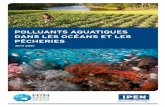« Quelques repères pour l’étude des gloses arabes dans les manuscrits ibériques latins...
-
Upload
xn--universitlyon2-jkb -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of « Quelques repères pour l’étude des gloses arabes dans les manuscrits ibériques latins...
189
Quelques repères pour l’étude des gloses arabes dans les manuscrits ibériques latins (ixe-xiiie siècles)
Cyrille Aillet
À plusieurs reprises, nous avons eu l’occasion d’évoquer l’intérêt que pou vait représenter, pour la connaissance du christianisme arabisé en péninsule Ibérique, l’étude des manuscrits latins annotés en arabe1. Dans cet article, nous tenterons de ré#échir un peu plus largement sur l’apport de ce matériel mar ginal à l’histoire culturelle des sociétés ibériques médiévales du ixe au xiiie siècle, et sur leur traitement scienti%que possible.
Commençons par rappeler les questions essentielles soulevées par ce phé nomène d’anno-tation. La plus évidente concerne bien évidemment le processus d’arabisation, puis l’usage de l’arabe par une partie des popu la tions chrétiennes en territoire islamique, mais également au sein même des roy aumes chrétiens du nord, où a/uèrent continuellement des groupes de chrétiens arabisés. Bien que cet aspect soit celui que nous avons choisi de mettre le plus en lumière dans nos travaux, il s’accompagne d’un autre ver sant de l’histoire culturelle de ces populations : à savoir leur évolution ling u is tique dans un milieu non-arabophone (celui des sociétés septentrionales), et leur éventuelle re-latinisation intellectuelle, qui a pu égale-ment s’accom pag ner de l’acquisition de nouveaux référents linguistiques vernaculaires – no-tamment, à Tolède aux xiie-xiiie siècles, l’acquisition orale et écrite du castillan. Les annota-tions laissées par les lecteurs en marge du livre sont susceptibles de jeter quelque lumière sur ces transitions de langue.
Parallèlement, l’accès à la cuisine interne des lecteurs – le plus souvent des ecclésiastiques, il faut toutefois le souligner – permet de juger de la fonc tionnalité qu’ils attribuent aux deux langues entre lesquelles ils na vi guent à l’écrit, mais aussi de leur capacité à manier celles-ci. En un mot, il s’agit d’un matériel important pour toute étude de la literacy médiévale.
On pourra toujours essayer aussi d’appréhender et de recomposer, quand c’est possible, des modes, voire des programmes de lecture. Les gloses mar gi nales constituent donc une source complémentaire – faute de témoignages écrits plus abondants – sur l’activité intellec-tuelle des chrétiens arabisés en pén insule Ibérique. Et puisque le noyau dur du texte principal est le plus sou vent formé par les écrits de référence de la culture tardo-antique ibérique, il peut être intéressant de voir comment ce patrimoine littéraire qui servait de via tique à la grande
1 Cyrille Aillet, Les Mozarabes. Islamisation, arabisation et christianisme en pén in su le Ibérique (ixe-xiie siècle) (Bibliothèque de la Casa de Velázquez 45), Madrid 2010 ; Id., Las glosas como fuente para la historia del cristianismo arabizado en la Península Ibérica (siglos ix-xiii), dans : Relegados al mar-gen. Marginalidad y espacios marginales en la cultura medieval, éd. par Inés Monteira Arias / Ana Belén Muñoz Martínez / Fernando Villaseñor Sebastián (Biblioteca de Historia del Arte 12), Madrid 2009, 19–30 ; Id., Recherches sur le christianisme arabisé (ixe-xiie siècle). Les manuscrits his-paniques annotés en arabe , dans : ¿Existe una identidad mozárabe ? Historia, lengua y cultura de los cristianos en al-Andalus (siglos ix-xii), éd. par Cyrille Aillet / Mayte Penelas / Philippe Roisse (Collection de la Casa de Velázquez 101), Madrid, 2008, 91–134.
190 Cyrille Aillet
majorité des sociétés ibériques chrétiennes a été adapté, relu, réinterprété peut-être à travers le %ltre de la langue arabe. Le change ment de langue n’est en e^et pas anodin : tout transfert linguistique charrie, même de manière discrète, des in#exions de sens.
En%n, les notes sont des marqueurs de l’histoire des manuscrits eux-mêmes, une histoire complexe où viennent se re#éter des déplacements humains, des exils quelquefois. Comme l’avait bien vu Manuel C. Díaz y Díaz, ces livres nous renseignent sur les migrations « moza-rabes » dont, par ailleurs, on a tant de peine à évaluer la portée et l’in#uence dans l’évolution des sociétés nord-ibériques2.
Délimitation du corpus et typologie interne
On peut considérer comme démesurée l’ampleur de ce questionnement au regard d’un cor-pus somme toute limité : sur 352 manuscrits « wisigothiques » ré per toriés, seule une peti-te cinquantaine (cinquante-et-un pour être exact), soit 13%, semblent pouvoir être rattachés sans conteste à la famille dite « moz arabe ». Encore faut-il éclairer le sens que l’on donne à ce vocable si dis cuté. Manuel C. Díaz y Díaz, sur lequel on peut s’appuyer pour parvenir à ce ré-sultat, l’emploie dans son sens traditionnel : des chrétiens issus des ter ri toires islamiques, qu’ils écrivent ou non en arabe, qu’ils vivent encore ou non dans le sud de la Péninsule3. Dans le cadre de cet écrit, nous nous intéresserons plutôt à un ensemble bien précis, formé par des manuscrits annotés en arabe, et qui portent donc les traces de ce processus d’arabisation qui est au cœur même de l’étymologie du terme « mozarabe ». Ils sont trente au total selon nos estimations, et contribuent donc fortement, et logiquement, à délimiter la famille dite « mozarabe ». Voilà un chi^re qui ne semble guè re faire le poids pour une étude sérielle, surtout si on les compare aux res sour ces qu’o^rent par exemple les collections de codices carolingiens pour une histoire des pratiques de lecture. Épiphénomène à l’échelle de l’histoire du livre médiéval, cet ensemble n’en est pas moins important et surtout signi%ant dans le cadre d’une enquête sur les manuscrits wisigothiques et sur les cultures ibériques médiévales. Car il faut avoir à l’esprit que ces livres sont en quelque sorte des rescapés échappés au naufrage du christianisme andalou et échoués dans les scriptoria d’accueil du nord. Leur sauvegarde, en dépit d’une existence tumultueuse, est due principalement au fait qu’ils pouvaient retrouver une seconde vie dans les bibliothèques du nord, car ils étaient écrits en latin et contenaient des textes du patrimoine littéraire com mun, et quelquefois même des copies rares, susceptibles de retenir l’atten tion des hommes d’Église du nord. Les manuscrits en arabe, dont il faut s’ima giner qu’ils côtoyaient dans les bibliothèques andalousiennes ces mêmes ouvrages, écrits en latin mais parfois tru^és de notes dans cette lan-gue, n’eurent pas cette chance : le nombre d’exemplaires conservé est ex trê me ment mince, car ils n’avaient guère d’utilité dans un contexte culturel latin4.
Ces trente ouvrages dessinent donc une situation commune : l’usage de l’arabe parmi les populations chrétiennes de la péninsule Ibérique entre le ixe siècle, où apparaissent en
2 Manuel C. Díaz y Díaz, La circulation des manuscrits dans la péninsule Ibérique du viiie au ixe sièc-le, Cahiers de civilisation médiévale 12 (1969), 219–241 et 383–392 ; Id., Manuscritos visigóticos del sur de la Península : ensayo de distribución regio nal, Séville 1995.
3 Díaz y Díaz, Manuscritos visigóticos (voire note 2).4 Le meilleur inventaire se trouve dans Pieter Sjoerd Van Koningsveld, Christian Ara bic Manuscripts
from the Iberian Peninsula and North Africa. A Historical In ter pretation, Al-Qan ara 15 (1994), 423–451.
191Gloses arabes dans les manuscrits ibériques latins
al-Andalus les premiers signes d’un rem place ment progressif du latin par l’arabe dans les pratiques écrites, et le xive sièc le, où l’arabe s’est déjà e^acé des usages courants à Tolède. Ce découpage n’en recèle pas moins une grande part d’arti%ce, car ces livres proviennent de contextes géographiques, culturels et sociaux variés. Ils ne retracent au cune ment l’exis-tence d’une communauté mozarabe au singulier, mais évo quent certainement l’histoire des populations chrétiennes ibériques, dont le prin cipal référent linguistique fut, pour un temps, l’arabe. Il est délicat de dé ter miner l’itinéraire de ces livres, car cela demande à la fois une vision d’ensemble de la production dite « wisigothique », que seul un petit nombre de paléographes possède, et la réalisation d’enquêtes minutieuses sur chaque échan tillon. Or les inventaires existants possèdent tous un défaut con sidé ra ble : ils restent muets sur la signi-%cation de ces annotations en arabe, faute de faire appel à des arabisants pour déchi^rer ces fragments de sens qui té moignent pourtant de façon éloquente de la vie des textes5. C’est donc avec des ressources limitées que nous avons entrepris cette tâche, qui demanderait né-anmoins à être poursuivie et a�née par un travail d’équipe.
Il en ressort toutefois quelques constats, que l’on appliquera au premier cor pus, celui des cinquante et un manuscrits rattachés à la famille « moz ara be » ( "g. 1), mais qui peut aussi fonctionner pour le second, constitué des trente ouvrages annotés en arabe. Tous, sans exception, ont accompli une par tie de leur existence hors des territoires islamiques, sinon ils n’auraient sans doute pas été conservés. Vingt-six d’entre eux ont été copiés en al-An da lus sans aucun doute possible, car un colophon ou des éléments de con tex te nous l’apprennent. Il n’est pas toujours possible de préciser le lieu exact de la copie : Cordoue domine, mais on possède aussi quelques volumes ori gi naires de Tolède avant la conquête castillane, et une Bible provenant de Sé ville. Un ensemble conséquent (douze exemplaires au moins) provient de To-lède après 1085, soit qu’ils aient été copiés sur place, soit qu’ils aient été con servés et utilisés par la population « mozarabe » locale. Cette commu nau té, pourvue de droits spéci%ques par le fuero d’Alphonse VI en 1101, com prenait à la fois des chrétiens autochtones, présents dans la ville et sa ré gion avant la conquête castillane, et des émigrés venus d’al-Andalus. En%n, neuf autres codices ont été copiés dans le nord de la Péninsule (hors Tolède) puis annotés en arabe, ou bien utilisés par des chrétiens d’origine méri dio na le installés sur place. Pour quatre autres manuscrits, il est di�cile de se pro non cer. Toujours est-il que l’histoire de ces livres est révéla-trice d’itinéraires tor tueux et de contextes diversi%és. Ces éléments d’enquête nous ont d’ail-leurs amenés à souligner l’éclatement spatial de ces phénomènes culturels, ca ractéristiques selon nous d’une « situation mozarabe » résolument trans fron talière, voire déterritorialisée.
La diversité des parcours e^ectués par ces livres et leurs lecteurs permet de contredire et de nuancer l’opinion ancienne de Pieter Van Koningsveld, pour qui l’ensemble des anno-tations en arabe que l’on pouvait observer dans les codices latins ibériques provenait des Mozarabes de Tolède aux xiie-xiiie siècles6. Nous avons démontré que son analyse paléo-graphique, guidée par une démarche originale, débouchait néanmoins sur des conclusions erronées. En e^et, le stock des gloses arabes est loin d’être uniforme, et l’on y trouve une certaine variété d’écritures, re#et d’un éventail chronologique plus large que celui qu’il
5 On le constatera dans l’actualisation du fameux catalogue de Agustín Millares Carlo, Corpus de códices visigóticos, éd. revue par Manuel C. Díaz y Díaz / Anscari M. Mundó / José Manuel Ruiz Asencio, 2 vol., Las Palmas de Gran Canaria 1999.
6 Pieter Sjoerd Van Koningsveld, �e Latin-Arabic Glossary of the Leiden Uni ver sity Library. A Contribution to the Study of Mozarabic Manuscripts and Literature, Leyde 1976.
192 Cyrille Aillet
défendait7. Pour qui s’intéresse à cette discipline encore bal bu tiante – notamment en contexte ibérique – qu’est la paléographie arabe, ce ma tériau marginal o^re d’ailleurs un support d’étude intéressant.
On peut y observer des graphies arabes anciennes, remontant très cer tai ne ment à la seconde moitié du ixe siècle, soit bien avant la date du premier ma nuscrit andalousien conservé8. C’est le cas des trois gloses lexicales dé po sées en marge du texte latin de l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée dans un codex sans doute copié à Cordoue, puis très pro-bablement rapporté au monastère d’Abellar à la %n du ixe siècle9. Ce livre fut annoté, dans son lieu de copie ou dans son lieu d’accueil, par des lecteurs familiers de l’arabe. L’écriture, raide et anguleuse, possède très peu de signes diacritiques et pas du tout de vocalisation : elle se démarque des séries que l’on connaît entre le milieu du xe et le xiiie siècle ( "g. 2).
Bien que cette typologie soit encore très rudimentaire, il nous semble pou voir également observer une seconde tranche chronologique cor res pon dant grossièrement à l’époque cali-fale et qui regroupe au moins trois manu scrits remarquables : le Codex visigothicus legionensis, une bible copiée à Va leránica en 960 et qui contient 353 notes en arabe ; la Bible dite de Sé vil-le, qui comporte 201 gloses arabes, dont certaines sont contemporaines de la copie (988) ou la suivent de peu10 ; un exemplaire des Morales sur Job de Gré goire le Grand, copié au xe siècle pour un évêque nommé Dulcidius, ar ri vé à Tolède à une date inconnue, et qui est pourvu de plus d’une centaine de no tes en arabe que nous pensons remonter à la seconde moitié du xe siècle ( "g. 3)11. Dans ces trois volumineux ouvrages, on observe une écriture très soignée, car la valeur de ces ouvrages, qui %guraient sans doute dans le tré sor de leur lieu de conservation, exigeait de l’application, même pour y dé po ser des annotations. Sur l’image nous voyons se détacher la traduction arabe d’un passage de l’Évangile (Luc 12, 20). Le copiste appose avec soin les signes diacritiques et la vocalisation, et les lettres sont toutes nettement distinctes. Le ductus possède encore les caractéristiques anguleuses du kou % que, mais les hampes infé-rieures commencent à s’allonger en-dessous de la ligne principale d’écriture.
Une troisième tranche chronologique s’interpose avant d’atteindre la pé rio de ciblée par P. Van Koningsveld. Elle nous est fournie par une œuvre bien datée, le recueil arabe des Canons de l’Église conservé à l’Escorial, et ache vé en 1050 ( "g. 4)12. On y retrouve précisé-ment les caractéristiques du style naskhī andalusī qui sert de repère temporel au savant néer-landais et qu’il date des xiie-xiiie siècles. Tashkīl et vocalisation y sont systématiques – ce qui traduit surtout un souci d’exactitude du texte –, et le ductus combine le caractère anguleux (« pseudo-kou%que ») de certaines lettres avec l’élan ce ment des hampes inférieures qui se rejoignent sous la ligne d’écriture et donnent au texte sa rythmique.
En%n, les exemples des écritures tolédanes des xiie-xiiie siècles abon dent, mais les gra-phies présentent des variations signi%catives suivant la fonc tion qui leur est attachée : simples gloses lexicales insérées entre des ter mes latins sans que le scribe y ait mis un soin excessif ( "g. 5), ou exercices de traduction de textes théologiques ( "g. 6) qui nécessitèrent sans doute au pré alable une certaine maturation intellectuelle et qui répondent un peu plus clai rement aux
7 Aillet, Les Mozarabes (voir note 1), 155–175.8 Le néologisme « andalousien » est emprunté à l’espagnol « andalusí » qui se réfère à al-Andalus, et
non à l’Andalousie.9 León, Archivo de la Catedral, ms. 15.10 Madrid, Biblioteca Nacional de España, Ms. Vit. 13.1.11 Tolède, Biblioteca Capitular, Ms. 11.4.12 San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio, ms. arab. 1623.
193Gloses arabes dans les manuscrits ibériques latins
canons du naskhī andalusī. Ces essais de datation pourront bien évidemment être revus et critiqués par de plus ex-
perts. Cependant, outre qu’ils démontrent que ce phénomène d’an notation s’étale dans le temps et dans l’espace, ils soulignent aussi l’in a dé quation de théories paléographiques insuf-%samment documentées et en core trop schématiques.
Fig. 1
Fig. 2
196 Cyrille Aillet
Migrations de livres
Outre l’étalement chronologique d’une pratique culturelle qui caractérise un secteur non négligeable des sociétés chrétiennes ibériques, cet échantillon va rié de gloses met en lumière les parcours migratoires des chrétiens an da lou siens. Plusieurs indices peuvent trahir le passa-ge des territoires isla mi ques aux royaumes du nord. Les ex-libris, comme celui que l’on peut ob ser ver dans le manuscrit 22 des archives de la cathédrale de León, sont rares13. Le plus sou-vent, le transfert vers une autre aire géographique s’exprime par le changement de graphie : c’est le cas pour les manuscrits andalousiens con servés à Monte Cassino et annotés sur place en écriture bénéventine14, c’est le cas aussi pour un codex de même provenance, arrivé à Santa Maria de Ripoll où l’on faisait usage de l’écriture caroline15. Dans certains cas, le la tin succède à l’arabe, encore qu’il n’est pas rare que l’ouvrage, resté entre les mains de ses anciens propri-
13 Samuel librum ex Spania veni : León, Archivo de la catedral, ms. 22, fº 34vº.14 Gabriella BRAGA / Bartolomeo PIRONE / Biancamaria SCARCIA AMORETTI, Note e osservazioni
in margine a due manoscritti Cassinesi (Cass. 4 e 19), dans : Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi, éd. par Ludovico Gatto / Paola Supino Martini, Florence 2002, t. I, 57–84.
15 Barcelone, Archivo de la Corona de Aragón, ms. Ripoll 49.
Fig. 6
197Gloses arabes dans les manuscrits ibériques latins
étaires, continue à être glosé dans cette lan gue : c’est ainsi que des générations successives de lecteurs se relaient dans les espaces libres de la Bible de Séville16.
Tandis que la géographie des provenances que l’on parvient à identi%er s’avère rela-tivement réduite (Cordoue, Séville, Tolède), la liste des points d’arrivée est plus fournie. Lorsque cela s’avère possible, il est intéressant de reconstituer des lots de manuscrits, comme ces deux codices arrivés à San Cos me y Damián de Abellar à la %n du ixe siècle : le codex 22 contient la transcrip tion des actes du concile de Cordoue en 839 ( "g. 7); le codex 15, an noté en arabe ( "g. 2), contient une copie de l’Histoire ecclésiastique d’Eu sèbe de Césarée17. Tous deux proviennent sans doute de Cordoue. Il serait souhaitable que des recoupements sériels, préalable nécessaire à la con sti tu tion de groupes régionaux, soient e^ectués sur une plus grande échelle, aussi bien à partir de critères paléographiques et codicologiques – comme l’a tenté Ma nuel C. Díaz y Díaz dans ses Manuscritos visigóticos del sur de la Pen ín su la – qu’à partir d’arguments stylistiques. C’est ainsi que l’étude des en lu mi nures peut compléter d’autres modes d’identi%cation, comme pour cet en semble de manuscrits respectivement émigrés à León (ms. 22), à Tolède (ms. 10.001 et ms. 35.6) et à Urgell (Codex miscellaneus patristicus) à des da tes incertaines, et dont les lettrines forment deux groupes distincts (mais ap parentés) par le style et la typologie, ce qui permet d’avancer l’idée d’une commune ori-gine cordouane, d’ailleurs étayée par d’autres indices ( "g. 8).
Certains de ces manuscrits ont connu une longue existence, comme la Bible de Séville, dont on possède les deux colophons : le premier en latin, le se cond en arabe. Le premier nous fait revivre la première phase de l’existence de cet ouvrage, conçu hors de Séville, puisqu’il fut patiemment com plété par deux évêques issus du milieu ecclésiastique sévillan puis élus respectivement à la tête des diocèses d’Écija et de Carthagène. La copie et l’enluminure de ce précieux codex se déroula donc probablement dans des lieux successifs, puis il fut o^ert à la cathédrale de Séville en 988 a%n d’honorer la Vierge18 :
Au nom du Seigneur, Notre Sauveur, Jésus Christ. Le commanditaire et le possesseur de ce livre, dans lequel "gurent l’Ancien et le Nouveau Testament fut Servandus, de divine mémoire. En e4et, il naquit et fut in struit dans le bienheureux siège de Séville, puis il obtint grâce à son mé ri te le siège épiscopal de Bastigitane [Écija]. Cet homme illustre a con cé dé le présent codex à Jean, son camarade et ami intime. Jean fut nour ri dans ce très fameux siège de Séville par son oncle — que sa mémoire soit bénie —, un homme de la plus haute sagesse et de la plus grande im por tance (loculentissimo) : Stefanus, évêque de Asidonensis [Medina-Si do nia]. Une fois instruit et entré dans l’ordre ecclésiastique, Jean fut en voyé au siège de Carthagène pour y être évêque. Puis, de là, il passa en suite à Cordoue, la grande cité royale, où il fut élu au siège épiscopal. De ce siège illustre, il décida, sain de corps et d’esprit, de faire don, au nom de Dieu, de ce codex dont la décoration était achevée (compte per fec tum), à l’évêché déjà nommé de Séville, en mémoire de la sainte et toujours vierge Marie. Fait le 23 décembre 988. Que personne parmi les clercs n’ose braver la puissance divine en l’emportant ou en le déplaçant hors du siège de Séville déjà évoqué. Puisse celui qui s’ab stien drait de suivre ces indications être condamné par Dieu, par ses anges et par tous les saints.
16 Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. Vitr. 13.1.17 León, Archivo de la Catedral, ms. 15 et 22.18 Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. Vitr. 13.1, dernier folio.
198 Cyrille Aillet
Quant à la notule en arabe, elle se réfère encore à un autre personnage. Selon nous, il ne s’agit ni d’une traduction ni d’un résumé du texte précédent : cet te brève clause con%rme la donation. Elle peut avoir été apposée par le mé tro politain de Séville pour accuser réception de l’ouvrage, ou bien avoir été ajoutée ultérieurement :
Donation pieuse au siège Sainte- Marie de Séville – que Dieu le protège –, […] Salvatus, modeste métropolitain.
Certainement annotée par des séries successives de lecteurs, la Bible semble avoir été ensuite conservée à Séville jusqu’à son arrivée à Tolède, que nous som mes enclins à situer en 1148 lorsque le dernier titulaire connu, un certain Clé ment, quitta son siège avant l’arrivée des Almohades pour se réfugier avec d’autres prélats méridionaux à Talavera.
La carte de signalisation de ces livres issus des milieux chrétiens arabisés cor respond à la géographie des migrations de populations chrétiennes ori gi naires des territoires isla-miques19 : León (la capitale, mais aussi Zamora, les mo na stères de Tábara, Sahagún, Abel-lar), Castille (Valeránica, Santo Do min go de Silos), Rioja (monastère d’Albelda), mais aussi la Marca hispanica (San ta Maria de Ripoll et le comté d’Urgell), sans oublier Tolède après 1085. Ces #ux de livres con%rment l’importance de l’apport migratoire et culturel des His-pani méridionaux, par ailleurs bien documenté par les textes et par l’onomastique romano-arabe, particulièrement concentrée dans les zones in ten sément restructurées et repeuplées par le pouvoir.
En%n, certains de ces livres apportent la con%rmation du maintien de l’usa ge – tout du moins écrit – de l’arabe par ces immigrés chrétiens. Il s’a vè re aussi que l’on peut suivre l’activité des gens d’Église d’origine mé ri dio na le qui, désormais installés dans des établisse-ments religieux hors du ter ri toi re islamique, continuent pendant quelque temps à pratiquer la langue qui leur était la plus familière. On observe les marques de cette prolongation de l’usa ge de l’arabe à Tolède, où le phénomène est bien connu, mais éga le ment à Monte Cassino en Italie20, à Santa Maria de Ripoll21, à Valeránica, à Za mora, à Sahagún et sans doute dans d’autres endroits. Il n’est en e^et pas tou jours possible de distinguer les notes de lecture ap-partenant au contexte an dalousien d’origine, de celles qui témoignent de la vie intellectuelle des chré tiens arabisés dans les sociétés nordiques. On a pourtant la certitude que les 353 notes en arabe du Codex visigothicus legionensis, une Bible copiée à Va leránica en 960, sont le re#et d’une communauté partiellement constituée de moines arabophones, ou « araboscriptes » si l’on veut être plus précis22. Un autre document étonnant est fourni par l’énorme volume des Moralia in Iob conservé actuellement aux archives de la cathédrale de Tolède, un ma nu scrit qui mériterait à lui seul une étude plus complète que celle que nous lui avons dédiée23. La page initiale présente une croix aux branches desquelles pen dent l’alpha et l’oméga, un décor clas-sique dans l’iconographie asturo-léo naise et dont on ne connaît aucun équivalent en al-Anda-lus : cet indice nous incite à situer la copie dans le nord ( "g. 9). Le commanditaire de l’œuvre
19 Aillet, Les Mozarabes (voir note 1), 378.20 Braga et al., Note e osservazioni (voir note 14).21 Barcelone, Archivo de la Corona de Aragón, ms. Ripoll 168.22 León, Biblioteca de la Colegiata de San Isidoro, ms. 2 (Codex visigothicus legio nensis).23 Tolède, Biblioteca Capitular, ms. 11.4.
199Gloses arabes dans les manuscrits ibériques latins
est identi%é par une acrostiche disséminé dans le labyrinthe de lettres du second folio ( "g. 9): Dulcidius, un personnage dont nous pen sons avoir prouvé qu’il s’agissait de l’évêque de Zamora entre 914 et 95624. Cet te fourchette chronologique convient d’ailleurs parfaitement au style d’en luminure et d’écriture du livre. Dans les marges de l’ouvrage se sont suc cédé plu-sieurs annotateurs qui ont laissé, outre quelques notes en latin, plus d’une centaine de gloses en arabe, dont beaucoup de traductions de pas sa ges bibliques et d’arguments théologiques ( "g. 10). Le passage par Tolède de ce manuscrit, à une date donnée, pose la question du lieu d’apposition de ces marginalia en arabe. La typologie de l’écriture se rapproche plus des gran-des Bibles glosées au xe siècle que des standards tolédans des xiie-xiiie sièc les. L’œuvre n’en possède pas moins un lien possible avec la ville du Ta ge, car Ibn „ayyān nous signale qu’après sa conquête par la monarchie astu rien ne en 893, Zamora fut repeuplée par des Tolédans25. Il semble en tout cas fort plausible qu’à Zamora, dans une région où l’immigration chrétienne mé ridionale est bien attestée et où l’on repère ces jeux d’emprunt carac té ris ti ques de l’art dit « mozarabe », des groupes de clercs arabisés aient utilisé la lan gue qui leur était la plus fami-lière pour pratiquer des exercices in tel lec tuels en marge de ce classique de la littérature latine.
Quant à la compilation de canons hispaniques classés par ordre chrono lo gi que (Hispana chronologica) que conserve un manuscrit de la Bibliothèque Na tionale, à Madrid, elle pour-rait aussi avoir été annotée en arabe en ter ri toi re chrétien. Dédiée à un abbé non-identi%é, Superius, elle comporte un riche pro gramme iconographique ( "g. 11) qui correspond plus à ce que l’on sait des scriptoria du nord qu’aux réalisations andalousiennes connues26. Au xvie siècle, l’ouvrage était conservé à Sahagún, lieu possible – mais non cer tain – où aurait pu s’accomplir le travail des lecteurs qui apposèrent une cen taine de gloses lexicales en arabe dans les marges du texte principal.
24 Aillet, Les Mozarabes (voir note 1), 165–166.25 Ibn ayyān, Kitāb al-Muqtabis III. Chronique du règne du calife umaiyade ‘Abd Allāh (888–912) à
Cordoue, éd. par Melchior Martínez Antuña, Vienne / Paris 1937, 109.26 Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 10.041 (Hispana chronologica).
Fig. 7
202 Cyrille Aillet
Échelles de langue, fonction de la glose et niveau d’arabisation
Les gloses nous donnent donc un aperçu de la géographie éclatée et mou van te de ces popula-tions chrétiennes arabisées entre ixe et xiiie siècle. Il serait tou tefois réducteur de limiter leur étude à cette seule fonction d’indice des phé nomèmes migratoires, car elles éclairent aussi de l’intérieur l’arabisation des chrétiens méridionaux. Dans ses limites chronologiques tout d’abord, puis que les gloses les plus anciennes dont on puisse avancer la datation re mon tent au ixe siècle, et que les Mozarabes de Tolède se latinisent ou se castel lanisent totalement tout au long du xiiie siècle. Le cœur du phénomène occupe donc les xe-xiie siècles.
On peut aussi apporter quelques éléments, à partir de ce support, sur la pro fondeur de l’arabisation, en ayant toutefois à l’esprit que ces manuscrits re #ètent l’activité d’une frange extrêmement réduite de la population chré tien ne originaire d’al-Andalus, car ces annota-teurs sont tous, ou presque tous, des moines ou des clercs. Cela explique qu’ils aient ap-paremment main tenu une assez bonne connaissance du latin, qu’ils continuent d’ailleurs à utiliser pour annoter le texte principal, et dont ils conjuguent quelquefois l’usage avec l’arabe dans des apostilles bilingues. Il n’existe en vérité au cune preuve tangible qui permette d’a�rmer que les notes en arabe ont été déposées par des individus qui ne comprenaient plus le latin ou qui le ré ap pre naient, comme on l’a dit à propos des gloses lexicales en arabe de la com pi lation grammaticale de Tolède ( "g. 5)27. En e^et, dans ces milieux ecclé sia stiques
27 Tolède, Biblioteca Capitular, ms. Caja 99.30. Voir Van Koningsveld, �e Latin-Arabic Glossary (voir note 6)
Fig. 11
203Gloses arabes dans les manuscrits ibériques latins
l’apprentissage du latin semble s’être toujours maintenu, ce qui ex plique sa persistance en tant que langue liturgique jusqu’au xiie siècle.
En revanche, plusieurs manuscrits apportent la preuve que le latin est de ve nu un medium purement livresque parmi les hommes d’Église an da lou siens à partir du xe / xie siècle. Non seulement l’arabe envahit dans certains cas les marges des livres, mais il supplante très large-ment le latin dans les pra tiques d’annotation. On peut d’ailleurs suivre, de manière encore sché ma ti que faute d’études plus poussées, l’avancée de ce processus d’appro pria tion de la langue arabe par le cercle des hommes d’Église chrétiens. Dans une note ancienne (ixe siècle) où un lecteur s’indigne de la consommation de vian de non vidée de son sang et rap-pelle l’interdit vétérotestamentaire, le vo ca bulaire est encore très pauvre et la syntaxe, très approximative, calque étroi tement la structure rhétorique latine28. Toutefois, dans les siècles sui vants, les apostilles en arabe démontrent l’autonomie des lecteurs par rapport aux schèmes linguistiques du latin : l’arabe constitue visiblement leur moyen de communication écrite le plus courant, le plus spontané. Ce matériau méri te rait d’être analysé par des linguistes, mais l’on peut d’ores et déjà signaler qu’il ne semble pas contenir de latinismes ou de romanismes évidents. En de hors d’un lexique spécialisé – qui transcrit quelquefois des termes tech ni ques latins –, on n’y décèle aucune preuve de l’existence d’un quelconque sous-groupe linguis-tique arabo-chrétien. Il s’agit donc d’un arabe standard, même si la langue des scripteurs arabophones ne contient guère d’exemples d’un travail littéraire. Il faut bien sûr rappeler que la plupart de ces mar gi na lia remplit une fonction purement instrumentale. La diversité des types de gloses témoigne en tout cas de la di^usion de l’arabe chez les annotateurs et la diversité de leurs usages plaide pour un usage courant de la langue arabe par les annotateurs.
Les usages de l’annotation sont bien connues, et les relever dans ce con tex te ne présente d’intérêt que dans la mesure où ils nous donnent accès à l’ac tivité intellectuelle des chrétiens arabisés en péninsule Ibérique. Le plus sou vent, l’annotation remplit une fonction lexicale : les termes arabes tra dui sent des mots ou des expressions du texte principal ( "g. 5). Quelquefois la glo se re#ète un véritable e^ort de réélaboration et de transfert du sens, com mun à toutes les opérations de traduction auxquelles les sociétés médiévales sont rompues. La glose, qui parfois inonde littéralement les marges des ou v ra ges, fait partie des pratiques scholastiques de lecture et d’apprentissage de la tradition. Dans un contexte d’arabisation, elle sert à établir des pas-serelles en tre deux contextes linguistiques disjoints, l’un vivant, l’autre devenu liv res que. Un autre indice témoigne de la profondeur du processus d’ara bisa tion : la communication para-textuelle, celle qui s’adresse à la communauté des lecteurs du manuscrit, se fait en arabe. C’est ainsi que l’on signale les pas sages les plus dignes d’intérêt ( "g. 12), et ce balisage marginal peut ser vir di^érents intérêts : on peut y voir les traces d’un travail en cours, limité dans le temps, ou les signes fondateurs d’une exégèse du texte. Par ailleurs, l’arabe intervient à tous les stades de l’existence du livre – copie, enlumi nu re, relecture avant %nalisation, puis lectures successives – même quand ce lui-ci se veut le réceptable de la tradition latine. Dans la Bible de Séville, ache-vée en 98829, les annotations sont quelquefois contemporaines de la co pie, ou la suivent de très près. C’est ainsi que l’un des enlumineurs insère, dans le cou de la huppe qui sert de lettrine d’ouverture au livre de Daniel, l’in jonction suivante : « Lis l’histoire de Daniel ! » ( "g. 13).
28 El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio, ms. &.I.14, fº 166vº ; Nemesio Mora ta, Las notas árabes del Cod. & I-14, dans : Códices visigóticos de la Bib lio te ca del Es co rial, éd. par Guillermo Antolín y Parajes, La Ciudad de Dios 108 (1917), 635–639.
29 Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. Vitr. 13.1.
204 Cyrille Aillet
Ailleurs, c’est un relecteur qui repère dans la copie de la Bible un passage déplacé et sig na le aux futurs usagers du livre comment il faut rétablir l’ordre de lecture correct.
Il faut bien comprendre toutefois que les notes éparpillées que l’on croise en marge du texte sont les traces d’une activité intellectuelle plus cohérente, le témoin dans certains cas de véritables programmes de lecture, de tra duc tion ( "g. 6) ou d’exégèse. On n’en perçoit que des bribes, mais cette toile de fond pourrait être partiellement recomposée par des micro-études ré a li sées à l’échelle de chaque manuscrit par des équipes de latinistes et d’ara bi sants travaillant sur l’histoire du texte et de sa réception. On peut en tout cas di� cilement se contenter des descriptions existantes dans le corpus des manu scrits dits « wisigothiques » puisqu’elles font l’impasse sur toute une phase de l’histoire et des usages du livre.
Fig. 12 Fig. 13
205Gloses arabes dans les manuscrits ibériques latins
Vers une étude des programmes de lecture
Certes, il n’est pas toujours aisé de reconstituer la matrice de ces pro gram mes de lecture dont on perçoit les indices souvent évanescents en marge des ma nu scrits. Toutefois, c’est cette démarche qui peut seule donner sens à cet te poussière de notes décontextualisées. L’une des preuves les plus e�caces de l’intérêt et de la possibilité d’une telle entreprise a consisté, dans notre thè se, à établir le sens commun d’une partie des annotations de la Bible de Sé ville30. Ce volumineux ouvrage a servi de support à plusieurs opérations. Com me on l’a vu, le souci d’établir une version correcte du texte biblique – un enjeu majeur puisque l’ouvrage était destiné à la cathédrale de Séville, la prin cipale métropole ecclésiastique du sud de la pénin-sule – a nécessité l’in ter vention de toute une équipe de copistes et de relecteurs ( "g. 13). Le codex a sans doute aussi servi de support pour des travaux – ponctuels ou plus ambitieux, il est di�cile de le dire – de traduction du texte sacré, com me on en connaît d’ailleurs plusieurs autres exemples en al-Andalus. En%n, une partie des lecteurs s’est appuyé sur ce codex pour y chercher des ar gu ments polémiques bibliques contre les juifs. Otto Karl Werckmeister avait vu juste en croyant distinguer un programme de lecture dans cet ouvrage, mais il est possible qu’il se soit égaré dans son interprétation31. Son article pro pose de voir dans l’iconographie les éléments d’une polémique contre l’islam basée sur la lecture eschatologique des livres prophétiques, en par ti cu lier ceux des « petits prophètes ». Or, sa démonstration repose presqu’ex clu sivement sur les trois vignettes où apparaissent les prophètes Michée, Na hum et Zacharie. Le fait qu’il s’agisse des seules enluminures représentant des personnages bibliques dans ce volume a suscité à juste titre l’inter ro ga tion de ce savant. Toutefois, peut-on vérita-blement faire de cette apparente ano malie la clef d’un programme symbolique caché ? La question mériterait sans doute d’être réexaminée par des spécialistes, mais les remarques sui-van tes n’en demeurent pas moins légitimes. Il semble tout d’abord pro blé ma tique d’a�rmer l’existence d’un programme iconographique à partir de trois images qui n’o^rent aucune ré-férence explicite à l’islam, si ce n’est la représentation de Michée avec un turban et celle de Nahum assis sur un cous sin les jambles repliées sous lui, dans une position que l’on voit sou-vent ap paraître dans l’iconographie califale. Le problème est que ces trois élé ments n’entrent pas en concordance avec le reste des enluminures du manu scrit, où il est délicat de repérer un quelconque message crypté. En%n, le sa vant allemand reste quasiment silencieux sur les notes en arabe, dont une sé rie conséquente (une quarantaine) se fait l’écho d’une violente dénonciation des juifs, basée essentiellement sur d’autres livres prophétiques, ceux d’Isaïe et de Jérémie. Il conviendrait de revenir sur les sources et sur les ingrédients de cette polémique à la lumière de l’exégèse biblique anti-judaïque, mais ce dos sier montre bien à quel point il est illusoire de vouloir comprendre les manu scrits wisigothiques sans intégrer l’étude du matériel marginal en arabe.
D’autres manuscrits pourraient se prêter à de telles études. Une équipe ita lienne a ainsi mis en lumière l’intérêt des annotations latines et arabes d’un ensemble de trois manuscrits d’origine ibérique conservés au monastère du Mont Cassin. Une étude complète des notes arabes apposées en marge des Moralia in Iob, dans un manuscrit de la cathédrale de Tolède
30 Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. Vitr. 13.1. Voir Aillet, Les Mozarabes (voir note 1), 236–241.
31 Otto Karl Werckmeister, Die Bilder der drei Propheten in der Biblia Hispa lense, Mad ri der Mittei-lungen 4 (1963), 141–188.
206 Cyrille Aillet
( "g. 3, 9, 10)32, serait nécessaire pour comprendre, mieux que nous ne l’avons fait, quelle vie ce texte patristique a connue en milieu mozarabe. Les traductions arabes ajoutées en regard de certains passages de l’Apologeticus de Samson ( "g. 6) mériteraient d’être éditées et analysées plus précisément, d’une part dans la perspective d’une étude lexicale, d’autre part a%n de mieux cerner la ré ception de cette œuvre sur laquelle nous ne savons %nalement que peu de choses33. En%n, il ne serait pas inintéressant de se pencher sur les manuscrits à contenu juridique, qui conservent pour plusieurs d’entre eux d’abondantes glo ses en arabe qui témoignent des e^orts d’actualisation du corpus wisi go thique dans un contexte dominé par le droit islamique34. Autant de chantiers pos sibles, qui prolongent nos propres travaux mais nécessitent le passage à un travail d’équipe associant philologues, paléographes et his-toriens, lati nis tes et arabisants. La première étape serait d’établir des descriptions ex haus ti ves et exactes de ces codices, incluant une édition ou tout du moins une étu de approfondie des marginalia. Il faudrait ensuite tenter de donner co hé ren ce à ce matériel épars, à l’échelle de chaque ouvrage d’une part, mais aussi dans le cadre d’une histoire de la réception des textes tardo-antiques et des programmes de lecture de la tradition dans l’Occident latin du haut Moyen Âge.
Conclusion
La relative occultation du phénomène de l’annotation en arabe dans les tra vaux réalisés par les spécialistes du corpus que l’on continue de quali%er de « wisigothique » – alors que l’écrasante majorité des témoins manuscrits sont largement postérieurs à cette période – témoigne bien de la coupure qui op pose encore ce domaine d’étude au camp des arabi-sants. Cette séparation est d’autant plus préjudiciable qu’elle contribue à conforter l’idée d’un cloi son nement, voire d’un antagonisme de ces sociétés qui pourtant étaient aussi com-plémentaires que rivales. Le matériel des gloses arabes démontre d’une part la profondeur du processus d’arabisation des élites ecclésiastiques chré tien nes en al-Andalus, mais aussi la dissémination de ces populations dans l’es pace péninsulaire. C’est ainsi que l’intense mou-vement migratoire des « mozarabes » vers le nord, qui ne se mue en exode qu’à partir du xiie siècle, dis perse des groupes de chrétiens arabophones qui transportent avec eux leurs bibliothèques, mais aussi leurs pratiques linguistiques. Il serait erroné de croire que le #ux inverse, du nord vers le sud, n’a pas existé : des clercs, des marchands, des soldats, des négo-ciateurs se rendent aussi à Cordoue ou plus largement en territoire islamique. Toutefois, il s’agit le plus souvent d’une migration temporaire, tandis que les Mozarabes ne semblent pas re venir dans leur patria. Quel impact produit l’implantation de ces populations ara bisées sur les sociétés locales ? Il nous semble que cette question n’a pas en core reçu toutes les réponses appropriées, faute justement de connecter les don nées disponibles, et de penser les sociétés ibériques comme des en sem bles en contact et en interaction constants. Il est bien évident que la présence de ces îlots signi%catifs de culture arabo-chrétienne dans les royaumes du nord donne à repenser d’autres phénomènes connexes comme l’onomastique ro mano-arabe,
32 Tolède, Biblioteca Capitular, ms. 11.4.33 Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 1872.34 Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 10.041 ; Ibid., ms. 10.064.
207Gloses arabes dans les manuscrits ibériques latins
que l’on trouve concentrée dans les chartes des ixe-xie sièc les35, et l’introduction de termes tirés de l’arabe, mais ensuite latinisés ou vernacularisés, dans le lexique des scribes du nord.
35 On pourra découvrir les principaux travaux sur ce thème dans Cyrille Aillet, An thro ponymie, migra-tions, frontières : notes sur la “situation mozarabe” dans le nord-ouest ibérique (ixe-xie siècle), Annales du Midi 120 [261] (2008), 5–32.
208 Cyrille Aillet
Table des illustrations
Fig. 1: Origine des manuscrits du corpus “mozarabe”
Fig. 2: León, Archivo de la catedral, ms. 15, fº 120rº (Eusebius Cæsariensis, Historia ecclesi-astica).
Fig. 3: Tolède, Biblioteca capitular, ms. 11.4, fº 249rº (Gregorius Magnus, Moralia in Iob).
Fig. 4: El Escorial, ms. arab. 1623, fº 23vº (Codex canonicus in Arabico, 1049-1050).
Fig. 5: Tolède, Biblioteca capitular, fº 9vº (Compilation grammaticale).
Fig. 6: Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 10.018, fº 152vº (Samson, Apologeticus), vue d’ensemble et note arabe du bas de la marge gauche.
Fig. 7: León, Archivo de la catedral, ms. 22, fº 5rº (copie des actes du concile de Cordoue. 839).
Fig. 8: Lettrines apparentées dans des manuscrits provenant sans doute de Cordoue. Respec-tivement, de gauche à droite et de haut en bas : León, Archivo de la Catedral, ms. 22, fº 51rº ; Tolède, Archivo de la Catedral, ms. 35.6, fº 14rº ; Urgell, Arxiu catedral, Codex miscellaneus patristicus, fº 94vº et Madrid, ms. 10.001 (Breviarium), fº 165 rº.
Fig. 9: Tolède, Biblioteca capitular, ms. 11.4, ^º 1vº et 2rº. (Gregorius Magnus, Moralia in Iob). La croix asturo-léonaise et l’acrostiche au nom de l’évêque Dulcidius.
Fig. 10: Ibid., ^º 174vº (traduction d’un passage sur l’Incarnation) et 256vº (traduction d’un verset de l’Évangile, Matthieu 6-6).
Fig. 11: Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 1872 (Hispana chronologica), fº 67vº. Un évêque reçoit la révélation des canons ecclésiastiques par la dictée du Saint-Esprit.
Fig. 12: Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 10.041, fº 47rº (Collectio hispanica chronologica). Une note marginale en arabe (balagh : « pénètres-toi du sens de cela ») attire l’attention du lecteur sur un canon.
Fig. 13: Madrid, Biblioteca Nacional, ms. Vitr. 13.1, fº 201vº (Biblia hispalense, 988). Dans le cou de la huppe, l’enlumineur a apposé l’annotation suivante : « iqra’ khabar Danîl » (« Lis l’histoire de Daniel ! »).