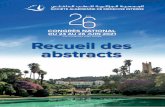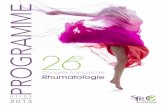Beeching : économie et société : quelques repères à propos du Néolithique. Introduction à...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Beeching : économie et société : quelques repères à propos du Néolithique. Introduction à...
à la fin de la Préhistoire
actualité de la recherche
ouvrage collectif sous la direction d’alain Beeching, éric thirault et Joël Vital
Documentsd’Archéologieen Rhône-Alpeset en Auvergne
DARAà la fin de la préhistoire
actualité de la recherche
Les 7e Rencontres méridionales de Préhistoire récente, tenues à Bron, sur le campus de l’Université Lumière-Lyon 2, les 3 et 4 novembre 2006, ont réuni plus de 150 préhistoriens venus du Sud de la France et des régions alentour. Ces Rencontres biennales représentent le lien majeur de la communauté des chercheurs pour les périodes allant du Mésolithique à l’Âge du Bronze dans la moitié sud de la France.
Les Actes présentés ici regroupent 24 contributions réparties en deux sections : l’actualité de la recherche, présentant les principaux résultats des fouilles et programmes récents, et le thème spécifique choisi pour cette session «économie et société à la fin de la Préhistoire ». Cette thématique large est abordée au fil de
9 contributions très ciblées portant sur les économies de subsistance, de production et d’échange ainsi que sur l’analyse de structures immobilières qui en témoignent, où l’on voit que l’idéel et le matériel ne sont jamais très éloignés dans ces sociétés du passé.
Association de Liaison pour le Patrimoine et l'Archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne
30 €
DARA
DARA
éco
no
mie
et s
oci
été
à la
fin
de
la p
réhi
sto
ire
– ac
tual
ité
dela
rech
erch
e
34
Couv. DARA 34.indd 1 24/09/10 15:01
alPara – maison de l’orient et de la méditerranée
économie et société
économie et société
à la fin de la Préhistoire
actualité de la recherche
ouvrage collectif sous la direction d’alain Beeching, éric thirault et Joël Vital
Documentsd’Archéologieen Rhône-Alpeset en Auvergne
DARAà la fin de la préhistoire
actualité de la recherche
Les 7e Rencontres méridionales de Préhistoire récente, tenues à Bron, sur le campus de l’Université Lumière-Lyon 2, les 3 et 4 novembre 2006, ont réuni plus de 150 préhistoriens venus du Sud de la France et des régions alentour. Ces Rencontres biennales représentent le lien majeur de la communauté des chercheurs pour les périodes allant du Mésolithique à l’Âge du Bronze dans la moitié sud de la France.
Les Actes présentés ici regroupent 24 contributions réparties en deux sections : l’actualité de la recherche, présentant les principaux résultats des fouilles et programmes récents, et le thème spécifique choisi pour cette session «économie et société à la fin de la Préhistoire ». Cette thématique large est abordée au fil de
9 contributions très ciblées portant sur les économies de subsistance, de production et d’échange ainsi que sur l’analyse de structures immobilières qui en témoignent, où l’on voit que l’idéel et le matériel ne sont jamais très éloignés dans ces sociétés du passé.
Association de Liaison pour le Patrimoine et l'Archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne
30 €
DARA
DARA
éco
no
mie
et s
oci
été
à la
fin
de
la p
réhi
sto
ire
– ac
tual
ité
dela
rech
erch
e
34
Couv. DARA 34.indd 1 24/09/10 15:01
alPara – maison de l’orient et de la méditerranée
économie et société
économie et société
Illustration de couvertureUne lône du Rhône près de Montélimar (Drôme).Photo Emmanuel Georges.
Illustration de la quatrième de couvertureSaint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) : fosse 59 du site néolithique des Moulins. Cette fosse plate présentait juxtaposés : une meule retour née de 60 kg, un fragment de radius humain, une perle en variscite catalane... illus trant en raccourci, à la fois l’ambivalence de signification d’un instrument fonctionnel hors de son lieu d’uti-li sation et l’imbrication des fonctions économiques et sociales.Photo CAPRA Valence.
Ouvrage collectif sous la direction d’Alain Beeching, éric Thirault et Joël Vital– économie et société à la fin de la Préhistoire – Actualité de la recherche : actes des 7e Rencontres méridionales de Préhistoire récente tenues à Bron (Rhône), les 3 et 4 novembre 2006.Lyon : Association de liaison pour le patrimoine et l’archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne / Publications de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux, Université Lumière-Lyon 2, CNRS, 2010.372 p., 21 x 29,7 cm.(Documents d’archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne ; 34).
économIe et socIété à la fIn de la PréhIstoIre
actualIté de la recherche
Actes des 7e Rencontres méridionales de Préhistoire récentetenues à Bron (Rhône), les 3 et 4 novembre 2006
sous la direction de
alain Beeching, éric thirault et Joël Vital
association de liaison pour le patrimoine et l’archéologie en rhône-alpes et en auvergnePublications de la maison de l’orient et de la méditerranée
lyon 2010
Documentsd’Archéologieen Rhône-Alpeset en Auvergne
N° 34
Les Documents d’archéologie en Rhône-Alpes et en AuvergneLa collection Documents d’archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne est consacrée à la diffusion de la recherche archéologique et historique du territoire des régions du Centre-Est et du Sud-Est de la France. Elle accueille des monographies de sites ou de monuments, des études synthétiques ou spécialisées, des actes de colloques, de la Préhistoire à l’époque moderne. La collection est ouverte à tous les acteurs de l’archéologie.
direction de la publication : Louis Blanchard et Jean-Baptiste Yondirection scientifique : élise Faure-Boucharlat et Jean-Baptiste Yon
secrétariat de rédaction et d’édition : Ingrid Berthelier et Vincente Voisin
édition et diffusionLes DARA sont édités et diffusés conjointement par l’Association de liaison pour le patrimoine et l’archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne (ALPARA, 25 rue Roger-Radisson, F-69005 Lyon) et les Publications de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux, Université Lumière-Lyon 2, CNRS (5-7 rue Raulin, F-69355 Lyon cedex 07).
ISBN 978-2-35668-016-7 – ISSN 1632-4374
comité de rédactionConseillers scientifiques : Anne Le Bot-Helly, conservatrice régionale de l’archéologie (DRAC Rhône-Alpes),
Frédérik Letterlé, conservateur régional de l’archéologie (DRAC Auvergne)
comité de lecture
Guy Barruol, directeur de recherche émérite, CNRSAnne Baud, maître de conférence en archéologie médiévale, Université Lumière-Lyon 2, UMR 5138 / Archéométrie et archéologieFrédérique Blaizot, ingénieur de recherche, Institut national de recherches archéologiques préventives, Rhône-Alpes-Auvergne, UMR 5199 / PACEALouis Blanchard, président de l’ALPARAélise Faure-Boucharlat, inspectrice générale des patrimoines, archéologie, Ministère de la culture et de la communicationPierre Jacquet, assistant technique et scientifique, Institut natio nal de recherches archéologiques préventives, Rhône-Alpes-Auvergne
Marie Le Mière, chargée de recherche, CNRS, UMR 5133 / ArchéorientAnne Pariente, conservatrice en chef, directrice du Service archéo lo gique de la Ville de LyonNicolas Reveyron, professeur d’histoire de l’art et archéologie du Moyen Âge, Université Lumière-Lyon 2, UMR 5138 / Archéo-mé trie et archéologie, membre senior de l’Institut universitaire de FrancePhilippe Thirion, ingénieur d’étude, Service régional de l’archéo logie (DRAC Rhône-Alpes)Jean-Baptiste Yon, chargé de recherche, CNRS, UMR 5189 / HiSoMA, responsable scientifique des publications de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée
Colette Annequin, professeur d’histoire et archéologie antiques, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble 2Marie-Christine Bailly-Maître, directrice de recherche, CNRS, UMR 6572 / LAMM, Aix-en-ProvenceJean-Paul Bravard, professeur de géographie, Université Lumière-Lyon 2, membre de l’Institut universitaire de FranceMarie-Agnès Gaidon-Bunuel, ingénieur d’étude, Service régio-nal de l’archéologie (DRAC Rhône-Alpes)Vincent Guichard, directeur général de Bibracte, Centre archéo lo gique européen du Mont-BeuvrayBruno Helly, directeur de recherche, CNRS, UMR 5189 / HiSoMARoger Lauxerois, conservateur en chef du patrimoine, ancien direc teur des musées de VienneChantal Mazard, conservatrice en chef du patrimoine, Direction de la culture et du patrimoine du Conseil général de l’IsèreMichèle Monin, archéologue, Service archéologique de la Ville de LyonPierre-Yves Nicod, archéologue, Université de Genève
Isabelle Parron, docteur en archéologie médiévale, respon-sable d’agence Archeodunum SASJean-François Reynaud, professeur honoraire, Université Lumière-Lyon 2Hugues Savay-Guerraz, conservateur, Musée gallo-romain de Lyon-FourvièreAnne Schmitt, chargée de recherche, CNRS, UMR 5138 / Archéo métrie et archéologieJoëlle Tardieu, ingénieur d’étude, Service régional de l’archéo-logie (DRAC Rhône-Alpes)Dominique Tardy, chargée de recherche, CNRS, USR 3155 / Institut de recherche sur l’architecture antique, PauJean-Michel Treffort, chargé de recherche, Institut national de recherches archéologiques préventives, Rhône-Alpes-AuvergneGérard Vernet, ingénieur chargé d’opération et de recherche, Institut national de recherches archéologiques préventives, et chercheur UMR 6042 / GEOLABJoël Vital, chargé de recherche, CNRS, UMR 5138 / Archéo-métrie et archéologie, Lyon-Valence
secrétariat d’édition du volume : Elysabeth Hue-Gay
La publication de cet ouvrage a été financée par le Ministère de la culture et de la communicationainsi que par l’Association Rencontres méridionales de Préhistoire récente.
Les avis exprimés dans ce volume n’engagent que la responsabilité des auteurs.
colloque organisé par
Association Rencontres méridionales de Préhistoire récenteCentre d’archéologie préhistorique du Rhône aux Alpes - Valence
DRAC – Service régional de l’archéologie Rhône-AlpesCNRS, UMR 5138 - Lyon
Université Lumière-Lyon 2, Chaire de Préhistoire
dans les locaux et avec le soutien de l’Université Lumière-Lyon 2
comité d’organisation
Alain Beeching (Université Lumière-Lyon 2), Yves Billaud (Ministère de la culture et de la communication, DRASSM), Anne Le Bot-Helly, Geneviève Martin (Ministère de la culture et de la communication, Service régional de l’archéologie), éric Thirault (Société Paléotime), Frédéric Cordier, Frédéric Jallet, Sylvie Saintot (Inrap), Joël Vital (CNRS)
comité de relecture
Alain Beeching, Yves Billaud, Jacques Léopold Brochier, André D’Anna, Hélène Dartevelle, Pierrick Fouéré, Jean-Pierre Giraud, Pierre-Arnaud de Labriffe, Pierre-Yves Nicod, Ingrid Sénépart, Thomas Perrin, Yaramila Tchérémissinoff, Jean-Paul Thévenot, éric Thirault, Jean Vaquer, Joël Vital et Jean-Louis Voruz
Préparation du manuscrit
éric Thirault
L’organisation matérielle du colloque a reposé sur la participation active de Geneviève Martin (SRA), l’aide financière de l’Université Lumière-Lyon 2, ainsi que sur l’aide bénévole de personnels de la Culture et d’étudiants de l’Université. La publication des Actes a pu se faire grâce à l’aide financière du Ministère de la culture et de la communication et à l’engagement du service des Publications de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux de Lyon. Que toutes les personnes impliquées dans ces différentes étapes soient remerciées ici.
7
sommaIre
Alain Beeching
Avant-propos............................................................................................................................................................................................................................ 9
thème : économIe et socIété à la fIn de la PréhIstoIre
Alain Beeching
économie et société : quelques repères à propos du Néolithique ..................................................................................................................... 13
Bernard gassin, Nuno F. Bicho, Laurent BouBy, Ramón Buxó y capdevila, Antonio F. carvalho, Ignacio Clemente conte, Juan Francisco giBaja, Jesús gonzàlez urquijo, Juan José iBàñez estévez, Jimmy linton, Philippe Marinval, Belén Márquez, Leonor peña‑chocarro, Guilhem pérez jordà, Sylvie philiBert, Amelia del Carmen rodríguez rodríguez et Lydia zapata
Variabilité des techniques de récolte et traitement des céréales dans l’Occident méditerranéen au Néolithique ancienet moyen : facteurs environnementaux, économiques et sociaux ...................................................................................................................... 19
Jean vaquer et Maxime reMicourt
Rythmes et modalités d’approvisionnement en silex blond bédoulien dans le Chasséen du bassin de l’Aude : le cas d’Auriac,Carcassonne (Aude) ............................................................................................................................................................................................................. 39
Gwenaëlle le Bras‑goude, Estelle herrscher et Jean vaquer
Variabilité isotopique de populations chasséennes : implications paléoalimentaires .................................................................................. 57
Pierre-Yves nicod, Régis picavet, Jacqueline argant, Jacques Léopold Brochier, Louis chaix, Claire delhon, Lucie Martin, Bernard Moulin, Dominique sordoillet et Stéphanie thiéBault
Une économie pastorale dans le Nord du Vercors : analyse pluridisciplinaire des niveaux néolithiques et protohistoriques dela Grande Rivoire (Sassenage, Isère) ............................................................................................................................................................................. 69
Philippe galant
économie souterraine et guerre des gangs sur les Grands Causses à la fin du Néolithique .................................................................... 87
Luc jaccottey et Annabelle Milleville
Aux origines de la meule : premiers exemples de carrières de moulins de type « va-et-vient », massif de la Serre, Jura ............... 109
Romana harfouche
Agriculture en terrasses à haute altitude au cours de l’Âge du Bronze dans les Pyrénées-Orientales (massif du Carlit) ............... 125
Alain Beeching, Jacques Léopold Brochier, Sylvie riMBault et Joël vital
Les sites à fosses circulaires du Néolithique et de l’Âge du Bronze ancien en moyenne vallée du Rhône : approchestypologiques et fonctionnelles, implications économiques et sociales ............................................................................................................. 147
8
actualIté en rhône-alPes
Raphaële guilBert, Alain Beeching et Frédéric cordier
L’industrie lithique du site castelnovien de plein air d’Espeluche-Lalo (Drôme) : spécificités techniques et culturelles................. 173
Alain Beeching, Jacques Léopold Brochier, Frédéric cordier, Dominique Baudais, Philippe hénon, Frédéric jallet, Jean-Michel treffort et Karine raynaud
Montélimar – Le Gournier : historique des recherches et présentation d’un « grand site » chasséen en vallée du Rhône ............ 187
Jean-Michel treffort et Philippe alix, avec la collaboration d’Anne-Claire Mauger
Montélimar – Portes de Provence, zone 5 : des alignements de foyers à pierres chauffées néolithiques dans le secteurdu Gournier .............................................................................................................................................................................................................................. 207
Yaramila tchéréMissinoff, Philippe alix, Vérane Brisotto, Frédérique ferBer et Sylvie saintot
Une sépulture chasséenne et un dépôt symbolique annexe (?) à Montélimar (Drôme), Portes de Provence (zone 5) ............. 223
Joël vital
Les séquences céramiques de la Balme de Sollières-Sardières (Savoie) et de la grotte de la Chauve-Sourisà Donzère (Drôme) : implications sur le Néolithique final transalpin, le phasage et le concept de Remedello ............................... 237
Thierry argant, Catherine latour‑argant et Stéphane gaillot
Nouveaux indices d’occupation préhistorique en rive gauche de la Saône à Lyon 4e (Rhône) .............................................................. 255
Jacqueline argant et Catherine latour‑argant
Abris sous roche et taphonomie pollinique ................................................................................................................................................................. 263
actualIté hors rhône-alPes
Jérôme rousseau, Gisèle allenet de riBeMont, Pascal Bertran, Séverine Braguier, Catherine dupont, Pierrick fouéré, Philippe forré, Michel coutureau et Jean-Marie jauneau
Les occupations néolithiques de la colline de Port-Punay à Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime) ................................................... 269
Maria A. Borello
Chassey-Cortaillod-Lagozza... ............................................................................................................................................................................................. 293
Carine Muller‑pelletier, avec la collaboration de David pelletier
Les structures de combustion à pierres chauffées du Néolithique moyen du site 1 des Acilloux (Cournon-d’Auvergne,Puy-de-Dôme) ........................................................................................................................................................................................................................ 305
Michel Billard
évolution des pathocénoses du Néolithique moyen à la Tène sur des séries ostéo-archéologiques de Limagne d’Auvergne(Puy-de-Dôme) ...................................................................................................................................................................................................................... 317
Francesco ruBat Borel
Premières données à propos du mégalithisme dans les Alpes du Piémont ................................................................................................... 327
Giorgio chelidonio
Ateliers de taille de silex dans la Préhistoire récente des Monti Lessini (Verona, Italie) .............................................................................. 339
Patrice courtaud et Patrice duMontier
La cavité sépulcrale de l’Homme de Pouey à Laruns (64) : les aménagements funéraires dans une grotte de l’Âge du Bronze 347
Philippe haMeau
Nouveaux abris à peintures à Fontaine-de-Vaucluse (Vaucluse) ......................................................................................................................... 359
13
Les quelques propositions qui suivent ont pour but de pré-sen ter la thématique principale de ces 7e Rencontres de Bron. Issues de l’intervention intro ductive, elles ne peuvent prétendre cou vrir à elles seules la totalité du vaste champ des questions rela tives à l’économie dans ses rapports à la société, voire même seulement à la Préhistoire. On tentera uni que ment et briè vement ici de montrer la complexité et la « profondeur de champ » de ce domaine d’interrogation, ainsi que les catégories d’ar guments que peut solliciter la Préhistoire pour y répondre.Une précision préalable semble nécessaire. Il n’y avait pas, dans les arrière-pensées du choix de ce thème, de pré sup-posé quant à la prééminence de l’économique sur toute autre dimen sion ou comportement des sociétés humaines du passé et du présent. On ne rentrera pas dans ce débat déjà ancien qui dépasse de beaucoup notre propos (Godelier 1974) bien qu’il s’invite parfois dans l’argumentation archéologique (Testart 1998 ; Cauvin 2000) ; ce qui montre d’ailleurs, s’il en était besoin, que la Préhistoire a bien toute sa place dans les inter-ro gations anthropologiques les plus larges. Pour en res ter à la seule frange de ce que ces Rencontres ont lar ge ment con tri-bué à nommer Préhistoire récente (terme dis cu table, mais fina-le ment moins ambigu que celui de Protohistoire quand il tente de reculer son emprise en deçà des premières traces écrites), nos prédécesseurs et nos aînés nous ont appris depuis déjà long temps que les seules innovations techniques (lithique poli, céra mique, métal...) et économiques (production ali-men taire et maté rielle, diffusion...) ne suffisent pas pour fon-der une chro no logie et une classification même sommaires des étapes de l’hu manité du passé. Des comportements plus glo baux, de dimen sion sociale, étaient déjà relevés : séden ta-ri sation, domesti cation, complexification sociale, révo lution des
symboles..., le champ de l’idéel étant rejoint par un autre biais que les modes de traitement de la mort, mais toujours à partir d’une documentation matérielle. Les vraies limites de l’enquête archéo logique sont d’ail leurs là. Sur la base – longtemps exclusive et pro ba ble ment encore dominante – d’une lecture matérialiste des faits, héri tée de Childe (Childe 1953) et privilégiant la stra té-gie ali men taire, puis les dynamismes techniques, les con traintes démo graphiques ou environnementales, ou sur celle que l’on dit idéaliste et qui trouve les res sorts du changement dans le psy chisme même de l’Homme (Cauvin 1994), les arguments archéo logiques restent en dernier ressort du domaine de l’objet ou de la trace, c’est-à-dire des impacts sur le monde phy sique. On peut argu menter sur ce que l’on trouve ou observe, plus dif fi ci lement sur ce que l’on ne voit pas. Au-delà, il faut éla bo rer des modèles cohérents et sol li citer le regard croisé des autres sciences sociales.
1. défInItIons et suBdIVIsIons d’usage
Tentons une définition : l’économie serait le champ des relations humaines visant à maîtriser et organiser l’accès aux ressources natu relles. Fondée sur l’inégalité de la répartition spatiale des trois
économIe et socIété : quelques rePères à ProPos du néolIthIque
alain Beeching
Beeching 26 mars .indd 13 23/09/10 15:13
14
règnes de la nature, elle concerne d’abord les rapports directs que l’homme entre tient avec la matière pour en faire son profit et la faire concourir à sa survie et à son existence biologique, par des procès d’acquisition et de transformation, tou chant donc par là à toute la sphère du technique. L’éco no mie concerne aussi l’en semble des relations d’homme à homme pour assurer et amé liorer cette acqui sition ou cette transformation, englobant ainsi toute la sphère du tra vail. Toujours au titre des relations entre hommes, l’éco no mie touche à la fonction de redis tribution, c’est-à-dire les circulations, transports, échanges, commerces... Au-delà enfin, il peut s’agir du regard que l’homme porte sur lui-même dans la possession ou le con trôle des biens matériels, c’est-à-dire la représentation sociale du statut qu’il en tire.Alain Testart le dit plus directement : « Nous qualifions d’éco no-miques tous les rapports sociaux qui impliquent une certaine maté rialité, c’est-à-dire qui mettent en œuvre des biens utiles à l’homme » (Testart 2005), posant d’emblée l’évidence du lien entre l’économique et le social.Il est donc difficile d’aborder cette question de l’éco no mie, au champ d’application considérable, sans passer par un découpage for maliste. Dans un but opératoire, et tout en sachant qu’elles sont liées dans le processus social, nous retiendrons les trois grandes subdivisions théo riques habituelles :– l’économie de subsistance, qui concerne les com por tements liés aux activités vivrières, la production alimen taire végétale et ani male. On peut préférer « économie de production alimentaire », évitant la con no ta tion de survie et laissant place à de multiples moti va tions sociales plus complexes. Les implications agro- et zoo tech niques de cette économie, le plus souvent avan cées et dis cutées par les « archéo-naturalistes », occupent sou vent l’es-sen tiel du débat ; les liaisons sociales sup po sées, quand elles sont examinées, étant ren voyées à des effets plus volontiers qu’à des causes dans ces comportements ;– l’économie de production matérielle, qui concerne les activités d’ac quisition et de transformation de la matière. C’est un domaine clas sique de la Pré histoire fran co phone, dont les discussions se sont long temps auto-alimentées en vase clos, à l’abri des ana-lyses sociales, avant que la pratique de l’enquête ethno archéo-logique n’ap porte cette dimension depuis quelques décennies. Les cas d’études actuelles de pro ductions céramiques (Longacre 1991 ; Gallay et al. 1998), plus rarement lithiques (Roux 1985 ; Pétrequin, Pétrequin 1993), dans une optique – notamment – de com préhension de celles du passé, sont nombreux. Par ce biais et sous cette influence se posent maintenant, en plus des ques tions technologiques traditionnelles, de nou velles inter ro-ga tions autrefois largement éludées : qui pro dui sait, dans quel cadre social, pour quoi ou pour qui, avec quels effets incidents ;– l’économie d’échange, qui s’attache à la redistribution évo quée en définition. C’est sans doute le domaine où les préhistoriens ont, dans les temps récents, le plus volon tiers pris en compte l’im portance du social dans les moti vations des comportements. Par tant, c’est celui où le recours à l’Anthropologie sociale est le plus sollicité.
2. rePères anthroPologIques : les BIens matérIels
Il ne peut s’agir ici que d’évocations ou de rappels géné-raux renvoyant à l’abondante littérature spécialisée trai tant de l’Anthropologie économique 1. Nous ne sommes bien sûr pas fon dés à entrer ici dans le détail de débats internes à cette branche ; les principes mis en exergue ne le sont que pour ali-men ter les débats propres à la Préhistoire.Au sens strict, l’Anthropologie économique est appa rue assez tar divement, dans la troisième décennie du xxe siècle, sous l’im-pul sion de divers auteurs dont Malinowski et Mauss, eux-mêmes influen cés par la nou velle science économique (définie par David Ricardo au xixe siècle et Adam Smith au tout début du xxe). Des liai sons sont établies entre les systèmes de production, d’uti lisation et de circulation des biens maté riels et les com por te-ments « exotiques » décrits par les ethnologues.B. Malinowski consacre la plus grande partie de son étude Les Argonautes du Pacifique occidental aux rap ports économiques et aux formes d’échange des popu la tions des îles Trobriand, près de la Nouvelle-Guinée (Malinowski 1963). Il y fait de l’économie la base du sys tème social. Marcel Mauss réfute, au contraire, cette prééminence et lie l’économique aux autres manifestations avec lesquelles il forme un système com plet (concept de « fait social total » : Mauss 1923).Les querelles entre formalistes et substantivistes à partir des années cinquante vont prolonger et déplacer ce débat sur le pri mat structurel de l’économique, mais c’est l’An thro pologie mar xiste qui va bientôt pola ri ser ce sujet, notam ment par sa réflexion de fond sur les « modes de production ». à partir des années soixante-dix, elle passe (C. Meillassoux, E. Terray, P. Bonte..., mais sur tout M. Godelier) d’une Anthropologie maté-ria liste et his to rique classique, où l’économie tient bon rang, à une théo rie de l’« extra-économique », retirant de fait à celle-ci le rôle central et même une simple auto no mie, pour réha biliter la parenté, le domestique, le poli tique, l’idéo lo gique... mais la ques tion se pose tou jours de savoir pour quoi et comment « les fonc tions éco no miques changent de lieu et de forme au cours de l’histoire » (Godelier, in Bonte, Izard 2004, p. 219-220) et en quoi elles entraînent ou accompagnent des chan ge ments dans l’évo lution des sociétés. En résumé, pourquoi « les formes de cir-cu lation des biens sont subor don nées aux rap ports sociaux qui règlent le procès de production » (ibid.).Plus récemment, A. Testart consacre à l’économie la pre mière par tie de son ouvrage éléments de clas si fication des sociétés (Testart 2005). Il revient sur les analyses des pionniers de l’Anthro pologie éco no mique (Malinowski et Mauss), et notam-ment sur les sys tèmes d’échanges cérémoniels (comme la kula des Trobriandais). Pour ces auteurs, la richesse qui en découle est rigoureusement non utilitaire puisqu’elle n’as sure que le pres tige à ceux qui la possèdent. Pour Testart, ce n’est pas exact,
1 - Nous nous sommes restrictivement référés pour notre part aux textes de K. Marx, H.S. Maine, L.H. Morgan, K. Bücher, B. Malinowski, R. Burling, E.E. Leclair, K. Polanyi, G. Dalton, D. Kaplan, M. Salhins, E. Wolf, M. Godelier, réunis par ce dernier (Godelier 1974), ainsi qu’à d’autres textes de certains de ces auteurs : Malinowski 1963 ; Sahlins 1976 ; Godelier 1970, 1973, 1982 ; mais aussi Mauss 1923 ; Meillassoux 1964 ; Lemonnier 1990 ; Testart 1986, 2005 ; Bonte 1974, 1975.
Beeching 26 mars .indd 14 23/09/10 15:13
15
puisque cette richesse sert au paiement d’obligations sociales impo sées par le droit ou la coutume (par exemple l’achat de la fian cée qui est bien l’achat – parfois lourd – d’un droit et non celui d’une personne). A. Testart en fait un principe de base : en société primitive, l’essentiel des mouvements éco no-miques ne concerne pas l’échange de biens maté riels (même indirectement) ou le paiement de ser vices, mais l’acquittement d’obli gations sociales. En Mélanésie, et plus largement en Océanie, le rachat de l’épouse, le prix du sang, les amendes pour adul tère, inceste, rupture de tabous par exemple, provoquent le trans fert de porcs, de coquillages, de haches polies et de divers autres objets « de luxe ». Les obligations sociales seraient donc la prin cipale cause de la création et de la diffusion des richesses, pour assurer non pas la sub sis tance, mais la simple existence sociale des indi vidus. Le mouvement des biens matériels (par exemple des objets, mais aussi des récoltes ou des ani maux) est une conséquence secondaire et non un but pre mier. Autre con séquence concernant la notion de bien de pres tige que l’on sol licite maintenant beaucoup dans notre discipline : c’est parce que ces biens sont indis pen sables (à différents niveaux) et iné-ga lement répar tis dans le groupe social qu’ils sont convoités et qu’il y a du pres tige à les détenir.
3. retour à la PréhIstoIre : questIons de terre et de terrItoIre exPloItés ?
On ne reprendra pas le discours fondamental et toujours néces-saire sur les limites de l’archéologie dans le con cert des sciences sociales (Gallay 1986 ; Stockowski 1991 ; Boissinot 1998). « Il est clair que des entités qui sont des données en ethnologie ou en socio logie ne peuvent faire l’objet que de présomptions lorsqu’on ne dis pose que des seules méthodes de l’archéologie. à ce titre, elles ne permettent pas d’asseoir de nouvelles pré somp tions » (Boissinot, op. cit., p. 24). On ne doit pas pour autant mini miser ou inférioriser ce qui relève de notre disci pline. Certes, les idées s’y traduisent plus souvent en arché types sommaires qu’en sys-tèmes explicatifs com plexes et reproductibles, mais l’évo lution pro gressive de ces visions globalisantes est en soi notre objet d’étude ; leur des tinée est d’être toujours imparfaites, amen dées, com plé tées par des informations ou des propositions nouvelles.Ainsi, l’analyse des comportements observés en Préhistoire récente occidentale peut s’enrichir des con stats anthro po lo-giques évoqués plus haut en postulant par exemple, pour les dépla cements d’objets, de styles, de techniques... et les irré gu la-ri tés de leur distribution, d’autres mobiles que les dépla ce ments col lectifs, les con quêtes pionnières, les accul tu ra tions, les hiérar-chies ver ticales... les plus souvent invoquées.Autre exemple : il y a, en dehors de cette question lan ci nante des variations morphologiques et des dépla ce ments d’objets, un
autre point important dans le débat préhistorien, que les ana-lyses anthropologiques et his to riques mettent bien en lumière : celui de la relation à la terre pour les activités éco no miques de subsistance. Comme le signale encore A. Testart (Testart 2005), l’appropriation de la terre comme bien foncier est seu le ment une des éven tualités possibles. On en fait volontiers, au moins impli citement, un des tropismes de l’Homme du passé. Aussi loin que les textes historiques le rapportent, en tout cas depuis le droit romain, il s’agit certes de la situa tion de base en Occident... et sans doute la raison de notre atta che ment spontané à cette configuration dans les hypothèses sur la Préhistoire. Mais il peut exis ter, comme en Afrique hors de l’emprise de l’Islam et de la colonisation, un droit de pro priété couvrant le seul pro duit du tra vail investi sur une parcelle de terre sans que celle-ci puisse s’approprier, se trans mettre, en dehors de ce travail. Ce second modèle serait de loin le plus fréquent en société primitive (ibid.). Les effets de la confrontation d’une divergence de con-cep tion à ce sujet sont évidents : on connaît aujourd’hui en Corse des litiges de pro priété entre communes de montagne et pro priétaires de la plaine qui sont les descendants séden tarisés d’an ciens pasteurs mobiles qui s’étaient appro priés le droit sur le sol par leurs seuls parcours.Cette question rejoint un débat qui nous est propre. L’archéologie de nos périodes d’étude fait de la séden ta ri sation un seuil emblé matique ; mais la projection con crète de ce concept est sou vent malaisée, la durée des cycles de stabilité-déplacement des groupes humains étu diés étant très variable selon, justement, les types d’éco nomie de subsistance, les ressources du sol, les con traintes climatiques et les rythmes sociaux. Les explications dynamiques et implicitement colo ni sa trices qui ont la faveur des principaux auteurs pour expli quer la pro pa ga-tion du Néolithique en Europe occi dentale s’appuient sur deux pos tulats forts :– la nature expansive du premier Néolithique, fondée sur un besoin social d’essaimage des groupes humains ;– corrélativement, le besoin de nouveaux sols agricoles.Ce schéma, qui conduit à l’utilisation de concepts comme ceux de « front pionnier » ou de « néolithisation pion nière », caractérise, de fait, le « modèle danubien » (Lichardus-Itten et al. 1985, III-3 ; Demoule 1990, p. 74 ; Demoule 2007, p. 18, 43-44). Il est sous-jacent aussi dans le modèle proposé par A. Gallay pour la néo li thi sa tion des Alpes et, en amont, de l’Italie septen trio-nale et de la France méridionale (Gallay 1989). Sans les dis cu-ter ici, on remar quera que ces concepts sont fondés sur l’idée d’une appro priation pro gres sive des sols à des fins agraires. Ce qui est probable dans l’aire danubienne ne l’est peut-être pas aussi sûrement ailleurs. Si la reva lo ri sation du sys tème pastoral des caprinés, d’une part (cf. infra), et la modes tie des premières instal lations villa geoises, d’autre part, sont prises en compte, on est fondé à envi sa ger, pour les zones géographiques méri dio-nales et alpines, un autre modèle – non-danubien – de contrôle éco no mique et social des parcours et des territoires.Plusieurs catégories interprétatives sont ici en jeu. D’abord, concrè tement, celle de la définition des modes de relation au sol ; ensuite, celle de la formalisation de modèles explicatifs pro gres-si vement plus complexes à mesure que l’on « monte » vers des énon cés plus glo baux sur les mécanismes des « changements cul turels » (au sens des préhistoriens) dans l’Europe occi den tale des derniers millénaires précédant l’Histoire.
Beeching 26 mars .indd 15 23/09/10 15:13
16
– Au premier niveau doivent se placer les débats sur les bases struc turelles de la relation au milieu et à l’éco no mie de subsistance : rapport au monde physique, aux res sources minérales, végé tales et animales, à la forêt, à la montagne, à la mer..., mais aussi importance relative de l’agri culture et de l’élevage, place de la prédation, etc. On a découvert, par exemple, les variations des cycles de présence / absence, emprise / déprise, dynamismes démo gra phiques et culturels, évolution des techniques, des options d’abattage... que per mettent de saisir sur près d’un mil lénaire et demi (4000-2500 BC cal.) des pro grammes de recherche com plets comme ceux des lacs juras siens (Pétrequin 1997 ; Pétrequin et al. 1999, 2002, 2005). Dans un autre domaine, on com-mence à bien situer la problématique zoo tech nique et cul turelle de l’élevage des caprinés dans le Néolithique méridional, le phé nomène grotte-bergerie au Chasséen, mais aussi à l’Âge du Bronze, les hypothèses qui en découlent sur la ges tion des troupeaux, ainsi que sur la mobi lité des groupes humains concernés... (Brochier 1996 ; Brochier et al. 1999 ; Brochier, Beeching 2006 ; Helmer et al. 2005).– Ces faits et bien d’autres de même type sont, à des degrés de démon stration variables, du ressort strict de l’en quête archéo-logique qui, dans ce cas, progresse par mul tiplication cohé-rente et regroupement raisonné des don nées du terrain. Mais, à un niveau d’intégration et d’ex plication supérieur de ces données, se mêlent des hypo thèses « culturelles » fondées sur des scé narios anthro pologiques. Les postulats globalisants dont
il était ques tion plus haut, qui ont longtemps tenté de pal lier nos faiblesses démonstratives en prenant rang de para digmes (impact univoque de la néolithisation, éco no mie agro-pastorale équilibrée, sédentarisation, entités cul tu relles, contacts, échanges…), sont peu à peu atta qués et remplacés par des « sys tèmes explicatifs » (plus que par des affirmations) issus du double éclairage archéo logique et anthropologique… le premier étant lui-même, comme l’on sait, composé de multiples apports spécialisés.On ne doit pas « porter » les limites de l’archéologie pré his to rique comme une chute originelle. Ses progrès tech niques et l’enri-chis sement de ses questionnements jalonnent son histoire ; et si nous restons et resterons pour tou jours très balbutiants, nous posons des ques tions qui ne peuvent être posées autrement par d’autres… Si, au bout du compte, il y a plusieurs réponses « indé ci dables » et si nous devons, pour en for mu ler certaines, emprun ter à d’autres disciplines les mots et les concepts, ce n’est pas un signe de faiblesse mais de richesse. L’enquête pré-his torique ne s’ar rête pas aux limites de l’archéologie.
AUTEUR
Alain Beeching, Université Lumière-Lyon 2, CAPRA Valence. Courriel : [email protected]
BIBlIograPhIe
Boissinot P. 1998. Que faire de l’identité avec les seules méthodes de l’archéologie ? In d’anna A., Binder D. (dir.). Production et identité cul turelle : actualité de la recherche : actes de la deuxième ses sion, Arles (Bouches-du-Rhône), 8-9 novembre 1996. Antibes : éd. de l’APDCA, p. 17-25.
Bonte P. 1974. études sur les sociétés de pasteurs nomades. II, Organisation économique et sociale des pasteurs d’Afrique orien tale. Paris : Centre d’études et de recherches marxistes. 95 p. (Les Cahiers du CERM ; 110).
Bonte P. 1975. L’organisation économique des Touaregs Kel Gress. In creswell R. (ed.). élé ments d’ethnologie. I, Huit terrains. Paris : A. Colin, p. 166-215.
Bonte P., izard m. (dir.) 2004. Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie. 3e éd. [1re éd. : 1991]. Paris : PUF. XII-842 p. (Quadrige).
Brochier J.-e. 1996. Feuilles ou fumiers ? Observations sur le rôle des poussières sphérolitiques dans l’interprétation des dépôts archéologiques holocènes. Anthropozoologica 24, p. 19-30.
Brochier J.L., Beeching a. 2006. Grottes bergeries, pastoralisme et mobilité dans les Alpes au Néolithique. In jourdain‑annequin C.,
duclos J.-Cl. (dir.). Aux origines de la transhumance : les Alpes et la vie pastorale d’hier à aujourd’hui. Paris : Picard, p. 131-157.
Brochier J.l., Beeching a., sidi MaaMar h., VitaL J. 1999. Les grottes bergeries des Préalpes et le pastoralisme alpin durant la fin de la Préhistoire. In Beeching A. (dir.). Circulations et identités cuturelles alpines à la fin de la Préhistoire : matériaux pour une étude (Programme collectif CIRCALP - 1997/1998). Valence : Centre d’archéologie préhistorique de Valence, p. 77-114. (Travaux du Centre d’archéologie préhistorique de Valence ; 2).
cauVin J. 1994. Naissance des divinités, nais sance de l’agriculture : la révolution des sym boles au Néolithique. Paris : CNRS éd. 304 p.-[8] p. de pl. (Empreintes de l’homme).
cauVin J. 2000. Symboles et sociétés au Néolithique. En guise de réponse à Alain Testart. Nouvelles de l’archéologie 79, p. 49-53.
chiLde V.g. 1953. L’Orient préhistorique. Nouv. éd. entièrement refondue. Paris : Payot. 322 p.-XXXII p. de pl. (Bibliothèque his torique).
deMouLe J.-P. 1990. La France de la Préhistoire : mille millénaires, des premiers hommes à la conquête romaine. Paris : Nathan. 193 p.
deMouLe J.-P. (dir.) 2007. La révolution néolithique en France. Paris : La Découverte. 179 p. (Archéologies de la France).
gaLLay a. 1986. L’archéologie demain. Paris : Belfond. 319 p. (Belfond / Sciences).
gaLLay a. 1989. La place des Alpes dans la néolithisation de l’Europe. In aurenche O., cauvin J. (dir.). Néolithisations : Proche- et Moyen-Orient, Méditerranée orientale, Nord de l’Afrique, Europe méridionale, Chine, Amérique du Sud. Oxford : BAR, p. 227-254. (Archaeological Series ; 5. BAR. Inter national Series ; 516).
gaLLay a., huysecoM e., Mayor a. 1998. Peuples et céramiques du delta intérieur du Niger (Mali) : un bilan de cinq années de mis sions (1988-1993). Mainz am Rhein : Ph. von Zabern. VIII-133 p.-[34] p. de pl. (Terra Archaeologica ; 3).
godeLier m. (ed.) 1970. Sur les sociétés précapitalistes : textes choisis de Marx, Engels, Lénine. Paris : éd. sociales. 414 p.
godeLier m. 1973. Horizon, trajets marxistes en anthropologie. Nouv. éd. Paris : Fr. Maspéro. 2 vol. (Petite collection Maspéro ; 190, 191).
godeLier m. (ed.) 1974. Un domaine contesté, l’anthropologie économique. Paris ; La Haye : Mouton ; Paris : école pratique
Beeching 26 mars .indd 16 23/09/10 15:13
17
des hautes études, 6e section. XV-374 p. (Textes de sciences sociales ; 5).
godeLier m. 1982. La production des grands hommes : pouvoir et domination mas cu line chez les Baruya de Nouvelle-Guinée. Paris : Fayard. 370 p.-[12] p. de pl. (L’Espace du politique ; 6).
heLMer d., gourichon L., sidi MaaMar h., Vigne J.-d. 2005. L’élevage des caprinés néo lithiques dans le Sud-Est de la France : sai sonnalité des abattages, relations entre grottes-bergeries et sites de plein air. Anthropozoologica 40/1, p. 167-189.
LeMonnier P. 1990. Guerres et festins : paix, échanges et compétition dans les Highlands de Nouvelle-Guinée. Paris : éd. de la Maison des Sciences de l’Homme. 189 p.-[8] p. de pl.
Lichardus J., Lichardus-itten m. 1985. La Protohistoire de l’Europe : le Néolithique et le Chalcolithique entre la Méditerranée et la mer Baltique. Paris : PUF. 640 p. (Nouvelle Clio ; 1 bis).
Longacre W.a. (ed.) 1991. Ceramic Ethnoarchaeo logy. Tucson : University of Arizona Press. VIII-307 p.
MaLinowski Br. 1963. Les Argonautes du Pacifique occidental. Paris : Gallimard. (L’Espèce humaine). [Trad. de : Argonauts of the western Pacific: an Account of native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanisian New Guinea, 1922].
Mauss m. 1923. Essai sur le don : forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, L’Année sociologique, 2e série. [Rééd. Paris : PUF, 2007. Quadrige].
MeiLLassoux c. 1964. L’anthropologie économique des Gouro de Côte-d’Ivoire : de l’éco nomie de subsistance à l’agriculture
commerciale. Paris : Mouton. 382 p.-[8] f. de pl. (Le Monde d’outre-mer passé et présent. 1re série, études ; 27).
Pétrequin P. (dir.) 1986. Les sites littoraux néo lithiques de Clairvaux-les-Lacs (Jura). I, Problématique générale : l’exemple de la station III. Paris : éd. de la Maison des Sciences de l’Homme. 404 p. (Archéologie et culture matérielle ; 2).
Pétrequin P. (dir.) 1997. Les sites littoraux néolithiques de Clairvaux-les-Lacs et de Chalain (Jura). III, Chalain station 3, 3200-2900 av. J.-C. Paris : éd. de la Maison des Sciences de l’Homme. 2 vol. (Archéologie et culture matérielle).
Pétrequin P., VieLLet a., iLLert n. 1999. Le Néolithique au nord-ouest des Alpes : rythmes lents de l’habitat, rythmes rapides des techniques et des styles ? In BraeMer F., cleuziou S., coudart A. (eds). Habitat et société : actes des XIXe Rencontres interna tionales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, 22, 23, 24 octobre 1998. Antibes : APDCA, p. 297-323.
Pétrequin P., arBogast r.-M., Bourquin-Mignot c., duPLaix a., Martineau r., Pétrequin a.-M., VieLLet a. 2002. Le mythe de la stabilité : déséquilibres et réajus te ments d’une communauté agricole néo lithique dans le Jura fran çais, du xxxiie au xxxe siècle av. J.-C. In richard h., vignot A. (dir.). équilibres et ruptures dans les éco systèmes depuis 20 000 ans en Europe de l’Ouest : actes du colloque international de Besançon, 18-22 septembre 2000. Besançon : Presses uni versitaires franc-comtoises, p. 175-190. (Annales littéraires de l’Université de Besançon ; 730. Environnement, sociétés et archéo logie ; 3).
Pétrequin P., Magny M., BaiLLy M. 2005. Habitat lacustre, densité de population et climat. L’exemple du Jura français. In della casa p., trachsel M. (dir.). Wes’04. Wetland Economies
and Societies: Proceedings of the International Conference, Zurich, 10-13 March 2004. Zurich : Schweizerisches Landesmuseum Zurich / Chronos Verlag, p. 143-168. (Collectio Archaeologica ; 3).
Pétrequin P., Pétrequin a.-M. 1993. écologie d’un outil : la hache de pierre en Irian Jaya (Indonésie). Paris : CNRS éd. 461 p. (Monographie du CRA ; 12).
roux V. 1985. Le matériel de broyage : étude ethnoarchéologique à Tichitt (Mauritanie). Paris : Recherches sur les civili sations. 111 p. (Mémoire ; 58).
sahLins m. 1976. Âge de pierre, âge d’abondance : l’économie des sociétés primitives. Paris : Gallimard. 409 p. (Bibliothèque des sciences humaines).
stockowski W. 1991. L’archéologie : démarches savantes et conceptions naïves. Nou velles de l’archéologie 44, p. 5-6.
testart a. 1986. Le communisme primitif. I, économie et idéologie. Paris : éd. de la Maison des Sciences de l’Homme. 548 p.
testart a. 1998. Révolution, révélation ou évolution sociale. à propos du livre de Jacques Cauvin : Naissance des divinités, naissance de l’agriculture... Nouvelles de l’archéologie 72, p. 25-29.
testart a. 2005. éléments de classification des sociétés. Paris : Errance. 156 p.
testart a. 2007. Enjeux et difficultés d’une archéo logie sociale du funéraire. In Baray L., Brun P., testart A. (dir.). Pra tiques funéraires et sociétés : nouvelles approches en archéologie et en anthropo lo gie sociale : actes du colloque inter disci pli naire de Sens, 12-14 juin 2003. Dijon : édi tions uni versitaires de Dijon, p. 9-13. (Art, archéologie & patrimoine).
Beeching 26 mars .indd 17 23/09/10 15:13













![L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631c4868d5372c006e045c90/lautonomie-enfantine-a-lepreuve-des-surdoues-contribution-ethnographique.jpg)