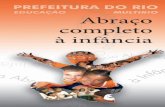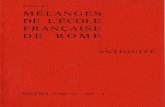L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une...
Transcript of L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une...
L’homme et la société, no 165-166, juillet-décembre 2007
L’autonomie enfantine à l’épreuve des
« surdoués » Contribution ethnographique à une approche sociale de l’enfance
Wilfried LIGNIER
« C’était d’une simplicité enfantine. Le ca-hier d’exercices fit bientôt partie des autres jouets. Mike lisait les consignes et passait en un éclair aux problèmes et aux exemples sans avoir besoin de mon aide. »
Audrey GROST, Genius in Residence, 1970
Le monde de l’enfance est singulier, possède des règles, des codes, des logiques et une cohérence qui lui sont propres. Telle est en substance la critique qu’adressent plusieurs développements récents en sociologie ou en anthropologie de l’enfance à la notion, passablement has been, de so-cialisation parentale ou institutionnelle
1. Régine Sirota écrit, par exemple, dans le texte introduisant un livre-manifeste dirigé par elle et explicite-ment intitulé Éléments pour une sociologie de l’enfance :
« Si globalement, l’apparition d’une sociologie de l’enfance est concomitante du déclin des grands récits du social, ce petit objet insolite apparaît en même temps que la remise en discussion des théories de la socialisation. Celle-ci surgit à la lumière d’un retour général vers l’acteur, de la redécouverte des théories de l’interactionnisme symbolique et des théories interprétatives, dans un premier
1. Pour une vue d’ensemble, cf. par exemple Djamila SAADI-MOKRANE (dir.), Société
et cultures enfantines, Lille, Université Charles-de-Gaulle Lille III, 2000 ; Collectif, « En-fance et Apprentissage », Terrain (numéro spécial), n° 40, mars 2003 ; Isabelle DANIC, Julie DELALANDE et Patrick RAYOU, Enquêter auprès d’enfants et de jeunes. Objets, mé-thodes et terrains de recherche en sciences sociales, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006 ; Régine SIROTA (dir.), Éléments pour une sociologie de l’enfance, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006.
206 Wilfried LIGNIER
temps, puis rebondit avec la mise en évidence d’une forte désinstitutionnalisation, et la montée des théories de l’individualisme.
2 »
Plus précisément, pour plusieurs chercheurs engagés dans ce qui est sans doute plus une mouvance qu’un véritable courant sociologique, les sciences sociales auraient péché à ne voir l’enfant — lorsqu’elles l’ont vu — que comme un adulte en devenir, qui subit les choix éducatifs faits par sa famille, qui absorbe progressivement la culture du milieu social dans lequel il baigne, et dont les intérêts sont essentiellement à trouver chez les adultes dont il dépend. Contre cette perspective profondément hétéronome, il serait possible de faire valoir, selon eux, une certaine autonomie des en-fants, au moins à deux niveaux. D’une part, chaque enfant serait suscep-tible, dans sa confrontation aux intérêts et aux investissements sociaux des adultes, de négociations, de contournements, de reformulations, d’une lati-tude d’action considérable face aux investissements et aux exigences des
adultes, bref, susceptible d’agir en « acteur ». D’autre part, les enfants, comme collectif, constitueraient un groupe social distinct, capable de faire jouer et de faire valoir des normes propres : une « culture enfantine », sin-gulière et singularisante, serait en effet empiriquement observable, en mi-lieu scolaire (par exemple, dans la cour de récréation), en milieu familial (importance des rapports entre frères et sœurs), et dans la plupart des lieux de l’enfance.
Cette perspective théorique gagne à être interrogée en se décalant un peu, méthodologiquement, des travaux empiriques qui lui sont habituel-lement associés. Ceux-ci, voulant tellement voir l’enfant, ont en effet ten-dance à occulter les enfants, notamment du point de vue de leur qualité de vie matérielle et de leur niveau culturel (la différenciation selon le sexe étant, cependant, régulièrement prise en compte). L’« enfance » de la so-ciologie de l’enfance est souvent générique, et quand la différenciation économique et culturelle est intégrée, c’est plutôt de manière secondaire, comme pour expliquer de simples modulations d’une condition sociale grossièrement partagée (i. e. être un enfant). À la limite, l’idée de « cul-ture enfantine » finirait par justifier l’oubli des distinctions tranchées et des oppositions sensibles dont les enfants eux-mêmes, entre eux, font l’ex-périence quotidienne — tandis que le principe d’une autonomie indivi-duelle des enfants tendrait, à la manière d’un individualisme méthodo-logique miniature, à accorder abusivement à tous une liberté d’action et des dispositions à l’autonomie en vérité très inégalement distribuées. A contrario, il est possible de projeter d’emblée l’enfance dans l’ordinaire sociologique (qui veut que le monde social soit hétérogène et que les en-
2. Régine SIROTA (dir.), op. cit., p. 14.
L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués » 207
fants soient toujours déjà inscrits dans cette hétérogénéité), c’est-à-dire de rejeter l’idée d’autonomie enfantine pour autant qu’elle revienne à l’iso-lement théorique et méthodologique d’une culture ou d’une identité sin-gulière. Il s’agit plus exactement de faire fonctionner la notion suivant son seul intérêt heuristique, autrement dit en troquant la question de principe — quel degré d’autonomie les enfants ont-ils ? — contre une attention aux usages — comment s’exprime l’autonomie dont disposent les enfants ? L’autonomie n’est alors plus une générosité intellectuelle faite à l’enfant ; elle sonne plutôt comme une invitation à s’interroger, ni plus ni moins, sur l’articulation des prérogatives des enfants avec un contexte donné.
I. L’autonomie des enfants « intellectuellement précoces » vue de près
L’enfance dont il est question dans cet article n’est pas abstraite de l’espace social ; c’est une enfance spécifique, celle dans laquelle sont en-gagés les enfants dits communément « surdoués » — et désignés sous le vocable d’enfants « intellectuellement précoces » (IP) par la psychologie clinique. Leur cas est d’autant plus stimulant dans la perspective d’une réflexion sur l’autonomie enfantine que celle-ci ne représente pas seule-ment, en l’occurrence, un enjeu scientifique propre au chercheur : elle constitue aussi un enjeu social, voire un « problème social », localement pertinent. Nombreux sont en effet ceux qui, parmi les observateurs ou parmi les agents de la précocité intellectuelle, s’interrogent sur les « ori-gines » de cette forme radicale d’excellence culturelle en mettant au centre de leur attention (plus ou moins intéressée) la distribution des rôles des uns et des autres : ces enfants extra-ordinaires sont-ils/doivent-ils être « poussés » par leurs parents ? Se font-ils/doivent-ils se faire au contraire tout seuls ? Dans le cas de la précocité intellectuelle, la question de l’au-tonomie est donc rendue d’autant plus impérative (pour le chercheur), qu’elle est sensible (pour tous ceux qui sont engagés dans cet univers, de près ou de loin). D’une certaine manière, le problème de savoir qui pro-duit l’excellence intellectuelle s’impose ici de lui-même — une fois mise à part la discussion également récurrente sur un éventuel donné biolo-gique
3. Rendons ce problème plus explicite. On conçoit sans difficulté que les enfants « surdoués » soient ou doivent être investis dans une forme d’excellence culturelle ; par contre, le sens exact de cet investissement est
3. Laisser de côté, pour la clarté de l’exposition, la dimension biologique associée à la
« précocité intellectuelle », ne signifie pas pour autant qu’elle ne relève pas de l’inves-tigation sociologique. On peut par exemple s’intéresser aux usages sociaux des arguments biologiques.
208 Wilfried LIGNIER
loin d’être clair. Dans l’univers social que recouvre la précocité intellec-tuelle, de qui relève au juste l’investissement dans l’excellence, et dans quelle mesure ? Prendre en charge un problème de ce genre revient, pour résumer, à se demander comment, dans des conditions sociales données qui correspondent en particulier à une place extrêmement forte accordée à une certaine culture, s’exprime l’autonomie d’enfants spécifiques.
Les remarques qui suivent s’appuient sur un travail de terrain mené dans un collège public français proposant une filière spécialisée à des en-fants IP
4. Ces enfants ont été sélectionnés via un test psychométrique col-lectif, passé volontairement à la fin de leur scolarité primaire, qui les a en quelque sorte « labellisés » IP ; ils ont dès lors toutes les chances d’effec-tuer tout le premier cycle de leur scolarité secondaire dans la filière en question (de la 6e à la 3e). La méthode adoptée a consisté en une obser-vation ethnographique de plusieurs mois menée auprès de la classe de 6e IP, fraîchement constituée (voir encadré ci-contre).
Une immersion dans l’univers social de la précocité intellectuelle permet avant tout de se débarrasser d’une certaine vision stéréotypée du « surdoué ». C’est d’abord celle que véhiculent de nombreux médias, en quête d’enfants « hors du commun », et du même coup, souvent hors du social :
« L’enfant surdoué ne se contente pas d’avoir un QI supérieur à 130 ni d’être en avance dans ses performances intellectuelles. Hypersensible, créatif, curieux de tout depuis son plus jeune âge, il est souvent anxieux et solitaire, et montre un décalage criant entre son intelligence et sa maturité affective. Fille ou garçon, issu d’un milieu modeste ou aisé, intellectuel ou non, il présente souvent un profil atypique et des structures de pensée différentes de celles qui prévalent chez les enfants de son âge. D’où, parfois, de réelles difficultés psychologiques et sco-laires. » (« Aider les surdoués », Le Monde, 22 novembre 2005)
4. De tels dispositifs éducatifs réservés explicitement aux enfants intellectuellement
précoces sont pour l’heure relativement rares dans l’enseignement secondaire français. L’Association française pour les enfants précoces (AFEP) en recensait moins de soixante en 2006, dont une douzaine seulement au sein d’établissements publics. L’offre dans le public a manifestement vocation à évoluer, si l’on en croit l’évolution récente des dis-positions ministérielles — dans le sens d’une légitimation de la problématique des enfants précoces (Rapport Delaubier, 2002), et, au-delà, d’un souci affirmé des modes de prise en charge spécifiques (comme en témoigne l’enquête ministérielle interne lancée en 2006 pour recenser les dispositifs existants).
L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués » 209
Une observation participante avec des enfants
Ce n’est qu’en se plaçant au plus près des enfants qu’on conserve une chance de préciser quels investissements sociaux ils produisent, quels sont ceux qu’ils subissent, ou encore quels sont ceux qu’ils relaient. À ce titre, l’observation par-ticipante avec des enfants est une méthode centrale et amplement justifiée du point de vue d’une réflexion sur les usages de l’autonomie enfantine.
S’inspirant de la méthode participante issue de la tradition ethnographique américaine récemment réactivée
5, le principe de collecte du matériel a consisté à jouer le jeu de l’identification aux enfants, en abdiquant toute autorité explicite sur eux, et surtout en se pliant au maximum à l’ordinaire de leur vie scolaire. L’objectif était de pénétrer autant que possible dans l’intimité du groupe de pairs de ces enfants âgés de 9 à 12 ans (suivant le nombre d’années d’avance), ainsi que de saisir dans le détail les enjeux concrètement éprouvés de leur scolarité singulière.
Dans le cas d’une enquête portant sur des enfants, des obstacles institution-nels à l’observation participante existent a priori
6. Lors de mes premiers contacts avec le collège, il m’a fallu expliquer au principal et aux enseignants concernés la place spéciale, dans tous les sens du terme, que j’entendais occuper dans le collège — en justifiant ma démarche par ma volonté de saisir la précocité intel-lectuelle du point de vue des enfants. Peut-être parce qu’elle fait écho à une cer-taine perspective pédagogique (« mettre l’enfant au cœur du système »), ma pro-position a globalement rencontré la bonne volonté du personnel du collège, qui s’est, entre autres, chargé, par divers moyens, de me « faire accepter » auprès des parents d’élèves : il fallait notamment les convaincre que « tout restait sous con-trôle » et que leurs enfants ne courraient aucun risque physique (spectre de la pédophilie) ou moral (la présence d’un observateur pouvant être perçue comme « néfaste » compte tenu des « fragilités » caractéristiques des enfants IP). L’accep-tation auprès des enfants a quant à elle été beaucoup plus rapide. Pour en donner une idée, dès le premier jour et comme pour me « tester », les jeunes enquêtés me priaient instamment de prendre une part active à leurs jeux de cour — invi-tation à « jouer le jeu » que je me devais d’accepter d’emblée. La participation, au gré de cette logique de test, n’a fait qu’augmenter au fil des semaines. Au final, j’ai été amené à suivre les cours avec assiduité, à faire les devoirs de-mandés, à aller en récréation avec les enfants, à manger avec eux au réfectoire, à participer aux exercices sportifs, ou encore à jouer, à chahuter, à bavarder, etc.
5. Gary Alan FINE & Kent L. SANDSTROM, Knowing Children. Participant Observa-tion with Minors, Newbury Park, Sage Publications, 1988 ; Loïc WACQUANT, Corps et Âme. Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur, Marseille, Éditions Agone, 2000.
6. La question des obstacles théoriques est laissée ici de côté.
210 Wilfried LIGNIER
L’observation participante en tant que telle a duré quatre mois, à raison de cinq jours de présence par semaine. Mes observations ont été notées chaque soir, dans un journal de recherche tenu au jour le jour. Par la suite, ce matériel principal a été complété par une première série d’entretiens auprès de plusieurs parents des en-fants rencontrés sur le terrain, ainsi que par la passation d’un ques-tionnaire portant sur la vie scolaire et culturelle de l’ensemble des élèves du collège concerné (tous niveaux, toutes classes confon-dues, en vue de statistiques comparatives). Ce matériel complémen-taire n’est que très marginalement mobilisé dans les développe-ments de cet article ; on peut dès lors assimiler ces derniers à des commentaires ethnographiques.
Il faut aussi se distancier de la vision mythique qu’entretiennent les
nombreux how-to-books (comme disent les anglo-saxons pour désigner les livres parascientifiques visant à « aider » des publics spécifiques), et ce, même lorsqu’ils se proposent, dans leur titre, de faire précisément la part du « mythe » et de la « réalité » concernant les « surdoués » :
« Le mythe du “ don polyvalent ” n’est pas apparu sans raison. Certains enfants correspondent parfaitement à cette image, comme David et Michael, décrits dans ce chapitre. Pour eux, le mythe est une réalité. […] La précocité de David a été remarquée d’abord dans le domaine du langage. À l’âge de huit mois, il mani-festait une excellente compréhension de la langue, avec environ un an d’avance sur la normale. […] À partir de dix-huit mois, David s’est mis à progresser si vite que sa mère a renoncé à noter les phrases qu’il prononçait […]. À cinq ans, David a commencé à s’intéresser au langage en tant que système.
7 »
Les enfants rencontrés dans l’enquête sont apparus dans une spécifi-cité bien moins radicale. D’une part, ce sont des enfants finalement assez « normaux » (par opposition à « pathologiques »), qui ne souffrent pas de graves difficultés en termes de scolarité (résultats nettement au-dessus de la moyenne aux évaluations de 6e) ou en termes de sociabilité (sauf rares exceptions, ces enfants possèdent un réseau amical au sein du collège, par exemple). D’autre part, et peut-être surtout, ils sont socialement situables : ce sont majoritairement des garçons (19 garçons pour 8 filles), et ils sont presque tous issus de familles économiquement et culturellement favori-sées (21 enfants sur 27 ont un père cadre ou ingénieur). Ce dernier constat tient sans doute pour beaucoup à la situation géographique du collège
7. Ellen WINNER, Surdoués. Mythes et réalités, Paris, Aubier, 1997 [1996], p. 26-27.
L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués » 211
(dans la banlieue huppée d’une grande ville française), mais ne s’y réduit pas complètement
8. Observer, écouter, interagir avec des enfants IP in vivo permet de se
forger au fil des jours une représentation moins grossière de ce qu’ils sont, ou, plus précisément, de ce qu’ils font et sont capables de faire, tout comme de ce que leur entourage fait et est capable de faire. Pour autant que les effets de l’activité de recherche sont contrôlés (ce qui ne veut pas dire oubliés), une connaissance pratique de la précocité intellectuelle se fait jour. Elle permet de dépasser les présupposés associés à la mécon-naissance, parmi lesquels celui de la « bête de foire » ou de la « bête à concours » subissant le dressage d’adultes à la fierté ambitieuse. Elle per-met également de s’affranchir des représentations que tendent à imposer de nombreux connaisseurs, parmi lesquelles celle d’un enfant exceptionnel qui surgit sans prévenir dans une famille, obligeant les adultes et les en-fants qu’il y trouve à suivre son rythme et à rester à la hauteur de son po-tentiel.
II. Quand les enfants servent l’excellence intellectuelle
L’autonomie des « surdoués » n’est certainement ni nulle, ni totale. Mais comment la caractériser au plus juste ? On peut commencer fronta-lement, en disséquant, à la recherche des investissements faits respective-ment par des enfants et des adultes, l’excellence intellectuelle en acte : autrement dit, en disséquant une performance.
8. Un effet propre de la précocité intellectuelle est en effet repérable sur ce terrain.
Une étude comparée réalisée par un psychologue dans le collège de l’enquête au début des années 2000 (Pierre VRIGNAUD, « L’identification des surdoués : chimère psychométrique ou réalité psychologique ? », in Alain VOM HOFE, Heidi CHARVIN, Jean-Luc BERNAUD et Dominique GUEDON (éds.), Psychologie différentielle. Recherches et réflexions, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 117-121) relevait déjà une surreprésentation (84 % contre 65,5 %) des PCS 3 (« cadres et professions intellectuelles supérieures ») pour un groupe de 100 enfants IP, par rapport au groupe témoin, constitué par 211 élèves des filières normales du collège. Notre propre enquête par questionnaire (réalisée en 2006), comparant, parmi les répondants, les élèves IP (n = 60) et les autres (n = 396), a confirmé cette différence d’origine sociale repérée par la profession du père (78 % contre 63 % de PCS 3), en notant qu’elle était toutefois moins marquée que l’inégalité suivant le niveau de diplôme du père : parmi les répondants, 88 % des élèves IP avaient un père ayant au moins un niveau bac+4, contre « seulement » 58 % des non-IP.
212 Wilfried LIGNIER
Analyse d’une performance significative
Dès les premières semaines de l’enquête, les performances de Nathan se sont imposées comme les plus exceptionnelles
9. L’épisode relaté ci-dessous a été provoqué par mes questions, suite à un incident en classe. Nathan, rappelé à l’ordre par l’enseignant pour ses bavardages, s’était défendu en arguant que son voisin de derrière n’arrêtait pas de lui poser des questions absurdes, notamment sur « la superficie exacte du Kazakhs-tan »… À cet instant, je pensais qu’il subissait là l’ironie d’un enfant excédé par son assurance ; j’avais manifestement tort :
En salle de permanence, les choses m’apparaîtront comme plus com-plexes (…). Nathan a chez lui un jeu de cartes sur les différents pays du monde, et il s’est mis en tête d’apprendre, tout seul (il n’a pas de frères et sœurs), d’abord les drapeaux (il se dit incollable) puis les superficies de chaque pays du monde. « En fait je fais un concours entre les pays » m’explique-t-il, c’est-à-dire qu’il cherche à savoir quel est le pays le plus petit et quel est le plus grand. À ce moment précis, j’ai droit à un test de ses connaissances lancé par ses camarades (…) : on lui demande tout, dans tous les sens, et lui cite les superficies des pays les plus divers, les plus petits, les plus méconnus, au chiffre près, et avec la référence de la mesure statistique (ex. : « Monaco, tant de km2, selon les chiffres de 1999 »). (Extrait du journal de terrain)
Il est possible de lire cet épisode comme un moment où est implici-tement dévoilée toute une série d’investissements habituellement masqués par le caractère « éblouissant » de la performance. Qui fait l’excellence géographique de Nathan ? Premièrement, il faut noter qu’elle a été rendue possible par la possession d’un jeu particulier, le jeu de cartes sur les pays du monde. Ce jeu a été acheté à Nathan par ses parents, parce qu’il prend sens à leurs yeux, parce qu’ils le trouvent « intéressant
10 ». Du côté de la disponibilité d’une certaine « culture matérielle
11 », de type éducatif, il faut percevoir l’investissement des parents dans une forme d’excellence culturelle. Deuxièmement, on peut noter que l’excellence géographique n’apparaît pas sans prendre sens également dans la sociabilité enfantine de Nathan. Bien au contraire, c’est parce que ses camarades le « cher-chent » sur la question — depuis les questions désobligeantes en classe
9. Tous les prénoms des enquêtés ont été modifiés. 10. Sur les diverses manières d’envisager l’intérêt parental pour un support destiné
aux enfants, cf. le travail incontournable de Jean-Claude CHAMBOREDON et Jean-Louis FABIANI, « Les albums pour enfants. Le champ de l’édition et les définitions sociales de l’enfance », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol. 14, avril 1977, sur les albums pour enfants.
11. Marie-Pierre JULIEN et Céline ROSSELIN, La culture matérielle, Paris, La Décou-verte, coll. « Repères », 2005.
L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués » 213
jusqu’au concours improvisé en salle de permanence — qu’elle peut exis-ter. Le groupe de pairs semble lui aussi, à sa manière, « intéressé » par la performance de Nathan : plusieurs élèves sont disposés à s’investir (en temps, en énergie) dans des jeux qui l’entretiennent et l’exhibent, visible-ment pour leur plus grand plaisir. Enfin, troisièmement, Nathan lui-même donne à voir ses investissements, lorsqu’il explicite les apprentissages sous-jacents à sa performance. Il lui a fallu non seulement du temps mais de la discipline et de la méthode. Il a commencé par les drapeaux (des images) puis il est passé aux superficies et aux dates (des nombres). Par ailleurs, il s’est investi en inventant « tout seul » une manière ludique d’accumuler la connaissance géographique (« je fais un concours entre les pays »).
Le repérage un peu sec des investissements des uns et des autres ne constitue pas en soi une explication de l’excellence géographique de Na-than. Il a cependant un intérêt tout à fait notable : il oblige à constater que, en matière d’excellence intellectuelle, poser le problème des investisse-ments sociaux en isolant certains types d’investissement de certains autres n’est pas pertinent. En pratique, chacun semble y « mettre du sien ». Les investissements des parents, du groupe de pairs, et des enfants se font sans réelle solution de continuité. Les parents de Nathan lui achètent un jeu qui rencontre sa bonne volonté ; Nathan veut apprendre la géographie et dispose d’opportunités de s’entraîner et de s’évaluer avec les cartes de ses parents et le concours (dans les deux sens du terme) de ses camarades ; les camarades de Nathan l’entraînent, enfin, dans un jeu auquel il se prête volontiers (il n’y trouve pas de la moquerie mais une occasion de briller). La culture des pairs et les intérêts exprimés par les enfants peuvent donc certes être distingués comme des niveaux d’analyse pertinents, dans ce cas précis, cela ne signifie pas qu’ils doivent être séparés du contexte social, et en particulier des intérêts et des investissements des adultes. Les enfants font bien certaines choses en propre — mais, parmi ces choses, se comptent peut-être avant tout les conditions nécessaires pour que les inves-tissements des adultes s’incarnent pratiquement.
Les relais enfantins d’une économie intensive de la culture
Si les investissements dans l’excellence intellectuelle des parents et des enfants (comme groupe et comme agents individuels) apparaissent au moins ponctuellement appareillés, a-t-on des éléments pour aller plus loin et formuler l’hypothèse que la précocité intellectuelle repose socialement sur le maintien d’un système spécial et relativement cohérent d’investis-sements parentaux et enfantins ? Les rares études sociales disponibles sur
214 Wilfried LIGNIER
la précocité intellectuelle 12
s’accordent pour en parler comme d’un régime culturel particulièrement exigeant, où tout est occasion à éducation, et où règne symétriquement une certaine crainte de l’improductivité culturelle, à l’école (« végéter » dans une classe de niveau moyen, avec des ensei-gnants qui n’en demandent pas assez) ou à la maison (spectre de la pa-resse). La question à poser à ce niveau est similaire à celle posée à propos d’une performance spécifique : comment les enfants participent-ils à l’éco-nomie de la culture intensive que recouvre la précocité intellectuelle ? Ou encore, dit différemment : dans quelle mesure l’usage qu’ils font de leur autonomie est-il cohérent avec un régime si exigeant ?
Dans les entretiens réalisés avec les parents, l’attention particulière à la « stimulation » perpétuelle de l’enfant, tout comme la crainte qu’il ait été amené à une époque ou qu’il soit amené aujourd’hui à « perdre » son « niveau » intellectuel revient en permanence. Faut-il pour autant parler d’une pression univoque des parents ? Sur le terrain, certaines manières de faire et certains propos des enfants laissent en réalité penser qu’ils sont les relais actifs, personnellement et collectivement, des désirs et des craintes de leurs parents. Ainsi de l’interaction, saisie sur le vif, entre ces deux en-fants parlant lecture dans la cour de récréation :
Damien : Tu lis quoi toi en ce moment, Charles ? Charles (bas et hésitant) : Bah, en ce moment… en ce moment, c’est plutôt
des BD… Damien : Non mais, je veux dire, tu lis quoi comme livre ? Charles : Euh… Damien (interprétant le silence de Charles, dans ma direction) : Charles il est
au chômage en ce moment ! (Extrait du journal de terrain)
Un sens aigu de la légitimité culturelle (une BD n’est pas un vrai livre) ainsi que de la responsabilité éducative de chaque enfant (« il est au chô-mage en ce moment ») s’exprime ici chez Damien. Ce dernier ne se con-tente pas de l’exprimer, il l’impose par son ton moqueur à son camarade qui ne proteste pas. Le groupe de pairs relaie tout à fait ici les exigences de l’économie culturelle d’excellence propre à la précocité intellectuelle — ce constat local contrastant avec certains constats globaux sur la lec-ture des adolescents en général, qui feraient plutôt ressortir que « le groupe de pairs et les valeurs de sociabilité l’emportent sur la lecture
13 ».
12. Cf. par exemple Joan FREEMAN, Gifted Children. Their identification and Deve-
lopment in a Social Context, Baltimore, University Park Press, 1979 ; Dewey CORNELL, Families of Gifted Children, Anna Arbor, UMI Research Press, 1984.
13. Christine DETREZ, « Du côté des lecteurs et des pratiques de lecture », in Jean-Yves MOLLIER et al., Où va le livre ? Édition 2002-2003, Paris, La Dispute, 2002, p. 215-229, p. 219.
L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués » 215
Avec les enfants IP, au fil d’échanges entre pairs, chacun est en fait for-tement invité à demeurer, du point de vue de son « métier de lecteur », dans des bornes raisonnables, qui ne l’éloignent pas trop d’un standard idéalement très élevé.
Le groupe enfantin, loin de générer des pratiques tendant à une sorte de sécession sociale, produirait plutôt une émulation tout à fait cohérente avec, sinon nécessaire à la dynamique générale de l’enfance intellectuel-lement précoce. Pour le montrer davantage, un autre exemple peut être pris, celui des concours parascolaires. Lors de l’enquête, les enfants ont eu l’occasion de participer, entre autres, à deux concours parascolaires de mathématiques d’envergure nationale. Ces concours entretiennent des liens évidents, quoique tacites, avec la précocité intellectuelle. Premièrement, ils constituent, dans leur principe, non seulement une mise en jeu de l’intelligence, une « sollicitation des capacités de réflexion » (concours Intégral), mais surtout une possibilité de s’évaluer au-delà des critères scolaires, grâce à la dimension nationale « qui permet aux meilleurs de se mesurer et de se comparer avec tous les autres » (concours Kangourou des mathématiques)
14. Deuxièmement, dans leur forme même, ces concours ne sont pas sans rappeler les tests psychométriques en général, et en par-ticulier la partie « logique » du test factoriel passé par chaque enfant IP pour entrer dans la section spécialisée
15. D’une part, il s’agit dans les deux cas de questionnaires à choix multiples, donnant lieu à un score et à un classement, et, d’autre part, certaines questions posées lors des con-cours ont une forme très similaire aux items du test annuel de sélection. En un certain sens, les concours parascolaires sont donc une institution et un moment qui permettent à la précocité intellectuelle de se rejouer et/ou de s’exhiber (les enfants des sections IP arrivant régulièrement bien clas-sés, au niveau du collège, voire au niveau national). Pour ce qui nous intéresse ici, il faut remarquer le rôle déterminant des enfants dans la constitution d’un enjeu fort autour de ces concours. Bien qu’ils puissent ressentir négativement l’enchaînement des concours au fil des mois et des années, les enfants IP entretiennent pratiquement le principe d’une asso-ciation entre identité « intelligente » et participation à ce genre d’activité, comme on le voit très bien dans cet épisode :
14. Citations extraites respectivement des sites Internet du concours Intégral (www.
concours-integral.org) et du concours Kangourou des mathématiques (www.mathkang. org).
15. Sur les spécificités des divers tests psychométriques, se rapporter à l’ouvrage de synthèse de Michel HUTEAU et Jacques LAUTREY, Les tests d’intelligence, Paris, La Dé-couverte, coll. « Repères », 1997.
216 Wilfried LIGNIER
Au début de l’heure il est question du concours Kangourou (qui a lieu demain) et du même coup des résultats du concours Intégral, que les enfants ne sont pas parvenus à obtenir. On parle des lots à gagner, sur quoi Zoé explique que tous auront un lot : elle le sait bien, elle qui « [a] fait le concours Kangourou chaque année depuis le CP jusqu’au CM2 » (…) Mon voisin de devant, Luc, confie que, s’il fait cette année les divers con-cours (Intégral, Big Challenge, Kangourou), il a la ferme intention de ne s’inscrire à rien l’année prochaine. Pourquoi alors persister dans des con-cours perçus éventuellement comme pesants, ou simplement « lourdin-gues » ? Une interaction qui suit immédiatement, entre le même Luc et Eva, ma voisine, répond peut-être d’elle-même à cette question (…) :
Luc : Tu le fais toi le concours Kangourou ? Eva : Non. Luc (plaisantant à demi) : Ah ! T’es bête ! (Extrait du journal de terrain)
La fin du passage est éloquente, et permet en quelque sorte de l’expli-quer. Si Zoé a une carrière déjà longue en matière de concours de ma-thématiques, et si Luc se prête au jeu cette année encore (qu’en sera-t-il l’année suivante ?) alors qu’il en a visiblement assez, cela tient sans doute au fait que qui ne fait pas le concours, qui ne « joue pas le jeu » de l’excel-lence intellectuelle est susceptible d’être dégradé symboliquement (« T’es bête ! »). Une fois encore, l’autonomie des enfants est manifeste, puis-qu’ils ont bien entendu la « liberté » de s’inscrire ou non au concours, et de s’y investir plus ou moins fortement ; reste que son usage semble tout à fait déterminé par les exigences locales d’excellence. Luc, qui évoque pourtant pour lui-même la possibilité d’user de son autonomie dans un sens contredisant l’impératif d’excellence, est aussi celui qui fait exister cet impératif dans son interaction avec Eva, illustrant comment une cer-taine dynamique de l’entre-enfants peut faire office de « force de rappel » au bon usage de l’autonomie : maintenir son rang d’IP oblige à investir des institutions au-delà de l’école, comme celles des concours.
III. Le « bon sens » des enfants IP : la culture enfantine sous contrôle
À travers l’exemple de la lecture et des concours de mathématiques, on voit que les enfants IP sont amenés à soutenir des investissements légitimes, ou en tout état de cause, cohérents avec le type d’excellence associé à la précocité intellectuelle. On peut aller un peu plus loin en insistant sur des comportements enfantins qui montrent que le soutien peut se faire maintien, qui prouverait autrement dit que les enfants vont jusqu’à perpétuer l’excellence malgré des forces intimes ou des tendances collec-tives qui ne vont pas nécessairement dans le « bon sens ».
L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués » 217
Une présentation de soi symboliquement orientée
Noter que les jeunes enquêtés sont à la hauteur de leur labellisation, en insistant uniquement sur le niveau de leurs investissements culturels au sens large, revient à manquer tout ce que celui-ci doit à des efforts spéci-fiques. Ce sont notamment des efforts de présentation « culturelle » de soi. À l’occasion d’une pause dans l’emploi du temps, j’ai pu inviter Nathan à se présenter culturellement, en l’interrogeant sur ses lectures :
WL : Est ce que tu lis beaucoup, toi ? Nathan : Enormément. Je lis énormément. WL : Et qu’est-ce que tu lis, des romans, des… ? Nathan : Je lis des romans ; j’ai lu [il prend une feuille sur laquelle il inscrit
les titres en même temps qu’il les prononce] Le Loup bleu, de Yasushi Inoué, Vingt mille lieues sous les mers, de Jules Verne (il écrit « milles » mais inscrit par contre le nom de l’auteur en lettres capitales).
WL : Et tu lis d’autres livres à part les romans, des livres de science, de… ? Nathan : Oui, mais surtout des romans, les romans c’est les meilleurs livres,
c’est les plus gros, alors y a beaucoup plus de chances que ce qu’il y a dedans soit intéressant. (Extrait du journal de terrain)
J’avais, à l’origine, retenu cet échange parce qu’il signalait pour moi une logique typique de productivisme culturel endossé par un enfant (« y a beaucoup plus de chances que ce qu’il y a dedans soit intéressant »). Mais par la suite, il a pris un sens encore différent, sur lequel il faut in-sister ici. J’ai eu l’occasion d’apprendre, vers la fin de l’enquête, que Na-than était un inconditionnel d’Harry Potter, c’est-à-dire d’une œuvre bien moins légitime que celles citées précédemment (cette information, rap-portée par des camarades, se fondait sur un anniversaire qui avait eu lieu chez Nathan, et où il avait été largement question du célèbre enfant-sorcier). Nathan n’a pas cru bon, ni dans l’épisode relaté, ni plus tard, d’évoquer avec moi ce goût profond pour Harry Potter. À propos de cet échange, il est plausible de parler, par conséquent, d’un effort de pré-sentation excellente de soi. Cette hypothèse semble crédible, compte tenu de certains détails dans la manière de faire de Nathan, notamment son uti-lisation passablement étrange de l’écrit dans une interaction en face-à-face. Nathan aurait-il pris le même soin à noter très consciencieusement les noms d’ouvrages sur une feuille, s’il s’était agi d’inscrire Harry Pot-ter ?
Maintenir la précocité intellectuelle signifie pour les enfants (peut-être avant toute considération sur le niveau effectif des pratiques) avoir au moins le souci de la préserver virtuellement. Bernard Zarca a pu montrer, à partir d’une étude sur des enfants plus jeunes, que le « sens social » des enfants est très tôt en place, et il en voulait pour preuve leur capacité à
218 Wilfried LIGNIER
ordonner différents métiers hiérarchiquement 16. On peut probablement
parler, à propos des enfants IP, d’un sens social aigu de la (d’une certaine) légitimité culturelle, dont témoignerait la capacité de certains à sélection-ner les « bons » investissements, lorsqu’ils sont questionnés sur leurs pra-tiques culturelles ou, plus exactement, lorsqu’ils sentent qu’est en jeu leur identité intellectuelle
17. Il est à noter que le « bon sens » de Nathan, à savoir sa dissimulation
effective de certaines lectures, touche à une consommation souvent consi-dérée comme emblématique d’une certaine « culture enfantine » — parce que « tous les enfants lisent Harry Potter »… On comprend donc qu’in-sister sur l’usage socialement cohérent de l’autonomie enfantine ne revient pas forcément à nier l’existence de pratiques enfantines relativement géné-ralisées, mais plutôt à constater que de telles pratiques, si elles existent, font de toute façon forcément l’objet de reprises et d’intégrations locales, par les enfants eux-mêmes. Ceux-ci savent les ordonner dans le « bon sens », et au besoin les mettre à distance. La place laissée par les enfants, dans des domaines et à des moments stratégiques, à la culture enfantine dépend ainsi lourdement des enjeux qu’impose une situation sociale singu-lière. Dit grossièrement, parce qu’Harry Potter ne « fait pas surdoué », il cède le pas à Jules Verne.
Une telle logique est d’autant plus sensible qu’elle n’est pas seulement à l’œuvre virtuellement, mais aussi de façon plus concrète, lorsqu’il s’agit de mettre à distance non pas des préférences, mais des pratiques effectives.
L’autocontrôle enfantin des « mauvaises » pratiques : le cas des jeux vidéo
En effet, au-delà des présentations que les enfants IP peuvent faire d’eux-mêmes, des comportements davantage objectivables témoignent d’un usage de l’autonomie enfantine qui sait, en dépit de tensions intimes nettes, se faire tout à fait cohérente vis-à-vis des investissements parentaux. Les pratiques enfantines qui menacent l’harmonie relative des pratiques qu’implique idéalement la dynamique locale d’excellence intellectuelle peuvent ainsi donner lieu à un autocontrôle, voire à une autocensure.
16. Bernard ZARCA, « Le sens social des enfants », Sociétés contemporaines, 1999,
n° 36, p. 67-101. 17. Ce qui est tendanciellement le cas face à un sociologue explicitement présent par
intérêt pour la précocité intellectuelle. De plus, l’échange cité avec Nathan a lieu au début de l’enquête, soit à un moment où le temps, facteur manifeste d’euphémisation de la position d’enquêteur, n’a pas fait son œuvre.
L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués » 219
Un exemple pertinent est celui des jeux vidéo. Les jeunes enquêtés, essentiellement des garçons, m’ont dès le premier jour parlé de jeux vidéo, m’expliquant en détail les tenants et les aboutissants de tel ou tel titre, me donnant à voir l’excitation que ceux-ci suscitaient chez eux ; ils en par-laient aussi énormément entre eux, dans un jargon élaboré. Là encore, les jeux vidéo sont un élément souvent évoqué de la culture enfantine « mo-derne », qui a été retrouvé sur le terrain comme une composante impor-tante de la culture de pairs. Mais il se trouve que dans le corpus des pra-tiques culturelles d’excellence, autrement dit du point de vue des normes sociales en vigueur localement, ces jeux n’ont guère droit de cité. Ils représentent plutôt le risque d’un investissement culturel à la fois lourd et improductif, incohérent du point de vue des autres investissements faits à l’école ou en famille. Lors de deux entretiens différents, où les parents n’évoquaient pas ou seulement à demi-mot les jeux vidéo lorsque je po-sais la question des activités et des goûts culturels de leurs enfants, les enfants en question étaient pourtant justement en train de jouer dans une pièce attenante (ce qu’ils se sont d’ailleurs vu gentiment reprocher devant moi, une fois les entretiens terminés). Une mère a pu me confier, lors d’un autre entretien, qu’elle ne voulait « pas de ça chez elle ». Plusieurs enfants ont eu l’occasion de me détailler les mesures de limitation prises dans leur famille à l’égard de la console de jeux ou de l’ordinateur
18. Est-ce à dire que la mise aux normes des pratiques enfantines est de
nature totalement externe (parentale) ? Plusieurs éléments laissent penser que non. D’une part, les enfants sont amenés à se reprocher entre eux une pratique relativement trop importante, sur le mode : « De toute façon, Un-tel, à part les jeux vidéo… » :
À la fin du repas, alors que Thibault et Léonce sont partis, Damien me dit quelque chose de significatif à propos de Thibault, bien que sur le ton de la plaisanterie : « Thibault, ce que j’aime bien chez lui, c’est qu’il a une PS2 [console de jeux vidéo Playstation 2] […] C’est qu’il est fort en jeux vidéo. Bon, le dernier livre qu’il a lu c’est Oui-Oui [titre-phare de la bi-bliothèque rose], mais bon ! ” » (Extrait du journal de terrain)
Le groupe de pairs garantit donc un certain ordre des choses en ma-tière d’excellence intellectuelle, en effectuant une forme de régulation
18. Contrairement à une idée répandue, la pratique des jeux vidéo n’est en fait pas
nécessairement corrélée à une faiblesse des autres investissements culturels — comme il a pu être montré pour la lecture (Christian BAUDELOT, Marie CARTIER et Christine DETREZ, Et pourtant ils lisent…, Paris, Seuil, coll. « L’Épreuve des faits », 1999, p. 61). L’inquié-tude et les interdictions des parents, qui semblent sanctionner le médium en tant que tel, gagnent sans doute à être comprises comme des avertissements et des précautions symbo-liques, relatives à des contenus illégitimes.
220 Wilfried LIGNIER
symbolique (trop jouer est stigmatisant, parce que cette pratique est per-çue comme anti-culturelle, « anti-excellente »). D’autre part, tout se passe comme si les enfants avaient une idée si claire des risques qu’ils prennent eux-mêmes à s’investir en quelque sorte « à perte », qu’ils sont disposés à reconnaître comme judicieux les interdits parentaux, voire disposés à mettre en œuvre eux-mêmes des interdits. Émeric trouve la décision de sa mère de « laisser [sa] Game Boy chez [sa] grand-mère » sévère — mais juste. Plus tranchée encore est l’attitude de François, qui s’exprime en ces termes :
« Les jeux vidéo, c’est une drogue, c’est comme une drogue, tu fais que ça, que ça. Moi, au bout d’un moment, je faisais que ça, j’ai pris une décision radi-cale : j’y joue plus du tout. » (Extrait du journal de terrain)
Ici, manifestement, une menace sur l’économie culturelle intensive est à la fois perçue, reconnue et même activement contrecarrée. Un usage fort de l’autonomie enfantine se donne donc à voir avec le cas de François : l’impératif d’investir dans le « bon sens » (par rapport au contexte) s’im-pose si intimement et si puissamment qu’il suscite une ascèse « radicale », dont on peut imaginer qu’elle n’a pas été des plus simple à assumer…
IV. Conclusion
La précocité intellectuelle n’est l’affaire exclusive ni de parents qui ne cesseraient de « pousser » leurs enfants, ni, symétriquement, d’enfants nés tout armés d’intelligence, avant de se voir projetés dans l’interdépendance et la différenciation sociale… Il est préférable de se représenter une com-binaison relativement heureuse des pratiques des uns et des autres si l’on cherche à préciser la dynamique de socialisation propre à la précocité in-tellectuelle. Ce cadre général ne fait pas des enfants IP des « idiots cul-turels », bien au contraire. Ce sont des enfants culturellement actifs que donne à voir une enquête qualitative, des enfants qui sont régulièrement amenés à soutenir et à maintenir leur excellence intellectuelle, en personne ou collectivement, en principe ou dans les faits. L’autonomie des enfants IP est, dans ces conditions, loin de les décontextualiser. Une attention aux usages de l’autonomie montre qu’elle demeure en relation avec une éco-nomie culturelle spécifique, qui imprime sa marque sur l’activité des en-fants, non en lui conférant une orientation obsessionnelle et univoque, mais plutôt en donnant lieu, en des moments et des espaces stratégiques, à des comportements tout à fait adaptés au style culturel localement en vigueur. Les enfants IP ne sont pas constamment en train de faire leur « intelligence », mais lorsqu’ils perçoivent, plus ou moins confusément, que celle-ci est en jeu, ou en danger, ils savent se présenter, se contrôler
L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués » 221
ou se censurer dans le « bon sens »… Ainsi, la précocité intellectuelle ne se fait pas en dépit de l’autonomie des enfants, elle se fait plutôt avec et par elle, dans une économie culturellement intensive soutenue objective-ment et subjectivement par tous — l’effort de cohérence allant jusqu’à la normalisation, par les enfants eux-mêmes, des pratiques culturelles « indé-sirables ».
Ce qui vaut pour l’enfance intellectuellement précoce vaut-il aussi pour l’enfance tout court ? Bien entendu, sur le fond, les enfants IP sont très spécifiques, et, par exemple, le contenu et l’orientation de leurs pratiques culturelles les distinguent à bien des égards d’autres enfants. Par contre, la logique contextuelle à l’œuvre dans les attitudes de ces enfants particu-liers, telle qu’elle peut être recueillie dans nombre d’observations ethno-graphiques, gagne probablement à être envisagée comme une propriété très générale de l’autonomie enfantine. Dans une enfance conçue non comme un âge de la vie (avec son identité, sa culture propre) mais comme un ensemble de pratiques — faisant plus ou moins système, mais engageant surtout simultanément des adultes et des enfants — la caractérisation pré-cise des usages locaux de l’autonomie enfantine serait alors un objectif important pour l’approche sociale de l’enfance en tant que telle. En spéci-fiant le sens plutôt que le degré des prérogatives enfantines, c’est un style de vie enfantin qu’on chercherait alors à définir, non un statut générique
de l’enfant. Autant dire que l’émergence d’une telle approche dépend d’abord de l’adoption de certaines dispositions théoriques en matière de sociologie de l’enfance. On peut, à ce titre et pour conclure, rappeler avec Louis Pinto, un certain sens des priorités pour la discipline :
« Le sociologue travaille avec objectif prioritaire, non pas de venir en aide à une théorie de la liberté grâce à des moyens propres, mais de rendre compte des régularités observables qu’il a pu mettre en évidence par des opérations de cons-truction d’objet.
19 »
CSPRP - Université Paris 7 CMH-ETT-ENS-EHESS-CNRS
19. Louis PINTO, « Ne pas multiplier les individus inutilement », Interrogations. Re-
vue pluridisciplinaire en sciences de l’homme et de la société, 2006, n° 2, en ligne à l’adresse internet http://www.revue-interrogations.org.
![Page 1: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: L’autonomie enfantine à l’épreuve des « surdoués ». Contribution ethnographique à une approche sociale de l’ enfance [article dans L'homme et la société, 2007]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013007/631c4868d5372c006e045c90/html5/thumbnails/17.jpg)