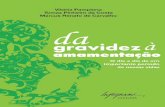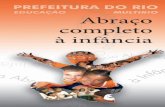“Héraklès à Herculanum”
Transcript of “Héraklès à Herculanum”
.
* Cet article est une version révisée et augmentée d’une conférence présentéeen 1992 aux Universités de Lausanne et Fribourg. Je remercie L. Kahil, C. Bérard,P. G. Capietti, C. Castelletti, A. Coralini, J.-R. Gisler, M. et K. Korrés, M. Torellipour leur aide et leurs suggestions. Je remercie tout particulièrement Jean-RobertGisler d’avoir bien voulu traduire mon texte en français.
1 Maiuri 1958; U. Pappalardo, Ercolano, dans EAA, suppl. 2 (1994), p. 484-489;U. Pappalardo, Ercolano. Scavi e ricerche nell’ultimo trentennio (con bibliografia dal1970 al 1998), dans OpPomp, 8, 1998, p. 1-35, fig. 7, pl. 3.
2 Sisenna 4, fr. 53 : «oppidum tumulo in excelso loco propter mare, parvis moe-nibus, inter duos fluvios infra Vesuvium conlocatum».
3 U. Pappalardo, L’eruzione pliniana del Vesuvio nel 79 d.C. : Ercolano, dansC. Albore Livadie et F. Widemann (éd.), Volcanology and archaeology, dans Pact, 25,Strasbourg, 1990, p. 197-215.
4 G. Pugliese Carratelli, Sulle origini di Ercolano, dans PP, 10, 1955, p. 417-422.5 V. Tran Tam Tinh, À la recherche d’Herculanum préromaine, dans CronPo
UMBERTO PAPPALARDO
LE MYTHE D’HÉRACLÈS À HERCULANUM *
Voici le mont Vésuve...ce lieu était fameux par le nom d’Hercule
Tout a sombré dans les flammes :Une lugubre cendre couvre le sol...
Martial, ép IV, 44(trad. H. J. Izaac, éd. Les belles lettres, Paris 1930)
À Karl Schefold, in memoriam
Si l’on en croit l’historien Sisenna du premier siècle av. J.-C., Hercula-num1 fut construite à proximité du Vésuve (distant de 7 km) comme «unepetite cité fortifiée dotée de murailles modestes, sur un promontoire domi-nant la mer et situé entre deux torrents»2. De la ville détruite par l’éruptiondu Vésuve en 79 ap. J.-C.3, nous connaissons assez bien le développementurbanistique et architectural. En revanche, nous ne connaissons que peude choses sur son origine4. Des sondages stratigraphiques effectués parTran Tam Tinh dans la casa dei Cervi nous ont livré des fragments de céra-mique dont les plus anciens remontent pas au-delà du IVe siècle av. J.-C.5.
926 UMBERTO PAPPALARDO
.
3, 1977, p. 40-56; V. Tran Tam Tinh, La casa dei Cervi à Herculanum, Rome, 1988(recension : A. Martin, dans ArchCl, 47, 1995, p. 367-369).
6 La cité semble être mentionnée pour la première fois à la fin du IVe siècle av.J.-C. par Théophraste (371-287 av. J.-C.). Elle y apparaît sous le nom d’Hérakléia(Théophraste, De historia plantarum, IX 16, 6). Toutefois, cette première mention estencore discutée. Pour la liste exhaustive des sources : L. García y García, Nova Biblio-theca Pompeiana. 250 anni di bibliografia archeologica, vol. 1, Rome, 1998 (Mono-grafie della Soprintendenza archeologica di Pompei, 14), p. 29-59.
7 A. Maiuri, Ercolano, Rome, 1970 (Itinerari dei musei, gallerie e monumenti d’I-talia, 53), en particulier p. 6. On pourrait donc également penser, pour Herculanum,à une fondation de Cumes s’il l’on tient compte du fait que le territoire de Cumes etdes Champs Phlégréens était considéré par Strabon (V 4, 6) comme l’endroit où s’é-tait déroulé le combat des Dieux contre les Géants et que les habitants de Cumesavaient à l’époque du tyran Aristodème une considération particulière pour Héra-clès : A. Mele, Aristodemo, Cuma e il Lazio, dans M. Cristofani (éd.), Etruria e Lazioarcaico, Rome, 1987, p. 155-177, en particulier p. 166.
8 Denys d’Halicarnasse, Antiquitates Romanae I 44, 1 (trad.V. Fromentin, éd.CUF, Paris, 1998) : «“�Hraklhv... polı¥xnhn eßpw¥ nymon ayΩtoy ktı¥sav, e¶nua oΩ sto¥lovayßt√ eßnaylo¥xei, h© kaıù nyn yΩpoù �Rwmaı¥wn oıßkoyme¥nh Ne¥av Po¥lewv kaıù Pomphı¥av eßnme¥sw∞ keıtai lime¥nav eßv pantıù kair√ bebaı¥oyv e¥xoysa ...»; cf. M. P. Martin, Héraclès enItalie d’après Denys d’Halicarnasse : I, 34-44, dans Athenaeum, 50, 1972, p. 252-275.
9 Sur Héraclès : J. Boardman et al., Herakles, dans LIMC, 5, 1990, p. 5-16.Sur l’utilisation politique du mythe d’Héraclès en Grèce : J. Boardman, Herakles,
Peisistratos and sons, dans RA, 1972, p. 52-72; J. Boardman, Herakles, Peisistratos
Les témoignages historiques6 et archéologiques nous inciteraient à pla-cer la fondation de la ville au IVe siècle av. J.-C. Cette datation s’accordebien avec celle de la naissance de la cité voisine de Naples, fondée par lesgens de Cumes vers 470 av. J.-C., mais il serait également possible d’imagi-ner pour Herculanum – ou pour ce promontoire élevé sur la mer et placéau centre du golfe de Naples – un établissement antérieur, placé sous lecontrôle des Grecs de Cumes qui, en 474, avec les Syracusains, ont battules Étrusques dans une bataille navale7.
Denys d’Halicarnasse au Ier siècle av. J.-C. rapporte que Herculanumavait été fondée par Héraclès, lequel serait arrivé sur les côtes de la Campa-nie au retour de son fameux voyage en Ibérie où il avait pris au géant Gé-ryon les troupeaux du soleil : «Héraclès... fonda une petite ville à son nom,là où sa flotte était au mouillage : cette ville, aujourd’hui encore habitéepar les Romains et située à mi-chemin entre Naples et Pompéi, possède desmouillages sûrs par tous les temps»8. Un tel récit signifie – au-delà dumythe – qu’il y avait là une cité qui se considérait comme grecque de nomet d’origine.
Les représentations d’Héraclès et de ses exploits ont eu beaucoup desuccès à Herculanum, comme dans tout le reste du monde grec et romain9.
927LE MYTHE D’HÉRACLÈS À HERCULANUM
.
and Eleusis, dans JHS, 95, 1975, p. 1-12; J. Boardman, Eracle, Teseo e le Amazzoni,dans E. La Rocca (éd.), L’esperimento della perfezione. Arte e società nell’Atene di Peri-cle, Milan, 1988, p. 196-233.
Sur l’utilisation politique du mythe d’Héraclès en Grande Grèce : L. Lacroix, Hé-raclès héros voyageur et civilisateur, in BAB, s. 5, 60, 1974, 1, p. 34 s.; A. Mele, op. cit.(supra note 7) p. 155-177, en particulier p. 166 (sur l’identification d’Aristodème avecl’Héraclès grec participant à la lutte contre les Géants = Etrusques); N. ValenzaMele, Eracle euboico a Cuma. La Gigantomachia e la Via Heraclea, dans Recherchessur les cultes grecs et l’Occident, vol. 1, Naples, 1979, p. 19-51. Sur l’utilisation poli-tique du mythe d’Héraclès dans le monde romain : J. Bayet, Les origines de l’Herculeromain, Paris, 1926; M. de Vos, Eracle e Priamo. Trasmissione di potere : mitologia edideologia imperiale, dans A. Mastrocinque (éd.), Ercole in Occidente, dans Labirinti,2, 1990, p. 81-90; S. Ritter, Herkules in der Kultur der späten Republik und der frühenKaiserzeit, Heidelberg, 1995; ou encore Stefan Ritter, Herkules in der römischenKunst von den Anfängen bis Augustus, Heidelberg, 1995.
Sur l’utilisation du mythe d’Héraclès dans la région du Vésuve : en généralA. Coralini, Hercules Domesticus a Pompei : la pittura parietale. Dati quantitativi,dans Actes du VIIe Colloque AIPMA, St. Romain en Gale 5.10.X.1998 (à paraître) etHercules domesticus. Immagini di Ercole nelle case della regione vesuviana (I secoloa.C.-79 d.C.), Naples, 2001.
Pompéi, casa dell’Ara Massima, culte privé d’Hercule attesté sur une peinturereprésentant «Héraclès au grand autel» (fouille de 1903) : A. Sogliano, NSc, 1908,p. 63 s.; A. Maiuri, dans Pompeiana. Raccolta di studi per il secondo centenario degliscavi di Pompei, Naples, 1950, p. 18-19; K. Stemmer, Casa dell’Ara Massima (Häuserin Pompei, 6), Munich, 1992.
Pompéi, pago marittimo, statuette en bronze de l’«Héraclès épitrapézios»(fouilles de 1901) : R. Paribeni, NSc, 1902, p. 572 s.; A. Maiuri, dans Pompeiana(op. cit.) p. 19.
Pompéi, via dell’Abbondanza, IX 11, 1, aux confins de IX 7. Frise représentantHéraclès parmi les douze «dei consientes» : V. Spinazzola, Pompei alla luce degli sca-vi nuovi di via dell’Abbondanza, 1953, p. 175-178, fig. 215-216 et pl. 1 et 18; deux frisesidentiques, œuvres du même atelier, se trouvent dans le vicolo dei Dodici Dei (sur lafaçade de l’angle nord-est de VIII 3) et dans la petite cour intérieure de la casa deiCasti Amanti.
Pompéi, maison de Loreius Tiburtinus : J.-M. Croisille, La frise d’Héraclès de lamaison de Loreius Tiburtinus à Pompéi et la tradition épique, dans Hommages à Hen-ry Bardon, dans Latomus, 187, 1985, p. 89-99. Pompéi, Petra Herculis : D. Camardoet A. Ferrara, Petra Herculis : un luogo di culto alla foce del Sarno, dans AION, 12,1990, p. 169-175, fig. 51-53; N. Murolo, Le Salinae Herculae di Pompei e il culto di Er-cole nella Campania antica, dans Studi sulla Campania preromana, Rome, 1995,p. 105-123 avec pl. 42.
Sorrente, fanum d’Héraclès non loin de la villa de Pollius Felix : Statius, SilvaeIII, 1, 82. Il 13 rapporte qu’en août d’une année non précisée (peut-être 90 ap. J.-C.)Pollius décida de construire en l’honneur d’Héraclès un sanctuaire plus digne du hé-ros en remplaçant le temple vétuste qui lui était jusqu’alors consacré. Le culte futsuspendu pendant une année, période nécessaire à la construction du temple. Quant
Il est de toute manière difficile de les considérer, précisément à Hercula-
928 UMBERTO PAPPALARDO
.
au poète, il composa pour l’inauguration du nouveau temple et alors qu’il se trouvaitune fois encore auprès de Pollius (dont il décrit la villa dans Silvae II, 2) ses SilvaeIII, 1. Cf. P. Mingazzini et F. Pfister, Surrentum. Forma Italiae, Regio I. Latium etCampania II, Rome, 1946 en particulier 18, 54, 60-61.
10 Un culte d’Hercule est attesté par une arula portant une dédicace à «Her-cules» et mise au jour lors des fouilles effectuées par les Bourbons près du puits dePedrano, dans la zone centrale de la ville : CIL X 1443; Guadagno, CronErc, 8, 1978,p. 154 n. 56 et CronErc, 11, 1981, p. 146, n. 99); Pagano 1996, p. 229-248, en parti-culier p. 237.
11 Maiuri 1958, p. 323; D. Ferrin Sutton, The Hercules statue from the house ofthe staggs in Herculaneum, dans RhM, 127, 1984, p. 96; selon l’auteur, la statue de lamaison des Cerfs représenterait l’Héraclès du «Syleus» d’Euripide s’apprêtant à vio-ler la fille de Syleus.
12 Maiuri 1958, p. 316; Pappalardo 1993, vol. 2, p. 220, no 408.13 Maiuri 1958, p. 54 s., fig. 51.14 M. Manni, Le pitture della casa dell’Atrio Tuscanico, Rome, 1974, p. 13, pl. 1,3
et 2,1; Pappalardo 1993, vol. 2, p. 230, no 437.
num, comme de simples scènes de genre, ne serait-ce qu’à cause de lasimple assonance «Hercules»-«Herculanum» qui devait constamment rap-peler aux habitants que leur cité était une fondation d’Héraclès et que leurslointaines origines remontaient à une époque mythique10. Quel usage fait-on dès lors de l’iconographie d’un dieu dans une ville qui en porte directe-ment le nom?
Dans les édifices privés, on trouve très souvent la représentation dudieu ou des allusions à sa sphère. Ainsi par exemple, de la décorationsculptée dans le jardin de la maison des Cerfs provient une statue d’Héra-clès couronné et ivre, urinant après avoir trop bu, signe qu’on savait encoresourire – comme nous le faisons aujourd’hui – de ses faiblesses (fig. 1)11.
Dans la meilleure tradition du rococo hellénistique se place en re-vanche un petit tableau hellénistique du cryptoportique-pinacothèque de lamaison des Cerfs où quelques Erotes, profitant de l’absence du dieu, jouentavec ses armes, la massue et l’arc (fig. 2)12.
Des fontaines publiques mises au jour dans la ville, chacune était dé-diée à une divinité. Cependant, celle qui se trouve au croisement des ar-tères commerciales les plus importantes, à l’angle du cardus V et du de-cumanus maximus – et il ne peut s’agir d’un hasard – était précisément dé-diée à Héraclès (fig. 3)13.
Dans la maison de l’Atrium Toscan une peinture de IVe style pompéienmontre Héraclès accompagné de deux officiants, près d’un autel, s’apprê-tant à sacrifier un taureau. L’aspect exemplaire mis en évidence ici est sansdoute la pietas, ou la dévotion religieuse du héros (fig. 4)14.
Les exemples cités jusqu’ici pourraient avoir le caractère de simples
929LE MYTHE D’HÉRACLÈS À HERCULANUM
.
Fig. 1 – Herculanum, maison des Cerfs, Héraclès ivre.
Fig. 2 – Herculanum, maison des Cerfs, pinax avec Erotes.
930 UMBERTO PAPPALARDO
.
Fig. 3 – Herculanum, fontaine d’Héraclès, détail.
Fig. 4 – Herculanum, maison de l’Atrium Toscan, pinax avec Héraclès sacrifiant.
931LE MYTHE D’HÉRACLÈS À HERCULANUM
.
15 Dans une somptueuse villa maritime, qui se trouve aujourd’hui sur le terri-toire de Torre del Greco, mais qui appartenait dans l’Antiquité au territoire d’Her-culanum, on disait qu’on avait retrouvé un groupe en bronze, copie d’un original deLysippe représentant Héraclès et la biche de Cérynie (aujourd’hui au Museo archeo-logico regionale de Palerme, no d’inv. 8364) : U. Pappalardo, F. Formicola, G. Rolan-di et F. Russo, Archeologia, geologia e vulcanologia nel territorio di Torre del Greco :tre discipline a confronto, dans Albore Livadie et Widemann, op. cit. (supra note 3)p. 125-181, en particulier p. 166-167, fig. 19; récemment, la sculpture a été attribuée –sur la base de mentions d’archives – à la maison de Salluste à Pompéi : M. Pagano, Idiari di scavo di Pompei, Ercolano e Stabiae di Francesco e Pietro La Vega, 1997,p. 169 (relation datée du 4 février 1805).
16 Sur la maison du Relief de Télèphe : Maiuri 1958, p. 345-360, pl. 31-32; E. deAlbentiis, La casa dei Romani, Milan, 1990, p. 262. Je pense que les thermes subur-bains situés au-dessous appartenaient à l’origine à cette maison, avant d’être donnésà la municipalité : U. Pappalardo, Die Suburbanen Thermen von Herculaneum, dansAW, 30, 3, 1999, p. 209-218; U. Pappalardo et H. Manderscheid, Le terme suburbanedi Ercolano. Architettura, gestione idrica e sistema di riscaldamento, dans RStPomp, 9,1998, p. 173-192.
17 Chr. Bauchhenss Thüriedl, Der Mythos von Telephos in der antiken Bildkunst,Würzburg, 1971; H. Froning, Marmor-Schmuckreliefs mit griechischen Mythen im 1.Jahrhundert v. Chr., Mayence, 1981, p. 22-30.
«mentions», presque dues au hasard, si le contexte n’était pas précisémentcelui de la cité fondée par le dieu. Parmi ces exemples, on pourrait égale-ment compter les nombreux cerfs apparaissant dans la peinture d’Hercula-num, une allusion évidente à un des exploits d’Héraclès, la chasse à labiche de Cérynie15.
Un des personnages les plus illustres de la ville fut Marcus Nonius Bal-bus, éminente personnalité sénatoriale de l’époque augustéenne, originairede Nuceria, mais habitant à Herculanum, qui revêtit les charges de préteuret de proconsul de la province de Crête et de Cyrène. Ayant bien méritéd’Herculanum pour avoir fait restaurer sa basilique, ses portes et ses forti-fications, il fut nommé patron de la cité et on lui éleva au moins dix sta-tues. Sa demeure était la maison dite du relief de Télèphe qui, par la no-blesse de son implantation, se distingue de la médiocrité provinciale del’architecture pompéiano-herculanéenne en se référant à des modèles ro-mains urbains16. La maison est appelée ainsi à cause de la découverte d’unensemble de reproductions artistiques parmi lesquelles figure un reliefnéoattique représentant la guérison de Télèphe, fils d’Héraclès et d’Augé,guéri par Achille avec la poudre de la lance avec laquelle ce dernier l’avaitblessé huit ans auparavant (fig. 5)17. À sa mort, on accordera à Marcus No-nius Balbus des honneurs exceptionnels et sa statue couronnée de lauriersera placée dans un enclos commémoratif édifié sur la place jouxtant les
932 UMBERTO PAPPALARDO
.
18 U. Pappalardo, Nuove testimonianze su Marco Nonio Balbo ad Ercolano, dansRM, 104, 1997, p. 285-297, pl. 59-68.
19 Maiuri 1958, p. 113-143; Pagano 1996, p. 229-262, fig. 1-21, en particulierp. 243-248.
Fig. 5 – Herculanum, maison de Marcus Nonius Balbus, relief de Télèphe.
thermes suburbains (fig. 6)18. Un fragment de l’épaulière droite de sa cui-rasse, non encore recomposé, montre un Héraclès de type scopasique, avecla léonté, ce qui est une allusion explicite au fondateur légendaire de la cité(fig. 7).
Plus intéressante encore apparaît la présence du dieu dans quasimenttous les édifices publics de la cité connus à ce jour – la palestre, la curie, labasilique et le Collège des Augustales – dans la mesure où elle semble êtreliée au culte de l’empereur ou aux thèmes de la propagande impériale.
La palestre d’Herculanum constitue une des grandes interventions pu-bliques de l’époque julio-claudienne à Herculanum19. Pour la construire, ilfallut agrandir la cité sur le côté sud occasionnant d’énormes déblaiements.Elle fut le siège d’une des plus importantes institutions publiques, la iuven-tus herculanensis, où s’enseignaient les nouvelles valeurs de l’idéologie im-périale. De telles institutions devaient précisément remonter à l’époque au-gustéenne, le princeps ayant décidé d’organiser les jeunes gens en collegia
933LE MYTHE D’HÉRACLÈS À HERCULANUM
.
Fig
. 6
– H
ercu
lan
um
, st
atu
e d
e M
arcu
s N
oniu
s B
alb
us.
Fig
. 7
– H
ercu
lan
um
, st
atu
e d
e M
arcu
s N
oniu
s B
alb
us,
épau
lièr
e av
ec «
Hér
aclè
s».
934 UMBERTO PAPPALARDO
.
20 Maiuri 1958, fig. 91.98.111; Pagano 1996, p. 229-248, en particulier p. 248.
Fig. 8 – Herculanum, vue axonométrique de la palestre.
iuvenum, associations à caractère sportif et paramilitaire. Dans ce contex-te, la palestre jouait un rôle important dans les programmes de propagandeimpériale, la nouvelle idéologie politique pouvant avoir facilement prisesur les adolescents. Le bâtiment était constitué d’un quadriportique, avecune grande aula en abside, sur le long côté. On y trouvait une statue colos-sale de l’empereur et la table agonistique destinée à la remise des prix auxjeunes vainqueurs des compétitions (fig. 8)20. Au centre, il y avait une pis-
935LE MYTHE D’HÉRACLÈS À HERCULANUM
.
21 Une vasque cruciforme a été retrouvée à Herculanum et dans la maison deGalba : Maiuri 1958, p. 403-407, fig. 342-343.
22 A. Maiuri, Fontana monumentale in bronzo nei nuovi scavi di Ercolano, dansBdA, 3, 1954, p. 193 s.
23 Maiuri, ibid. Sur la question, voir : S. Woodford, The iconography of the infantHerakles strangling snakes, dans Image et céramique grecque. Actes Colloque Rouen25-26.XI.1982, Rouen, 1983, p. 121-129.
24 C.-N. Cochin et J.-C. Bellicard, Observations sur les antiquités d’Herculanum,Paris, 1755, [reprint : Genève (Minkoff)], 1972, p. 19, pl. 5. L’identification exacte deces édifices semble aujourd’hui très problématique; les auteurs suivants ont cherchéà mettre de l’ordre dans les données : Allroggen Bedel 1974, p. 97-109; Muscettola1982, p. 2-16; Allroggen Bedel 1983, p. 139-158, en particulier p. 155-157, fig. 1.7(plan de Bardet); G. Guadagno, Ercolano. Eredità di cultura e nuovi dati, dansL. Franchi dell’Orto (éd.), Ercolano 1738-1988. 250 anni di ricerca archeologica. Attidel Convegno Ravello-Ercolano-Napoli-Pompei 30.X-5.XI. 1988, Rome, 1993, p. 73-98,en particulier p. 78-79, note 34; Pagano 1996, p. 229-248, en particulier p. 249. fig. 2(plan de Bardet intégré dans les nouvelles données).
25 Muscettola 1982, p. 2-16; Pagano 1996, p. 229-248, en particulier p. 238-240,s.v. Basilica.
cine en forme de croix21 avec, en son centre, une hydre en bronze. Lemonstre serpentiforme à cinq têtes s’enroulait autour d’un tronc d’arbre etcrachait de l’eau en éventail dans la vasque (fig. 9)22. Il est évident que cettefontaine insolite ne constituait pas une simple décoration, mais qu’elle de-vait plutôt servir d’exemple stimulant pour les jeunes gens à l’exercice :comme le dieu fondateur, la virtus heroica est censée leur rappeler qu’il estnécessaire de s’habituer à vaincre la fatigue si l’on veut gagner des prix. Cen’est donc point un hasard si la statue était placée dans un axe optique enrelation avec la table agonistique et la statue de l’empereur.
Dans le même édifice, en contrepoint plaisant au sérieux du thème, ap-paraît en revanche un petit Héraclès qui étrangle les serpents perfidementenvoyés par Héra, peint sur un candélabre près de l’angle nord-ouest del’ambulacre (fig. 10)23.
Près de l’angle nord-ouest des fouilles actuelles, au croisement du car-do V et du decumanus maximus, il y avait une concentration d’édifices pu-blics, résultat d’une systématisation urbanistique d’époque julio-clau-dienne au centre de l’ancienne cité. Bien que tous les édifices n’aient pasété mis au jour, nous en connaissons le plan grâce à un dessin de 1754 exé-cuté par Charles-Nicolas Cochin et Jérôme-Charles Bellicard. Ils ont été gé-néralement reconnus comme étant la curie, la basilique et le Collège desAugustales24.
Dans la curie, où étaient placées les statues impériales et la galerie desportraits de la famille des Balbi25, on trouve sur l’architrave une frise
936 UMBERTO PAPPALARDO
.
Fig
. 9 –
Her
cula
nu
m, p
ales
tre,
fon
tai-
ne
en b
ron
ze d
e l’H
ydre
, d
étai
l.F
ig.
10 –
Her
cula
nu
m,
pal
estr
e, H
érac
lès
étra
ngl
ant
les
serp
ents
.
937LE MYTHE D’HÉRACLÈS À HERCULANUM
.
26 M. Pagano, Un ciclo delle imprese di Ercole con iscrizioni greche da Ercolano,dans RM, 97, 1990, p. 43-45 (datation à l’époque de Vespasien).
27 Maiuri 1958, p. 87-90, fig. 66-67 (plan de Bardet et reconstitution de RaffaelloMorghen); Pagano 1996, p. 229-248, en particulier p. 240-243.
28 Schefold 1972, p. 207-208, pl. 47; Pappalardo 1993, vol. 2, p. 235, no 452.
Fig. 11 – Herculanum, curie, frise de la centauromachie.
comportant des didascalies en grec et des représentations de quelques tra-vaux d’Héraclès, notamment sa lutte contre les Centaures alors qu’il étaitl’hôte de Pholos (fig. 11)26.
La basilique d’Herculanum – comme on l’a dit plus haut – n’a pas en-core été entièrement dégagée. Mais son plan nous est connu non seulementpar le dessin de Cochin et Bellicard, mais aussi par celui de Bardet (datantde 1743), sans oublier une reconstitution, aussi fantaisiste que suggestive,exécutée par le peintre Raffaello Morghen à l’initiative de Bonucci, direc-teur des fouilles au XIXe siècle27.
Comme dans l’édifice d’Eumachia à Pompéi, la basilique se présentecomme un bâtiment doté d’un portique, d’absides et de niches sur les pa-rois du fond. Dans les absides se trouvaient des peintures représentant«Thésée libérateur»28 et «Héraclès retrouvant Télèphe en Arcadie»
938 UMBERTO PAPPALARDO
.
29 Schefold 1972, p. 205-206, pl. 48; Pappalardo 1993, vol. 2, p. 235, no 451. Surl’activité du Peintre de la Basilique d’Herculanum : M. Gabriel, Masters of Campa-nian painting, New York, 1952, p. 7-34.
Le tableau représentant la découverte par Héraclès de Télèphe enfant dans laBasilique d’Hercolanum semble être de la même main que celui de l’«Arrivée d’Io àCanope» dans le Temple d’Isis à Pompéi : S. De Caro (éd.), Alla ricerca di Iside : ana-lisi, studi e restauri dell’Iseo pompeiano nel Museo di Napoli, Rome, 1992, p. 55-56,no 1.633, pl. 10.
30 Schefold 1972, p. 201 s., pl. 46; Pappalardo 1993, vol. 2, p. 236, no 453.31 A.M.G. Little, The Homeric house cycle and the Herculaneum megalography,
dans AJA, 68, 1964, p. 390-395, en particulier p. 393-395, pl. 122, fig. 7; W. Wohl-mayr, Überlegungen zur Basilika von Herculaneum, dans Akten des 3. Österrei-chischen Archäologentages, Vienne, 1989, p. 193-196, (recomposition du programmedécoratif de la basilique, tant sculptural que pictural); T. Najbjerg, Public paintedand sculptural programms of the early Roman Empire. The case study of the so-calledBasilica in Herculaneum, Thèse, Princeton, 1997.
32 F. Matz, Zum Telephosbilde aus Herculaneum, dans AM, 39, 1914, p. 67-71;R. Hamann, Herakles findet Telephos, dans AbhBerlin, 9, 1952-1953, p. 17 s.; J. W. Sa-lomonson, Telephos und die römischen Zwillinge, dans OudhMeded, 38, 1957, p. 15 s.(on y reconnaît l’opposition – comme dans les Vies parallèles de Plutarque – des fon-dateurs de Rome et de Pergame, les deux villes principales de l’antiquité); R. Han-nah, Et in Arcadia ego ? The finding of Telephos, dans Antichthon, 20, 1986, p. 86-105avec fig. 1; F. Gury, La découverte de Télèphe à Herculanum, dans 4. InternationalesKolloquium zur römischen Wandmalerei. Köln 20.-23.IX.1989 (KölnJbVFrühGesch,24, 1991), p. 97-104 (essai intéressant de «lecture romaine» de la représentation).
(fig. 12)29, les niches mineures comportant les peintures de «Chiron etAchille»30 et «Pan et Olympos»31.
Ce cycle était traversé de multiples significations. En effet, le tableaude «Thésée libérateur» faisait pendant à celui d’«Héraclès retrouvant Té-lèphe en Arcadie». Il servait donc à enorgueillir la conscience des cives her-culanenses qui reconnaissaient dans le dieu fondateur de leur ville, le créa-teur de la souche de la dynastie pergaménienne. En réalité, Rome étaitconsidérée non seulement comme la «nouvelle Athènes» (Thésée), maisaussi comme l’héritière du royaume de Pergame (Télèphe)32.
Héraclès retrouve son jeune fils Télèphe allaité par une biche et nonpar une lionne – ainsi que nous le rapportent les sources littéraires – aupied d’une personnification de l’Arcadie. On a cependant ajouté une lionnesur la droite pour symboliser, avec l’aigle de Zeus, les destinées royales dePergame. La figure ailée est Parthénos, personnification du mont où naquitTélèphe. La figure majestueuse de l’Arcadie prend comme modèle celle dela frise de Pergame, mais elle peut aussi être interprétée comme la grandeDéesse Mère, à cause de la présence du lion. À côté de l’Arcadie, on voit une
939LE MYTHE D’HÉRACLÈS À HERCULANUM
.
Fig. 12 – Herculanum, basilique, «Héraclès et Télèphe».
corbeille de raisin et, derrière, un satyre avec syrinx et pedum, symbolesdes fêtes dionysiaques que l’on célébrait à Pergame. La figure d’Héraclèss’inspire, quant à elle, de la morphologie des Géants de l’autel de Pergame.Il est probable que cette peinture soit inspirée par un modèle pergaméniendatant du milieu de la période hellénistique. Bien que la multiplicité des si-gnifications ait sans doute fait partie intégrante de l’original et qu’elle aitété intentionnelle, le contenu du document peint s’est encore enrichi aumoment de son adaptation syncrétique en tant que copie romaine.
Dans le cycle interviennent deux autres peintures, celle du «Chironthessalien initiant Achille d’Asie Mineure au jeu de la lyre», qui faisait lependant à celle du «Pan arcadien enseignant le jeu de la flûte à Olympos
940 UMBERTO PAPPALARDO
.
33 Pline, Naturalis Historia 36, 29. F. Coarelli, Guida archeologica di Roma, Mi-lan, 1974, p. 240, p. 262 (les comices centuriates chargées d’élire les principales ma-gistratures se réunissaient sur la vaste place rectangulaire située immédiatement àl’est du Panthéon).
34 Schefold 1972, p. 144. 217. 262, pl. 50 a.35 Pappalardo 1993, vol. 1, fig. 125 (lion de Némée), fig. 126 (sanglier d’Eurystée)
e fig. 156 (Jupiter et l’arc-en-ciel); Wohlmayr, op. cit. (supra note 31) p. 193-196, enparticulier p. 196, note 9.
36 Pappalardo 1993, vol. 1, pl. 144-146, vol. 2, p. 230-231, no 437-440; U. Pappa-lardo, Spazio sacro e spazio profano : il Collegio degli Augustali di Ercolano, dansE. Moormann (éd.), Functional and spatial analysis of wall painting. Proceedings ofthe fifth international Congress on ancient wall painting, Universiteit van Amsterdam8-12.IX.1992, dans BABesch, Suppl. 3, 1993, p. 90-95, fig. 1-9, pl. 1, 4; R. Etienne, Àpropos du «cosiddetto» édifice des Augustales d’Herculanum, dans Franchi dell’Orto,op. cit. (supra note 24) p. 345-305.
37 Cf. Ovide, Métamorphoses 9, 1-95.
d’Asie Mineure». Ces tableaux exaltaient la «paideia grecque civilisatrice».Les deux groupes étaient représentés à Rome dans le portique des SaeptaIulia, où étaient également représentés les Argonautiques33, présentes éga-lement dans la basilique d’Herculanum par la peinture figurant «Médéetuant les fils qu’elle a eus de Jason»34. De cette manière s’établissait un lienidéal entre l’édifice d’Herculanum et les Saepta de Rome.
Au-dessus des niches latérales se trouvaient des peintures figurant lesexploits d’Héraclès, de son enfance jusqu’aux travaux, y compris les tra-vaux non canoniques35.
Le Collège des Augustales d’Herculanum était, comme l’atteste une ins-cription, le bâtiment consacré par la bourgeoisie locale au culte impérial36.L’attention de la foule qui se réunissait dans la grande salle hypostyle, dé-nuée de décorations, était attirée par une grande niche du fond, richementdécorée par une peinture. On y trouvait exposé, contre un édicule à fondblanc surmonté d’une corona civica, le buste de l’empereur.
Les parois latérales, peintes dans le IVe style pompéien, montraient ungrand édicule central dans lequel se superposaient, à droite, un tableau fi-gurant «Héraclès et Achéloos» et, à gauche, «l’apothéose d’Héraclès».
Dans le premier tableau, le dieu fleuve Achéloos cherche à enlever Dé-janire, l’épouse d’Héraclès (fig. 13). Dans la lutte qui s’ensuit, Héraclès bri-sera la corne (dans ce cas les cornes) d’Achéloos, corne de laquelle jailliral’abondance37. Dans le contexte général, la scène se présente comme une al-légorie de la munificentia. En réalité, non seulement l’empereur, mais aussitoute la famille impériale, se faisaient représenter avec la corne d’abon-dance, symbole de la prospérité garantie à l’humanité par le régime impé-
941LE MYTHE D’HÉRACLÈS À HERCULANUM
.
38 Cfr. P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, Munich, 1987, [trad. ital. :Augusto e il potere delle immagini, Turin, 1989], p. 267, fig. 196. Dans le Collège desAugustales de Misène on a retrouvé une statue idéalisée de matrone de la maison ju-lio-claudienne représentée comme personnification de l’Abondance, avec la «cornu-copia» : A. de Franciscis, Il sacello degli Augustali a Miseno, Naples, 1991, p. 20-21 etfig. 9; de Pouzzoles proviennent en revanche une statue de Livie (ibid., note 8) et uneautre d’Auguste (ibid., note 9), toutes deux avec corne d’abondance. Sur le «Caméede Vienne», où apparaissent Germanicus et Agrippine l’Aînée (à droite) à l’occasiondes noces de Claude et d’Agrippine la Jeune; les portraits en buste reposent sur des
Fig. 13 – Herculanum, Collège des Augustales, «Héraclès et Achéloos».
rial. Le célèbre Camée de Vienne peut être considéré comme le meilleurexemple de cette allégorie38.
942 UMBERTO PAPPALARDO
.
cornes d’abondance : Th. Kraus, Das römische Weltreich, dans PKG, 2, 1967, no 29a(en couleurs).
Fig. 14 – Herculanum, Collège des Augustales, «Apothéose d’Héraclès».
Dans le second tableau, Héraclès est introduit dans l’Olympe, ac-compagné de sa protectrice Athéna et de Héra (fig. 14). Le message généralque veut communiquer la scène est celui que les créatures humainespeuvent elles aussi atteindre la perfection divine. Pourtant, la présenced’Héra est insolite, car le héros est accompagné d’habitude par Athéna etHermès. En examinant attentivement le fond, on remarquera la présenced’un arc-en-ciel, symbole de Zeus. Nous nous trouvons donc en présence
943LE MYTHE D’HÉRACLÈS À HERCULANUM
.
39 Œuvres d’Antonio di Chelino (1458), Francesco Laurana (1453) et autres :F. Bologna, Napoli e le rotte mediterranee della pittura, Naples, 1977, p. 100-101;S. A. Muscettola, Memorie ritrovate di Napoli antica, dans Scritti in ricordo di Gio-vanni Previtali, dans Prospettiva, 53-56, 1988-1989, vol. 1, p. 236-244, en particulierp. 238-239, fig. 6-7
40 A. Allroggen Bedel, Gli scavi di Ercolano nella politica culturale dei Borboni,dans Franchi dell’Orto, op. cit. (supra note 24) p. 35-39, en particulier p. 39; A. All-roggen Bedel, Archäologie und Politik : Herculaneum und Pompeji im 18. Jahrhun-dert, dans Hephaistos, 14, 1996, p. 217-252, en particulier p. 241-242.
d’un mythe grec faisant l’objet d’une lecture des Romains, et ce d’autantplus qu’Héraclès n’est pas accueilli dans l’Olympe mais devant la Triade ca-pitoline, constituée justement de Jupiter (l’arc-en-ciel), Junon (Héra) et Mi-nerve (Athéna).
À côté des panneaux centraux se trouvent deux vues d’architecture enraccourci surmontées de biges guidés par des Victoires, alors que dans lesprédelles sont représentés des prix de concours, sous la forme de palmes etde vases d’or et d’argent.
Le programme symbolique et éducatif apparaît donc comme ayanttrois niveaux : celui du culte divin de l’empereur (avec le buste), celui duculte du fondateur Héraclès, divinisé en tant que bienfaiteur de l’humanitéet celui des pinakia avec les prix des concours, en référence aux buts quipouvaient être atteints par les hommes.
Il paraît important de souligner combien le culte des divinités, et sesantécédents d’ordre mythique, sert de toile de fond au culte impérial en luiconférant une aura héroïque et religieuse.
La figure d’Héraclès, héros de nature humaine devenu divinité aprèsavoir accompli des exploits gigantesques, devait servir de modèle à l’ambi-tieuse bourgeoisie romaine dans sa dure ascension au cœur d’une sociétésubdivisée en classes de cens. Par ailleurs, elle a aussi servi aux empereursromains dans leur évolution progressive vers la divinisation.
De manière analogue, elle servira aux monarques absolus d’Occident –au moins jusqu’au XVIIIe et au XIXe siècles – à légitimer leur propre pou-voir, par l’allusion à la double nature humaine et divine du souverain.
Cet aspect se retrouve, par exemple, sur les reliefs de l’arc de triomphedu Maschio Angioino à Naples (1443) où, hormis l’exaltation du roi Al-phonse Ier d’Aragon, apparaît la présentation de son fils Ferrante commesuccesseur au trône, avec moultes références au mythe d’Héraclès, commeun «petit Héraclès étranglant les serpents», la massue ou la léonté(fig. 15)39.
De même, les Bourbons, qui aimaient à se faire identifier à Héraclès40,exposèrent devant le grand escalier d’honneur du Palais de Caserte la sta-
944 UMBERTO PAPPALARDO
.
Fig. 15 – Naples, Maschio Angioino, relief d’Alphonse d’Aragon.
Fig. 16 – Caserta, Palais Royal, grand escalier d’honneur avec la statue de l’Héraclèsde Lysippe au fond.
945LE MYTHE D’HÉRACLÈS À HERCULANUM
.
41 F. de Filippis, Il palazzo reale di Caserta e i Borboni di Napoli, Cava dei Tirreni,1968; M. R. Caroselli, La Reggia di Caserta. Lavori, costi, effetto della costruzione,Naples, 1968; P. Moreno, Il Farnese ritrovato ed altri tipi di Eracle a riposo, dans ME-FRA, 94, 1, 1982, p. 379-526, fig. 1; cf. P. Moreno, Vita e arte di Lisippo, Milan, 1987,p. 162-185; F. Rausa, Marmi Farnesi nel Giardino inglese della Reggia di Caserta, dansBollettino d’arte, 100, 1997, p. 33-54, en partic. p. 34 avec fig. 1.
42 Porte de Brandebourg (1788-1791) : G. D. Ulferts, Friede nach siegreichemKrieg. Das Bildprogramm : Skulpturen und Malereien, dans R. Bothe (dir.), Das Bran-denburger Tor 1791-1991. Eine Monographie, Berlin, 1991, p. 93-123, en particulierp. 113-123.
tue monumentale d’Héraclès au repos de Lysippe, découverte dans lesThermes de Caracalla et venue de Rome à Naples avec la Collection Far-nèse (fig. 16)41.
À l’imitation de la Grèce et des cours méditerranéennes, on trouve aus-si à Berlin, dans les arcades de la Porte de Brandebourg (1788-1791) des re-présentations des travaux d’Héraclès, modèle de vertu militaire digne d’êtreimité42.
Umberto PAPPALARDO
ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
Muscettola 1982 = S. Adamo Muscettola, Nuove letture borboniche. I Nonii Balbi ed ilForo di Ercolano, dans Prospettiva, 28, 1982, p. 2-16.
Allroggen Bedel 1974 = A. Allroggen Bedel, Das sogenannte Forum von Herculaneumund die bourbonischen Grabungen von 1739, dans CronErcol, 4, 1974, p. 97-109.
Allroggen Bedel 1983 = A. Allroggen Bedel, Dokumente des 18. Jahrhunderts zur To-pographie von Herculaneum, dans CronErcol, 13, 1983, p. 139-158.
Maiuri 1958 = A. Maiuri, Ercolano. I nuovi scavi (1927-1958), I, Rome, 1958.Pagano 1996 = M. Pagano, La nuova pianta della città e alcuni edifici pubblici di Erco-
lano, dans CronErcol, 26, 1996, p. 229-262.Pappalardo 1993 = U. Pappalardo, Le IIIe style, dans A. de Franciscis et al., La pein-
ture de Pompéi. Avec un catalogue raisonné, 1-2, Paris, 1993.Schefold 1972 = K. Schefold, La peinture pompéienne, Bâle, 1972.