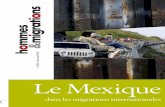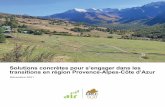PARABENES DANS LES PRODUITS COSMETIQUES
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of PARABENES DANS LES PRODUITS COSMETIQUES
IVERSITÉ MOHAMMED V-RABAT FACULTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
ANNEE : 2016 THÈSE N° :126
PARABENES DANS LES PRODUITS
COSMETIQUES :QUELLES ALTERNATIVES ,QUELLE
PLACE DES COSMETIQUES BIO .
THÈSE
Présentée et soutenue publiquement le:………..….…2016
PAR Mlle Fatima ezzahra BELAOUFI
Née le 23 Mai 1991 à El jadida
Pour l'Obtention du Doctorat en pharmacie MOTS CLES : Parabènes, produits cosmétiques, perturbateurs endocriniens, alternatives, cosmétiques biologiques
MEMBRES DE JURY Mme.S.TELLAL PRÉSIDENT
Professeur de Biochimie
Mme. K. ALAOUI RAPPORTEUR Professeur de Pharmacologie
Mme. F. JABOUIRIK Professeur de Pédiatrie
Mr. A. LAATIRIS Professeur de Pharmacie galénique
JUGES
UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT
DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969 : ProfesseurAbdelmalek FARAJ
1969 – 1974 : Professeur Abdellatif BERBICH 1974 – 1981 : Professeur Bachir LAZRAK 1981 – 1989 : Professeur Taieb CHKILI 1989 – 1997 : Professeur Mohamed Tahar ALAOUI 1997 – 2003 : Professeur Abdelmajid BELMAHI 2003 – 2013 : Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI
ADMINISTRATION : Doyen : Professeur Mohamed ADNAOUI Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines Professeur Mohammed AHALLAT Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération Professeur Taoufiq DAKKA Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie Professeur Jamal TAOUFIK Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT
1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981 Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih Chirurgie Cardio-Vasculaire Pr. TAOBANE Hamid* Chirurgie Thoracique Mai et Novembre 1982 Pr. BENOSMAN Abdellatif Chirurgie Thoracique Novembre 1983 Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI Rhumatologie
Décembre 1984 Pr. MAAOUNI Abdelaziz Médecine Interne – Clinique Royale Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi Anesthésie -Réanimation Pr. SETTAF Abdellatif pathologie Chirurgicale
Novembre et Décembre 1985 Pr. BENJELLOUN Halima Cardiologie Pr. BENSAID Younes Pathologie Chirurgicale Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa Neurologie
Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali Radiologie Pr. CHAHED OUAZZANI Houria Gastro-Entérologie Pr. EL YAACOUBI Moradh Traumatologie Orthopédie Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah Gastro-Entérologie Pr. LACHKAR Hassan Médecine Interne Pr. YAHYAOUI Mohamed Neurologie
Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib Chirurgie Pédiatrique Pr. DAFIRI Rachida Radiologie Pr. HERMAS Mohamed Traumatologie Orthopédie
Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed Médecine Interne –Doyen de la FMPR Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali* Cardiologie Pr. CHAD Bouziane Pathologie Chirurgicale Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda Neurologie
Janvier et Novembre 1990
Pr. CHKOFF Rachid Pathologie Chirurgicale Pr. HACHIM Mohammed* Médecine-Interne Pr. KHARBACH Aîcha Gynécologie -Obstétrique Pr. MANSOURI Fatima Anatomie-Pathologique Pr. TAZI Saoud Anas Anesthésie Réanimation
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia Anatomie-Pathologique Pr. AZZOUZI Abderrahim Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO Pr. BAYAHIA Rabéa Néphrologie Pr. BELKOUCHI Abdelkader Chirurgie Générale Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif Chirurgie Générale Pr. BENSOUDA Yahia Pharmacie galénique Pr. BERRAHO Amina Ophtalmologie Pr. BEZZAD Rachid Gynécologie Obstétrique Pr. CHABRAOUI Layachi Biochimie et Chimie Pr. CHERRAH Yahia Pharmacologie Pr. CHOKAIRI Omar Histologie Embryologie Pr. KHATTAB Mohamed Pédiatrie Pr. SOULAYMANI Rachida Pharmacologie – Dir. du Centre National PV
Pr. TAOUFIK Jamal Chimie thérapeutique Décembre 1992 Pr. AHALLAT Mohamed Chirurgie Générale Pr. BENSOUDA Adil Anesthésie Réanimation Pr. BOUJIDA Mohamed Najib Radiologie Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza Gastro-Entérologie Pr. CHRAIBI Chafiq Gynécologie Obstétrique Pr. DAOUDI Rajae Ophtalmologie Pr. DEHAYNI Mohamed* Gynécologie Obstétrique Pr. EL OUAHABI Abdessamad Neurochirurgie Pr. FELLAT Rokaya Cardiologie Pr. GHAFIR Driss* Médecine Interne Pr. JIDDANE Mohamed Anatomie Pr. TAGHY Ahmed Chirurgie Générale Pr. ZOUHDI Mimoun Microbiologie
Mars 1994 Pr. BENJAAFAR Noureddine Radiothérapie Pr. BEN RAIS Nozha Biophysique Pr. CAOUI Malika Biophysique Pr. CHRAIBI Abdelmjid Endocrinologie et Maladies Métaboliques Pr. EL AMRANI Sabah Gynécologie Obstétrique Pr. EL AOUAD Rajae Immunologie Pr. EL BARDOUNI Ahmed Traumato-Orthopédie Pr. EL HASSANI My Rachid Radiologie Pr. ERROUGANI Abdelkader Chirurgie Générale- Directeur CHIS Pr. ESSAKALI Malika Immunologie Pr. ETTAYEBI Fouad Chirurgie Pédiatrique Pr. HADRI Larbi* Médecine Interne Pr. HASSAM Badredine Dermatologie Pr. IFRINE Lahssan Chirurgie Générale Pr. JELTHI Ahmed Anatomie Pathologique Pr. MAHFOUD Mustapha Traumatologie – Orthopédie Pr. MOUDENE Ahmed* Traumatologie- Orthopédie Pr. RHRAB Brahim Gynécologie –Obstétrique Pr. SENOUCI Karima Dermatologie
Mars 1994 Pr. ABBAR Mohamed* Urologie Pr. ABDELHAK M’barek Chirurgie Pédiatrique Pr. BELAIDI Halima Neurologie Pr. BRAHMI Rida Slimane Gynécologie Obstétrique Pr. BENTAHILA Abdelali Pédiatrie Pr. BENYAHIA Mohammed Ali Gynécologie Obstétrique
Pr. BERRADA Mohamed Saleh Traumatologie – Orthopédie Pr. CHAMI Ilham Radiologie Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae Ophtalmologie Pr. EL ABBADI Najia Neurochirurgie Pr. HANINE Ahmed* Radiologie Pr. JALIL Abdelouahed Chirurgie Générale Pr. LAKHDAR Amina Gynécologie Obstétrique Pr. MOUANE Nezha Pédiatrie Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane Réanimation Médicale Pr. AMRAOUI Mohamed Chirurgie Générale Pr. BAIDADA Abdelaziz Gynécologie Obstétrique Pr. BARGACH Samir Gynécologie Obstétrique Pr. CHAARI Jilali* Médecine Interne Pr. DIMOU M’barek* Anesthésie Réanimation Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine* Anesthésie Réanimation Pr. EL MESNAOUI Abbes Chirurgie Générale Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila Oto-Rhino-Laryngologie Pr. HDA Abdelhamid* Cardiologie - Dir. HMIMV Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed Urologie Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia Ophtalmologie Pr. SEFIANI Abdelaziz Génétique Pr. ZEGGWAGH Amine Ali Réanimation Médicale
Décembre 1996 Pr. AMIL Touriya* Radiologie Pr. BELKACEM Rachid Chirurgie Pédiatrie Pr. BOULANOUAR Abdelkrim Ophtalmologie Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan Chirurgie Générale Pr. GAOUZI Ahmed Pédiatrie Pr. MAHFOUDI M’barek* Radiologie Pr. MOHAMMADI Mohamed Médecine Interne Pr. OUADGHIRI Mohamed Traumatologie-Orthopédie Pr. OUZEDDOUN Naima Néphrologie Pr. ZBIR EL Mehdi* Cardiologie
Novembre 1997 Pr. ALAMI Mohamed Hassan Gynécologie-Obstétrique Pr. BEN SLIMANE Lounis Urologie Pr. BIROUK Nazha Neurologie Pr. CHAOUIR Souad* Radiologie Pr. ERREIMI Naima Pédiatrie Pr. FELLAT Nadia Cardiologie Pr. HAIMEUR Charki* Anesthésie Réanimation
Pr. KADDOURI Noureddine Chirurgie Pédiatrique Pr. KOUTANI Abdellatif Urologie Pr. LAHLOU Mohamed Khalid Chirurgie Générale Pr. MAHRAOUI CHAFIQ Pédiatrie Pr. OUAHABI Hamid* Neurologie Pr. TAOUFIQ Jallal Psychiatrie Pr. YOUSFI MALKI Mounia Gynécologie Obstétrique
Novembre 1998 Pr. AFIFI RAJAA Gastro-Entérologie Pr. BENOMAR ALI Neurologie – Doyen Abulcassis Pr. BOUGTAB Abdesslam Chirurgie Générale Pr. ER RIHANI Hassan Oncologie Médicale Pr. EZZAITOUNI Fatima Néphrologie Pr. LAZRAK Khalid * Traumatologie Orthopédie Pr. BENKIRANE Majid* Hématologie Pr. KHATOURI ALI* Cardiologie Pr. LABRAIMI Ahmed* Anatomie Pathologique
Janvier 2000 Pr. ABID Ahmed* Pneumophtisiologie Pr. AIT OUMAR Hassan Pédiatrie Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd Pédiatrie Pr. BOURKADI Jamal-Eddine Pneumo-phtisiologie Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer Chirurgie Générale Pr. ECHARRAB El Mahjoub Chirurgie Générale Pr. EL FTOUH Mustapha Pneumo-phtisiologie Pr. EL MOSTARCHID Brahim* Neurochirurgie Pr. ISMAILI Hassane* Traumatologie Orthopédie Pr. MAHMOUDI Abdelkrim* Anesthésie-Réanimation inspecteur SS Pr. TACHINANTE Rajae Anesthésie-Réanimation Pr. TAZI MEZALEK Zoubida Médecine Interne
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia Neurologie Pr. AIT OURHROUI Mohamed Dermatologie Pr. AJANA Fatima Zohra Gastro-Entérologie Pr. BENAMR Said Chirurgie Générale Pr. CHERTI Mohammed Cardiologie Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma Anesthésie-Réanimation Pr. EL HASSANI Amine Pédiatrie Pr. EL KHADER Khalid Urologie Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah* Rhumatologie Pr. GHARBI Mohamed El Hassan Endocrinologie et Maladies Métaboliques Pr. HSSAIDA Rachid* Anesthésie-Réanimation Pr. LAHLOU Abdou Traumatologie Orthopédie
Pr. MAFTAH Mohamed* Neurochirurgie Pr. MAHASSINI Najat Anatomie Pathologique Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae Pédiatrie Pr. NASSIH Mohamed* Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale Pr. ROUIMI Abdelhadi* Neurologie Décembre 2000 Pr. ZOHAIR ABDELAH* ORL
Décembre 2001 Pr. ABABOU Adil Anesthésie-Réanimation Pr. BALKHI Hicham* Anesthésie-Réanimation Pr. BENABDELJLIL Maria Neurologie Pr. BENAMAR Loubna Néphrologie Pr. BENAMOR Jouda Pneumo-phtisiologie Pr. BENELBARHDADI Imane Gastro-Entérologie Pr. BENNANI Rajae Cardiologie Pr. BENOUACHANE Thami Pédiatrie Pr. BEZZA Ahmed* Rhumatologie Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi Anatomie Pr. BOUMDIN El Hassane* Radiologie Pr. CHAT Latifa Radiologie Pr. DAALI Mustapha* Chirurgie Générale Pr. DRISSI Sidi Mourad* Radiologie Pr. EL HIJRI Ahmed Anesthésie-Réanimation Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid Neuro-Chirurgie Pr. EL MADHI Tarik Chirurgie-Pédiatrique Pr. EL OUNANI Mohamed Chirurgie Générale Pr. ETTAIR Said Pédiatrie Pr. GAZZAZ Miloudi* Neuro-Chirurgie Pr. HRORA Abdelmalek Chirurgie Générale Pr. KABBAJ Saad Anesthésie-Réanimation Pr. KABIRI EL Hassane* Chirurgie Thoracique Pr. LAMRANI Moulay Omar Traumatologie Orthopédie Pr. LEKEHAL Brahim Chirurgie Vasculaire Périphérique Pr. MAHASSIN Fattouma* Médecine Interne Pr. MEDARHRI Jalil Chirurgie Générale Pr. MIKDAME Mohammed* Hématologie Clinique Pr. MOHSINE Raouf Chirurgie Générale Pr. NOUINI Yassine Urologie Pr. SABBAH Farid Chirurgie Générale Pr. SEFIANI Yasser Chirurgie Vasculaire Périphérique Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia Pédiatrie
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane* Anatomie Pathologique Pr. AMEUR Ahmed * Urologie Pr. AMRI Rachida Cardiologie Pr. AOURARH Aziz* Gastro-Entérologie Pr. BAMOU Youssef * Biochimie-Chimie Pr. BELMEJDOUB Ghizlene* Endocrinologie et Maladies Métaboliques Pr. BENZEKRI Laila Dermatologie Pr. BENZZOUBEIR Nadia Gastro-Entérologie Pr. BERNOUSSI Zakiya Anatomie Pathologique Pr. BICHRA Mohamed Zakariya* Psychiatrie Pr. CHOHO Abdelkrim * Chirurgie Générale Pr. CHKIRATE Bouchra Pédiatrie Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair Chirurgie Pédiatrique Pr. EL HAOURI Mohamed * Dermatologie Pr. EL MANSARI Omar* Chirurgie Générale Pr. FILALI ADIB Abdelhai Gynécologie Obstétrique Pr. HAJJI Zakia Ophtalmologie Pr. IKEN Ali Urologie Pr. JAAFAR Abdeloihab* Traumatologie Orthopédie Pr. KRIOUILE Yamina Pédiatrie Pr. LAGHMARI Mina Ophtalmologie Pr. MABROUK Hfid* Traumatologie Orthopédie Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss* Gynécologie Obstétrique Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid* Cardiologie Pr. NAITLHO Abdelhamid* Médecine Interne Pr. OUJILAL Abdelilah Oto-Rhino-Laryngologie Pr. RACHID Khalid * Traumatologie Orthopédie Pr. RAISS Mohamed Chirurgie Générale Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha* Pneumophtisiologie Pr. RHOU Hakima Néphrologie Pr. SIAH Samir * Anesthésie Réanimation Pr. THIMOU Amal Pédiatrie Pr. ZENTAR Aziz* Chirurgie Générale
Janvier 2004 Pr. ABDELLAH El Hassan Ophtalmologie Pr. AMRANI Mariam Anatomie Pathologique Pr. BENBOUZID Mohammed Anas Oto-Rhino-Laryngologie Pr. BENKIRANE Ahmed* Gastro-Entérologie Pr. BOUGHALEM Mohamed* Anesthésie Réanimation Pr. BOULAADAS Malik Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale Pr. BOURAZZA Ahmed* Neurologie Pr. CHAGAR Belkacem* Traumatologie Orthopédie
Pr. CHERRADI Nadia Anatomie Pathologique Pr. EL FENNI Jamal* Radiologie Pr. EL HANCHI ZAKI Gynécologie Obstétrique Pr. EL KHORASSANI Mohamed Pédiatrie Pr. EL YOUNASSI Badreddine* Cardiologie Pr. HACHI Hafid Chirurgie Générale Pr. JABOUIRIK Fatima Pédiatrie Pr. KHABOUZE Samira Gynécologie Obstétrique Pr. KHARMAZ Mohamed Traumatologie Orthopédie Pr. LEZREK Mohammed* Urologie Pr. MOUGHIL Said Chirurgie Cardio-Vasculaire Pr. OUBAAZ Abdelbarre* Ophtalmologie Pr. TARIB Abdelilah* Pharmacie Clinique Pr. TIJAMI Fouad Chirurgie Générale Pr. ZARZUR Jamila Cardiologie Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah Chirurgie Réparatrice et Plastique Pr. AL KANDRY Sif Eddine* Chirurgie Générale Pr. ALAOUI Ahmed Essaid Microbiologie Pr. ALLALI Fadoua Rhumatologie Pr. AMAZOUZI Abdellah Ophtalmologie Pr. AZIZ Noureddine* Radiologie Pr. BAHIRI Rachid Rhumatologie Pr. BARKAT Amina Pédiatrie Pr. BENHALIMA Hanane Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale Pr. BENYASS Aatif Cardiologie Pr. BERNOUSSI Abdelghani Ophtalmologie Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed Ophtalmologie Pr. DOUDOUH Abderrahim* Biophysique Pr. EL HAMZAOUI Sakina* Microbiologie Pr. HAJJI Leila Cardiologie (mise en disponibilité) Pr. HESSISSEN Leila Pédiatrie Pr. JIDAL Mohamed* Radiologie Pr. LAAROUSSI Mohamed Chirurgie Cardio-vasculaire Pr. LYAGOUBI Mohammed Parasitologie Pr. NIAMANE Radouane* Rhumatologie Pr. RAGALA Abdelhak Gynécologie Obstétrique Pr. SBIHI Souad Histo-Embryologie Cytogénétique Pr. ZERAIDI Najia Gynécologie Obstétrique
Décembre 2005 Pr. CHANI Mohamed Anesthésie Réanimation
Avril 2006 Pr. ACHEMLAL Lahsen* Rhumatologie
Pr. AKJOUJ Said* Radiologie Pr. BELMEKKI Abdelkader* Hématologie Pr. BENCHEIKH Razika O.R.L Pr. BIYI Abdelhamid* Biophysique Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine Chirurgie - Pédiatrique Pr. BOULAHYA Abdellatif* Chirurgie Cardio – Vasculaire Pr. CHENGUETI ANSARI Anas Gynécologie Obstétrique Pr. DOGHMI Nawal Cardiologie Pr. ESSAMRI Wafaa Gastro-entérologie Pr. FELLAT Ibtissam Cardiologie Pr. FAROUDY Mamoun Anesthésie Réanimation Pr. GHADOUANE Mohammed* Urologie Pr. HARMOUCHE Hicham Médecine Interne Pr. HANAFI Sidi Mohamed* Anesthésie Réanimation Pr. IDRISS LAHLOU Amine* Microbiologie Pr. JROUNDI Laila Radiologie Pr. KARMOUNI Tariq Urologie Pr. KILI Amina Pédiatrie Pr. KISRA Hassan Psychiatrie Pr. KISRA Mounir Chirurgie – Pédiatrique Pr. LAATIRIS Abdelkader* Pharmacie Galénique Pr. LMIMOUNI Badreddine* Parasitologie Pr. MANSOURI Hamid* Radiothérapie Pr. OUANASS Abderrazzak Psychiatrie Pr. SAFI Soumaya* Endocrinologie Pr. SEKKAT Fatima Zahra Psychiatrie Pr. SOUALHI Mouna Pneumo – Phtisiologie Pr. TELLAL Saida* Biochimie Pr. ZAHRAOUI Rachida Pneumo – Phtisiologie
Octobre 2007 Pr. ABIDI Khalid Réanimation médicale Pr. ACHACHI Leila Pneumo phtisiologie Pr. ACHOUR Abdessamad* Chirurgie générale Pr. AIT HOUSSA Mahdi* Chirurgie cardio vasculaire Pr. AMHAJJI Larbi* Traumatologie orthopédie Pr. AMMAR Haddou* ORL Pr. AOUFI Sarra Parasitologie Pr. BAITE Abdelouahed* Anesthésie réanimation directeur ERSSM Pr. BALOUCH Lhousaine* Biochimie-chimie Pr. BENZIANE Hamid* Pharmacie clinique Pr. BOUTIMZINE Nourdine Ophtalmologie Pr. CHARKAOUI Naoual* Pharmacie galénique Pr. EHIRCHIOU Abdelkader* Chirurgie générale Pr. ELABSI Mohamed Chirurgie générale
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid Anesthésie réanimation Pr. EL OMARI Fatima Psychiatrie Pr. GANA Rachid Neuro chirurgie Pr. GHARIB Noureddine Chirurgie plastique et réparatrice Pr. HADADI Khalid* Radiothérapie Pr. ICHOU Mohamed* Oncologie médicale Pr. ISMAILI Nadia Dermatologie Pr. KEBDANI Tayeb Radiothérapie Pr. LALAOUI SALIM Jaafar* Anesthésie réanimation Pr. LOUZI Lhoussain* Microbiologie Pr. MADANI Naoufel Réanimation médicale Pr. MAHI Mohamed* Radiologie Pr. MARC Karima Pneumo phtisiologie Pr. MASRAR Azlarab Hématologie biologique Pr. MOUTAJ Redouane * Parasitologie Pr. MRABET Mustapha* Médecine préventive santé publique et hygiène
Pr. MRANI Saad* Virologie Pr. OUZZIF Ez zohra* Biochimie-chimie Pr. RABHI Monsef* Médecine interne Pr. RADOUANE Bouchaib* Radiologie Pr. SEFFAR Myriame Microbiologie Pr. SEKHSOKH Yessine* Microbiologie Pr. SIFAT Hassan* Radiothérapie Pr. TABERKANET Mustafa* Chirurgie vasculaire périphérique Pr. TACHFOUTI Samira Ophtalmologie Pr. TAJDINE Mohammed Tariq* Chirurgie générale Pr. TANANE Mansour* Traumatologie orthopédie Pr. TLIGUI Houssain Parasitologie Pr. TOUATI Zakia Cardiologie
Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN Ophtalmologie
Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed* Anesthésie Réanimation Pr TAHIRI My El Hassan* Chirurgie Générale Mars 2009 Pr. ABOUZAHIR Ali* Médecine interne Pr. AGDR Aomar* Pédiatre Pr. AIT ALI Abdelmounaim* Chirurgie Générale Pr. AIT BENHADDOU El hachmia Neurologie Pr. AKHADDAR Ali* Neuro-chirurgie Pr. ALLALI Nazik Radiologie Pr. AMAHZOUNE Brahim* Chirurgie Cardio-vasculaire
Pr. AMINE Bouchra Rhumatologie Pr. ARKHA Yassir Neuro-chirurgie Pr. AZENDOUR Hicham* Anesthésie Réanimation Pr. BELYAMANI Lahcen* Anesthésie Réanimation Pr. BJIJOU Younes Anatomie Pr. BOUHSAIN Sanae* Biochimie-chimie Pr. BOUI Mohammed* Dermatologie Pr. BOUNAIM Ahmed* Chirurgie Générale Pr. BOUSSOUGA Mostapha* Traumatologie orthopédique Pr. CHAKOUR Mohammed * Hématologie biologique Pr. CHTATA Hassan Toufik* Chirurgie vasculaire périphérique Pr. DOGHMI Kamal* Hématologie clinique Pr. EL MALKI Hadj Omar Chirurgie Générale Pr. EL OUENNASS Mostapha* Microbiologie Pr. ENNIBI Khalid* Médecine interne Pr. FATHI Khalid Gynécologie obstétrique Pr. HASSIKOU Hasna * Rhumatologie Pr. KABBAJ Nawal Gastro-entérologie Pr. KABIRI Meryem Pédiatrie Pr. KARBOUBI Lamya Pédiatrie Pr. L’KASSIMI Hachemi* Microbiologie Pr. LAMSAOURI Jamal* Chimie Thérapeutique Pr. MARMADE Lahcen Chirurgie Cardio-vasculaire Pr. MESKINI Toufik Pédiatrie Pr. MESSAOUDI Nezha * Hématologie biologique Pr. MSSROURI Rahal Chirurgie Générale Pr. NASSAR Ittimade Radiologie Pr. OUKERRAJ Latifa Cardiologie Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani * Pneumo-phtisiologie Pr. ZOUHAIR Said* Microbiologie
PROFESSEURS AGREGES : Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha Anesthésie réanimation Pr. AMEZIANE Taoufiq* Médecine interne Pr. BELAGUID Abdelaziz Physiologie Pr. BOUAITY Brahim* ORL Pr. CHADLI Mariama* Microbiologie Pr. CHEMSI Mohamed* Médecine aéronautique Pr. DAMI Abdellah* Biochimie chimie Pr. DARBI Abdellatif* Radiologie Pr. DENDANE Mohammed Anouar Chirurgie pédiatrique Pr. EL HAFIDI Naima Pédiatrie Pr. EL KHARRAS Abdennasser* Radiologie Pr. EL MAZOUZ Samir Chirurgie plastique et réparatrice
Pr. EL SAYEGH Hachem Urologie Pr. ERRABIH Ikram Gastro entérologie Pr. LAMALMI Najat Anatomie pathologique Pr. LEZREK Mounir Ophtalmologie Pr. MALIH Mohamed* Pédiatrie Pr. MOSADIK Ahlam Anesthésie Réanimation Pr. MOUJAHID Mountassir* Chirurgie générale Pr. NAZIH Mouna* Hématologie Pr. ZOUAIDIA Fouad Anatomie pathologique Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed Chirurgie Pédiatrique Pr. ABOUELALAA Khalil* Anesthésie Réanimation Pr. BELAIZI Mohamed* Psychiatrie Pr. BENCHEBBA Driss* Traumatologie Orthopédique Pr. DRISSI Mohamed* Anesthésie Réanimation Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna Chirurgie Générale Pr. EL KHATTABI Abdessadek* Médecine Interne Pr. EL OUAZZANI Hanane* Pneumophtisiologie Pr. ER-RAJI Mounir Chirurgie Pédiatrique Pr. JAHID Ahmed Anatomie pathologique Pr. MEHSSANI Jamal* Psychiatrie Pr. RAISSOUNI Maha* Cardiologie Février 2013
Pr. AHID Samir Pharmacologie – Chimie Pr. AIT EL CADI Mina Toxicologie Pr. AMRANI HANCHI Laila Gastro-Entérologie Pr. AMOUR Mourad Anesthésie Réanimation Pr. AWAB Almahdi Anesthésie Réanimation Pr. BELAYACHI Jihane Réanimation Médicale Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain Anesthésie Réanimation Pr. BENCHEKROUN Laila Biochimie-Chimie Pr. BENKIRANE Souad Hématologiebiologique Pr. BENNANA Ahmed* Informatique Pharmaceutique Pr. BENSEFFAJ Nadia Immunologie Pr. BENSGHIR Mustapha* Anesthésie Réanimation Pr. BENYAHIA Mohammed* Néphrologie Pr. BOUATIA Mustapha Chimie Analytique Pr. BOUABID Ahmed Salim* Traumatologie Orthopédie Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba Anatomie Pr. CHAIB Ali* Cardiologie Pr. DENDANE Tarek Réanimation Médicale Pr. DINI Nouzha* Pédiatrie Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali Anesthésie Réanimation Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa Radiologie
Pr. ELFATEMI Nizare Neuro-Chirurgie Pr. EL GUERROUJ Hasnae Médecine Nucléaire Pr. EL HARTI Jaouad Chimie Thérapeutique Pr. EL JOUDI Rachid* Toxicologie Pr. EL KABABRI Maria Pédiatrie Pr. EL KHANNOUSSI Basma Anatomie Pathologie Pr. EL KHLOUFI Samir Anatomie Pr. EL KORAICHI Alae Anesthésie Réanimation Pr. EN-NOUALI Hassane* Radiologie Pr. ERRGUIG Laila Physiologie Pr. FIKRI Meryim Radiologie Pr. GHANIMI Zineb Pédiatrie Pr. GHFIR Imade Médecine Nucléaire Pr. IMANE Zineb Pédiatrie Pr. IRAQI Hind Endocrinologie et maladies métaboliques Pr. KABBAJ Hakima Microbiologie Pr. KADIRI Mohamed* Psychiatrie Pr. LATIB Rachida Radiologie Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra Médecine Interne Pr. MEDDAH Bouchra Pharmacologie Pr. MELHAOUI Adyl Neuro-chirurgie Pr. MRABTI Hind Oncologie Médicale Pr. NEJJARI Rachid Pharmacognosie Pr. OUBEJJA Houda Chirurgie Pédiatrique Pr. OUKABLI Mohamed* Anatomie Pathologique Pr. RAHALI Younes Pharmacie Galénique Pr. RATBI Ilham Génétique Pr. RAHMANI Mounia Neurologie Pr. REDA Karim* Ophtalmologie Pr. REGRAGUI Wafa Neurologie Pr. RKAIN Hanan Physiologie Pr. ROSTOM Samira Rhumatologie Pr. ROUAS Lamiaa Anatomie Pathologique Pr. ROUIBAA Fedoua* Gastro-Entérologie Pr. SALIHOUN Mouna Gastro-Entérologie Pr. SAYAH Rochde Chirurgie Cardio-Vasculaire Pr. SEDDIK Hassan* Gastro-Entérologie Pr. ZERHOUNI Hicham Chirurgie Pédiatrique Pr. ZINE Ali* Traumatologie Orthopédie Avril 2013 Pr. EL KHATIB Mohamed Karim* Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale Pr. GHOUNDALE Omar* Urologie Pr. ZYANI Mohammad* Médecine Interne
2- ENSEIGNANTS – CHERCHEURS SCIENTIFIQUES PROFESSEURS / PRs. HABILITES
Pr. ABOUDRAR Saadia Physiologie Pr. ALAMI OUHABI Naima Biochimie – chimie Pr. ALAOUI KATIM Pharmacologie Pr. ALAOUI SLIMANI Lalla Naïma Histologie-Embryologie Pr. ANSAR M’hammed Chimie Organique et Pharmacie Chimique Pr. BOUHOUCHE Ahmed Génétique Humaine Pr. BOUKLOUZE Abdelaziz Applications Pharmaceutiques Pr. BOURJOUANE Mohamed Microbiologie Pr. BARKYOU Malika Histologie-Embryologie Pr. CHAHED OUAZZANI Lalla Chadia Biochimie – chimie Pr. DAKKA Taoufiq Physiologie Pr. DRAOUI Mustapha Chimie Analytique Pr. EL GUESSABI Lahcen Pharmacognosie Pr. ETTAIB Abdelkader Zootechnie Pr. FAOUZI Moulay El Abbes Pharmacologie Pr. HAMZAOUI Laila Biophysique Pr. HMAMOUCHI Mohamed Chimie Organique Pr. IBRAHIMI Azeddine Biologie moléculaire Pr. KHANFRI Jamal Eddine Biologie Pr. OULAD BOUYAHYA IDRISSI Med Chimie Organique Pr. REDHA Ahlam Chimie Pr. TOUATI Driss Pharmacognosie Pr. ZAHIDI Ahmed Pharmacologie Pr. ZELLOU Amina Chimie Organique
Mise à jour le 09/01/2015 par le
Service des Ressources Humaines
*Enseignants Militaires
A ma très chère mère
Mme DAMI ETTALIBI
Ce travail est le fruit de tes efforts, des longues années de
sacrifices aux quels tu as consentis.
Je ne trouverais jamais assez de mots pour t’exprimer toute ma
gratitude et mon affection.
Que Dieu t’accorde longue vie et te rende au centuple tout ce
que tu fais pour nous
A mon très cher père
Mr IBRAHIM BELAOUFI
.
Tu as remplis ton devoir envers tes enfants, tu nous a mis dans
le droit chemin. Tu nous as appris la simplicité, la politesse, le
respect des autres et l’honnêteté. Nous sommes fiers de toi.
Reçoit à ton tour le témoignage de notre respect et de notre
reconnaissance infinis. Que dieu te garde longtemps parmi
nous.
A la mémoire de mes grands parents
Qui ont été toujours dans mon esprit et dans mon cœur, je
vous dédie aujourd’hui ma réussite.
Que Dieu, le miséricordieux, vous accueille dans son éternel
paradis.
A mon frère et mon maitre de stage d’officine
Dr KARIM EDDINE BELAOUFI
Tes conseils de pharmacien aguerri. Ta patience sans fin, ta
compréhension et ton encouragement sont pour moi le soutien
indispensable que tu as toujours su m’apporter. Je te dois ce
que je suis aujourd’hui et ce que je serai demain et je ferai
toujours de mon mieux pour rester ta fierté et ne jamais te
décevoir.
A mes chers frères et sœurs
Fouzia,fatiha ,nezha ,halima ,amina ,laouni,karim
,youssef,yassine,mohamed .
En témoignage de mon affection fraternelle et profonde
estime.Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite.
Restons unis et solidaires.
A tous mes cousins et cousines
Ratiba,Yasmine,mouna,nejwa,loubna,zineb,dounia, adib
ahmed, ,….
En témoignage de mon affection.
Aux familles
Belaoufi,ettalibi,elaoufi,salama ,cherkaoui
Merci de m’avoir accueillir parmi vous. Puisse ce travail
témoigner de ma profonde affection et de ma sincère estime.
A mes chères ami(e)s et collègues
Soukaina , majda ,ouassila ,sara,wafae,hanane ,souad,
moulk, jihane ,nadia, hassan, ,yassine,redouane …..,
Je ne peux trouver les mots justes et sincères pour vous
exprimer mon affection et mes pensées, vous êtes pour moi des
frères, soeurs et des amis sur qui je peux compter.
En témoignage de l’amitié qui nous uni et des souvenirs de
tous les moments que nous avons passé ensemble, je vous
dédie ce travail et je vous souhaite une vie pleine de santé et
de joie
A tous les enseignants qui ont participé à ma formation.
A tous ceux ou celles qui me sont chers et que j’ai omis
involontairement de citer…
A NOTRE MAITRE ET PRESIDENT DE JURY
Le Professeur EL BARDOUNI Ahmed
Qui m'a fait l'honneur en acceptant de présider le jury de cette
thèse.
J'ai eu le privilège de profiter de votre enseignement, et j'espère
être digne de votre confiance.
Que ces lignes puissent témoigner de mon grand respect, ma
très haute considération et ma profonde reconnaissance.
A Allah
Tout puissant
Qui m’a inspiré
Qui m’a guidé dans le bon chemin
Je vous dois ce que je suis devenue
Louanges et remerciements
Pour votre clémence et miséricorde.
A
Notre maître et présidente de thèse
Madame le le professeur SAIDA TELLAL
Professeur de Biochimie
Vous nous avez accordé un immense honneur
et un grand privilège en acceptant la présidence de notre jury
de thèse.
Nous vous prions, cher Maître, d'accepter dans ce travail le
témoignage de notre haute considération,
de notre profonde reconnaissance et de notre sincère respect.
A
Notre maître et rapporteur de these
Madame le le professeur KATIM ALAOUI
Professeur de Pharmacologie
et
Presidente de la Fondation MohammedVI pour la recherche
et la sauvegade de l’arganier
Nous tenons à vous exprimer toute notre reconnaissance,pour
l’honneur que vous nous avez fait en acceptant de diriger ce
travail.
Vous nous avez toujours réservé le meilleur accueil malgré vos
obligations professionnelles. .
Vos conseils et vos orientations nous ont été très précieux.
Nous espérons être dignes de votre confiance.
Veuillez trouver ici, cher Maître, l’expression de nos vifs
remerciements et de notre estime.
A
Notre maître et juge de thèse
Madame le le professeur FATIMA JABOUIRIK
Professeur de Pédiatrie
Nous sommes profondément reconnaissants de l’honneur que
vous nous faites en acceptant de juger ce travail.
Nous avons apprécié votre accueil bienveillant, votre gentillesse
ainsi que votre compréhension.
Veuillez trouver dans ce travail l’expression de notre grande
attention et notre profond respect.
A
Notre maître et juge de thèse
Monsieur le professeur Abdelkader LAATIRIS
Professeur de Pharmacie Galénique
Nous sommes très fières et nous vous remercions de l’honneur
que vous nous faites en acceptant de juger notre travail qui est
pour nous l’occasion de vous témoigner notre respect et notre
profonde considération.
Puisse ce travail être digne de votre confiance et vos
compétences professionnelle
Liste des Abréviations
A.B : Agriculture biologique
AFNOR : Association française de normalisation
AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
AMM : Autorisation de mise sur le marché
ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
Aw : Activité de l’eau : water activity
BHA : Butyl HydroxyAnisol
BHT : ButylHydroxyToluène
Bio : Biologique
BPF : Bonnes Pratiques de Fabrication
CCAM : Comité de Contrôle de l'Attribution de la Mention
CE : Communauté Européenne
CFTA : Association des cosmétiques, produits de toilette et parfums
CI : Color Index
CIR : Révision des Ingrédients Cosmétiques
CMR : Substances chimiques Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour Reproduction
COFRAC : Comité Français d’Accréditation
COLIPA : Comité de liaison de la parfumerie
DEFI : Dispositif Exclusif Formule Intacte
DGCCRF : Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes
DMP : Direction du Médicament et de la Pharmacie
Fig : Figure
H.E.B.B.D : Huile Essentielle Botaniquement et Biochimiquement Définie
HAS : Hyaluronicacidsynthase
HECT : Huile Essentielle Chémotypée
INCI : International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
INPI : Institut National de la Propriété Industrielle
ISO : Organisation internationale de normalisation
MIT : Methylisothiazolinone
MCF-7 : Michigan Cancer Foundation-7
OGM : organismes génétiquement modifiés
PAO : Période Après Ouverture
PBT : Substances persistantes bioaccumulables et toxiques;
PEG : polyéthylène glycol
QAI : Quality Assurance International
RBA : Relative binding affinity
REACH : Enregistrement, Evaluation, autorisation et restriction des produits Chimiques
SCCP : Comité scientifique desproduits de consommation
SCCS : Scientific Committee on Consumer Safety
SFD : Société Française de Dermatologie
Tab : Tableau
UHT : Ultra Haute Température
UVB : UltraViolet B
VPvB : Substances très persistantes et très bioaccumulables
Liste des tableaux
Tab.1 : Spécifications microbiologiques selon la catégorie du produit -------------------------- 31
Tab2: Tableau récapitulatif des propriétés physico-chimiques des principaux parabènes ---- 56
Tab3: Valeurs d’aw minimales permettant la croissance de microorganismes représentatifs, à
25°C -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84
Tab 4: Domaines de pH de croissance des microorganismes ------------------------------------- 85
Tab5: Différents conservateurs utilisés dans les cosmétiques bios, avec pour information, les
labels bio les autorisant --------------------------------------------------------------------------------- 92
Tab 6: Données sur l’origine, la nature et le potentiel antimicrobien des agents de
conservation autorisés par le référentiel Cosmo-Standard. ----------------------------------------- 93
Liste des figures
Fig.1: Structure de la peau. ------------------------------------------------------------------------------- 6
Fig.2:Différentes couches et cellules de l’épiderme. ------------------------------------------------ 10
Fig.3:Vue en coupe (à gauche) et du dessus (à droite) du bout d'un doigt et son ongle ------- 13
Fig.4 : Schéma d’un follicule pileux . ----------------------------------------------------------------- 14
Fig.5: Composition d’un produit cosmétique . ------------------------------------------------------- 19
Fig.6 : Les mentions obligatoires et non obligatoir concernant l’étiquetage -------------------- 43
Fig.7: Structure générale d'un parabène -------------------------------------------------------------- 54
Fig.8: Synthèse d’acide para-hydroxybenzoïque par la réaction de Kolbe-Schmitt) ---------- 54
Fig.9: Structures des principaux parabènes . --------------------------------------------------------- 55
Fig.10: Organisation du Système endocrinien ----------------------------------------------------------- 64
Fig.11: Evolution de la nature du conservateur et de la concentration utilisée dans les produits
cosmétiques analysés par la société COSMEPAR entre 2010 et 2013. ------------------------------- 75
Fig.12: Evolution de la non-conformité des challenges tests pour les produits cosmétiques testés
par la société COSMEPAR entre 2010 et 2013 (non conforme ou critère B). ----------------------- 75
Fig.13: Evolution du potentiel irritant des formules cosmétiques entre 2008 et 2013 -------------- 76
Fig.14: Structure chimique du Methylisothiazolinone (MIT) ------------------------------------------ 76
Fig .15: Structure chimique du phénoxyéthanol. --------------------------------------------------------- 78
Fig.16: Monodoses stériles de démaquillant yeux Toleriane de LaRoche-Posay®. ---------------- 80
Fig.17: Flacon pompe du soin Toleriane Ultra de LaRoche-Posay®. ------------------------------- 81
Fig.18: D.E.F.I., Laboratoires AVENE®. ---------------------------------------------------------------- 82
Fig.19: Soin contour des yeux Dermatherm®. ----------------------------------------------------------- 83
Fig.20: Différents logos en place sur les flacons d’huiles essentielles certifiant leur qualité ----- 88
Fig.21: Label ECOCERT. ----------------------------------------------------------------------------------- 98
Fig.22: Résumé des étapes du contrôle et de certification ECOCERT -------------------------------- 99
Fig.23: Label Qualité France. ------------------------------------------------------------------------------- 99
Fig.24: Label Nature & Progrès. ------------------------------------------------------------------------- 101
Fig.25: Label BIO COSMEBIO. ------------------------------------------------------------------------- 103
Fig .26: Label ECO COSMEBIO. ----------------------------------------------------------------------- 103
Fig.27: label AB. ------------------------------------------------------------------------------------------- 104
Fig.28: Label BDIH. --------------------------------------------------------------------------------------- 105
Fig.29: Label Soil Association.--------------------------------------------------------------------------- 106
Fig.30: Label Ecogarantie. -------------------------------------------------------------------------------- 107
Fig.31: Label AIAB. --------------------------------------------------------------------------------------- 108
Fig.32: Label Soil Association-COSMOS. ------------------------------------------------------------- 110
Fig.33: Label NaTrue. ------------------------------------------------------------------------------------- 111
Fig.34: Nouveau label NaTrue. --------------------------------------------------------------------------- 112
Fig.35: Logotype WELEDA. ----------------------------------------------------------------------------- 113
Fig.36: Logotype SANOFLORE. ------------------------------------------------------------------------ 115
Fig.37: Logotype DR HAUSCHKA. -------------------------------------------------------------------- 116
Fig.38: Logotype NUXE .--------------------------------------------------------------------------------- 117
Fig.39: Logotype CAUDALIE. -------------------------------------------------------------------------- 118
Fig.40: Logotype KIBIO ---------------------------------------------------------------------------------- 118
Fig.41: Logotype CATTIER. ----------------------------------------------------------------------------- 119
Fig.42 : Répartition selon le sexe. ------------------------------------------------------------------------ 126
Fig.43 : Répartition selon la tranche d'âge. ------------------------------------------------------------- 126
Fig.44 : Lieux d'achat des produits cosmétiques. ------------------------------------------------------ 127
Fig.45 : Éléments importants lors de l'achat d'un produit cosmétique. ------------------------------ 127
Fig .46: Achat des cosmétiques bios --------------------------------------------------------------------- 128
Fig.47: Motivations d'achat des cosmétiques bio ------------------------------------------------------ 128
Fig.48:Catégories des cosmétiques bios consommés -------------------------------------------------- 129
Table des Matières
INTRODUCTION .................................................................................................................... 1
PARTIE 1 : LES COSMETIQUES
1- Définition d’un produit cosmétique: ............................................................................... 4
2- Frontière avec le médicament : ....................................................................................... 4
3- Rappels sur la peau .......................................................................................................... 5
3.1- La structure de la peau ............................................................................................. 5
3.2- Pénétration percutanée des cosmétiques ................................................................ 14
4- Les composants d’un produit cosmétique ..................................................................... 19
4.1- Le Principe Actif ....................................................................................................... 19
4.2- Les excipients ........................................................................................................... 19
5- Catégories de Cosmétiques ........................................................................................... 25
6- Produits frontières ......................................................................................................... 27
7- Stabilité des cosmétiques .............................................................................................. 28
7.1- Introduction ............................................................................................................... 28
7.2- Analyse microbiologique du produit ......................................................................... 29
8- Réglementation des cosmétiques .................................................................................. 32
8.1- Réglementation européenne : ................................................................................... 32
8.1.1- Les institutions en charge des produits cosmétiques .............................................. 34
8.1.2-Réglementation en matière de fabrication ............................................................... 35
8.1.3-Règlementation relatives à la composition des produits cosmétiques ..................... 37
8.1.4- Dossier d’Information Produit : ............................................................................. 38
8.1.5- Règlement en matière d’étiquetage ....................................................................... 39
8.1.6- Expérimentation animale ....................................................................................... 43
8.1.7-Réglementation des substances chimiques .............................................................. 44
8.1.8- Cosmétovigilance .................................................................................................. 47
8.2- Réglementation Marocaine ....................................................................................... 49
PARTIE 2 : LES PARABENES
1- Généralités ..................................................................................................................... 53
1.1- Structure chimique et synthèse .............................................................................. 53
1.2- Propriétés physico-chimiques ................................................................................ 55
1.3- Origine ................................................................................................................... 57
1.4- Action contre les micro-organismes ...................................................................... 57
1.5- Utilisation des parabènes dans les cosmétiques ..................................................... 58
1.6- Pharmacocinétique ................................................................................................. 59
2- Polémique sur les parabènes : Eléments ....................................................................... 62
2.1- Etude de Dabre, 2004 : origine de la polémique .................................................... 62
2.2- Parabènes et Perturbation Endocrinienne .............................................................. 63
2.3- Activité oestrogénique des parabènes : .................................................................. 64
2.4- Effets sur le système reproducteur ......................................................................... 66
2.5- Parabènes et cancer de sein .................................................................................... 67
2.6- Parabènes et Vieillissement cutané ........................................................................ 68
3- Réglementation des parabènes ...................................................................................... 69
3.2- Réglementation aux Etats-Unis .............................................................................. 71
3.3. Réglementation au Canada ....................................................................................... 71
PARTIE 3 : LES ALTERNATIVES PROPOSEES
1- La mention « Sans Parabènes » : ça veut dire quoi ? ...................................................... 73
2- Alternatives proposées .................................................................................................. 74
2.1- D’autres alternatives chimiques ............................................................................. 74
2.2- Alternatives techniques .......................................................................................... 79
2.3. Adaptation des formulations : Autoprotection ....................................................... 83
2.4- Alternatives naturelles .......................................................................................... 86
2.5- Alternatives chimiques retrouvées à l’état naturel:Les conservateurs « nature-identiques » ....................................................................................................................... 91
PARTIE 4 : LES COSMETIQUES BIO
1- Introduction ................................................................................................................... 96
1.1- Définition d’un produit cosmétique biologique : ................................................... 96
1.2- Différences entre Cosmétique biologique et Cosmétique naturelle ....................... 97
1.3- Différences entre Cosmétique conventionnelle et Cosmétique biologique ........... 97
2- Labels et certification .................................................................................................... 98
2.1-Certification des cosmétiques biologiques ................................................................. 98
2.2- Labels en cosmétique biologique ........................................................................... 100
2.2.2- Labels en France ............................................................................................... 101
2.2.3- Labels étrangers ................................................................................................ 105
3- Cosmétiques biologiques présents à l’officine ............................................................ 113
3.1- Les gammes purement « bio » ................................................................................ 113
3.1.1- WELEDA ............................................................................................................. 113
3.1.2- SANOFLORE ....................................................................................................... 115
3.1.3- DR HAUSCHKA ................................................................................................ 116
3.2- Les gammes classiques qui tendent vers le « bio » ................................................. 117
3.2.1- BIO BEAUTE BY NUXE .................................................................................... 117
3.2.2- CAUDALIE .......................................................................................................... 118
3.3- Autres gammes « bio » ........................................................................................... 118
3.3.1- KIBIO ® ............................................................................................................... 118
3.3.2- CATTIER ............................................................................................................ 119
4- Avantages et inconvénients de la cosmétique « bio » ................................................ 120
4.1- Avantages de la cosmétique « bio » ..................................................................... 120
4.2- Inconvénients de la cosmétique « bio » ............................................................... 121
PARTIE 5 : Enquête sur les habitudes d’achat des cosmétiques et la perception des cosmétiques bio chez le consommateur marocain
1 - Introduction……………………………………………………………………..111
3 - Matériels et méthodes…………………………………………………………..111
4 - Résultats de l’enquête…………………………………………………………..112
5 - Interprétation de l’enquête…………………………………………………….. 116
6 - Conclusion de l’enquête………………………………………………………..118
Conclusion et Perspectives………………………………………………………………...119
Résumés………………………………………………………………………………..........121
Bibliographie……………………………………………………………………….............131
Webographie………………………………………………………………………..............139
INTRODUCTION
La mise en valeur du corps semble être une préoccupation relativement récente, pourtant elle
est très ancienne et remonte à l’Antiquité : Les classes aisées de l’Egypte ancienne utilisaient
de nombreuses substances naturelles pour s’embellir, notamment le khôl (fard issu de la
carbonisation de la substance grasse) pour mettre en valeur les traits de leur visage. Par la
suite, ce sont les romains des premiers siècles de notre ère, notamment Néron et Poppée, qui
utilisaient la craie (calcaire d’origine marine) et la céruse (carbonate de plomb) pour
s’éclaircir la peau à des fins esthétiques. Ainsi, à l’origine, les premiers cosmétiques ont été
conçus a partir d’éléments naturels ayant subi très peu de transformation.
Par la suite , la révolution industrielle ainsi que les découvertes de la chimie ont permis aux
hommes de s’affranchir progressivement des contraintes imposées par la nature .Ainsi, la
synthèse de nouvelles molécules a permis de faire évoluer les cosmétiques afin qu’ ils
répondent de mieux en mieux aux attentes des consommateurs .Effectivement, les
cosmétiques ainsi crées se conservent plus longtemps, ont des textures et des parfums plus
agréables, et renferment des actifs plus efficaces.
Cependant, ces avancées ont leur contrepartie .en effet, ces nouvelles molécules s’avèrent
parfois nocives pour l’organisme. C’est notamment le cas des parabènes conservateurs
présents dans de très nombreux produits cosmétiques sont depuis quelque années à l’ origine
de controverses diverses concernant leur effet perturbateur endocrinien et leur possible
implication dans le cancer du sein.la médiatisation de ce sujet crée un climat d'inquiétude
chez le consommateur et l’amènent à chercher des réponses à ses inquiétudes notamment sur
internet. En effet, nombre sont les consommateurs qui alimentent de leurs questions et de
leurs points de vue, des blogs, des discussions en ligne et des articles tout public .ce
phénomène maintient alors la psychose et la désinformation.
Par conséquent ,les consommateurs qui se sentent concernés cherchent de plus en plus à fuir
ces substances et se tournent vers une nouvelle génération de cosmétiques, qui se veut plus
proche de la nature, que se soit par le respect et la protection de l'environnement ou par le
respect de la santé humaine en évitant certains ingrédients de la cosmétique traditionnelle
jugés dangereux. Cette effervescence pour les produits cosmétiques « naturels » et « bio »s’est
2
aussi confirmée à l’intérieur de nos officines. La demande est aujourd’hui si forte que de réels
espaces leurs sont dédiés.
C’est dans ce contexte qu’il m’a semblé intéressant de faire un état des lieux de la situation
autour des parabènes et de la cosmétique bio, telle qu’elle est en 2016. En tant que
pharmacien, nous devons disposer d’une information scientifique, claire, complète et
actualisée autour des produits de santé pour pouvoir répondre à toutes les interrogations de
nos patients et leur donner un conseil personnalisé .
Dans un premier temps nous allons nous intéresser aux produits cosmétiques et leur
réglementation actuelle.
Puis nous ferons une description complète des parabènes et après nous aborderons l’analyse
des études qui sont à l’ origine de la controverse des parabènes.
Nous discuterons en suite les différentes alternatives aux parabènes disponibles aujourd’hui
sur le marché
Enfin, nous avons cherché à connaître les différences qu’apportent les cosmétiques
biologiques. Pèsent-ils vraiment dans la balance en ce qui concerne notre santé ? Que veulent
dire les différents labels apposés sur les Packagings ? .ainsi nous ferons le point sur l’offre
actuelle des cosmétiques bio proposées par les pharmacies d’officines.
4
1- Définition d’un produit cosmétique:
La définition d’un produit cosmétique est donnée par l’article L.5131-1du Code de la Santé
Publique:
« On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en
contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les
systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec
les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer,
de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de
corriger les odeurs corporelles »[W1].
Cette définition n’est pas nouvelle puisqu’elle a été établie à peu près sous cette forme lorsde
la rédaction de la loi française de 1975, imposant une réglementation des
produitsCosmétiques à la suite de la tragique affaire du talc Mohrange (36 enfants décédés et
168 autres gravement intoxiqués, suite à une erreur de manipulation lors de la fabrication du
produit)[W2].
2- Frontière avec le médicament :
La définition française du médicament selon le Code de la santé publique article L5111-1 est
la suivante :
« On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que
toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou
pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger
ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique,
immunologique ou métabolique » [W3].
On pourrait dire que le médicament présente une efficacité thérapeutique vis-à-vis d’un
individu malade, le produit cosmétique présente une efficacité « physiologique » limitée à
5
l’enveloppe cutanée ou muqueuse d’un individu sain ou présumé tel et ne constitue en aucun
cas un traitement pour un individu malade.
La différenciation sera néanmoins toujours délicate, les critères de définition du médicament
pouvant s’appuyer sur la présentation, la fonction, la composition, le vocabulaire employé.
Selon les revendications, un produit pourrait donc être cosmétique ou médicament. Ainsi, un
produit anti-acnéique est un médicament, l’acné étant une pathologie; la même
formuleconsidérée comme « régulatrice de la sécrétion sébacée » représenterait un produit
cosmétique.
Sur un plan législatif, le médicament nécessite l’obtention d’une autorisation de mise sur le
marché ou AMM auprès du Ministère de la Sante alors que le cosmétique ne requiert qu’une
déclaration auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé
accompagnée d’un dossier technique.
3- Rappels sur la peau
3.1- La structure de la peau
La peau constitue l’organe le plus lourd (masse) et le plus étendu (superficie) du corps
humain, avec une surface de 1.5 m² à 2 m² pour une épaisseur de 0.5 à 4 mm et un poids de
3kg.
La structure cutanée est une structure hétérogène composé de 3 couches superposées :
épiderme, derme et hypoderme, et des annexes cutanées (phanères, glandes sudoripares et
sébacées) (fig1)[1].
6
3.1.1- L’épiderme:
Couchela plus superficielle de la peau, l’épiderme est un épithélium stratifié pavimenteux
kératinisé reposant sur le derme par la jonction dérmo-épidermique.
L’épiderme n’est irrigué par aucun vaisseau sanguin et est seulement alimenté par diffusion
depuis le derme. Il se compose de quatre types de cellules et de quatre à cinq couches
distinctes (selon le site anatomique). C'est un système cinétique hautement organisé, en
renouvellement constant. Les cellules épidermiques prolifèrent au niveau de sa couche la plus
profonde soitla couche basale, et se différencient au cours de leur migration vers les couches
supérieures pour former successivement la couche épineuse, la couche granuleuse, la couche
claire et la couche cornée [3,4].
3.1.1.1- Cellules de l’épiderme
L’épiderme comprend 4 types de cellules ayant chacune une structure et des fonctions bien
précises :
• Kératinocytes : (keras: corne ; kytos: cellule)
Constituent 90% des cellules épidermiques. La division cellulaire a lieu dans la couche basale
et la
Fig.1: Structure de la peau [2].
7
différenciation se fait lors de la migration vers la surface de la peau où les cellules meurent et
desquament. Durant leur ascension, ces cellules migrent de manière ordonnée et produisent de
la kératine [4], protéine fibreuse et résistante qui protège la peau et les tissus sous-jacents
contre la chaleur et les substances chimiques. Les kératinocytes produisent des granules
lamellés qui libèrent un enduit imperméabilisant.
• Les mélanocytes : (melas: noir)
Constituant environ 8% des cellules épidermiques, les mélanocytes sont des cellules de
grande taille avec des prolongements cytoplasmiques appelés dendrites qui s’insinuent entre
les kératinocytes. Ils sont insérés dans la couche basale germinative et reposent sur la lame
basale. Ils présentent des vésicules renfermant des mélanosomes, organites responsables de la
synthèse de la mélanine, pigment brun colorant la peau et absorbant des rayonnements
ultraviolets [5].
• Les cellules de Langerhans :
De forme étoilée et mobiles, elles se déplacent entre le derme et l’épiderme. Ces cellules sont
considérées comme des macrophages intraépidermiques, elles sont produites dans la moelle
osseuse puis migrent dans l’épiderme. Les cellules de Langerhans interviennent notamment
dans les phénomènes immunologiques épidermiques, dans la maturation des cellules
épithéliales, dans la kératinisation et dans la régulation des mitoses.
• Les cellules de Merckel :
Ce sont les moins nombreuses de l’épiderme. Situées dans la couche la plus profonde de
l’épiderme, elles entrent en contact avec le prolongement aplati (portion réceptrice) d’un
neurone sensitif, appelé corpuscule tactile non capsulé ou encore disque de Merkel. Ensemble,
les cellules de Merkel et les corpuscules tactiles non capsulés constituent un récepteur
sensoriel cutané qui détecte différents types de stimulus tactile [5].
8
3.1.1.2-Couches de l’épiderme
L’épiderme se subdivise en plusieurs couches (Fig.2), leur nombre est variable en fonction du
site anatomique.
• La couche germinative ou couche basale (stratum germinativium) :
Couche la plus profonde de l’épiderme à la jonction du derme, elle abrite les mélanocytes.
représente également le lieu de départ des kératinocytes qui assurent le renouvellement
cellulaire de la peau grâce à des mitoses successives [6]. Certains kératinocytes restent dans la
couche basale et d'autres migrent vers les autres couches pour se spécialiser en exerçant une
pression sur les cellules supérieures.
• La couche de Malpighi ou couche « épineuse » (stratum spinosum) :
Les kératinocytes commencent à s’aplatir et sont répartis sur huit à dix couches pour former
l’essentiel de l’épaisseur de l’épiderme. Les filaments de kératine deviennent plus épais et
plus denses, d’où cet aspect de cellules à épines qui les caractérise. Cette couche confère à la
peau sa résistance et sa souplesse.
• La couche granuleuse (stratum granulosum) :
Les cellules sont considérablement aplaties et sont réparties sur 3 à 5 couches. Leurs noyaux
et organites commencent à dégénérer et les filaments intermédiaires deviennent de plus en
plus présents. L’aspect granuleux est dû à la présence de grains de kératohyaline présents dans
les cellules et de petits grains lamellaires : les kératinosomes ou corps d’Odland.Les
kératinosomes riches en phospholipides, lipides et protéines, contiennent des granules
lamellés qui libèrent une sécrétion lipidique qui comble les espaces entre les cellules
superficielles de l’épiderme et améliore son étanchéité [4].
9
• La couche claire (stratum lucidium) :
Ce stratum lucidiumn’est présent que dans la peau du bout des doigts, de la paume de la main
et de la plante des pieds. Cette couche est constituée de plusieurs strates de kératinocytes
aplatis ou morts et aux contours mal définis [5]. La couche claire a pour mission de servir de
barrière à la peau, contre les agressions physiques (coupures, piqures, …) mais aussi
chimiques (xénobiotiques, solvants).
• La couche cornée (stratum corneum):
C’est la couche la plus superficielle de l’épiderme. Elle est constituée de 20 à 30 strates de
cellules. La couche cornée est composée de cellules anucléées formées d'un cytosquelette de
kératine et empilées les unes sur les autres, appelées cornéocytes. Les cornéocytes, éléments
constitutifs du stratum corneum, sont des cellules mortes, plates, contenant de l’eau et de la
kératine.
La couche cornée présente deux parties [5], une partie où les 2cornéocytes sont encore reliés
les uns aux autres grâce aux cornéodesmosomes, et une autre partie où sous l’action
d’enzymes spécifiques, les cornéodesmosomes se dégradent, permettant aux cornéocytes de
se détacher : c’est la desquamation. Ce processus participe au renouvellement continu de
l’épiderme.
10
3.1.2- La jonction dermo-épidermique
Elle apparait sous la forme d’une structure ondulée ou alternent des saillies de l’épiderme
dans le derme dites «crêtes épidermiques» et des saillies du derme dans l’épiderme dites «
papilles dermiques».La jonction dermo-épidermique assure 3 missions principales :
supportant mécaniquement l’épiderme, maintenant le contact entre le derme et l’épiderme et
assurant une fonction de barrière et de filtre sélectif [6].
3.1.3- Le derme
C’est la couche essentielle de la peau car elle lui confère sa résistance et son élasticité ; il est
plus épais que l’épiderme (de 1 à 4 mm en moyenne) mais moins dense [7].
Le derme correspond à l’association de cellules fixes peu nombreuses, les fibroblastes situés
dans un gel ou substance fondamentale qu’ils synthétisent eux-mêmes substance à caractère
Fig.2:Différentes couches et cellules de l’épiderme [W4].
11
hydrophile et capable de retenir 1.000 fois son poids en eau. Ce qui explique la souplesse et la
consistance particulière de la peau. Les fibroblastes se multiplient tous les trois ans, le tissu
conjonctif est donc plus lent à se renouveler, et synthétisent deux types de fibres :
- les fibres de collagène, composant l’essentiel du derme, formant des faisceaux qui confèrent
à la peau une grande solidité.
- les fibres d’élastine, moins nombreuses, formant un maillage souple procurant une élasticité.
Le derme comprend 2 couches :
– Le derme papillaire ou superficiel, en contact avec la jonction dermo-epidermique,est
un tissu conjonctif lâche. Il est constitué de fibres de collagène et de fibres élastiquesc
orientées perpendiculairement à la jonction dermo-épidermique.
– Le derme réticulaire ou profond est un tissu conjonctif plus dense. Il contient des
faisceaux de collagène épais et des fibres élastiques orientés parallèlement à la
jonction dermo-épidermique [8].
La circulation sanguine s’effectue au niveau du derme, le rôle de ces vaisseaux sanguins étant
de régulariser la température de l’organisme et surtout d’assurer la nutrition.
3.1.4- L’hypoderme
L'hypoderme présente la même structure que le derme, mais n'a pas la même nature de tissu
conjonctif. Il est très pauvre en élastine et correspond donc à un tissu conjonctif lâche. Il est
cependant très riche en adipocytes, ce qui lui confère un pouvoir isolant et lui permet de
constituer une réserve d'énergie.
3.1.5- Les annexes cutanées
Les annexes cutanées regroupent les glandes cutanées (glandes sudoripares eccrines,
apocrines et glandes sébacées) et les phanères (poils et ongles).
Ces annexes sont d’origine épidermique bien que situées dans le derme et l'hypoderme.
12
• Glandes sudoripares et sudorales
Les glandes sudoripares, de deux types, secrètent la sueur, indispensable à la constitution du
film hydrolipidique, à la thermorégulation de l’organisme et à sa détoxification.
- Les eccrines siègent dans le derme et déversent la sueur à la surface de l'épiderme, sur tout
le corps. Ce sont les plus nombreuses (2 à 5 millions), abondantes sous la plante des pieds, les
paumes des mains et les aisselles. La sueur est constituée principalement d'eau, d'acide
lactique, d'urée, d’acides aminés, de toxines issues du métabolisme et de substances qui
luttent contre les bactéries. Cette sueur eccrine a pour principale fonction de refroidir
l'organisme et de le thermoréguler.
- Les apocrines sont situées dans l’hypoderme et déversent la sueur dans le follicule pilo-
sébacé. Elles sont localisées dans des zones précises, aisselles, paupières, pubis et parties
génitales. Elles ne sont actives qu'au moment de la puberté et sont stimulées par les émotions
et le stress. Cette sécrétion est laiteuse et riche en lipides. Initialement inodore, elle peut
devenir malodorante en se dégradant, sous l'action combinée de l'oxygène de l'air et des
enzymes produites par la microflore.
• Glandes sébacées
Dans le derme, elles sont accolées au follicule pileux pour former le follicule pilo-sébacé.
A chaque poil est donc annexée une glande sébacée qui fabrique et excrète du sébum à la
surface de la peau. Ce sébum participe avec la sueur à la composition du film hydrolipidique,
qui protège la peau du dessèchement, des petites écorchures ou agressions cutanées et qui
possède aussi des propriétés anti-fongiques. La quantité de sécrétion dépend de la température
cutanée, de l'heure, du poids corporel, de l'âge et de l’activité hormonale (testostérone).
• Ongles
Constitués de kératine dure fabriquée par les cellules de la matrice de l’ongle, située dans le
derme, ils ont un rôle de protection notamment de l’extrémité de la phalange des doigts et des
orteils, de préhension, d’agression et de défense. La kératine de l’ongle, appelée onichyne ,
13
présente une teneur en eau faible (12%), une concentration de lipides de 0.5 à 1.5 %, du
calcium et du soufre [9].
L’ongle est constitué d’une partie visible ou corps de l’ongle et d’une racine, cachée sous un
repli cutané.
La lunule est la partie blanchâtre du corps de l’ongle, située au voisinage de la racine.
La peau qui recouvre la racine est appelé bourrelet unguéal et son extrémité libre cuticule.
Constitué essentiellement de kératine, l’ongle contient aussi des mélanocytes,sur toute la
hauteur de l’épithélium. Les cellules de Langerhans sont également présentes.
Le temps de pousse d’un ongle est variable, en moyenne 3 à 4 millimètres parmois au niveau
des ongles de la main [10].
Fig.3:Vue en coupe (à gauche) et du dessus (à droite) du bout d'un doigt et son ongle [2].
• Follicule pileux
Formé d’une tige constituée de cellules kératinisées et d’une racine, sa racine est implantée
dans l’épaisseur du derme par une extrémité bombée appelée le bulbe pileux.
La croissance du poil s’effectue grâce à la prolifération des cellules de la racine ; chaque poil
est muni d’un muscle redresseur du poil dont la contraction provoque l’érection du poil et
d’une glande sébacée.
Le poil présente un cycle pilaire constitué de trois phases :
– la phase anagène : phase de croissance où le follicule est profond et a une activité
kératogène. Elle dure 2 à 3 ans chez l’homme
s’allonge de 0.2 à 0.5mm par jour.
– la phase catagène : courte, de 3 semaines en moyenne. La partie profonde du follicule
pileux se résorbe.
– la phase télogène qui dure 3 à 6 mois. Le poil est au repos, puis un nouveau f
anagène se reforme et le poil télogène tombe
Fig
3.2- Pénétration percutanée des cosmétiques
L'une des principales fonctions de la peau est la fonction de barrière.
ne pas perdre d'eau et d'électrolytes et empêche la pénétration de molécu
l'environnement. Cette «barrière
est mise à profit pour la pénétration percutanée des c
La pénétration percutanée est un élément indispensable pour comprendre les réactions
possibles de l'organisme à une substance appliquée sur la peau.
14
phase de croissance où le follicule est profond et a une activité
kératogène. Elle dure 2 à 3 ans chez l’homme et 6 à 8 ans chez la femme
s’allonge de 0.2 à 0.5mm par jour.
courte, de 3 semaines en moyenne. La partie profonde du follicule
la phase télogène qui dure 3 à 6 mois. Le poil est au repos, puis un nouveau f
anagène se reforme et le poil télogène tombe définitivement [10].
Fig.4 : Schéma d’un follicule pileux [2].
Pénétration percutanée des cosmétiques
L'une des principales fonctions de la peau est la fonction de barrière. Elle permet à la peau de
ne pas perdre d'eau et d'électrolytes et empêche la pénétration de molécu
l'environnement. Cette «barrière» n'est cependant pas infaillible et cette perméabilité relative
est mise à profit pour la pénétration percutanée des cosmétiques.
La pénétration percutanée est un élément indispensable pour comprendre les réactions
possibles de l'organisme à une substance appliquée sur la peau.
phase de croissance où le follicule est profond et a une activité
et 6 à 8 ans chez la femme ; le poil
courte, de 3 semaines en moyenne. La partie profonde du follicule
la phase télogène qui dure 3 à 6 mois. Le poil est au repos, puis un nouveau follicule
Elle permet à la peau de
ne pas perdre d'eau et d'électrolytes et empêche la pénétration de molécules de
et cette perméabilité relative
La pénétration percutanée est un élément indispensable pour comprendre les réactions
15
3.2.1- Définition
L’absorption percutanée proprement dite correspond au transfert d’une substance à travers la
peau depuis le milieu extérieur jusqu’au sang. Elle peut être définie comme la somme de trois
événements successifs :
- un contact au niveau de la couche cornée,
-une pénétration au travers de chaque structure du tégument (couche cornée, épiderme vivant,
derme et annexes pilosébacées)
- une phase de résorption dans la microcirculation dermique papillaire et lymphatique.
L’étape de pénétration est, en termes physiques, une diffusion passive sous la dépendance
d’un partage qui se produit à l’interface environnement/couche cornée. La pénétration est
facilitée si le pénétrant a une forte tendance à se séparer du véhicule de dépôt et à migrer à
travers les différentes couches de l’épiderme et du derme jusqu’aux capillaires sanguins [11].
3.2.2-Les différentes voies de pénétration percutanée des molécules
Anatomiquement, deux voies distinctes s’offrent pour la pénétration des substances, la voie
transépidermiqueet la voie transfolliculaire.
Dans le cas de la voie transépidermique, la diffusion de la molécule s’effectue soit à travers
les cellules cornées, essentiellement constituées de protéines hydrophiles, soit à travers les
espaces intercellulaires de la couche cornée, constitués de lipides. Du fait de son caractère
amphiphile, le domaine intercellulaire hydrolipidique constitue un canal de diffusion
préférentiel pour les substances lipo- et hydrosolubles. Les substances lipophiles diffusent à
travers les zones hydrophobes des bicouches lipidiques intercellulaires. Les composés plus
hydrophiles migrent, d’une part, à travers les zones hydrophiles des bicouches lipidiques
intercellulaires et d’autre part, en utilisant la voie intracellulaire. Les substances lipophiles
peuvent également emprunter la voie transfolliculaire via les follicules pilosébacés et/ou les
glandes sudoripares. Cependant, cette voie reste minoritaire.
La pénétration ne s’effectue pas exclusivement par l’une des voies, les deux participants au
phénomène ; la pénétration globale est la résultante d’un passage transépidermique et d’un
passage par les annexes.
16
3.2.3-Facteurs influençant la pénétrationpercutanée :
• Age
– La couche cornée est immature chez le grand prématuré (< à 31 semaines) pour lequel la
diffusion percutanée est multipliée par 100 à 1 000 fois par rapport au nouveau-né à terme.
S’en suit une normalisation en 15 jours.
– Chez le nourrisson et l’enfant, la barrière cutanée est normale, mais le risque est maintenu
en raison du rapport surface/poids, trois fois plus élevé que chez l’adulte.
– Chez le sujet de plus de 60 ans, la sénescence cutanée avec diminution de l’hydratation peut
être responsable d’une diminution modérée de l’absorption percutanée des molécules
hydrophiles (pas de changement pour les molécules lipophiles) [12].
• Site d’application
Dans larégion rétro-auriculaire, deux fois plus perméable, les applications de systèmes
transdermiques sont fréquentes.
Les différences selon les régions s’expliquent par la variation de la composition du stratum
corneum (lipides, hydratation) et par la densité des annexes pilo-sébacées.
• Rythme et durée d’application
La couche cornée agit comme un réservoir en principe actif, relarguant pendant des heures la
substance appliquée en surface (effet réservoir) et ne nécessitant donc pas des applications
itératives dans la journée.
• Etat de la peau
Certains états plus ou moins pathologiques vont faciliter l’absorption des produits
cosmétiques (inflammations, poussées psoriasiques, lésions de grattage, brûlures …) par
augmentation de la perméabilité cutanée.
17
• Température Lorsque la température cutanée est élevée, elle favorise toute diffusion à travers la couche
cornée. En créant une vasodilatation, le flux sanguin superficiel et la résorption par le système
capillaire du derme se trouvent augmentés, ce qui pourrait conférer à la molécule un effet
systémique. Cet effet sera plus important pour les molécules ayant déjà une forte pénétration
cutanée.
• Flux sanguin
Le flux sanguin participe à une meilleure pénétration des produits dans le sens où, en
éliminant au fur et à mesure les molécules, il crée un gradient de concentration entre la
surface de la peau et le derme. Il faut savoir que certaines zones corporelles sont plus
vascularisées que d'autres ; c'est le cas du visage, du cou, de la paume des mains et de la pulpe
des doigts.
• Occlusion et hydratation de la peau
La perméabilité de la couche cornée normalement hydratée (environ 10%) est 10 fois
supérieure à celle du stratum corneum sec [13].
Plus précisément, cette hydratation favoriserait la diffusion des substances hydrophiles. En
effet, les molécules d’eau encombreraient les têtes polaires des lipides et réduiraient les
interactions entre chaînes carbonées[14].
L’hydratation de l’épiderme doit être augmentée afin de favoriser la pénétration, on peut pour
cela favoriser la migration de l’eau des couches profondes vers le stratum corneum par un
apport externe ou en réalisant une occlusion [13].
18
• Nature physico-chimique de la substance active
L’absorption et la diffusion cutanée d’une molécule vont dépendre de ses caractéristiques
physicochimiques (taille, poids moléculaire, état ionique, polarité), de son affinité pour le
stratum corneum et de sa stabilité dans le véhicule. Le poids moléculaire d’une substance est
le paramètre le plus important permettant de prédire sa diffusion à travers la peau, les
molécules complexes de haut poids moléculaire pénétrant difficilement dans la couche
cornée. La diffusion percutanée décroit de manière exponentielle avec l’augmentation du
poids moléculaire [15]. La diffusion à travers la peau humaine de molécules de poids
moléculaire supérieur à 500 daltons est très faible. D’autre part, compte tenu de la structure de
la couche cornée, les molécules les mieux absorbées sont à la fois liposolubles et
hydrosolubles. Les molécules non ionisées diffusent plus facilement à travers le stratum
corneum que les molécules ionisées, les différences de diffusion sont plus faibles pour les
molécules hydrophiles que pour les molécules lipophiles [16].
• Véhicule
Il transporte, renferme la molécule active et la cède au film hydrolipidique de surface dans
lequel il se mélange. Ce véhicule aura peu de possibilités de pénétration mais il peut faciliter
celle des substances actives.
4- Les composants d’un produit cosmétique
Fig. 5: Composition d’un produit cosmétique
4.1- Le Principe Actif
A l’origine de tout cosmétique, il y a un principe actif, c’est
un pouvoir correcteur. Il existe trois sortes de principes actifs :
- Les principes actifs d’origine phyto
production industrielle est effectuée dans des usines agréées afin de s’assurer, de l’origine à
l’utilisation de l’extrait définitif, de sa parfaite qualité et innocuité.
- Les principes actifs d’origine chimique : il y’
de manière synthétique.
- Les principes actifs d’origine biotechnologique : cela consiste à modifier partiellement le
patrimoine génétique d’organismes vivants pour en opt
4.2- Les excipients
Le terme d’excipient désigne les substances autres que les actifs entrant dans la composition
des cosmétiques. Leur ajout apporte une texture, une consistance ou encore de la stabilité au
produit. Ils ont pour rôles de:
19
Les composants d’un produit cosmétique
Composition d’un produit cosmétique [17].
A l’origine de tout cosmétique, il y a un principe actif, c’est-à-dire une substance qui possède
un pouvoir correcteur. Il existe trois sortes de principes actifs :
actifs d’origine phyto-chimiques, c’est-à-dire issus des végétaux : la
production industrielle est effectuée dans des usines agréées afin de s’assurer, de l’origine à
l’utilisation de l’extrait définitif, de sa parfaite qualité et innocuité.
ctifs d’origine chimique : il y’a fabrication de nouvelles molécules obtenues
Les principes actifs d’origine biotechnologique : cela consiste à modifier partiellement le
patrimoine génétique d’organismes vivants pour en optimiser une ou plusieurs fonctions
Le terme d’excipient désigne les substances autres que les actifs entrant dans la composition
des cosmétiques. Leur ajout apporte une texture, une consistance ou encore de la stabilité au
dire une substance qui possède
dire issus des végétaux : la
production industrielle est effectuée dans des usines agréées afin de s’assurer, de l’origine à
a fabrication de nouvelles molécules obtenues
Les principes actifs d’origine biotechnologique : cela consiste à modifier partiellement le
imiser une ou plusieurs fonctions.
Le terme d’excipient désigne les substances autres que les actifs entrant dans la composition
des cosmétiques. Leur ajout apporte une texture, une consistance ou encore de la stabilité au
20
- Véhiculer le principe actif
- Aider à sa diffusion
- Modifier la perméabilité de la peau de façon réversible
- Modifier l’hydratation
On classe les excipients selon leur degré d’hydrophobie et leur consistance.
4.2.1- Excipients aqueux ou hydrophiles
• L’eau(Aqua)
C’est l’ingrédient le plus recruté en cosmétologie, il représente parfois 95% du produit
cosmétique dans lequel il est contenu. L’eau utilisée est le plus souvent déminéralisée (ou
déionisée) et filtrée. Elle sert surtout de solvant pour dissoudre les substances hydrosolubles.
Au contact de la surface cutanée l’eau va très rapidement s’évaporer et provoquer un effet
desséchant sur la peau. Les eaux florales ou thermales peuvent être considérées comme des
actifs aux propriétés spécifiques [18].
• Les solvants
Les solvants, en cosmétologie, sont représentés par des alcools et des glycols (au moins deux
groupes alcools). Le principal alcool utilisé est l’éthanol (alcool). Les alcools s’évaporent dès
le contact sur la peau ce qui provoque le desséchement de l’épiderme. Pour éviter une
déshydratation trop importante, le degré alcoolique est limité. L’éthylène glycol
(ethyleneglycol) et le propylène glycol (propylene glycol) sont présents dans des
formulations cosmétiques. Le propylène glycol dissout les lipides épidermiques, la barrière
cutanée s’en trouve altérée et l’eau épidermique en profite pour s’échapper [18].
• Humectants
Ils sont très souvent présents dans les solutions, les gels, les émulsions. Ce sont des
substances hygroscopiques qui ont pour but de maintenir l’eau au niveau de la préparation ou
de la peau. Dans ce dernier cas, ils se comportent comme des « actifs » [19].
21
Ex : Glycérol Propylène glycol Polyoxyéthylènes glycols Sorbitol
• Gélifiants ou épaississants
Ils sont appelés également agents de texture hydrophile : ce sont des macromolécules capables
d’augmenter la viscosité des phases aqueuses dans lesquelles ils sont dispersés. Ils possèdent
des propriétés épaississantes ou des propriétés gélifiantes. Ils assurent une certaine stabilité
aux formulations en régulant leur consistance, modifiant l’étalement et fournissant un
caractère filmogène [20].
• Origine naturelle
-> Végétale : ce sont des polysaccharides extraits d’algues (alginates, carraghénates), de la
sève (gomme arabique), de graines ou de pépins (pectine, gomme guar, amidon). Les plus
utilisés sont les alginates de sodium (algin) ou de propylène glycol et les galactomannanes.
Ces substances sont sensibles à la contamination par des micro-organismes.
-> Minérale: il y a la silice colloïdale et les silicates (veegum, montmorillonite, bentonite). Ils
peuvent être chimiquement remaniés pour obtenir une affinité envers les substances
lipophiles. Dans ce cas là, ils pourront épaissir la phase grasse des émulsions ou les produits
anhydres.
• Origine semi-synthétique
La gomme xanthane (xanthangum) a des caractéristiques très appréciables en cosmétologie.
Elle est peu contaminable, stable et perfectionne le toucher des émulsions. Les dérivés
cellulosiques sont utilisés comme épaississants, gélifiants (ex :
l’hydroxypropylmethylcellulose et l’hydroxyethylcellulose). Ils sont stables mais ont une
texture plutôt collante corrigée par l’ajout de glycérol ou de sorbitol.
22
• Origine synthétique
Ils sont représentés par les polymères carboxyvinyliques (carbomer) bénéficiant d’une bonne
stabilité, d’une résistance aux contaminations et proposant un effet rafraîchissant, un toucher
doux et agréable sur la peau. Ces composés donnent généralement des solutions colloïdales
acides. Pour neutraliser cette acidité, il faut associer à ces carbomères des bases comme la
soude ou la triéthanolamine [18].
.
4.2.2- Excipients lipophiles
• Les hydrocarbures
- Les huiles de paraffine : ce sont des produits de viscosité variable ;
- Les paraffines : qui sont de consistance solide utilisées pour leur caractère occlusif ;
- Les vaselines : ce sont des produits pâteux ayant un caractère filant et gras ;
- Les huiles de silicone : ce sont des polysiloxanes méthyliques (diméthylpolysiloxanes)
connus sous le nom de« diméticones ». Ce sont des huiles très hydrophobes, filmogènes,
possédant une grande stabilité chimique et thermique sans variation de la viscosité. Leur
tension superficielle basse très proche de celle de la peau leur assure un bon étalement. Elles
sont utilisées dans la formulation de crèmes protectrices dites barrières. Cependant, leur
caractère occlusif les contre-indique dans le cas de peaux lésées.
• La lanoline et ses dérivés (ou graisse de laine)
Elle est extraite du suint de mouton peu différent du sébum humain. Elle est constituée
principalement d’esters, mais également d’acides gras et d’alcools gras libres. Sa
caractéristique principale est de contenir des stérols et des alcools triterpéniques amphiphiles
qui lui confèrent des propriétés de base autoémulsionnable. La lanoline est surtout utilisée
pour son pouvoir pénétrant et émollient.
23
• Les cires
Ce sont des substances solides de caractère lipophile, la cire d’abeille est la plus utilisée dans
les pommades (cérat de Galien : préparation officinale servant de base à différentes spécialités
pharmaceutiques). Ce sont des facteurs de consistance, filmogènes occlusifs et indispensables
pour augmenter le caractère antidéshydratant des émulsions.
• Les huiles d’origine végétales
De type oléique, linoléique et de type linolénique. Elles sont constituées en majeure partie de
triglycérides à base d’acides oléique (C18 :1), linoléique (C18 :2), linolénique (C18 : 3). Ces
huiles sont insaturées et très oxydables nécessitant l’adjonction d’agents antioxydants.
4.2.3- Les agents émulsionnants
Sont des molécules amphiphiles appelées également agents de surface ou tensioactifs
possédant une extrémité hydrophile et une extrémité lipophile, ce qui leur permet de se placer
en couche monomoléculaire à l’interface de deux phases non miscibles pour stabiliser
uneémulsion. Ils sont aussi capables de former des solutions micellaires au-dessus d’une
certaine concentration appelée concentration micellaire critique [21].
4.2.4- Les additifs
Les additifs sont des substances inertes, ajoutées à faible dose «1%) à l'actif et à l'excipient
dans le but de parfumer, de colorer, d'améliorer la conservation du cosmétique.
• Conservateurs antimicrobiens
Les conservateurs se définissent comme des substances naturelles ou synthétiques qui
protègent un produit de la contamination microbienne (bactéries, moisissures et levures) La
présence de conservateurs est indispensable dans toutes les préparations pour application
topique surtout dès qu’elles contiennent une petite proportion d’eau. Les pharmacopées ne
comportent plus de liste positive de conservateurs alors que la Directive Cosmétique en
possède une, inscrite à l’annexe VI. Il s’agit d’une liste de conservateurs antimicrobiens.
24
La législation autorise l’utilisation d’une cinquantaine de molécules antimicrobiennes, mais
les plus utilisées sont les suivantes :
- L’acide sorbique : fongicide
- L’acide déhydroacétique : fongicide
- L’acide benzoïque : fongicide
- Les esters de l’acide parahydroxybenzoïque (PARABENS) : fongicides et bactéricides
- L’acide salicylique : fongicide et bactéricide
-Phenoxyéthanol
- Le formol : fongicide et bactéricide
- Le chlorure de benzalkonium : fongicide et bactéricide –
- Le triclosan : fongicide et bactéricide
- La chlorhexidine : fongicide et bactéricide
- Le glutaraldéhyde : fongicide et bactéricide.
• Les conservateurs antioxydants
II s'agit de substances ajoutées au cosmétique dans le but de freiner le rancissement des corps
gras et de ralentir l'oxydation des substances oxydables. L’objectif est de protéger le produit
de l'oxydation due à l'air, mais également des dégradations photo-induites.
o Le tocophérol (vitamine E)
o L’acide ascorbique (vitamine C)
o Les huiles essentielles (thym, carvi, romarin)
o Le BHA (butyl hydroxy anisol)
o Le BHT (butyl hydroxy toluène)
25
• Les colorants
D’origine synthétique, minérale ou encore végétale, les colorants sont reconnaissables dans
une formule par la dénomination CI (ColorIndex ) suivie d un numéro allant de 10000 à
80000
Les colorants peuvent être classes en différentes catégories en fonction de leurs
caractéristiques de solubilité :
o Les colorants hydrosolubles
o Les colorants liposolubles
o Les pigments
o Les laques
• Les parfums
Retrouvés dans les formules cosmétiques sous la dénomination « parfum », il s agit des
substances odorantes d’origine synthétique ou naturelle, elles confèrent au produit une odeur
agréable et durable dans le temps qui constitue un réel atout marketing.
5- Catégories de Cosmétiques
Les produits cosmétiques ont été classés en différentes catégories selon leur typologie par
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM),
anciennement l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS),
dans l’arrêté du 30 juin 2000 :
- Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, pieds notamment) ;
-Masques de beauté, à l'exclusion des produits d'abrasion superficielle de la peau par voie
chimique ;
- Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres) ;
- Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l'hygiène
corporelle et autres poudres ;
26
- Savons de toilette, savons déodorants et autres savons ;
- Parfums, eaux de toilette et eau de Cologne ;
- Préparations pour le bain et la douche (sels, mousses, huiles, gel et autres préparations) ;
- Dépilatoires ;
- Déodorants et antisudoraux ;
- Produits de soins capillaires ;
- Teintures capillaires et décolorantes ;
- Produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation ;
- Produits de mise en plis ;
- Produits de nettoyage (lotions, poudres, shampooings) ;
- Produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles) ;
- Produits de coiffage (lotions, laques, brillantines) ;
- Produits pour le rasage (savons, mousses, lotions, et autres produits) ;
- Produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux ;
- Produits destinés à être appliqués aux lèvres ;
- Produits pour soins dentaires et buccaux ;
- Produits pour les soins et le maquillage des ongles ;
- Produits pour les soins intimes externes ;
- Produits solaires ;
- Produits de bronzage sans soleil ;
- Produits permettant de blanchir la peau ;
- Produits antirides.
Par ailleurs, il convient également de relever qu’aux termes de ce même arrêté, un certain
nombre de produits ont été expressément exclus de la liste des cosmétiques, àsavoir :
- Les solutions de lavage oculaire, auriculaire, nasal qui sont des dispositifs médicaux ;
- Les lubrifiants qui sont, soit des médicaments, soit des dispositifs médicaux ;
- Les compléments alimentaires à visée esthétique (embellissement de la peau, des ongles, des
cheveux, appelés improprement « cosmétiques par voie orale ») qui sont des produits
alimentaires ;
27
- Les produits de tatouages qui sont des produits de consommation courante.
6- Produits frontières
Compte tenu de l’évolution de la science cosmétique ces dernières années, la frontière entre
médicament et cosmétique apparait de plus en plus floue, ce qui engendre de nombreuses
difficultés quant à la qualification de certains produits, ce qui a conduit à la création d’une
nouvelle classification sous le nom de produits frontières [22].
Les produits frontières correspondent à une catégorie de produits non connue du droit
communautaire. Ces produits qui se situent à la frontière le plus souvent du médicament, sont
en réalité des produits pour lesquels il existe un doute sur leur qualification et qui sont, par
conséquent, à l’origine de nombreux litiges. Or, leur qualification en tant que médicaments ou
autres produits est fondamentale car elle conditionne le régime juridique applicable et
détermine notamment les règles relatives à la promotion et à la distribution du produit, règles
de publicité ou monopole des pharmaciens; c’est le cas des dermo-cosmétiques.
Qu’est-ce qu’un dermocosmétique? Contrairement au produit cosmétique, on ne retrouve pas de définition du produit dermo-
cosmétique dans le droit de l’Union Européenne et dans les textes législatifs ou
réglementaires français.
Le terme dermo-cosmétique a été inventé par Pierre Fabre, fondateur du Groupe
Pharmaceutique éponyme naquit un mot issu du marketing, créant une catégorie de produits à
mi distance entre la beauté et la santé. Le terme dermo-cosmétique est particulièrement adapté
pour les produits préconisés pour les peaux spécifiques, pathologiques ou à problèmes.
On peut retrouver sur le site de la marque Avène du même groupe cette définition : « Les
produits dermocosmétique répondent en raison de leur technicité et de leur qualité à un
problème particulier de peau ou de cheveu. Ils appartiennent, pour la plupart, à la catégorie
des produits de conseil pharmaceutique et font parfois l’objet d’une recommandation de la
part de médecins de type dermatologues, auprès de leurs patients. »
28
Une autre définition émane de la marque La Roche Posay : « Un produit dermocosmétique
s’applique localement sur la peau, le cuir chevelu et les cheveux. Il conjugue une action
cosmétique et dermatologique. Les soins dermo-cosmétiques sont formulés pour préserver la
santé et la beauté de la peau et des cheveux. Ils aident à hydrater les peaux sèches, traiter un
état pelliculaire, soulager le psoriasis… »
Bernard Fabre du Centre de Développement des Produits Végétaux des laboratoires Pierre
Fabre considère qu’un dermocosmétique est avant tout un soin ayant une activité biologique
démontrée et destinée à corriger un déséquilibre cutané. Il explique que « ces produits ont
besoin de l’accompagnement d’un médecin ou d’un pharmacien, dans la mesure où ils traitent
un problème de peau particulier ».
7- Stabilité des cosmétiques 7.1- Introduction
La stabilité des produits cosmétiques est un des paramètres clé pour une garantie de qualité du
produit et la satisfaction du consommateur. Le règlement européen CE 1223/2009 dans son
annexe1précise que l’évaluation de la sécurité du produit doit prendre en compte ses
caractéristiques physico chimiques et sa stabilité dans des conditions de stockage
normalement prévisibles.
La forme finale d’un produit cosmétique résulte du mélange d’ingrédients judicieusement
choisis et associés, appartenant à trois grandes familles de composés :
� Le principe actif qui définit l’efficacité du produit cosmétique
� L’excipient, qui définit la forme finale du produit et vectorise les actifs
� Les additifs, qui contribuent l’amélioration des propriétés du produit fini
L’ensemble est conditionné dans un contenant qui est lui-même susceptible d’interagir avec le
produit. Au cours de sa vie, le produit est exposé à des influences tel que la température,
l’humidité ou la lumière ; chacun de ces facteurs peut modifier l’équilibre fragile en dégradant
certains composés et favorisant une éventuelle croissance microbienne. Le fabriquant devra
s’assurer de la maitrise des risques suivants :
o La dégradation de certains ingrédients critiques, conservateurs, filtres solaires
29
o Le développement microbien dans le produit
o L’apparition de produits de dégradations toxiques
o La pollution ou adsorption due au contenant
o La perte d étanchéité du contenant
Fondamentalement, il existe trois formes de tests de stabilité :
• les tests d'intégrité physique et chimique qui évaluent la couleur, odeur, parfum, pH,
viscosité, texture, flux et stabilité de l'émulsion (signes de séparation) ;
• les tests de stabilité microbiologique qui évaluent le degré de contamination par des
bactéries, moisissures et levures
• les tests de stabilité d'emballage qui évaluent l'impact des emballages sur le produit
contenu.
7.2- Analyse microbiologique du produit
Les industriels doivent contrôler la qualité microbiologique et la composition des produits
cosmétiques qu’ils fabriquent. En conséquence ils sont amenés à vérifier la contamination des
produits, l’absence de bactéries pathogènes, ou encore le taux de bactéries commensales. Ces
contrôles microbiologiques sont ainsi réalisés tout au long de la chaîne de fabrication, de la
matière première au produit fini, en passant par l’environnement de production. Les bactéries
sont les agents contaminants les plus fréquemment rencontrés aussitôt après la fabrication des
produits. Les champignons inférieurs (moisissures, levures) sont moins fréquents. Bien que la
législation n’impose pas actuellement de normes de contamination minimale, la
contamination microbiologique des produits cosmétiques demeure une préoccupation
première pour l’industrie cosmétique. Depuis 2006, de nombreuses normes ISO (International
Organisation for Standardization) ont été établies et elles décrivent de manière détaillée les
protocoles microbiologiques qui doivent être appliqués en vue d’une certification par la
COFRAC (Comité Français d’Accréditation) :
- NF ISO 21148 : « instructions générales »
- NF ISO 21149 : « dénombrement et détection des bactéries aérobies mésophiles »
- NF ISO 16212 : « dénombrement des levures et des moisissures »
30
- NF ISO 18415 : « détection des micro-organismes spécifiés et non spécifiés »
D’une manière générale, on distinguera :
- Les bactéries aérobies mésophiles (taux limite < 100 UFC*/g) ;
- Les moisissures et les levures (taux limite < 100 UFC/g) ;
- Les germes pathogènes (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus
et Candida albicans) qui devront être absents.
Afin de déterminer quels sont les produits nécessitant une analyse microbiologique envue
d’une détection de microorganismes spécifiés et non spécifiés, il est conseillé aux industriels
d’effectuer une analyse du risque microbiologique selon la norme NF EN ISO 29621 de juin
2011. En effet, les produits présentant un faible risque microbiologique ne nécessitent pas la
mise en œuvre des normes internationales de microbiologie relatives aux cosmétiques. On
peut citer par exemple les produits défrisants qui présentent un pH =10,0 ou encore les vernis
à ongles à base de solvants.
Une attention particulière doit être accordée aux produits cosmétiques utilisés autour des
yeux, sur les muqueuses en général, sur une peau lésée, chez les enfants de moins de trois ans,
chez les personnes âgées et chez les personnes au système immunitaire fragilisé
(2009/1223/CE). En effet, les recommandations du SCCS classent les produits en deux
catégories distinctes (Tab 1).
31
Tab.1 : Spécifications microbiologiques selon la catégorie du produit [W5].
Catégorie Type de produit
Numération des
bactéries aérobies
mésophiles totales
Agents
pathogènes
(Pseudomonas
aeruginosa,
Staphylococcus
aureus et Candida
albicans)
Catégorie 1
Produits destinés aux
enfants de moins de trois
ans, utilisés sur le contour
des yeux ou sur les
muqueuses.
102 cfu/g ou102cfu/ml
dans 0,5 g ou 0,5 ml de
produit.
Non détectable
dans 0,5 g ou
0,5ml de produit.
Catégorie 2 Autres produits.
103 cfu/g ou103 cfu/ml
dans 0,1g ou 0,1ml de
produit.
Non détectable
dans 0,1 g ou
0,1ml de produit.
D’autre part, l’industriel devra réaliser des contrôles in situ de l’efficacité du système de
conservation de son produit cosmétique. Différentes normes définissent un test d’efficacité de
la conservation antimicrobienne ouChallengeTest [23] :
o Norme ISO 11930: Cosmétiques – Microbiologie – Évaluation de la protection
antimicrobienne d'un produit cosmétique;
o Pharmacopée Européenne 7.0 EP 5.1.3 : Efficacité de la
conservationantimicrobienne ;
o Pharmacopée US - USP 51: Preservative Efficacy Testing and Preservative
Challenge Testing by Antimicrobial Test.
Leur principe général est identique et consiste en la contamination du produit par un inoculum
déterminé de micro-organismes tests, et au suivi de l’évolution de la population viable dans le
32
produit contaminé par dénombrement des germes revivifiables dans des échantillons prélevés
à intervalles de temps donnés (en général à J2, J7, J14, et J28). Pour les préparations
àapplication locale, comme les cosmétiques, cinq microorganismes tests sont préconisés : [24]
� Pseudomonas aeruginosaATCC 9027 (souches équivalentes : CIP 82.118, NCIMB
8626, NBRC 13275, KCTC 2513) ;
� Staphylococcus aureus ATCC 6538 (souches équivalentes : CIP 4.83, NCTC10788,
NCIMN 9518, NBRC 13276, KCTC 1916) ;
� Escherichia coli ATCC 8739 (souches équivalentes : CIP 53.126, NCIMB 8545,
NBRC 3972, KCTC 2571, NCTC 8545) ;
� Candida albicans ATCC 10231 (souches équivalentes : IP 48.72, NCPF 3179, NBRC
1594, KCTC 17205) ;
� Aspergillus niger / brasiliensisATCC 16404 (souches équivalentes : IP 1431.83, IMI
149007, NBRC 9455, KCTC 6317) ;
L’essai d’efficacité du système de conservation doit être effectué :
- A la conception du produit pour sélectionner le système le plus efficace.
- Lors de l’étude de stabilité, pour s’assurer de son efficacité à la date de péremption du
produit.
- A chaque changement d’un élément de la formulation ou du conditionnement.
8- Réglementation des cosmétiques
8.1- Réglementation européenne :
Ils sont en usage depuis des siècles. Utilisés au quotidien, les produits d'hygiène et de beauté
comptent aujourd'hui parmi les produits de consommation les plus réglementés et contrôlés.
En matière de réglementation, depuis le 11 juillet 2013, c'est le Règlement Cosmétique CE
1223/2009 qui remplace la directive européenne 76/768/CEE et ses 7 amendements ; Grâce à
cette réglementation et à l'engagement des fabricants, un produit cosmétique est
nécessairement sûr pour la santé humaine.
33
La réglementation repose sur 3 principes :
• Sécurité des matières premières (ingrédients ou «substances»).
• Qualité des techniques de fabrication.
• Surveillance du marché.
Parmi les principales nouveautés introduites, l’on cite:
• La désignation des personnes responsables des procédures (de la fabrication à la mise
sur le marché).
• Le respect des bonnes pratiques de fabrication,
• La mise à jour des dossiers d’information sur les cosmétiques (dorénavant valables
dans toute l'Union Européenne),
• La notification des produits cosmétiques sur le portail européen prévu à cet effet,
• La mise en place d'un système de cosmétovigilancepar tout responsable de la mise sur
le marché des produits.
Les annexes ont aussi été légèrement modifiées :
– Annexe I : nouvel intitulé : « Rapport sur la sécurité du produit cosmétique ». Elle est composée de deux parties :
o Partie A : Informations sur la sécurité (profil sur la toxicologie des ingrédients
avec les informations sur les effets indésirables plus ou moins graves.) Les
autres informations correspondent à l’ancien dossier.
o Partie B : Evaluation de la sécurité du produit cosmétique, sont retrouvées les
conclusions sur la partie précédente, les justifications de ces conclusions, les
références de l’évaluateur de la sécurité et les avertissements nécessaires.
– Annexe II : Elle correspond toujours à la liste des substances interdites à l’utilisation
des cosmétiques.
– Annexe III : Elle correspond toujours à la liste restrictive incluant les 26 constituants
de parfum allergisants et les composants de teintures capillaires (présents sur une liste
provisoire auparavant)
– Annexe IV : liste des colorants autorisés.
– Annexe V : liste des conservateurs antimicrobiens autorisés.
34
– Annexe VI : liste des filtres ultraviolets autorisés.
– Annexe VII : les logos (livre ouvert, PAO, date de durabilité minimale).
– Annexe VIII : liste des méthodes alternatives à l’expérimentation animale validées.
8.1.1- Les institutions en charge des produits cosmétiques
L’objectif des différentes autorités en charge des produits cosmétiques est d’assurer la
sécurité des utilisateurs, ce qui correspond à l’article 2 de la Directive Européenne : « le
produit cosmétique ne doit pas nuire à la santé humaine dans les conditions normales ou
raisonnablement prévisibles d’emploi ».
En France ce sont l’ANSMet la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et
de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui veillent au bon respect de la réglementation des
produits cosmétiques. Ils réalisent des contrôles, ponctuels ou au cours d’enquêtes dans les
laboratoires, effectuent des prélèvements et donnent les autorisations de lieux d’essais
cliniques. Ils assurent aussi la gestion des déclarations de défauts de qualités sur les produits
et inspectent les entreprises qui s’occupent de la fabrication, du conditionnement, de
l’importation et de la mise sur le marché des cosmétiques. L’ANSM peut prendre des
décisions de police sanitaire. Elle s’occupe aussi de recueillir et de gérer les déclarations des
effets indésirables liés aux produits cosmétiques. Un groupe de travail est créé en Février
2013 au sein de l’ANSM. Il est composé d’experts scientifiques (en allergologie, en
dermatologie, en galénique …), d’industriels cosmétologiques et de représentants des
associations de consommateurs. Il permet de donner des avis et de prendre des mesures sur la
sécurité d’emploi des cosmétiques, leur composition et la toxicité des ingrédients pouvant
entrer dans la composition de certains produits cosmétiques. La réglementation des produits
cosmétiques est aussi dirigée par les services du ministère de la santé (Direction Générale de
la Santé).
Au niveau européen, les institutions qui s’occupent de la règlementation des produits
cosmétiques sont la commission européenne et le conseil européen. Le conseil européen met
en place des recommandations sur l’utilisation et la composition des produits cosmétiques
pour protéger le consommateur tandis que la commission européenne donne des Directives
35
sur les méthodes d’analyse et sur l’adaptation au progrès technique des annexes du règlement.
Est retrouvée également au niveau européen une association professionnelle des industries
cosmétiques, la Cosmetics Europe, anciennement appelée la COLIPA [25][W6, W7].
8.1.2-Réglementation en matière de fabrication
8.1.2.1-Déclaration d’établissement
Selon l’article L5131-2 du Code de la Santé Publique :
« L’ouverture et l’exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou
d’importation, même à titre accessoire, de produits cosmétiques, de même que l’extension de
l’activité d’un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration
auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette déclaration est
effectuée par le fabricant (…) ou par le responsable de la mise sur le marché (…). »
Le fabricant a donc la responsabilité de déclarer aux autorités compétente la
commercialisation d’un produit cosmétique. De plus, toute modification des éléments déclarés
doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.
8.1.2.2-Notion de « Personne Responsable »
Le Règlement Cosmétique a introduit la notion de "Personne Responsable". Celle-ci se trouve
obligatoirement dans l'un des 31 pays de l'Espace Economique Européen. Il peut s'agir soit du
fabricant (celui qui fabrique ou fait fabriquer et commercialise sous son nom ou sous sa
marque), soit de l'importateur pour des produits fabriqués hors UE (ou toute personne
désignée par eux par écrit) ou encore du distributeur s'il commercialise un produit sous sa
marque propre ou s'il a modifié un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que sa
conformité peut en être affectée. Personne physique ou morale, cette "Personne Responsable"
doit garantir la conformité du produit cosmétique aux obligations du Règlement. Elle permet
aussi aux Autorités d'avoir un seul interlocuteur par produit cosmétique.
36
8.1.2.3-Respect des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)
Le concept de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) des produits cosmétiques existe depuis
de nombreuses années mais la rédaction d'un référentiel reconnu internationalement date
seulement de janvier 2008 sous la forme d'une norme internationale soit la norme NF EN ISO
22716 [W8].
Les BPF sont définies dans la norme ISO 22716 comme un ensemble de conseils pratiques et
organisationnels permettant de garantir la conformité du produit, notamment par la maîtrise
des facteurs humains, techniques et administratifs. Elles visent en particulier des critères
d’hygiène et de sécurité des produits cosmétiques.
Un des piliers de ce nouveau règlement cosmétique (1223/2009) est le respect des Bonnes
Pratiques de Fabrication (BPF). L’article correspondant stipule : « Article 8 : Les Bonnes
Pratiques de Fabrication [W9].
1. / La fabrication des produits cosmétiques respecte les bonnes pratiques de fabrication en
vue de garantir les objectifs de l’article 1er.
2. / Le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication est présumé lorsque la fabrication est
effectuée conformément aux normes harmonisées applicables dont les références ont été
publiées au Journal Officiel de l’Union européenne.
De 2008 à 2013, tous produits cosmétiques mis à disposition sur le marché européen ont à
être mis en adéquation avec la norme ISO 22716, descriptif officiel des Bonnes Pratiques de
Fabrication, articulée autour de la production, du contrôle, du conditionnement, du stockage
et du transport des cosmétiques.
Les objectifssont de garantir la qualité du produit cosmétique. Ainsi les BPF vont :
• Faciliter l’organisation et la réalisation des activités d’un établissement cosmétique, de façon
à maîtriser les facteurs pouvant avoir une incidence sur la qualité des produits cosmétiques.
• Prendre en considération les besoins propres au secteur de la cosmétique.
• Réduire les risques de confusions, d’oublis, de détériorations, de contaminations et d’erreurs.
37
• Impliquer le personnel : information et formation au poste affecté et aux BPF.
• Garantir au consommateur la qualité d’un produit cosmétique.
• Disposer d’un référentiel reconnu à l’international facilitant les importations et les
exportations.
8.1.2.4-Notification
Dans le règlement (CE) N°1223/2009, une notification simplifiée, centralisée et électronique
est prévue et remplace l’envoi des formules aux centres antipoison. Celle-ci permet
d’informer toutes les autorités compétentes du marché intérieur à travers un portail de
notification unique. L’analyse d’impact (CE, 2008) montre qu’il serait possible de réduire
d’approximativement 80 % les frais administratifs liés à la notification aux centres antipoison.
Bien que la démarche soit simplifiée en termes de notification, tous les produits doivent être
conformes au moment de l’entrée en application du texte. Les formules déjà envoyées aux
centres antipoison devront donc être re-notifiées. Le portail est disponible depuis janvier
2012.
8.1.3-Règlementation relatives à la composition des produits cosmétiques
La composition des cosmétiques est très strictement réglementée au niveau européen.
Les Annexes du Règlement Cosmétique énumèrent les substances interdites (annexe II), les
substances règlementées (annexe III) et trois listes positives de substances autorisées comme
colorant (annexe IV), conservateur (annexe V) et filtres ultraviolets (annexe VI).
Dans les annexes III à VI, sont précisées à quelle concentration maximale et à quelles
conditions les substances peuvent être utilisées en toute sécurité, ainsi que les conditions
d'emploi et les avertissements devant être obligatoirement repris sur l'étiquetage.
Ces Annexes sont régulièrement actualisées par la Commission Européenne sur la base des
avis d'un comité d'experts indépendants ou Comité Scientifique pour la Sécurité des
Consommateurs (CSSC) [W10].
Afin d’assurer un niveau de protection élevé pour la santé humaine et l’environnement, les
substances chimiques dangereuses sont classées selon trois catégories (1A, 1B, 2) en fonction
de leur danger en matière de cancérogénicité, mutagénicité et reprotoxicité.L’utilisation des
38
substances classées comme CMR est interdite. Des exceptions peuvent être autorisées et faire
l’objet de dérogations sous certaines conditions. Les produits cosmétiques peuvent contenir
des nanomatériaux et nanoparticules. Cette autorisation ne s’applique pas aux nanomatériaux
utilisés comme colorants, filtres ultraviolets ou agents conservateurs réglementés par l’article
14 du règlement européen du 30 novembre 2009, sauf spécification contraire [W11][26].
8.1.4- Dossier d’Information Produit :
Avant d'être mis sur le marché, un produit cosmétique doit faire l'objet d'un "Dossier
d'information sur le produit" très complet contenant, entre autres, les informations et données
suivantes :[W11 ,W12]
• Une description du produit cosmétique permettant l’établissement d’un lien clair entre
le dossier d’information et le produit cosmétique concerné.
• Le rapport sur la sécurité du produit cosmétique comportant.
o La formule qualitative et quantitative du produit précisant l’identité chimique
des substances.
o Les caractéristiques physiques/chimiques et l’analyse de stabilité du produit
cosmétique.
o La qualité microbiologique du produit justifiée des résultats du Challenge Test
o Les résultats d’analyse du matériau d’emballage.
o Les données relatives à l’exposition au produit cosmétique et aux substances
selon divers paramètres, prenant en considération les effets toxicologiques
envisageables.
o Les résultats des analyses toxicologiques.
o Les éventuels effets indésirables du produit cosmétique sur la santé humaine.
• Une description de la méthode de fabrication et une déclaration de conformité aux
bonnes pratiques de fabrication.
• Les preuves de l’effet revendiqué par le produit cosmétique.
• Les données relatives au développement ou à l’évaluation de la sécurité du produit
cosmétique ou de ses ingrédients.
39
Ce dossier est ensuite conservé par le fabricant. Il doit être présenté à chaque réquisition par
différentes autorités de contrôle qui peuvent être des pharmaciens inspecteurs de la santé, des
médecins inspecteurs de la santé, des inspecteurs de l'AFSSAPS ou des inspecteurs de la
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
8.1.5- Règlement en matière d’étiquetage Le « récipient » et l’« emballage » de chaque produit cosmétique mis sur le marché doivent
comporter de manière lisible, clairement compréhensible et indélébile, dans la(les) langue(s)
nationale(s) ou officielle(s) de l’Etat membre concerné, les mentions suivantes : [W11,W13]
1. / Le nom et l’adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi dans
l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Ces mentions
peuvent être abrégées à condition qu’elles permettent d’identifier l’entreprise. Si plusieurs
adresses sont indiquées, celle où le responsable de la mise sur le marché tient à disposition le
dossier d'information sur le produit est mise en évidence.
2. / Le pays d’origine des produits lorsqu’ils sont fabriqués dans les pays qui n’appartiennent
pas à l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
3. / Le contenu nominal (quantité du produit), en masse ou en volume, au moment de son
conditionnement, sauf pour :
• Les emballages contenant moins de 5 gr ou 5 ml de produit ;
• Les échantillons gratuits ;
• Les produits présentés sous forme d’unidoses ;
• les produits pré-emballés contenant un ensemble de pièces.
4. / La date de durabilité minimale (date de péremption) pour les produits dont la durabilité est
inférieure à 30 mois. Il s’agit de la date jusqu’à laquelle le produit, conservé dans les
conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale.
Cette date est annoncée par la mention « A utiliser de préférence avant fin … », suivie soit :
• De la date elle-même ;
•De l’indication de l’endroit de l’étiquetage où elle figure. La date se compose, dans l’ordre, du mois et de l’année (ex : 07/2012), ou bien du jour, du mois et de l’année (ex : 08/07/2012).
•Ou un pictogramme sous forme de sablier suivi de la date ;
En cas de besoin, les conditions dont le respect permet d’assurer la durabilité indiquée, sont
également mentionnées.
5. / La durée minimale d’utilisation des produits cosmétiques après ouverture ou « Période
Après Ouverture (PAO) », c'est
dommages pour le consommateur. Elle est obligatoire
produits dont la durabilité minimale (péremption) est supérieure à 30 mois. Cette période est
indiquée par un symbole représentant un pot de crème ouvert, suivi de la durée d'utilisation
(exprimée en mois et/ou années).
Si la période est indiquée en mois, elle peut être mentionnée par un nombre suivi par le mot «
mois » ou par l’abréviation « M » qui correspond à « Menses », mois en latin.
A titre d’exemple, le symbole « 12M » ci
conserve 12 mois après son ouverture
6./Les précautions particulières d’emploi. En l’absence de place suffisante, elles doivent être
reportées sur une notice, une bande, une carte jointe ou attachée à l’emballage. Dans ces cas,
le consommateur y est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole
7./Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication.
Cette indication peut ne figurer que sur l’emballage si les dimensions du produit cosmétique
sont réduites.
8./ La fonction du produit (crème hydratante, après
présentation du produit.
9./ La liste des ingrédients selon leur dénomination INCI (International Nomenclature of
CosmeticIngredients) dans un
liste est précédée du terme « INGREDIENTS ». Cette liste peut figurer uniquement sur
l’emballage ou en cas d’impossibilité pratique sur une notice, une bande ou une carte jointe
ou attachée au produit. Dans ce dernier cas, le consommateur est renvoyé soit par une
indication abrégée, soit par le symbole
Les ingrédients en concentration inférieure à 1% peuvent être mentionnés dans le désordre
après ceux dont la concentration est supérieure à
40
En cas de besoin, les conditions dont le respect permet d’assurer la durabilité indiquée, sont
La durée minimale d’utilisation des produits cosmétiques après ouverture ou « Période
Après Ouverture (PAO) », c'est-à-dire la durée d’utilisation optimale après ouverture sans
dommages pour le consommateur. Elle est obligatoire sur l’étiquetage uniquement pour les
produits dont la durabilité minimale (péremption) est supérieure à 30 mois. Cette période est
indiquée par un symbole représentant un pot de crème ouvert, suivi de la durée d'utilisation
(exprimée en mois et/ou années).
Si la période est indiquée en mois, elle peut être mentionnée par un nombre suivi par le mot «
mois » ou par l’abréviation « M » qui correspond à « Menses », mois en latin.
A titre d’exemple, le symbole « 12M » ci-contre, signifie que le produit cosméti
mois après son ouverture
Les précautions particulières d’emploi. En l’absence de place suffisante, elles doivent être
reportées sur une notice, une bande, une carte jointe ou attachée à l’emballage. Dans ces cas,
st renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole
Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication.
Cette indication peut ne figurer que sur l’emballage si les dimensions du produit cosmétique
La fonction du produit (crème hydratante, après-shampooing, …), sauf si cela ressort de la
La liste des ingrédients selon leur dénomination INCI (International Nomenclature of
ordre décroissant de leur importance pondérale (quantité). Cette
liste est précédée du terme « INGREDIENTS ». Cette liste peut figurer uniquement sur
l’emballage ou en cas d’impossibilité pratique sur une notice, une bande ou une carte jointe
au produit. Dans ce dernier cas, le consommateur est renvoyé soit par une
indication abrégée, soit par le symbole
Les ingrédients en concentration inférieure à 1% peuvent être mentionnés dans le désordre
après ceux dont la concentration est supérieure à 1%. Les colorants peuvent être mentionnés
En cas de besoin, les conditions dont le respect permet d’assurer la durabilité indiquée, sont
La durée minimale d’utilisation des produits cosmétiques après ouverture ou « Période
dire la durée d’utilisation optimale après ouverture sans
sur l’étiquetage uniquement pour les
produits dont la durabilité minimale (péremption) est supérieure à 30 mois. Cette période est
indiquée par un symbole représentant un pot de crème ouvert, suivi de la durée d'utilisation
Si la période est indiquée en mois, elle peut être mentionnée par un nombre suivi par le mot «
mois » ou par l’abréviation « M » qui correspond à « Menses », mois en latin.
ie que le produit cosmétique se
Les précautions particulières d’emploi. En l’absence de place suffisante, elles doivent être
reportées sur une notice, une bande, une carte jointe ou attachée à l’emballage. Dans ces cas,
st renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole
Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication.
Cette indication peut ne figurer que sur l’emballage si les dimensions du produit cosmétique
shampooing, …), sauf si cela ressort de la
La liste des ingrédients selon leur dénomination INCI (International Nomenclature of
ordre décroissant de leur importance pondérale (quantité). Cette
liste est précédée du terme « INGREDIENTS ». Cette liste peut figurer uniquement sur
l’emballage ou en cas d’impossibilité pratique sur une notice, une bande ou une carte jointe
au produit. Dans ce dernier cas, le consommateur est renvoyé soit par une
Les ingrédients en concentration inférieure à 1% peuvent être mentionnés dans le désordre
1%. Les colorants peuvent être mentionnés
41
dans le désordre après les autres ingrédients. Ils sont désignés soit par leur numéro, soit par
leur dénomination.
Les termes « parfum » ou « aroma » indiquent la présence d’ingrédients ayant pour vocation à
parfumer le produit. S’il s’agit de substances susceptibles de provoquer des allergies, elles
doivent être détaillées dans la liste des ingrédients.
Tout ingrédient présent sous la forme d’un nanomatériau doit être clairement indiqué dans la
liste des ingrédients. Le nom de l’ingrédient est suivi de la mention [nano].
Les fabricants peuvent utiliser des termes liés aux cosmétiques sur l'étiquette ou l'emballage
de leurs produits bien que les termes ci-dessous ne soient pas définis dans le Règlement sur
les cosmétiques ;
-- « sans conservateur » signifie que le produit ne contient aucune substance inscrite sur la
liste positive des conservateurs ;
- « oil free » ne veut pas dire que le produit ne contient pas d’huile mais qu’il ne contient pas
de substance minérale classique, type paraffine ;
- « sans tensioactif » indique une stabilisation par gélifiants ;
- « non comédogène » signifie que le produit ne contient pas de substance connue comme
favorisant l’apparition des comédons ;
- « hypoallergénique » indique que le produit ne contient pas de substance àpotentiel
allergisant ou photoallergisant connu ;
- « pour peaux sensibles ou réactives » indique une composition voisine de celle des produits
hypoallergéniques, simple et avec des ingrédients de grande pureté.
-« biologique »signifie qu'il est composé à plus de 95 % d'ingrédients biologiques. Les
ingrédients individuels peuvent aussi être étiquetés « biologiques » s'ils respectent les normes.
42
En dehors de ces obligations, le fabricant du produit peut imposer sur l’étiquetage ce qu’il veut.
Logo de conformité propose par la profession assurant que la protection des produits solaires contre les UVB est conforme à la réglementation
Les allégations n’étaient a ce jour, ni contrôlées, ni régulées. Le nouveau règlement rappelle l’interdiction de revendiquer des allégations vantant des propriétés a un produit qui ne les possède pas. D’ ici juillet 2016, des listes de critères communs devant être réunis pour pouvoir aspirer à une allégation seront publiées.
Fonction du produit
Sur les produits de protection solaire doivent être indiques
clairement le facteur de protection solaire
(FPS ou SPF) et la
Volume ou poids contenu dans le produit sauf si celui-ci est <5ml ou 5g
Obligatoire
Non obligatoire
43
Fig.6 : Les mentions obligatoires et non obligatoires concernant l’étiquetage [17].
8.1.6- Expérimentation animale
Le secteur cosmétique s'est engagé depuis trente ans dans le développement de méthodes
alternatives à l’expérimentation sur l'animal de laboratoire. L'Union Européenne instaura
l’interdiction de mener des expérimentations sur l'animal de laboratoire et de commercialiser
des produits finis contenant des substances testées sur l'animal de laboratoire.
Depuis 2004, l'expérimentation de produits cosmétiques finis sur les animaux de laboratoire
est interdite.
Liste des ingrédients (n’est parfois que sur emballage) cité selon la nomenclature internationale INCI par ordre de concentration décroissante
Nom et adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché avec indication du pays d’origine dans le cas d’un produit importé
Les précautions particulières d’emploi
Référence ou numéro de lot du produit pour son identification
La durée minimale d’utilisation des produits cosmétiques après ouverture ou « Période Après Ouverture (PAO) » pour les produits dont la durabilité minimale est supérieure à 30 mois
La date de durabilité minimale
(pour les produits dont la durabilité est inférieure à 30 mois. Cette date est précédée d’un sablier ou la mention « A utiliser de préférence avant fin … »
44
En 2009, cette interdiction d'expérimentation sur l'animal de laboratoire a été élargie aux
substances utilisées dans les produits cosmétiques. A cette même date est entrée en vigueur
l'interdiction de commercialiser des produits cosmétiques contenant des substances testées sur
l'animal de laboratoire.
Néanmoins trois exceptions demeurent, soit la reprotoxicité, la toxicité à dose répétée et la
toxicocinétique, sous réserve que ces tests aient été conduits en dehors de l'Union
Européenne.
Cette interdiction de commercialisation des produits finis contenant des substances testées sur
les animaux de laboratoire avec ces trois dernières exceptions est entrée en vigueur le 11 mars
2013 dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne [W14, W15].
8.1.7-Réglementation des substances chimiques
8.1.7.1- L’ INCI
L’International Nomenclature for CosmeticIngredients (INCI), soit la Nomenclature
Internationale des Ingrédients Cosmétiques, a été créée en 1973 par l’association américaine
Cosmetic Toiletry and Fragrance Association (CFTA). Elle est obligatoire en Europe depuis
1998. Cela permet d’avoir une nomenclature commune aux pays européens. Les noms
chimiques et usuels y sont mentionnés en anglais, les noms de plantes sont indexés en latin.
Les colorants sont nommés par la dénomination Color Index (CI) suivi d’un chiffre compris
entre 10 000 et 80 000. Les ingrédients y sont cités par ordre décroissant selon leur
concentration jusqu’à une concentration de 1% en dessous de laquelle ils ne sont plus classés.
Le plus souvent, sont retrouvés en grande quantité, donc en début de liste, l’eau, les matières
grasses, les tensioactifs et les substances actives. En petite quantité (enfin de liste) figurent les
conservateurs, les antioxydants, les colorants et les parfums [27, 28].
8.1.7.2- Loi sur la gestion des substances chimiques : Loi REACH
De l'anglais "Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals ", REACH est un
règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne adopté fin décembre
2006 et entré en vigueur le 1er juin 2007.Remplaçant plus de quarante directives et
règlements, il crée un seul système applicable à tous les produits chimiques. Il vise
45
notamment à renforcer les connaissances sur les substances chimiques, assurer une meilleure
information de l'ensemble des acteurs, accroître la protection de la santé et de
l'environnement et assurer une meilleure gestion des risques liés à leur production et
utilisation.
Parmi les dispositions importantes prévues du règlement REACH, figure la création
d’une Agence européenne des produits chimiques (ECHA), basée à Helsinki, dont le rôle est
d’assurer la mise en œuvre, la gestion et la coordination administrative, scientifique et
technique du système[W16].
• Champ d’application :
Le champ d’application du règlement couvre toutes les substances, qu’elles soient fabriquées,
importées, mises sur le marché ou utilisées, telles quelles ou incluses dans des mélanges.
Le règlement exclut de son champ d’application:
• les substances radioactives (couvertes par la Directive 96/29);
• les substances soumises à un contrôle douanier qui se trouvent en dépôt temporaire, en
zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation, ou encore en transit;
• les intermédiaires non isolés;
Par ailleurs, les règles relatives à l’enregistrement, aux utilisateurs en aval, à l’évaluation et à
l’autorisation ne s’appliquent pas aux substances utilisées dans les médicaments à usage
humain ou vétérinaire ou dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux (y
compris les additifs) pour autant qu’ils rentrent dans le champ d’application de la législation
communautaire sur les médicaments ou sur les aliments[W17].
Le Règlement repose sur trois axes :
� Enregistrement
D’ici 2018, les industriels doivent enregistrer toutes les substances qu’ils fabriquent ou
importent en quantité supérieure à 1 tonne/an auprès de l’Agence Européenne des Produits
46
Chimiques (ECHA).Ils doivent ainsi fournir un certain nombre d’informations sur la
fabrication, les usages identifiés et les propriétés toxicologiques et écotoxicologiques de leurs
substances, faute de quoi, ils ne pourront plus mettre leur substance sur le marché ; c’est le
principe « Pas de données, Pas de marché ». Le niveau d’exigences en matière d’informations
à fournir varie en fonction du tonnage des substances mises sur le marché.
Au-delà d’une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes mise sur le marché, le producteur ou
l’importateur de la substance doit en plus fournir un rapport sur la sécurité chimique (RSC ou
CSR), soit une évaluation des risques assortie de propositions de mesures de gestion des
risques adéquates pour garantir la sécurité des personnes et de l’environnement [W18].
� Évaluation
Elle comprend l’évaluation des dossiers par l’Agence (évaluation des propositions d’essais et
évaluation de la conformité des dossiers) et l’évaluation des substances par les Autorités
Compétentes (ACs) des Etats membres. Les substances soumises à évaluation sont définies en
fonction de critères de priorités fixés par l’Agence en lien avec les ACs, et listées sur un plan
d’action continu.
� Autorisation
L’autorisation des substances dites " Préoccupantes " telles que les cancérogènes, mutagènes,
toxiques pour la reproduction (CMR) ; les substances persistantes bioaccumulables et
toxiques (PBT) ; les substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) ; et toute
autre substance, de niveau de préoccupation équivalent, identifiée comme pouvant avoir des
effets graves sur la santé humaine et/ou l’environnement, tel que les perturbateurs
endocriniens. Les autorisations d’utilisations sont octroyées par la Commission Européenne
sur dossier.
� Restriction
Enfin, la procédure de restriction constitue le « filet de sécurité » du système mis en place par
le règlement REACH car elle permet aux états membres ou à la Commission Européenne
d’intervenir pour proposer des mesures de gestion des risques pour toute substance, sans
47
condition de tonnage, dès lors qu’ils estiment que la mise sur le marché ou l’utilisation de
cette substance entraîne un risque qui n’est pas valablement maîtrisé.
8.1.8- Cosmétovigilance
8.1.8.1- Introduction
La cosmétovigilance a été introduite dès 2003 dans le cadre du 7ème amendement à la
Directive réglementant les produits cosmétiques est encadrée par le Règlement (CE)
n°1223/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits
cosmétiques (règlement cosmétique), notamment l'article 23 et les articles L.5131-5, L.5431-8
et R.5131-6 à R.5131-15 du code de la santé publique. Elle s’exerce sur l’ensemble
des produits cosmétiques après leur mise sur le marché.
Elle s'appuie sur :
o La déclaration des effets indésirables ou secondaires et le recueil des informations les
concernant
o L’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation des informations relatives à ces effets dans un
but de prévention
o La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d’emploi des produits
cosmétiques
o La réalisation et le suivi d’actions correctives, en cas de nécessité.
8.1.8.2-Quelques définitions
L’effet secondaire est un effet provoqué par un cosmétique qui n'est initialement pas
recherché. Les effets secondaires ne sont pas forcément nocifs, Certains peuvent être
bénéfiques, et sont généralement connus pour des molécules qui ont été longtemps étudiées et
qui sont depuis longtemps sur le marché.
L'effet indésirable est une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l’utilisation
normale ou raisonnablement prévisible d’un produit cosmétique
48
L’effet indésirable grave est défini comme un effet indésirable entraînant une incapacité
fonctionnelle temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies
congénitales, un risque vital immédiat ou un décès
Le mésusage correspond à une utilisation non conforme à la destination du produit, à son
usage normal ou raisonnablement prévisible ou à son mode d’emploi ou aux précautions
particulières d’emploi
8.1.8.3- Acteurs de la cosmétovigilance et leurs obligations
• Personne Responsable des produits cosmétiques
La personne responsable désignée (l’article 4 du règlement cosmétique) soit :
– le fabricant établi dans l’Union Européenne
– l’importateur ou un mandataire établis dans l’Union Européenne
– le distributeur qui met sur le marché sous son nom ou sa marque ou qui modifie un
produit de telle sorte que sa conformité aux exigences du règlement cosmétique risque
d’en être affectée,
A l’obligation de déclarer, sans délai :
o Tous les effets indésirables graves à l’autorité compétente où cet effet a été constaté.
o Tous les effets indésirables graves dont elle a eu connaissance ou dont on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elle en ait connaissance
o Des mesures correctives prises, le cas échéant (article 23 du règlement cosmétique).
La personne responsable peut déclarer à l’ANSM les autres effets indésirables et les effets
susceptibles de résulter d’un mésusage du produit.
Par ailleurs, toutes les données disponibles sur les effets indésirables et les effets indésirables
graves pour le produit doivent être intégrées au rapport sur la sécurité du produit cosmétique.
49
• Les professionnels de santé
Médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers et autres ont l’obligation de déclarer, sans délai,
à l’ANSM :
o Tous les effets indésirables graves dont ils ont connaissance, susceptibles de résulter de
l’utilisation d’un produit cosmétique.
o Les autres effets indésirables dont ils ont connaissance ainsi que les effets susceptibles de
résulter d’un mésusage du produit.
• Consommateurs et utilisateurs professionnels
Les Consommateurs et les professionnels de la beauté, les coiffeurs,….peuvent déclarer à
l’ANSM tout effet indésirable ainsi que les effets indésirables susceptibles de résulter
d’un mésusage.
Le système RAPEX permet aux pays européens d'échanger rapidement des informations sur
les produits concernés et les actions de correction engagées (par exemple, un rappel de lot).
8.2- Réglementation Marocaine
La fabrication et l’importation des produits cosmétiques sont désormais soumis à une
procédure d’enregistrement préalable à leur mise sur le marché selon la circulaire du
Ministère de la Santé N° 48 DMP/20, qui fixe le cadre relatif à l’enregistrement des produits
cosmétiques. Cette circulaire vient combler le vide juridique en la matière en attendant
l’élaboration d’une réglementation spécifique pour ces produits.
La circulaire énonce un certain nombre de principes généraux très proches de ceux de la
Directive européenne 76/768/CEE et renvoie d’ailleurs explicitement aux annexes de ce texte.
50
8.2.1- Objectifs et champs d’application
Ce texte a pour objectif de préserver la santé des consommateurs marocains en garantissant la
qualité, l’efficacité, la sécurité d’emploi des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle mis
à leur disposition.
La présente circulaire définit les caractéristiques de composition auxquelles
doivent répondre les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et prescrit des règles pour
leur étiquetage ainsi que pour leur emballage. Elle ne vise que les produits cosmétiques et
d’hygiène corporelle [W19].
Ses dispositions définissent et arrêtent :
-Les champs d’application et les définitions ;
- La composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative
d’enregistrement des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle ;
- L’enregistrement d’un produit cosmétique et d’hygiène corporelle ;
- Les critères d’évaluation d’un dossier technique ;
- Le certificat d’enregistrement retrait ou d’interdiction de vente d’un produit cosmétique ;
8.2.2- Commission de la Cosmétologie
La création d’une commission de cosmétologie est une actualité au Maroc. Cette commission
comprend la Direction du Médicament et de la Pharmacie (DMP), le Centre Antipoison et de
Pharmacovigilance, la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies et des
Professeurs d’Enseignement Supérieur en Dermatologie des Facultés de Médecine de Rabat,
Casablanca, Fès et Marrakech. La présidence est assurée par le Directeur du médicament et de
la pharmacie. Cette structure est chargée d’examiner les dossiers de demande
d’enregistrement et de renouvellement d’enregistrement des produits cosmétiques et
d’hygiène corporelle. Elle aura pour mission de donner un avis sur lequel le ministère de la
santé se basera pour l’octroi du certificat d’enregistrement ou de son renouvellement. La
51
commission de cosmétologie devra également donner un avis sur toutes les questions de
suspension, de retrait ou d’interdiction de vente d’un produit.
8.2.3- Dossier d’enregistrement
Le dossier de demande d’enregistrement d’un produit cosmétique doit être déposé auprès de
la Direction du médicament et de la pharmacie.
La demande d’homologation-enregistrement d’un produit cosmétique comporte un dossier
administratif et technique. Plusieurs pièces sont à fournir dans le cadre du premier dossier, à
savoir une demande adressée à la DMP précisant la nature de la demande (enregistrement,
renouvellement, mise à jour), le nom du laboratoire fabricant , l’adresse et la raison sociale
des sites de fabrication, de conditionnement ou d’importation, le nom, le dosage, la forme et
la présentation du produit cosmétique, le certificat de libre vente ou attestation d’autorisation
de mise en vente dans le pays d’origine visée par l’autorité de tutelle, le certificat d’examen
validant le système complet d’assurance qualité et le numéro d’identification, une copie de la
quittance de paiement, des échantillons du modèle de vente, l’accusé de réception du dépôt de
la fiche auprès du centre antipoison de la formule qualitative et quantitative du produit. Pour
sa part, le dossier technique contient la formule qualitative et quantitative du produit, les
spécifications physico-chimiques des matières premières et du produit fini, les critères de
pureté et de contrôle microbiologique des produits cosmétiques, la méthode de fabrication,
l’étude de stabilité, avec durée de validité du produit, la description de l’emballage primaire et
secondaire.…
Une fois délivrée, l’autorisation de commercialisation est valable 5 ans. La demande de
renouvellement doit être déposée trois mois avant son expiration.
53
1- Généralités
Les parabènes représentent une grande famille de composants organiques. Ils tiennent leur
nom de parahydroxybenzoates, ce sont des esters d'acide p-hydroxybenzoïque [29].
Leur première utilisation en tant que conservateurs remonte à 1930 pour remplacer d’autres
conservateurs, les formaldéhydes, jugés nocifs pour la santé humaine et d’usage désormais
restreint aux vernis à ongles [30].
Selon la définition de la Communauté Européenne [W20] on entend par conservateur toute
substance “ qui prolonge la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant
des altérations dues aux micro-organismes ”.
Du fait de leur activité effective antibactérienne et antimycosique, ils sont utilisés comme
antimicrobiens dans les aliments, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
L’absence de nocivité liée à leur utilisation depuis des années en ont fait des substances
considérées comme sûres, mais leur innocuité a été remise en question dernièrement par des
études qui montrent une activité oestrogénique des parabènes et leur présence dans des
cellules cancéreuses. Ces nouvelles informations lancé une véritable polémique autour de ces
composés.
1.1- Structure chimique et synthèse
Les parabènes, en tant qu'esters, sont préparés à partir de l'acide p-hydroxybenzoïque et
l'alcool correspondant à la chaîne alkyle souhaitée. Le procédé industriel utilise le phénol
comme précurseur de l'acide, selon la réaction de Kolbe-Schmitt qui consiste en la
carboxylation à chaud et sous pression du phénol en présence d'un sel métallique et de
dioxyde de carbone (Fig.8)[31].
Fig.8: Synthèse d’acide para
Les différents composés de cette famille d’esters diffèrent par la nature et la lo
chaîne alkyle R présente en position para du cycle benzénique
Les composés de la famille des parabènes les plus couramment utilisés sont les suivants :
• Méthylparabène (R = -
• Ethylparabène (R = -CH2
• Propylparabène (R = -CH2CH2CH3 ; E216) et son sel de sodium (E217) ;
• Butylparabène (R = -CH(CH2)2CH3)
• Isopropylparaben
• Benzylparaben
Fig.7: Structure générale d'un parabène ;
54
: Synthèse d’acide para-hydroxybenzoïque par la réaction de Kolbe
Les différents composés de cette famille d’esters diffèrent par la nature et la lo
chaîne alkyle R présente en position para du cycle benzénique.
Les composés de la famille des parabènes les plus couramment utilisés sont les suivants :
-CH3 ; E218) et son sel de sodium (E219) ;
CH2CH3 ; E214) et son sel de sodium (E215) ;
CH2CH2CH3 ; E216) et son sel de sodium (E217) ;
CH(CH2)2CH3)
Structure générale d'un parabène ; -R est un groupe alkyle.
hydroxybenzoïque par la réaction de Kolbe-Schmitt) [31].
Les différents composés de cette famille d’esters diffèrent par la nature et la longueur de leur
Les composés de la famille des parabènes les plus couramment utilisés sont les suivants :
CH3 ; E214) et son sel de sodium (E215) ;
CH2CH2CH3 ; E216) et son sel de sodium (E217) ;
R est un groupe alkyle.
1.2- Propriétés physico-chimiques
Les différentes propriétés physico
regroupées dans le tableau 2. Cependant, on trouve aussi l'isopropyl, l'isobutyl et le
benzylparaben qui ne sont pas détaillés dans le tableau du fait de leur faible emploi.
Méthylparaben
Isopropylparaben
Fig.9
55
chimiques
priétés physico-chimiques des parabènes les plus couramment
. Cependant, on trouve aussi l'isopropyl, l'isobutyl et le
benzylparaben qui ne sont pas détaillés dans le tableau du fait de leur faible emploi.
Ethylparaben Propylparaben
Butylparaben
9: Structures des principaux parabènes [29].
les plus couramment utilisés sont
. Cependant, on trouve aussi l'isopropyl, l'isobutyl et le
benzylparaben qui ne sont pas détaillés dans le tableau du fait de leur faible emploi.
Propylparaben
Benzylaparaben
56
Tab.2: Tableau récapitulatif des propriétés physico-chimiques des principaux parabènes [32].
R Methyl Ethyl Propyl Butyl
Masse Molaire (g.mol -1)
152,05
166,06
180,08
194,09
Point de fusion (°C)
131
116-118
96-98
68-69
Point d’ébullition (°C)
270-280
297-298
Solubilité dans l'eau à 25°C
0,25 %
0,17 %
0,05 %
0,02 %
PKa 8,17
8,22
8,35
8,37
Apparence (à 25°C)
Cristaux incolores sans odeur et sans goût
Leur solubilité dans l’eau étant assez faible,des solubilisants sont employés et
parfois,notament en industrie alimentaire, les parabènes sont remplacés par leur sels.
La structure de ces molécules joue un rôle déterminant dans leurs propriétés
physicochimiques, le méthyl et l’éthylparaben (parabènes « à chaîne courte ») sont beaucoup
plus solubles que le propyl et butylparaben (parabènes « à chaîne longue »).
La structure des parabènes est stable dans l'air et présente une résistance accrue à l'hydrolyse
quand la chaîne alkyl est longue. La température de fusion des parabènes est assez haute, cela
permet de les utiliser dans des produits qui peuvent être placés à très forte chaleur sans les
dénaturer [33].
57
1.3- Origine
Généralement synthétiques, les parabènes, dont le méthylparabène et le propylparabène
notamment, existent à l’état naturel dans un certain nombre d’aliments tels la mûre, l’orge, la
fraise, le cassis, la vanille, la carotte, la pêche, les haricots blancs, le pamplemousse ou
l’oignon, ou encore dans des aliments préparés à partir de plantes (jus de raisin, vin blanc,
vinaigre de vin...), les extraits de levure et certains fromages. On les trouve également dans
les produits fabriqués par les abeilles (propolis, gelée royale...). Ils sont par
ailleursnaturellement présents dans le corps humainet plus particulièrement chez la femme en
tant que précurseur du coenzyme Q10 et peuvent être synthétisés parcertaines bactéries
marines comme moyens de défense vis-à-vis d’autres microorganismes[34].
1.4- Action contre les micro-organismes
Les parabènes sont actifs vis-à-vis d’un grand nombre de microorganismes.
Leur spectre d’action est très large :
– Bactéries: Bacillus cereus;Escherichia coli ; Streptococcuspyogenes; Staphylococcus
aereus…
– Champignons : Aspergillus niger;Candidaalbicans ; Penicillium digitatum
Les bactéries à Gram positif (Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus…) sont plus sensibles
queles bactéries à Gram négatif (Escherichia, Salmonella, Pseudomonas). Ils sont souvent
employés en combinaison avec d'autres conservateurs comme des précurseurs
duformaldéhyde, des isothiazolinones ou du phénoxyéthanol afin de compléter leur spectre
d’action [35].
Leur solubilité dans l'eau décroît et leur pouvoir antibactérien augmente avec la longueur de
leur chaîne alkyle. Ainsi, les méthyl et éthylparabènes, bien que présentant les plus faibles
actions antimicrobiennes, sont les plus utilisés du fait de leur grande solubilité en phase
aqueuse. En effet, les attaques microbiennes sont majoritaires dans cette phase [36, 37], c'est
pourquoi, en formulation, l’onpréfère souvent utiliser une combinaison des différents
parabens, à chaînes alkyles courtes et moyennes, plutôt qu'un seul. La protection de toutes les
phases (aqueuse et huileuse) est ainsi assurée [38].
58
Le mécanisme d'action des parabènes sur les bactéries est de nos jours encore mal connu.
Une étude réalisée par Nguyen en 2005[39] explique que les parabènes activeraient les canaux
mécanosensibles des bactéries pour les détruire. Ces canaux correspondent à des "valves de
sécurité" des bactéries qui leurs permettent de résister à un choc osmotique; lorsque la
bactérie est brutalement plongée dans l'eau pure, un flux entrant d'eau provoque le gonflement
de la cellule qui induit une augmentation de la tension membranaire de la cellule et provoque
l'ouverture du canal. La sortie d'ions et de petites molécules permet une diminution de la
tension et évite l'éclatement de la cellule. Lorsque les parabènes activent ces canaux, ceux-ci
s'ouvrent anormalement et une partie du contenu cytoplasmique indispensable à la survie de la
bactérie est expulsé. S’ensuit la lyse de la cellule.
Toutefois, ce mécanisme d'action ne fait pas l'unanimité .d'autres études proposent, d’autres
mécanismes d’action tels que l'altération du système enzymatique ou la modification du
système de reproduction des bactéries par dénaturation des acides nucléiques.
1.5- Utilisation des parabènes dans les cosmétiques
Les parabènes sont employés dans un grand nombre de produits cosmétiques pour leurs
propriétés antifongiques et antimicrobiennes [36,39].
En 2006, ils étaient recensés dans 80 %des produits d’hygiène et de beauté toutes catégories,
soit dans plus de 13 200 formulations [40].
Une étude menée en Espagne en 2009 sur 215 produits cosmétiques indique un taux de
présence des parabènes de 99% dans des produits rinçables (crèmes et lotions) et de 77%
dans des produits sans rinçage (démaquillants) [41].
D’une manière générale, l’on retrouve les parabènes dans les lotions et crèmes hydratantes
pour le visage, le corps et les mains, les produits de maquillage et démaquillants, les crèmes et
lotions de nuit, les shampooings et après-shampooings, les déodorants ou encore les crèmes
solaires.
59
Une étude de Rastogi et al. en 2006 [40] a montré la présence majoritairement, dans les
cosmétiques, du méthylparaben, puis de l’éthylparaben, du propylparaben, du butylparaben et
enfin du benzylparaben.
Cette large utilisation des parabènes dans les produits cosmétiquess’explique par leurs
nombreux avantages :
� Faible toxicité générale,
� Large spectre d'activité (sur les bactéries, levures, moisissures et champignons),
� Bonne stabilité chimique (vis-à-vis du pH et de la température),
� Bonne tolérance : des études ont montré que les parabènes étaient relativement non
irritants et non sensibilisants sur les peaux normales,
� Propriétés organoleptiques remarquables et indispensables pour certaines formulations
(inodores, incolores, insipides),
� Biodégradabilité,
� Faible coût.
L’estimation de l’exposition via les cosmétiques n’a pas été finalisée, à ce jour, par le comité
scientifique SCCS (ScientificCommittee on ConsumerSafety). La méthodologie classique
d’estimation par la somme des expositions possibles par type de produits est discutée par
Cowan-Ellsberry et Robison [42] en 2009. Les auteurs estiment l’exposition via les
cosmétiques à 1,26 mg/kgpc/j, en considérant l’ensemble des parabènes et les fréquences
d’utilisation des produits.
1.6- Pharmacocinétique
1.6.1- Absorption
• Voie orale
Dans la littérature, quatre espèces animales ont servi à l’étude toxicocinétique des parabènes
(rat, chien, chat et lapin) [33].Les parabènes administrés par voie orale sont facilement
absorbés à partir du tube gastro intestinal, la liaison ester est ensuite hydrolysée par les
estérases hépatiques et rénales. Le faible nombre d’études réalisées chez l’Homme par voie
orale montre des résultats similaires à ceux observés chez les animaux de laboratoire [43,44].
60
L’administration par voie orale de méthylparabène ou d’éthylparabène donne lieu à une
absorption rapide, une métabolisation importante et rapide et une forte excrétion.
• Voie cutanée
Elle resterait le mode d’exposition principal pour les cosmétiques et produits de soins.
L’industrie évalue à 17.76 g la quantité quotidienne utilisée par un adulte de produits
cosmétiques contenant potentiellement des parabènes et à 378 mg pour les jeunes enfants
[45].
Il était convenu que l’absorption des parabènes à travers la peau était favorisée par
l’augmentation de la longueur de la chaine alkyle qui augmente leur lipophilie [46,47]. Or, El
Hussein et al.en 2007 ont étudié l’absorption des méthyl, éthyl, propyl et butyl parabènes in
vitro sur peau humaine [48]. Une lotion commerciale contenant les quatre parabènes à
différentes concentrations est appliquée pendant 24 h, les quatre parabènes diffusent d’autant
mieux dans le fluide récepteur qu’ils sont peu lipophiles et que la chaîne est courte (méthyl,
éthyl, propyl, butyl parabènes : 18 %, 14 %, 9 %, 2 %). En outre, l’absorption augmente avec
des doses répétées Ces résultats rejoignent ceux obtenus par Pedersen et al.en 2007
[49],Nicoli et al.en 2008 [50], Thiagoet al.en2010 [51]et Aubert et al. en 2012[52].
L’influence des autres composants des cosmétiques doit également être mentionnée; ainsi,
l’éthanol peut inhiber l’activité des estérases in vitro, augmenter la pénétration du méthyl
parabène dans la peau de cobaye et induire la conversion par transestérification du méthyl
parabène en butyl parabène [53].
De même, les parabènes sont souvent utilisés en association en raison de leur effet synergique
antibactérien (par exemple méthyl et propyl). Caonet al.en2010 ont étudié le flux dermique
de ces combinaisons dans un modèle in vitro d’oreille de porc [54]. Individuellement, la
solubilité et la lipophilicité des molécules rendent compte de l’absorption transcutanée
(méthyl parabène>éthyl parabène>propyl parabène>butyl parabène). La combinaison du
propyl avec les autres parabènes réduit leur flux d’environ deux fois pour le méthyl et le
butyl, et huit fois pour l’éthyl de manière probablement corellée à une rétention dans
l’épiderme et le derme.
61
1.6.2- Métabolisme
La quasi totalité de la dose de parabènes administrés par voie orale est transformée en 5 à 72 h
en acide p-hydroxybenzoïque et conjugués par hydrolyse estérasique et conjugaison par les
systèmes enzymatiques hépatiques et rénaux; jusqu’à 86 % du methylparaben est excrété
dans l’urine 24h après son administration ; le métabolisme est rapide, des métabolites
apparaissent au niveau urinaire trente minutes après l’ingestion des parabènes. Leur hydrolyse
dans le foie ou dans les reins est totale, 100 % sont hydrolysés en trois minutes [55].
Les parabènes peuvent également subir une hydrolyse lors de leur administration par voie
cutanée. Ainsi, Wooi et al. [56] et Seko et al.[57] rapportent que 70% du propylparaben
appliqué sur la peau de rats est métabolisé. En employant du diisopropylfluorophosphate
(inhibiteur d'estérase), ils constatent l'absence de métabolites actifs et montrent que les
carboxyl estérases, présentes dans la peau et la graisse sous-cutanée, sont responsables de
cette métabolisation. Le métabolisme au niveau cutané reste important, ce qui induirait une
faible exposition systémique du consommateur. Cependant, une étude a montré que 40 % du
methyl-paraben appliqué sur la peau d'un rat y pénétrait de manière intacte [58].
Une étude récente in vivo sur des volontaires humains indique quand à elle que moins de 1%
d’une forte dose de butylparaben appliquée sur la peau était absorbée intacte par celle-ci [59].
La plupart des études toxicocinétiques par voie cutanée ont utilisé le rat comme modèle. Les
données sont à utiliser avec précaution, en raison de la différence de métabolisme mise en
évidence : L’hydrolyse au niveau de la peau humaine est 3 à 4 fois moins efficace que celle
réalisée au niveau de la peau de rat. Par ailleurs, les estérases des deux espèces semblent avoir
des spécificités de substrat différentes : les préparations de peaux de rat hydrolysent d’autant
mieux les parabènes que la chaîne de l’ester est longue, alors que l‘hydrolyse par la peau
humaine est meilleure sur les parabènes à chaîne courte [60,61].
1.6.3. Excrétion
Les métabolites obtenus par l'hydrolysation des parabènes sont excrétés par voie urinaire. Le
métabolite majoritaire étant l'acide p-hydroxybenzoïque, on observe néanmoins d'autres
métabolites tels que la glycine, l'acide glucuronique et certains acides sulfuriques conjugués.
62
Dans une série d’études chez le lapin, Tasukamotoet al.[62] ont suivi le devenir métabolique
des parabènes administrés par gavage ; ceux-ci ne s’accumulent pas dans l’organisme, les
métabolites majoritaires sont excrétés dans les urines par ordre décroissant :acidep-
hydroxybenzoique libre (39%), glycine (15%), acide glucuronique et certains acides
sulfuriques conjugués. L’excrétion urinaire est rapide, 86% des métabolites sont éliminés en
24h. Il s’avère que le taux d’excrétion urinaire de l'acide p-hydroxybenzoique diminue
lorsque la longueur de la chaine alkyle augmente.
2- Polémique sur les parabènes : Eléments
Une étude réalisée en 2004 par Darbre et al. à l’Université de Reading au Royaume Uni [63],
largement médiatisée, révèle au grand public l’implication potentielle des parabènes contenus
dans les cosmétiques dans la survenue du cancer du sein.
2.1- Etude de Dabre, 2004 : origine de la polémique
Il ressort de cette étude que :
� Les ingrédients chimiques utilisés dans les déodorants et qui appliqués
quotidiennement sur les aisselles auraient un lien avec les cancers du sein.
� Des parabènes, méthylparaben principalement, sont retrouvés dans le tissu mammaire
� Un lien de cause à effet entre la présence des parabènes et le développement des
cancers du sein est émis : Les chercheurs ont observé 20 biopsies de tumeurs de sein et
ont trouvé des parabènes sous forme d’esters non métabolisés parmi 18 d’entres elles,
dont 4 à haute concentration.
2.1.1- Analyse et interprétation de l’étude
Les parabènes retrouvés sous forme d’esters non métabolisés impliquent qu’une proportion
des parabènes présents dans les cosmétiques peut être absorbée par l’épiderme, retenue et
accumulée dans les tissus de l’organisme sans être hydrolysés par les estérases. D’autres
63
études ont montré que les parabènes pouvaient copier la façon dont les œstrogènes contribuent
à développer un cancer.
Par ailleurs, le méthylparaben est celui qui est retrouvé en plus forte quantité ce qui s'explique
soit par le fait qu'il fait partie des deux parabènes les plus fréquemment employés (avec le
propylparaben), soit par le fait qu'il s'absorbe mieux dans les graisses.
Ces résultats sont cependant à relativiser car cette étude n’a pas permis d’identifier ni la
source des parabènes, ni la voie d’entrée, orale ou topique, systémique ou non.
Il reste à retenir de cette étude qu’elle ne permet pas de mettre en évidence un lien possible
entre l’exposition aux parabènes via l’usage des cosmétiques et la survenue de tumeurs
mammaires.
2.1.2- Réactions des scientifiques
L’étude de Darbre a engendré de nombreuses réactions émanant des scientifiques :
• Elle ne présente aucun tissu témoin de référence (sein normal) ou d’autres tissus sains
sur lesquels une éventuelle détection de concentrations en parabènes annulerait les
résultats de l’étude.
• La nature des tumeurs, bénignes ou malignes, et leur manipulation ne sont pas
décrites.
• Le nombre d’échantillons est restreint.
• Aucune information sur le contexte des patients donneurs n’est fournie pas plus que la
durée d’utilisation de produits contenant des parabènes ; l’accumulation potentielle qui
en découle reste imprécise.
2.2- Parabènes et Perturbation Endocrinienne
Les parabènes sont suspectés de perturber le système endocrinien en mimant les propriétés de
certaines hormones, notamment par l’activation des récepteurs aux œstrogènes. Ils auraient en
effet la capacité de générer une activité oestrogénique, d’où la question de savoir quels
seraient leurs effetssur la fertilité et leur risque d’induire des cancers hormonodépendants tels
que le cancer du sein.
64
– Perturbateur endocrinien, Définition :
Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances chimiques
naturelle(s) ou artificielle(s) exogène(s) à l’organisme, pouvant altérer les fonctions de son
appareil endocrinien et induisant des effets nocifs sur la santé de cet organisme ou de ses
descendants[W21].
Fig.10: Organisation du Système endocrinien [W21].
Un perturbateur endocrinien peut donc interférer avec la synthèse, le stockage, la libération, la
sécrétion, le transport, l’élimination ou l’action des hormones naturelles.
Il agit par effet:
- Agoniste en se liant sur le récepteur hormonal puis mimant les effets,
- Antagoniste en se liant sur le récepteur et bloquant les effets,
- Sur la biodisponibilité des hormones en influant sur leur synthèse, leur dégradation ou leur
circulation.
2.3- Activité oestrogénique des parabènes :
Même si les parabènes sont reconnus comme des substances relativement sûres, leur effet
oestrogénisant est très controversé à l'heure actuelle. Celui-ci a été étudié du fait de leur
65
structure similaire à d'autres produits connus pour être “ œstrogène-like ” : les alkylphenols.
En effet, la présence d'un groupement alcool en para sur le cycle aromatique est considérée
comme une condition importante pour observer un effet oestrogénique [W22].
Dès 1998, des études ont mis en évidence la capacité des parabènes à se lier aux récepteurs
œstrogéniques avec toutefois une capacité de liaison 10 000, 30 000, 150 000 et 2 500 000
fois plus faible (respectivement pour le butyl, le propyl, l’éthyl et le méthyl parabène) que le
ligand naturel, le 17β-œstradiol. L’intensité de l’activité oestrogénique mesurée augmente
avec la longueur de la chaine méthyl, éthyl, propyl, butylparaben, le PABA, métabolite
principal,ne présentant aucune affinité pour ces récepteurs [64].
Dans un test d’inhibition compétitive, Blair et al.[65]en 2000 ont testé sept parabènes pour
leur capacité à déplacer l’œstradiol tritié du récepteur aux œstrogènes isolé de l’utérus de rate
ovariectomisée ; l’éthylhexylparabèn se révèle le plus puissant (RBA – relative
bindingaffinity – 0,018 %) suivi parl’heptyl (0,008%), le benzyl (0,003%), le butyl
(0,0009%), le propyl (0,0006 %), l’éthyl (0,0006 %) puis le méthyl parabène (0,0004 %).
De nombreuses études ont évalué l’affinité des parabènes pour les récepteurs des œstrogènes à
l’aide du test de prolifération des cellules issues de la lignée tumorale mammaire MCF-7
(Darbre et al. [66];Pugazhendhiet al.[67]; Van Meeuwen et al.[68]; Sadler et al.[69]). La
capacité de stimulation est 10 000 à 10 000 000 fois inférieure à celle du 17β-œstradiol
(Okuboet al.[70]; Byford et al.[71]) et l’activité œstrogénique augmente dans l’ordre méthyl,
éthyl, propyl, butyl, isopropyl et isobutyl parabènes.
Pour Terasaka et al. [72], la longueur des chaînes alkyles des parabènes influe sur l’effet
œstrogénique dans les cellules MCF-7. Il existe une corrélation forte entre l’expression des
gènes dépendants des œstrogènes et ceux induits par le propyl parabène, comparativement au
méthyl parabène ou à l’éthyl parabène.
Une hypothèse concernant l’activité œstrogénique des parabènes a été proposée par
Prusakiewiczet al. en 2007 [73]. Les auteurs ont rapporté que les parabènes inhibent les
sulfotransférases de la peau et des kératinocytes. Ces enzymes participent au métabolisme des
œstrogènes et leur inhibition pourrait conduire à une augmentation du taux des œstrogènes
endogènes. Dans cette étude, le butyl parabène a montré la plus forte activité inhibitrice. Cela
66
explique que l’application cutanée chronique de parabènes puisse provoquer des effets
oestrogéniques.
Ce sont des résultats sensiblement identiques qui ont été observés lors d’études in vivo chez le
rat immature ou la souris immature ; lors de ces essais utérotrophiques, seuls les butyl,
isobutyl et benzyl parabènes provoquent une augmentation du poids de l’utérus, confirmant
que seuls les parabènes à chaîne longue présentent un effet œstrogénique. De leur côté, les
méthyl et éthyl parabènes et l’acide p-hydroxybenzoique n’ont aucun effet sur le poids utérin
[74, 75,76].
2.4- Effets sur le système reproducteur
Compte tenu de l'activité œstrogénique potentielle sur des modèles in vitro des parabènes, la
question de l'effet sur le système reproducteur s'est rapidement posée. En 2005 et 2007, des
travaux confirment la capacité des parabènes à se fixer sur les récepteurs aux œstrogènes et
montrent également que ces molécules sont capables de se fixer sur les récepteurs aux
androgènes et notamment ceux de la testostérone. Les parabènes sont soupçonnés d'avoir une
activité antagoniste de la testostérone en inhibant l'activité transcriptionnelle testostérone
dépendante [77,78].Une étude très récente vient confirmer ces résultats et ajoute que les
parabènes de type methyl, ethyl et propyl ont également une activité agoniste des
glucocorticoïdes qui n'avait jamais été démontrée précédemment [79].
Meeker et al.en2010 [80] ont étudié les taux urinaires de méthyl, propyl, butyl parabènes chez
une centaine d’hommes consultants pour infertilité et ont analysé les relations avec les taux
sériques d’hormones et les paramètres du sperme ainsi que les dommages de l’ADN des
spermatozoïdes (essai de la comète). Les échantillons d’urine contenaient à 100%du méthyl,
92 % du propyl et 32 % du butyl parabène. Aucune relation n’était observée entre le methyl
ou le propyl et les paramètres testés. Par contre la présence du butylparabène est
significativement associée (p=0,03) aux dommages de l’ADN, avec une relation dose
dépendante observée avec la fragmentation de l’ADN des spermatozoïdes.
67
Les études in vivo chez les rats et souris s’accordent sur l’absence d’effets sur les hormones
sexuelles ou sur les organes de reproduction masculins des deux molécules à chaîne courte
(méthyl et éthyl) [81,82]. Pour les chaînes longues (propyl et butyl), les résultats des études
réalisées in vivo restent contradictoires [83, 84,85] et il semblerait, selon certains auteurs, que
le métabolisme rapide de ces molécules par les estérases, et leur pénétration percutanée moins
importante comparée aux chaînes courtes, pourrait constituer une explication de leur innocuité
in vivo [81].
2.5- Parabènes et cancer de sein
Ainsi, les parabènes présentent la capacité de se fixer sur les récepteurs des œstrogènes et les
activent. L'œstradiol joue un rôle très important dans la prolifération des cellules mammaires.
Lorsqu'un cancer se déclare, les cellules se multiplient en se différenciant. Les premières
cellules cancéreuses se multiplient mais sont encore différenciées et possèdent toujours leurs
récepteurs. On peut alors imaginer que les parabènes peuvent venir se fixer à ces récepteurs et
activer la prolifération de ces cellules cancéreuses. Afin d'éclaircir ce point, des scientifiques
ont mené diverses expérimentations.
Les études in vitro sont en faveur de l’hypothèse d’un effet cancérigène des parabènes sur le
tissu mammaire. En effet, ils favorisent la prolifération des cellules MCF-7 du cancer du sein
[67,71].
Après la célèbre étude de Darbre en 2004, d’autres études ont tenté d’élucider un éventuel lien
entre les parabènes et les cancers. Une récente étude menée en 2012 [86] par la même équipe
mesure les concentrations de cinq parabènes différents dans des tissus de cancer du sein
provenant de 40 mastectomies.
Tous ont été retrouvés, à des concentrations de 16,8 ng pour le n-propyl-, 5,8 ng pour le
nbutyl-3,4 ng pour l’éthyl- et 2,1 ng pour l’isobutyl-parabène. Ils ont analysé chaque tissu à 4
endroits différents, sur un total de 160 échantillons .Les parabènes ont été retrouvés dans 158
échantillons sur 160. Les parabènes étaient le plus concentrés dans la partie axillaire, près de
l’aisselle. Ils concluent que, étant donné que les parabènes sont connus pour être des
68
perturbateurs hormonaux et que les zones les plus concentrés en parabènes correspondent
aussi aux zones où le cancer est le plus fréquent, il y a forcément un lien entre les parabènes et
le cancer du sein. De plus, le fait que la zone axillaire soit la plus touchée pointe fortement
vers un lien avec l’usage des déodorants corporels, quoique 7 des 40 patiente ont affirmé ne
jamais en utiliser.
Harvey et Everett en 2012 [87]. Ont tenté d’expliquer comment des parabènes se sont
retrouvés dans une tumeur mammaire. Selon eux, leur présence ne peut s’expliquer que par
une absorption cutanée, les parabènes étant rapidement métabolisés lorsqu’ils sont absorbés
par voie orale. Ce constat est nécessaire mais non suffisant. En l'état actuel des
connaissances, les données toxicologiques et épidémiologiques ne permettent pas d’affirmer
un lien de causalité entre une utilisation au long cours de produits cosmétiques contenant des
parabènes et un risque avéré de cancer du sein.
2.6- Parabènes et Vieillissement cutané
Une étude menée par Nishizawaet al.en 2006 [88] montre que les parabènes peuvent
engendrer un stress oxydatif sur la peau. Un mélange de méthyl ou ethyl-paraben, du
glutathion et du dioxygène est réalisé. Il y a production de 1,4-benzoquinone .ces travaux
montrent une augmentation de la consommation de l’antioxydant glutathion mais également
la synthèse de peroxyde d'hydrogène, ces deux facteurs pouvant provoquer un stress oxydatif.
Des études faites au Japon montrent les effets du méthylparabène sur les kératinocytes
humains lors d’une exposition aux UVB. : le méthylparabène appliqué sur la peau réagit avec
les UVB donnant ainsi des sous-produits du méthylparabène causant des dégradations de
l’ADN [89] et facilitant l’induction de processus nuisibles pour la peau (mortalité cellulaire,
stress oxydatif.)[90].
Une autre étude a été menée sur des kératinocytes en 2007
methyl-paraben qui a été testé. Selon l'étude, le methyl
l'ARN messager de la HAS (Hyaluronicacidsynthase) 1 et 2 et du collagène de type IV. La
modification de concentration de ces composés naturels de la peau serait responsable d'un
changement de conformation des kératinocytes, entraînant une incapacité pour ces cellules de
proliférer. Or, la peau est en renouvellement constant. L'incapacité pour la
renouveler entraîne inexorablement une irritation cutanée.
3- Réglementation des parabènes
3.1- Réglementation Européenne
Comme précisé dans la première partie, depuis le 11 juillet 2013, les produits cosmétiques
commercialisés sur le marché de l’U
N°1223/2009 du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009, relatif aux produits
cosmétiques. Ce règlement établit des règles auxquelles doit satisfaire tout produit cosmétique
mis à disposition sur le marché.
L’ethyl-parabène et le méthyl-
Cosmétique (liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques).Cette annexe
autorise une concentration maximale de 0.4% en acide pour un ester et
mélange d’esters.
Initialement soumises aux mêmes limites, les concentrations admises de butyl
propylparabènes, également présents à l’Annexe V, ont été ramenées à 0.14% pour la somme
des concentrations individuelles depuis le 16 avri
(UE)N°1004/2014 modifiant l’Annexe V du règlement N°1223/2009. Par ailleurs, en réaction
69
a été menée sur des kératinocytes en 2007 [91] où une fois encore, c'est le
paraben qui a été testé. Selon l'étude, le methyl-paraben diminue l'expression de
l'ARN messager de la HAS (Hyaluronicacidsynthase) 1 et 2 et du collagène de type IV. La
ification de concentration de ces composés naturels de la peau serait responsable d'un
changement de conformation des kératinocytes, entraînant une incapacité pour ces cellules de
proliférer. Or, la peau est en renouvellement constant. L'incapacité pour la
renouveler entraîne inexorablement une irritation cutanée.
Réglementation des parabènes
Réglementation Européenne
Comme précisé dans la première partie, depuis le 11 juillet 2013, les produits cosmétiques
commercialisés sur le marché de l’Union Européenne doivent répondre au
N°1223/2009 du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009, relatif aux produits
cosmétiques. Ce règlement établit des règles auxquelles doit satisfaire tout produit cosmétique
mis à disposition sur le marché.
-parabène sont inscrits dans l’annexe V (entrée 12) duRèglement
Cosmétique (liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques).Cette annexe
autorise une concentration maximale de 0.4% en acide pour un ester et de 0.8% pour un
Initialement soumises aux mêmes limites, les concentrations admises de butyl
présents à l’Annexe V, ont été ramenées à 0.14% pour la somme
des concentrations individuelles depuis le 16 avril 2015, en application du
modifiant l’Annexe V du règlement N°1223/2009. Par ailleurs, en réaction
où une fois encore, c'est le
paraben diminue l'expression de
l'ARN messager de la HAS (Hyaluronicacidsynthase) 1 et 2 et du collagène de type IV. La
ification de concentration de ces composés naturels de la peau serait responsable d'un
changement de conformation des kératinocytes, entraînant une incapacité pour ces cellules de
proliférer. Or, la peau est en renouvellement constant. L'incapacité pour la peau de se
Comme précisé dans la première partie, depuis le 11 juillet 2013, les produits cosmétiques
nion Européenne doivent répondre au Règlement
N°1223/2009 du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009, relatif aux produits
cosmétiques. Ce règlement établit des règles auxquelles doit satisfaire tout produit cosmétique
parabène sont inscrits dans l’annexe V (entrée 12) duRèglement
Cosmétique (liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques).Cette annexe
de 0.8% pour un
Initialement soumises aux mêmes limites, les concentrations admises de butyl- et
présents à l’Annexe V, ont été ramenées à 0.14% pour la somme
l 2015, en application du Règlement
modifiant l’Annexe V du règlement N°1223/2009. Par ailleurs, en réaction
70
à la décision unilatérale du Danemark en 2011, l'utilisation de ces deux agents conservateurs
est interdite dans les produits sans rinçage destinés à être appliqués sur la zone du siège des
enfants de moins de trois ans, étant donné que le risque de pénétration percutanée est plus
élevé en présence d'une irritation et occlusion de la peau qu'avec une peau intacte. Les
nouvelles règles sont appliquées aux produits mis en rayon après le 16 avril 2015. Ces
modifications ont fait suite aux recommandations récentes du Comité Scientifique pour la
Sécurité des Consommateurs [92].
Les isopropylparabène, isobutylparabène, phénylparabène, pentylparabène et le
benzylparabèneont été inscrits dans l'annexe II (liste des substances interdites dans les
produits cosmétiques) du Règlement cosmétique, et donc interdits dans les cosmétiques parle
Règlement (UE) N° 358/2014 de la Commission du 9 avril 2014.
Loi antiparabènes : Loi Lachaud
Le 13 Juillet 2010, une proposition de loi française émanait d’Yvan Lachaud. Un texte des
plus simples comprend un article unique :"La fabrication, l’importation, la vente ou l’offre
de produits contenant des phtalates, des parabènes ou des alkylphénols sont interdites."
Cette proposition a été renvoyée à la Commission des Affaires Sociales et examinée lors de la
séance du 05 avril qui arejeté l'ensemble de la proposition de loi, interdiction ou même
suspension de ces substances.
Le 03 Mai 2011, l’Assemblée Nationale votait par 236 voix contre 222 voix l'interdiction de
ces conservateurs, ainsi que des phtalates et des alkylphénols, tous suspectés d'agir en
perturbateurs endocriniens et d'avoir de graves répercussions sur la santé humaine,
notamment en termes de malformations des fœtus et de baisse de la fertilité. Mais pour être
validé, le texte de loi voté le 3 Mai 2011 par l'Assemblée Nationale doit l’être également par
le Sénat, il n'était qu'en première lecture. À ce jour, la proposition de loi Lachaud ne figure
pas à l’ordre du jour du Sénat.
71
3.2- Réglementation aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, la Révision des Ingrédients Cosmétiques (CIR) a recommandé les mêmes
concentrations maximales de parabènes que celles suggérées par le SCCP et légiférées par
l’UE. Cependant, les recommandations de la CIR ne sont que des directives que les fabricants
ne sont pas obligés de suivre.
3.3. Réglementation au Canada
Au Canada,il n'existe aucune restriction sur l'utilisation des parabènes dans les cosmétiques.
Selon l’organisme Santé Canada, la mesure prise par l’Union Européenne est essentiellement
fondée sur l’existence de lacunes relatives aux données scientifiques et non sur la présence de
données indiquant qu’il existe un risque; cette façon de faire n’est pas conforme à l’approche
canadienne en matière de réglementation des produits cosmétiques. Le Ministère de la Santé
continue de surveiller les données scientifiques sur les parabènes, mais constate que les
données actuelles semblent indiquer que ces substances ne sont que faiblement œstrogéniques
à forte concentration et qu’elles sont faiblement absorbées par voie cutanée. Cependant les
produits fabriqués au Canada ne sont pas réservés exclusivement au marché canadien, mais
sont aussi destinés à l’exportation, notamment aux États-Unis et en Europe. La réglementation
sur les cosmétiques est plus souple aux États-Unis qu’au Canada, mais elle est plus rigide en
Europe. Les fabricants canadiens suivent donc la réglementation européenne afin de pouvoir
exporter leurs produits.
73
Depuis la polémique sur les conservateurs issus de la pétrochimie et en particulier des
parabènes, on voit apparaitre de plus en plus fréquemment sur le packaging des produits
cosmétiques, la mention « sans parabènes ». Cette tendance ne concerne pas que les
cosmétiques biologiques ou naturels ; cette notation fleurit également sur les étiquettes des
cosmétiques conventionnels. Cette mention, très « vendeuse », est devenue un argument
marketingutilisé par de nombreuses marques, pas toujours très rigoureusement.
1- La mention « Sans Parabènes » : ça veut dire quoi ?
• SANS PARABEN = SANS CONSERVATEUR
L’on rencontre certains produits cosmétiques estampillés "Sans Parabènes" alors que leur
formule ne nécessite nécessairement de conservateur pour assurer leur sécurité bactérienne et
microbiologique., L’approche, certes, n'est pas mensongère, mais relève du pur marketing, et
n’est certainement pas une information réellement pertinente pour le consommateur.
• SANS PARABEN = AVEC D'AUTRES CONSERVATEURS
Le consommateur associe souvent cette mention à un produit sain et la comprend comme
désignant un produit exempt de substance synthétique conservatrice. C'est parfois vrai, mais il
arrive aussi que cette interprétation soit tout à fait erronée. Il faut alors comprendre le "Sans
Parabènes" dans son acception la plus stricte. Sans parabènes veut dire sans les
composés conservateurs de la classe des parabènes, sans plus. On peut ainsi trouver dans le
produit d'autres composés conservateurs, souvent d'origine synthétique, et aux effets
potentiels irritants, allergisants ou toxiques plus problématiques encore que ceux associés à
l'utilisation des parabènes.
• SANS PARABEN = SANS PARABEN AJOUTÉ
Dans ce cas, aucun parabène n'a en effet été ajouté à la formule pour assurer sa conservation.
Ce qui n'empêche pas qu'on puisse en trouver tout de même dans le produit. Il y est le plus
souvent par le biais d'un ou de plusieurs ingrédients conservés, eux, à l'aide de parabènes qui
74
se retrouvent dans le produit fini, en faible quantité, certes, mais présents tout de même. Dans
ce cas, l'allégation est, de fait, mensongère.
2- Alternatives proposées
2.1- D’autres alternatives chimiques
Une importante campagne de reformulation résulte de ce contexte médiatique non favorable
aux parabènes dont l’utilisation connaît une nette diminution entre 2010 et 2013 ; le
phénoxyéthanol et le méthylisothiazolinone sont les principaux substituts aux parabènes
utilisés en cosmétique (Fig.11).
Cette reformulation massive des produits est également démontrée par un passage de 3 à 8%
de la proportion de challenge tests non-conformes entre 2010 et 2012, expliqué par le spectre
d’activité antimicrobien des nouveaux systèmes conservateurs inférieurs à celui des parabènes
(Fig.12) et une multiplication par deux de la proportion de formules présentant un potentiel
irritant entre les périodes 2008-2011 et 2012-2013 (Fig.13).
75
Fig.11: Evolution de la nature du conservateur et de la concentration utilisée dans les produits cosmétiques analysés par la société COSMEPAR entre 2010 et 2013 [W23].
Fig.12: Evolution de la non-conformité des challenges tests pour les produits cosmétiques testés par la société COSMEPAR entre 2010 et 2013 (non conforme ou critère B) [W23].
Fig.13: Evolution du potentiel i
2.1.1- Methylisothiazolinone (MIT)
Conservateur du groupe des isothiazolinones
rincés et non-rincés, son usage est réglementé au niveau européen (Annexe V du Règlement
1223/2009/EC du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux
Produits Cosmétiques) ; sa concentration doit être inférieure ou égale à 0,01% (1
14: Structure chimique du Methylisothiazolinone (MIT)
76
Evolution du potentiel irritant des formules cosmétiques entre 2008 et 2013
Methylisothiazolinone (MIT)
isothiazolinones, utilisé dans de nombreux produits cosméti
rincés, son usage est réglementé au niveau européen (Annexe V du Règlement
1223/2009/EC du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux
; sa concentration doit être inférieure ou égale à 0,01% (1
Fig.
Structure chimique du Methylisothiazolinone (MIT) [W24]
rritant des formules cosmétiques entre 2008 et 2013 [W23].
produits cosmétiques
rincés, son usage est réglementé au niveau européen (Annexe V du Règlement
1223/2009/EC du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux
; sa concentration doit être inférieure ou égale à 0,01% (100 ppm).
[W24].
77
Selon la Société Française de Dermatologie (SFD) [W25], le MIT entrainerait un nombre
croissant d’irritations et d’eczémas, notamment sur les mains, visage et siège avec l’utilisation
de plus en plus répandue des lingettes
Le CSSC a rendu son avis en décembre 2013[W26] qui confirme l’augmentation importante
depuis 2010-2011 du nombre de cas de sensibilisationà la MIT dans divers pays d’Europe
dont la France, avec une moyenne de 2 à 4% de personnes souffrant d’eczéma de contact et
réagissant positivement au MIT lors de tests épicutanés soit sensibilisées à cette substance.
Des réactions d’allergie ont par ailleurs été observées chez des personnes sensibilisées
exposées à des concentrations très faibles de MIT, < 15 ppm. Le CSSC recommande donc de
ne plus utiliser le MIT dans les produits cosmétiques non rincés et de limiter la concentration
dans les produits rincés à des niveaux garantissant l’absence de réactions
d’élicitation(0,0015% soit 15 ppm). De plus, le CSSC attire l’attention sur les risques liés à
une exposition via d’autres types de produits comme les produits ménagers, notamment chez
des personnes déjà sensibilisées.
L’association très fréquente du Methylisothiazolinone / Methychlorolisothiazolinone est dotée
d'un potentiel allergisant encore plus fort. La réglementation européenne en a tenu compte en
limitant dans ce cas la concentration maximale d'un mélange Methylchlorolisothiazolinone et
Methylisothiazolinone dans un rapport 3:1 dans les produits finis à 0,0015 %.
2.1.2- Phénoxyéthanol
Le phénoxyéthanol est un dérivé de l’éthylène glycol appartenant à la famille des éthers de
glycol possédant un noyau benzénique et une fonction alcool(Fig.15). Il se présente sous la
forme d’un liquide huileux et non volatil, son utilisation répandueest due à sa stabilité et sa
bonne compatibilité avec la majorité des matières premièrescosmétiques.
78
Fig. 15: Structure chimique du phénoxyéthanol [W27].
Le phénoxyéthanol est utilisé en tant que conservateur dans les produits cosmétiques. Il est à
ce titre soumis à la réglementation européenne relative aux produits cosmétiques (Directive
76/768/CEE modifiée4, Annexe VI, Entrée 29) qui limite sa concentration maximale
d’utilisation à 1% dans les produits cosmétiques. Il reste l’un des conservateurs les plus
utilisés dans l’industrie cosmétique, seul ou en association avec d’autres conservateurs
(Afssaps, 2009).
Selon un rapport de l’ANSM établi en Mai 2012 [W28], le phénoxyéthanol est absorbé par
voie orale et cutanée. Il est métabolisé, principalement par le foie, en acide phénoxyacétique
et est éliminé essentiellement dans les urines. Il présente une faible toxicité aiguë pour
l’animal, il n’est ni irritant pour la peau nisensibilisant et provoque une irritation oculaire
modérée à sévère. Une exposition répétée induit une nocivité variable selon les espèces,
hématotoxicité chez le lapin et hépatotoxicité chez le rat.
L’ANSM a émis des recommandations pour les produits destinés aux enfants de moins de 3
ans, l’évaluation des risques à destination des produits utilisés dans les érythèmes fessiers a
abouti à une sécurité insuffisante ne pouvant pas garantir une sécurité d’utilisation optimale.
De ce fait, il a été établi par l’Agence que les produits destinés à la toilette du siège des bébés
doivent être exempts de ce composé. Pour l’ensemble des autres soins bébé, la teneur
maximale de phénoxyéthanol doit être réduite à 0,4% en raison d’effets hépatotoxiques
relatés. Ces valeurs prennent en compte la possibilité d’exposition cumulée.
79
2.2- Alternatives techniques
La commercialisation de produits cosmétiques stables contenant la quantité minimale de
conservateur nécessaire ou n’en possédant pas du tout représente donc aujourd’hui un réel
besoin aussi bien qu’un véritable challenge technologique. Dans ce contexte, le
conditionnement primaire joue un rôle majeur et doit être force de propositions. Les
industriels rivalisent d’innovations afin de créer des conditionnements primaires innovants,
permettant de limiter, voire même de supprimer, la quantité en agents antimicrobiens
introduits.
2.2.1- Tube monodose
Il représente le moyen le plus classique évitant une contamination microbienne dans un
cosmétique, le conditionnant en unidoses [92].
Le conditionnement est stérile et peut donc être utilisé pour des formules qui ne contiennent
aucun conservateur. Il garantit l’efficacité des actifs qu’il contient pendant trois jours
maximum. Au-delà de cette date, la stérilité n’est plus assurée car ce conditionnement
n’empêche pas l’entrée d’air. L’un des inconvénients majeurs est la quantité de matériaux de
conditionnement utilisée qui se trouve être décuplée pour un volume de produit donné par
rapport aux multidoses.
Cette méthode est peu rentable, peu économique et peu écologique mais reste tout de même
relativement utilisée dans des monodoses stériles de démaquillant qui conviennent aux yeux
très sensibles et n’ayant aucune autre alternative en terme de démaquillant.
80
Fig.16: Monodoses stériles de démaquillants yeux Toleriane de LaRoche-Posay® [W29].
2.2.2- Flacon Airless
Le but d’un doseur Airless est d’empêcher toute entrée d’air dans le contenant qui pourrait
oxyder la formule et la dégrader [93]. Cette technologie est ancrée au conditionnement
primaire, soit au récipient même, qui présente aussi l’avantage de n’entraîner aucune perte de
produit par l’intermédiaire d’une poche rétractable.
C’est un conditionnement multidoses mais qui n’est pas stérile. Il n’est donc pas adapté à
desformules ne contenant aucun conservateur ; il existe dans ce flacon airless, au niveau de la
tête doseuse, un espace mort qui n’évite pas une rétro contamination possible. Il est donc
impératif que la formule contenue dans ce type de conditionnement contienne des
conservateurs.
Le système Airless est exploité dans le soin Toleriane Ultra de LaRoche-Posay®, présenté en flacon pompe.
Fig.17: Flacon pompe du soin Toleriane Ultra de
2.2.3- DEFI : Dispositif Exclusif Formule Intacte
Après plus de 10 années de Recherche & Développement, l’innovation D.E.F.I (Dispositif
Exclusif Formule Intacte) a été mise au point
système de fermeture breveté permettant de protéger les formules stériles, à l’abri de tout
germe, dans un tube de grande contenance.
membrane souple qui se soulève lorsqu’on exerce une pression sur le tube pour revenir en
place quand on relâche la pression, de manière à ne jamais exposer le produit à l'air et aux
bactéries. Le bouchon/capot s’ajuste parfaitement sur la capsule, une
l’étanchéité est garantie, ce qui permet d’exclure tout conservateur d’un produit
tout en gardant une formule stérile. Avec ce dernier, aucun volume mort n’est induit ce qui
maintient la stérilité de la formule
Le premier soin Avène® ayant bénéficié de l’innovation D.E.F.I. est la ligne Tolérance
Extrème, conçue pour les peaux hypersensibles et allergiques qui propose une formule
minimaliste en termes d’ingrédients afin de proposer une bonne tolérance.
A-derma® en a aussi fait bénéficier sa ligne Exomega, soit le baume émollient et la crème
Emolliente destinées aux peaux sèches à très sèches atopiques.
81
Flacon pompe du soin Toleriane Ultra de LaRoche-Posay®
DEFI : Dispositif Exclusif Formule Intacte
Après plus de 10 années de Recherche & Développement, l’innovation D.E.F.I (Dispositif
Exclusif Formule Intacte) a été mise au point par le groupe Pierre Fabre, axée sur
e fermeture breveté permettant de protéger les formules stériles, à l’abri de tout
germe, dans un tube de grande contenance. Ce système comporte un
membrane souple qui se soulève lorsqu’on exerce une pression sur le tube pour revenir en
ce quand on relâche la pression, de manière à ne jamais exposer le produit à l'air et aux
bactéries. Le bouchon/capot s’ajuste parfaitement sur la capsule, une
l’étanchéité est garantie, ce qui permet d’exclure tout conservateur d’un produit
tout en gardant une formule stérile. Avec ce dernier, aucun volume mort n’est induit ce qui
formule [W31].
Le premier soin Avène® ayant bénéficié de l’innovation D.E.F.I. est la ligne Tolérance
les peaux hypersensibles et allergiques qui propose une formule
minimaliste en termes d’ingrédients afin de proposer une bonne tolérance.
derma® en a aussi fait bénéficier sa ligne Exomega, soit le baume émollient et la crème
aux sèches à très sèches atopiques.
Posay® [W30].
Après plus de 10 années de Recherche & Développement, l’innovation D.E.F.I (Dispositif
par le groupe Pierre Fabre, axée sur le premier
e fermeture breveté permettant de protéger les formules stériles, à l’abri de tout
embout avec une
membrane souple qui se soulève lorsqu’on exerce une pression sur le tube pour revenir en
ce quand on relâche la pression, de manière à ne jamais exposer le produit à l'air et aux
bactéries. Le bouchon/capot s’ajuste parfaitement sur la capsule, une fermeture dont
l’étanchéité est garantie, ce qui permet d’exclure tout conservateur d’un produit cosmétique,
tout en gardant une formule stérile. Avec ce dernier, aucun volume mort n’est induit ce qui
Le premier soin Avène® ayant bénéficié de l’innovation D.E.F.I. est la ligne Tolérance
les peaux hypersensibles et allergiques qui propose une formule
derma® en a aussi fait bénéficier sa ligne Exomega, soit le baume émollient et la crème
82
Fig.18: D.E.F.I., Laboratoires AVENE® [W32].
2.2.4- Système UHT
Le laboratoire CL Tech s'est intéressé au principe de la stérilisation UHT du lait, qu'il a adapté
ensuite aux formulations cosmétiques. Ce procédé consiste à chauffer la formule à très haute
température (135°C) pendant une durée très courte (3 à 7 secondes) puis refroidissement, ce
qui permet une élimination quasi-complète des microorganismes et la non-altération des
principes actifs [94]. Cette méthode de conservation pour les cosmétiques est brevetée par les
Laboratoires Dermatherm. Les soins qu’ils proposent sont donc stériles grâce à cette méthode,
et sont ensuite conditionnés dans des flacons-pompes airless à protection de l’air et de la
lumière, dont le bouchon est recouvert par un film antimicrobien nettoyant la valve et
bactéricide. Ce film recrée une zone stérile sous le bouchon lorsque celui-ci est repositionné
83
Fig.19: Soin contour des yeux Dermatherm® [W33].
2.3. Adaptation des formulations : Autoprotection 2.3.1- Activité de l’eau
Afin de survivre et de se développer, les micro-organismes doivent maintenir un état de
turgescence à l’intérieur des cellules, phénomène possible par osmose avec le milieu
extracellulaire [95]. Par conséquent, afin d’assurer leur croissance et leur multiplication,
lesmicro-organismes doivent être en présence d’eau en quantité suffisante. De ce fait, une
notion d’activité de l’eau, ou disponibilité de l’eau, a été définie, elle représente les forces de
liaisons entre l’eau et les constituants du produit.
L’activité de l’eau (water activity) correspond à la mesure des molécules d’eau non
complexées. Elle est symbolisée par l’indice aw (allant de 0 à 1) et par la formule suivante
:[96]
Avec :
aw = P/ P0
84
P : pression de vapeur de la solution (Pa).
P0 : pression de vapeur de l’eau pure (Pa) mesurée à température constante.
Par définition, la pression de vapeur est la pression sous laquelle la formule est en équilibre
avec sa vapeur à une température constante.
Ainsi, plus la valeur de aw est élevée et se rapproche de 1, plus la prolifération des
microorganismes est importante en raison de la dilution de l’eau. Chaque espèce de
microorganisme étant spécifique, la valeur minimale de l’aw pour laquelle la multiplication
cellulaire peut avoir lieu varie. Typiquement, les levures etmoisissures peuvent se développer
à des valeurs d’aw plus faibles que les bactéries.
Tab.3: Valeurs d’aw minimales permettant la croissance de microorganismes représentatifs, à 25°C [95].
Microorganismes
Aw minimum
Bactéries Pseudomonas aeruginosa
0,97
Escherichia coli
0 ,95
Staphylococcus aureus
0,86
Levures et moisissures Aspergillus niger
0,77
Candida albicans
0,87
Il est possible d’ajouter des humectants afin de diminuer la valeur de l’activité de l’eau telle
que le chlorure de sodium, l’éthanol, le lactate de sodium, le propylène glycol, le glycérol,
le sorbitol ainsi que le glucose. Les fonctions hydroxyles des humectants permettent la
formation de liaisons hydrogènes avec les molécules d’eau, induisant une réduction de
l’aw.Les sels inorganiques ainsi que les hydrocolloïdes (gomme de xanthane, gomme de guar
85
ou autres), utilisés pour augmenter la viscosité des formulations, abaissent également la valeur
de l’aw en formant un réseau tridimensionnel qui limite la mobilité des molécules d’eau dans
le milieu [95,96].
2.3.2- pH
Tout microorganisme possède un pH de croissance optimum (Tab.4). Les pH decroissance se
situent généralement entre 5 et 8. D’une manière générale, les bactéries se développent mieux
dans des milieux proches de la neutralité alors que les levures et moisissures sont
généralement acido-résistantes avec un pH de croissance optimum se situant entre 4 et 6 mais
avec des valeurs extrêmes de 2 à 9 pour les levureset de 2 à 11 pour les moisissures [95].
Tab.4: Domaines de pH de croissance des microorganismes [95].
Microorganismes pH de croissance
Bactéries 4,0 - 9,0
Levures 1,5 - 8,0
Moisissures 5,0 - 11
Le fonctionnement cellulaire microbien dépend du maintien du pH intracellulaireapproprié
(pHi). Ainsi, plus le pH du milieu dans lequel se trouvent les cellules s’éloigne du pHi, plus
les microorganismes se trouvent dans des conditions de stress défavorables à tout
développement. Il faut cependant noter que les bactéries sont capables de maintenir un pHi
plutôt constant, même si le pH extracellulaire fluctue. En effet, les membranes cellulaires ont
une perméabilité sélective, permettant ainsi le passage d’ionset de composés spécifiques entre
l’intérieur et l’extérieur de la cellule, ce qui assure un maintien du pH intracellulaire qui peut
être très différent du pH externe (jusqu‘à 2unités de pH). Cependant, cette régulation est
limitée dans le temps [95].
86
Le formulateur possède un large choix d’acides pour équilibrer le pH de ses formules. Il faut
noter que les acides forts comme l’acide chlorhydrique ne jouent un rôle que sur le pH externe
des cellules microbiennes alors que les acides faibles, plus lipophiles, sont capables de
traverser la membrane cellulaire et d’agir sur le pH cytoplasmique.
Cependant, la majorité des produits cosmétiques ont un pH qui se situe entre 5 et 8. Endehors
de certaines exceptions, il est donc difficile d’utiliser ce paramètre pour limiter lacroissance
microbienne au sein du produit fini.
2.4- Alternatives naturelles
2.4.1- Huiles essentielles
Les huiles essentielles sont utilisées depuis des centaines d’années pour leurs propriétés
odorantes. Ces dernières années, leurs propriétés antimicrobiennes et antifongiques ont été le
centre d’intérêt d’un grand nombre d’études [97].
Rosmarinus officinalis, Lavandula officinalis, ,Artemisia afra, Thymus vulgaris, Eucalyptus
globulus, Laurus nobilis, Salvia officinalis etMelaleuca alternifolia sont les principales
plantes utilisées aujourd’hui par les industriels de la cosmétique pour extraire des huiles
essentielles substituant les conservateurs de synthèse [98].
2.4.1.1- Définition des huiles essentielles
La Pharmacopée européenne décrit l’huile essentielle comme étant « un produit odorant,
généralement de composition complexe, obtenu à partir d’une matière première végétale
botaniquement définie, soit par entrainement à la vapeur d’eau, soit par distillation sèche,
soit par un procédé mécanique sans chauffage » [99].
Selon l’AFNOR, elle désigne un produit obtenu à partir d’une matière première d’origine
végétale, après séparation de la phase aqueuse par des procédés physiques soit par
entraînement à la vapeur d’eau, soit par des procédés mécaniques à partir de l’épicarpe des
plantes contenant des citrals, soit par distillation sèche. L’huile essentielle est ensuite séparée
87
de la phase aqueuse par des procédés physiques n’entrainant pas de changement significatif de
sa composition [100].
La composition des huiles essentielles est très complexe, elles peuvent renfermer jusqu’à
plusieurs centaines de molécules chimiques différentes. Les plus fréquemment rencontrés sont
les alcools (phénols et sesquiterpénols), les cétones, les aldéhydes terpéniques, les esters, les
éthers, les terpènes et les oxydes.
2.4.1.2- Labels et certifications
Une huile essentielle doit être certifiée par sa composition et son origine. En effet, une même
plante peut fournir plusieurs huiles essentielles en fonction de l’organe utilisé. Ainsi par
exemple, l’oranger amer (Citrus aurantium) est à l’origine de l’essence d’orange amère à
partir du fruit, de l’essence de Néroli avec la fleur et de l’essence de petit grain bigaradier lors
de l’hydrodistillation de la feuille, des ramilles et des petits fruits [101].
Certains labels permettent de certifier l’origine botanique et géographique d’une plante, c’est
le cas des huiles désignées par :
- Le label H.E.B.B.D ou Huile Essentielle Botaniquement et Biochimiquement Définie,
crée par D.Baudoux pour Pranarom® (1991), signifie que l’huile essentielle possède un
bulletin d’analyse établi avec le C.N.R.S. C’est un label de qualité des huiles essentielles.
-HECT ou Huile Essentielle Chémotypée, crée par P.Malhebiau (1984) pour certains
laboratoires et marques comme Phyosunaroms®, gage de qualité des huiles essentielles sur le
plan botanique et biochimique.
Certaines peuvent être issues de l’agriculture biologique, elles portent alors les
labels suivant :
-Le label BIO garantie une huile essentielle d'origine biologique.
-Une huile essentielle possédant un label ECOCERT est une huile essentielle soumise au
contrôle régulier d’un organisme de certification agréé par les pouvoirs publics.
88
-Le label A.B. correspondant à Agriculture Biologique, certifie que l’huile essentielle
possède au minimum quatre-vingt quinze pour cent d’ingrédients issus de l’Agriculture
Biologique, c'est-à-dire cultivée sans engrais, ni pesticides, et ne contenant pas
d’O.G.M.
Fig.20: Différents logos en place sur les flacons d’huiles essentielles certifiant leur
qualité [W34][B35].
2.4.1.3- Mode d’action antibactérien des huiles essentielles
Les mécanismes par lesquels les huiles essentielles exercent leur activité antimicrobienne
sont mal connus, du fait de la complexité de la composition chimique ; il est difficile de
donner une idée précise sur le mode d’action des huiles essentielles. Il est probable que leur
activité antibactérienne ne découle pas d’un mécanisme unique, mais de plusieurs sites
d’action au niveau cellulaire.
K Hulin et al. (1998) [102] rapportent que les huiles essentielles semblent posséder plusieurs
modes d’action sur les différents microorganismes :
� Interférence avec la bicouche lipidique de la membrane cellulaire, provoquant une
augmentation de la perméabilité et la perte des constituants cellulaires.
� Altération des différents systèmes enzymatiques dont ceux impliqués dans la
production de l’énergie cellulaire et la synthèse des composants de structure.
� Destruction ou inactivation du matériel génétique.
Les huiles essentielles ont un spectre d’action très large dû principalement à leur grande
affinité aux lipides membranaires grâce à leur nature hydrophobe [103]. Elles vont donc
pouvoir inhiber la croissance des bactéries, des levures, ainsi que des moisissures.
L’activité antimicrobienne des huiles essentielles est hautement dépendante de leur
composition chimique, notamment de leurs constituants majeurs ; les composés chimiques
89
àplus grande efficacité et à large spectre sont les phénols (thymol,carvacrol, eugenol), les
alcools (αterpinéol, terpinen -4- ol,linalol ), les aldéhydes, les cétones et rarement les terpènes
[104].
2.4.1.4- Contraintes d’utilisation
L’utilisation des huiles essentielles pour leurs propriétés conservatrices pose cependant un
certain nombre de problèmes tels qu’une odeur marquée, parfois problématique pour une
utilisation cosmétique (incompatibilité entre l’odeur de l’huile essentielle et leproduit
cosmétique à protéger), ou la présence d’allergènes, sources de réactions cutanées, voire
d’allergies de contact. Ainsi, le linalol présent dans l’huile essentielle de lavande et le
cinnamaldéhyde de la cannelle sont des allergènes naturels. Notons également que dans
certains cas, l’emploi des huiles essentielles est limité, notamment chez les personnes dont la
peau est sensible, chez les femmes enceintes et les enfants [105].
2.4.2- Alcool
L’alcool peut constituer une alternative aux conservateurs chimiques quand il est à faible
concentration. À forte concentration, il est cependant asséchant et irritant pour les peaux
sensibles tandis que, correctement dosé, il possède des effets antimicrobiens appréciables dans
les produits cosmétiques.
L’avantage est que l’alcool est une substance naturelle qui peut parfois avoir une origine
Biologique, elle pourra participer à la labellisation « bio » d’un produit.
L’alcool le plus fréquemment utilisé dans les produits cosmétiques pour ses qualités
conservatrices est l’éthanol obtenu par :
- Fermentation du sucre extrait des végétaux (betterave, canne à sucre…)
- Hydrolyse de l’amidon contenu dans les céréales (blé, maïs…).
90
2.4.3- Extraits naturels
Les extraits naturels présentent une grande complexité chimique, leur composition chimique
n’est souvent pas bien connue. Un certain nombre d’extraits végétaux ont été étudiés pour
leurs propriétés antimicrobiennes et sont aujourd’hui présents sur le marché de la cosmétique,
tels que l’extrait de pépins de pamplemousse ou l’extrait de lichen (voir Annexe I) [95].
2.4.3.1- Modes d’obtention
Les extraits naturels peuvent être obtenus au moyen de solvants (eau et solvants organiques).
Le végétal, généralement haché ou broyé, est mélangé avec un solvant qui a la capacité de
solubiliser les métabolites d’intérêts. Une fois les débris végétaux éliminés, le solvant est
éliminé, généralement par évaporation sous pression réduite, pour conduire à l’extrait qui se
présente sous la forme d’une pâte plus ou moins visqueuse ou d’un solide.
Plusieurs solvants peuvent être utilisés. Ils sont le plus souvent organiques (hexane,éther de
pétrole, acétate d’éthyle, éthanol, acétone...). L’éthanol et l’acétone peuvent être utilisés en
mélange avec l’eau. L’on assiste ces dernières années au développement des techniques
d’extraction à l’aide de fluides supercritiques, et plus particulièrement au dioxyde de carbone,
dans des conditions de température et de pression bien précises, ces fluides à l’état
supercritique possèdent des propriétés particulièrement intéressantes pour l’extraction.
L’extraction assistée par micro-ondes prend également beaucoup d’ampleur ces dernières
années. Ces deux derniers exemples s’inscrivent dans le développement de la chimie verte,
notamment l’utilisation de solvants verts (éco-solvants). Pour être ainsi définis, les solvants
doivent présenter une faible toxicité, être facile à recycler, faciles à éliminer du produit final
et présenter une faible réactivité.
2.4.3.2- Contraintes d’utilisation
• Solubilité
De très nombreux travaux portent sur les propriétés biologiques d’extraits végétaux ; les
paramètres tels que le mode d’extraction, la provenance de la matière végétale ou encore la
partie de la plante étudiée sont comparés afin de définir les conditions conférant la meilleure
91
activité biologique mais, bien souvent, un extrait ainsi développé ne tient pas compte de
l’utilisation ultérieure du produit d’extraction.. En fonction de l’utilisation prévue, il est
souvent nécessaire de disperser ou solubiliser l’extrait dans des matrices adaptées pour une
utilisation optimale. Certains extraits peuvent alors s’avérer difficiles à solubiliser dans les
solvants usuels [106].
• Couleur des extraits
Les extraits contiennent de nombreuses molécules colorées, solubles dans les alcools ou
mélanges eau-alcool .Parmi celles-ci, figurent les flavonoïdes (jaunes à orangé),les
anthocyanes (bleus, violet, rouge), les tannins (marron à brun) et la chlorophylle (vert)[107].
L’incorporation d’un extrait végétal contenant de telles molécules dans un produit cosmétique
génère une coloration souvent peu esthétique et limitant le domaine d’application.
2.5- Alternatives chimiques retrouvées à l’état naturel:Les conservateurs « nature-identiques »
Les principales marques de cosmétiques estampillées « Bio » utilisent les conservateurs
autorisés par les labels. En effet de nos jours, il est encore difficile de trouver des
conservateurs naturels pouvant remplacer totalement les conservateurs synthétiques. On
retrouve :
� L’acide benzoïque et ses sels
� L’acide salicylique et ses sels
� L’acide sorbique et ses sels
� L’acide déhydroacétique et ses sels
� L’alcool benzylique et ses sels,
� L’acide formique et son sel de sodium,
� L’acide propionique et ses sels,
92
Tab.5: Différents conservateurs utilisés dans les cosmétiques bios, avec pour information, les labels bio les autorisant [W36].
BDIH Ecocert/Cosmebios Nature &
Progrès
Soil association
NaTrue Cosmos
Acide benzoïque
� � � � � �
Acide sorbique
� � � � � �
Acide salicylique
� � � �
Alcool benzylique
� � � � �
Acide Déhydroacétique
� � � �
Acide propionique
� � � �
Acide formique
� �
Tab.6: Données sur l’origine, la nature et le potentiel antimicrobien des agents de conservation autorisés par le référentiel
Cosmo-Standard.
Agents conservateurs Origines naturelles
Acide benzoïque et
ses sels
[108][109]
le benjoin du Laos, Styrax tonkinensis
Le benjoin du Laos est la résine
obtenue par incision du tronc de
tonkinensis
Dans certains légumes tels que les
carottes et fruits rouges tels que les
framboises ou les canneberges.
Acide salicylique et ses sels
[110][W37][111]
la reine des
prés (Filipendulaulmaria
Le saule blan(Salix alba
Acide sorbique et ses sels
[38]
Graines de Sorbier de l’oiseleur
(Sorbus aucuparia)
les feuilles du frêne (Fraxinus
excelsior)
Acide
déhydroacétique et
ses sels [36]
Fleurs de Solandre ou Liane trompette
(Solandra grandiflora
93
Données sur l’origine, la nature et le potentiel antimicrobien des agents de conservation autorisés par le référentiel
Origines naturelles Structure chimique Activité antimicrobienne
Styrax tonkinensis
Le benjoin du Laos est la résine
obtenue par incision du tronc de S.
Dans certains légumes tels que les
carottes et fruits rouges tels que les
framboises ou les canneberges.
Surtout efficace contre les
Levures
FilipendulaulmariaL.)
Salix alba L.,)
Meilleure activité contre
certaines Gram(
Bonne activité antifongique
Graines de Sorbier de l’oiseleur
Fraxinus
Essentiellement antifongique,
actif également contre les
certaines bactéries
Gram (-)
de Solandre ou Liane trompette
grandiflora
Surtout efficace contre les
moisissures
Inefficace contre
Données sur l’origine, la nature et le potentiel antimicrobien des agents de conservation autorisés par le référentiel
Activité antimicrobienne
rtout efficace contre les
Meilleure activité contre Gram(+) et
certaines Gram(-).
Bonne activité antifongique
Essentiellement antifongique,
actif également contre les levures et
certaines bactéries
Surtout efficace contre les levures et
Inefficace contre Pseudomonas
Alcoolbenzylique[112][113][114]
Les fleurs blanches de jasmin (genre
Jasminum famille des Oléacées)
huile essentielle d’Ylang Ylang
( Cananga odorata Lam.)
Acide propionique et son sel
[W39]
L’accumulation d’acide propionique
est réalisée par certaines bactéries,
genre
Propioni bacterium, en utilisant des
substrats variés, comme les sucres, le
glycérol, l’acide lactique, l’acide
malique.
Acide formique
[115][116][117]
poils tecteurs de la grande ortie (
dioicaL.)
Sapin (aiguilles de sapin)
94
Les fleurs blanches de jasmin (genre
famille des Oléacées)
e d’Ylang Ylang
Lam.)
Surtout actif contre Gram (+)
Activité plus limitée contre
et les levures
Faible activité contre lesMoisissures
L’accumulation d’acide propionique
taines bactéries, du
, en utilisant des
substrats variés, comme les sucres, le
glycérol, l’acide lactique, l’acide
L’acide propionique et ses sels sont
surtout efficaces contre les
moisissures.
poils tecteurs de la grande ortie (Urtica
Sapin (aiguilles de sapin)
L’acide formique, listé comme
conservateur
Surtout actif contre Gram (+)
Activité plus limitée contre Gram (-)
Faible activité contre lesMoisissures
L’acide propionique et ses sels sont
surtout efficaces contre les
L’acide formique, listé comme
96
1- Introduction
Pendant de nombreuses années, les cosmétiques dits « naturels » ont peu intéressé le grand
public et concernaient seulement certains fervents des produits biologiques. Les polémiques
récentes ont alerté le grand public sur le possible danger des substances chimiques dans les
cosmétiques.
C'est dans ce contexte que le marché du cosmétique naturel a eu un essor spectaculaire. En
effet, le retour à des matières premières simples et non toxiques ainsi que les progrès de la
formulation des produits « naturels », ont permis à ce marché de se développer. Toutes les
marques, de la parfumerie, en passant par la grande distribution jusqu'à la parapharmacie, se
mettent au vert.
Le marché mondial des cosmétiques naturels et biologiques est en pleine expansion.
Cependant,qui dit cosmétique « naturel » ne dit pas forcément cosmétique « biologique ».
Qu'est-ce qui se cache derrière ces appellations?.
1.1- Définition d’un produit cosmétique biologique :
Il n’existe pas de définition officielle des produits cosmétiques biologiques, ce qui est
communément appelé « Cosmétiques Bio » désigne une famille de produits composés
d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle, en proportion plus ou moins importante selon les
marques [118].
L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité a publié, en 2009, une
recommandation sur les produits cosmétiques préconisant que l'emploi du terme « Bio »
implique le respect d'au moins une des conditions suivantes [W40].
� Présence de 100 % d'ingrédients certifiés issus de l'agriculture biologique;
� Certification biologique accréditée;
� Respect d'un référentiel publié d'exigence équivalente à celle des certificateurs.
Dans le même sens, le Guide Pratique du Ministère de l'Écologie(France), édité en 2010,
préconise principalement que seul le composant agricole du produit soit qualifié de « Bio »,
que le produit soit composé d'une part significative d'ingrédients d'origine agricole certifiés
97
biologiques et qu'il ne contienne pas, ou très peu, de substances chimiques de synthèse
[W41].
1.2- Différences entre Cosmétique biologique et Cosmétique naturelle
La définition d'un cosmétique naturel émane du Comité d'Experts sur les produits
cosmétiques du Conseil de l'Europe en 2000. On entend donc par « cosmétique naturel » tout
produit qui se compose de substances naturelles c'est à dire toute substance étant d'origine
végétale, animale ou minérale ou les mélanges de ces substances. Ce produit doit être obtenu
dans des conditions bien définies (méthodes physiques, microbiologiques ou enzymatiques).
Un produit ne pourra donc pas être défini comme naturel s'il contient des substances d'origine
synthétique (à l'exception des conservateurs, parfum et gaz propulseur [119].
La différence entre un cosmétique « naturel » et un cosmétique « bio » n’est donc pas facile à
établir. Selon R. Stiens, auteur des ouvrages « La vérité sur les cosmétiques» et « La vérité
sur les cosmétiques naturels » la cosmétique naturelle est la base de la cosmétique bio. Elle y
explique que la proportion bio d'un produit ne concerne qu'une partie minoritaire du produit
global.Un produit cosmétique naturel n'est donc pas forcément bio, alors qu'un produit
cosmétique bio est naturel puisqu'il est fabriqué à partir de substances naturelles, la
cosmétique naturelle est donc la base de la cosmétique bio[W42].
1.3- Différences entre Cosmétique conventionnelle et Cosmétique biologique
La cosmétique conventionnelle utilisant des composés issus de la chimie de synthèse diffère
de la cosmétique bio par:
� La qualité des ingrédients choisis(voir Annexe II)
� La quantité d’ingrédients naturels ou bio :l’on peut retrouver dans la composition d’un
cosmétique conventionnel des ingrédients naturels ou même bio, définis comme des
produits cosmétiques utilisant les propriétés de certaines plantes médicinales. Mais
dans la plus part des cas, ces ingrédients sont retrouvés en très faible quantité tandis
qu’un produit cosmétique bio va contenir le maximum d’ingrédients naturels (de 95 à
98
100%) dans lesquels l’on retrouvera une quantité d’ingrédients issus de l’agriculture
biologique.
� L’exclusion de certains ingrédients : de nombreux ingrédients sont exclus de la
composition d’un cosmétique bio/naturel, soit les OGMS, les conservateurs de
synthèse, les parfums synthétiques, les colorants ou pigments de synthèse, les huiles
de synthèse ainsi que tous les ingrédients obtenus par des procédés non respectueux de
l’environnement
� Le processus de fabrication : la chimie de synthèse est interdite dans le processus de
fabrication d’un cosmétique bio. Ces produits suivent les exigences de la chimie verte.
2- Labels et certification
2.1-Certification des cosmétiques biologiques
En France, pour pouvoir être qualifié de biologique, un cosmétique doit être certifié par un
organisme de certification, Ecocert ou Qualité France.
2.1.1. Ecocert
Fig.21: Label ECOCERT.
Agréé par le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation et également par le
Ministère de l’Économie et des Finances, Ecocert a été fondé en 1991. Il est accrédité par le
COFRAC ou Comité Français d’Accréditation [120].
L'organisme ECOCERT est une référence mondiale dans le milieu de la certification des
cosmétiques biologiques ; en France, il certifie plus de 70% de la production et détient
également des labels comme AB et COSMEBIO, exigeant que :
– Les cosmétiques certifiés ECOCERT contiennent au minimum 95%d'ingrédients d'origine
naturelle dont au moins 10% issus de l'agriculture biologique.
– Les 5% restants doivent faire partie d'une liste bien limitée, seuls 6
autorisés: benzoate de sodium, alcool benzylique, acide
sels, acide salicylique et ses sels, acide sorbique
– L'information des consommateurs est
l'étiquette du pourcentage réel de produits bio contenus dans le
– ECOCERT interdit l'usage des parfums de
dans ses produits.
– Les tests sur les animaux sont prohibés.
Les producteurs sont contrôlés 2 fois par an par l’organisme et
Certificat pour leurs produits que si le processu
ECOCERT :
Fig.22: Résumé des étapes du contrôle et de certification ECOCERT
2.1.2 Qualité France :
99
Les 5% restants doivent faire partie d'une liste bien limitée, seuls 6
enzoate de sodium, alcool benzylique, acide formique, acide propionique et ses
cide salicylique et ses sels, acide sorbique et ses sels.
L'information des consommateurs est primordiale, ECOCERT impose
l'étiquette du pourcentage réel de produits bio contenus dans le produit.
ECOCERT interdit l'usage des parfums de synthèse, de colorants, de silicone et
Les tests sur les animaux sont prohibés.
Les producteurs sont contrôlés 2 fois par an par l’organisme et ne reçoivent une Licence et un
leurs produits que si le processus de fabrication respecte entièrement la charte
Résumé des étapes du contrôle et de certification ECOCERT
Fig.23: Label Qualité France.
Les 5% restants doivent faire partie d'une liste bien limitée, seuls 6conservateurs sont
formique, acide propionique et ses
, ECOCERT impose l'apposition sur
synthèse, de colorants, de silicone et de glycol
ne reçoivent une Licence et un
s de fabrication respecte entièrement la charte
Résumé des étapes du contrôle et de certification ECOCERT [119].
100
Qualité France est un organisme fondé en 2002 par le bureau VERITAS Certification France.
L'Association Qualité France existe depuis 1947 avec vocation la délivrance de certificats en
agriculture biologique. En rejoignant le bureau VERITAS en 2002, elle gagne le statut
d'entreprise.Cet organisme est agréé par les pouvoirs publics français et accrédité par le
COFRAC.
Les garanties apportées par l'organisme sont les mêmes que celles d'ECOCERT [40].
La certification par cette entreprise se fait en quatre phases :
– Contractualisation de la certification : L'entreprise demandeuse de la certification contacte
le chargé d'affaire de Qualité France et envoie une fiche de renseignement complétée. Le
chargé d'affaire envoie au bénéficiaire un contrat de certification.
– Évaluation initiale du bénéficiaire et de ses sous-traitants éventuels : Le bénéficiaire signe le
contrat et l'audit initial est planifié. L'audit initial du bénéficiaire et des sous-traitants est
réalisé puis un rapport des erreurs à corriger est transmis par le chargé d'affaire.
– Certification : Le rapport d'audit et les non-conformités éventuelles passent en
Commission où sont validées les formules et les étiquetages, le bénéficiaire obtient alors la
certification.
– Surveillance : Des audits de vérification sont organisés régulièrement auprès de l'entreprise
et de ses sous-traitants
2.2- Labels en cosmétique biologique
2.2.1- Qu'est ce qu'un label?
Un label est un signe apposé sur l'emballage d'un produit afin d'informer le consommateur
que ce produit respecte un ensemble de critères définis dans un cahier des charges particulier.
L’application des critères du cahier des charges est contrôlée par un organisme indépendant
de certification, lui-même reconnu par l'Etat, un label est donc une garantie pour le
consommateur et un engagement de la part d'un producteur qui doit accepter les contrôles
imposés mais qui, en retour, bénéficie de la notoriété et de la protection du label concerné.
101
Un label Bio représente par exemple un certificat figurant sur l'emballage qui indique que le
produit a été fabriqué et conditionné selon des conditions respectueuses de l'environnement et
de l'homme. Un label Bio ne garantit cependant pas que le produit soit 100% naturel et bio ;
par le jeu des pourcentages, un cosmétique peut être labellisé « bio» alors qu'il ne contient que
10% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique.
2.2.2- Labels en France
2.2.2.1- Nature et progrès
Fig.24: Label Nature & Progrès.
Le14 mars 1964, des agriculteurs, consommateurs, médecins, agronomes et nutritionnistes
créent une association au service du développement de I'agrobiologie et une revue du même
nom : Nature& Progrès. Cette association française labellisait à l'origine uniquement des
produits alimentaires.
En 1998, Nature et Progrès crée le premier cahier des charges définissant la fabrication des
produits cosmétiques biologiques, « Cosmétiques, produits d'hygiène et savonnerie
»,régulièrement réactualisé [W43].Le respect de ce cahier des charges par les laboratoires est
vérifié par un organisme indépendant de certification qui transmet le dossier au comité de
contrôle de l'association, le CCAM ou Comité de Contrôle de l'Attribution de la Mention.
Les idées fondamentales de cette charte sont les suivantes:
–Les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle Nature & Progrès sont formulés avec des
substances ou compositions de matières premières obtenues en ayant recours à des procédés
physiques ou chimiques simples, sans utilisation de molécules de synthèse, et répondant à
toutes les étapes de la fabrication à des normes et à des critères précis de respect de
l'environnement.
102
–Les produits cosmétiques écologiques labellisés devront être essentiellement composés de
matières végétales issues de l'agriculture biologiques suivant les disponibilités, ou de matières
minérales non pétrochimiques autorisées par Nature & Progrès.
Aujourd'hui, le label « Nature & Progrès », du même nom que l'organisme certificateur, n’est
donné à une société pour l'un de ses produits uniquement si plus de 70% de ses produits
répondent aux critères de la charte. L'adhérent doit alors évoluer vers 100% «Nature &
Progrès» sur toute son activité dans un délai de 5 ans.
2.2.2.2- COSMEBIO
COSMEBIO est né en 2002 de l'association d'une dizaine de laboratoires pionniers ayant pour
vocation la mise en avant et la propagation des valeurs de la filière Bio. A l'heure actuelle, il
fédère plus de 380 entreprises, fournisseurs d'ingrédients, laboratoires cosmétiques, sous
traitants et distributeurs [121].
COSMEBIO est certifié par ECOCERT et Qualité France. Il est à l'origine de la Charte «
Cosmétique Écologique et Biologique » qui définit les principes fondamentaux et les règles
pour les fabricants qui souhaitent s'engager dans la cosmétique biologique. Cette Charte
donne naissance à deux cahiers des charges très exigeants déposés au Ministère Français de
l'industrie. Le premier cahier des charges fut élaboré en collaboration avec ECOCERT et
publié au Journal Officiel en avril 2003. Le second, publié en juillet 2004, a été élaboré avec
Qualité France. Ces cahiers des charges définissent de façon précise les exigences que doit
présenter le produit ainsi que les modalités de production et de contrôle par les organismes de
certification. Ils précisent également le pourcentage de produits naturels et issus de
biologique rapporté à l'ensemble des ingrédients du produit.
COSMEBIO est également co-fondateur du groupe européen COSMOS-standard, référentiel
européen en matière de cosmétiques biologiques et naturels lancé en2011.COSMEBIO a
déposé deux labels auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Ces deux labels sont facilement différentiables et correspondent à deux niveaux d'exigence
distincts.
103
Fig.25: Label BIO COSMEBIO.
Le label BIO assure :
– Un minimum de 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle.
– Au minimum 95% des ingrédients végétaux sont issus de l'Agriculture Biologique.
– Au minimum 10% des ingrédients de l'ensemble du produit sont issus de l'Agriculture
Biologique.
Fig.26: Label ECO COSMEBIO.
Le label ECO assure :
– Un minimum de 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle.
– Au minimum 50% des ingrédients végétaux sont issus de l'Agriculture Biologique.
– Au minimum 5% des ingrédients de l'ensemble du produit sont issus de l'Agriculture
Biologique.
Le référentiel autorise toutefois une quantité minime d'ingrédients de synthèse sous réserve
qu'ils ne puissent pas être remplacés par des produits naturels. Les ingrédients autorisés sont
imposés sous forme d'une liste positive très restreinte. En sont exclus : les dérivés du PEG
(polyéthylène glycol), les silicones, les dérivés pétrochimiques, les OGM (organismes
génétiquement modifiés) et les nanoparticules.
104
Les parabènes sont exclus des produits COSMEBIO depuis 2002 puis définitivement interdits
en 2008 [W44].
La charte impose aussi une surveillance sur les procédés d'obtention des cosmétiques qui
doivent être non polluants, ils doivent respecter l'environnement et la biodiversité. Les
emballages doivent être restreints au minimum, recyclables et imprimés avec des encres non
polluantes.
Le pourcentage d'ingrédients naturels et biologiques doit être clairement indiqué sur
l'emballage[W45].
Les produits labellisés COSMEBIO ainsi que les matières premières ne sont pas testés sur les
animaux sauf lorsque la loi l'exige [W46].
2.2.2.3- Le label AB
Fig.27: label AB.
Le label AB pour Agriculture Biologique est reconnu en 1993 par le gouvernement français
La certification des produits portant ce label est assurée par les organismes ECOCERT,
Qualité France, ULASE, AGROCERT, ACLAVE et Certipaq [122].
En cosmétique, son utilisation est réduite ; elle concerne uniquement les huiles essentielles et
les huiles végétales. Les huiles essentielles labellisées sont produites exclusivement en Union
Européenne.
Ce label garantit une composition de 95% de produits issus de l'agriculture biologique ainsi
qu'un mode d'extraction mécanique comme la pression à froid qui exclut l'utilisation de
solvants.
105
2.2.3- Labels étrangers
2.2.3.1- En Allemagne :BDIH
Fig.28: Label BDIH.
C’est en Allemagne, pays précurseur en la matière, qu’est né en 1951 le BDIH ou
Association Fédérale des Entreprises Commerciales Allemandes pour les médicaments, les
produits diététiques, les compléments alimentaires ou les soins corporels. En 2001, les
marques allemandes pionnières de l’industrie du produit cosmétique bio, à savoir notamment
Weleda®, Wala® DrHauschka, Logona® et Lavera® se rassemblent dans le « Groupe de
travail Cosmétiques Naturels » au sein du BDIH. Il en sortira un cahier des charges complet et
très strict concernant la production de produits cosmétiques naturels pouvant porter la
mention « Cosmétique Naturel Contrôlé ». L’ossature du cahier des charges BDIH est une
liste positive d’ingrédients autorisés qui contient 690 composants sur les 20000 à disposition.
Un seul ingrédient non autorisé exclut la certification du produit entier. Le certificat de
conformité est délivré produit par produit et est valable quinze mois. Les contrôles sont
effectués par un organisme de certification indépendant suisse, l’IMO ou Institute for Mark et
ecology [W47][117].
Les exigences majeures du BDIH sont axées sur :
- Matières premières végétales, le plus souvent possible de culture biologique contrôlée ou de
cueillette sauvage respectueuse de l’environnement, avec une liste positive déterminant les
plantes devant obligatoirement provenir de l’agriculture biologique.
- Pas d’essai sur les animaux pour les matières premières et les produits finis.
106
- Utilisation de matières premières à intervention réduite : composants (graisses, huiles,cires,
lécithine, lanoline…) obtenus par hydrolyse, hydrogénation, réaction d’estérification,
transestérification…
- Pas de colorant ni de parfum chimique de synthèse, silicone, paraffine et autres dérivés du
pétrole.
- Conservation à l’aide de substances naturelles ou définies identiques à la nature (acide
benzoïque, acide sorbique, acide salicylique…). L’utilisation doit être mentionnée par«
Conservé avec ».
- Pas d’emploi de parabène, ni de phénoxyéthanol.
- Pas de matière première végétale ou animale obtenue par manipulation génétique.
- Pas de rayons radioactifs quels qu’ils soient pour la stérilisation des matières premières et
des produits.
- Respect de l’environnement : procédés de fabrication non polluants, exploitabilité optimale
des matières premières et des produits finis, emballages économes [W48].
2.2.3.2- En Angleterre : La Soil Association
Fig.29: Label Soil Association.
La Soil Association a été fondée en 1946 par un groupe de fermiers, scientifiques et
nutritionnistes anglais. Elle a pour but de promouvoir l'Agriculture Biologique et se compose
de trois entités soit l'association elle même, une association de consommateurs et un
organisme de certification [W49].
107
Concernant les produits cosmétiques, la charte impose un maximum d'ingrédients issus de
l'Agriculture biologique et un minimum de matières premières non biologiques, utilisées
seulement si elles n'ont pas d'équivalent bio. Les OGM sont interdits et les procédés de
fabrication doivent être les plus écologiques possibles.
Certains produits sont formellement interdits tels les silicones, parabènes, donneurs de
formaldéhyde, Polyéthylène Glycol, ammoniums quaternaires, dérivés de pétrochimie,
tensioactifs irritants ou nanoparticules.
La Soil Association Limited contrôle ce label.
Il existe deux niveaux de certification :
– Les produits contenant plus de 95% d'ingrédients issus de l'Agriculture Biologique sont
labellisés « UK Soil Association Organic ».
–Les produits qui contiennent moins de 95% d'ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
ne possèdent pas ce label. La mention « organic » est inscrite à côté de chaque ingrédient.
2.2.3.3- En Belgique : Ecogarantie
Fig.30: Label Ecogarantie.
Ce label belge est issu d'un regroupement d'acteurs du secteur biologique
(producteurs,transformateurs, distributeurs, consommateurs et organismes techniques) ou Bio
forum. Son cahier des charges a été élaboré par un groupe de travail composé d’entreprises
belges et internationales, il est adapté à chacun des secteurs concernés par le label,produits
cosmétiques, produits d’entretien et sel marin [W50].
La préparation des produits portant le label Ecogarantie est basée sur les principes suivants:
- L’utilisation la plus poussée possible de produits végétaux biologiques ;
108
- L’interdiction de tester les produits finis sur les animaux ;
- L’interdiction des ingrédients d’origine pétrochimique ;
- L’abstention d’utiliser des minéraux nocifs ;
- L’interdiction d’irradier les produits ;
- L’interdiction d’utiliser tout produit, génétiquement modifié ;
- La maximalisation de la biodégradabilité ;
- L a régulation stricte de l’utilisation de stabilisants, émulsifiants, conservateurs.
Les matières premières agricoles doivent être issues de l’agriculture biologique et les produits
finis peuvent être uniquement obtenus par les procédés physiques et chimiques listés dans le
cahier des charges.
Le contrôle et la certification du cahier des charges Ecogarantie ont été confiés aux deux
organismes belges indépendants et agréés par le Ministère de l’Agriculture belge,Certisys et
Integra.
2.2.3.4- En Italie : AIAB
Deux associations italiennes, l’Association Italienne pour l'Agriculture Biologique et l'Institut
de Certification pour l'Ethique et l'Environnement se sont entendus pour établir un cahier des
charges désignant les produits cosmétiques les plus écologiques [122].
Le but de la charte est de promouvoir les ingrédients issus de l'Agriculture biologique et de
bannir les composés polluants, allergisants, irritants ou dangereux.
Fig.31: Label AIAB.
109
Elle privilégie les procédés de fabrication respectueux de l'environnement et dénonce l'excès
d'emballage.Aucun pourcentage minimal d'ingrédients naturels ou issus de l'Agriculture
biologique n'est imposé mais la formule doit comporter au moins un ingrédient bio.
Une liste d'ingrédients interdits est présente au cahier des charges ; ces ingrédients sont exclus
de part leur toxicité pour la peau et l'environnement ou leur origine synthétique.
Ainsi sont interdits :
– Les Polyéthylène Glycol et dérivés
– Les substances éthoxylées
– Les détergents trop agressifs
– Les substances polluantes
– Les substances à risque cancérigène avéré
– Les substances d'origine animale (collagène)
– Les silicones
– Les polymères acryliques
– Les conservateurs comme les parabenes, le formaldéhyde, les dérivés halogénés
– Les thiazolinones et les borates
– Les colorants synthétiques
– Les dérivés synthétiques de l'aluminium
2.2.4- Harmonisation en Europe
Devant une telle quantité de labels, et en absence d'une réglementation européenne claire en
matière de cosmétique biologique, les fabricants et certificateurs ont voulu voir émerger une
labellisation plus simple avec des chartes harmonisées. Ainsi, en 2008, deux labels à vocation
européenne ont vu le jour, COSMOS et Natrue à objectifs très semblables soit aider le
consommateur à se reconnaître parmi les nombreux labels et promouvoir la cosmétique
biologique en Europe.
2.2.4.1- COSMOS
110
En 2008, sept organismes européens se sont regroupés dans le but d'harmoniser les labels
français, italiens, allemands, belges et britanniques dans le domaine des cosmétiques
biologiques. Ainsi est né le label COSMOS soit COSMetic Organic Standard [123].
L'association propose une charte disponible depuis janvier 2010 dont le but est la promotion
de l'utilisation des produits issus de l'Agriculture Biologique, le respectde la biodiversité,
l'utilisation responsable des ressources naturelles et le respect de l'environnement, la mise en
place de techniques de fabrication non polluantes et respectueuses de la santé humaine,
l'intégration du concept de chimie verte en remplacement de la pétrochimie.
La charte prohibe les nanoparticules, les OGM, l'irradiation des produits et les tests sur les
animaux que se soit pour les produits finis ou pour les ingrédients.
Il existe une liste positive et une liste négative d'ingrédients pouvant être contenus dans les
cosmétiques biologiques. De même il existe une liste de procédés chimiques et physiques
autorisés dans la fabrication de ces produits.
COSMOS propose deux types de certification :
– COSMOS-Natural : Il n'y a pas de règles à respecter concernant les ingrédients issus de
l'Agriculture biologique. La présence d'ingrédients d'origine naturelle devra être inscrite dans
la liste des ingrédients INCI.
Fig.32: Label Soil Association-COSMOS.
COSMOS-Organic : Au moins 20% du total des ingrédients doit être biologique, au moins
95% des ingrédients physiquement transformés doivent être biologiques et au moins 30% des
ingrédients chimiquement transformés doivent être biologiques.
La charte COSMOS classe les ingrédients des cosmétiques en trois grandes catégories :
– Les ingrédients non certifiables comme l'eau (hormis certaines eaux florales qui peuvent
être certifiées biologiques).
111
– Les ingrédients certifiables, issus de l'Agriculture Biologique qui peuvent être physiquement
ou chimiquement transformés à condition que les procédés utilisés pour la transformation
soient non polluants et autorisés dans le cadre de la chimie verte.
– Les autres ingrédients qui prennent en compte les possibilités d'évolution des techniques.
La charte COSMOS s'applique à tous les niveaux de fabrication du produit : origine des
composants, fabrication, traçabilité, packaging, étiquetage et stockage.
Elle impose plusieurs choses sur le packaging :
– La mention COSMOS-Natural ou COSMOS-Organic en dessous du logo du label national.
– Le nom de l'organisme certificateur.
– Le pourcentage total d'ingrédients issus de l'Agriculture biologique sur le produit fini sans
compter l'eau et les minéraux.
– La composition au format INCI.
2.2.4.2- NaTrue
Fig.33: Label NaTrue.
L'entreprise a vu le jour à Bruxelles par la volonté de l'European Natural and Organic
Cosmetics Interest Grouping, regroupement de fabricants de produits naturels et biologiques
allemands pour la plupart (Logona, Weleda, Lavera...).Les produits labellisés Natrue (True
friends of Natural and Organic cosmetics) sont certifiés par un organisme américain
indépendant le QAI (Quality Assurance International). Les fabricants doivent en plus obtenir
une certification par les institutions Natrue implantées dans chaque pays[W51].
112
Depuis sa création, l'organisme compte plus de cent entreprises partenaires. L’organisme
décerne trois niveaux de label distingués par le nombre d'étoiles présentes sur le logo :
– Une étoile : décernée aux cosmétiques naturels ayant une composition stricte concernant les
ingrédients d'origine naturelle.
– Deux étoiles : le cosmétique contient un minimum de 15% d'ingrédients d'origine naturelle,
un maximum de 15% d'ingrédients transformés d'origine naturelle,il provient à 70% de
cultures d'origine biologique contrôlées.
– Trois étoiles : Niveau le plus exigent, il est attribué aux cosmétiques biologiques. Il
n'autorise que les produits ayant minimum 20% d'ingrédients d'originenaturelle et végétale,
maximum 15% d'ingrédients transformés d'origine naturelle et une provenance d'au moins
95% de produits issus de l'Agriculture Biologique.
Le logo utilisant les étoiles étant trop peu « lisible » par le consommateur, le label utilise donc
le même logo pour les trois catégories de produit, avec la mention de son statut : « Natural
Cosmetics », « Natural Cosmetics with organic portion » ou« Organic Cosmetics »
Fig.34: Nouveau label NaTrue.
Pour la conservation, seules six composants « nature-identiques » c'est-à-dire qui existent
dans la nature mais sont produits de manière synthétique, sont autorisés soit les acides
benzoïque, formique, salicylique, propionique et sorbique ainsi que l'alcool benzylique.
Les réactions chimiques autorisées pour la transformation sont les hydrolyses, neutralisation,
condensation,estérification, transestérification,hydrogénation, glycosidation, phosphoridation,
sulfatation, acylation, amidation et oxydation.
Natrue a également des exigences élevées dans les domaines de l'éthique et de l'écologie. Il
impose une transparence totale aux producteurs [122].
113
2.2.4.3- COSMOS/NaTrue : quelles différences ?
Les deux cahiers des charges ont pour objectif premier de promouvoir la cosmétique naturelle
et biologique, et de simplifier le message auprès des professionnels et des consommateurs,
mais en empruntant des chemins légèrement différents.
Certains reprochent à NaTrue une identité trop allemande car avant tout fondée par des
industriels allemands membres du BDIH. Depuis quelques temps, NaTrues est rapproché de
l'organisme de certification américain QAI en vue d'une équivalence entre le label européen et
la certification américaine NSF (NationalScience Fondation). Des produits américains
peuvent donc être mis sur le marché européen sous le label NaTrue.
De son côté, COSMOS, malgré une volonté d'harmonisation se voit utilisé par chaque label
national qui intègre le cahier des charges COSMOS au sien. Ainsi il n’existe pas un cahier des
charges unique chez COSMOS mais autant de cahiers qu'il y a de labels membres.
Un des avantages de NaTrue est la présence d'un logo unique sur les produits labellisés à
l'inverse de COSMOS qui utilise les labels préexistants et ainsi n'a pas un label
unique.Cependant certains déplorent chez NaTrue l'absence sur l'emballage du pourcentage de
produits issus de l'Agriculture Biologique.
A l'inverse, l’on critique chez COSMOS l’ambiguïté et la complexité du calcul des
partsd'ingrédients biologiques dans le produit fini.
3- Cosmétiques biologiques présents à l’officine
3.1- Les gammes purement « bio »
3.1.1- WELEDA
Fig.35: Logotype WELEDA.
114
En 1921, les laboratoires Weleda voient le jour en Suisse (Arlesheim) et en Allemagne
(Schwäbisch-Gmund). Le chimiste autrichien Oskar Schmiedel développe en collaboration
avec ItaWegman et Rudolf Steiner les premiers médicaments dont le concept est encore
aujourd'hui une valeur fondamentale des laboratoires Weleda,la médecine doit apporter
l'impulsion nécessaire à l'autoguérison du corps [W52].
Les premiers cosmétiques Weleda voient le jour en 1924 et les laboratoiress'implantent dans
différents pays dont la France en 1924 à Saint Louis en Alsace. En1925,Weleda s'implante
aux Pays Bas, en Autriche, en Grande Bretagne, en Tchécoslovaquie et enfin en 1931 aux
États-Unis. Le nom Weleda vient du celte,désignant les femmes qui maitrisaient les vertus
curatives des plantes.De nombreux produits conçus à cette époque sont encore
commercialisés par la marque de nos jours comme l'huile capillaire nourrissante au romarin
ou encore l'huile de massage à l'arnica. Dans les années soixante, la marque développe sa
célèbre gamme au calendula pour les bébés.
En 1992, la marque est implantée dans 30 pays avec une gamme de plus de 10000produits
que ce soit en cosmétique ou médicaments.
En 2007, Weleda créé le label Natrue en association avec d'autres sociétéseuropéennes.
Weleda fabrique des produits 100% d'origine naturelle, en excluant desingrédients tels que les
huiles minérales, les parabenes, les silicones, lesconservateurs, les parfums de synthèse...
Les matières premières sont en grande majorité issues de l'agriculture biologique.
Pour préserver la biodiversité, Weleda s'engage à réduire la part de cueillette sauvage de
plantes pour privilégier la culture « biodynamique » c'est à dire qui renforce la vitalité des
plantes, la fertilité des sols et qui préserve l'environnement.Pour les plantes qui ne peuvent pas
être cultivées dans leurs propres jardins, Weleda utilise des partenaires qui cultivent les
plantes de par le monde avec le respect de la biodiversité et de l'environnement.
Depuis 2011, Weleda est membre de l'Union for Ethical Bio Trade qui promeut un
approvisionnement en ingrédients respectueux de l'environnement.
115
3.1.2- SANOFLORE
Fig.36: Logotype SANOFLORE.
En 1972, un petit groupe de botanistes et d'agriculteurs bio français créent le Jardin Botanique
Sanoflore à Gigors-et-Lozeron au coeur du Vercors [W53].En 1986, ils fondent le laboratoire
Sanoflore spécialisé dans l'aromathérapie et la phytothérapie, puis, en 2003, apparaît la
première ligne de cosmétiques. En 2006 le laboratoire est approché par le groupe L'Oréal qui
lui associe sa recherche avancée.
En 2008, le laboratoire emploie un nez spécialiste des parfums naturels afin de développer
d'avantage l'aspect plaisir de ses produits. De ces associations, naissent des produits qui
connaissent un grand succès comme l’élixir des Reines ou l'Essence Merveilleuse.
Le Jardin Botanique Sanoflore compte plus de 350 espèces de plantes médicinales et
aromatiques base de recherche cosmétique de la gamme [W53].
La charte de la marque implique une entente entre la science et la nature :
– Privilégier l'utilisation de plantes et d'ingrédients 100% naturels cultivés sans pesticides ni
produits chimiques ou issus de la filière biologique.
– Utiliser des techniques d'extraction comme la distillation à la vapeur d'eau qui préservent les
propriétés actives et la richesse sensorielle des plantes fraîches.
– Sélectionner des actifs naturels qui rivalisent en efficacité avec les actifs utilisés
en cosmétique traditionnelle.
– Développer des protocoles d'évaluation adaptés aux matières premières d'origine naturelle.
– Évaluer par des tests in vitro et in vivo la qualité et la sensorialité des produits.
– Évaluer l'efficacité et la tolérance des formules sous contrôle dermatologique en utilisant un
large panel de testeurs dont au moins la moitié ont la peau sensible.
– Utiliser des parfums 100% naturels préparés par le nez de la marque : Maïlis Richard Royer.
– Exclure de ses formules : Parabè
d'aluminium, phénoxyéthanol...
– Proposer des flacons 100% recyclables au design très soigné.
Les produits Sanoflore répondent
3.1.3- DR HAUSCHKA
Fi
En 1935, le docteur Rudolph HAUSCHKA fonde le laboratoire WALA
le but de commercialiser des médicaments fabri
anthroposophique basée sur l’homme et la nature
L’association entre Rudolph HAUSCHKA et Elisabeth SIGMUND, à l’origine du concept
cosmétique donnera naissance à la gamme «
puis, un peu plus tard, cette gamme sera rebaptisée DR HAUSCHKA et certifiée par le label
BIHD.
Pour les chercheurs du laboratoire DRHAUSCHKA, la peau possède ses propres forces de
nutrition et de régénération et le rôle d’un cosmétique est de soutenir
dans ses fonctions naturelles. C’est cette «
laboratoire [W54].
116
Exclure de ses formules : Parabènes, silicones, produits issus de la pétrochimie,sels
d'aluminium, phénoxyéthanol...
Proposer des flacons 100% recyclables au design très soigné.
Les produits Sanoflore répondent à la charte Cosmébio et sont certifiés Ecocert.
Fig.37: Logotype DR HAUSCHKA.
En 1935, le docteur Rudolph HAUSCHKA fonde le laboratoire WALA à Ludwigsburg dans
le but de commercialiser des médicaments fabriques selon les connaissances de la médecine
anthroposophique basée sur l’homme et la nature
L’association entre Rudolph HAUSCHKA et Elisabeth SIGMUND, à l’origine du concept
cosmétique donnera naissance à la gamme « cosmétique curative d’Elisabeth SIGMUND
puis, un peu plus tard, cette gamme sera rebaptisée DR HAUSCHKA et certifiée par le label
Pour les chercheurs du laboratoire DRHAUSCHKA, la peau possède ses propres forces de
nutrition et de régénération et le rôle d’un cosmétique est de soutenir et de stimuler la peau
dans ses fonctions naturelles. C’est cette « autocorrection » qui fait la particularité de ce
s, silicones, produits issus de la pétrochimie,sels
à la charte Cosmébio et sont certifiés Ecocert.
à Ludwigsburg dans
ques selon les connaissances de la médecine
L’association entre Rudolph HAUSCHKA et Elisabeth SIGMUND, à l’origine du concept
curative d’Elisabeth SIGMUND »
puis, un peu plus tard, cette gamme sera rebaptisée DR HAUSCHKA et certifiée par le label
Pour les chercheurs du laboratoire DRHAUSCHKA, la peau possède ses propres forces de
et de stimuler la peau
qui fait la particularité de ce
3.3- Les gammes classiques qui tendent vers le «
3.3.1- BIO BEAUTE BY NUXE
Bien que le laboratoire Nuxe® existe depuis 1957, ce n’est qu’en 2007 que l’on voit
apparaître une gamme à part de produits cosmétiques biologiques certifiés Cosmébio
l’organisme Ecocert. Ce lancement s’appuie sur la renommée des produits cos
conventionnels Nuxe®, et propose la « PulpyCosmetology® » basée sur l’utilisation des
bio, plus riches en anti-oxydants et en vitamine C, et des huiles de fruits.
Nuxe® met ainsi en place le « Pacte Bio Beauté® »
• BIO-CONCEPTION
naturels 100% purs : sans silicone, sans PEG, sans matière issue de la pétrochimie
sans matière génétiquement modifiée, sans colorant de synthèse, sans
sans formol, sans produit à base de dérivés éthoxylés, sans
• BIO-EFFICACITE : Bio
et sécuritaires: forte concentration en actifs
dermatologique sur volontaires ; bonne tolérance cutanée et oculaire ; non
• BIO-PLAISIR : Bio-
textures exceptionnelles, parfums 100% naturels.
• ECO-RESPONSABLE
en protégeant les espèces animales (
et à minimiser son empreinte écologique sur la terre, tous les
étuis participent à la protection des forêts ; ils sont
117
Les gammes classiques qui tendent vers le « bio »
BIO BEAUTE BY NUXE
Fig.38: Logotype NUXE .
Bien que le laboratoire Nuxe® existe depuis 1957, ce n’est qu’en 2007 que l’on voit
apparaître une gamme à part de produits cosmétiques biologiques certifiés Cosmébio
Ecocert. Ce lancement s’appuie sur la renommée des produits cos
Nuxe®, et propose la « PulpyCosmetology® » basée sur l’utilisation des
oxydants et en vitamine C, et des huiles de fruits.
Nuxe® met ainsi en place le « Pacte Bio Beauté® » qui respecte 4 engagements
CONCEPTION : Bio-Beauté® s’engage à sélectionner uniquement des extraits
naturels 100% purs : sans silicone, sans PEG, sans matière issue de la pétrochimie
sans matière génétiquement modifiée, sans colorant de synthèse, sans para
sans formol, sans produit à base de dérivés éthoxylés, sans phénoxyéthanol.
: Bio-Beauté® s’engage à offrir des produits hautement efficaces
ritaires: forte concentration en actifs; tests cliniques réalisés sous contr
dermatologique sur volontaires ; bonne tolérance cutanée et oculaire ; non comédogènes.
-Beauté® s’engage sur une qualité cosmétique irréprochable
textures exceptionnelles, parfums 100% naturels.
RESPONSABLE : Bio-Beauté® s’engage à préserver les richesses naturelles
en protégeant les espèces animales (aucun test sur animal, aucun ingrédient
et à minimiser son empreinte écologique sur la terre, tous les composants sont recyclables, les
ction des forêts ; ils sont imprimés avec des encres sur base végétale
Bien que le laboratoire Nuxe® existe depuis 1957, ce n’est qu’en 2007 que l’on voit
apparaître une gamme à part de produits cosmétiques biologiques certifiés Cosmébio par
Ecocert. Ce lancement s’appuie sur la renommée des produits cosmétiques
Nuxe®, et propose la « PulpyCosmetology® » basée sur l’utilisation des fruits
qui respecte 4 engagements [W55] :
Beauté® s’engage à sélectionner uniquement des extraits
naturels 100% purs : sans silicone, sans PEG, sans matière issue de la pétrochimie (paraffine),
parabène, sans EDTA,
phénoxyéthanol.
Beauté® s’engage à offrir des produits hautement efficaces
; tests cliniques réalisés sous contrôle
comédogènes.
alité cosmétique irréprochable
à préserver les richesses naturelles
aucun test sur animal, aucun ingrédient d’origine animale)
composants sont recyclables, les
imprimés avec des encres sur base végétale
et leur taille a été réduite, les notices
limiter la consommation de papier.
3.3.2- CAUDALIE
CAUDALIE est une gamme née en 1993 de l’association de Mathilde et Bertrand THOMAS,
avec le Pr VERCAUTEREN de l’Université de Bordeaux. L’idée de réaliser ces cosmétiques
est née sur les terres du château Smith Haut Lafitte en évaluant le
du raisin sur la peau. En effet, les pépins
piégeurs de radicaux libres, peut être dix mille fois plus que la vitamine E. De plus, la pulpe
du raisin est très riche en oligoélé
resveratrol qui stimule le renouvellement cellulaire et la viniférine, anti tâche qui améliore
l’état de la peau.
En septembre 1995, les trois premiers produits de la gamme sont sur le marché. Aujourd‘
la gamme compte 35 produits et 7 huiles.
Depuis 2006, le laboratoire a décidé de modifier la formulation en s’affranchissant des
molécules non naturelles [W56]
3.4- Autres gammes « bio
3.4.1- KIBIO ®
118
et leur taille a été réduite, les notices d’utilisation sont progressivement supprimées pour
papier.
Fig.39: Logotype CAUDALIE.
CAUDALIE est une gamme née en 1993 de l’association de Mathilde et Bertrand THOMAS,
de l’Université de Bordeaux. L’idée de réaliser ces cosmétiques
est née sur les terres du château Smith Haut Lafitte en évaluant les connaissances des bienfaits
du raisin sur la peau. En effet, les pépins de raisins contiennent des poly
piégeurs de radicaux libres, peut être dix mille fois plus que la vitamine E. De plus, la pulpe
du raisin est très riche en oligoéléments ; les sarments et rafles du raisin renferment du
resveratrol qui stimule le renouvellement cellulaire et la viniférine, anti tâche qui améliore
En septembre 1995, les trois premiers produits de la gamme sont sur le marché. Aujourd‘
la gamme compte 35 produits et 7 huiles.
Depuis 2006, le laboratoire a décidé de modifier la formulation en s’affranchissant des
[W56].
»
Fig.40: Logotype Kibio.
d’utilisation sont progressivement supprimées pour
CAUDALIE est une gamme née en 1993 de l’association de Mathilde et Bertrand THOMAS,
de l’Université de Bordeaux. L’idée de réaliser ces cosmétiques
s connaissances des bienfaits
de raisins contiennent des polyphénols, puissants
piégeurs de radicaux libres, peut être dix mille fois plus que la vitamine E. De plus, la pulpe
; les sarments et rafles du raisin renferment du
resveratrol qui stimule le renouvellement cellulaire et la viniférine, anti tâche qui améliore
En septembre 1995, les trois premiers produits de la gamme sont sur le marché. Aujourd‘hui,
Depuis 2006, le laboratoire a décidé de modifier la formulation en s’affranchissant des
119
Jeune société française créée en 2005, Kibio® conçoit des produits cosmétiques riches en
actifs végétaux, particulièrement efficaces comme l’aloévera, la poudre de noyaux de dattes
ou les micro-algues. Organisée autour de trois gestes essentiels, nettoyer, hydrater, optimiser,
la gamme Kibio® renforce l’efficacité de ses produits par un rituel de beauté inspiré de l’Asie
et de l’énergie vitale du ki.
Les produits sont certifiés par Ecocert et comportent le label Cosmébio ou Cosméco.
L’entreprise a été rachetée en 2010 par la société Clarins, qui avait soutenu sa création. Ce
rachat annonce la distribution des produits Kibio® au niveau international [W57].
3.4.2- CATTIER
Fig.41: Logotype CATTIER.
Cattier a été créé en 1968 par Pierre Cattier. Très attaché aux médecines douces, il s’est
intéressé au développement de produits à base d’argile de l'argile.
Depuis 2000, la marque possède toute une gamme de cosmétiques biologiques, et représente
l'une des entreprises pionnières en France [W58].
Les produits de la marque se veulent en conformité avec le respect de l'environnement et des
utilisateurs.
L'engagement de Cattier porte sur :
– Les produits utilisés sont naturels et issus en partie de l'agriculture biologique.
– Les OGM sont interdits.
– Les paraffines, silicones et sels d'aluminium sont interdits.
– Il n’y a pasde colorants artificiels ou parfums de synthèse.
– Les ingrédients interdits par Ecocert ne sont pas utilisés.
– Les tests sur les animaux sont interdits.
120
– Les emballages sont en matériaux recyclables (y compris le tube de stick àlèvres en
bioplastique), il n'y a pas de notice et les encres utilisées sont non polluantes.
4- Avantages et inconvénients de la cosmétique « bio »
4.1- Avantages de la cosmétique « bio »
• Pour le consommateur
Les cosmétiques « bio » impliquent que tous les ingrédients entrant dans la composition du
produit sont « généralement » issus des plantes. Ils mettent ce point en opposition avec les
cosmétiques conventionnels qui pour leur part, utilisent de nombreux excipients servant
uniquement à apporter une texture, un parfum ou permettant une conservation du produit à
moindre coût. Le consommateur a donc l’impression qu’en achetant un cosmétique bio, il
disposera d’un concentré d’ingrédients actifs sans danger pour sa santé et donc d’une
efficacité optimale.
• Pour l’environnement
Aujourd’hui, les préoccupations éthiques concernant l’écologie et le respect de
l’environnement sont une réelle priorité pour les industries mais aussi pour les
consommateurs. Les cosmétiques bio s'inscrivent largement dans cette démarche et le
prouvent par différents moyens de communication. En effet, ils ont toujours interdit
l’utilisation d’ingrédients testés sur les animaux. Les procédés de fabrication de ces produits
sont très rigoureux et impliquent que les substances utilisées pour la formulation soient toutes
biodégradables ainsi que les composés utilisés pour les emballages. Les industries de
cosmétiques bio limitent également la quantité de déchets liés à la production.
Les cosmétiques bio utilisant au maximum des ingrédients issus de l’Agriculture Biologique,
garantissent l’utilisation de pratiques plus respectueuses de l’environnement que celles
utilisées dans la cosmétique conventionnelle, à travers l’absence d’OGM, de pesticides et
d’engrais mais aussi à travers la préservation des sols et des ressources naturelles.
121
Le développement des cosmétiques bio permet une stimulation en matière de recherche et
d'innovation pour favoriser la substitution des ingrédients synthétiques au profit de nouvelles
molécules actives issues du monde végétal, permettant une prise deconscience de l’intérêt et
de la nécessité de la sauvegarde des espèces naturelles.
4.2- Inconvénients de la cosmétique « bio »
• Pour le consommateur Il a souvent été reproché aux cosmétiques bio des textures et des senteurs moins agréables que
celles des cosmétiques conventionnels. Depuis ces dernières années, de nombreux progrès ont
été fait dans ce domaine et désormais certains cosmétiques bio rivalisent avec les cosmétiques
classiques.
De plus, l’absence quasi totale de conservateurs synthétiques ou leur substitution pardes
conservateurs naturels comme les huiles essentielles réduit significativement ladurée
d’utilisation de ces produits. C’est un point sur lequel l’AFSSAPS s’est penché en2009 et a
lancé une campagne de prélèvements et de contrôles de la propretémicrobiologique et de
l’efficacité de la conservation de ces produits [W59].
La confusion des termes « bio » et « hypoallergénique » doit être levée. En effet, les produits
labellisés cosmétiques bios peuvent contenir des huiles extraites de différentes essences
naturelles et sont susceptibles de provoquer des allergies comme tout autre produit naturel. Il
s’agit donc d’informer le public des risques, certes affaiblis, mais potentiels de ce type de
cosmétologie, d’autant que pour la plupart des consommateurs, la cosmétique « bio » est
synonyme d’innocuité.
Face à la diversité des labels, le consommateur peut se sentir perdu et ne pas savoir quoi
choisir. Ces différents labels n’ont pas tous les mêmes exigences et ne garantissent pas tous le
même pourcentage d’ingrédients bio, leur qualité n’est donc pas forcément similaire.
• Pour le fabricant
La plus grande et importante difficultés repose sur la recherche des matières premières,
l’approvisionnement en matières premières d’origine biologique en premier lieu peut s’avérer
122
compliqué, nécessitant du temps et de nombreux contrôles dont le fabricant doit prendre en
compte.
Les formulateurs de produits cosmétiques bio doivent composer en tenant compte de
nombreuses contraintes[124]:
� Exigence de texture
Lorsque 95% des matières premières utilisées en cosmétique classique(substances minérales,
silicones, tensioactifs, émulsifiants, conservateurs et parfums de synthèse) sont supprimées,
les producteurs doivent refaire leurs gammes en faisant abstraction des substances « bonnes à
tout faire » dont ils connaissent parfaitement le comportement à l’usage et en toutes
circonstances.
Les gels, crèmes, shampoings au toucher doux ont une stabilité et une viscosité faciles à
obtenir en chimie de synthèse mais beaucoup plus difficiles à réaliser en bio. Les silicones
par exemple, très largement représentés depuis vingt ans en cosmétique pour leur aspect
multifonctionnel (toucher soyeux, démêlage et brillance des cheveux…), sont interdits dans le
cadre des labels bio et doivent être remplacés par des molécules offrant des propriétés
semblables. L’on s’en rapproche par l’association de différentes matières premières, dont de
très fines poudres de riz, par exemple, qui peuvent s’apparenter au même toucher.
� Exigence d’odeur
Dans les produits cosmétiques biologiques, tout commence par les réflexions sur l’odeur.
C’est souvent la première réaction des clientes qui essayent pour la première fois un baume,
une crème, une huile de massage… en version bio. Habitué et conditionné aux odeurs de
synthèse qui ont formaté nos récepteurs olfactifs, le nez a du mal à apprécier d’emblée les
odeurs issues du naturel sans une courte phase de transition. Dans un sens ou dans l’autre, le
corps doit s’habituer et se réadapter. Passé ce premier effet de surprise, les organes sensoriels
s’ouvrent, intègrent ces nouveaux codes senteurs et la molécule naturelle reprend sa place
Au niveau de ses récepteurs.
123
� Exigence de stabilité dans le temps
S’il est vrai que la mention « Sans parabène » est recherchée par le consommateur, il n’est pas
toujours aisé pour le formulateur de travailler avec de nouveaux systèmes de conservation.
� Il se heurte d’emblée au problème de compatibilité entre les ingrédients de la formule
et les conservateurs, avec le risque de provoquer des instabilités ou une séparation des
phases.
� Ensuite il aura à vérifier par des tests exigeants que le nouveau système de
conservation protège bien le produit de la dégradation microbiologique.
� Puis, il aura à tester précisément la concentration en conservateurs pour éviter
lesurdosage (et les irritations qui peuvent l’accompagner), tout en garantissant
lasécurité microbiologique.
� En ce qui concerne la tolérance, des tests dermatologiques devront être effectués.
Les systèmes de conservation des produits cosmétiques naturels impliquent de bien penser le
contenu et le contenant, ce qui suppose à la fois de:
� choisir des substances qui ont des propriétés conservatrices (huiles essentielles,
alcool).
� se pencher sur le conditionnement du produit (exemple du système de pompe
«Airless»).
� travailler sur l’activité de l’eau .
� travailler sur le pH .
Il est juste de souligner que les cosmétiques bio ne peuvent pas, à l’heure actuelle, rivaliser
avec certains produits des gammes dermatologiques. Ces produits contiennent des actifs
souvent issus de la synthèse chimique et de ce fait, il n’a pas encore été trouvé d’équivalent
dans le règne végétal. De plus, les extraits végétaux utilisés présentent parfois de sérieux
risques allergiques conduisant excluant les peaux sensibles. Cette problématique est retrouvée
dans le domaine de la photo-protection où les gammes solaires bios qui voient le jour sont
composées de filtres minéraux qui ne permettent que des indices de protection faibles voire
modérés.
124
PARTIE 5 :
Enquête sur les habitudes
d’achat des cosmétiques et la
perception des cosmétiques
bio chez le consommateur
marocain
125
1-Introduction :
Depuis quelques années les substances chimiques se sont très souvent retrouvées mises en
avant quant aux effets potentiels de ces dernières sur la santé. Les conservateurs tels que les
parabènes sont sur la sellette dans le domaine des produits cosmétiques.
Face à l'inquiétude grandissante du public sur les substances chimiques, le consommateur se
tourne vers les produits cosmétiques biologiques qui revendiquent particulièrement la non-
utilisation de ces conservateurs.
Il nous a donc semblé intéressant d'interroger les consommateurs sur ce sujet.
2-Objectifs de l’enquête :
� Aperçu des habitudes, des préoccupations des consommateurs lors d’achat d’un
produits cosmétiques.
� Evaluer le niveau d’information du public à propos du sujet sur les parabènes.
� Evaluer la perception des cosmétiques bio chez les consommateurs.
3- Matériels et méthodes :
L'enquête a été crée sous deux formats : (Voir Annexe )
� une version classique papier, ce qui reste le moyen le plus sûr d’obtenir les
informations recherchées.
� une version Internet via Google Form qui a permis la diffusion par mail et par le
réseau social Facebook aux consommateurs.Les avantages de ce format résident dans
le fait que les intéressés remplissent en ligne le questionnaire et l'envoient directement,
les réponses sont ensuite automatiquement classées dans un tableau Excel aisément
consultable.
Soixante questionnaires ont ainsi été collectés durant une période d’un mois et demi, du 15
Juillet2016 au 30 Août 2016.
126
4-Résultats de l’enquête
Fig.42 : Répartition selon le sexe.
Fig.43 : Répartition selon la tranche d'âge.
82%
18%
femmes
hommes
26,4%
67,9%
3,8%1,9%
0,0%0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 et plus
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55 et plus
127
Fig.44 : Lieux d'achat des produits cosmétiques.
Fig.45 : Éléments importants lors de l'achat d'un produit cosmétique.
30,8%
44,9%
19,2%
1,3%3,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Pharmacie
Parapharmacie
Grandes surfaces
internet
Autres
40,3%
32,5%
22,1%
1,3%3,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
Prix
Ingrédients
Marque
Packaging
respect de l’environnement
128
Fig. 46: Achat des cosmétiques bios
Fig.47: Motivations d'achat des cosmétiques bio
36%
22%
42%oui
non
je compte en acheter
10,1%
39,1%
46,4%
4,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Respect de l'
environnement
Meilleur pour la
santé
Ingrédients
naturels
Plus efficace que
les cosmetiques
conventionnels
Respect de l'
environnement
Meilleur pour la santé
Ingrédients naturels
Plus efficace que les
cosmetiques
conventionnels
129
Fig.48:Catégories des cosmétiques bios consommés
5-Interprétation des résultats
Les femmes ont été plus portées à participer à l’enquête que les hommes soit 84 % des
participants étaient des femmes. Certaines personnes confondent cosmétiques et maquillage,
et cette question de terminologie peut avoir dissuadé les hommes de participer .De façon plus
générale, cette statistique reflète sans doute un plus grand intérêt pour les cosmétiques chez
les femmes. Les campagnes de marketing ainsi que d’autres influences culturelles perpétuent
l’association entre cosmétiques et féminité.
L’enquête a permis d’avoir un aperçu des habitudes et préoccupations d’achat des produits
cosmétiques et la conception des cosmétiques bio chez une majorité de femmes âgées de
15à35 ans cette tranche d’âge englobe les consommatrices cible du marché des cosmétiques
ainsi que les futures consommatrices.
La parapharmacie représente l’endroit privilégié pour les consommateurs (41%), vient ensuite
la pharmacie (31%) et les grandes surfaces (19%). Par contre, les achats sur internet ne
suscitent pas d’engouement pour les consommateurs car ils recherchent probablement un
2,9%
42,6%
22,1%
8,8%
16,2%
7,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
Maquillage (mascara, fard à
paupières/joues, vernis à
ongles…)
Soins du visage
(crème, sérum, contour des
yeux, nettoyant, lotion, masque,
gommage, baume à lèvres…)Soins du corps
(crème, lait, gommage, crème
mains, huile de bain/massage…)
Soins spécifiques pour bébés et
enfants (lait de toilette, crème
pour le change…)
Hygiène (gel
douche, savon, shampooing, den
tifrice, déodorant, mousse à
raser…Produits solaires (crème et lait
solaire/après-solaire)
130
conseil associé et/ ou une filière plus sécurisée. Les consommateurs évoquent d’autres lieux
d’achat comme les parfumeries ou les magasins des marques.
Les résultats obtenus ont permis de dégager les points suivants :
� Les ingrédients représentent une préoccupation majeure lors de l’achat d’un
produit cosmétique
Les consommateurs deviennent de plus en plus sensibles à la composition de leurs
produits cosmétiques puisque (32,5%) en font un critère majeur lors de l’achat d’un
produit cosmétique après le prix. Le packaging et le respect de l’environnement ont peu
d’importance. D’après ce résultat on constate une évolution des mentalités et une
modification importante des habitudes de consommation des cosmétiques. Jusqu’ici, le
passage de la barrière cutanée était connu, mais personne ne prenait ce facteur réellement
en compte. Face aux accusations actuelles, il devient impossible de contourner cet élément
ce qui explique que le consommateur devient de plus en plus conscient et exigeant en ce
qui concerne la composition de ses produits cosmétiques.
� Un déficit d'informations concernant les ingrédients polémiques
Concernant la question sur les ingrédients à éviter dans les cosmétiques et malgré les
nombreux sujets traités par les médias, la télévision et les sites Internet, parmi les 60
personnes interrogées, 20 ont pu répondre, ce qui laisse à penser que la majorité se sentent
insuffisamment informés aux sujet des substances à risque que peuvent contenir les produits
cosmétiques.
� Les parabènes : les plus connus
Les parabènes sont les ingrédients cosmétiques les plus médiatisés depuis 2005 et, parmi
ceux pointés du doigt, les plus connus et cités par 60% des répondants à cette question,
d’ autres ingrédients ont été cités :les sels d'aluminium ,les silicones,les
parfums,formaldéhydes , les filtres anti-UV,Le BHT, ou ButylHydroxyToluène et le
BHA, ButylHydroxyAnisole.
131
� L'opinion des consommateurs est au final favorable aux cosmétiques bio
L’enquête a mis en avant le fait que le bio est connu de tous. Ce concept est relié en majorité
à des idées positives ,la majorité (78 %) achète ou compte acheter des produits de beauté bio.
Le consommateur apprécie les cosmétiques bio pour leur côté santé et leurs formulations
naturelles. La médiatisation de l’affaire des parabènes en 2005 a également joué un grand
rôle dans les choix des consommateurs. Ceux-ci ont trouvé dans les cosmétiques bios la
sécurité, le naturel et l’écologie qu’ils recherchaient.Parmi les produits cosmétiques bio
achetés arrivent en tête les soins de visages (42,6 %) suivi par les soins du corps (22,1%), La
préférence pour les soins du visage et du corps montre que les consommateurs pensent que le
bio est bon pour leur santé et leur peau.
132
Conclusion de l’enquête
On peut donc conclure que les consommateurs veulent connaître la composition de leurs
produits quotidiens. La présence des parabènes est une préoccupation du public et la notion de
risque pour la santé est une question récurrente. Malgré le fait que les cosmétiques bio restent
marginaux par rapport aux cosmétiques conventionnels dans le quotidien des individus, ils
connaissent un succès croissant auprès des consommateurs. On constate en effet une évolution
des mentalités concernant le respect de la santé et de l’environnement, ce qui est propice à
une meilleure perception des produits bio.
Approfondir nos connaissances dans le sujet des parabènes en cosmétique et de leur principale
alternative, autrement dit les produits biologiques, semble légitime au regard de cette
enquête ; Le pharmacien d'officine n'est pas un simple commerçant mais un professionnel de
santé, un scientifique hautement qualifié dans ses fonctions pharmaceutiques, et en ce qui
concerne le cosmétique, son rôle est de conseiller et d'assurer la sécurité du patient.
Néanmoins, certaines limites doivent être soulignées pour cette recherche ; elles sont liées
d’une part à la taille réduite de notre échantillon et d’autre part à la population cible ; il aurait
été intéressant d’élargir cette enquête en proposant un autre questionnaire aux professionnels
(pharmacie et parapharmacie), afin d’obtenir des résultats plus complets.
133
Conclusion et Perspectives
"Les parabènes présentent-ils un danger pour la santé ?" L’on ne peut au final pas répondre
directement à cette question. Suite à l’analyse de ces différentes études, beaucoup de
questions sont soulevées au fur et à mesure des différentes découvertes. La polémique des
parabènes n’est pas terminée. Les études menées in vitro prêtent aux parabènes différents
potentialités plus ou moins dangereuses, les études sur les modèles animaux révèlent elles
aussi des résultats qui pourraient suggérer que les parabènes sont très nocifs. Or de tels
modèles ne sont pas directement extrapolables pour l'organisme humain. Celui-ci étant très
complexe, les résultats obtenus ne seraient pas forcément les mêmes. En absence de données
épidémiologiques solides, la législation prend les devants en limitant l'utilisation des
parabènes dans les cosmétiques.
La marche vers le "Sans parabènes" est bien entamée. Les inquiétudes des consommateurs
alimentées par les titres des Unes de presse ne devraient pas entraîner une substitution hâtive
par d’autres conservateurs dont on ne connait pas les effets à long terme. À l’heure actuelle,
aucune molécule de synthèse n'a encore prouvé pareilles capacités en matière d'efficacité ou
de praticité. Les alternatives techniques telles les flacons Airless, le système DEFI semblent
très prometteuses mais restent couteuses. Les cosmétiques biologiques sont donc un bon
compromis pour les consommateurs qui désirent des produits performants et agréables à
utiliser tout en respectant les convictions de l'utilisateur quant au respect de l'environnement
dans la fabrication de ces produits et au respect de la santé humaine par l'éviction des
ingrédients à polémique. En revanche, les extraits végétaux utilisés dans les cosmétiques bio
présentent parfois de sérieux risques allergiques conduisant à une contre-indication pour les
peaux sensibles.
Le thème des parabènes est étroitement lié à l’activité officinale, étant donné qu’il peut guider
les conseils relatifs aux produits cosmétiques et répondre aux inquiétudes des consommateurs.
Ainsi, face à une patiente à peau saine, il est à conseiller des cosmétiques contenant des
parabènes, en considération de leur toxicité quasi nulle et de leur tolérance admise. La
patiente gagnerait aussi à être orientée vers des cosmétiques bio si elle est sensible aux valeurs
134
qu’ils véhiculent comme le respect de l’environnement et de l’agriculture biologique. En
revanche, sera contre indiquée leur application sur une peau lésée atopique, chez une femme
enceinte (les parabènes restent des perturbateurs endocriniens) et chez le jeune enfant dont la
fonction barrière de la peau est encore immature où prendront le pas des produits sans
conservateurs à risques d’allergies ou d’intolérance limités.
Et demain…
� Les cosmétiques faits maison.
De la tendance des cosmétiques naturels et biologiques découle la tendance des cosmétiques
faits maison. En effet, de plus en plus de femmes réalisent leurs cosmétiques à base de
plantes récoltées dans leurs jardins.
� La Cosméfood ou cosmétofood
La tendance « cosméfood ou cosmétofood» ne fait qu’évoluer en Europe et au Japon. Le but
de cette démarche est d’apporter à l’apparence extérieure tous les bienfaits des aliments
enrichis en principes actifs. Les vitamines contenues dans les aliments peuvent contribuer à
améliorer les problèmes de peau liés aux agressions extérieures (exemple : crèmes au
chocolat, aux fruits, au caviar…).
� La slow cosmétique
La slow cosmétique est un mouvement (inspiré de la Slow Food®) créé par Julien Kaibeck.
Il consiste à proposer une alternative aux cosmétiques conventionnels commercialisés par les
grandes firmes industrielles, à consommer moins de cosmétiques et à adopter une attitude
écologique. M. Kaibeck a écrit un livre intitulé du nom de son mouvement, dans lequel il
explique les besoins de la peau, évoque les dangers éventuels des cosmétiques classiques et
donne des alternatives à leur emploi par le biais de recettes réalisables à la maison, à base
d’huiles végétales et d’huiles essentielles et d’ingrédients simples et sains.
136
RESUME
Résumé Titre : Parabènes dans les produits cosmétiques : quelles alternatives, quelle place
des cosmétiques bio.
Auteur: BELAOUFI FATIMA EZZAHRA
Mot clé : Parabènes, produits cosmétiques, perturbateurs endocriniens, alternatives,
cosmétiques biologiques.
Les parabènes sont des esters de l’acide Para-hydroxybenzoïque, utilisés comme
conservateurs depuis les années 30 dans la plupart des produits cosmétiques, alimentaires et
pharmaceutiques.Ces dernières années, ils sont au cœur d'une polémique suite à une étude
publiée en 2004 par Darbre et col , qui confère aux parabènes présents dans la composition de
cosmétiques une activité oestrogénique et les implique dans la genèse et le développement de
tumeurs du sein.
D’après l’analyse des publications scientifiques actuelles et avis publiés par les autorités de
santé, les parabènes sont à ce jour des conservateurs controversés. En absence de données
épidémiologiques solides, la législation prend les devants en limitant l'utilisation des
parabènes dans les cosmétiques. Dans ce contexte, de nombreuses alternatives émergent sur le
marché, sans que les solutions proposées par la cosmétique conventionnelle ne soient
l'alternative idéale en termes de composition. En effet, les conservateurs de synthèse utilisés
dans les produits sans parabènes sont remis en cause en raison d'autres effets indésirables. Les
solutions liées au packaging sont encore peu répandues mais présentent un avenir prometteur.
Enfin, les solutions proposées par la cosmétique biologique séduisent de plus en plus les
consommateurs, il est cependant important de noter que certains ingrédients peuvent être
allergisants et que les cosmétiques BIO peuvent ne pas convenir aux différents profils de
consommateurs. Enfin, notre enquête menée auprès de différents catégories de
consommateurs au Maroc a révélé le grand intérêt porté à la sécurité de la composition des
produits cosmétiques et un besoin important d’information concernant les ingrédients à
risque dans les cosmétiques, en particulier les parabènes. Le pharmacien d’officine aura donc
un rôle important à jouer en terme de conseil, afin de dispenser un produit sûr et adapté à la
typologie cutanée du patient.
137
ABSTRACT
Title: Parabens in cosmetics : what alternatives ,what place for organic cosmetics.
Author: BELAOUFI FATIMA EZZAHRA
Keywords: Parabens, cosmetic products, endocrine disrupters, alternatives, organic cosmetics
The parabens are esters of parahydroxybenzoic acid, used as conservatives since 1930 in most
of cosmetic ,food and pharmaceutical products.In recent years, they are at the heart of a
controversy as a result of a study published in 2004 by Darbre and Col., which gives parabens
present in the composition of cosmetic estrogenic activity and involves them in the genesis
and development of breast tumors.
Indeed,according to the analysis of the current scientific literature and notices published by
the health authorities, parabens to this day are the Conservatives controversial. In the absence
of epidemiological data, the legislation takes the lead in limiting the use of the parabens in
cosmetics. In this context; many of the alternatives are emerging on the market. But the
solutions offered by conventional cosmetics aren’t the ideal alternative in terms of
ingredients. Indeed, synthetic preservatives used in “free-paraben” cosmetic products are
being questioned due to their possible side effects. Alternatives in terms of packaging are still
not widely used but have a promising future. Finally, organic cosmetics are becoming more
and more attractive to consumers. however, it is important to note that some ingredients may
be allergenic and that organic cosmetics may not be suitable for all the different types of
consumers.Finally, our survey of different categories of consumers in Morocco revealed the
great interest in the safety of cosmetic products and a great need for information about the
ingredients at risk in cosmetics, especially parabens.The pharmacist will have an important
role to play in Council , in order to provide a safe and suitable product to the patient's skin
type.
138
����
��ن ��� ��ات ا������ ا������: ا���را��� �� ��� ��ات ا������ :ا����ان� �� ،�� .�� ه� ا���ا
��$�� ا�#ه�اء �!���� :ا����
��� ا���را���،��� ��ات ا������، ا*�(ل ا�'�د ا�%��ء، ا�����، ��� ��ات ا������ :ا����ت ا�� ������ا
ا���را��� ه� ا�9�ات 8�1 ��اه��روآ�� �-#و�7 ، و4��5�م آ��اد ��1,� �-0 ا�/(.�-�ت �� ��,+
�� ا��-�ات اB*��ة ، أ?�< ا����9ل ا���ا��� �=�ح . ا���اد ا�'0ا��� و ا�%�����,��� ��ات ا������
���5# ا���را��� (Darbre et coll)$�ف �� H�12004 دراFG �9�ت �� �Eم , E�ة ��5ؤCت
و�F5رك �� PFGة ا����و��� ه���ن ��FG O�Fط ا����Nدة �� 5�آ��� ��� ��ات ا������ �-�Fط
.و5=�ر أورام ا�/�ي
5 !�� ا��-�Fرات ا��!��� ا� ���� وا��TUرات ا�%�درة �� ��S ا��!=�ت ا�% �� ا���را��� Vا�9-�دا إ�
�� \��ب ا���=��ت ا������� ا�P� ، ���Z*0 ا��F��Y ز��م . 0ا ��اد ��1,� �/��ة �!��له� V�1 ���-� ه
�� ه0ا ا����ق، ا����� �� ا���ا�� [*0ة . ا����درة �� ا� � �� ا4�9�ام ا���را��� �� ��� ��ات ا������
��ات ا������ ا���!Z��� C ���5� ا������ �_��Z5 ل ا����! �� ا��/��� �� �1` �� ا�,_�ر �� ا���ق، ا�
����ا��اYS أن ا���اد ا� ��,� ا��E�-=?C ا����4��� �� �-���ت دون ا���را��� �_� [.�ر ���G�N . ا��
وأ*��ا، �cن . ا� !�ل ا����!C b�!'���� �Z 5#ال \�� وا��9 ا�F�GCر و��� ���_� �����Z واE�. أ*�ى
��ات ا������ ا��������� ��S �� �1��Zل ا���! �� ا�� ���0�5ب ا��#�� وا��#�� �� ا����_!
���، آbF .�5�را�TUرة أن ��8 ا�����Gت S� H��5 اCر�\ ������� ��N� �b!�4�� ��9�- ا����_!
ا�9=(ع ا��أي ا�0ى �d� b!�4� +eت ا����_!��� �� ا��'�ب اه����� آ���ا ��(�� �-���ت ا������
� ��ات ا������، و�N�1 آ���ة �! %�ل V!E ��!���ت �1ل ا����� �� �=* ��F5 �S ت ا����G�
. و ������� �!%���� دور�_+ �� ا�-%< وZ5��g�-� + [�� و�-�H9 �-�ع �F�ة ا����8,و*�?� ا���را���
140
ANNEXE I : Exemples d’extraits aux propriétés conservatrices présents sur le marché de la cosmétique.
ANNEXE II: Comparaison des ingrédients des cosmétiques classiques et bios
Extraits
Noms commerciaux
Actifs
Activité
Fournisseurs
Extrait de lichen (Barbe de Jupiter)
Lichen Herbsasol® Extract PG
Acides usnique et vulpinique
Antimicrobienne Cosmetochem International
Asparagopsisarmata (Algue rouge)
Ysaline® 100 INCI* : asparagopsisarmata
extract
Composés organiques halogénés
Antimicrobienne (C. albicans, E.
coli, P.
aeruginosa, V.
anguillarum, E.
gergiviae, S.
aureus)
Algues & Mer
Podocarpustotara(bois de coeur recyclé)
TotarolTM INCI podocarpustotara
woodextract
Totarol (diterpène aromatique C20H30O)
Antimicrobienne (S.aureus) Antioxydante
Essentially NZ
Citrus grandis (pamplemousse, extrait de pépins)
P50 VTF-0373 INCI : citrus grandis
seed
extract
Flavonoïdes polyphénoliques
Antimicrobienne Antifongique
Chemie Research &Manufacturing Vege Tech Bio-Botanica
Lonicerajaponica Extrait de chèvrefeuille du Japon (bourgeons)
PlantservativeWSr, WMr
INCI :LoniceraCaprifolium
extract,LoniceraJaponica
extract
Lonicérine (alcaloïde indolique) acide phydroxybenzoïque (parabène) naturel
Antimicrobienne Campo
Viola Tricolor –Extrait de pensées sauvage
INCI : viola
tricolorextract Flavonoïdes, saponines, acide salicylique, vitamine E
Antimicrobienne Alban Müller International
Pimpinellaanisum– Extrait d’anis
INCI : pimpinellaanisum
extract Acide p-anisique Antimicrobienne Active Concepts
LLC Alban Müller
142
ANNEXE III
Enquête sur les habitudes d’achat et la perception
des cosmétiques bio chez le consommateur.
DESCRIPTION
Dans le cadre de mon sujet de doctorat en pharmacie, je souhaite réaliser une enquête sur les habitudes d’achat et la perception des cosmétiques bio. Vous êtes toutes et tous invités à donner votre avis. Je vous remercie d’avance pour votre participation.
Vous
Vous êtes :
Une femme
Un homme
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
15 – 24ans
25 – 34 ans
35 – 44 ans
45 – 54 ans
55 et plus
Vos habitudes et préoccupations
Lieu d’achat des produits cosmétiques
Plusieurs réponses possibles.
Pharmacie
143
Parapharmacie
Grandes surfaces
Internet
Autres……………………………………………………………….
Vos critères de choix d 'un produit cosmétique
Plusieurs réponses possibles.
Prix
Ingrédients
Marque
Packaging
Respect de l’environnement
Selon vous, quel (s) ingrédient (s) pourrait être dangereux dans les cosmétiques, qu’il faut éviter?............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Vous et les cosmétiques bio
Achetez vous des cosmétiques bio ?
Une seule réponse possible
Oui
Non
Je compte en acheter
Quelles sont vos motivations à utiliser des cosmétiques bio ?
Plusieurs réponses possibles
Respect de l’environnement
C'est meilleur pour la santé
144
Ingrédients naturels
C’est plus efficace que les cosmétiques classiques
Quelles catégories de cosmétique bio utilisez-vous ?
Plusieurs réponses possibles.
Maquillage (mascara, fard à paupières/joues, vernis à ongles…)
Soins du visage (crème, sérum, contour des yeux, nettoyant, lotion, masque, gommage, baume à lèvres…)
Soins du corps (crème, lait, gommage, crème mains, huile de bain/massage…)
Soins spécifiques pour bébés et enfants (lait de toilette, crème pour le change…)
Hygiène (gel douche, savon, shampooing, dentifrice, déodorant, mousse à raser…)
Produits solaires (crème et lait solaire/après-solaire)
145
BIBLIOGRAPHIE
[1] :Guillet G,Cartier H ;Dermatologie: guide pratique, dermatologie générale, dermato-allergologie,angeologie,venereologie. Thoiry, France ; Ed. Heures de France ;1999 ;382p
[2] : Friedrich B ; Hygiène du nourrisson : Les produits cosmétiques d’hygiène et leur évolution depuis les cinquante dernières années ; Thèse de Doctorat en Pharmacie, Nancy ; Université Henri Poincaré ; 2008.
[3] :CEDEF – Collège des Enseignants en Dermatologie de France. Barrière cutanée. Cours de sémiologie.Mai2011.
[4] :Mélissopoulos A, Levacher C, Robert L, Ballotti R ; La peau : structure et physiologie ; 2ème édition. Paris, France ; Ed. Tec & Doc : Lavoisier ; 2012 ; 272 p.
[5] :MARIEB Elaine N ; Anatomie et physiologie humaines : Ch. 5 Le système tégumentaire ; 8ème édition ; Ed. du Renouveau pédagogique inc ; 2010 ; 172 p
[6] :Demarchez M ; La jonction dermo-épidermique ;Biologie de la peau / Biology of skin.
[7] :Martini M-C ; Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie ;Cachan, France ; Ed. Médicales internationales : Lavoisier ; 2011 ; 500 p.
[8] : Demarchez M ; Le système nerveux cutané ; Biologie de la peau. Mai 2011.
[9] :Comprendre la peau ?; Les grandes fonctions de la peau :structure des annexes cutanée ; Annales de dermatologie et de vénérologie ; 2005 ; 132 : 8S5-48.
[10] : Dréno B ; Anatomie, immunologie de la peau et de ses annexes ; Annales de dermatologie et de vénérologie ; 2008 ; 35 (53) ; 149-52
[11] : Evelyne C ; Progrès en dermato-allergologie ; Dijon ; 2002 ; 271 p
146
[12] :Comprendre la peau ?; Les grandes fonctions de la peau : Barrière cutanée - Absorption percutanée ;Annales de dermatologie et de vénérologie ; 2005 ; 132 : 8S49-68.
[13] : Robert P ; Dermopharmacologie clinique. ;Sainte-Hyacinthe : Edi serm ; 1985 ; 313 p.
[14] :Barbaras M ; Soins du visage et produits cosmétiques en officine ;Thèse de Doctorat en Pharmacie ,Nancy ; Université Henri Poincaré ; 1996.
[15]: Magnusson B-M et al : «Molecular size as the main determinant of solute
maximum flux across the skin» ; J Invest Dermatol ; 2004 ; 122 ; 993-999.
[16]: Hadgraft J, Valenta C: « pH, pK(a) and dermal delivery »; Int J Pharm; 2000 ;200;243-247
[17]: Charles C ; Création d’un site internet de conseils en dermocosmétologie du visage, chez l’adulte destiné aux pharmaciens d’officine ;Thèse de Doctorat en Pharmacie ,Grenoble ; Université Joseph Fourier ; 2012.
[18] : Martini M.C ; Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie ; 2éme édition. Cachan ; Ed. Médicales internationales ; 2011.
[19] :Martini M-C ; Excipients en cosmétologie ; Encyclopédie Médicale et chirurgicale: cosmétologie et dermatologie esthétique ; 2006.
[20] :Martini M-C; Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie ; 2003.
[21] :Zerrouk N, Arnaud P ; Composition des topiques ; Annales de dermatologie et de vénérologie ; Éd . Masson ;2009 ; 136 ; 5-7.
[22] :Audouard M, Aulois-griot.M ; Des produits cosmétiques aux produits frontières à la recherche d’un cadre juridique ; Bulletin De L’ordre 385 ; Décembre 2004.
[23]:Wolfgang S : «Comparison of microbial challenge testing methods for
cosmetics»;Today Household and Personal Care Today; March/April 2013; 8(2).
[24]:Russell A- D: «Challenge testing: principles and practice»; International Journal of Cosmetic Science; June 2003; 25; 147–153
147
[25] :Martini M-C ; Actifs et additifs en cosmétologie ;Paris ;Ed.Tec & Doc ; 2006 ;1051 p.
[26] :Martini M-C. Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie : Chapitre1,«Législation » ; paris, France: Éd. Médicales internationales : Lavoisier, 2011, 500
[27] :Vigan M ; Réglementation européenne des cosmétiques ;EMC- Dermatologie Cosmétologie ; 2004 ;154–163 .
[28] :Lacharme F ; Les produits cosmétiques biologiques : labels, composition et analyse critique de quelques formules ;Thèse pharmacie, Grenoble, France ; Université Joseph Fourier ; 2011.
[29]: Cashmana L ,Warshaw E M : «Parabens: A Review of Epidemiology,
Structure,Allergenicity, and Hormonal Properties » ; Dermatitis ; 2005; 16 ,57-66.
[30] : Sabalitschka T.« Application of ethyl p-hydroxybenzoate in maintenance
of sterility, in sterilization and in disinfection» ; Arch Pharm ; 1930; 268 ,653-73
[31]: Lindsey A-S., Jeskey H : «The Kolbe-Schmitt reaction» ; Chemical Reviews; 1957 ;57,583- 620.
[32] :Peterson G., Rasmussen D ., Gustavson K.:Study on enhancing the endocrine disrupter priority list with a focus on low production volume chemicals.; DHI Water and Environment; 2007 ; 252p
[33]:Soni M G. , Carabini G., Burdock G A .: «Safety assessment of esters of
p-hydroxybenzoic acid (parabens)»;. Food and Chemical Toxicology; 2005 ;43( 7), 985-1015.
[34]: Peng X et al.; «Discovery of a marine bacterium producing 4-
hydroxybenzoate and its alkyl esters, parabens». Appl Environ Microbiol; 2006; 72(8) ,5556-61.
[35]:Elder.RL : «Final report on the safety assessment of methylparaben,
ethylparaben,
propylparaben and butylparaben.» ; J. Am. Coll. Toxicol.; 1984; 3,147-209 .
148
[36]:Nguyen T, Clare B, Guo WB, Martina C: «The effects of parabens on
the mechanosensitive channels of E. coli» ; European Biophysics Journal ; 2005; 34 (5); 389-395
[37] Routledge E J ,Parker J, Odum J , Ashby J, Sumpter J P : «Some Alkyl
Hydroxy Benzoate Preservatives (Parabens) Are Estrogenic»; Toxicology and applied pharmacology; 1998; 153 ,12-19
[38]: Dal Pozzo A ,Pastori N : «Percutaneous absorption of parabens from
cosmetic Formulations» ; Int. J. Cosmetic Sci.; 1996 ; 18,57-66
[39]:Oishi.S : «Effects of butyl paraben on the male reproductive system in
mice» ; Arch Toxicol ; 2002; 76;423-429.
[40]: Rastogi S C et al : «Contents of methyl-, ethyl-, propyl-, butyl- and
benzylparaben in cosmetic products»; Contact Dermatitis ;2006; 32(1) ,28-30.
[41]:Tavares R S et al ; «Parabens in male infertility--Is there a mitochondrial connection?» ; Reproductive Toxicology; 2009 ; 27(1) , 1-7.
[42]:Cowan-Ellsberry.CE, Robison. SH :« Refining aggregate exposure:
example using parabens”; RegulToxicolPharmacol. ;2009; 55 ,321-329
[43] :Jones PS, Thigpen D, Morrison JL, Richardson AP : «p-
Hydroxybenzoic acid esters as preservatives. III. The physiological disposition
of p-hydroxybenzoic acid and its esters»; J Am Pharm AssocSci ;1956; 45 ,265-273.
[44]: Abbas S, Greige-Gerges H, Karam N, Piet M-H, Netter P, Magdalou J. «Metabolism of parabens (4-hydroxybenzoic acid esters) by hepatic esterases
and UDP-glucuronosyltransferases in man» ; Drug Metab. Pharmacokinet ; 2010;25(6) ,568-77.
[45]: Final amended report, 2008:«Final amended report on the safety
assessment of Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isopropylparaben,
Butylparaben, Isobutylparaben, and Benzylparaben as used in cosmetic
products; Int J Toxicol ;2008; 27 (4),1-82.
[46]:Phillips J.C et al : «the metabolism of ethyl and n- propyl-p-
hydroxybenzoate (“parabens”) in male cats» ; toxicology letters ;1978 ; 2,237-242
149
[47]:Routledge .E J , Parker. J, Odum .J , Ashby. J, Sumpter.J P: «Some
Alkyl Hydroxy Benzoate Preservatives (Parabens) Are Estrogenic»; Toxicology and applied pharmacology 1998 ; 153 ;12-19.
[48] El Hussein L.S,Muret .P, Berard. M, Makki .S, Humbert .P; «Assessment of principal parabens used in cosmetics after their passage through
human epidermis-dermis layers (ex-vivo study)» ;ExpDermatol ; 2007; 16, 830-836.
[49]:Pedersen. S et al; :«In vitro skin permeation and retention of parabens
from cosmetic formulations.» ;Int. J. Cosmet. Sci; 2007; 29 ,361–367.
[50] Nicoli.S et al : «Association of nicotinamide with parabens: effect on
solubility, partition and transdermal permeation.» ;Eur. J. Pharm. Biopharm. ; 2008; 69, 613–621.
[51]:Thiago.C : «Evaluation of the transdermal permeation of different paraben
combinations through a pig ear skin model» ; International journal of Pharmaceutics; 2010; 391( 1), 1-7.
[52]:Aubert .N,Ameller. T, Legrand .JJ: «Systemic exposure to parabens:
pharmacokinetics, tissue distribution, excretion balance, and plasma
metabolites of [14C]-methyl-, propylandbutylparaben in rats after oral, topical
or subcutaneous administration» ; Food ChemToxicol ; 2012, 50, 445–454.
[53]:Oh. S Y. et al. :«The effect of ethanol on the simultaneous transport and
metabolism of methyl phydroxybenzoate in excised skin of Yucatan micropig» ;Int J Pharm;2002; 236; 35–42
[54]:Caon .T, Costa. AC, De oliveira .MA, Micke. GA, Simoes. CM : «Evaluation of the transdermal permeation of different paraben combinations
through a pig ear skin model»; Int J Pharm.; 2010; 391,1-6.
[55]: Soni .M G et al : «Evaluation of the health aspects of methyl paraben: a
review of the published literature»; Food and Chemical Toxicology; 2002; 40 (10) ,1335-1373.
[56]: Seko .N ,Bando. H ,Lim. C W ,Yamashita. F, Hashida .M:« Theoretical
analysis of the effect of cutaneous metabolism on skin permeation of parabens
150
based on a two-layer skin diffusion/metabolism model»; Biol. Pharm. Bull; 1999; 22;281-287.
[57]:Wooi. C, Yamashita. F,.Takakura.Y .Hasida .M: «The effect of
cutaneous metabolism on skin permeation of drugs: analysis based on a
diffusion/metabolism model»;Drug Delivery System; 1998 ; 13 ,423-428.
[58]:Darbre . P D et Harvey .P W :«Paraben esters: review of recent studies
of endocrine toxicity, absorption, esterase and human exposure, and discussion
of potential human health risks» ;Journal of Applied Toxicology ;2008; 28 (5),561-578.
[59]:Janjua. N R,Mortensen .G K, Andersson .A M, Kongshoj.B, Wulf.H C:«Systemic Uptake of Diethyl Phthalate, Dibutyl Phthalate, and Butyl Paraben
Following Whole-Body Topical Application and Reproductive and Thyroid
Hormone Levels in Humans»;Environmental Science & Technology ;2007; 41 (15); 5564-5570.
[60]: Prusakiewicz .JJ, Ackermann .C, Voorman.R :« Comparison of skin
esterase activities from different species». Pharm Res. ; 2006 ; 23,1517-1524.
[61]: Harville.HM, Voorman. R,. Prusakiewicz JJ : « Comparison of paraben
stability in human and rat skin» ;Drug MetabLett ;2007; 1;17-21.
[62]:Tasukamoto .H and Terada.S : «Metabolism of drugs. XLVII. Metabolic
fate of phydroxybenzoic acid and its derivatives in rabbits.»; Chemical and Pharmaceutical Bulletin;
1964; 12, 765-769.
[63]:Darbre. P D et al : «Concentrations of parabens in human breast
tumours».Journal of applied toxicology, 2004; 24( 1), 5-13.
[64]:Routledge EJ, Parker J, Odum J, Ashby J, Sumpter JP :«Some alkyl
hydroxy benzoate preservatives (parabens) are estrogenic» ;ToxicolApplPharmacol ;1998; 153 , 12-19.
[65]:Blair . RM et al : «The estrogen receptor relative binding affinities of 188
natural and xenochemicals: structural diversity of ligands» ;ToxicolSci; 2000 ;54 ,138-153.
151
[66]:Darbre PD et al :«Œstrogenic activity of benzylparaben»; J ApplToxicol; 2003; 23, 43-51.
[67] :Pugazhendhi D, Sadler AJ, Darbre PD. «Comparison of the global gene
expression profiles produced by methylparaben, n-butylparaben and 17beta-
œstradiol in MCF7 human breast cancer cells» ;J ApplToxicol ;2007; 27, 67-77.
[68]:Van Meeuwen JA et al : «Aromatase inhibiting and combined estrogenic
effects of parabens and estrogenic effects of other additives in cosmetics» ;Toxicol Appl Pharmacol ;2008; 230 , 372-382.
[69]: Sadler. AJ, Pugazhendhi.D, Darbre .PD:«Use of global gene expression
patterns in mechanistic studies of œstrogen action in MCF7 human breast
cancer cells»; Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology ; 2009; 114 , 21-32.
[70]: Okubo T, Yokoyama Y, Kano K, Kano I : «ER-dependent estrogenic
activity of parabens assessed by proliferation of human breast cancer MCF-7
cells and expression of ER alpha and PR»; Food ChemToxicol ;2001 ;39 ,1225-1232.
[71]:Byford JR et al : «Œstrogenic activity of parabens in MCF7 human breast
cancer cells.» ; J Steroid BiochemMolBiol; 2002; 80, 49-60.
[72]:Terasaka S , Inoue A , Tanji M , Kiyama R. : «Expression profiling of
estrogen-responsive genes in breast cancer cells treated with alkylphenols,
chlorinated phenols, parabens, or bis- and benzoylphenols for evaluation of
estrogenic activity» ;ToxicolLett ;2006 ;163 ,130-141.
[73] Prusakiewicz JJ et al :« Parabens inhibit human skin estrogen
sulfotransferase activity: possible link to paraben estrogenic effects.»; Toxicology ;2007; 232 ,248-256.
[74]:Hossaini A , Larsen J J, Larsen .J C: «Lack of oestrogenic effects of
food preservatives (parabens) in uterotrophic assays»; Food and Chemical Toxicology; 2000; 38 (4) ,319-323.
[75]:Routledge E J ,Parker J, Odum J ,Ashby. J, Sumpter. J P :«Some alkyl
hydroxy benzoate preservatives (parabens) are estrogenic.» ;Toxicology and
applied pharmacology; 1998 ;153( 1), 12-19.
152
[76]:Darbre P D et al: «Oestrogenic activity of isobutylparaben in vitro and in
vivo »
;J. Appl. Toxicol ;2002; 22,219–226.
[77]:SatohK, Nonaka R, Ohyama K I , Nagai F :«Androgenic and
antiandrogenic effects of alkylphenols and parabens assessed using the reporter
gene assay with stably transfected CHO-K1 cells (AR-EcoScreen System)». Journal of health science; 2005; 51( 5), 557-568.
[78]: Chen J et al : «Antiandrogenic properties of parabens and other phenolic
containing small molecules in personal care products.» ;Toxicology and applied pharmacology ;2007; 221( 3); 278-284.
[79]:Kolsek K, Gobec M, Rascan I M , Dolenc M S: «Screening of bisphenol
A, triclosan and paraben analogues as modulators of the glucocorticoid and
androgen receptor activities» ;Toxicology in Vitro; 2015 ;29 (1) ,8-15.
[80]:Meeker J D, Yang T, Ye X, Calafat A M , Hauser R: «Urinary
Concentrations of Parabens and Serum Hormone Levels, Semen Quality
Parameters, and Sperm DNA Damage.»; Environ Health Perspect; 2010; 119(2).
[81]:Oishi S: «Lack of spermatotoxic effects of methyl and ethyl esters of p-
hydroxybenzoic acid in rats.»; Food and chemical toxicology; 2004; 42(11), 1845-1849.
[82]: Hoberman A M et al : «Lack of effect of butylparaben and
methylparaben on the reproductive system in male rats.». Developmental and Reproductive Toxicology; 2008; 83(2) ; 123-133.
[83]:Oishi S.: «Effects of butyl paraben on the male reproductive system in
mice»; Arch Toxicol ;2002 ;76 ,423-129.
[84]:Oishi S «Effects of propyl paraben on the male reproductive system» ;Food and Chemical Toxicology; 2002; 40( 12) ,1807-1813.
[85]:Oishi.S; «Effects of butylparaben on the male reproductive system in rats» ;ToxicolInd Health ;2000;17,31–39.
153
[86]:Barr L et al ;«Measurement of paraben concentrations in human breast
tissue at serial locations across the breast from axilla to sternum»; Journal of Applied Toxicology ;2012; 32( 3) , 219-232.
[87]:Harvey.PW, Everett .DJ. : «Parabens detection in different zones of the
human breast: consideration of source and implications of findings.»; J
ApplToxicol.; 2012;32(5) ,305-9.
. [88]:Nishizawa C et al :« Reaction of para-hydroxybenzoic acid esters with
singlet oxygen in the presence of glutathione produces glutathione conjugates of
hydroquinone, potent inducers of oxidative stress» ; Free radical research; 2006; 40 (3), 233-240.
[89]: Okamoto Y, Hayashi T, Matsunami S, Ueda K, Kojima N : «Combined
activation of methylparaben by light irradiation and esterase metabolism
toward oxidative DNA damage» Chem Res Toxicol;2008 ;21(8) ,1594-9.
[90]: Handa O et al :«Methylparaben potentiates UV-induced damage of skin
keratinocytes.» Toxicology; 2006; 227( 1), 62-72.
[91]: Ishiwatari S et al : «Effects of methyl paraben on skin keratinocytes.» ; Journal of Applied Toxicology; 2007 ;27 (1) , 1-9.
[92]: Kabara J.J , Orth D.S. : «Preservative-free and selfpreserving cosmetics
and drugs» ;Cosmet. Toiletries; 1998; 113; 51–58.
[93] :Varvaresou A, Papageorgiou S, Tsirivas E, Protopapa E, Kintziou H, Kefala V: «Self-preserving cosmetics» ; Int. J. Cosmetic Science ; 2009 ; 31; 163–175.
[94]:Lopez D: « Cosmetic product sterilization » ; 2007 ; WO 2007/148022 A2.
[95] :Kerdudo A ; Optimisation de la conservation des cosmétiques: impact de la formulation, recherche de nouveaux conservateurs naturels,encapsulation ;Thèse de Doctorat ,Nice ; 2014
[96]: Berthele H , Sella O, Lavarde M , Mielcarek C, Pense-Lheritier A-M ,Pirnay S : «Determination of the influence of factors (ethanol, pH and aw) on
the preservation of cosmetics using experimental design»; Int. J. Cosm. Sci.; 2014 ; 36 ; 54–61
154
[97] : Fernandez X, Chemat F. : Les huiles essentielles – Vertus etApplications ; Ed. Vuibert, 2012.
[98]:Papageorggiou S ,Varvaresou A , Tsirivas E, Demetzos C.:«New
alternatives to cosmetics preservation» ; Journal of Cosmetic Science ; March/April 2010 ; 61; 107–123.
[99] Pharmacopée européenne ;Recommandations relatives aux critères de qualité des huiles essentielles. ;Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé (Afssaps) ; Mai 2008.
[100] : Paris M , Hurabielle M ; Abrégé de matière médicale. ; Pharmacognosie, Tome I ;édition Masson ; 1981.
[101] :Bruneton J ; Pharmacognosie – Phytochimie - Plantes médicinales ; Ed. TEC&DOC ; Paris ; 2009.
[102] : Hulin V., Mathot A.G., Mafart P., Dufossé L. : «Les propriétés
antimicrobiennes des huiles essentielles et composés d’aromes» Sciences des aliments ; 1998 ; 18 ; 563-582.
[103]:Dorman H.J.D, Deans H.J.D. « Antimicrobial agents from plants:
antibacterial activity of plant volatile oils» ; Journal of Applied Microbiology. 2000 ;88 (2) ;308–316,
[104] :Degryse AC., Delpla A., Voinier MA. : Risques et bénéfices possibles des huiles essentielles ; Atelier sante et environnement IGS –EHESP 2008.
[105] : Fernandez X., Merck F., Kerdudo A. : Conservateurs pour cosmétiques –Antioxydants et anti-UV. Formulation ; Techniques de l’ingénieur, J2285, 2012.
[106]: Spigno G., Donsì F., Amendola D., Sessa M., Ferrari G., Marco De Faveri, D. : «Nanoencapsulation systems to improve solubility and antioxidant
efficiency of a grapemarc extract into hazelnut paste». Journal of Food Engineering ; 2013 ; 114 ; 297-214.
[108] : Girotti-Chanu, C. : Etude de la lipolyse et de la synthèse de composés du derme sous l’effet de la cirsimarine, flavone extraite de Microteadebilis ; Thèse ; Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 2006.
155
[109]:Davidson P.M., Taylor, T.M. : Chemocial preservatives and natural antimicrobial Compounds ; Food Microbiology; 3rd Edition, Ed. American Society for Microbiology ; 2007 ;713-745.
[110] :Bruneton, J. Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales ; Éd. Lavoisier, Paris, 2010.
[111] : Bruneton, J. Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales, Éd. Lavoisier, Paris,2010.
[112] : Papp I., Simándi B., Blazics B., Alberti Á., Héthelyi É., Svőke, Kéry Á.: «Monitoring volatile and non-volatile salicylates in Filipendulaulmariaby
different chromatographic techniques»; Chromatographia; 2008; 68; 125-129.
[113]: Olivero J., Gracia T., Payares P., Vivas R., Díaz D., Daza E., Geerlings P.: «Molecularstructure and gas chromatographic retention behavior
of the components of Ylang-Ylang oil». Journal of Pharmaceutical Sciences, 1997 ; 86(5); 625-630.
[114]:Stashenko E.E., Quiroz Prada N., Martínez J.R.: «Study of Colombian
Ylang-Ylang (Canangaodorata) oils obtained by different extractiontechniques». Journal of High Resolution Chromatography ;1996 ; 19; 353-358.
[115]: Steinberg, D.C.: Preservaties: a categorical examination ;Preservatives for Cosmetics;
Third Edition; Ed. Allured Books ; 2012 ; 21-132.
[116] : Bruneton, J. Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales ; Éd. Lavoisier, Paris, 2010 ; 901-903.
[117] : Bruneton, J. :Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales, Éd. Lavoisier, Paris ; 2010 ;700-701.
[118] :Morillon.F., Le livre vert de la Cosmétique Bio, le Courrier du Livre, Paris, 2008 :
Chapitre 2, 23-56.
[119] :Baures. C., Bedda. S., Garderes. E., et al., Les cosmétiques biologiques à la
156
loupe, Management des Industries de Santé, Groupe ESC Toulouse, 2009,53.
[120] :Règles de référence à la certification, Référentiel cosmétique écologique et biologique d'ECOCERT, 2011, 3.
[121] :Santonnat.B.,Cosmébio, 10 ans de confiance 2002-2012, Association Professionnelle de Cosmétique écologique et biologique, 2012.
.[122] :Cosmos, Le processus de certification selon le référentiel Cosmos,ECOCERT Greenlife SAS, 2012,1.
[123] :Demange E., Ghesquiere A., Achetons de la cosmétique bio, Minerva,
Genève,2007 : « Les marques », 65-104.
[124] .Stiens R, La vérité sur les cosmétiques naturels, Leduc.S, Paris, 2006 : Chapitre 1, « Pour le bien de la peau et des cheveux », 143-210.
157
Webographie
[W1] : Légifrance .Article L5131-1 du Code de la santé publique, Disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023385246&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111026 ,
[W2] :wikipedia.Affaire_du_talc_Morhange, Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_talc_Morhange
[W3] : Légifrance.Article L5111-1 du Code de la santé publique.Disponible sur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689867
[W5]: SCCS. 2011. The SCCS's Notes of Guidance for the testing of cosmetic ingredients and their safety evaluation 7th revision - adopted at its 9th plenary meeting of 14 December 2010 (SCCS/1416/11). Disponible sur :
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_s_004.pdf
[W5]: La structure de la peau et les cellules pigmentaires de l’épiderme . Disponible sur :
acces.ens-lyon.fr
[W6] : ANSM. (2010). Recommandations de bon usage des produits cosmétiques à l’attention des consommateurs.Disponible sur:
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/71d7cd061c2b47e0ab2 0a040b0435887.pdf
[W7] :L’Observatoire des cosmétiques. Cosmetics Europe. Disponible sur : http://www.observatoiredescosmetiques.com/news/lexiquecosmetique/cosmetics-europe-1010.html
[W8] : AFNOR.(2008). Les bonnes pratiques de fabrication en cosmetologie. disponible sur : www.afnor.fr
[W9] :Règlement cosmétique 1223/2009 .article8. Disponible sur :
158
:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:fr:PDF
[W10] :Macherey A-C, Diers B. Dossier SagaScience - Chimie et Beauté : innocuité des produits cosmétiques. disponible sur : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/cheveux/inno_prod_cos.html
[W11] :ANSM.(Janv 2014). Questions/Réponses�: réglementation produits des produits cosmétiques. Disponible sur:
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/72d7c7e851c27408536 138f9408de406.pdf
[W12] : EUR-Lex.2009.Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)..Disponible sur:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:FR:PDF
[W13] : AFSSAPS. Novembre 2010. Recommandations de bon usage des produits cosmétiques à l’attention des consommateurs. Disponible sur :
http://ansm.sante.fr/content/download/30135/397886/version/2/file/Reco-bonUsage-ProdCosmetique.pdf
[W14] :Fédération des entreprises de beauté .Qualité et sécurité des produits – Eléments sur la réglementation. Disponible sur
http://www.febea.fr/securite-du-consommateur/la-reglementation/
[W15] : Communication de la commission au parlement europeen et conseil concernant l’interdiction de l’expérimentation animale et l’interdiction de mise sur le marché dans le secteur des cosmétiques et faisant le point sur les méthodes de substitution à l’expérimentation animale le 11.3.2013 .disponible sur
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/animal_testing/com_at_2013_fr.pdf
[W16] : l’observatoire des cosmétiques.(dec 2009). REACH. Disponible sur :
159
http://www.observatoiredescosmetiques.com/pro/actualite/lexique-cosmetique/reach-298
[W17] :eur-lex.(2014). Agence européenne des produits chimiques. Cadre réglementaire de gestion des substances chimiques (REACH). Disponible sur :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al21282
[W18] : ANSES(2014 ).Règlement REACH : enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Disponible sur :
www.anses.fr/fr/content/règlement-reach-enregistrement-évaluation-et-autorisation-des-substances-chimiques [W19] :Circulaire du ministère de la santé (N° 48 DMP/20). Disponible sur : http://pharmacies.ma/PDF/circulaire48.pdf
[W20]: Directive 95/2/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ; JO n° L61 du 18 mars 1995:1-56. Disponible sur :
http://ec.europa.eu/ food/fs/sfp/addit_ flavor/flav11_fr.pdf
[W21]: Comité de la prévention et de la précaution. Les perturbateurs endocriniens: quels risques ; 2003.
[W22]:INSERM ; Reproduction et environnement (2011). chap 60 , Parabens :Etudes structure-fonction,études in silico parabens.Études . Disponible sur http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/222/Chapitre_60.html [W23] : Fiacre J.L., 2014. Reformulation cosmétique : bilan, Disponible sur http://www.cosmepar.fr/reformulation-cosmetique-bilan. [W24] : Structure chimique du Methylisothiazolinone. disponible sur :
https://en.wikipedia.org/wiki/Methylisothiazolinone
[W25] : SFD .Communiqué de presse Allergie de contact et conservateurs ; Paris, le 23 octobre 2014. disponible sur : http://www.sfdermato.org/
[W26] :European Commission - Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS),« Opinion on Methylisothiazolinone» (P94) 2013. disponible sur :
160
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/index_en.htm
[W27] :Structure chimique duPhenoxyethanol. disponible sur :
.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2-phenoxyethanol-Line-Structure.svg
[W28] :ANSM ; Evaluation du risque lié a l’utilisation du phénoxyéthanol dans les produits cosmetiques ; Mai 2012 ;41 .Disponible sur : www.ansm.sante.fr
[W29] :Monodoses stériles de démaquillant yeux Toleriane de Roche-Posay.Disponible sur : http://www.laroche-posay.fr
[W30] :Innovation packaging 100 % hermétique . Disponible sur :
www.laroche-posay.fr
[W31] :Cosmétique stérile. Disponible sur :
http://www.pierre-fabre.com/fr/cosmetique-sterile
[W32] :Promens répond aux attentes d’ultra-sécurité avec D.E.F.I. Disponible sur : www.premiumbeautynews.com
[W33] :Soin contour des yeux Dermatherm®. Disponible sur :
www.dermatherm
[W34] :Huiles essentielles Phytosun . disponible sur :
www.phytosunaroms.com
[W35] :Procédé d’obtention des huiles essentielles Pranarôm .disponible sur : www.pranarom.com
[W36] :Quel cahier de charges autorise quels conservateurs ? .disponible sur : www.laveritesurlescosmetiques.com
[W37] :Saule-blanc. Disponible sur :
161
http://www.guide-phytosante.org/anti-inflam-antalgiques/saule-blanc/saule-blancdescription-plante.html [W38] :Sorbus aucuparia L.Fraxinus excelsiorL. Disponible sur : http://www.bien-etrenaturel.info/plantes/index.html
[W39] :Solandra-grandiflora. Disponible sur : www.natrue.org
[W40] : Recommandation produits cosmétiques ARPP, déc. 09. Disponible sur :
www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Produits_Cosmetiques-2.
[W41] : Guide pratique des allégations environnementales à l’usage des professionnels et des consommateurs, 10.11.10 .disponible sur :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-pratique-des-allegations.html
[W42] :R. Stiens La Cosmétique bio c‘est quoi, au juste ? 50 questions et 50 réponses disponible sur : www.laveritesurlescosmetiques.com ·
[W43] :Nature et Progrès. Disponible sur : http://www.natureetprogres.org/ [W44] :Cosmebio, Les produits cosmétiques labélisés COSMEBIO, sans parabènes,Association Professionnelle de Cosmétique écologique et biologique, 2012. smétique écologique et biologique, 2012. Disponible sur : http://www.cosmebio.org/ [W45] :Cosmebio, Les mentions obligatoires devant figurer sur les produitscosmétiques naturels et biologiques, Association Professionnelle deCosmétique écologique et biologique, 2012. Disponible sur : http://www.cosmebio.org/ [W46] :Cosmebio, Les expérimentations animales sont-elles interdites ?, Association Professionnelle de Cosmétique écologique et biologique, 2012. Disponible sur : http://www.cosmebio.org/
162
[W47] :Cosmétiques Naturels Contrôlés, BDIH, disponible sur : http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/f/directive_cosmetiques_naturels.htm [W48] :Bioréflexe, disponible sur : http://www.bioreflexe.com/info_charte-bdih-certifications-et-labels-sante-biocosmetiques.Htm [W49]soil association, Disponible sur :
http://www.soilassociation.org/certification , [W50] :Ecogarantie, Disponible sur : http://ecogarantie.com/fr [W51] :naTrue, Disponible sur : http://www.natrue.org/fr/ ,.
[W52] :WELEDA, Disponible sur :
http://www.weleda.fr/le-laboratoire/histoire/depuis-1921 , [W53] :SANOFLORE . Disponible sur : http://www.sanoflore.fr/article/A-l-origine-des-hommes-et-unepassion/ a32.aspx,. [W54] :dr-Hauschka, Disponible sur :
http://www.ecocentric.fr/html/docteur-hauschka [W55] :Bio-beauté, Disponible sur : http://www.bio-beaute.fr/esprit-bio-beaute/le-pacte-bio-beaute.html [W56] :CAUDALIE, Nicolas César, « Cosmétiques : Caudalie va fructifier au
Brésil avec ses pépins de raisins » . Disponible sur : www. latribune.fr [W57] :KIBIO, Disponible sur : http://www.kibio.com/fr/marque/nos-convictions.php [W58] :CATTIER-PARIS. Disponible sur : http://www.cattier-paris.com/cattier/the-charter/le-label-cosmebio.htm
163
[W59] :AFSSAPS. Surveillance du marché : Produits cosmétiques ‘’sans conservateur’ ’labellisés ‘’BIO’’. 2009. Disponible sur : http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c0a74c52ab788bc 5ea5e3c59fc3ca3e2.pdf ,
Serment de Galien Je jure en présence des maîtres de cette faculté :
- D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon
art et de leur témoigner ma reconnaisse en restant fidèle à
leur renseignement.
- D’exercer ma profession avec conscience, dans l’intérêt de la
santé public, sans jamais oublier ma responsabilité et mes
devoirs envers le malade et sa dignité humain.
- D’être fidèle dans l’exercice de la pharmacie à la législation
en vigueur, aux règles de l’honneur, de la probité et du
désintéressement.
- De ne dévoiler à personne les secrets qui m’auraient été
confiés ou dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de
ma profession, de ne jamais consentir à utiliser mes
connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et
favoriser les actes criminels.
- Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses, que je sois méprisé de mes confrères si je manquais
à mes engagements.
Serment de Galien Je jure en présence des maîtres de cette faculté :
- D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon
art et de leur témoigner ma reconnaisse en restant fidèle à
leur renseignement.
- D’exercer ma profession avec conscience, dans l’intérêt de la
santé public, sans jamais oublier ma responsabilité et mes
devoirs envers le malade et sa dignité humain.
- D’être fidèle dans l’exercice de la pharmacie à la législation
en vigueur, aux règles de l’honneur, de la probité et du
désintéressement.
- De ne dévoiler à personne les secrets qui m’auraient été
confiés ou dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de
ma profession, de ne jamais consentir à utiliser mes
connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et
favoriser les actes criminels.
- Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses, que je sois méprisé de mes confrères si je manquais شهيد واهللا على ما أقول
Serment de Galien
Je jure en présence des maîtres de cette faculté :
- D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaisse en restant fidèle à leur renseignement.
- D’exercer ma profession avec conscience, dans l’intérêt de la santé public, sans jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humain.
- D’être fidèle dans l’exercice de la pharmacie à législation en vigueur aux règles de l’honneur, de la probité et du désintéressement.
- De ne pas dévoiler à personne les secrets qui m’auraient été confiés ou dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de ma profession, de ne jamais consentir à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels.
أن أراقب اهللا في مهنتي -
أن أبجل أساتذتي الذين تعلمت على أيديهم مبادئ مهنتي - .وأعترف لهم بالجميل وأبقى دوما وفيا لتعاليمهم
بوازع من ضميري لما فيه صالحالصحة أن أزاول مهنتي -العمومية، وأن ال أقصر أبدا في مسؤوليتي وواجباتي تجاه
.المريض وكرامته اإلنسانية
أن ألتزم أثناء ممارستي للصيدلة بالقوانين المعمول بها وبأدب - .السلوك والشرف، وكذا باالستقامة والترفع
قد أطلع عليها أن ال أفشي األسرار التي قد تعهد إلى أو التي -أثناء القيام بمهامي، وأن ال أوافق على استعمال معلوماتي
.إلفساد األخالق أو تشجيع األعمال اإلجرامية
من طرف ألحضى بتقدير الناس إن أنا تقيدت بعهودي، أو أحتقر -
.زمالئي إن أنا لم أف بالتزاماتي
واهللا على ما أقول شهيد
����� ��� ا����ط- ا���� ������ط وا������ ا��� آ���
126:أ%�و$� ر"! 2016:��ـ�
:في مستحضرات التجميل نالبارابي
.ضويةماهي البدائل، ما مكان مستحضرات التجميل الع
:أطروحة ����م����و���������..........................................� �
من طرف فاطمة الزهراء بلعوفي: نسة اآل
بالجديدة 1991ماي 23المزدادة في
������ـ�ـ�دة ا�ـ�آـ ـ�را ــ� ا��ـ�ـ�ـ� ات ا������ :األساسيةالكلمات ��� ات ا������، ا���ل ا���د ا����ء، ا�����، ���� �،���ا���را
�ا��� �.
�א��������� �:������א��א������א�� �
ر��� ����ة � لة ا���� .-, ا+*��ء ا�(����)�� ة &% أ#��ذ
��ف ���يا�آ��� ة ا����� ا������&% .-, ة أ#��ذ
� ةا�������� !" #$�!% 20 ا01/�ل&% ةأ#��ذ
�ا�(!در ������'&� ا���� �3��ا������ ا�.-, أ#��ذ &% ���
أ'+!ء