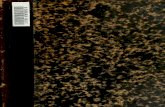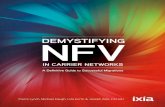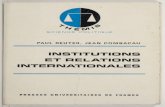In the wake: postcolonial migrations from the Horn of Africa
Introduction (Le Mexique dans les migrations internationales)
Transcript of Introduction (Le Mexique dans les migrations internationales)
"
Établissement public du Palais de la Porte DoréeCité nationale de l’histoire de l’immigrationAquarium - 293, avenue Daumesnil - 75012 Pariswww.hommes-et-migrations.frkarima.dekiouk@histoire-immigration.fr
Nom - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prénom - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Organisme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adresse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Code postal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ville - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pays - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Téléphone - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E-mail - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
m Je m’abonne pour un an (6 numéros) pour la première fois et bénéficie de l’abonnement découverte à 29 !(Offre réservée uniquement aux abonnés – particuliers et associations – résidants en France métropolitaine)
m Je me réabonne (abonné n° ……..…....…………..…....…… )Institutions, bibliothèques, entreprises : m France 58 !
m Étranger 77 !
Particuliers et associations : m France 49 !m Étranger 67 !
m Je commande le numéro 1296
m Je commande ……..... numéro(s)(Cochez les numéros commandés sur la liste au verso,10 ! sur place, 12 ! frais de port compris)
Pour l’étranger, compter 1,50 ! supplémentaire de frais de port par numéro
Montant de la commande ……..…....…..…....…… !
Je règle ce montant :m par chèque bancaire ci-joint à l’ordre de l’Agent comptable de la CNHI
m par versement sur notre compte à la Recette générale des Finances 75097 Paris cedex 02RIB n° 10071 75000 00001005018 61IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0501 861 - BIC : BDFEFRPPXXX
Important : Pour nos abonnés à l’étranger, nous ne pouvons accepter les chèques.
Si l’adresse de la facturation est différente de l’adresse ci-dessus, prière de nous l’indiquer
……..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....……
……..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....……
Date ……..…....…………..…....…… Signature
2012m n° 1296 Le Mexique dans les migrations
internationales 12 ! m n° 1295 Algérie - France,
une communauté de destin 12 !2011m n° 1294 L’intégration en débat 12 ! m n° 1293 L’immigration dans les musées :
une comparaison internationale 12 !m n° 1292 Les discriminations au féminin pluriel 12 !m n° 1291 Diasporas sri lankaises, entre guerre et paix 12 !m n° 1290 Travailleurs sociaux et migrations :
connaître pour mieux intervenir 12 !m n° 1289 Les frontières du sport. Diversité des contextes
depuis l’entre-deux-guerres 12 !2010m n° 1288 Langues et migrations 12 !m n° 1286-87 Les migrations subsahariennes 12 !m n° 1285 L’appel du pied 12 !m n° 1284 Migrations et environnement 12 !m n° 1283 Cuisines et dépendances 12 !
2009m n° 1282 Santé et droits des étrangers :
réalités et enjeux 12 !m n° 1281 France – Brésil, sous l’angle des migrations
et de l’altérité 12 !m n° 1280 Les Turcs en France : quels ancrages ? 12 !m n° 1279 L’Afrique en mouvement 12 !m n° 1278 Histoires des immigrations.
Panorama régional. Volume II 12 !m n° 1277 France – Allemagne : Politiques
d’immigration et identité nationale 12 !2008m n° 1276 Soldats de France 12 !m n° 1275 Minorités et migrations en Bulgarie.
H-D : L’interculturalité à l’Île de la Réunion 12 !m n° hors-série L’interculturalité en débat 12 !m n° 1274 L’espace caribéen : institutions
et migrations depuis le XVIIe siècle 12 !m n° 1273 Histoires des immigrations.
Panorama régional 12 !m n° 1272 Mondialisation et migrations internationales 12 !m n° 1271 La Convention sur les droits des travailleurs
migrants. Enjeux et perspectives 12 !2007m n° 1270 Migrations latino-américaines 12 !m n° 1268-69 Diasporas indiennes dans la ville 12 !m n° 1267 La cité nationale, une collection en devenir 12 !m n° hors-série La cité nationale, quels publics 12 !m n° 1266 Nouvelles figures de l’immigration
en France et en Méditerranée 12 !m n° 1265 Diaspora arménienne et territorialités 12 !2006m n° 1264 Logés à la même enseigne ? 12 !m n° 1263 Immigration et marché du travail 12 !m n° 1262 Le couple, attention fragile 12 !m n° 1261 Accueillir autrement 12 !m n° 1260 Bretagne, terre d’immigration en devenir 12 !m n° 1259 Laïcité : les 100 ans d’une idée neuve. 12 !
II. Culture(s), religion(s) et politique2005m n° 1258 Laïcité : les 100 ans d’une idée neuve. 12 !
I. À l’écolem n° 1257 Trajectoire d’un intellectuel engagé 12 !
Numéros disponibles Bon de commande à retourner à :
n° 12
96 -
mar
s-av
ril 2
012
Le Mexiquedans les migrations internationales
hommes & migrations n° 1296 I mars-avril 2012 Le Mexique dans les migrations internationales I hommes & migrations n° 1296
DossierLe Mexique dans les migrations internationalesUn dossier coordonné par Virginie Baby-Collin, maître de conférences, université d’Aix-Marseille, UMR Telemme, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) et Delphine Mercier, directrice du Centre d’études mexicaines et centraméricaines (Cemca), Mexico
n Introduction 6Par Virginie Baby-Collin et DelphineMercier
n La dynamique migratoire au MexiqueUn futur incertain 12Par Jorge DurandL’émigration mexicaine en direction des États-Unis pourrait bien être arrivée à saturation. Le Mexique en pleine explosion démographiqueconstituait pourtant une réserve de main-d’œuvrepour son puissant voisin du Nord. Désormais, la circulation migratoire entre le Mexique et les États-Unis se heurte à une frontière de moins en moins perméable. Depuis plusieursannées, la perception négative des migrantsmexicains sur le territoire américain se conjugue à une politique dissuasive censée répondre à la crise économique.
n Migration et développementDe l’ambivalence à la désillusion ? 22Par Silvia E. Giorguli Saucedo et Edith Y. GutiérrezDans un contexte d’incertitude économique et politique, la migration vers les États-Unis est de moins en moins envisagée par les Mexicainscomme une opportunité, phénomène qui se combine à un important flux de migrants deretour. Pour la première fois, le solde migratoireest proche de zéro. Ce nouveau scénario permet de réévaluer les modestes contributions de la migration internationale au développementlocal et de repenser l’impact de la migration, tout comme les défis que ces changementsimpliquent pour l’avenir.
n L’industrie de la migrationOrganiser la mobilité dans le système migratoireMexique-États-Unis 34Par Rubén Hernández-LeónEntre le Mexique et les États-Unis, le transportdes migrants est devenu une véritable industrie.Des compagnies d’autocars ayant pignon
n La nouvelle loi sur la migration au Mexique ou “Le bon, la brute et le truand” 64Par Primitivo Rodríguez OcegueraPays d’origine, de destination, de passage et deretour des migrants, le Mexique vient de se doteren 2011 d’une nouvelle loi sur la migration. Si lavolonté de mieux encadrer les flux de populationsen provenance ou à destination des États-Unispeut paraître louable en termes de défense des migrants, elle traduit surtout l’application d’unestratégie sécuritaire sous la houlette du voisinaméricain. Pour paraphraser le célèbre western de Sergio Leone : “Le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargéet ceux qui sont contrôlés… toi, tu es contrôlé”.
n Ethnicités transnationalesMigrations indigènes mexicainesvers les États-Unis 74Par Laura Velasco OrtizL’étude des migrations indigènes d’originemexicaine aux États-Unis questionne la notiond’identité définie à partir de la seule référence à l’État-nation d’origine. L’appartenance ethniqueexcède en effet l’appartenance nationale. Les Purépechas, les Nahuas ou les Mixtèques,par exemple, revendiquent une identité ethno-raciale spécifique qui leur permet de maintenir et d’affirmer une cohésion de groupe dans leur pays de destination. Une manièred’échapper aux assignations identitaires ou plutôt de se les réapproprier.
n Migration de retourUn regard quantitatif sur les enfants arrivant au Mexique en provenance des États-Unis 88Par Víctor ZúñigaLe flux migratoire de retour des États-Unis vers le Mexique est en pleine augmentation. Pour preuve, le nombre d’enfants et d’adolescents considérés comme des migrants de retour inscritsdans les écoles mexicaines. Ils sont actuellement
plus de 400 000 à être nés ou à avoir débuté leur scolarité sur le territoire américain. Bénéficiant de la double nationalité, américaine en vertu du droit du sol, et mexicaine en vertu de celui dusang, ces enfants sont confrontés à des choixidentitaires dans le pays d’origine de leurs parents.
n Migration et traditionLa fête patronale entrechangement et continuité 100Par Patricia AriasAu Mexique, dans les communautés rurales, les célébrations des fêtes patronales sont le point d’orgue du culte rendu aux saints. Organisées à l’échelle des villages dont elles mobilisent les populations, elles permettent de célébrer la permanence d’une identitécommune. La participation de chacun est requiseen fonction des responsabilités qu’il occupe dans la communauté. Non contents de faire des fêtes patronales l’occasion d’un retour, les Mexicains imposent aux migrants d’yparticiper financièrement. Une exigence qui ne vapas sans heurts lorsque se distendent les liensavec le village d’origine.
En couverture : montage réalisé à partir d’une photo de Irineo Mujica et Alberto Donis Rodriguez © D. R.
sur rue disputent ce juteux marché à de multiplesacteurs informels équipés de camionnettes qui sillonnent les régions frontalières. Suivant qu’ilsaient ou non des papiers, les migrants font appel à l’un ou l’autre de ces modes de transport.Monterrey, Houston, Tijuana ou San Diegoconstituent les plaques tournantes de ce commerce dont l’objet est de vendre auxmigrants les conditions de leur mobilité.
n Le coyotage et les barrièresimposées à la mobilité humainepar les États nationauxLe cas des Mexicains et Centraméricains migrant vers les États-Unis 46Par David SpenerAu Mexique et dans les pays centraméricains, les inégalités économiques poussent des milliersde personnes à abandonner leur pays d’origine pour chercher une place sur le marchéde l’emploi américain. N’ayant pour la plupartaucune chance d’entrer aux États-Unis par la voie légale, les migrants sont obligés de faireappel aux services de passeurs, les “coyotes”.Soumis à toutes formes de violence, de rançonnage voire d’exécution par les cartels de la drogue ou les passeurs eux-mêmes, les migrants sont victimes de l’incurie de l’Étatmexicain.
n Contrôle des frontièresQuestions de droits humains et d’éthique sur une stratégieétats-unienne 54 Par Nestor RodriguezLe renforcement de la frontière entre les États-Unis et le Mexique a un effet direct sur ceux qui tentent de la franchir. Face à un passagerendu de plus en plus difficile, les migrants n’ont d’autre choix que de traverser des zonesdangereuses. Pour contourner cette politique de dissuasion, ils risquent leur vie. La police des frontières américaine est en première ligne de ce dispositif. Derrière,c’est toute une bureaucratie qui semble rester sourde aux conséquences tragiques de sa politique migratoire.
Chroniques
Repérage I 112Mexicaines aux États-Unis, Espagnoles en France (1950-1970),par Blanca Cecilia Ceceña Camacho
Frontières territoriales et frontièressymboliques. L’immigration auprisme de l’action publique françaiseet italienne, par Annalisa Lendaro
Débats I 126Islam, laïcité et commensalité dans les cantines scolaires publiques. Ou comment continuer à manger ensemble “à la table de la République” ? Par Stéphane Papi
Kiosque I 136Revue de presse. De la nécessité de lire Pascal au mois de janvierpar Mustapha Harzoune
Musiques I 142Emel Mathlouthi, par François Bensignor
Cinéma I 148Par André Videau
Livres I 150Par Mustapha Harzoune, Monique Ayoun et Eugénie Barbezat
“En regardant de l’autre côté” © Alfonso Caraveo
6 Dossier I Le Mexique dans les migrations internationales I
Ce dossier présente un corpus original de travaux menés par des chercheurs, principa -lement mexicains, portant sur les enjeux et les évolutions contemporaines desmigrations internationales au Mexique et, pour la plupart, jamais encore traduits enlangue française.L’emblématique couple migratoire Mexique/États-Unis traverse l’une des frontièresles plus convoitées et les plus sécurisées du monde contemporain. Plus de 10 % de lapopulation mexicaine vit aux États-Unis (soit 17 % de la population active états-unienne) où elle représente le premier groupe étranger(1). Au Mexique, le phénomène est inversé : à peine 1 % de la population(2) est né à l’exté -rieur, dont les trois quarts aux États-Unis (majoritairement d’origine mexi caine), et unpetit quart en Amérique centrale. L’accroissement récent de la population étrangère est l’une des composantes desévolutions du panorama du Mexique dans la migration internationale : pays de départavant tout, c’est aussi un pays de retour, de transit et d’immigration.La migration mexicaine aux États-Unis a connu depuis le milieu des années quatre-vingt plusieurs transformations majeures. La réforme migratoire états-unienne de 1986(Irca) a permis la régularisation du séjour de 3,2 millions de migrants irréguliers, enmajorité mexicains, et a parallèlement amorcé une politique de durcissement descontrôles et de fermeture de la frontière. Ce processus s’est renforcé durant les annéesquatre-vingt-dix, et s’est accéléré après les événements du 11 septembre 2001 impli -quant des conséquences sécuritaires. Ces évolutions ont contribué à la transformationdes formes de la migration. Ces migrations, qui étaient circulaires (continuels allers-retours entre destination et origine), sont devenues sédentaires, tout d’abord parce queles régularisations ont favorisé les mesures de regroupement familial, et ensuite parceque le durcissement des conditions de passage de la frontière a notablement ralenti lescirculations au profit d’un allongement des séjours. Les flux de migrants ont néanmoins énormément augmenté depuis les années quatre-vingt-dix. En effet, deux phénomènes concomitants expliquent cette croissance : toutd’abord, l’émigration s’est généralisée à l’ensemble des régions du Mexique, au-delà
IntroductionPar Virginie Baby-Collin, maître de conférences, université d’Aix-Marseille, UMR
Telemme, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH)et Delphine Mercier, directrice du Centre d’études mexicaines et centraméricaines
(Cemca), Mexico
I hommes & migrations n° 1296 7
des espaces traditionnels d’émigration du centre-ouest du pays et, ensuite, lesdestinations des migrants se sont démultipliées en couvrant l’ensemble des États-Unis et non plus seulement les régions longtemps privilégiées du Sud-Ouest, del’Illinois et de la Floride.La croissance considérable des remises financières envoyées par les migrants afavorisé une réflexion sur le lien entre la migration et le développement, a impulsédes politiques d’encadrement et d’incitation à la productivité des remises et suscitédes débats sur le rôle des individus migrants dans le développement de leurs régionsd’origine.
De nouvelles formes de migration en temps de crise économique
Depuis quelques années pourtant, et notamment depuis la crise de 2007, le soldemigratoire à la frontière n’a cessé de diminuer jusqu’à devenir nul en 2012, faithistoriquement nouveau qui atteste d’un nombre important de retours ainsi que d’unralentissement des flux d’entrées dans l’autre sens. Ce fait nouveau renvoie aux difficultés croissantes du passage d’une frontière à la foisde plus en plus sécurisée et de plus en plus dangereuse, de par les risques encourus parles passeurs et leurs clients, et la croissance des groupes mafieux contrôlant les routesde la migration. Mais c’est également lié à la baisse relative de la relation coût/bénéficede la migration mexicaine aux États-Unis où la crise économique a tendu les marchésde l’emploi, où la crise immobilière a particulièrement affecté les populations ensituation de vulnérabilité, et où les législations anti-immigration ont renforcé unclimat d’insécurité croissant pour les sans-papiers. Ces changements traversent tous les articles du dossier lesquels, depuis des perspectivesdisciplinaires complémentaires (géographie, sociologie, anthropologie, sciences politi ques),en explorent chacun un volet spécifique. Les trois premiers textes soulèvent des discussions théoriques fondamentales dansl’analyse des migrations. L’article de Jorge Durand, à la dimension englobante, ouvrele dossier en s’interrogeant sur le futur de la dynamique migratoire. Il met en relationles évolutions des contextes politiques, économiques et sociaux états-unien etmexicain, pour évaluer le poids des composantes structurelles et conjoncturelles dansla récente “baisse imprévue” des flux et son devenir, et discute la relation coût/bénéficedu point de vue du migrant. La baisse des remises depuis la crise états-unienne, leursfluctuations conjoncturelles en général, mais aussi la vulnérabilité des foyersmexicains dont les revenus en dépendent, font douter d’un financement solide dudéveloppement par le biais des transferts.
8 Dossier I Le Mexique dans les migrations internationales I
C’est ce que soutiennent Silvia Giorguli et Édith Gutiérrez qui discutent à la lumièrede ces changements la relation entre migration et développement, remettant enquestion la vision des migrants comme acteurs du développement local. La prise deconscience du coût représenté par la perte d’actifs qu’impliquent les départs initieune incitation gouvernementale au retour, mais aussi à la non-migration, ce qui exigedes politiques mexicaines engagées dans le soutien à la formation et l’emploi. En effet, comme le montre Rubén Hernández-León, la migration développe sa propreindustrie, regroupant entrepreneurs, entreprises, services qui facilitent les mobilitésinternationales, l’installation, la circulation des migrants, de leurs proches, de leursbiens et des transferts. Outre des acteurs, cette industrie comprend des organisations,des infrastructures, légales et illégales, participant de la cocréation de la migration.Cette proposition théorique est étayée à partir de l’exemple de l’industrie du transportdes migrants, selon une perspective historique et géographiquement multisituée,mettant en évidence comment économie souterraine et formelle, acteurs individuelscomme grandes entreprises de transport, participent de la constitution de nœuds derelations et de la structuration des systèmes migratoires.
Durcissement de la frontière et stratégies de contournement
Les trois textes suivants interrogent les acteurs informels et étatiques de la migration.David Spener s’est penché sur les pratiques de “coyotage” ou de passage clandestinde la frontière, l’épreuve de la présence récente des cartels de la drogue sur les routesde la traversée des Centraméricains et des Mexicains qui sont devenues de plus enplus dangereuses depuis le milieu des années deux mille. À travers l’hypothèse de lacollusion des mafias et des fonctionnaires, il confirme l’importance de cette économiede la migration et la nécessité d’une réflexion sur la responsabilité des États mexicainet états-unien dans la dégradation des situations. C’est la responsabilité éthique et morale de la bureaucratie des services de contrôlede la frontière aux États-Unis que discute ensuite Nestor Rodríguez, questionnant lescauses des nombreux décès de migrants sans papiers dans leurs tentatives de passage,et dont le nombre a considérablement augmenté depuis la mise en place d’opérationsde surveillance accrue au milieu des années quatre-vingt-dix, atteignant près de 500morts en 2005. Mais c’est l’État mexicain qu’interroge Primitivo Rodríguez Oceguera en analysantles différentes composantes de la nouvelle loi migratoire mexicaine de 2011. Au-delàd’un exposé de motifs pavé de bonnes intentions, la loi propose une politique répressivequi s’inscrit dans la continuité de la politique états-unienne, mêlant migration etsécurité nationale, contribuant à une instrumentalisation politique du Mexique par les
I hommes & migrations n° 1296 9
États-Unis et ne permet tant pas d’affronter sérieusement les enjeux du lienmigration/développement, ni de la sécurisation des migrants centraméricains de plusen plus nombreux à transiter par “l’enfer mexicain”.Les trois derniers textes replacent en pre mière ligne les acteurs migrants, interrogeantl’évolution de certaines pratiques et normes sociales. Laura Velasco Ortiz montre com mentla migration de groupes indigènes a favorisé une nécessaire sortie du prisme dominantdu nationalisme méthodologique dans lequel une vision uniformisatrice de la sociétémexicaine les avait cantonnés. La migration a permis une ré-ethnicisation différenciéedes groupes, au service d’une politisation transnationale instrumentale pour certains,plus normative et ancrée dans des pratiques familiales ou communau taires pourd’autres. Victor Zúñiga, à partir des résultats d’une enquête réalisée dans des écoles publiquesde quatre États mexicains, met en lumière la situation nouvelle des enfantsbinationaux, souvent nés aux États-Unis et de retour au Mexique en nombre croissant.Il questionne la complexe redéfinition de leurs identités, différenciées selon le sexemais aussi selon leur dimension ethnique. Le texte de Patricia Arias révèle enfin les changements induits par les évolutionsrécentes de la migration dans les pratiques festives des communautés rurales et enparticulier les fêtes patronales. D’un côté, dans les régions traditionnelles de lamigration ancrées dans des pratiques catholiques, aux fêtes des absents succèdent lesexportations des icônes et des pratiques aux États-Unis, tandis que le développementcommercial d’un tourisme des festivités dans les lieux d’origine ne semble pas du goûtde tous. De l’autre, dans les régions indigènes inscrites dans des systèmes communau -taires fortement structurés, traversés par des tensions très fortes à l’heure où les migrantsrésistent à accomplir leurs traditionnelles obligations de charges, surgissent des conflitsde pouvoir entre migrants et non-migrants, mais aussi entre générations, qui révèlentles fragilités économiques d’un monde rural mexicain en transformation.
Le prisme mexicain dans les migrations internationales
Ces perspectives mexicaines sont complétées par quelques textes hors dossier quipermettent un croisement des regards. Sous un angle historique (seconde moitié duXXe siècle) et comparatif, Blanca Ceceña observe les modalités de l’insertion fémininedans la domesticité, des Mexicaines de Los Angeles et des Espagnoles de Paris,éclairant des modèles économiques et politiques distincts. Annalisa Lendaro analyse, à partir d’une comparaison des politiques publiquesfrançaise et italienne d’aujourd’hui, la façon dont la catégorie d’“immigré” estconstruite et utilisée par l’action publique. Son approche est menée à partir d’une
10 Dossier I Le Mexique dans les migrations internationales I
entrée territoriale (comparaison de deux régions) et sectorielle (dans le secteur dubâtiment et la domesticité). Elle met ainsi en lumière la façon dont se définissent, auniveau institutionnel, organisationnel et des pratiques, des modèles d’insertiondifférenciés.Ces quelques textes issus du cas mexicain rappellent que les enjeux soulevés par ledossier dépassent largement le cadre qui les concerne. C’était l’objet même ducolloque à l’origine de cette publication, organisé à Marseille(3) en octobre 2011, dontle pari était de mettre en perspective les migrations internationales observées à partirdu prisme mexicain et comparées avec celles des rives de la Méditerranée. Marseille,ville construite sur l’histoire de nombreuses migrations était le lieu emblématiquepour organiser cet événement conçu dans le cadre de l’année du Mexique en Franceet maintenu grâce au soutien de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette perspective de dialogue entre l’Amérique latine et la Méditerranée avait étéinitiée dès 2005 lors d’un accord de coopération développé entre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’État du Nuevo León au Mexique. Cet échange que nous avonsappelé “Sud à Sud” a depuis été particulièrement fécond d’un point de vue scientifique,d’une part, permettant une nouvelle lecture des migrations interna tionales, et d’unpoint de vue institutionnel, d’autre part, favorisant de nombreuses circulations d’étu -diants, de chercheurs, de connaissances porteuses d’éclairages Sud-Sud novateurs.Le défi va au-delà du terrain scientifique, car l’étude des migrations soulève des enjeuxpolitiques, sociaux, économiques et culturels fondamentaux du monde contemporain.La circulation accrue des personnes renvoie tant aux formes complexes de globalisationdes mondes du travail, aux profondes inégalités de développement au sein desquelsces mouvements s’inscrivent, qu’aux formes de transnationalisation des familles, desliens, des cultures, que les flux génèrent. Les cosmopolitismes se renouvellent, lescultures transnationales se consolident, en même temps que les enjeux identitaires etsécuritaires se font politiquement plus violents, souvent au mépris des droits del’homme, comme en témoignent les fermetures de frontières, les murs et les restrictionsdes circulations de personnes. La recherche sur les migrations est aussi une dénon -ciation de l’injustice de ces milliers de morts survenues dans la traversée de laMéditerranée comme dans celle du Rio Bravo. n
1. Plus de 11,7 millions de Mexicains nés au Mexique vivent aux États-Unis, soit plus de 30 % de la population états-unienne née à l’étranger.2. Soit près d’un million de personnes.3. Colloque international : “Le Mexique dans les migrations internationales, mises en perspective méditerranéennes”,17-19 octobre 2011, organisé par le Centre d’études mexicaines et centraméricaines – MAEE/CNRS, le LEST, l’IRD, Telemme, Mimed, la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, l’université de Provence et la régionProvence-Alpes-Côte d’Azur, avec le concours de l’ANR.
Notes