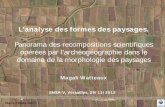Les stéréotypes dans la construction des identités nationales ...
"Placer l'autel dans la ville: intégration des cultes impériaux et construction civique en Gaule",...
-
Upload
univ-brest -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of "Placer l'autel dans la ville: intégration des cultes impériaux et construction civique en Gaule",...
CAESARODUNUMXLVII - XLVIII
P R É S E N C E D E S D I V I N I T É S E T D E S C U LT E S
dans les villes et les agglomérations secondaires de la Gaule romaine et des régions voisines
Textes réunis par Robert Bedon et Hélène Mavéraud-Tardiveau
Université de LimogesCentre de Recherches
André Piganiol
Équipe EHIC
2013 - 2014
Ce livre prend place dans la lignée des précédents ouvrages de la série Caesarodunum, laquelle se donne pour objectif, de volume en volume, d’examiner et de chercher à mieux comprendre différents aspects de la civilisation gallo-romaine.
Il fait suite au colloque tenu à Limoges en 2014, et qui avait réuni des communications portant sur les créations matérielles qui correspondent à la religion ayant existé dans la Gaule romaine et dans les régions voisines antérieurement au christianisme, telles que nous nous efforçons de les connaître et de les interpréter, essentiellement à partir des vestiges remis au jour par l’archéologie ainsi que par l’étude de l’épigraphie.
Les vingt-trois contributions rassemblées dans ses pages se trouvent consacrées pour les unes à des représentations figurées de divinités, pour d’autres à l’architecture et à l’organisation de sanctuaires, pour d’autres encore à l’insertion des structures cultuelles dans les agglomérations, et pour un dernier groupe à la présence de ces créations matérielles dans les cités et dans les provinces.
Il se constitue de la sorte un tableau d’ensemble, fondé sur des exemples illustrant un nombre significatif des réalisations matérielles issues des demandes et des offres créées par cette religion, et qui tiennent une grande place parmi les vestiges qui nous en ont été transmis.
Comme on pouvait s’y attendre, il se confirme que ces réalisations contribuaient fortement au cadre iconographique, ornemental, architectural et urbanistique dans lequel se déroulaient la vie quotidienne des habitants ainsi que les cérémonies et les fêtes religieuses qui les réunissaient.
PR
ÉSE
NC
E D
ES
DIV
INIT
ÉS
ET
DE
S C
ULT
ES
dans
les v
illes
et l
es a
gglo
mér
atio
ns se
cond
aire
s de
la G
aule
rom
aine
et d
es ré
gion
s voi
sines
CA
ESA
RO
DU
NU
M X
LVII
- X
LVII
I
ISBN : 978-284-287-687-6
30 €
présence des divinités et des cultes couverture.indd 1 23/05/2016 15:06
Caesarodunum, XLVII-XLVIII, 2013-2014, p. 289-314.
Placer l’autel dans la ville : intégration des cultes impériaux et
construction civique en Gaule Marin MAUGER
Université de Bretagne Occidentale EA 4451 - CRBC Résumé : La consécration d’un autel aux cultes impériaux est un acte complexe entre prescription rituelle, affirmation d’une allégeance à Rome et autoreprésentation du dédicant. L’étude de l’emplacement des différents monuments permet de mettre en avant ces stratégies dédicatoires et d’analyser chaque échelle de célébration du culte. Cependant, réfléchir à la place prise par l’autel à la période julio-claudienne revient finalement à étudier l’apparition et l’intégration des cultes liés à l’empereur dans les cités de Gaule. Ainsi, plus qu’une enquête sur la visibilité de l’autel, l’objectif principal de cette tentative de remise en contexte est un questionnement sur le caractère structurant des cultes impériaux dans l’organisation urbaine des cités au début de l’Empire. Abstract : The consecration of an altar to the imperial cult is a complex act between the ritual prescription, the affirmation of allegiance to Rome and the self-representation of the dedicant. The study of the location of some different monuments allows us to highlight these dedicatory strategies and analyze each stage of the worship celebration. However, thinking about the role played by the altar during the Julio-Claudian period actually means studying the emergence and the integration of the cults associated with the emperor in the cities of Gaul. Thus, more than an investigation on the visibility of the altar, the main objective of this suggested recontextualization is a reflection on the structuring nature of the imperial cult in the urban organization of the cities at the beginning of the Empire.
__________
Marin MAUGER
290
En 12 av. J.-C., les soixante peuples de Gaule vouent un autel à Rome et Auguste au sanctuaire provincial du Confluent1. Cette consécration marque l’apparition d’une forme du culte impérial dans les provinces gauloises. L’autel nouvellement dédié symbolise alors le consensus des cités de Gaule à l’égard de l’hégémonie de Rome et de l’empereur. Plus généralement, la dédicace d’un autel, qu’elle soit réalisée à l’échelle d’une province ou d’une cité, relève d’une véritable réflexion des dédicants sur le respect des rites, les attentes de la communauté, l’affirmation d’une allégeance à Rome et leur auto-représentation. Cette stratégie dédicatoire préside non seulement à la définition du culte, mais aussi à celle de la nature du monument et de sa place dans la cité. Le décret de Pise concernant les honneurs funèbres dédiés à Lucius César2 met en lumière le protocole déve-loppé par les autorités publiques pour la consécration de l’autel. L’examen préliminaire de plusieurs emplacements pour l’édification du monument3 prouve l’importance, pour la communauté pisane, de l’espace cultuel circonscrit.
Où était placé l’autel dans la ville ? Qui pouvait le voir ? La mise
en scène des célébrations pousse à définir l’autel comme le support principal des cérémonies, faisant le lien entre les dieux et les hom-mes. Il est alors nécessaire de déterminer le cadre de cette repré-sentation pour entrevoir les enjeux du culte. Notre réflexion ne se limite pas au problème de la visibilité de l’autel dans la ville. L’objectif principal de cette remise en contexte des autels est d’approcher le caractère structurant du culte impérial à la période julio-claudienne dans l’organisation urbaine des cités. Ainsi, nous bornerons notre propos à l’échelle municipale et au culte civique.
La tentative de restitution que nous allons présenter se trouve
cependant limitée par l’indigence du corpus à notre disposition. En effet, moins de vingt autels municipaux consacrés à une forme du culte impérial sont connus pour les Trois Gaules et la Narbonnaise à la période julio-claudienne. Nous devons également déplorer une absence quasi-totale de contexte pour ces monuments, généralement 1 TITE-LIVE, Periochae, 139 ; SUÉTONE, Vie de Claude, 2, 1 ; JUVENAL, 1, 44 ; DION CASSIUS, 54, 32, 1 ; STRABON, Géographie, IV, 3, 2. 2 C.I.L., XI, 1420 = AE. 2010, 37. 3 Ibidem l.14-15 : La lacune du texte empêche de définir précisément les lieux proposés par les autorités civiques.
LA PLACE DE L’AUTEL EN GAULE
291
retrouvés en remploi. Ce manque crucial de données archéologiques impose une étude préliminaire de ces monuments, prenant en compte les destinataires du culte, les dédicants, la forme et la taille de l’autel, afin de proposer une hypothèse sur leur lieu d’exposition. La consécration d’un autel à l’empereur est un acte fédérateur qui joue un rôle important dans le consensus municipal en affirmant par le sacrifice la constitution d’une unité civique et l’approbation du pouvoir impérial. Quel emplacement paraît mieux adapté que le forum, à la fois centre public et religieux, pour accueillir les premières célébrations en l’honneur de l’empereur et de l’autonomie municipale? I. L’autel au cœur de la ville : les cultes impériaux sur le forum
Rechercher l’autel consacré à l’empereur sur le forum des cités
de Gaule ne constitue pas en soi une nouveauté. W. Van Andringa a, pour les Trois Gaules, démontré la valeur structurante des autels dédiés à l’empereur sur la place publique de cités en pleine consti-tution civique et urbanistique4. Pour la Narbonnaise, les études menées par P. Gros sur l’urbanisme de certaines colonies ont montré que le développement du culte impérial débutait par l’instauration d’autels voués au culte dynastique, et plus particulièrement au culte funéraire rendu aux Caesares5. L’étude de ces monuments consacrés aux deux princes défunts lui permet d’ailleurs d’affirmer que le « culte fut d’abord ‘dynastique’ avant de devenir ‘impérial’ »6. En effet, 4 W. VAN ANDRINGA, La religion en Gaule romaine, Paris, 2002, p. 45-57. 5 P. GROS, « l’Augusteum de Nîmes », RAN, 17, 1984, p. 123-134 ; «Un programme augustéen : le centre monumental de la colonie d'Arles », Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, 102, 1987, p. 339-363 ; « Les étapes de l’aménagement monumental du forum : observations comparatives (Italie, Gaule, Narbonnaise, Tarra-connaise) », dans La città nell’Italia settentrionale in età romana. Morfologie, strutture, funzionamento dei centri urbani delle regiones X e XI. Actes du colloque de Trieste, 13-15 mars 1987, Rome, 1990, p. 29-68. ; « Les autels des Caesares et leur signification dans l’espace urbain des villes julio-claudiennes », dans R. ETIENNE, M.-T. LE DINAHET, L'espace sacrificiel dans les civilisations méditerranéennes de l'Antiquité, Paris, 1991, p.179-186 ; « Nouveaux paysages urbains et cultes dynastiques : remar-ques sur l’idéologie de la ville augustéenne à partir des centres monumentaux d’Athè-nes, Thasos, Arles et Nîmes », dans Chr. GOUDINEAU, les villes augustéennes en Gaule. Acte du colloque d’Autun (juin 1985), Autun, 1991, p. 127-140. 6 P. GROS, « Les autels des Caesares et leur signification dans l’espace urbain des villes julio-claudiennes », 1988, p. 179.
Marin MAUGER
292
Auguste a, de son vivant, connu de nombreux deuils parmi ses héritiers et de ce fait la célébration de ces princes a précédé par simple fait chronologique, l'instauration de la célébration, posthume elle aussi, du premier empereur. Ainsi, à partir de la période augus-téenne, le forum est pensé comme le lieu privilégié de l’idéologie dynastique. Néanmoins, est-il assurément l’espace dévolu au culte dynastique ? Le culte dynastique sur la place publique : des Mânes dans la ville?
A Glanum, la découverte d’une plate-forme sur laquelle deux
autels flanquent une base de colonne a été interprétée par B. Frischer comme un ensemble cultuel voué aux Caesares et à Auguste7. L’emplacement stratégique de la structure à la charnière du bloc-forum et des temples géminés en fait un lieu central de la ville. Le parallèle avec le monument de Thasos ou d’Athènes retrouvé sur l’agora, consacré à Auguste et aux princes héritiers, renforce l’attribution hypothétique des autels de Glanum8. De plus, cet ensemble se situe à proximité du temple de Valetudo, dédié par Agrippa, le père naturel des princes. Enfin, la découverte d’un togatus acéphale portant la bulla9 et souvent identifié à Caius ou Lucius César renforcerait l’attribution du monument à un ensemble dynastique voué à des membres de la gens Augusta. La plate-forme placée à la confluence des deux voies principales de la ville et axée sur le forum et les temples géminés est un élément central pour l’organisation urbanistique. L’attribution, si elle est exacte, du complexe cultuel aux Caesares confirmerait la valeur structurante du culte dynastique pour la cité. Néanmoins deux questions doivent être posées : d’une part, existe-t-il un lien entre ces deux autels et les temples géminés ? Il est en effet permis de penser que les deux autels sont en relation directe avec les temples situés à l’angle sud du forum. La gémellité des autels répondrait à celle des temples. La position centrale de la plate-forme à la charnière entre le forum et les temples constituerait une 7 B. FRISCHER, « Monumenta et Arae Honoris Virtutisque causa : Evidence of Memo-rials for Roman Civic Heroes », BCAR, 88, 1982-3, p. 71, fig. 63-2. 8 Guide de Thasos, E.F.A., Paris, 1967, p. 31 ; I.G. II², 3250. 9 E. ROSSO, L’image de l’empereur en Gaule romaine : portraits et inscriptions, Paris, 2006, p.136 et n°141 p. 374-375.
LA PLACE DE L’AUTEL EN GAULE
293
solution des architectes pour faire face à l’exiguïté topographique de la ville. Le forum deviendrait alors le lieu de réunion lors des sacrifices, ce qui expliquerait l’orientation du monument vers la place publique10. La datation précoce des deux temples, l’un vers 30, l’autre vers 27 av. J.-C., interdirait l’attribution des deux autels au culte des Caesares, si les monuments s’avéraient être liés11. Cependant, aucune chronologie relative n’est possible dans l’état actuel de la documentation, ce qui empêche de confirmer ou d’infirmer le lien entre les deux ensembles. D’autre part, si l’attribution des autels aux Caesares est acceptée, quelle était la nature précise du culte : dynastique, en mettant en scène l’empereur et ses héritiers, funéraire, en honorant les Mânes des deux princes, ou héroïsante, divinisation civique des principes iuuentutis ?
L’intégration d’un culte dynastique à travers la mise en place
d’autels voués aux Caesares est plus assurée dans les Trois Gaules, grâce à deux inscriptions fragmentaires retrouvées à Reims12 et à Trèves13. La mise au jour du décor sculpté du monument de Reims14 et l’utilisation du génitif dans les deux inscriptions incitent à identifier des autels funéraires. Cependant, la découverte en remploi des blocs empêche de définir le contexte originel des monuments auxquels ils appartenaient. Malgré l’absence d’informations concernant l’empla-cement primaire des monuments, il a été proposé de placer par analogie ces autels sur la place publique. En effet, les honneurs posthumes rendus aux Caesares trouvent dans plusieurs cités de l’Empire une place de choix sur le forum ou l’agora comme à Thasos, à Nîmes et peut-être à Glanum15. Cette intégration d’édifices funérai- 10 En effet, il faut noter que même si les autels sont alignés sur les temples géminés, ils font avant tout face au forum. 11 P. GROS, « Les temples géminés de Glanum. Etude préliminaire », RAN, 14, 1981, p. 156. 12 C.I.L., XIII, 3254 = A.E., 1982, 715. 13 C.I.L., XIII, 3671 = A.E., 2010, 37. 14 R. NEISS, « Une dédicace de la cité des Rèmes à C. César et L. César », dans Bull. de la Soc. Archéologique Champenoise, 1982, p. 3-8 ; E. ROSSO, « Les hommages rendus à Caius et à Lucius César dans les provinces gauloises et alpines », dans M. CHRISTOL, D. DARDE (dir.), L’expression du pouvoir au début de l'Empire. Autour de la Maison Carrée à Nîmes, Arles, 2009, p. 102. 15 Guide de Thasos, o.c.(note n°8), p. 31 ; R. AMY, P. GROS, La Maison carrée de Nîmes, Paris, 1979.
Marin MAUGER
294
res au cœur de la ville offrirait une double fonction à ces monuments, à la fois idéologique et politico-religieuse. Ces édifices par leur posi-tion centrale mettraient en place les premiers jalons de la religion civique des cités, tout en affirmant par le sacrifice sur l’autel l’allégeance au pouvoir de l’empereur. Ils participeraient ainsi à la définition de l’espace civique marquant la primauté de Rome sur le système municipal, la place publique devenant un « laboratoire » pour le développement du culte impérial à travers l’intégration des monuments du culte dynastique.
Cependant, dans quelle mesure l’acte fédérateur de la commu-nauté civique revêt-il la forme d’un sacrifice aux Mânes sur la place publique? Le culte funéraire détermine-t-il l’emplacement futur du culte impérial dans la ville ? Une cité choisit-elle réellement d’honorer les petits-fils d’Auguste avant l’empereur lui-même? En d’autres termes, le culte dynastique précède-t-il le culte de l’empereur ? Le culte de l’empereur sur le forum
En Narbonnaise, le développement précoce des colonies permet
la mise en place de l’autel sur un forum possédant déjà les organes nécessaires à l’administration de la cité. L’autel est donc intégré dans une ville constituée. La consécration du monument ne correspond pas à l’acte fondateur de l’unité civique, mais à l’expression renouvelée de la concorde municipale avec Rome, et entre les citoyens.
A Narbonne, en 11 ap. J.-C., la consécration d’un autel voué au Numen Augusti en acquittement d’un vœu de la plèbe réunit les citoyens et les incolae de la cité pour remercier l’empereur d’une action menée en faveur de la colonie. Même si la détermination du contexte d’origine des autels impose une réflexion globale sur la nature du culte, les dédicants et les participants aux cérémonies, la restitution de l’emplacement sur le forum n’est pas nécessairement une simple hypothèse. La lex arae Narbonensis indique l’édification in foro, c’est-à-dire sur le forum, de l’autel dédié au Numen de l’empe-reur. Les prescriptions rituelles qui sont détaillées dans la loi imposent l’édification de l’autel dans un locus celeberrimus16 pouvant accueillir 16 Decreta pisana : C.I.L., XI, 1421, l.35 ; Narbonne : C.I.L., XII, 4393, l. 29-30.
LA PLACE DE L’AUTEL EN GAULE
295
un grand nombre de personnes. Le forum de la colonie devient ainsi un lieu privilégié de l’expression du culte impérial et du consensus civique.
Dans les Trois Gaules, la période julio-claudienne est une époque charnière pour le développement des cités. Les communautés se constituent et les centres civiques s’organisent. Dans le processus de définition de l’espace public, la fondation de l’autel ancre dans la trame urbaine le nouveau culte civique.
A Bordeaux, un autel consacré à l’Auguste et au génie de la cité
des Bituriges Vivisques illustre ce processus d’intégration du sacré sur la place publique, dès le début de l’organisation urbaine17. La dimension de l’autel est loin de l’aspect monumental attendu pour un monument bâti sur le forum, cependant sa consécration par la cité permet de défendre cette hypothèse18. De plus, l’étude conjointe du formulaire dédicatoire et du décor de l’autel met en lumière deux niveaux de représentation du monument. Il marque à la fois l’accep-tation du pouvoir de Rome en honorant l’empereur comme le rappelle la couronne de chêne sculptée sur la face postérieure et proclame l’unité du système municipal par le sacrifice au génie de la cité19.
A Bagnères-de-Bigorre, la dédicace d’un autel au Numen Augusti par Sembedonis, au nom des habitants du vicus, confirme le con-sensus nécessaire à la consécration d’un autel20. Le monument est probablement érigé, à la période julio-claudienne21, sur une place 17 C.I.L., XIII, 566 = I.L.S. 7038 = I.L.A., Bordeaux, 1. 18 La consécration par la cité est supposée par le développement au nominatif de Bit. Viv., plutôt qu'au génitif. Néanmoins si on accepte le développement au génitif pour faire mention d'un génie de la cité des Bituriges Vivisques, l'absence de dédicant conforterait la dédicace par les autorités civiques. (I.L.A., Bordeaux, 1 ; W. VAN AN-DRINGA, o. c. (note n°4), 2002, p. 199.) 19 W. VAN ANDRINGA, o.c. (note n°4), 2002, p. 199, propose également de replacer le contexte d’origine de l’autel sur le forum de la cité. 20 C.I.L., XIII, 389 = A.E., 2006, 806. 21 M.-T. RAEPSAET-CHARLIER, Diis deabusque sacrum : formulaire votif et datation dans les Trois Gaules et les deux Germanies, Paris, 1993, p. 45. L’auteur date l’autel de la période julio-claudienne. D. FISHWICK, « genius and numen », The Harvard Theological Review, 62, 3, 1969, p 358-359, note n° 12, propose une datation plus large au Ier s. ap. J.-C.
Marin MAUGER
296
publique qui n’a pas le statut de forum22, mais qui revêt des fonctions proches. Le monument n’a pas vocation à être un élément structurant de l’organisation du vicus. Il renforce cependant la fonction de la place en lui conférant en plus d’un caractère politique, le statut d’espace de réunion pour le culte public. II. Des prêtres avant le temple : la connaissance de l’autel par le sacerdoce Les autels conservés ne traduisent pas la diversité des cultes impé-riaux présents dès la période julio-claudienne en Gaule. En effet, seuls deux cultes émergent des documents à notre disposition, celui des Caesares et celui de l’empereur, principalement sous la forme de son Numen. Ces données sont tronquées par l’indigence du corpus. Le culte qui se diffuse le plus à la période augustéenne en Narbonnai-se et à la période julio-claudienne dans les Trois Gaules est le culte de Rome et d’Auguste. Aucun autel municipal faisant mention d’un tel culte n’a été découvert23, cependant cette lacune de la documentation ne signifie pas son absence. A Rodez, la découverte d’une inscription mentionnant une prêtrise de Rome et d’Auguste César atteste la présence du culte impérial. La mention de ce sacerdoce assurément augustéen est connu grâce à une inscription opisthographe retrouvée dans les couches tardives de démolition du forum24. Les fouilles me-nées dans cette zone démontrent que la monumentalisation de l’espa-ce civique n’a lieu que dans la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C25. Néanmoins, l’inscription mentionnant la prêtrise permet d’affirmer l’existence d’un monument avant la mise en place du temple présent 22 Nous préférons nommer le centre civique par le terme de place publique plutôt que de forum, non pas pour nier la possibilité d’un forum dans les agglomérations dites « secondaires », mais pour hiérarchiser « les implications juridiques, administratives et religieuses qui sont associés au mot » : M. DONDIN-PAYRE, « forum et structures civi-ques dans les Gaules : Les témoignages écrits », dans A. BOUET, le forum en Gaule et dans les régions voisines, Bordeaux, 2012, p. 61. 23 Nous choisissons de ne pas intégrer l’autel monumental de l’ « Augusteum » de Nîmes. L’attribution proposée est trop incertaine pour définir ce monument comme un autel du culte de Rome et d’Auguste ou d’une autre forme du culte impérial. 24 A.E., 1994, 1215 = A.E., 2011, 753. 25 R. SABLAYROLLES, « Un prêtre du culte impérial à Segodunum sous le règne d’Auguste », dans P. GRUAT, Les Rutènes du peuple à la cité, de l'indépendance à l'installation dans le cadre romain 150 a.C. - 100 p.C, Bordeaux, 2011, p. 559-571.
LA PLACE DE L’AUTEL EN GAULE
297
sur le forum. La forme prise par ce premier monument doit certaine-ment être celle d’un autel. Néanmoins, sa forme et sa place sont diffi-ciles à définir, même si l’hypothèse du forum reste séduisante d’après le lieu de découverte de l’inscription26.
A Feurs, un sacerdos Aug[…] est connu sous le règne de Claude grâce à la dédicace du théâtre de la ville27. Ce prêtre n’est a priori pas rattaché à un autel. En effet, la construction du forum est datée autour de 10 ap. J.-C, c’est-à-dire à la fin de la période augustéenne28. L’édification du temple in foro est terminée au cours du règne de Tibère. Le prêtre du culte impérial a probablement exercé sa charge dans ce temple précoce, dont l’attribution reste inconnue. L’invocation dédicatoire du théâtre, consacré au Diuus Augustus pour la sauve-garde de Claude, permet néanmoins de supposer que le prêtre est un sacerdos augustalis, c'est-à-dire un prêtre du divin Auguste29. Cette interprétation du sacerdoce et de la nature du culte dont il a la charge coïncident avec la datation du temple. Ce monument est en relation avec la monumentalisation du forum. Comme le rappelle P. Valette, l’emplacement de ce dernier est inscrit précocement dans la trame urbaine,dès la mise en place des axes de circulation30. Au cours de cette période de définition des espaces civiques, un autel consacré à Rome et Auguste a pu être institué, définissant ainsi l’emplacement du futur temple. Néanmoins aucune donnée certaine ne permet de confirmer une telle hypothèse. Il faut donc considérer deux possibilités pour l’émergence du culte de l’empereur dans la cité des Ségusiaves : soit le culte impérial est intégré par le biais d’un monument voué au divus Augustus à la période tibérienne, soit il apparaît plus précocement avec le culte de Rome et d’Auguste sous la forme d’un autel. L’actualisation du culte et l’institution de la prêtrise s’expliquerait alors par les changements survenus suite à la mort du prince et à la 26 La découverte de l’inscription sur le forum pourrait renforcer cette hypothèse. Cependant, il ne faut pas oublier le rôle que joue le forum dans l'exaltation des élites civiques. L'inscription pouvait donc faire partie des statues honorant les meilleurs des citoyens. 27 C.I.L., XIII, 1642. 28 P. VALETTE, Forum Segusiavorum : le cadre urbain d'une ville antique, Ier s.-IIIe s., Lyon, 1999, p. 168. 29 E. LYASSE, « Germanicus flamen Augustalis et la création de nouveaux flaminats à Rome », Gerión, 25, Paris, 2007, p. 305. 30 Voir supra, note n°28.
Marin MAUGER
298
refondation du lieu de culte. Ce processus est connu dans plusieurs colonies de Narbonnaise31, province limitrophe à la cité de Feurs, et d’autres parallèles peuvent être trouvés dans certaines cités des Trois Gaules, notamment à Saintes32.
En Narbonnaise, les témoignages de prêtrises d’époque augus-
téenne sont plus nombreux. Néanmoins, la constitution précoce des centres civiques rend difficile le rapprochement entre les prêtres et un monument de culte. En Arles, la découverte, sur le forum, d’une inscription mentionnant un prêtre de Rome et d’Auguste César33 suppose la mise en place d’un culte impérial d’époque augustéenne. Ce témoignage est renforcé par la dédicace du pont Flavien de Saint-Chamas réalisée à titre posthume par un flamen Romae et Augusti34 et datable de la troisième décennie avant notre ère35. L’institution de ces prêtrises avant la création d’un temple incite à réfléchir au lieu d’exercice de ces prêtres. Il serait possible de proposer la présence d’un autel monumental sur le forum, suivant en cela l’hypothèse fortement remise en question de P. Gros qui voit sur le forum adiec-tum un autel dynastique36. Néanmoins, aucune donnée ne confirme 31 Le groupe d’inscriptions de Vienne est le plus révélateur de ce processus. Période augustéenne : flamen de Rome et Auguste (I.L.N., Vienne, 849) ; période tibérienne : flamen du Diui Augusti (I.L.N., Vienne 66) ; après le milieu du Ier s. ap. J.-C. : flamen Aug (I.L.N., Vienne 547 ; I.L.N., Vienne 846). Cette évolution est également notable à Nîmes ; Béziers ; Arles ; Apt. 32 C.I.L., XIII, 1048 + 1074 = I.L.A., Santons, 20. Pour les questions posées par cette prêtrise, voir W. VAN ANDRINGA, o. c. (note 4), 2002, p. 215-216. 33 A.E., 1952, 169 = A.E., 1999, 1020. 34 C.I.L., XII, 647. 35 A. ROTH-CONGÈS, « L'acanthe dans le décor architectonique protoaugustéen en Provence », RAN, 16, 1983, p. 112. 36 Les études menées par M. CHRISTOL, « L'épigraphie et les débuts du culte impérial dans les colonies de vétérans en Narbonnaise », RAN, 32, 1999, p. 11-14, par J.-Ch. BALTY, « Notes d’iconographie Julio-claudienne, IV: M. Claudius Marcellus et le type B de l’iconographie d’Auguste jeune », AK , 20, 1977, p. 102-118, et par E. Rosso, o. c. (note n°9), 2006, p. 132-133 semblent suffisamment convaincantes pour rejeter la proposition de P. GROS, « Un programme augustéen : le centre monumental de la co-lonie d'Arles », Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, 102, 1987, p. 347-348, selon laquelle un autel se trouverait au centre du forum adiectum d’Arles. Aucune preuve ne peut être avancée dans ce sens. De plus, il semble que le clipeus uirtutis, qui est l’un des arguments principaux de la démonstration de P. Gros pour restituer l’autel sur le forum, trouverait davantage sa place dans la curie coloniale qui devait le jouxter, suivant en cela l’exemple romain : Res Gestae Diui Augusti, 34.
LA PLACE DE L’AUTEL EN GAULE
299
l’existence d’un autel, d’autant plus que les vestiges découverts dans les cryptoportiques se rapportent davantage à la monumentalité d’un temple de période protoaugustéenne37.
Pour les autres colonies de Narbonnaise où un sacerdoce augus-
téen est connu, la mise en relation de la prêtrise avec un monument précis est malaisée. En effet, la construction précoce des temples du culte impérial, avant le changement d’ère, perturbe l’établissement d’une chronologie relative entre la prêtrise et le temple, comme c’est notamment le cas à Béziers, Nîmes ou Apt38. L’exemple de la cité de Vienne invite cependant à relativiser l’omniprésence des autels dans la définition de l’espace urbain. En effet, l’ensemble des prêtrises julio-claudiennes de la cité sont attribuables à un monument : le temple du forum. L’édifice connaît une évolution de sa dédicace due à des campagnes de rénovation, probablement à la suite de séismes39. Ainsi, l’évolution de la titulature sacerdotale correspond aux étapes successives de la dédicace. De plus, la datation protoaugustéenne d’une inscription mentionnant un flamen Romae et Augusti40 s’accor-de avec la datation du premier état du temple. La mise en place précoce du monument sur le forum, dès les années suivant l’institu-tion du culte de Rome et d’Auguste, ne certifie pas l’antériorité d’un autel. Cette attestation précoce d’un temple voué au culte impérial impose une réflexion sur la thèse généralement admise de l’autel comme antécédent du temple.
III. L’autel : un antécédent du temple ?
La tentative de remise en contexte des autels prouve leur impor-
tance dans la définition des espaces publics. L’intégration progressive du culte impérial dans la cité par le biais de ces monuments permet de réfléchir à la place du temple dans ce processus. Les autels voués au culte de l’empereur au commencement de la période julio-clau-dienne sont-ils nécessairement liés à un temple ou s’agit-il de cons- 37 M.-P. ROTHE, M. HEIJMANS, C.A.G. 13/5, Arles, p. 362-364; A. ROTH-CONGES, o.c. (note n°35), 1983, p. 112. 38 C.I.L., XII, 4230 = A.E., 1999, 1033; C.I.L., XII, 1121 = I.L.N., Apt, 24. 39 F. ADJADJ, C.A.G. 38/3, Vienne, p. 270 40 C.I.L., XII, 2600 = I.L.N., Vienne, 849.
Marin MAUGER
300
tructions autonomes structurant l’espace et définissant l’emplace-ment réservé à l’édification du temple dans la trame urbaine ?
Le modèle établi par l’autel du Confluent montre que la décision
d’édifier un autel monumental en 12 av. J.-C. n’est pas accompagnée de la construction d’un temple lié à cet édifice. En effet, il faut attendre la période flavienne pour qu’un temple consacré à Rome et Auguste soit bâti au sanctuaire des Trois Gaules41. Le modèle provincial défi-nit, pour les premiers temps de l’empire, l’autel comme une structure autonome pour la mise en place du culte lié à l’empereur. Les dimen-sions réduites de l’autel bordelais42 pose la question de son lien avec un probable temple consacré au culte de l’empereur et au génie de la cité. Cependant, sa dédicace datée de la période julio-claudienne pour ne pas dire augustéenne suppose une situation similaire à celle de Bavay43. A cette époque, la place publique n’a pas revêtu le statut de forum et l’amorce de la trame urbaine n’intègre pas nécessai-rement un temple dans le cœur civique44. Le caractère cependant trop laconique de la documentation ne permet pas de développer davan-tage cette hypothèse45. L’emplacement généralement admis pour les autels de Reims et de Trêves serait, par analogie avec les monu-ments de Thasos et de Nîmes, à situer sur la place publique46. Néan-moins, le culte funéraire rendu aux Caesares n’attend pas la mise en place d’un temple et l’institution d’un sacerdoce47. Rien n’empêche de ce fait qu’un autel ou qu’un temple voué à Rome et Auguste ait été 41 D. FISHWICK, “The Temple of the Three Gauls”, The Journal of Roman Studies, 62, 1972, p. 46-52. 42 C.I.L., XIII, 566 = I.L.S. 7038 = I.L.A., Bordeaux, 1. L'autel mesure: H. = 1,48 m. ; l. = 0,73 m. ; ép. = 0,58 m. 43 Il faut noter l'existence, à Bavay, d’un autel monumental ou base de statue voué à Tibère pour son adventus (C.I.L., XIII, 3570 = I.L.S. 8898). 44 M. DONDIN-PAYRE, o.c. (note n°22), 2012, p. 55-63. 45 Même si la datation julio-claudienne de l'autel de Bordeaux semble acceptable pour plusieurs raisons, telle la forme du monument, le formulaire et le lien entre texte et décor, il faut admettre que la mention Augusto sacrum, qui est un hapax en Aquitaine, et la présence d’un génie funéraire dans la patère sur la face latérale gauche laissent planer un doute sur la datation du monument. 46 Pour les autels de Reims et Trèves voir supra, note n°12-13. Pour Nîmes et Thasos, voir supra, note n°8. 47 J. SCHEID, Quand faire, c’est croire : les rites sacrificiels des Romains, Paris, 2005, p. 194.
LA PLACE DE L’AUTEL EN GAULE
301
construit dans ces cités à partir 12 av. J.-C., date de la consécration de l’autel de Lyon48. Ce phénomène est attesté par Cassiodore qui rapporte qu’après avoir présidé à la consécration de l’autel provincial des Trois Gaules, Drusus l’ancien en remontant vers les Germanies initie la consécration d’un templum voué à l’empereur dans la cité des Lingons49.
Ainsi, malgré la mise en place dans de nombreuses villes des Trois Gaules d’un autel souvent consacré à Rome et Auguste sur le modèle du Confluent, il n’est pas possible de généraliser ce proces-sus. En effet, comme Cassiodore le laisse entendre, certaines cités introduisent le culte impérial par la consécration d’un temple dédié à Rome et Auguste, dès le début du principat50. A Saint-Bertrand de Comminges, par exemple, la construction du temple sur le forum commence à la période augustéenne. L’attribution du temple reste incertaine à cause de l’absence d’une dédicace, et malgré la décou-verte de plusieurs indices épigraphiques en lien avec le culte impérial dans l’enceinte du sanctuaire51. Néanmoins, la datation augustéenne de ce monument, qu’il soit voué ou non à une forme du culte impérial, amène à considérer l’existence d’une monumentalisation précoce de leur centre civique pour certaines cités de Gaule52. Dans ce cas 48 G. BREITNER, K. P. GOETHERT, « Ein Altar für Augustus und Roma in Trier. Zum Neufund einer Marmorplatte mit Rankendekor » dans Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier, 2008, p. 7-13. 49 CASSIODORE, Chronicon, II, p. 135 (éd. Mommsen) : Drusus Nero et L. Quintius his conss. apud Lingonum gentem templum Caesari Drusus sacravit. 50 Il est nécessaire de rester prudent sur l’identification d’un temple à partir du mot templum. Voir à ce propos : J. SCHEID, A. DUBOURDIEU, « Lieux de culte, lieux sacrés : les usages de la langue. L'Italie romaine », dans A. VAUCHEZ, Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires, Rome, 2000, p.59-80. 51 Cependant il paraît nécessaire d'observer une grande prudence quant à l’attribution du temple. En effet, les auteurs de la synthèse, A. BADIE, R. SABLAYROLLES, J.-L. SCHENCK-DAVID, Saint-Bertrand de Comminges. I, Le temple du forum et le monu-ment à enceinte circulaire, Bordeaux, 1994, p. 108-109, rappellent que les sources à notre disposition sont découvertes systématiquement en remploi. Ainsi, même si des inscriptions liées à des prêtres de Rome et d’Auguste ont été mises au jour, l'absence de contexte empêche toute certitude. 52 On peut supposer, dans le cas de Saint-Bertrand-de-Comminges, que le trophée augustéen ait joué un rôle dans la définition des espaces et ait permis la mise en place précoce d’un temple. Le trophée définit une idéologie de la victoire liée à l’exaltation des imperatores, qui peut être propédeutique à l’exaltation cultuelle de l’empereur en tant que chef victorieux. Cependant, l’attribution toujours problématique du temple empêche toute conclusion trop hâtive.
Marin MAUGER
302
précis, l’autel ne définit pas l’emplacement du futur temple, les deux monuments étant contemporains et fonctionnant ensemble.
En Narbonnaise, la mise en place systématique d’autels consa-crés au culte dynastique définissant l’espace de monumentalisation du culte impérial est un processus souvent admis53. Cependant, une réévaluation des données démontre qu’aucun autel monumental n’est consacré avant un temple. L’identification incertaine, il faut le rappeler, du sanctuaire de la Fontaine de Nîmes à un Augusteum ne garantit pas que la plate-forme à rinceaux, où devait être placé un autel, soit dédiée au culte de l’empereur54, plutôt qu’à celui du dieu poliade. En effet, la présence de Nemausus, dieu tutélaire et divinité de la source de Nîmes, est fortement marquée dans le sanctuaire par de nombreuses attestations épigraphiques55, et renforcée par un ensemble de divinités liées au culte des sources56. Concernant le culte de l’empereur, seules deux dédicaces jumelles en l’honneur d’Auguste datées de 25 av. J.-C.57, ainsi que quelques rares représentations attribuées de manière incertaine à un empereur58 sont attestées. Le dossier demanderait une réévaluation avec l’ensemble des données archéologiques pour affirmer ou infirmer l’attribution de l’autel au culte de Rome et d’Auguste ou à celui du Genius de l’empereur.
Concernant le monument dynastique du forum d’Arles proposé par P. Gros, les arguments avancés par M. Christol, J.-Ch. Balty et E. Rosso incitent, comme nous l’avons vu, à ne pas restituer l’autel présumé du forum adiectum59. Ainsi, un monument d’époque augus-téenne est assurément lié au culte de Rome et d’Auguste dans la 53 Voir supra, note 5. 54 P. GROS, « L’Augusteum de Nîmes », RAN, 17, 1984, p. 123-134. 55 C.I.L., XII, 3070 / 3072/ 3093/ 3094/ 3095/ 3096/ 3098/ 3101. 56 I.A.N. 43 : inscriptions aux mères némausiques ; C.I.L., XII, 3104 : aux nymphes ; C.I.L, XII, 3108 et 3109 : aux nymphes augustes. 57 C.I.L., XII, 3148 et 3149. 58 E. Rosso, dans sa monographie sur l’image de l’empereur en Gaule, n’intègre qu’une dédicace à Claude provenant de l’Augusteum : E. ROSSO, o.c. (note 9), 2006, n° 200, p. 432-433, et un portrait d’Antonia Minor trouvé près de la tour Magne, n° 199, p.431-432. 59 Voir supra, note 36.
LA PLACE DE L’AUTEL EN GAULE
303
colonie, comme le rappellent deux inscriptions mentionnant un flamen Romae et Augusti60. Néanmoins, il est impossible, dans l’état actuel de la documentation, de définir sa nature et sa localisation61. A Glanum, l’absence de données stratigraphiques certaines inter-dit toute précision concernant la chronologie relative entre les deux autels placés à l’extrémité du bloc-forum et les temples géminés62. Si le podium supportant les deux autels est construit après les temples, l’attribution proposée par B. Frischer d’un ensemble voué au culte des Caesares sur le modèle d’Athènes ou de Thasos63 serait acceptable. Cette hypothèse permettrait de rappeler l’aspect, certes, central et hautement symbolique du culte dynastique, mais l’autel perdrait alors la prérogative, qui lui est généralement attribuée, dans la circons-cription de l’espace dédié à l’intégration future du culte impérial.
A Narbonne, la consécration de l’autel du Numen Augusti sur le forum de la colonie n’exclut pas la présence préalable d’un temple de Rome et d’Auguste. En effet, la nature votive du monument offert par la plèbe n’impose pas, d’après la lex arae64, la création d’un sacer-doce attaché au culte du Numen. La mise en place en 11 ap. J.-C. du culte du Numen Augusti témoigne de la rapidité de diffusion des cultes dans la province. En effet, le culte du Numen d’Auguste est rendu officiel autour de 6 ap. J.-C. suite à la consécration à Rome d’un autel par Tibère65. L’attestation de Narbonne est la plus précoce connue dans les provinces. Il faut attendre 18 ap. J.-C. pour trouver la dédicace d’un second autel dans la colonie de Forum Clodii66. Ainsi, il serait étonnant que Narbonne, malgré son zèle avéré67 et son statut 60 Voir supra, notes 33 et 34. 61 Le temple d’époque tibérienne est trop tardif pour être attribué au culte de Rome et d’Auguste. De plus, rien ne permet d'affirmer le lien entre le temple et le culte impérial. 62 Voir supra, note n°11. 63 Voir supra, note n°8. 64 C.I.L., XII, 4333, l. 15-16: Trois chevaliers et trois affranchis gèrent les cérémonies définies dans le calendrier civique. 65 A. DEGRASSI, Inscriptiones Italiae, 13, 2, 115; D. FISHWICK, The Imperial cult in the Latin West, II. 1, Leiden, 1991, p. 378. 66 C.I.L., XI, 3303 = I.L.S. 154 = A.E., 2008, 522. 67 On rappellera également l’autel dédié à la Pax Augusta, C.I.L., XII, 4335, autour du changement d’ère (vers 2 ap. J.-C.), moins de dix ans après la dédicace de l'ara Pacis
Marin MAUGER
304
de capitale de province, n’ait pas intégré à cette date le culte de Rome et d’Auguste alors présent dans la majorité des colonies de la province.
Enfin à Vienne, un temple de Rome et d’Auguste est construit sur
le forum au début de la période augustéenne. Les fragments sculptés d’un hypothétique autel dynastique figurant Auguste et Tibère auraient également été retrouvés sur le forum de la colonie68. Si la restitution d’un autel est exacte, ce dernier resterait néanmoins postérieur à la création du temple. En effet, les critères stylistiques et la présence de Tibère aux côtés d’Auguste incitent à dater le monument de la première décennie de notre ère69.
Dans l’état actuel des connaissances, aucune donnée ne vérifie
l’antériorité supposée de l’autel sur le temple en Narbonnaise. Ce constat est appuyé par l’apparition dans l’épigraphie des prêtrises vouées à Rome et Auguste en même temps que la création des temples70. De plus, à l’exception de Narbonne, aucun autel n’est attribuable de manière certaine au culte de l’empereur.
La documentation à notre disposition est donc trop ténue pour établir l’antériorité de l’autel sur le temple dans toute la Gaule. Suivant le contexte, une grande partie des cités des Trois Gaules a proba-blement recouru à l’autel pour intégrer le culte impérial dans le centre urbain, étant encouragée par le modèle provincial. Cependant d’au-tres cités ont pu comme en Narbonnaise construire directement un temple. Lorsque nous utilisons le terme « temple », nous entendons bien évidemment que le monument est lié à un autel. Ce dernier en recevant le sacrifice devient l’intermédiaire principal entre les hommes et les dieux, contrairement au temple, qui peut être conçu comme la
Augustae. La monumentalité des autels est différente, mais les cultes sont les mêmes, ce qui montre leur diffusion rapide dans la capitale de province. 68 F. SALVIAT, D. TERRER, « Portraits d’Auguste à Vienne, de Tibère au musée de Lyon : un relief dynastique en Gaule ? », RAN, 16, 1983, p. 135-144 ; ROSSO, o.c. (note 9), 2006, p. 134-135, et n°84-85 p. 294-297. 69 E. ROSSO, o.c. (note n°9), 2006, p. 297. 70 En effet, les prêtrises (par exemple C.I.L., XII, 4230 = A.E., 1999, 1033; I.L.N., Vienne, 849) apparaissent à l'époque augustéenne, comme plusieurs temples de Narbonnaise.
LA PLACE DE L’AUTEL EN GAULE
305
demeure de la divinité71. Il n’est donc pas possible dans l’état actuel de nos connaissances de soutenir la thèse de l’existence systéma-tique d’un autel autonome et monumental avant l’édification du temple consacré à une forme du culte impérial.
IV. Structurer l’espace civique par l’autel :
une prérogative du culte dynastique ou impérial ?
Si l’autel ne constitue pas un antécédent à l’instauration du temple, quel rôle lui attribuer non seulement dans la structuration de la religion publique, mais aussi dans celle de la communauté municipale et de l’espace urbain ? De plus, dans le processus de construction identitaire développé par les cités, les cultes dynastiques et impériaux tiennent-ils une place similaire? En somme, le culte dynastique est-il réellement propédeutique au culte de l’empereur, comme cela est souvent admis ?
Nous cherchons ainsi à définir si les autels dynastiques ont réelle-
ment précédé les monuments consacrés au culte de l’empereur dans les cités ou s’ils ont défini dans un premier temps l’emplacement du culte voué au prince et a posteriori du culte impérial. Nous pouvons résumer notre réflexion ainsi : le culte dynastique structure-t-il la religion civique et l’espace urbain dans les premières décennies de l’empire, facilitant l’intégration du culte de l’empereur dans les cités de Gaule, ou faut-il admettre une coexistence des deux cultes avec une prérogative du culte de l’empereur ? Pour mener cette réflexion, nous avons choisi de reprendre l’ensemble des autels dynastiques de Gaule (Reims, Trèves et Glanum72) en cherchant à les intégrer dans un contexte archéologique et historique plus large.
Ces trois autels sont voués, en admettant l’hypothèse de B.
Frischer pour Glanum73, aux Caesares, les petits-fils d’Auguste. L’emplacement primaire de ces monuments, restitué par analogie, est le forum. D’après cette hypothèse largement acceptée, l’intégration 71 W. VAN ANDRINGA, « Sanctuaires et genèse urbaine en Gaule romaine », dans D. CASTELLA, Topographie sacrée et rituels, Bâle, 2008, p. 134. 72 Voir supra, notes 7, 12, 13. 73 Voir supra, note 7.
Marin MAUGER
306
précoce de ces constructions au cœur de la cité a pour rôle la structuration de l’espace consacré à la religion publique. Cependant la nature du culte lié à ces autels pose un premier problème. Tout comme la notion de culte impérial74, celle de culte dynastique revêt différents aspects. Ainsi, les cultes rendus à la famille impériale va-rient, selon qu’ils prennent la forme d’un hommage cultuel du vivant de la personne, comme en témoignent probablement les sacerdoces de Germanicus et Livie à Vienne75, à Vaison-la-Romaine76, à Béziers77 ou même à Olisipo78, d’une assimilation à une divinité comme dans les nombreuses attestations des cités orientales de l’empire79, ou à un culte des Mânes, comme c’est le cas à Reims et très certainement à Trèves. En effet, les autels retrouvés dans les Trois Gaules sont consacrés aux princes de la jeunesse à titre posthume. Le culte est donc funéraire. Néanmoins, dans le processus de construction identitaire des cités de Gaule, quelle est la place octroyée au culte des Mânes dans le centre civique ? La communauté se fédère-t-elle réellement autour d’un culte funéraire ? L’atrox fortuna80, qui frappe l’empereur, et de ce fait l’empire, a-t-elle suscité la mise en place « spontanée » du culte dynastique et funéraire, là où le culte de l’empereur n’avait point encore trouvé de place ?
A Reims et à Trèves, les deux monuments funéraires sont les
premières attestations impériales connues pour ces cités. L’absence de témoignages antérieurs a mené les chercheurs à considérer ces fondations comme le medium d’intégration de l’idéologie et du culte impérial, en suivant le processus que nous avons plusieurs fois exposé. Cependant, l’observation attentive du corpus d’inscriptions pour ces cités montre la pauvreté de l’épigraphie impériale et la possibilité de lacunes documentaires. En effet, les autres mentions 74 E. BICKERMAN, « Consecratio », dans W. den BOER, Le culte des souverains dans l’Empire romain, Genève, 1973, p.3-25. 75 C.I.L., XII, 1872 = I.L.N., Vienne, 66. 76 C.I.L., XII, 1363 = A.E., 2002, 924. 77 C.I.L., XII, 4249. 78 C.I.L., II, 194 = I.L.S. 6896. 79 G. FRIJA, Les prêtres des empereurs, Rennes, 2012, p. 135-136 et cat n° 02, 78, 86, 94, 115, 116, 247,333, 398, 412. 80 SUÉTONE, Vie de Tibère, 23, 3.
LA PLACE DE L’AUTEL EN GAULE
307
d’un empereur dans ces cités datent au plus tôt du règne de Titus pour Trèves81 et de Maximien pour Reims82. Pour les représentations statuaires impériales, l’attestation trévire la plus précoce date du règne de Vespasien83. Aucun portrait impérial n’est en revanche connu pour Reims. L’indigence des occurrences impériales dans ces deux cités incite à considérer la découverte des autels voués au Caesares comme fortuite.
Rien n’interdit de penser qu’un autel consacré au culte de l’empe-
reur ait été institué avant la mort des deux princes. Pour appuyer cette affirmation, plusieurs arguments peuvent être avancés : la zone char-nière que représente le nord-est de la Gaule au cours des décennies du changement d’ère, d’une part, et l’importance des légats de provinces dans l’institution du culte de l’empereur, d’autre part. Ces deux arguments sont d’ailleurs fortement liés. En effet, au cours de cette période, les légats de la province de Gaule Belgique sont des membres de la famille impériale envoyés pour mener l’offensive contre les Germains. Ainsi, leur présence répétée dans la région a probablement mené à l’institution précoce des hommages impériaux. Dion rapporte que Drusus initie la fondation de l’autel du Confluent à Lyon84 et qu’en arrivant à Cologne, il accepte la mise en place de l’autel des Ubiens85. De plus, sur le chemin pour la Germanie, il s’arrête chez les Lingons, où il autorise la construction d’un templum Caesaris86. Etant donné la position centrale de Trèves, entre la cité des Lingons et Cologne, il paraît certain que les Trévires furent rapi-dement mis au fait des constructions lié au culte de l’empereur dans la région. La découverte, lors d’un sondage au cœur de la ville moder- 81 A.E., 1988, 891. Seules deux autres inscriptions sont connues : une à Constance Chlore, C.I.L., XIII 3672, l’autre à un empereur indéterminé, C.I.L., XIII, 9132. 82 C.I.L., XIII, 9020 / A.E., 1946, 21. Une seule autre inscription est connue par Constantin : C.I.L., XIII, 3255 = I.L.S. 703. 83 E. ROSSO, o. c. (note n°9), 2006, cat. n° 54 p. 260-261. Cette représentation de Ves-pasien aurait été taillée à partir d'un portrait de Vitellius. Deux autres portraits sont connus pour la cité : l’un d’un prince de la famille antonine, E. ROSSO, o. c., 2006, cat. n° 55, p. 261-262, l’autre probablement d’Honorius, E. ROSSO, o. c., 2006, cat. n° 57, p. 263-265. 84 DION CASSIUS, 54, 32, 1-2. 85 TACITE, Annales 1, 39, 1-4 ; D. FISHWICK, oc. (note 65), vol. I. 1, Leiden, 1987, p. 137-139. 86 Voir supra, note 49.
Marin MAUGER
308
ne, d’un fragment de marbre sculpté présentant une guirlande de feuilles de chênes87 appuie la thèse d’un développement précoce du chef-lieu de cité. La ressemblance, du moins dans le fragment conservé, avec les panneaux ornés de guirlandes mis au jour à Lyon et généralement identifiés à une partie de l’autel des Trois Gaules88 incite à dater le fragment trévire de la dernière décennie avant notre ère. Sans nous aventurer dans les restitutions excessives proposées par K.-P. Goethert89, nous souhaiterions rappeler la facture com-parable et de ce fait l’existence d’un art augustéen précoce dans la ville de Trèves qui permettrait, malgré l’indigence du corpus, de soutenir la possibilité d’un autel voué à Rome et Auguste avant le changement d’ère.
A Reims, aucun témoignage archéologique ne conforte l’hypo-thèse d’une installation du culte de l’empereur avant la mort des Caesares. Cependant, la ville est, à la période augustéenne, le siège du gouverneur de province et reçoit à plusieurs reprises, entre la dernière décennie avant notre ère et la fin du règne d’Auguste, des membres de la famille impériale, comme Drusus, Tibère et Germa-nicus90. La présence prolongée des membres de la Gens Augusta dans la cité laisse supposer une structuration urbaine précoce comme en témoigne la mise en place de la trame urbaine à l’époque augustéenne91.
De la sorte, si nous admettons la possibilité de l’instauration d’un
autel ou d’un temple voué au culte de l’empereur dans les villes de Reims et de Trèves avant la mort des Caesares, quelle fonction donner à ces autels dans la construction identitaire et communautaire de la cité ? Le monument consacré au culte de l’empereur prend alors la première place dans l’espace public et en tant qu’élément fédéra-teur de la communauté civique. Cette première fondation, toute hypothétique qu’elle soit, définit-elle l’espace d’agglomération de 87 Voir supra, note 48. 88 R.B.R., 03, 1758 = C.I.L., XIII, 1664. 89 K. P. GOETHERT, « Un autel pour Rome et Auguste à Trèves. Une copie de l’autel de Lyon », dans Monuments Piot, 88, 2010, p. 83-92. 90 J.-M. DOYEN, Economie, monnaie et société à Reims sous l’Empire romain, Reims, 2007, p. 361. 91 R. CHOSSENOT, A. ESTEBAN, C.A.G. 51/2, Reims, p. 200.
LA PLACE DE L’AUTEL EN GAULE
309
l’ensemble des honneurs impériaux ou faut-il rechercher la mise en place des autels dynastiques dans un autre lieu de la ville ?
Les decreta pisana offrent le parallèle le mieux documenté et le
plus proche, par le culte funéraire, des autels de Reims et Trèves. Les honneurs posthumes mis en place par la cité italienne sont ratifiés dans l’augusteum du forum92. L’instauration du culte dynastique inter-vient donc après l’intégration sur la place publique du culte de l’empe-reur et la création d’un flaminat augustalis93. Cependant, la lacune du document empêche de définir le lieu où a été construit l’autel. La discussion des autorités civiques pour définir l’emplacement le mieux adapté pour la fondation de l’autel permet néanmoins de supposer que le monument n’est pas intégré à l’augusteum. En effet, Gaius Canius Saturnius avec l’aide de dix hommes doit définir le lieu le plus approprié pour la mise en place de l’autel et une fois la décision prise, il doit acheter avec l’argent public (publica pecunia) à des particuliers cet emplacement (a privatis eius loci)94. L’acquisition par les autorités civiques d’un terrain privé confirme l’hypothèse que l’espace d’inté-gration de l’autel n’est pas le forum, ce dernier appartenant au patri-moine de la cité.
Si la place de l’autel dynastique ne se trouve pas sur le forum, où chercher cette construction dans la ville ? En reconsidérant l’exemple rémois, on peut proposer une nouvelle hypothèse. En effet, la ving-taine de blocs appartenant à l’autel des Caesares a été découverte en remploi dans la première assise du soubassement de l’enceinte tar-dive, lors de la fouille menée à la porte Bazée95. De plus, l’ensemble des blocs mis au jour lors du démantèlement de cette partie du rem-part est composé majoritairement de cippes ou d’éléments d’architec-ture appartenant à des monuments funéraires96. Aucune composante de la parure monumentale du forum n’a été signalée. La porte Colla-trice, où a été retrouvé l’autel, est, avec la porte de Mars, l’entrée de la ville la plus éloignée du forum. La concentration des blocs compo- 92 Decreta Pisana (C.I.L., XI, 1420) l.1 : in foro in Augusteo. 93 Decreta Pisana (C.I.L., XI, 1421) l. 44 et l. 49. 94 Decreta Pisana (C.I.L., XI, 1420) l. 15. 95 R. NEISS, Civitas Remi. Reims et son enceinte au IVe siècle, Reims, 2004, p. 64 et planche I fig. B. 96 R. CHOSSENOT, A. ESTEBAN, C.A.G. 51/2, Reims, p. 204-206.
Marin MAUGER
310
sant l’autel en ce point précis est donc notable. Enfin, le sondage réalisé le long de cette section de l’enceinte a permis la mise au jour du cardo d’époque augustéenne97. Le cumul de ces informations incite à développer une nouvelle hypothèse concernant la localisation de l’autel. Nous proposons ainsi de définir le monument voué aux Caesares comme un édifice de limites marquant la séparation entre l’espace civique et l’espace funéraire. L’emplacement de l’autel serait alors à placer le long du cardo augustéen à proximité de l’entrée méri-dionale de la cité. Le marquage de cette limite est renforcé au IIe s. ap. J.-C. par la construction de l’arc Bazée98, matérialisant le passage entre le cardo et la voie menant vers Rome. Prenant en considération cet axe routier, le choix de placer l’autel le long de cette voie s’expli-que par la venue répétée des gouverneurs de provinces, alors membres de la famille impériale.
Les hommages dynastiques ou en l’honneur des imperatores
trouvent en Gaule une place de choix dans les lieux de passage. E. Rosso a déjà mis en avant plusieurs ensembles marqués par l’idéo-logie dynastique et le culte des imperatores99, tel l’arc de Saintes, associant Tibère à ses deux fils100, la chapelle de Senlis, située contre la muraille et associant les statues de plusieurs imperatores101, l’hé-rôon de Suse102, qu’Ammien Marcellin situe proximum moenibus103, ou encore l’hommage statuaire rendu à Caius César à l’entrée du pont de Sens104. Concernant l’aspect funéraire du culte, la situation à proximité d’un lieu de passage offre des exemples comme l’enclos funéraire situé à la Porta Nola de Pompéi105, ou comme ceux 97 Id., ibidem, p. 200. 98 Id., ibidem, p. 202-203. 99 E. ROSSO, o.c. (note 9), 2006, p.145-148. 100 E. ROSSO, « Vie d’un groupe statuaire julio-claudien à Mediolanum Santonum », dans Labyrinthe, 7, 2000, p. 103-122. 101 E. ROSSO, o c. (note 9), 2006, p. 148. 102 Id., ibidem, p.147-148 ; L. BRECCIAROLI TABORELLI, « L’heroon di cozio a Segu-sio. Un esempio di adesione all'ideologia del principato augusteo », dans Athenaeum, 82, Pavia, 1994, p. 331-339. 103 AMMIEN MARCELLIN, 15, 10, 7. 104 E. ROSSO, o.c. (note 9), 2006, p. 147 et cat. n° 78 p. 290-291. 105 Tombeau de M. Cerrinius : G. SPANO, « Scavi fuori Porta di Nola », dans N.S.A., 1910, p. 385-393.
LA PLACE DE L’AUTEL EN GAULE
311
d’Aquilée106. Enfin, l’entrée de la ville est un lieu de passage qui ré-pond à la prescription du locus celeberrimus imposé dans les decreta Pisana pour l’édification d’un arc en l’honneur de Caius107.
Finalement, la fondation de l’autel dynastique en limite de la ville
n’interdit pas d’attribuer à ce monument la portée symbolique et la valeur structurante qui lui sont généralement reconnues. L’autel n’a certes plus la fonction de circonscrire sur la place publique le culte impérial et l’espace dévolu au temple. Cependant il conserve un rôle dans l’organisation de l’espace, marquant la séparation entre la ville et l’extérieur, entre la communauté civique, humaine et divine, et le monde des morts. Cette position ambivalente correspond au statut posthume des deux princes. Le culte public de leurs Mânes et les honneurs qui les accompagnent les placent dans un entre-deux, à la fois au-dessus de la communauté indistincte des Mânes et, malgré l’aspect héroïsant des hommages, en-dessous des dieux108. Conclusion : le rôle de l’autel dans la mise en place du culte dit « impérial »
L’attention portée par les autorités civiques à l'emplacement de l’autel, en fonction du culte auquel il est consacré, met en avant l’impasse à laquelle conduit l’emploi générique du terme « culte impérial » à la période augusto-tibérienne. Le culte impérial, s’il en est, n’apparaît en Gaule qu’à partir de la période claudienne, voire flavienne. Cette période correspond à une phase de mutations dans la politique idéologique, mais également dans l’approche cultuelle des honneurs rendus à l’empereur. Sous Auguste et a fortiori sous Tibère, la réflexion sur l’espace attribué à l’autel permet de différencier deux catégories de cultes, ceux rendus à l’empereur, honorant le prince sous une forme divine spécifique et ceux à destination de sa gens. Cette distinction entre cultes de l’empereur et cultes dynastiques permet de comprendre les modalités d’instauration du culte dit « impérial » à une période ultérieure. Les deux cultes peuvent coexister dans une même cité, mais la nature distincte des rites 106 J. M. C. TOYNBEE, Death and burial in the Roman World, London, 1971, p. 79-80. 107 Decreta Pisana (C.I.L., XI, 1421) l. 35. 108 J. SCHEID, o.c. (note 47), 2005, p. 207.
Marin MAUGER
312
suppose une symbolique différente et un emplacement particulier. A la période augustéenne, le culte de l’empereur est pensé comme un honneur intrinsèque à la personne d’Auguste, le chef victorieux. La mise en place du culte dynastique correspond à la concrétisation de la politique idéologique d’Auguste envers ses successeurs ; les crudelia fata109 qui frappent la famille impériale permettent l’intégration du culte en Gaule et dans l’Occident. A la période tibérienne, l’évolution de l’idéologie dynastique, suite à la mort d’Auguste, implique un remanie-ment des honneurs cultuels. En Gaule, la mise en avant de la gens du nouveau prince se traduit par le fleurissement des groupes statuaires dynastiques en hommage principalement à Germanicus et ses pro-ches110. En Narbonnaise, les cultes dynastiques se multiplient et s’individualisent. Ainsi, des prêtrises en l’honneur de Livie111 ou de Germanicus et Drusus112 sont mises en place dans plusieurs colonies. Parallèlement, le culte de l’empereur se développe sous la forme d’un culte au Divus Augustus en Narbonnaise113, tandis que la majorité des cités des Trois Gaules transfère le culte de Rome et d’Auguste au nouvel empereur, suivant la ligne définie par le modèle provincial114.
En Narbonnaise, la monumentalisation précoce des lieux de culte
pour l’empereur et l’absence d’autels dynastiques amènent probable-ment à une réunion, au cours du règne de Tibère, dans un même espace, des cultes voués au prince et à sa gens115. Ce regroupement des cultes se traduit dès le milieu du Ier s. ap. J.-C. par la mise en place d’une prêtrise générique, celle du flamen Aug116. Ce sacerdoce, 109 Decreta Pisana (C.I.L., XI, 1421), l. 13. 110 Voir supra, note 100; E. ROSSO, « La série de dédicaces julio-claudiennes de Ruscino, Château-Roussillon », RAN, 33, 2000, p. 202-222. 111 C.I.L., XII, 4249; C.I.L., XII, 1363 = A.E., 2002, 924. 112 C.I.L., XII, 3180 = A.E., 2005, 1005; C.I.L., XII, 3207 = I.A.N. 110; C.I.L., XII, 1872 = I.L.N., Vienne, 66. 113 A Vienne, on voit la transition entre la première dédicace du temple de Rome et la dédicace tibérienne au Diuus Augustus. C.I.L., XII, 1872 = I.L.N., Vienne, 66. 114 D. FISHWICK, o.c. (note 65), vol. III. 2, Leiden, 2002, p. 19-25. 115 Voir supra, note n° 113. 116 C.I.L., XII, 2249 = I.L.N., Vienne, 386 ; C.I.L., XII, 2608 = I.L.N., Vienne, 846 ; C.I.L., XII, 2349 = I.L.N., Vienne, 547 ; C.I.L., XII, 527 = I.L.N., Aix, 26 ; C.I.L., XII, 2676 = I.L.N., Alba 8 ; C.I.L., XII, 1372 ; C.I.L., XII, 1368 ; C.I.L., XII, 1529.
LA PLACE DE L’AUTEL EN GAULE
313
par la diversité des cultes qui lui incombent, se rapproche de la construction historique entendue par le terme « culte impérial ».
Dans les Trois Gaules, la construction d’autels voués au culte de
Rome et Auguste dans le centre civique et de monuments consacrés au culte ou aux honneurs dynastiques dans un espace annexe peut expliquer l’évolution plus lente du processus117. Ainsi, les attestations d’un flamen Aug n’apparaissent pas avant le IIe s. ap. J.-C. Cette évolution ne doit cependant pas être généralisée. Plusieurs cités conservent au cours des IIe-IIIe s. ap. J.-C. la prêtrise civique de Rome et d’Auguste118. Néanmoins, dans les cités ayant précocement institué des honneurs dynastiques, comme Trèves, Sens119 ou Saintes120, le sacerdoce traditionnellement voué au culte de l’empereur est remplacé par la prêtrise générique consacrée au culte impérial121.
Ainsi, la distinction établie à la période augusto-tibérienne entre
les cultes de l’empereur, d’une part, et les cultes dynastiques, d’autre part, permet d’appréhender l’intégration progressive du culte impérial en Gaule. Finalement, il nous semble possible d’accepter l’affirmation de P. Gros selon laquelle « le culte fut ‘dynastique’ avant de devenir ‘impérial’ »122, à condition d'adjoindre au culte de la gens celui de l'empereur. Le caractère lacunaire du corpus, pour les premières années de l'Empire, empêche toute conclusion définitive. Cependant, nous pouvons supposer que le culte ou les honneurs dynastiques sont nécessaires à la constitution du culte impérial. Ainsi, les cités, qui 117 Nous n’entrerons pas ici dans les débats, néanmoins essentiels, liés au statut juridique de la cité et de son influence sur la prêtrise. Pour un résumé des problématiques : W. VAN ANDRINGA, « Prêtrises et cités dans les Trois Gaules et les Germanies au Haut Empire », dans M. DONDIN-PAYRE, M.-T. RAEPSAET-CHAR-LIER, Cités, Municipes, Colonies : les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut-Empire romain, Paris, 1999, p. 425-446. 118 A.E., 1982, 716 ; C.I.L., XIII, 11353 ; A.E., 2001, 1383 ; C.I.L., XIII, 1376. 119 C.I.L., XIII, 2942 = A.E., 1895, 67. Pour W. VAN ANDRINGA, o.c. (note n°4), 2002, p. 51-52, fig. p. 52, , l'inscription est gravée sur un autel en l'honneur de Caius César, tandis que pour E. ROSSO, o.c. (note 9), 2006, cat. n° 78, elle correspond davantage à une base de statue monumentale ou équestre. 120 C.I.L., XIII, 1036 = I.L.A., Santons, 7. 121 Trèves : C.I.L., XIII, 4030 = A.E., 2007, 122 ; Sens : C.I.L., XIII 2940 = A.E., 2066, 823 / A.E., 1992, 1240 ; Saintes : C.I.L., XIII 1048 + 1074 = I.L.A., Santons 20. 122 Voir supra, note 6.
Marin MAUGER
314
conservent la prêtrise de Rome et d'Auguste jusqu'à la fin du Haut-Empire, n'ont probablement pas développé le culte impérial. C'est donc la réunion dans une même cité des honneurs dynastiques et du culte de l'empereur qui permet la mise en place ultérieure du culte impérial.
Caesarodunum, XLVII-XLVIII, 2013-2014, p. 593-595.
TABLE DES MATIÈRES Robert BEDON et Hélène MAVÉRAUD-TARDIVEAU :
Avant-Propos p. 9-11 Henri LAVAGNE : Introduction p. 13-20 I. Œuvres plastiques étudiées individuellement
ou dans un contexte local Véronique BRUNET-GASTON, Une statuette de Diane
retrouvée dans le complexe monumental de la Rue Belin à Reims p. 23-34
Jean HIERNARD : Du nouveau sur une œuvre d’exception :
la « Minerve » de Poitiers p. 35-48 Jean-Yves ÉVEILLARD : Les divinités protectrices de l’établissement
de salaison de poissons des Plomarc’h (Finistère) p. 49-66 Vincent HINCKER, Grégory SCHÜTZ, Julien DESHAYES :
Figures inédites de Mithra. La découverte de deux blocs sculptés à Jort (Calvados, Basse-Normandie) p. 67-80
II. Présence des dieux dans les sanctuaires des agglomérations Gérard MOITRIEUX : Un sanctuaire de Mithra à Deneuvre
(Meurthe-et-Moselle) p. 83-103 Jean BRODEUR, Lore PETIT : Le mithraeum d'Angers
et son « décor » 105-129 Christophe MANIQUET : Tintignac (Naves, dépt de la Corrèze) :
un imposant lieu de culte en territoire lémovice, mais pour quelles divinités ? p. 131-172
594
Bernard CLÉMENÇON : L'héritage celtique chez les Arvernes à Augustonemetum p. 173-195
Isabelle FAUDUET : Mercure dans les sanctuaires des Trois Gaules p. 197-217
Patrice MONTZAMIR : Présence des divinités dans les sanctuaires
de la partie sud de la cité des Lémovices p. 219-236 Benoît PACE : Organisation spatiale des expressions religieuses
en Aquitaine méridionale durant l’époque romaine : l’apport des Systèmes d’Informations Géographiques p. 237-268
III. Présence des dieux dans la scénographie des agglomérations :
Structuration urbaine, monuments et ornementation Frédéric GERBER : « Les dieux sont au coin de la rue ».
Les autels de carrefour en Gaule et l’archéologie p. 271-288 Marin MAUGER : Placer l’autel dans la ville : intégration
des cultes impériaux et construction civique en Gaule p. 289-314 Yvan MALIGORNE : Présence de l’élément divin dans les ordres
architecturaux des monuments gaulois p. 315-333 Nicolas DELFERRIÈRE : Bacchus, Neptune, une nymphe : quelques
exemples de divinités représentées sur les revêtements architecturaux gallo-romains des Éduens, des Lingons, des Sénons et des Tricasses p. 345-357
IV. Dieux, cultes et expressions cultuelles urbaines dans les civitates et les provinciae.
Hélène MAVÉRAUD-TARDIVEAU : Minerve dans la civitas des Bituriges Cubi p. 361-382
595
Pierre TRONCHE : Epona, déesse à l’étoile et dieux-masques : considérations sur des figurations particulières de divinités en Saintonge p. 383-408
Nicolas MATHIEU : Volkanus / Vulcain dans les Gaules
et les Germanies Une enquête épigraphique et iconographique principalement chez les Voconces et en Lyonnaise p. 409-454
Bernard RÉMY : Des dieux et des hommes au Pègue
(dépt de la Drôme), chef-lieu du pagus Aletanus (?) et dans ses environs immédiats (Montbrison-sur-le-Lez, Rousset-les-Vignes, Taulignan) p. 455-490
Florian BLANCHARD : Présence des divinités et des cultes
dans les villes des Namnètes et des Pictons. Ier siècle av J.-C. -IVe siècle ap. J.-C. Bilan et perspectives p. 491-527
Patrice LAJOYE : Des dieux et des villes en Lyonnaise Seconde.
Quels cultes au cœur des agglomérations ? p. 529-542 Christian VERNOU : Sculptures de bois en Gaule romaine :
entre offrandes cultuelles et effigies divines p. 543-564 Jeanne-Marie DEMAROLLE : Inscriptions sacrées et pratiques
dévotionnelles dans la cité des Médiomatriques p. 565-591 Table des matières p. 593-595 Anciennes parutions dans la série Caesarodunum p. 597-599
Caesarodunum, XLVII-XLVIII, 2013-2014, p. 597-599.
Caesarodunum collection créée par Raymond Chevallier Actes de colloques et Mélanges publiés
antérieurement Caesarodunum, VIII- = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Pour une géographie sacrée de l’Occident romain (Tours, 1972), Tours, 1973, 182 pages. Caesarodunum, X = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Du Léman à l'Océan" (Paris, 1974), Tours, 1975, 229 pages. Caesarodunum, XI = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Le uicus gallo-romain" (Paris, 1976), Tours, 1977, 334 pages. Réédition, Paris, Errance, 1986. Caesarodunum, XII = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Géographie commerciale de la Gaule" (Paris, 1976), Tours, 1977, 2 vol., 278 et 248 pages. Caesarodunum, XIII = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Archéologie du paysage" (Paris, 1977), Tours, 1978, 2 vol., 354 et 263 pages. Caesarodunum, XIV = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Travaux militaires en Gaule Romaine et dans les provinces voisines" (Paris, 1978), Paris, 1978, 2 vol., 244 et 246 pages. Caesarodunum, XV = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Archéologie du paysage urbain" (Paris, 1979), Tours, 1980, 201 pages. Caesarodunum, XVI = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Frontières en Gaule" (Paris, 1980), Tours, 1981, 237 pages. Caesarodunum, XVII = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "La uilla romaine dans les provinces du Nord-Ouest" (Paris, 1981), Tours, 1982, 425 pages. Caesarodunum, XVIII = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Les voies anciennes en Gaule et dans les provinces du Nord-Ouest" (Paris, 1982), Tours, 1983, 488 pages. Caesarodunum, XIX = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Ethnohistoire et archéologie" (Paris, 1983), Tours, 1984, 360 pages.
ANCIENNES PARUTIONS
598
Caesarodunum, XX = R. BEDON, P. AUDIN (éd.), Actes du Colloque "Les débuts de l'urbanisation en Gaule et dans les provinces voisines" (Paris, 1984), Tours, 1985, 443 pages. Caesarodunum, XXI = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Le bois en Gaule et dans les provinces voisines" (Paris, 1985), Paris, Errance, 1986, 328 pages. Caesarodunum, XXII = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Mines et métallurgie en Gaule et dans les provinces voisines" (Paris, l986), Paris, Errance, 1987, 405 pages. Caesarodunum, XXIII = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Le monde des images en Gaule et dans les provinces voisines" (Paris, E.N.S., l987), Paris, Errance, 1988, 256 pages. Caesarodunum, XXIV = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Archéologie de la vigne et du vin en Gaule (Paris, 1989), Paris, De Boccard, 1990, 261 pages. Caesarodunum, XXV = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Peuplement et exploitation en milieu alpin. Antiquité et Haut Moyen Age" (Belley, 1989), Tours, 1991, 254 pages. Caesarodunum, XXVI = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Les eaux thermales et les cultes des eaux en Gaule et dans les provinces voisines" (Aix-les-Bains, l990), Tours, 1992, 472 pages. Caesarodunum XXVII = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Les archéologues et l'archéologie (Bourg-en-Bresse, 1992), Tours, 1993, 418 pages. Caesarodunum, XXVIII = R. BEDON, P.-M. MARTIN, Ch. M. TERNES (éd.), Mélanges R. Chevallier. II, 1, Tours, 1994, 320 pages. Caesarodunum, XXIX = R. BEDON, P.-M. MARTIN, Ch. M. TERNES (éd.), Mélanges R. Chevallier. II, 2, Tours, 1995, 344 pages. Caesarodunum hors série = R. CHEVALLIER (éd.), Actes du Colloque "Homme et animal dans l'Antiquité romaine (Nantes, 1991), Tours, 1995, 470 pages. Caesarodunum, XXX = R. BEDON (éd.), Actes du colloque "Les villes de la Gaule Lyonnaise (Paris, E.N.S., 1995), Limoges, PULIM, 1996, 467 pages. Caesarodunum, XXXXI = R. BEDON (éd.), Actes du Colloque "Les aqueducs de la Gaule Romaine et des régions voisines (Limoges, 1996), Limoges, PULIM, 1999, 786 pages (diffusion C.I.D.). Caesarodunum, XXXII = R. BEDON (éd.), Actes du colloque "Suburbia. Les faubourgs en Gaule Romaine et dans les régions voisines (Paris, E.N.S., 1997), Limoges, PULIM, 1998, 367 pages.
ANCIENNES PARUTIONS
599
Caesarodunum, XXXIII-XXXIV = R. BEDON, A. MALISSARD (éd.), Actes du Colloque "La Loire et les fleuves de la Gaule Romaine et des régions voisines (Orléans, 1998), Limoges, PULIM, 2001, 605 pages (diffusion C.I.D.). Caesarodunum, XXXV-XXXVI = R. BEDON, N. DUPRÉ (éd.), Actes du Colloque "Amoenitas urbium. Les agréments de la vie urbaine en Gaule Romaine et dans les régions voisines (Limoges, 2000), Limoges, PULIM, 2001, 605 pages (diffusion C.I.D.). Caesarodunum, XXXVII-XXXVIII = R. BEDON, N. DUPRÉ (éd.), Actes du Colloque "Rus amoenum. Les agréments de la vie rurale en Gaule Romaine et dans les régions voisines (Limoges, 2002), Limoges, PULIM, 2003-2004, 490 pages (diffusion C.I.D.). Caesarodunum, XXXIX = R. BEDON, E. HERMON (éd.), Actes du Colloque "Concepts, pratiques et enjeux environnementaux dans l’empire romain (Québec, 2004), Limoges, PULIM, 2005, 404 pages (diffusion C.I.D.). Caesarodunum, XL = R. BEDON, Y. LIÉBERT, H. MAVÉRAUD (éd.), Actes du Colloque "Les espaces clos dans l’urbanisme et l’architecture en Gaule Romaine et dans les régions voisines (Limoges, 2004), Limoges, PULIM, 2006, 456 pages (diffusion C.I.D.). Caesarodunum, XLI-XLII = R. BEDON (éd.), Vicinitas aquae. La vie au bord de l’eau en Gaule Romaine et dans les régions voisines (Limoges, 2007), Limoges, PULIM, 2009, 378 pages (diffusion C.I.D.). Caesarodunum, XLIII-XLIV = R. BEDON (éd.), Macella, tabernae, portus. Les structures matérielles de l’économie en Gaule romaine et dans les régions voisines (Limoges, 2009), Limoges, PULIM, 2011, 442 pages (diffu-sion C.I.D.). Caesarodunum, XLV-XVI = R. BEDON (éd.), Confinia. Confins et péri-phéries dans l’Occident romain (Limoges, 2012), Limoges, PULIM, 2014, 622 pages (diffusion C.I.D.).