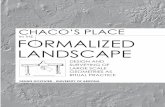Thomas d'Aquin et la place des mots en logique (Philosophia perennis 1 [1994], 35-66)
La place des groupements d'exploitations dans l'évolution des firmes en agriculture
Transcript of La place des groupements d'exploitations dans l'évolution des firmes en agriculture
Philippe Nicolas
La place des groupements d'exploitations dans l'évolution desfirmes en agricultureIn: Économie rurale. N°63, 1965. pp. 27-38.
Citer ce document / Cite this document :
Nicolas Philippe. La place des groupements d'exploitations dans l'évolution des firmes en agriculture. In: Économie rurale. N°63,1965. pp. 27-38.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecoru_0013-0559_1965_num_63_1_1878
AbstractAlthough joint farming is in the center oj present interest it is not yet very Well \nown. Up to the presenttime, agriculture has been to a great extent an enterprise where most oj the inputs are self supplied andwhere the farmer carries on numerous activities. Technical progress has brought about a slow evolutionespecially in the ancillary farm activities. In the beginning mechanization does not bring about anystructural change. But when it develops, it forces the farmers to group their farms or to give them up.The integration phenomenon which has been spectacular in poultry breeding could affect otherbranches of production in the coming years. « Industrial and commercial joint farming » would helpfarmers to \eep the control over ancillary activities.Ambitious farmers would he able to participate in big modern enterprises with joint management. Thecooperatives would profit by this situation. The events that upset the organization and the externalrelations of a farm claim new research methods. This group farming could accomplish the transitionfrom a self supplied agriculture to an industrial agriculture. This would be a conspicuous experience ifthe farmers could ^eep their decision power.
RésuméBien qu'au centre de l'actualité agricole, les groupements d'exploitation sont encore mal connus.Jusqu'à nos jours, l'agriculture a été, pour une grande part, artisanale, l'exploitant exerçant denombreuses activités.Une lente évolution s'est faite sous l'action du progrès technique, en particulier dans les activitéspériphériques de l'exploitation. Au départ la mécanisation ne bouleverse pas les structures. Mais en sedéveloppant, elle oblige les exploitations à se grouper ou à disparaître. Les phénomènes d'intégration,spectaculaires en aviculture, pourraient affecter, dans les années qui viennent, d'autres branches deproduction.«L'agriculture de groupe industrielle et commerciale» devrait permettre aux agriculteurs de garder lecontrôle des activités périphériques. Les agriculteurs dynamiques pourraient participer à de grandesentreprises modernes à gestion collective. Les coopératives bénéficieraient de cette situation.Les bouleversements qui affectent l'exploitation dans son organisation intérieure et ses relationsextérieures obligent le chercheur à développer de nouvelles méthodes d'étude.Le passage d'une agriculture artisanale à une agriculture industrielle peut être réussi par l'intermédiairedes groupements. S'il maintient le pouvoir de décision des travailleurs, ce serait une expériencesingulière.
r
LA PLACE DES GROUPEMENTS D'EXPLOITATION
DANS L'EVOLUTION DES FIRMES EN AGRICULTURE
par Philippe NICOLAS
Chargé de Recherches à l'I.N.R.A.
THE PLACE OF JOINT FARMING IN THE EVOLUTION OF FARM SYSTEMS
Although joint farming is in the center oj present interest it is not yet very Well \nown. Up to the present time, agriculture has been to a great extent an enterprise where most oj the inputs are self supplied and where the farmer carries on numerous activities. Technical progress has brought about a slow evolution especially in the ancillary farm activities. In the beginning mechanization does not bring about any structural change. But when it develops, it forces the farmers to group their farms or to give them up. The integration phenomenon which has been spectacular in poultry breeding could affect other branches of production in the coming years. « Industrial and commercial joint farming » would help farmers to \eep the control over ancillary activities.
Ambitious farmers would he able to participate in big modern enterprises with joint management. The cooperatives would profit by this situation. The events that upset the organization and the external relations of a farm claim new research methods. This group farming could accomplish the transition from a self supplied agriculture to an industrial agriculture. This would be a conspicuous experience if the farmers could ^eep their decision power.
Bien qu'au centre de l'actualité agricole, les groupements d'exploitation sont encore mal connus. Jusqu'à nos jours, l'agriculture a été, pour une grande part, artisanale, l'exploitant exerçant de nomb
reuses activités. Une lente évolution s'est faite sous l'action du progrès technique, en particulier dans les activités péri
phériques de l'exploitation. Au départ la mécanisation ne bouleverse pas les structures. Mais en se développant, elle oblige les exploitations à se grouper ou à disparaître. Les phénomènes d'intégration, spectaculaires en aviculture, pourraient affecter, dans les années qui viennent, d'autres branches de production.
«L'agriculture de groupe industrielle et commerciale» devrait permettre aux agriculteurs de garder le contrôle des activités périphériques. Les agriculteurs dynamiques pourraient participer à de grandes entreprises modernes à gestion collective. Les coopératives bénéficieraient de cette situation.
Les bouleversements qui affectent l'exploitation dans son organisation intérieure et ses relations extérieures obligent le chercheur à développer de nouvelles méthodes d'étude.
Le passage d'une agriculture artisanale à une agriculture industrielle peut être réussi par l'intermédiaire des groupements. S'il maintient le pouvoir de décision des travailleurs, ce serait une expérience singulière.
Des CUMA aux GAEC
De nouvelles formes d'associations d'agriculteurs dans l'entreprise, mais pour des activités de production agricole proprement dites ( 1 ) , se sont développées en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Ce type d'associations, déjà pratiqué bien avant cette date dans Têntr'aide traditionnelle (par exemple pour -le battage), a pris i une ampleur et un aspect nouveaux en raison des progrès très rapides des techniques.
Les groupements pour l'achat et l'utilisation du matériel, soit sous la forme des C.U.M.A. (2), soit surtout, du moins en France, sous la forme plus spontanée des groupements de fait, recouvrirent d'abord le territoire d'un véritable feutrage d'associations. De ces formes primitives surgirent ensuite les associations dans un chantier ou un atelier collectif, puis les groupements d'exploitations complètes.
Ce phénomène ne retint qu'assez peu l'attention au cours des années « 50 » et son travail peut être qualifié, dans cette période, de . souterrain (3).
Mais l'importance que les problèmes des structures des exploitations prirent, dans les faits et dans l'opinion, à partir de 1960, firent de ces associations un sujet d'actualité.
Nous entreprîmes, à cette époque, dans le cadre de l'I.N.R.A., et avec le concours de l'Union des Groupements pour l'Exploitation Agricole (U.G.E. A. qui, à l'époque, s'appelait U.E.C.R.), d'en faire un premier recensement et d'établir quelques monographies. Les résultats, publiés en avril 1962, permirent de présenter une première classification (4) .
Cependant, cette enquête n'était nullement exhaustive; de plus, ce phénomène a naturellement poursuivi son évolution.
Toujours restés au cœur de l'actualité depuis lors, les groupements d'exploitation ont donné lieu à une abondante littérature, à des enquêtes monographiques, à des prises de position économique, technique, juridique, voire politique.
Avec la parution récente (3 décembre 1964) des décrets d'application consécutifs aux dispositions
(1) II faut donc les distinguer des activités d'amont et d'aval réalisées dans les coopératives.
(2) Les C.U.M.A. existaient avant la guerre, mais prirent une ampleur particulière à la Libération, pour des raisons techniques et administratives.
(3) II est à noter cependant que des monographies et des articles furent publiés dès cette époque, notamment dans le bulletin de l'Union des Ententes et Communautés Rurales (U.E.C.R.) et dans la revue Paysan. Mais le grand engouement ne vint qu'en suite.
(4) Nicolas Ph. — Croissance des entreprises et groupements agricoles d'exploitation. I.N.R.A., avril 1962, publié dans la revue « Agriculture de Groupe », juillet 1962.
de la loi du 8 août 1962, l'intérêt continue à croître. Commentaires, conférences de presse, déclarations des représentants d'organisations professionnelles se succèdent. L'agriculture de groupe eût même les honneurs de la page économique du journal « Le Monde » (28 et 29 mars 1965). Mais avec l'intérêt, les controverses elles aussi rebondissent.
Le phénomène est-il à l'échelle de la littérature et de la publicité qu'il inspire ou s'agit-il d'un événement marginal ? Le groupement d'exploitation permettra-t-il de résoudre une partie des difficultés des agriculteurs ou n'est-il qu'un expédient d'une efficacité douteuse ? Car, si on ne leur reproche plus aujourd'hui (ou du moins rarement) d'être des kol» khozes déguisés, on ne leur accorde souvent qu'une utilité discutable.
L'absence d'un recensement exhaustif et d'études systématiques interdit malheureusement de répondre et d'éclairer suffisamment le débat. Les statuts- types, d'autre part, n'étant pas encore parus, un grand nombre d'associations de faits, qui voudraient prendre la forme juridique « G.A.E.C. » (Groupement agricole d'exploitation en commun) restent sur leur faim. Vingt, trente groupements de fait attendent souvent, dans un même département, de pouvoir accéder au grand jour. L'accord de l'agrément révélera peut-être ainsi, dès la parution des statuts-types, plusieurs milliers de G.A.E.C. vivant aujourd'hui « incognito ».
Pour pallier cette fâcheuse carence d'informations, un certain nombre d'organismes (5) réalisent cette année des études et un recensement.
Nous sommes donc à la veille de nouvelles observations « sur le vif » et nous n'apporterons que fort peu d'éléments concrets nouveaux, par rapport à notre dernière publication. Cet exposé n'est qu'un effort de mise au point pour tenter de préciser les directions principales qu'il serait - souhaitable de donner à nos investigations.
Le point de départ de notre analyse est la constatation que les groupements pour l'exploitation agricole ont un double rôle :
— un rôle économique : préparation des structures pour l'accueil de l'innovation;
— un rôle sociologique : préservation des prérogatives de l'exploitant agricole par l'action collective.
De ce fait ils présentent des analogies avec les autres transformations qui ont affecté la structure de toutes les firmes de l'agriculture. Nous essaierons d'abord de mettre ces analogies en évidence par une description sommaire de l'évolution, puis de discerner le rôle qu'ils pourraient jouer dans l'avenir.
(5) Notamment C.N.J.A., I.G.E.R., U.G.E.A., I.N.R.A.
28 —
Nous distinguerons une première période d'évolution : celle de la réduction des activités des exploitations agricoles et de la reprise, à plus grande échelle, de ces activités dans des organismes tiers.
La seconde période sera celle de la coordination
des activités par liaisons verticales de ces organismes et de ce qui reste de l'exploitation.
Un rapide aperçu sur la situation actuelle de la recherche sur les problèmes de dimensions et d'organisation des firmes, sera esquissé dans une dernière partie.
LA REDUCTION DES ACTIVITES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE
Faible croissance interne des exploitations, mais développement d'organismes tiers.
Au 19e siècle, V agriculteur est un homme aux multiples métiers.
En France, la révolution industrielle ne fjut pas associée, comme elle le fut en Angleterre, à une réforme agraire (enclosure) .
De sorte qu'au XIXme siècle, l'agriculteur français est, dans le cas le plus général, un travailleur isolé, vivant avec sa famille, sur une petite exploitation. Non seulement ce personnage est bien loin de pouvoir pratiquer une division du travail dans l'atelier, mais encore il est lui-même très peu spécialisé. Autrement dit, dans son cas, la division du travail dans la société est très peu poussée, et il se livre à des activités multiples, qui correspondent séparément à un métier.
Les facteurs de production, beaucoup plus rudi- mentaires qu'aujourd'hui, ne sont pas fournis par l'extérieur, mais par l'exploitation (auto-approvisionnement) (6) . Il vend lui-même ce qu'il ne consomme pas. Ses productions sont multiples et il les transforme. Il assure aussi la gestion et l'expérimentation technique, pour autant qu'elles existent autrement que sous la forme de routines.
Naturellement ces activités sont faiblement individualisées, et beaucoup, pratiquées plus ou moins consciemment à petite échelle, présentent un état embryonnaire (pour la vente par exemple, pensons à la forte auto-consommation) . L'agriculteur est non seulement un entrepreneur de transport, mais un commerçant, un artisan etc.. qui s'ignore.
La division du travail dans la société est si peu poussée au début du XIXme siècle, qu'il est aussi, souvent, tisserand et fileur (7). C'est lorsque la machine a rendu nécessaire le rassemblement des
(6) Certes, il existait des entreprises chargées de la fourniture des facteurs : maréchal-ferrant, bourrelier, etc.. Mais les engrais chimiques, les aliments du bétail, les produits de traitement etc.. avaient des homologues fournis par l'exploitation elle-même.
(7) DUNHAM (A.-L.). — La révolution industrielle en France - Paris 1953.
travailleurs dans l'atelier (8) , que ces activités ont été détachées de l'exploitation.
L'évolution technique force à la spécialisation
A certains indices, on pourrait croire que la situation a peu évolué en France depuis cette période. En effet, les exploitations les plus nombreuses sont les exploitations familiales à « deux U.T.H. » ou « deux hommes actifs », vouées à la poly-culture et au poly-élevage.
Il ne saurait donc être question d'une grande spécialisation, et encore moins d'une grande division du travail dans l'atelier.
Mais une appréciation aussi rapide risquerait d'être trompeuse. Car elle nous masquerait la lente mais certaine modification des structures depuis le XIX""8 siècle, tout autant que les transformations qui les affectent depuis la Libération, et le bouleversement qui doit les atteindre dans les prochaines décennies.
En fait, on a assisté à un incontestable renforcement de la spécialisation, chaque fois que l'évolution des techniques propres à l'exploitation, ainsi que celle des marchés et des transports, rendaient avantageux l'exercice de certaines activités à plus grande échelle.
L'exploitation abandonne certaines activités à des tiers.
Cette spécialisation ne s'est pas réalisée par la croissance interne des exploitations agricoles. C'est- à-dire que ces dernières n'ont pas augmenté leurs dimensions (terres, personnel, capital) pour se transformer en grandes firmes complexes assurant toutes les activités d'origine dans des départements distincts.
De même, dans l'industrie, ce n'est pas l'entreprise artisanale qui a donné l'entreprise industrielle puisque, le plus souvent, ce sont des marchands qui ont contrôlé le travail à domicile et rassemblé les travailleurs dans des manufactures.
Chaque exploitant ne pouvant, dans les conditions économiques et politiques de la France, assumer seul
(8) Nous ne prétendons pas qu'il n'existait pas d'ateliers, et de manufactures, avant la mécanisation.
-29-
à plus grande échelle, toutes les tâches primitives, ces dernières ont été abandonnées par l'exploitation pour être reprises par d'autres organismes préexistants ou créés pour la circonstance.
Naturellement, le progrès des techniques propres à l'agriculture, ou des techniques des industries en relation avec l'agriculture, modifie les caractères de ces activités. Aux engrais organiques s'ajoutent les engrais chimiques; aux outils, les machines; aux fourrages, les aliments du bétail, etc..
Les activités qui ressemblaient le plus à celles de l'industrie (transformation des produits, fabrication des facteurs) et qui étaient également le plus proche des autres secteurs ou des consommateurs, se spécialisèrent les premières. Ceci pour des raisons techniques et pour des raisons commerciales (pouvoir de marchandage). Devenues autonomes, ces activités étaient pratiquées non plus pour une exploitation, comme auparavant, mais pour un ensemble d'exploitations.
Les avantages techniques de l'accroissement d'échelle sont bien connus (9) .
On peut utiliser économiquement les machines et pratiquer la division du travail. Un simple accroissement d'échelle, sans mécanisation, mais permettant une réduction de certains frais généraux et une division du travail rudimentaire, peut être avantageux; si l'innovation mécanique exige et provoque le plus souvent l'accroissement d'échelle, il n'est pas exclu que ce dernier caractère se manifeste sans changement notable dans l'équipement.
Bien que n'attaquant pas encore de front la production du sol et l'élevage, le progrès technique bouleverse les activités périphériques de l'exploitation agricole.
Les dimensions de l'exploitation ne sont pas remises en question.
Sur ce qui reste de l'exploitation agricole, la pression de l'innovation s'exerce d'abord assez peu. Toutes les innovations n'exigent pas un accroissement d'échelle : par exemple, les engrais, les produits de traitement, ou les semences sélectionnées. Les premières entreprises qui se mécanisent, les grandes, avec salariés, peuvent le faire sans changer notablement leurs structures et leurs dimensions alors qu'elles aussi avaient été contraintes d'abandonner les activités périphériques. L'exploitation familiale, enfin, est protégée, pour des raisons sociales, politiques, voire économiques. Protection contre la concurrence étrangère, de la 3m< République aux premiers effets du Traité de Rome ; protection contre la concurrence intérieure, par l'intervention de l'Etat sur les prix.
Mais, quoique les dimensions de l'exploitation ne soient pas encore remises en question, l'innovation présente une nouvelle exigence. On sait que Raymond Aron, dans la cinquième de ses leçons sur la « Société Industrielle », professée à la Sor- bonne en 1955-1956 (10) propose de définir l'entreprise industrielle au moyen de cinq caractères : elle est séparée de la famille; elle utilise la division technologique du travail; elle suppose une accumulation du capital (c'est-à-dire, en particulier, le développement des machines) ; elle introduit le calcul rationnel; elle concentre les ouvriers sur le lieu de travail.
Nous avons déjà vu apparaître les trois premiers caractères, première manifestation de ce que l'on appelle « l'industrialisation de l'agriculture » (11), et qui traduit simplement l'application, aux activités de l'agriculture, des méthodes utilisées pour les activités de l'industrie. Le cinquième caractère pose des problèmes spécifiques dans le cas de l'agriculture.
Mais à partir de 1945, le quatrième caractère apparaît et se manifeste comme les premiers, par une spécialisation et un regroupement des activités, ici les activités de calcul économique et d'études techniques, dans des organismes tiers les pratiquant à plus grande échelle (12).
Le progrès technique impose l'association
A peu près vers la même époque, la mécanisation lentement mise en place au cours des décennies précédentes (surtout dans les plus grandes exploitations) prend un essor décisif et pénètre également dans les entreprises moyennes et mêmes petites. Mais, en raison de l'exiguïté de ces dernières, il y a le plus souvent sous-emploi et même inadaptation. Le cas est flagrant pour les tracteurs, leur puissance dépendant non des dimensions, mais de la nature des sols et des travaux. De sorte que, à nouveau, des organismes tiers apparaissent et se multiplient : ce sont les firmes de services mécanisées, privées ou coopératives (C.U.M.A.) qui permettent l'accroissement d'échelle et l'utilisation économique des machines.
Ainsi, à ce stade, il est clair que, lorsque le progrès technique affecte une activité et ne peut être accueilli dans les structures en place, ou par croissance interne, l'activité affectée est détachée de l'exploitation et exercée à une plus grande échelle par un organisme tiers.
(9) Nous avons analysé ces avantages en détail, dans le cas de l'agriculture, dans notre note d'avril 1962, déjà citée.
(10) ARON (Raymond). — Dix-huit leçons sur la société industrielle - Gallimard, 1962, p. 97 à 100.
(11) Cette expression est depuis longtemps critiquée par certains économistes ruraux qui insistent sur les caractères différents de l'industrie et de l'agriculture. Ils y voient une source de confusion et ils craignent un amalgame trop hâtif.
(12) II s'agit naturellement des C.E.T.A. et des centres de gestion.
-30-
Ces modalités d'accueil vont persister mais, à côté d'elles, d'autres vont se manifester qui, d'ailleurs, étaient déjà contenues en germe dans l'en- tr'aide paysanne.
L'agriculteur, ne pouvant guère abandonner de nouvelles activités, sans abandonner l'agriculture elle-même, va tenter de constituer un cadre d'accueil pour l'innovation, en exerçant directement ces activités en association avec d'autres agriculteurs.
L'emploi des machines est trop étroitement lié à la production, et les productions elles-mêmes trop étroitement interdépendantes, pour que l'on puisse les pratiquer isolément. Les agriculteurs jugent donc nécessaire de s'occuper eux-mêmes des unes et des autres, en association, mais au sein d'un même ensemble.
Naturellement cette nécessité n'a rien d'absolu. Nous l'avons vu, on peut avoir recours à des entreprises. Les plus grandes exploitations peuvent encore accueillir l'innovation mécanique individuellement. Toutes les productions ne sont pas interdépendantes, et on peut encore se spécialiser. On peut même constituer des organismes distincts pour certaines productions difficilement praticables isolément : les « céréaliers » et les arboriculteurs cherchent à créer des troupeaux bovins collectifs, contrôlés par eux, certes, mais à gestion autonome.
Le phénomène affecte toutes les entreprises
II n'en reste pas moins que l'association d'exploitants dans des groupements où ils fournissent eux- même l'essentiel du travail, s'est développée considérablement depuis une vingtaine d'années, timidement d'abord et lorsqu'elle ne mettait pas trop en question l'autonomie de l'agriculteur. On court au plus pressé : l'achat et l'usage des machines en commun (qui concerne en France la quasi-totalité des exploitations où le travail est fourni en majeure partie par la famille). Mais on en vient vite aux chantiers collectifs (avec division du travail), également très répandus. La collectivisation de l'ensemble d'une production est beaucoup plus rare, d'autant plus que, lorsqu'elle affecte une production étroitement liée à d'autres dans un complexe difficilement dissociable (bovins, fourrages, et même céréales) , par l'assolement ou l'inorganisation du marché elle entraîne en peu de temps la collectivisation de l'ensemble de l'exploitation.
En dépit de la rareté des groupements complets (quelques milliers peut-être, pour autant que l'insuffisance présente des observations nous permette d'avancer un chiffre), l'association des agriculteurs pour l'exercice collectif des activités de production agricole, n'en reste pas moins une réalité. Et elle représente bien une nouvelle modalité d'accueil de l'innovation.
Elle affecte toutes les entreprises puisque même les grandes exploitations se groupent pour des éta-
bles collectives qui restent, quel que soit leur mode de gestion, très étroitement liées au reste des productions (fourrages, fumier) , puisque même les arboriculteurs (vergers collectifs), et les aviculteurs (poulaillers collectifs) s'associent.
Mais ces derniers, on le sait, en raison de leur indépendance par rapport au sol, et de leur avance technique, sont déjà entraînés, par la grâce d'une innovation continue et accélérée, dans de nouveaux avatars.
Car les causes qui ont suscité la dissociation des activités, provoquent maintenant leur recoordination. Nous les examinerons tout à l'heure séparément bien que, depuis une dizaine d'années, ces phénomènes se chevauchent dans le temps (13).
Pour en terminer avec cette première analyse insistons bien sur un point essentiel. On se groupe pour rechercher des avantages liés à l'échelle. Mais on ne recherche pas obligatoirement l'innovation et une division très poussée du travail. Ainsi on garde cinq étables archaïques, éloignées les unes des autres, et on s'associe pour établir une rotation dans les traites du dimanche. Il y a juxtaposition plutôt que fusion. Mais naturellement, les avantages complets ne sont accordés que par la fusion (innovations et division du travail) . Evitons de cr
itiquer cette dernière forme, achevée, en montrant les insuffisances de la première !
L* « Agriculture de Groupe » permet aux agriculteurs de contrôler une partie des nouveaux organismes tiers.
Les lenteurs de V industrialisation...
Parmi les organismes environnants créés ou développés par l'industrialisation, ainsi que parmi les exploitations-soldes à plus grande échelle, une partie importante se trouve contrôlée par les exploitants agricoles au moyen de l'action collective.
Talonnés par le progrès technique et menacés d'être débordés par la révolution industrielle dont l'une des conséquences est la concentration du pouvoir économique dans un petit nombre de firmes oligopolistiques, les agriculteurs ont réagi et se sont tournés vers l'association. Réaction peu différente de celle des artisans et de certains théoriciens du XIX™ siècle, qui fondaient dans la coopération tous leurs espoirs dans la lutte contre le capitalisme naissant (14).
Mais, par une sorte de coquetterie du sort, le retard du secteur agricole qui, en bien des domaines,
(13) II eut été surprenant de rencontrer, à une même date toutes les firmes et toutes les productions au même stade d'évolution, étant donnée leur hétérogénéité.
(14) LHOMME Jean. — La grande bourgeoise au pouvoir - Paris, P.U.F., 1960.
— 31
avait été fort préjudiciable aux agriculteurs, s'est montré favorable à la coopération agricole.
C'est bien là, incontestablement, l'une des particularités de l'agriculture. Sans revenir au dogme de l'isolement de l'agriculture, en marge de l'industrialisation, on ne doit cependant jamais admettre d'emblée l'analogie totale. Le seul fait qu'entre agriculture et industrie existe un décalage de plusieurs décennies équivaut à un aveu. Ce décalage qui est un symptôme, est également la source de nouvelles disparités. La situation de l'agriculture est un peu comparable à celle de ces pays, qui, deux siècles après l'Angleterre, commencent à s'industrialiser.
Ils ont déjà subi le choc des transformations des autres pays et ils doivent compter, de plus, avec l'action présente de ces mêmes pays industrialisés. ... ont permis la création d'organismes collectifs
Quoi qu'il en soit, bénéficiant de la lenteur relative de l'industrialisation, les agriculteurs que les événements ne bousculaient pas au même rythme que les artisans ont réussi à construire toute une gamme d'organismes contrôlés et administrés collectivement.
Ce furent les coopératives (et S.I.C.A.), les C.U. M. A., les CE. T. A., les Centres de Gestion et, derniers en date, les groupements d'exploitations, avec les caractères spécifiques que nous avons signalés précédemment.
Tous ces organismes ont en commun de constituer un cadre d'accueil pour l'innovation et de permettre aux agriculteurs de sauvegarder leur indépendance économique, ils présentent des analogies économiques et sociologiques.
Ils présentent aussi des différences. Si dans les groupements d'exploitations, et ce point est d'ailleurs inscrit dans la loi, à forme G.A.E.C., les agriculteurs travaillent eux-mêmes avec les moyens de production mis en commun, par contre, dans les coopératives, le travail est essentiellement exécuté par des salariés. LesC.U.M.A. représenteraient sous cet aspect, un cas intermédiaire. D'autre part, si l'on peut espérer que, dans les groupements d'exploitations (qui associent un nombre restreint d'agriculteurs : moins de dix) , chaque membre participe effectivement aux responsabilités et aux décisions, on sait que dans le cas des coopératives, le désintéressement est un phénomène général. Ceci ne veut pas dire que leur gestion échappe aux agriculteurs : 1 une des principales critiques présentées au cours des derniers travaux de la S.F.E.R. insistait au contraire sur lejmanque de liberté des directeurs, soumis au contrôle permanent des administrateurs. Certains observateurs d'autre part, soupçonneraient déjà une sorte de « danger technocratique » au sein des groupements. Ils craignent que la plupart des
ciés, abandonnant progressivement leurs responsabilités, s'en remettent finalement aux décisions d'un seul.
Quoiqu'il en soit, les analogies restent assez fortes et évidentes pour que l'on cherche à rassembler toutes ces formes d'action collective sous un même terme générique.
C'est ainsi que le sens de l'expression « Agriculture de Groupe » qui a d'ailleurs toujours été flottant, tend récemment à s'élargir pour englober non seulement les groupes partiels ou complets d'exploitations, mais aussi les coopératives et toutes les « firmes-services » collectives. Dans un exposé présenté à Rennes, en mai 1963, M. Moisan (Président du C.E.D.A.G.) déclarait : « N'oublions pas que l'Agriculture de Groupe, c'est aussi la coopérative de vente ou d'approvisionnement » (15). M. Liau- don, au dernier Congrès du C.N.J.A., parle : « d'Agriculture de Groupe industrielle et commerciale » en précisant que « Coopératives et Unions seront les véritables entreprises de l'Agriculture de Groupe » (16).
L'analogie sociologique est donc bien mise en évidence. Quant à l'analogie économique (rôle progressif, d'accueil de l'innovation) elle nous paraît clairement exprimée par le Professeur Malassis qui écrit (17) : « Par Agriculture de Groupe, nous entendons donc de nouvelles formes d'organisation de la production... c'est un ensemble de recherches... pour répondre à certaines évolutions des conditions de la production et aussi à certaines aspirations du monde rural ».
Aussi les groupements d'exploitations se situent de façon significative dans l'évolution des firmes de l'agriculture, et dans les adaptations sociologiques à cette évolution.
Cependant, la révolution industrielle qui, comme nous l'avons dit, avait laissé un répit aux agriculteurs, entraîne maintenant les événements dans un mouvement accéléré. Aux phénomènes de dissociation, qui se poursuivent encore, se sont superposés des phénomènes de recoordination dans de grands ensembles complexes au moyen de liaisons verticales.
Comment les agriculteurs envisagents-ils de répondre à ces nouveaux événements, et quelle sera la place des Groupements d'Exploitations dans cette conjoncture ?
(15) Journée régionale d'étude de l'agriculture de groupe. Rennes, le 4 mai 1963. Document n° 10 du C.E.D.A..G
(16) Pour une agriculture de groupe industrielle et commerciale - Rapport du IXme Congrès du C.N.J.A. 30 septembre 1964.
(17) Document n« 10 du C.E.D.A.G., déjà cité.
-32-
LA RECOORDINATION DES ACTIVITES : LES LIAISONS VERTICALES
La recoordination pourrait affecter toutes les productions.
Les causes qui ont suscité la dissociation des activités provoquent maintenant leur recoordination, disions nous plus haut.
Nous faisons naturellement allusion aux phénomènes d'intégration, ou de quasi intégration, qui se sont manifestés de façon spectaculaire pour l'aviculture et que les travaux de J. Le Bihan ont abondamment illustrés.
Les organismes d'amont et d'aval cherchent à s'assurer le contrôle de leurs approvisionnements et de leurs débouchés. Ce phénomène n'est pas nouveau, puisqu'on le rencontre en France dès le début de la révolution industrielle (18). L'accueil de l'innovation impose le plus souvent, en effet, de gros investissements qui doivent être amortis convenablement. De plus, pour conserver ses débouchés ou en conquérir de nouveaux, il est nécessaire d'assurer une offre régulière, de nature et de qualité déterminée, et de réduire les coûts de production et de collecte. De sorte qu'un investissement sur une opération, peut rendre nécessaire une opération analogue sur les opérations qui précèdent ou sur celles qui suivent.
On a dit que ce qui se passait dans l'aviculture était tout à fait particulier, en raison de la spécifité même de cette branche. Il est certain qu'elle se prêtait mieux que tout autre à l'application de méthodes industrielles. Indépendante du sol, n'achoppant pas sur le goulot d'étranglement que représentent les reproducteurs (comme dans le cas des porcs et des bovins) elle se prête à une production de masse systématisée. Mais sera-t-elle seule à s'y prêter, ou, au contraire, est-elle la première (en raison de ses caractères favorables) à subir une évolution qui devrait affecter tous les produits ?
Si l'on considère les autres productions indépendantes de l'assolement ou du sol, la seconde éventualité paraît la plus vraisemblable. On en voit déjà les prémices. Ainsi, par exemple, la presse (19) rendait compte récemment des projets d'une Union de Coopératives Fruitières du Midi qui veut « créer des vergers produisant de la matière première utilisable » au lieu d'édifier a posteriori une « usine poubelle ». Les arboriculteurs seraient liés à leur usine par des contrats définitifs. Les premiers seront tenus de livrer toute leur récolte et la seconde de l'acheter. Pour l'intégration des porcs, d'autre part, nous avons pu constater, au cours d'une enquête
dans un département du Centre, que la « phase de décollage » était déjà dépassée.
En ce qui concerne les productions interdépendantes comme les bovins, les fourrages, voire les céréales, la situation est moins claire. Tout d'abord elles sont déjà soumises entre elles à des liaisons verticales particulièrement difficiles à rompre en raison de l'état actuel des techniques (assolement, fumure) et des marchés (fourrages, fumiers). Sauf dans le cas des « céréaliers », on peut dire qu'elles n'ont pas encore atteint la phase de dissociation (20) . La plupart des étables collectives, en particulier, n'ont eu en tant qu'organismes autonomes, qu'une vie éphémère, l'ensemble des exploitations se groupant quelques mois après leur création. C'est ce qui ressort clairement des observations que MM. Delas- sault pour l'I.N.R.A., et Outers, pour l'U.G.E.A. ont faites en 1962 au cours d'une enquête de plusieurs mois.
Mais, il n'en est pas moins vrai que les nécessités d'une recoordination plus étendue avec l'amont et l'aval se font déjà sentir. Inutile de faire des investissements dans une étable moderne si le lait, propre, conservé en cuves réfrigérées, doit être ramassé par des coopératives archaïques. Les coopératives dynamiques, de leur côté, se préoccupent des installations qui pourraient être réalisées dans les exploitations, dont le plus souvent elles déplorent l'exiguïté. On connaît d'autre part les efforts importants qui sont entrepris actuellement pour la production de « viande industrielle ». Enfin, le choix de la forme S.I.C.A., plutôt que la forme coopérative, pour les organismes de transformation de bétail en viande, montre bien l'importance des nécessités de l'approvisionnement. Importance qui ne pourrait que croître si ces organismes faisaient de notables investissements. Il n'est jusqu'à la production des céréales elles-mêmes qui pourrait faire, et fait déjà, l'objet d'une sorte de planification par des organismes de commercialisation.
Naturellement les modalités de la recoordination ne seront pas les mêmes pour toutes les productions et il faudra qu'elles s'adaptent aux caractères propres de l'offre et de la demande de chaque produit.
« Etant donné, qu'en plus des caractères déjà énu- mérés, elle exigera une forte organisation commerciale, un important pouvoir de négociation, et une notable diversification des produits offerts, aussi bien pour satisfaire la clientèle que pour se prémunir contre les risques, les organismes coordinateurs auront tendance à accroître leurs dimensions au-delà même des nécessités de la technique. Or, à la dis-
(18) GILLE B. — Recherches sur la formation de la grande entreprise capitaliste. Paris, S.E.V.P.E.N., 1959.
(19) Le Monde, 18 février 1965.
(20) Si elle doit être atteinte : il est possible que la coordination avec l'amont et l'aval enlève toutes raisons d'être à ce stade intermédiaire.
— 33 —
parité des dimensions correspond une disparité des pouvoirs. Et précisément le pouvoir de décision passe du producteur de base à la firme intégrante parce qu'elle est de loin la plus puissante et parce que d'elle dépend l'écoulement des produits. C'est l'étude des marchés, la prospection des possibilités de vente qui détermine le programme de production (21). Les exploitants agricoles, les responsables « d'ateliers » ne prennent plus, dès lors, que des décisions dépendantes. Les organismes ne sont plus des firmes autonomes mais des satellites.
Si l'on considère l'agitation qui règne dans l'aviculture, on peut raisonnablement penser que les agriculteurs mesurent assez bien l'inconvénient de dépendre, sans pouvoir de contrôle, de firmes géantes et polyvalentes (22) .
Certains agriculteurs prennent suffisamment au sérieux les possibilités d'une généralisation des phénomènes de recoordination verticale, quelles qu'en soient les modalités, pour se préoccuper d'un développement nouveau de l'action collective. C'est ce que nous allons examiner maintenant.
L'Agriculture de Groupe industrielle et commerciale.
Puisque l'évolution semble se diriger vers la constitution de grands ensembles complexes, englobant production, approvisionnement et commercialisation, et que le pouvoir de décision semble échapper progressivement aux agriculteurs pour se concentrer dans les activités périphériques, certains de ces agriculteurs estiment l'essentiel d'accorder une importance nouvelle à des organismes périphériques particuliers, les coopératives agricoles.
De là, la prise de position du C.N.J.A. au cours de son IXme Congrès est particulièrement nette. « Les ateliers de production » écrit M. Liaudon, « doivent s'insérer dans des ensembles plus vastes... coopératives de base et Union de coopératives qui seront les véritables entreprises de l'Agriculture de Groupe ». Ce qui se trouve résumé par la formule suivante : « Nous choisissons une Agriculture de Groupe industrielle et commerciale » (23) .
Mais naturellement, au sein des ensembles constitués autour des coopératives et de leurs Unions, on ne rencontrera pas seulement des groupements agricoles pour l'exploitation en commun, ces types d'en-
(21) Voir l'exposé de M. Knoertzer à la dernière réunion de la S.F.E.R. In : Economie Rurale, n° 62, octobre-décembre 1964.
(22) Les difficultés de l'aviculture proviennent aussi naturellement, de problèmes spéciaux d'écoulement.
(23) II est prescrit dans le même rapport que les agriculteurs ne revendiquent pas, pour les coopératives, un monopole qui affadirait sans doute « l'esprit de compétition et l'émulation nécessaire au progrès ».
treprises n'étant encore représentés que par une minorité des exploitations agricoles. Dans le « schéma d'ensemble des structures de l'Agriculture de Groupe Industrielle et Commerciale (A.G.I.C.) » M. Liaudon prévoit plusieurs formes d'entreprises de base (en « ateliers »). Selon la terminologie et les abréviations qu'il utilise, on rencontrera :
1) Des exploitations patronales (E.P.) ; 2) Des nouvelles entreprises agricoles (N.E.A.)
(24); 3) Des groupements d'exploitations (G.E.) ; 4) Des petites exploitations isolées (P.E.I.) . Entre les deux premières formes et les groupe
ments, la différence est d'ordre sociologique. Le travail est surtout « familial » dans les groupements, tout au moins lorsqu'il s'agit de G.A.E.C, salarié dans les autres cas.
Par contre, l'accueil de l'innovation, la participation effective à la gestion des coopératives sont possibles dans l'une ou l'autre des trois premières formes.
Il n'est pas exclu, comme nous l'avons vu, que les exploitations patronales, elles aussi, se groupent pour une partie des productions. Ces diverses formules d'accueil de l'innovation dans l'exploitation, sont évidemment adaptées à des situations régionales spécifiques. Mais toutes sont, économiquement, des formes progressives.
Au contraire, et pour une même « population », entre les G.A.E.C. et les petites exploitations isolées, il existe une différence économique fondamentale.
C'est en opposant ces deux dernières formes d'exploitation que nous allons essayer de dégager le rôle que pourraient jouer les groupements dans la constitution d'une « Agriculture de Groupe industrielle et commerciale ».
De grandes entreprises modernes à gestion collective.
Sur le plan économique, la situation est assez claire. Non seulement les groupements pourraient abaisser les coûts de production, fournir des produits standardisés de qualité appropriée, mais encore dans les liaisons verticales, ils pourraient concentrer l'offre (lait, viande etc..) et la demande (engrais, aliments du bétail, etc.). Ils permettraient aussi d'éviter des gaspillages dans les transports, dans l'équipement de ramassage et d'approvisionnement, dans les frais d'administration (factures, comptabilité-matière, gestion etc.). A la condition naturellement que ces organismes jouent
(24) Voir les publications de M. Bernard Poullain. Numéro spécial de la revue « Jeune Patron », n° 166 - juin-juillet 1963
— 34 —
pleinement leur rôle, et qu'il n'y ait pas seulement juxtaposition des exploitations, mais fusion. C'est-à- dire que l'on ne se contente pas d'accoler, par exemple, cinq étables archaïques, mais qu'on en crée une nouvelle, modernisée, pour un troupeau commun. Certes, on rencontrera alors des problèmes d'investissement et de financement, particulièrement ardus, et nous ne prétendons qu'il seront résolus facilement. Nous sommes d'accord pour que l'on procède sur ce point avec la plus grande prudence.
Mais il faudra bien un jour accueillir l'innovation; si l'agriculture de groupe -la repoussait, c'est alors à juste titre, que l'on pourrait l'accuser, comme on l'a déjà fait: «d'additionner les insuffisances». Lorsque l'on augmente la productivité du travail par un équipement plus efficace, on peut, dans les exploitations « patronales » qui conservent la même superficie, se spécialiser et réduire le nombre des salariés. C'est ainsi que certaines exploitations de la plaine de Versailles, qui ont concentré leurs efforts sur les céréales, auraient réduit leurs forces de travail de 12 UTH à 4 UTH entre 1956 et 1964, ceci pour une surface sensiblement identique, de l'ordre de 150 ha (25). Dans le cas d'exploitants qui s'associent, pour rester agriculteurs, dans des groupements où le travail salarié est marginal, on ne peut évidemment adopter une telle solution. Naturellement, on peut choisir des productions plus intensives, ou indépendantes du sol. On peu surtout, libérer les femmes du travail de la terre. Mais, ces palliatifs ayant épuisé leurs vertus, il faudra aussi développer l'entreprise. On voit donc que les groupements, s'ils suivent la logique qui a présidé à leur création, ne peuvent en aucun cas être considérés comme des freins à la migration agricole. Leur véritable but est, en fait, de permettre à certains agriculteurs dynamiques, attachés à leurs responsabilités, de constituer de grandes entreprises modernes gérées collectivement.
Il en va pour l'Agriculture de Groupe « industrielle et commerciale » comme pour les groupements d'exploitations. Il ne s'agit pas de juxtaposer, mais de fusionner, et de croître. On ne doit pas se contenter de rassembler des exploitations archaïques autour de coopératives moribondes. Il semble que ce soit bien là, l'opinion de M. Liau- don (26) . « Nous souhaitons que le plus grand nombre de petites et moyennes exploitations participent à la rénovation de leurs exploitations et de leurs coopératives ». Les petites exploitations isolées se prêteront-elles facilement à cette ambition ?
Au reste, si elles s'engagent dans l'agriculture de groupe « industrielle et commerciale » peut-être seront-elles conduites progressivement à former des groupements d'exploitations. Car, comme l'écrit M.
Moisan (27) : « L'agriculture de groupe facilite la planification. Il est d'ailleurs à remarquer que certaines coopératives d'abattage et de vente de produits animaux étudient actuellement la mise en place d'ateliers de production de groupe. Les ateliers permettent à ces coopératives de pouvoir mieux organiser leur production en fonction de leurs débouchés, de rendre les produits plus homogènes et de diminuer les coûts de ramassage ».
Réduire l'antinomie entre démocratie et efficacité.
Voici pour l'aspect économique. Mais sur le plan sociologique également, les groupements d'exploitations pourraient avoir un rôle important à jouer. Ce sont aussi les coopératives en effet qu'il convient de « rénover ». Et l'on insiste spécialement comme on l'a fait au cours des derniers travaux de la S. F. E.R. (28) , sur la nécessité d'améliorer au plus vite :
— la discipline et la formation des adhérents et particulièrement celle des administrateurs;
— la participation des agriculteurs à la gestion de leurs coopératives, qu'ils doivent considérer non comme un moyen occasionnel pour écouler leurs produits, mais comme leur entreprise propre, dont ils sont responsables et qu'ils doivent comprendre et aider.
Or, il est clair que le groupement d'exploitations permet la spécialisation et qu'il offre à certains associés le loisir d'étudier plus particulièrement les problèmes d'approvisionnement et de commercialisation et donc de participer plus longuement, et avec plus de compétence à la gestion de leur coopérative.
Ainsi, l'antinomie entre démocratie et efficacité, qui a si longtemps retenu les participants de la dernière session de la S. F. E.R. , pourrait être, en partie, surmontée (29) .
Si l'Agriculture de Groupe industrielle et commerciale, que les jeunes agriculteurs appellent de tous leurs vœux, devait se développer, il ne faudrait pas commettre l'erreur de sous-estimer ni la résistance des structures en place, ni le dynamisme et les moyens des grandes entreprises non coopératives les groupements d'exploitations pourraient, incontestablement et pour une « clientèle » particulière, y jouer un rôle eminent.
Quoiqu'il en soit toutes ces nouvelles formes d'entreprises posent aux « économistes ruraux » des problèmes nouveaux, qu'ils n'ont pas encore résolus, et dont nous allons maintenant examiner quelques aspects particuliers.
(25) Voir les travaux de MM. Cordonnier et Tirel, Laboratoire I.N.R.A. de Grignon.
(26) Déjà cité.
(27) No 10 du C.E.D.A.G. déjà cité. (28) Economie Rurale, n° 62, octobre-décembre 1964. (29) II faudrait également prendre en considération la
situation des salariés de l'entreprise agricole et de la coopérative. Nous n'aborderons pas ce problème, vaste et complexe, dans le cadre limité de cet article.
— 35 —
ASPECTS DE LA RECHERCHE SUR LES DIMENSIONS ET L'ORGANISATION DES FIRMES
Nous ne pouvons aborder dans cette note tous les problèmes posés par l'Agriculture de Groupe industrielle et commerciale, et notamment, parmi les plus importants, celui de la formation des agriculteurs et celui du financement pour lequel l'Etat devrait jouer un rôle décisif.
Nous n'examinerons ici que ceux qui ont retenu de tous temps les « économistes ruraux » et depuis plusieurs années les chercheurs de l'I.N.R.A. : ceux de l'organisation et de la dimension des firmes.
Si nous essayons de les aborder dans les conditions actuelles, nous constatons que se trouvent bouleversés, non seulement les méthodes d'étude, mais aussi l'objet même de l'étude, c'est-à-dire l'exploitation agricole. Considérons successivement ces deux aspects.
L'exploitation est en cours de métamorphose
D'abord, les exploitations ont tendance à s'agglomérer en ensembles plus vastes : les groupements d'exploitation. Mais dans de multiples phases transitoires, seuls certains facteurs, certains chantiers temporaires ou ateliers permanents font l'objet d'associations, et, entre ces éléments existent des liens très divers, souvent assez lâches (30) .
Ensuite, dans la quasi-intégration et l'intégration verticale, ces ateliers, exploitations, groupements, peuvent voir leur autonomie progressivement réduite jusqu'au stade ultime où le pouvoir de décision revient tout entier au pôle d'intégration. Ils ne sont plus, au mieux, que des éléments satellites.
Leurs décisions et objectifs propres dépendent des décisions et des objectifs de l'ensemble. On ne peut plus étudier séparément leurs dimensions et leurs organisations optimales, indépendamment des objectifs de l'ensemble dans lequel ils s'insèrent.
Ce phénomène n'est pas nouveau, l'optimum des parties considérées isolément n'ayant aucune raison dans le cas le plus probable, de s'identifier à l'optimum de l'ensemble. Mais, dans la recherche « classique » c'étaient les éléments de l'exploitation qu'on ne pouvait considérer isolément sans se heurter à un sous-optimum parfois proche de l'absurdité (d'où le caractère illusoire des calculs de prix de revient) en raison des relations d'interdépendance. Désormais ces difficultés se rencontrent de plus en plus pour les exploitations elles-mêmes.
Dès lors, la recherche de l'organisation et des dimensions les meilleures suppose des observations
et des analyses renouvelées, portant sur les structures en formation et non plus seulement sur celles des exploitations mais aussi sur celles des ensembles constitués d'éléments intégrés ou quasi-intégrés.
Ces nouvelles observations, préalable nécessaire à toutes recherches sur modèles, sont actuellement en cours de réalisation au sein de l'I.N.R.A., en liaison avec d'autres organismes.
Les enquêtes, les monographies sur les groupements d'exploitations, déjà réalisées, vont se poursuivre en 1965 avec l'U.G.E.A. Il semble indispensable d'en dresser une classification plus élaborée, pour laquelle on devrait se référer à :
— la nature des productions en cause, leur autonomie, ou au contraire leur dépendance mutuelle ;
— la nature des innovations et l'importance des investissements nécessaires ;
— la nature des liaisons verticales à l'amont et à l'aval selon les caractères de l'offre et de la demande des produits.
Ce troisième point nous conduit naturellement à renouveler également les observations sur la structure et le comportement des organismes environnants, observations que pour notre part, nous limiterons en 1965 aux coopératives (31).
En somme, si l'on pouvait supposer l'exploitation agricole « classique » relativement bien connue et se lancer gaillardement dans la construction de modèles et leur traitement par un appareil mathématique raffiné, on ne peut plus se limiter à cet exercice, dès lors que l'on ignore ce qu'est exactement une exploitation agricole.
Les méthodes de recherche sur l'organisation et les dimensions des exploitations agricoles.
Les méthodes les plus élaborées qui ont été utilisées en France à ce jour pour les exploitations agricoles, nous semblent être encore la programmation linéaire et ses dérivés (32) .
Or, en ce qui concerne notre problème, deux restrictions concernant son emploi doivent être aussitôt énoncées.
D'abord, on ne l'a appliquée qu'aux problèmes de l'exploitation « classique », c'est-à-dire centre de décision autonome.
(30) Pour une description des diverses formes, préliminaires à une typologie plus complète, voir notre rapport d'avril 1962, déjà cité.
(31) Des observations ont déjà été faites par l'I.N.R.A. depuis plusieurs années sur toutes les catégories d'organismes environnants, notamment par J. Le Bihan. P. Coulomb a réalisé d'autre part une première analyse des liaisons verticales selon la nature de l'offre et de la demande des produits.
(32) Gervais M., Nicolas Ph., Servolin C. « Programmation linéaire et agriculture » ; Gestion, nov. 1963.
— 36 —
Ensuite, en raison de sa nature même, les éléments introduisants des variations non proportionnelles ne peuvent être pris en compte directement par la programmation linéaire. Or ceci concerne tout particulièrement les économies d'échelle liées à l'accueil des innovations ce qui, en conséquence, interdit de rechercher directement sur un même modèle des dimensions optimales.
Les économies d'échelle exigeant un changement d'équipement et, par suite, un changement des coefficients techniques et économiques de la matrice, c'est tout le modèle qu'il faut modifier et non plus seulement la fonction de préférence et le second membre. De sorte que les techniques de paramé- trisations restent impuissantes dans la détermination des dimensions.
Prendre en compte l'innovation donc le changement d'échelle, oblige à construire une série de modèles ne pouvant être illimitée, le domaine à explorer n'est étudié que de façon discontinue. Certaines solutions peuvent échapper, le choix même des modèles est entaché d'arbitraire, la part du travail qu'on ne peut faire exécuter à la machine est considérable.
Dans la recherche d'un système de culture optimum pour un équipement donné, la programmation présente un avantage sur la technique des « budgets » manuels, plus ou moins classiques dans les Centres de Gestion. L'une explore toutes les solutions possibles, l'autre une partie. Dans le cas d'un changement d'équipement, la programmation linéaire en revient, elle aussi, à l'exploration discontinue.
Il est possible, cependant, que la construction d'une série de modèles à coefficients techniques différents ne constitue pas un inconvénient majeur. C'est un point qui apparaîtra plus clairement lorsque les expériences en cours à l'I.N.R.A. seront terminés (33) .
Il n'en reste pas moins d'importants efforts à poursuivre pour traiter les problèmes de dimensions par des techniques élaborées. Sur ce point, il faut citer les essais en cours, au laboratoire I.N.R.A. de Gri- gnon et à celui de Paris, pour exploiter les possibilités des programmes en nombres entiers. Leurs limites actuelles semblent se trouver dans le coût d'utilisation des ordinateurs, le temps de résolution étant imprévisible et pouvant atteindre une durée prohibitive.
Pour conclure sur ces problèmes d'organisation et de dimension des firmes, ajoutons que l'attitude d'esprit avec laquelle on les aborde doit, elle-même, être modifiée.
On recherchait trop souvent des solutions dans un esprit statique. La lenteur de l'évolution, la faiblesse des innovations incitaient plus ou moins consciemment à croire qu'il existait une organisation et des dimensions optimales définitives. On sait maintenant que les conclusions n'en seront valables que pour une petite période. S'il existe des dimensions optimales, ce ne peut être que pour un certain moment de la vie de la firme. Cette dernière, si elle veut vivre, ne doit pas cesser d'innover et de croître. Le problème principal est celui de la croissance et de ses modalités les meilleures. L'organisation et les dimensions souhaitables, que ce soit pour des raisons techniques ou pour la stratégie commerciale, ne cessent de se modifier. C'est sans doute ce que voulait exprimer E.T. Penrose en les qualifiant de « sous-produits » de la croissance. Les chercheurs, comme les entrepreneurs, doivent s'habituer à une histoire accélérée. On en revient à l'importance des problèmes posés par l'accueil de l'innovation (donc le plus souvent par l'investissement et le financement) et l'adaptation continue des hommes (donc la formation permanente) que nous soulevions au début. C'est à leur résolution qu'organisation et dimensions des firmes doivent être adaptées.
VERS UNE TYPOLOGIE DES GROUPEMENTS
Dégager les caractères primordiaux des groupements agricoles pour l'exploitation à la veille de nouvelles observations « sur le vif », tels étaient nos objectifs, disions-nous en introduction.
A la fin de cet exposé, nous pensons donc légitime de souligner les points essentiels qui pourraient faire l'objet de nouvelles recherches et conduire à la constitution d'une typologie.
Tout d'abord, c'est une partie seulement des exploitations qui se groupe. Tout au moins pour les
(33) Travaux de J.-M. Boussard. Laboratoire I.N.R.A. de Paris.
groupements engageant toute une production, ou l'ensemble de l'exploitation; et alors il s'agit d'une faible minorité. Le recensement en cours devrait nous permettre d'en mieux connaître la proportion. Il est essentiel d'en déterminer la clientèle. Quelle est l'influence des dimensions, de la nature des productions, de l'état des techniques ? On sait que des groupements se rencontrent actuellement en toutes régions, pour toutes dimensions, pour tous systèmes de culture. Assisterons-nous à un retour des bovins en région céréalière, par l'installation de troupeaux collectifs, en dépit des décisions de Bruxelles sur les prix ? Les arboriculteurs constitueront-ils des éta- bles collectives pour résoudre leurs problèmes de
-37 -
fumure ? Puisque, enfin, des producteurs de volailles intégrés réalisent des poulaillers collectifs, on ne peut limiter la clientèle des groupements aux petites et moyennes entreprises de poly-culture et poly- élevage, encore qu'il soit nécessaire de distinguer entre le « G.A.E.C. » familial et la société où le travail est fourni essentiellement par des salariés.
Il faut étudier ensuite le comportement des groupements par rapport à l'innovation. Ont-ils un caractère conservateur ou progressif ?
Toute une clientèle, qui constituait déjà des sociétés civiles pour résoudre des problèmes familiaux, se ralliera au G.A.E.C. pour des raisons juridiques et fiscales évidentes. Cela ne prouve pas qu'ils transformeront leurs méthodes.
Une autre clientèle par contre utilisera les groupements comme cadre de l'innovation.
La nature de ces innovations, l'importance des investissements, l'amélioration de leur rentabilité, les conditions de financement (notamment le crédit) et les problèmes posés par la maîtrise de nouvelles techniques souvent mal connues doivent donc être étudiés.
Enfin, nous l'avons vu, les groupements peuvent constituer une étape dans la « prise en masse » des entreprises de l'agriculture.
Ils peuvent favoriser intégration et quasi-intégration, notamment coopérative.
Inversement, l'intégration, notamment coopérative, peut favoriser la constitution de groupements (citation de M. Moisan page 35). Insistons sur l'importance de l'étude des liaisons verticales, selon la nature de l'offre et de la demande.
Ce point est fondamental au point de vue économique mais il l'est tout autant au point de vue sociologique. Par le rôle qu'ils peuvent jouer dans la constitution d'une « Agriculture de Groupe industrielle et commerciale », les groupements pourraient permettre aux agriculteurs de poursuivre leurs expériences d'association dans l'entreprise. De sorte que l'expérience actuelle, déjà singulière (puisque, nous l'avons vu, la coopération, en raison de la brutalité de la révolution industrielle, n'a pu se développer dans l'industrie) , le serait encore plus si elle se poursuivait et surtout si elle réussissait.
Si les agriculteurs parvenaient (avec l'aide de l'Etat) à passer de l'entreprise artisanale à l'entreprise industrielle sans que tous les travailleurs perdent tout pouvoir de décision (34) , peut-être auraient-ils réussi, dans une certaine mesure, à brûler une étape dans l'évolution de l'entreprise.
Sans s'exagérer l'importance d'un tel événement, il y a là cependant, matière à réflexions.
(34) Le cas des salariés, qui donne à l'affaire son caractère ambigu, a déjà fait l'objet de réserve.
Bibliographie sommaire
— Centre National des Jeunes Agriculteurs. IXm* Congrès. Paris, 30 sept. - l*r octobre 1964. (Rapports) .
— Vers la nouvelle entreprise agricole ? — Paysans, n° 48, juin-juil. 1964.
— Agriculture de Groupe. Trimestriel, U.G.E.A., 45, rue de Naples, Paris (9m#) .
Notamment : HANROT (M.). — Groupements Agricoles Fonc
iers et Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun. In: n° 30, juin 1963.
HANROT (M.). — Les Groupements agricoles d'exploitations et l'évolution de l'agriculture, suppl. au n° 31, sept. 63, 30 p. Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun, numéro spécial, suppl. n° 35, déc. 1964, 48 p. (avec commentaire du décret du 3 déc. 1964 par Philippe KAHN).
— Documents C.E.D.A.G. Irrégulier, C.E.D.A.G., 65, rue de Saint-Brieuc, Rennes.
— Une voie d'évolution: l'agriculture d'entreprise. Paris, C.E.N.A.G.
— 38 —














![Thomas d'Aquin et la place des mots en logique (Philosophia perennis 1 [1994], 35-66)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6318b243e9c87e0c090fca9d/thomas-daquin-et-la-place-des-mots-en-logique-philosophia-perennis-1-1994-35-66.jpg)