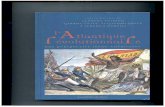Intégration latino-américaine, dépendance de la Chine et sous-impérialisme brésilien en...
Transcript of Intégration latino-américaine, dépendance de la Chine et sous-impérialisme brésilien en...
Intégration latino-américaine, dépendance de la Chine et sous-impérialisme brésilien en Amérique latine1
Marcelo Dias Carcanholo2 et Alexis Saludjian3
Mots clés: Économie du développement, école marxiste de la dépendance, Amérique Latine.
Keywords : Development economics , Marxist Dependency school, Latin America.
Introduction:
L'article se propose de discuter l'intégration latino américaine dans le cadre actuel de
reconfiguration de l'économie mondiale et du rôle de la Chine, premier partenaire commerciale de
nombreux pays de la région et notamment du Brésil. Nous présenterons des données sur la structure
des échanges commerciaux entre l'Amérique du Sud (et également du Brésil considéré
individuellement) et la Chine depuis les années 1980 (données UN-COMTRADE) afin d'évaluer la
reprimarisation de l'économie latino américaine (et brésilienne), l'appauvrissement technologique
relatif des exportations. A partir de ces données et d'une approche théorique proche de la théorie de
la dépendance latino-américaine nous traiterons de la sino-dépendance mais aussi d'un certain sous-
impérialisme brésilien par rapport au reste de l'Amérique latine. Ces deux derniers aspects nous
permettrons de discuter d'une stratégie alternative non-libérale de développement de l'Amérique
latine en contradiction avec l'actuelle vision d'insertion libérale dans l'économie mondiale de
nombreux pays de la région comme le Brésil.
1. Néo-libéralisme et Dépendance en Amérique Latine
1 Article présenté à la conférence: Political economy and the outlook for capitalism, organisé par l'Association Fran-çaise d'Économie Politique (AFEP), Association d'Economie Hethérodoxe (AHE) et l'International Initiative for the
Promotion of Poltical Economy (IIPPE), Paris (France), 5-8 Juillet 2012.
2 Faculdade de Economia, Universidade Federal Fluminense. E-mail: [email protected]
3 Instituto de Economia, Univesidade Federal do Rio de Janeiro; chercheur associé au CEPN (Univ. Paris 13). E-mail: [email protected]
1
1.1- Néo-libéralisme en Amérique Latine
Les promesses suggérées par le néo-libéralisme4 ont toujours inclus la reprise du
développement dans la région mais une analyse objective de ses résultats permet de constater que
les performances macro-économiques de l'Amérique Latine durant la période néo-libérale est un
fiasco. Les premières tentatives d'application de l'idéologie néo-libérale datent des années 1970
dans le Cône Sud-américain. Son application effective s'est manifestée par l'intermédiaire de
différentes situations conjoncturelles.
Durant la décennie 1970, même en pleine crise économique mondiale, le contexte
international présentait une relative liquidité dans les marchés financiers internationaux, permettant
ainsi l'application de la stratégie néo-libérale par le financement externe dans le cadre de ce qui est
connu comme l'approche monétaire de la balance des paiements. Dans la décennie suivante, en
raison de la continuité de la crise de l'économie mondiale et de la basse liquidité internationale due
au contexte de crise des dettes extérieures, l'approche de l'ajustement exportateur dans les
économies de la région a prédominé. À partir des années 1990, avec le retour de l'importante
liquidité internationale, due entre autre à la restructuration des dettes extérieures, c'est l'approche de
l'ajustement importateur qui a principalement joué. L’augmentation de la vulnérabilité externe5 et
par voie de conséquence de la restriction externe à la croissance et à l'instabilité du change ont
culminé en diverses crises de la balance des paiements qui ont caractérisées toute cette période.
Au vingt-et-unième siècle, principalement à partir de 2002, avec la croissance de l'économie
mondiale, la région a de nouveau connu une phase exportatrice. La croissance de l'économie
mondiale durant cette période a permis une forte élévation de la demande mondiale de produits dans
lesquels la région s'est de nouveau spécialisée dans les années 1990 dans ses exportations : les
matières premières (primary commodities). Au même moment, en raison de la participation de
capitaux financiers spéculatifs dans le marché des commodities, le prix de ces produits a connu une
forte accélération à partir de 2002/2003 (Paschoa et Carcanholo, 2010), ce qui a contribué à
dynamiser les exportations tant en raison des prix des produits qu'en raison de la quantité demandée 4 Le néo-libéralisme est une idéologie politique et économique qui défend une plus grande liberté d'action pour les capi -taux dans les différents marchés nationaux et internationaux. Cette idéologie cherche explicitement à intervenir dans la réalité de manière à déréglementer, libéraliser et ouvrir les économies afin que le flux international de capitaux puisse se dérouler sans entraves. Cette idéologie est devenue hégémonique a partir des années 1970 et s'est traduite par une liste de politiques économiques dans les années 1990, plus connu comme Consensus de Washington. Sur ce point voir (Kuc-zynski et Williamson, 2004) et pour une vision critique (Carcanholo, 2010) et (Saludjian 2010).
5 Nous appelons vulnérabilité externe d'une économie, la capacité de celle-ci de répondre aux chocs externes adverses dans le contexte de l'économie mondiale. Ce degré de vulnérabilité externe dépend du degré d'autonomie de la politique économique comme du degré d’ouverture externe de cette économie. Normalement, plus le degré d'ouverture est élevé, plus la vulnérabilité externe est élevée. Voir (Carcanholo (2005).
2
d'exportations d'Amérique Latine.
Pendant cette même période, la hausse du cycle de liquidité internationale (2002-2007) a
permis des taux d'intérêts bas dans le marché de crédit mondial donnant ainsi une marge à la
réduction des taux d'intérêts internes mais aussi à une forte entrée de capitaux externes ce qui a eu
pour conséquence une forte hausse de la valorisation du taux de change dans de nombreuses
économies de la région. Ce cadre externe extrêmement favorable pour la région durant la période
2002-2007 a permis la réduction conjoncturelle des indicateurs de vulnérabilité externe dans la
région et une reprise de la croissance économique. La crise mondiale de 2007-2008 a changé ce
contexte favorable sur le volet externe entrainant un retour des problèmes structurels des économies
de la région comme la restriction externe (structurelle) à la croissance, due au niveau élevé de la
vulnérabilité externe des économie elle-même accrue par les reformes structurelles pro-marché
mises en place de manière accélérée durant les années 1990.
Telles furent les différentes conjonctures que la région a du affronter depuis que l'hégémonie
néo-libérale caractérise majoritairement les expériences de développement dans la région. Ainsi,
quelque soit la conjoncture considérée, il convient d'analyser le résultat des promesses néo-libérales
depuis le début de l'application de cette idéologie dans les années 1970.
Le tableau 1 montre les taux de croissance des principales économies latino-américaines
durant la période 1971-2004. Durant la période d'intensification la plus forte de l'hégémonie
pratique et idéologique du néo-libéralisme (1990-2004), le taux de croissance moyen était de 2,6% ,
de loin inférieur au niveau observé entre 1971-1980 qui s'élevait à 5,6%. Le résultat de la période
néo-libérale, grandement appuyé par l'ouverture externe, ne se situe que devant la période 1981-
1989 (avec 1,3%) considérée comme la « décennie perdue » pour la région sous le poids des
problèmes de l'endettement externe accumulé depuis les années 1970.
Tableau 1: Taux de croissance du PIB en Amérique Latine, 1971-2004 (%)
1971-80 1981-89 1990-97 1998-03 2004 1990-04Argentine 2,8 -1,0 5,0 -1,4 9,0 2,6
Brésil 8,6 2,3 2,0 1,2 5,2 2,0Chili 2,5 2,8 7,0 2,7 6,0 5,2
Colombie 5,4 3,7 3,9 1,0 3,5 2,8Mexique 6,5 1,4 3,1 2,8 4,4 3,1
Pérou 3,9 -0,7 3,9 2,0 5,1 3,2Uruguay 2,7 0,4 3,9 -2,5 11,8 1,8
Venezuela 1,8 -0,3 3,8 -2,8 17,3 1,9
3
Amérique Latine- Total 5,6 1,3 3,2 1,2 5,8 2,6
- Par habitant 3,0 -0,8 1,4 -0,4 4,2 0,9- Par travailleur 1,7 -1,5 0,5 -1,2 3,4 0,0
Source: Ffrench-Davis (2005: 20)
Notons que la performance a été encore pire entre 1998-2003 (1,2%), époque de grande
concentration de crises de change et de balance des paiements dans de nombreuses économies de la
région en raison de la vulnérabilité externe issue des stratégies néo-libérales. D'autre part, si l'on
observe la croissance du PIB per capita entre 1990-2004, on peut conclure à une performance très
médiocre (0,9%) de cette stratégie. Si l'on considère maintenant la croissance du PIB par travailleur,
un indicateur de productivité, le résultat est clair : la productivité de la région a stagné durant la
période considérée.
On note également qu'à partir de 2004, les résultats commencent à s'améliorer justement en
raison du cadre externe favorable. En 2005, le taux de croissance du PIB en Amérique Latine et
Caraïbes a été de 5,0% et augmente jusque 5,8% les deux années suivantes. En 2008, déjà sous
l'effet de la crise économique mondiale, ce taux se réduit à 4,1% et en 2009, avec la récession
touchant fortement l'ensemble de la région, le taux enregistre un résultat négatif (-2,3%).
Ainsi, force est de constater qu’indépendamment de la conjoncture, la promesse de reprise
de la croissance dans la région ne se sont pas vérifiées, et ceci pas parce que le programme des
reformes structurelles pro-marché n'aient pas été appliquées à l'envi comme le soutiennent certains
défenseurs du néo-libéralisme (Kuczynski et Williamson, 2004, par exemple), mais au contraire
justement à cause de l'application effective de la stratégie néo-libérale.
1.2- Raisons de l’échec néo-libéral et condition de la dépendance
Du point de vue de son économie politique, le néo-libéralisme dans la région a construit un
nouveau régime d'accumulation du capital qui s'est constitué à partir de profondes modifications
dans les relations capital-travail et inter-capitalistes. On a assisté à la combinaison d'une
fragilisation des forces politiques du travail (ce qui a accru encore plus la super-exploitation du
travail , caractéristique marquante du capitalisme dépendant6 ) et d'une réunification de différentes
6 La super-exploitation du travail est la caractéristique des formations sociales dans lesquelles la dynamique de l'accu-mulation capitaliste est principalement fondée “sur la plus forte exploitation du travailleur et pas dans le développement de sa capacité productive” (MARINI, 2000, p. 125). Ainsi, on peut vérifier une tendance à la chute permanente des prix de la force de travail par rapport à sa valeur qui peut se manifester de trois manières: i) augmentation de la journée de travail sans élévation des prix de la force de travail correspondant à l'augmentation de son utilisation; ii) augmentation de l'intensité du travail dans une augmentation salariale correspondante à sa plus grande dépense/usure; iii) réduction de
4
fractions du capital dans les blocs de pouvoir dominants en dépit des caractéristiques distinctes de
cette conformation selon le pays concerné.
La catégorie de dépendance implique une situation dans laquelle une économie est
conditionnée par le développement et l'expansion d'une autre à laquelle elle est subordonnée. Ainsi,
la condition de sous-développement est strictement liée à l'expansion des pays centraux. Cette
condition représente donc une subordination externe mais avec des manifestations internes suivants
des arrangements social, politique et idéologique spécifiques7.
Il est possible d'identifier deux déterminants historico-structurel de la dépendance : (i) le
mécanisme de l'échange inégal sur le plan du commerce international dans un réel processus de
transfert de valeurs ; (ii) le transfert de plus-value des pays dépendants pour les pays avancés sous
la forme d'intérêts, profits, amortisations, dividendes et royalties par la simple raison que les
premiers importent du capital des ces derniers. Ceci signifie que, soit par le commerce international
soit par l'internationalisation du capital (productif et de porte-feuille), la condition de dépendance
se caractérise par le fait que, structurellement, ces économies produisent une plus-value qui, de
manière croissante, ne fait pas partie de l'appropriation/accumulation interne du capital. Une
fraction de cette valeur excédentaire est transférée vers des économies centrales et fait partie de la
dynamique capitaliste du Centre et non pas de économies dépendantes.
a) Le premier aspect est d'autant plus important qu'il est très souvent mal compris. Il est
connu dans la littérature traditionnel comme la réduction des termes de l'échange quand il serait
mieux compris à partir du mécanisme de l'échange inégal. Marini (2000) fait référence, à l'heure de
l'explication du secret de l'échange inégal sur le plan du commerce international, à deux
mécanismes (même si de notre point de vue il ferait référence à trois mécanismes). Même s'ils sont
liés, ils traitent de niveaux d'abstraction différents dans le processus d'échanges de marchandises.
À un premier niveau d'analyse, le fait de considérer que différents capitaux peuvent produire
un même type de marchandise avec différents degrés de productivité implique que chacun des
capitaux possède des valeurs individuelles distinctes, d'autant plus faibles que la productivité du
capital considéré est élevée. Comme la marchandise est vendue pour sa valeur travail ou sociale en
fonction du temps de travail socialement nécessaire, les capitaux de productivité au-dessus de la
moyenne vendraient leurs marchandises au prix de marché8 en s'appropriant ainsi d'une plus-value
la consommation du travailleur au-delà de sa limite normale (MARTINS, 1999).7 Santos (1970) identifie trois formes historiques de la dépendance: i) coloniale; ii) financière-industrielle; iii) technolo-gico-industrielle de l'après-guerre sous l'emprise des entreprises transnationales. L'identification de l'actualité néo-libé-rale comme une nouvelle forme historique de le dépendance financière pourrait être étudiée. À cet effet , voir (Amaral, 2006).8 Il s'agit d'un niveau d'abstraction élevé parce que, comme (Marx, 1983, livre III, caps. IX e X) le montre, ceci suppose que les prix de marché correspondent aux prix de production de marché qui correspondent pour leur part aux valeurs de marché. Marx observe que cela n'est possible que dans des secteurs de production ayant une composition organique du
5
plus élevée que celles qu'ils ont eux-même produits : la plus-value extraordinaire. Ainsi, à ce niveau
d'abstraction plus élevé, la loi de la valeur, à l'échelle de l'économie mondiale, implique que les
économies qui possèdent des capitaux ayant une productivité plus faible que la moyenne mondiale
tendent à produire plus de valeur (valeur individuelle plus élevée en raison de la plus faible
productivité dans la production de la marchandise en question) qu'elles ne parviennent à
s'approprier réellement (en effet, la vente tend à se réaliser à la valeur de marché c'est-à-dire en
fonction du temps de travail socialement nécessaire à la production de la marchandise qui inclut
également les capitaux qui produisent avec une productivité plus élevée et donc une valeur
individuelle inférieure). Cette différence de productivité des marchandises qui sont produites soit
dans une économie Centrale soit dans une économie dépendante permet un premier mécanisme de
transfert de plus-value produite dans l'économie dépendante et qui est appropriée/accumulée dans
l'économie centrale.
b. Un second mécanisme de transfert apparaît quand nous considérons un niveau
d'abstraction inférieur dans les échanges de marchandises. À l'époque de Marx, quand nous sortons
de la concurrence dans un même secteur et que l'on considère la concurrence entre différentes
sphères de la production dans ce que cet auteur a étudié comme la formation des prix de production
et du taux de profit moyen9, nous observons un profit extraordinaire pour les secteurs qui produisent
avec une productivité plus élevée en comparaison avec la moyenne de l'économie. C'est dans ce
cadre qu'est démontré le fait que les secteurs qui produisent leurs marchandises spécifiques avec
une composition organique du capital (productivité) au-dessus de la moyenne présentent un prix de
production de marché supérieur des valeurs de marché, et ainsi vendront10 leurs marchandises à un
prix qui leur permette de s'approprier de plus de valeur que ces secteurs n'en produisent.
L'inverse se produit dans les secteurs qui produisent leurs marchandises dans les secteurs
avec des niveaux de productivité en-dessous de la moyenne de l'économie considérée dans sa
totalité. Nous avons ici le second mécanisme de transfert de valeur. Comme les capitaux des
économie dépendantes tendent, en moyenne, à avoir des productivités en-dessous de la moyenne de
tous les secteurs de l'économie mondiale, il apparaît un transfert d'une partie de la plus-value
produite dans les économie dépendantes qui sera appropriée sous la forme d'un profit moyen
supérieur à la plus-value produite, par les capitaux des économies centrales11. Marini (2000) établit
capital égale à la moyenne de l'économie (mondiale dans le cas spécifique que nous traitons ici) et qui de plus pré-sentent une demande pour sa marchandise équivalente au volume de production. 9 Voir (Marx, 1983, livre III, cap. IX).10 Dans ce niveau d'abstraction, nous ne considérons que la demande est égale à l'offre de ces marchandises de façon à ce que les prix effectifs de marché correspondent aux prix de production de marché. 11 Pour plus de détails sir ces mécanismes de transfert, utilisant la loi de la valeur de Marx, dans le sens que cet auteur lui a donné c'est-à-dire comme loi de tendance, voir (Amaral et Carcanholo, 2009).
6
une relation entre ce mécanisme et le monopole de la production de marchandises ayant une
composition organique des capitaux des économies centrales. Cependant, le monopole a également
un rapport étroit avec le dernier niveau d'abstraction des échanges de marchandises, les prix
effectifs de marché, ce qui nous amène à un troisième mécanisme de transfert de valeur.
Lorsque ces capitaux atteignent un degré de monopole important dans leurs marchés
respectifs, ils peuvent, pour une période déterminée, maintenir des prix de marché au-dessus des
prix de production de marché c'est-à-dire qu'ils peuvent supporter temporairement des volumes de
production en-dessous des demandes de ces marchandises. Comme les prix de marchés seraient,
dans cette situation, au-dessus des prix de production (au-delà des fluctuations conjoncturelles), ces
capitaux pourraient s'approprier d'un profit effectif au-dessus de la moyenne, une masse de valeur
appropriée au-delà de celle qui a été réellement produite par ces capitaux.
c. Le contexte international est également en rapport avec les déterminants structurels de la
dépendance. En période d'expansion de l'économie mondiale, la demande d'exportations des pays de
la périphérie augmentent. Lorsque le cycle de liquidité international est en hausse, un crédit
abondant apparaît dans les marchés internationaux et dans la majorité des cas avec un taux d'intérêt
bas. Dans ce contexte international favorable, même si les déterminants structurels de la
dépendance continuent d'exister, il existe des marges de manœuvre pour les économie dépendantes.
L'inverse (conjoncture défavorable) n'est pas vrai. Dans ce cas, les problèmes structurels se
manifestent dans les indicateurs de vulnérabilité externe des économies.
Ces éléments déterminants de la dépendance (les éléments structurels et le contexte externe
qui approfondit ou atténue les caractéristiques structurelles ) provoquent une forte sortie structurelle
de ressources entrainant des problèmes récurrents d'étranglements externes et de restrictions
externes à la croissance.
Tableau 2: Transferts financiers nets par pays en développement 1995-2007 (en milliards de US$)Région 1995 2000 2003 2006 2007*Afrique 5,7 -31,6 -22,6 -86,2 -59,2Amérique Latine -0,6 -2,9 -61,6 -127,2 -99,8Asie 21,3 -119,7 -169,9 -369,9 -468,1Economies en Transition
-2,7 -58,0 -50,5 -135,6 -109,2
Moyen Orient 23,0 -31,4 -43,8 -144,7 -132,7Total 41,9 -243,7 -330,4 -863,7 -869,0
* estimationsSource: Ortiz et Ugarteche (2008: 02), sur la base de données de l' ONU (2008).
La seule manière que possède l'accumulation du capital interne à une économie dépendante
7
de se poursuivre est d'augmenter sa production d'e plus-value. Ainsi, même si une partie croissante
de cette plus-value est appropriée et donc accumulée à l’extérieur (dans les économies du centre) le
reste peut (à partir du taux de profit interne) soutenir une dynamique d'accumulation interne même
si elle est bridée et dépendante. La forme associée à cette condition de dépendance pour élever la
production de valeur est la super-exploitation de la force de travail12 qui implique une augmentation
de la proportion de plus-value (dépenses avec la force de travail) ou d'une élévation du taux de plus-
value que ce soit par la pression sur les salaires ou l'extension de la journée de travail en association
avec l'augmentation de l'intensité du travail. Ainsi, les déterminants de la dépendance ont pour
conséquences un transfert massif de valeur produite dans la Périphérie appropriée dans le Centre de
l'accumulation mondiale et une dynamique capitaliste dans la périphérie qui est garantie par la
super-exploitation de la force de travail au lieu de bloquer ces mécanismes de transfert de valeur13.
Dans le cadre de cette dynamique d'accumulation de capital, le capitalisme dépendant peut croitre
en contournant sa restriction externe.
En limitant la consommation de la force de travail, la super-exploitation de la force de
travail ne constitue pas, en principe, de frein à l'accumulation interne de capital parce que sa
dynamique de réalisation peut dépendre du marché externe et/ou d'un régime de consommation qui
privilégie les couches moyenne et haute de la population14. Dans ce dernier cas, cependant,
l'augmentation des profits peut être orientée non pas comme demande interne (sans contrepartie de
12 La super-exploitation de la force de travail, caractéristique structurelle des économie dépendantes, n'exclut pas le fait qu’éventuellement, une économie dépendante spécifique ait un marché interne d'une taille raisonnable et qu'ainsi elle possède une plus grande marge de manoeuvre dans sa condition de dépendance. Ceci, ainsi que certains autres éléments, nous permettent de comprendre pourquoi la condition de dépendance est une question de degré et pas proprement une caractéristique que telle ou telle économie a ou pas. Les différents degrés de dépendance d'une économie varient par exemple en fonction des différents degrés de vulnérabilité externe comme nous l'avons mentionné plus haut.
13 Il n'est pas rare de trouver l’interprétation qui considère la super-exploitation comme s'il s'agissait d'échange inégal entre nations comme s'il était question de l'exploitation des nations pauvres par les nations riches. Comme l'a expliqué Marx (1983, vol. V: 293), “c'est, en premier lieu, une fausse abstraction de considérer qu'une nation, dont le mode de production repose sur la valeur et qui, de plus, est organisé de façon capitaliste comme un corps collectif qui ne travaille que pour les nécessités nationales” (notre traduction). Ce type d’interprétation, typiquement weberienne, ne parvient pas à saisir que les mécanismes de transfert de valeur: i) se situent au plan de la circulation/réalisation de la valeur pro -duite alors que la super-exploitation se situe au niveau des relations de production; ii) qu'il ne s'agit pas d'une “nation exploitant une autre” mais de capitaux qui agissent dans une économie ou une autre indépendamment de leurs “nationa-lités”si tant est que “nationalité du capital” ait un sens.
14 De nouveau, dans le même sens de la question relative aux différents degrés de dépendance, ceci n'exclut pas la possi -bilité, conjoncturelle, qu'une économie dépendante spécifique puisse élargir d'une certaine forme les politiques sociales assistantielles permettant ainsi durant un certain temps la constitution d'un marché interne avec une partie de classes moins favorisées. Toutefois, ceci n'altère pas le fait structurel de sa dépendance (même si cela participe au degré de cette dépendance) ni le fait de la super-exploitation de la force de travail qui est une caractéristique de la condition de dépendance. D'ailleurs, si les politiques sociales sont de type compensatoires, elles compensent justement quelque chose issu de cette super-exploitation!
8
la production interne) mais vers une augmentation des importations soit de biens de consommation
pour ces couches de la population soit pour des moyens de production nécessaires à l'accumulation.
Que ce soit dans un cas comme dans l'autre, les problèmes de déficits structurels de la balance des
paiements s'aggravent comme formes de manifestation des mécanismes du transfert de valeur. Le
maintient des taux de croissance soutenus dans la périphérie met de nouveau en avant, à un niveau
encore plus élevé, les déterminants restrictifs de la dépendance. La condition de dépendance est
structurelle, propre à la logique de l`accumulation mondiale et tend à s'approfondir justement parce
que les déterminants sont renforcés par cette propre logique.
2. Evolution du processus d'intégration en Amérique Latine
Une stratégie de développement alternative au néo-libéralisme, quelle qu'elle soit, doit se
confronter à la difficulté de la question nationale/locale et des différentes souverainetés
nationales/locales.
De plus, il convient de noter que l'importance de cette question nationale pour les stratégies
alternatives de développement est accentuée par l'analyse de la possibilité réelle de ces projets
d'exister. La stratégie néo-libérale présuppose la construction d'une marché interne de masse pour
réduire la dépendance de l'exportation de production interne comme forme de réalisation de la
valeur produite. Cependant, cette possibilité n'existe simplement pas pour certains pays en raison de
l'impossibilité de construire ou (re)créer un marché interne propre. Ainsi, ces économies n'ont
comme alternatives que l'intégration régionale pour construire un marché interne régional
permettant à la région comme un tout de ne plus dépendre des exportations comme logique de
réalisation de la production.
Mêmes les économies de grande taille avec un certain degré de développement du marché
interne peuvent gagner à s'intégrer régionalement. Il est vrai que celles-ci pourraient choisir une
voie purement nationaliste, rompant avec la stratégie de développement néo-libérale et créant un
marché interne de masse tout en réduisant a vulnérabilité externe. Pourtant, cette option purement
nationaliste peut gagner plus de poids économique, politique, social et idéologique à mesure qu'elle
augmente l'amplitude de cette réponse souveraine en contrepoint de la logique hégémonique. En ce
sens, même en se situant dans une perspective nationaliste, la meilleure manière de défendre une
insertion nationalement souveraine est de construire une stratégie/insertion
internationaliste/régionale.
9
Ainsi, l'intégration des économies d'Amérique latine, en termes commerciale et productive, est
une composante stratégique additionnelle dans la construction d'une conception de développement
qui rompe avec les régimes de ces dernières décennies. Mais quelles devrait être les caractéristiques
de cette intégration régionale ? Dans la prochaine sous-section nous étudierons l'intégration
régionale en Amérique latine depuis les années 1990.
2.1. Intégration économique Régionale en Amérique du Sud: Un rapide panorama des années
1990
L'intégration latino-américaine récente (voir encadré 1 ci-dessous) a une longue histoire
derrière elle depuis la tentative de restructuration productive régionale des cepaliens originaux aux
accents keynésiens dans les années 1960 en passant par l'ALADI libérale des années 1980. Au
retour de la démocratie les accords sectoriels et de coordination productive (PICE en 1986) ont été
signé entre l'Argentine et le Brésil. La signature en 1991 de l'accord du Mercosur par les présidents
de l'époque, C. Menem en Argentine et F. Collor de Mello au Brésil fonde une approche (néo)
libérale dominante en Amérique du Sud à l'heure du Consensus de Washington. Le « meilleur
élève » du FMI, l'Argentine, a su tirer partie du taux de change du peso « 1 à 1 » avec le dollar
nord-américain (Loi de Convertibilité de 1991) pour impulser une forte augmentation du commerce
intra-Mercosur. La stabilisation du Plan Real au Brésil, la crise mexicaine (tequila en 1994-1995), et
la crise asiatique en 1997 ont fait que celle qui était la quatrième zone commerciale du monde
(après l'ALENA, l'UE et l'APEC) retrouve des niveaux de commerce semblables aux niveaux pré-
intégration dès 1999 ou 2000 (de lórdre de 10 à 15% du commerce total.
L'option de l'ALCA (Zone de libre commerce des Amériques) appuyée par les Etats-Unis
d'Amérique dès 1990 (« l'Amérique de l'Alaska à la Terre du Feu » selon l'expression du président
étasunien de l'époque G. Bush) a semblé un temps contrée par l'initiative du Mercosur
Encadré : Principaux accords d'intégration économique régionale en Amérique Latine
� 1960: Accords régionaux pour un Marché Commun Latino-Américain à la Prebisch (appelé plus tard par les tenants du Régionalisme libéral de Régionalisme fermé);
� 1969: Accord d'intégration sous-régional au nord de l'Amérique du Sud (Accord de Carthagène en Colombie)� 1979-1983: Début de l'institutionnalisation de la CAN (Communauté Andine de Nations) e du régionalisme
ouvert;� 1980: Crise de la dette e ALADI;� 1986: Programme d'Intégration et de Coopération Economique (PICE) Brésil-Argentine dans le cadre d'un retour
à un développementisme cepalien des années 1960;� 1991: Mercosur dans le carde analytique libéral des années 1990 (Consensus de Washington);� 1994: Sommet de Miami (pro-ALCA);� 2000: IIRSA (modèles du BID en 2000 avec pour objectif de justifier l'ALCA proposée par G. Bush en 1990 –
10
Aire de Libre Commerce de l'Alaska à la Terre du Feu);� 2004: CSN (Communauté Sud-américaine des Nations) e ALBA (L'Alliance bolivarienne pour les peuples de
notre Amérique - Traité de commerce des Peuples (ALBA – TCP);� 2005: Sommet de Mar del Plata (“fin” institutionnelle de l'ALCA ) ;� 2006 : Adhésion du Venezuela au sein du Mercosur ;� 2008 : UNASUR
Source : Elaboration des auteurs à partir des divers accords d'intégration régionaux et sous-régionaux
Pour ce qui concerne l'intégration sous-régionale du nord de l'Amérique du Sud, la signature
de l'Accord de Carthagène en 1969 entre la Bolivie, la Colombie, le Chile (avant de se retirer), le
Pérou et l'Equateur marque le début d'un processus qui culminera en 1979 avec la création de la
Communauté Andine des Nations. Ces pays adoptent en 1983, un modèle d'intégration ouverte
dans laquelle règne explicitement la logique de marché. L'accent de ce processus d'intégration est
mis sur le commerce et les résultats en termes de commerce intra-bloc augmentent jusqu'en 1998
(de 5% du commerce total des pays de la zones en 1980 jusqu’à 15% en 1998 (voir graphique en
annexe). Ainsi, une consolidation institutionnelle a eu lieu entre 1979-193 (création du Conseil
Andin des Ministres de l’Extérieur, du Tribunal Andin de Justice et du parlement Andin). En 1995
fut créée une zone de libre-commerce et un droit de douane extérieur commun a été adopté.
L'élection de H. Chavez en 1998 a généré de nombreuses tensions au sein de la CAN a fini par
pratiquement la paralyser suite à l'adhésion du Venezuela dans le Mercosur en 2006.
Comme nous le verrons dans la prochaine section, la rénovation politique des années suivant
la crise Argentine de 2001 a largement compromis la légitimité du discours (néo) libéral et plusieurs
pays comme l'Argentine, le Brésil et le Venezuela se sont prononcés contre l'ALCA. Ceci s'est soldé
par la création à la même époque en 2004 de la Communauté Sud-américaine des Nations (CSN),
de l'ALBA et de l'abandon du projet institutionnel de l'ALCA lors du Sommet de Mar del Plata
(Argentine en 2005).
2.2- Prétendue re-configuration du processus d'intégration au cours du XXIème siècle
L'intégration régionale n'est pas une caractéristique récente dans la région15. Il s'agit donc, à
partir de l'évaluation du processus de cette intégration régionale des dernières décennies, d'expliquer
le résultat produit par cette division régionale du travail, implicite dans la spécialisation productive
et commerciale des économies de la région.
Au début des années 2000, la situation politique d'une grande partie de la région a changé en
raison des conséquences économiques et sociales de plusieurs pays d'Amérique du Sud. L’espérance
de changement d'orientation de la politique économique et dans certains cas de politique (« !que se
15 Gambina et alli. (2010) font un bref résumé de ces expériences. Sur le Mercosur voir (Saludjian, 2006).
11
vayan todos !» en Argentine : « Qu'ils partent tous [les politiques] !») a motivé l' élection de
nombreux gouvernements appelés « progressistes » (non néo-libéraux) en Amérique du Sud.
L'objectif de cette section est de montrer que, même avec les gouvernements critiques du
néo-libéralisme, les modèles en place à l'époque néo-libérale ont été peu modifié avec l'arrivée de
ces nouveaux gouvernements qualifiés de progressistes (particulièrement en Argentine et au Brésil).
Dans le cas du Mercosur, les gouvernements argentin (de l'après crise de 2001), brésilien (à
partir de l'élection de Lula), uruguayen (après l'élection de Tabaré Vázquez) e paraguayen (après
l'élection de Lugo) ont multiplié les discours et gestes symboliques annonçant une rénovation et
réorientation du Mercosur considéré comme objectif prioritaire d'un futur commun. Néanmoins, les
divergences et tensions économiques entre membres du bloc régional ont continué sans que le
mécanisme de règlement des différends (Protocole d'Accord de Olivos en 2002) ne parvienne à
empêcher les tensions commerciales et même diplomatiques16. La difficulté de l'accord des
différents Parlements du Mercosur à la ratification de l'entrée du Venezuela dans le bloc régional a
mis en lumière l'existence d'intérêts contradictoires entre les pays et entre les groupes politiques et
économiques de ces pays17. Du côté vénézuelien, en plus de l’intérêt de se rapprocher
institutionnellement du Brésil, principal pays de la région, l'entrée dans le Mercosur garantit
également une certaine stabilité politique comme la montré la réaction du Mercosur durant la
tentative du coup d'Etat au Paraguay en 199918.
En Bolivie et en Equateur, le changement de modèle économique a eu lien avec un niveau plus
profond et avec des chocs politiques plus marqués en raison de certaines mesures économiques et
politiques (occupation de champs d'exploitation de pétrole et gaz où travaillait l’entreprise mixte
publique/privée brésilienne Petrobras) qui ont contrariées le fonctionnement plein du modèle néo-
libéral et ont amené des pressions politiques et/ou militaires fortes.
A l'échelle sud-américaine, nous pouvons parler d'un certain essoufflement du référentiel
légitimateur du modèle (néo) libéral. Cet essoufflement a laissé place à plusieurs initiatives. La
proposition de l'ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas de 2004 à 2009 et ALBA-TCP
Alianza Bolivariana Para Los Pueblos de Nuestra América depuis 2009) en est resté à un stade
relativement modeste avec des échanges entre le Venezuela et Cuba (pétrole contre services de
16 Par exemple le cas Botnia entre l'Argentina et l'Uruguay, le cas d'Itaipú entre le Brésil et le Paraguay et de nom-breuses controverses commerciales entre le Brésil et l'Argentine sur une large gamme de produits.
17 Le Venezuela est finalement entré comme membre effectif du Mercosur le 31 Juillet 2012 à la suite de l'exclusion du Paraguay du bloc économique en raison de la destitution express du Président Lugo que les pays du bloc ont interprété comme un coup d'Etat.
18 Le coup d'État au Paraguay en Juillet 2012 remet quelque peu en cause ce point et mériterait que l'on s'y attarde dans un autre travail.
12
médecins cubains et également de professionnels de l'éducation) ou entre la Bolivie et Cuba (aide
technique). A Partir de 2009, l'ALBA est composée de neuf membres : la République Bolivarienne
du Venezuela, la République de Cuba, la République de Bolivie, la République du Nicaragua et la
Mancomunidad de Dominique, la République de l'Honduras, la République de l'Equateur, Saint
Vincent et Grenadines et Antigua et les Barbades19.
Concernant les fondements des modèles d'intégration économique particulièrement dans le
Cône Sud, ceux-ci ont largement maintenus en raison notamment de la conjoncture favorable due
au cycle de prix élevés des matières premières, base pour l'Amérique du Sud du commerce avec le
reste du monde, mais aussi en raison de la forte demande de la Chine (actuellement principal
partenaire commercial et investisseur dans la région)20. Cette situation favorable a permis que
certains acteurs économiques nationaux (agro-industrie, financier) soient en condition privilégiée
appuyant la manutention de la macro-stabilité orthodoxe. La composante nationale est un élément
qui a un potentiel de contradiction avec les tentatives d'intégration dans la région. Les ajustements
en termes de politiques et de programmes économiques à la recherche d'une plus grande légitimité
populaire (interne à chaque pays), internationale (ou externe comme au niveau de l'ONU, à Davos
ou au sein de l'OMC) et également « populaire et internationale » (Forums sociaux mondiaux,
ONGs, syndicats, etc) n'ont pas affecté le cœur du fonctionnement du modèle de développement ni
la hiérarchie du pouvoir.21
Notons que, loin d'avoir disparu durant la décennie 2000, les accords de libre-commerce se
sont multipliés dans la région. Ainsi, le Pérou, le Chili mais aussi la Colombie, la Bolivie et
l'Uruguay continuent de signer des accords de libre-commerce avec des partenaires de la région
mais aussi hors de la région. Il n'existe donc pas d'incompatibilité entre les accords de libre-
commerce bilatéraux et les périodes d'avancés de l'intégration sud-américaine (tant
institutionnellement que dans le discours politique ).
Les difficultés liées aux sources et formes de financement de ces projets, des modèles de
développement et d'intégration économique sont un bon exemple de ce mouvement contradictoire :
libéral en terme d'hypothèses et de modèles mais « alternatifs » ou « progressistes » dans le
discours. Le poids du BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social du Brésil)
depuis la fin des années 2000 et sa stratégie d'appui à l'expansion des grandes entreprises privées
19 Voir: http://www.alianzabolivariana.org/. Il ne s'agit pas ici de minimiser les problèmes et limites de ce type d'expérience en ce qui concerne la construction d'une trajectoire souveraine de développement (face à la forte présence d'entreprises transnationales et oligopoles nationaux) ni les problèmes de pauvreté ni la forte demande sociale insatisfaite.20 Il ne s'agit pas ici de nier les efforts politiques mais d'évaluer su ceux-ci ont été suffisant pour modifier un projet éco -nomique d'intégration alternatif.21 Ceci ne s'applique pas en ces termes au Venezuela, à la Bolivie, et comme nous l'avons vu en Octobre 2010, à l'Equa -teur (tentative de coup d'Etat).
13
(ou mixtes) brésiliennes ne laisse que peu d'espace à une proposition alternative comme la
proposition originale de la Banque du Sud formulée par le Venezuela et l'Equateur.
Cette section a présenté rapidement les modifications politiques qui ont eu lieu dans la
région dans les années 2000 et l'inertie des processus de formulation des politiques d'intégration
régionale. Le modèle d'intégration a intégré les discussions politiques (avec la création de
l'UNASUR22) mais les canaux de transmission entre la volonté politique (apparente ou déclarée)
d'une part et les effets économiques dans les secteurs économiques, entre agents économiques et
institutionnels d'autre part sont loin d'être automatiques23. Ces canaux (politique-économique) ont
souffert des attaques permanentes durant les années 1980-1990 si l'on considère la libéralisation
commerciale, financière et la destruction dans la confiance et la légitimité des institutions
publiques. Nous avons présenté certains éléments structurels qui ne peuvent pas être modifier ni
rapidement ni sans un coût en terme de légitimité politique.
2.3- Processus d'intégration et résultats en terme de commerce et d'insertion internationale
La première observation sur le commerce extérieur que nous pouvons faire dans le cas de
l'Amérique latine et les Caraïbes est que même s'il s'est accru depuis 1985, la somme des
exportations et des importations en proportion du PIB a toujours été en-dessous de la moyenne
mondiale. De plus, les exportations de la région représentent 4,3% du total mondial en 1980 et,
même si elles ont augmenté un peu à la fin du siècle passé atteignant 4,8% du total mondial en
2000, cette proportion s'est de nouveau réduite au cours de la décennie 2000-2010 pour atteindre
4,3% en 2008 (Macedo et Silva, 2010: 14).
Ainsi, nous souhaitons montrer ici que la région a approfondi un processus de
reprimarisation de ses exportations depuis les années 1990 justement en raison de la restructuration
productive provoquée par l'expansion du degré d'ouverture commerciale des économies.
Ce processus de reprimarisation des exportations24 dans la région est un sérieux problème
que l'intégration régionale va devoir affronter en se plaçant dans le cadre d'une stratégie alternative
22 Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) à partir de la Declaración del Cusco (décembro 2004) et UNASUR à partir de la signature du Tratado Constitutivo da UNASUL à Brasília en mai 2008.
23 L'Initiative de l'IIRSA (infrastructure) d'abord contrôlée par la Banque Inter-américaine de Développement (institu -tion financière internationale basée à Washington DC) a été intégrée au COSIPLAN (organe de l 'UNASUR ) en 2010 mais maintient sa structure, les projets et l'approche qui existaient jusqu'alors.
24 Nous entendons par reprimarisation des exportations l'augmentation relative des produits primaires dans la structure totale des exportations des économies.
14
de développement. Si cette configuration se maintient, et même si une intégration différente des
économies de la région a lieu, la relation du bloc avec le reste du monde continuera à être basée sur
un déterminant structurel de la dépendance. Ce processus est aggravé par le fait que la
détermination des prix des commodities dans les marchés internationaux n'est pas influencé par les
économies dépendantes. En réalité, le comportement des prix des commodities reflète la logique des
fonds d'investissement des marchés dérivés, ce qui ajoute un composant clairement spéculatif dans
la formation de ces prix (Paschoa et Carcanholo, 2010) et ainsi une augmentation du degré de
dépendance des économies qui se spécialisent dans l'exportation de ses produits.
Nous devons souligner le fait qu'il existe une différence théorique entre une approche
orthodoxe et une approche critique en ce qui concerne l'étude du contenu technologique des biens
dans le commerce international. A l 'inverse de la théorie orthodoxe, nous privilégions ici la vision
de la théorie marxiste de la dépendance comme nous l'avons déjà évoqué. Ainsi, les différences de
productivité entre les capitaux dans la concurrence intra ou inter sectorielle, détermine l'échange
inégal. Même si ce n'est pas une relation si directe, les capitaux qui se spécialisent dans la
production de marchandises industrialisées avec un degré plus élevé de contenu technologique
tendent à présenter une productivité plus élevée que ceux qui se spécialisent dans la production de
marchandises primaires et basées en ressources naturelles. Cela est d'autant plus le cas que la
dépendance technologique a été une des caractéristiques mises en avant par la théorie marxiste de la
Dépendance dans la phase de l'industrialisation en Amérique Latine sur la base de la présence
croissante des entreprises transnationales dans la région.
Nous présentons ci-dessous une étude sur l'évolution du commerce suivant la
composition en contenu technologique des exportations et importations sur la base des données de
l'UN-COMTRADE et spécifiquement de la classification SITC (Standard International Trade
Classification) suivant la méthodologie de (S. Lall, 2000) et (UNCTAD, 2002, p.87-95). Les
graphiques indiquent la structure des exportations, des importations totales et du solde commercial
de l'Amérique du Sud en différenciant les produits primaires des produits industrialisés d'une part et
pour ces derniers, en fonction du contenu technologique en suivant la classification évoquée
précédemment25.
Graphique 126: Exportations de l'Amérique du Sud vers le Reste du Monde par type de produits et par contenu technologique (en %)
25 Dans cette classification, le pétrole et les produits dérivés ne sont pas pris en compte. Voir détails dans (UNCTAD, 2002).26 Note/traduction (cette note sert pour tous les graphiques de l'article):
Premier graphique : en bleu avec losange : Produits primaires ; en rose avec carré : produits industrialisés ;
15
Source: UN-COMTRADE
Graphique 2: Importations de l'Amérique du Sud depuis le Reste du Monde par type de produit (en %)
Deuxième graphique : en bleu et losange : Produits industrialisés à haut niveau d'intensité technologique ; en rose et carré : Produits industrialisés à niveau technologique faible ; en vert et triangle : Produits industrialisés à niveau technologique moyen ; en bleu et croix : Produits industrialisés intensifs en ressources primaires.
16
Source: UN-COMTRADE
Graphique 3: Solde commercial de l'Amérique du Sud vis-à-vis du reste du monde par type de produit et par degré de contenu technologique des produits industrialisés (1985-2009) en dollars
Source: UN-COMTRADE
Analysons le commerce avec de l'Amérique du Sud avec le Reste du Monde: En termes
généraux, la composition des exportations de l'Amérique du Sud continue stable depuis 1985 avec
17
une prépondérance de produits primaires (40% du total depuis 2000). Les produits industrialisés
représentent près de 30% des exportations de la région. De ce montant, les produits intensifs en
technologie moyenne représentent la plus grand part (30% à 35% depuis 1996). les produits
intensifs en technologie élevée représentent 25% en 2008 après avoir atteint plus de 30% en 2000.
Les produits respectivement intensifs en travail et en ressources naturelles et en technologie basse
représentent environs 20% du total des biens industrialisés. Les importations de l'Amérique du Sud
continuent d'être à 70% composées de biens industrialisées dont 40% de cette proportion composées
de biens de technologie moyenne et élevée (40% pour chacune des catégorie). Finalement, si nous
considérons le solde (exportations moins importations par type de produits et par type de
technologie), nous observons que celui-ci est positif (exportations supérieures aux importations)
depuis 1985 pour les produits primaires avec une forte augmentation de cet excédent à partir de
2003/2004. Durant la même période, le déficit (importations supérieurs aux exportations) des
produits industrialisés est devenu beaucoup plus élevé (50 milliards de dollars en 2004 et près de
200 milliards de dollars en 2008/2009). Les soldes négatifs des biens industrialisés contenant un
degré de technologie élevé et moyen ont représenté 90 et 80 milliards de dollars respectivement.
Cette première approximation du commerce de l'Amérique du Sud avec le Reste du monde a
montré que la structure exportatrice de produits primaires et importateur de produits industrialisés
s'est maintenu stable au cours de la période considérée (1985-2009). Depuis 2003, le déficit en
biens industriels s'approfondit même s'il est compensé en valeur par l'excédent également en
augmentation des biens primaires. Comme nous l'avons indiqué précédemment, le poids de la Chine
et la période de hauts niveaux des prix des commodities ont été des facteurs déterminants de cette
situation. L'Amérique du Sud maintient un type d'insertion dans l'économie mondiale en certains
points semblable à celle des années 1990 avec une légère amélioration dans le contenu
technologique moyen et élevé. Nous verrons dans la section suivante qu'une étude plus fine permet
de mitiger cette modification et up-grade technologique en soulignant le rôle de la Chine et lcelui
du Brésil.
3. Croissante dépendante de la Chine et le sous- impérialisme brésilien
3.1. La croissante dépendance de la Chine dans la région
L'observation du rôle croissant de la Chine dans le commerce mondial durant la première
décennie du XXIème siècle est devenue une évidence. Ainsi, d'après les données de la CEPAL
(CEPAL, 2010:9), la Chine a dépassé l'Allemagne dans le classement des exportations mondiales
18
mais est également devenue le principal exportateur mondial de biens. Sur un total de 6,3 milliards
de dollars des exportations dans le monde en 2000, la participation des Etats-unis d'Amérique était
de 12%, celle de l'Allemagne de 9% et celle de la Chine de 4%. En 2009, cette participation atteint
8% pour les Etats-Unis d'Amérique, 9% pour l'Allemagne et 10% pour la Chine sur un total des
exportations mondiales de 12,46 milliards de dollars.
En termes de structure des exportations, le tableau 3 montre clairement la réduction du
pourcentage des produits primaires dans le total des exportations. Celles-ci représentaient 20,15%
en 1990. Ce pourcentage chute à 9,0% en 1995, 6,2% en 2000, 2,3% en 2008 et 2,5% en 2009. A
l'inverse, les exportations de biens manufacturés de niveaux technologiques moyen et élevé qui
représentent 26,18% du total des exportations en 1990, atteignent 31,8% en 1995, 42% en 2000,
56% en 2007 et 2008 et même 58% en 2009. Clairement, au cours de cette période, les exportations
chinoises se sont concentrées dans les produits manufacturés de moyenne et haute technologie au
détriment des produits primaires. Notons au passage que ce processus se déroule lors d'une
trajectoire de croissance extrêmement rapide du total des exportations du pays.
Tableau 3: Exportations chinoises de biens par catégorie de produit (%)1990 1995 2000 2007 2008 2009
Produits primaires 20,15 9,01 6,20 2,30 2,36 2,49Manufactures basées en ressources naturelles
11,43 12,05 9,89 9,33 9,73 8,81
Manufactures de basse technologie
40,16 46,34 41,21 30,99 30,53 30,11
Manufactures de moyenne technologie
20,84 18,85 19,64 23,29 24,66 23,53
Manufactures de haute technologie
5,35 13,01 22,39 33,60 32,28 34,55
Autres transactions 2,07 0,67 0,67 0,49 0,44 0,51Source: SIGCI-CEPAL
Du point de vue de la structure des importations, comme le montre le tableau 4 , la
croissance accélérée des importations augmente sa participation en produits primaires d'environs
10% dans les années 1990 à 24,6% en 2008 et 22% en 2009. Cette augmentation relative est
également accompagnée par les manufactures basées en ressources naturelles même si à un rythme
inférieur. Celles-ci représentaient 11.9% en 1990 et atteignent 14,4% du total des importations en
2009. Même si la participation relative des manufactures de moyenne et haute technologie ont
atteint un niveau relativement stable durant la période, on se doit de noter le niveau élevé d'environs
60% en 2007 avant de se réduire légèrement en 2008 et 2009.
19
Tableau 4 : Importations chinoises de biens par catégories de produits (%)1990 1995 2000 2007 2008 2009
Produits primaires 10,78 10,33 13,70 18,84 24,66 22,01Manufactures basées en ressources naturelles 11,90 13,91 15,21 14,03 14,11 14,48Manufactures de basse technologie 17,03 14,94 11,55 6,40 5,78 5,71Manufactures de moyenne technologie 45,93 42,05 30,37 25,23 23,86 25,30Manufactures de haute technologie 13,41 17,42 28,04 34,98 30,97 31,90Autres transactions 0,96 0,99 1,13 0,51 0,62 0,61
Source: SIGCI-CEPAL
Ainsi, on constate que les exportations comme les importations chinoises augmentent
fortement durant la dernière décennie modifiant son insertion dans l'économie mondiale. Durant
cette même période, la participation des exportations de manufactures de moyenne et haute
technologie a fortement augmenté alors que pour ce qui est des importations, les produits primaires
et les manufactures basées en ressources naturelles ont augmenté.
Graphique 4: Exportations de l'Amérique du Sud vers la Chine par type de produits et par contenu
technologique (en %)
Graphique 5: Importations de l'Amérique du Sud depuis la Chine par type de produits et par
20
contenu technologique (en %)
Source: UN-COMTRADE.
Graphique 6: Solde commercial de l'Amérique du Sud vis-à-vis de la Chine par type de produit et
par degré de contenu technologique des produits industrialisés (1985-2009) en dollars
21
SOURCE: UN-COMTRADE.
Concernant le commerce de l'Amérique du Sud avec la Chine, l'inversion se produit à la
fin des années 1980 quand les biens primaires représentent la plus grand part des exportations de
l'Amérique du sud (plus de 80% du total des exportations). Le niveau technologique des moins de
10% de biens industrialisés exportés est principalement composé de biens à bas contenu
technologique (plus de 40%). A l'inverse, près de 90% des importations de la Chine sont des biens
industrialisés et pour plus de 40% ces derniers sont de haute technologie. Les biens industrialisés
intensifs en travail et en ressources naturelles importés de Chine par l'Amérique du sud voient leur
pourcentage des importations totales diminuer à partir de 1992 pour atteindre moins de 20% du total
des biens industrialisés. Le solde commercial en biens primaires s'accroit depuis 2002/2003 pour
atteindre près de 40 milliards de dollars en 2009. En contrepartie, le solde des biens industrialisés
(dont 50% de haute technologie) a connu une évolution inverse atteignant une déficit de plus de 40
milliards de dollars en 2008/2009. Ainsi, la structure du commerce avec le nouveau principal
partenaire commercial de l'Amérique du Sud est devenu depuis les années 1980 un commerce
reprimarisé et dépendant de la Chine.
Au vue de tous ces élements, il nous reste à nous interroger sur l'origine et destination de ce
flux croissant de produits chinois ainsi que sur la spécialisation des exportations et importations
chinoises par pays/régions.
D'une part, il nous faut constater que le taux de croissance des exportations et d'importations
22
chinoises (à destination ou depuis l'Amérique Latine et le Caraïbes) est deux fois plus élevé que le
taux de croissance des exportations et importations totales de la Chine durant la dernière décennie.
Tableau 5: Taux de croissance annuel moyen des exportations chinoises para partenairesRégions\Périodes 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2009Amérique Latine e Caraïbes
32,2 17,8 26,8 26,1
Asie-Pacifique 26,5 9,3 20,3 11,6Etats Unis 36,7 16,1 25,6 10,2Union Européenne
26,3 15 28,8 14,9
Reste du monde 8,6 7,1 26,6 14,3Monde 19,1 10,9 25 13,4
Source: CEPAL (2010: 08).
L'analyse de la structure du commerce extérieur chinois est marquante quand on note que,
dans les années 1980, la Chine se spécialisait dans l'exportation de commodities alors que certains
pays d'Amérique Latine exportaient certains produits manufacturés. Ces profils d'exportations se
sont inversés. Selon Tepassê et Carvalho (2010: 02), « la Chine est devenue un grand consommateur
de commodities, principalement d'origine minière, combustibles minéraux et fruits oléagineux. Le
déficit de produit non-manufacturés a cru de 113 fois entre 1998-2008 alors que l'excédent en
produits de haute technologie a cru 55 fois et le secteur de moyenne/haute technologie est passé
d'un déficit de 17,45 milliards de dollars à un excédent de 37,95 milliards de dollars durant la même
période ».
3.2 - Capital transnational à partir du Brésil: le sous-impérialisme brésilien
Le type d'intégration régionale qui existe aujourd'hui en Amérique Latine présente des
éléments déterminants de ce que certains auteurs de la théorie marxiste de la dépendance appelle le
sous-impérialisme27. Comme d'autres catégories centrales de cette théorie, ce concept est souvent
mal compris nous obligeant à faire quelques mises au point.
Marini (1977: 31) définit le sous-impérialisme à partir de deux composantes. En premier
lieu, quand les économies dépendantes, en raison de l'internationalisation du capital productif,
reçoivent des flux considérables d’Investissement Direct Étranger, généralement venant des
économies centrales, et peuvent engendrer une composition organique du capital supérieure. En
effet, ces capitaux des économies centrales disposent d'un niveau de développement des forces
27 Pour une présentation de l'évolution historique du sous-impérialisme brésilien, voir (Marini, 1977) et (Luce, 2007).
23
productives supérieur que les capitaux existants précédemment dans ces économies dépendantes.
Ainsi ces économies ont des compositions organiques du capital de niveau moyen en relation avec
le niveau mondial.
En second lieu, mais en rapport direct avec le premier point, ces économies commencent à
exercer une politique expansionniste relativement autonome vis-à-vis du capitalisme central.
Ceci signifie que le sous-impérialisme d'une économie considérée implique la croissance de
la composition organique du capital et que, du point de vue du commerce international, ce sous-
impérialisme lui permet de répliquer le mécanisme de l'échange inégal (dans les trois niveaux
d'abstraction discutée précédemment) envers ses partenaires commerciaux qui présentent des
niveaux de productivité inférieurs au sein des mêmes secteurs de production et/ou dans la
comparaison entre les secteurs qui prédominent dans les structures de commerce extérieur entre les
économies. Ainsi, le sous-impérialisme tend à refléter, à une échelle inférieure28, le mécanisme
d'échange inégal qui caractérise la relation entre le capitalisme central et le capitalisme dépendant
mais désormais au sein d'une différenciation interne au capitalisme dépendant. Ainsi, cette re-
configuration du commerce extérieur entre l'économie sous-impérialiste et les autres économies
dépendantes est liée également à un processus d'exportation de capital à partir de l'économie sous-
impérialiste. Ce mécanisme d'expansion du capital productif et/ou financier qui a caractérisé la
phase classique de l'impérialisme des économies Centrales se réplique, d'une certaine forme et à une
échelle inférieure, entre les économies sous-impérialistes et celles qui en sont dépendantes.
L'économie sous-impérialiste commence ainsi à exercer une politique régionale expansionniste
relativement autonome.
Cette dernière caractéristique est sans doute celle qui est la moins bien comprise quand on se
réfère au sous-impérialisme. Ce qu'il importe de noter est qu'il s'agit d'une autonomie relative ce qui
ne veut pas dire :
i) que cette économie sous-impérialiste ne souffre plus des pressions de l'impérialisme
central;
ii) que sa politique expansionniste ne soit pas subordonnée et liée à ces pressions et
finalement ;
iii) que cette expansion relativement autonome ne soit pas déterminée par la logique de
l'accumulation du capital trans-nationnalisé.
Le qualificatif de « relatif » s'appliquant au degré de l'autonomie de la politique
expansionniste a ici toute son importance. 28 Ce qui ne signifie pas que ce soit une délimitation purement géographique mais selon la logique du capital qui peut agir dans tel ou tel espace déterminé. Plus spécifiquement, le fait qu'un capital s’établisse dans une économie plutôt qu'une autre ne le rend pas pour autant “capital national”.
24
Si l'on se reporte maintenant à la structure du commerce en Amérique du Sud, le sous-
impérialisme brésilien se manifeste dans les processus actuels d'intégration productive et
commerciale qui, au-delà de la reprimarisation des exportations des économies de la région,
produisent une hétérogénéité préoccupante.
Graphique 7: Exportations du Brésil vers le reste de l'Amérique du Sud par type de produits et par
contenu technologique (en %)
Source: UN-COMTRADE
Graphique 8: Importations du Brésil depuis le reste de l'Amérique du Sud par type de produits et
par contenu technologique (en %)
25
Source: UN-COMTRADE
Graphique 9: Solde commercial du Brésil vis-à-vis du reste de l'Amérique du Sud par type de produit et par degré de contenu technologique des produits industrialisés (1985-2009) en dollars
Source: UN-COMTRADE
L'analyse des données du commerce entre le Brésil et les autres économies de la région pour
la période 1985-2009 montre que le Brésil exporte près de 80% de produits industrialisés vers le
reste de l'Amérique du Sud et que ceux-ci sont composés de biens de haute et moyenne technologie.
26
Le solde commercial entre le Brésil et le reste de l'Amérique du sud est également conséquent dans
ces deux catégories (respectivement 4 et 9 milliard de dollars en 2008). Le changement a eu lieu
principalement durant la décennie 2000.
On peut donc conclure qu'il existe un spécialisation hétérogène dans la région. L'économie
brésilienne s'est spécialisée dans l'exportation de produits à contenu technologique moyen et élevé
pour le reste de l'Amérique du Sud alors que celle-ci s'est spécialisée en exportation vers le Brésil
de produits primaires et basés en ressources naturelles29. Ceci reproduit à l'échelle régionale la
division internationale du travail qui différencie les économies centrales et les économies
dépendantes créant ce que nous pouvons dénommer de dépendance régionale. Si l'on souhaite
construire une stratégie de développement réellement alternative, dans laquelle l'intégration
régionale elle aussi alternative soit un facteur clé, il est nécessaire que celle-ci propose une nouvelle
division régionale du travail qui corrige la spécialisation hétérogène entre les économies qui la
compose.
Conclusion
A l'heure de la re-configuration du capitalisme contemporain à l'échelle mondiale, cet article
tente de mettre en lumière les résultats de l'insertion des économies sud-américaines dans une
perspective critique basée sur l'analyse marxiste de la Dépendance. Une fois présentée le cadre
analytique dans la première section, nous avons montré comment l'intégration sud-américaine a
évolué depuis les années 1990 et comment cette intégration a suivi les caractéristiques de
l'ouverture et libéralisation même après l'ascension au pouvoir de gouvernements dits
« progressistes » dans la zone. Ce type d'intégration économique et le constat du poids de la Chine
dans les échanges ont joué un rôle fondamental dans la dynamique de l'appauvrissement
technologiques des exportations et une reprimarisation des économies de la région. Enfin, dans ce
contexte sud-américain, le Brésil s'affirme comme base du capitalisme transnational pour ce que
nous avons caractérisé comme sous-impérialisme.
Une autre intégration sud-américaine peut permettre la constitution d'un espace politique et
économique plus vaste (que ce soit pour les petites comme les grandes économies de la région)
donnant un marge de manoeuvre plus importante lors de l'affrontement avec l'impérialisme et avec
les classes dominantes locales qui se bénéficient de cette subordination dès lors qu'une stratégie
alternative existe. A cet effet, il est essentiel de réaffirmer et approfondir un cadre analytique
29 Cette conclusion, illustrée para l'observation en 2009, reflète une tendance observable depuis les années 1990. En rai-son de l'espace disponible, nous ne reproduisons pas ici toute la série depuis 1990 mais celle-ci peut être consultée dans la base de données disponible sur le lien suivant: http://www.cepal.org/comercio.
27
réellement critique c'est-à-dire une critique de l'économie politique actuelle concernant la
thématique de l'intégration économique régionale.
Bibliographie
Amaral, M. S. (2006) A Investida Neoliberal na América Latina e as Novas Determinações da
Dependência. Dissertação de Mestrado – PPGE-UFU, Uberlândia.
Amaral, M. S. et Carcanholo, M. D. (2009) A Superexploração do Trabalho em Economias
Periféricas Dependentes. Revita Katalysis, vol. 12, n.2, Florianópolis.
Carcanholo, M. D. (2010) Neoconservadorismo com Roupagem Alternativa: a Nova Cepal dentro
do Consenso de Washington. Em: Castelo, R. (Org.) Encruzilhadas da América Latina no
Século XXI. Rio de Janeiro: Pão e Rosas.
Carcanholo, M. D. (2008) Dialética do Desenvolvimento Periférico: dependência, superexploração
da força de trabalho e política econômica. Revista de Economia Contemporânea, Rio de
Janeiro, Vol. 12, n.2, pp. 247-272, maio/agosto.
Carcanholo, M. D. (2005) A Vulnerabilidade Econômica do Brasil: abertura externa a partir dos
anos 90. Aparecida: Idéias & Letras.
Castelo, R. (2010) O Novo-desenvolvimentismo e a decadência ideológica do estruturalismo latino-
americano. Em: Castelo, R. (Org.) Encruzilhadas da América Latina no Século XXI. Rio de
Janeiro: Pão e Rosas.
CEPAL (2010) La República Popular China y América Latina y el Caribe: hacia una relación
estratégica. Santiago: CEPAL.
Ffrench-Davis, R. (2005) Reformas para América Latina: después del fundamentalismo neoliberal.
Buenos Aires: CEPAL, Siglo XXI Editores.
Gambina, J., Roffinelli, G. et Pinazo, G. (2010) Propuestas Alternativas para la Integración
Regional: modelo de acumulación capitalista a comienzos del siglo XXI y la integración em
procesos de cambio político. Tiempo de Crisis – Revista de Economía Política
Latinoamericana, ano 1, n. 2, segundo trimestre, Caracas.
Gambina J. 2011. Un modelo en discusión, em Página 12, “Debate:Que integración regional
conviene?”, 20 de junho, http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-170443-2011-06-
20.html .
Gambina J. 2010. La crisis capitalista y sus alternativas. Una mirada desde América Latina y el Ca-
ribe. Colección Grupos de Trabaj, de. Clacso.
Kuczynski, P. P. et Williamson, J. (2004) Depois do Consenso de Washington: retomando o
28
crescimento e a reforma na América Latina. São Paulo: Ed. Saraiva.
Luce, M. S. (2007) O Subimperialismo Brasileiro Revisitado: a política de integração regional do
governo Lula. Dissertação de Mestrado, UFRGS.
Macedo e Silva, A. C. (2010) O Expresso do Oriente: redistribuindo a produção e o comércio
globais. Observatório da Economia Global, textos avulsos, n.2, abril. CECON – Unicamp.
Marini, R. M. (2000) Dialética da dependência. Em: SADER, E. (Org). Dialética da dependência:
uma antologia da obra de Ruy Marini. Petrópolis-Rio de Janeiro:Vozes/Buenos
Aires:CLACSO.
Marini, R. M. (1977) La Acumulación Capitalista Mundial y El Subimperialismo. http://www.marini-
escritos.unam.mx
Martins, C. E. (1999) Superexploração do trabalho e acumulação de capital: reflexões teórico-
metodológicas para uma economia política da dependência. IV Encontro Nacional de
Economia Política, Porto Alegre-RS.
Marx, K. (1983) O Capital: crítica da economia política. 5 volumes, São Paulo: Abril Cultural.
ONU (2008) World Economic Situation and Prospects. Departamento de Assuntos Econômicos e
Sociais, ONU, Nova York.
Ortiz, I. et Ugarteche, O. (2008) El Banco del Sur: avances y desafíos. CADTM, outubro.
Disponível em http://www.cadtm.org/El-Banco-del-Sur-Avances-y
Paschoa, J. P. P. et Carcanholo, M. D. (2010) Crise Alimentar e Financeira: a lógica especulativa
atual do capital fictício. Em: Gambina, J. C. (Org.) La Crisis Capitalista y sus Alternativas:
una mirada desde América Latina y El Caribe. Buenos Aires: Clacso Libros.
Saludjian, A. 2010. Estratégias de Desenvolvimento e Inserção da América Latina na Economia
Mundial. Os estruturalistas e neoestruturalistas da Cepal: uma abordagem crítica. Em:
Castelo, R. (Org.) Encruzilhadas da América Latina no Século XXI. Rio de Janeiro: Pão e
Rosas.
Saludjian, A. 2006. Pour une autre intégration Sud-américaine: Critiques du Mercosur néo-libéral.
Paris: Editions L’Harmattan.
Santos, T. dos (1978) Imperialismo y Dependencia. México: Ediciones Era.
Santos, T. dos (1970) The Structure of Dependence. The American Economic Review, Nova York.
29