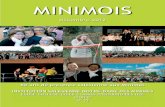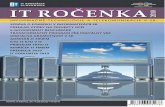Invention de la philosophie américaine comme invention de soi: R.W. Emerson
La Revue F Américaine - Forgotten Books
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La Revue F Américaine - Forgotten Books
L’
HONORABLE A . TURGEON M . GEORGES GARNEAUMin i s t re des Terres et F orêts . Mai re de Québec .
Membresfde la Comm i s s ion nomm ée par le gouvernement fédéral pour l'établ issem en t d
’
un parc à Québec et pour la célébrat i on des fêtes du t rois ième cen tenai rede la fondat ion de Québec .
L ’HONORABLE P. H . ROY L’
HONORABLE P. E . L EBLANCPrés iden t de la cham bre des députés [ Chef de l
’
oppos it ion con servatri ce , àdellaÏprovin ce de Québec , déput é du l
’
As semblée Légi s lat ive de la provin cecom té de St . Jean . de Québec , député du com té de Laval.
M . A . GAL IPEAULT M . L .—A. CARR IER
Echevin de la v i lle de Québec et député par le com té de L évi s au
Prés i den t du Com i té de Pol i ce. parlem en t fédéral.
L’
HONORABLE C _
_ E _ D UBORD M . G .—A . VAND RY
conse i ller légis lat i f pour ' 13. D i recteur des G rands Magasm s
province de Québec . Z . Paquet .
L’
HONORABLE JUGE BOSSÉ L’
EON . L . A . TASCHEREAUMin ist re des Travaux Publi cs et duJuge de la Cour du Banc du R 0 i ° Travai l de la province de Québec .
M . GEORGES TANGUAYSIR FRAN Ç O IS LANGEL IER X-Mai re de Québec, député par le
com té du Lac Sai n t -Jean à l’
asJuge en chef d i v i s i on de Québec de la sem blée L égi s lat ive de la
J Cour‘
Supérieure. prov in ce de Québec .
LA PECHE A LA PETITE MORUE .— Cabanon in stallé sur la glace pour
le bénéfice des pêcheurs . A l’
in tér ieur se t rouve l’
or ifiÿe percé dan s laglace où les pêcheurs jetten t l ’hameçon .
‘3
lTROIS PAR FAITS COMPAGNONS .
VIE D E MAQUIGNONS . Essayons le poulain !
COUR SE IMPROVISÉE .— Eu route pour le vi llage.
LES PRECURSEURS D ES BR ISE-GLACE .
—“G lis sez
,m ortels ,
n’
appuyez pas !
LES JEUNES S ’
AFF IRMENT.UN JEUNE APPRENTI DE LARAQUETTE
OU LES INTEBETS SE PARTAGENT. Viei lle gravure .)
Avis au public
La Revue F ranco-Améri cai ne n ’a pas la prétention de comblerune lacune ; elle se contente de prendr e tout simplement sa placeau soleil , en promettant de se rendre utile , et avec l
’espoir d ’attirer l ’attent ion des Canadiens—F rançais
,qu ’ils habitent le Canada
ou les Etats—Unis,sur certaines questions d ’un intérêt national .
Les fondateurs,en en faisant une revue litt éraire
,économique
et sociale,manifestent
,sans doute
,l ’intention d ’aborder un
nombre très vari é de sujets,comme on pourra le constater par
le programme—prospectus publi é dans le présent numéro .
Mais leur but principal,est de concentrer plus spécialement
leur s efforts sur les questions d ’int érêt pratique qui affectentd ’une f eqon plus immédiate notre organisation nationale , nosdevoirs comm e race
,nos états de services et les droits qu ’ils
nous confèrent,en un mot
,notre rôle comme race française .
Les développements merveilleux que prend chaque j our notrepays
,la marée montante de l ’immigration qui envahit les
vastes plaines de l ’ouest et déplace d ’année en année le centrede notre activit é nationale sont des avertissements que lesmaîtres du sol ne peuvent feindre d ’ignorer
,et cela
,les membres
du groupe français moins que les autres . C ’est le progrès quipasse il faut le suivre ou se résigner à être infailliblementécras é par lui . Quel rôle voulons —nous j ouer
,quelle position
voulons—nous occuper dans ce XXi ème siècle qu ’on nous montresi plein de promesses ? Nous ne pouvons répondre a cettequestion qu ’en consultant notre pass é
,en nous demandant si nous
avons marché du même pas que ceux qui nous entourent et,s i
nous . nous sommes laiss és devancer,en recherchant les moyens
à prendre pour rej oindre la colonne principale de la nation .
L ’ étude de nos questions économiques au point de vue
canadien— français nous révélera plus d ’un état . de choses àaméliorer , plus ‘
d’
une situation à corriger,plus d ’un programme
à compléter . S ’il est vrai,et rien ne prouve que ce ne soit pas
vrai , qu’une race
,pour être puissante
,doit poss éder les ins
t i tut ions qui reçoivent ses épargnes nous étudierons a cepoint de vue les causes de nos succ ès et de nos échecs . Nousverrons si , dans notre monde financier
,nous occupons la position
que nous garantissait notre titre de ma îtres du sol . Où estall ée notre épargne
,quelle est l ’importance de nos banques
,
6 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
de nos institutions financi ères comparées aux institutions fondées par ceux qui sont arrivés bien après nous dans le paysLes sociétés nationales sont une source de force
,un moyen
d ’action que personne n ’ose plus mettre en doute . Qu ’est—ceque nous avons fait sous ce rapportL ’étude de cette quest ion nous permettra de constater les
progrès de la mutualit é parmi nos populations , puis aussi , dereconna ître que si la fraternit é ne nous a pas laiss és indiff érents ,elle nous a trop souvent pouss és à d ’étranges égarements .On verra la comment notre influence a ét é livr ée à nos advers aires et quels moyens nous devons prendr e pour la reconquérir.Les Canad iens des Etat s -Un is
Les diff érents articles de notre programme—prospectus embrassent toute l ’action canadienne—française dans l ’Am ér iquedu Nord, et partant une attention sp éciale sera accordée auvigour eux rejeton de notre race qui a déjà pouss é de profondesracines , à côté de nous, dans la fiévreuse r épublique américa ine .Et il ne sera pas sans int érêt
,pour les fervents de la cause
nationale,d’étudier dans les détails l ’œuvre splendide aecom
plie dans la république américaine par des nôtresde voir comment ils savent prouver leur loyauté envers le ”
drapeau et les ins t itutions de la république,tout en restant
attachés à. leur foi,leur langue et leurs coutumes faisant
lentement la conquête d ’une large place dans la politique , lecommerce et l ’industrie de leur nouvelle patrie s amant parcentaines les écoles
,les églises
,les sociét és de bienfaisance et
de secours mutuel dans la Nouvelle—Anglete rre, se montrantpartout les plus fermes soutiens de l ’Egl ise en dépit , tropsouvent
,du mauvais vouloir de ceux—là mêmes qui auraient
dû les encourager et les aider dans la r éalisation de leur idéal .Cinquante années de luttes pour l ’existence et pour la foi
,cin
quante ann ées de progrès malgr é la pers écution religieuse,
voilà ce que La Revue F ranco—Améri cai ne se fera un devoir deraconter et de mettre en pleine lumière . Et cette tâche
,on le
sait,lui sera rendue d ’autant plus facile et d ’autant plus
agréable que son directeur aura,pour l ’aider
,les souvenirs de
plusieurs années de travaux et de luttes au milieu même de cegroupe vigoureux et si profondément patriotique .Nous présentons donc au public
,avec confiance , cette Revue
F ranco-Améri cai ne dont le seul but est d ’être utile et dont ladevise
,à l ’égard de nos compatriotes
,sera celle d ’un roi fameux :
Je sers — La D i rec t ion.
8 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
mœurs politiques,constitutions
,préjugés
,conception de la
liberté,droits des gens
,etc .
,administration fédérale et pro
vinciale .
MUTUAL ITE : Organisation et fonctionn ement des soc1 et és
de bienfaisance et de secours mutuel,évolution des systèmes
,
responsabilit és encourues,échecs
,succ ès
,moyens à prendre
pour assurer l ’avenir,
'statistiques de vitalit é et de mortalité,
etc .,le principe national et religieux dans la mutualit é
,erreurs
commises sous ce rapport dans le pass é,l ’association comme
moyen d ’action,etc .
PATR IOTISME Rôle que peut j ouer la race canadieune
française sur le continent,sa mission
,son développement au
milieu de circonstances adverses , les vertus civiques qui fontsa force
,la conscience qu ’e lle doit avoir de sa dignité et de son
droit d ’égalit é avec ses voisins le rôle j ou é par desnôtres dans la civilisation américaine , etc .La Revue
,essentiellement consacrée aux intérêts canadiens
français,s’
ef forcera,en outre
,de tenir ses lecteurs au courant
du mouvement des idées dans le monde,en accordant une
attention plus spéciale aux relations de notre groupe avec lamère patrie— de là son titre de Revue F ranco—Amér i cai ne.
Philosophie,l ittérature
,économie politique
,histoire
,religion
,
voilà en résumé et à grands traits quels seront les sujets quilui donneront le ton et le but de son travail .Aj outer a cela la chronique des modes , des arts lib éraux , ducommerce
,des Opérations de bourses
,banques , assurances de
vie,etc .La Revue sera catholique .
La Littérature canadienne et les Franco
Américains
Des re lations qui ont existé de tout temps entre les canadi eus de notre vi ei lle province et ceux des Etats-Unis , lesre lations li ttérai res sont peut-être les plus fortes et les plusconstantes .
Les Franco-Améri cains de la Nouvelle Angleterre li sentnos journaux et nos revues
,i ls achètent nos l ivres , ils vont
entendre les conférenci ers que nous leur envoyons .E t on peut presque dire qu ’ ils se sont
,en maintes occa
sions,montrés plus souci eux de tout ce qui touche a nos pro
duction s li ttérai res,que nous n e l ’avons fait nous -même s au
Canada .
Evidemm en t ,— ces productions littéraires étant relative
ment rares, j
’
as s im i le i ci a la littérature , ce qu i n ’y toucheque de loin et de très loin parfoi s
,nos journaux ou nos con
f érencier s .
Mais , sous quelque forme que ce soit , i l n ’ en est pas moinsvrai que tout cela leur apporte quelque chose de notre pensée ,de la forme que nous tâchons de lu i donner ; et tout ce la ,c ’ est littérature , jusqu ’ à un certain point .
S i vrai e , s i réel le es t cette communauté de sentiments littéra ires et d ’ intérêts arti stiques
,parmi les canadiens des
deux côtés de la fronti ère,que M f Abder Halden
,en ses
essai s de critique sur notre l i ttérature,a consacré tout un
chapitre à Henri d ’
Ar les, un écr ivain de la Nouvel le -An
gleter re que nous connai ss ions déjà en la province de Québecet dont nous avons avec joie accue i ll i la fraternité .
I l y a la, croyons-nous , une nouve lle ra i son d ’ espérer en
l ’aven i r de notre littérature ; et l ’aide que nous pouvon s attendre de nos compatriotes des Etats —Un i s e st auss i as suréqu
’
im por tan t .
Dans ma courte carr i ère d ’écrivain canadien -fran çais,j ’ai
toujours remarqué avec une certaine philosophie que nos
LA REVUE FRANCO-AMERICAINEefforts l ittérai res sont soulignés plus fortement , et reconnuspl us librement par ces confrères d ’outre—frontière .
E t j e n ’hésite pas a di re que les éloges les plus spontanéset les plus forts nous viennent très souvent des journauxf ranco-américains .
Et cela s ’ étend à ceux qui nous ont précédés .Tandi s qu ’au Canada
,au sein même du petit cercle de lit
t érateur s qui luttent entre deux bouchées de vie quotidi enne ,o n reni e notre passé littéraire pour se donner l ’air d ’avoirtout inventé
,dans la Nouvel le—Angleter re ,
nos œuvres sontplus lues
,plus goûtées , moins oub liées je parle lades œuvres
d e que lques-un s de .nos vieux écrivains , poètes et historiens ,
‘
c hroniqueurs et romanciers , qui sont encore les me i lleurssouvenirs de notre histoire littéraire .
De plus,si l ’on aime à nous lire , chez ces compatriotes de
là-bas,c ’est surtout quand nous traitons du pays , de nos tra
di tion s,de notre langue et de nos espoirs .
Je croi s que l ’on a peu souci,en ces petites villes éton
nantes de l ’est américain,de nos imitations plus ou moins
colorées de cette école névrosée dont la France nous envoiepériodiquement quelques échos .
Ce qui convient à un peuple j eune comm e le nôtre , a unp euple dont les premiers déve loppements demandent deseffort s virils et énergiques , ce ne sont pas une ver s ification
d ’hôpital et des impressions sub limées dans le vague et l ’ indéfini .C ’est une littérature saine et vigoureuse
,germée au pays .
Nous l ’avons déjà dit et nous le maintenons ; l ’ influencede certaines tendances li ttérai res de la France actuel le epeut qu ’ être préjudi ciable à nos j eunes écrivains .
E lles les é loignent du m i li eu où nous vivons,pour les porter
à des .enthousiasmes et ades vi s ions que la plupart des n ôtre sne peuvent comprendre ; ou si nous les comprenons , l ’ imitateur n ’ayant pas cessé d etre le “ servi le pecus dont parlaitHorace , e lles ne peuvent nous intéresser vraiment que pourd es raisons d ’estime ou de sympathie , qui n
’ont qu’un
c aractère li ttérai re très vague .
Je ne crois pas qu ’ il y ait possibilité d ’une littératuren ationale qui ne soit pas basée sur une communion d ’ idées
LA REVUE FRANCO —AMÉRICAINE 1 1
e t de tendances entre l ’écrivain et les lecteurs auxquels i ls
’adres se .
E t c ’est précisément parce que les F ranco-Amér icains ont
continué à aimer ce qui , dans nos œuvres littéraires , leurparle du Canada
,que nous pouvons compter sur eux pour
déve lopper une littérature canadienne .
On a en maintes occas ions , signalé les obstacles auque l—3s e heurtent les espo irs de ceux qui ont f oi en cet avenir : lacomparaison des œuvres françaises , la dual ité des langues au
Canada,la nécessité du pain quotidien a laque lle ne saurait
répondr e le seul travai l littéraire au Canada , la di sproport ionentre l ’ éducation du peuple et l erudi tion graduel le de nos
écr ivains , et autres .
Mais nous ne devons pas non plus faire preuve d ’
impa
tience .
Nous voyons dans l ’histoire que le déve loppement artistique a toujours suivi , chez les peuples ,
le développementéconom ique .
Ce n ’est que lorsqu ’un peuple a acquis surabondammentde richesses , qu
’ i l peut se payer le luxe d ’une vaste sociétéd
’écrivains et d ’artistes .
Aussi ,— quoique ceux que leur destinée pousse invincib lement aux ar ts ne doivent pas s
’ en détourner ,— à l ’heureactue lle il importe surtout que nous travai llion s à procurer ,par l ’amé lioration constante des méthodes de culture , parune poussée commerciale et industrie lle intense , notre puissance
,notre vitali té économiques .
Et c ’ est la m ati ère d ’ éducation,éducation par l ecole et
éducation par la presse .
Tandis qu ’une classe choi s i e d ’écrivain s continuera nostraditions littérai res et que les lecteurs grandiront en nombre , d
’année en année,nos progrès économiques rendront
poss ib le notre épanouissement littéraire .
I l faut d ’
abord que nous apprenions a être pu i s sants de laforce qui fai t les peuples ; l ’exploitation inte lligente de leursressources .
Ce n ’ est que lorsque nous aurons conquis cette puissanceque nous pourrons espérer la puissance li ttéraire et artistique .
En attendant , soyons soucieux du peu que nous avons etn ’oub lions pas dans quelles conditions nous l ’avons acquis .
1 2 LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINENe méprisons pas notre passé littéraire : aimons-le pour la.
s incéri té de l ’ e ffort et le caractère national qu ’on y retrouve .
Et continuons de marcher dans cette voie , qu i peut nousmener que lque part
,au lieu de nous arrêter à cueillir sur le
bord de la route quelques pales fleurs , dont la graine estvenue en notre terr e apportée sur les ailes d ’un vent lointain , et qu i n
’auront de parfum qu ’un jour .Il nous faut une littérature nationale
, qui exprime l ’ idéalcommun des Canadi ens de notre
. provin ce et des FrancoAm.éri cains de la Nouvele—Angleter re : travai llons -y dès
maintenant sans nous lasser . Et n ’oub lions pas que notredéve loppement économique est es sentiellement néces sai re àce déve loppement l ittéraire .
Il y a la un vaste champ pour nos éducateurs .
Fe rnand Ri nf ret
Le sentiment national dans le mutualité
C ’est de toutes les questions d intérêt national celle qui ,nous ne savons trop pourquoi , attire le moins l
’
attention denos compatriotes . Et
,lorsque nous affirmons cela
,nous tenons
compte de ce qui a ét é fait de bien dans ce sens parmi les nôtres .Comme question de fait
,la mutualit é est fort en honneur
dans la plupart de nos villes et de nos centres,mais elle l ’est
surtout a cause de ses avantages mat ériels . A tel point que ,peu apeu
,elle est devenue une question de boutique
,une mar
chandise que les recruteurs colportent pour le compte du plusoffrant
,sans se soucier des principes de haute port ée morale
qui s ’y rattachent,quelquefois même sans s ’inquiéter du côt é
m atériel dont on ne voit pas , on dont on ne veut pas voir , lesé l éments de faiblesse et d
’incertitude . Le travail,alors
,au
lieu d ’avoir ce caract ère de bienfaisance et de patriotisme dontil a besoin pour être complet et vraiment mutualiste
,ne s ’arrête
plus que devant une formule recruter des membres,recruter
des membres à tout prix .
Limiter ainsi la question c ’est ouvrir la porte toute grande à.des abus tous les j ours plus nombreux
,sans compter que c ’est
jeter inconsidér ément sur le bord du chemin un de nos plussûrs moyens d ’activit é nationale . On le comprendra mieuxlorsqu ’on aura mesuré toute la profondeur de l ’abîme creus échez nous par l ’ œuvre néfaste des mutualit és cosmopolites .C ’est une idée de ralliement national et d ’action patriotique
,
— j ’allais dire que c ’est l ’instinct de la conservation qui inspiraà Ludger Duvernay la fondation de notre soci été St JeanBaptiste
,la première de nos mutualit és canadienn es— françaises .
Encore,cette soci ét é n ’est—elle qu ’une mutualit é essentielle
ment et exclusivement patriotique parce qu ’elle n ’a pas encoresongé à étendre son action jusqu ’au secours mutuel qui estpourtant son corollaire naturel et nécessaire . Mais
,a l ’époque
de sa fondation et plus tard,lors de sa r éorganisation
,on ne
songeait qu ’au besoin immédiat de créer une idée nationale envue de luttes futures
,puis aussi de fournir un point de ralliement
aux esprits quelque peu troubl és par les tragiques événementsde 1 837— 1 838 . On c édait surtout devant la nécessit é de sesentir les coudes
,de grouper les volontés
,de retremper les
1 4 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
courages en montrant les rangs plus serr és et plus forts pourla lutt 3, d
’établ ir entre les cœurs les liens indissolubles d ’uneamiti é jur ée en face des mêmes idéaux et des mêmes dangers .Ce fut une œuvre splendide qui r épondit parfaitement à lapens ée de ses fondateurs et donn a des fruits abondante. Quele temps
,et avec le temps , des conditions nouvelles de vie
sociale et nationale aient indiqué qu ’il fallait étendre plus loinune sphère qui ne suffi t plus aux besoins de notre époque , c ’est.ce qui est peut-être encore discutable . C ’est
,dans tous les cas
,
ce qu ’il serait temps de discuter . Nous aurons,du reste , l
’occasion de poser ce probl ème devant nos lecteurs dans une
étude subs équentPour le moment
,qu ’il nous suffi se de noter les circonstances
dans lesquelles les patriotes ont songé à s ’armer de l ’association .
Un peu plus tard,et sur un terrain où les luttes n ’ont pas
cess é d ’être ardentes,les Canadiens—français émigr és aux Etats
Unis demandèrent a la sociét é mutuelle la cohésion indispensable pour revendiquer des droits imprescriptibles et sauver dunaufrage le dépôt sacré de la foi et des traditions ancestrales .Les conditions économiques particulières où ils se trouvaientde l ’autre côt é des frontières les portèrent à organiser une
œuvre qui,tout en réunissant toutes les qualit és patriotiques
des organisations connues au pays,offraient à leurs familles
,
sous forme de secours matériels,la protection qu ’ils en atten
daient dans un domaine purement moral . C ’est que le besoinde s ’aider les uns les autres dans la lutte pour la vie apparaissaita leurs yeux aussi impérieux que la nécessité de grouper leursforces pour revendiquer , trop souvent contre des cor éligion
naires,des privil èges que la très large constitution américaine
ne le 1 ir défendait pas de r éclamer . D ’autre part,ils eurent
bientôt sous les yeux,surtout depuis 1 868
,l ’exemple de leurs
concitoyens d ’autre origine multipliant dans tous les Etats dessociétés populaires sous des noms plutôt pompeux qui rêvél èrent plus tard des tendances quelquefois troublantes .Mais les F raDoo—Américains— c ’est le nom dont se r éclament
auj ourd ’hui nos compatriotes des Etats-Unis— h’avaient pas
attendu que cet exemple leur fût donn é pour se mettre euxmêmes à l ’ œuvre et pour organiser chez eux le secours mutuelet la défense de la nationalit é . En 1 868
,alors que fut fondée
la première soci ét é de bienfaisance américaine , les nôtres poss édaient déjà une vingtaine, ou tout près, de sociétés de secour smutuel parfaitement organis ées et donnant les premiers indicesd
’un déve loppement ”qui devait
,durant les vingt—cinq années
1 6 LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE
canadienne— française vers les Etats—Unis devint moins activee t que
,d ’un autre côté
,le z èle des patriotes s ’appliqua surtout
a remplir les cadres splendides qu ’on avait bâtis pendant lesd erniers vingt— cinq ans . Auj ourd ’hui
,dans la Nouvelle
Angleterre, et même dans l’
Ouest , le mouvement des soci étésa pris une tournure plus pratique
,en ce sens qu ’il tend à rendre
plus complet le contact entre les groupes , et qu’il est en train
d e cr éer,au moyen d ’une foule d ’organisations autonomes mais
unies,une force nationale qui imposera le respect et garantira
un avenir que même les plus enthousiastes ne regardaient passans inquiétude .Les résultats obtenus dans cette direction sont déj à cons i
d érables,a te l point que les Franco Am éricains poss èdent dans '
leurs soci étés nationales fédératives , l’
Union Saint—Jean—Baptiste d’
Am ér ique , l’
Associat ion Canado—Am éricaine et l ’Ordredes Forestiers Franco—Américains
,pour citer les trois plus
importantes,des associations dignes de prendre place au premier
rang de la mutualit é américaine . Même,l’
Un ion St-JeanBaptiste d’
Am ér ique, au dire des commissaires d’assurance de
plusieurs Etats,offre le type le plus complet d ’assurance fra
t ernelle qui soit connu aux Etats—Unis . Au Canada, le mêmeprogrès s ’est accompli avec les sociétés admirables que sont lesArtisans Canadiens—Français
,l’Al liance Nationale
,l’Un ion St
Joseph,des soci étés qui
,disons-le
,devraient recevoir l ’encou
ragemen t unanime de tous les Canadiens— français , tout commeles sociétés franco-américaines que nous venons également den ommer devraient pouvoir compter sur l ’appui unanime ete nthousiaste de tous nos compatriotes établis de l ’autre côt éde la frontière . De là. à établir
,au moyen de nos soci étés
,des
relations plus intimes et surtout plus suivies entre ces deuxgroupes égaux de notre nationalit é il n ’y a qu ’un pas
,et ce
pas ne saurait plus être fait trop tôt .Si les limites de cet article nous le permettaient
,nous prou
ver ions facilement qu ’au strict point de vue financier,que par
la force même de leurs syst èmes et les garanties qu ’elles offrentà leurs membres
,nos sociétés nationales ne laissent pas même
aux amants de la mutualit é cosmopolite l ’excuse d ’avoir cherchéailleurs des avantages qu ’ils ne trouvaient pas chez eux . Maiscette étude nous entraînerait trop loin. D ’ailleurs
,l ’idée
même qui a présidé à la fondation des sociétés de secoursmutuel nationales
,devrait suffire à convaincre que c ’est de
leur côt é que nous devons diriger nos efforts,que c ’est sous leur
bannière que nous devons chercher secours et protection .
LA REVUE FRANCO —AMÉRICAINE 1 7
D ’autant plus qu ’en agissant ainsi nous contribuons à cons oliderles forces de notre race et que nous faisons , pour ainsi dire ,d ’une pierre deux coups . On serait émerveill é , si on pouvaitconstater tout ce que nos soci ét és ont accompli
,au Canada
comme aux Etats—Unis,pour la conservation de la langue et
de la foi chez les nôtres,pour la conservation des coutumes et
des traditions ancestrales,pour la défense des droits du faible ,
pour la sauvegarde des int érêts essentiels à notre vie nationalePourtant
,si tout cela a pu être accompli pendant que des mil
liers de compatriotes portaient a des organisations touj oursindifférentes quand elles ne nous étaient pas hostiles , leursépargnes et leur dévouement
,quel n ’eut pas ét é la splendeur
de l ’ œuvre accomplie sous l ’effort unanime de tous C ’est uneerreur de jugement
,dira— t-on
,qui a permis l ’exode de tant des
nôtres vers des mutualit és qu ’ils ne connaissaient même pas ,mais erreur fatale entre toutes
,erreur capable de tuer une race
plus vigoure‘use que la nôtre,si nous n’avions eu le contrepoids
de nos organisations propres . Un oubli , diront d ’autres .Qu ’importe le nom si le résultat est le même Des peuples
,
dit Montesquieu,sont tombés des plus hauts sommets de la
civilisation a la ruine et a la servitude pour s ’être abandonnéspendant deux générations .” Depuis deux générations , quelsprogrès ont accompli les Canadiens— français Il y en a denotables
,mais à quel prix ont—ils ét é obtenus
On aura beau dire,le sentiment de la race ne se dépouille pas
comm e un vie il habit . Il n’est pas un accessoire de conventionque l ’on puisse sacrifier aupremier caprice venu , que l ’on puissec éder devant un intérêt même cons idérable . Il a pouss é dansle cœur de l ’homme des racines trop profondes , il le rattachepar trop de fibres vivantes à ce pass é plein d’
aneêtres dont ilest la continuation et dont il est
,malgr é lui , orgueilleux, pour
qu’il ne se sente pas tressaillir éternellement de cette s ève qui
le féconde à travers les si ècles . Ceux—là mêmes qui le r épu
dient , pour le compte de quelque innovation fasc inante , ens entent encore toute la force
,et le premier cri du cœur viendra
d émentir les paroles dont ils avaient cru sceller l ’apostas ie deleur sang . Les Anglais
,qui s ’y connaissent , ont dit fort bien
Le sang est plus épais que l ’eau Et on sait si cet axiomeest touj ours présent à leur mémoire .Du reste
,les exemples ne manquent pas qui prouvent la
vitalit é de ce sentiment plus fort que les révolutions et lesconquêtes
,et qu ’on retrouve encore dans la cendre éte inte de
tant d ’autres choses sacrées,langue
,foi
,coutumes
,traditions
,
LA REVUE FRANCO —AMÉRICAINE
emportées dans le tourbillon des circonstances et des conditionspolitiques . Les autres disparaissent , celui— là reste . Aprèsplusieurs si ècles d ’évolution
,de progrès matériel et de change
ments incessants,nous retrouvons encore aux Etats—Unis
,
vivace et fier,le sentiment
,de la race proclamé par un chef
d’
Etat fameux qui vénère le souvenir épique de ses ancêtreshollandais établis à New Amsterdam .
Pourquoi croirait—on,après cela
,que le sentiment national
est chose futile et qu ’on a tort de le faire intervenir dans ledomaine de notre organisati on sociale . Nous voudrions l ’enchasser que nous ne le pourrions pas . Et les mesures que nouspourrions prendre contre lui ressembleraient beaucoup au proc édé de ce roi de l ’antiquité qui voulut enchaîner la mer .Le sang est plus épais que l ’eau dans les organisationsmutualistes comme ailleurs . C ’est une vérit é que nous rencontrons tous les j ours sur notre route et dont nous ne semblonspas vouloir faire notre profit .Le fait que les soci ét és de secours mutuel sont des collecti
vités , indique déj à suffisamment qu ’elles agiront d ’une certainefaçon selon qu ’elles seront compos ées de membres appartenantà telle ou telle nationalité . S ’il s ’agit d ’une organisation cosmopolite , c
’est le groupe national le plus nombreux qui luiimprimera son caractère . On y distribuera bien
,pour l ’amour
de l ’harmonie,les charges de façon acontenter tous les groupes
,
mais la direction immédiate , le rôle prépondérant , est touj oursr éservé au groupe plus nombreux qui s ’est donné pour missionde donner le ton à. la société . Qui a j amais prétendu que lesForestiers Indépendants n ’ étaient pas une société essentie llement anglaise On ne songe même pas à nier qu ’elle appartienne d ’
assez près,par ses chefs
,au groupe maçonnique .
Nous pourrions dire la même chose des Forestiers Catholiques,
des Woodmen of the World , du Royal Arcanum,des Knights
of Columbus,de la Union Fraternal League
,etc . Toutes ces
organisations se réclament d ’un principe auquel elles donnentdes accents de clairon et qu ’
elles r ésument dans une formuleBrothcrhood of Men (Fraternit é de l ’homme ) , une sorte deréédition de ce cri de Libert é
,Eg. l it é
,Fraternit é
,
” quiouvrit en Europe l ’è re sanglante des révolutions et fit de ladéclaration des droits de l ’homme le l inceul de la libert é .Mais la formule était brillante et elle obtint du succ ès . Lessociétés qui l ’ava ient inscrite sur leurs bannières recrutèrentdes membres par centaines d emille
,surtout parmi les éléments
plus faibles . Au fond,cette fraternité de l ’homme tant
LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE 1 9
vant ée ne sortit pas de la formule et nous pûmes voir chaqueorganisation pour suivre discr ètement le but que lui donnaientses chefs . Organisations anglaises , elles consolid èrent des int ér êts anglais , elles accomplirent une œuvre anglaise . Ce faitfut surtout apparent aux Etats-Unis où nos compatriotesFranco—Américains furent les premiers à souffrir de ce modenouveau de charit é . L ’attitude des Forestiers Catholiquesenvers le congrès de Springfield, l ’abolition de la lang ue française par les Forestiers d’
Am ér ique , leur ouvrirent enfin lesyeux et provoquèrent des mouvements de revendication nationale qui r évolutionnèrent , dans l
’espace de quatre ou cinqannées
,la mutualit é franco—américaine . Le j our où pareil
r éveil se produira dans la Province de Québec,au sujet de la
mutualit é anglophone,ce j our— là. l ’esprit national aura bris é
une de ses plus fortes entraves nous aurons vu la fin des doctrines énervantes qui font de l’int érêt le premier mobile desactions nous aurons compris , enfin , qu
’une race,pour être
forte,doit concentrer son énergie dans ses propres institutions
,
et affirmer carrément son droit à l ’existence . Du reste,cela
n ’empêche ni les bonnes relat ions,n i le respect mutuel entre les
divers groupes ethniques qui composent une nation comme lanôtre .Après tout
,nous avons c édé trop facilement devant cette
affirmation de M . D esmollins sur la supériorit é des Anglosaxons .
” Notre situation économique nous a peut- être pouss és
,plus que d ’autres , à accepter ce jugement pour décisif.
Pour notre part,nous préférons nous en tenir à la thèse de
M . Brunet i ère que nous devons être les artisans de notre propresupériorit é , en développant avec plus de soin les traits principaux de notre caract ère et en dessinant avec plus de netteténotre figure nationale . Voici ce que disait l ’illustre académ icien Les Anglo-Saxons , plus heureux que . nous en ce moment
,et plus favoris és de la fortune
,nous sont— ils supérieurs
Je n ’en sais rien je ne le crois pas quelque chose en moi serefuse à le croire . Mais cette supériorit é s ’il me fallait lareconnaître
,j e dirais hardiment et j e montrerais ais ément qu ’ils
la doivent surtout ace qu ’ils sont,touj ours et en tout demeurés
des Anglo-Saxons . Cc_
qu ’ils sont et quoi qu ’ils soient,.
défauts et qualités mêl és et compens és,ils le sont pour avoir
mis à l ’être une orgueilleuse obstination et si nous voulonsles imiter , la manière n
’en est pas de les copier servilement,ni
de démarquer , pour ainsi dire , leurs habitudes , mais d ’êtrenous connue ils sont eux
,Français comme ils sont Anglais
20 LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE
de pers évérer dans la direction , d’abonder dans le sens de notre
propre histoire et ainsi, d’aj outer un anneau d ’âge en âge à
la cha îne de nos traditions .”Voilà des paroles d ’or qui devraient faire loi dans tous les
domaines de notre activit é nationale . Qu’il nous suffise,en
ce moment, de les appliquer à la mutualit é qui est , de nos ‘
jours ,une des plus puissantes manifestations de l ’activit é populaire .En nous atteignant par ce côté
,c ’est au cœur que le saxon isme
nous frappe . Les tenants de la mutualit é cosmopolite,touj ours
à base Anglo-saxonne,invoquent tr ès haut le prétexte qu’ils tra
vaillent à l ’entente cordiale des groupes tandis qu ’ils visentsurtout à l ’absorption des minorit és . L ’entente cordiale estd ’expression trop noble pour recourir à. pare ils moyens . Ellen ’est possible qu ’entre des groupes qui se sentent égaux, ellene rapproche que des personalités distinctes . S ’il en est autrement
,i l n ’y a plus que
”
des vainqueurs et des vaincus . Unemutualit é essentiellement canadienne—française accomplira pluspour l ’entente cordiale des races au pays que tout le cort ègefantasmagorique des organisations qui nous arrivent de partoutet cherchent à se refaire, à nos]dépem , des échecs subis dans leurspropres milieux. On admettra , enfin, que les Canadiensfrançais ont tout a gagner en concentrant leur influence dansdes institutions qui leur soient propres . Leur loyauté auratouj ours cette suffisante ressource de lutter d ’émulation
,dans
la sphère qui leur est accordée,avec les él éments qui les
entourent , à savoir qui fera le plus et le mieux pour la gloire etla prospérité du pays. Et les anglais eux—mêmes admettrontqu’en voul ant les égaler
,et si {possible , les dépasser, nous leur
faisons le plus délicat comme le_ plus2pr écieux des compliments .
J. L. K.-Laf lamme .
Ape rç u his tor ique
Le 8 juillet 1 608 ,Samuel de Champlain débarquait sur la
pointe de Québec pour y jeter les fondations de notre ville .
D ès son premier voyage en 1 603, le grand découvreur avaitremarqué l ’ importance et la beauté exceptionne lle de l ’endroit et , i l n
’
hés i ta pas a venir y fixer son habitation ,
“ n ’ayant pu trouver , dit-il , de lieu plus commode ni demieux situé que la pointe de Québec ains i appelée des sau
vages laquelle était rempli de noyers .
“ I l était imposs ible en eff et , écrit Laverdiere , de mieuxplacer le chef—lieu d ’une colonie naissante . Un superbepromontoir e formant une citade lle déjà. pr esque achevée parles mains de la nature ; un vaste bassin ,
une rade profondeoù plusieurs flottes peuvent mouiller a l ’abri des tempêtes ,un ensemb le de beautés pittoresques comme on en trouvepeu dans le monde entier une position centrale , au bordd ’un fleuve majestueux et profond . tout devait faire approuver le choix que fit en cette occas ion le père de la Nou
velle-France .
Dès son arrivée,Champlain se mit à l ’œuvre et la pre
mière habitation de Québec ne tarda pas a s’ élever , à la
basse—vi lle , a peu près sur le site actuel de l ’ église de NotreDame-des —Vi ctoires .Comme i l arrive presque toujours en de pareilles ci rcons
tances , les commencem ents furent difficiles et , pendant plusieurs années , la j eune cité n ’eut de vi lle que le nom .
L ’arr ivée des R écol lets de Louis Hébert ( 1 6 1 7l _ ,de Madame de Champlain ( 1 620 ) et de que lques autresfamil les vint y mettre un peu de vie et d ’animation .
Dès 1 61 5 , on construis it , au fond du Cul-de—sac ,la pre
mière chapel le de Québec .( 1 ) Cet art icle es t le rem ier d’
un e sér ie que la Revue publiera sur Québec , ses m on um ent s
,ég ises , musées , s ites historiques , etc . , d
’
i ci aux grandef êtes du m oi s de ju in et du m oi s de jui llet . Nous devons à la t rès gracieuseobligean ce de M. l
’
abbé A . E . Gosselin ,du sém inai re de Québec , et à celle
de M . Ed . Marcotte , propr i étai re de l’
Alm anach de adres ses pour Québecet L évrs , la faveur de publier l 'art i cle qu i précède .
22 LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINEPeu après
,en 1 6 1 9
,les R écol lets commencèrent la con
struction de leur couvent de Notre-Dame-des-Anges près dela rivi ère Saint-Charles
,a ppe lée jusque -là Cahi r-Coubat par
les sauvages,sur les bords de laque lle
,paraît— i l , devait s
’ é leverla future c i té que l ’on avait déjà nommée Urbs L udovi ca .
Mai s la construction du fort Saint-Louis sur le cap Diamantet la nécessi té de grouper les hab i tants firent abandonner cepremier plan . Ce n ’est que longtemps après que l ’on vi t ,
sur le premi er site assigné à la ci té de Champlain , s’étendre
le faubourg Saint-R och .
Commencé en 1 620,le fort Saint-Loui s a sub i dans le
cours des temps de nombreux changements . Il n e fut toutd ’abord qu ’une simple dem eur e en boi s a laquel le on travaillade 1 620 a 1 624 . En 1 626
,i l fut rasé et on le reconstruis it
au même endroi t,mai s dans des proporti ons p lus vastes .
Ce fort, qu i dans l ’ intention de Champlain ,
avait été bât ipour en imposer aux mécontents
,devait tomber peu après ,
avec la vi lle e lle-même,aux mains d ’ennemis plus redon
tab les que ne“ l ’ étai ent les traiteurs .
En 1 628 ,les Anglais
,condui ts par les frères K irke firent
une premi ère tentative du côté de Québec la fière réponsede Champlain les empêcha d ’avancer . L ’année suivante
,
instru i ts de l ’état critique dans lequel se trouvai t la ville , i lsvinrent sommer Champlain de la leur rendre . Le gouverneur
,réduit à. la famine
,manquant de mun itions
,dut se ré
signer a voi r passer aux mains des Anglais un étab li ssementpour leque l i l avait tant fai t . Il se rendit en France avecles hab itants qu i voulurent l ’accompagner et Loui s Ki rkeprit possess ion du fort Saint-Louis qu ’
i l hab i ta de 1 629 a1 632.
Le trai té de Saint-G ermain-eu —Laye,en 1 632
,rendit le
Canada a la France et Champlain put reveni r,en 1 633
,re
prendre son anci en gouvernement,à Québec .
La chape lle de la basse —ville étant disparue,Champlain fit
bât i r à son retour en 1 633, près du fort St-Loui s , une cha
pe lle plus vaste , a laquel le il donna le nom de Notre-Damede-R ecouvrance .
Deux ans après , le 25 décembre 1 635 ,Champ lain décédait
à Québec , laissant avec des regrets sincères , le souvenir d ’unhomme de b i en , d
’un chréti en convaincu et d ’un excel lentadministrateur .
LA REVUE FRANCO —AMÉRICAINE 25.
Son successeur , M . de Montmagny , chevalier de Malte ,
demeura douze an s a la tête du gouvernement du pays et
Québec 'flt des progrès sous son administration .
Peu après son arr ivée , le gouverneur fit reconstruire enpierre le fort Saint-Louis . Dans le même temps il en traçaitle plan de la ville et faisait alligner les rues .Puis
,dans la suite
,i l assiste on prend part aux fondations
importantes qui eurent li eu a cette époque : c ’ est d ’abord leco llège des jésuites qui s ’é lèvent sur le site qu ’
occupe aujourd
’
hui l’
Hôtel —de —Vi lle ; vi ennent ensuite les couvents desUrsu lines et des Hospitalière s
,le premier construit en 1 641
,
VIEUX CHATEAU ST-LOUIS,con s trui t par M. de Mon tm agny
— 1 6364 648 .
le second en 1 644-45 . Ces deux communautés,arrivées le
l er août 1 639,avai ent été logée s dans des maisons d ’em
prunt : les Ursulines dans un petit logement , a la BasseVil le
,et les Hospitalières dan s la ma ison de Messieurs de la
Cie des Cent Associés . Cel les-ci,après avoir passé quelques
années à. la mission de Sillery étaient revenues à Québec auprintemps de 1 644 .
M . de Montmagny vit encore,en 1 647 ,
les commencements de la grande égli s e ,
future cathédrale du prem i erévêque de Québec
,église qui devait remplacer la chape lle de
Notre-Dame -de -R ecouvrance incendiée en 1 640 .
LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE
Toutes ces constructions font voi r que la population avaitaugmenté à. Québec . En effet
,depui s 1 634 , les co lons
étai ent arrivés en plus grand nombre et b i en que la vi lle nefût pas très populeuse on y avai t compté en 1 640 ,
3 mariages ,
21 baptêmes et 2 sépultures .
M . d’
Ai llehous t qui remplaça M . de Montmagny n ’eutqu
’
à continuer l ’œuvre de son prédécesseur ; mai s i l ne putfai re beaucoup
,son gouvernement ayant été trop court . Il
fit pourtant travai ller au fort Saint-Loui s sous la protectionduque l les Hurons fug iti fs devai ent ven i r se placer quelquesannées plus tard .
Sous MM . de Lauzon et de Charny-Lauzon ,i l ne se passa
ri en de b i en important à Québec .
Depui s 1 632,la vi lle
,aussi b i en que les autres étab li sse
ments avai ent été de s servis par les pères Jésui tes aidés parquelques rares prêtres sécul i ers comme MM . N i colet , L es ueur de Saint— Sauveur
,de Queylus ,
etc .
En 1 659,sous le gouvernement de M . d
’
Argen son , Mgr .de Laval arrivai t à Québec avec que lques ecclés iastiques .
Tout le monde connaît les di fficultés qu i s é levèrent entre lesautori tés civi les et re l igi euses
,au sujet de la trai te de l ’eau
de -vie . D’
Avaugour ,succes seur de M . d
’
Argen son ,fut rap
pelé,et de M ésy nommé à sa place . L ’année 1 663 fut par
t i culi èrem en t remarquable a Québec ; sans parler du tremb lement de terre qu i , pendan t plus de s ix moi s , vint j eter laterreur dans la colon i e , rappelons seulement pour mémoi rel ’abandon de la Nouve l le —France
,par la C ie des Cent As
soc i és qu i cède ses dro i ts au R oi,l ’étab l i ssement à Québec
d ’un conse i l souverain et la fondation du G rand Sém inai re .
L es années suivantes furent marquées par un accro i sse :ment cons idérab le de la population et par des améliorationsde tous genres . Ce n ’ est pas i c i le li eu de rappe ler l ’œuvrede Tracy
,Talon et Courcelle . On en trouve les détai ls dans
n os h i stori ens . Mai s parmi les fai ts qu i intére ssent parti enli èrem en t Québec , à. cette époque , i l convi ent de noter l ’arrivée du régiment de Car ignan en 1 665
,la consécration de
l ’ égli se cathédrale de Québec et la pose de la prem i ère pi errede la chape lle des Jésu ites en 1 666
,la fondation du Pet it
Séminai re en 1 668 , etc . Le recensement fai t par Talon,en
1 666 donnai t à la vi l le une population de 547 âm es .
Et i l n e faudrait pas c roi re que tout y fût a’état rudim en
tai re ou sauvage . L es hab i tants manquai ent n i de bonne
LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE 27
m anières ni de distinction . Sans parler de plusieurs fami llesr emarquab les qu i hab i tai ent Québec depuis assez longtemps ,l ’arr ivée du régiment de Carignan avait doté la ville d ’unb on nombre d ’o fficiers di stingués qui ne devaient pas peuc ontribuer a donner a la société ce bon ton que l ’on y r é
marquai t alors . D ’autre part , les moyens d ’ instructionpour .la j eunes se ne fai saient pas défaut : le col lège desJésui tes était b i en organisé depui s plusieurs années et lesDames Ursulines donnaient aux filles une éducation soignée .
Aussi b i en, grâce a cette im pulsion vigoureuse qu ’on lui
avai t donnee Québec continua à grandi r et aprospérer , nonpas
,certes
,a la manière de certaines vi lles qui surgis sent
c omme par enchantement , mais suivant les temps et les circ onstances . Et pourtant les alertes et les malheurs ne luim anquèrent pas . Passons rapidement sur les gouvernements de Frontenac
,de L aBar re et de Denonville et signa
lons l ’ incendi e de 1 682 qui détruisit presque toute la bassevil le de Québec
,et en 1 687
,l ’épidém i e de rougeole qu i s ’at
t aquai t aussi b i en aux personnes âgées qu ’aux enfants .
En 1 690,sous la seconde admin istration de Frontenac
Québec eut à repousser les attaques de l ’Angleter re . Toutle m onde connaît cet épi sode du siège de Québec en 1 690 etil n ’est pas besoin de redi re i ci
,ni la fière répon se de Fronte
n ale , ni la bel le défense des habitants , n i la défai te de Ph ippsqu i dut retourner , aprè s avo i r laissé une parti e de ses canon ss ur les grèves de la Canardi ère .
Pour commémorer cet évén em en t'
on donna à l eglise de labasse -ville , termi née l ’année précédente et qui était dédiée àl’
En f an t—Jésus le nom de Notre -Dame-de — la-Victoire,nom
qui fut change en ce lui de Notre -Dame -des -Victoi res aprèsla malheureuse expéd ition de W alker en 1 71 1 .
La seconde admin i stration de Frontenac fut remarquableencore par les travaux qu i se firent à Québec : mentionnon sseulement les réparations ou agrandissements de la cathé
d rale et du château Saint—Lou i s,la construction de la pre
m i ère chape lle du S éminai re et du premier palai s épis copalbâti par Mgr . de Saint—Valier .A cette époque auss i on travailla aux fort ifications de la
vi lle et l ’on vi t s ’élever alors les portes Saint-Jean,Saint
Lou i s et du Palais .En 1 693
, Mgr . de Saint-‘Valier établissait l ’Hôpi tal-General .
30 LA REVUE FRANCO —AMÉRICAINE
A la mort de Frontenac en 1 698, Québec comptait 1 988
hab i tants .
1 700 -1 760
M . de Calli èr es qui succéda à Frontenac mourut à Québecen 1 703 et M . de Vaudreui l le remplaça .
Les premi ères années du 1 8e siècle furent , on peut dire ,
des années d ’ épreuves pour Québec . Les deux incendi es duSém inai re en 1 70 1 et 1 705 ,
la grande pi cote en 1 702, la maladi e du pourpre qui
,en 1 71 0 — 1 71 1
,en leva plusieur prêtres
et une foule de citoyens,enfin l ’ incendie du palais de l ’In
tendant en 1 71 3 furent autant de suj ets de tristesse ou dedeui l pour
,les Québecquoi s .
En 1 71 6 ,Québec pouvait passer pour un gros village : i l
renfermai t une population de âmes .
Le recensement nous fait connaître les rues qu i existaienta cette époque ; leurs noms n ’ont pas changé pour la plupartet ce sont encore , a la Haute-vi lle : les rues Saint-Louis ,Saint-Jean
,Sainte—Anne
,Du Fort
,Desjardins
,Buade
,etc .
,
et a la Basse-vi lle : les rues Sous-le-Fort , Sault-au-Matelot ,Champlain
,Notre —Dame
,etc .
En général , les marchands demeurai ent a la basse —vi lle ,rue Notre -Dame .
Les travaux de fortifications peuvent compter parmi lesplus importants qui se firent à Québec de 1 689 a 1 759 . Ces
travaux qui furent di r igés par les ingénieurs L evasseur deNér ée , Chaus segros de L éry ,
etc .,et qui coûtèrent des som
mes considérab les ne furent complétés que sous le régimeanglai s .
L ’anci enne brasserie Ta lon devenue le palais de l ’In tendant fut incendiée nous l ’avons dit
,en 1 71 3 : la avaient
habité Champigny , Beauharnois , les R audot père et fils et
Begon . R econstrui t peu après i l fut de nouveau détrui t parle feu en 1 726 ; toujours au même endroi t , aujourd ’hui labrasserie Boswel l , on érigea un autre palai s plus grand etplus beau que les précédents .Les gouverneurs continuèrent à occuper le fort Saint
Loui s que Frontenac avait démoli en 1 694 et reconstruit lesannées suivantes . C ’est la que moururent MM . de Fronten ac en 1 698 , de Cali ères en 1 703,
de Vaudreuil en 1 725 et
de la Jonqui ère en 1 752.
LA REVUE FRANCO-AMERICAINEJe sui s un chien qui ronge l
’
os
En le rongean t je prends m on reposUn tem ps viendra qui n ’
est pas venu
Que je m orderay qui m’
aura m ordu.
On sait aussi ce qu ’ il faut penser de cette légende , et desp ub lications récentes ont d éterminé ce qu ’ e lle contenait devérité .
Les derni ères années de la domination française furentp énib les pour la colonie . La guerre qui devait se terminerpar la pri se de Québec et par la perte de tout le Canada futentremê lée de revers et de succès . En 1 756 , arrivaient quelques bata i l lons français ayant à leur tête , Montcalm , Lévis ,Baugainvi lle , Bour lam arque ,
etc . Les grandes campagnes ,eurent lieu de 1 755 a 1 759 ; la famine se fit sentir à Québeccomme dans tout le pays et i l fut un temps où le cheval étaits ervi à toutes les sauces . Ce f ut aussi le temps où Bigot etses complices s
’
amusaien t le mieux .
Au mois de juin 1 759 , Wolfe parut devant Québec avec uneflotte considérab le . L es détai ls de ce siège sont trop connuspour qu ’ i l fail le les rappeler ici . Mais le bombardement dela ville , la bataille des plaines d ’
Abraham ,le 1 3 septembre ,
*la mort de Wolfe ce jour même ,celle de Montcalm le lende
m ain matin , dans la maison du chirur gien Arnoux ,ne sau
raient être passés sous s i lence .
Le 1 8 septembre , la vil le capitulait et les Anglais y entrè
rent . Levis , arrivé trop tard pour empêcher ce malheur neperdit pas courage et se prépara a prendre sa revanché e leprintemps suivant . La glori euse bataille de Sainte—Foy luidonna , un instant , l
’espoir de reprendre la ville dont i l comm ença a faire le siège , mais l ’arrivée des vaisseaux anglaisle força à regagner Montréa l avec son armée .
Québec ne devait plus voir le drapeau f rançais flotter sur
s es murs .
Dom inat ion Angla i s e
L es trois ann ées qui suivirent la capitulation 'de Montréalf urent des années d ’attente . L es Canadiens , délivrés de laguerre qui les avait ruinés et dont ils ne pouvaient soutenirplus longtemps les lourdes exigences , généralement bient raités par le gouvernement anglais , ne se sentaient pas tropmalheureux . Toutefois , une grande partie des habitants
LA REVUE FRANCO —AMÉRICAINE 33
e spéraient encore que la France n e les abandonn erait pas à.l’
Angleterre . Le traité de Paris vint leur en lever leurs dernieres i lus ion s et de même que les militaires avaient quittéQuébec en 1 759 et en 1 760 ,
ainsi plus ieurs fami lles repasser ent en France en 1 763 et en 1 764 .
La vi lle avait considérab lement souff ert du bombardement ; la plupart des édifices pub lics , la cathédrale , le Sém inaire
,lè col lège des Jésuites , le couvent des R écollets ,
le
palais de l ’In tendan t étaient fortement endommagés ou en
partie détruits : la basse-vil le n ’était, à proprement parler ,
qu ’un monceau de ruines .On s
’
occupa aussitôt que possible de rém édier au mal .
Murray fit réparer lui-même un bon nombre de maisons poury loger ses troupes et en _
1 764 , i l vint demeurer au châteauSaint—Louis auquel il avait fait fai re les réparations les plusurgentes .
Parmi les grands édifices d ’alors plus ieurs sont disparusaujourd ’hui : le palais de l ’In tendant , le collège des Jésuites ,le couvent des R écollets ,
l e palais épiscopal , sont chose dupassé .
Les communautés r eligieuses comme les Ursulines ,l’
Hôtel—Dieu,l’
Hôpi tal général n ’avaient pas trop souff ertdu s iège et continuèr ent leurs œuvres de charité .L e Séminaire ouvr it ses portes à la jeun esse étudiante en
1 765 et sa chapelle , réparée , servit de cathédrale à l’ évêque
de Québec,de 1 767 a 1 774 .
Pendant s ix an s , le Canada n’avait pas en d ’ évêque , et ce
n ’
est qu ’ en 1 766 , grace a la recommandation de Murray ,que Mgr Briand put se faire sacrer évêque de Québec .Les réparations a la cathédrale furent commencées en 1 767
et s e continuèrent durant plusieurs années .
L ’année 1 764 avait vu l ’apparition de la Gazette de Québec , prem ier journal publié dans notre province .
En 1 765 la population de la ville s ’élevait a âmes .
En 1 766 , Murray qui avait été sympathique aux Canadiensfut re levé de son gouvernement . Son successeur
,Carleton
,
plus tard lord Dorchester , ne leur montra pas moins d ’ in térêt et fut l ’un des gouverneurs les plus populaires qu ’
ait eusle Canada .
Comme son prédécesseur , i l occupa le château SaintL ouis .
34 LA REVUE FRANCO-AMERICAINEEn 1 775 , les Etats-Unis , en di fficultés avec leur mère patrie
et ne pouvant porter les armes chez e lle , firent invasion auCanada . Le siège de Québec fut un des principaux épi sodesde cette guerre . Montréal et Trois-R ivi ères étaient déjàtombés aux mains des améri cains ; Québec seul ne leur avaitpas encore ouvert ses portes . Carleton s ’y refugia confiantdans la loyauté des hab i tants .On sait quel fut le résultat de cette attaque . L
’
i n for tun é
Montgomery vint tomber sous les balles anglaises , a la barr i ère Près —de-Ville , au pi ed du cap Diamant . C ’était le 31décembre .
De son côté , Arnold , qui venai t du côté de Saint-R och ,fut
blessé gri èvement et dut abandonner la partie tandi s que sesbraves offici ers et soldats attaqués des deux côtés par lestroupes anglaises se faisaient tuer ou tombaient prisonniersau Sault—au-Matelot .L
’
habi li té de Carleton et la loyauté des Québecquoi s avai entsauvé la ville .
En 1 778 ,H aldim an d vint prendre le gouvernement du
pays . Son admi nistration qui parut détestab le aux Canadien s mai s dont , en toute justi ce , on ne saurait le rendreseul responsab le
,ne fut marquée par aucun événement capi
tal a Québec . Il suffira de noter qu ’un nouveau corps delogi s fut ajouté au château Saint-Loui s . C ’est ce bâtiment
,
commencé en 1 784 ,
i
qui s ’appel lera plus tard le château Haldimand , et qui , a part un interval le de cinq années , servitd
’
Ecole-Normale de 1 857 a 1 892.
Durant la derni ère part i e du 1 8e si ècle on travai lla auxfortifications de Québec . Il ne peut être question d ’ en fairei ci l ’h i storique ; rappelons cependant que la citadelle actue llea été faite de 1 823 a 1 832 et qu ’ e lle a coûté 25 mi llions dedollars . Mai s i l est une parti e de ces fortifications que nousne pouvons passer sous silence nous voulons parler des portesque plus i eurs se rappel lent avoir vues .
La porte Saint-Loui s bâtie “ sous Frontenac,en 1 693
,
dit-on , fut modifiée ou réparée en 1 783; celle que nousvoyons aujourd ’hui ne date que de 1 873.
La porte Saint-Jean , construite elle aussi sous Frontenac , fut rebâtie en 1 79 1 et en 1 867 et démolie en 1 898 .
La porte du Palais qui existait depuis le temps de Frontenac fut refaite de 1 823a 1 832 et démolie en 1 864 .
LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE 35
La porte Hope , élevée en 1 786 ,à la côte de la Canoterîe ,
disparut en 1 874 .
PORTE ST-LOUIS actuelle , date de 1 873, remplace celleconst ru ite en 1 693
La porte Prescott , bâtie en 1 797 , dans la côte de la Montagne , fut démoli e en 1 871 .
VIEILLE PORTE ST-JEAN cons t rui te sous F rontenac»rétabli e en 1 79 1 .
Quant à.la porte Kent , elle n’a été construite qu
’
en 1 879 .
L es portes Saint-Louis et Kent sont très belles on n’
au
LA REVUE FRANCO —AMERICAINE
rait pu en dire autant des anciennes à l ’exception de celle duPalais qui seule pouvait être un ornement pour la vi lle .
PORTE ST—JEAN,recon s trui te en
1 867,démol ie en 1 898
Car leton , devenu lord Dorchester , repr it son gouvernement qu
’ il conserva de 1 786 a 1 79 1 et de 1 793a1 795. Il ne
PORTE DU PALAIS,existaitd epuis F rontenac , refai te de
1 823à 1 832, démolie en 1 864.
f ut pas la pour inaugurer le régime con sti tutionel que l’
An
g leterre venait de nous accorder par l’
Acte de 1 79 1 .
LA REVUE FRANCO —AMÉRICAINE 37
Ce fut A1ured C larke , qui fit , en décembre 1 792, l’ouver
ture des Chambres , dans l ’ancien palais épiscopal que legouvern ement avait loué en 1 778 . Ce palais fut vendu en
1 831 avec le terrain y attenant au gouvernement de la province . Les réparations et agrandissements qu ’on y fit fairede 1 831 a 1 852 ne laissèrent rien de l ’ancien palais épiscopal .En 1 854 ,
le Parlement fut incendié . On le reconstruis it enbriques en 1 859-1 860 et i l brûla de nouveau en 1 883. L e ter
rain est devenu le joli petit parc Montmorency .
L es successeurs de Dorches ter jusqu ’ en 1 840 ,furent Pres
cott,M ilnes , Craig , Prévost , R ichmond ,
Dalhousie , Aylmer ,
PORTE HOPE , côte de la Can oterie élevée en 1 786 ,di sparut en 1 874 .
Gosford et Durham . Ce fut l ’époque des grandes luttesentre le parti canadien et le parti anglais ; nous n ’avons pasà en parler ici .La vi lle s
’
agrandissai t peu a peu . En 1 8 1 5 elle r enferma it une population de âmes : les faubourgs s
’
etendaien t sur les bords de la rivière Saint-Charles et sur le coteauSainte-G eneviève .
Saint-R och , aujourd ’hui l ’un des quartiers les plus populeux et les plus actifs de la ville
,form ait en 1 829 ,
un groupes i considérab le que les autorités religieuses n
’
hés i tèrent pasa l
’
ér iger en paroisse.
38 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
L e faubourg Saint-Jean-Baptiste demeura plus longtemps uni à la cure de Québec : devenu desserte en 1 849 , ilne fut érigé en paroisse distincte qu ’ en 1 886 .
Depuis ce temps d ’autres paroisses ont été formées SaintPatri ce dont l ’ égli se
,bâti e en 1 831 —32, fut érigée canoni
quemen t en 1 854 ; Saint-Sauveur en 1 867 ; Saint-Malo en
1 898 ; Jacques -Cartier en 1 90 1 .
Durant ce siècle non seulement la ville s’est agrandie
mais e lle '
s’est embel lie par la construction d ’édifices publics
remarquables et par l ’érection de monuments consacrés à lamémoire de nos grands hommes .
En 1 827-28 fut érigé , dans le jardin du Fort , le monumentWolfe-Montcalm . On y lit l ’ inscription très s imple maistrès be l le qu i suit :
Mor tem Vi rtus Comm unem
F am am H i stor iaMonum en tum Poster itas
Dedi t .
En 1 832,lord Aylmer consacra à la mémoire de Wolfe un
modeste marbre qui fut remp lacé en 1 849 , par un autremonument plus digne du héros .
En 1 860 fut inauguré le monument des braves , sur le chem in Saint-Foy
,pour rappe ler la mémoire de la bataille de
1 760 .
Une statue de la rem e Victoria fut placée dans le parcParent en 1 897.
L’année suivante vit l ’ érection du monum ent Champlain ,
érection qui donna lieu a de grandes et bel les fêtes que personne n
’
a oubli ées .D ’autres monuments s i tués en dehors de la ville sont dus
auss i en grande partie a la générosité des citoyens de Québectels sont , ce lui du P . Massé érigé à. Sillery en 1 870 , et l
e
monument Cartier-B rebeu f é levé sur les bords de la rivièreSaint-Charles en 1 889 .
Mais rien peut—être n ’a plus contribué à l ’embelli ssem ent
de la ville que la construction de la terrass e Duff erin .
Nous ne pouvons mi eux faire que de reproduire ici cequ
’
en dit M . Ernest Gagnon dans son be l ouvrage sur le
F ort et le Château Sain t-L eurs“ Lord Durham fit raser , dit M . Gagnon
,en 1 838
,les
ruines du château incendié en 1 834 , et fit construire sur une
part ie des fondements de l ’ancien édifice,à environ 1 80 pieds
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Le Palais de justice fut ouvert en 1 887 , et le châteauFrontenac inauguré en décembre 1 893. Trois an s après , en1 896 ,
c etait le tour de l ’Hôtel-de-Ville placé sur le cite del ’ancien collège des Jésuites ; enfin l ’Audi tor ium fut inaugure en avril 1 903.
En 1 897-98 les Sœurs franciscaines é levaient leur couventet leur très be l le chape lle et en 1 90 1 les Frères Mineurscommençai ent leur monastère dont la chape lle vient d ’ êtreterm inée .
Nous aurions pu nommer encore des chape lles commece lle du Sém inai re et des Ursul ines , des hospices commeceux de Sainte Bri gi tte pour les Irlandais , et de Saint Antoine dans la paroiss e de Saint R och , l ’Hospice Saint Charlesdans l ’ancien Hôpital de Marine , etc .
La population“ anglaise et protestante a,el le aussi , ses
églises et ses insti tutions de charité . La cathédrale anglicane date de 1 800 ; les autres , comme les chape lles ou églisesde la Trinité
,Saint-Pierre
,Saint-Paul
,etc .
, sen t de dateplus récente . Saint-Mathieu ne fut ér igé en paroisse qu ’en1 875 , tandi s que l ’église Saint—André remonte au commencement du 1 8e s ièclè , etc .
Les principales institutions de charité sont le Jeff ery Hale ,The F emale Orphan Asylum , The F inlay Asylum ,
etc ., etc .
Le 1 9e s 1 ecle , de même que le siècle précédent , fut marqué à Québec par de nom breuses calamités . On gardeencore le souveni r des épidémies du choléra en 1 832,
1 834 ,
1 849,1 851 et 1 854 . A Québec , en 1 832,
la maladie enlevaau —delà de 3000 personnes , dit-on . Et en 1 854 ,
el le fit 3486victimes .
Ajoutons à cela des incendies sans nombre ,ce qui avaluà Québec
,pour un temps du moins , le surnom de ville des
incendies . Ceux du faubourg Saint-R och et du faubourgSaint-Jean en 1 845 , a un mois d
’ intervalle,sont resté célè
bres par le montant des pertes et par le nombre d es malbenreux qu ’ ils laissèrent sur le pavé . Il y eut encore d ’autresfeux considérab les en 1 862 dans le quartier Saint-Jean ; en1 866 et 1 870 ,
a Saint-R och ; en 1 876 ,dans le quartier Mont
calm Mais aucun de ces incendies ne fut aussi désastreuxque ce lui qui détruisit une grande partie du faubourg SaintJean en 1 88 1 .
Parm i les incendies parti cu liers peu ont laissé de plus
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 4 1
tristes souvenirs que celui du Théâtre Saint-Louis , le 1 3juin 1 846 ,
où près de 50 personnes trouvèrent la mor t .Ce lui de la Chapelle du Séminaire le 1 er j anvier 1 888 , fut
aussi considéré comme une calamite publique a cause de laperte des tableaux précieux qu ’ e lle renfermait .Mais dans Québec où la charité est inépuisable les désas
tres se réparent promptement et après l ’ incendie , un peuplus tôt , un peu plus tard , la vi lle se révélait plus grande etplus bel le . Sans doute
,sa population n ’est pas encore au
aujourd ’hui ce lle des grandes vil les mais e lle augmente et deâmes qu ’ elle était en 1 861 e lle a atteint , en 1 90 1 ,
le
chif fre de âmes .
Nous n ’avons pas parlé , dans ces courtes notes , des causesqui , dans les cinquante dernières années , ont pu contribuer àl ’accroissement de la ville ; el les sont multiples , mais i l n ’
en
est pas de plus effectives que l etabli s sem en t des lignes dechemins de fer et de bateaux à vapeur .Trois compagnies de chemins de fer ont leur terminus à
Québec : Pacifique Canadien , Québec et Lac Saint-Jean et
Quebec R ai lway Light Power Co .
Cette dernière n ’a encore qu ’un tronçon de ligne en dehors de la ville : c ’ est l ’ancien Québec Montmorency et
Charlevoix entre Québec et Saint-Joachim a cette mêmecompagnie appartient auss i le tramway électrique inauguré àQuébec dans l ’été de 1 898 .
Le premier convoi du Pacifique Canadien arriva à Québecle 8 février 1 879 ; la gare avait été construite l ’année précédente .
La voie entre Québec et le Lac Saint-Jean ne fut complétée qu
’en 1 887 ; depuis plusieurs années e lle se rend jusqu
’
à Chicoutimi .Le premier bateau à vapeur qui sil lonna les eaux du Saint
Laurent fut probab lement l’
Accommodation . I l fit le
voyage de Montréal à Québec en 1 809 .
I l a été remplacé avantageusement , depuis , par les bateauxde la Compagn ie R iche lieu qui sont de véritab les palais flottants .Le L auzon fut le premier bateau à vapeur qui traversa
régulièrement entre Québec et Lévis ; ce fut en 1 8 1 8 . Quelques années plus tard , en 1 831 ,
le L ady Aylm er voyageaitentre Québec et Saint-Nicolas .
4 2 LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE
Aujourd ’hui,grâce a la compagnie de la Traverse
,les
communications entre les deux rives sont faciles , en hiverc omme en été . Le service régulier de
_ plus ieurs cabotiere ,
durant la belle sai son , ne contribue pas peu à faciliter lest ransports et par sui te à augmenter le commerce et la prospér i té de la ville .
Depuis que lques années Québec a fait des progrès maisi l semb le qu ’une ère nouvelle va s ’ouvrir bientôt . L a construction du Pont de Québec
,malheureusement retardée par
l a terrib le catastrophe du mois de sepetmbre 1 907 ,catastro
phe qu i a causé une centaine de pertes de vie et qui va coûterdes mi llions au pays
,et d ’autre entrepr ises considérab les ,
vont nécessiter des amé liorations,des agrandissements ,
destravaux importants . La ville
,trop reserrée dans ses limi tes
actue lles , s’
étendra peu-à-peu dans les campagnes environn antes . Mai s pour en arriver la,
la bonne entente et leconcours de toutes les énergi es sont nécessaires . L es Québecquoi s ne failliront pas a leur devoir et , dans un avenir pluso u moins rapproché , la vieille cité de Champlain aura acquisl ’ extension et l ’ importance que lui assurent sa position et sesa vantages naturels .
A. E. Gos s e l in, pt re .
TOUR MARTELLO,sur les Plain e d
’
Abraham .
Revue fantais iste par Jean Valier .
PER SONNAGESB LAGAPART
,journal i ste , 25 an s tr ès grand , m in ce brun de poi l et blond
d’
espéran ces vêtemen t un peu Montm ar tre
S AMUEL D E CHAMPLAIN,fam i li èrem en t dés ign é ci-apr ès sous le pet i t n om
de SAM ; porte le costum e ri 0 1 0 que tout le m onde lu i a vu dan s lesprocess ion s de la Sain t—Jean apt i ste .
M UF LEF IN,correspondan t spécial (du reste , les cor respondan ts s on t toujours
spéciaux) d’
un grand journal populai re de Mon tr éal . Tren te ans ,
calvi t ie qu i suggèrerait a Bazin un autre rom an Le blé qu i ne l èveplus .
”
PAUL ETTE,femme de BLAGAPAR '
P 20 an s , blonde , vive , tout a fa i t f in —de
s i ècle,la vraie femm e du journal iste qui ne gobe pas ses art icles de fond .
L a s cène se passe d ’
abord à Québec. Se t heures du soi r . L a lum i èrem anque , i l fait noi r comme dans un f our . 1 tom be une neige épai sæ ,
len te ,molle comme des pet i ts chats de peupl ier , et qu i se change tout de su i te en
e au , sous prétexte qu ’
i l y a des grilles d ’
égout dan s les rues : c’
es t m ars qui
s’
en vien t,comm e d
’
hab i tude,n ous fai re accroi re qu
’
i l fera beau et chaud
au m oi s de m ai . L es rares passan ts pataugen t ; par hasard {un t ramway ,
comm e égaré , m eugle un instan t , pui s di sparaît . Blagapart , qui s’
est at
tardé au bureau de rédact ion ,m et son paletot , s ’
en fon ce un chapeau m on
n oi r sur les yeux,pui s sort avec Paulet te , qu i est venue le chercher .
BLAGAPART .— (alluman t une cigarette) Bien j ’ai boucl é mon
article,allons-nous—eu prendre l ’air
,ma petite Paulette . Diable !
encore de la neige . Le printemps s ’avance,mais bien lente
ment i l a des allures de tricentenaire ce bon printemps .ÎPAULETTE .
— TOŒ de même,c ’est .beau
,J ’aime mieux ça
que l ’ét é . L ’ét é,on cuit
,puis ensuite
,l ’hiver
,on gèle .
le BLAGAPART .— Oui
,c ’est l ’hiver de la médaille . .Hum
(à part) J’esp ère que personne autre ne m ’a entendu . (Il seheurte à quelque chose) Maudit poteau de tél égraphe ! Jevous demande un peu pourquoi on est venu braquer cett ecolonne à potence droit devant notre porte . C ’est insens é .Je r éclamerai
,j e bûcherai dans le j ournal . (S
’
an imaut) Jeferai toute une affaire s ’il le faut
,j e j etterai un gouverne
ment ou deux à bas pour abattre cette stupide colonne(Il s
’arrête surpr i s ) Mais la colonne marche .
LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE
PAULETTE .—Mon Dieu q u
’est—cc que c ’estBLAGAPART.
— (épouvan té) C’est une color n é -fantôme
LA COLONNE — N’ayez pas peur , monseigneur , ne craignez
rien,belle marquise . .Le roi
,mon maître ne vous veut pas
de mal au contraire,il d ésire le bonheur de tous les habi
tants de ce pays .BLAGAPART .
— (Il se remet un peu .) Le roi , votre maître ?Que diable chantez-vous là ? (à par t.) Voi là un particulierqui s
’habille d’une singuli ère façon . (haut) Dites donc , monami
,savez-vous que le Mardi— gras est passé depuis quelques
semaines et qu ’il est un peu tard pour faire des blagues .
Diable! en core de la neige .
LA COLONNE — Je ne suis pas déguisé,monseigneur c ’est
plutôt vous qui êtes accoutr é un peu étrangement .
BLAGAPART .— Mais
,c ’est vous le farceur . Regarde-moi ça ,
Paulette : un chapeau à plumes , une culotte , un grand col , uneépée . C ’est un mardi—gras
,ni plus ni moins . Dis donc
,mon
vieux,est—ce que tu ne serais pas un figurant échappé de la
mascarade à monsieur Lascelles Tu res embles a feu Champlain comme si tu venais de dévaler de ton monument .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 45
LA COLONNE — Pas étonnant , j e suis Champlain en personne .BLAGAPART ET PAULETTE .
— Aie un revenantBLAGAPART.
— (reprenan t son calme) Ah ! voilà une bombepour mon j our nal . Hallo
,Sam ! attends une minute que je
t’interviewe. (Très exci té) Paulette , Paulette , vois-tu ça ,Champlain en personne , Samuel , Sam . D égoise—moi ton histoire . Rentrons à. la r édaction .
F SAM .— Non
,caus ons en nous promenant .
BLAGAPART.— Ç a me va . Al ors , dis-mor d’où tu viens
,ce
que tu viens faire .
SAM .— Ou parle beaucoup de vous autres de l ’autre côt é .
Alors comme je suis dou é du pouvoir de me transporter oùj e veux instantanément , je me suis dit Allons voir ‘
comment
Tiens , une chaise à porteurs i lluminéeu i f out’
le camp toute seuleles choses se passent sur cette boule mal arrondie qu ’est laterre . Et j e suis venu .
BLAGAPART .— (ü lut ser re la mai n ) Merci d
’être venuSAM .
— Jé ne suis pas venu pour rien . Comme je vous l ’aidit, sur un signe , je puis me transporter, moi et mes interlocuteurs
,où bon me semble .
BLAGAPART .— C
’est un phénomène de transportation,comme eût dit feu Israël Tarte .SAM .
— Jé veux donc profiter de l ’occasion pour voir un peuce qui se passe dans le monde
,et si madame . . la
BLAGAPART .— (regardan t Paulette en sour ian t) Dites ma
dame la comtesse, ça suffit . (à par t) Puisque ça l ’amuse, lebonhomme , pourquoi ne pas se payer un peu de parchemin
SAM .— AV&IIÈ de partir
,il serait peut— être à propos que vous
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
me renseignassiez sur les quelques changements qui ont dûsurvenir depuis le XVIe si ècle . Ai nsi
,sous le bon roi Henri
,.
mon maître,il y avait trois grandes forces Le roi
,les parle
ments et le clergé .BLAGAPART .
— Auj ourd ’hui,il y a trois grandes farces Le
parlementarisme,le socialisme et le j ournalisme .
SAM . Tiens,une chaise à porteurs i llum i
née qui fout ’ le camp toute seule .PAULETTE .
— C ’est un tramway .
SAM .
— Qu ’est— ce que c ’est que ça un tramwayBLAGAPART .
— Inutile d ’expliquer, ça prendrait trop de
temps . Qu’il me suffise de te dire , mon cher Sam ,que le
monde a ét é boul evers é plusieurs fois depuis la fondation deQuébec
,et que tout s ’est amélioré . Ainsi
,pour ne citer que
quelques—unes des plus merveilleuses inventions,nous avons
le t él égraphe,grâce auquel nous pouvons communiquer au
loin . Je vais donner un exemple . Ainsi,je veux faire savoir a
mon agent à Montréal que je vends cent actions,disons
,de la
c ompagnie des Cent—Associ és,a 98 . Je lui tél égraphie
Vendez 1 00 actions Cent-Associ és à 98. J’attends une demiheure
,après quoi je reçois la réponse suivante Avons acheté
pour votre compte actions Cent-As soci és,à Et
grâce au t él égraphe,en un clin d ’œil
,je suis ruiné .
SAM .— AIOTS le t él égraphe
,ce n’est pas une bonne invention
BLAGAPART.— Cela ne dépend pas du tél égraphe , mais de
mon agent,qui
,en général
,est une canaille . Vois-tu , le
courtier est aussi une de nos inventions modernes les plus est im ées . On ne fait rien sans lui
,mais il fait beaucoup avec
nous .SAM .
— VOUS m ’intéressez énormément . Maintenant , si vous
voulez,partons . Où allons-nous d ’abord
BLAGAPART .— Jé t
’avoue que je suis un peu ému a l ’id ée
de me voir ainsi quitter le sol pour planer. Toi, Paulette ,qu ’en dis-tuPAULETTE .
— MOÎ, ça m
’amuse,j e risque n ’importe quoi .
Va pour l ’Angleterre . Al lons voir le roi. Tiens , un bout decroissant . (Elle chante )
Bonsoir,madame la lune
Cha.mfl ain fait un s igne , on entend son épée cliqueter en t re ses jambes ,et houp ! les t rois voyageurs son t part i s .Palai s de W indsor , nui t complète , lum i ère au corps de garde .
BLAGAPART.— We wish to see the King .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
SAM — La SuèdeBLAGAPART .
— Pas fameux,non plus
‘
; il y a eu de la chicane .On voulait en venir aux mains à preuve que la Norvègeétait prête à relever le gant de SuèdeSAM .
— Jé ne comprends pas beaucoup .
PAULETTE .
— Ca ne m ’étonne pas .BLAGAPART .
— Tiens , voulez-vous que j e vous dise , ce quenous avons de mieux a faire
,c ’est de nous diriger sur Paris
immédiatement .SAM et PAULETTE .
— C ’est ça , Va pour Paris .SAM .
— Al lOD S voir la tour de NesleBLAGAPART .
— Tu vas la trouver allongée,mon v eux
,sur
tout depuis qu’Eif fel y a mis lamain.
Un s igne de Sam et i ls reparten t .PARIS . Minui t , le boulevard est groui llan t de populo . Les camelots
crien t les journ aux du soi r,les fiacres et les vi ctorias en com bren t la chaus
sée ; la rue , ébloui ssan te de clartés,reten t i t du brouhaha du Tout-Pari s qui
s’énerve de plai s i r . Sam se frotte les yeux,
Paulette les écarqui lle afin de
Voi r plus .SAM — C ’est la première fois de ma vie que je viens aParis .
BLAGAPART .— C
’est bien heureux pour toi,car sans cela
,
tu le trouverais diablement changé .SAM — J
’aimerais entrer au théâtre . Si nous allions à
l’Hôtel-de-BourgogneBLAGAPART .
— Démoli,mon vieux . Du reste
,les théâtres
s ont a la ve ille de fermer, il est minuit . Cherchons quelqueboui-boui
,c ’est plus amusant .
(Ils traversent la place de l’
Opéra et entren t Olympia.
On joue une revue intitul ée Aboulez les artistes .PAULETTE .
— Qu’est—cc que ça peut bien être , Aboulez lesartistesBLAGAPART .
— Tu vas voir,écoute plutôt .
(Une joli e chanteuse, pas très jeune quoi qu
’au mai llot
, s’a
dressant à un personnage qui représen te le poète Rostand, chante)
Le Cyran o, R ostand, que tu nous a donn é
Garde en son cercle étroi t tes promes ses encloses .
Au temps des s ouven irs , poète un peu vann é ,Tu te croi s arrivé peut-êt re , ou bien tu poses .
Toujours es t-il que , pour l ’une de ces deux causes ,Depui s l’Aiglon ,nul oi seau dan s 1
’ai r n
’
a plané,
Et ue le Cyrano que tu n ous a donné
Gar e en son cercle étroi t tes prom es ses en closes .
Ne laisse pas en trer l’
oubli de toutes choses
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 49
Dan s ton Cambo de b lan cs jard in s en vi ronné .
Plutôt que de dorm i r pour calm er tes névroses ,F onds—n ous un pet i t coq , et , s
’
i l chan te du nez,Deux Cyranos , au lieu d ’
un seul , n ous seron t n és .
ROSTAND . Je ponds Cam bo m e semble
SAM — Ç a ne m’amuse pas . Il y a autre chose que je dés i
r erais voir aParis .BLAGAPART .
— Nous sommes a ta disposition parle Sam .
SAM .— Je voudrais voir la reine Ranavalo
BLAGAPART .— Pourquoi diable
SAM .-Pour voir si elle a quelque ressemblance avec les sau
vages du CanadaBLAGAPART .
— C’
cst tout le contraire , mon cher Sam elleest devenue Parisienne du coup . Pour elle l ’exil c ’est la patrie
,
et une patrie chouette . Du reste,elle ne deme ure pas tou
j ours aParis .PAULETTE .
— D’
autant moins que , malgré l’art des grandes
faiseuses,elle conserve trop l ’apparence d ’un Tanagra qui
aurait ét é cuit à TananariveSAM .
— Ellé n ’est pas j oliePAULETTE .
— Oh pas du tout,il ne faut pas la voir de près .
Prenez-eu ma parole,c ’est une princesse qui y gagne à rester
l ointaine .SAM .
— Jé ne puis faire autrement que de suivre le conseild
’une personne aussi j olie que madame la comtesse .
(Blagapart et Paulette toussent) .PAULETTE .
— Il se fait tard,si vous voulez
,nous allons revoir
l’autre Normandie .
BLAGAPART .— J
’en suis , en route pour l
’
Am érique. Maisd îtes-donc
,si nous passions par New—York
SAM — C ’est entendu . Hop
NEW YORK . Mêmes lum ières et m ême m ouvemen t qu’
à Pari s , sauf quec’es t plus heurté , plus colossal en core et . m oins amusan t . Sam
,Pau
lette et Blagapart er ren t dan s les rues .
BLAGAPART .— Tiens
,une belle maison .
PAULETTE . C ’est marqué Cooper sur la
porte .BLAGAPART .
— (l l li t) Cooper , ingénieur .— Entrons .SAM .
— Ï l est tard pour déranger les gens .BLAGAPART .
— L é S Américains, ça ne se couche pas leurs
banques sont ouvertes même la nuit .(Ils sonnen t, on vi en t ouvr i r ) .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
BLAGAPART .— Voici nos cartes
,introduisez—nous
LE NEGRE .— Impossible monsieur Cooper est très occupé
en ce moment,il fait le mort dans une partie de bridge qui se
j oue à Québec par le t él égraphe .(Ils s
’
en von t) .SAM — Qu ’est— ce que c
’est que monsieur CooperBLAGAPART .
— C ’est un malheureux acrobate qui a fait unfaux pas sur la neuvi ème corde .SAM .
— Il la mérite R etournons à Québec . Hop(Un i n stan t après ) .SAM .
— OÙ sommes-nousBLAGAPART .
—SUI‘ les plaines d ’Abraham .
SAM — C ’est désertBLAGAPART .
— Pas touj ours . Tantôt a Paris,il était une
heure de la nuit,mais ici il n ’est que huit heures . Dans quel
ques heures les plaines seront peupl ées,comptes-y ,
mon vieuxSam . A la faveur de la nui t
,tout ce qu ’il y a de malfaiteurs
se r éunira ici . C ’est un lieu très agréable le j our,mais dange
reux la nuit . Du reste , on songe à améliorer .
SAM — L’endroi t
BLAGAPART .
— NOR ,le sort de ces malheureux .
SAM .— Ofl va les pendre
BLAGAPART .— Pas le moins du monde . On va rendre moins
dur leur métier . Les plaines vont être nivel ées,ratissées afin
de rendre le chemin du crime aussi agréable que celui de lavertu . On tracera des all ées tortueuses , de vrais dédales , onplantera des massifs touff us afin de faciliter la tâche du truand
,
on placera des bancs pour lui permettre de se reposer , une foisqu ’il aura‘ bien tapé sur le bourgeois tout cela va être embelli
,
fignolé , enfin ce sera un splendide décor pour représenter desdrames vécus . Même
,afin de ne pas tromper le public sur la
nature de ces améliorations et d ’empêcher les gens paisibles des ’y risquer
,on parle d ’y élever une statue monumentale .
SAM — Comme la mienneBLAGAPART .
— Pas tout a fait . La statue aura des ailes,
embl èmes du vol elle aura l ’air de s ’élancer vers le ciel , dequitter les plaines d ’
Abraham pour retourner au sein du mêmeça représentera un ange et ça s
’appellera L’Ange de l
’Apache.
”
PAULETTE .— Ouf
SAM .— J
’ai soif.BLAGAPART .
— M0 l aussi . Mais il y a une chose qui m ’
embête .
PAULETTE .— Quoi
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 5 1
sai s,le samedi soir
,les buvettes
sont fermées dès sept heur es et ne sont rouvertes que le lendemain
,durant la grand
’messe.
SAM — SingulierPAULETTE .
— J’ai une idée .
BLAGAPART .— Prête-la nous .
PAULETTE .— Al lons faire une surprise a notre ami Muflefin ,
le reporter de la .
BLAGAPART . Chut ne di s pas le nom dujournal
, ça lui ferait trop de réclame . Ton idée est bonne.
Hola Sam,fouette ton cheval surnaturel .
SAM — Tout de suite .L a m ai son de Muflef in . Très pauvre m ai s t r ès honn ête
,la m ai son de
Muflefin . Muflefin va ouvri r en b ras de chem i se.
MUF L EEIN .— Touj ours far ceur
,ce bon Blagapart . Dis donc ,qui est-ce que tua s dégui s é ainsi pour te payer ma tête
PAULETTE .— Cé n
’est pas un déguisement,monsieur Muflefin ,
monsieur est le . .marquis . . le comte . . le . . j e ne saispas .
BLAGAPART .— (bas a Paulette) La langue te fourche quand il
faut parler de gueules hein la comtessePAULETTE .
— Monsieur est le fondateur de Québec,que nous
avons rencontré tout a l ’heur e .MUF LEF IN .
— Je suis tr ès honor é de parler au fondateur .
(à Sam , qui ne semble pas en tendre) ..Au vénérable fondateur de Québec . .Aie monsieur
de Champlain,vous ne m ’
entendez pasSAM — HeinMUF LEF IN .
— J€ dis que j e suis tr ès honor é de faire la connaissance du fondateur de Québec .SAM — D é qui voulez-vous parlerMUF LEF IN .
— M£LÏ S c ’est de vous . (A part) . Il est modeste,comme tous les hommes de valeur .SAM .
-Moi Je ne m ’en serai s j amais dout é . Je crois quevous faites erreur .MUF LEF IN .
— Mais enfin,il est bien connu que vous avez fondé
Québec .SAM .
— M0 l ? j e n ’
ai jamais songé à cela . Je suis venu icicomme employé de la compag i ie des Cent—Associ és j e tâchaisde vendre aux sauvages de la bimbeloterie
,des affaires de quatre
sous pour des fourrures de plusieurs m illiers de livres .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
BLAGAPART .— Il ne s ’agit pas de ça , nOus avons la gorge sèche .
Muflefin,au lieu de faire ta poire
,donne-nous en pour la soif.
(Muflefin s’exécute et place sur la table plusi eurs boutei lles ) .
MUELEF IN .— Là
,servez-vous
,pendant que je finis mon travail .
(Ils boi ven t à plusi eurs repri ses . Sam s’échaufie, Paulette r i t et
belles den ts,Blagapart est rêveur ) .
SAM .— (Ii ti tube un peu) ; Mais , monsieur Muflefin ,
non seulement vous écrivez
,mais vous dessinez . Qu ’est-ce que vous
faites laMUF LEF IN .
— Un incendi e . C ’est l ’incendie de demain quej e dessine pour mon j ournal . Vous voyez
,j ’ai fait le calcul
des pertes subies,des morts
,etc .
,etc .
SAM — Mais vous ne savez pas s ’il y aura un incendi e .
Justemen t l’
eau qu’
i l faut pour de peti ts navi res .
MUF LEF IN .— Il y en a touj ours un il en faut un pour tous les
jours . On le prépare d ’avance .SAM — C ’est étonnant . Mais au fait , à force de voul oir de
vancer , vous reculez .MUF LEF IN .
— Comment çaSAM — Mais oui . L’incendi e que vous dessinez pour demain,
vous,le faites aujourd ’hui , de sorte que demain , il sera déjà
vœux.
MUFLEF IN .— (avec un sour i re de pi tw) Nai f Vous savez bien
que c’est sur les vieux portraits qu ’on paraît le plus j eune.
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 53
A propos,di tes-moi donc
,quelle id ée vous avez eue de fonder
QuébecSAM .
— Je vous ai di t que ce n ’étai t pas moi .MUF LEFIN .
— Olfi,oui
,j e sais . . la modestie . Mettons que
c ’est vous . En tous cas , vous avez eu une singul i ère idée.
Pourquoi n ’avez-vous pas fondé Montr éal plutôt Montréal
est une bien plus belle ville , et pui s son port a justement l ’eauqu ’il faut pour de petits navir es comm e ceux que vous avi ez .SAM .
— OUÎ, de notre temps , la marine était en enfance .PAULETTE .
— Vous n ’aviez pas des hommes comme l ’empereurd
’Allemagne pour vous renseigner .SAM — L ’empereur d’
Allemagne qui est-ilBLAGAPART .
— Un homme de bon conseil , et di scretSAM — (Très pompetæ) Mon cher monsieur Muflefin ,
j e vousremercie de votre hospitalit é ; vous êtes très aimable , . .maisi l est tard et j e brûle d ’aller raconter ce que j ’ai vu . De ce quej e vais leur en boucher un coinBLAGAPART .
— L é voilà qui parle argot . Tope—lâ , mon vi euxSam .
SAM — Adieu,il faut que j e disparaisse.
PAULETTE .— Monsieur le . . comte . le marqui s .
BLAGAPART .— Appelle-lé donc monsieur
,tout court c ’est
déjà beau .
PAULETTE .— Monsieur de Champlain
,qu ’est-ce qui vous a plu
davantage à QuébecBLAGAPART . (A part) Elle sera bien toujours la femme d’
un
j ournaliste .SAM .
— Je vais vous le dire .
Il se t ient sur le seu i l de la' porte
,et avan t de di sparaître , i l chan te :
(A i r du ref rai n de la Ton ki noi se)
Y a qu ’
un’
femm e a qui je tienne ,C
’
est la Cana,c
’
est la Can a,la Canadienne ;
Elle “
est jolie , elle est fraîche ,Pu is— vous savez— pas pim bêche .
Con tre ell’
pas d’
danger qu’
j’
dé oi se ,Ma Québéco , ma Québéco , m aQuébécoise ;Je vai s emporter aux c ieux
Le souv’
n i r de ses beaux yeux .
V ieux articles et vieux ouvrages
La det te de s Etat s -Un is enve rs les canad iens -f ranc a i s .
(The Am erican Cathol ic Quartely R eview ,Vol . XI , N o. 1 6
Octobre
Parmi les é léments qui ont pris part à l ’exp loration , l ’occupation et le déve loppement de la vaste partie du continentcouverte par notre drapeau , i l en est un qui a été singulièrement oubl ié dans les calculs généraux ,
ou qui a été tout simplement confondu avec l ’émigration venue de la mère-patri ed
’
Europe . C ’
est cet é lément canadien-français si intimement mê lé à. notre histoire depui s au moins deux cents an s
et dont le passé serait un suj et de légi time orgueil pourn ’
importe quelle race .
F ideles a la politique d ’ exploration suivie par Champlainet les re ligieux qui avaient adopté la règle de Saint-Françoisou de la grotte de Manrèse ,
les générations successives deCanadi ens de naissance ont sillonné le -continent dans toutesles directions , portant courageusement leur part du fardeaudans toutes les entreprises de découverte , de comm erce ou deguerre , dans le but de déve lopper , fortifier et défendre leurco loni e . Sous leur impuls ion , le Canada ou la Nouve l leFrance ne prit pas de l ’extension seulement sur les cartesfrançaises , mais , au moyen de postes militaires , de miss ions
( 1 ) NOTE D U DIRECTEUR — La Revue F ran co-Am éri ca i ne publ iera,s ous ce
t it re,les renseignemen ts recuei ll is dan s les vieux journ aux
,les vieux ouvrages
t rai tan t du’
jrôle jouéjpar notre élém en t en Am ér ique . Ce sera un des m oyens
de{refai re en chapitres î s épar és l’
hi stoi re de n os ém igrat ion s qui on t déj àéloign é plus de des n ôtres de la Provin ce de Québec pour lesouper _
aux Etats-Un is,dan s les provin ces vois ines ou les vas tes terr i toi res
e l’
Ouest . On ver ra ,de la
'
fis orte , comm en t furen t appr éci és les hauts fai t sde n otre race par ceux qui en furen t les t ém oin s . D e plus , cet te compi lat ionde nos pet ites histoi res permet tra à n os d i ff éren ts groupes de se m ieux con
naître et surtout de s’
est im er davan tage en cons tatan t que n i la d is tan ce ,
n i le tem ps n’
on t en core pu éteindre chez tous la comm un aut é d’
id éal et
d’
aspi rat ion s .
L’
étude que nous publ ions aujourd ’
hui es t une t raduct ion d’
un art i cle
de l’ Am er i can Quarterly Review consacr é à l
’
ouvrage de M . Tass é sur
les Canadiens de l’
Oues t . On y t rouvera plus ieurs con s idérat ion s d ’
un in t é
r êt part icul ier pour nos compat ri otes des Etats-Un i s .
Le deuxi èm e“art i cle ,
con sacr é aux Acad ien s , par M . Charles Le Goffic ,es t em prun t é à l ’ Ouvrier
”
,de Par i s . 1 er juin ,
1 90 1 .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Jo liette,né Canadien , accompagné par le Père Marquette ,
remonta le Missi ssippi jusqu ’à l ’ embouchure de l ’Ark an sas ;Le Moyne d ’
Ibervi lle atteigni t l ’ embouchure de la rivière ducôté de la mer
,en pri t possession et y fonda la colonie de la
Loui siane qui devint puissante sous la direction de sonfrère de Bienvi lle . L es Canadiens accompagnèrent La Sa lleau Texas ; Jubhereau de St-Deni s fonda Natchitoches , traversa le désert jusqu
’
aùx premi ers postes espagnols et atteignit la ville de Mexico . Le Jésu i te Canadien , Beaudoin ,
convertit les Cris parmi lesque ls il prêcha l ’évangi le pendantplus i eurs années . Bi s sot de Vincennes , né sur les bords duSaint-Laurent , fonda le poste qui porte encore son nom , etVarenne de la V érandrye explora le haut Missouri et la région des Montagnes R ocheuses jusqu ’
à la vallée de la Saskatchewan . Des forts furent établi s à Mak inac et N iagara parle m arquis Canadi en de Vaudreuil .I l y a plus de cent an s , une population canadienne étai t
déjà. groupée autour de Oswego,N iagara et Fort Duquesne .
Détroi t était un étab lissement important de canadiens avantque la colonisation anglai se ait traversé les Alléghan ies .
N iagara,Fort St-Joseph
,Kaskaskia , Mackinac , Fort Char
tres,Cahoki a
,Carondelet , Ste-G eneviève ,
'
St-Philippe ,Prair ie du R ocher , Vincennes , Sault Ste-Mar ie , ,
St-Louisfurent toutes des villes purement canadiennes ayant leur organ i sation régulière , reconnues par décrets officiels ,
ayantéglises
,officiers civils
,notaires , etc .
,leur vaillante popula
tion cultivant la terre,faisant le commerce
,tout en contri
huant bravement leur part aux difl'
éren tes opérations militaires dans cette guerre si longue et si ardente qui ne futdésastreuse pour la France que parce que la France et sonroi di ssolu manquèrent de fidé li té au
_
Canada . La p lus brillante victoire qui , pendant cette guerre , racheta la gloire dunom français fut remportée sur la Monogahéla par un canadi en , le Chevalier de Beaujeu , ce héros chrétien dont les derniers moments furent consolés par la conviction qu ’ il avaitnob lement servi le pays de sa nai ssance et celui de ses ancêtres en taillant en pi èces la plus belle des armées anglaisesqui aient essayé d ’enlever a la France le royaume conquispar ses fils canadiens .
’élément canadien dans la Louisiane était considérab le .Le premier enfant blanc né en L ouisiane fut celui de C laudeJausset , un canadien . Un grand nombre s ’
y rendit par voie
LA REVUE FRANCO -AM ÉRICAINE 57
du Missi ssipi , puis arriva aussi dans la Louisiane , où leursdescendants forment encore un groupe vivant sur la Teche ,une partie considérab le de ces Acadiens que l ’Angleterrearracha a leurs doux foyers de la Baie de Fundy parce qu ’
i lsétaient des “ papistes reconnus et irréductib les .Jusqu ’ en 1 763 le terri toire couvert par ces étab lis sements
françai s était reconnu comme formant le Canada et laLoui siane , le pays des Illinoi s et tout le pays au sud fai santo fficie llement partie de cette dernière colonie , bien que toutela partie supérieure du Mississippi fût purement canadienne .
Ceci était non seulement réclamé par les françai s mais étaitencore admis par les anglais . Des documents datés dusi ècle dernier (XVIIIèm e ) et conservés dans les archives dela Pennsylvanie parlent de Fort Duquesne , aujourd ’huiPittsburg
,comme faisant partie du Canada .
La populati on canadienne étab lie aussi a bonne heu redans l ’Ouest n ’est pas disparue , elle n ’ est pas éteinte . A lachute des postes français , pendant la guerre , plus ieurs deceux qui habitaient dans leurs environs se retirèrent , généralemen t dans les Ill inois et à Détroit , et quand vint la chutefinale
,quand le drapeau blanc de France fut baissé a Fort
Chartres par le canadien St-Ange de Be llerive , plus de lamoitié de la population des Illinois , supposant que le territoire situé a l ’ouest du M i s i ss ippi resterait colonie française ,traversa le fleuve et fonda les premiers étab lissements del’
Etat du Missouri ; le reste se rendit en Louisiane mais n e
quitta pas notre territoire actuel . Que lques -un s , découvrantleur erreur
,revinrent sur leurs pas , et pendant plus ieurs an
nées les Illinois restèrent terr itoire essen tiellem ent canadi en .
Si peu connu des anglais,en e ff et
,et des colon s étab l i s sur
les bords de la mer , était le pays caché par les Monts Alléghani es dont chaque ruisseau et chaque sentier étaient familiersaux canadiens , que les troupes an glaises destinées à l ’occupation de Fort Chartres étaient très perplexes sur la route a su ivre pour se rendre a destination . Il ne pouvait être questiond ’une m arche a travers le pays inconnu qui séparait la côtedu Mississipp i . Alors le major Loftus essaya , avec quatrecents soldats réguliers d ’atteindre le fort en passan t par laNouve lle Orléans ; i l fut repoussé par les indiens cachés enembuscade le long des rives du M i ssissipi . Le capitainePitman essaya de s ’y rendre a la faveur d ’un dégui sement ,mais i l perdit courage et abandonna le voyage . Le lieutenant
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
Fraser ne réussi t pas davantage et i l dut essuyer de son mieuxles condoléances moqueuses que lui addres sèren t les offici ersfrançais et espagnols de la Nouvelle Orléans se réjouissantfort de la déconfiture de ces mi l itaires anglais s i désireuxd
’
abattre le drapeau f rançai s . E t ce ne fut pas avant lemoi s d ’octobre 1 765 que le capitaine Sterling , avec centhommes du Quarante -deux i ème Montagnards , après unemarche pénible et prudente , avec Fort P itt situé a la tête del’
Ohio comme point de départ , atteignit le Fort Chartres quilui fut rendu par St -Ange de Be llerive .
Assuré par le gouvernement anglais du libre exercice deleur droits re ligi eux ,
les canadien s de l ’Ouest reprirent leursoccupations pacifiques ; ils devinrent les hommes de confian ce des officiers anglais et des com pagni es de commercepour les nouve lles explorations , pour les négociations avecles sauvages et la direction des tribus , et pour le développem ent des ressources du pays . Ils furent ainsi portés à se di sperser sur tout le territoire de l ’ouest .Pendant notre guerre de l ’Indépendan ce cet élément cana
di en se rangea de divers côtés . La mission de Carro ll ,F rankl in et Chase au Canada en attira beaucoup a la causeaméricaine surtout de ceux qui ne s
’étaient jamais cordialement soumis al ’Angleterre . D es vo lontai res s ’
en rolèren t enassez grand nombre dans l ’armée américaine pour y formerdes régiments com plets , et ceux-ci , après avoir bien servipendant la lutte , reçuren t , a la fin de la guerre des concess ions de terr ains dans le nord de l ’Etat de New York où leursdescendants vivent encore et forment le noyau de la population d ’origine canadi enne . Le R év . M . L avalin i ère afficha
s i ouvertement ses préférences pour les américains—
qu ’ il futexpulsé du Canada et vint s ’ étab li r à New York .
Détroit fut gardé jalousement par les anglais auxquels laguerre de Pontiac avait donné une leçon . Partout où s ’ét endit la pui ssance des armes anglaises les pionniers canadiems et les tribus indiennes furent attachés au service de lamère patri e Dans l
’
Illinoi s et l ’Indian a,cependant , les canadiens accue i l lirent C lark avec joie , ets ous la directi on du R év . M . G ibault et du colone l Vigo ilsassoc i èrent leur fortune à ce lle des colonies et conquirent leNord-Ouest pour les Etats Unis . La dette de reconnaissanceque le pays doit a ces Canadi ens n ’est pas petite et on n
’ena j amais b i en appréc i é toute la valeur . Pendant les Opéra
LA REVUE FRANCO -AMERICAINE 5
t ions qu i suivirent un détachement canadien , engagé dans lailutte con tre l ’ ennem i commun , fut presque complètementanéanti .Quand l
’
E spagn e déclara la guerre à l ’Angleterre les
p ionn i ers du Missouri furent en butte à l ’hostilité des anglais
,et la défaite infligée à l ’ennemi sauvage qui tenta de
massacrer les habitant de la petite vi lle de Corpus Christiest un des faits d ’armes les plus br illants de la guerre del ’ indépendance .
Ducharme ,le commandant de cette expédition contre un
v illage presque entièrement canadien était lui-même canadien
,et M . Tassé donne un précis de sa carrière dans un de
ses volumes .De la sorte cet é lément can adien de l ’ouest , qui avait perdu
sa nationalité française , se trouva partagé entre les troisnat ions rivales— les am éricains , les anglais et les espagnols ,— et comme i l comptait un grand nombre d ’hommes audacieux
,actifs
,absolument habitués à la vie des indiens et de
la frontière ce groupe de Canadiens-français produisit plusieurs soldats qui se distinguèrent au service de chaquenation
,et l ’on vi t fréquemment canadien lutter contre cana
d ien .
Pendant notre seconde guerre avec l ’Angleterre il y eutdans une certaine mesure répétition de cette anomal i e . L es
c anadiens de chaque côté de la frontière prirent part auxopérations militai res sous les drapeaux de l ’Angleterre et desEtats Unis ; m ême un certain nombre , dans ce dern i er paysc édant à de vieil les relations et restant fidèles a une premièrea llégéan ce , combattirent activement pour les intérêts ang lais .L es histoires ordinaires des Etats Unis ignorent plus ou
m oins ces servi ces que les canadiens ont rendus à notrecause , mai s qu i n
’en sont pas mo ins rée ls et importantsgrands à l ’ époque où i ls furent rendus et grands dans leursconsequences .
Lorsque la paix fut rétab l i e,vint du Canada une ém igra
tion qui se continue encore et qu i , a certa ines époques , a atte 1 nt des proportions considérab les . Dans l ’ouest les anglais conservèrent que lques -un s des forts pendant plus i eursannées , y compri s Détro it , et de cette façon exercèrent uneInfluence qui attira beaucoup de can adiens de ce côté ; pui sle éomm erce des fourrures
, qu i se déve loppa rapidementapres l ’achat de la Louis iane
,excita la concurrence entre une
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
puissante compagni e commerciale anglaise et une maisonrivale de St-Loui s , mai s toutes defix comptèrent surtout surles canadi ens comme voyageurs , trappeurs , et en généra lpour leurs employés . Ces dern i ers devinrent a la fin lespionni ers du territoi re si tué entre la Baie Verte et la Colombie . Et comme les Etats-Uni s grandi rent et acquirent leterritoire du trans-M i ssissippi , of frant à tous des foyers et unchamp d ’activité , le Canada dont la population croissai trapidement sans avoir les mêmes avantages , continua à contr ibuer largement à l ’ immigration .
“
Aujourd ’hui , dit M .
Tassé,les Etats qui possèdent les plus forts groupes de Ca
n adien s sont l ’Illinoi s ,le M i s sour i ,Îe M i ch igan , le VVi scon
s in et le M innes sota . Le M i ssouri,fondé par les Canadi ens ,
a conservé dans une large mesure les descendants de sa première population . Dans l ’Illi noi s la race canadienne se r é
trouve principalement à Ch i cago,Bourbonnai s , Manteno ,
Peti tes Iles,Ste-Anne
,E rab le
,Mom én i et Kankakee . Il y
a environ canadi ens dans le Minnesota et autant dansle M i chigan . Dans le M in n es sota on les retrouve surtout aSt-Paul , les Chutes de St -Antoine , le Petit Canada , le Lacqui Parle et l ’Ai le de Corbeau (Crow ’ s W ing . ) Le comté deMonroe , Michigan , compte canadi ens et i ls sont nombreux dans les comtés de Ste -C lai re et de Macomb . Dansle W i scons in cette population est tout aussi nombreuse maisbeaucoup plus di spersée . Il y a aussi des mi l li ers de canadien s dans l ’Ohio ,
l’
Iowa,le Dakota
,le Montana
,le Co lo
rado , le Kansas , I ’
Ar i zona le Nouveau Mexique,la Cali
f orn ie ,l’
Oregon et le terri toire de Wash ington .
Dans l ’ est , New York et la Nouve lle Angleterre ont reçuune immigration canadi enne considérab le
,et dans plusieurs
centres manufacturiers , comme dans plusieurs centres depêcheurs , ce sont les canadiens qui dominent ; i ls y possèdentleurs propres égli ses , leurs écoles , leurs soci étés littérai reset de bienfai sance , leurs journaux ,
et font preuve d ’un es
prit d ’ entrepri se digne de tout é loge .
Ici encore , on s’ est peu occupé de l ’h i stoi re de cet é lément .
Nous en retrouvons que lque trace dans l ’histoire dd eomm er
ce des fourrures , dans les re lations des voyages de Mackenz i e,
d’Hen r i et Harmon , dans l" ‘
Astor i a”d
’
Irving ,dans les ré
c i ts du canadi en G abrie l Franchere,dans les re lations des
voyages de L ewi s et C larke , de Pike et Long , dans Schoo lcraft et Fremont ; mais ce ne sont que des études f ragm en
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 6 1
taires où le voyageur,dans le cours de la descr iption ,
di s
parait et ré parai t tour a tour .A la Soci été Historique du W isconsin et a la constanteénergie de l
’
Hon . Lyman C . Draper dans la recherche et lacollection des souvenirs des premi ers pionniers canadiens decet Etat
,est dû le mérite d ’avoir attiré l ’attention , dans
notre pays , sur l ’ importance de cet é lément et d ’en avo irfait une apréci ation convenab le en une sorte de complément Itl ’histoire de notre pays . La façon part iale , toute d
’un côté ,d ’écrire nos annales
,qui appartient a l ’école Cotton-Mather ,
et qui s ’ est,dans un e certaine mesure , continuée jusqu
’à nosjours , l ’habitude de présenter nos guerres de frontières despremi ers jours comme le résultat inévitable de la férocitéinnée des canadiens est maintenant re léguée dans le domainede la fab le et des comtes de fées .Evident , et appuyé par des documents authentiques , nous
apparait le fait que le Canada,dès l ’origine ,
a cherché f réquemmen t et avec persistance
,à établir des re lations com
m erciales amicales avec les colonies anglaises ,a éviter de
prendre part a toute guerre qui pourrait être allumée enEurope , et a s
’absten i r d ’uti lis er le concours des indiensdans les hosti lité qui pourraient devenir inévitables entre lescolonies limitrophes .L es anciens écrivains de la Nouve lle Angleterr e , trompeurset jugeant à faux , nous font de leurs Mason ,
Underhill,
Church , et des autres guerriers indiens des portraits de héroschrétiens du type le plus pur
,mais nous représentent sous
des couleurs à glacer le sang dans les veines les part isanscanadiens— Hertels , Joncaires , Le Bers , St-Cas tyn s ,
L eMoynes . L es écrivains n ’ont jama is cherché à savoir ce
qu’
étaien t ces hommes . L es études et les publications récen tes de littérateurs canadiens nous permettent de voir ceshommes sous leurs vraies couleurs
, de fai re la relation vér idi
que des événements en les comparant avec des récits que lquef oi s absolument opposés et profondément entachés depréjugés nationaux et re ligieux .
Les Canadiens se distinguèrent dans leur propre pays etl’
étranger . Nous n ’en parlons que pour ce qui a trait à leursrelations avec l ’histoire et le progrès des Etats Unis ,
maisnous pourrions rappe ler dans ses détails la brillante carrièredu comte de Vaudreuil qui , par son habil i té
, sauva la flottefrançaise d ’une des truction complète au Cap F inistère en
LA REVUE FRANCO -AM ÉRICAINE
1 748 nous pourrions parler du baron de Vaudreuil tué au:
si ège de Prague ; d’un autre Vaudreui l contribuant à la dé
faite de G raves au large de Chesapeake ; de Beaujeu membrede la flotte de D ’
E staing et prenant part a la campagne deRussie de Napoléon du baron Juchereau de St-Denis devenufameux comme ingénieur militaire et comme écrivain ; duvicomte de Lery dont le nom est inscrit sur l ’Arc de Tr iomphe de Paris .
Une é t ude s ur le s Ac ad iens .Pari s ,
rer j u in
Je viens d ’ entendre, a la Société de géographie , une con
ference de M . Dubosc de Beaumont sur l’
Acadie française .
L’
Acadi e fait parti e de la D om in ion du Canada . Les habitants
, par ordre du féroce co lone l anglais W inslow , furentdéport és en mas se
,le 1 0 septembre 1 755 , sur cinq bâtiments
envoyés de Boston , qui les j etèrent a la côte près du capSavaral . La plupart péri rent de faim ou de misère , et lesAnglai s crurent avoi r fai t tab le rase des Acadiens . Ils se
trompai ent .L ’amour de l ’Acadie était si fortement ancré dans le cœur
des survivants,que deux ou trois mille d ’entre eux trou
vèren t moyen de regagner subrepticem ent leur pays natal .Ils se j oigni rent a ceux de leurs frères qui avaient échappé àla férocité de W ins low et qui se cachaient dans les grottes duli ttora l et dans les fourrés de l ’ intérieur . L
’
in surrection des
Etats Uni s,qui éclata que lques années plus tard
,détourna
d ’ eux l ’attent ion de leurs oppresseurs . Ils purent se recons ti tuer par familles et par villages : ils n ’ étaient encore que6
,000.à la fin du xv mèm e si ècle i ls sont aujourd ’huitous catholiques qui forment une petite nation ,
ayant soncaractère propre , ses églises , ses éco les , ses collèges , ses journaux , ses députés au Parlement . La langue qu ’ ils parlentet qu ’on enseigne à leurs enfants est le français . Te l estleur attachement pour la mère-patrie qu ’au mois de septembre de
_
l ’année derni ère i ls ont tenu une grande conventionnationale a l ’efiet de créer des sociétés de secours mutuelsexclusivement françai ses , des banques populaires françaises ,
et de nouer avec nos maisons de commerce françaises des relat i on s qui permi ssent aux produits de la métropole de lutteravantageusement , sur leurs marchés ,
avec les produits amér i ca i ns ou anglais .
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
dans sa touchante épopée rustique d ’
Evangd ine , a stigmatiséc es odieux procédés de conquête , dont l ’histoire n ’avait pasoffert d ’
exemple jusqu ’alors et qui resteront la honte de leursauteurs . Un argument dont abusent un peu les écrivainsétrangers est que , pour juger des mérites coloniaux de laF rance
,i l n ’y a qu
’
à fai re le compte des colonies qu ’ e lle asuccessivement perdues au cours des s ièc les . Mais notrec as est-i l donc s i exceptionel ? L
’
Angleterre n’a-t-e lle pas
vu l ’ indépendance des Etats-Unis se constituer sur les ruinesde son emp ire colonia l ? Les Portugais n
’
on t-ils pas perdule Brésil , les E spagnols leurs imm enses possess ions d ’
Am é
rique ? Pour juger congrûm en t de la valeur colonisatriced ’une race , i l est beaucoup plus logique de s
’appuyer sur lavitali té mora le et inte llectue lle de ses créations coloniales quesur les conditions politiques où le hasard des armes les a
momentanément placés . L ’ exemple de l ’Acadie françaisee st , a ce point de vue , souverainement expressif et péremptoire .
L'
idée de M lle Jeanne
PAR S . BOUCHER IT
Ainsi,Mademoise lle , c ’ est b i en décidé par votre haut e
sagesse . B i en que le monde entier entre en vacances , au
jourd’
hui,1 er août , et doive y rester pendant les mo i s que
D i eu a évidemment faits pour qu ’on se repose,vous exigez
que je continue a travai ller ! C ’ est une tyrannie !Cette interpe llati on
,d ’une forme assez peu respectueuse
et prononcée sur un ton qui l ’ étai t encore moins , fut adres éepar Jeanne Viviers a son institutrice , M lle Hermance Maroi s ,bonne grosse personne dont ri en
,dans l ’ extérieur ni la phy
s ionom ie ,ne révé lai t une di spositi on parti culi ère a ce des
pot i sm e dont on l ’accusai t . Tout au contrai re,son vi sage
calme et doux , entouré de boucles blanches d ’une modesurannée
,respi rai t une mansuétude qu i pouvait b i en aller
parfoi s jusqu ’à la faib lesse viv-â—vis d ’une élève aus s i grac ieuse qu
’
i ndi sciplin ée .
Jeanne Vivi ers étai t une enfant de quinze —ans,charmante
avec sa masse de cheveux châtains,à reflets métall iques
, qui
s é pandait librement en cascade sur ses épau les,encore un
peu anguleuses , avec ses yeux brillants et audacieux,ses
lèvres rouges comme une fleur de grenadi er et son ai r à lafoi s souriant et mutin
,où i l y avait le charme n ai ssan t
‘
de laj eune fille et l ’espiègler ie de la gamine .
E lle avai t un cœur d ’or,une âme candide et pur comme le
plus pur cri stal , un espri t d ’une vivacité primesautière,
ple in d ’
imprévu et de piquant . Mais comme les plus parfai tes créatures n e sont pas sans défaut
,Jeanne en possédait
un très accentué ; e lle avai t la p lus profonde horreur de l otude . Le piano lui parai ssait un instrumen t de torture
,le
dessin un exercice qu ’on devai t réserver comme suppl i ce ao
ces soi re aux prisonn iers . La géographie et l ’h i stoi re lui
semblaient des choses pleines de mystères qu ’e lle préféra itne pas approfondi r . L
’
orthographe surtout étai t pour e lleun terrain broussail leux
,semé de fondrières au mi l ieu des
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
que l les el le ne s’
aven turai t que d ’un pas très hési tant . E l leavai t trouvé un moyen ori gina l de sorti r de certaines di fficultés grammati cales . M lle Maroi s lui ayant , un jour , donnéun devoi r héri ssé de pluriels scabreux ,
e lle avai t passé outretout simplement et s ’ était bornée a écri re , à la fin de la page ,toute une ligne de S avec cette mention “ Pour mettre ou i len faudra .
”
On comprend qu ’avec ces di spositions , l ’annonce , que M l leMaroi s venai t de lui fai re , de travai ller un peu , oh ! ri enqu ’un peu
,pendant la péri ode officie lle des vacances ,
lui
inspi rai t les réflexions les plus amères et presque des ve lléi tés de révolte ouverte . E lle avai t s i b i en compté sur deuxmoi s de farn i ente absolu
,sans autre souci que ce lui des pro
menades a faire ou des parties à organi ser avec son frèreHenry
,a peu près aussi labori eux qu ’ e lle .E l le avai t cru ,
d ’une f oi s i joyeuse,di re
, pour soixante . j ours , un completadi eu aux mé thodes et au lexiques
,aux bouquins et aux
cah i ers ! E l le s ’ était tant promi s d ’ errer du matin au soi r,
indéfiniment et sans but,sous les beaux ombrages du parc
qu i entourai t le château ,ou
,perspective plus séduisante
encore , comme marquée de plus d ’
indépendance,dans les
vastes boi s vois ins qu ’un mur seu l séparait de la propr i été (1son père ! De tous les morceaux de chant qu ’on lui fai sai tapprendre et qu i s é chappai ent de sa mémoi re aussi fac i lement qu ’
i ls y entrai ent,un seu l vers lu i demeurait toujours
présent , ce lui qui commence un des ai rs de GalathéeAh ! qu ’
i l est doux de ne ri en faireE lle le répétai t mentalement comm e une espérance ten
drem en t caressée , en attendant l ’aurore du 1 er août , jourbéni où i l deviendrai t une réali té . E t voi là que la terrib leM lle Maroi s lu i s i gn ifia que “ vacances signifierai t pour e lledim inution
,et non suppression du travai l abhorré et que
,
même au mi li eu des p lai si rs qui lui étaient lai ssés— vraimentc ’ étai t encore heureux qu ’on daignât lui en laisser un peuel le serai t toujours poursuivi e par le cauchemar de la tab led ’ étude ou du piano qui l
’
attendaien t !— Oui , Mademoi se lle , j e 'le répète
,repri t-e lle après un
instant où la colère avai t si lenci eusement boui llonnée au dedans d ’ e lle , l ’organ i sation que vous avez réglée pour ces deuxmoi s constitue une véritab le barbarie . Vacances et travai lsont deux mots qui hurlent d ’être unis . On est en vacances
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 67
ou on n ’y est pas Voi là le di cti onnaire tenez Je l ’ouvreet j e li s : Temps durant leque l les travaux cessent dans lesécoles . Ainsi parceque j e sui s élevée chez mon père , parM lle Hermance Maroi s
, qui devrai t être bonne et compatissante pour m oi
,j e serai privée du répit qu ’on accorde à tous
les barbôui llés de la classe muni c ipale ! C’
pst une injusti cerévo ltante .
E t ma santé,ma pauvre petite santé
,vous n ’y pensez pas
E lle n ’y rési stera pas,c ’est certain . Je mourrai a la fleur
de mon âge,sous l ’ effort excessif de travai l que vous m ’
im
posez et vous aurez mon trépas sur la consci ence .
— Non,ma chérie , vous ne mourrez pas ,
répondit l ’ in st i tutri ce que cette terrib le perspective avait effrayée pendant uneseconde
,mais que rassura vite la vue de la m ine rose et res
plendi ssan te de J aurez tout le temps voulupour vous reposer et vous amuser . . Mais deux heures d ’ exerc i ces le matin et deux heures le soir ne feront que vousrendre vos longues récréations plus douces . D ’ailleurs , ce
n ’ est pas moi seu le qui ai t décidé qu ’ il en serai t ainsi . C ’estvotre père lui -même qu i a fi xé ce programme . .
— Ah c ’est père qu i . exclama la j eune fi lle san s acheversa pensée , mai s d
’un ton tout a coup radouci . .Et est-ce queHenry travai llera aussi ?
— Mais certainement ! i l travaillera,mais d ’une autre
manière .
— Comment ?— Votre père veut que chaque jour i l ai lle passer deuxheures le soi r et deux heures le matin dan s les ate liers pours ’ initier successivement ‘a tous les servi ces de la fabrique .
— Mai s j ’ irai s bien aussi ! s ’
écri a Jeann e tentée . I l y aa la fabrique autant d ’
ouvr ières qùe d’ouvr iers et on pourrai t
bien m ’
apprendre , comme à Henry ,le filage et le brochag
de la soie .
—Ce n ’ est pas la même chose . Votre frère est destiné ,vous le savez
,à aider plus tard votre père dans la di rection
de la fabr ique . I l est donc nécessaire qu ’ i l commence a s’
yexercer de bonne heure . En lui donnant ce but pour occuper la l iberté de ses vacances , M . Viviers agit sagement ,comme toujours . Tandis que vous .
— Moi , j e n’aurai pas de fabrique à diriger , soupira Jeanne .
et il faudra continuer ame bourrer des haut faits de PhilippeAnguste et des heureux effets des dièzes et des bémo ls . L e
LA REVUE FRANCO —AM ÉRICAINE
sort des femmes est bien déplorab le ! E st-ce que Henryaura aus s i des devo i rs à faire ?Non
,mon enfant . Outre que ses études a l ’ate lier suffi
ront,son précepteur a demandé aM . Vivi ers de lui permettre
de consacrer tout son temps a ses propres travaux ._
— Ah oui ! fitJ eanne en riant , les travaux de M . Lombre ,ses fameux travaux ! son . hi stoi re de Pér i clès ! Qu ’ est-ce quec etai t donc que ce Pér i clès ? Je ne me le rappe lle plus b i enMademoiselle .
—Un grec cé lèbre , répondit M lle Maroi s , non sans unecertaine hési tation .
— Il y a longtemps qu ’
i l est mort ?— Oh ! plusi eurs si èc le avant notre ère .
— Quel dommage que M . Lombre n ’ait pas vécu de Sontemps !
— Pourquoi cela ?Mais parce qu ’
i l aurai t en des documents plus certainspour écrire son hi stoi re
,r iposta la folle enfant , et puis parce
qu i’ l serai t mort depui s longtemps comme son héros et quenous serions privées de l ’honneur de vivre avec lui .Oh
,Jeanne ! Pourquoi détestez -vous tant ce pauvre M .
Lombre ?— Je ne le déteste pas . I l m ’
hor r ipi le ,voi là tout ! E st
ce que c ’est français,Mademoi sel le “ horripi ler” ?
— R igoureusement,oui . .mai s ce n ’ est pas du style noble .
Ca ,j e m ’ en moque . j e sui s une bourgeoi se . E s t-ce
qu horripi ler prend un h ?Oui .Eh b i en ! ce Mons i eur Lombre m ’
horr i pi le avec un h .
Cela fut dit avec une m im ique '
s i drôle que M l le Marois neput s ’empêcher de rire ; au fond du reste , e lle pensait exactement comme Jeanne et ne pouvait pas souff rir le précepteur ,pédant , vaniteux , qui la traitai t de fort haut et comme unepersonne sans conséquence .
— Mai s quelles rai sons , repri t-e lle avec une apparentesévérité revenue
,d ’ en vouloi r ainsi a M . Lombre ?
— Oh ! J ’ en ai des foules . D ’abord i l s ’appel le Casimi rCasimi r Lombre . Je vous demande un peu ! Quand on a
pour nom Lombre , on ne s ’appelle pas Casimi r . Mai s cen
’ est pas ma raison principale .
— En e ff et , elle ne serai t pas bien sérieuse .
—Ce que j e lui reproche de beaucoup plus grave,c ’ est
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 69
d etre bou ffi d ’
orguei l , plein de lui-même et d ’
avoir le cœursec comme un morceau de pi erre .
— Et d ’où ti rez -vous , grande psychologue , vos affirmationss i pos itives ?
— Ne vous moquez pas de moi , Mademo i se lle . Je ne suis n ipeti te
, n i grande psy…psycho . enfin,ce que vous avez
di t ! Je sui s très en l ’air , c ’ est vrai ; mai s’observe tout de
même,allez ! sans qu ’on s ’ en doute
,et j e sais bien ,
a partm oi , fai re mes petites réflexions . Eh bien ! j ’ai observé queM . Casimir Lombre . que l nom ne prononce pas deuxphrases sans dire : moi , j e . Moi ! pour lui , tout est l ‘a .
Dites-lui qu ’ i l a fai t.une averse et que vous avez été mouillée .
Au lieu de s ’
api toyer sur votre sort , tout aussi tôt il vous répondra : Moi
,j ’avai s un parapluie . R acontez -lui que vous
avez mal a la tête . moi,j e vai s très bien ! Moi ! toujours
moi ! . Cela suffit pour coter un homme . L ’autre jour ,quand i l s ’ est absenté pendant vingt-quatre heures avec papaet Henry . j e suis entrée dans sa chambre avec Fannypour mesurer les rideaux . Voyons ! Dans votre chambrevous avez les photographies de ceux que vous aimez
,n ’ est
ce pas ? Il semb le qu ’
i l soit bon d ’avoir ainsi près de soi leportrait des êtres chers . Moi
,j ’ai papa
,ma pauvre maman
,
mon frère Henry , vous , ma bonne demoise lle , que j ’aimeb i en , quoique . je vous fasse souvent enrager . M . Lombrea sept portraits . Tous de lui-même
,de l ’unique
,du grand
Casimi r . Casimi r sur la cheminée,sur la console
,sur les
murs ! Casimir les yeux inspirés,les cheveux au vent
,pen
sant probab lement a Pér i clès . Casimi r en uniforme decol légi en . Cas imir de face
,de profi l
,de tros quarts
,avec
sa barbe , sans barbe . Cas im i r partout . Voi là pourquoij e n ’aime pas Casimir . Un homme qui se gobe autant queça , n
’en faut plus— Jeanne ! Jeanne ! fit vivement l ’ i n sti tutr ice enchantéede trouver un prétexte pour ne pas témoigner son approba
tion,quand donc vous déferez -vous de vos vilaines habi tudes
et parlerez-vous correctement ?— Je pense correctement , c
’est l ’essentie l,riposta Jeanne
avec qui i l était di ffici le d ’avo i r le derni er mot . Enfin lamsons ce Monsi eur où il est . Qu ’est-ce que nous allons faireaujourd ’hui pour notre premi er jour de vacances ? Car jesuppose bien que n i vous ni mon père ne pousserez la cruauté
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
jusqu a me forcer a fai re des études\
de syntaxe pour monpremier jour de congé .
Ce fut M . Vivi ers qui répondi t à la question de sa fi lle enentrant dans la salle d ’études . Jeari n e ne lui gardai t sansdoute pas rancune de sa décision au suj et des devoi rs devacances
,car légère comme une gazelle
,e l le bondi t vers lui
et , l’
en laçan t de ses deux bras ,l’
embras sa a pleine bouche .
— J e vi ens savoir,dit-i l comment on se porte dans l
e
quart i er des femmes . Ce matin,au saut du li t
, j’
ai dû merendre a Lyon
,au magasin
,et j e n ’ai pas vou lu attendre au
déjeuner pour te di re bonjour .R i en qu a la mani ère dont il couvait sa fi l le des yeux en
lui adressant ces simples paro les,on comprenai t l ’ immensité
de la tendresse de ce père,de même qu ’ il étai t faci le de devi
ner ce lle qu ’
i l recevai t de Jeanne,non seulement par son
j oyeux bai ser,mai s par la soumi ssion immédiate avec laque lle…
e lle s etai t inclinée devant la volonté,si dure qu ’ e lle fût
,de
M . Vivi ers pour les devoirs de vacances .I l prit une chaise et se m i t a deviser gaîment de choses et
autres . Le babil musi cal de sa fi lle,ses j ets d ’ espri t parfois
si drôles , dans leur impétuosi té spontanée , étaient le mei lleur ,le seul délassement que connût ce grand industrie l absorbétout le jour dans un incessant labeur .M . Vivi ers , parti de bas , étai t arrivé , j eune encore , a
une situation considérable dans la fabri cation des éto ff es desoi e . Il avai t débuté jadis comme ouvr i er . Soutenu par . untravai l courageux et probe
,aidé par une intelligence supé
r ieure, servi aussi par des ci rconstances heureuses , il étai t
monté d ’éche lon en échelon . Le s imple canut d ’autrefoisavait fin i par pouvoi r
,a force d economi es
,acheter en propre
un méti er Jacquard , pui s deux , pui s trois , et travai ller pourson compte
,en employant même deux de ses anci ens cama
rades,artisans comme lu i . L ibre maintenant de suivre son
inspiration,ple in d ’ idées neuves et originales , il composa ,
en art iste véritab le , d ’
étonnan ts brochages où se dessinai ent ,par un jeu hab i le de soies , des bouquets de fleurs d ’unefinesse et d ’un goût exqui s .
Si petit qu ’ i l fût encore,il exposa , en 1 878 , des étoff es
merveil leuses , dont i l avait inventé le dessin et fait lui mêmele tissage
,qui firent révolution dans les procédés us ités . On
fut tout étonné de voir ce nom nouveau surgi r au milieu desgrands noms de l ’ industrie lyonnaise , et a l ’admiration très
Revue des faits et des œuvres
Ant ia lcoo l isme Ce que bo ivent
les s avant s , les é c r iva ins , le s a rt i s t es
La croisade entreprise dans la province de Québec contrel ’alcoolisme
,croisade qui a déj à enrôl é parmi ses apôtres les
plus dévoués,les têtes dirigeantes de la soci ét é
,médecins
,
membres du barreau ou de la magistrature,donne de l ’actua
lit é aun travail tout récent auquel s ’est livr ée une publicationfrançaise tr ès haute cot ée .Ce n ’est pas tout d ’enseigner au peuple qu ’il ne doit point
faire usage d ’alcool ou de boissons alcoolis ées . La sagessede ce conseil deviendra beaucoup plus manifeste à son esprit
,
sa raison se laissera plus facilement convaincre,si
,à côt é
des préceptes moraux qu ’on lui cite,on met en même temps
sous ses yeux l ’exemple,combien plus éloquent
,des grands
citoyens qu ’il admire et respecte déj à et qui mettent à profitet en pratique les enseignements qu ’on lui donne. C ’estainsi qu ’un confrère français nous apporte une gerbe de cesexemples que nous offrons comm e la preuve mise en action dubien fondé de tout ce qui a ét é fait et dit pour la cause de latempérance en notre pays .La R evue de Paris (1 ) s
’est inqui ét ée de découvrir quelusage on faisait ’de l ’alcool
,ou des boissons capiteuses dans
le monde de la pensée ou de l ’art . Les écrivains,a—t — elle
demandé,au
_ cours d’une enquête qui restera fameuse
,les
grands artistes,les savants
,demandent—ils aux boissons ca
piteuses,l’
hallucination qui leur inspire le chef—d ’œuvre
comme la force qui leur permet de le r éaliser . C ’est un préjugé di fficilement déracinable que celui— ci innombrablessont les honnêtes citoyens qui croient que Shakespeare a écritses drames dans les tavernes
,que R embrandt peignait dans les
cabarets et qu’Al f red de Musset n ’a commenc é a avoir du talent
que lorsqu ’il a ét é int égralement imbib é d’
abs inthe.
”
L ’enquête de la “R evue est nettement hostile à toute
boisson alcoolis ée . Voici le resumé des opinions principalesqui ont ét é recueillies :Pour M . BERTHELOT
,l ’alcool ne doit j amais entrer dans un
r égime régulier la boisson ordinaire du savant était l ’eau
LA REVUE FRANCO -AM ÉRICAINE 73
rougie— trois parties d ’eau et une partie de vin,il aj outait
au d îner,après le potage
,un petit verre de Bordeaux vieux .
M . SA INT SAENS,préfère l ’eau à toute boisson . Si
,dit— i l
,
j e pouvais avoir de la vraie eau de source,bien pure et bien
fraîche,j e la préférerais a toute autre boisson .
”— M. CLARETIE
ne travaille j amais mieux que lorsqu ’il est à j eun .
M . ERNEST HEBERT , donne la réponse cur ieuse que voiciLe vin
,di t-il
,la bi ère
,le cognac
,donnent une animation
passagère à la pensée,bientôt suivie d ’une dépression para
lysante en raison directe du degr é d’excitation obtenu par les
boissons alcoolis ées . Je bois de l ’eau,et j e m ’en trouve bien .
M . FLAMMAR ION,ne travaille utilement au point de vue
de la composition,que le matin de huit heures amidi
,après
son premier déj euner,pris sans boisson avec deux œufs à. la
coque .CAROLUS DURAN
, ne boit gu ère que de l’eau .
SULLY PRUDHOMME,buvait de l ’eau mélangée de jus de citron .
JULES LEMA ITRE,ne boit que de l ’eau il a gagné
,dit— i l
,
à ce régime,un appétit tr ès r égulier . HENR I LAVEDAN con
sidère l ’alcool comme la pire des boissons ; couramment,
dit— i l,j e ne bois que de l ’eau
,glac ée si possible . VICTOR IEN
SARDOU ne peut pas supporter un demi— verre d ’eau—de—vieen revanche
,il est buveur de café trois fois par j our . MAU
R ICE BARRES A mon avis,pour bien travailler
,il ne faut
pas de stimulant il faut la possession paisible de soi—même .L ’idéal
,c ’est une belle nature
,avec les fenêtres ouvertes à. la
campagne . Jamais,j amais d ’alcool .”
M . D E FREYCINET a fait usage toute sa vie d ’eau rougieMistral rappelle le di cton provençal l
’
eau fai t deven i r j oli samère
,morte à quatre—vingts ans pass é
,ne buvait que de l ’eau ;
pour lui il boit du vin trempé d ’eau aux deux tiers . Pour M .
PAUL BOURGET l ’alcool à si faible dose soit— i l pris et sous n ’importe quelle forme est un empêchement absolu au travail .M . EM ILE OLLIV IER J’ai ét é toute ma vie un buveur d ’eau
,
ma femme et mes enfants ont suivi mon exemple . EUGENECARR IERE ne croyait pas à l ’alcool
,le travail ne peut être que
le r ésultat d ’équilibre moral,rien ne vaut les heures de clair
voyance du matin qui suivent les veill ées paisibles . MmeDAN IEL—LESUEUR ne boit que de l ’eau . M . PIERRE LOTI :Je suis aux trois quarts musulman
,j e ne bois j amais d ’alcool
,
j e ne bois même pas de vin .
” BENJAM IN CONSTANT buvaitdu thé de préférence . REYER ne boit que de l ’eau rougieVictor MARGUERITTE boit de l ’eau généralement il r ésume
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
ainsi son opinion :“ l ’eau lave et désalt èrê,levin tonifie
,l’
alcoolætuef
Les partisans du vin sont la minorit é M . D E VOGUE estprésident des Agriculteurs de France La France
,dit— i l
,
e st le pays qui a donné au monde,depuis longtemps
,le plus
de vin et le meilleur ceux qui en usaient ont donné à cemême monde la plus forte
,la plus riche des litt ératures mo
dernes ., Cela me parait r épondre a votre question .
”— AU
GUSTE ROB IN estime que le vin est une excellente chose .JEAN R IOHEPIN En mangeant
,j e bois du vin l ’alcool peut
exciter comme un coup de fouet . — R OLL Ce que j e boismais du vin
,de la bi ère
,de l ’eau
,au gré de ma fantaisie qui ne
se plierait à aucune exigence .” —DAGNAN—BOUV ERET Trèsindiff éremment
,j e bois du vin
,de la bi ère ou de l ’eau
,sans
avoir j amais pu constater si cela m ’
aidai t ou me gênait .”Arrêtant la leur enquête
,les auteurs de l ’article terminent
en reconnaissant qu ’il y a eu cependant deux hommes dontl’
œuvre a ét é effectu ée sous l ’influence du poison de l ’alcool .Mais l ’exception confirme la r ègle
,disent— ils . En l ’espèce
,
elle la confirme d ’une manière assez funeste . Ces deux hommes ont eu une vi e peu enviable
,et ils sont morts j eunes et
tristement . L ’un d ’eux est Hoffmann l ’autre est Edgar Poë .
D ’abord magistrat et musicien,Hoffmann ne commença à
é crire qu ’après sa trenti ème année . S’inspi rant du mesm é
risme,il évoquait dans le délire de l ’ivresse des personnages
“ fantastiques qui rappellent les prouesses des hypnotiseurs contemporains . Il passait toutes ses nui ts au cabaret
,et si ce
genre d ’existence profita a son talent,l ’existence fut brève et
le talent plus bref encore .“ L ’esprit d’Hoffmann s
’
obscurci t promptement . Les derniers ouvrages du conteur sont loin de valoir les premiers .Hitzig
,son écuyer de gloire
,l’
averti ssait qu ’il devenait nuageuxet m orue.
Edgard Poe dut à l ’alcool des visions et des terreurs dontsa litt érature est profondément impressionnée . Il connaissaitle vertige moral qui force à accomplir un acte que l ’on réprouve
,
Il le décrit dans le D émon de la perver s i té et il retrace , dansle Chat Nai r
,les impulsions irrésistibles de l ’alcoolique. D ’au
tres de ses contes rappellent les hallucinations du buveur .La plupart de ses chef—d’
œuvres ont été créés entre deuxcrises de deli r i um tremens
,chefs-d ’
œuvre étranges,certes .
Poé a dit que l ’étranget é était la beauté , et il a ét é un poètebeau
,quoique étrange . Il y a donc eu deux génies alcooli
q ues . Nous n ’en connaissons pas un de plus .”
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 75
”
L’
Ac t ion Soc ia le Cat ho l ique
e t s on j ourna l
L ’ œuvre qui , depui s quelques mois a surtout attir é l’atten
tion des canadiens— français,au Canada et aux Etats—Unis ,
c ’est la fondation à Québec,par Sa Grandeur Mgr Bégin , de
l’Œuvre de l
’Action Sociale Catholique et du j ournal quotidien
qui en est l’organe . C ’est une réponse admirable aux appels
d e Pie X qui veut que l ’action catholique s ’organ ise ets ’exerce vigoureusement dans tous les pays .” Chez nous ,dont la foi catholique est la première des traditions nationales ,c ’est le commencement d ’une ère où s
’
exercera plus activeet plus pratique la co— opération des la1 ques et des religieuxpour la sauvegarde des int érêts de l ’Egli se. Fonder cette oeuvrec ’était envisager hardîment l ’aveni r
,tout en se rendant compte
des dangers qui,pour ne pas être reconnus encore comme im
médiats par plusieurs,n ’en menacent pas moins notre soci ét é
canadienne dans ses oeuvres vives . Aussi le premi er actede cette œuvre de l ’Action Sociale Catholique
,la fondation
du j our nal quotidien,fut— i l accueilli avec la plus vive satis
faction dans toute la province et fut— i l,dès ses commence
ments,l ’obj et d ’une sa ction pontificale (Bref de Pie X ,
27“mai Depuis
,le j ournal a reçu l ’encouragement public
de sa Grandeur Mgr l ’archevêque de Montréal,et il peut déj à
compte sur l ’appui unanime d e l ’épi soopat canadien. .
Sans doute,l ’œuvre de la presse catholique n ’était pas tout
.à- fait inconnue parmi les Canadiens— français . Mais les pub licat ion s
,nombreuses il est vrai
,qui faisaient déjà, et depuis
longtemps , une lutte vraiment digne d ’ éloges pour les principes en mati ère de morale , d
’éducation,de droit chrétien
,
ne s’
adressaien t-ils encore qu’
à un petit nombre de lecteurs .Il fallait à l ’ œuvre nouvelle le concours n écesai re du j ournalq uotidi en , de cet ami qu ’on retrouve à tous les foyers et quinous fournit , avec la récréation du soir , la saine informationet l ’écho du bien à travers le monde .Et il s ’agit ici plutôt d ’une œuvre de préservation . Nousne pensons pas
,dit Mgr Bégin
,qu ’il faille attendre que l ’on
monte violemm ent à l ’assaut des esprits pour organiser ici”
les œuvres de défense ." L’
Acti on Soci ale Catholi que consacrera la r éunion de toutes les énergies dan s le bien , le r éveildes esprits à l ’int érêt du mouvement social chrétien dans l ’univers , le sentiment , chez les catholiques , de la supériorit é dese nseignements de l ’Egli se , même en mati ère de libre discus
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
sion,et le désir de faire prévaloir cet enseignement parce que
le meilleur et le plus sûr . Ce sera la formation d ’un peuplecatholique averti contre lequel s ’acharneront en vain les doctrines subversives qui
,chez tant de peuples ont tari
,par l ’aban
don de l ’id ée religieuse,la source de la paix sociale et de la
véritable grandeur ce sera le maintien dans l ’âme de notrepeuple
,d ’essence latine
, de l’id éal qui a port é les races chr é
tiennes jusqu ’aux plus hauts sommets de la gloire et qui estun idéal catholique .Le programme de l ’Acti on Soci ale Catholi que, de Québeccomprendra deux parties distinctes1 . L ’
en sei gnemen t dont les obj ets principaux seront de développer le sens catholique , faire l ’éducation de la consciencesociale catholique
,étudier les questions sociales
,etc .
,au
moyen de cercles d ’étude,conférences
,congrès
,et par la presse»
2. L’
acti on par les associations religieuses,d ’hygi ène morale
,
de bienfaisance,ouvri ères
,professionnelles
,etc .
Ce programme est vaste sans doute ; il faudra plusieursannées de travail et de z èle pers évérant pour réaliser danstoute sa mesure le rêve caressé par ceux— l à mêmes qui en onttrac é les lignes . Mais il a l ’avantage de s ’adresser à. un peupleneuf
,conscient de ses devoirs et de sa mission
,habitué a rece
voir de ses directeurs religieux les conseils qui sauvent et qui ,à plusieurs époques de son histoire , lui ont permis de traverserles crises les plus s érieuses et de conserver intact pendanttrois si ècles le dépôt sacr é de ses traditions et de sa foi .Un penseur français a dit avec raison Pour qu ’une na
tion chrétienne soit florissante,. la condition indispensable
est qu ’elle r éalise l ’id éal chr étien pour lequel elle a ét é conçue ,qui a présidé à son développement
,qui lui a donné ses lois ,
ses institutions,en un m et
,sa civi lisation tout enti ère . Ce
n ’est j amais en dehors de ses traditions qu ’il faut chercherla grandeur d ’une nationC ’est dans la poursuite de cet idéal chr étien que le peuple
canadien— français a grandi,qu ’il s ’est développé . Jusque
dans ses heures les plus difficiles,et alors que l ’horizon lui
apparaissait le plus sombre,il n ’a pas cess é de reconnaître dans
son idéal religieux la colonne de feu guidant ses pas vers laterre promise .
L ’œuvre dont on vient de le doter,et qu ’il accueille avec une
sorte de pi ét é patriotique,n ’est qu ’
une nouvelle manifestation de sa vitalit é et de son énergie dans le bien .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 77
Un proj et vi ce-roya l.L
’
Ange de la Pa ix et les
P la ines d’
Abraham
Il est ce1 taines faveurs que , même si elles partent de haut ,«etËpeut être à. cause de cela , vous acceptez avec la m êm é
ango i sse que si elles vous appœ taient un message de malheur .Vous les subissez en silence,du moins avec autant de bonne
grâce que possible , tandis que , dans votre for int érieur , vousê tes tent és de maudire le sort qui s ’acharne a vous vouloirtant de bien .
”Et tout ceci est dû a ce que pour certains
tempéramments , l’histoire et la tradition n ’ont plus ce mérite
de garder pieusement hors de toute atteinte les rares j ardinss ecrets où les peuples
,tout aussi bien que les individus
,
a iment à cultiver discrètement quelques fleurs du pass é,les
s ouvenirs tendres des prem iers âges et des premi ères gloires .C
’est qu ’on ne se rappelle pas assez souvent le mot de MussetLes morts dorment en paix dans le sein de la terre— ainsi
doivent dormir nos sentiments éteints .” C ’est pour cela aussique nous voyons des amiti és nouvelles , escomptant tr ès imprudemment des liens qui
,sans cela seraient solidement ci
m ent és,trouver j usque dans leurs débordantes manifestations
de sympathie,le moyen de faire saigner des plaies que le temp
achevait de cicatriser .Après tout
,certains rapprochements
,surtout lorsque se
s ont, des rapprochements historiques , ne peuvent être faitsqu ’avec d’
infin ies précautions , tandis que d’autres
,il ne fau
drait seulement pas songer à les faire . On le comprend biendans la province de Québec depuis le j our , où de par la faveurvice— royale
,le troisièm e centenaire de la fondation de Québec est
en train de devenir ce qu ’un j ournaliste à fort bien appel él’
apothéose de la conquête .”Que l ’id ée soit fort louable de vouloir conserver les champs
de bataille des Plaines d’Abraham et de Ste Foye
,il n ’en
reste pas moins vrai que l ’occasion choisie pour l ’inauguration de ce champ sacr é en un parc national est fort mal choisie
,
et que le mode dont on veut mener cette entreprise a bonnefin est plus mal choisi encore . —Et , au point de vue de l ’hi stoi re
,ce proj et qui coûtera des millions ne vaudra pas l a pens éegénéreuse qui a déj à réuni sur le socle d ’un même monumentles deux noms héroïques de Wolfe et de Montcalm . De plus
,
le troisième centenaire de Québee,en dépit des meilleures volont és , ne peut évoquer , n
’
évoque pas une id ée sœur de l’id ée qui
est rest ée attachée au souvenir sanglant des Plaines et de
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
Ste Foye . Malgré tout,et en dépit de tout ce que l ’on pourra .
faire et dire,associer le souvenir de Wolfe a celui du troi sième
centenaire de Québec,c ’est pour ceux qui le veulent
,tenter la
.
conquête du passé historique après avoir conquis le sol ets ’être emparé du présent . Même au milieu des plus brillautes solennit és
,dans tout le déploiement militaire que l ’on
prépare,sous les yeux mêmes du Prince de Galles
,rien n
’
empêchera les anglais de ne pas voir autre chose que Wolfe è scaladant le Foulon et victorieux jusque dans la mort tandisque rien non plus n ’
empêchera les Canadiens— français de voirsurtout
,dans ce tableau subitement j et é devant leurs yeux
,
Montcalm accourant de Beauport pour sauver Québec etpayant de sa vie ce suprême effort tenté pour garder la Nouvelle—France puis à Ste Foye
,la pensée canadi enne— française
n’
évoquera encore que le souvenir de l’
immortel Lévis tentantinutilement la revanche et
,irréductible
,brûlant ses drapeaux
plutôt que de les rendre . Et à cette occasion,anglais et fran
çai s n’auront pas tort . Chacun admire dans l ’histoire les
pages et les héros qui r éunissent le mieux sa pensée et sesaffections . Les anglais préfèrent Azincourt , et les Français , .
Fontenoy .
Aussi,l ’impression causée parmi les canadiens—français
,par
le proj et de Lord Grey qui veut int éresser tout l ’empire a cequ ’on appelle déj à d ’une façon fort tapageuse le “ Parc desBatailles
,a— t— elle ét é plutôt pénible . Et elle s ’est mani
f est ée au moment où le Parlement fédéral , à la demande deSir Wilfrid Laurier
,attribuait une somme de pour
les fêtes du troisi ème centenaire et l ’entretien des Champsde bataille des Plaines d’
Abraham et de Ste . Foxe . Tout lemonde aperçut la tournure très nettement anglaise que prenait l ’organisation . C ’est alors que l ’on commença de s ’inquieter et que H . Omer Heroux posa car ém ent la question
,
dans la Vérit é en disantNous n ’avons point perdu l ’espoir d entendre un déput é
canadien—français dire tout haut ce que tant de gens pense 1 ttout bas
,affirmer que c ’est bien Champlain que l ’on fêtera .
cet ét é et non point les préludes de la domination anglaise ,et remettre au point les théories que l ’on prône depuis quelques semaines
,à propos de paix et d ’entente cordi ale .
L’
Ange de la Paix dominera L OS champs de batailledisons donc une bonne fois quelle paix règne dans ce pays etque nous n ’en sOmm es pas encore r éduits à. baiser la mainqui nous frappe . Dans tout l ’Ouest , découvert par nos ' aïeux
,
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
à y reporter l ’attention . Aussi,quels noms furent j amais
plus dignes d ’être r éunis dans une c él ébration historique,
que ceux de Laval et de Champlain ! Ils r ésument à euxseul s l ’idée patriotique et religieuse qui présida sur ce continent a la naissance et au développement de notre race dontils sont
,presque au même titre
,les immortels fondateurs .
Du reste,il suffit de se rappeler le sentiment de vénération
nationale qui s ’attache à ces fêtes (elles auront lieu les 23 et24 j uin
, ) au motif qui les a fait nai tre , à l ’élan de générosit équ ’elles ont pr évoqué parmi tous les fils de la Nouvelle—France
,
pour se convaincre de leur importance . Le monument quisera dévoil é c ’est a une souscription nationale que nous ledevons
,et a son dévoilement
,on sentira qu ’avec le grand
nom consacré par ce marbre et ce bronze,une idée
,où chaque
canadien— français aura mis un peu de son cœur,s’
épanoui t
après une germination de trois si ècles,s’
élançant , féconde etpure
,vers de nouveaux espoirs . Pour le moment
,d ’autres
proj ets,représentant d ’autres id ées
,sont en train d ’atti rer
l ’attention ai lleurs,mais les fêtes du 23 et du 24 j uin ont pris
dans les âmes une place choisie — qu’on songerait en vain àleur ravir . Elles constitueront vraiment un événement p ourtous ceux qui croi ent encore qu ’avec les dates décisives
,l ’bis
toire des peuples ne recommence pas mais continue . A ceuxlà mêmes qui veulent façonner l ’histoire aux besoins d ’unrêve impérialiste
,elle rappellera que les traditions nationales
sont choses sacrées et que les vainqueurs doivent s ’y arrêtercomme on s ’arrête avec respect sur le seuil d ’un temple . C ’esten vain qu ’on tenterait de leur subst ituer des idéaux plus neufs .
Sans cela il faudrait cesser de croire que l ’histoire est lamémoire du monde .”
Lé on Kemne r.
L’
I L L U S T R A T IO NSupplément de La Revue Fmum —Américaine
Première Année , No. 2. l er Mai 1 908 .
PerSOnnages en vue
Mgr L. N. BEGIN, archevêque de Québec
HON . L . R .
_
ROY , HON . JULES ALL ARD ,Min i s tre de
Sec réta 1 re de la prov 1 n ce de Quebec . l’
Agri culture de la provin ce de Québec.
R NAPOLEON,CAS
'
AULT ,
'
ex-Juge-e -Pr0
chef de là‘
COür ;Supé rîeure , prés ident dela Com
‘
m ission de R évis ion des Statuts
de la province de Québec . tuts de la p rovince de Québec.
HON , J , B . B , PREVOST , ex—m in is tre de M. L E D R . A . JOB IN,dep 1 té par le com té
la Colon i sat ion , député par le com té de de Québec-Est à l’
As semblée L égislaTerrebonne a l’Assem blé L égi s lat ive de t ive de Québec?
,échevin de la vi lle deQuébec . Québec .
FEL IX TURCOTTE,de la maison B . GARNEAU, Con sei ller L
'
s
lat i f pour la rovince deQuébec , che deNaz . Turcotte 0 1 e,de Québec la m ais on Pièrre Garneau F i ls .
M. NAF . LAVOIE ,In specteur de la, . M. LED R . AR f EUR ROUSSEAU ,
Pro
Banque Nationale, Québec .fesseu f à l ’Un ivers i té L aval , —à Québec.
LT .—COL . ROY ,
Comm andan t du d ist r ict M° S H_
ONE ,Agen t du chem in
fer du Pac i fique Canad i en et de paquem i l itai re de Québec , No . 7 . bots , à Québec ,
d M'
l'
e a 1 me et
Trésor ier'
de la vi lle de Qué bec .
R . P . LEMAY, archi te
‘
cte‘
, échev in M. L E
la vi lle de Québec .
La religmn et les assimilateurs dans laNouvelle Angleterre
La presse canadienn e-française a plusieurs fois apport é à la province de Québec l ’écho des luttes
,souvent tr ès
vi ves,soutenues aux Etats—Unis
,non seulement par nos com
patriotes Franco—Américains,mais encore par tous les groupes
catholiques dont la langue maternelle n ’est pas l ’anglais .Allemands
,polonais
,italiens
,portugais
,canadi ens— français
souffrent des mêmes abus de pouvoir,sont aux prises avec
les mêmes adversaires,r ésistent aux mêmes tentatives d ’ab
sorption . Dans la Nouvelle Angleterre,poser la question
comme nous venons de le faire dans le titre de cet article,
parler de la religion et des assimilateurs c ’est évoquerprincipalement l ’histoire du groupe franco— américain
,fort de
plus d ’un million,en même temps que signaler à l ’attention
du lecteur un état de choses dans l ’église américaine d ’uneinvraisemblance telle que plusieurs ont pendant longtempsrefus é d ’y croire . Certains événements plutôt r écents
,en
arrachant quelques masques et en mettant à nu certainesplaies
,ont posé la question en pleine lumi ère et sous son aspect
véritable,pour ceux qui veulent tuer les races comme pour
ceux qui prétendent les sauver .Personne ne doute auj ourd ’hui
,dans la Nouvelle—Angle
terre,que l ’épi scopat irlando—américain ne soit plus déterminé
que j amais auser de toute l ’influence de l ’Egli se pour amenerde force
,et à. br ève échéance
,la fusion de toutes les races
dans un él ément qui ne parlerait plus que la langue anglaise .Ce rêve fut caress é il y a cinquante ans et on sait quelles d écept ions cruelles il r éservait a ceux qui l
’ont fait . Il y a vingtcinq ans , certains prélats pr édisaient que de nos j ours il neserait plus question de langue française dans la NouvelleAngleterre aussi bien que dans tous les Etats—Unis . Commequestion de fait
,le français non seulement s ’est maintenu
mais encore s ’est développ é lamême où on pr édisait sa ruineet des évêques mêmes qui ne voyaient dans l ’él ément francoam ér ieain qu ’un él ément transitoire ont vu le nombre deparoisses franco-américaines se tripler dans leurs propresdioc èses
,et provoquer la formation de dioc èses nouveaux ;
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
ils ont pu constater davantage,ils ont p u voir que le groupe
franco—américain avait fourni tous les él éments de progrèscatholique du derni er quart de si ècle dans l ’Est des EtatsUnis où il devenait en même temps le plus solide pilier del’
Eglise.
Sans doute,tous n ’
envi sagent pas la situation des nôtresaux Etats—Unis sous cet aspect . Et il faudra
,longtemps
encore,invoquer l ’éloquence des chiffres et des faits avant de
parvenir à faire la lumi ère sur cette question . Ah ! par exemple, si l
’on consentait à la dégager des multiples intérêtsmatériels que l ’on y deguise soigneusement sous j e ne saisquelles th éories politico-religieuses
,si on se décidait un bon
j our à ne plus l ’envi sager qu’aux seuls points de vue des droits
stricts et de la justice indéni able,elle serait bien pr ès d ’être
tranch ée . Il est vrai que cela pourrait occasionner le d éplacement de certaines influences
,l’écroulement de certaines am
bitions,mais l ’Egli se n
’aurait qu’à se rejouir de tout cela ,
tout en b énissant son divin fondateur d ’avoir donné au mondeun nouvel exemple de sa sollicitude pour ceux qui observentsa loi et pratiquent ses enseignements .Mais
,nous l ’avons dit
,trop de consid érations sont ame
nées de l ’avant dans l ’étude de ce probl ème pour que nouspuissions en esp érer
’
a solution immédiate ou même prochaine .Nous ne sommes plus au temps où même dans la NouvelleAngleterre , les successeurs de Mgr de Cheverus pouvaientb énéficier du développement de leur propre nationalit é . Denos j ours
,les tenants de l ’am ér i can i sme assim ilateur s ’occu
pent surtout de conserver une influence qu ’ils sont prêts,au
besoin,à. maintenir contre toutes les évolutions
,et cela en
invoquant une sorte de patriotisme qu ’ils ont invent é et donton ne leur sait nullement gr é . L ’indépendance absolue desreligions
,voulue par la constitution américaine
,rend inutile
le z èle entr é que certaines sectes pourraient mettre à protégercertains idéaux . Nous verrons
,d ’ailleurs
,bientôt qu ’au fond
ce patriotisme dont quelques prélats irlando— américains fontparade n ’est pas touj ours tout aussi désint éressé qu ’on pourrait le croire .
Auparavant , nous allons noter le fait qu ’avec le tempscette question
,cessant d ’être locale et de se limiter à certains
diocèses,s ’est peu apeu‘ transport ée sur une sc ène plus grande .
De griefs en griefs,de pétitions en pétitions
,les Franco
Américains ont ét é poussés à. rechercher les décisions des tribunaux supérieurs de l ’Egli se. Ce furent d ’abord les catho
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
“ C ’est au nom des plus grands Intérêts de l ’Egli se que lesAm ér icani sants défendent à Rome leurs proj ets d ’assimilation .
Les gouvernants américains,disent—ils
,cherchent avant tout
la solution du suprême probl ème de la fusion des races . En
face de ces él éments d ivers que le vieux monde déverse sansarrêt au sein de la R épublique
,ils cherchent le facteur tout
puissant qui pourrait leur permettre de façonner un peuple .ayant la même âme
,la même mentalit é
,les mêmes mœurs .
Ce facteur suprême est demeur é jusqu ’ici introuvable . L ’Eglise
catholique seule,soutiennent les am éri cani sants
,pourrait
revendiquer l ’honneur d ’Opérer ce grand travail . Aussi bien
s i les hommes d’Etat américains découvraient en elle la puis
sance d ’assimilation et de cohésion,qui oserait prévoir tous
les progrès,toutes les grandes choses que l ’Egli se catholique
pourrait alors accomplir,libre de tonte entrave
,secondée
même par la faveur toute—puissante des pouvoirs publics ?Et pour atteindre ce but que faudrait— i l en somme que lesministres de l ’Egli se deviennent eux—mêmes des assim ilateur sà outrance Non pas
,on ne leur demande pas cette besogne
mais que les prêtres s ’occupent uni quement de leur mi ni st ère,
s ans s’imm i scer dans les coteries nationales s éparatistes
qu ’ils demeurent neutres,estimant que leur devoir
,après tout
,
ne leur impose que de sauvegarder la foi des leurs,et non de
compromettre l ’aveni r de l ’Egli se dans des luttes bruyantespour le maintien de nationalit és fatalement destinées à p érir .Si l
’Etat
,en effet
,que plusieurs années de luttes intestines
comm encent a émouvoir,découvre que l ’Egli se catholique ,
loin d ’être la puissance de cohésion qu ’elle se proclame,met
au contraire toute son énergie à. maintenir la distinction desraces et à prolonger la vie des nationalit és indépendantes
,
revêches a l ’esprit,aux mœurs américaines
,il est fort ement
à craindre que les politiques des Etats—Unis , se sentant travers és dans leur œuvre surtout par l ’Egli se, ne se retournentviolemment contre elle et ne recommencent l ’ère des pers éentions . On va même jusqu ’à mettre en avant les alarmes deshommes d’
Etat,regardant avec eff roi la propagation de la
race française dans les r égions voisines de Québec,et le secret
espoir que nous nourrissons de former un j our un état françai s indépendant .
A ceux qui osent rép éter encore que le maintien de lalangue est le meilleur garant du maintien de la foi
,on répond
qu’il en pouvait être ainsi
,il y a quarante ou cinquante ans
,
quand l’organisation religieuse n ’était pas même ébauchée
,
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 85
que le canadien ignorait à peu près compl ètement la langueanglaise
,mais qu ’il n ’en saurait plus être de même , main
tenant que le catholique est assur é de rencontrer partout unpasteur de sa religion et qu ’il n ’est plus personne qui ne soiten état d ’entendre l ’anglais
,apr ès quelques mois seulement
de séj our en Amérique .Aux id éalistes qui voudraient soutenir que l ’on ne de
mande apr ès tout le maintien des nationalit és que pour le plusgrand bien de la r épublique américaine
,la raison et l ’exp érience
prouvant qu ’un él ément perd touj ours de sa valeur en perdant sa nationalit é
,on répond encore que l ’assim ilation peut
être une source de dégénérescence là où elle se fait au profitd ’une race inférieure
,mais qu ’elle est
,au contraire
,un instru
ment de renfort et de rel èvement la où elle se fait au profitd ’une race sup érieure ou d ’une race qui peut revendiquerl ’égalit é de valeur . Le Canadien— français
,l ’allemand
,le pole
nais,ont tout a gagner au point de vue de leurs int érêts ma
t ér iels,a adopter
‘
au plus t ôt les robustes qualit és ethniquesd ’un peuple dont le progr ès
,
— i l faut bien modestement enconvenir— étonnent le monde
,surtout
,s ’ils veulent bientôt
lutter a armes égales,et s ’il veulent ne pas oublier que c ’est
attir és par le prestige de ce peuple qu ’ils ont quitt é leurspatries respectives .
Voi là,aussi fidèlement que j ’ai pu l ecr ire
,la thèse
des am ér i can i sants . Quels succ ès rencontre— t—elle dans le
monde officiel de l ’Egli se Je ne saurais lai —dessus rien affir
mer de précis . Seulement quand on a touch é de pr ès,apr ès
quelques mois de s éj our en Europe,l ’énorme prestige dont
j ouit partout le nom américain,quand on songe aux moyens
mat ériels que les chargés d ’affaires peuvent d éployer,et qu
’à
Rome , ainsi que dans toutes les chan celleries du monde , c esont les dél égu és de toutes sortes qui apportent la grossesomm e des renseignements on peut au moins conj ecturer qu ’ilfaut porter la guerre sur les points mêmes où l ’ennemi bataille .”
Cette lettre , écrite dans le mois d’août dernier
,nous rap
porte des impressions qui datent d’un peu plus loin . Elle
nous rappelle , en même temps , le prem ier exemple de l ’ingérenced ’un attach é américain à Rome dans les affaires de l ’Eglise.
Nous avons à peine besoin de rappeler la triste déconvenued ’un certain Mr . Bellamy Storer et de sa charmante épouse
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
qui s’étaient mis dans la tête d ’obtenir un chapeau de cardinal
pour le bouillant archevêque de St . Paul,Minn .
,Mgr Ireland .
Mr . Storer a—t — i l fait prévaloir auprès des cardinaux romainsla thèse que vient d ’exposer notre correspondant Nous nele savons pas . Ce que nous savons c
’est que M . Storer faisaitpartie du service diplomatique et qu ’il s ’y occupait d ’affairesreligieuses . La correspondance qu ’il échangea avec le pr és ident Roosevelt à ce suj et restera fameuse . Comme résultatfinal nous pourrons peut— être constater que les diplomatesam ér ican isants Ont fait plus tort à l ’Egli se avec cette seuleaffaire que s ’ils avaient favoris é la fondation de cinquanteéglises et de cinquante écoles franco-américaines auxquelles
,
soit dit en passant,personne ne s ’oppose
,aux Etats—Unis
,à
part quelques évêques catholiques irlando—américains . M .
Storer,a,depuis
,étal é ses sentiments aux côtés de l ’arche
vêque O’Connell dans des r éunions de soci ét és où l ’on trou
vait moyen d ’allier l ’id ée irlandaise à. l ’id ée américaine .Pendant les quelques années que nous avons pass ées aux
Etats—Unis,nous avons plus d ’une fois eu l ’occasion de causer
d e cette question franco—américaine avec des américains des ouche
,ém inents dans le commerce
,la politique ou l ’industrie .
Tous ont ét é unanimes à trouver étrange cette situation quiest faite aux nôtres dans leur organisati on religieuse tous
,
avec le sens de justice qui est un des traits caractéristiquesd e leur race
,ont franchement exprimé l ’opinion que même si tous
les Franco—Américains parlaient la langue anglaise,ils auraient
encore droit ades prêtres de même origine qu ’eux,et que rien
,
à leurs yeux,ne semble justifier cette prétention enracinée
en certains quartiers que l ’él ément irlandais doive avoir dansla Nouvelle Angleterre le monopole de la direction catholique .
Aussi bien,ils sont nombreux les exemples que nous pour
rions citer de hauts personnages se prononçant pour le maint ien des traditions nationales chez les groupes qui formentla nation…Une loi fédérale exige que pour devenir citoyenaméricain chaque individu sache parler et écrire convenablement l ’anglais . Cela leur suffit . Et si l ’on s ’inqui ète despreportions que prend le mouvement d ’immigration versles Etats
,c ’est qu ’on y voit surtout une menace pour l ’équi
libre économique du pays,la menace d ’une concurrence rui
neuse sur le marché du travail pour les enfants du sol,sans
c ompter le danger que cette immigration n’apporte dans lap ays un él ément social perturbateur . Et ici même
,on ne
.s e gène pas de reconnaître et de dire que,depui s sa venue aux
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
Du reste,on a essayé de cette fusion aux Etats—Unis et
parmi ceux— là mêmes qui la prêchent auj ourd ’hui . On aabouti à cette d éclaration de Mgr McFaul , ( 1 ) évêque deTrenton
,New Jersey
,qu ’il devrait y avoir de
catholiques aux Etats—Uni s . Or,il y en a environ
dont d’allemarids
,de polonais
,de canadiens— fran
cais et d’italien s . Où sont all és les autres Est— ce que
l ’immigration irlandaise n ’a encore fourni quede citoyens à la r épublique . Le Rev. Père Byrne (2) écrivaiten 1 873 que de son temps il y avait au moinsd
’irlandai s dans la r épublique américaine . Voilà certes
,
un point qu ’il faudra élucider un j our . Ce sera le meilleurargument à. apporter contre les théories des saxon isants .
Ce sera un r éveil terrible que celui des pasteurs reconnaissant qu ’ils ont détourné le troupeau du Ma ître des sentiersde la foi et du salut .
Pas plus aux Etats-Unis qu’ailleurs la vraie religion duChrist ne doit servir à l ’application de théories politico— écono
m iques . Même si on lui demandait de le faire,elle ne pour
; rait pas refuser de tendre sa main chargée de b énédictions,
et d ’ouvrir son cœur plein de tendresses éternelles,à. ceux
de ses enfants que la rage du si ècle poursuit et que blesse parfois encore l ’ambition secr ète de pasteurs aveugles .
J. L. K.-Laf lamme .
( 1 ) D i s cours pronon cé à St . L ou i s , Mo.,Etat s—Un i s
,devan t le Germ an
Cathol ic Cen tralverein ,le 1 1 sept . 1 904 . Voi r The Review ,” St . L ou i s
,
Mo . ,du 22 sept . 1 904 .
(2) Ir i sh Em igration to the Un ited States what i t has been and whati t i s
,par le Rev. Stephen Byrne , O . S .
’
D .—NewYork . The catholi c So
ciety 1 873.
Un beau et bon livre
L’
Indé pendance é conom ique du Canada f ranca is , Par Er rolBouchette
,Compagn i e d
’
Imprim er ie d’A r thabask a
,1 907
Voilà.un beau et bon livre,et en librairie depuis deux ans
déj àLe sort des écr ivains canadiens
,
— surtout ceux qui ont desid ées
,
— n ’est pas touj ours des plus envi ables .C ’est une monnaie dont le cours n ’est pas touj ours a la
hausse dans notre pays que les id ées,et ceux qui en sont por
teurs doivent être pourvus d ’une forte abnégation pour lescommuniquer au public sous la forme du livre .C ’est ce qu ’a fait M . Bouchette et j e ne comprendrais pas
le silence fait par la grande presse autour de ce livre,si j e ne la
connaissais assez pour savoir qu ’un livre s érieux,d ’une utilit é
aussi évidente que l ’ouvrage de M . Bouchette,ne méritera
j amais dans ses colonnes la r éclame barnumesque d ’unconcours du sac de sel ou des exploits de la brouette .Il y a peut— être une raison de plus
,c ’est que ce livre dit de
rudes et salutaires vérit és à. beaucoup de ceux—là mêmes quientret iennent nos grands j ournaux ou sont entretenus par eux .
L ’auteur avait d éj à publi é en articles dans la RevueCanadienne les différents chapitres de son livre il les ar éunis dans un j oli volume
,dont l ’excellente typographie
est dûe à une imprimerie d’Arthabaska
,prouvant qu ’on com
mence chez nous à respecter la toilette , si nécessaire pourtant ,de nos livres canadiens .
Le titre du livre m ’a tout de suite attir é,le nom de l ’au
teur m ’a retenu,et j ’aj outerai que l ’œuvre elle—même m ’
a
s éduit .M . Bouchette est un travailleur et un patriote ardent .
Dans son modeste bureau d ’assistant conservateur de la bibliothèque du par lement fédéral , il passe ses loisirs à chercher ,à. creuser
,n ’ayant qu
’un but,travailler a l a suprématie mo
rale,intellectuelle et mat érielle de sa race .Pour lui
,le moyen
,le seul
,d ’atteindre ce but est dans le
rel èvement économique du Canada—français . Le salut estdans la maîtrise par nos compatriotes de l ’industrie chez nous .C ’est ce qu ’il indique dans la premi ère partie de son livre
,et ce
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
qu ’il nous avait_lai ss é entrevoir dans cette pensée de Schulze
Gavernitz placée en tête de l ’ouvrageToutes les aspirations sociales sont st ériles sans le solide
fondement économi que des grandes industries puissantes etmarchant dans la voie du progr ès technique .”
Pour M . Bouchette,si notre race veut arriver à. se main
tenir non,à. vivre
,c’est par le développement de l ’indus
trie .La province de Québec occupe une
_ pos it ion unique à cepoint de vue dans la confédération
,et chaque groupe français
,
dans les autres provinces,se sentirait nécessairement de la
pr épondérance économique prise par la province—mère .Dans Québec
,les forces hydrauliques
,les mines
,les forêt s
et les autres richesses naturelles,avec ce grand chemin qui
marche,
” le Saint—Laurent,font à notre province un avenir
énorme,si nous savons secouer notre torpeur et entrer r éso
lûm ent’
dans la voie du progr ès industriel .Nous sommes la clef de voûte de la conf édération
,elle
se tient politiquement par nous,elle ne vivra que de nous
,si
nous le voulons bien .
La premi ère chose a faire,d ’apr ès M . Bouchette
,est
d ’améliorer notre syst ème d ’instruction ; pas tant que notresyst ème d ’éducation . Si j ’ai bien compris l ’écrivain et l ’économ i ste
,ce n ’est pas seulement a notre organisation scolaire
inférieure,mais surtout au défaut de suite et de fermet é
dans l ’application de la loi,que nous devons nos illettr és
,
et partant et plus encore le gaspillage du patrimoine ancestralet de la richesse nationale .
“La réforme pour être s érieuse,dit— i l avec M . Gér in
,
devra porter sur ces trois points les moyens d ’existencede la population
,la formation de la classe ouvri ère
,la forma
tion de la classe dirigeante .”Et comme il a raison ! Le défaut de formation est une
de nos plus menaçantes faiblesses,avec
,tout naturellement
,
cet impérieusement premier des besoins,vivre .
A tout cela M . Bouchette,indique un remède le dé
V é lOppement chez nous de l ’industrie .Couronner les Laurentides d ’usines
,voilà le but
,le r êve
demain la r éalit é et le salut .Et pour cela
,développer l ’instruction primaire et cr éer
l ’éducation être de son si ècle,c ’est—à—dire
,ne pas trop
se bercer aux songes du passé,et n ’avoir pas surtout le défaut
de cette qualit é essentiellement française,la logique . de
92 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
cessera d etre un fleuve de vie pour devenir un flot fatal charroyant à l ’océan tout le sol arable de Sa vall ée d
’
af freuses
tempêtes chargées de froidure achèveront de transformeren désert le pays dénudé qui ne pourra plus nourrir ses habitants . Voilà ce que nous r éserve l ’avenir , si nous dévastonsnos forêts . Elles s ’étendent au nord sur une superficie deplus de cinquante millions d ’acres au sud et dans les provincesmar itimes
,on en trouve encore plus de quat re millions d ’acres .
Au premier coup d ’œil et vues de loin,elles peuvent paraître
presqu’
intactes mais ce n ’est qu ’en apparence,du moins
dans tous les endroits accessibles . Le feu et la hache les amoindr i ssent incessamment . Quelque vastes qu ’elles paraissent,elles dispara îtront avant la génération qui grandit
,si nous
n ’y prenons garde .Que faut— i l donc faire Devons—nous renoncer à. les ex
ploiter et a défr i cher la terre pour des fins agricoles ? Pasdu tout
,l ’exploitation intelligente et honnête
,loin de nu i re
à la for êt lui est bienfaisante on peut s ’en convaincre enparcourant certaines exploitations particuli ères
,surtout les
bois qui appartiennent à. Sir Henri Joly de Lotbin i ère,ce vê
r itable ami de son pays . Dans son domaine,tr ès vaste pour
celui d ’un particulier,il pratique la coupe r égl ée
,et pour
chaque arbr e qui tombe , il en fait surgir de terre , en variantles essences
,dix
,vingt et cent . Ses gardes veillent nuit et
j our pour prot éger les massifs contre les incendies . Puissecet homme de bien faire école
,puissent tous les canadiens
s ’inspirer de ses sentiments . Appelons de nos vœux ce moment ou personne ne pourra diminuer la for êt sans encourirla r éprobation publique . N ’est— i l pas clair que celui qui ladétruit est un parricide coupable d ’une tentative contre l ’exi stence même de la patrie
Pour prot éger la for êt,la loi sera touj our s impuissante
sans le secours de l ’opinion publique . Quand celui qui couperaun arbre inutilement ou sans le remplacer sera tenu pour unignorant ou un imb écile , quand le d évastateur de la forêt seranot é d ’
in fam ie et montr é du doigt par ses concitoyens,quand
celui qui y mettra le feu passera pour un ali éné dangereuxdont on demandera l ’internement
,quand le t émoin d ’un de
de ces forfaits et ne le dénonçant pas sera jugé aussi coupableque l ’agent actif du cr ime
,alors seulement la loi cessera d ’être
une lettre morte pour devenir efficace et active .“ Ainsi donc
,si le mal doit continuer
,ne nous avisons pas
d ’en accuser les gouvernements qui sont nos mandataire s
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 93
et qui seront touj ours plus ou moins faits à notre image .S ’ils se montrent apathiques
,le mal vient de nous ; n
’attendons
pas que d ’autres fassent notre œuvre,car alors elle ne sera
peut— être j amais faite Ce n ’est que rarement qu ’il surgitparmi le peuple de ces âmes puissantes et droites
,assez clair
voyantes pour voir la vérit é et assez justes pou r l ’imposer .
”
Je dédie ces lignes à nos mi ni stres et à ceux qui disentquand il n ’y aura plus de bois on aura trouvé autre chosepour faire du papier .Je n ’ai pas pu r ésister au plaisir de citer toute la page
,elle est
vraie et M . Bouchette a bien mérit é pour l ’avoir dite,car un
homme politique di rait la même chose qu ’on ne l ’écouteraitpas et qu ’on lui attribuerait de faux motifs et des penséesde derri ère la tête .
M . Bouchette traite au long l ’exploitation de la forêtet l ’organi sation de l ’industrie foresti ère
,j e ne peux rien citer
de ces pages,car tous les mots sont dans la moelle et il faut
les lire .La conclusion du livre j e la trouve ici Le Canada ne
conservera son indépendance économique et son autonomiepolitique qu ’
à la condi tion de développer son industrie nationale
Le Canada français ne conservera sa place au soleil ques ’il sait maintenir sa popul ation nombreuse
,saine
,vigoureuse
et éclair ée . Pour cela il lui faut de toute nécessit é,s ’empa
rer de l ’industrie foresti ère,dont la nature semble lui avoir
pr épar é le monopole .”
C ’est cela, - et c ’est tout le livre r ésumé . L ’ouvrage deM . Bouchette est un livre qu ’on dévOre et qu ’on relit ensuiteà t ête reposée . Qu ’on s ’en p énètre bien il marque le cheminde l ’avenir et de la race , comme la colonne de feu aux Hébreux all ant vers la terre promi se .
Ce devrait être un ouvrage de chevet pour tous ceux quipensent un peu à la patrie de temps à autres .
La langue dans laquelle il est écrit, (nous n
’avons pasqualit é pour la juger) , nous a paru être sobre , simple et claire .Ces qualit és sont bien françaises comme l ’id ée qui a inspi r é lel ivre de M . Bouchette.
Armand Lavergne.
La puissance de l’
association et la faiblessedes classes laborieuses
Bien que la puissance de l ’association fût connue de laplus haute antiquit é
,comme le t émoignent les vestiges que
l ’on en retrouve dans l ’histoire de tous les peuples,cette force
,
cependant,fut touj ours plus ou moins contrar i ée ou annul ée
par les passions humaines,surtout par la j alousie engendrant
la crainte de voir son voisin b énéficier plus que soi de cettemême puissance . Se 'ntant sa faiblesse
,l ’homme éprouve
le besoin de s ’unir ason semblable pour tr iompher des obstacleset fortifier ses moyens d’action
,mais cet instinct si naturel
est en partie paralys é par l ’envie ou l ’individualisme,fruit
le plus souvent d ’une j alousie avouée ou inconsciente,qui le
porte a s’
i soler de peur qu ’un autre ne profite plus que lui desbienfaits dont il a pour tant sa part l égitime . Mais certainsbesoins ont vite fini par imposer l ’association
,d ’abord sur le
terrain politique propr ement dit,les individus se groupant
pour se prot éger contre les agressions ext ér ieures et s ’assurer,
par des moyens que la collectivit é seule pouvait utilisereffectivement
,l ’usage ou la conservation des fruits de leur
travail individuel en même temps que la vie et la libert é,
le plus pr écieux de tous les biens . Plus tard,cette première
conquête sur l ’envie qui isole,fut étendue à d ’autres domai
nes où l ’individu ne pouvait se pr émunir suffisamment contrecertaines éventualit és inexorables dans leur reproduction
,
mais incertaines quant a la p ériodicit é de leur manifestation .
C ’est ainsi que les accidents sur terr e et sur mer,la mort
même,
fir ent na ître l ’assurance ayant pour base l ’associationde ceux susceptibles d ’en être les victimes
,et pour obj et
d ’att énuer les conséquences parfois d ésastreuses de ces eventualit és . Mais même dans ces nouvelles modalit és de l ’espr itd
’associaton appara ît encore le vieil ég0 1 sm e sous la formede l ’actionnair e désireux de s ’enrichir aux dépens de ce mêmeespr it
,en faisant payer à l ’associ é le pr ix de son intervention .
En effet,a quoi bon l ’actionnaire dans l ’assurance connue
ailleurs,du reste
,quand c ’est le soci étaire qui est tout
,puisque
sans lui le premier ne songerait même pas à se grouper . Tel
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
vers une amélioration touj ours plus grande dans son bienêtre mat ériel et que ce genre d ’association est destiné a sesp écialiser
’
à certaines activit és économiques,ou à. di sparaître
peut— être graduellement,tout comme depuis cent ans l ’en
trepr i se individuelle recule de plus en plus dans bien des domaines , devant la force des collectivit és parce qu ’elle est uneforce sup érieure
,mieux outill ée
,plus énergiquement orga
ni s ée et , partant , plus’
en état d ’atteindre un but à la fingrandiose et avantageux .
Il va sans dire qu ’à. travers ces manifestations
,fondées
Sur un int érêt égoïste,de l ’esprit de l ’association
,d ’autres
activit és issues du même esprit,mais non plus animées des
mêmes tendances,se produisirent avec une certaine continuit é
,
et se d éveloppèrent même plus ou moins, grâce a la p ens ée
chr étienne d ’abord,puis a ce sentiu ent de fraternelle solidarit é
qui sommeille touj our s au fond du cœur de l ’homme . C ’estainsi que des associations n’ayant qu ’un but
,celui de faire
du bien a leurs membres,sans pour cela nuire à personne
,
en dépouillant autrui de ce qui lui appart enait l égitimement,
associations cherchant à protéger leur s adhérents sans pourcela sp éculer sur qui que ce soit
,soci ét és purement bienf ai
santes,ont presque de tout temps exist é sous divers noms
,
poursuivant des ob j ets vari és,mais surtout le secours en cas
d ’accident,de maladie et
,dans les cas de morts
,d ’aider
aux survivants cas de crise,en un mot
,où l ’individu isol é
est impuissant à se prot éger d ’une f açon efficace . Si ces sortesd e groupements de personnes
,les premiers en date
,ne se sont
pas développés , comme on serait port é de le croire , et n’ont
pas acquis une force comparable à ceux r éunissant les capit aux
,ou ne saurait
,sans se tromper
,en assigner la cause aune
faiblesse inhérente à la nature même de ces organismes . A
notre avis,cette insuffisance de développement est due au
manque de formation,à la mentalit é de ceux qui étaient
appel és par leur situation ou leur besoin à former ces organi smes et à les fort ifier par leur c oncours
,mentalit é obscurcie
encore par le malheureux égoïsme dont nous retrouvonsp art out la trace et par une invincible défiance . Nous croyonsavoir la preuve de la j ustesse de cette opinion, dans ce qui sepasse de nos j ours parmi les couches sociales les plus humbles .Ne voyons—nous pas , depuis plus d ’un demi si ècle , les classeslaborieuses
,plus éclair ées
,mieux renseignées et
,partant
,j ouissant d ’une mentalit é plus élargie où l ’égoïsme fait placeà de généreux sentiments
,où la défiance recule devant la
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 97
confiance,se grouper beaucoup plus qu ’
autref oi s,comprendre
davantage qu ’il est de leur int ér êt de s ’un ir afin de fortifierleur faiblesse
,et cr éer même une vér itable puissance par d ’im
posautes collectivit és .Leur reprochera—t-ou ,
à ces classes laborieuses , d’avoir
fait fausse route en b ien des cas,de ne pas avoir dirig é leurs
énergies de mani ère à en r ecueillir des fruits durables sur leterrain économique
,d ’avoir us é des forces nouvelles Qu
’elless ’étaient acquises en des luttes st ériles souvent d ésas treusespour leurs p lus cher s int ér êts , que l on pourrait r épondreque ces erreurs
,
— fussent-elles aussi r éelles et aussi grandesqu ’on le pr étend
,
— sont la r ésultante inévi table du manquede formation que c ’est au contact des faits
,des exp ér iences
r ép ét ées que la,comme ailleurs
,du reste
,les jugements se
rect ifient,la clair e—vue s
’
élabore et que l ’on finit par avoirune conception nette des meilleurs moyens d ’atteindre lebut désir é . Les mêmes errements
,les mêmes extravagances
,
les mêmes illusions et les mêmes déceptions se sont— i lsproduits d ’une autre façon dans le monde de la hautefinance et des associations à base capitaliste ? Qu’il suffisede rappeler en passant le r égime de Law
,en F rance
,au
temps où commençaient à peindre les soci ét és par actions,
pour démontrer que la perfection ne s’acquier t pas du pre
mier coup,si jamais on peut y atteindre ici-bas . Et pourtant
,
les nombreux désastres que le r égime capitaliste de la soci ét épar action a s ém és et s ème encore de nos j ours n ’ont pas
,que
nous saclrions,suggér é à personne la suppression totale et
définitive de ce mode d ’association pour en reveni r à l ’ancienindividualisme .
Aj outerait-ou que l ’ignorance,la fraude et la malhon
uêtet é pourraient vi cier les organi smes populaires que lesclasses laborieuses cr éeraient pour satisfaire à des besoinsautres que ceux pr évus par les soci étés mutuelles existantes
,
que nous r épondr ions que ces mêmes tares ravagent assezl es organi sations à bases capitalistes pour ôter toute envi e designaler cette appr éhens ion connue un motif su ffisant derefuser l ’existence et la libert é aux premiers . A—t—ou jamaisrêvé de supprimer nos grandes ou moyennes soci ét és à fondssocial parce que tous les j ours il s ’y trouve des gens qui enfont un mauvais usage aux dépens de leurs administr és oudu p ublic ? Non . On pèse le bien et le mal qu ’elles font
,
et c omm e on croit que la somme de bien l ’emporte,on con
t inue à. se servir , de la façon la plus naturelle du monde , de
98 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
ce levier puissant de progrès mat ériel,sans qu ’un seul sur
cent mille individus parmi nous se demande s érieusements ’il n ’existe pas un moyen tout aussi fécond
,sans pourtant
favoriser et d évelopper l ’égoïsme connue le fait le r égimeque nous avons dans notre monde économique . Et cependant
,ce moyen existe
,il s ’est r évél é par ses bienf aits partout
! où il a ét é appliqu é
,et bientôt son excellence se manifestera
à tous les esprits dans une‘
clart é éblouissante,malgré les
luttes acharnées de ceux qu ’il dépouillera de la néfaste domination qu ’ils exercent auj ourd ’hui . Et ce moyen
,il ap
part ient aux classes laborieuses de s’
en emparer .La faute du monde du travail est de ne pas avoir compris
plus tôt que la était le vrai remède aux maux dont il souff re .Au lieu d ’avoir entrepris une lutte inégale avec le capital
,
s’
i l eut,au contraire
,conquis ce même capital par l ’épargne
,
et s ’il eut appliqu é ses énergies a se cr éer les organismes nécessai res à. lui conserver l ’entier contrôle de ce capital
,la lutte
,
cette fois,pour avoir ét é silencieuse et pacifique
,aurait ét é
mille fois plus fructueuse . Que l ’on songe un instant auxs ouffrances
,aux privations multiples
,aux angoisses et
,enfin
,
auxdépenses d irectes ou autres,que représentent les milliers
de gr èves qui ont ét é la suite des confli ts ouvriers , et l’on
se convaincra vite qu ’il n ’en aurait pas fallu la milli ème partiepour créer par l ’épargne un capital se chiffrant par mi lliards,capital que ces mêmes ouvriers auraient formé
,auraient con
trôlé,capital qui aurait ét é leur serviteur au lieu d ’être leur
maître aux mains des autres . Dans cet te hypothèse , plusd
’antagoui sme entre ces deux mondes du travail et du ca
pital,si indi spensables l ’uu ”
à l ’autre, qu
’on
'
ne'
peut concevoirl ’existence de l ’un sans que l ’autre soit
,pas plus que l ’on peut
imaginer un eff et sans caùse,puisque le capital n ’est apr ès
tout,que du travail épargné et accumul é . L
’antagoni sme
disparu par la r éunion dans les mêmes mains de ces deuxinstruments de production
,cet antagoni sme né de l ’égoïsme que
l ’on retrouve t ouj ours au fond de ces discordes ou de ces combats économiques
,il s ’ensuit que l ’harmonie naturelle entre
ces deux él éments s ’établirait et se maintiendrait d ’elle—même,
parce qu ’alors on comprendr ait enfin cette vérit é qui sauteaux yeux Que l ’un et l ’autre sont faits pour s ’aider
,non
pour lutter,non pour se nuire ou s
’étrangler . Mais pour r é
aliser une aussi heureuse conception,il faut l ’organi sation
intelligente et énergique des forces populaires,il faut que
les travailleurs de tous ordres sachent s ’unir et fortifier leur
1 00 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
est leî‘
f’domaine de chacun
,et q ue l mdividu y est prot égé
,
soutenu par la collectivit é puisqu ’il y va de son avantagedirect . Comme dans le corps humain composé d ’
innombra
bles cellules et dont pas une seule ne peut souff r ir sans que toutesles autres s ’en ressentent
,de même aussi l ’étroite union des
unit és sociales amène la même influence reciproque, ,une
répercussion constante des unes sur les autres . Pourquoine pas chercher à. remplacer le détestable chacun pour soi parle tous pour chacun
,si beau et si élev é
L’ignoran ce, dira—t —ou
,offr ira touj ours un obstacle in
franchissable à la r éalisation d ’une telle conception,ce qui
fait qu ’elle n ’est et ne peut êtr e qu ’un rêve . Mais l ’ignorancene peut— elle pas être vaincue
,sinon avec facilit é et ra pide
ment,du moins avec du temps et de la persévérance Quand
cette ignoranc e devra lutter avec une vér it é qui éclatera auxyeux de tous
,r épondant aux
g
secr ètes aspirations de chacun,
r éalisant une amélioration sans cesse désir ée mais non at
teinte,cette ignorance ne sera—t— elle pas déj à à. demi vaincue
Le temps sera assur ément un facteur important dans cetteévolution . Eh oui tout progr ès r éel ne s ’accomplit pas duj our au lendemain . Il faudra sans doute du temps
,mais
n ’est— il pas nri lle fois pr éférable d ’utiliser celui qui passe à.pr épar er un avenir meilleur
,en dissipant les ténèbres des
fausses idées,des pr é jugés et même des haines
,que de l ’em
ployer à. pour suivre une lutte st érile en bienf aits durables,
lutte plutôt effroyable par ses conséquences économiques,
dont nous n ’avons vu jusqu ’ici que les pr éludes car,qui peut
dire les désastres qu ’elle semera Mais cette ignorance estelle
,apr ès tout
,aussi enracinée
,aussi profonde qu ’on le dit
Les masses populaires ne nous donnent—elles pas , depuis cinquante ans
,des exemples r épét és de discipline et d ’esprit
d ’association qui comportent une certaine abnégation et , quisont de natur e afaire r éfléchi r N ’y avons—nous pas la preuvequelles comprennent les bienfaits de l ’action concert éeElles en ont vu la fécondit é et les incontestables avantagesdans les applications restreintes qu ’elles en ont faites , et celaa suffi pour éclairer leur esprit plus qu ’on ne saurait se le figurerà premi ère vue. Elles ont su emprunter aux autres classesl ’arme puissante de l ’entente . Leurs unions syndicales ,leur s soci ét és de secour s mutuel
,en un mot
,leurs activit és
croissant sans cesse dans le domaine des luttes industrielleset de la pr évoyance sociale ne nous permettent—elles pas depr édire qu ’elles saur ont aborder
,avec fermet é et succ ès , le
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 1 0 1
d omaine économique afin de s ’y faire la place l égitime quileur appartient
,le j our où on leur aura indiqué le but à at
t eindre et les moyens d ’y parvenir .Mais n ’est—i l pas é trange de constater qu
’en Am ériquel ’utilisation du formidable levier de l ’association n ’ait guèrefranchi des limites assez restreintes apr ès tout
,puisqu ’on
n’a pas encore songé à envahir hardiment le domaine des
a ctivit és r éellement économ iques de la consommation , dela production et du crédit . R ègle g énérale
,les classes
’
ouvri è res n ’ont cherch é jusqu ’ici à se prémuni r par l ’associat ion contre les conséquences des temps de crise , seulement ,telles que la maladie qui prive la famille du gain de son chef
,
ou de la mort qui la d épouille de son seul soutien . L ’assurances ous quelque forme qu ’on l
’
envi sage, qu’elle soit indus
tr iali s ée comm e dans les grandes compagnies à fonds social ,-où l ’actionnaire et le manipulateur
,qui se confondent souvent
dans le même indivi du,savent fort bien s
’attr ibuer la part
du lion qu ’elle soit plus fraternelle,moins égoïste
,comme
dans les soci ét és de secours mutuel et les organismes à basede solidarit é
,l ’assurance sous ces deux aspects est une activit é
«qui n ’a qu ’un but restreint,celui de pourvoir à. des besoins
a ccidentels et,par cons équent
,formant l ’exception
,besoins
tr ès dignes de la plus vive sollicitude,il est vrai
,mais qui
,
apr ès tout,ne constituent que des exceptions .
Dans un autre ordre d ’id ée,l ’ouvrier a voulu améliorer
encore sa situation par l ’él évation de son salaire et la diminut ion des heures de travail
,afin d ’accro ître celles du repos
dont une partie pourrait être utilis ée par l etude au développement de ses facult és intellectuelles . Pour r éussir à accro îtres on salaire ou ses ressources
,il n ’a rien imaginé de mieux
q ue la lutte , parfois même violente , contre l ’employeur .P our que cette lutte lui offrit plus de chances de succ ès
,il
recourut a la force de l ’association . De la la formation deces nombreuses unions de tous métiers
,de tous genres
,cher
chant un point d ’appui plus puissant encore dans la fédérationnationale
,d ’abord
,internationale ensuite . L ’obj et principal
de ces organismes est la lutte contre le capital,c ’est-à—dire
le patron,qu ’il soit représent é par un individu ou par une col
l ect ivit é,compagnie ou trust gigantesque
,comme on en trouve
t ant aux Etats—Unis . Mais ici encore,c ’est la conflit possible
,
s inon touj ours probable ou inévitable,entre deux int érêts
antagonistes que l ’on a en vue c ’est la guerre pour laquelleo n s
’
arme de part et d ’autre pour les cas où les pourparlers,
1 02 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
les n égot iat ions , qui correspondent aux efforts de la diplomatiedans les relations entre peuples
,n
’about i ssent pas a une eu
tente plus ou moins instable . Les partis au conflit en permanen ce
,qu ’il soit à l ’état aigu ou simplement latent
,se
redoutant les uns les autres,redoublent de vigilance et
accroissent sans cesse leurs moyens d ’action . Le trust,par
l’aglom ération des capitaux qui lui permet d
’
étrangler la
concurrence,et de se reprendre aux dépens du consommateur
s ’il lui arr ive de succomber dans la lutte avec l e travail laclasse ouvr i ère
,en groupant ses millions d ’unit és
,en les dis
ciplinant et en pr élevant sur les gains de chaque j our une partdestinée à la cr éation d ’un tr ésor commun où elle puiserale j our où éclateront les hostilit és
,c ’est-à— dire
,la gr ève . D e
cette état de choses tr ès sonrmairement esquiss é,quel bien
peut r ésulter pour la soci ét é en général Peut-on nierque ce r égime qui
,grâce à Dieu
,n ’est que transitoire
,n ’in
flige au corps social tout entier des blessur es profondes , etque
,pour une amélioration sensible
,nous l ’admettons
,arra
chee à l ’égoïsm e,il a fallu s ’imposer des souff rances sans nom
bre,des pr ivations cruelles
,d ’autant plus cruelles que d ’in
nombrables victimes innocentes en étaient atteintes .On pourrait peut- être finir par en prendr e son parti
,s’i l
n ’y avait pas une autre solution,toute pacifique celle—IR
,
toute bienfaisante,et essentiellement pratique . Or
,cette
solution fondée sur la raison existe,et elle est à. la port ée
de tous . Nous la trouvons encor e et touj ours dans l ’association
,principe extraordinairement fécond
,dont la m ervei l
leuse souplesse d ’
applicat ion ,
— comme l ’a affirmé M . Meline,
ancien premier ministre de France,
— permet d ’atteindre lesr ésultats les plus inattendus et les plus avantageux . Il nes ’agit que d ’étendre les activit és de l ’association
,d ’y faire
appel dans un autre ordr e d ’id ées,et pour cela
,de cr éer des
organismes qui r épondent a un nouveau but, qui donnent pleine
satisfaction aux besoins écoh om iques auxquels on pourvoitauj ourd ’hui d ’une façon si empir i que et
,partant
,s i in suffi
sante,puisqu ’elle laisse touj our s subsister la possibilit é d ’
un
conflit probable et désastreux . Que la cause première re
monte a l ’ignorance ou à. l ’égorsme individuel,cela est évi
dent . L ’essentiel est de se rendre compte de la nature dumal afin d ’en rechercher le vrai remède . L ’histoire des mani f estat ions de l ’esprit d ’association
,depuis près de trois
quarts de si ècles,contient de tr ès précieux enseignements
,
et il appart ient aa’
tous ceux qui veulent la r éelle amélioration
As pec t gé né ra l.— La Te rras s e .
,
Le s Monument s .
Toute description de cette ville serait serait incompl ète sielle ne commençait par cette entr ée en mati ère que l ’on retrouvepartout Quebec
,superbement situ é sur un promontoire
formé au confluent du St . Laurent et de la riv1 ere St . CharlesL e guide de Bœdeker aj oute que c ’est peut— être la ville la pluspittoresque de l ’Am ér ique du Nord , et elle ravit l ’admirationdu tour iste le plus blas é tant par la hardiesse de son
_
s ite quepar l ’heroïsme de son histoire et le contraste que l ’on y trouveentre son aspect de vieille ville européenne et le caract èrede sa population .
Charles Marshall en donne une descr iption qui permettrad
’en apprécier davantage toutes les beaut és . Nous citons
Sans parall èle pour le pittoresque et la magnificence
de sa position sur le continent Américain,et pour le romanes
que de ses relations historiques,Québec
,solidement assise
sur ses hauteurs inexpugnables,est la reine des villes du Nou
veau Monde .A ses pieds coule le maj estueux St —Laurent
,digne route
d ’un grand empire,qui s ’y rétr écit jusqu ’à une largueur
d’environ deux milles
, ( 1 ) pour prendre une largeur d’une
vingtaine de milles un peu plus bas et d ’une quarantainedans le golfe . C ’est du r étr écissement de la grande rivi èrea ce point que la ville tire son nom
,Québec voulant dire
dans le language des indiens,le d étroit .” A l est de la ville
,
la splendide rivi ère St . Charles roule ses eaux vers le grandfleuve à travers une vall ée richement fertile . Les eaux mêl éesdes deux rivi ères se part agent ensuite pour enchâsser commeun j oyau la belle et somptueuse Ile d ’
Orléans .
La ville , vue de distance , s’él ève solennelle et digne
,
comme une grande pyramide d ’édifices monumentaux . Sesmaisons groupées
,hautes
,irr éguli ères
,a toits pointus
,se
pressent tout le long de la rive puis grimpent vers les hauteurs( 1 ) Comm e ques t ion de fai tfla la rgeur dulfleuve devan t Québec
?ne
’
£d épasse
p as t rois quar ts de m i lle.
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 1 05
sur le penchant de la falaise . Des masses immenses d ’églisesde pi erre , de coll èges , d
’édifices publics surmontés de mi narets étincellants , pe cent à. t ave s la co rn e des habitations .
La puret é de l ’atmosphère permet d ’employer le fer—blancrecouvrir les toits et les clochers et la sombre apparence
des constructions de pierre est baignée dans 1 1 1 1 oc éan de lumi ère . Au dessus de tout se prolonge la ligne sombre d ’unedes fameuses citadelles de l ’univers
,le Gibraltar de l ’Am é
rique.’A cette descr iption enthousiaste faite
,
par un écrivainqui n
’a pas les mêmes raisons que la population canadienne
L .\ REVUE FRANCO-AMERICAINE
française d ’admir er la ville,aj outons cet indescriptible cachet
qui,pour nous
,fait de Québec
,la “ ‘ ville aux souvenirs et
le plus r iche écrin de notre histoire .Pénétrons dans la ville
,apr ès la
'
rude ascension de laCôte de la Montagne
,et visitons les premiers j oyaux de cet
écrin incomparab le la terrasse Duffer in et les monuments .ï e r ras s e Duff e r in .
C ’est une immense plate forme de bois longue d ’unquart de mille et large de 50 à. 70 pieds
,construite sur le bord
de la falaise,au sud— est de la ville et à. 1 85 pieds au-dessus de
la Basse ville et du fleuve . La premi ère partie en fut cons
L a terrasse de Québec .
tru ite par Lord Durham elle fut plus tar d reconstruite etconsidérablement agrandie par lord Duffer in et inaugur éeen 1 879 par le Marquis de Lorne et la Pr incesse Louise . Certains ont conservé à. sa partie nord le nom de terrasse Durham . D ’ailleurs
,depuis 1 838
,on l ’a appel ée successivement
Plateforme St—Louis,Terrasse Durham Terrasse Frontenac .”
Pour les étrangers elle est l ’unique,l incomparable Terrasse
de Québec,la promenade aux vastes horizons
,souvent ani
m ée par la présence d ’une foule j oyeuse,touj ours peupl ée
de rêveurs,d ’artistes
,de poètes et de souvenirs . La “ plate
LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE 1 09
En flânant,on adm ire
,à loisir le fleuve et les Laurentides ;
on respire abondamment comme au bord de la mer et l ’onéprouve la même sensation de vivifiànt bien— être.
Il en est ainsi dans toute la ville haute . On s ’y croiraiten bateau— ou même en ballon . L ’atmosph ère n ’est pascelles des cit és ordinaires il faut gagner le port pour se sentirrentr é dans la vie commune
,revenu à. quelque Havre moins
vaste,mais d ’une s emblable act ivit é
'
commerciale. Au piedde la citadelle et au niveau du Château—Frontenac
,on plane .
On n ’y conçoit qu ’une exist ence de paix physique etintellectuelle
,magn ifiée par des pens ées larges comme les
hor i zons . Si Amér ique signifie industr ies fièvreuses,génie
des entrepr ises mat ér ielles,monomanie du gain
,combien peu
amér icain est donc ce Québec supérieur Ah restons—y leplus longt emps possible l ’âme française formule ici le vœude saint Pierre au Thabor .
Les Monuments
Champla in ( r )
L ’id ée d ’élever un monument au fondateur de Québecfut discut ée en diverses occas ion s ‘
durant les derniers cinquanteans . En 1 890
, la soci ét é Saint—Jean—Baptiste r ésolut demettre ce proj et à exécution . Une assembl ée de citoyensfut convoqu ée dans ce but et on nomma un comit é dont leprésident fut l ’honorable juge Chauveau . On di stribua deslistes de souscr iptions et en moins de deux ans on r éalisa lasomme de somme qui fut port ée àpar une décision du comit é . Le site du monument fut choisile 20 f évrier , 1 895, et le 23mai 1 896, le comit é confia la const ru ct ion du monument aMM . Chevr é et LeCardonn el
,le pre
mier sculpteur , le deuxi ème architecte , de Paris . La constructiondu piedestal fut commencée le 1 5 j uin
,1 898 . Tous les mat é
riaux furent import és de F rance . Les gradi ns sont en granitdes Vosges , et le pi édestal en pierre de Chateau Landon .
Champlain est debout sur le sommet,chapeau en main
,sa
luant la terre canadienne . La statue a 1 4 pieds et 9 poucesde haut et pèse 6926 l ivr es . Sur le pi édestal est un haut relief
( 1 ) Extrai t de Quebec under two flags de MM. Doughty et D i onne .
LA REVUE ERANCO -AMER1 0 A1 NE
Mor .e n,V i r tus . Co nm unem
,
F a n am H i s tor ia .
Monumen tum Pos ter i tas
Dedi t .
Sur l ’arri èreHus jusce
Monumen t i in Mem or iam vi r0 rum i llustrium ,
WOL FE ET MONTCALMF undamen tum P . C .
Georgius , Com es de Dalhous ie :In septen tr ional i s Am erîcae part ibus
Ad Bri ta nnos pert inen t ibusSumm am rerum adm in i st rans
LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE 1 1 3
Opus per m ultos ann os praeterm i ssum ,
Qu id duc i egregio con ven ien t i us
Auctor i tate p rom oven s . examplo s t im u lans,
Mun ificen t ia f ovens
D ie nov em br i s XV .
A . D . MDCCCXXVII .Georgio IV ,
Br i tann iarum Rege ,
Monum en t aux s oldats d’
Af r ique.— Sur l
’
Esplanade .
_
Ce monument a le mérite unique,de réunir dans une
m ême gloire le souvenir de deux généraux morts pendant lam ême bataille en se disputant la vi ctoire . Wolfe vainqueur
,
gagna à l’Angleterre sa plus belle colonie . Montcalm vaincu ,
‘vit en mourant les derniers j ours de la puissance française«dans le Nouveau Monde .
1 1 4 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Gue rre d’
Af r ique
Monument élevé sur l ’Esplanade, pr ès de la Porte SaintLouis
,à la mémoire des soldats canadiens de Québec
,morts
sous les drapeaux anglais pendant la guerre sud—africaine .Fut dévoilé le 1 5 août
,1 905. M . Jean Lionnet dans la Revue
Hebdomadai re,en dit ce qui suit
Mais en sortant du Club de la Garnison,sit r é en face
,
sur la rue St —Louis,l ’on voyait sur la
, place de monumentélevé à la mémoire des soldats mort s dans l ’Af r ique du Sudun guerrier au costume coloni al
,sous prétext e de brandir
un dr apeau,soulevait p éniblement
,avec un manche à balai
,
une esp èce de lourd matelas . Et il fallait bien reconna ître,
hélas que ce n ’était point l ’ œuvre d ’un sculpteur normandou manceau— ou canadien- français .”
Short -Wa l l ic k
Le monument Short—Wallick,élevé à la mémoire d’
un
officier et d ’un soldat anglais morts en combattant — l ’incendie
qui d évastait le quartier de Saint—Sauveur le 1 6 mai,1 889 .
Il est situ é sur la Grande All ée en face du manège militaire .
Wo lf e
Ce monument est situ é pr ès de la prison de Québec .C ’est une colonne ronde surmontée d ’un sabre et d ’un cnsque
Sur un des côt és du pi édestal on lit c es mots
HERE D 1 ED
VVOL F E
VICTOR IOUSSEPT . 1 3
,1 759
inscrits en relief en bas de la colonne .
Re ine Victor ia
Ce monument situ é dans le Parc Victoria sur les bo dsde la rivi ère Saint-Charles . C ’est une statue de bronze peur éuss ie . Fut dévoil é par Lord Aberdeen
,en 1 897.
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
Gé né ra l Montgome ry
Il s ’agit ici d ’une simple inscription plac ée sur le cap,
au—dessous de la citadelle et marquant l ’endr oit exact outomba le général américain Montgomery
,le 31 décembre
,
1 775,pendant une attaque dirigée contre Québee. C ’est
Inscript ion placée sur le cap au dessous de laci tadelle , en m émoi re du
général am éricain R ichard Mon tgomery
un épisode de l ’indépendance des Etats—Uni t. Les patriotesamér icains qui n ’avaient pu engager les canad1 ens à épouserl eur cause r ésolur ent de s ’emparer du Canada
,contre lequel
ils lancèrent des troupes commandées par Ar nold et Montgomery . A cette occasion la loyaut é des Canadiens sauva
'
l e Canada à l’Angleterre. L ’ins cription comm émorant cet
événement ne contient que ces mots Here Montgomeryf ell
,Dec .
,3l st
,En 1 904
,deux nouvelles inscriptions
,
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 1 1 7
commémorant le même événement,furent plac ées par une
soci ét é hi stor ique œle Québee, l’une sous le cap Diamant et
l ’autre dans la Banque Molson à. l ’en coignure des rues St .Pierre et St . Jacques .
Jacques Cart ie r
Ce monument d ’une natur e tr ès originale est situ é auconfluent des r ivi ères St —Char les et Lairet
,à quelque distance
du pont Dorchester actuel . L ’id ée de ce monument fut lancéeen 1 885 par le Cercle Catholique de Québec . On voulaitériger un monument aux mémoires du découvreur de Québecet des Rev. Pères j ésuites de Brebœuf
,Massé et Lalemant
,
ce monument devant comprendre une reproduction exactede la croix plant ée par Jacques—Cartier
,le 3 mai
,1 536 . Ce
proj et de monument fut r éalis é en 1 887.
Ce monument de Jacques-Cartier r essemble beaucoup ,par sa forme au cippe funéraire des anciens . Sa hauteur estd ’envi ron 25 pieds y compris le tertre sur lequel il est install é .Il est construit
,partie en gnei ss laurent ien et partie en pierre
de Deschambault . Il est revêtu de plusieur s inscriptionsdont les suivantes
JACQUES CARTIERET SES HARDIS COMPAGNONS
LES MARINSD E LA GRANDE HERM INE
PETITE HERM INE ET D E L’EMER ILLON
PASSERENT ICI D’H IVER
D E 1 535— 36
Le 3mai 1 536 Jacques-Cartier planta a l ’endroit où i lavait pass é l ’hiver
,une croix de 35 pieds de hauteur portant
un écusson à fleurs—de-lys et l ’inscription suivante
FRANC ISCUS PRIMUSD EI GRAT IA FRANOORUM
REX REGNAT .
”
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
Jacques-Cart ier , découvreur du Can ada ,1 535.
Le 23 septembre 1 625,les Pères Jean de Br ébœuf
,
Ennemond Mass é et Charles Lalemant prirent solennellementpossession du terrain connu sous le nom de F ort JacquesCartier pour y ér ger la première r ésidence des Jésu tes miss ionnaires à Québec . ’
La dédicace du monument Jacques—Cartier eut lieu le 24j uin 1 889 au milieu d un immense concours de peuple . Cej our—là
,une messe fut célébrée par le Cardin al Taschereau sur
le site même du monument .
1 20 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
est tournée vers cette partie du champ de bataille qu’occupait
l ’armée française au matin du 28 avril . Entre les épaules etles hanches
,il y a un mouvement d ’une grande hardiesse
,et
le buste parait litt éralement tordu . La Vi ctoi re hés i tante,
comme on a appel é ce beau bronze,semble prendre à regret
une direction nouvelle,et ses regards persistent à se tourner
ver s les troupes si longtemps et encore une fois victorieusesdont les clairons ne devront plus r ésonner sur les remparts dela capitale de la Nouvelle—France .
Monumen t des Braves sur le chem in Ste—F oye .
Les ossements humains trouvés sur l ’emplacement dumoulin de Dumont
,en 1 854
,avaient ét é transport és en grande
pompe a la cathédrale de Québec,et
,avant leur inhumation a
l ’endroit où s ’él ève auj ourd ’hui la colonne commémorative ,l ’archevêque Turgeon
,dans une cér émonie extrêmement solen
nelle,avait prononcé sur ces restes des combattants rivaux les
paroles d ’espérance et de foi en la r ésurrection de la liturgiecatholique .
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 1 21
“L ’année suivante,le 1 8 juillet 1 855 le général Rowan
,
administrateur,gouverneur int érimaire du Canada
,posait la
pierre angulaire du monument des braves de 1 760 en présence de M . de Belvèze
,commandant de la corvette La
Capricieuse le premier vaisseau de guerre français qui eûtremont é le fleuve Saint—Laurent depuis 1 759 en pr ésence aussidu 60e r égiment d ’infanterie
,avec drapeaux
,d ’un corps d ’ar
t i lleri e,d ’un détachement de marins de la corvette française
,
l ’arme au bras,d
’un groupe de Hurons de Lorette portant le
costume de guerre,et d ’une foule immense de spectateurs .
Ce fut à. cette occasion que M . Chauveau , père , prononçale c él èbre discours dont voici la p éroraison et qui j eta un si Vi féclat sur la renommée alors naissante de l ’illustre orateur .
…Guerriers que nous vénérons,vous avez pay é votre
dette à la patrie,c ’est à nous de payer la nôtre . Votre j ournée
est remplie , votre tâche laborieuse et sanglante est terminée,la nôtre a peine commence . Vous vous êtes couch és dans lagloire
,ne vous levez pas ! Pour nous
,quels que soient nos
aspirations , notre dévouement , notre courage , Dieu seul sait oùet commentnous nous coucherons . Mais vous
,donn ez en paix
sous les bases de ce monument,entour és de notre vénération
,
de notre amour,de notre perp étuel enthousiasme……dormez
j usqu ’
à ce qu’
éclatent dans les airs les sons d ’une trompette plus retentissante que celle qui vous sonnait la charge
,
accompagnée des roulements d ’un tonnerre mille fois plus form idable que celui qui c él ébrait vos glorieuses funérailles etalors tous
,Anglais et Français
,grenadiers
,montagnards, mili
ciens et sauvages,vous vous l èverez
,non pas pour une gloire
comme celle que nous,f aibles
_
mortels,nous entreprenons de
vous donner,non pas pour une gloire d ’un si ècle ou de plusieurs
si ècles,mais pour une gloire sans terme et sans limites
,et qui
commencera avec la grande revue que Dieu lui—même passeraquand les temps ne ser‘ont plus .”
La Revue des faits et des œuvres
Po l it ique ang la i s e ; La ret ra ite de M. Campbe l l
Banne rman et l’
avè nement de M. As quit h.
Sir Henry Campbell—Bannerman,dont la santé inspirait
depuis plusieurs mois de s érieuses inquiétudes,vient de résigner
ses fonctions de premier ministre dans le par lement anglais .Il a ét é remplacé
,comme cela était pr évu
,d ’ailleur s
,par M.
Asquith, qui remplissait dans le minist ère les fonctions de
chancelier de l ’échiquier (mini stre des Finances) .La Nati onal Revi ew nous donne , à ce propos , une analyse
des tendances et des idées du nouveau premier ministreauquel elle hésite à promettre un avenir plein de succès . Celatient
,paraît— i l
,a ce que le nouveau premier ne partage pas sur
plusieurs points les opinions de son prédécesseur,a ce que tous
deux,dans le même parti
,étaient chefs de groupes que la
Revi ewappelle les lib éraux de droite et les lib éraux de gauche”La Revi ew
,il faut le noter
,est conservatrice— impérialiste .
Voici donc les r éflexions auxquelles Se livr e son directeur,
M . Maxse“ Le point délicat
,c ’est que M . Asquith ne repr ésente pas
tout-à— fait la même nuance lib érale que M . Campbell—Bannerman . Celui-ci est un vieux gladston ien aux opinions assezavancées
,un peu de radicalisme ne lui fait pas peur il a tou
j ours ménagé les socialistes,qui l ’en ont d ’ailleurs r écompens é
en l ’attaquant avec la derni ère violence . On sait dans quellevoie de “ r éformisme à. outrance il avait engagé le minist èr eau lendemain des élections d
’
am ères désillusions ont un peurefroidi son z èle
,depuis lors . On se rappelle aussi la virulence
de ses attaques contre la Chambre des lords,coupable d ’avoir
trop vigoureusemen amendé le bill sur l ’éducation . SirHenry est un pacifiste militant (si l ’on peut accoupler cesdeux mots) , un humani taire plein de ferveur et de naïvet é ,fidèle disciple de Gladstone et de Br ight . Il avait pr is tr èsau sér ieux la Conférence de La Haye là aussi
,les désillusions
ne lui ont pas ét é ménagées . Inutile de rappeler que l ’impér iali sme n ’a pas de plus fougueux adversaire les conservateursle traitent couramment de Li ttle—Englander , partisan d
’unepetite Angleterre .
1 24 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
guerr e a fait connaître à M . G1 0 usseau qu ’il donnait des ordresau général d’
Am ade pour que les cinq religieux franciscainsfrançais envoyés au Maroc puissent y remplir leur minist èreaupr ès de leu 1 s cor éligionnaires du corps de débarquement .
”
—4 . M . Combes , qui est pr ésident de la commission d ’enquêtes énatoriale sur la liquidation des congr égations
,publie dans la
Revue bleue un article où il expose longuement les raisons pourlesquelles le S énat a ordonné une enquête et la façon dont lacommi ssion entend la conduire .Il demande au gouvernement ( 1 en finir par des ordres
rigoureux et une surveillance efficace avec les lenteurs plus oumoins volontair es
,plus ou moins calcul ées des liqu idateur s
il faut qu ’il n ’hésite pas a faire prononcer la déchéance deceux d ’entre eux qui laissent s ’éterni ser
,soit par négligence
,
soit de propos délib ér é,les ventes des biens et les procès .”
Et il aj outeDisons tout avec franchise on est envahi malgr é sol
par des craintes de gaspillage,quand on entre dans le détai i
des sommes dépensées par rapport aux r ésultats acquis .Nous demandons instamment aux mi nistr es compétents
d ’accél érer,fût-cc par des mesures rigoureuses
,une opération
susceptible de donner prise par son allure tr”aînante aux piressoupçons .
Le t ro i s ième Centena i re de Qué bec .
L’
Ange de la Pa ix s ur la C itade l le
L’enthousiasme qui avait paru accueilli r le proj et de Son
Excellence le Gouverneur—Général au suj et de ce que l ’onappelle encore le Parc des Batailles est devenu moinsbruyant aux yeux de plusieurs . Au fond
,ce n ’est pas autre
chose que la r éaction inévitable qui suit toute entreprise donton a mal calcul é les cons équences et dont les bases n ’ont pasét é établies avec assez de sagesse . Au reste
,on comprend
m ieux,auj ourd ’hui qu ’on essai e de la surmonter
,la difficulté
de r éuni r sur une date et dans une même célébration desévénements entre lesquels l ’histoire a pos é la barri ère d ’unsi ècle et demi .Certes , l
’id ée de consacrer les. Plaines d’Abraham et le
champ de Ste-Foy a la vénération nationale était louable .Personne ne le conteste . Mais était—cc bien le temps demettre cette idée à exécution sous la forme que l ’on suggère .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 1 25
L es critiques assur ément très raides qui , depuis quelquess emaines
,sont dirigées par des j ournalistes anglais contre
c ertains détails du proj et de lord Grey nous confirment davant age dans 1 ’0 pinion que nous avons exprimée dans la RevueF ranco—Amér i cai ne du mois dernier .
Actuellement,on critique surtout l ’idée d ’installer la fa
m euse Statue de la Paix à la citadelle sur le Bastion du Roi .Elle y sera peut-être moins isol ée que sur les Plaines
,mais;elle
n’
y sera certainement pas beaucoup plus à sa place . Et quand ondiscute ce point on oublie que peut— être la cause de tout cebruit est au fond l ’Ange de la Paix lui—même qui n ’est si difficileà. loger que parce qu ’il est inutile et sans Signi fication . D ’ordinaire, le monument utile et justifié par l ’histoire a sa placet oute trouvée on sait où le mettre avant même qu ’il existeet quand il monte sur son pi édestal il ne fait que repara îtredans le décors t émoin des hauts faits dont il a pour mission deperpétuer le souvenir . On peut quelquefois manquer de goûtdans le choix du site
,mais les h éros de bronze que la mémoire
des peuples vénère doivent se sentir à l ’aise là où on les placeet pouvoir dire aux passants qui défilent à leurs pieds C ’estici que s
’est accomplie l ’ œuvre qui me ramène au milieu devous .”
A notre sens l ’An ge de la Paix plac é à la citadelle seratrop haut . Il y verra de tr0 p loin , pour ne pas apercevoirdans des provinces lointaines les fils de ceux qui lui accordentl ’hospitalit é en proie à des injustices et à des mis ères qu ’il nepeut couvrir de ses ailes . Lui qui devait être la cons écrationd ’une idée
,verr a qu’il est venu trop tôt et qu ’il ne consacre
t out au plus qu’une espérance . Apr ès tout
,la paix véritable
du pays ne peut reposer que sur le respect des droits de tous . I lfallait d ’abord s ’assurer que ce respect était partout maintenu
,
qu’il était d ’abord enraciné dans toutes les consciences comme
i l est écr it dans la constitution . On ne l ’a pas fait,malheureu
s ement .D ’autre part , l
’Ange de la Paix ne fournira pas seul tous
les suj ets de controverse . D ’autres mati ères qui contribuerontà donner le ton aux fêtes prochaines menacent de soulever desr écriminations . Ceux qui redoutaient que les fêtes du trois i ème centenaire prissent une tournure décidément trop peuf rançaise voient avec inqui étude certain “ certificat de mérite”que l
’on va distribuer aux enf ants qui auront accumul é des gross ous pour le rachat des champs de bataille . Une reproductionde ce certificat que nous avons sous les yeux nous montre en
1 26 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
trypt ique les portraits de trois héros r éuni ssant deux ailesimm enses— celles de l ’Ange, sans doute— qui servent d ’
enlu
m inure à tout le document . Les portraits sont ceux de Champlain à.gauche
,de Montcalm adroite
,et de Wolfe au centre et
les dominant . Pourquoi le conquérant avant le fondateur s ic ’est ce dernier que l ’on veut surtout fêterPourquoi s ’occuper de pareilles vétilles
,dira-t -ou Ce
sont avec ces vétilles,lorsqu ’elles sont habilement employées
,
que l ’on étouffe les idées c ’est l ’ivraie qui,r épandue dans la
nuit,r éussit souvent à étouff er le bon grain et apriver le semeur
sans défiance du fruit de son travail .Quelles que soient les conséquences de cette aventure
,nous
nous contentons de souhaiter qu ’elle ne r éussi sse pas a éveillerdes souvenirs cuisants et a éloigner davantage le but poursuivipar ceux qui l ’ont entreprise . Chacun assist era à la fête en ypuisant les souvenirs qui sont le plus pr ès de son cœur . Nousle dis ions dans notre dernier article , il est inutile de violenterl ’histoire pour en obtenir des rapprochements qu ’elle r éprouve .Ce qui nous rassure dans tout ceci
,c ’est que la galanter ie fran
çai se qui , en 1 759 , couvr it d ’une égale gloire vainqueurs etvaincus saura
,en 1 908
,oublier l ’ardeur indiscr ète de certains
de nos amis et nous faire songer à la sincérit é de cette étreinteun peu nerveuse qu ’on nous donne en voilant l ’id ée maîtressedu troisi ème centenaire de Québec .
Les dro it s du f ranç a i s : Une pé t i t ion de l’
As s oc iat ion
Catho l ique de la Jeunes s e Canad ienne-Franç a i s e
Quelques cercles de l ’Associat ion Catholique de la JeunesseCanadienne—Française ont lancé un mouvement fort louabler éclamant la reconnaissance prat ique de la langue françaisedans le pays .
Ils font signer une petition qui sera présentée aux autor it éscompétentes et dont voici le text e
AUX HONORABLES M IN ISTRES ET DEPUTES DE LA CHAMBRED ES COMMUNES
Consid érant que, cle-droit,les langues française et anglaise
sont sur un pied d ’égalit é,particuli èrement dans la province
de Québec ;Consid érant que
,de fait
,dans les servi ces d ’utilit é publique
les compagnies et leurs employés négligent l ’usage du français,
1 28 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
On a l ’habitude de mesurer l ’influence d ’une m inorit é aunombre des membres qu ’elle a dans le gouvernement et dansl ’admini stration . C ’est une erreur pour ce qui est des fonctionnaires
,à. moins qu ’il n ’
y ait une règle défini e établissant quel ’entrée dans un service est
,de soi
,une marque de supériorit é
ou de compétence exceptionnelle . Et c ’est tellement le cas qu ’unministre déplorait
,r écemment , l
’indifférence que les j eunesCanadiens— français montrent à se soumettre à certains r èglements r égissant l ’admission dans les services administratifs .En général
,ils ne songent pas à subir les examens requi s —par
la loi . On compte sur la faveur d ’un homme politique pour secaser dans l ’admini stration
,et une fois qu ’on est casé
,on
compte sur une autre faveur pour se maintenir en place .Pourquoi ne pas subir un examen qui fera rentrer le méritepersonnel en ligne de compte A la satisfaction d ’être plac éconvenablement s
’ajouterait celle d
’être plus digne du posteque l
’on a conquis,et de voir s ’ouvr ir devant soi la route des
promotions enviables . On aura fait de son métier une carri ère .Nous signalons ce fait à nos j eunes compatriotes qui se
destinent à entrer dans le service admini stratif . Qu ’ils se prévalent de tous les moyens mis à. leur disposition pour se classerofficiellement parmi les meilleurs serviteurs du pays . Et s ’ilsont l ’ambition d ’être fonctionnaires
,qu ’ils aient aussi l ’ambition
d ’être les meilleurs fonctionnaires .
Le t hé at re à Qué bec : Inte rd ict ion d’
une piè ce de Sardou
par l’
autor it é re l igieus e
Sa Grandeur Mgr Bégin a prononc é l ’interdiction cont rela représentation d ’une pièce de Sardou . C ’est un acte d ’énergie et de protection dont il faut le remercier . Il faut ,d
’autre part,féliciter la population de Québec qui s ’est em
pressée de se rendre au désir de son premier pasteur en s ’abstenant d ’assister à une repr ésentation essentiellement immoraleet
,du reste
,absolument dénuée d ’art . D ’ailleurs
,comment
une pi èce de théâtre peut—elle être artistique et s ’écarter desr ègles de bienséance et de saine morale qui sont de mode pourles dramaturges comm e pour le reste des mort elsr Certains art istes
,ou r éput és tels
,se méprennent assur é
m ent sur la mentalit é des auditoires auxquels ils s ’adressent .Pour nous
,au Canada
,nous avons la fort désagr éable besogne
de nous protéger contre la cohue des émancipateurs exotiques
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 1 29
qui ont entrepris notre éducation moderne en toutes choses— comptant bien que cette tâche les fera vivr e anos dépenset qui nous apportent
,quelquefois sous le manteau de grandes
r éputations,ce que le théâtre français a de moins recomman
dable et aussi de plus dégoûtant . Ils comptent sur la fouleinnombrable des badauds
,touj ours prête à s
’extas ier devant
l’impr évu et surtout devant ce qu ’elle ne comprend pas .Pour ceux— là
,quand ils croient avoir vu quelque chose d ’extra
ordinaire,même si cela a pu troubler leur conscience
,toute
leur appréciation se r ésume à cette exclamation stupide d ’unde leurs congénères au sortir d ’une repr ésentation louchedonnée à Montréal par une cél èbre vieillesse Au pointde vue art
,c ’est extra
Songez donc Et qu ’une voix autoris ée s ’él ève et protestecontre ce qui est un attentat à la morale en même temps qu ’aus ens artistique véritable
,vous en entendrez quelques—uns pro
tester au nom du progr ès et gémir contre ce qu ’ils appellentune intol érance aveugle . Aux Etats—Uni s , cette badauderie àl ’égard des esprits d ’outre—mer a dot é les b iblioth èques publiques de toute la litt érature fangeuse qui fait le déshonneurdu talent français . Au point de vue art
,c ’est extra et
l ’on achète . Mais là comm e ailleur s,les esprits droits
,les
citoyens soucieux de la morale et épris du beau,du bon et du
vrai,protestent contre cet assaut des consciences et s ’expriment
quelquefois avec une décision admirable . Nous nous rappelonsfort bien comm ent un grand j ournal américain appr écia lespi èces j ouées à Providence
,R . I .
,par Mme Sarah Bernhardt .
Le j ournal admettait bien le talent de l ’actrice,mais il aj outait :
Mais tout ceci n ’est pas la —haute tragédie . Et il s ’agit biende savoir
,assurément
,si l ’eff et qu ’elle produit sur ses auditoires
,
aussi boulversant et r éel qu ’il paraisse,est autre chose que le
décha înement d ’un trouble mol éculaire turbulent dans le syst ème nerveux.
Parlant de la Sorci ère une autre pi èce de Sardou quia déj à ét é interdite à Québec
,l e même j ournal dit Elle
contient_moins d
’horreurs que d ’autres pi èces de Sardou
,
— laTosca par exemple— mais elle en contient encore assezpour justifier M . Jules Lemaitre d ’appeler son auteur le Caligula du drame poss édant une soif insatiable de sang . C ’estencore de la Tosca que M . Lemaitre di sait On n ’y trouveque des gestes fous et des cris . Toute beaut é de forme etd
’expression y est impossible .”
1 30 LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE
Aj outez à cela une mise en sc ène où les choses les plussaintes sont profanées
,des dialogues où le scabreux du
langage le dispute à l ’ihdécence du geste,des rôles avec des
h éros couverts de sang,et vous avez déj à une pi èce horrible
même si elle est j ou ée par des gens de talent . Faites— là j ouerpar des cabotins
,et vous avez la Tosca telle qu ’on a voulu la
donner au théâtre Bennett . Ah cette intervention de l ’archevêque est fort heureuse en vengeant la morale elle a aussivengé l ’art .On dira que Québec est fort mal partagé sous le rapport
des th éâtres . C ’est vrai et il en sera ainsi tant que nousn ’aurons pas manifest é
,aussi souvent qu ’il le faudra
,notre
d étermination d ’exiger une qualification morale des pi èces donton voudra nous donner la représentation . Nous n ’aurons lesbonnes pi èces que quand on aura bien compris cela . Il est vraique sous ce rapport les espr its pourraient encore “ être divisés ,mais un grand pas aura ét é fait dans la bonne direction
,et
entre gens également soucieux du bien il sera tr ès faci le des ’entendre . Il ne faut pas oublier que la coutume , chez nous ,si étrange que cela soit
,admet au théâtre les j eunes filles et les
enfants . Il ne faut pas que le père de famille ait à rougir dece qu
’entendra la j eune fille assise à son côt é . Du reste
,l ’ha
bitude du théâtre n ’offre pas que le danger de ce qu ’on peut yentendre ou voir . Il y entre beaucoup d ’autres considérationsque nous ne nous attarderons pas à signaler ici . C ’est uner écréation dont il faut user avec mesure .
Actuellement,nous courons peu de risques de commettre
des excès sous ce rapport . Avec les représentations de vaudeville idiot que nous donnent , depuis le commencement de lasaison
,des troupes américaines de troisi ème ou quatri ème ordre
,
il est douteux que la passion du théâtre ne passe chez nos gensa l ’état épidémique . Nous avons cependant
,vu des gens
revêtir leurs habits de gala pour aller applaudir des j ongleur s,
des él éphants dress és et des chiens savants
Léon Kemne r.
1 32 LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE
américaine a su déj a reconnaître en lui décernant le glorieuxsurnom de fondateur du Wisconsin— father of the Wi sconsi n .
”
Il ne perdit j amais les convictions religieuses de sa j eun esse
,et vers la fin de sa vie il aida généreusement les prêtres
dont le nombre devenait moins grand et s ’ef força , quand cef ut possible , d
’assurer leurs services à la petite populationqu i s
’était group ée autour de lui .Jean Bapti ste Cadot
,bien que d ’une personnalit é moins
éminente,fut le dernier comm andant français et le premier
c ommandant anglais au Sault Ste Marie,et p endant des années
r esta à la tête du groupe qui s ’était établi là..Bien différent de ces deux homm es fut Charles Reaume
,
i nsoucieux et extravagant,échouant dans sa j eunesse comme
négociant au Canada,abandonnant femm e et foyer
,fait pri
s onnier par les américains sur le St Laurent,puis de nouveau
à Vincennes,se fixant enfin à la Baie Vert e (Green Bay) où
i l fut nomm é—
j uge sous le régime anglais et continua ensuitep endant près de trente ans à adm ini strer la justice sous ler égime républicain . Sa science de la loi
,française
,anglaise
ou américaine,n ’était pas considérable
,mais on n ’ était pas
exigeant dans ce poste nouveau,et l ’impart ialit é de l
’homme,
de ème que la f acilit é de son jugement à discerner le mérited
’une cause servaient davantage les int érêts de ceux quiavaient à se présenter devant son tribunal . Mme Kinzie ( 1 )r aconte l ’anecdote suivante sur son compte Deux hommescomparaissaient un j our devant R éaume. Le juge écoutepatiemment la plainte bien accentuée de l
’un,et la d éfense
non moins énergique de l ’autre . Après l ’interrogatoire dest émoins , il se l ève avec dignit é et prononce la sentence suivante Vous êtes tous les deux dans le tort vous
,Boisvert
,
le demandeur,vous m ’
apporterez un voyage de foin , et vous ,Cr èle
,le défendeur
,vous m ’
appofi erez un voyage de bois .La cause est r égl éePlusieurs autres Canadiens- français furent investis de la
d ignit é judi ciaire à cette époque recul ée et parmi ceux—là
M . Tass é mentionne Joseph Rolette , Jacques Porlier , FrancisB outhillier
,Michel Brisebois et Nicolas Boivin .
Porlier se destina d ’abord a la prêtrise
,mais il quitta le
s éminaire pour aller dans l ’Ouest . Il était sans nul doute,
en 1 820,le citoyen le plus important de la Baie Verte . Ses
( 1 ) L’
anecdote es t emprun tée à l ’ouvrage deMm e K in z ie : Waubm, qu i
e st sem é de t ra i t s curieux sur les comm en cem en ts du Nord Oues t .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 1 33
man 1 eres affables l e rendirent cher à tous et , avant de montersur le banc il avait le premier rendu à ses%on ci toyens le servi ceessentiel d ’organiser une école r éguli ère . Il a laiss é un nomsans tache et une mémoire respect ée Il r emplit la chargede confiance a laquelle on l ’avait appel é avec intelligenceet int égrit é et a la satisfact on un i verselle du public . C ’estafin de mi eux s ’acquitter des devoirs de sa charge qu’il tradui si t en français les lois du Wisconsin .
Joseph R olette est un autre j eune canadien qui,laissant
de côt é ses études classiques et les études plu ° s érieuses verslesquelles ses parents le poussaient
,quitta sa famille établie
sur les bords du St . Laurent p our s ’en aller dans l ’ouest immense . Bien que le commerce l ’eût amené sur le territoireaméricain
,ses attaches politique s étaient anglaises (British)
et lorsque la guerre de 1 8 1 2 éclata il prit une part énergiqueaux opérations de l ’ouest . C ’est sur son conseil que les fortsde Makinac et de la R ivi ère du Chien furent enl evés aux
Américains . Lorsque la paix fut r établie,R olette se fixaËà
la Prairie du Chien où une population canadienne considérableétait d éjà établie . Là il se livra au commerce
,avec beau
coup de succ ès,et acquit une grande influence sur les Indiens .
Plusieur s en devinrent si jaloux qu ’ils persuadèrent à l ’officierqui commandait le fort à la Prairie du Chien de le bannir dansuneîle éloignée . John Jacob Astor reconnut l ’habilet é de Roletteet en fit son agent en 1 820 . A part ir de cette date il fut undes homm es les plus éminents de cette partie du pays . Sesbateaux—marchands sillonnèrent toutes les rivi ères et tousles lacs pendant qu ’il d éveloppait son vi llage
,bâtissant une
scierie,encourageant les écoles et cul tivant une grande étendue
de terrain . Il était lib éral,généreux
,hospitalier
,touj ours
prêt à secourir les pauvr es et à tendre la main à ceux quiavaient besoin d ’aide pour arriver au succès . Il fut nomméjuge de son comt é et servit dans la guerre de Black—Hawok .
Rolette n ’était pas seulement le marchand le plus actif et leplus important de cette part ie du Nord—Quest , il en était aussile citoyen le plus éclair é et le plus instruit Sa soci ét é fulvivement recherch ée par tous les voyageurs de distinctionqu i visit èrent à cette époque la Prairie-du—Chien ; car sesmani ères étaient tout—à—fait courtoises
,et sa conversation
tr ès int éressante,nourrie d ’anecdotes et de bons mots . Son
prestige sur les sauvages ne fit que s ’accroître avec les années .Il était conn u de toutes les peuplades depuis Saint—Louis
1 34 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
j usqu ’à la colonie de lord Selkirk et depuis la rivi ère Ouiscons inj usqu ’à Mackinac . Les indiens l ’appelaient le roi .”
La colonie canadienne de la Prairie—du—Chien eut à soufi rir d ’une décision injuste des autorit és américaines par laquelle on leur enleva les
.terres qu
’i ls avai ent occupées et
améliorées pendant des années . Si Rolette fut un de ceuxdont les droits furent respect és
,il mourut pauvre cependant
en 1 842,après avoir cont ribu é plus que tout autre a rendre
son village important .
Milwaukee,la ville la plus active du Wisconsin
,avec son
vaste commerce de grain,reconnait connue son fondateur
le canadien Laurent Salomon Juneau . Il ne fut pas , a vraidire , son premier pionnier parce qu ’il y avait ét é préc édé en1 777 par Laurent Ducharme et plus tard par Laframboise
,
Chaput,Grignon et Beaub ien . Mai s l
’augmentation de cettecolonie
,le développement de ses ressources
,sont dus aJuneau
qui y construisit sa log-cabin en 1 8 1 8,au moment où les
bois revêtaient leurs couleurs automnale . Son énergie,son
activit é,son habilet é lui gagnèrent la confiance et l ’estime
des sauvages et son poste devint assez florissant pour attirerd ’autres co ons . Lorsque le terrain fut mis en vente en 1 830Juneau
,acheta cent trente acres sur le bord de la rivi ère
au nord de la rue Milwaukee . Une ville prit bientôt naissance ,dont Juneau fut le premier maître de poste et le premier maire .La crise de 1 837 l ’arr êta comme elle arrêta plusieurs autresvilles nouvelles
,mais Milwaukee se ressaisit et continua de
progresser . La maison de Juneau fut la premi ère chapellecatholique mise à la disposition des habitants qui s ’y rassem
blaient autour du Rev. M . Blonduel . Lorsque , quelquesannées plus tard
,i l vit la ville qu ’il avait fondée élevée par le
Saint Père a la dignit é de ville épiscopale,il donna à Mon
seigneur Henni,un site magnifique pour sa cathédrale . Avec
le même esprit de générosit é il construisit un palais de justicesur un terrain qu ’il avait donné à la ville
,puis il la dota d ’un
parc splendide . Son naturel généreux et sa foi simple , quine le protégeaient pas contre les agioteurs sans scrupule , leconduisirent a la fin au bord de la banqueroute , et Juneause trouva ruiné . Il vendit sa propri ét é , paya ses dettes , et
se retira à Theresa,dans le comté de Dodge où il reprit son
ancienne vie de commerce . Jouissant touj ours du respectde tous dans l ’Etat
,il fut délégué à la convention démol
crat ique présidentielle en 1 856 . Il mourut peu de temps
1 36 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Convaincu que son titre , venant des sauvages , serait pour lemoins précaire
,Dubuque résolut de le revêtir de toutes les
formes de la loi . La rive ouest du Mississippi se trouvaitdans la Louisiane
,province alors suj ette à. ’
Espagne . En
1 796,Dubuque présenta à Carondelet
,le gouverneur espagnol
à la Nouvelle Orl éans,une petition demandant la concession
des terres sur lesquel es se trouvaient les mines qu’il avait
d écouvertes . Le gouverneur étudia la chose,et le 20 no
vembre 1 796,accorda en bonne et due forme la concession
demandée . Afin de pouvoir développer la mi ne espagnole,
”
comme elle était appel ée,Dubuque vendit une partie de son
terrain aux Chouteaus de St . Louis,et lorsque la Louisiane
fut transférée aux Etats—Uni s,il eut soin
,dans le t rait é signé
avec les Sacs et les R enards,d ’inclure une clause garantissant
ses droits . Il continua d ’exploiter les mines jusqu ’en 1 8 1 1 ,jusqu ’
à. sa mort,et on dit qu ’il a ét é le premier homme qui
ait pu engager les indiens à travailler . Les indiens lui firentdes funérailles avec toute la pompe qu ’ils conn aissaient
,ils
l’
enterr èrent sur une haute colline,et pendant des années
ils allumèrent à la nuit tombante une lampe funéraire sur satombe qui devint une sorte de lieu de p élerinage .
Davenport,dans le même Etat
,reconna ît comme son
fondateur le canadi en An toine Leclerc,qui arriva à.Peor ia vers
1 809,un peu avant la destruction de cette ville par le cruel
Craig . Il s ’installa plus tard à Rocky Island où il fut rej ointpar le colonel Davenport . Tr ès influent auprès des sauvagesil obtint de larges étendues de terrains
,des Sacs et des Renards
et plus heureux que Dubuque,ses droits furent reconnus et
respect és par le gouvernement américain .
En effet,apr ès la mort de Dubuque , le gouvernement
américain,malgr é
°
la concession faite par les indiens et confirm ée par les autorit és espagnoles
,s ’empara de la mine
espagnole ne laissant plus que le nom de Dubuque pourrappeler l ’histoire de cette fondation .
Not es h is t or ique s s ui r l’Eg l i s e Cat ho l ique dans l’
0 regon
pendant les de rn ie rs 4 0 ans , Par Mgr . F . N . Blanchet ,Portland ,
Oregon , 1 878 ,1 2 m o , ,
1 86 pages . (Cathol ic Quarter ly R eview,
Dans les Notes historiques sur l ’église catholique dansl’Oregon que nous pouvons
,sans cra1 ndre de nous tromper
,
attribuer au vénérable évêque de l ’Oregon ,nous retrouvons
LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE 1 37
les pionni ers canadiens,dans cet Etat et le territoire adj acent
,
leur industrie et leur courage,aussi bien que cette fidélit é à. la
religion qui les porta a aller aSt—Boni face demander un prêtreà Mgr Provencher
,alors que cet apôtre ne put que les ren
voyer à Québec . Le R év. M . Blanchet r épondi t à leur appel . Pionnier et prêtre , il rassembla ces canadiens éloignésautour de l ’autel
,et c él ébra la messe pour la premi ère fois dans
l’Oregon le 1 4 octobre 1 838 . Pierre Chrysologue Pambrun ,un pionnier de F ort Wallawalla
,Joseph Gervais
,Etienne
Lucier,Pierre Bel ègue, à F ort Vancouver , et Simon Plamondon ,
à Cowlitz,reçur ent le prêtre à bras ouvert s
,et leurs maisons
furent les premi ères chapelles du pays et plusieurs qui étaientdéjà établis dans le pays depuis au moins dix ou douze anseurent la cons olation d ’entendre la messe et de s ’approcherdes Sacrements .
Ces notes historiques nous montrent la vie des pionniersCanadiens de l ’Oregon ,
les progrès de la reli gion parmi eux,et
la part qu ’ils ont prise dans le développement et la prospérit éde la côte du Pacifique
E . N . Quinnette est actuellement ( 1 879) maire d’
Olympia,capitale du territoire de Washington . Joseph Perreault estagent territorial de l ’instruction publique dans l ’Idaho
,et on
renéontre beaucoup d ’échevins
,de sh érifs
,etc .
,etc . Presque
tous les Canadiens des Etats—Unis,à part les ouvr iers de fa
briques de la Nouvelle Angleterre , sont citoyens américains .Les b iographies publi ées par M . Tass é n ’
embrassent quel’Ouest
,mais l ’él ément canadien
,comm e nous l ’avons vu
,ne
s ’est pas borné aux nouveaux Etats et aux Territoires . Il aaugment é consid érablement pendant les derniers dix ans
,et
nous trouvons dans le recensement de 1 870 qu ’on porte àle nombre de ceux qui
,nés dans l ’Am ér iqueBritanni que ,
sont venus aux Etats—Uni s . Les rapport s ne distinguent pasles Canadiens—F rançais des autres
,mais ce sont ces derniers qui
forment la masse de ces innn igrants ; plusieurs même sont inscrits connue français et ne sont pas
,par cons équent
,inclus dans
ce chiffre Les Canadiens—F rançais doivent former le dixi èmede toute la population d ’origine étrangère aux Etats-Unis .Le plus grand nombre
,est dans le Michigan
,où il forme
8 pour cent de la population New York en a le Massachusetts
,5 pour cent de la populat îon de ce vieil
Etat des puritains et des s éparatistes . L’Illinoi s vient ensuite
avec Le Vermont avec ses en a la plus forteproport ion de tous les autres Etats le Wisconsin en a
1 38 LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE
tandis que le Rhode Island,la Pennsylvanie
,la Californ ie
,le
Connecticut,le New Hampshire
,l’
Ohio,le Minnesota et l ’l owa
en ont de à
Le nombre des canadiens qui ont émigré de 1 840 à 1 850est de cette émigration suivit innn édiatement la R ébellion de 1 837.
M . Gagnon,r édacteur du j ournal Le Travailleur et
d ’autres messieurs,qui organis èrent la grande manifestation
de Montréal en 1 874,dans le but de lancer un mouvement de
rapatriement,affirment qu ’il y a aux Etats—Unis cana
diens,et enfants de canadiens
,qui ont conservé leur langue
,
leurs traditions,etc .
Quarante mille canadiens se sont enrôl és dans les arméesde l ’Un ion pendant la guerre de S écession environ ontservi dans les armées du sud
,en qualit é d ’officiers .
Cette population était àa peu près exclusivement catho
lique,et
,a cause de cela
,expos é e aux railleries et aux attaques
du fanatisme plusieurs devinrent ou honteux de leur religionou indifférents
,principalement dans les centres où ils trouvèrent
les églises remplies,et les instructions données dans une langue
qu ’ils ne comprenaient pas . Il leur manqua,aussi
,quelques
unes des cérémonies auxquelles ils étaient habitu és,et ils ne
se sentirent plus chez eux . Il leur fallait leurs églises à eux .
Ces églises ils les ont construites dans différents endroits oùleur nombre justifiait semblable entreprise
,et des prêtres cana
diens,formés comme tant des nôtres l ’ont ét é pendant des
années au Grand Séminaire fondé par Laval à Québec,ou à
Montréal par les fils d ’
Olier,desservent leurs compatriotes dans
diverses parties des Etats-Unis . Ils ont des écoles,des acadé
mies,dirigées par des communaut és sœurs de celles du Canada
ou qui leur sont affili ées . Les Clercs de St—Viateur ont uncollège à Bourbonnais les Jésuites dans l ’Etat de New—Yorkles Prêtres de la Sainte—Croix dans l ’Indiana les Pères Oblatssont affili és au Canada et plusieurs de leurs religieux sont néset ont ét é instruits dans cette vieille province catholique . LesSœurs de la Chari t é
,fondées pa1 Madame d
’
Youvi lle a Montr éal
,et ordinairement appel ées Sœurs Grises , ont des maisons,
entr ’autres,a Salem et Lawrence Mass
,Ogdensburg et Platts
burg,N .
—Y.,St—Johnsbury
,Vt .
,et une mi ssi on parm i les sau
vages au Lac du Diable,dans le Dakota . Les Sœurs de la
Congrégation de Notre—Dame,fondées aMontréal par la Vén é
rable Marguerite Bourgeoys , dont on presse vigoureuse‘ment en
1 40 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
que la canadienne a une meilleure notion de l ’obe1 ssance etqu ’elle est plus respectueuse des liens de la famille .Ce n ’est pas seulement au moyen de leur clergé et de
leurs communaut és religieuses que les canadiens se sont ef forcés de garder leur identit é
,mais encore au moyen de cette
grande puissance moderne,la presse . Parm i les j ournaux
du vieux Massachusetts,on compte Le Protecteur Canadi en
,
Le Jean Bapti ste, Le Travai lleur . New York a La Patr i e
Nouvelle le Rhode Island,Le Courr i er
“
Canadien l’Illinois
,
Le Courr i er de l’Illi noi s ce qui prouve que l ’ él ément cana
dien se compose d ’une population qui lit,et qui ne manque
ni d ’activit é,ni d ’énergie à subven ir aux besoins de sa nou
velle situation .
”( 1 )
Pour le grand nombre des ignorants de notre pays quis’imaginent que les canadiens parlent un patois inintelligibleà l ’oreille ou l ’œ il d ’un F rançais
,ce sera peut— être leur ap
prendre une nouvelle que de leur dire que les art i cles de cesj ournaux sont écrits avec une grande pureté de style et avecbeaucoup de force et d’
éloquence.
M . Tass é,se limitant à l ’Ouest , ne parle pas de la Loni
siane,et
,pourtant
,dans cet Etat
,les él éments canadien et
français sont si intimement mêl és qu ’i l ne serait pas facile
de les séparer l ’un de l ’autre . Ses fondateurs et ses premiersgouverneurs
,d
’
Ibervi lle,de Bienville
,La Motte Cadillac
étaient canadiens ou depuis longtemps identifiés avec leCanada .
Plusieurs officiers américains s’alli èrent par le mariage
à des familles canadiennes dans l ’Ouest et dans le Sud,et
leurs descendants,portant des noms anglais
,se montrent
encore fiers de leur descendance canadienne—française . Legénéral Macomb
,de l ’armée des Etats—Unis
,descendait par
sa mère des Navarres,de Détroit . Le commodore Barrett
,
dans la marine,réclame pour ses ancêtres la famille de Jumon
ville,l ’officier canadien tu é par Washington dans l ’Ohio .
Ainsi le sang canadien est déjà r épandu dans toute lapopulation ; et comme l ’imm igration venant du Domin ionvoisin va probablement continuer
,cet él ément va augmenter
en importance . Le dernier si ècle a vu plus d ’un changementil n ’en a peut-être pas vu de plus étrange que cette influence
( 1 ) Depui s c‘
et te époque la pres se fran co—am ér i caine a pr i s des développem en ts con s idérables . Elle ne com pte pas m oin s de c inq journaux quot id ien set d
’
une vi ngtaine de journ aux mensuels , hebdom adai res etc .
LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE 1 41
du Canada sur les Etats-Unis . La Providence semble avoirpris plaisir à donner aux calculs et aux desseins des hommesles r ésultats mêmes qui étaient contraires à leur ambitionet à leurs efforts . Depuis la derni ère décade du dix— septi èmesi ècle les colonies américaines et sp écialement celles de laNouvelle Angleterre s ’appliquèrent avec toute la fureur d ’unz èle fanatique à écraser le Canada . Des expéditions
,sous la
direction des mini stres,furent lancées avec mission de détruire
à coups de haches toute image de Jésus Crucifiéque l ’on pourrait trouver dans les églises catholiques de laprovince française . Les outrages connn i s de sang-froid dansles édifices consacrés au culte
,et qui ont droit au respect
d ’après toutes les lois internationales,sont faits historiques
,
et excit èrent alors connue maintenant la réprobation de tousles esprits droits . Le Canada tomba a la fin
,épuis é
,non pas
pour avoir manqué de bravoure dans les combats,mais parce
qu ’il fut abandonné par un roi méprisable . Al ors la Providence emp êcha ce qui paraissait inévitable . Le catholicismene fut pas détruit
,le Canada resta fidèle à sa foi et il l ’est
en core auj ourd ’hui . Les colonies dans leur rage fir ent dece fait une des grandes raisons pour lesquelles elles levèrentl’étendard de la révolte . Elles commencèrent la r évolutionomme ultra Protestants
,mais quand elles eurent besoin de
secours,elles mirent de côt é leur ul tra protestantisme pour
parler le language de la lib éralit é et de la tol érance devantles envoyés
,l ’armée et la flotte de la France catholique . Les
nouveaux gouvernements locaux et le nouveau gouvernementcentral se sont constamment efforc és d ’atteindr e ce point quel’Etat ne fasse violence aux convictions d ’aucun citoyen
,
homme,femme ou enfant
,et n’impose a. personne aucune
doctrine religieuse,aucuns systèmes
,aucune mani ère de voir
Pendant ce temps,le Canada envoie en ce pays ses fils
catholiques,ses prêtres
,ses religieuses d évouées . La Nou
velle Angleterre qui voulut avec tant d’
acharnement écraserle Canada et le catholicisme canadien
,voit auj ourd ’hui ses
villes peupl ées de canadiens catholiques,ornées d ’églises et
de couvents . Les Cotton,les Mathers
,les Endicotts et les
Winthrop ont— ils j amais pu rêver un pareil r ésultat ? Out-ilspu prévoir que lorsque leur calvinisme rigide et anti— chr étienaurait fait place a l ’un itar ian isme
,il y aurait catho
l i ques canadi ens dans le Massachusetts , dans le NewHampshire
,le double de ce chiffre dans les New Hampshire
1 42 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
Grants,
dans le Rhode Island et autant dans le Connect icut
,dans le district du Maine
,vivant de leur vie
canadienne,avec églises , prêtres , religieuses , reproduisant la
province abhorrée sur ce sol même de la Nouvelle Angleterrequ ’ils avaient essayé de garantir contre tous dissidents par unemuraille de feu . Qu ’il vint des catholiques des autres pays c ’entét é à leurs yeux assez mal déj à ;mal , tr ès mal la venue des irlandais catholiques détest és suffisamment horrible la présencedes catholiques originaires de la Nouvelle Angleterre , et ily en avait beaucoup mais rien
,croyons—nous n ’eut davan
tage tourné le sang de ces bonnes âmes de la Nouvelle Angleterre au commencement du si ècle dernier
,que la seule pensée
de la possibilit é qu ’un j our viendrait où canadienscatholiques s ’
établi raient sans être molest és sur le sol sacré dela Nouvelle-Angleterre.
1 44 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Sur la sc ène d ’un théâtre très coquet,une épinette de
grande dimension était plac ée une r0ue,mue par une mani
velle,était fixée sur l ’un des côtés une j olie blondinette de
treize ans,assise devant le clavier
,attendait .
C ’était Babet,la fille du sieur Raisin .
Lorsque les places furent garnies de spectateurs,l ’inventeur
prit la parole— Mesdames et Messieurs
,dit—
,i l j ’ai l ’honneur de vous pré
senter l ’eépinette enchant ée annonc ée à la porte ; Mlle Babet ,ici présente
,va avoir l ’avantage d ’exécuter devant vous un
menuet que l ’épinette rendra aussitôt son pour son ,note pour note.
Le public paraissait incrédule .
La fille j oua le menuet avec beaucoup de goût le sieurR aisin tourna la manivelle , aussitôt l
’
épinette reproduisit lemenuet au grand ébahissement de la foule qui t émoigna soncontentement en applaudi ssant bruyamment .
— C ’est incroyable,di t un bourgeois ; qu
’elle admi rableinvention
— Cela tient de la sorcelleri e,opina une vieille demoiselle
qui ne semblait pas ressur ée.
— Je ferai remarquer au public,dit le sieur Raisin
,qu ’il
n’
y a aucun truc , vous pouvez tous vous en assurer .— Je vois ce que c ’
,est di t un spectateur
,l ’éepinette rec èle
dans l ’int érieur un appareil qui ennuagasine les sonS ° j e sui smécanicien
,cela ne me parait pas impossible .
—Mesdames et Messieurs,reprit le sieur R aisin
,j e prie les
membres de l ’honorable soci ét é de voul oir bien désigner unair parmi les airs connus Mlle Babet le j ouera aussitôt etvous pourrez vous convaincre que l ’épinette enchant ée rendindifféremment n ’importe quel morceau .
Veui llez désigner un air .— Je demande une gavotte
,dit une j eune femme .
—Oui,oui
,une gavotte
,approuva le public .
La fillette s ’avança gracieusement sur le devant de la sc ène .— Je vais j ouer
,di t—elle
,la Gavotte deM lle de Condé.
Elle s ’ass i t devant le clavier et exécuta le morceau demandé ;quand elle eut fin i
,son père tourna la manivelle : tout de suite
l ’epinette rendit trait pour trait la gavotte .Ce fut un enthousiasme indescriptible on n ’avait j amais
r ien entendu de semblable .Le sieur R aisin j ouissait de son triomphe.— Désignez un autre morceau
,di t—i l .
Un garde—française demanda le Vi rela i de la Rei ne Blanche
LA REVUE FR ANCO-AMER ICAINE 1 45
Babet acc éda à son désir , et l epinette le rendit sans en omettreune note .Des bravos éclat èrent .La séance était terminée les spectateurs se retir èrent
,ils
furent aussitôt remplac és par d ’autres la renommée de l ’épinette enchant ée se r épandit dans tout Paris et la foule aff luadans la baraque .Mme Raisin encaissait le maximum des recettes .Après la foire
,le sieur R aisi n
,avec sa famille
,s ’installa à
Paris pour se reposer il comptait exhiber son invention enprovince et se préparait à partir
,quand un courrier venan t de
la cour lui apporta un message .L ’ex—organiste , très ému , l
’
ouvri t en tremblant il lut :Le roi ayant entendu parler de l ’épinette enchant ée du
sieur R aisin,désire la voir l ’inventeur est invit é à. se rendre
au château de Versailles demain avec son instrument .Cette lettre lui servira d ’introduction .
L’Intendant du Roi .
Le sieur R aisin appela aussitôt sa femme il exultait .— Le roi
,dit— i l
,le grand roi me fait mander au palais de
Versailles il veut entendr e l ’épinette enchant ée quel honneur pour nous ma fortune est faite .Mme R aisin et Babet partageaient sa j oie .Le sieur R aisin ne pensa plus qu
’
à paraître dignement devant le roi sa femme passa en revue sa garde—robe et lui prépara ses plus beaux habits .Le lendemain une voiture du palais vint le chercher et trans
porta l ’épinette.
Il installa son instrument dans un salon et attelrdi t .Il semblait inquiet .Un laquais ouvrit les portes et annonça le roi .Louis XIV parut
,accompagné de la reine
,des princes et
princesses de sang , et de tous les hauts personnages de la cour ,ministres
,maréchaux
, genti lshom es,courtisans .
R aisin s’inclina
,fort troubl é le roi lui parla avec bien
vei llance, le complimenta sur la grâce de sa fil lette et lui demanda de présenter son invention .
Babet se plaça devant le clavi er et j oua un air religieuxson père tourna la manivelle
,aussitôt l ’epinette r épéta l ’air .
Le roi exprima sa surpri se,tous les assistants renchérirent .
Il demanda un autre morceau .
Babet j oua l ’air de Vi veHen ri IV,que l ’épinette reproduisit .
1 46 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE— C ’est singulier
,dit le roi par quel ingénieux mécanisme
c e clavecin pout— i l rendre les sons Cela tient du prodige .Quel que soit l ’air que l ’on j oue
,il peut le reproduire
— Oui,Sire
,dit Raisin .
Le roi pria une princesse de j ouer de l é pinette .Raisin semblait êtreSur des épines .La princesse s ’ass i t devant le clavecin et j oua un air d’
Ar
m i de,de Lulli .
L’
êepinette le reproduisit sans en omettre une note .Une autre princesse exécuta une ariette
,que l ’épiuette tra
dui sit avec le même succ ès .— C ’est admirable dit le roi cette invention est la plus
remarquable de mon règne .Raisin savourait son triomphe .Le roi lui octroya une pension de quatre mille livres .— Maintenant
,dit Louis XIV
,veuillez nous montrer le
savant mécanisme de votre appareil .— C ’est . . que . balbutia Raisin
,qui pâlit .
— Faites—nous connaître,reprit le roi
,le principe sur lequel
repose votre invention .
Sire,dit R aisin
,j e vous en prie ne rn
’en demandez pasdavantage : c ’est mon secret .
Il n ’y a pas de secret pour le roi,dit Louis XIV ouvrez
votre instrument .Je n ’
ai pas la clé .
Qu’
à cela ne tienne , dit Louis XIV ,j e vais le faire ouvrir
par le serrurier de la cour .On alla quérir le serruri er qui décloua la caisse renfermant
le mécanisme de l ’épe iuette et l’on aperçut
,assis dans l ’inté
rieur,un enfant de s i x ans .
Un deuxi ème clavier était plac é dans la cai sse c ’étaitl ’enfant qui reproduisait les airs j oués sur l ’épiuette.
Le roi ne put s ’empêcher de rire et toute la cour l ’imita .
Le bel enfant s’
écr iai t la reine qui prit par la main lepauvre petit tout tremblant .
L ’idée est ingénieuse,dit le roi ; où donc est l ’inventeur
Le sieur R aisin,craignant que sa supercherie n ’ait courrouc é
le roi,cherchait à s ’enfui r ; on le ramena .
Sire,dit— i l
,pardonnez—moi .
Le roi sourit et le rassura en lui maintenant sa pension .
L ’enfant,fil s du sieur Raisin
,fut combl é de cadeaux par la
r eine et les princesses .Aujourd
’hui
,l’
idée originale du sieur R aisin est r éalis ée .Eugè ne Four r ie r.
1 48 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Et j e vous réponds qu ’elle en j ouissait , RoberteLe vicaire n ’avait pas achevé de hausser les épaul es qu ’il putapercevoir la pauvre petite évoluant
,ivre de vanit é
,au milieu
d ’un véritable bazar .
Il y avait de tout,dans cette chambre de prem1 ere commu
niante . .une bonne demi—douzaine de b énitiers . . sur unecommode
,un lot de statuettes en ivoire
,en bronze
, polychrômes
. sur la table,un assortiment de chapelets
,de médailles
,de
cadres en peluche ou en bois sculpt é .Le rayon de la bij outerie était abondamm ent représent é par
un guéridon surchargé de bracelets,de montres
,de colliers
,de
boucles d ’oreilles,d
’
agrafes , d’épingles
,de broches
,de boutons
,
de cachets,etc .
,etc .
A côt é,sur un canapé
,un déballage de maroquinerie
,des
missels,des imitations
,des porte—monnaie
,des porte— cartes
,
des portefeuilles . . le tout fleurant fort le cui r de Russie ou lechagrin . . le tout chiffré
,armori é
,en acier
,en argent
,en or
Plus loin,la cristallerie . . verres d ’eau
,services à. thé
,dé
j enners,etc
L ’abb é n ’eut que le temps de se retenir,il allait s ’écr ier
— C ’est donc la foire,ici
C’
eût ét é évidemment maladroit , car la mère et la fille,
l ’une comme l ’autre,étaient dans un ravissement dont il eût
été parfaitement impossible de les faire descendre .— Savez-vous combien il y en a— Une cinquantaine .
— Vous êtes ldin . . quatre-fi ngt-dix— sept .La pauvre
petite a ét é combl ée . Des gens que nous connaissons àpa ne .
Tous ces cadeaux,en effet
,étaient soigneusement accompa
'
gn és d’une carte . .C
’était bien la vani t é mondaine qui atrouvé le moyen sacril ège de se glisser dans l ’acte le plus augustequi se pui sse accomplir . .Docile esclave de l ’orguei l , la modeici encore
,s ’étale triomphante
,étendant son action imb écile
sur des âmes de douze ans et leur dérobant odieusement uneattention qui devrait être uniquement absorb ée par Dieu .
— Alors,Roberte
,vous êtes bien contente d emande
l ’abb é pour dire quelque chose— Oh oui . . répondit l ’enfant
,j ’en ai trois de plus qu
’An
dr ée .
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 1 49
L ’abb é partit,étouf fant .
Ainsi donc,voilà ce que le monde faisait
,à présent , de la
premi ère communion des petites chr étiennes .Le prêtre deJésus—Chri st essayait , trois années durant , de les préparer , cesch ères âmes candi des
,au plus beau j our de leur vie
,et
,la veille
de ce j our,avec quelques miroitements d ’or
,avec quelques
reflets de nacre,avec
,sur tout
,la complicit é des amis et des
mères,la mode éclipsait tout cela .
N’
étai t-ce pas à désespérerComme l ’abb é lai ssait
,en un geste vague
,retomber son bras
décour agé,il songea que la petite du concierge faisait
,elle
aussi,sa premi ère connuuuion .
Il entra dans la loge . L ’enfant écrivait .
Et l ’abb é,s ’étant approch é
,lut ces lignes trac ées en gros
caract ères sur un cahi er de deux sousAujourd ’hui
,j e suis bien contente
,parce que
,demain
,j e
vais recevoir Jésus .Jean des Toure l les .
L’
idée de M lle j eanne
PAR S. BOUCHERIT
— Tu pourr as commencer cette distraction quand tu voudras . Après déj euner , je pense que tout ce monde—là serainstallé . Nous irons lui faire visite .
— Mademoise lle , Mademoiselle ! s ’eoria Jeanne quand sonpère fut parti , j ’ai une idée . Je ferai la maman avec lespetits Dubreuil . C ’est bien _
le devoir de la fi lle du patron .
Mais est-ce que ça ne pourrait pas com pter comme devoir devacances ?
On di t indi ff éremment,dans le pays : le château de Mont
bue l et la fabrique de Mon tbuel . L ’un comprend l ’autre .
C ’ est un ancien domaine seigneurial où se dresse , au mili eud ’un vaste parc très artistiquement dessiné , un bâtimentflanqué de deux ailes en saillie et , au mi lieu , d
’une tour , quia véritab lement grand air . A quelque di stance
,un mur ,
é levé par M . Vivi ers,clôt la propriété d ’agrément . Der
riere ce mur , une large cour ; au fond ,s
’ é lève la fabriqueavec tous ses services divers depuis les bureaux jusqu ’aux réf ectoire
,où les ouvriers cé libataires trouvent des repas sains
et a bas prix . Une seule porte dans ce mur sert de commun i cation entre le château et la fabrique qui , tout raprochés
qu ’ ils sont , n ’ en demeurent pas moins di stincts et séparés .M . Viviers seul a la clef de cette porte . Ce n ’ est pas parorgueil m al placé que lui
,anci en ouvrier
,veut mettre ains i
une barrière entre ses ouvriers et lui ; mais il a voulu fai renettement deux parts de sa vie : le travai l et les joi es dufoyer , le patron et le père .
Les deux porti ons de ce peti t royaume communiquentencore par un bâtiment frai s
,coquet
,agréab le à l ’œi l qui ,
construit à. l ’ extrémi té du mur de séparation,s ’étend égale
1 52 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
m eucer , pui squ’ i l était l ’aîné . Mais celui-ci mérite une m en
tion parti culi ère .
C ’était un grand garçon qui marchait sur dix-sept ans , qu iavait l ’air timide et gauche , les bras tr0 p longs , la démarchedégingandée avec les yeux un peux hagards et , sur les lèvres ,un perpétuel sourire d’une exmess ion niaise . Dans son eu
f ance ,il avait eu
'
une fièvre typhoïde très grave , dont onl ’avait sauvé par miracle . Corporellem en t , il n ’ en avai t conserve aucune trace . Son esprit seul gardait ‘ l ’ empreinte decette terrib le crise . Il n etait pas idiot ; c ’
eût été beaucouptrop dire ; mais son inte lligence ne s ’ était pas déve loppée enproportion de son corps . E l le avait été comme arrêtée subitement par la maladie . I l comprenait bien
,sans doute , ce
qu ’on lui disait,mais i l répondait rarement
,parlant très len
tement,en cherchant les mots
,difficilement amenés par sa
mémoire rebel le . Il demeurait sombre,enfermé
,peu com
mun i cati f , très doux ,très bon
,très tendre , mais comme
honteux de son infériorité et fuyant la vue de tout nouveauvisage . I l ne savait rien
,pas même la lecture
,pas même
le catéchisme . Ses parents avaient dû le retirer de l ’écoleoù on avait essayé de le mettre . Un instituteur brutal etsans plus de tête que de cœur
,au lieu de l ’attirer par la dou
oeur,l ’avait effarouché par sa rudesse , et le pauvre enfant
étai t rentré chez lui e ff aré,buté
,se sentant un obj et de m é
pris et de raillerie de la part des autres garçons de son âge ,
et ayant dans l ’ espri t juste assez de lueur pour comprendreson humiliation et en souf frir . I l avait vécu
,depui s
,d ’une
sorte de vie mécanique , pas gênant , cherchant même a serendre utile , quand i l le pouvai t , dans les besognes machinales du ménage , mais demeurant le plus souvent seul , assisdans que lque coin , regardant pendant des heures le cie l b leuou que lque site champêtre
,les bois surtout qu ’ il paraissait
aimer d ’une tendresse particulière . On eût dit alors,ma!
gré son inertie extérieure , que son regard s’
an im ai t par in stants d ’une flamme et qu ’ il passait dans cet espr i t engourdides impressions mystéri euses qu ’ i l ne savait pas traduire .
Puis la lumi ère s ’
éteignai t et i l ne restait plus qu ’un pauvreêtre sans parole et qu ’on pouvait croire sans pensée .
Le déménagement et l ’arri vée à. Montbuel l ’avait fortagi té . La vue de li eux nouveaux lui faisait instinctivementprésager la vue de nouveaux visages
, ce qui était sa grandeterreur . Pourtant , quand i l vit la coquette maison ,
tout
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 1 53
entourée de verdure qui lu i faisai t une enve loppe parfumée ,et qu ’ i l aperçut les grands arbres du parc et les bois qui yfai saient suite sur les coteaux voisins , il eut un sourire sati sfait et confiant . Mais cette heureuse disposition dura peu .
Dubreuil,sortant du cabinet du patron , arr i va et , de sa vo i x
de commandant , prononça— A la besogne ! Qu ’on range tout , les mal les , les paquets !Que tout soit mis en ordre et vivement ! Si on a faim , ou
mangera un morceau sur le pouce . Mais a midi , tout lem onde sur le pont et en tenue numéro un ! L e patron m ’adi t qu ’après son déj euner il nous ferait l ’honneur de venirnous rendre visite avec ses enfants . Ainsi il ne s ’agit pas deflâner . Leste ! A la corvée !E t tout aussitôt ce fut Un remue -ménage indescriptib le .
Père,mère
,les fi llettes
,Pierre lui-même se mirent à
l ’œuvre,Vidant les mal les à. grande brassées , empilant tout
dans les armoires inconnues ; ou rangerait plus tard . Onbalayait
,on astiquai t . I l n ’était pas jusqu ’au gros joufflu
qui ne cherchât à aider en essayant de t raîner , tout en titubant
,des paquets plus gros que lui , mais qui , voyant qu ’ i l
n ’y pouvait pas parvenir , se dit avec une raison précocequ ’ i l ne faisait que gêner les autres et qu ’ il serait infinimentmieux
,pour eux et pour lui
,dans ce grand fauteuil de velours
grenat,le plus beau meuble de la maison
,qui semb lait lui
tendre ses bras moelleux . Que lle joie quand ,après une
gym nest ique hérorque , i l y fut grimpé ! Quelles dé lices dedanser sur les ressorts qui le faisaient rebondir ! Quels crisheureux et hélas ! imprudents ! Car ils attirèrent l ’attentionde la mère dont la main était aussi leste que le cœur étaitbon , et une vigoureuse taloche fit comprendre au pauvrejou fflu que les fauteuils de ve lours grenat ne sont pas faitspour la danse des enfants , mais réservés au patron ,
quand i lfait par hasard a son surveillant la faveur de venir le voir .Enfin ,
dès onze heures , tout était prêt , mis en place ,et la
maison resplendissait de propreté . On y eût en vain cherchéun atôm e de poussière . Les malles vidées avaient disparudans le grenier . Les murs 8 etaient ornés du musée intimede la famille , des portraits photographies , des en luminuresde batailles , et au m ilieu , à. la place d
’honneur,du brevet et de
la médaille militaire de Dubreuil .L ’organisation des choses était faite
,on songea aux indi
vidus . Il s ’agissait de se mettre , suivant l ’ordre du père , en
1 54 LA REVUE FRANCO-AMER ICAINE
tenue numéro un . Mme Dubreui l reVêti t sa robe de taffetasnoi r et sa chaîne d ’or qui ne voyai t le jour que dans lesgrandes circonstances . E lle m i t à son cou une broche dechrysocale ornée d ’un e photographie de son mari . L es deuxfillettes furent vêtus de b lanc avec des rubans b leus dans lescheveux
,le costume qu ’e lles portai ent
,a leur derni ère r és i
dence,le j our de la Fête d e Dieu . Dès lors e lles n ’
osèren t
plus s ’asseoi r n i même remuer autrement qu ’ en écartant lesbras pour ne pas froisser leurs jupes . Le bon joufflu fut enfoui dans une robe de piqué bien raide et
,quoiqu ’
i l ne compri t pas très exactement la rai son de cette cérémonie sub i te ,obé i ssant à. la consigne
,i l restai t planté au mi lieu du corri
dor , immob i le , trouvant le temps '
bien long et songeant qu ’
i lferait b i en mei lleur a j ouer dans cette grande cour qu ’
i l entrevoyai t par la porte ouverte , ou a se rouler sur cette pelouseverte qu ’
i l apercevai t là.-bas .
Mme Dubreui l étai t partagée entre l em otion de la reception qui se préparai t , une joi e orguei lleuse et un sentimentd
’
hum i li ation materne l le a l ’ idée de montrer son P i erre . Ce
lui -ci tremb lait,ayant compr i s qu ’
i l allai t voir des étrangers .
On l ’avai t endimanché comme les autres de ses vêtementsdes grands jours . Ces préparatifs le troub lai ent infin imentet la mère devait le surve i ller de très près pour qu ’ i l ne cherchat pas à. échapper à. l
’
en trevue retardée, en s
’
en fuyan t versquelque retrai te cachée .
On attendit ainsi sous le armes pendant un long temps .
Enfin , vers une heure et demi e , Dubreui l , qui guettai t ,aperçut le groupe sortant du château derrière la grandepelouse et cri a :
— Les voi là !Aussitôt tout le monde quitta la maison et se mit en ligne
,
comme un régiment , devant la porte , dans un silence ému .
L’
arrivée des vi si teurs n ’ eut pourtant rien de bien imposant .
L’
avant garde se composait de deux levrettes qui s ’avancèren t prudemment pour reconnaître le terrain et qui
,après
s’
être arrêtées , médusées , a quelque mètres de la ligne desDubreui l , se repl i èrent précipi tamment au grand galop sur
le corps d ’armée .
Puis bientôt arrivèrent , courant comme des chevaux échappés , Henry Viviers , un grand garçon de treize ans environ
,
1 56 LA REVUE F RANCO -AMERICA INE
Mme Dubreuil,un peu émue de cetteprésentation .
— Madame Dubreuil,dit-il aimab lement , j e suis enchanté
de faire connai s sance avec vous et votre petite famille ; mais ,s i vous le voulez b i en ,
nous la continuerons dans la maison ,
parce qu ’
i l fait ici un Soleil du diab le et que j ’ai très chaud .
En serre —file venai t M lle Maroi s toute ronde , roulant surses petites j ambes
,et dont la figure avait la forme et , grâce
au solei l , la couleur de ces ballons rouges que l ’on donnedans les magasins aux enfants bien sages . A côté d ’ e lles
’
avançai t M . Cas imir Lombre . Sa tête était assez regulière , mêm e presque be lle , avec la barbe en pointe et les cheveux longs d ’un b lond roux . Mais cet aspect , qui n
’aura itri en eu de désagréab le
,était déparé “par un reflet in suppor
tab le de fatuité prétentieuse . Il y avait un p li te l lementdédaigneux dans ses lèvres pincées et tom bantes aux extré
m ités et , dans ses yeux ,un regard tel lement méprisant pour
la pauvre humanité,indigne de lui
,qu ’on sentait tout de
suite ce qu ’ i l était : un pédant plein de lui-même et bouffldu mérite qu ’ il se supposait .
Quand on fut au salon— car il y avait un salon,la pièce où
s’
étalai t le fauteuil de ve lours grenat , si fatal au pauvrejoufflu— les présentation s officie lles eurent lieu
,grandement
embe lli es pour les enfants par un sac de gâteaux qu ’
appor
tai t M lle Maroi s et que Jeanne leur partagea .
— Mai s , où est donc votre aîné ? demanda M . Viviers àl ’anci en gendarme . Il me semb le que vous m
’
aviez ditavoir un grand fi ls de seiz e ou dix-sept ans .En e ffet , au mi lieu de la confusion ,
Pierre avait di sparu .
Dès qu ’ i l avait vu arriver tout ce monde,spécialement Henry
dont les allures délurées lui firent une peur épouvantable,il
s ’ était dissimulé et,contournant la mai son
,avai t cherché
l ‘abri d ’un massi f vois in .
— Mon D i eu ! Monsieur,
fit Mme Dubreui l devenue trèsrouge , mon pauvre Pierre . vous savez . a l ’ espri t un peufaib le . En voyant tant de personnes nouve lles
,
la crainte . Il est très sauvage . Je vous prie de l ’exeuser .
Ou1 oui . Je sais en eff et,reprit M . Viviers avec
sympathie . Son père m ’a di t . Mais i l verra à l ’usageque nous ne sommes pas méchants . Nous tâcherons del’
am adouer . Je lui trouverai,aux ateliers
,que lque travail
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 1 57
facile qui l ’occupe sans le fatiguer . et puis avec des soins ,
avec le temps,en grandi ssant , i l guéri ra peut—être .
— Ces maladi es— là sont généralement incurab les , fit le précepteur d
’un ton doctoral .Jeanne qui était p longée dans la contemplation d ’une eu
lum inure représentant la batail le de Solferino , se retournabrusquement et
,fixant M . Casimi r Lom bre , dit :
— Qu ’ est—ce que vous en savez ? E st-ce que vous êtesmédecin ?
— Jeanne ! s é cria sévèrement M lle Marois .— Ti ens ! C ’ est vrai aussi ! continua l ’ enfant terrib le en
bougonnant . D ’abord,j e suis sûre que M . Casimir se
trompe . Et puis c ’ est mal , en tout cas , de dire ces choseslà. pour faire de la peine aux gens !E lle avait la figure vraiment irritée . Ceux qui la con
naissaient ne pouvaient s ’
y .m éprendre . Quand e lle appelaitle précepteur M . Casimir” en grossi ssant sa voix , on savaitce que ce la signifiait
,moquerie ou colère
,el le l ’appelait sou
vent ainsi .Vivement e lle quitta le salon
,sans voi r que Mme Dubreuil ,
touchée au cœur , lui lançait un regard chargé d ’une infiniereconnai ssance maternelle .
M . V iviers détourna l ’entretien de ce pénib le suj et et expliqua a son nouve l employé certains détails de son service ,la necesité de ne pas trop frayer avec les ouvriers
,pour con
server sur eux l ’autorité nécessaire a son contrôle , et lui f aisant une série de recommandations marquées au coin de son
esprit pratique et bon .
Au mi lieu de son discours,i l fut interrompu par la rentrée
de Jeanne ramenant Pierre qu ’ e lle tenait par la main .
— L e voi là ! dit—el le triomphante . Nous sommes déjàune pai re d ’am i s . Je l ’ai retrouvé derrière un massif et i lm ’a dit qu ’ il voulait bien venir avec moi
,parce que j e ne lui
faisais pas peur du tout . N ’est—ce pas,Pierre , que j e ne
vous fais pas peur , moi ?Et puis , vous savez , ajouta-t—e lle avec un ton de rodo
mon t , si que lqu ’un vous ennuie,i l aura a ffaire a moi . Je
vous prends sous ma protection . Voi là !
Le lendemain de la visite de la fami lle Vivi ers a ce lle dunouveau surveil lant , on «put jouir d ’un Spectacle qu ’on n ’avait
1 58 LA REVUE FRAN ( iQ -AMERICA INE
jamais vu : Jeanne V ivi ers se promenait gravement dansune allée du parc
,a côté de sa gouvern ante , au li eu de courir
comme une folle a travers les pelouses et lui parlant , enfai sant force gestes , mai s avec un calme re lati f bien rarechez cette exubérante p eti te personne .
La bonne M le Maroi s,tout en trottinant , écoutai t et di s
cutait,prenant évidemment l ’ entreti en très au séri eux .
L ’obj et de cette conférence étai t en e ffet , des plus graves .Jeanne V ivi ers avai t eu une idée Cela n ’avait , en soimême
,rien de bien étonnant . Jeanne avai t souvent des
idées . Mai s ce qui était plus extraordinai re , c ’ étai t qu ’ e l lconservât la même pendant vingt quatre heures et , depui sving qua.atre heures , elle étai t ob sédée par une unique penséequ ’ e lle tournai t et retournait sans arrêt dans son espri tardent .
E lle voulait guéri r Pierre Dubreui l et , pour employer sonexpression plus pittoresque qu ’
élégan te , en faire que lqu ’unqu i ressemb lerai t à tout le monde . I l ne faut pas trop scru
ter le fond des cœurs et chercher a pénétrer les mobiles vrai sdes proj ets en apparence les plus louables . Sans doute ,l ’ intention généreuse de Jeanne prenait sa source dans unecharité dont son bon peti t cœur étai t parfaitement susceptib le . Mai s éti ez -vous bien sûre , mignonne Jeanne , que ledési re de faire pi èce a M . Casimi r Lom bre ne fut pour riendans votre résoluti on ? Quelle joi e s i vous arriviez a mettrel ’équi libre dans le cerveau chance lant de P i erre mai s quellegloire auss i et que l orguei l s i vous parveni ez à. démontrer parun fai t éclatant
,au précepteur
,votre bête noi r
,qu ’
i l n ’y en
tendai t ri en et que le cas du j eune Dubreuil était parfaitement guér i ssab le ! Ce sentiment
,du reste
,doi t vous être
facilement pardonné ; car ce qui vous avai t tant révoltée ,c
’ était que la froide et implacab le déclaration du précepteurai t été fai te devant la pauvre mère qui avai t dû en sou ffri rcomme s i un bi stouri étai t entré dans la chai r de son cœur .
A quoi bon ém ettre ce crue l pron ostic,même en supposant
qu ’ il fût vr ai ; et puis , d ’ailleurs,qu ’ est —ce qui assure qu ’
i l lefût ? Et , l ‘a—dessus , cette petite imagination s ’étai t mi se atrotter
,à.galoper même , laissant de côté , et pour cause , toute con
sideration médicale , et se bornant à des rai sonnements purement moraux et , apr ès
' tout , plausibles . Pourquoi ll ’in telligence de ce garçon qu i n
’ était pas complètement éteinte
1 60 LA REVUE FRANCO -AMERICAINE
vue jusque-là . Son espri t est une terr e en friche couvertede ronces
,d
’or t ies , de broussailles , de tout ce que vous vou
drez,c ’ est possible . Pourquoi n ’ est-on jamai s parvenu a la
cultiver Parce qu ’on n ’a pas pris le bon moyen . On a agiavec lui comme avec tout le monde , alors que sa nature maladive exigeait un trai tement part iculi er .Chacun de nous demande a être mené d ’une façon spéciale .
Tenez m oi qu i connais bien mes défauts , s i j’ai un caprice ,
comme j ’ en ai souvent , vous pourri ez me battre pendant liùi tj ours et huit nui ts consécutives ou m ’
interdi re à tout j amaisde manger de la crèru e dont j e raffole , que vous ne me feri ezpas céder et
,quand j e vous voi s la figure triste de mes lub i es ,
j e cède tout de sui te,parce que vous êtes une excellente fem
me,que j e vous aime de tout mon cœur et que j
’
ai de la peinede voi r que j e vous en fais .
Eh b i en ! Pour Pierre , j e sui s sûre qu’on n ’a pas su le
prendre . Le père Dubreui l a l ’ai r d ’un bien brave hommeMai s c ’ est un gendarme qui doi t mieux savoir dresser unprocès —verbal ou condui re les gens au poste qu ’élever les enfauts malades . La mère Dubreui l est plus douce
,mais e lle
ne m ’a pas l ’ai r , malgré sa bonté , d ’être la finesse même .
Sa tendresse n ’ est peut—être pas toujours dépourvue de brusquer i e . E lle ne doi t pas avoir plus de soup lesse que j e n ’ enai pour jouer du piano , comme vous me le fai tes souvent observer . Pu i s i l y aura peut-être en des camarades taquins
,
mépri sants , , moqueurs , que sais-j e ? Alors P i erre a peur,
tremb le , se sauve devant les gens comme un chien épouvantéet , a dix-sept ans , i l ne sai t pas — lire
,ne
‘
connaît pas le prem ier . m ot du catéch i sme et ignore qu ’ i l y a un b on Dieu .
Eh b i en ! m oi qu i ne sui s pas une savante , malgré vosefforts , chère Madem orselle , ni une pédante comme M . Casi1 1 .II‘
, j e pr étend réali ser une cure merveilleuse , un phenomène , même un m i racle , et j ’y parviendrai .
— Que comptez —vous faire , mon enfant ? répondit M l leMaroi s , plus émue qu ’ el le ne voulai t le paraître .
(A suivre.)
LA SO C IETE D E
LA REVUE FRANC O -AMERICAINE
27 RUE BUADE, QUEBEC .
. L’
I L L U S T R A T IO NSupplément de La Revue Fmum —Am éricaine
Mgr Paul-Eugène Roy, évêque auxiliaire de Québec
Le lac St . Charles , viei lle gravure . (Collect ion Fai rchi ld .) Actuellemen tla pr ise d ’
eau de l’
aqueduc de Québec.
L es Chutes de Lorette et le vi llage indien ,i l y a 1 00 an s .
(Collect ion F ai rchi ld .)
Le Pont Rouge sur la r ivière Jacques—Car trer i l y a 1 00 ans .
(Collect ion Fai rchi ld .
Bureau de péage sur le pont JacqueÊ
—Car t i
eî. (D u
“Sportsman in Canada
e olf rey
Les tentatives d’
assimilation dans la Nou
velle—Angleterre et leurs résultats
Les fêtes qui viennent d ’avoir lieu aux Etats—Unis àl ’occasion” du centi ème anniversaire de la fondation des dioceses de Boston et New York démontrent jusqu ’
à l ’évidenceque le sentiment national est intimement li é au sentimentreligieux . Le ton de ces fêtes
,l ’inspiration des discours , le
déploiement des drapeaux,l ’évocation des souvenirs s écu
laires,la présence de visiteurs distingu és
,celle
,par exemple
,
du primat d ’Irlande
, ( 1 ) tout a donné a. cette manifestationqu ’on voulait bien américaine
,une saveur sp éciale . En
dépit de tout,à l ’insu peut— être de certains ultra—américains ,
c ’est bien l ’apothéose des catholiques irlandais qu ’on a faitea cette occasion . Et si on a arbor é le drapeau étoil é on a m i sa ses côt és le drapeau vert de plus
,il n ’est pas bien sûr que
sur le drapeau étoil é lui—meme plusieurs n ’aient vu dans unélan atavique fort louable
,se dessiner la harpe d ’or d Hibernie.
Pour notre part,nous r éclamons avec trop de persistance
les droits nationaux des catholiques Franco—Américains,pour
ne pas nous r éj ouir des manifestations nationales d ’adver
saires qui pensent évidemment comme nous chaque fois qu ’ilslaissent parler librem ent leur cœur . Leur fiert é nationalejustifie la nôtre ; en se r éclamant de leurs ancêtres et envantant l ’éclatante beaut é de leur histoire
,ce sont nos droits
au même culte ancestral qu ’ils consacrent . Les deux centenaires de New York et Boston n
’auraient — ils eu le seul r é
sultat de mettre pareils faits en évidence qu ’ils auraientét é éminemment beaux et utiles . D u reste
,les fêtes cente
naires, quand elles ne sont pas défigur ées par d
’am icales in
discr étions , ont touj ours cela de bon de rappeler aux générations le caract ère de la succession qui leur fut transmise
,
de refaire sous leurs yeux la chaîne des traditions,des mérites
et des devoirs qu ’elles continueront à leur tour jusqu ’
à la pro
( 1 ) Le cardinal L ogue.
1 62 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
c haine étape s éculaire . Malheureusement nous ne concevonsl ’histoire que d ’apr ès les données de notre époque
,d ’apr ès
les horizons que nos ambitions quotidiennes ont donnés ànotre vie où a notre mani ère de penser . Et nous ne mettonstant d ’enthousiasme à c él ébrer le pass é que parce que
,dans
l ’intimit é de notre cœur,c ’est
,au fond
,notre propre couronne
que nous tressons avec tous les lauriers moissonnés pieuses ement sur les tombeaux des ancêtres et dans les champsde l ’histoire . C ’est un sentiment égoïste né de cette convi ct ion profonde que nous sommes bien la continuation desépoques lointaines et que notre vie
,nos pens ées
,nos œuvres
,
rue sont que la vie,les pens ées
,les œuvres
,des générations
q u i nous ont préc édés . C’est ce qui porte
,quelquefois
,de
nouveaux venus à glisser dans la couronne des souvenirs hist oriques tr0 p frais , des fleurs trop j eunes ou mal écloses
,ou
encore à oublier d’y mettre celles qui,écloses â l ’époque des
premi ères floraisons,ont ét é
,avec le temps
,envahies
,perdues ,
dans l ’exub érance des florai sons nouvelles .C ’est ainsi qu
’
à New York et à. Boston,en voulant li
miter a un si ècle les gloires de l ’Egli se, on a oubli é les faitsépiques qui précédèrent les deux fondations .Certes
,nous ne voulons pas nier l ’importance du rôle
j ou é dans la formation de ces deux dioc èses par l’él ément
irlandais . La présence du Cardinal Logue n’était pas de trop
dans une cél ébration où l ’œuvre catholique d ’Erin brillaitd ’un si vif éclat . Mais la j oie que nous éprouvons à constaterles progrès de ces deux églises dioc ésaines grandit
,chez nous ,
a la pensée que cette abondante moisson,est due au travail
initial des immortels semeurs que furent le premier évêquede Québec et la l égion sainte des missionnaires français lancés-à la conqu ête des âmes dans le Nouveau-Monde . Nous avonsrelu avec émotion ces pages d ’histoire où l ’on voit Mgr deLaval
,évêque de toute l ’Am ér ique du Nord , envoyer des
m issionnaires aux colons de Lord Baltimore,où l ’on voit
un consul de France fonder la première église catholique deNew-York
,où l ’on voit un évêque françai s veiller sur le ber
ceau du dioc èse de Boston,où on en voit un autre , Mgr F laget ,
j eter un vif éclat sur la ville épiscopale de Baidstown , surcette petite ville qui donna un j our tant de promesses d ’avenir ,mais que les circonstances sont venues si cruellement d écevoir ,ne lui
_
laissant,comme seul souveni r de ses premiers r êves
d e grandeur,que sa vaste cathédrale veuve de son évêque
et quelques annales bien remplies .
1 64 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
cept ion que l’on s ’est faite en certains quartiers de ce que l
’on
appelle dans t ous les pays à forte immigration l ’assimilationdes nouveaux venus .
Les politiques américains,même en exigeant certaines
qualifications au point de vue de la langue pour des fins d ’unif orm it é administrative
,ne songèrent j ama i s à détruire chez
les nouveaux citoyens le Caract ère essentiel qui est le fruitdu sang , de la tournure d
’esprit,et de tout ce que donne aun
individu le courant atavique de plusieurs générations d ’ancêtres . Ils voulaient l ’un i form it é de conception dans lerespect des institutions et des lois
,l’un i form it é de loyaut é
et d ’amour pour le drapeau,l’un i form it é d ’initiative et de
z èle pour le développement de cette r épublique modèle qui,
prenant un j our sa place au premier rang des nations,offrirait
,
en même temps , ce spectacle unique d ’une union politiqueoù se trouven t l ’act ivi t é et le génie de tous les peuples de laterre . Ils eurent tout cela
,sans secousse
,sans coercion
,par
le simple fonctionn ement des lois et le libre consentementde la conscience populaire .
Comment la hi érarchie catholique des derniers cinquanteans dans la Nouvelle Angleterre a— t— elle pu voir dans cetteassimilation politique un exemple ‘a suivre en l ’exagéran t dansle domaine religieux
,c ’est ce qu i’ l n ’est pas tr ès facile de
comprendre, a moi ns que nous n ’y voyions des motifs d ’un
ordre purement temporel . Certes,nous pr éférons admettre
qu ’une erreur de tactique a ét é commise plutôt que deconclure que les assimilateurs
,même les plus notoires
,c èdent
à des considérations d ’un ordre tr ès éloigné du souci de conserver la foi dans les âmes .
Erreur ou calcul,l ’assimilation est devenue une arme
tournée contre les él éments catholiques nouveaux aux EtatsUnis . Mais il fallait choisir le point exact à frapper , le côt ésp écial qu ’il faudrait modifier pour atteindre la formationr êvée . Le travail , limit é a un groupe relativement restreint
,devait prendre une tournure plus prononcée . D e
plus,contrairement à ce qui eut lieu pour l ’all égean ce poli
tique,l ’assimilation voulue par les évêques de la Nouvelle
Angleterre, ne pouvait s’appliquer aux lois de l ’Eglise, a ses
r ègles de foi,a ses dogmes
,parce que ceux auxquels elle s
’a
dressai t étaient dé jà d’accord avec eux sur toutes ces questions .
Il fallut s ’attaquer à autre chose . On s ’attaqua à la languematernelle des fidèles et ce qui avait ét é une assimilation
LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE 1 65
possible dans le domaine politique , devint , dans le domainereligieux
,une croisade pour la fusion des races au b énéfice
des détenteurs actuels du pouvoir . La transformation étaittrop radicale pour ne pas soulever de vigoureuses protestat ions elle en souleva de nombreuses , , et , parfois , de tr èsviolentes
,surtout parmi les Canadiens-français , qui , une fois
rendus aux Etats—Unis , se rappel èrent comment , aux princ ipales époques de leur histoire , la fidélit é aux traditions anoestrales , l
’attachement a la langue maternelle,sauvèrent
du naufrage et leur foi et leur vie nationale . Du reste,ils ne
pouvaient comprendre que,laiss és libres par les gouvernants
et la constitution de leur nouvelle patrie , ils pussent être en butteà pareille attaque dans les églises mêmes que l ’on allait demander a leur dévouement et a leur esprit de foi .
Si les assimilateurs persist èrent dans leur d éterminationde tout niveler en faisant table rase de tous les principes chersà leurs nouvelles ouailles , ces derni ères ne montr èrent pasmoins d ’
obst inat ion dans leur r ésistance . Les catholiquesfranco-américains
,en particulier , avertis par l ’exp érience
de ceux—là mêmes qui voulaient leur perte comme race , maint inrent leur int égrit é nationale et , donnant à l
’Egli se, dans les
Etats de l ’Est , un essor irr ésistible , prouvèrent en pleine bat aille la faus 'set é des doctrines de leurs ennemis .
A tel point que , de nos j ours , si les catholiques irlandaispeuvent revendiquer l ’honneur , partagé , du reste , d ’avoirét é les pionniers de l ’église catholique dans les Etats-Uni s
,
les F ranco-Américains peuvent leur demander— Qu’
avez
vous fait de tout cela Et nous savons b ien que les plus ardents a r éclamer ce pass é ne seront pas les plus empress és àr épondre .
Les faits,appuyés d eloquentes statistiques
,prouvent
ce qu ’a pu faire même l ’assimilation politique chez ceux quin ’ont pu prot éger leur foi par le solide rampart de la languematernelle . Parlant dans leurs églises la même langue quedans les clubs politiques , habitu és d ’avance à c éder devantle saxon isme absorbant de leurs vainqueurs , les irlandaiscatholiques n ’avaient qu ’un pas a faire pour donner dans leserreurs religieuses de leur grand entourage . Ce pas
,ils l ’ont
fait avec un entrain qui étonne et avec un empressement quia j et é la maj orit é de leurs fr ères dans l ’immense cohue des
d’incroyants que contient la R é ublique.
Il est un fait que nous tenons à rappe er et qu ’il est bonde ne pas perdre de vue. C ’est qu ’il y a tout au plus aux
LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE
Etats—Unis de catholiqueS‘
et que sur ce nombreles irlandais catholiques ne dépassent pas
Ou sont all és les d’i rlandai s catholiques que
r éclamait le R év. Père Byrne,en 1 873? ( 1 ) Qui nous le
dira ? L’ass im ilat ion , qu i a ét é désastreuse pour ceux—là
mêmes qui la pr êchent , n ’aurait—elle pas eu les mêmes effets
sur les él éments nouveaux ? Elle aurait eu des eff ets plusterribles encore parce qu ’elle leur aurait enlevé avec laf f oile caract ère sp écial a leur race qui faisait leur force et leurpermettait de mettre toute la mesure de leur talent au servicede la r épublique .
On a prouvé tant de fois que la langue maternelle étaitla meilleure sauvegarde de la foi , qu
’il paraîtrait oiseux d ’insister davantage sur ce point . Qu ’il nous suffise de nous r éj ouir
,en passant
,de la r ésistance
,victorieuse jusqu ’ici
,oppo
sée par les catholiques franco— américains a toutes les tentatives faites pour changer leur physionomie . A toutes lesth éories politico— économiques invoqu ées pour les engager àreni er leur origine
,ils opposent touj ours un refus courageux
qui ne peut être encore mieux exprimé que par cette paroled ’un penseur : Nous ne sommes pas faits pour ces nourritures
,eu nous changeant on nous dénature .Leur meilleure excuse est encore d ’avoir sauvé l ’Egli se
dans la Nouvelle—Angleterre et de s ’y être constitu és ses plusfermes appuis . Il est vrai
,cependant
,que le dernier mot
n ’est pas encore dit sur cette question . Dès les premiersj ours
,on Opposa une digue au développement franco— am ér i
cain . Mais le flot montant de l ’immigration franco-américainepassa par dessus ; il inonda les rives trop étroites laiss ées àson cours et sema partout sur son passage le progr ès et lafécondit é . Auj ourd ’hui que l ’immigration canadienne est moinsforte
,qu ’elle est même a peu pr ès arr êt ée
,on constate l ’im
mense moisson de bien qu ’elle a pr épar ée,mais on constate
aussi que,si le flot s ’est fait un lit a sa taille
,la digue est rest ée .
Le programme d ’assimilation est touj ours vi vant et ceuxqui l ’ont trac é ne sont pas moins déterminés auj ourd ’huiqu ’il y a trente ans al ’exécuter . Là où il a pu l ’être il a caus édes désastres . Là. où on a simplement persist é a le mettreà. exécution il a ouvert dans le sein de l ’Egli se des plaies qui
«l
( 1 ) Iri sh Imm igrat ionto the Un i ted States . The Cathol ic Publ icat ionSociety. New York , 1 873.
1 68 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
mais nous sommes les plus avancés parce que nous sommesles premiers . F aites comme nous reniez votre pass é , votrelangue
,vos traditions . Soyez de votre temps et de votre
pays ! ”Merci Et la r éponse sort vibrante de toutes les poitrines :
Merci Votre offre est all échante mais elle ne nous tentepas . Vous allez vite , mais cela ne veut pas dire que voussoyez les plus avancés . L
’ass im ilat ion a—t-elle , chez vous ,
fait autre chose que d évelopper une sorte de patriotismea igri qui
,dans un moment de danger , n e fournirait pas un
s oldat de plus a la r épublique De notre temps , nous le sommes
,mais notre ambition est encore de suivr e R ome et non de la
d evancer . De notre pays , nous le sommes aussi et nos soldatsmorts pour la patrie en 1 776
,en 1 865 ou 1 897 sont c on fondus
dans un commun amour par la patrie . Nous sommes de notret emps
,de notre pays
,mais n ous voulons aussi être de notre
Eglise,et nous voulons l ’être à. la mani ère de nos aïeux qui
compensaient par une foi robuste les élans de certain apostolatmoderne . Notre lang ue fut touj ours le plus solide rempartde notre foi . Laissez-nous prier Dieu comme nous l ’appr irentnos mères
,et si nous bâtissons des églises , faites que nous y
ayons le droit d ’être chez nous . Au fond,ce que vous prenez
pour de l ’obst inat ion à. sauver des idées qui meurent n ’est,
de notre part,qu ’un ardent désir de mieux servir le Maître
en lui conservant la fidélit é de nos enfants . Dans tout cecatholicisme tapageur que vous voulez nous faire acheterd
’une apostasie nationale,et qui n’est pas celui de R ome
,nous
ne voyons encore que l ’ éclat d ’une parade ou les Chevaliersde Colomb battent la grosse caisse . Laissez—nous vivre , puisque nous ne voulons pas mourir , et gagner paisiblement le cielavec l ’humble mais fervent credo des ancêtres .”
J. L. K. Laflamme .
Le j ournalisme Canadien-Français
J ’avais promis à mon ami,l ’aimable et sympathique direc
teur de la Revue F ranco-Améri cai ne, un article sur la situationdu j ournalisme Canadien— français . Je me proposais b ien detenir ma promesse . Je regrette infiniment de ne la tenir qu ’
à
demi .Car
,b ien que j ’aie d éjà mon exp érience personnelle
,qui
,à
elle seule,eût suffi à illustrer de façon assez compl ète la situation
de notre j ournalisme,j ’avais fait quelques recherches et recueilli
quelques notes,qui n ’auraient pas manqué de donner plus de
for ce encore a mes conclusions . Je n ’ai pas eu le temps demettre l ’ordre dans ces notes . Et pour ne pas faire totalementd éfaut au directeur de La Revue
'
F ranco—Amér i cai ne,j e me vois
forc é,à. mon grand regret , de ne donner , auj ourd ’hui , que
l ’esquisse du travail que j e me proposais de faire .Ce travail
,j e le ferai certainement . La situation de nos
joum alistes— notœ situation— car j’appart iens , moi aussi , a la
profession— est trop mis érable,pour qu ’elle puisse
,et dans
notre int érêt,et dans celui du public canadien
,durer beaucoup
plus longtemps . Il faut absolument que quelqu ’ùn j ette le cri
d’alarme
,ou
,si l ’on veut
,l e cri de ralliement .
Je me proposais donc de démontrer l ’absolue et pressantenécessit é de nous rallier
,de nous organiser . C ’était la ma
conclusion principale .Je voulai s arr iver à ma conclusion par le raisonnement
suivantDans la situation où nous sommes
,isol és
,inconnus les
uns aux autres,nous sommes un peu dans l ’état des esclaves
de R ome . Nous appartenons a des maîtres . Ces ma îtresexploitent notre plume et notre cerveau . Nous ne pensonsque par eux
,nous n ’écrivons que pour eux . En échange de
nos services,nous recevons un salaire mis érable
,que souvent
,
dédaignerait le typographe qui compose nos articles à. lamachine .
Pour le travail de forçat que nous faisons,apart la pitance
de chaque semaine qu ’on nous j ette,comme à regret
,nous ne
recevons ni égard,ni consid ération des maîtres à la solde de
1 70 LAREVUE FRANCO-AMERICAINE
qui nori s Sommes . ° Nous payant pour chanter leur gloire— oui,
hélas pour vivr e,il faut accepter pareil marché— nous payant
pour chanter le'ur gloire,du moment que notre voix semble
faiblir,nous sommes
,par eux
,chass és du j ournal dans lequel
nous nous morfondions et que nous reste—t-i l à faire nousoffrir à un autre maître , qui consentira a nous payer , pourécrire qu ’il est un grand homme .Pis que cela
,pour satisfaire nos tyrans
,nous nous d échirons
les uns les autres . Qui n ’a j amais vu une bataille de chiens.Le maître siffle son chien
,et le lance sur un autre . Ils se
déchirent au sang . Tel est,trop souvent le devoir honteux du
j ournaliste . Il sert un ma ître . Son confr ère en sert un autre,
ou n ’en sert aucun . Généralement,tous les j ournalistes
servent un ma ître . Qu ’on m ’en nomme un,dans nos grands
j ournaux,qui soit ind épendant . Il doit penser par le cerveau
étroit d ’un homme d ’affaires,dir ecteur financier ou directeur
politique . C ’est la.r ègle s’
i l pense trop bien,ou écrit trop
bien ce qu ’il pense,il est mal class é . Donc
,voilà.un j ournaliste
qui ne partage pas toutes les idées de votre maître . Vite,
l ’ordre de l ’attaquer , de le déchirer , de le détruire de r éputation ,nous arrive . Et il faut marcher ou partir .
C ’est la le comble de l ’ignom in ie .
Le j ournalisme est une puissance,dit—ou . Pauvres j our
nali stes . Ils sont les seuls à. l ’ignorer . Pour eux,bien trop
souvent,le j ournalisme est une faiblesse . En l
’embrassaut
,
ils se déclassent .Quand il est j eune
,et qu ’apr ès avoir fait des études
s érieuses,le j ournaliste commence sa carri ère
,il a de belles et
nob les ambit ions . Il étudie,il tâche de se perfectionner dans
l ’art d ’écrire . Il croit en sa mission,qui est de découvr ir la
vérit é,et de la dire avec art . Pauvre j eune homme
,cache ta
noblesse et tes ambitions .Ne dis pas que tu étudies
,on va te rire au nez
,que tu as
le respect de toi—même,de ta plume et de ta pensée . Car
,
entre dans ce bureau de j ournal,et regarde qui l ’in fam it é de
tes maîtres te donne comme camarades de bureau,comme
confr ères des repris de justice,des âmes damnées
,des fourbes
des traîtres,des plumes vendues
,comme tu as vendu la t ienne
,
sans le savoir .Voi là le j ournalisme canadien— françaisLa situation qu ’on lui a faite en a chass é les esprits d ’élite
,
ou les a r éduits à l ’abrut issemenu
Les maîtres qui l ’exploite, n ’y voulant avoir que des
La réponse des faits
La s upé n or it é de s Ang lo-Saxon s et les Canad ie ns
f rança is dans la Province d’
0 nt ar io.
Peu de questions d ’un int érêt général sont discut ées dansla Province de Québec sans que l ’on cite avec beaucoup decomplaisance l ’exemple que nous donne la Province d’
Ontar io.
Cette hab itude a même dégén ère en une autre moins louablequi , chaque fois qu
’une revendication nationale est nécessaireou qu ’un probl ème doit être r ésolu et demande de notre partune attitude énergique et bien tranch ée
,pose l ’inévitable et
peu courageuse question : Que va—t -on penser de tout celadans la Province d ’Ontario . J ’ai même plus d ’une fois entendu cette question pos ée par des personnages que nousaurions mieux aimés plus tenaces dans les revendications honorables et moins disposés à accepter de gaiet é de cœur àla politique d éprimante des compromis .
Mais pu i sque 1 ’Opini on d ’
Outar io p èse d ’un si gr and poidsdans la balance
,il n ’est peut-être pas hors de propos de se
demander quel rôle j ouent dans cette province même ceux desnôtres qui y ont établi leurs foyers et qu i y ont developpé ,dans l ’espace de quelques années
,une influence avec laquelle
il faut d éjà compter . Ces compatriotes sont— ils aussi convaincus que certains anglophiles de l ’irr ém édiable supériorit éde leur entourage anglo— saxon C ’est un point qui mérited ’être étudi é et sur lequel j ’ai reçu tout recemment , uneopini on que les lecteurs de la Revue aimeront à connaître .
J’ai donc reçu une lette qui,sur cette question même ,
m ’a apport é les r éflexions suivantesUn ami
,tr ès épris du livr e de M . D emollins A quoi
tient la sup ériorit é des anglo-saxons— me clamait les grandesqualit és de la race qui s
’
énorguei llit de son immens e supé
r ior it é sociale,politique
,commerciale
,industrielle
,financi ère
et morale . A côt é,mon ami ne voyait que faiblesse
,misère ,
pauvret é,néant . Et la preuve Il la trouvait dan s la question
suivante : A qui appartiennent les grandes fortunes,à Ottawa ,
par exemple,et dans toute la r égion ? A qui l ’influence
A qui tout
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 1 73
Voyons,lui dis— je, ne nous emballons pas .
Ce qui est un fait acquis peut être expliqu é de diversesmam eres
,mais il ne peut pas être ni é . De ce que les Anglo
saxons,qui ont eu des avantages except ionels pour acqu érir
les plus beaux domaines sur les rives du St Laurent,depuis
le lac Saint Louis jusqu ’aux grands lacs et dans toute la vall éede l ’Ottawa
,poss èdent encore des fortunes bien plus cousi
dérables que celles des Canadiens—français,cela ne tient pas
assur ément à leur sup ériorit é manifeste sur ces derniers .Et pour bien juger cette question il faut teni r compte de certains faits
,de certaines tournur es de caract ères
,tr ès pronou
cées chez les uns et moins accentuées chez d ’autres,il faut
,
enfin,en comparant les titres des races diff érentes
,teni r compte
de leurs dispositions particu li ères et du champ pr éfér é de leuraction dans le monde . A chacun le sien .
Ainsi,la race française poss ède bien quelques qualit és
qui peuvent lui donner un certain relief et lui assurer sa justepart d ’influence . Aussi longtemps que nous ne perdrons pasle sentiment de notre force et que nous aurons le courage dej ouer notre rôle providentiel
,il n ’y aura pas lieu de d ésesp érer
de notre destinée .A ceux qui seraient tent és de conclure à notre anéantis
sement ou a notre éternelle médiocrit é,l ’histoire
,les statisti
ques,les annales particuli ères
,donnent d éjà. une r éponse qui
,
en r établissant les faits ou,du moins
,en les faisant connaître
davantage,peut d éjà.dérider les fronts les plus sombres . Quel
les furent les conditions de la colonisation anglo—saxonne dansl’
Ontar io
Nous trouvons dans les archives du Canada,année
1 892,les chiff res suivants au suj et des concessions de terrains
faites par le gouvernement,en 1 80 1 et 1 802
,aux loyaux sujets
br i tann iques qui se retir èrent devant l’
Indépendance Am é
rrcarne
1 74 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
COMTES .
D unclas 73
Storm—ont .
Russell
Ces chiffres sont,pour le moins , tr ès instructifs , s
’ils nes ont pas pour tous également suggestifs . Le gouvernementanglais poursuivait un double but cr éer une aristocratiefonci ère et établir une digue infranchissable à l
’expansionfrançaise . Ne sait-on pas que sur l ’autre rive du fleuve
,depuis
”
le comt é d ’Argenteui l jusqu
’au fort Coulonge,a 70 miles
d’Ottawa (sauf la seigneurie de l a Petite Nation vendue parle S éminaire de Québec â Joseph Papineau) — toutes les terresles mieux bois ées
,les endroits les plus prospi ces aÎl
’industrie,
tous les pouvoirs d ’eaux étaient concédés aux anglais . Citonsquelques faits
En 1 799,le capitaine Robertson reçut du gouvernement
acres de terre sur les deux rives de la Li èvre aBuckingham . Philemon Wright— eu 1 807— reçoit un quart de canton— il avait choisi les Chaudi ères et le canton de Hul l
,d
’Aylmer
à la Gatineau . A Templeton ,c ’est Alexandre MacMi llan ;
à. Cardley, Sanf ord LocBin et la famille McLeod Bigelowà Buckingham
,MeNat aux Chats , etc ., etc .
Est— cc que toutes les concessions foresti ères avec lesavantages commerciaux splendides qu ’elles ont offerts n ’
ex
1 76 LA REVUE FRANCO—AMERICAINE
La seule chose étonnante,et vraiment providentielle
,
c ’est de voir le triomphe des catholiques et la décadence irr ém édiable de l ’él ément protestant dans cette partie du Canada .
Qu ’on s ’ étonne maintenant de voir les grosses fortunesaux mains des Anglais
,et qu ’on attribue leurs richesses aune
supériorit é de race . ( 1 )Il serait trop long d énumérer ici les d étails de l ’expan
sion française depuis la conquête . Mais nous avons b ien ledroit de nous demander si la race sup érieure n ’est pas cellequi demeure . Nous venons de voir que les capitaux ne‘ suffisent pas touj ours pour édifier une œuvre vivante
,et que faire
reposer la sup ériorit é d ’une race sur eux c ’est pr éparer àcette race de cruelles d ésillusions .
Tant que les canadiens s ’attacheront à posséder la terreet a la féconder de leur labeur ils ne cesseront d ’accro ître lapuissance de leur race . Ils poss èderont la vraie richesse quileur convient avec l ’infiuen ce du nombre, et s
’ils veulent êtreunis— ils commanderont touj ours le respect .
Char les Dupl l.
( 1 ) Cf r. Histoire de la Prov. Eccl. d’
Ottawa , par R . P. Al exi s , Capucin
Mascarade
défian t le bloc ,S
’
avan ce avec la m i tre en t êteIl m arche comme un coq ,F ier de pouvoi r m on trer sa cr ête .
'le
c’
est le bon bourgeois ,Len t , lourd , ventru comme une
Un de ces hommes coi s [tonne ,Que r ien ne presse n i n
’étonne .
B
ressemble au croi ssan t .
Hugo l ’appellerai t Fauci lleD
’
or pur qui , dans le champD es étoi les , luit et scint ille .
°le
Due peut que glisserAvec que m oit i é de roue
Il a dû se lasser
Jadis de rouler dans la boue .
et
paraît compl iqué ,On croirai t vorr une serrureAu ventre détraquéMais la chose n
’
est pas bien sûre.
sir:
veuf de son pendu ,
N’
en est pas m oins une poten ce .
Il n’
aurait r ien perduEn changean t un peu d
’
appa[ren ce
E
F
G les genoux au nez
Comm e une chatte de bout i que ,Prend les ai rs ennuyésD e quelque sphynx én igmat ique.
de Lettres
Hest m oyennageux.
K
Son pon t levi s , qui ne s’
abai sseJam ars , est ombrageuxComme une haute forteresse .
le m onocle au f ron t ,Semble avoi r aval é sa canne
Il raid it son plastronC
’
est le vér itable anglom ane.
'le
lui, presse le pas ,
Et c’
est a peine s’
il effleure
Le sol . Ses grands t ibiasDoiven t fai re du t rente à l’
heure .
Ma la m ajest é ,
N
Il a dû naître m ajusculePour la solenn it é ,On ne lui connaît pas d ’
émule.
°!fl‘
évoque un and nom .
Sous ce chi re , qui galvan iœ ,
Surgi t NapoléonAvec sa red ingote gr ise .
918
Lm algré son beau nom
Ne plane pas dan s l ’atm osphère .
Couché de tout son longPar terre , il peut servi r d
de
équeræ .
fil?
One boit que du vin
,
Car jamai s l’
eau seule ne saoulePochard ,
i l lutte en vainIl faut qu
’
il tom be , i l faut qu Il
[roule ,
11 78 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
ne fai t pas d ’
effet , V Vase précieux ,
Il es t san s aucune im portan ce . Lum ineux cr is tal de Bohême ,S i quelqu
’
un le refai t , Palai s myst ér ieux
Ce sera pour le m ieux , je pen se . Où s’
en ferme le chrysan thème.
937
_
est dern ier bateau N ,folichon ,
{Avec sa longue robe à traîne Court sur lapoiute des bottrnes ;Qui , se serran t au haut Il lève le talon
Prend le corps comme en une Comm e feraien t des baller ines .
[gaine‘il?
est un vrai serpen t ,Mai s ça le blesse et , sur un s igne ,Il ferai t faux serm en t
Qu’
i l étai t n é pour être un cygne .
T.Voi ci le gibet Ybelle fleur qui
Qui revien t , et , cette foi s , double. Ent r’
ouvre à pe ine sa corolle .
Es t—cc que l’
alphabet Il n’
est pas grec , c’
est 1 ,Nous viendra i t du pays du
{gpu
;Ma i s rom ain , par sa grâce m olle .
e
veut aller a d iaZ apparaît en fin ,
D e tous côt és i l tombe,i l vibre Il z igzague ,
i l r i t,i l gr im ace ,
Ma is S’
i l pen che ,d éj à Ce fou , cet Arlequ in
Il a repr i s son équi l ibre. Clôt la m ascarade qui passe .
JEAN V ALIER .
XSombre in connu ,
Les bras croi s és , m édi te et pen se ,R odin l
’
eût fai t tout nuUn pen seur peut m on trer sa
[pause .
1 80 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
enfants . Fils d’ém igrant , j
’ai connu les déboires et les épreuvesr éservés à l ’étranger et ces d éboires et ces épreuves ont ét éles mêmes pour tous . J’ai ét é le t émoin des luttes qu ’ont euà soutenir les nôtres
,et c ’est parce que j ’ai connu ces luttes s i
franchement patriotiques que mon cœur est rest é ancr é à lafoi de mes ancêtres , que je suis rest é attach é à la langue qu ’unemère canadienne et française m ’a appris a parler . On ne me
reprochera jamai s d ’avoir désert é le drapeau de ma nationalit é ,comme on ne me reprochera j amais de renier ou de trahir ledrapeau de la patrie nouvelle . Par le sang de mes veines
, par
la langue et la foi, j
’appart ien s a cette nationalit é canadienne
française,superbe par ses d écouvreurs
,ses pionniers
,ses h éros
et ses martyrs ,— par l’allégeance, j e suis citoyen américain ,
glorieux de ce titre,fil s de cette démocratie virile et généreuse
qui étonne le monde par la hardiesse de ses conceptions,ses
conqu êtes pacifiques,ses triomphes dans toutes les sph ères de
l ’activi t é humaine . Nous sommes,mes amis
,les descendants
d ’une race illustre,nous sommes aussi citoyens d ’une puissant e
d émocratie ne sont— cê point là des titres qui nous donnent ledroit d ’être fiers
,de marcher le front haut
,de croire que nous
sommes les égaux des autres él éments , capables de servir avecfidélit é,hab ilet é et honneur la R épublique
,de défendre avec
loyaut é le drapeau étoil é et les institutions que ce drapeauprotège
Cette pr étention ou fiert é l égitime,mes compatriotes
,
nous devons l ’avoir,elle doit être la base de nos aspirations
nationales . Elle sera le stimulant nécessaire au mouvement .franco—américain . Soyons fiers et nous serons étonn és desprogr ès accomplis . Cette fiert é nous donnera un plus grandnombre de repr ésentants dans la politique et aussi des chefsrespect és et écout és
,et dignes de l ’être .
Mais pour obtenir ces r ésultats,il faut aussi entrer de
plein—pied dans la vie américaine,dans le mouvement lib éral
de notre époque , se dépouiller de tous les pr éjugés d émodés ,être loyal aux part is,et surtout ne pas émietter nos forces .
Le progr ès des Canadiens , en ce pays , depuis un quartde si ècle
,est consid érable . Non seulement nous sommes nom
breux dans l ’Est et l ’Ouest,non seulement les électeurs de
notre origine augmentent,mais la propri ét é acquise par les
nôtres se chiffre dans les millions, j
’oserai s dire dans les cent
millions,et c ’est bien cette propri ét é
,sacr ée a plus d ’un titre ,
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 1 8 1
r epr ésentant souvent le travail ardu,les privations
,les sacri
fi ces la sant é même des nôtres,qu ’il faut savoir prot éger .
Par instinct,par éducation
,et j ’aj outerai par nos
c royances religieuses , nous sommes cons ervateurs , c’est pour
q uoi nos tendances politiques ont ét é g énéralement r épublic aines — le parti r épublicain ayant ét é le moins entach é ded émagogie et celui qui a touj ours su le mieux sauvegarder lesi ntérêts pr écieux du peuple .
Ce parti dont vous êtes les auxiliaires d évou és,demande
,
cette année,durant la campagne prochaine
,votre généreux et
patriotique appui,vous qui repr ésentez si b ien les forces vives
de la nationalit é . Vous êtes l ’espoir de cette nationalit é,
l’espoir aussi d ’un parti qui s ’honore de votre loyaut é .
Et ce soir,mes amis
,comme un des vôtres
,j et é par le
s ort on les circonstances dans la mêl ée depuis vingt— cinq ans,
ayant eu a essuyer défaites sur d éfaites,mais ne f aiblissant
j amais,j ’ai la satisfaction de dire que le drapeau du devoir , de
laËconcorde et de l’union plac é dans mes mains par mes com
patriotes du Rhode—Island n ’a pas ét é sali,que nous ne sommes
plus des parias mais b ien des égaux,que nos justes revendi ca
tions seront,a l ’avenir
,entendues
,que le parti r épublicain qui
compte la maj orit é des électeurs canadiens dans ses rangs,
reconnaît auj ourd ’hui l ’importance des services rendus parn otre él ément et veut le r écompenser en lui ouvr ant les carr i ères honorables .
A nous maintenant de pousser de l ’avant nos compat r iotes de valeur r éelle , hommes fiers de leur origine maiss inc èrement Américains . Il faut mettre au service de la causecommune tous les d évouements surtout le d évouement deshommes sér ieux . Dans un pays cosmopolite comme les EtatsUnis
,le prestige d ’une race d épend touj ours du caract ère
,du
talent et de l ’hab ilet é de ses repr ésentants .J’ai l
’orgueil de croire que la race qui a donné à l ’empire
c olonial de l ’Angleterre des hommes comme Papineau , Lafontaine
,Cartier
,Chapleau
,Mercier et L aurier
,donnera aussi à
cette R épublique des patriotes sinc ères,des hommes d’
Etat
illustres .C ’est là. mon espoir
,et j e ne demande pas davantage
pour la gloire de ma race,de cette race vigoureuse et civil isatrice
qui a port é la croix,et non le glaive
,des r égions bor éales aux
S ierras,de l ’Atlantique au Pacifique , et inscrit avec son sang
s a loyaut é sur les drapeaux de Carillon,de Chateauguay et
d’Ant ietam .
”
1 82 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Mgr Paul-Eugè ne Roy, é vê que auxi l ia i re de Qué bec
Le premier mai dernier,l’Acti on Soci ale annonçait dans
les termes suivants la nomination de Mgr RoyHier
,fête de Mgr de Laval
,ont ét é reçues à l ’Ar chevêché
,
les bulles,dat ées du 8 avril , qui nomment auxiliaire de Mon sei
gueur l ’Archevêque de Québec , sous le t itre d’évêque d
’Eleu
théropoli s , M . l ’abb é Paul—Eugène Roy, directeur-général del’Acti on Soci ale catholi que.
”
Le même j ournal faisait suivre cette note d ’une courteesquisse biographique du nouvel élu
Mgr Paul—Eugène Roy n’a pas encore cinquante ans .
Il est né à Berthier,comt é de Montmagny
,d ’une famille qui a
donné à l ’Egli se cinq prêtres le nouvel auxiliaire de Québec ,M . l ’abb é Phi l éas Roy, cur é de St—Anastasie , M . l ’abb é CamilleRoy, l
’écrivain connu,le R . P . Ars ène Roy, de l
’Ordre des
F r ères Prêcheurs et M . l ’abb é Alexandr e Roy, vicaire à Beauport . Une sœur du nouvel évêque est religieuse à l ’HôtelD ieud u Sacr é—Cœur .
“Mgr Roy a fait ses études classiques au coll ège de L éviset au Séminaire de Québec , et il a compl ét é à Paris , à l
’Ecole
des Carmes,sa formation litt éraire et eccl ésiastique . A son
retour d’Europe, il prit possession de la chaire de rh étorique
du Séminaire de Québec , puis occupa les d élicates fonctionsde pr éfet des études . Apr ès cinq années de service donnéesason Alma Mater il alla aux Etats-Unis prendre la directiond ’une paroisse canadienne aHartford , Conn . Il y passa quatreans
,pendant lesquels il prodi gua à nos compatriotes d ’outre
quarante-cinqui ème,son talent et son dévouement
,puis revint
à Québec où , pendant deux années , il s’efforça , par un travail
incessant et des démarches sans cesse r ép ét ées,de sauver de la
ruine l ’Hôtel—Dieu du Sacré—Cœur . Il y r éussit,puis fut chargé
d ’organiser la nouvelle paroisse Notre-Dame de Jacques-0 artier .Il se donna tout ent ier à ce travail
,qui n ’
épuisait point cependant son ardeur
,et il fut en même temps
,un des plus fervents
pr édicateurs de la derni ère campagne de t empérance .C ’est au milieu de ces lab eurs que Mgr l ’Archevêque de
Québec alla le chercher pour lui confier la tâche lourde entretoutes de fonder et de diriger l ’Oeuvre de l ’Action Sociale
catholique et celle de la Presse catholique. C ’est à ces œuvresqu ’il a donné tout son travail de ces deux derni ères années etce sont elles qui , probabl ement , ont fixé sur lui le choix duSouverain Ponti fe.
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
s’éteindr e
,et voici que toutes les pr étentions orgueilleuses
,les
fanfaronnades des champions salari és,l es gasconnades d ’un
chef supr ême tr ès malin , les promesses de garantie inébranlabledonnées à. tout venant , voi là que tout cet échafaudage der éclame tapageuse et de chif fres fantaisistes s ’écroule devantla simple conclusion d ’une enqu ête fédérale . Les taux dePl . 0 . F .
,pas les mêmes pour tous ses membres
,n ’étaient pas
suffisants et il faut combler de quelque mani ère l ’abime quele temps et l ’impr évoyance des chefs ont creus é entre les obligat ions de la soci ét é et ses ressources .
Certains mutualistes qui ont ét é mêl és à l ’organisation dePl . 0 . F . en ces derni ères années approuvent le changementd ’autres ne l ’approuvent pas en invoquant les droits acquisdes vieux membres . Ces droits acquis ne sont pas douteux
,
mais combien incertaine est la garantie qu ’ils seront respect éset qu’on fera droit à tous Ils dépendent nécessairementde l ’existence même de la soci ét é . Et si cette soci ét é n ’est pasétablie sur des bases solides
,qui paiera les vieux membres ,que deviendront leurs ‘droits acquis lorsque la soci ét é aura
épuis é sa r éserve et que ses revenus seront insuffis antsCertes
,M . Stevenson a raison de demander une augmen
tation des taux de l ’as surance dans sa soci ét é, mais il commetencore l ’erreur de ne pas étendr e l ’augmentation à tous lesmembres
,les taux actuels n ’étant pas encore suffisants b ien
qu ’il s soient plus élevés que ceux de 1 896 .
Certains disent que le changement propos é va chasser tousles vieux membres de la soci ét é en leur imposant un fardeauqu ’ils ne pourront plus porter . Malheur , alors , à ceux qui ontfait croire à ces braves gens qu ’ils pouvaient avoir une assurancede sans la payer ce qu ’elle valait Ceux qui ont trompéainsi leurs concitoyens sont morts et c ’est un spectacle navrantque de voir aux prises avec l ’impitoyable r éalit é des faits ceuxqui ont cru à. la parole des faux prophètes .Il est
,surtout
,infin iment cruel de voir si brutalement
d ésabus és les milliers de nos compatriotes qui ont port é avecune confiance aveugle leurs “ capitaux à des étrangers
,à des
ennemis,avec le naïf espoir de trouver dans une organi sation
cosmopolite la protection que leurs propres organi sationsnationales leur offraient d éjà d ’une façon plus modeste , mais ,pour le moins
,d ’une façon aussi sûr e . Car
,dans le cas des
organi sations nationales,il reste touj our s cette suprême res
s ource d ’un élan patriotique qui comblera les vides et feratraverser vi ctorieusement les temps de crise. Et il est inutile
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 1 85
d ’aj outer que rien de tel ne peut se rencontrer dans le cosmopolit isme sans cœur qui ne repose que sur les int érêts égoïsteset qui croule avec eux .
L ’exemple des Forestiers Indépendants va coûter cher ala Province de Québec et à certains centres de la NouvelleAngleterre où il atteint profondément les int érêts Canadiensfrançais et franco-américains . Profitera-t-i l à. quelques—uns aumoins Nous l ’espérons bien , mais nous redoutons touj ourscette disposition natur elle a tant de gens qui les porte vers cequ ’ils ne comprennent pas
,a se laisser éblouir par l ’éclat de
mensongères beaut és,à ne pas r ésister à la piperie des mots et
à pr éférer le drapeau d ’une fraternit é vide a la banni ère saintedes institutions nationales qui r éunissent avec une même sollicitude les int érêts de la race aux int érêts de l ’individu et de lafamille .Il fallait une occasion extraordinaire pour que nous puis
sions dire anos compatriotes ce qui leur a ét é cent fois r ép ét é :Groupez—vous sous vos propres drapeaux entrez dans vospropres organisations avant d ’aller ailleurs :” L ’I . 0 . F . vientde nous fournir cette occasion . Et il devait b ien cela auxCanadiens—Français
,lui qui leur aura fait tant de mal
Le protes tant i sme et les Franco-Amé r ica ins .
Opin ion de Ml le Yvonne Lema it re .
La chr oni que suivante de Mlle Yvonne Lemaître,la bril
lante directrice du F ranco—Améri cai n,de Lowell
,Mass
,est à
citer en entier . Dit Mlle LemaitreSaiRon généralement que les enfants des Canadiens
protestants ne parlent pas le françaisOn entend assez souvent proclamer
,assez vaguement et
un peu en l ’air,que la perte de la foi catholique chez les Cana
dieus est invariablement suivie de la perte de la langue française. Les Canadiens catholiques
,t outefois , ayant peu de
rapports sociaux avec les Canadiens protestants , écoutent cecid ’une orei lle distraite et ne se rendent pas compte a quel pointc ’est vrai .
C ’est même le probl ème qui effraie grandement la soci ét épubl ique ou Home Mission Society qui supporte deson argent la plupart des églises protestantes canadiennes .L es enfants des vieux piliers ne parlant plus la langue de
1 86 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
leur s p ères,qui est celle du pasteur
,s ’en vont entendre la
prêche aux églises américaines . Chaque fois qu ’un pilier s ’enva
,sa mort laisse un trou b éant dans la congrégation déjà
pitoyablement mince du temple paternel . Les enfant s neviendront pas le remplacer dans l ’église dont ils ne comprennentplus la langue . Et les églises canadiennes protestantes p ériclitent misérablement
,diminuent de j our en j our au lieu de
grandir,si bien qu ’un service divin dans un temple canadien
protestant n ’est plus qu ’une esp èce, de farce aux yeux du
F ranco—Américain catholique habitu é aux foules se pressantdans nos églises catholiques chaque dimanche . Le pauvrepasteur
,avec un z èle digne de banquettes plus remplies
,com
mente la Bible à une quinzaine d ’âmes . C ’est maigre,surtout
au moment psychologique de la quête .J’ai entendu le r év. Dr Emmerich
,de Boston
,ministre
tr ès haut cot é dans les sph ères Congr égat ional”de l
’Etat
,et
secr étaire g én éral de cette même soci ét é b iblique dont j e vousparlais plus haut
,reprocher amèrement aux Canadiens protes
tants ce fait que leurs enfants ne parlaient pas français .Le r évérend docteur y voyait
,et avec raison
,l’an éan
t i ssement certain des églises protestantes canadiennes . Apr èstrente et quarante ans d ’existence
,ces églises n ’ont pas plus
d ’adhérents,mais moins . Les enfants n ’y remplacent pas les
parents . Ces églises ne se supportent pas plus toutes seulesauj ourd ’hui qu ’au premier j our . Et la soci ét é biblique doittouj ours y aller de son petit denier
,une fonction qu ’elle com
mence non sans raison a trouver j oliment ennuyeuse .Ceci fut dit a une conférence des églises Congrega
t ional canadiennes de l ’Etat,tenue en cette petite église de
la rue Bowers que les Canadiens catholiques ont touj oursappel ée et appelleront touj ours l
’Egli se de Côt é Je dus y
assister en qualit é de reporter et j ’y vis et entendis une foulede choses int éressantes touchant la psychologie de ce groupede notre race
,tellement modifi é
,toutefois
,par l ’abandon de la
vieille religion des ancêtres , q u’il est devenu presque une racea part . Et cette question du français était
,entre toutes
,la
plus int éressante qu ’on toucha . Elle était la plus significative,
et tout s ’y rapportait,puisque la vie même des églises en dé
m ad.
Le Dr Emmerich alla jusqu ’à suggérer l etablissement
( 1 ecoles paroissiales,comme dans l ’église catholique
,pour
enseigner aux petits Canadiens protestants l ’idiome paternel .Mais c ’était là un beau rêve dont la r éalisation dépendait
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
fêtes de la St —Jean—Baptiste,il y a deux ans
,une petite histoire
qui me sembla pathétique . L ’un des membres de l ’église deCôt é voulait à tout prix cél ébrer la St—Jean—Baptis te
,lui
aussi . Il voulait prendr e part a la fête des Canadiens . Ilvoul ait être dans la cavalcade . Il s ’adr essa au chef d ’
étatma30 r .
Mais tu es protestant,mon vieux
,lui r épondit celui—ci
,qui le connaissait b ien . Qu ’est-ce que tu veux que j e fasseavec un protestant
— Mais j e suis Canadien,moi aussi . C ’est la fête des
Canadiens,j e puis b ien en être
,ce me semble .
C ’est la fête des Canadiens,oui
,mais tout de même ce
n ’est pas votre fête avous autres . Vous n ’êtes plus des nôtres .Pourtant
— Il n ’y a pas de pourtant . J ’en suis pein é , mais tudevrais comprendre que ce n ’est pas ta place .
Et le di sciple de Chiniquy vit tristement défil er dutrottoir
,quant vint le grand j our la belle cavalcade pour
laquelle on n ’avait pas voulu de lui .
Le t ro i s iè me centena i re de
Qué bec et le proj et Grey
Le M inistre de la Milice,M . Borden
,a annoncé que le
proj et de mob iliser hommes de troupes à Québec,pour
les fêtes du troisi ème centenaire était abandonné . Il y auratout au plus quelques r égiments
,avec un efiectif tqtal de
hommes, qui seront choisis par le comit é d
’organisationdes fêtes . Le ministre a d éclar é en être venu à cette décisionapr ès avoir constat é que les compagni es de chemins de fer nepouvaient pas se charger de transporter les troupes sans nuireà leur trafic r égulier . Voilà l ’explication officielle . Pour certains qui se disent rens eignés
,il y a b ien d ’autres raisons qui
tiennent plutôt de la r épugnance éprouvée dans tout le pays àdonner dans le proj et trop ouvertement impérialiste de LordGrey . Et l ’on regrette généralement que son interventionindiscr ète aura eu pour r ésultat de gâter une grande fête hi stor ique,la plus int éressante qui eût ét é c él ébr ée sur le continent .Il n’est pas douteux que dans la province de Québec , et à
Québec même,cette manifestation
,avec la tour nure anglaise
qu ’on lui donne,soul ève peu d ’enthousiasme . Le gouverneur
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 1 89
général a même pu,dit—on
,s ’en convaincre au cours des entre
tiens particuliers qu ’il a eus r écemm ent avec plusieurs desd éput és français à Ottawa
,aussi b ien qu ’avec certains cana
dieus—français éminents qui se sont honor és d ’une visite aR ideau Hall .
L ’un d ’entre eux,nous faisant part de la conversation
qu ’il avait eue avec le gouverneur-général au suj et des fêtesde Québec
,nous racontait comme suit un des incidents pi
quants de l ’entretien .
J ’ai,disait— il
,demandé a lord Grey ce qu ’il penserait
,
par exemple,d ’un programme de fête commune
,anglo— saxonne
,
— où les américains seraient organi sateurs de concert avecles anglais— de l ’insistance qu
’apporteraient les Etats—Unis
à faire figurer comme un des principaux événements a comm émorer
,la bataille de Bunker Hil l
,et j ’ai eu comme r éponse
une tête que j e n ’oublierai j amaisPourtant
,c ’est b ien acela que se r ésume toute la question .
On aura commis une erreur grave en glissant Wolfe et lesBattlefields dans une fête de famil le française
,pacifique .
D ’autre part nous nous demandons si on ne s ’est pastromp é tout autant
,dans les premiers temps
,en n
’associant
pas dans une fête commune le d évoilement du monumentde Mgr Laval et la c él ébration du troisi ème centenaire deQuébec . Ces deux fêtes n ’en devaient faire qu ’une . En
les s éparant on a permis au saxoni sme imp érialis te d ’en d évorer une.
Où tout cela va—t il nous conduire
Lé on Kemne r.
La Bas i l ique
Champlain érigea en 1 633 la prem1 ere église de Québecsous le vocable de Notre—Dame de la R ecouvrance . Maisl ’augmentation soudaine de la population ( 1 634—35) força del ’agrandir . Elle fut consacr ée à l ’Immacul ée Conception le 8décembre 1 636 . Le 1 4 juin
,
‘
elle fut compl ètement détruitepar le feu avec tout ce qu ’elle contenait
,vases sacrés
,registres
paroissiaux,etc . On ne prit des mesures pour la reconstruire
que le 8 octobre 1 646 , en conservant le site de l’église de Notre
Dame de la Reconvrance. La pose de la pierre angulaire eutlieu le 23septembre 1 647. Voici le texte du document donnantla date et relatant les faits de cette c ér émonie
Le 23septembre 1 640,le R év. Père Hierosme Lallemant
,
sup érieur de la mission,et M . de Montmagny
,le gouverneur
,
pos èrent la pierre angulaire de l’église de Notre-Dame de la
Conception,à Québec
,sous le vocable de Notre—Dame de la
Paix . La dite pierre est à l ’angle du câdre du chassis à maingauche en entrant dans l ’égi lse, du côt é et dans le coin le pluspr ès du maître— autel . Les noms de Jésus et Marie sont inscritsdans la pierre sur une plaque de plomb .
B . VIMONT .
Le nom de Notre—Dame de la Paix fut donné a la nouvelleéglise en mémoire de la paix qui venait d ’être conclue à. TroisR ivi ères avec les Iroquois . Les travaux de construction nefurent vraiment pouss és avec vigueur qu ’en 1 648 . La messey fut c él ébr ée pour la première fois le j our de Noël
,1 640 .
C ’est le Père Lallemand qui b énit l ’église et y cél ébra la première messe . L ’église ne fut définitivement terminée et dédi éeque le 31 mars 1 657. Les dimensions du bâtiment étaient de1 00 x 33. L ’église paroissiale fut ér igée canon iquement parMgr de Laval et remise au Séminaire en 1 664 . Elle fut consacr ée le 1 1 j uillet 1 666 . En 1 689
,elle fut agrandie de 50
pieds . En 1 745,elle fut encore allongée de 40 pieds et on
construisit les deux ailes de côt é qui existent encore . Tousces travaux furent terminés en 1 748
,cent ans apr ès la pose de
1 92 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
clocher . R éparations en 1 769 et la rallonge de 22 pieds ducôt é du sanctuaire
,de sorte que l ’églisea vai t a
’ ors une longueurde 21 6 pieds et une largeur de 94 pieds
,murs compris .
Depuis 1 771,époque où l ’église fut compl ètement restaur ée
quelques‘
changements ont ét é faits à la façade en 1 843,et en
1 849 , on commençait la construction de la tour qui n’est pas
encore terminée . En 1 775, le gouverneur Guy Carleton la dota
d ’un cadran et de trois cloches . Ce cadran fut remplac é parun autre en bois en 1 823.
L ’int érieur de la Basilique offre un int érêt tout particulierau touriste
,tant par l ’atmosph ère de sereine pi ét é qu ’on y
trouve,que par le ton sobre de ses décorations
,la richesse de ses
peintures,son baldaquin
,sa chair e
,ses chapelles lat érales et
les pieux souvenirs qui s ’y rattachent . Dans le chœur de cetteéglise reposent les restes de presque tous les évêques de Québec
,
ceux des cur és et des chanoines de la domination française,des
derniers R écollets,ainsi que ceux de centaines de laïques
,
hommes et femmes , appartenant aux premières familles de
Parmi les principaux tableaux de la Basil ique se trouventun Crucifiement de Van D yck (premier pil ier , pr ès du chœur
,
côt é nord de la nef) , un St—Paul , de Carlo Moratt i (dans lechœur) , des toiles de Restout , Blanchard , Vignon et Plamondon .
La pi èce du maître—autel est apparemment une copie de Lebrun .
Plusieurs plaques commémoratives y consacrent les noms desévêques de Québec
,et de quatre gouverneurs français
,y com
pris F rontenac . On peut vi siter la collection des vêtementssacr és en s ’adressant au suisse . Le chapeau rouge de feu leCardinal Taschereau est suspendu à la voûte au—dessus duchœur , vis—à—vis le trône épiscopal .
La cure de Qu ébec,disent MM . Doughty et Dionne
,la
seule inamovible au Canada,mérite une étude sp éciale
,non
seulement parce qu ’elle a ét é occup ée par des hommes éminents ,mais a cause du rang élevé qn
’on lui a toujour s accordé .
Trois prêtres l ’ont quitt ée pour monter sur le si ège épiscopalde Québec
,d ’autres l ’ont occup ée en même temps qu ’ils étaient
supérieurs du Séminaire tous se sont distingués par leurstalents ou leurs vertus . Henr i de Berni ères , Ar go de Maizerets
,
Bertrand de la Tour,Plessis
,Signay, Bail largeon , Proulx,
furent des cur és modèles dont le sanctuaire a gardé de pr écieuxsouvenirs .
“ Le cur éîactuel , M . F . X . Pagny , dont la nomination datede 1 888 , a beaucoup contribu é à orner la basilique et à lui
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 1 93
donner le cachet splendide qui la fait admirer auj ourd ’hui .C ’est à son initiative que l ’on doit les plaques commémorativesaux quatre gouverneurs français
,et aux Jésuites et R écollets
dont les cendres reposent dans les voûtes de l ’église .L
’
Eg l is e de St-Roch.
La pierre angulaire de cette église fut b énite le 28 août1 8 1 1
, par le Vicaire-Général D escheneaux. Le 1 1 avr il de lamême année
,le terrain de l ’église avait ét é donné à l ’évêque
de Québec,Mgr Plessis
,par M . John Munn et conc éd é par
M . Joseph Frenette pour la constru ction d ’une église . L’église
,
apart la sacristie,fut d étruite par le feu le 1 8 décembre 1 8 1 6.
R econstru it e en 1 8 1 8 . Jusque là la banlieue de St-R ochn ’était qu ’une branche de la paroisse de Notre—Dame deQu ébec . C ’est dans cette église que fut consacr é
,le 1 7 juin
,
1 821 , Mgr McEachern,premier évêque de Charlottetown .
Le 26 septembre 1 829,la paroisse fut érigée canon iquement
par Mgr Bernard Claude Panet .Le 28 mai 1 845
,l ’église fut détru ite par le feu .
La paroisse de St—R och a augment é rapidement depuis safondation
,au point qu ’elle a ét é subdivis ée en de nouvelles
paroisses : St—Sauveur,1 er mai 1 867 Limoi lou
,24 mai 1 895 ;
Stadacona, 24 mai 1 895 Jacques-Cartier , 25 septembre 1 90 1 .
La paroisse de St —Sauveur a,elle—même
,donné naissance a la
paroisse de St-Malo .
L ’église de St-Roch est suffisamment spacieuse,1 78 x 91
pieds . En 1 871,construction de la chapelle du Sacr é—Cœur
,
rue St —F rançois,apr ès une retraite pr êchée par le P ère Resther ,
Dans le sanctuaire de l ’église de St—R och est conservé lecœur de Mgr Plessis
,qui y fut transport é de l ’Hôpital—Général
le 30 septembre,1 847.
Les trois cloches furent install ées dans le clocher en juilletSur la façade de l eglise se trouve une statue dor ée de St
R och et son chien .
L‘Eg l i s e de St -Jean-Bapt is t e .
Commencée en 1 847 et terminée en 1 849 . Dimensions,
1 80 x 80 pieds . De 1 849 a 1 886,elle fait partie de la desserte
de la cathédrale et sous la direction d ’un chapelain . Le 8 juin
1 94 LA REVUE FRANCO —AM ÉRICAINE
1 88 1, elle est détruite dans le grand incendie qui d évasta le
faubourg St—Jean . Elle fut reconstruite plus grande et dédi éele 27 juillet 1 884 .
La paroisse de St Jean-Bapt 1 5te fut érigée canon iquem ent
par le Ca dinal Taschereau,le 24 mai 1 886 ‘
,son érection civile ‘
fut sanctionnée par la l égislature provinciale le 24 juin de lamême année . Population d ’environ âmes .
L ’int ér ieur de cette église est tr ès beau , mais l ’ext érieuren est surtout remarquable pour l ’él égance de ses proportionset la beaut é de sa façade .
Not re-Dame de la Garde .
Style romain,1 00 x 50 pieds . Construction autoris ée le
9 avril 1 877. Er igée en paro i sse le 23 juillet 1 885 et détachéede la paroisse Notre—Dame dont elle avait fait partie jusque-la .Eg l is e de St-Ma lo.
F ondée le 1 er juillet 1 898 . Dédi ée le 4 février° 1 899,par
Sa Grandeur Mgr Bégin . Style”
romain . Premier cur é,
M . l ’abb é Henr i D eF oy, actuellement de la paroisse Ste—Famillede Woonsocket
,R . I .
,Etats—Unis . Son successeur
,M . l ’abb é
H . Bouffard,est le cur é actuel de la paroisse .
Près de l ’église se trouve le couvent des Sœurs de NotreDame
,bâti en 1 90 1
,puis le coll ège des Fr ères Maristes
,cons
truit en 1 899 . La paroisse poss ède aussi une maison de laProvidence
,dirigée par les Sœurs Franciscaines .
Monas tè re e t é g l is e des Urs ul ine s .
Les Ursulines logèrent d ’abord,en août 1 639
,dans un
r éduit situ é a la b asse—vil e,a l ’endroit occup é auj ourd ’hui par
l ’hôtel Blanchard,en face de l ’église de Notre-Dame des Vic
toires . Au printemps de 1 64 1,les religieuses se construisirent
un monast ère de 92 x 28 pieds , à la haute—ville , sur un terrainque leur avait donné la Compagnie des Cent Associ és . C ’estla plus spacieuse et la plus belle maison du Canada
,écrit la
Mère Marie de l ’Incarnat ion .
Le 29 mai 1 652,les religieuses ouvrent un autre monast ère ,
de proportions plus consid érables . Le premier bâtiment avaitét é détruit par le feu
,le 30 décembre 1 650 . Le 20 octobre
1 96 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
PETITES TO ILES1 .
— É pousailles mystiques de Ste—Catherine , Pietro daCortova .
2.— La Sainte F ace de Notre-Seigneur .
3.-La Madone et l ’En fant .
4 .— Notre-Seigneur tombant Sous le poids de la Croix .
5.
— St-Jérôme recevant sa derni ère communi on (copiesupposée de Domenichini .)
6 .—La Sainte-F amille
,visite de Jean—Baptiste (l égendaire) .
MONUMENTS HISTOR IQUES
1 .
— Au marquis de Montcalm ,enseveli en 1 759 monu
ment érig é eu 1 859 épitaphe composée par l ’Académ ie F rançaise en 1 763.
2.— Tablette de marbre
,plac ée par le gouverneur anglais
,
Lord Aylmer,en 1 831 .
3.
— A'
la mémoire des Pères Jésuites,de Quen et D uperron ,qui ont travaill é à la conversion des tribus huronnes
,m orts en
1 659,1 655. Aussi au Fr ère lay L i égeois
,mort à Québec
,en
1 655.
TABLETTES COMMEMORATIVES1 .
— Père Thomas Maguire,chapelain des Ursulines pendant
1 8 ans . Déc édé à 82 ans , le 1 9 juillet 1 854.
2.
—Père Patrick Doherty (épitaphe) .3. Père Georges LeMoine
,chapelain des Ursulines de
1 854 à. 1 890 , mort à 73 ans , dans sa cinquanti ème année deprêtrise .
Le monast ère poss ède de vieilles gravures de Basset lej eune
,Andran et F . Landry de Paris
,des archives pr écieuses
contenant l ’autographe du roi Louis XV ,une biblioth èque
religieuse,litt éraire
,scientifique et p édagogique de
volumes,une relique de la vr aie Croix
,un crucifix en argent
massif donné par Mme de l a Peltr ie,plusieurs portraits de
personnages historiques,entre autres celui de la R évérende
Mère Marie de l ’Incarnat ion ,etc .
,etc .
Dans la chapelle des Ursulines,en 1 831
,Lord Aylmer fit
placer une tablette de marbre commémorative a Montcalm ,
dont les cendres reposent dans les voûtes de la chapelle . La
t ab lette porte l ’inscription suivante .
LA REVUE FRANCO-AM ÉR ICAINE 1 97
HONNEUR A MONTOALMLE DESTIN EN LUI D EROBANT LA V ICTOIRE
,
L’A RECOMPENSE PAR UNE MORT GLORIEUSE.
La chapelle des Saints contient la fameuse lampe votivedonnée par Marie Madeleine de R epentigny en 1 71 7. Cettel ampe fut remplac ée par une descendante d ’une branche de lafamille
,Miss Madeleine Arthon
,qui donna une lampe '
en argentsolide
,fabriquée par la c él èbre maison Armand Calliat de Lyon .
Le Rev. L . St—G. Lindsay,ancien chapelain du couvent
,en a
fait la description suivanteCette lampe
,qui est enti èrement d ’argent 1 er titre
,avec
dorure ors et couleurs,et émaux au feu
,aussi b ien que les
cha în es et le pavillon,p èse grammes . En voici le poème
dans les d étails Un large bandeau cisel é en relief,supporte
quinze roses émaill ées,cinq blanches
,cinq rouges et cinq
j aunes,couleurs embl ématiques des myst ères du Rosaire .
Trois volutes auxquelles les chaines sont attach ées supportentcette lampe qui se termine par un pendentif cisel é en relief etpar une croix émaill ée . Trois chapelets aux grains de lapisbleu du Tyr ol sont suspendus au-dessus du bandeau de lalampe . Des lys au naturel t imbrent le bandeau du pavillonet s ’accrochent aux volutes .
Cette lampe votive n ’a pas cess é de brûler depuis qu ’ellea ét é donnée au couvent par Mlle de R epentigny .
Marie Madeleine de R epentigny entra au couvent desUrsulines à l ’âge de dix ans
,plus tard s ’y fit religieuse
,apr ès
la mort de son fianc é . M . Kirby mêle son nom à. une intrigued ’amour dans son roman Le chien d ’or C ’est son fr èrequi aurait tu é Nicolas Jacquin Philibert .Eg l i s e de St -Pat r ice
Eglise des irlandais catholiques,rue MacMahon
,pr ès de la
Côte du Palais . Construite en 1 831,1 46 x 65 pieds
,agrandie
enË1 845, dirigée par les Pères R édemptoristes depuis le 29septembre 1 874 . Contient une excellente toile de M . CharlesHuot
,repr ésentant le Couronnement de Marie
Not re-Dame des Vict o i res
Situ ée à la basse-ville . La plus m odeste des églises deQuébec elle rappelle une multitude de souvenirs glorieux etfrançais . Elle fut fondée il v a 21 8 ans .
1 98 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Pose de la pierre angulaire le 1 er mai\
1 608. Le gouverneurétait pr ésent et Mgr de Laval officiait . Terminée apr ès l ’arrivée à Québec de Mgr de St-Valier . L
’éve êque la dédia d
’aborda l
’En fant—Jésus et la petite chapelle que l ’on voit a gauche
en entrant fut appel ée la_chapelle de Ste-Genevi ève .
Apr ès l ’in fructueuse tentative de Phipps contre Québec,en
1 690,l ’évêque décida de dédier l ’église à Notre-Dame de la
Vi ctoire ; et il ordonna qu ’une fête avec procession en l ’honneurde la Vi é rge, fût c él ébr ée chaque année , le quatri ème dimanched ’octobre .Vingt et un ans plus tard le nom de 1 eglise fut encore
changé apr ès que,par une nouvelle intervention de la Provi
dence,la ville eut ét é sauvée d ’un nouveau si ège . En 1 71 1
,
une flotte anglaise commandée par l ’amiral Walker se dirigeasur Qu ébec . La flotte redout ée se perdit dans un épais broui llard
,et huit des navires all èrent se briser sur les rochers de
l’Ile aux Oeufs . Toute la population de Québec fit un pèler i
nage d’act ions de grâce à Notre—Dame de la Victoire . On
plaça ensuite l ’église sous le vocable de Notre—Dame desVictoires pour rappeler aux générations futures les faveursaccordées aux Canadiens-Français par la Mère de Dieu .
L ’église fut complètement détruite lors du si ège et de laprise de Québec
,en 1 759 . Elle fut reconstruite en 1 765. Les
citoyens en firent achever l ’int érieur en 1 8 1 7. Le 23mai 1 888,
on c él ébr a par une grande fête religieuse pr ésidée par le Cardinal Taschereau
,le deuxi ème centenaire de la fondation de
l ’église de Notre-Dame des Victoires .Quelques mois auparavant
,elle avait ét é fra îchem ent
peinte à. fresque . Les d écorations de l ’int ér ieur sont d ’un goûttr ès délicat . Sur la f] ise de la muraille
,du côt é de l ’évangile
,
sont les armes du Card inal Taschereau et de Jacquer —Cartierdu côt é de l ’épître, sont les armes de Mgr de Laval et de Champlain . Sur des panneaux se trouvent des repr ésentations destrophées enl evés aux anglais à la bataille de Beauport en 1 690
,
et de la destruction de la flotte de Walker . Dans le choeur ,au—dessus de l ’autel
,sont inscrits les mots : Kebeka Liberata .
La vil le de Qu ébec,symbolis ée par une femme couronnée
,
est assise sur un roc au pied duquel l ’esprit Indien du StLaurent renverse une urne . Près du groupe
,un castor . A
leurs pieds il y a des boucliers,des cuirasses et des étendards
portant les armes de l ’Angleterre. Ce suj et a ét é emprunt é àune médaille frapp ée du temps de Louis XIV
,pour perpétuer
l a mémoire des vi ctoires françaises . A l ’arri ère de l ’église,sur
°
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
1 898. L ’int érieur de la chapelle est de_
\
toute beaut é on y a
install é il y a une couple d ’années un splendide autel en marbrede Carrare et en onyx mexicain . On y fait l ’adoration perpétuelle du Tr ès Saint— Sacrement . Chapelain le R éV .
Paquet .
EGLISE D ES RECOLLETS
Monas tè re et Eg l i s e de s Reco l let s
Fut construite en 1 693,sur
° le t errain occupé aujourd ’huipar la cath édr ale anglicane et le palais de justice. Le terraindes R écollets fut expropri é par le gouvernement apr ès la mort
,
1 8 mai 1 800,du R év. Père Félix de Berey
,le dernier des R écol
l ets qui aient vécu au Canada .
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 20 1
L’
Eg l i s e de Jacques-Cart ie r
Construction c'ommencée dans le mois d ’août 1 851 . Inaugur ée comme chapelle de la Congr égation de St—R och , le 1 1septembre 1 863. Ouverte au public pour services paroissiauxen 1 865. En 1 90 1
,la Congr égation donna sa chapelle à Mgr
Bégin,qui en fit l ’église de la nouvelle paroisse de Jacques
Cartier,érigée canoni quement le 25 septembre 1 90 1 . La pa
roisse est plac ée sous le vocable de l ’Immaculée Conception .
Son premier cur é fut l ’abb é Paul Eugène Roy, plus tardDirecteur de l ’Acti on Sociale Catholi que, et auj ourd ’hui évêqueauxiliaire de Québec .No t re-Dame du Chem in
Situ ée sur le chemin de Ste-Foy, a côt é de Villa Manr èse,
l a maison des Jésuites qui ont la desserte de l ’église . Elle estdue a la générosit é du Chevalier Louis de Gonzague Bai llargéet de quelques citoyens de Québec . Bel int érieur . Inaugur éeen 1 895.
Eg l i s e de St -Sauveur
Elle fut construite il y a plus de 50 ans,mais ne fut érigée
en paroisse qu ’en 1 867. On lui a donné son nom en mémoiredu premier prêtre s éculier venu à Québec en 1 634. D étruitepar le feu en 1 866
,elle fut reconstruite l ’année suivante . Elle
est dirigée par les P ères Oblats . D écoration int érieure parM . Charles Huot.
Not re-Dame de Lourdes
Constru ite par les Pères Oblats en 1 870 . Consacr ée le 8décembre 1 880 .
En 1 882,le Cardinal Taschereau la reconnut comme la
chapelle du Tiers-Ordre des F ranciscains.‘
Chape l le de la Congré gat ion de la Haut e Vi l le
Sur la rue d’Auteui l
,angle de la rue Dauphine
, ( 1 ) sur unterrain octroyé par Sir John Sherbrooke
,le 9 novembre 1 8 1 7,
( 1 ) La rue Dauphine étai t connue sous le n om de rue Sain te-Anne, enbas , par oppos ition à la rue Sain te-Anne actuelle qui es t plus élevée.
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
à la demande de Mgr Plessis . Nous en retrouvons l ’histoiredans l ’extrait suivant de l
’Histoire de la Congrégation de
Notre-Dame de QuébecOn se mit aussitôt à l ’œuvre ponr construire la chapelle
avec un logement adj acent qui servirait de sacristie et de presbyt ère.
L a Chapelle actuelle de la Congrégat ion de laHaute-Vi lle de Québec .
Une souscription ” fut ouvert e en ville afin d ’aider aux
frais de construction,car les ressources modiques de la con
gr égat ion n’y auraient pas suffi . La chapelle f ut ouverte
au culte vers 1 820 . On y installa la cloche de l ’ancienneéglise des Jésuites .Pour favoriser la fr équentation de cette chapelle et aider
à l ’amortissement de la dette,l ’évêque décida
,le 4 mai 1 826
,
qu ’un salut du saint Sacrement aurait lieu le vendredi dechaque semaine et qu ’une messe publique serait c él ébr ée
LA REVUE FRANCO—AMERICAINE
Les Eg l is es Prot es tant es
Qu ébec poss ède plusieurs églises protestantes dont laplus ancienne est sans contredit la cath édrale anglicane situ éeà l ’ouest de la Place d ’
Armes,en ar r i ê1 e du Palais de Justice
,
sur le terrain Où se trouvait autrefois l ’église des R écoll e t
L A CATHEDRALE ANGLICAINE
d étruite par le feu,avec leur couvent en 1 796 L ’église
actuelle fut dédi ée en 1 804. C ’est tout près de cette égliseque se trouvait Form e sous leqt el Jacques—Cartier assembla
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 205
ses compagnons apr ès son arrivée dans la colonie . Cet arbrefut abattu par le vent dans le mois de septembre 1 845. Avantl ’érection de l ’église anglicane à. Québec les exercises de cetted énomination religieuse avaient lieu dans la vieille église desR écollets . Apr ès l ’incendie le gouvernement anglais s ’empara du sol et y fit construire l ’ égli se actuelle . On peut yvoir le drapeau du 69ème R égiment reçu des mains du PrinceArt hur lorsque ce régiment fut envoy é en garnison au Canada.
Les autres églises protestantes de la ville sont les suivantes :Trinity Church
,
ӎpi scopalienne, rue St . Stanislas , autre
fois occupée par les militaires église Méthodiste,même rue
,
en haut église baptiste,rue McMahon ; église St . Andr é,
presbyt érienne,rue Ste . Anne Chalmers Church
,
” presbyt ér ienne, rue Ste . Ursule , sc ène de l ’émeute Gavazzi , en 1 859église protestante française
,rue St . Jean
,en dehors des murs
église St . Mathieu,épi sc0 palienne, sur la même rue , mais
plus à l ’ouest . Il y a aussi des églises épisc0 paliennes sur la
rue St . Valier,à St . Roch et sur la rue Champlain .
V ieux articles et vieux ouvrages
Le s Canad iens de l’
Oue s t , par Joseph Tas sé , deux1 em e édition ,
—M ontréal , Im prim eri e Can ad ienne ,I 878 ,_ (Cathol i c Quarterly
R eview .Oc t . 1 879 ) 2èm e par ti e.
Davenport,dans l ’Etat de l ’Iowa
,reconnaît pour son fon
dateur le canadien Antoine Leclerc qui vint s ’étab lir à Péor iaen 1 809
,un peu avant la destruction de ce vi llage par Craig .
Un peu plus tard,il alla se fixer à R ocky Island Où sa modeste
hab itation fut b ientôt j et ée dans l ’ombre par la maison queconstruisit le C olonel Davenport . Connaissant a fond tous lessecrets de la for êt profonde
,familier avec les id ées et les dialectes
d es Indiens,Leclerc j oua un rôle important comme interprète
et agent . Les Sacs et les R enards donnèrent a sa femme unevaste étendue de terrain et
,plus heureux que Dubuque
,cette
donation fut reconnue par le gouvernement américain,et
Leclerc vécut assez longtemps pour voir le développement deDavenport
,même pour vendre la maison qu ’il y avait construite
à une compagnie de chemin de fer qui en fit une gare . Leclercprit une part active dans toutes les Opérations entreprises avecles Sacs et les Renards il recueillit des l èvres même de BlackHawk une autob iographie de ce chef c él èbre et la fit publieren Angleterre .Pendant plusieurs années il fut maître de poste et juge de
paix avec juridiction sur toutes les causes épineuses soulevéesentre blancs et indiens . Lorsque
,en 1 840
,on organisa dans sa
ville une Association de Pionniers il en fut le premierpr ésident .
Leclerc resta touj ours fidèle à sa religion . Il donna desemplacements pour les églises et les institutions catholiquesaussitôt que des prêtres furent rendus sur les lieux . Il souscr ivit puis donna ensuite mille dollars de plus
,pour la
construction de l ’église St-Pierre,actuellement l ’église St
Antoine . En 1 836,il construisit l ’église Ste-Marguerite
,puis
la donna avec le terrain sur lequel elle était érigée à son évêque .Ce cadeau était vraiment digne de c es âges de foi .
La vi eille ville canadienne de Détroit eut aussi ses personnages de marque . L ’histoire de ses premi ères années nous
208 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Louis’
Provençal , un autre canadien , fut un des pionniersdu Minnessota . Mais le canadien le plus éminent de cet Etatfut Jean—Baptiste Faribault
,dont le frè re Bartholom ée
,rest é
au Canada,rendit de si grands services à l ’histoire de sa colonie
natale et en recueillant plusieurs des plus rares et des plusprécieux ouvr ages qui s ’y rapport ent . Son catalogue faitpart ie de notre bibliographie .
Jcan-Baptiste , né à Berthi er en 1 774 , attira l ’attention duDuc de Kent par son habi let é artistique et reçut l ’offre d ’unecommission
,mais il pr éféra entrer au service de la North West
Company . Son premier poste fut Kankakee . La et à. BâtonR ouge
,sur la rivi ère Desmoines
,il fit ses premiers essais dans
le commerce des fourrures et il obtint beaucoup de succ ès . Illui tardait encore de retourner au Canada , mais il accepta toutde même le commandement de Petits Rapides . Apr ès troisans de s éj our à ce poste il épousa une fille métisse et établitd éfinitivement son foyer dans l ’Ouest . Apr ès dix annéespass ées au servi ce de la Compagnie , il r ésolut de faire le commerce des fourrures pour son propre compte
,et
,s ’étant fixé à
la Prairie du Chien , il établit un commerce lucratif avec lesWinnebagoes
,les Sioux et les Renards qui habitaient dans les
environs . Le plomb miné par son compatriote Dubuque et lesfourrures amass ées par les indiens furent les principaux obj etsqu ’il acheta pour les transport er ensuite à St—Louis dans desvoyages qui duraient jusqu ’
à quinze j ours . Lorsque la guerreéclata entre l ’Angleterre et les Etats-Unis , en 1 8 1 2, F aribaultrefusa de prendre cause pour ces derniers . Il fut en cons é
quen ce fait prisonnier par le Colonel McCall et emmené surune canonni ère anglaise . Lorsque les Anglais attaqu èrent laPrairie du Chien
,sa femme et ses enfants s
’
en fui rent àWinona
,ne se doutant gu ère qu ’il était prisonnier des
assaillants . Sa maison fut détruite par les Winnebagoes,et
ses bestiaux et ses marchandises pill és . Tout lui fut enlevéet il se trouva
,apr ès tant d ’années de lab eur
,dans un com
plet dénuement . Son courage,cependant
,ne l ’abandonna
pas,et il entreprit de refaire sa fortune mais lorsque les
Anglais se retir èrent,ils mirent le feu aux bâtisses de la
Prairie du Chien qu ’ils laiss èren t compl ètement dévast ée .La North Wes t Company
,exclue de notre territoire
,fut
forcée de vendre ses promi ét és , et Farib ault put profiter decette occasion . Après avoir exerc é son commerce pendantquelques années a la Prairie du Chi en
,il se transporta à. Pike
Island,tout pr ès de l ’endroit où s
’
éleva plus tard le Fort
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 209
Snelling . Là,il entreprit de cultiver la terre il fut le premier
à casser le sol pour des fins agricoles à l ’ouest du Mississippi etau nord de la rivi ère D esMoines . L ’île
,qui avait un demi
m ille carr é,lui fut c édée par les Indiens et son titre fut valid é
d ans le trait é de 1 820 . Deux ans plus tard une inondationb alaya l ’île
,détruisant tout ce qui s ’y trouvait d ’améliorations
,
et,en 1 826
,à cause d ’une accumulation de la glace
,la maison
qu’il avait courageusement reconstruite fut ras ée et son trou
peau de bestiaux fut noyé . Quittant ce poste trop expos é , ils e retira à Mendota où il fit un commerce tr ès florissant
,et
gagna bientôt la confiance des Sauvages qui l ’appelèrent Chapolin i stoy, ou queue de castor .” Ceci
,cependant
,n
’
empêcha
pas qu ’il fût,en une occasion
,poignard é et bless é gr avement
par une brave En 1 8 1 7 il rencontra le premier prêtr e quiv isita cette r égion et put
,avec sa famille
,profiter des secours
de la religion . En 1 840,il trouva mourant à F ort Snelling le
R év. M . Galt ier qu ’il amena dans sa maison et auquel il donnales soins les plus assidus . Sa maison devint celle du vaillantapôtre pour lequel il construisit une petite chapelle
,la première
é rigée dans le Minnesota , que fr équenta b ientôt une congr égat ion de Canadiens et d’
Indiens . Cette église fut consacr ée à-I’Apôtre des Gentils et c
’est de là. que la ville de St-Paul a priss on nom . Le vénérable Vicaire-Général Ravoux succ éda àl’abb é Galt ier et il professa tou j ours la plus haute est im é pourle pionnier canadien qui mourut en 1 860
,regrett é de tous
,et
apr ès avoir donné à. ses enfants une éducation que peu d ’enfantshabitant les pays neufs peuvent obtenir . Son fils Alexandredevint tr ès influent
,occupant successivement des positions
importantes pour les Etats-Unis dans les n égociat ions .avec lessauvages
,puis celle de l égislateur dans l ’Etat que son p ère
avait tant contribu é à fonder . Le Minnessota a un comté etune ville portant le nom de F ar ibault
,et ce fils y contribua
g énéreusement à l ’église catholique . C ’est lui qui,avec le
concours du général F ields,j eta les bases de Far ibaultvi lle.
Superior City,sur le Lac Sup érieur
,est une ville qui se
r éclame de fondateurs canadiens dans les personnes de JeanBaptiste Lefeb vre
,Saint Denis
,Roy et Saint Jean .
St-Paul,qui doit son nom aun pr être catholique
,le R év.
M . Galt ier , lionore parmi ses pionniers , le canadien Vital Gu '
er 1 n
dont la g énérosit é envers la ville et l ’église catholique futremarquable . Le progr ès de St-Paul lui permit de conquériru ne situation de richesse et d ’importance
,mais son honnêtet é
e t sa franchise en firent une victime facile pour les exploiteurs
21 0 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
sans scrupule qui envahissent les villes naissantes . Son avoirfut diss éminé et il mourut pauvre après avoir fait des cadeauxprinciers et avoir r épondu avec empressement aux appels char itables . St-Paul a élevé un monument acet homme de mérite
,
et l ’historien dela ville fait le plus grand éloge de sa valeur .Pemb ina compte parmi ses pionniers Joseph Rolette
,fils
de celui qui a d éj à ét é mentionné dans cette étude . Il repr ésenta sa ville à la Législature du Minnessota et était un hommetrès entreprenant . Tous les proj ets devant contribuer audéveloppement du pays le trouvaient parmi les plus ardentset son nom est encore vénér é dans le comt é de Rolette
,Dakota .
A une p ériode plus recul ée appartient Jean—BaptisteMallet qui
,en 1 777 fonda un établissement sur le site actuel
de la ville de Péor ia,Illinois
,qui fut pendant longtemps connue
sous le nom de Ville à Mallet .” Cet établissement et Cahokiafournirent les volontaires pour l ’exp édition de Brady contre leF ort St —Joseph . Ces volontaires enlevèrent le fort aux Anglais
,
mais en revenant dans leurs foyers,ils tomb èrent dans une
embuscade que l eur tendirent les sauvages et furent presquetous tu és ou faits prisonniers . Indompt é par ce revers
,Mallet
,
en 1 878,marcha contre le même fort
,s ’en empara
,enleva les
magasins évalués à et mit fin aux opérations anglaisesdans cette partie du pays . La Ville a Mallet attira leshab itants de la vieille Péor ia et prosp éra jusqu ’en 1 8 1 2 alorsque le capitaine Craig de la milice de l ’Illinois
,dont le camp
avait ét é attaqu é par les sauvages,se vengea sur les colons
inoff ensifs,pillant leurs maisons
,s’
emparant de leurs chevauxet détruisant leurs bestiaux et leurs r écoltes . Les habitantseux—mêmes furent faits prisonniers et lorsqu ’ils furent remis enlib ert é ce ne fut que pour retrouver leurs maisons r éduites encendres par les sauvages . Ils demandèrent en vain une indemn it é au Congrès américain ; on ne fit j amais droit a leursr éclamations .
Pierre Ménard,de Kaskas kia
,cette vieille ville d ’
or igine
canadienne fut,au cours du dernier si ècle
,un des hommes les
plus éminents de l ’Ouest . A partir de l ’année 1 786 , il s’occupa
de commerce,d ’abord à. Vincennes
,comme agent du colonel
Vigo,puis aKaskaskia
,ensuite comme associ é de Manuel Liza ,
et étendit le champ de ses op érations jusqu ’aux MontagnesR ocheuses . Comme agent au service des Etats-Unis , il conclutplusieur s trait és avec les tribus indiennes . Il fut élu par lecomté de R andolph a la Législature du Territoire de l ’Indiana,et lorsque l ’Illinois devint territoire
,il si égea au cons eil légi s
21 2 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
l es absurdit és de ce nouvel apostat . Pourtant il avait avantsa chute dirig é une émigration canadienne considérable desbords du St . Laurent vers Bourbonnais
,et il conçut le proj et
,
qu ’il r éalisa en partie,de grouper a cet endroit tous l es Cana
di ens dispers és dans les Etats—Uni s . Ce groupe atteignitde son temps une population de six ou sept m ille habitants .Joseph Robidou
,fils d ’un des premiers pionni ers de St .
Louis,cons truisit une habitation (cabin) , en 1 803, au pied des
Monts des Serpents Noirs (Black snake Hills) et fit le commerceavec les Iowas
,les R enards
,les Pawnees et les Kansas
,parmi
lesquels il devint b ientôt tr ès influent . Le magasin de R obidou fut vite connu de tout le monde
,et apr ès qu ’il eut acquis
une étendue de terrain des sauvages en paiement des dettesdues par les tribus
, (1 ) Robidou ,invita les colons a veni r
’té ablir aupr ès de lui et fonda la ville de St . Joseph ‘a laquelle
i l donna lenom de son ssaint patron et dont il fut le premierm agistrat .Un autre membre de cette race canadienne
,Jean Baptiste
L ouis Roy, est rest é fameux dans les annales de l’
Ouest pourl a r ésistance h éroïque qu ’il fit
,en 1 8 1 4
,à la Côte Sans Dessein
,
avec sa femme,contre une armée consid érable d’
l owas,de
R enards et de Sacs . Plusieurs canadiens avaient ét é attir és:au dehors du fort
,par une fuite simul ée
,puis isol és
‘
. Roy,
port ant sa vi eille mère , s’
échappa avec sa femme et un comp agnou j usqu
’à sa maison
,au milieu d ’une pluie de balles .
L e si ège commença . Mme Roy,fondait des balles pour les
h ommes et,lorsqu ’elle en avait le loisir
,employait son propre
fusil contre les Indiens et avec un effet terrible car elle étaitune habile tireuse . Leur feu était si rapide qu ’ils durentm ouiller les canons de leurs fusils . Le deuxi ème j our leurcompag non s ’étant hasardé a regarder a travers un trou demuraille fut bless é mortellement . Les sauvages s
’aperçurent
b ientôt de leur avantage et r éussirent à mettre le feu au toitde la maison
,Roy monta sur le toit et éteignit les flammes
,
t andis que sa brave épouse,employant successivement tous les
f usils chargés d ’avance empêcha les sauvages de tourner leursarmes contre son mari . Le trois i ème j our les trouva enti èrement épuisés . Leur endurance était rendue à sa limite, maisi ls décidèrent de maur ir bravement et ouvrirent le quatri èmej our avec une telle fusillade de toutes les parties de la maisonque les sauvages , poussant des grands crisse retir èrent , lais
( 1 ) Treat ies between the Un i ted States and the Indian Tribes , p. 525.
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 21 3
sant les cadavres de quatorze de leurs camarades autour de lamaison qui venait d ’être d éfendue avec l ’énergie de désespoir .Louis Vital Bogy
, ( 1 ) qui peut être considér é comme lep ère du vi eux Kaskaskia
,qui devint commissaire des affaires
Indiennes pour les Etats-Uni s,sous le pr ésident Johnson
,
et qui mourut s énateur des Etats-Unis pour l ’Etat du Missour i
,est un des membres les plus distingu és de cet él ément
Canadien F rançais . Pendant ses études,il fut victime d ’un
accident qui le força pendant longtemps ase servi r de b équilles .En dépit de ce contretemps
,il commença à étudier le droit
en 1 8 1 2,déclarant même alors
,dans une lettre a sa mère
,
que l ’ambition de sa vie était de représenter un j our l ’Etatdu Missour i dans le S énat des Etats—Unis , et qu ’il était déterm iné à atteindr e ce but même s ’il fallai t y t ravailler jusqu ’
à
l ’âge de soixante ans . Apr ès avoir compl ét é ses études classiques et avoir étudi é le droit aKaskask ia
,il retourna à Ste .
Genevi ève où il acheta une magnifique propri ét é et se lançadans la vie publique . En 1 852
,il se porta candidat au Con
gr ès des Etats-Unis contre Thomas H. Benton qui n ’
obtint
que difficilement sa r éélection,Bogy ayant remport é tous les
comtés,except é celui où se trouvait St . Louis . Ains i port é
au premi er rang,Bogy
,fut aussitôt élu pour la Législature
du Missour i .Il acheta
,avec quelques autres le Pilot Knob
,une mon
tagne riche en m in érai de fer et construisit le Iron MountainR ailway afin de transporter le m in érai sur le marché . Iln
’abandonna j amais sa profession . Tout en s ’occupant depolitique et
°
de travaux publics,il conserva une client èle con
s idérable jusqu ’à la guerre civile
,alors qu ’il fut exclu par le
serment que les fanatiques impos èrent à. l ’Etat du Wisconsin .
Il se porta candidat au Congr ès en 1 863 contre Blair,mais le
terrorisme employé contre lui l ’empêcha d’être élu . Trois
ans plus tard,comme nous l ’avons d éjà dit
,il fut nommé
commissaire des aff ai r es Indiennes,et en 1 873 il était élu
au Sénat des Etats—Unis,atteignant le but qu ambitionnait
sa j eunesse .Comme commissaire des affaires Indiennes
,il r épara
quelques-unes des injustices commises par ce Bureau enversles missions catholiques
,et au Sénat il ne craignait j amais
de confesser sa foi catholique . Il d éfendit même avec le plus( 1 ) Ce nom est ortographiede d i ff érentes m an i ères dan s nos registresBaugy ,
Baugrs , Beaugre , Bangle , Bougainvi lle écr ivi t Bogi 3. Les m embres de cette fam i lle au Mi ssour i s ignent Bogy.
_
12 1 4 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
noble cour age la loyaut é catholique c ontre les attaques hon-
. teuses du s énateur Edmunds . ( 1 )Les noms que nous avons mentionnés jusqu ’ici se rappor
tent plus sp écialement au Nord Ouest . Michel Branamour
Ménard,neveu du lieutenant—gouverneur de l ’Illinois portant
ce nom,est un des héros de l ’histoire du Texas . Il se rendit
au Texas en 1 829,et comme commerçant il y acquit une tell e
influence parmi les blancs et les sauvages qu ’au moment d ela r évolte contre le Mexique
,le gouvernement nouveau compta
sur Ménard pour obtenir l ’amiti é ou au moins “la neutralit édes tribus indiennes . Il fut membre de la Convention const itut ionnelle et lors de l ’organi sation de lar épublique il fut éluau Congr èsF . X . Aubrey
,esprit aventureux
,brillant
,organisa un
vaste commerce sur terre avec le Nouveau Mexique . Sa vieabonde en aventures et en p ér ils de toutes sortes parmi lestribus sauvages de la prairie il échappa a tous ces dangerspour être finalement assassine par le maj or Weightman .
De la même façon le canadien Leroux atteignit une granderenommée .
La Californie a eu un Canadien énergique dans PrudentBeaudry qui travailla à développer ses ressources sp écialementdans Los Angeles et les environs .Lorsque nous arrivons à l ’Or égon ,
qui fut d ’abord colon is é âWallamette et Cowlitz par les Canadiens employés par laCompagnie de la Baie d’Hudson
,nous retrouvons parmi les
premiers pionni ers Gabriel F ranchère qui s ’y rendit dans les
( 1 ) Dan s le débat , le Sénateur Edm un ds avait été part iculrerem en t
violen t dan s son attaqire con t re l’
Egli se et le Syllabus . Il s’
agi ssa it d’
un
amendem en t à la con st itut ion am é ri caine ( 1 875—76 ) prohiban t dan s toutela r épubl ique les subven t ion s aux écoles s épar ées , un r égime qui fut établ idan s la sui te . Voi ci un extrai t du vigour eux di scours que M . Bogy pronon çaà cette occas ion .
Dan s ce pays , comm e dan s tous les autres pays ,les cathol iques son t
en faveur d ’
un e par fa ite l iber té rel igieuse , et une jus te in terpr état ion duSyllabus m on t re qu
’
i l ne con t ien t r ien qui soit en oppos i t ion avec les grandspr in cipes de l ibert é , fon dés sur°
ce que tous les hommes éclai rés do iven treconnaître : “
la loi d ivine . Tous les gouvernem en t s doiven t s’
appuyersur cet te base pour se m a in ten i r , et celui qu i ne veut pas l
’
accepter sapeet d ét rui t le pr in cipe m êm e de la l iber t é et de tous les bon s gouvern em en ts .
On a parl é de l ’ in toléran ce des cathol i ques . Eh b ien ! n ’
es t-i l pas
vra i que les cathol iques du Maryland on t ét é les prem iers a déployer labann i ère de la l ibert é rel igieuse Quoi qu’
on di se,les prem iers , i ls on tproclam é cette l ibert é dan s le Nouveau Monde , n on pas comm e une con
cess ion,comm e un com promi s
,m ai s parce qu
’
elle étai t con forme à leurs
convi ct ion s .
”
Chez le Pharmacien
Il fait un temps frisquet,point trop désagr éable une
j olie gel ée blanche qui met du rose sur le nez mignon des fillettes
,du bleu sur celui de leurs mamans , du vi olet , quand la
dame est d ’un certain âge,
” comme on dit dans les j ournauxde mode .Voici justement une respectable personne r épondant à
cette qualification, prudente , qui se dispose à entrer chez lepharmacien du coin .
La porte s ’ouvre sous sa poussée,la sonnerie tinte et le
patron,coiff é d ’un bonnet grec brodé d ’
arabesques en fil d’or
,
perd de vue un instant le flacon qu ’il remplit avec une sagelenteur
,d ’un signe de tête amical
,souhaite la b ienvenue à sa
cliente et la prie de s ’asseoir . Il sera à ses ordres dans deuxminutes .
Il fait b on dans la pharmacie,chauffée sans exagération
le soleil d ’hiver envoie ses pâles rayons à travers les bocauxpleins d ’eau color ée
,et de brillantes taches rouges
,j aunes
,bleues égaient le pavé en mosaïque .Les petites boîtes
,les petits sacs portant des chromos aux
teintes criardes , les bouteilles encapuchonnées d ’
étain dor é,
les fioles plus mignonnes avec leur petit bonnet de peau blanche
,nou é d ’un coquet ruban
,font un j oli effet dans les vitrines
des comptoirs et , contre les murs , l’alignement maj estueux
des bocaux de cristal à étiquettes vert et or , des pots de faïenceà décor bleu fait comme un r égiment de vaillants soldats prêtsà combattre les mis ères humaines .
Mlle Ledoux s ’est assise,et j ouirait assez confortablement
du b ien-être qui l ’entour e, si son esprit n ’était en proie à degraves incertitudes
Elle lit,d ’un œil inquiet
,les inscriptions des divers r é
cipients .
Le pharmacien,un brave homme
,un peu a l ’ancienne
mode,n ’a point voulu sacrifier au nouveau style et sa
vaisselle professionnelle qui date du temps Où il s ’est ins tall é,
c ’est—â—dire il y a quelque trente ans,a conservé les antiques
et savantes appellations .
LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE 21 7
Chez lui,l ’eau pure est de l ’aqua simples , la guimauve
de l’althéa offici nali s , la camomille de l
’an themi s nobi li s
,le
lierre terrestre du glechoma hederacea et , qui le croirait, l ’inoff ensif Bouillon blanc r épond au nom hirsute de VerbaswmThapsus
Elle croit b ien,cependant . retrouver de Vi eilles connais
sances dans ces feuilles dess éch ées,ces fleurs sans forme ni
couleur bien accus ées,mais l ’étranget é solennelle des appella
tions lui inspire une crainte mêl ée de respect aussi , quandle bonhomme à. la calotte brodée l ’interroge et lui demandece qu ’elle d ésire
,elle h ésite comme S ’i l s ’agissait d ’une ques
t ion de vie ou de mort .
— Je voudrais,dit-elle enfin
,une tisane calmante .
— C ’est bien facile . Voulez-vous du t illeul de la fleurd
’orangerElle secoua la tête .Non . Quelque chose de plus s érieux
,un vrai calmant .
Des feuilles de coquelicotDu coquelicot C ’est une sorte de pavot
,n ’est—ce pas
En effet .Oh j e n ’en veux pas Il me faut un calmant qui ne
calme pas trop,parce que
,voyez-veus
,c ’est quelque fois tr ès
dangereux,ces stup éfiants . j ’ai connu une dame qui .
Elle commence à raconter l ’histoire de la dame . Le
pharmacien,qui n ’
a nulle envie de l ’entendr e,l’interrompt .
Voulez-vous de la tisane des quatre fleursQu ’est-ce qu ’il y a dans ces quatre fleur sUne foule de choses de la violette
,de la mauve
,de la
bourrache .
Est-ce que tant d ’herbes médicinales, ça ne fait pas un
mélange mauvais pour l ’estomacJamais la tisane des quatre fleurs n ’a empoisonné per
sonne,â ma connaissance du moinsEmpoisonné Comment dites-vous Il y a du poison
dans ces fleurs-là Mais,au contraire Je viens de vous di re
que c ’est un compos é absolument inoff ensif.Alors
, ça sera comme si j e prenais de l ’eau claire .Le pharmacien il est excusable fait un geste d ’im
patience , rate le pliss é dont il entourait le bouchon de sa fiole,d échire le papier rose et le j ette à terre .
Enfin gémit la dame,puisque vous êtes pharmacien
c’est pour vendre des dr ogues
Assurément Mais quelle drogue voulez-vous
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Est—ce que j e sais moi C ’est a vous de me cons eillerQu ’est-ce que vous avezJe commence un rhume . Je tousse .
S i vous toussez, prenez des pasti lles Géraudel, dit le
pharmacien qui n’est point ennemi d ’une plaisanterie anodi ne .
Mais la cliente ne plaisante pas,elle
Je ne veux point de pastilles . Je veux une tisane,quelque chose de chaud à boire .
De la violette Ca fera—t-i l votre aff aireE lle r éfléchit longuement .La sonnette t inte . Une j eune fil le
,rouge
,haletante
,les
yeux gros de larmes , entre et tend une ordonn ance au pharmaci en qui raff ermit son binocle et lit avec attention .
Sa figure prend une expression s érieuse .Asseyez-vous un ins tant
,Mademoiselle
,dit—i l . Je
vais pr éparer ceci .Oh Monsieur le plus vite possible Le médecin a
dit que c ’était tr ès press é,j ’ai couru
_ tout l e tempsOui
,j e vois Je vais faire diligence.
Monsieur mais,Monsieur glapit une voix aigre
,c ’est
moi qu ’il faut servir d ’abord J’étais ici avant cette j euneOn va s ’occuper de vous
,di t le pharmacien d ’un ton
plutôt rogue .Et il colle à ses l èvres le cornet d ’un tube acoustique .On entend un pas leste qui dégringole dans l ’escalier
,un
j eune aide entre dans la boutique par la porte du fond . Sesyeux malins ont promptement dévisag é sa pratique .”
Que vous faut-il,Madame demande-t i l d ’un air
Une tisane pour le rhume . Une tisane calmante,etc .
,
etc ., etc .Parfaitement Je vois ce qui convient avotre tempé
r amment .
C ’est du glycyrrhi za glabra . J’ai obtenu des cur es merv eilleuses
C ’est sans dangerAucun
,d ’aucune sorte .
Et on prend çaQuand on veut
,en inf usion tr ès chaude
,sucrée avec
d u miel,de préférence
Il ouvre un bocal portant le nom ci-dessus,en tire une
p oignée de petits b âtonnets, p èse, rep èse, enf erme le tout dans:un petit sac
,plie bien carr ément
,ficelle
,cachète
,reçoit les
L'
idée de Mlle JeannePAR S. BOUCHERIT
— J e rendrai Pierre D ubreui l un être sociab le , fit Jeanneavec gravi té . Je lui apprendrai la lecture et le catéchisme .Les autres se chargeront du reste .
— Ma pauvre petite,j e crains bien que vous n ’y perdiez
vos peines .“ J ’aurai du moins l ’honneur de l ’avoir entrepr is !
Ça c’est dans des vers que vous m ’avez fait apprendre
l ’autre j our . Je ne sais pas de qui i l sont , par exemple ,mais ça m
’est égale . Enfin j ’ai mon plan et vous m ’y aiderez , n
’ est-cc pas ? Voyez -vous que nous arrivions au but quej e rêve ? C ’ est cela qui ferait des vacances bien employées !E t j
’
y ,songe . Voi là un travai l qui constituera un fameux
devoir de vacances , auque l vous n ’aviez pas penSé et qui conc i liera tout , pui squ
’ en enseignant moi-même j e repasseraimes cours . Ce ne serait pas juste
,vous comprenez bien ,
qu ’en plus de l ’ instruction de Jean j e fisse encore des dictéeset des prob lèmes pour mon propre compte . Ce serait de lasuré . suro . Comment - dites-vous ça ?
— Surérogation .
— Préci sément . Je ne peux pas suréroger . Oh ! ma
chère demoise lle , que j e ri rai s du nez de M . Casimir Lombrequand il verrai t guéri celui qu ’ i l prétend incurab le et guéripar qui ? Par Jeanne Viviers
,une écervelée
,une toquée ,
comme i l le pense , j ’ en suis sûre . Car il ne le dit pas .
S ’ i l le disait , j e lui riverais son clou et ce ne serait pas long .
Voyons ! Voulez -vous m ’aider à ti rer Pierre Dubreui l de sa
misère morale ? E st-ce di t ?— Chère mi gnonne , avant de vous répondre , laissez -moi
vous exprimer un scrupule . Je crois qu ’ il faudrait consulterMonsi eur votre père sur ce proj et .Jeanne n ’avait pas prévu cette objection : elle resta un
moment pensive .
— Ma bonne demoise lle Hermance,répondit-e lle enfin
,
vous savez si j ’aime mon chère papa . I l est si bon que j e
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 221
s uis sûre qu ’ i l m ’
approuverait . Mais il est que lquefois aussiun peu moqueur et
,s ’ i l ri ait de mon proj et , ne fût-ce qu ’
un
peu ,j e me sentirais découragée . Ne mettons personne dans
n otre secret . Si nous réussissons , nous ferons une grosseSurprise amon père . Si nous échouons , ce n
’est pas la peined e divulguer notre échec . On a son amour—propre . Non ,
person’ne‘ ! Cela vaut mieux ,
ni papa ni Henry , qui iraitc rier ce que nous faisons par dessus les toits . Mais si ! J
’
aiun e idée . Décidément
,j ’ai beaucoup d ’ idées aujourd
’
hui .N ous allons faire notre confidence a M . le Curé . .L a! voi là
qui mettra votre conscience en repos . . et la mi enne aussia cause du catéchisme . Et puis , dans l ’aveni r , son concours nous sera nécessaire pour compléter notre œuvre .
— Jusqu’
où voulez -vous donc qu ’on pousse l education dePierre ?Jeanne s ’arrêta dans sa marche et répondit , émue , a mi
voix— Jusqu a s a première communron .
Cette fois,M lle Marois n ’y tint plus . E l le oub lia sa
dignité et,au beau milieu de l ’ allée , e l le prit son é lève dans
ses bras et l ’embrassa comme une mère . Même Jeannes entit couler sur sa joue quelque chose d ’
hum ide .
E lle sortit , très attendrie , de cette étreinte et , sa pétulancejuvénile reparaissant , e l le s
’
écr ia :
— Alons ! vite ! Nos chapeaux . . et en route pour le presbytère . .En avant ! marche !
— Ma1 s dit l ’ in sti tutri ce en souriant , je ne vous ai pas ditque j
’
adherai s .
— Vous avez fait mi eux que le dire , Mademoise lle . Vousavez prouvé .
Et e lle prit sa course vers le château , tandis que M lle Mar ois suivai t de son pas a lourdi
,se pressant tant qu ’ e l le pou
vait . Mais e l le ne pouvait pas beaucoup,et e lle n ’était pas
au perron que Jeanne réapparaissait , ayant en un clin d ’œi lchangé de robe et le chapeau sur la tête . Ce n ’ était pas uncanotier , insu ffisamment é légant pour aller a la cure ; mais i lé tait toujours de travers .
—Hardi , Mademoise l le ! cr ia l ’ enfant de sa voix rieuseActivons , activon s l comme dit papa aux ouvriers
,les jours
de presse . Louis XIV n ’aimait pas a attendre . C ’est vousqui me l
’avez appri s .
222 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Le curé de Mon tbuel était un prêtre de haute piété et dehaute valeur . Il comprit et approuva sans hésiter le projetde Jeanne . Nu l mieux que lui ne connaissait cette petiteâme pure et droite et , avec une intelligente bonté , i l passaiten souriant sur les vivacités que lquefois un peu impétueusesde cette nature ardente , mais généreuse . Même il off r it àJeanne son concours immédiat . Mais la jeune fille tenait àaccomp lir son œuvre e lle—même .
— C ’ est bien,mon enfant
,fit le curé . Je m ’
abstiendrai
pour l ’ instant . Je vOus laisserai tout le mérite et je m’ interviendrai que quand vous m ’
appellerz . Mais , continua-t-i len riant
,puisque votre exclusivisme ambitieux ne veut pas
de mon aide,vous ne m ’
empêcherez pas cependant de vousbénir de vos nob les intentions et de prier le bon Dieu de lesfaire réussir .
— Ça , tant que vous voudrez , Monsieur le Curé , ripostaJeanne .
— Maintenant,dit-e lle à M lle Marois , en sortant de la
cure,nous voilà munies de l ’approbation de l
’
Egli se . Ilne s ’agit p lus que de commencer notre petit travail . Si vousm ’ en croyez
,nous al lons nous y mettre dès aujourd ’hui ,
tout chaud,tout boui llant . Le temps de changer mon uni
forme de gala , que j ’avais mis en l ’honneur de M . le Curé .
Ce ne sera pas long .
Que lques mi nutes après,l’
in sti tutr i ce et Jeanne gagnaientla maison du surveillant et , justement , e lles trouvèrentPierre qui bêchait une p late—bande près de l ’ entrée ; au bruitde leurs pas qui faisaient craquer le sab le ; i l leva la tête etfit un mouvement pour fuir .
— Eh bien ! s é cria Jeanne . C ’est ains i que vous me recevez , l ’ami Pierre ? Voulez -vous venir ici , tout de suite !Pierre lai ssa tomber sa bêche et s ’
avan_ ça avec son sour ire
béat . Il semb lait n ’avoir pas de volonté propre à obéir à. unesuggestion . Quand il entendit Jeanne lui parler de sa voixharmoni euse et douce , son visage prit une expression ravie .
Ses yeux la regardaient,étonnés toujours mais plus clairs ,
fixés sur elle avec un rayon joyeux . On aurait dit un croyant surpris , mais charmé , par une appari tion cé leste ; et , defa i t , en ce moment , Jeanne , dans sa robe b lanche à grandsplrs , avec un large ruban rose comme ceinture , ses beaux
224 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
d’aller le chercher . I l fit une mine s i eff arée qu ’e lle devinasa crainte et ajouta en souriant
— Soyez tranqui lle . Nous ne nous en irons pas sans vous .
I l gagna la maison et revint en courant . Il eut un éclat derire quand il vit que Jeanne était toujours a la même place ,
l’
attendan t .
M lle Marois non p lus «ne lui faisait pas peur ; el le participait du rayonnement de Jeanne , ou peut-être même ne lavoyait-i l pas .Le parc qui entoure le château de Mon tbuel , sans être
immense,ne laisse pas que d ’avoir des proport ions assez
vastes . Il est surtout admirab lement aménagé . Les propr i étai res anciens ont laissé de longue date des futaies dontles troncs é lancés s ’é lèvent aujourd ’hui a des hauteurs étonnantes . On passe sous leur ombrage comme sous des arcades d ’égli se
,dans un silence exqui s , ne permettant guère
de soupçonner qu ’ à. queq es pas s ’agite tout un foyer d ’act ivité et de production . La nature a favorisé ces li eux Sur
des pentes s i douces qu ’on ne saurait les appe ler des collines ,
des tapis de mousse,entrecoupés de hêtres gigantesques
,de
chênes aux larges ram ures et de bouquets de sapins sombres ,
dévalent vers un ruisse let minuscule , si modeste qu ’
i l n ’
a
pas de nom géographi que , ce qui ne l’empêche pas de couler ,
j oyeux et limpide , en gazouillant , sur un lit de cai llouxb lancs .Les promeneurs marchèrent ainsi longtemps
,longtemps ,
au mili eu des grands arbres , dont les branches touffues lesgarantissaient du solei l , et des enivrantes senteurs qui montaien t des bruyères . Un bruissement s ’élevait de l ’herbe .
chant de travail de myriades de bestioles qui butinaient,in
visib les , les fleurs des boi s .Il y avai t dans le parc un coin parti culièrement charman t ,
obj et des préférences de Jeanne . C ’était une clairière assezvaste , si bien entourée d epai s se verdures qu
’ i l semb laitqu
’on y fût séparé complètement du reste du monde . Destailli s fourrés en formaient la ceinture
,si serrés qu ’
i ls di ss imulai ent le senti er y accédant…De grands pins parasols yy étendaient leur ombre , entourant comm e un cortège d ’honneur un chêne gigantesque au tronc couvert de li erre L es ol y étai t caché par les fougères , les genêts d ’or et de largesplaques de thym parfumé . D ’un côté seulement
,l ’horizon
s’
ouvrai t dans une étroite éclairci . Un saut de loup,percé
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 225
dans le mur de c lôture du parc , perm ettait à l ’œil de s ’ enfoncer dans les bois extérieurs par une al lée dont la per spective semblai t infin ie . Au—dessus
,dans un espace qu ’on
aurai t di t ménagé a plai s ir , on apercevait un morceau du cie lb leu .
Jeanne avait fait installer la un banc de mousse et prenaitsouvent pour but de ses promenades la Crai ri ère des fées” ,
ainsi qu ’e lle avait surnommé ce lieu , par un caprice enfantin .
Toute petite ,e lle y venait j ouer ; plus grande , e lle y venait
rêver . Car cette nature,toute vivace qu ’ e l le fût , avait ses
heures de rêverie . M lle Marois aflectionai t aussi cette re
traite verdoyante . Son p lai sir,a e lle , était de s ’y laisser
a ller a une douce somno lence,bercée par le discret murmure
du rui sseau voisin et le roucoulement des tourtere lles sauvages »perchées dans les arbres d ’
alen tour .
Jean ne avai t décidé que la “ C lairière des fées serait lasalle d ’étude de Pierre
,et e lle l ’y amena dès le premier jour .
L ’ e f fet que produi si t cet endroit charmant sur cet esprit fermé fut instantané
_et d ’une étonnante v ivacité . Pierre se
mi t à rire , courant à travers les herbes du sol , touchant lestroncs des arbres comme pour en prendre possession : puistout a coup s ’arrêtant en face de l ’a llée des bois où justement , en ce moment , se j ouait une harmonieuse successionde rayons de solei l et d ’ombres
,i l s ’
écri a extasié,les yeux
brillants—Beau Beau ! Beau— C ’ est beau ,
— n ’est—ce pas,Pierre
, di t Jeanne qui voulutcommencer aussitôt son œuvre . Eh bien ! venez vous asseoir la, près de m oi . Nous allons causer . Ces grandsarbres que vous admirez , toutes ces verdures si vari ées quinous entourent , ces oi seaux que vous entendez chanter , ce
ci e l b leu qui s ’ étend au-dessus de nos têtes,ce soleil qui
nous éclaire , moi qui ‘
vous parle , vous qui m ’
écoutez ,c ’est
Dieu qui a tout fait , tout . J’aime bien le bon Dieu
,Pierre
,
i l faut que vous l ’aim iez bien aussi .— Dieu ! Dieu ! répétai t le j eune homme comme pour se
bien graver le nom dans la mémoire .
.
Alors Jeanne , la folle enfant qu ’on aurait cru susceptiblen r de patience ni de mesure , se mit à parler d ’une voix lentepour ne pas brusquer l ’ inte l ligence si faib le a laquel le e lles
’
adressai t , racontant dans un langage simple,enfantin par
Instants , mais d ’autant plus compréhensib le pour ce grand
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
enfant,la création du monde , l ’origine des choses , l ’ infin ie
pui ssance de Dieu . E l le s ’animait en parlant , trouvant ene l le des ressources de science qu ’ e lle ignorait , tout étonnéee lle—même des expressions qui lui venaient aux lèvres , sic lai res s i simples , qu ’aucun esprit n ’aurait pu n e les pascom prendre . Un rayonnement illuminait son front li sse .Ses yeux brillai ent d ’
ardeur et d ’ espérance . L ’ange étaittransformé en apôtre et dans ses regards , dans toute e lle , onsentait un prosé lyti sme débordant
,irrési stib le .
M lle Marois l’
écoutai t , émerveillée et émue . E lle n e
songea pas au sommei l ce j our-là et les échos de la clai rièren ’ eurent pas à répéter le murmure accoutumé de ses ronflements di screts . Orgueui lleuse ,
elle aurait pu être fière deson é lève
,devenue a son tour éducatrice . Mai s , aussi mo
deste que bonne,e l le se rendai t bien compte que l ’ inspiration
de Jeanne venait de plus haut qu ’e lle,et e l le demeura hum
blement spectatrice attendrie .
P i erre aussi écoutai t ravi,extasié ! Nul ne saurait dire ce
qui se passai t dans les ténèbres de cette âme où une lumièrepénétrai t pour la premi ère foi s . Ce qu ’
i l y a de certain e t
ce que la mignonne catéch i ste constata avec une joie immensec ’ est que son e ffort n ’
éta1 t pas perdu . Imitant en ce la M lleMaroi s qu i , après lu i avo i r expl iqué une leçon ,
la lui f ai sai trépéter , pour s
’assurer s i e lle avai t été compri se , Jeanne ,quand e lle arrêta son cours sagement limi té
,interrogea
I‘
1 er re sur ce qu ’e ll venai t de lui ense igner . De sa voixhési tante , le j eune homme répondi t . I l commi t b i en sansdoute que lques erreurs que la maîtresse improvisée rectifiait
br ièvement au passage ; mais le point capital étai t acqui s : i lcomprenait . Avec du temps et une persévérante volonté
,
on arriverai t .— Victoi re ! Victoire , s ecr ia Jeanne dans l ’exaltation de
sa joi e . Nous le sauverons,Mademoise lle Hermance !
E lle se j eta dans les bras de son institutrice et , cette fois ,ce fut ce lle ci qui senti t couler sur sa joue une larme qu i n evenai t pas de ses yeux .
Telle fut la prem i è re leçon donnée par Jeanne la folle , comme e lle se surnommai t el le-même
,à Pierre l ’ innocen t .
V .
Les jours se succédèrent et se ressemb lèrent . Chaqueaprès-midi a heure fixe ,
M lle Maroi s et Jeanne se rendaienta la Clai rrere des fées , dont P i erre avait appris le chemin .
228 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
passion véritab le pour son œuvre . E lfe se sentait grandievi s -avi s d ’ e lle même par la pensée que grâce a e lle , une i n
telligen ce s’ouvrai t
,un être allait être appelé à la vre qui ,
sans el le,était condamné à végéter dans une existence pure
ment animale devant forcément aboutir à l ’abruti s sem ent .
L ’amb i tion du succès final se doub lait , chez M lle Viviers .d ’un sentiment de responsab i lité qui , sans l ’eff rayer , la ren
dai t plus grave . L ’ enfant écerve lée di spar i s sai t peu a_ peuet fai sait place a la j eune fii lle qui pensait et voulait . P lussouvent
,Jeanne éprouvait le besoin de se rendre à l ’ église et
d ’y retremper son courage dans la pri ère . D ’ instinct , e lleavait toujours été pi euse
,e lle le devint plus profondément
avec une rai son qu i mûri ssait . Pierre , occasion de ces
changements,rendai t ainsi a sa bienfaitrice le service qu ’ i l
en recevait .Le curé de Mon tbuel
,confident des efforts faits et des ré
sultats obtenus , encourageait l’
én ergique enfant et M .
Casimir Lombre s ’ étai t chargé lui même de lui donner unstim i1 1an t nouveau .
A un moment,Jeanne fut un peu souffrante , un petit
chaud et froid,un rien
,su f fi sant cependant pour qu ’ e lle dût
garder la ma i son et interrompre pendant trois jours lesséances de la “ C lairi ère des fées . Le soi r du tro i s ièmejour , à dîner , le précepteur , parlant de sa voix de tête quidonnai t à son langage un ai r de fatuité insupportab le , raconta une aventure qu ’
i l avait eue dan s sa journée .
— J e me promenai s, di t-il , ce matin après déj euner , à
deux pas d ’ ici , auprès du massi f de rhododendrons qui faitface au château , lorsque j ’ai entendu au mili eu du fourré unbruit étrange de feuilles froi ssées comme par le mouvementd ’une bête fauve ; j e me suis auss itôt éloigné .
— Admirable bravoure ! s é cri a Jeanne qui n ’
abdiquart passon animosi té a l egard du précepteur .
—Agir autrement , Mademoi selle , eût été de la témérité ,non de la bravoure . Mai s , tout a l ’heure , j ’ai voulu voir sice phén omène se reprodui rait et j e me sui s avancé de nouveau vers le massif .
— B i en armé , j’ espère fit Jeanne incorrigib le .
—Armé d ’une forte canne . Le même brui t s ’est renonve le , meme plus vrolen t , et tout a coup le massif s ’est ouvertet Il en sort i . devrn ez quoi . Le fils de Dubreui l
,le sur
ve i llant . cet idiot ! D ’un peu plus j e lui aurais donné une
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 229
leçon avec mon gourdin pour lui apprendre a se cacher ainsidans les massifs et a faire peur aux gens . Il a eu l ’audacede s ’approcher de mm et , bien que j e me sois tenu à distance ,j ’ai entendu ses paroles incohérentes . car il parle a prés ent ! I l m ’a parlé de vous , Mademoiselle , de santé , d ’
abs ence , d
’
inqu 1 etude ,de clairi ère des fées , de lecture , de j e n e
s ais quoi . un esprit complètement dérangé enfin . Vraim ent , Monsieur V iviers , je ne sai s pas si vous ne fer iez pasbien de conseiller a son père de faire enfermer ce garçon .
I l pourrait arriver que lque malheur a lui ou par lui .— Enfermer ! s é cria J eanne furieuse . Enfermer l etre
le plus doux ,le plus inoffensif ! Parce qu ’ il vous fait peur ,
Monsieur Casimir,
Voilà. une raison Tout vous faitpeur d
’abord . L ’autre j our,vous tremb liez en entendant
coasser les grenouilles de l ’étang de Voyron . Voulez -vousqu
’ on les enferme aussi ? . Quant à P i erre Dubreuil , il estbien libre
,le pauvre être , d ’aimer les rhododendrons . Et
puis qu ’on ne s’
avi se pas d ’y toucher , ni vous , MonsieurCasimir
,ni personne . C ’ est mon protégé , j e vous l ’ai di t .
— Soit ma fi lle,dit M . Viviers . Mai s qu ’ est-ce que ton
protégé avai t à faire dans un massif auprès du château ? .
Du reste,j e ne suis pas d ’avis ni de l
’
en f erm er , ni de legêner , le pauvre enfant . Je l ’ai vu que lquefois et j e letrouve intéressant . J ’ai m ême remarqué qu ’ il devenaitmoins sauvage . Il ne fuit plus quand i l v ous voit , i l commence à répondre aux questions qu ’on lui fait . Je croisqu ’on pourrait l ’employer aux ate liers , si toutefois tu le permets , Jeannette , puisqu
’on ne peut pas y toucher sans tonautor isation .
— Ça , répondit M l le V iviers , c ’ est une autre a ff aire . Jepense , comme toi , que le travai l ne pourra qu ’être bon àPierre Dubreuil . Je te demande seulement d ’attendre l ’hiver pour cet essai . Tant que les beaux jours durent
,le grand
air lui fait d u bien . Je m ’ en suis aperçue aussi . Puis j ’aiune autre raison .
— Soit , Mademoisel le . Je respecte votre secret,fit M .
Viviers avec un sour i re‘
qui prouvait qu’ i l en savait peut-être
plus long qu’
i l n ’ en voulait dire .
Jeanne était révoltée et touchée . R évoltée par 1 1 déebarbare de M . Lombre , touchée par l ’action de Pierre . I lavait voulu , c
’était clair , avoir de ses nouve lles , inquiet dene l ’avoir pas vue depuis trois jours
,préoccupé de l ’ in terrup
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
tion de ses leçons de lecture : il avait é chappé le mot . I ltenai t donc a ses leçons ! C etai t une exce llente garantiede succès et Jeanne
,sans chercher plus loin , se promit de re
doub ler d ’
ardeur pour arriver a ses fins en ce qui concernaitPierre . Ce n etai t peut-être pas le résultat que s ’ étai t proposé M . Casim i r .Par que l mi racle de pati ence Jeanne
,cette enfant impé
tueuse,par que l effort prodigieux de persévérante douceur
Jeanne,cette j eune fi lle vive comm e le salpêtre , parvint-e lle
a réaliser son œuvre ? E t aussi que l mystérieuse fascinationexerça-t-e lle sur l ’ espri t engourdi de Pierre“, réussissant laoù personne autre peut-être n ’aurait réussi . Toujour s est-i lque quand approcha la Toussaint
,terme fixé par M . Vivi ers
pour les vacances de ses enfants,le fi ls de Dubreui l n ’était
p lus reconnaissab le .
En même temps que la nature acœ mpli ssai t en lui latransformation physique vou lue par l ’âge
,la char ité quoti
di enne , incessante , intel ligemment vigi lante de Jeanne ao
compli ssai t en lui la transformation intellectue lle .
Oh ce Il etait pas encore un aigle ! Mais où était le sauvage d ’antan au rire niais
,aux peurs bestiales
, a l ’ espritc los ? Chaque jour avait apporté son contingent d ’e fforts etde succès dont le total étai t déjà te l que même les non initiés
,
au moins en apparance , comme M . Viviers,en étaient
frappés et que seul un Casimi r Lombre ne s ’ en apercevaitpas , n
’étant occupé qu’
à se contempler lui-même .
Il se faisai t même chez'
Pierre un éve i l que nul ne soupçonnai t , pas même Jeanne . De tout temps une tendancenature lle , inexpliquée et singulière , l ’avait porté à resterpendant de longues heures dans des contemplations béatesdes si tes plus ou moins pittoresques qui l ’envi ronnaien t .
Autant i l étai t indi fférent au mouvement des hommes,autant
i . s ’emb lait s ’ intéresser aux spectacles de la nature . . Peuexigeant d ’ai lleurs . Un champ
,un arbre
,un
' nuage quipassait sur le sole i l , dessinant des forme s fantastiques au
m i lieu de j eux de lumière , su ffisaien t à fixer son attention absorbée . La “ C lai rière des fées ”
,avec ses ombres mysté
r i euses , ses perspectives de sous-bois discrètement ensolei llées
, l ’avait visib lement charmé et,quand il s ’y trouvait seul
,
avant l’
arrivée de ses institutrices,on aurait pu le surprendre
r etraçant du doigt , dans le vide de l ’air ,les lignes‘ succes
8 1 ves qui se déroulaient sous ses yeux . On aurait dit que le
232 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Par un hasard singu lier— pas pour tout le monde— le curése trouvait là .
Comme à la prem 1 ere visite,Pierre manquait à l ’appe l .
Mais comme la premi ère foi s aussi,il apparut b i entôt amené
par Jeanne . E lle semb lait grave,émue ; mais e l le ne pou
vait se départir ni de son enjouement nature l , n i de la satisfaction de vengeance permise qu ’ elle avait décidée dans sa
petite tête .
Pierre entra sans manifester aucune crainte , ainsi qu’autr e
fois,et salua sans gaucherie .
Messi eurs et Mesdames,dit Jeanne
,il y a trois mois ,
voyant pour la premi ère foi s le j eune homme que voici dontune grave maladi e avait fatigué l ’ esprit , un grand savant adécidé du haut de sa science que son état étai t incurab le .
Te lle n ’a pas été l ’opinion d ’une peti te qui n ’ est pas savantedu tout . E lle s ’ est promi se de montrer à tous qu ’un grandsavant peut se tromper et j e vais vous en donner la preuve .
Pierre mon ami,voudriez -vous avoir la bonté de demander
amon père le journal qu ’ i l a dan s sa poche et de nous en lireque lques passages ?M . Vivi ers tendit le “
j ournal et Pierre lut couramment lespremières l ignes .
— Assez ! reprit Jeanne . Maintenant,Pierre
,mon ami
,
voulez -vous bien dire a M . le Curé combien il y a de personnes eu D i eu ?
—Il y en a trois , le Père , le F ils , et le Saint—Esprit .— R écitez -lui
,j e vous prie , le Credo .
— J e crois en Dieu le Père tout puissant,créateur du cie l
et de la terre et en Jésus-Chr ist son fils unique , Notre Seigneur .
— Il suffit , interrom pit M . Viviers attendri, .C ’est toi
,
ma Jeanne , qui a fait ce miracle ?— Moi-même , répondit Jeanne , avec l
’aide de Dieu à quiM . le Curé a demandé dans ses pri ères de bénir mon entreprise
, et vous voyez que Dieu l’a bénie .
Le père Dubreuil sanglotait dans son mouchoir . Mme
Dubreui l sais it la main de Jeanne et la porta a ses lèvres . L es
fi llettes , sans trop savoir pourquoi fondirent en pleurs et legros jouflu , voyant tout le monde si ému ,
se mit 'apousser descris perçants qui amenèrent son expulsion immédiate .
Pier re regardait sa bienfaitr ice avec une ex«pess ion de
gratitude que rien n e peut rendre et Jeanne,triomphante
,
LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE 233
s e tenait debout au mi lieu de tous , rayonnante de joie et delégitime or guei l , sans priver de j eter de temps en tempsun regard ironique sur M . Casimir Lombre , qui mordi llaits es moustaches en affectant de demeurer indifférent a cettes cene .
M . Viviers n ’était pas un de ces industr ie ls , comme on envoit trop , qui se préoccupent uniquement d ’augmenter le pluspossib le leurs gains personne ls et demandent à leurs ouvrie rsle maximum de travail possible sans s ’ inquiéter le moins dumonde de leur état mora l et de leur existence , une fois qu ’ i lss ont sortis de l ’atelier . Ayant été ouvrier lui-même
,ayant
vécu au milieu des ouvriers ,i l connaissait leurs vertus , leurs
faib lesses,leurs besoins
,leurs aspirations et savait
,par une
expérience qu’
éclai rai t sa limpide intel ligence , tout ce qu ’ ily a de mérite vrai
,de courageuse énergie , de résignation sou
mise et de dévouement sincère chez les art isans qui travaillent de leurs mains , grands enfants pour la plupart que lesexp loiteurs ambitieux entraînent souvent a la révolte , en lesleurrant d ’
utopies insensées , et parce qu ’ il ne se trouve pers onne pour les attirer vers le bien .
Le père de Jeanne était un vrai chétien . Ses ouvriersn
’étaient pas pour lui des machines de production . Ils fais aien t partie de sa famille , ils étaient ses amis , ses enfants .I l s
’
intéres sai t au sort du moindre d ’ entre eux , leur parlant ,s ans grossièreté jamais , avec une bonté pénétrante ; doux etcharitab le autant qu ’
i l le pouvait , énergique quand il le fallai t,mais les traitant tous jusqu ’aux p lus humb les , avec cette
a ffection sans morgue et aussi sans basse flatter ie qui est lavér itable et sainte fraternité .
La fabr ique de Mon tbuel passe a bon droit , pour une dec elles qui ont réalisé le plus de perfectionnements et de progrès au point de vue industriel ; mais elle est citée surtout aupoint de vue industriel ; mais elle est citée surtout au pointde vue de son admirab le organisation lygi én ique et des condi tion s matérie lles et morales que le patron cherche i n cess amm ent à améliorer dans l ’ intérêt de ses ouvriers . Pourn ’ en citer qu ’un exemple , M . Viviers fut l ’un des premiers à.organiser un atel ier spécial où les femm es , récemment mères ,s ont employyées aun travai l facile , sans fatigue ni danger , ets ans quitter leur enfant qui repose dans un berceau près de
234 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
chacune d ’e lles et qu ’e l les peuvent allaiter ou bercer d ’
un
s imple mouvement du pi ed,tout en continuant leur tâche .
Jeanne en entreprenant lt régénération intellectue lle dePierre Dubreui l , s ’ était montrée la digne fi lle de M . Viviers .Ce lui-ci pr it en main la continuation de son œuvre . Aprèsentente avec le père Dubreui l , M . le Curé
,M lle Marois et
Jeanne bien entendu,qui avai t bien gagné de faire part ie de
cet aréopage , on régla ainsi la vie du j eune homme . L e
matin , i l i rai t dans un ate li er de travai l simple , ce lui où l ’ontransposait mathématiquement les dessins choi sis pour lesbrochages sur des c arton s destinés à être mis aux mains desouvriers . Dans l ’après -midi , i l irait prendre des leçons deM lle Maroi s et de Jeanne e lle—même dans la salle d ’ études auchateau . Chaque soir
,i l i rait passer une heure chez M . le
Curé qu i per f ection erai t son éducation re ligieuse , fort somm ai re encore .
Cette organisati on plut a tout le monde , à Pierre qui semb lait repri s de ses ten eurs passées
,dès qu ’ il était question
de l ’éloigner de Jeanne , à Jeanne e lle-même qui s ’ était attachée a son é lève avec l ’aff ection que l ’on éprouve toujourspour l ’œuvre que l ’on a créée à M lle Marois , très fière d ’avoirété choi s i e , à. M . Casimir meme qui avait craint un momentde l ’être et était fermement résolu à décliner la mission d ’ ins ti tuteur de celui qu ’ il continuait d ’appe ler l ’ idiot . Pér i clès
ne lui aurait jamais pardonné .
Les choses pri rent ainsi leurs cours simplement , tranquillement
,et l ’année se passa sans amener aucun incident autre
que le déve loppement continu des facultés inte llectuelles dePierre . On aurait dit que ce cerveau si longtemps engourdivoulai t
,m aintenant qu ’
i l était éveil lé,ratraper le temps per
du par la rapidi téde ses progrès . En quelques semaines , lej eune homme sut écrire d ’une calligraphie un peu grossepeut—être mais qui devait rapidement se perfectionner etéquivaloir— oe n ’ était pas bien di ffici le— à cel le de Jeannequi avouai t avec franchise qu ’e lle écrivait comme un petitchat . Les cours se succédèrent ensuite dans les diversesbranches de l ’ instruction é lémentaire . Mais rien ne suffisai tà l ’appéti t dévorant de Pierre . Il était comme un foyer qu ’
onne peut suffire à alimenter de combustib le . Son in telligencs
’ élevai t a mesure qu ’ il apprenait , et plus il apprenait , plus i lvoulait apprendre .
Il arriva même un jour où l’
honnête M lle Marois se vi t
236 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
i tude ,chacun des décalques devant être le guide des divers
ouvriers qui tisseraient une même étoff e . M . Viviers avaitcru pouvoir attacher Pierre a ce service , précisément parcequ ’ i l exigeait simplement de l ’attention et ne comportai taucune initiati ve . Ce la m archa aa peu près dans les prem i erstemps . Mais
,peu a peu
,le crayon du j eune ouvrier s
’
ém an
cipa . I l donna le dessin de fleurs qui étaient bien des fleurs ,mais pas du tout ce lles du modè le . Un e rose se penchaità moitié eff euillée la où e lle aurait dû se dresser en pleinevigueur . Des brins d ’herbe
,hardiment j etés
,apparaissaient
là où i l n ’y en avai t pas . Un jour même ce fut tout un bouquet nouveau que produisit Pierre .
Le contre maître gronda et en référa aM. Viviers quitrouva le dessin s i original
,si neuf
,si charmant qu ’ il le fit
r ( fa 1 re par le dessinateur avec que lques légères corrections etdonna comme un modè le nouveau ,
cette copie qui , en réal i té , n en étai t pas une . Il ordonna qu ’on lui rendit l ’ improvi sation de Pierre et la mit dans sa poche , étonné et songeur .
Mais des soins p lus hauts in terrompa1 ent et les leçonsc lassiques et les travaux industriels pour le j eune Dubr eui l .Après une année de catéchisme où Pierre avait apporté un
z è le ardent et une piété naïve et touchante,le Curé le jugea
di gne de faire sa première communion .
A suivre.)
Bibliographie
HuII.— Son an g ine .
S es progre s .— Son aven i r.
M . E .—E . Cinq—Mars , journaliste , sous ce t itre , dans un
beau volume grand format , d’él égante toilette , orné de cart es ,
de vignettes et de nombreuses gravures,nous donne la mono
graphie de la cit é de Hull . A mon avis,le meilleur de ce
travail n ’est pas celui de l ’historien ou de l ’annali ste, quipatiemment a collig é les vieux r écits
,mais b ien celui de l ’éco
nom iste qui a foi en l ’avenir de Hull , et qui cherche a fairepartager son esp érance . Le r écit des origines de la ville deHull
,fondée par M . Phil émon Wright , au commencement du
XIXe si ècle,ressemble à. une page de roman . Nous raconter
les premi ères années de Hull,c ’est nous r évéler un héros
d’épopée. Philemon Wright n ’était pas un homme ordinaire .Il fallait une âme fortement trempée pour t enter de fonder unehab itation à. 1 20 milles de tout centre et a 80 milles deîtoutevoie de communication
,au milieu de la for êt où r ésidaient seuls
les Indiens plutôt hostiles alors .Il fallait une énergie indomptable pour parer aux difficult és
sans nombre de l ’installation,aux premi ers revers . Wright ne
s ’arr êta pas même un instant à douter du succ ès de l ’entreprisequand des pert es énormes vinr ent d ès la première heure lemenacer d ’une ruine comp ète. Il avait la hardiesse des forts ,l a t énacit é des âmes vaillantes
,et le coup d
’œ il d ’un espritsup érieur qui voit bien au—delà du pr ésent .
Ce n ’est pas le moindre titre de gloire de M .Wright que cechoix de Hull pour site de son établissement . Il sait ce qu ’ilchoisit
,pourquoi il le choisit
,et quel parti il va pouvoir tirer
des ressources naturelles .Il vint inaugurer le commerce de bois . Wright choisit le
site le plus avantageux possible à la construction des moulins .
Hull est la ville qui poss ède le plus d ’avantage pour faciliterles grandes industries .
La thèse de M . Cinq—Mars car en somme c ’est une thèseque le chapitre Son avenir signale à juste titre
,à tous
238 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
les hommes qui s ’int éressent à. l ’avenir économique de notrepays
,Hull comme LA FUTURE GRANDE “ VILLE INDUS
TRIELLE . Jugez s ’il n ’a pas raisonHull poss ède des pouvoirs d ’eau d ’une capacit é presque
incalculable . La Chaudière les Petites Chaudi ères lesRem i cks l es chut es de la Crique Brevoerz .
Je ne crois pas qn’i l existe sous le soleil une ville où
l ’énergie électrique se vende,comme ici
, $5 par cheval—vapeurpar année
,24 heures par j our .
Hull est plac é sur la ligne principale du Pacifique Canadien
,à proximit é plus qu ’aucune autre de toutes les villes que
fera surgir le Grand—Tronc-Pacifique.
Avant longt emps,les trains du Pacifique Canadien
,entre
Halifax et Vancouver,passeront directement à Hull
,puis à
Waltham,pour traverser à.Pembroke .
Nous avons l ’avantage naturel sur Ottawa,pour le
transport par eau,à. cause de l ’acc ès facile de nos rives . Nous
avons quatre milles de front sur l ’Outaouais,et une couple de
milles sur la Gatineau,pour y construire des quais et des hangars .
Ceci se r éal isera d ’autant plus sûrement que le canal dela Baie Georgienne, dont la construction est désormais assur ée ,traversera notre vill e .
La rivi ère Gatineau devra nécessairement être cana i s ée,
dans quelques années,pour relier les deux transcontinentaux
,
en sus des chemins de fer de la Gatineau et de Pontiac,qui
convergent aussi à Hull .Hull a tous les avantages naturels possibles pour le
transport et pour la force motrice il est du devoir 1mpér ieuxde nos concitoyens de veiller au gain .
M . Cinq-Mars est un vrai patriote,qui doit souffrir parfois
du voisinage de certains écrivains de la PresseCes courtes citations font mieux comprendre le titre d ’un
chapitre écrit par un enfant de Hull,M . R odolphe Laf err i ère
Hull port de mer dont nous détachons les passages suivants :Nous sommes le plus grand centre en Amérique britan
nique pour la production de l ’électricit é . Niagara avec seschevaux—vapeur d ’énergi e ne repr ésente pas la moiti é
des forces hydrauliques dont Hull est le centre . Noussommes le plus grand centre de production du bois dans l ’univers entier
,et les forêts du côt é nord contribuent à enrichir
pour le pr ésent une foule d ’industr iels étab lis sur la rive sud .
La production annuelle du bois de sciage dans la vall ée del’
Outoauais varie entre et de pieds .
240 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
de sa civilisation. Et voici comment‘
i l nous pr épare auxsur prises
,car il y en a
,de son travail
Des canadiens de l ’Ouest,di t—i l , y en a t— i l j amais eu
Le Français d’Am ér ique ne s
’est- i l pas cantonné dans l ’est,
et l ’immense r égion que“ s ’ étend du lac Supérieur à l ’OcéanPacifique n ’est—elle pas l ’apanage exclusif de la race anglaise
Le pr ésent ouvrage est la r éponse à ces questions.Il d émontrera sans ambages que
,bien que la race anglo
saxonne aff ecte auj ourd ’hui les airs d ’une maîtresse au NordOuest et que les innombrables étrangers qu ’on y transplanteignorent jusqu’aux premiers él éments du rôle j ou é par lesenfants de la belle France
_
” dans ces immenses contr ées,
ses découvreurs et ses pionniers étaient des canadi ens—français,
ses hordes sauvages furent r écon cili ées avec notre civilisation pardes canadi ens-français
,et des apôtres de la Croix venus du St .
Laur ent y pr écédèrent les mini stres de n’importe quel autreculte .
Traiteurs etç
trappeurs , coureur s de bois et explorateursy étaient à l ’or igine
,et demeur èrent longtemps , presque tous
de notre nationalit é Durant de longues années,qui disait
blanc, disait canadien—français au Nord-Ouest . '
L ’Anglai s etl ’Ecossai s s ’y trouvaient parfois
,mais ils y étaient plutôt
étrangers,et la langue de Shakespeare devait
,même sur leurs
l èvres,faire place à celle de Corneille et de Bossuet .Ce sont ces faits incontestables que j
’ai voulu consacrerimplicitement par les pages qui suivent .
”
Il suff it de lire le volume pour se convaincre que le Rev.
Père Morice a atteint parfaitement le but qu ’il se proposait .Style clair
,rapide
,rappelant à certains traits quelques chose
des vastes horizons qu ’il décrit,l ’ouvrage est vraiment une
œuvre capitale pour l ’histoire de notre race .
LA SO C IETE D E
LA REVUE FRANC O -AMERICAINE
27 RUE BUADE. QUEBEC .
L’
I L L U S T R A T IO NSupplément de La Revue Franco—Américaine
SON AUI‘ESSE ROYALE LE PRINCE D E GALLES, qui viendra à. Québec à.
l’
occas ion des f êtes du Troi s ième Centenai re .
Aux Canadiens des Etats-Unis
Comme le vent du nord empOrte les oiseauxPar de là les grands monts
,les forêts et les eaux
,
Bien souvent,dans le si ècle en délire où nous sommes
,
Un souffle irr ésistible emporte au loin les hommes,
Jetant sur tous les bords leurs groupes dispers és .
Ce souff le impétueux, frères, vous a poussésHors des champs arros és par le sang de vos p èresEt vous avez foul é des plages plus prospères ,Vous y gagnez en paix
,pour un repas frugal
,
Le pain qui vous manquait sur le vieux sol natalEt tendant à des vents favorables vos voiles ,Sous le fier étendard aux plis sem ési d ’étoiles
,
Qu ’il vous faut désormai s respecter et servir,Vous entrevoyez tous le port de l ’avenir
,Vous sentez eni vr és du vin des esp érances,Vos cœurs
,rest és français
,battre pour les deux F rances
,
Pour la Gaule chr étienne et pour le Canada .Vous aimez le pays où le ciel vous guida
,
Mais vous n ’oubliez pas les rives du grand fleuve,
Où vous avez pourtant sub i plus d ’une épreuveEt
,comme les oiseaux— chass és par les frimas
Vers des bosquets ombreux qui ne se fanent pasGardent sous d ’autres cieux leur suave ramage
,
Savent se rappeler l ’arbre,au mouvant ombrage
,
Qui berça le doux nid abritant leurs amours,
Fr ères,dans votre exil
,vous conservez touj ours
,
En dépit des railleurs,des jaloux et des traîtres
,
L’idiome si vieux que parlaient vos ancêtres
,
Et dont ils ont laissé tant d ’échos enchanteurs
Vous conservez touj ours sur l ’autel de vos cœurs,
Qui vibrent pour le grand , pour le pur et le juste,Votre robus te foi,votre croyance auguste .
242 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Oui,vous chér issez tous le rivage lointain
D ’où voulut vous bannir l ’in sondable destin,
Et,des chers souvenir s d ’antan l ’âme berc ée
,
Souvent vous contemplez des yeux de la pensée,
Dans un rayonn ement féerique et triomphant,
Le vi eux foyer t émoin de vos ébats d ’enfant,
Le sentier qu ’en courant,pris d ’une gaiet é folle .
Vous suiviez tous les j ours,au sortir de l ’école
,
Le bosquet verdoyant,plein de confuses voix
,
Où vous avez aim é pour la premi ère fois,
Et la tant vieille église, aux murs voi] és de lierreOù vous alliez prier aupr ès de votre mère
,Dont les yeux,ô douleur ! pour touj ours se sont clos .
Devant vous apparaît parfois le sombre enclosQui vous vit
,l ’œ il en pleurs
,penchés sur une tombe
,
Et quand vient le printemps , le vent du soir qui tombeSemble vous apporter par moment les parfumsDes fleurs dont vous orniez le tertre des défuntsQu ’a gardés dans son sein le sol de la patrie .
Oui,vous aimez touj ours avec idolâtrie
Le vieux terroir fécond où dorment vos a1 euxDe votre sang français vous êtes orgueilleux
,Vous êtes orgueilleux de la tâche héroïqueQue vous voit accomplir la grande R épublique
,
Et vous vous montrez tous les dignes rej etonsDes courageux Normands et des hardis BretonsQui surent
,hache au poing et mousquet
_
à l ’épaule,
Cr éer au nouveau monde une nouvelle Gaule .
Le front dans les rayons de l ’astre du Progr ès,
Qui fait étinceler cit és,hameaux
,gu érets
,Dormant à l ’étranger les plus nobles exemples,
Partout vous, élevez à.Jéhovah des templesVous fondez
,attentifs à la voix du devoir
,
Des foyers Où l ’enf ance à flots boit le savoir,Vous étendez sans fin une chaîne typique
,
Qui tôt ou tard devra,ceinturant l ’Am ér ique,
Y j oindre d ’un lien marqu é de votre sceauTous les groupes français en un vaste faisceau .
La Soc iété neutre au double point de vue
national et religieux
La plupart de nos soci ét és de secours mutuel auront cetteannée leur convention générale . Quelques—unes ont déj àtenu ces assises importantes et modifié leurs r èglements
,leurs
modes d ’administration , suivant que l ’exp érience le leur eu
seigne ou que des conditions nouvelles les y engagent . Cha
cune profitera de cette occasion pour engager ses membres àfaire une propagande active et à r épandre dans leur entour ageles principes de l ’organisation
,à faire connaître ses multi
ples avantages,à développer l
’esprit de solidarit é qui a faitde son œuvre un drapeau et de ses moyens d ’action une deviseà la fois nationale et religieuse .Nos soci ét és nationales
, puisque c’est d ’elles que nous
voulons parler,étudieront soigneusement
,avec les causes
qui leur valurent quelque succ ès,celles qui
,sur certains points
,
ont paralys é leurs eff orts et mis un obstacle souvent inf ranchi ssable à. leur d éveloppement . Parmi ces derni ères ellesreconnaîtront
,auî prem ier rang , la concurrence qui leur est
faite,gr âce a l ’irr éflexi on de mill iers de compatriotes
,par les
nombreuses soci étés cosmopolites qui ont fait des recruesdans notre propre milieu
,qui en font encore
,et qui subst i
tuent lentement un cosmopolitisme décevant a une saineœ ncentrat ionl de l
’énergie nationale . L ’exemple que,dans
ce cosmopolitisme même , l ’on trouve de l ’esprit pratiqueanglo—saxon est impuissant à ouvrir les yeux du plus grandnombre , et nous ass istons , a, certaines époques surtout , à l ’emigration de nos énergies— combien pr écieuses -vers des œu
vres ne pouvantfles int éresser que de tr ès loin . C ’est ains ique tout pr ès de canadiens—français
,sinon davantage
,
sont enr ôl és sous les bann i ères de soci ét és neutres mais anglophones comme les Independen t F oresærs (I . 0 . F .) les Wodmen
of the World,les Eagles
,
”la Un i on F raternel League, les
Canadi an F oresærs , l’Anci en t Order of Un i ted Workmen
,
ou d ’autres également anglophones mais qui font professionde catholicisme comme les Catholic F oresters
,la C . M . B . A.
,
LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE 245
les Kn ights of Columbus . Certaines de ces derni ères ont mêmedes pr étentions telles qu ’elles vous feraient douter que vouspuissiez un j our avoir une place en paradis sans avoir pass épar les trois ou quatre dégr és d ’initiat ion qu ’elles imposentà leurs membres .
Au point de vue catholique , les premi ères sont absolumentcondamnables . Au point de vue national les premi ères et lesderni ères ne peuvent qu ’avoir des effets d ésastreux . Et toutceci semble mal compris parce qu ’à la mutualit é pure et simplese rattachent une multitude d ’int ér êts qui lui sont parfaitement étrangers . Cela est dû au fait que son organisation
,à
peu pr ès parfaite,off re à. tous les marchands d ’influence
,à
tous les exploiteurs de la bonne foi des gens,à toutes les petites
ambitions étayées sur des app étits,un moyen puissant d ’at
teindre leur bri t . La fraternit é devi ent le manteau qui couvr ede secr ètes intentions et porte dans ses plis des égoïsmesscandaleux si exposés d ’une autre mani ère . Combien de fois
,
par exemple,n
’
avon s—nous pas entendu des négociants,des
politiques donner comme motif de leur entr ée dans telle outelle soci ét é
,l ’excès de client èle que cela pourrait attirer à
leurs comptoirs,ou les chances de succ ès que cela pourrait
leur donner dans une élection . D ’autres part,on n ’ignore
pas qu ’un des arguments le plus fr équemment employés pares agents recruteurs
,c ’est cet esprit de solidarit é dont se
vantent plus particuli èrement certaines mutualit és cosmopo
lites anglophones . On fait croire aux gens qu ’il est impossiblede r éussir sans porter la livr ée d ’une organisation t énébreusequelconque et qui doit surtout ne pas être canadienne-françai se . Pourtant on n ’a j amais d émontré que lesmembres de telle organisation anglophone fameuse ont tousb énéfici é de cette solidarit é
,qui se r ésume
,en somme
,à cer
tains cas bien choisis et exploit és avec habilet é .La soci ét é neutre nous offre le type le plus complet de
cette exploitation des int érêts et des consciences au profitde ne j e ne sais quel sentiment
,touj ours tr ès vague pour le
commun des membres,mais paraissant tr ès clairement d é
fini pour ceux qui,étant les chefs
,connaissent tr ès bien le
but moral,économique ou politique de leur organisation et
y tendent par tous les moyens à leur disposition . Et puis,
y-a-t-i l une soci ét é vraiement neutreLa r éponse à cette question nous est donnée par les rituels
d ’initiation qui,même dans les soci ét és les plus neutres
,et
246 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
dans celles—là plus que dans toutes les autres,sont tous em
preints d’une fort e teinte religieuse . Nous y retrouvons des
hymnes spéciaux,des pri ères sp éciales
,des c érémoni es spe
ciales,des manifestations spéciales qui
,pour avoir des appa
renees assez inoffensives,n ’en forment pas moins un culte à
part,acceptable pour les protestants
,qui ont r épudi é avec
le dogme les invincibles traditions de la foi,mais condamnable
par tous les catholiques dont le culte est r égi par une organ isat ion à. base divine . Ce sentiment religieux lui—même
,
ou,s . l ’on pr éfère
,ce sentiment demi—relig eux gliss é dans la
mutualit é saxon i sante s ’explique assez facilement . Mis enœuvre par des organi sations venant surtout des Etats-Unisou les trois quarts de la population n
’
observe aucun culte ,il r épond
,chez ceux— là
,à ce besoin intense de mysticisme
religieux qui,même chez les incroyants
,a besoin d ’être as
souvi . On ne peut pas parler de la charit é,de la bienveillance ,
de la fraternité,de la concorde
,sans cotoyer , au moins , la
route trac ée i y a dix—neuf si ècles par celui qui est la vérit é,
la voie et la vie . Le protestantisme se meurt d ’avoir vouluméconnaître cet enseignement . Ses temples se sont vidésau b énéfice des loges jusqu ’à ce que ces derni ères soient ellesmêmes d ésert ées pour le compte de ce que certains appellentdéjaune religion de l ’humanit é .
” Il est vrai que,dans ce der
nier cas,la désertion sera plus lente à venir a cause de la digue
formidable qu ’on lui a faite des int érêts particuliers . Maiselle viendra
,assur ément
,le j our où un homme courageux
,
où une race vaillante exigera de ces organisations,suppos ées
indifférentes à toutes croyances,d ’être en réalit é ce qu ’elles
pr étendent être,c ’est-à—dire des soci ét és s tr i ctemen t neutres .
C ’est par une affirmation énergique de ce genre que les juifsde New-York sont en train de prouver que les écoles libresde la r épublique amér icaine étaient loin d ’être libres et neutres au point de vue de l ’enseignement .Nous parlions
,il y a un instant
,de la sol
'
dar i t é dont sevantent les soci ét és neutres . Comme question de fait
,cette
solidarit é,dans une circonstance fameuse
,. loin de prot éger
les int érêts religieux,a même ét é impuissante à prot éger la
langue maternelle des milliers de Franco—Américains enrôl ésdans l ’Ordre des Forestiers d ’
Am ér ique . Et les nôtres ontdû , après plusieurs années de d évouement , abandonner cettesoci ét é qui leur avait promis tant d ’af fection . Dans ce cas ,au moins
,es événements ont donné raison au proverbe que
à quelque chose malheur est bon .
” Que feraient ces soci étés
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
sont pas aussi indépendantes qu ’elles veu lent bien le dire,elles
sont imbues de pr éjugés protestant s et franc—maçons quiexercent peu à peu une influence pern icieuse sur leur s membres .Sous certaines apparences de bienfaisance
,elles cachent un
esprit sectaire ennemi du catholicisme . Les meilleurs euxmêmes s ’y laissent prendre . Prenez—y garde . On lit dans lavie du Général de Soni s
, qui fut aussi fervent chr étien! quevaillant soldat
,qu ’au début de sa carri ère mil itaire
,trompé
par les apparences de la franc—maçonnerie,il s ’y enrôla mais
il ne tarda pas à.reconnaître son erreur et il s ’échappa du pi ègequi lui avait ét é tendu .
Ces soci ét és vous off rent peut-être quelques avantagesmat ériels . Mais ne trouvez—vous pas ces mêmes avantagesdans vos soci ét és catholiques canadiennes
Groupez—vous,souvenez-vous que vous êtes catholiques
et Canadiens,et donnez de pr éférence votre nom aux soci ét és
catholiques et canadiennes . Cherchez dans votre uni on lafor ce dont vous avez besoin pour rester fidèles aux traditionsreligieuses de votre race . Vous diviser
,ce serait vous exposer
à. perdre votre foi,vous diviser
,ce serait vous amoindrir et
courir le danger de périr .”
Le R év. Père aurait pu aj outer qu ’en s’
enrôlant dans cessoci ét és on favorise la propagande protestante et on soutientses œuvres . Nous en avons eu une preuve dans cet orphelinatque le feu Oronhyatekha tenta de fonder pour le compte del’I. O . F . L ’entreprise n ’a pas r éussi et l ’orphel inat a ét éfermé il y a une couple de mois mais cela n ’enl ève rien à.l ’id ée qui lui donna naissance .Il faudrait aussi mentionner le z èle que les membres
,une
fois admis , se croient tenus de d éployé en faveur de leursoci ét é . On commence par faire ressortir les avantages mat érie
'
s de l ’association . Plus tard,on s ’appuie sur certains faits
isol és pour y trouver un esprit philantrophique qu’on ne veut
plus voir ailleurs . Et, d
’écart en écart,on en vient à attaquer
jusqu ’
à nos propres institutions nat ionales . Or,la soci ét é de
langue anglaise ne d évelopperait que cet esprit ant ipatr ioquechez les nôtres que cela serait une raison suffisante pour lacombattre . Nous d émontrerons dans un prochain numéro quele syst ème d ’assurance de ces associations cosmopolites est loind ’être aussi solide qu ’on le pr étend . Nous aurons alors démontr é notre th èse d ’une façon tr ès compl ète .
Qu ’il nous suffise, pou 1 le moment , de signaler tout cequ ’i l y a de mensonger dans cette pr étendue neutralit é dont se
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 249
parent certaines organisations . Nous venons de voir ce quevaut cette neutralit é au point de vue religieux . Le mêmeraisonnement ,en groupant d
’autres id éaux,d ’autres aspirations
autour des mêmes int érêts , prouve qu ’elle ne vaut pas davant age au point de vue national . Et ceci nous permet d ’incluredans la d émonstration certaines associations catholiques àtendances ultra—saxonnes . Il est inutile de les nommer . Onles reconnaît à leurs pr étentions plutôt qu
’
à leurs œuvres .Là encore nous sommes prêts à commettre tous les exc ès tantnous avons l ’admiration facile .
Pour notre part , nous n’oublierons j ama i s la surprise que
nous causa un j our le champion d ’une de ces associations ennous disant qu ’il fallait appartenir à sa soci ét é pour avoir uneid ée exacte de ce qu ’est la religion catholique . Je me contentaide faire observer à cet enthousiaste que le monde catholiqueserait fort emb êt é le j our où il d écouvrirait qu ’on s ’était trompéen fondant l ’Egli se, au lieu de fonder les Chevaliers de Colomb ,par exemple que
,d ’autre part
,les canadiens— français de la
provi nce de Québec avaient du être b ien malheureux tantqu ’une soci ét é irlando—am ér i cainene fût pas venue leur enseignerà être de vrais catholiques d ’élite .
L’
engouement qui permet de tels excès d ’enthousiasme nepeut pas durer
,mais tant qu ’il dure il peut causer des torts à.
peu pr ès irr éparables à ceux qui s ’y laissent prendre . Lesfaits
,sur ce point comme sur tous les autres
,finir ont bien par
nous dési ller les yeux,surtout si nous nous donnons la peine
de regarder ce que font pour'
nous et surtout contre nous,ces
associations incomparables . Une petite excursion dans l ’Ouest,
d ans certains dioc èses d ’
Ontar io,dans les centres de la Nouvelle
Angleterre, nous apprendraient des choses fort su rprenantes .En r ésumé
,affirmons que ni nos int érêts religieux
,ni nos
int érêts nationaux ne peuvent être mieux sauvegard és etd éfendus par ces amis nouveaux
,qui nous viennent de Chicago
ou de New Haven , que par les Chefs de nos institutions canad iennes-françaises de Montr éal
,de Québec ou d ’
Ottawa: Apr èst out , qui verra à nos propres int érêts si nous n ’y voyons nousmême Quant aux organisations qui veulent nous sauver ennous poussant à l ’abandon de ce qui a fait jusqu ’ici la force den otre race , qui pr étendent r égénérer notre catholicisme en
l’af fublant d
’or ipaux qui le d éparent , nous ne pouvons qu
’opposer la simplicit é de nos coutumes
,la franchise de notre foi
,
en nous demandant devant l ’ardeur de ces nouveaux prosélytesQuis custodiat ipsos custodes
250 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Ce langage sera peut— être nouveau pour nos compatriotesde la Province de Québec . Il est
,certes
,important qu ’ils
l’entendent
,parce que ce sont eux qui ont la garde du patri
moine national et que toute faiblesse de leur part fournira desarmes contre leurs fr ères diss éminés sur tous les points ducontinent . Ces armes , on en a déjà ét é bless é dans les centresde la Nouvelle-Angleterre et dans les groupes français del’Ontar io.
Nous le r épétons,la soci ét é mutuelle est un levier trop
puissant pour que nous ne songions pas a l e ‘ nationaliser pournotre propre d éfense . Un orateur , disait il y a quatre ans , aucours d ’une pompeuse r éception faite au chef d ’une soci ét éneutre Le mutualiste n ’est— il pas le propagateur de l ’id éechr étienne Aimez—vous les uns les autres Pour lescanadiens— français qui donnent leur énergie
,leur dévouement
,
leur argent,à des soci ét és autres que leurs soci ét és nationales
,
cette idée chrétienne se r ésume à aimer les autres . Enseignercela
,c ’est mal comprendre les devoirs du mutualiste ou ne pas
les comprendre du tout . Le mutualiste a pour mission d ’étendre le cercle b ienfaisant de la famille mais il ne doit paspour cela
,saper asa base ou abandonner l ’organisation nationale
qui est d éjà une extension de l ’influence familiale . S ’il sortde ce milieu
,il fait exactement ce que font les Canadiens
recrut és par l ’I. 0 . F . et les autres soci ét és anglophones,
neutres ou catholiques il t ire les marrons du feu pour quelquebertrand audacieux .
Et s ’il fut un temps Où notre race doit redoubler de prudence dans la concentration de ses efforts c’est bien celui— ci oùl ’immigration que nos gouvernants attirent à.prix d ’argent surnos bords
,nous enfonce tous les j ours plus profondément dans
notre rôle de minorit é .M . Jules Claret îe a prononc é une paro’
e qui s ’appliquefort bien a notre situation . Notre si ècle
,dit— i l
,n ’est pas
celui des aff aiblis,des anémiés c ’est le si ècle des émiett és .’
Toute notre histoire est r ésumée dans cette courte pens ée .Nous sommes émiett és sur toute la surface du continentaméricain . A ceux qui forment les groupes principaux dela race de cons erver intact l ’id éal que les autres maintiennentet maintiendr ont sous tous les cieux . La mutualit é neutre etanglo-saxonne a ét é jusqu
’aujourd
’hui le mal dont nous avons
le plus souffert . Une mutualit é canadienne— française et cathol ique tournera à notre avantage un moyen d ’action que depuis
Le Journalisme Canadien=Français
L ’article que j ’ai écrit sur ce suj et,dans la livraison de
mai,n ’était pas encore imprim é
,que les j ournalistes de Québec
s ’étaient d éjà f ormés en association,C ’est donc la preuve
qu ’il était temps de parler haut .J ’ai pu dire de dures v érit és Cependant
,j ’ai cru qu ’il
valait autant être franc,une bonne fois
,et dire publiquement
,
ce que tout le monde pense tout bas .Quelques—uns pourront croire
,peut— être
,que j ’ai exagéré
la situation . Quand il faut sonder une plaie,le mieux est
encore d ’aller au fond . On est sûr de son aff aire,et le remède
,
ensuite,est plus salutaire .
L ’ini tiative prise par les j ournalistes Québecquoi s est fortlouable . Mais j e me permettrai de dire que ce n ’est qu ’uncommencement .
L’ancienen association de la presse
,fondée il y a d éjà
plusieurs années,était tomb ée dans une inertie voisin de la
mort . Ceux qui la composaient n ’étaient plus des j ournalistesactifs c ’étaient des j ournalistes amateurs
,pour la plupart
,
qui collaboraient,par ci par là
,aux j ournaux
,et qui
,r éellement
,
ne consid éraient leur association que comme un titre auxbillets de faveur
,sur les chemins de fer .
N ’ayant plus d ’int érêt dans la carri ère active,ils se sou
ciaient du bien- être et du perfectionnement de la professioncomme de leurs premi ères culottes .il‘ Les véritables j ournalistes de la nouvelle génération
,et
même ceux de l ’ancienne,qui sont rest és professionn els
,ont
senti le besoin de remettre l ’association sur un pied plus moderneet plus pratique . Ils se sont donc r éunis , ont noinm é des
officiers nouveaux,pris dans les rangs militants c ’est tout ce
qu ’il y a de mieux . Il fallait commencer par là, et toute nouveaut é
,prise au bon point de vue
,est sûre de l ’avenir .
Cependant,à t out mouvement
,il faut un but . C ’est le
but qui fait l ’action . Un but général fait l ’action généraleun but particulier
,la fait part iculi ère.
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 253
La nouvelle association de la presse,à Québec
,s ’est—elle
propos ée un but général ou particulierLe but général serait l ’amélioration de la situation des
j ournalistes et l ’avancement de la profession .
Est-ce bien la le but que se sont propos és les j ournalistes,en se r éunissantIl a ét é question d ’un comit é de r éception des j ournalistes
étrangers,lors de la c él ébration du tricentenaire . L ’id ée est
excellente . Mais il paraîtra étrange qu ’on ait song é aux autres,
avant de songer à soi . Je ne veux pas du tout m ’
opposer , entant que j ournaliste
,a ce que nous accordions l ’hospi talit é la
plus large,à nos confr ères étrangers , qui visiteront notre ville ,
dans les mois de juin et de juillet . Nous ferons,a l a fois
,
œuvre de camarades et de citoyens,et nous aiderons à faire
admirer et c él ébrer notre Ville et notre pays,par ceux qui sont
,
vér italbement,la renommée . Notre ville b énéficiera énorm é
ment de la bonne impression qu ’elle fera sur les repr ésentantsde j ournaux étrangers .Je ne dis pas que les j ournalistes em ipètent , ainsi , sur
l ’agr éable devoir d ’un comit é,qui aurait dû
,tout au moins ,
prendre l ’initiative et la direction de la r éception à. faire auxj ournalistes étrangers le sous— com it é de publicit é ducomit é exécutif du tricentenaire . Je surprendr ai peut— êtremes lecteurs
,en disant qu ’il existe un sous- comit é de publi
cit é compos é,si j e ne me trompes
,des r édacteurs des j our
n aux de Québec et de Lévis,et de quelques hommes d ’affaires
de la ville .Que fait ce sous— comit é ? Se r éunit— i l quelquefois
F ait- i l rapport au comit é exécutif ? Personne n ’en entendparler . Les j ournalistes qui le composent ne comprennent— ilspas que la meilleure r éclame
,la meilleure publicit é qu ’ils
peuvent donner à Québec et a la c él ébration,c ’est de voir à.
ce que les j ournalistes étrangers soient bien reçus,b ien informés
et b ien guid és dans la ville que tout ce qu’ilr apprennent
,c
qu ’ils entendent et ce qu ’ils voient les impressionnent favorablement
,sur notre histoire
,nos mœurs
,nos habitudes notre
vie sociale et nationale,notre tol érance
,notre largeur d esprit
,
notre d ésir de vi vr e en harmonie avec tous les él éments duCanada .
Puisque le comit é exécutif a la charge d ’organiser les fêteset d ’en faire un succ ès
,non seulement financier
,mais aussi
s ocial et national,il semble étrange qu ’un sous-comit é aussi
254 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
important ne donne aucun signe de vie,et qu ’il faille que les
j ournalistes,dont le travail sera quadrupl é
,durant les fêtes
— car ils devront enregistrer tous les détails de la c él ébrationet être sans cesse sur les dents pour renseigner leurs j ournauxdoivent prendr e l ’initiative de recevoir
,informer et guider les
j ournalistes étrangers .Enfin
,cela est ? Et nous ne pouvons trouver plus bel
exemple de dési rrt éressement et de patriotisme Ces pauvresj ournalistes
,dont la situation est si pr écaire
,dont le travail
est si ext énuant dont les services sont si mal payés,d ès le
premier j our qu ils se r éunissent,pour j eter les bases d ’une
association destinée à les prot éger,ne songent pas un instant
à. leur propre sort,pour ne s ’occuper que de celui de leurs con
fr ères étrangers,qui viendront à Québec
,et de la bonne r épu
tation d ’hospitalit é de cette vil le , ainsi que du soin de sa
renommée historique et sociale .Quel bel exemple
,et qui prouve jusqu ’où ces h ommes
,ces
j eunes gens généreux,qu ’on exploite
,savent pousser l ’oubli
d ’eux—mêmes
Quel autre but s ’est—ou propos é,en r éuni ssant les journa
listes,et en faisant revivre l ’Associat ion de laPresse , à QuébecJe cherche vainement la r ésolution qui déclare que les
j ournalistes,dans leurs pol émiques
,doivent se respecter , et se
traiter en gentilshommes celle qui établit un certain degr é deconnaissances
,pour être admis dans la profession celle qui
d éclare qu ’un j ournaliste,digne de ce nom
,mérite un salaire
convenable celle qui affirme qu ’il faut s ’entre— aider mutuellement ; celle qui établit le principe de solidarit é ; celle quiproteste contre l ’exploitation dont nous sommes l ’obj et celle,enfin
,qui contient l ’affirmation calejor ique et pr écis e , que lej ournalisme est la profession la plus noble et la plus digne , et
qu ’elle n ’existe pas pour l ’unique service des polit ic1 ens , maisqu ’elle a pour but de renseigner impartialement le peuple surles événements publics
,de propager les saines doctrines , de
combattre les mauvaises et de faire l ’éducation intellectuelleet moral e de lanation .
Il semble donc qu ’il faut tout refaire, pour faire pluscompl ètement .
Petite France
Un D rame
C ’est entre les lueurs des éclairs jaillis de deux ép éesfrançaises
, presqu’
aux mêmes lieux,bien qu
’à. deux si ècles
d ’intervalle,que se déroule cette épopée qui a nom l ’histoire du
Canada . Sur la premi ère page , héroïque prologue , dat ée de1 535
,Jacques Cartier
,l ’épée haute , étincelant au soleil de
juillet,ouvre ces annales . Entour é de son équipage agenouill é
,
il prend possession de ces terres au nom de son souverain…_
Puis,s ’ouvre cet écrin de perles ignor ées qui embrasse
enti ère la p ériode coloniale française tissu d ’évènementsmerveilleux
,où les prouesses
,les
'
combats,les d écouvertes et
les aventures de tout genr e , se d étachent , comme des têtes des aints d ’une fresque du moyen—âge sur le fond d ’or d ’un porti ue……q
A l epilogue,en l ’année 1 759
,sous un ciel gris d ’automne
,
l’on aperçoit
,au milieu des plaines d ’
Abraham,le marqui s qui ,
l’épée à la main
,conduit ses troupes sur les batteries anglaises
,
puis tombe mortellement frapp é, signant de son sang le derni erfeuillet de ce drame national .
Et,le trait é de Paris
,enr égi strant , quatre ans plus tard,
l a cession du Canada à l ’Angleterre. Le rideau tombe sur cettesc ène Où s
’
amoncellent les ruines d ’un empire colonial .
Quels souvenirsTrois si ècles durant
,au milieu des alternatives de sa
fortune,la F rance monarchique se prit de tendre affection
pour cette aînée de ses coloni es qui s ’appelait le Canada .C ’était une rude époque pour la fondation d ’un établisse
ment lointain . L’Eur 0 pe, à. peine remise des troubles dont
l ’avaient agit ée les pr étendants à l ’empire,toute fr émissante
de discordes religieuses,enfiévr ée d
’
expédit ions militaires , et
cependant artistique et savante,revenait
,apr ès un long détour
,
LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE 257
aux sources du beau,ressuscitant l ’antiquit é et ses chefs
d ’œuvres . Sur les fronti ères françaises , les Etats , s’
eff orçant
de constituer leur uni t é nationale , s’
affirmaient comme desrivaux féroces de la France , et se disposaient à lui disputer la .
pr épondérance . Aussi,ce premier essai de colonisation , si loin ,
en Amérique,tent é entre le d éclin du r égime féodal et l ’aube
de l ’âge moderne,t émoigna non seulement de la puissance du
royaume de F rance,mais encore de la vitalit é de la race qui
l’hab
'
tait,de l ’expansion et de l ’influence de son génie . Oeuvre
à la fois de spontanéit é et de pr évoyance , tous consid ér èrentcette tentative comme la prise de possession d ’un monde et legerme d ’un empire futur .
Pendant les intervalles de r épit que lui lai ss èrent les succ èset les revers de ses campagnes d ’
Italie au travers de ses guerf esde religion au plus fort des troubles de la Ligue et de la Fronde
,
en d épit des embarras cr éés par ses discordes , ainsi qu’au
milieu des fêtes organis ées à Versailles en l ’honneur de sesnombreuses victoires
,la F rance se pr éoccupe constamment de
cette fille établie en Amérique . Depuis François Ier jusqu ’à
Louis XV,souverains et ministres s ’int éress èrent aux progr ès
et à l ’avenir de la nouvelle coloni e .Et si F rançois Ier et ses successeurs parurent se rappeler
que le nom de Nouvelle—F rance,donné aces terres par Vérazzani
,
dans l ’hommage qu ’il en fit à son royal armateur,avait une
port ée plus haute qu ’une flatter ie de court isan,le peuple
,de
son côt é,et particuli èrement les populations de la Bretagne
,
de la Normandie et de la Saintonge,se souvinrent touj ours que
ces compatriotes d ’outre—mer,l a plupart leurs parents ou leurs
amis,avaient
,dans un j our d ’enthousiasme
,en souvenir du
vi eux pays,baptis é cette terre du nom familier et si touchant
de Peti te F rance.
La Nouvelle—F rance,celle des trait és
,a disparu mais la
Peti te F rance,celle du peuple
,survit . Et tant qu ’un cœur
canadien battra sur les bords du Saint—Laurent,la Peti te F rance
comptera un autel et un fidèle .Ce fut au commencement de la tâche laborieuse qu ’elle
avait entreprise que la F rance,la grande
,employa la valeur
,de
ses capitaines et les talents de ses administrateurs . Maintesfois , elle s
’
émut aux r écits des aventures et des périls de cettepoignée d ’enfants que l ’audace d ’un de ses marins et la sagessed ’un ministre avaient j et é de l ’autre côt é de l ’eau……La .
F rance qui confia à cette petite troupe son drapeau fleur delis é
258 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
n’
eût point lieu,certes
,de s ’en repentir j amais mains plus
loyales ne le défendirent jusqu ’au dernier j our avec plus deconstance et de courage . Elles le d éfendirent avec éclat , ce
drapeau,contre l ’h0st ilit é des tribus indiennes , d
’abord , puis ,plus tard
,en face de l ’ennemi s éculaire
,l’
Anglai s . Et pourt ant
,pour d éfendre tant d ’honneur et d ’
1 nt ér êts , il n’y avait
que cette troupe,composée de matelots et de soldats , de
quelques artisans et laboureurs , qui ne dispos èrent j amais desforces qu ’exigeait leur œuvre . Il ne t int pas qu ’
a eux deconqu érir cette partie de l ’Am ér ique du Nord ; ce qui leur fitd éfaut
,ce furent les servi ces de la métropole et , aux moments
critiques,décisifs
,l ’appui
,la voix de cette patrie alors muette ,
et,qu ’en dépit de son indifférence et de son abandon , ils
saluaient,expirants
,d ’un dernier cri de fidélit é et d ’amour .
Les échos des Plaines d’Abraham
,interrogés , rediraient encore
ce suprême appel de nos phalanges .Page écourt ée de nos annales
,l etablissement de la France
au Canada restera une des pages émouvantes et la plus glorieusede l ’histoire coloni ale de ce pays . Là
,en effet
,sur ce vaste
th éâtre,du nord de l ’Am ér ique, au mil ieu des solitudes d
’uncontinent inexplor é
,couvert de forêts
,sillonné de fleuves
, .
constell é de lacs,peupl é de tribus guerri ères , un noyau de
F rançais accomplit pendant deux si ècles des prodiges d’hé
roïsme. Sur cette sc ène d ’un genr e nouveau pour l ’époque ,et dans tous les rangs
,apparurent de vrais h éros et d ’
adm i rables
talents chefs militaires,admini strateurs
,pr élats
,mission
naires,d écouvreurs ; des plus haut placés aux plus humbles ,
a tous les degr és de la hi érarchi e , éclatent un même élan et unemême ardeur . C ’est comme une s ève généreuse qui circuledans les veines de ce petit peuple
,et rend l ’esprit de sacrifice
chose si simple que nul n ’en est surpris,ne s ’en pr évaut et ne
s ’en flatte .
Aussi,quelle histoire
Cinq années sont à peine écoul ées depuis que ChristopheColomb a doubl é la terre ; le pape vi ent de faire deux partségales des mondes nouveaux
,donnant l ’une à l ’Espagne et
l ’autre au Portugal ; les souverains , m i s en éveil , lancentaussitôt vers cet hém isph ère convoit é
,a travers toutes les
mers,des découvreurs à leur solde il s ’agit d
’arriver premier
260 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Etabli s en Amérique plus d ’un demi— si ècle apr ès lesF rançais
,les Anglais
,que fort ifie
,de j our en j our
,un courant
continue d ’immigration,j alousent les succ ès de leurs s éculaires
ennemis envieux de leurs possessions , les voilà qui rallumentsur ce sol les vieilles haines nationales et les pr éjugés
,les
rancunes,l’0 ppos it ion des int ér êts , envenimant les rapports
de voisinage,la guerre éclate l
’Am ér ique, elle aussi , aura sa
guerre de Cent Ans . Elle dura même un si ècle et demi .C ’est alors que se d éroule ce tissu d ’évènements mervei l
l eux,qui forme le nœud du drame . R ien ne manque à l ’épopée .
Il y a des découvr eurs il y a des militaires de génie dont lesexploits rappellent ceux des anciens comme dans la grandeF rance
,on y voit une h éroïne . F aut-il citer un grand admi
ni strateur Talon…… Il y a un pr élat illustre qui devientla tige des archevêques de Québec . Cherchez—vous des mart yrs Il y en a . Des victoires
,des si èges Rappelons-nous
chaque engagement,chaque assaut . Oui
O notre hi stoi re, écrin de perles ignorées
Nous le r épétons,rien ne manque . Mon Dieu il fallait
un chapitre de douloureux exode,un acte barbare qui ferait
couler des larmes et du sang à flots,quelque chose
,enfin
,qui
fût sans analogie dans l ’histoire de ce temps—là et qui surpassâten cruaut é ces enl èvements de peuples que
,autrefois
,des
despotes de l ’As ie tra înaient a la suite de leurs hordes nousavons cette odieuse transportation en masse de nos fr èresd
’Acadie
,au mépr is de la foi jur ée — L
’hi stoire et la poésie
,
vengeant la justice et le droit outragés,se sont chargées de
flétr ir les coupables . Sur l ’emplacement des ruines embras éesde leurs foyers
,de leur s champs d évast és et de leurs troupeaux
d étruits ; aux lieux mêmes , où cette population j et ée pargroupes sur cent r ivages , vivait paisiblement , plane , comme unéternel remords
,le fantôme de ce peuple agricole et pasteur
,
l a poétique figure d ’Evangéline, cette fianc ée qui mourut
vierge et dont la destinée et les malheurs ont assur é l ’immortalit é a celui qui les a chant és dans un imp ér i ssable po ème……
Deux grandes figures,deux caract ères
,r ésument cette
Il iade coloniale .,L ’un
,modeste pilote de Saint—Malo
,. repr é
sente la hardiesse d ’esprit unie a la foi,la patience doubl ée de
d écision et d ’audace vertus qui semblent s ’exclure,mais qu ’on
trouve aun haut degr é dans cette bourgeoisie virile de marins
LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE 26 1
et de marchands du seizi ème si ècle .— L ’autre,âme généreuse
,
cœur intr épide,porte sur les champs de bataille du Ncuveau
Monde,le courage chevaleresque des soldats de F ontenoy .
Chargé de livrer le dernier combat et voyant la victoire infidèle ,Montcalm sût ravir encore
,par l ’héroïsme de sa mort
,une
part de la gloire de son vainqueur . L ’un ouvr e le dramel ’autre en marque l ’épi logue.
La perte de cette province ext érieure fut pour la F ranceune diminut ion de force et de prestige comme le serait pourune famille la mort d ’un de ses fils d évou és en qui les parentsont plac é
,avec leurs affections les plus chères
,les esp érances
de leur vieillesse . Cette mutilation fut comme un Îambeau dechair violemment arrach é des flancs de la mère—patrie . La
plaie,maintenant cicatris ée
,s ’ouvre à certains j ours ; elle
s aigne même,parfois et pas une âme française
,en visitant
nos villes et en parcourant nos campagnes,ne verra sans
émotion revivre les mœurs,les coutumes de ses aïeux
,n ’en
tendra,sans tressaillir
,r ésonner a son oreille cette langue
française,qu ’on dirait avoir ét é express ément formée pour
faciliter,parmi les hommes
,l ’échange des sentiments et des
id ées car nulle,en sa pr écision et sa clart é
,n
’
expr imê mieuxqu ’elle,et sans équivoque
,tout ce que l ’esprit conçoit d ’hon
n ête et de beau,tout ce que le cœur ressent de bon et de
g énéreux .
La puissance française vient de disparaître pour touj oursde l ’Am ér ique du Nord . Une superbe i ncuri e vient de faireperdre à la France l ’occasion la plus favorable d ’agrandissementet de puissance . Le beau r êve de R ichelieu
,de -Colbert et de
Vauban,de faire de ce côt é—ci de l ’oc éan une nouvelle F rance
forte et heureuse n ’a pas ét é r éalis é . Lorsque l ’on r éfléchità toute cette puissance perdue
,dit M . E . Rameau
,lorsque
l ’on étudie dans notre histoire les vis ées creuses,les amb itions
irrationnelles,les passions misérables auxquelles on a sacrifi é
à grands frais ce magni fique avenir , le cœur se soul ève der egrets et d ’
indignat ion contre la politique et le syst ème quiruinèrent les forces de la F rance et la contraignirent aux
tristes nécessit és de la r évolution .
”
Quant à nous,ne portons pas de jugement . Un orateur
a dit Que la F rance est diff icile à juger L ’on diraitque cette parole est à notre adresse . Il nous est plus difficile
262 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
qu’à toute autre nation
,a dit
,en effet
,un de ‘ nos orateurs
,
M . Thos Chapais,de juger la France avec cette impartialit é
froide qui est un des attributs de la justice . Son sang bouillonne dans nos veines . Elle a ét é la mèr e de notre national it é
,elle est rest ée la mère de nos intelligences . Ses
vieilles chansons ont berc é nos premiers sommei ls et,en appre
nant notre histoire,nous y
_
avons trouvé. pendant un si ècleet demi
,l e prolongement de la sienne .”
Les Anglais sont donc nos maîtres . Notre r ésistance a
ét é h éroïque . De supr êm es ef forts ont épuis é le dernierhomme et le dernier écu . Que vont devenir
,à pr ésent
,les
pauvres colons canadiens—français,s épar és de la mère—patrie
La Providence veille sur C ’es t à ce moment qu ’entreen lice le clergé canadien qui commence son œuvre de paix etde r égénération . Les colons français
,abandonnés par leur
m ère,maltrait és par leurs nouveaux maîtres
,se tournent vers
l’Egli se et identifient , pour ainsi dire , leur vie nationale avecleur vie religieuse . De cette identification sortira ce tte belleinstitution de la paroisse canadienne—française qui sera la
raison de notre survi vance et de notre multiplication sous ladomination anglaise la condition de notre grandeur future .Toutefois
,pour le moment
,le pays
,calme a l a surface;
est encore t ès agit é au fond .
Chaque j our,les nouveaux occupants outrageaient nos
populations au suj et de leurs croyances,ou les l ésaient dans
leurs droits . La lutte se continuait latente,mais opiniâtre.
De m ilitaire elle était devenue politique . Les délib érationssecr ètes des Conseils
,les lentes proc édures des Assembl ées
,
remplac èrent l ’agitation des camps et les coups de mains.A vrai dire
,cette tactique nouvelle
,sournoise
,embarrassa un
peu les vaincus dans les commencements ; mais dans leurbouche
,muette au début
,la parol e devint bientôt aussi dan
gereuse que l’épée l ’avait ét é dans les mains de leurs pères.
Ils se servirent de la nouvelle arme l égale avec autant deprudence que d ’
habi let é. La bataille recommençait donc,.
acharnée . Pour ce peuple,demeur é fid èle à son origine et à.
sa foi,l ’enj eu du combat en valait la peine il n ’y allait rien
moins que de son existence même . Pour lui,il s ’agissait de
ne point se laisser enlever les deux biens qui,pour l ’homme
,
repr ésentent tout ici—bas,coeur et esprit
,sentiment et raison
c’est—à—dire
,sa langue et sa religion .
— Ravi r à la foi s le Dieuet le Verbe d ’un peuple
,c ’est plus que le d étruire
,c ’est l ’avi lir ;
264 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
oc éans l’Atlant ique, le Pacifique et la mer Glaciale, former la
mobile ceinture de ses lieues de rivages.
Et,malgr é le drapeau d ’
Albion qui flotte sur tous lespoints de cette immense étendue de terre au centre
,il y a un
endroit qui reste touj ours la Peti te F rance,où la langue de la
Grande,ses mœurs et jusqu ’à ses l égendes
,se sont conservées
plus vivantes encore que chez elle . Quand un Français racontece pays lointain
,décrit les sc ènes de cette nature sauvage ou
cultiv ée,mais partout pittoresque , il doit lui sembler qu
’ild écouvr e à nouveau une province du vieux pays . En effet
,quelque part où il ira à travers nos bois,nos fleuves
,nos lacs
et notre golfe ; aux sommets de nos montagnes comme au fondde nos vall ées sur les rivages du Saint-Laurent ou du Mississipi
,
aux bords de l Atlantique et jusque sur les banquises de la mer
polaire,il retrouvera les traces des explorateurs de son pays
,
les ruines des forts qui lui ont appartenu,les vestiges de ses
expéditions militaires et ceux de cette l égion d ’
aventur iers
voyageurs,corsaires ou trappeurs
,qui
,un si ècle avant les
Américains,pénétr èrent dans le F ar Wes t
,marquant de leur
hutte de pionni er ou de leur poste de trappeur,avec une
étonnante sagacit é,les endroits où s ’él èvent auj ourd ’hui des
villes populeuses frayant,au milieu des solitudes
,les sentiers
sur lesquels l ’industrie n ’a plus eu qu’à poser ses rails . Ce
F rançais pourra dire,avec un l égitime orgueil
,malgré tout
,et
en dépit des millions d’Anglo
—Américains qui couvriront bientôtce continent
,que l ’occupation de ses ancêtres ne s ’y effacera
j amais……Touj ours,il rencontrera quelqu
’
épave du naufrageEt
,de ce mot Canada
,rest é quand même en dépit de la
d énomination D omi n i on,comme protestation des sentiments
et des souvenirs , surgit—il un reproche à la mère—patrie ou
demeure—t—i l ainsi que la compens ation des sacrifices accomplisj adis Qu ’importe r éparation de l ’histoire ou dédommagem ent de la post érit é
,le Canada
,celui de Jacques-Cartier
,fut
,
sera et reste touj ours la Peti te F rance
Damase Potvin.
Revue des Faits et des Oeuvres
Les de rn ie rs évé nement s .
Au moment où le quatri ème numéro de la Revue va souspresse , de grands événements viennent d
’avoir lieu à. Québec
qui demandent plus qu ’une mention ordinaire . Le d évoilement du Monument Laval
,le Congr ès des Jeunes , la c él ébra
t ion de la fête nationale des Canadiens-F rançais , ont fait dela vieille cit é de Champlain le théâtre de r éj ouissances patriot iques exceptionnellement éclatantes . Aussi avons-nous cru
bon de renvoyer à un prochain numéro le plaisir d ’en parlerau l ong
,a cause de la distance qui nous en s éparera d éjà, pour
en t irer les enseignements que nous y avons puis és . mD ’autre part
,la fête nationale ne passe pas inaperçue
chez nos compatriotes des Etats-Unis . Et,pendant que des
m illiers des leurs étaient à nos côt és pour glorifier Laval , lesF ranco—Am éricains c él ébraient sur des centaines de pointsde la Nouvelle—Angleterre, dans les Etat s de l ’Ouest ou ducentre
,les gloires nationales
,les hauts faits des ancêtres
,et
formulaient dans des accents d ’une touchante confianceleurs espoirs en de glorieux lendemains . Pour eux aussi , ilfaudra les avoir vus à. l ’œuvre
,il faudra avoir entendu leurs
chants,écout é leurs discours
,avant de mettre sous les yeux
de nos lecteurs le sens exact des manifestations qui , chez eux,allient si bien le culte des vieux souveni rs patriotiques et lafidélit é aux traditions saintes de la race
,à. la loyaut é géné
reuse et fi ère qu ’ils accordent sans r éserve à leur nouveaudrapeau . Au mois pr ochain le plaisir de cueillir ensembleet de former en bouquet les fleurs pr écieuses qui se sont épanouies
,il n ’y a pas encore une semaine
,et des deux côt és de
l a fronti ère,sous la chaude influence des souvenirs et des
espoir s patriotiques
266 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Franç o i s Coppé e .
N ous empruntons à l ’Uni vers de Paris ces notes biographiques cons acr ées à l
’un des grands poètes français de notreépoque
,F rançois Coppée, décédé il y a quelques semaines .
C ’est en 1 886 , écrit l’Un i vers
, que François Coppéeparisien de Paris, fil s d
’
un employ é au minist ère de la guerre— d ébuta dans la carr i ère litt éraire en publiant son premierrecueil de vers
,intitul é le Reli quai re. Il avait vingt—quatre
ans et travaillait comme commis chez un architecte,apr ès
avoir fait ses études,jusqu ’à la troisi ème
,au lyc ée Saint—Louis.
Et quoique l ’époque parût . peu propice à l ’éclosion d ’une gloirepoétique,— alors qu ’on ne lisait et ne voulait l ire
,parmi le
grand public d ’autres vers que ceux de Hugo— le j eune poèteobtint bientôt une notori ét é qu ’il n ’avait pas dû esp érer.Cette notori ét é il la dut tout d ’abord au genr e qu ’il avaitadopt é
,et au métier dont
,d ès ses premiers essais
,il fit
preuve. Il eut , d ’ailleurs , la bonne fortune d ’être,au théâtre
,
interpr ét é,d ès le début
, par des artistes peu banales car cefurent Mme Agar et Mme Sarah Bernhardt qui
,le 1 4 j anvier
1 869,cr éèrent
,à l
’0 déon
,cette exquise petite comédie qu ’est
le Passan t. Entre-temps,il avait publi é
,en 1 868
,un deux
i ème volume de vers , intitul é In timi tés , apr ès lequel vinr ent ,coup sur coup
,les Humbles le Cahier rouge
Promenades et i n térieurs ( 1 875) et Réci ts et Elégies ( 1 878)cependant qu ’au théâtre
,il donnait en collaboration avec
Verlaine,la revue Tout—Pari s à Bobino
,puis D eux douleurs
,
F ai s ce que doi s , l’Abandonnée
,les Bi joux de la déli vrance et
enfin le Luthier de Cremone,qui fut son principal succ ès .
En 1 884,l’Académ ie française l ’élut
,et il continua son
œuvre . On eut encore de lui , au théâtre , la Guerre de cent
ans,le Trésor
,la Batai lle d
’Hem ani,la M ai son de M oli ère
,
Madame de M aintenon,Severo Toselli
,les Jacobi tes et Pour
la Couronne. Il publia,dans cette p ériode
,plusieurs s éries
de contes en prose,que couronna son grand roman
,le Cou
pable.
Pendant toute cette partie de sa vie,François Coppée
s’était tenu éloigné de toute pratique religieuse. Mais , loinde se montrer hostile à l ’Egli se, il exprimait, dans la plupartde ses ouvrages
,des sentiments qui r évélaient un catholicisme
inst inctif.En 1 896
,il fit une grave maladi e qui rendit nécessaire
une opération dangereuse. Il demanda un confesseur . Ce
268 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
Est—0e donc vrai Le cœur se lasse ,Comm e le corps va se courban tEn moi seul toujours m ’
absorban t ,J ’i rai s , viei llard à t ête basse “
?
Non C’
est m ouri r plus qu ’
à m oit i é
Je pr étends , cruelle nature ,R és i stan t à ta loi s i dure ,Garder intacte m a pi t i é .
Oh les cheveux blan cs et les r i dess accepte, j ’y consens
Mais , au m oin s, j usqu
’
en mes vi eux an s ,
Que m es yeux ne soien t point aridesCar l
’
homme n’
est laid n i perversQu
’
au regard sec de l’
égoïsm e ,
Et l’
eau d’
une larm e est un pri sm e
Qui t ran sfigure l’
un ivers .
Loui s Fré chette
Celui que les Canadiens—français reconnaissaient,depuis
Cr émazie,comme leur po ète national
,vient de mourir à.Mont
r éal,apr ès une maladie de quelques heur es .M . Louis F r échette est n é à la Pointe—L évi s
,en
Apr ès un s éj our aux Etats-Unis,Séj 0 U 1 qui fut marqu é par la .
publication d ’un pamphlet La voix d’un exil é
,
” notrecompatriote était à son retour élu à la Législature .
En 1 880 l’Académ ie Française couronnait F leurs
bor éales et Oiseaux de Neige qui forment un troisi èmeVolume apr ès Mes loisirs et Pêle—mêle .”M . F r échette s ’est aussi r év él é dramaturge en donnant
aux lettres canadiennes Papineau et Véroni ce.
La Légende d ’un peuple reste son p- incipal ouvra ge.
M . Albert Lozeau , un de nos j eunes poètes le plus en renoma dépos é sur sa tombe ce t émoignage ému
De tous nos poètes,F r échette fut certainement le plus
f écond et le plus artiste . Sa connaissance des mœurs et dulanguage des habitants du pays s ’est exprimée en des contespittoresques lesquels constituent la partie la plus savoureuseet originale de son œuvre en prose .
M . Frechette accueillait avec bonhomie la j eunesse ;on l ’a même vu
,malade
,rendre visite à des conf r ères dont i l
avait plus de deux fois l ’âge,pour leur serrer la main et leur
dire un mot d ’encouragement . M . F - échette était bon et
dou é d ’une exquise sensibilit é .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 269
On l ’a souvent critiqu é et parfois d énigré c’est la
r ançon du succ ès .Mai s ses beaux vers patriotiques resteront à la gloire
du Canada et de la France et le souvenir de l ’homme tendrequ
’il fut ne p érira pas .
”
Un journal anglais de Montr éal , le D ai ly S tar , a consacréà l
’écrivain disparu un article élogieux où il d éclare que letalent de Fr échette suffi rait à engager ceux qui ne connaissentpas notre langue à l
’
apprendre à cause des beaut és que ses
po èmes nous r évèlent .C ’est assur ément une des grandes figures de notre li tté
rature nationale, sinon la plus grande , qui disparait . Nos
lecteurs nous sauront gr é de leur donner ici les derni ers chantsde ce poète où l ’on semble reconnaître une sort e de pr évi siond
’une fin que lui—même sentait prochaine .
Pourquoi craindre la Mort,la grande in évi table
Qu’
elle soi t le repos , qu ’
elle soi t le r évei l ,Pourquoi de cette aurore ou de ce bon somm ei l
Se fai re s i souven t un spectre redoutableAucun fan tôme n
’
est eff rayant au soleil .
D e m ême qu’
on accuei lle un ami véri table ,Si l
’
hôte au f ron t pâli prend place à votre table,Levez en son honneur la coupe au jus vermei l .
Pour m oi , je me con fie à la Just i ce imm ense.
Or ta jus t i ce , à. toi Seigneur , c ’
est la Clémen ce
par ta bont é céleste rassur é,
Quand le terme viendra de m a course éphém ère ,Je pen cherai ma t ête et je m
’
endorm i raiSan s peur , comm e un en fant sur le sein de sa m ère.
l’
e nve rs de l’
amour
Un incident dont le Sun de New-York a été l ’instrumentn
’est pas loin de donner une saveur spéciale aux caresses que
nous font en ce moment nos amis et fr ères anglo—saxons .Il s
’agit d
’un canadien—anglais qui a entrepris de di re aux
américains ce que signi fie le mot Canuck,
” Don ’t yer knowL isons d ’abord ce que ce chatouilleux personnage écrit au
Il semble exister beaucoup de malentendu,ici et là
,
au sujet de la signification du mot Canuck,
”et pour moi
même et pour mes compatriotes expatri és je d ésire protestercontre l ’expression.
270 LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE
Le plus grand nombre des New—Yorkai s semblent avoirl’idée que toutes les personnes qui viennent du Canada sont desCanucks et un grand nombre emploient cette expression commes i c ’était un terme d ’
Opprobre. Or un Canuck est un Canadien français ou habitant et les échantillons de ce typequi ont travers é la fronti ère pour se déverser dans les Etatsde la Nouvelle—Angleterre ont peu fait pour donner une bonner éputation a ce titre .
Mais le Canuck dans son village natal de la provincede Québec est une sorte de citoyen assez décent
,comme ceux:
qui . ont lu les œuvres de Sir Gilbert Parker le savent ear
Parker a enregistr é les habitudes et les traits de ce peuple avec:une fid èle exactitude .
Ces habitant s sont rest és fixés assez généralement sur
le sol de la Province de Québec , mais au fur et a mesur e del’augmentation de la population il n ’y avait pas de moyensde subsistance pour tous , et la population canadienne-française s
’accroît a un taux stupéfiant , sans égard aux principes
économiques tels qu’expos és par les th éoriciens .
Ce surplus de population,en grande partie impr évoyante;
s’est d évers é
,naturellement arr-delà des fronti ères
,dans la
Nouvelle—Angleterre. Un grand nombre des ouvriers dansles villes industrielles sont des Canadiens—français
,ou Canucks
,
ET DANS L ’ESTIME POPULAIRE ILS NE SONT PAS
CONSIDERES BEAUCOUP AU—DESSUS DES ANIMAUXQUI NE PARLENT PAS (DUMB ANIMALS) . Il n ’y a pas
de Canucks de cette classe à New—York,mais le nom y a pris
racine et il est employ é trop fr équemment pour les Canadiensde pur sang anglais.
En ces derni ères années ces habitants ont envahi lesprovinces maritimes du Canada
,où ils ne sont pas plus haute
ment regardés que dans la Nouvelle—Angleterre. Les Fran
çai s furent chass és de ces provinces il y a plus de cent ans et
auj ourd ’hui la race y revi ent .Canuck signifie Canadien français et rien de plus . Les
New—Yorkai s voudront— ils s ’en souvenirC ’est aussi simple que ça Les New—Yorkais feront b ien
de marquer d ’une coquille d ’huître le j our où ils ont eu la
visite de cet imb écileLes j ournaux de la Nouvelle—Angleterre ont protest é
vigoureusement contre les assertions de cet anglais expatri é,
”
et ils ont b ien fait . A Lowell,Mass ,
une assembl ée de pro
272 LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE
ont pu voir un gouvernement de sectaires souiller le Panthéonde la dépouille d ’un Zola .
Le travail d ’épuration dirig é contre la pornographies ’étend même jusqu ’au théâtre ou la license n ’était pas moinsgrande . D ’apr ès quelques correspondances de Paris il faudr ait espérer , la aussi
,un assainissement qui s ’est encore
trop fait attendre . Un j ournaliste envoyait r écemment à.un j ournal d’
Am ér ique une lettre où nous lisons les expressionssuivantes
L’abolit ion de la censure dans les théâtre français a
produit son r ésultat logique . La licens e du language a envahile th éâtre à tel point que le public a dû protester . Il y a
quelques semaines une dame,tr ès haut cot ée dans la soci ét é
et le monde des lettres,proposait publiquement dans un
j ournal de Paris,aux personnes de son sexe de boycotter sans
piti é les th éâtres et les caf és ou l ’indécence fait loi . Toutaussitôt
,un acad émicien
,M . Etienne Lamp , publia dans
l’Echo de Par i s , un art icle tr ès vigoureux
,intitul é Assez
contre les promoteurs de l ’immoralit é publique qu ’il appel eles exploiteurs des curiosit és malsaines .”
M . Hervi eu,avait dit fort spirituellement lors de l ’abo
lition de la censure L ’animal en cage ne s ’empresse past ouj ours de sortir au moment même ou la port e lui est ouverte .Auj ourd ’hui on reconnaît que la b ête est bien au large et onveut le remettre en cage . Tout ceci est fort b ien
,mais on
fini ra bientôt par manquer de cages,si l ’on ne prend imm é
diatement des mesures d ’hygi ène morale,empêchant
,grâce
à. l ’éducation saine,la formation des mentalit és qui font les
pornographes et ceux qui les honorent .
Zola au Pant hé on
Voici un événement qu ’il faut signaler au monde au mêmet itre que les grandes calamit és . Il marque chez ceux qui l ’ontvoulu , préparé , accompli , un cynisme , une absence de tout sensmoral , un aveuglement qui rappellent les j ours sinistres dela D éesse Raison .
”Au fond, c
’est la revanche du juif surle Gentil , c
’est un nouvel attentat port é par la franc—maçonnerio au pass é glorieux de la F rance et à la mémoire de ses
hommes illustres . Apr ès avoir crochet é les églises,pers écuté
LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE 273
les Petites Sœurs,volé les morts , il ne restait plus qu ’un der
nier outrage à attendr e des sectaires du Palais Bourbon .
Et,cet outrage , ils l
’ont commis il y a quelques semaines,en violant le sanctuaire des gloires nationales, en souillantles tombeaux des grands hommes de F rance par le voisinagedes restes impurs du prince des pornographes .Un écrivain anglais parle quelque part de Skulls that
cannot teach and Will not learn c ’est toute la mesure descervaux qui viennent d’
infliger à. la F rance cet inqualifiableaff ront . On invoquera divers pr étext es pour justifier pareilleaudace. Il y a touj ours des pr étextes . Mais on ne
, pourra
nier que l’
apothéose de Zola a ét é en même temps l ’apothéosede la corruption et du crime
,et qu ’en ouvrant la porte du Pan
théon au pornographe on l’
a ouverte en même temps à. latrahison
,au vice
,a la d égradation , et qu ’un gouvernement
capable de pareille infamie ne surprendra plus personne lejour où
,continuant son œuvre
,il placera aux côt és du grand
remueur de boue des traîtres comme Dreyfus . et Ullmo ou
des crimi nels comme Solei lland.
Lé on Kemne r.
Edifices Publics , Hopitaux, Institutions et endroits
intéressants.
Un ivers it é Lava l ( 1 )
L’Universit é Laval a ét é fondée en 1 852, par le S éminaire
de Qu ébec . La Charte Royal e,qui lui a ét é ascordée par S.M.
La Reine Victoria,a ét é signée à Westminster le 8 décem
bre 1 852.
Par la Bulle In ter varias solli ci tudines du 1 5 avril 1 876,
le Souverain Pontife Pie IX,de glorieuse et sainte mémoi re
,
a donne à l ’Université Laval son‘ compl ément en lui accordantl’érection canoni que solennelle avec les privil èges les plusétendus . “
En vertu de cette Bulle,l’Univers it é a pour protecteur
à Rome,auprès du Saint—Si ège
,Son Eminence le Cardinal
Pr éfet de la Propagande. La haute surveillance de la doctrineet de la di scipline , c
’est—à—dire de la foi et des mœur s,est dé
volue à un Conseil Supérieur compos é de NN . SS. les Evequesde la Province civile de Québec, sous la pr ésidence de SaGrandeur Mgr l
’Archevêque de Québec
,nommé lui—même
Chancelier Apostolique de l ’Universit é.En vertu de la Charte Royale
,le Visiteur de l ’Un iversit é
Laval est touj ours l ’Archevêque catholique de Québec, quia dr oit de veto sur tous les r èglements et sur toutes les nominations . Le Supérieur du Séminaire de Québec est de dr oitle Recteur de l ’Universit é. Le Conseil de l ’Universit é se
compose des Directeur s du Séminaire de Québec et des troisplus anciens professeurs titulaires ordinaires de chacune desf acult és .Il y a quatre facult és
,qui sont les facult és de Th éologie,
de Droit , de Médecine et des Ar t s . Les dégrés auxquels peuvent parveni r les él èves, dans chacune des facult és , sont ceuxde Bachelier
,de Maître ou Licenci é
,et de Docteur.
( 1 ) Annuaire de l’
Un ivers i té Laval .
276 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
apport é des modifications importantes à la décision du 1 erf évrier 1 876
,en accordant aux sections de Montr éal le quas i
ind épendance pratique.
Ce qui suit ne regarde que l ’organisation de l ’Universitéà Québec.
ORGANISATION DE L ’ENSE IGNEMENTL
’année acad émique comprend neuf mois et se divise
en trois termes . Le premier commence vers le 1 5 septembre,
et fin i t à Noël le second finit à Pâques,et le troisi ème fin it
vers lafin de juin .
L ’enseignement est donné par des professeurs ti tulai resordinaires ou e xtraordinaires
, par des professeurs agrégés et
par des professeurs chargés de cours . Les premiers sont seulsprofesseurs au sens de la Charte
,peuvent seuls être membres
du Conseil Universitaire et avoir voix délibérat ive dans lesconseils des facult és .
Les cours sont priv és dans les facult és de Théologie,
de Droit et de Médecine . Cependant tout prêtre peut êtreadmis au cours de Théologie il en est de même à l ’égarddes avocats et des notaires pour les cours de Droit
,et â l ’égard
des médecins et des chirurgiens pour les cours de Médecine.
Dans la facult é des Arts,il y a des cours publics et des cours
privés ceux—ci ne sont que pour les él èves ou étudiants dela facult é.
EDIFICES .— Le corps principal
,généralement désigné
sous le nom d’Univers it é Laval
,est celui où se donnent les
cours de Droit et des Art s,et où se trouvent les musées et la
bibliothèque. Les autres sont1 . L ’ECOLE DE MEDECINE
,qui a 70 pieds de long et trois
étages . C ’est là. que se donnent les cours de la faculté deMédecine. On y voit deux mus ées fort complets .
2. LA F ACULTE D E THEOLOGIE.— Edifi0€ tout r écent de
260 pieds de longs et à cinq étages , bât i en mat ériaux incombustibles . Ce grand s éminaire peut recevoir au—delà de 1 00él èves en Théologie
,à part les 20 ou 30 professeurs ecclé
siastiques attachés à l ’établissement et qui y ont aussi leurlogement .
3. LE PETIT SEMINAIRE DE QUEBEC est attenant l ’Universit é. C ’
est le premier des coll èges affil i és et il peut facilement admettre dans ses classes 500 él èves et plus. Sur ce
nombre,200 en moyenne sont pens ionnaires.
LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE 277
MUSEE DE PEINTURE
Les toiles qui composent ce mus ée viennent en grandepartie de la collection de feu l
’Honorable Joseph L égar é, un
d e nos plus anciens art istes Canadiens . Parmi ces tableaux,le plus grand nombre furent envoyés au Canada par l ’abb éDesjardins
,vicaire général de Paris
,qui r ésida quelques années
au Canada durant la r évolution française . Il acheta ces
tableaux à tr ès bas prix, et , par reconnaissance, les exp édiaen ce pays . Voilà comment il se trouve ici une foule de peintures anciennes et de grande val eur.
Plusieurs autres furent achet és pour M . Legar é par M.
Reiflenstein ,durant un tour d’
Europe. Ce voyageur eut lachance de trouver toute une collection de peintur es chez unefamille noble en embarras financier
,et put ainsi s ’en procurer
un bon nombre pour le compte de son ami du Canada.
On ne sera pas surpris apr ès cela de trouver dans la mus éede peinture de l ’Un ivers it é Laval
,un Lesueur
,deux Parrocel
,
un Romanelli,quatre Salvator Rosa
,un Joseph Vernet
,un
Van Dyck,un Simon Vouet
,un Tintoret , un Poussin, un Puget ,
un Albane,un David
,etc .
La musée de peinture comprend plusieurs salles Où les
toi les sont class ifiées d ’une façon sp éciale . Nous observeronsla même classification en donnant le suj et de quelques toileset les noms des auteur s
LE MUSEE
St—Jérôme dans le désert,par Vignon .
Martyre de sainte Catherine,par F . Chauveau.
Le Veau d ’or,par F ranck.
La Religion et la Temps . Ecole espagnole .Antiquit és romaines
, par H. Rober t.
Jésus rencontrant sainte Véroni que,par Vargas .
St—Michel chassant les anges rebels . Ecole italienne .Ecole d’
Athènes,d ’apr ès Raphael
,par Paul—Pan tius
Antoine Rober t.
David contemplant la tête de Goliath, (sig ) Pierre Puget.
Martyre de M . Robert Longé ( 1 764) par L . Allies .Les F illes de Jéthro
,par Romanelli .
St—Michel terrassant le d émon,par Simon Vouel .
Solitaires de la Thébaïde,par Gui llot.
278 LA REVUE FRANCO—AMERICAINE
Moïse,par Giovani Lanfranco.
Martyre de saint Etienne. Ecole de Padoue.
Couronnement de la Vierge, par le Ti ntoret,Jacques—Cartier
,â Stadacon é
,prenant possession du
Canada au nom du roi -de F rance, par Hawksett.
Hérodiade recevant le chef de saint Jean—Baptiste. Ecoleitalienne .Joueur de Cornemuse
,d ’apr ès Van Dyck
, par M oli nari .
Jésus en Croix,par Gan ache.
Chasseurs et Combat de Chiens, par Rademaker .
Sainte Madeleine,par D avi d
Vase orné de fleurs (panneau) , par F iesne.
Intérieur d ’une église,par P . Neefs , l
’ancien .
St—Barthélemy, par Janssens .
Bonaparte , d’apr ès David
, (sig ) Pradier .Adoration des Mages
,par Carreno.
Les anges adorant l ’Enf ant Jésus, par M ignard.
Saint Louis Bertrand, par Pi sano .
Couronnement d’épines , par ArnoldM i tens .
D iane de Poitiers,par Jean Goujon .
Paysage Troupeau de vaches et ru ines, par Castiglione.
Saint Pierre et Saint Paul . Ecole italienne, (fin du 1 7e
s i ècle) .Chasse
,par ven der M eulen .
Paysage flamand, (sc ène d
’hiver) , 1 7e si ècle .
Jésus et la Vierge, (le Benedicite) . Ecole italienne.
Joyeuse bacchanale,par Stevens .
Sentence de mort, par
*
V.-H Janssens .
Martyre du pape saint Vigile, par W.
-J Baumgaertnæ.
Tête d ’étude, (sur bois) , par Stopleben .
Fleurs, par J .
-B. M onnayer .
Le reni ement de saint Pierre. Ecole romaine.
Episode de la guerre de Trente ans . Ecole hollandaise.
Paysage (moulin , ruines) , par ran Bloemen .
Chasse, (sur bois) , par van der M eulen .
Sc ène de cabaret . Ecole flamande.
Mater Dolorosa par van Dyck.
Médecin pansant un soldat bless é. Ecole de Harlem,
1 7e siècle‘
.
Vase et F ruits, par Heem .
Boucher,Boulanger et Matelot , par John Opie.
Adoration des Bergers . Ecole allemande,1 7e si ècle.
Toilette d 'une F lamande, par Schalken .
280 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
Assomption de la Vierge. Ecole italienne,1 7e siècle.
La Purificat ion . par F eti .
Ermitage, par H. Vargasson .
Saint Jean l ’Evangéliste. Ecole italienne.
Moine étudiant à la lueur d’un flambeau . Ecole espa
gnole.
Vi eux Moine en m éditaton à la lueur d'un flambeau.
Ecole espagnole.
Foire, par Monniæ.
Tête du Christ . Câdre tr ès ancien .
SALLE DES COURS LITTERAIRES
Le Souper à Emmaus , attribué au Ti tien .
La derni ère Cène d ’apr ès Léonard de Vinci .Martyre de saint Sébastien, par Salvator Rosa.
Martyre de saint Laurent, par CarloM aratti .
Madone par N. Gordigiani .
Le Chri st et la Samaritaine, par J . van Hoeke.
Sain te Fami le, par Maratta .
Pr édication de saint Jean—Baptiste, par Ni colas
Maria Cœcilia Phyfier d’Alt ishofen
,1 804.
Sybille, par Solimena .
Retour d ’Egypte (sur cuivre) .
Impression des stigmates de saint François d’As s ise,
Saint Thomas Ap.,d ’apr ès Guercino.
Saint Antoine prêchant aux poissons .L
’Ange Raphaël et Tobie (sur cuivre) .
La sainte Vierge,l’Enf ant J ésus et saint Jean l ’Evangé
liste, par Baroœio.
La Visitation . Ecole de Bologne.La Prima Vera (Le printemps de la vi e) , par J . Wi nch
La sainte Vierge et les Saints. Esquisse de Gui doSainte Madeleine au désert
, par Barthol Schidom .
Adoration des Bergers,d ’apr ès la Corr ège.
Saint Jérôme, par Barthol Schi done.
La sainte Vierge et les Saints, par F . Solimena .
Joseph et ses F r ères .Le Souper chez Simon le pharisien, (copie) .Loth sortant de Sodome.Sainte Madeleine.
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
PREM IERE ANTICHAMBRE
Scène champêtre . Ecole italienne .Apparition des Anges aux Bergers . Ecole flamande .Saint Jérôme commentant les Saintes Ecritures . Ecole
italienne.
Paysage canadien (sc ène d election) . Château—R icher .Sér énade dans les rues de Rome . Ecole romaine .Copie de la sainte F ace
,conservée à Saint—Pierre de Rome. .
Ecole romaine .Papsage d
’Italie. Ecole italienne .
Portrait,par. Gainsborough.
L’Immacul ée Conception . Ecole espagnole .
SALON DE RECEPTION
Mgr F rançois de Montmorency Laval,1 er évêque de
Québec et fondateur du S éminaire de Québec .M l
’Abbé L .
—J Casault,fondateur et premier recteur de
l’Un iversit é
,par Théop. Hamel.
Mgr Elz .—Alex . Taschereau
,plus tard archevêque de
Québec,et 1 er cardinal canadien
,2é recteur de l ’Universit é,
par Pasqualoni .Mgr M.
—E. Méthot,3e recteur de l ’Un ivers it é, par Bug.
Hamel.Mgr T.
—E. Hamel,V. G.
,4e recteur de l ’Uni vers it é, par
S . E. le Cardi nal F ranchi,par L . F ontana.
Mg1 C .—F . Baillargeon
,ai chevêque de Québec et 2e Visi
teur de 1 Un iversit é,par Irivernoi s
S . E. le cardinal Ledochowsk i,par Carnevali .
S . M . la reine Vi ctoria,copie
,par J . Légaré.
S . E. le cardinal Barnabo,par Pasqualoni .
Portrait de M . l’Abbé H .
—R . Casgrain ,historien et litt é
rateur canadien,ancien professeur a la facult é des Arts et
b ienf aiteur de l ’Uni vers ité .
Mgr E .—J Horan
,évêque de Kingston
,un des fondateurs
de l ’Uni vers it é,par Théo. Hamel.
Mgr B . Paquet,5e recteur de l ’Universit é
,par Eng.
Hamel.
Mgr J -C.—K.
-Laflamme,6e recteur de l ’Un ivers ité
, par
Ghs . Huot.
Mgr O.—E . Mathieu
,7e recteur de l ’Un iversité
,par P . Gabri ni .
LA REVUE FRANCO —AM ÉRICAINE
S . E . le cardinal Sim éon i,par Pasqualon i .
Port rait du docteur Morrin,professeur et bienfaiteur de
l’Un ivers it é (facult é de médecine) , par Théo. Hamel .
Portrait de S . S . le Pape Pie X,par Chs Huot. Rome
,1 904.
S S . le Pape Pie IX (grandeur naturelle) , par Pasqualon i .S .
“
E. le cardinal Gotti,par P . Gabr in i .
Sur un r iche table en marbre au centre du salon se trouveune magnifique cassette en argent contenant la bulle d ’
érection
canonique de l ’Un ivers it é Laval,en 1 876 [
SECONDE ANTICHAMBRE
Pain,Fromage et Ail
, (s ig ) J uan de Hermi da .
Couronnement de la sainte Vierge . Ecole allemande .Le R édempteur . Ecole française .Paysage d ’
Italie. Ecole italienne .Marine . Ecole italienne .Ascension de Notre—Seigneur . Ecole italienne .Paysage Montagnes et Ruines . Ecole italienne .La Vierge
,l’En fant Jésus et saine Jean—Baptiste . Pan
neau du 1 6e si ècle . Ecole italienne .La Liseuse Panneau . Ecole flamande . Tr ès bien
conservé .Paysage d ’
Irlande. Ecole anglaise .Bataille d ’
Indiens,par Légaré.
Ecce Homo Ecole italienne .Conducteur et ses Chiens sur la piste d ’esclaves marrons
,
par Wi lliam M arsden,1 885.
Moine lisant . Ecole espagnole .Fuite en Egypte . All égorie . Ecole de Sardaigne .
Dans la nouvelle chapelle du Séminaire,constr uite sur
l ’emplacement de l ’ancienne (Où ont péri , en 1 888, les dix plusbelles toiles qu ’il y eût peut— être en Amérique) , on peut admirer plusieurs beaux tableaux .
Chapelle Saint—Thomas d ’Aquin Dieu Cr éateur en
tour é d ’anges,d ’après Poussi n .
Chapelle Saint—Antoine de Padoue Deux Anges, par
Lebrun .
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
Musée de M inéralogie, renf erme pluS de échantillons .
Musée de Géologie, renf erme plus de échantillons .Musée de Botan i que, ce musée occupe les trois dern ères
galeries qui font suite au musée géologique . La prem i èregalerie renferme une collection des bois économiques canadiens. Chaque arbre de la forêt canadienne est repr ésent épar deux échant illons de grande dimension , disposés dans unordre méthodique . L ’un des deux est seulement varlopé ,l ’autre est poli et verni . Cette col eetion est en tout semblableà elle qui a obtenu des r écompenses tr ès flatteuses dans deuxexpositions universelles d’
Eur 0 pe, à Dublin et à Paris . La
seconde est occupée por plusieurs autres collections .
La derni ère salle contient l ’herbier ou plutôt la collectiondes herbiers de provenances diverses
,tous authentiques
,qui
comprennent 1 . l’herbier américain (plante du Canada et
des Etats—Unis) 2. l’herbier général . L ’herbier américain
se compose des collections de C.—C. Parry , E. Hall et J .
—B .
Harbour , Charles Geyer , N . Rield, Leidenberg , M . Vincent ,plus un grand nombre d ’échantillons fourni s par Moser
,Smith
et Durand . Plusieurs plantes sont étiquet ées de la mainmême de Nuttall et de Raffinesque.
Les plantes du Canada ont ét é recueillies en grande partie par l
’
Abbé O . Brunet .L ’herbier de l ’Univers it é contient plus de plantes .
MUSEE ETHNOLOGIQUE
Les deux premières galer 1 es sont en grande partie occupéespar la collection ethnologique de M . Joseph—Charles Tach é
,
ancien D éput é Ministre du D épartement de l ’Agr iculture, àOttawa . Cette collection cons iste en un nombre cons id érablede crânes indiens dont les formes
,compar ées à celles des
crânes pr éhistoriques de l ’Eur 0 pe, pr ésentent le plus vif int ér êt . Aj outons une foule d ’
ustens iles à. l ’usage de nos tribusindiennes , de curieux fragments de poter ie , des instrumentsde chasse et de guerre
,etc . Ces reliques d ’un autre âge ont
ét é retir ées,pour la plupart
,des tombeaux Hurons.
Là se trouve encore une momie égyptienne dans son
sarcophage . Une autre est plac ée dans une vitrine lat érale.
Le musée chinois et j aponais,bien que commencé tout
r écemment,est déjà remarquable.
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
MUSEE ZOOLOGIQUE
Parmi les plus importants des mami f ères canadiens,on
remarque l ’orignal , le caribou , l ’ours , l e raton, la loutre , lecastor
,deux moufettes d ’
Am ér ique, dont l’un a pelage j au
nâtre. On y voit aussi bon nombre de mam i f ères étrangers,
parmi lesquels se trouvent plusieurs esp èces de singes , un loupdes Ardennes
,etc.
Les collections itchyologiques et herpétologiques renferment plusieurs individus dignes de remarque . Parmi lesreptiles
,signalons un crocodile du S énégal
,un magnifique‘
alligator de la F ror ide,p us ieur s serpents de forte taille
,ainsi
qu ’un bon nombre de tortues .La collection ornithologique comprend à. peu pr ès 600
esp èces repr ésent ées par plus de 1 200 individus venant detoutes les parties du monde . Presque toutes les esp ècescanadiennes ont ici des repr ésentants
,ainsi que plusieurs
raret és européennes .La tribu des oiseaux chanteurs est tr ès nombreuse et
r iche en espèces rares ou étrangères .
BIBLIOTHEQUE
Elle renf erme au delà de volumes,En voic i
les principales subdivisions1 . Histoire du Canada
,politique et jurisprudence os
nadienne.
2. Documents sess ionnels des différentes l égislatures duDominion
3. Education et p édagogie4. Litt érature5. Histoire de l ’Egl i se, générale et part iculi ère6 . Histoire civil e et politique
,générale et particuli ère
7. Histoire des diff érents Etats des deux Amériques,
en dehors du Canada8. PhilOSOphie
9 . Sciences1 0 . Médecine1 1 . Dr oit1 2. Th éologie et droit canon1 3. Ecriture sainte , controverse , éloquence sacr ée et
ascétisme
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
1 4. Bibliographie1 5. R evues et j ournaux1 6. Archéologie civile et religieuse1 7. Beaux—Arts1 8. Agriculture , horticulture , etc .
SALLE DES PROMOTIONS
Vaste salle avec galeries lat érales et pouvant conteni rau delà de 1 500 personnes .
C ’est dans cet appartement que se fait la collation solennelle des diplômes
,à la fin de chaque année académique . Là
aussi ont lieu les r éceptions officielles de l ’Un iversit é. Le
Prince de Galles y recut les hommages du corps Universitaireen 1 860 . Ce fut à l ’occasion de cette visite que Son AltesseRoyale fonda un pr ix au Petit S éminaire de Québec
,prix
qui est actuellement a la disposition de la F acult é des Arts .C ’est encore laque la Princesse Louise et le Marquis de Lornefurent reçus lors de leur vi site Officielleà. l ’Un ivezsit é.
Son Excellence Mgr Conr0 y,D él égu é Apostolique au
Canada,fut également l ’obj et d ’une r éception solennelle dans ”
cette même salle,ainsi que Son Excellence l ’abb é Don Henri
Smeulders,Commissaire Aposto
’
ique.
En 1 896,r éception solennelle de Lord Russell de Killowen .
C ’est encore dans cette salle que furent officiellementecus M . le Comte de Paris
,M . le duc d ’
Orl éans,M . le duc
d’Uzès
,M . le comte de L évi s—Mirepoix
,le contre—amir al de
Cuverville .Les gouverneurs généraux Lord Stanl ey de Preston
,
Lord Pberdeen,Lord Minto
,en 1 904 et Lord Grey
,
en 1 905, ont aussi ét é l’obj et
,dans cette meme salle d ’une
solennelle r éception .
En 1 90 1,les professeurs et les él èves de Laval pr ésent è
rent ici leur s hommages au duc d ’York
,maintenant Prince
Galles.Son Excellence Mgr Satolli
,ma
'
ntenant cardinal SonExcellence Mgr Rafael Merry del Val ,— Maintenant cardinalet Secr étaire d’
Etat,— Mgr D . Falconio
,évêque de Ler issa
,D él égu é Apostolique au Canada,Mgr Donatus Sbarett i ,
évêque d ’Ephèse et Dél égu é Apost0 1 1 que, ont reçu dans cette
salle les hommages du corps universitaires .
1288 LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE
.Le Sém ina i re de Qué bec
Le Séminaire de Québec fut fondé en 1 663 et établi officiellement cinq ans plus tard , en 1 668.
Cette même année . de 1 668,l ’illustre fondateur du Semi
naire,Mgr de Laval
,reçut de Colbert une lettre l ’enéourageant
dans son proj et et lui faisant part des sentiments du Roi àce suj et . Cette lettre était dat ée du 6 mars 1 668 et félicitaitMgr ne Laval du soin qu ’il apportait à l ’éducation des j eunesfrançais de la coloni e et lui faisait part des intentions du roisur les nations sauvages
,qui sont soumises à. son ob éissance
,
et de l ’éducation à.donner a leurs enf ants,pour leur a pprendre
notre langue et les élever dans les mêmes coutumes et façonsde vivre que les français .”
L ’histoire compl ète du Séminaire de Québec n écessi
terait une étude plus étendue que cell e que nous pouvonsconsacrer dans ce Guide . Cependant
,on nous saura gr é de
donner ici les principaux passages d ’une Note sur le PetitS éminaire de Québec publi ée en févr ier 1 850 par l ’Abei lleune petite feuille hebdomadaire publi ée par les él èves duSéminaire sous la surveillance de leurs professeurs . Apr èsavoir cit é la lettre de Colbert
,l ’écrivain de l ’Abei lle di t
Cette idée de franciser les sauvages n ’était pas nouvelle . Les Jésuites en avaient tent é la r éalisation trente ans
auparavant,lors de la fondation de leur coll ège le mauvais
succ ès qu ’ils avaient eu venait de leur faire rej eter les propos i tions de M . Talon qui crut que l ’évêque de Pétr ée se prêteraità ses desseins et engagea Colbert a lui
_
écrire . Le pr élat regarda cette lettre comme une marque qu ’il était temps d ’exécuter le dessein qu ’il avait touj ours eu de fonder un PETITSEM INA IRE pour former d ès leur bas âge les enf ants que Dieuappelle à l ’état eccl ésiastique . Faute de moyens il s ’étaitborné apayer la pension de plusieurs enfants chez les Jésuites
,
attendant de la Providence des secour s que le m ini stre du Rois emblait enfin lui permettre .
Il fit promptement accomoder une vieille maison achet éede Mde
‘
Couillard,situ ée aupr ès du presbytère actuelle . Le
9 octobre,
j our de St . Deni s,il fit solennellement l ’ou
verture du PETIT SEM INAIRE D E L ’ENFANT JESUS . Les premiers él èves furent huit français et six hurons que l ’on seproposait de franciser . Les Jésuites se décidèrent alors àprendre quelques Algonquins . Mais
,dit M . De La Tour
,
ce mélange que , l’
on croyait utile ne servit de rien aux sauvages
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 289
et nuisit aux français… …On eut d ’abord beaucoup depeine a en obteni r les sauvages infiniment attachés à leursenfants
,ne peuvent se r ésoudr e à s ’en s éparer . On en prit
beaucoup de soin,mais on n ’a j amais pu
,ni ouvrir assez leur
esprit pour les faire entrer dans les mati ères théologiques ,ni fixer assez leur l égèret é pour les attacher au service desautels . Apr ès plusieurs années pass ées au Sém inaire ’malgr é
eux et comme en prison,ils s
’
en fuyaient aussitôt qu ’ils pouvaient et allaient avec les autres courir les bois .”
Les petits hurons sortirent bientôt et ne furent pointremplacés . Le dernier fut retir é par ses parents le 1 5 mars ,1 673. Six ans apr ès on reçut un Iroquoi s du Sault qui restaquelques mois et un métis que l ’on fut oblig é de renvoyer .Il faut ensuite descendre plus d ’un si ècle pour rencontrerdans les annales le nom de Vi ncen t—Vi ncen t
,sauvage de Lorette
encore vivant . Il est le premier et le seul qui ait fait un courscomplet d ’études . Ses succ ès furent loin d ’être br illans
,
et il n ’a pas du reste d émenti son or igine,c ar plus d ’une fois
il a quitt é les th èmes et les versions pour aller comme les autrescouri r les boi s et il les court encore .
Le pensionnat des Jésuites,qui n ’éta it pas bien nombreux
,
tomba par la retraite des s éminaristes . Ceux—ci continu èrentnéanmoins jusqu ’en 1 759 d ’aller en classe avec les ext ernesdes RR . PP.
,parce que le S éminaire n ’avait ni les ressources
p écuniaires,ni le logement convenable
,ni les professeur s
nécessaires à un cour s complet .Les annales prouvent qu ’il y avait une prem ere et une
seconde année de philosophie , une rh étorique et une seconde ,une troisi ème et une quatri ème
,non pas ensemble
,mais alter
nativement,de deux ans en deux ans . Il y avait aussi une
classe de r udimens et une peti te école pour ceux qui ne saventpas lire . La dur ée des études variait selon la science et l ’aptitude des él èves elle est généralement bornée entre cinqet sept ans . Quelques—uns venaient de F rance commencerou continuer ici leurs études on remarque parmi eux descommis
,des apprentis et même des soldats .
Ceux qui ne témoignaient pas d ’aptitude ou de goûtpour les études sortaient après avoir appris le métier de couvreur
,de maçon
,de cordonnier
,de couturier
,de charpentier ,
de sculpteur,de serrurier
,de . menuisier
,etc . La sculpture
était surtout en honneur les eccl ésiastiques du Grand S ém inaire avaient un atelier bien garni
,et les écoliers ltur ai
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
dèrént à temps perdu entre les études,a sculpter les orne
ments de la chapelle que M . de la Potherie estime àécus et appelle très belle
,L ’agriculture n ’était pas oubli ée
la Grande F erme de St—Joachim et le Séminaire que Mgr deLaval y avait établi en sont la preuve .
Les él èves allaient à l ’office de la cathédr al e et portaientune soutane rouge avec un bonnet carr é ou un camail demême couleur . Mgr de S . Valier leur rend ce t émoignagedans une lettre Ils se tiennent d ’un air si dévot durantla c él ébration de l ’office divin qu ’ils ins pirent la d évotion aux
peuples .”
Le capot bleu avec nervures blanches remonte aux
premiers temps . Les directeurs du Sémi nai re des M i s si onEtrangeres de Paris voulurent au commencement du 1 8mesi ècle changer cette couleur voici ce que r épondirent lesdirecteurs de Qu ébec ( 1 759) Permettez—nous de vous direque c ’est le sentiment de la plupart et même de MM . nos Intendants
,qu ’étant en possession de tout temps de cette cou
leur,a laquelle l ’on est accoutumé
,ce changement paraîtrait
étrange . C ’est ce qui dist ingpe les enfants du Séminai re ,surtout en leur mani ère
,car
_il y en a bien d ’autres qui portent
le bleu,chaque pays , chaque gui se. Nous savons que cela
paraîtrait particulier dans d ’autre pays qu ’en Canada . M .
Raudot, (i n tendan t) nous a dit qu
’on l ’avait pr évenu lei —dessus,
mais qu ’en les voyant il avait changé de sentiment et qu ’illes trouvait fort propres .
Il parait que la ceinture état pr im it ivermn t blanche,
et qu ’elle devint peu a peu chamarr ée de toutes les couleursmélangées avec un goût sauvage . La ceinture ver te actuelle
,
moins dispendieuse et beaucoup mieux assortie au reste del ’habillement date de 1 838 . Elle n ’a ét é obligatoire qu ’en1 840 .
La tête était couverte d ’un tapabor , esp èce de bonnetsupprimé en 1 726 et remplac é en 1 842par la casquette actuelle :dans l ’intervalle qui est de plus d ’un si ècle chacun se couvraitcomme il l ’entendait .
En 1 726,on voulut introduire l ’usage de fai re porter
la soutane aux philosophes,mais on revint au bout de quel
ques années ‘
a la premi ère coutume .Le nombre des pensionnaires
,d ’abord r éduit à quatorze
,
faute de pouvoir en loger davantage,augmenta rapidement
lorsque en 1 677, on eut construit un nouveau bâtiment , a.
LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE 293
de ne garder que 1 2 él èves sur 54 parce qu ’il était impossibled ’en garder davantage . Le s éminaire était reconstruit à :: lamort de Mgr de Laval
,le 9 mai
,1 708.
A la picote et aux incendies succéda la rougeole qui enl èvatrois écoliers
,l ’un en 1 71 1
,l ’autre en 1 71 4 et le derni er
,Jv ues
Barron,de Montr éal
,le 1 0 février
,1 71 5.
En 1 757,apr ès les vacances
,on est oblig é de renvoyer
tous les él èves faute de pouvoir les nourrir à. cause de la faminecausée par la guerre .
Le Séminaire ferme ses portes pendant six ans à partirdu si ège de Québec . Il recommence à prendre des él èves aucommencement d ’octobre
,1 765. En 1 775
,les él èves s ’en
rôlent pour repousser l ’invasion américaine commandée parMontgomery . En 1 8 1 2
,nouvelle invasion américaine ; les
écoliers forment une compagn ie qui n ’a pas vu le feu . En
1 822,le s ém inaire est agrandi .En 1 832
,épidem ie de chol éra . Les él èves restent dans
leurs foyers du 1 2 juin au 29 septembre.L ’écrivain rappelle en terminant son article que depuis
la fondation du S éminaire pr ès de 900 él èves y ont terminéun cours complet dont pr ès de la moiti é se sont vou és a l ’étateccl ésiastique ; parmi ces derni ers se trouvent les noms de1 1 évêques . Et si l ’on se rappelle que cet art ile était écriten 1 850
,il sut de suivre
,pendant le dernier demi si ècle
les annales de cette maison d ’éducation pour y trouver lesnoms des personnages les plus fameux de notre histoire na
t ionale,politique et religieuse .
Un endr oit in t éressant à vi siter dans le Petit—Séminaire,
c ’est une petite chapelle situ ée dans la partie la plus anciennede la maison . En voici une description que nous devons àl’
amabilit é de M . l ’abb é Adolphe Garneau,professeur de
dessin au Séminaire
CHAPELLE INTERIEURE
Cette chapelle existe dans la partie la plus ancienne duSéminaire ; elle est situ ée au premier étage et donne sur lecorridor vout é au centre du corps de logis vis—à—vis le perron depierre de la cour de r écr éation . D ’
apr ès la tradition les appartements de Monseigneur de Laval se trouvaient au rez—de
294 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
chauss ée, ( 1 ) au-dessous précisement de cette chambre . Le
local lui-même tr ès exigu,puisqu ’il n ’a qu ’une superficie
d ’environ 280 pieds soit 1 8 pieds de profondeur sur 1 6 delargeur
,
— nè contient que deux fenêtres . Cet éclairage uniquement lat éral (à droite ) fait perdre à la chapelle beaucoupde son apparence
,et tout en exagérant le relief laisse dans
l ’ombre certaine parties p acées en retraite .Tout le fond de l ’appartement est occup é par le r étable.
En se rapportant aux grav ures , on peut voir que le tombeaude l ’autel est en marbre noir et blanc . Cette pi èce
,absolu
ment ins ign ifiante au point de vue architectural a ét é install éeil y a bientôt 40 ans
,et même les vandales qui l ’ont placée
n ’ont pas craint d ’entai ller les bases des colonnes pour y en
claver les parements lat éraux de la table de l ’autel ils ontmême b 1 is é les sculptures du panneau central . L ’autel original (en bois) existait encore et il a ét é enfin remis en placecet hiver 1 908 . La restauration est maintenant presque complète.
Le r étable se divise en trois pa1 t ies ou panneaux sensiblement égaux . La partie centrale porte encadr ée une ancienne gravure toute pas s ée représentent les épousailles de laSainte Vierge . Le cadre partie int égrante du panneau a ét éfinement scu
'
pt é le travai l comme partout ailleurs dans cer étable est superbe . Détail original
,la vitre recouvrant la
gravure est en trois morceaux il semble qu ’il aurait ét é impossible de se procurer une pleine grandeur
,et cela explique
un peu pourquoi la gravure ainsi partiellement exposée àla poussi ère p énétrant par les fissures a bruni et est maintenant si fatigu ée . (2) Depuis que ceci a ét é écrit la vitre a étéremplac ée et la gravur e a subi un nettoyage qui permet dedistinguer les personnages .
Au—dessous du cadre prennent naissance deux guirlandesd
’olivier (feuilles en fleurs ) —Souvenir de Monseigneur Olivier
( 1 ) Le cintrage des voûtes au rez-de—chauss ée est t r ès i rr égul ierm êm e en certaines part ies la courbe est plus accen tuée d
’
un côt é que del’
autre . L’
on est port é à croi re que les maçons ne bât issaien t pas sur ci n
tres mobi les,m ai s b ien sur un ama s en terre battue la voûte term in ée , on
enlevait la terre . Ces murs ont quatre à cinq pieds d ’
épai sseur et son t fai tsen cai ll outt is ; le m ort ier es t tellemen t hom ogene et adhère s i bien aux
m oëllons que ceux—ci se bri sen t plutôt que de se dis joindre .
(2) Gravure en cuivre du tableau de Rubens , P.P. ( 1 577 Cette
gravure remarquable , probablemen t du XVIIIème s i ècle est—elle con tem
poraine du retable A-t-elle été placée dans ce cadre plus tard Celaest poss ible , car les marges sont en part ies coupées . On ne peut fai re toutefois que des con jectuœs . En bas de la gravure , au centre on l itRagot , sc. et se vend à Paris , chez Basset , rue S. Jacques , à Ste—Genevi ève .
”
LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE
ni les cannelures,ni les rudentures
,ni même la fine fleur cen
trale du chapiteau corinthien . Et tous les membres de labase le tore sup érieur
,les deux scoties
,le filet
,le tore in
f ér ieur et la plinthe .'
Au pi édestal remarquons le filet , letalon
,la goutti ère
,la gorge
,les deux astragales
,le filet , les
deux frises,tandi squ
’au bas nous retrouvons l ’astragle in
f ér ieur,la gueule renvers ée, le r églet , tore et plinthe .
L’
entablement,tr ès riche
,a demandé un travail énorme .
Voyez l ’architrave dont le listel est tout fouill é au ciseau ,la frise avec ses gracieux rinceaux , le fil et du larmier fin ementcisel é
,les denticules d élicats et les gracieux modillons su ivant
rigoureusement la règle de la proporti on,qui veut qu ’
à l ’entablement corinthien
,l ’un deux vienne touj ours tomber sur
le milieu de la colonne .Ne quittons pas l ’oratoire sans remarquer le placard à
gauche et le buff et,dont une partie seule est visible sur la
gravure . Les battants inf érieur s du buff et ont deux panneauxd ’une seule planche large environ 22 pouces .
Les panneaux du placard sont du vi eux style ici commedans le retable et le buff et
,les moulures ne sont pas aj out ées
,
mais font partie int égrante des montants et croisillons . Tousles assemblages sont faits à la chevi lle . Les charni ères quimaintiennent les vanteaux du placard sont remarquableselles sont formées de deux platines en cuivre maintenues pardes griffes int érieures et couvrant les vis qui fixent les côt ésdes charni ères au bois . Quoique le buffet ait ét é recouvertd ’une épaisse couche de peinture blanche
,cependant à l ’ex
amen,il ne semble pas de beaucoup post érieur au placard .
Tout le retable est sculpt é en c èdre ou du moins en thuya,sauf les armoires en noyer tendre, ainsi que le placard à. gauche .Ci-joint 0 0 pie des inscriptions plac ées sous les consoles
sor tenant les statues des deux panneaux symétriques
O MATER MAR IA SALVETO VIR JUSTEAB OR IG 1 NAL I D Av 1 nrcr THRONI
L ABE PRESERVATA HAERES,PATER JESU
,
CORBA TERGE NOSTRA . ET MARIAE SPONSE .
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 297
Hopita l Gé né ra l.
Fondé en 1 693 par Mgr de Saint Valier et confié auxSœurs Hospitali ères qui formèrent en 1 702 un corps s épar é decelui de l ’Hôtel-Dieu . Cet établissement est situ é sur les bordsde la rivi ère Saint—Charles et fut conc éd é
,terrain et bâtiments
,
par les R écollets , le 1 3septembre 1 692. D ’apr ès les termes deleur contrat les R écollets c édaient à Mgr de Saint Valier unevaste étendue de terrain
,leur chapelle et leur couvent de
Notre-Dame des Anges . Les religieuses hospitali ères enprirent possession le l er avr il 1 693et eurent d ès les commencements pr ès de quarante personnes sous leurs charges . C ’estun hospice des incurables . Deux ailes consid érables furentaj out ées à l ’établissement en 1 71 0— 1 71 1 . En 1 736
,les reli
gieuses d écident de recevoir les soldats retir és du servi ce etinvalides et de construire une aile qui leur serait sp écialementaffect ée . En 1 743
,nouvelle construction de 1 50 pieds à l ’ouest
de celle commencée en 1 736,puis les besoins de l ’institution
devenant pressants,on fait subir des alt érations au couvent
,
lui enl evant son caract ère d ’
ant iquit é qui en faisait la plusvieille institution r eligieuse de la Nouvelle-France . En 1 850
,
embellissement des bâtiments de l ’institution et neuf ans plustard on l ’augmente d ’une maison de sant é . Jusqu
’à l
’ouvrrture
de l ’asile de Beauport en 1 845,l’Hôpital
-Gén éral avait recueilliles ali énés .
L’Hôpital
—Général est une des institutions historiques lesplus int éressantes de la ville et du pays . Apr ès le si ège deQuébec
,en 1 759
,les bless és anglais y furent reçus avec le
mêm e empressement que les bless és français . Les soldats deArnold et Montgomery y reçurent les mêmes soins que s ’ilsavaient ét é dans un hôpital de Boston
,en 1 775. Arnold lui
même , bless é pendant l ’attaque contre Qu ébec y fut reçu ettrait é avec le plus grand soin .
Cette institution poss ède une toile,un Ecce Homo
que les connaisseurs attr ibuent à un maître,mais dont l ’auteur
n ’est pas connu . La maison poss ède en outre une foule dereliques histor iques de la plus grande valeur
,dont plusieurs
lui ont ét é données par Mme de Maintenon,épouse de Louis
XIV et par Mgr de Saint Valier .L
’
Hote l—D ieu du Pré c ieux Sang
C ’est , avec le couvent des Ursulines , le plus vieux monast ère du Canada . Situ é dans la rue du Pal ais
,près de la m e
St-Jean , et à l’angle de la rue Charlevoix . Fondé en 1 637 et
298 LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE
confi é aux Hospitaheres arriv ées à Québec le l er août 1 639,
la même année que les Ursulines . Construit en 1 654 et b éni ten 1 658 par M . deQueylus . Cette ins titution est af f ect ée ausoin des malades de toutes les classes . Pauvres comme richesy sont admis . Le service médical y est irr éprochable et estconfi é à un certain nombre de professeurs de l ’Un ivers it é Laval .
La chapelle du couvent qui a son entr ée sur la rue Charlevoix, est tr ès ancienne et contient plusieurs tablettes comm émorat ives tr ès int éressantes et de nombreuses toiles d ’unegrande valeur . Citons les principales
La Nativi t é,Stella .
La Vierge et l ’En fant,Noel Coypol .
Vision de Ste—Thér èse,Geul Monaght .
Saint—Bruno en méditation,Eustache LeSueur .
La descente de la Croix,copie par Plamondon .
Les Douze Apôtres,0 0 pie par Bai llargée , le vieux .
Le moine en pri ère,De Zurbaran .
La Crucifixion,Van Dyke .
Nuit de Noël,Stella (don de Mgr Dosquet .)
Mais les reliques les plus int éressantes conserv ées à l ’HôtelDieu sont peut— être le crâne du Père de Brebœuf et les ossementsdu Père Lallemant
,les deux martyrs j ésuites .
Les archives de l ’Hôtel-Dieu sont aussi tr ès int éressantes .Elles contiennent nombre de vieilles cartes et de vieux manuscrits portant les signatures des gouverneurs et des intendantsfrançais du Canada . Il serait trop long d ’en faire ici uneénumération compl ète .
Hot e l—D ieu du Sac ré —Cœur
Fondé en 1 873,grâce aux efforts de l ’archevêque de Québec
généreusement secondé par le Chevalier Falardeau qui estreconnu comme son fondateur temporel .
Le but de cette institution est enti erement charitable .L
’Hôtel—Dieu du Sacré—Cœur est prépos é au soin des enfantstrouvés et des vieillards infirmes .
De fondation relativement r écente elle ne poss ède pasautant de reliques histor iques que d ’autres institutions dontnous avons d éj à par l é . On y trouve cependant des statuesayant appartenu à l ’ancienne église des Jésuites sous le r égimefrançais et plusieurs autres articles d ’un int érêt hi storiqueconsid érable
,entre autres une toile ayant appartenu à la galerie
de Lord Metcalf,ancien gouverneur du Canada .
300 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
dirigent aussi l ’As ile de St-Michel Archange,a la Canard1 ere,
sur la route de Beauport . De plus,les Sœurs de la Charit é
ont encore charge de l ’As i le St-Antoine à St—Roch,et de l ’Asile
Ste-Brigite,sur la Grande All ée .
As i le Sr-Anto ine
Fondé le 28 octobre 1 897 et établi dans le superbe bâtimentdonné dans un but de cha: it é par le Cer cle Catholique deQuébec . Il est situ é sur la rue St —François a St—Roch et estdestiné aux viei llazds de la paroisse de St —R och . Il fut augmenté d ’une aile en 1 90 1 .
As i le Ste-Br ig ite
Institution d estinée aux catholiques irlandais et s ’occupedes orphelins et des vieillards . On peut faire remonter sa
fondation à 1 856 . C ’est cette année— l à qu ’une premi ère colleete faite parmi les officiers de la garnison ( 1 7 livres) futremise au R év. Père Nelligan pour le secours des pauvres .La propr i ét é sur laquelle se trouve la bâtisse actuelle , sur laGrande All ée date de 1 858 . L ’institution est sous la surveillance de cinq syndics dont quatre laïques et un chapelain .
Le Pa la i s Ep i s copa l
Situ é au sommet de la Côte de la Montagne là. où la .ué
s etend en éventail ent e la m e Du Fo-t,la rue conduisant au
vieux fo- t de Champlain et celle qui conduit au vieux ChateauSt-Lou 1 s . On en posa la pierr e angulaire le 25 août 1 844 .
C ’est une imposante construction en pier r e de taille qui a coût éet qui fut en grande partie érigée par Mgr Tu geon .
Comme son nom l ’indique,c ’est la r ésidence de l ’archevêque ,
Sa G andeur Mgr Bégin,de Sa Grandeur Mgr Roy, évêque
ar xi liaire,de Mgr Ma ois , G and Vicaire , et des messieur s
p êt es attachés à l ’adm in i st.ation du dioc èse . Le palais épiscopal contient une chapelle
,une sac istle
,et une salle du tr ône ,
à part les appa*
tem ents part i culie s de ceux qui y hab i tent .On y trouve plusieurs toiles remaq ables , dont les port aits desévêques de Québec
,des Papes Pie VI
,G1 égoi e XVI , Léon
XIII et Pie X,de feu Son Eminence le Ca dinal Tascher eau ,
etc .,ainsi que de tr ès pr écieuses ar chives . Parm i les souvenir s
ayant appartenu a des personnages éminents,on y conserve
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 30 1
deux croix pectorales ayant appartenu à Mgr de Laval,une
montre en or de Mgr Plessis , une autre de Mgr Siguay , une croixpectorale en or
,souveni r de Son Eminence le cardinal Franchi .
L E PAL AIS EP ISCOPAL .
L’
Ec o le Norma le Lava l
L’Ecole Normale Laval fut inaugur ée le 1 2mai 1 857
,dans
le Vieux Chateau ou Chateau Haldimand Le si ège dugouvernement à.cette époque n
’était pas stable . Le parlementsi égeait à certaines époques à Kingston ou à Toronto et ad ’autres à Montr éal ou à Québec . De 1 860 a 1 865 on se servitde l ’Ecole Normale pour les Départements Publics de l ’adm in i strat ion . Les classes se tenaient alors dans la maison aujourd
’hui occup ée par les Jésuites sur la rue Dauphine . L
’Ecole
Normale retourna dans le Vieux Chateau en 1 866 et y restajusqu ’en 1 892
,alors que la vieille bâtisse fut achet ée par la
Compagnie du Chemin de fer Canadien du Pacifique et démoliepour faire place au Chateau Frontenac . L
’Ecole Normale fut
alors transport ée au pensionnat de l ’Univers it é Laval où elleresta jusqu ’en 1 900 . Elle occupe maintenant la propri ét éachet ée de M . J. Théodore Ross
,sur le chemin de Ste-Foye
,
tout pr ès et en dehors des limites de la ville . Le gouvernementa payé pour cette propri ét é et y a aj out é depuis uneaile où se trouve une chapelle‘ et un corps de logis à l ’usage desé èves .
302 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Le Club de la Garn i s on
Situ é sur la rue St-Louis,tout pr ès des murs et en face de
l’Esplanade. Il occupa d ’abord le vieil Office du Géniedont on peut voir encore une gravure dat ée de 1 820 . Il futfondé en 1 879 et eut pour premier pr ésident le LieutenantColonel D uchesnay, D .A .G. Il fut à son origine destiné auxofficiers seulement
,mais on a fini par y admettre les civils . Il
poss ède des archives tr ès int éressantes concernant surtout lespremiers j ours de la domination anglaise au Canada .
L’
Hote l de Vi l le
L ’hôtel de ville actuel se trouve en face de la Cath édr ale,
sur le terrain occup é autrefois par le vieux coll ège des Jésuites .Ce coll ège servit de casernes pendant longt emps et on l ’appelaitalors les casernes des Jésuites .” Dans le mois de novembre1 889
,une partie du terrain sur lequel il se trouvait fut achet é
pour y ér iger des édifices publics,le vieil hôtel de ville se
trouvant alor s sur la rue St —Louis . La pierre angulaire dunouvel édifice fut posée le 1 3 août 1 895 et l ’inauguration eutlieu le 1 9 septembre de l ’année suivante sous la pr ésidence dumaire Parent . Cet édifice a coût é
La Pr is on
La plus vi eille prison de Qu ébec s elevait sur le terrainappar tenant à. la famille de Bécancour
,pr ès du Fort St-Louis
,
à. l ’angle des rues St-Louis et des Carr i ères,à peu pr ès en face
de l ’entr ée pr incipale de la cour du Chateau Frontenac . Pendantles derni ères années de la domination française la pr ison étaitsitu ée en arri ère du Palais de l ’intendant
,pr ès de la rivi ère
St —Charles,à un endroit appel é communément la cour à
charbon En 1 784 ce furent les chambres inoccupées ducouvent des R écollets qui servirent de prison . Lorsque lecouvent eut ét é d étruit par le feu
,les prisonn iers furent gard és
dans les bâtisses voisines des casernes militaires pr ès de laCôte du Palais . En 1 8 1 0
,on commença la construction d ’une
prison sur le t errain situ é entre les rues St-Stanislas,Dauphine
et Ste-Angèle cette pr ison fut inaugurée en 1 8 1 4 et employéejusqu ’en 1 867. C ’est la bâtisse actuelle du Coll ège Morr in .
On n ’a r emplac é que la porte principale qui se trouve sur la
304 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
le palais de justice et la cath édrale Anglicane avait ét é donnépar Louis XIV aux R écollets en 1 68 1
,pour qu ’ils y construi
s i ssent un hospice . Les missionnaires y établirent une branchede leur monast ère de Notre—Dame des Anges . Ce couvent setrouvait sur la partie nord—est du terrain actuellement occupépar l ’église anglicane .
Le Pa la i s de Jus t ice
Situ é à l ’angle de la rue St —Louis et de la Place d ’
Armes .
Fut inaugur é le 21 décembre 1 887. Le terrain sur lequel il estélevé couvre une superficie de pieds . Le vi eux palaisde justice
,situ é sur la rue St—Louis fut d étruit par le feu le l er
février 1 873. Dans l ’intervalle les cours si égèrent dans le vieilhôpital militaire
,en arri ère de la rue St—Louis et cela pendant
1 4 ans . Le palais de justice actuel,de style renaissance et
rappelant les vi eux châteaux de l ’époque de François Ier,a
coût é C ’est sans contredit un des plus beaux édificesde Québec .Le Couvent des Rec o l let s
La place de la S énéchauss ée,où s ’él èvent maintenant le
Palais de Justice et l ’église anglicane,fut donnée par le roi
Louis XIV aux RR . PP . R écollets,en 1 68 1 .
Les R écollets de Notre—Dame-des-Anges,qui avaient ains i
reçu de Louis XIV,en 1 68 1
,le don de l ’emplacement occup é
antérieurement par la S énéchaussée,en face du fort Saint
Louis,y établirent une succursale de leur monast ère que l ’on
appela Le Couvent du Château . Plus tard,en 1 693
,
Monseigneur de Saint—Vallier ayant obtenu de l ’Hôtel-Dieu duPrécieux-Sang un essaim de religieuses pour fonder un hôpitalg énéral aNotre-Dame—des-Anges
,les R écollets c édèrent leur
établissement des bords de la rivi ère Saint—Charles,et le
Couvent du Château quoique insuffisant,devint leur uni que
établissement à Québec . C ’est à cette époque que fut construite la belle église des R écollets ( 1 ) que Charlevoix disaitêtre digne de Versailles et qui couvr ait un espace dontles bornes est et ouest seraient auj ourd ’hui le centre du hautde la Place d ’
Armes et l ’extr émit é sud— est du terrain occup épar le Palais de Justice . Elle était ornée de vitraux colori és
( 1 ) L a const ruct ion en fut comm en cée le 1 4 jui llet 1 693.
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 305
’
et de beaux tableaux dus au pinceau du c él èbre Fr ère Luc .La flèche de son clocher
,que respect èrent les obus en 1 759
,
était d ’une puret é de lignes admirable .Le premier couvent ou Couvent du Château s ’élevait
à peu de distance sur la partie nord-est du terrain occupéauj ourd ’hui par l eglise anglicane . Le deuxi ème couvent
,
construit apr ès l ’année 1 700,était contigu à l ’église
,et formait
avec celle-ci un carr é parfait . Au centre se trouvait la cour,qui était spacieuse et de forme r éguli ère .
Le clocher de l ’église des R écollets s ’élevait au point pr écisoù se trouve auj ourd ’hui l ’entr ée principale du Palais de Justice .Tout le corps de l ’édifice (l ’église) était sur la Place d ’
Armes .
Le couvent,qui lui était contigu
, (le deuxi ème couvent ) , étaitconstruit en grande partie sur la Place d ’
Armes,en moindre
partie sur le terrain du Palais de Justice,et en moindre partie
encore sur le terrain de l ’église anglicane .L ’église et le couvent des R écollets furent d étruits par un
incendie le 6 septembre 1 796 .
Le gouvernement anglais s etait d é jà empar é d ’une partiedu couvent des R écollets
,et l ’on s ’était même servi de l ’église
de ces religieux pour le culte anglican,a certains j ours déter
minés . D ’autre part,le gouvernement avait pris presque com
plètement possession du coll ège de Québec ou coll ège desJésuites
,et l ’on y admini strait la jurt ice depuis 1 763.
Le dernier Commissaire de l ’Ordre des F ranciscains R écollets reconnu par le gouvernement anglais
, (le R . P . Félix deBercy) étant décéd é à Québec , le 1 8 mai 1 800 , les biens del’
Ordre tomb èrent pratiquement en d ésh érence,et le gouverne
ment s ’empara d ’une partie du terrain du couvent incendi é le6 septembre 1 796 pour y ériger les Salles d ’
Audience etOffices du district de Québec conf ormément à la l égislationci-dessus indiqu ée . Cette construction
,à laquelle on donna
plus tard le nom de Palais de Justice,fut terminée en 1 804.
Des additions successives furent faites au lpan primitif,et
l ’édifice finit par coûter Il était en parfait ordrelorsqu ’il fut détruit par un incendie
,le 1 er février 1 873.
L’
Eco le des Art s et Mé t ie rs à Qué bec
L ecole des arts et métiers,à Québec
,a ét é construite sur
un terrain donné au cons eil des arts et manufactures par l ’honorable James-Gibb Ross
,s énateur
,par contrat pass é devant
Mtre J -A. Charlebois,notaire
,le 25 août 1 884 .
306 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Le ministre des Travaux Publics,
agissant comme fidéicommissaire pour le conseil des arts et manufactures ”
,reçut
cette donation et confia l ’érection de l ’école à M . F erdinand deVarennes
,constructeur
,par contrat portant la date du 25 sep
tembre 1 884 . (Charlebois , notaire) . Les plans et devi s del ’édifi ce avaient ét é pr épar és par M . J.
-F . Peachy,architecte .
L’
Hc te l du Gouve rnement ( 1 )
Le terrain sur lequel a ét é construit l ’Hôtel du Gouvernement
,à.Québec
,faisait autrefois par tie du fief Saint-F rançois
,
dont la cr éation en terre noble et la premi ère concession , parla Compagnie de la Nouvelle-France au sieur Jean Bourdon
,
remonte au 1 0 mars de l ’année 1 646 , sous le gouvernement deM . de Montmagny .
Ce terrain est situ é immédiatement au nord-ouest de laGrande-All ée
,a proximit é de la porte Saint-Louis
,dans la
partie de la ville appel ée Quartier Montcalm (extra mures) ,et porte le numéro 4436 du cadastre officiel de ce quartier .
Sa superficie est de pieds,mesure anglaise . Il fut
acheté du gouvernement du Canada,par la province de Québec
,
le 1 4 août 1 876,sous le gouvernement de Boucherville
,au prix
de spécialement pour y ériger l ’ édifice de la Législatureet des D épartements publics . On l ’appelait alors Cr i cket F ield.
Ce terrain était autrefois borné au nord-est par la rue
Saint—Eustache . La portion de cette rue qui touchait ainsi auterrain de l ’Hôtel du Gouvernement a ét é c édée
,il y a quelques
années,par la corporation de la cit é de Québec
,au gouverne
ment de la Pr ovince,à certaines conditions .
Elle forme auj ourd ’hui l ’al l ée dite de la F ontaine,et court
parall èlement à la façade du Palais Législatif,entre la Grande
All ée et la rue Saitnte-Julie . Elle touche à la base même dela fontaine d édi ée aux races abor igènes de l ’Am ér ique du Nord ,qui fait face a l ’entr ée d ’honneur du Palais .
La partie de l ’édifice qui donne sur l ’avenue Dufferin (corpsprincipal ) est occupé par le Cons eil L égislatif et l ’AssembléeeLégislative on la d ésigne sous le nom spécial de PalaisLégislatif .”
Les trois autres côt és de l ’édifice sont appel és Départements Publics ils font face
,respectivement
,à la Grande
Al l ée,à la rue Saint-August in
,et à la rue Sainte-Julie . On y
a install é les bureaux du Li eutenant-Gouverneur,du Conseil
Notes de M . Ernest Gagnon .
308 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Le coût total de l ’Hôtel du Gouvernement,c ’est—a-dire de
l ’édifice du Palais Législatif et des Départements publics,y
compris les sommes payées pour la construction de la fontaineet de la clôture en grani t , pour l
’acquisition des terrains del ’ancien Cr i cket—F i eld
,de l ’ancien pat inoir et de partie de la rue
Saint-Eustache pour le nivellement et l ’embellissement de cesterrains
,ains i que le prix des statues de la façade principal e et
de la fontaine,etc .
,etc .
,
— est de (un million sixcent soixante et neuf mille deux ccnt quarante-neuf piastres etseize cent ins ) .
Deux accidents ont un peu augmenté le coût de l ’édificel o
,l ’incendie de l ’ancien Parlement
,voisin de l ’archevêch é ,
arrivé le 1 9 avr il 1 883,qui occasionna les frais d ’une installation
temporai re dens l ’édifice en voie de construction pour. la sessionsuivante de la Législature 20
,la double explosion de dynamite
caus ée par des mains criminelles,le 1 1 octobre 1 884
,et qui
nécessita certains travaux de reconstruction .
Les travaux de construction du Palais Législatif exécut ésen vertu du contrat du 9 février 1 883
,furent terminés dans
l ’automne de 1 886,sous le mini st ère Ross .
Les travaux de maçonn erie des trois côt és de l ’édificedonnant sur les rues Grande All ée
,Saint-August in et Sainte
Julie,furent commencés dès l ’ann ée 1 877 par les entrepreneurs
Piton et Cimon . Ils furent interrompus à l ’automne , puisrepris au printemps de 1 878 . Le mill ésime 1 878 que l ’onvoit sur l ’avant— corps central de la façade de la Grande Al l ée
,
indique l ’année même où l ’on a plac é la pierre portant cechiffre et non l ’année du commencement des travaux .
Le style de l ’Hôtel du Gouvernement peut être appel éstyle renaissance française du XVII si ècle . Car la renaissancedes formes classiques s ’est manifest ée de diverses mani ères
,en
F rance,en Al lemagne
,en Italie
,etc . puis
,ces manifestations
se sont successivement modifi ées et ont formé en quelque sort edes époques secondaires dans l ’époque générale .
La façade principale du vaste carr é de l ’Hôtel du Gouvernement est remarquable par les belles proport ions de sa tourcentrale
,dédi ée à Jacques Cartier
,par la puret é de lignes des
avant-corps accol és a cette tour,dédi és
,
— l ’un a Champlain,
l ’autre à Maisonneuve,
— par l ’élégance des pavillons des angleset par tout l ’ens embîe de l ’ornementat ion .
Au rez-de— chauss ée du campanile , ou tour centrale , setrouve l ’entr ée d ’honneur par laquelle le Lieutenant-Gouver
LA REVUE FRANCO-AM ÉR ICAINE 309
neur se rend au Conseil Législatif pour y rencontrer les membresdes deux Chambr es de la Législature
,dans les grandes cér é
moni es officielles du commencement et de la fin de chaquesess ion .
Les n’ohes pratiqu ées dans a maçonner ie de la façade ducampanile et des avant-corps de centre
,devr ont contenir les
statues de Jacques Cartier,le d écouvr eur du Canada ; de
Champlain,le fondateur de Québec de Maisonneuve
,le fon
dateur de Montr éal de Laviolette,e fondateur des Trois
R ivi ères de Pie - 1 e Boucher,gouverneur des Trois-R ivi ères
,
type accompl -de l ’ancien seigneur canadien puis celles dupère de Br ébœuf
,le grand j ésuite mar tyr
,du p èr e r écollet
Nicolas Viel,noyé pa r les Sauvages dans les rapides appel és
depuis Sault-au-R écollet de Mgr de Montmor ency—Laval,le
pr emier évêque — de Qu ébec de M . Olier,le fondateur de la
Compagnie de Saint-Sulpice et de la Compagnie de Notre-Dam ede Mont éa enfin celles de F -ontenac
,de Lévis
,de Wolfe
,de
Montcalm,et de deux cél ébr it és du dix—neuvi ème si ècle Lord
Elgin et le colonel Cha * les-Michel de Salabe 1 y.
Les armes de chacun des personnages dont on vient de lireles noms
,
— celles de leur famille ou celle de leur ville ou de leurinstitut— sont sculpt ées dans la pierre au—dessus de chaqueniche . La disposition de ces niches et de ces statues indiqueune perception tr ès nette des grandes lignes de l ’histoire duCanada
Le fronton de l ’avant-corps d édi é à. Champlain est surmont é d ’un beau groupe en bronze de M . Philippe HébertLa Poés ie et l
’Hi stoi re . un autre groupe en bronze du même
auteur La Religi on et la Patr i e,couronne le fronton de l ’avant
corps d édi é aMaisonneuve .
En face de l ’entr ée d ’honneur,au pied du campanile
,et
établie dans la déclivi t é du terrain,se trouve la fontaine monu
mentale d édi ée aux races abor ig ènes du Canada dont il a ét épa l é plus haut . Son portique
,qui est d ’ordre toscan
,est orné
,
au sommet,d ’un groupe en bronze repr ésentant une famille
indienne . Tout au bas,au fond de la pi èce d ’eau formée par
une vasque quas i elliptique de quarante-cinq pieds de longueur ,sur vingt-huit de largeur
,un autre bronze
,un pêcheur à la
n igogue ou harponneur indien,dardant un poisson au milieu
d ’une cascade,compl ète l ’ornementat ion de ce gracieux hors
d ’œuvre .
Voici la liste des statues exécutées par M . Philippe Hébertqui sont d éj à placées au Palais Législatif
31 0 LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE
Campanile — Wolfe,Montcalm .
Avant-corps Champlain — Frontenac,Elgin
,La Poés ie et
Avant-corps Maisonneuve — L évi s,Salaberry
,La Religion
et la Patri e
Fontaine — Une famille indienne .
— Un harponneur indien .
Les décorations de l ’int ér ieur sont tr ès élaborées et dumeilleur goût . Il serait inutile de vouloir ‘
en donner ici unedescription détaill ée . Nous n ’en citons que quelques-unes
En pénétrant dans le premier vestibule de l ’entr ée d ’honneur du Palais Législatif
,on aperçoit
,à dr oite
,sculpt é dans le
parement en gr ès de l’Ohio dont les murs de ce vestibule sont
revêtus,l’écusson du marquis de Lorne
,avec la barque nor
mande de la maison d ’Arge et la devise Ne obli vi scari s .
Au-dessous,les dates 1 878- 1 883 indiquent la dur ée du terme
d ’office du marquis de Lorne comme gouverneur-général duCanada .
A gauche sont sculpt ées les armes du marquis de Lansdowne
,ex—gouverneur-général
,avec la devise Vi r tute non
verbi s et les dates 1 883- 1 888 .
Les lambris d ’appui en noyer noir des vestibules du rezde-chauss ée
,du premier et du deuxi ème étage du Palais
Législatif,sont ornés d ’
arabesques , d’armoir ies et d ’inscriptions
,
cisel ées et dor ées,d ’un goût et d ’une science extrêmement
remarquables . C ’est l ’histoire écrite en langue héraldique . Ony lit
,au rez-de— chauss ée
,les armes et les noms de personnages
appartenant à la première pér iode des annales historiques del’
Am ér ique du Nord et du Canada Vérazzan i,Sébastien Cabot
,
De la Roche,De Caen
,Roberval
,Pontgravé , Poutr incourt ,
De Monts,L éry,
De Chaste,Pontchartrain
,Châteaufort
,Guer
cheville,Lauzon
,Courcelles
,Hocquart , Denonville , Begon ,
Duquesne,la duchesse d ’
Aigui llon ,Madame de la Peltr ie
,
Mar ie Guyart de l’
Incarnat ion .
Dans un car touche,au pied du grand escalier du vestibule
,
on voit,trac és en or
,un soleil éclairant le m onde
,avec la devise :
Nec plur i bus impar et l’inscr iption Louis XIV .
”En face
,
sur un autre cartouche,sont gravés les armes et le nom de
Colbert .A l ’étage supér ieur
,et dans les situations identiques
,sont
les armoiries de George III d ’
Angleterre et de son ministreWilliam Pitt .
Le visiteur a gravi un escalier et l ’histoire a marché d ’unsi ècle .
31 2 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
Henry Perceval,percepteur des douanes à Québec , membre du
Conseil Législatif et du Conseil Exécutif . Celui— ci avait ‘
pour
parent et protecteur l ’honorable Spencer Perceval,chancelier
de l ’Echiquier de la Grande—Bretagne , et c’est en l ’honneur de
ce derni er personnage , qui ne vint probablement j amais en cepays
,que le nom de Spencer-Wood fut substitu é à celui de
Powell—Place .De 1 808 à. 1 8 1 1
,pendant la “restauration du château Saint
Louis,le gouverneur sir James-Henry Craig
,habita le château
de Powell—Place qui devait devenir plus tard la r ésidenceofficielle de lord Elgin et de sir Edmund Head .
M . Henry Atkinson acheta Spencer—Wood en 1 833,et i l
en vendit la plus grande partie au gouvernement en 1 852 et en1 854
,au prix de 354 1 , Le nom de Spencer—Wood resta
attaché à la portion est de la propri ét é (celle qu’avait achet ée
le gouvernement et où se trouvait le chateau ) ; la portionouest se nomme auj ourd ’hui Spencer—Grange : Monsieur J.
—M.
LeMoine,alli é de la famille de M . Atkinson
,en est le pro
pr i étaire.
Apr ès l ’incendie du Parlement,à Montr éal
,en 1 849
,l e
gouvernement du Canada songea à faire construire un édificesur le terrain du Jardin du Fort
,à Québec
,pour y installer les
minist ères publics,et à. faire ériger une r ésidence pour le gou
verneur—général sur la terrasse Durham,un peu au nord-est du
château Frontenac actuel mais ce proj et fut abandonné,et
lorsque la capitale du Canada fut transfér ée à.Québec , en 1 852,le gouvernement fit du château de Spencer—Wood la r ésidenceofficielle du gouverneur-général du Canada
,qui était alors lord
Elgin .
Le successeur de lord Elgin,sir Edmund Head
,habita
aussi l ’ancien château de Spencer—Wood. Ce vaste édifice futdétruit par un incendie le 28 févr ier 1 860
,j our de l ’ouverture
du Parlement . C ’était un bâtiment d ’une tr ès belle apparence,
mais qui était devenu passablement délabr éLe château actuel a ét é construit au cours des années 1 862
et 1 863,et il fut inaugur é par lord Monck
,gouverneur-général
du Canada . Sous le r égime de la Confédération,c ’est—à—dire
depuis 1 867,le château a été la r ésidence officielle de tous nos
lieutenants—gouverneur .
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 31 3
La C itade l le et les Fo rt i f i cat ions
Québec a ét é appel é le Gibr altar de l ’Am ér ique àcause de son sit e et des fortifications qu ’il poss ède . Aussile tour iste ti ent— il touj our s à visiter sa citadelle et ses princip ales fortifications .l C ’est de la Terrasse Frontenac que l ’on a la meilleur e vue
def la citadelle et des fortifications imposantes qui l’entourent
PORTE D E L A CITADELLEavec ses 40 acres de champ de parade
,ses bastions
,ses foss és
,
le tout situ é sur le point le plus élevé du Cap Diamant et dominant la rade . On entre dans la forteresse par ce qu ’on appellela Côte de la Citadelle à l ’est de la porte St . Louis . sur la rue
31 4 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
St—Louis , et par la Porte de Chaînes qui donne acc ès dans lesfoss és
,puis par la Porte Dalhousie qui introduit les touristes
au cœur même de la citadelle . Là,un des soldats du corps
de garde se met obligeamment a la disposition des visiteurs .Un pour boire n ’est pas rigueur
,mais il est de tr ès bon ton .
Apr ès avoir traver s é le champ de parade et pass é devantle quartier des officiers puis celui des soldats
,on arr ive sur le
Bastion du Roi d ’où l ’on a un point de vue qui est cit é commel ’un des plus beaux du monde sans excepter Naples . Lar ésidence du Gouve neur Génér al
,le quar tier des officiers
,
l ’ar senal,les écu ies
,les bâtiments
,le Musée militair e
,sont
autant de suj ets d ’att action qu ’
i l importe de ne pas ignor er .Le Bastion du Roi est a plus de 300 pieds au— dessus du
niveau du St —‘Laur ent . Les fo- t ificat ion s du Cap Diamant
furent 1 econ stru ites en 1 823pa: les Anglais et coût è ent environ
Au milieu du champ de parade est conservé un petit canonen cuivre qui fut pris aux américains a la batai lle de BunkerHill . Et on raconte de nombr euses anecdotes sur les r éflexionséchangées entr e soldats de la garnison et tour istes américainsau suj et de ce souven ir historique int éressant de diversesmani ères les citoyens des deux pays . On dit même que dej eunes américains tent èrent un j our d ’enlever cette relique etfurent si pr ès de r éussir que depuis on la survei lle avec plusd ’attention que j ama
'
s .
Glo r ieux Souven i rs de France
Québec poss ède deux fameuses reliques qui sont à peineremarquées de la maj orit é des touristes ce sont deux canonsrusses exposés sur la Terrasse Frontenac et plac és un de chaquecôt é d e l ’estrade des musiciens . Ces deux canons fur ent prisà la tour de Malakof
,que les Français emport èrent d ’assaut le
8 septembre 1 855,pendant la guerre de Crimée , au siège de
Sébastopol . Français et Anglais étaient alli és dans cette guerreet les premiers donnèrent à leur s amis d ’alors ces deux magnifiques pi èces d
’artillerie qui furent envoy ées au Canada commemarque de l ’entente cordiale qui existait entre les deuxnat ons . Cette entente vient d etr e ressuscit ée apr ès quelquesannées d ’une froideur dont les Français eurent à souffr ir sur touten 1 870 . On reconnaît l ’origine des canons dont nous venonsde parler à l ’aigle impérial russe qui orne le dessus de la pi èce .
31 6 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
de Montréal et celui de Qu ébec toutefois le comit écroit encore rester au—dessous de la vérit é en portant àle n ombre total des personnes qui Ont quitt é le Canada pendant les cinq derni ères années .
On peut distinguer huit classes d ’
én rigrans .
Premi ère classe .— Ouwiers de Québec et de Montréalformant les deux tiers de l ’émigration . Cause d
’
emigration .
Etat précaire du commerce et de l ’indust * ie en Canada . Marrque de manufactures et de travaux publics . Haut prix desgages aux Etats Unis . Sort à l ’étranger . Ils tr availlent auxcanaux et chemins de fer
,dans les manufactures ou dans les
chantiers . Leurs salaires sont élevés , mais les dépenses sontfortes . Quelques-uns parviennent à s ’établir confortablement .
Deuxi ème classe . Ouvriers de nos campagnes . Cause
d emigrati on . Manque d ’ouvrage . Les cultivateurs étant ordinairement adroits exécutent eux—mêmes ce qu ’ils demanderaient à l ’ouvrier manque de manufactures et de travauxpublics . Sor t a l
’
étranger . Le même que la pr écédedte
ils ont pourtant moins de chances de succ ès .Troisi ème classe .— Rai lsmen . Qui ne trouvent plus d ’em
ploi dans les chantiers de l ’Ottawa . Sor t à l’étranger . Leplus d éplorable ils y sont employés aux ouvrages les plusvils on les y considèrent par leur mauvaise conduite commele r ébut de la soci ét é .
Quatri ème c lasse .— Fils de bonne famille de cultivateurs .Cau£se d
’ém igrati on . Difficult é de se pr ocurer des terres à
cause de leur haut pzix. R efus des seigneurs de concéder .Exigence des grands propr i étaires . Manque de voies et decommunications faciles . Défaut d ’instruction et cr édul it échez les j eunes gens . Contagion de l ’exemple . Impr évoyancedes parents qri i ne songent pas à acheter des terr es pour leursenfants mais mo: cellent entre eux la ferme qu ’ils leur laissent .
Cinqureme classe . Familles de pauvres cultivateurs desseigneuries . Cause d
’
em igration . Dettes caus ées souvent parle luxe . Mauvaises r écoltes . Distance du ma r ché et man
que de chemin et de navigation par la vapeur . Taux élevésdes rentes dans les nouvelles concessions . Sor t à l ’étranger .
Ils travaillent chez les cultivateur s américains ou dans lesmanufactures . Quand ils ont vendu leur s terres à un prixassez élevé ils gagnent les Etats de l ’Ouest et y prospèrentassez souvent .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 31 7
Sixi ème classe .— Défr i cheur s des Townships . Cause d’
é
m igration . Diffi cult és insurmontables r ésultants du manquede voies de communication
,ou de leur mauvais état . Sor t
à l ’étranger . Le même que la pr éc édente.Septi ème classe . Habitants à leur aise qui vendent
leurs terres et par tent pour l ’Ouest . Cause d’em igrati on .
Mauvaises r écoltes . D éfaut d ’instruction qui s ’oppose àl ’amélioration de l ’agr i culture . Manque de voies de commu
n i cation,de centres qui serviraient de mar ch é . Propagande
des émigr és ver s l ’Ouest . Inqui étude caus ée par l ’instabilit édes institutions municipales . Déclamations des demi-savantset éteignoir s
,fond ées sur l ’horreur des taxes . Sor t à l ’étranger .
Ils prospèrent généralement . Ils succombent souvent auxmaladies end émiques ou contractent avant de s
’
acclimater
des infirm it és pour la vie .L
’
ém igration de cette classe , le nerf et la r ichesse d ’unpays
,n ’a pris de l ’extension que depuis deux ou trois ans .
Huiti ème classe .— Jeunes gens instruits appar tenant à.des familles pauvres . Cause d
’em igrati on . Petit nombr e
de carr i ères ouverte à la j eunesse instruite ni armée,ni
marine . Encombrement des professions lib érales . Injustepr éférence accord ée aux j eunes gen s d ’une origine sur ceuxde l ’autre . Etat pr écaire du commerce et de l ’industrie quiempêchent les j eunes gens de s ’y livr er . Pr éjugés sociauxqui rabaissent ces deux carr i ères . Instruction impropre ouinsuf fisante . Sort l
’étranger . Bon nombre de j eunes cana
diens ont r éussi aux Etats-Unis dans le commer ce ou les professions lib érales
,quelques—uns se sont distingu és dans l ’armée
américaine . Beaucoup se livrent à des exc ès d éshonorants .Cette classe d ’
ém igrants se dirige ordinairement vers NewYork et la Houvelle Or l éans où plusieurs p érissent par suitedu climat et de fi èvre .
Pour arrêter cette émigration devenue une vraie calanrit épour le pays
,le comit é propose divers moyens . Le gouver
nement a mis en œuvre une des mesures les plus efficaces enencourageant la colonisation par la r éduction du prix desterres à des termes faciles et R imouski
,les Townships de
l ’est,le Saguenay et l
’
Outaouais s ’offrent au défricheur,le
gouvernement s ’occupe d ’y établir des centres judiciaires etl’a d éj à fait au Saguenay . Mais c ’est en vain qu ’on procureraà la population qui s ’y porte tous ces avantages
,si on ne la
met pas , par des voies et des communications en rapport avecle reste de la province . Il serait urgent de tern riner celles
31 8 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
qui sont commencées et d ’améliorer celles qui existent . Onsent tous les j ours les avantages d ’un chemin de Métis à Mataneet des Trois Pistoles au Tém i scouata . Dans les comtés deDorchester et de l ’Islet
,à Kamouraska
,à R imouski et dans
d ’autres endroits de la province,de superbes et fertiles terri
toires seraient ouverts à l’agriculture par de nouveaux
chemins dont les frais seraient compensés par la vente des .
terres . D ’ailleurs les déboursements forts l égers seraientnécessaires
,les colons travailleraient eux—mêmes pour payer
leurs terres en tout ou en part ie .Les belles terres du Sag uenay ont attir é un nombre
consid érable de défricheurs . Il serait à désirer que le gouvernement étendit à deux ans encore le privil ège
,accord é
à ceux qui s’y établiraient jusqu ’au 1 er mai 1 850
,de ne payer
que 1 sheling de l ’acre .Il serait nécessaire de rallier le Saguenay et les paroisse
des comtés en bas de Québec à cette ville par la navigationà la vapeur .
L’
Outaouai s offre également une grande étendue de terrains excellents
,et les colons qui s ’y établissent ont l ’avantage
de trouver dans les chantiers un débit avantageux de leursproduits . On ne peut tr0 p louer le z èle des Père Oblats quiont engagé beaucoup de gens des chantiers à se fixer sur desterres dans les comtés {de l
’Ottawa . Ici
,comme ailleurs
,le
besoin de voies de communication se fait sentir . On avaitcommencé un chemin dans la direction du Grand Calumeten le poussant au—delà
,j usqu ’aux Iles des Allumettes
,on
ouvrirait aux défricheurs 200 milles du sol le plus r ichedu pays .Les townships de l ’est ont occupé l ’attention du gouver
nement pendant les derni ères vacances . Plusieurs nouveauxétablissements y ont ét é faits . Ici encore on demande deschemins . Il serait très important d ’en ouvrir un de Gentillyau township de Blandford
,et un autre qui uni rait les rivi ères
St—F rançoi s et Yamaska . Telles sont les mesures les plusurgentes pour encourager la colon i sation et arrêter l ’ém igration à l ’étranger . Parmi les moyens morns directs , on pourrait citer l ’ouverture d ’un chemi n de Québec à un point quelconque des nouveaux établissements du Saguenay et l ’exécution du chemin de fer de Québec à Halifax
,un obstacle au
progr ès des établissements r écents,est le mauvais état des
chemins qui ont coût é si ‘ cher au gouvernement et qui vontencore exiger de nouvelles dépenses . Il serait de l ’avantage
Chronique artistique
Le conce rt de Be rt he Roy à Qué bec .
C ’est avec des bravos enthousiastes,des applaudi ssem «—nts
et des gerbes de fleurs que Québec a accueilli Berthe Royl ’autre soir
,dans la j olie salle de l ’Auditor ium qui
,durant
tout l ’hiver,n
’avait vu que les danses grotesques des clowns ,les pantomimes et les gr imaces de chanteuses du Bowery etles farces d émesur ément niaises d ’
amuseurs de bas étages .La condition où se t ouve le théâtr e
,en cette vieille ville fran
çai se qui s’est touj ours laiss ée appeler l ’Athènes du Canada
,
n ’a pourtant pas d étruit tout à. fait le sens du bon et dubeau
,si on en juge par l ’auditoire nombreux qui emplissait
l’Auditor ium le 4 juin .
La petite fille—prodige qu ’était Berthe Roy,il y a huit
ou dix ans,est devenue une gracieuse j eune fille et une artiste .
Des traits harmonieux,de beaux yeux et de beaux cheveux
noirs dont la masse,serr ée par un croissant
,dessinait admi
rablement le front une taille souple , une d émarche ais ée ,puis
,par dessus tout
,un air de vraie modestie et un sour ir e
enchanteur,voilà.pour le physique . L ’artiste est remarquable
par une technique tr ès sûre,une bonne qualit é de son
,une
force contenue consid érable — je dirai plus— admirable à. cetâge
,et une grande nettet é d articulation .
Mademoiselle Roy a j ou é sur un mauvais piano il n ’yavait rien à. en ti rer . Et cependant elle a tir é de beaux eff ets .Ce contretemps a sans doute nui parfois à. l ’interpr étation quel ’artiste aurait voulu r éaliser . D ’autre par t
,peut-être
,la vie
,
effleur ée à.peine , ne lui a—t—elle pas encore r évél é le sens profond et souvent profondément douloureux des choses quepensent les maîtres . Nous ne voudrions pourtant pas qu ’elleviei ll it pour ce qui est de la vie , nous lui souhaitel ion s derester touj ours la fraîche j eune fille qui porte les robes à lacheville
,mais
,pour ce qui est de l ’art
,elle peut aller plus loin
,
et ce n ’est pas lui faire injure que d ’espérer qu ’elle nous revienne bientôt vêtue de la longue r obe à traîne et aur éol éedu complet épanouissement de son m erveilleux talent .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 321
M . Chamberland,violoniste , a du tempérament , beau
coup de tempérament et de l ’habilet é . Il sait où il va,il
sait ce qu ’il veut dire et il le dit comme il l ’entend . Il ne faitpas non plus tr0 p de concessions au goût populaire
,ce qui
est un mérite .M . Gagné a une vraie voix de t énor . Il a partagé avec
Mlle Godbout les honneur s du rappel dans le duo de Roméoet Juliette .”
Nous aimer ions entendre Mme Montreuil dans un autrerôle que celui d’
accompagnatr i ce, dont , du r este,elle s ’est
acquitt ée en perfection .
Mons ieur du Ba lcon
L rdée de Mlle j eanne
PAR S. BOUCHER IT
(Sui te)
L ’annonce de cette déci sion causa à Jeanne l ’émotion la
plus profonde . C ’étai t le couronnement de son œuvre ,c
’ était le but secret de ses plus ardents dés irs . Ce devi ntl ’unique obj et de ses entreti ens avec M lle Marois . Lajeune fi lle
,avec la juvéni le exaltation de son esprit , l ’ in sti tu
trice,avec ce goût de la mise en scène inné chez toute femme
tombèrent d ’accord sur l ’utilité de donner a cette cérémoniele plus de splendeur possib le . E lles rêvaient d ’une égliseornée de fleurs du haut en bas , d
’
autel décoré de lumièresresplendissante s
,du catéchumène conduit vers le saint lieu
en procession solennel le . R ien ne leur paraissait assez beau1 1 . assez pompeux . M . Viviers et le Curé coupèrent court àces enthousiasmes . Très sagement , i ls firent remarquer auxdeux femmes que la véritab les gr andeur d
’
un acte , commece lui qui allait s
’
accom pli r ,ne dépendait pas d ’un apparat
extérieur , et que la simplicité ne - ferai t qu ’ en rehausserl
‘
éclat . Une cérémoni e collective comme celle de la prem i ère communion de tous les enfants d ’une commune ep âte à une manif estation où toutes les fami l les directementintéressées apporten leur conotingen t d ’émotion et de d—corations . Mais dans le cas actuel , où Pierre serait l ’uniqueobj et de la fête
,trop de pompe ne pourrait que troub ler son
( Sprit , qui avait encore besoin de ménagements , et ef farou
cher sa timidité non encore complètement éteinte . M .
V iviers ajouta que ce serait,de leur part même , faire acte
d'
osten tation orgueil leus e , ce qui étai t contrai re à ses goûtset a ses habitudes .
Jeanne dut se ranger,non sans quelque regret , à ces rai
sonnem en ts pleins de bon sens et il fut décidé que Pierreferait sa première communion un dimanche ordinaire , à lamesse du matin , tout simplement , sans que personne fut prévenu , autre que les deux fami lles .
321 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
l ’église se vidai t si lenci eusem ent . Quand i ls se levèrentpour parti r , i ls etai ent seuls . Mais devant la grille duchâteau et la mai son ' du surve i llant
,ils trouvèrent tous les
ouvri ers rangés en hai e : Lorsqu ’
i ls furent près d ’eux , unvie i llard a la barbe b lanche
,dont le dos voûté sur le métier
di sai t les longs servi ces , s ’
avan ça et , sans mot dire , tendit aM . Vivi ers un superbe bouquet dont la banderole portait :Au père de ses ouvri ers ! Pui s i l pri t des mains d ’
unefemme un autre bouquet
,ce lui -là tout blanc
,fai t de roses et
d’
œi llets,du mi li eu desque ls s
’ é levai t un li s éclatant . Surle ruban
,blanc aussi
,étai t écri t : A l ’ange sauveur , les
camarades de P i erre .
Ma lgré son énergi e,M . Viviers trem b lai t d emotion et ,
sans pouvoi r trouver une paro le,serrai t nerveusement les
mains tendues vers lui . Quant à Jeanne,éperdue , e l le santa
au cou du vie i l ouvrier,de Dubreuil
,de Mme Dubreui l
, des
fi llettes,de P i erre
,san s oub li er le jou fflu son am i . Pui s son
expans ion n ’étant pas satisfai te , e lle se j eta dans les rangs etse m i t à embrasser a tort et a travers
,dans le ta s , les
femmes , les homm es , les enfants , tout le monde . M lleMaroi s eut son tour . En véri té
,s i Casimi r avai t été la
,e lle
l ’aurai t embrasséUn repas de fam i lle ter mina cette douce journée . M .
Vivi ers avai t exigé que toute la fami lle Dubreui l s ’
as s ît a
sa tab le . M . le Curé assi stai t à la réuni on ainsi que le doyendes ouvri ers e t la doyenne des ouvri ères . Ce fut une fêteintime , simple comm e tous les cœurs qui s ’y trouvaient rassemb lés , et qui , au mi li eu de la joi e , gardai t l ’empreinte dessaintes émotions du m atin . Aucun incident ne la troub la
,
s i ce n ’est qu ’on fut ob ligé d ’arrêter le gros joufflu qui se livrai t à des débauches exagérées de crème à la vani lle .
L es vacances ,cette année-là
,se terminèrent par un in
eident fort inattendu .
M . Vivi ers avai t un ami très intime qui , part i commelui-même du bas de l echel le , étai t , par le travai l , arrivé au
sommet . M . Constant Saint—Yves , n é dans les rangs lesplus humb les é levé comme M . V ivi er s dans la modeste écolecommunale (1 un peti t vi llage des bords de la Saône , est au
jourd’
hu i m enbre de l’
In sti tut , offici er de la Légion d ’hon d
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 325
neur et l ’une des glo i res de la «pe intur e française . Tout lem onde connaît ses paysages qui r ivi li sen t avec ceux deDaubigny et d
’
Harpign ies ,et qui se di stinguent par un
exqui s sentiment de poési e et une expression de lumineusec larté dont i l semb le avoi r appri s le secret de son maître , legrand Corot .Les relati ons de M . Saint-Yves et de M . Viviers sont tou
jours restées fraterne l lement intimes . Leur conformitéd ’origine
,leurs communs souveni rs d ’ enfance
,leur égale
é lévati on d ame,le déve loppement s imultané de leurs car
r ières plus éloignés en apparence qu ’ en réalité— la grandeindustrie pratiquée comme le fai sai t M . Vivi ers , ne confin e
t -e lle pas au grand art —tont avait créé entre ces deuxhommes de ces li ens qui ne se rompent jamai s . La distanceet le temps passent
,sans les atte indre
,sur de te l les aff ec
tions . Ah ! on ne se voyai t pas souvent,l ’un vivant , a
Lyon,l ’autre a Pari s . On ne s ecr ivai t pas non plus b i en
fréquemment,chacun étant fort absorbé par ses occupations .
Mai s quand on s e retrouvai t de loin en lo in ,on en étai t juste
au point où l ’on s ’était qui tté dans un e amiti é inébranlab le .
M . Viviers reçut un matin le billet suivant :Mon cher am i
, j’
a i besoin d ’ai r pur pour moi . J’aibeso in d ’arbres et d ’eaux pour un tab leau que j e rêve . Tuas tout cela a M on tbuel . J
’
ar r iverai après —demain pour ypasser deux ou tro i s moi s . Fai s-moi préparer la chambrebleue , que j
’
ai occupée dans la peti te visite que j e t ’ai faiteil y a cinq ans . E l le m ’
avai t beaucoup plu .
Tendresses a toi et a Jeannette qu i doi t être une grandedemoiselle . C . SAINT-YVES .
P S .— A propos
,fa i s—m oi aussi arranger un atelier que lque
part,a la fabrique par exemple
,pourvu qu ’
i l y ai t beaucoupde lum i ère .
Le té légraphe porta une réponse enthousiaste,et tout fut
en mouvement a Mon tbuel pour l ’arr ivée du nouveau venu .
Jeanne ne perd it pas une pare i lle occas ion de rempl i r sesdevo i rs de maîtresse de mai son
,et surtout de s e démener
comme l ’exi geai t sa nature pétulante .
E lle était enchantée de la venue de M . Sai nt—Yves .
D ’abord,toute nouveauté est une joie dans la vie forcément
un peu uni forme de la campagne . Puis elle avait gardé duprécédent séjour du pe intre un souveni r où se mêlaient agréablem en t son caractère exceptionnellement gai , et l ’ image
326 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
des poupées magiques qu ’ il avait apportées . Il n ’
apporte
rait sans doute plus de poupées , mai s assurément il n ’
arr ive
rait pas les m ains vides ,et Jeannette voyai t déjà des per
spectives pleines de séduction . . des fanfre luches , des coff rets ,des bijoux pent—être . . Oh ! s i c ’étai ent des bi joux .Enfin
,
quoi qu ’ il y eût,M . Saint-Yves serai t le bienvenu et Jeanne
avai t comme un pressentiment j oyeux que ce voyage seraitmarqué par un bonheur plus grand même que celui desbfionx.
M . Saint—Yves arri va et apporta— prem ier cadeau— sa
gaîté aussi vive que de“bon aloi , qui faisai t à certains mo
ments du grand artiste un véritab le camarade de j eux pourJeanne et pour Henry . On n e savai t , dans certains cas , avo ir leurs folles parti es , que l était le plus enfant des trois .L
’
en trai n juvénile , surprenant chez cet homme aux cheveuxgri s et au nom cé lèbre
,s
’
alli ai t,chez lui , d ’une manière
étrange et charmante,à l ’é lévation de son espri t plein de
poésie et a une rare finesse d ’observation,qu ’ i l n ’
appliquai t
pas seulement aux choses de la nature pour les reproduiredans ses tab leaux ,
mais au caractère des gens qu ’ il pénétraiten un clin d ’œil . C ’
est ains i qu ’ il eut vite fait de devinerCas imir
,sans que Jeanne eût besoin de s ’ en mêler
,et qu ’ i l
le prit comme plastron de plaisanteries ,toujours si délicates
qu ’ il était impos sib le de s ’ en fâ cher et si spiri tuelles que ledestinatai re ne les comprenai t pas toujours . Mai s M lleViviers
,plus maligne
,les saisi ssai t toutes et en savait pres
que autant de gré à l ’auteur que du superbe collier sorti desmal les du peintre et qui avait dépassé ses plus ambiti eusesespérances .
Naturel lement,M . Saint-Yves fut vite au couran t de l ’hi s
toi re de Pierre . Jeanne,M lle Marois
,M . Viviers
,le curé
lui -même la lui contèren t,chacun a son point de vue
,et per
sonne n e la lui aurai t contée qu ’ i l aurai t en vi te fai t de lapénétrer a lui tout seul . Peut-être même fit-i l , a cet égard ,
certa ines remarques que personne n’avait faite s , mai s qu ’
i lgarda pour lui .Il goûta personnellement beaucoup Pierre
,quand ce lui—ci
f ut présenté . Son aventure presque miraculeuse, ,cette
éclosion subite d ’un espri t qui semb lait a jamais éte int , et quela volonté d ’une graci euse fillette avait rappelé à la vie ,
étaient faites pour intéres ser un arti ste toujours un peu amidu romanesque . Pui s le j eune Dubreui l était vraiment plai
328 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
sait indiquer dans un coin dn —
c ie l , pût se soulever de sesailes légères dans l ether amb iant .M . Saint Yves , d ’ordinai re s i gai , même un peu loquace .
se transformait,quand i l avai t la palette a la mai n . Pas
un mot ne sortai t de s es lèvres entr ’ouvertes . Pas un de sesregards ne s
’
égarai t loin de ses modè les . Il était tout a sonsuj et et a l ’ inspi ration qui le lui f ai sai t ‘
reprodui re ,avec une
minuti euse exactitude dans le détai l et en lui donnant l ’emprein te de cette poési e dont le feu sacré vivai t en lui . Mai stout a coup i l s ’arrêtait , poussai t un soupi r de soulagementsati sfai t
,donnai t un derni er coup d ’
oei l a son ébauche déjàvivante et parfaite ,
et,l ’arti ste en thous i
‘
a‘
lste se changeanten homme qui avai t fa im , i l s
’
écr iai t avec sa bonne humeurrevenue
— Maintenant,Monsieur P i errot
,a tab le !
Alors P i erre sortai t d ’un pan i er des vivandes froides , desfruits
,un flacon de vi eux vin
,et les deux compagnons déjeu
naien t gaîment , assis sur l ’herbe , devenus camarades malgréla di fférence des rangs .
Pendant le repas et le récréat ion qui su ivai t , M . SaintYves n
’
arrêtai t pas son étude mai s c ’était P i erre alors qu ’
i létudiai t Celui -c i se livrai t chaque jour davantage , retenuau début par. un reste de timidi té , mai s , depu i s , m i s en conhance par la rondeur s imple de l ’arti ste . Même
,avec lu i , i l
s e sentai t plus l ibre , plus expansi f qu ’avec Jeanne . Iln ’ était plus ar rêté par cette sorte de vénérati on respectueus e
,
quas i religen se ,qu ’
i l avai t pour la jenn n e fi lle,et dans cette
âme toute neuve,s i récemment éve i llée et qu i s
’
ouvrai t
candidement devant lui,M . Sant-Yves apercevait des pers
pect ives encore b i en autrement be lles que ce lles que reprodn i s ai t son pinceau . Son intérêt ne ta rda pas a se changeren une . affection véri tab le
,profonde
,paterne lle .
(A su i r r n . )
LA SO C IETE D E
LA REVUE FRANC O -AMERIC AINE
27 RUE BUADE, Q UEBEC .
L’
I L L U S T R A Α
IO NSupplément de
“
La Revue Franco-Américaine
Première Année , No . 5.
HON . CHAS . W ARREN F AIRBANKS,
V ice-pr é s ident et représen tan t des Etat s —Un is aux fê tes duTro i s rème Cen tena i re .
%$ÈŒŒÈÈŒŒ$ŒÈÈŒÈÊÈÊŒÊÈÈÈÊÈÈÈŒÈÈÈÈÈ
Œ$ È
L e m arqui s de L év isLà_
la batai lle de Ste-Foye
ËŒÈ È È ŒÈ $ È È ŒŒŒŒÈ È È Ë Ê È È
L’
Espagne Catholique et le Progrès
Parmi les nombreux reproches qu ’une éco le historiquefait à l ’égli se
,i l en est peu de plus sensib le que ce lui d ’
avoiramené la décadence de ses meil leures enfants , les nationslatines
,et parmi les exemples qu ’on apporte , comme argu
ments de fai t, pour étayer certaines thèses Il n ’ en est pas
auquel on ait»plus fréquemment recours que ce lui de l ’Espagne . Première puissance de l ’Europe durant tout le XVIsi ècle
,la nation très catholique interdit chez e l le la propa
gande des doctrines protestantes, con tien t sn r tout le con
tin en t européen ,
°
l’
eff or t de la réforme envahissante , et l ’E spagne décline peu a peu . La décadence
,d ’abord lente et
mitigée d ’
éclatan ts faits d ’armes sons Philippe II , s ’accentuesous ses successeurs ; le dix—neuvi ème s i ècle commencé ave cl’
épouvan table guerre dont le centenaire a été récemmentfêté par toute la péninsule
,n ’ est qu ’une longue sui te de
guerres c ivi les et de désastres . Le siècle nouveau,i l est
r ai , s’ouvre sous de me i lleures auspices
,mais n ou s sommes
en h i stoire et l ’h i stoire s ’occupe du passé .
L a conclusion s ’ impose donc ; le catholicisme a été fatall’
E spagne .
Pour di sséquer ce sophisme et le détruire lambeau parlambeau , i l faudrait un volume et nous n ’avons que quelquespages .
Disons d ’abord que l ’E spagn e entièrement catholique ,n
’est pas celle de Charles V,de Philippe II on de leurs snc
ces senr s . L’
E spagn e de la décadence n ’est pas une nationtoute catholique
,car le césari sme
,le pouvoi r absolu et sans
contrôle d ’un seul , a trouvé place chez e lle , et le césarismen ’ est pas un héritage de la tradi tion catholique
,c ’est un re
tour vers le pagani sme ancien ; non ,l’
Espagne toute catholique , ce l le de Pe lage , de St-F erdinand de Castille , du CidCampéador , c
’est une E spagne progressive que l ’effort de songéni e porte au premier rang des pui ssances européennes !
Le siècle de Charles V ,tout ple in de splendeurs et de
conquêtes porte avec lui des germes pern i cienx : Le champ
LA REVUE FRANCO —AMERICAINEque doit couvrir la justi ce roya le s
’est étendu au loin , s i loinque le soleil ne peut l ’ éclai rer tout entier .
Mais le roi auquel une si grande somme de pouvoirs estdévolue , le roi n ’est souvent que le rej eton incapab le d ’unedyn astie dégén érée ,jonet entre les mains de que lque in tr igant . Dès lors , quoi d ’étonnant si le vaste engrenage de .
l ’empire dépendant d ’un moteur défectueux se rouille d ‘inan i tion on se détraqne ?L es règnes de F erdinand VI et de Charles III s emb lèrent
relever le pays , mais l ’ incapacité de Charles IV ramenabientôt un état de choses te l que Napoléon
,j etant un coup
d’oei l sur ce vieil édifice et n ’ en voyant que les façades dé
c répites , crut qu’ i l suffirait du bruit de son nom pour le j eter
par terre et planter son drapeau sur ses ruines . Alors,il se
passa une chose que n ’avait pas prévue le grand empereurLa partie offi cie lle et organi sée de la nation , qui de longuedate avait rompu avec les vieilles traditions catholiques , se
m ontra ce qu ’ e lle était lâche et abj ecte , mais le peuple , que
n ’avaient pu atteindre les idées de la réforme on de la révolut ion ,
le peuple , qui malgré l ’opprobre de ses gouvernants ,avait gardé l ’âm e très haute , une fois abandonné à lui-même ,
sans armée,sans gouvernement
,osa j eter le gant au vain
queur du monde . Six cent mil le soldats impériaux con
vr i ren t de leurs bataillons épais le sol entier de la péninsule ;pendant six an s
,un peuple vit ses vi lles détruites ,
ses campagnes dévastées , son sang couler à flot
,sans que l ’ idée
seule lui vint d ’accepter ce qu ’ i l croyait être un déshonneur ,et finalement
,resta maître chez lui .
D e cette page d ’histoire deux fai ts ressortent,pleins de
lumineuse évidence , c ’ est (1 une part , la faib lesse de l ’étatespagnol et de son administration décrépite , de l ’autre laforce insoupçonnée qui se révé la chez le peuple à l ’heure dudanger .
Nous avons déjà , dans la mesure que comportait cemodeste article , donné l ’explication de l ’un et de l ’autre .
Ferdinand VII,en 1 808
,avai t lai ssé son royaume rela
tivem en t paisib le ; a son retour , en 1 8 1 4 , i l le retrouva bonlever sé de fond en comb le . La guerr e avait fait surgir touteune pléiade d ’hommes ambitieux et énergiques : officiers dont
332 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
de 1 8 1 5 Êr 1 870 ,ce lle de la transformation économ i que du
m onde civilisé , en fut une de pa i x intéri eure .
L’
E spagn e ,au contraire , ne connut pas de repos , la
guerre civi le y eut pour théâtre des provinces entières . Pendant des années , carli stes , libéraux et répub licains appor
tèren t a leurs luttes fratri cides toute l ’ardeur d ’un tempé
ramm en t passionné .
En 1 878,avec l ’avén em enfi d
’
Alphon se XII , la guerrere ligi euse cesse d ’
en sanglan ter les champs de bataille , maisn ’en continue pas moins a troub ler l ’atmosphère politique etsoc iale de la nati on Les luttes stéri les , les discussions théor iques se poursuivront longtemps à l ’ombre des parlements .
Voi là donc,esqui ssé à grandes lignes
,le tab leau de ce
que fut le XIX si èc le en E spagne . Un fai t y apparait sai llant
,c ’est la guer re implacab le , que se font les deux idées ,
ou plutôt les deux doctrines,libérale et catholique .
Dès lors,i l serai t convenab le avant d ’accuser l ’Egli se
des maux de ce malheureux pays,i l serait convenab le de
vo i r s i des doctrines diamétralement opposées à ce lles qu ’e lleenseigne
,n ’ont pas entamé dans une mesure assez forte
,la
f oi du peuple très catho lique .
Ceux qu i accusent l’
Egli se ,on les a vus à l ’œuvre dans
ce malheureux pays ; on a vu ce qu etaient leur tolérance,
leur l iberté et leur progrès ! Dès 1 8 1 2,alors que la guerre
battai t son plein , les Cor tès de Cadix ,trouvai ent pratique de
proclamer dans une consti tution restée célèbre, tous les prin
c i pes” de la révolution françai se . C ’ étai t j eter les germes
d ’une guerre civi le , c etai t rendre impopu lai res en les confondant avec les principes exécrés
,les réformes d ’ordre
admini strati f dont dépendai t l ’aveni r du pays c ’étai t enfindans un s i ècle de transformation économique
,détourner des
œuvres les plus indi spensab les,l ’espri t . d ’un peuple déjà trop
porté aux di scussions stéri les .
Ah oui ! Ils ont fai t de belles choses les anti cléri cauxE spagnols , et s i leur pays est resté arriére , eux ,
du moins,
i ls ont marché de l ’avant !Mendi zabal , un de leurs grands hommes devenus m in i s
tres a trouvé moyen de fai re,un dem i si ècle avant ses con
gén eres de F ran ce , cette fameuse liquidation des b i ensecclés iastiques qu i la i ssa chez le peuple une impress ion quel
LA REVUE FRANCO —AM ÉRICAl 333
que peu deçue ,ce lle qu é prouvèrent maints spectateurs du
IIIe centenai re après le passage des pi cpokets .
Un autre de leurs chefs —d ’
œuvre a été le démembremen tdes vi ei lles provinces nationales en provinces minuscules ,presque aussi rédui tes que les dépar tements français . Cettemesure fai sant tout dépendre du pouvoir central , brisaitl ’ espri t régional
,le patriotisme local qui avaient fait la force
i nvinc ib le du pays dans sa lutte contre Napoléon , e lle dimin uait l ’ initi ative
,et rendait beaucoup plus facile
,la propaga
ti on par tout le territoi re des malaises que ne manqueraitpas d ’
épronver un pouvoi r central mal a ffermi .C ’est tel lement le cas qu ’un vaste mouvement régiona
l i ste a pr1 s nai ssance,il y a que lques années en E spagne ,
dans les quatre provinces les plus progressives du pays,ce lles
comprises généralement sous le nom de pays catalan . Aux
dern i ères élections , la solidarité catalane , formée d ’unecoali tion de répub licains et de carli stes , a obtenu un succèsécrasant , envoyant du coup a la chambre 49 députés .
Cette ini tiative , ven ant d’une région qui passe a bon
droi t pour l ’une des plus industrieuses de l ’Europe est toutun symptôme , et ce sera le grand mér ite du gouvernementMaura , d
’avoir compris la nécessité de cette réforme et del ’avo i r entreprise franchement dans un proj et de loi quel ibéraux et radi caux s ’ e fforcent en vain d ’
éton ff er,a force
d’
obs truction .
L à, —bas comm e ail leurs, et plus qu ’ail leurs
,les an tid é
r i canx nourri ssent un e prédi lection toute spéciale pour lesquestions d ’ordre spéculati f
,les phrases ronflan tes
,les mots
de l iberté , de progrès , etc . Mais quant à envisager les problèmes vitaux du pays et a les resoudre
,c ’est une autre
affai re . Leur presse , et disons en passant qu ’ ils contrôlentpresque tous les j ournaux du pays
,leur presse n ’a qu ’un but
arracher au peuple la foi de ses pères et pour atteindre cebut ri en n ’est épargné . Tous les j ours
,l’
Heraldo de Madrid ,
E l Imparc ial , E l L iberal , El Pai s , et une foule d ’autres,
servent a leurs lecteurs un plat de calomn ies où l ’ ignoran céle d i spute à la méchancetéDans ces conditions là., il semb le qu ’
un juge impartial,
constatant que le pays est arriéré et voulant découvrir lacause véritable de cette décadence
,ira demander à l ’école
anti re l ig ieuse et a la maçonnerie toute pu i ssante une bonneparti e du compte qu ’
i l se préparai t à exiger de 1 Egli se .
334 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
Un ob s ervateur impartial con statera que la partieseptentrionale du pays , ce lle où se sont le mieux conservéesles vieilles tradi tions catholiques , est a la fois , la plus virile ,la plus laborieuse et la plus progressive , il constaterait aussique les catho liques , s i on en excepte les Carlistes qui ne sontqu ’une minori té
,ont accepté loyalement les institutions par
lem en tai res garantissant les libertés de la pres se et des cultes ,chères à l ’école libérale et que s ’
i l n ’en tenait qu ’à eux , lesdiverses factions poli tiques trouveraient une base d ’ ententepour travai ller en commun au relevem en t du pays .
Avant de terminer cette di ssertation déjà trop longue ,i l est bon d ’
insister sur les nombreux motifs qui font espéreren l ’avenir de la grande nation latine . L ’
E spagne ,pauvre ,
aff aib lie,vaincue
,a gardé a un haut degré le sentiment de
la fierté nationale . Le peuple que tant de vi ci ssi tudes ont
rendu sceptique,ne croi t plus a l ’honneteté de ses gouverne
ments,mai s il a confiance en lui —même . Lors des dernières
guerres coloniales , l ’E spagne ,encore sous le coup des ruines
accumulées par un si èc le de malheurs trouva moyen d ’envoyer à Cuba hommes et d ’obteni r pour payer cetteentreprise la somme énorme de $800
Aujourd ’hui,ses finances restaur ees ,
son industrie et soncommerce renai ssants , son j eune roi plein de vai l lance
,tout
s ’uni t pour lui fai re espérer un meilleur avenir .
Donat Fo rt in.
336 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
m ais touj ours également importante . Et c ’est un peu de
t out cela qu’à. la demande du directeur de la Revue F ranco
Amér i cai ne,j ’invite le lecteur a causer pendant quelques pages .
Le Canada,r ichement dot é de ressources agr icoles
,fo
rest i ères et mini ères,serait d ’apr ès un économiste la der
n i ère r éserve de l ’humanit é,sa dern i èze fronti ère .
”
Grace aux deux grarides races qui vivent sur le sol canadien
,nous élevons un magni fique édifice national dans lequel
les peuples des Etats—Unis et de l ’Europe viennent chercherl’ai san ce et la libert é .Le peuple canadien doit avoir des aspirations communes .
Pour atteindre ce noble but,nous devons exercer une vigilance
spéciale au point de vue du caract ère des immigrants . Ilsdoivent d ésirer
,comme nous
,la prospérit é mat ér ielle et mo
rale dn Canada . C ’est l ’héritage qu ’ils doivent transmettreà leurs enfants sur ce sol jeune et hospitalier .
Pour la s élection des immigrants nous avons de grandestraditions à suivre . Nous devons nous inspirer des enseignements de notre histoire nous devons évoquer un pass é pleinde gloire et rappeler les exemples des fondateurs du Canada .
Fnstel de Coulanges écrit Le pass é ne meurt j amais complétement pour l ’homme . L ’homme peut bien l ’oublier maisil le garde touj ours en lui . Car
,tel qu ’il est à chaque époque
,
il est le produit et le r ésumé de toutes les id ées ant érieures .S ’il descend en son âme
,il peut r etrouver et distinguer ces
différentes époques d ’apr ès ce que chacune d ’elles a laiss éen lui .”
Nous devons appliquer ces principes à notre histoire etj eter un regard sur nos traditions .
Les immigrants de la Nonvelle—F rance étaint choisisavec les soins les plus minutieux . Dans les veines de nos pèrescirculait le sang le plus noble et le plus généreux de la France .Nos ancêtres venaient de la Normandie
,de l ’An jou ,
dela Picardie
,de la Bretagne
,de ces provinces fortes
,morales
,
aimant la religion,l a libert é et la France .
Les hommes qu i présidaient aux destinées de la Francedans le si ècle de Louis le Grand
,d ésiraient fonder au del à
des mers,une autre France comme une expansion du pays
natal .Aussi se m ontraient— i ls tr ès s évères dans le choix des cc
l ons . Le Canada—Français fut l ’ œuvr e de grands patrioteset de profonds l égislateur s .
LA REVUE FRANCO -AMER ICAINE 337
Le Canada-Français fut l ’œuvr e des meilleurs paysansde la France hommes dou és des plus hautes qualit és mor ales
,physiques et civiques
,entreprenants
,industr ieux
,bra
v es et vertueux .
Les documents historiques nous d émontrent que les fem “
mes françaises envoy ées dans la Nouvelle—France par les soinsde R ichelieu
,de Colbert
,de Talon
,de Laval
,étaient choisies
avec la plus grande prudence .
L ’œuvre des filles émigr ées du 1 7ème srecle mér ite l ’adm irat ion des moralistes les plus aust ères .Tous les historiens prouvent la noblesse de l ’or igine de8
C anadiens—F rançais . Aussi ont— ils pu grandir,prosp érer
,se
multiplier au milieu des épreuves et consacrer t oute l ’énergiede l ’âme nationale , t outes les! forces de leur puissante organ i sat ion physique et morale au progr ès du Canada . ClaudioJannet
,parlant de la sup ériorit é morale des él éments qui ont
fondé la colonie -canadienne dit Depui s Champlain jusqu ’audernier j our de la domination française
,les gouvernements
de la colonie se sont touj ours pr éoccup és d ’en exclure les individus d ’une moralit é douteuse .”
Selon un orateur Ce qui fait auj ourd ’hui notre honneur et notre force
,ce n ’est pas simplement de tirer notre ori
gine de la France,mais d ’être i ssu d ’elle au moment le plus
glorieux de son histoire et quand la main qui agita notre berceau se pr êtait encore aux gestes divins .”
Apr ès la cession du Canada à l ’Angleterre, la race anglosaxonne grandit à nos côt és . Au terme de la guerre de l
’ind épendance amér icaine en 1 783
,les Loyalistes de l ’Empi re
Uni,
fidèles serviteur s du trône de l ’Angleterre durant la r ébellion
,pers écut és par leurs fr ères r évolt és
,affluèrent par
milliers dans les provinces canadiennes . D ’apr ès un écr ivainLes loyalistes ont fourni au Canada le meilleur sang dont les
t rei zes colonies amér icaines pouvaient s’
énergnei llir .
” Cesimmigrants furent les fondateurs du nouvel empi e br itanniqueen Am é: ique . Leur s progr ès furent constants et dignes d ’adm irat ion .
Aussi sommes-nous fiers de leurs succ ès . M . Hal l dansson magn ifiique volume intitul é L ’immigration
,
” écritNous devons nous rappeler que les premiers habitants de laNouvelle—Angleterre furent choisis avec le plus grand soin .
”
C ’est de l ’idéalisme,peut—on di e Non
,c ’est notzo histoire
338 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
notre grandeâhi stoire. Et quand ses pages sont remplies defaits hérorques , on doit les mettre sous les yeux de nos pepulat ions .
Je reconnais l ’importance,la nécessit é des efforts du
Gouvernement et du P arlement afin de favor iser une immigratien désirable . Sans doute
,les descendants des Français
et les descendants des Loyalistes,ou mieux des Canadiens
,
sont les plus aptes à développer les ressources du Canada .
Si nous voulons suivre nos grandes traditions nationalesnous devons surtout encourager l ’immigration des classesagricoles . Dans toutes les provinces de ’ a conféd érationnous avons des milliers d ’acres des meilleurs terres . Grâceà leur fertilit é
,elles sont destinées à devenir les pourvoyeuses
de l ’Europe et de l’
Or ient . Nous voulons des agr i culteurspour en sem en c *r nos terr es inoccup ées afin d ’augmenter levolume de nos produits et d ’
accgoître notre richesse nationale .
Dans plusieurs pays,nous pouvons r ecruter des immigrants
agr icoles recommandables . Dans la noble posit ion de cul
t ivateur ils sauront développer nos ressources nat ionales .
Les autor it és ont adopt é à l ’égard de l ’agriculture dansla province de Qu ébec une politique recommandable . Je lamentionne en l i sant une lettre de M . R én é Dupont . Cettecorrespondance est adress ée aux r édacteur s de la presse ca
nadienne
Monsi eur le r édactenr,
- Pour activer le mouvement ver sla province de Qu ébec , le minist ère de l
’Int ér ieur vient d ’au
tor iser l ’o: gan i sat ion d’une branche de renseignements pour
les te:. res d éj à cultivées et qui sont disponibles,de mani ère
à renseigner toutes les personnes d ésireuses de fair e l ’acquis i t icn de ces terres .
Jusqu ’à pr ésent,ces renseignements manquaient
,quoi
que souvent nous ayons en des demandes pour l ’achat deste: es déj à avancées . Cette branche de se: vice sera aî ladi spositi on de tous ceux qu i d ésirent fair e l
’acquisi tion dede fe me dans n
’
impo te quelle section du pays , on de ceuxqu i , pour une rai son ou pour une autre
,ont des te: 1 es disponi
bles .A titre de renseignement
,j e vous in clr .s un blanc qr e nous
transmettons a tous ceux qui ont des terres à vend e,et j e
se ais tr ès heureux s i vous t ouviez moyen,dans vos p écie1 ses
colonnes,de donner un bon mot a nos compatr iotes au sr j et
de ce mouvement nouveau .
340 LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE
gratuitement des situations,
com rrîe j ournaliers de fermeou domestiques
,aux émigrants désirant s ’établir dans la pro
vince . Cette décision sera d ’un grand avantage à la classeagricole de même qu ’aux agents d ’immigration qui pourronts
’entendre avec les agents provinciaux et procurer exactementla classe d ’immigrants nécessaire .
D ’apr ès sa d écision —le ministre de l ’Int ér ieur vient denommer vingt agents dans Québec et les autres seront choisiss ous peu .
Depuis cette date de nouveaux agents ont ét é choisis .L ’agr iculture souff re du manque de main—d
’
œuvre dans laprovince de Québec . Le pr ésident de la Soci ét é de Colonisation et de Repatr iemen t de Montréal
,disait en j anvier 1 908
La détermination que nous avons pr ise,a eu pour bon r é
sultat d ’aider les cultivateurs ase procurer de la main-d ’
œuvre,
et à un certain nombre de familles à s ’assurer les services dedomestiques . Nos bureaux ont plac é ainsi plusieurs centainesd ’ouvriers de ferme et de domestiques sans compter qu ’ilsont
,en même temps
,fourni aux particuliers et aux industriels
l ’occasion de profiter par leur entremise du même avantage .
”
Dans quelques localit és,nos j ournalier s vont redouter la
c ompétition des ouvr iers de ferme venant de l ’étranger . Undes citoyens les plus distingu és du comt é que j
’
ai l ’honneurde repr ésenter
,m ’écrivait la semaine derni ère L
’
hono
rable monsieur Oliver a r ésolu de nommer dans chaque comt éde la province de Québec un agent chargé de r ecruter des ouvr iers de ferme et des domestiques afin d ’aider nos cultivateurs à se procurer la main-d ’
œuvre nécessaire . Ce mouvement
,entrepris dans un noble but
,n
’
augmenterai t— i l pasl’exode des nôtres vers les villes et vers les centres industrielsdes Etats—Unis ? N ’introduirons-nous pas dans nos paroissesdes s ocialistes et des anticl éricaux ‘
? N ’y a—t — i l pas dangerd ’introduire des él éments qui briseront l ’harmonie entre lec lergé et les fidèles
Je soumets cette lettre à l ’attention du public croyantqu ’elle renferme des opinions dignes d ’êtr e étudi ées . LeGouvernement doit être bien prudent dans le choix et la dist r ibut ion de ses agents . Ceux— ci ne doivent introduire aum ilieu de nos populations morales que des immigrants dontles bons ant écédents sont connus .
Le 1 5 avril 1 907,j e demandais au Gouvernement de faire
les efforts les plus énergiques et les plus généreux afin de favor i ser le recrutement d ’immigrants français et belges dés i
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 34 1
rables . Le minist ère a adopt é une politique plus acti ve à.l ’égard de la F rance . Il a nommé trois nouveaux agentsd ’immigration . Des mesures paraissent avoir ét é prises en
vue d ’une distribution plus large de litt ératur e et de rensei
gnement s . Le ministre de l ’Int ér ieur s ’est acquis le concoursactif de plusieurs agences d ’immigr at ion française . Celles— cireçoivent une commission quand elles envoient au Canadades immigrants appartenant à quelqué classe sp éciale .
Dans le pass é,les gouvernements canadiens se sont cru
oblig és de recourir au syst ème des primes,pour favoriser et
et encourager l ’immigration . On of fr it des pr imes aux agentsde compagnies de
’
navigation pour assurer le recrutemen
d ’immigrants dans les îles Britanniques . A cette époquela Nouvelle-Zélande
,l’
Australie,la R épublique Argentine
d épensaient des sommes tr ès élevées pour maintenir un syst ème d ’assistance à l ’immigrat ion . Les colonies australiennespayaient en tout ou en bonne partie le transport des immigrantsdésirables . L
’Argent ine, le Chili , l e Br ésil utilisaient la même
méthode . Les Etats—Unis exerçaient une immense attrac
tion sur les populations . Les autor it és canadiennes crurenttrouver une bonne méthode dans l ’assistance à l ’immigration
,
au moyen de commission . Mais les repr ésentants des Agencesd
’lmm igrat ion n
’ont malheureusement aucun int érêt à s ’occuper du caract ère
,de la moralit é des immigrants
,les agents
qui reçoivent une commission doivent avoir pour souci naturel d ’envoyer le plus grand nombr e possible d ’immigrants auCanada . Que leur importe le caract èr e ! Que leur importela moralit é de nos populations J ’en suis convaincu
,le Gou
vernement abandonnera bientôt cette politique . A l ’heurede la cr ise commerciale et monétaire
,on redoute la suspension
des pr imes à l ’égard des immigrants,mais j e crois que la crise
commerciale a plutôt consolid é notre cr édit commercial àl ’égard des autres peuples .Durant l ’année fiscale 1 906— 1 907 nous avons reçu
immigrants des Etats—Unis . Le montant pay é en primesaux Etats—Unis ne s ’est élev é qu ’à et ces immigrantsamér icains nous ont apport é une valeur de quarante millionsde piastres . Durant les neuf mois de l ’année fiscale 1 9061 907
, immigrants .sont entr és dans notr e pays et nousavons accord é une prime pour immigrants . Nouspourr ions obtenir de bons r ésultats aux Etats-Unis
,dans
les Iles Britanniques,dans l
’
Europe continentale,sans
LA REVUE F RANCO-AM ÉRICAINE
recourir au syst ème des primes . En effet,les conditions
économiques du Canada subissent d ’heureuses modifications .
Notre pays grandit merveilleusement au milieu des nationscivilis ées . Son nom est déj à tr ès fameux dans plusieurs cont r ées et bientôt le Canada pourra rivaliser avec les Etats—Uni s“
Umme centre d ’attraction pour les immigrants .Dans tous les pays où nous étendons le champ de notre
t lOÏ l agricole,commerciale et industrielle
,nous devons avoir
des agents d ’immigration et des agents de commerce qui comprennent nos besoins et nos aspirations . Ces agents peuventdonner des conférences
,des renseignements a toutes les classes
de la soci ét é . Ils doivent être instruits , renseignés sur nosressources
,nos lois
,nos conditions économiques . Ils doivent
être honnêtes,progressifs
,capables d ’aider au développement
de nos relatons sociales,commerciales et industrielles . Un
j ournaliste écrivait avec raison le 7 avril Une commissioncompos ée d ’hommes renseignés sur la situation de notre commerce et qui irait s
’
instru ire sur les marchés du monde desdébouchés à faire anos produits et des occasions offertes à nosimportateurs
,contribuerait à accroître rapidement et profita
blement notre commerce ext érieur,qui a d éj à mani fest é de
puis quelques années une si prodigieuse force d ’expansion.Elle activerait
,a l ’étranger
,la demande pour nos marchan
dises,et en diffusant le connaissance de nos ressources natu
relles,dirigerait incidemment vers nous un courant continu
et abondant de capital nouveau et d ’immigration ém inem
ment d ésirable .
”
On peut aussi envoyer a l ’étranger des dél égu és spé
ciaux— des immigrants qui ont r éussi dans notre contr ée .Sur le sol natal
,ils raconteront leurs succ ès et formeront la
meilleure classe de nos agents d ’immigration . Attironsdavantage les j ournalistes étrangers et les membres d esChambres de Commerce des Etats—Unis et de l ’Europe. Cesdistingu és visiteurs admireront nos richesses naturelles
,le
diront à leurs compatriotes et nous recevrons de bons immigrants . Les expositions de nos produits dans les vi lles etvillages deviennent aussi un facteur important dans le labeurde l ’immigration .
Les populations des Etats—Unis e t des îles Britanni quesconnaissent assez bien nos ressources et nos conditions économ iques . Hier
,la presse canadienne nous annonçait un
grand mouvement d ’immigration des Etats-Unis vers le
344 LA REVUE -FRANoo-AMERICAINE
pour ainsi dire française nous pouvons recruter de bons immigrants agr icoles
,des garçons de ferme intelligents et des ' in
dust riels d ou és d ’une grande habilit é . Ce syst ème est peut-êtredispendieux
,mais il s ’agit de rechercher la solution d ’un pro
bl ème national . La question sociale l ’emporte sur la question matér ielle .
M . Leroy-Beaulieu constate que le Canada est aujotrrd’
hui
l e pays qui offre le plus d ’
attrait aux immigrants et se développe le plus vite au point de vue agricole surtout .”
Apr ès l ’exposition de Li ège,j e lisais dans la R evue Econo
mique et InternationaleL ’exposition des produits canadiens nous r évèle ou
nous rappelle qu ’il y a là , au nord de cet immense continentaméricain
,des terr itoires abondamment pourvus de toutes
les r ichesses de la nature,occupés par une population peu
nombreuse,mais énergique
,entreprenante
,résolument d écid ée
à faire fructifier,avec le concours étranger
,des tr ésors enfer
m ês dans le sol . Il y a là pour les pays à population t r 0 pdense de vastes d ébouchés
,d ’autant plus dignes d ’attirer
l ’attention que le climat y est salubre et tempér é . L ’étrangerest étonné des r éalit és actuelles et des possibilit és de l ’avenirdu Canada .
Nous pouvons lui démontrer nos progr ès dans la transportat ion ,
dans la construction des voies ferr ées,électriques
,
t él égraphiques et t él éphoniques,dans l ’amélioration de nos
voies fluviales,dans l ’épargne
,dans les industries agricoles
,
foresti ères et mini ères .L
’immen s it é et la fertilit é des terrains agricoles
,la richesse
de nos forêts,la r ichesse de nos minéraux le fer et le char
bon surtout, qui sont les muscles et le sang de l ’industrie mo
derne,
” le développement de nos industr ies,la j ouissance de
la libert é religieuse et politique,la grandeur de l ’enseignement
chr étien,les heureuses conditions économiques et sociales
,
l ’harmonie subsistant entre l ’Egli se et l’Etat
,entre le capital
et le travail,entre le patron et l ’ouvr ier
,entraînent les popu
lat ion s vers le Canada .
On critique quelquefois avec amertume la loi r églemen
tant l ’immigration canadienne . Bien appliqu ée,notre légi s
lation concernant nos immigrant s paraît r épondre aux besoinséconomiques et sociaux de l a nation . Elle renferme les dispositions nécessaires pour éloigner les mauvais immigrants.
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 345
L ’examen médical devient de plus en plus en plus s érieuxau moins à. Québec . D ’apr ès le rapport de M . Bryce (page1 20 ) immigrants furent détenus à l ’hôpital de Qu ébecdurant l ’année fiscale 1 904— 1 905. Durant l ’année fiscle 1 9061 907
,523 immigrants seulement furent d étenus à l ’hôpital
de Qu ébec . L ’examen dans les ports europ éens est plus s érieux et nous en bén éficions . Aux Etats—Unis on impose unep énalit é de 31 00 aux compagnies de navigat ion qui transportent volontairement ou sans inspection suffisante des personnesatteintes de tuberculose
,d ’ épilepsie
,de maladies contagieuses
quand elles prennent place sur le navire .
” Il est quelquefoistr ès difficile de se rendre compte parfaitement de l état physique
,mental et moral d ’un immigrant lors de l ’examen . Nous
pouvons renvoyer les immigrants non recommandables .Et puis le choix des immigrants ne peut se faire d
’une façonjudicieuse sans le secour s d ’une inspection médicale rigoureuse . Qu ’est— ce que nous faisons sous ce rapport Le docteurJ. D . Pagé
,a pr is charge de l ’hôpital des immigrants à. Qué
bec eu 1 904 . Avant cette date,il n ’y avait pas de syst ème
scientifique d ’inspection nrédi cale. Bien que deux m éde
eins fussent pr épos és à l ’inspection,le Gouvernement n ’avait
pas de maison de détention pour les immigrants malades ousuj ets à. l ’observation . Depuis
,reconnaissant la nécessit é
d ’une organisation médicale effective,on a aj out é aux fonc
tions de médecin de l ’hôpital,l ’office de médecin en chef du
port de Québec . Le docteur Pagé a organis é s érieusement leservice d ’inspection médicale à Québec . Je suis en positiond ’affirmer que le bureau d ’inspection médicale des immigrantsà Qu ébec
,n ’est pas inférieur à ceux que nous pouvons visiter
dans les ports américains . Notre loi concernant les immigrantsdit Il n ’est permis de d ébarquer en Canada à nul immigrant qui est faible d ’esprit
,épileptique
,dément .” Ceux
qui ont de l ’expérience dans la pratique médicale savent combien i l est quelquefois diff icile de faire le diagnostic de l ’épileps ie. Certains individus
,conservant toute leur intelligence
,
ont rarement des crises épileptiques . On sait aussi combienil est difficile de reconnaître la tuberculose lors de sa premi èrepériode . Le médecin est oblig é de faire une auscultation prolong ée et r épét ée
,souvent il est obligé de recourir à plusieurs
examens bact ériologiques . Au suj et de l ’ali énation mentale et de la criminalit é
,les hommes vers és dans la science
l égale savent combien il est difficile dans un proc ès criminelde faire le diagnostic de l ’état mental d ’un accus é .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Sans doute il serait plus prudent de fermer les portes denotre j eune et entreprenant pays aux immigrants dont nousne pouvons pas connaître les ant éc édents . Celui qui d ésireentrer dans notre pays devrait être porteur d ’un certificatétablissant qu ’il n ’a commis aucun crime impliquant turpitudemorale . Ce certificat pourrait être d écerné par le ' greffierd ’un tribunal
,par un magistrat int ègre , ou un mini stres des
cultes . Là encore,nous
‘
pourr ions redouter la substitution .
On loue souvent avec enthousiasme les lois restrictives desEtats-Uni s à l ’égard des immigrants . Il me parait impossiblede comparer nos conditions économiques avec celles de nosvoisins . Notre immigration
,au point de vue du caract èfre
,
de la moralit é,ne me paraît pas inférieure à celle qui se rend
aux Etats—Uni s . Jadis les peuples forts,robustes du nord
et de l ’Ouest de l ’Eur0 pe ém igraîerrt en grand nombre auxEtats—Unis . Depuis 1 890
,ces conditions se sont modifiées
,
et les immigrants des pays du Nord,c ’est—à-dire les plus facile
lement a ssimilables ne dom inent plus dans les statistiquesde l ’immigration américaine . Depuis 1 890
,les peupl es du
Sud et de l ’Or ient de l ’Europe inondent les Etats-Unis . Commele dit Leroy—Beaulieu L
’énorme accroissement des immi
grants tend à introduire des él éments beaucoup plus hét érogènes , plus difficiles à assimiler
,plus pauvres
,moins ins
t ruits,plus arri ér és a tous les points de vues .” Ainsi les
Etats—Unis recevaient en 1 907
De la RussieDe l ’Autr iche—Hongr ie
Remarquons que les Etats—Unis en 1 907 recevaient seulement immigrants de l ’Angleterre.
C ’est là unäf ait grave , dit Leroy—Beaulieu toutefois lesél éments nouveaux qui arrivent ainsi depuis quelques annéesn ’ont pas encore eu le temps d ’exercer une influence sensiblesur le peuple américain . Et l a mas se de celui-ci est maintenant si consid érable qu ’il n ’en sera peut-être pas modifié bienprofondément à l ’aveni r .Nos immigrants vi ennent en grand nombre des EtatsUni s,de la Germanie
,de la France
,de la Belgique et des îles
Britanniques .Je ne dés ire pas critiquer avec trop d’
amertume les 1mrn igrants qui nous viennent de la Russie, de l ’Italie, de la Hongrie,
348 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
Le Canada poss ède d ’immenses ressources . Les fils dusol et les immigrants de bonne mœurs ;* de bonne sant é et parfaitement
,
en état de pourvoir à leur propre subsistance peuvent subsister de nos 1 i chesses nationales .Les nouvelles générations d ’
imm igrants ,äâdevenant de'
plus en plus fortes,de plus en plus nombreuses
,seront peut
être un j our les maîtresses du Canada .
Si nos immigrants s ’inspirent des id ées du christianisme,
nous pourrons obtenir justice .
Nous méritons d ’étre respect és par les peuples qui vien
nent habiter le Canada .
En effet,nous avons t ouj ours montr é une grande gén é
ros it é à l ’égard des immigrants . En 1 831,la l égislature du
Bas—Canada proclamait l ’ émancipation de juifs en les ad
mettant a l ’égalit é de t ous les droits civils et politiques .En 1 847
,des milliers et des millier s d ’
Irlandai s,fuyant
la famine qui s évissait en Irlande se port èrent vers le Canada .
La maladie fit de nombreuses victimes . Les nôtres .leur prodigu ègent tous les soins nécessaires . Ils sacr ifièrent leurvie pour les sauver . Nous devons éprouver les mêmes sentiments
,la même sympathie à l ’égard des bons immigrants .
Mais,fallut— i l pour cela r etarder quelque peu le peuple
ment de nos vastes domaines colon i sables,nous ne devons pas
sacrifier la qualit é du nombre des immigrants . Et si nousvoulons bien rester maîtres chez nous
,notre premier devoir
est tout d ’abord de voir a ce que notre hospit alit é pour êtrelarge et généreuse
,ne devienne pas un moyen d asservisse
ment qui puisse un j our être dirig é contre les vi eux él émentsqui ont d écouver t et fait le pays
D r._Eugene Paque t ,
D éputé de l’Is let
_
au
par lemen t fédéral.
Québec, 8 j anvier , 1 908.
Les Canadiens—fi ançais de l’
Etat de
NewYork
D i s cours pronon cé _
a la conven tion f ranco-am ér i cain e d’
Al
bany , N .Y., le 4 août 1 884 , par le R ev. F . X. Chagnon ,
curé de Cham plain . Quelles s on t les forces et quels
son t les mei lleur s M oyens capables de procurer aucc Ca:
di en s -f rançai s de cet E tat la vi tali té dom es tique ,sociale
et religi euse ?
J ’assiste pour le 7ème fois aux Conventions Nationalesde l
’
Etat de NevVYork . C ’ est avec un sentiment diffici le àexprimer que j e vois cette présente réunion , nombreuse , etcomposée . d ’hommes honorable
'
s,instruits et remplis de pa
tr ioti sm e pour la grande cause que nous venon s tous déf endr 'e
'
ici . 'L e“ but de nos conventions , MM . les délégués , est
grand 1mporta’
n t'
,rempli de responsabilités . Les fondateurs
ont du s ’ imposer de grands sacrifices p ôur parvenir aux résultats bienfai
‘
sa'nts que nous constatons ‘
aujourd’
hu i l Ils
on t“ combattu les préjugés populaires ils ont dû Combattre
également l ’apath ie d ’
un grand nombre , et donner une direction sage , r e ligieuse et vraiment nationale àf ces assemblées popu laires .
C ’ est '
au prix de sacrifices de temps et d ’argent qu ’ ils ontpris en mains les intérêts de leurs com patriotes émigrés .
Mais , g râce à Dieu ,la Providence d ivine qui conduit les
m 0uvemen ts des peuples , a béni leurs efforts . Tout n ’ estpas fait ; MM . Au contra 1 re , i l nous reste une tâche encorebien lourde ! Par ‘
nos convention‘s,nous avons bien fait
pénétrer dans tous les centres canadiens de cet Etat, cettequ ’ ils nous faut rester canadiens-français
,ca
tholiques , tout en demeurant loyauxsuj ets améri cains . Mais ,
que deviendront - ces nouvel les générations qui s ’élèvent au
m ilieu de ’
noüs ? Ces 'enfants canadiens — français,i ssus de
fam i lles catholiques , conserveront— ils la Foi de leurs parents ?Parleront-ils toujours la langue de '
leur s ancêtres ? Voi là le
350 LA REVUE FRANCO -AM ÉRICAINEprob lème immense que nous avons a résoudre ! Voi là unequestion que nous devons étudier avec tout le respect et lepatriotisme quenous pouvons trouver dans nos ames !
La question est large , el le renferme en réalité , tout leprogramme national des Canadi ens de ce pays . Je compteque j e ne serai pas seu l a la traiter . Je vo i s a mes côtes unbon nombre de compatriotes compétents j e vois de vieux vêtéran s de nos conventions nationales . J ’ai raison d ’espérerqu ’ ils compléteront ce que j e vai s entreprendre . M . le Prés i den t
,en préparant les considérati ons que j e vais communi
quer a cette as semb lée , j ’ai recuei lli toutes les information spossib les sur la si tuation actuelle des Canadi ens-français del’
Etat de New York . Je me suis posé une série de questionsauxquelles j e vai s répondre bri èvement , mais avec ordre etsincérité .
1 . Que l est le nombre actue l des Canadiens- français , ca
tholiques dans l ’état de New York ?2. Depuis que l temps cette immigration est-e l le com
m en cée ?
8 . Quelles ont été,pour le plus grand nombre , les veri
tab les raisons de cette immigration ?4 Ç Quelle est aujourd ’hui la véritable situation matérie lle ,
morale et re ligieuse des Canadi ens — français de l ’Etat ?5. .Que lles sont les forces et que ls sont les moyens capa
bles de procurer à ces compatriotes la vi talité domestique , soc iale et religieuse .
Pour répondre convenab lement a la première question , _
j’
ai consulté les recensements of fi ciels de la nation ; j ’ai compi lé les stati stiques des divers rapports de la convention dePlattsburgh ; pui s , j ’ai consulté un bon nombre de prêtres ,missi onnai res qu i ont le soin spiritue l de nos c ompatri otes .
Et voici ma réponse : l ’état de Nevv-York est divisé en soix
ante comtés , subdivi sé en 1 000 ou 1 200 towns . Pour les fin srel igieuses, il y a six diocèses catho liques romains , renfermant
âm es, soumises a l ’autorité religieuse de six évêques ,
un archevêque , un cardinal ; 1 052 prêtres sont chargés de ladesserte des miss ions . Sur ce nombre on compte aujourd ’huisoixante-dix prêtres canadiens ou français qui s ’occupent spéc ialem en t des Canadiens . Il y a sûrement de nos compatr iotes dans tous les comtés et toutes les towns de l ’Etat . Unnombre de sept ou huit milles sont dispersés dans le congrégation s re ligi euses de nationalités différentes .
352 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
Coopersvil le .
R ouses PointChamplainCc iota W est ChazyMooers ForksAltonaE llenburgh
Cherubusco .
TitusvilleTrout-R iverConstableFort CovingtonMassena et MisPostdam .
BrushtonBrashers
,Mis .
Constab leville .
Ogden sburgh
C layton .
Cap Vincent .
G ouverneur…Baldwinsville .
Onondag
UticaBallstonvv &ÜC Ï VIHG
RochesterBuffalo .
Platteburgh .
1 8 ,745
Voi là, messieurs , le bilan de notre f orce numérique .C ’est peu
,me direz —vous , a côté des cinq mi llions d ’âmes
appartenant à d ’autres nationalités . C ’ est peu , s i nouslaissons ces descendants Canadiens —français s
’ass imuler aun peuple qui ne pourra jamais faire de nous que descitoyens médiocres ou nuis ibles . Mais cette force sera
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 353
grande pour le bien,féconde pour les œuvres sociales et re
ligieuses , s i e lle demeure fidè le à sa mission ; e lle sera pu i ssante par sa multiplicati on , si nous savons nous appropn er ,les qualités énergiques du caractère saxon , et conserver toujour nos mœurs pures
,et notre foi religieuse . Notre hrs
toire nationale nous a glorieusement enseigné ce queâm es , courageusement unies dans une même pensée de foiet de dévouement
,pouvaient accomplir dans l ’ espace d ’un
siècle ! R éunissons nos forces par l ’union et le sacrifice .
Emparons-nous de suite , car le temps presse ,des meilleur s
moyens de protection,et l ’avenir redira dans cinquante an s ,
ce que Canadiens-Français de l ’état de NewYork ontfait depuis 1 884 .
Je passe a la deuxième question , M . le Président .L
’
ém igration canadienne dans cet Etat est-e lle bien an
cienne ?C ’ est un fait histor ique , admis de tous , que les premiers
missionnaires du Canada et les découvreurs français furentles premi ers à parcourir le territoire de l ’ état de New Yorket y implanter la civilisation chrétienne . Nous avons desdroi ts au sol que nous foulons
,comme a la protection du
drapeau étoi lé Il y a deux cent quarante ans , nous apprend ,l ’bon . F . Woods , un missionnaire français venai t se refugierà l ’ endroit précis où cette vil le d ’
A1bany est construite , etque l ’on appe lait alors Fort Orange . A la fondation de laprem i ère église catholique de cette vi lle nous voyions desCanadiens-Français agir comme vieux citoyens catholiquesde ce pays . Pierre Morange est encore un Canadien-Francais , marchand de grande réputation , et citoyen d
’
Albany ,
prenant une part active à la réception du général Lafayette .
1 .un 1 609 le capitaine Samuel de Champlain découvrait le lacqui porte son nom , en même temps qu
’ i l étudiait avecscience un grand nombre de postes qui forment aujourd ’huile comté C linton
,le comté le plus canadien de tout l ’Etat .
Nous y sommes âmes sur une population deC ’ est a l ’époque malheureuse des troub les de 37-38 ,
qu’une émigr ation plus forte , plus régulière forma les centres
de New York cité , d ’
Oswego , de Fort Covington ,de Mas
sena, d
’
Ogden sburgh , de Champlain et de P lattsburgh . Unpetit groupe d
’
Acadien s avait déj à formé une petite miss ionreligieuse sur . les bords de la rivière Chazy ,
que les pèresj ésui tes du fort Laprairie visitai ent anuellem en t .
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
Vers 1 858 une autre ém igratiofi canadienne commençaà se di riger vers Troy et Cohoes où e lle forme aujourd ’huiun é lément qu i est le cingui èm e de la population totale .
P lattsburgh,Ogden sburgh ,
Oswego,et les town s en
vi ronnantes furent les princ ipaux centres où se portèrent nosinfortunés compatriotes
,fuyant les forces et les tyran ies
anglai ses . Bu ff alo a éga lement reçu une émigration canadi enne très ancienne .
Maintenant,messi eurs
,vous di re que la plupart de nos
compatriotes émigrés dans cet Etat avaient des motifs louables de le fai re
,c ’ est chose facile à démontrer .
Les prem i ers ne cherchaient qu’
à découvrir de nouvel lesterres afin d ’ajouter de nouveaux fleurons a la couronne deFrance . Ils avai ent pour compagnon le véritab le soldat dela cro ix
,le m i ssionnai re R écolet ou Jésui te , et leurs courses
et découvertes seront toujours les plus be lles pages de l ’hi stoire amér i ca ine : Parkman
,malgré ses préjugés sectaires ,
1 end cet hommage a nos pères prem i ers pionni ers de cetEtat , qu
’
i ls furent les vrai s c ivi lisateurs de l ’Am ér ique .
Que penser,que di re de la conduite des victimes de —37 !
malgré l ’ erreur de leur nob le et généreuse résistance ; est— i lposs ib le de ne pas béni r la Providence
,qui a fourni un re
f uge'
assuré a ces pauvres fami lles canadiennes fuyant devantle feu , le fer et la proscription . Honneur ! reconnai ssance àce magnan ime
,Mart in VanBuren
,président alors de la
nation amér i cain e, qu i ofir i t a nos malheureux proscrits , le
sol , l ’ industri e et la protection d ’un peuple généreux !Ceux de nos frères qui vinrent chercher la rémunération
du travai l dans les usines de Troy et Cohoes,doivent leur
abandon de la Patrie a l ’ i n cur ie des gouvernements d ’alorsqu i s
’épui sai en t dans des luttes stériles,au lieu de réunir
leurs forces en faveur de la grande cause de la colonisation .
S ans doute , qu’
i l ne faut pas méconnaître que les vicesde l ’ in tempéran ce et du luxe ont chassé plus d ’une fami llecanadi enne de leurs fertiles terres pour en faire des esclavesdu capi taliste américain ; mais en vérité , qu ’
avon s -nous faiten Canada pour les reteni r ? La presse d ’alors
,les orateurs
pub li cs , les gouvernements eux-mêmes , par leurs organesles plus autorisés
,ne cessaie‘nt de j eter l ’an athèm e a ces pau
vres enfants de la Patri e qui ne fuyaient que devant lamisère morale et matérie lle . Ruinés par l
’
imprévoyance et
le ' vi ce de son chef ,combien de fami lles canadi ennes n ’out
356 LA REVUE FRANCO —AM ÉRICAINE
gneur s les Evêques comprennent parfaitement , mais qu ’ i lsne peuvent p as toujours satisfaire ; mais a côté nous avonsde be lles espérances pour l ’avenir , et des consolations actuelles .
Je m ’aperçois MM .,que j ’ai déjà été long. Je ne ferai
'
qu’
indiquer nos forces et les moyens que nos devons prendreS ] nous voulons procurer une plus forte vitalité à l ’ é lémentcanadien des Etats —Unis .Nos forces
, nous les trouverons d ’abord dans ce signede la Foi catholique que l ’Egli se a déposé sur nos fronts ànotre entrée dans le monde
,et dans cette be lle langue fran
çai se‘ que nos ancêtres ont déposée sur nos lèvres . Soyons
franchement chréti en et attachés à l ’ enseignement de l ’Egli se de D i eu ,
et nous seront inébranlab les comme le roc surl equel repose cette Eglise divine ! Parlons français et toujours on nous distinguera honorablement parmi les autresnationalitésNous , Canadiens —français , catholiques , nous aurons la
V itali té domestique en portant le respect le plus grand posBible à ce contrat conjuga l
,institué par Dieu
,surn aturali sé
par Notre Seigneur Jésus -Christ,et devenu la base sacrée
de tout bonheur domestique ._Le divorce matrimonial a été
i nventé pour le malheur et le châtiment domestique des peuples corrompus ! _
Il,n e convient nul le part au peuple cana
di en . En garde donc,chers compatriotes
,contre cette
erreur funeste , sanctionnée par les lois de ce pays ! Le divorce est une peste qui apportera au sein de vos familles ladésolation religieuse et ,
sociale .
L a vitalité domestique , nous la trouverons encore dansla pratique de l" ce onom ie
,é loignant de nous les vers rongeurs
du luxe et l ’abruti ssem ent de l ’ in teinpéran ce . Soyons prévo yants dans nos affai res de chaque j our ; ayons cette nob leet lég1 tim e ambition de sort ir de notre état d ’ infériori té . Et
pourquoi pas , MM . n ’avoir pas cette ambition ?Nous avons l ’ inte lligence , nous aimons le travail on
nous reconnaît l ’habi li té dans toutes les industries ! D ’oùvient donc que nous ne pourrions pas parvenir
,comme les re
pré sen tan ts de tous les autres peuples ,à commander le ca
pital , _
a créer des étab lissements de commerce , a avoir notrepart aux c harges pub liques ? Ah ! c ’ est que nous manquonssouvent de cette nob le fierté gauloise qui faisait dire a unroi de F rance cette be lle parole devenu un axiome français :tout es t perdu for s l
’
honneur !
LA REVUE '
FRANCO-AMER 1 0 AINE 357
Mainten ant,comment aurons-nous la Vitalité sociale ?
Par l ’ ins truction générale de ces générations nombreuses quis ’élèvent dans nos familles canadiennes ! C ’ est l ’ école françai se ,
anglaise,et catholique qu ’ i l nous faut ! L a, est tout
le programme “ de notre amé lioration sociale . Si nous ne
mettons “pas a cette question vitale , toute notre énergie ettout notre dévouement nous sommes perdus a la Foi et atout espoir de progrès social ! Cette vérité importante aujourd
’
hui e lle est admise par tout Canadien digne de ce nomI l faudrait tout un livre pour la développer convenab lement .Prêchons la tous avec force . Dans une cause aussi sacrée ,tout chréti en doi t se faire apôtre Un troisième moyen c ’est ,
de prendre une part plus active,plus consciencieuse , aux
afiai res publiques de notre patri e d ’adoption . La naturalisation dan s cet état n ’ est pas un besoin considérab le , vu quele grand nombre des nôtres sont c i toyens par naissance endroi ts acquis depui s longtemps . En 1 880 , dans le comtéC linton
,i l n ’y avait que 700 voteur s étrangers sur
Instrui sons—nous bien sur la valeur des partis politiquesqu i se disputent le pouvoir dans ce pays . Lisons les journaux
,préférab lement ceux pub liés aux Etats-Unis ; formons ,
parmi nous,des sociétés de b i enfai sance , nati onales , des
clubs d ’
am usem en ts honnêtes . C ’est par la que nous nousconnaîtrons davantage
,et que nous apprendrons combien i l
est nécessaire de nous protéger . Les écoles du soir sont possib les dans tous les vil lages
,et si les travailleurs savai ent
s ’ en servir nous verrions bientôt un progrès socia l parmi eux .
Enfin MM .,la
‘
vi tali té religieuse , nous l ’aurons toujoursparmi les Canadiens émigrés tant que le bon prêtre canadiense trouvera au milieu d ’ eux
,partageant leur vie
,parlant leur
langue , et les réchau ffant sur le sein de leur mère divine ,l
'
Egli se C atholique ! Il y a cependant , des dangers biengrands à éviter . Les mariages mixtes
,la lecture des mau
vais j ournaux et des livres hérétiques,la fréquentation des
églises protestantes et surtout mes chers amis,l ’affiliation à
ces soci étée ténébreuses où l ’on attire un trop grand nombrehé las ! de nos malheureux compatriotes . D éfion s —nous decet étendard trompeur qu ’on arbore sous nos yeux : on yinscrit “ science et charité ,
” et cependant c ’est un signe deralliem ent et de guerre contre les doctrines et les traditionsde l ’Egli se Catholique . Nous l ’aurons
_
cette vitalité religieuse en produisant des œuvres de chari té . Nous l ’aurons ,
358 LA REVUE FRANCO-AMERICAINEsi nous sommes catholiques pratiquants , mais non des catholiques l ibéraux ,
prétendant é largir les dogmes de l ’Egli se ,
et adouci r la sévérité de ses règles de morale . Ceux— làn ’on jamais apporté aucune f orce a l
’
Egli se catholique aucontrai re
,i ls deviennent b i entôt matérialistes , i ls tombent
rapidement dans cette infidélité re ligieuse que nous voyonsrégner au m i lieu de nous pour la perte de la nation am ér i
caine .
Voila nos forces nationales ; voi là que lques —uns des dangers qui m en açen t notre existence comme Canadiens-françai s et catholiques .
Conservons notre F oi , notre langue , nos mœurs et nosbe lles tradi tions et l ’avenir sera sûrement à nous .
F. X. Chagnon ,
Prêtre M i s .
360 LA REVUE FRANCO-AMÉRÏ CAINE
considérable des canadiens-français . C e consei l fut repouss éet peu s ’ en est fal lu qu ’ i l n ’ait détruit à tout jamai s la possibi li té d ’ étab li r des re lations plus étroites .entre ces deuxbranches cousines de notre race . Même
,pouvons-nous di re
que le malentendu n ’a pas duré et que nous nous entendonsaujourd ’hui comme nous devrions le faire ? I l es t sûr , danstous les cas
,que n otre ami ti é y gagnerai t à être plus chaude
et plus confian te .
Après tout,ce que nous voulons
,c
’
est_
le succès de notrefami l le françai se et catholique d ’
Am ér ique . Et notre succèsne Se ra que plus grand si nous le remportons en conservantchacun de notre côté le caractère di ctin cti f de chacun desmembres de notre fam i lle ; notre h i stoi re n ’ en sera pas moinsbe lle pour conteni r dans des cadres voi sins , mai s séparés , lestouchantes épopées des P laines d ’
Abraham et de G rand—Pré .
Aussi,à la ve i l le de cette convention que vont tenir no s
frères acadi ens,leur offrons-nous
,apart nos fé lici tations pour
le courage avec leque l i ls savent vivre et grandi r , les vœuxardents que nous form ons pour que se lèvent sur leur groupesles j ours de justi ce
,de liberté
,de grandeur et . de pa ix qu ’
i lsappe llent de toutes leurs âm es
, pour que se réa li sent lesespoi rs de paix re l ig i euse qu ’
i ls conservent au même ti tre queleurs tradi tions ancestrales
,pour qu ’
i ls atte ignent enfin ceport de bonheur vers leque l i ls tendent toujours avec leurinébranlab le f oi , les yeux tournés vers cette étoi le sub limedont l ’emb lème orne d ’un point d ’or les troi s couleurs de leurdrapeau .
Les travaux de la convention ont été. partagés entre quatrecommi ss ions qui s
’
occuperon t des suj ets suivants — 1 . En sei
gn em en t du françai s dan : les éco les ; 2. Agri cu lture et colon i s ation ; 3. La presse acadi enne ; 4 . R e lations des acadiensde s Provinces Mari times
,des E tats—Un i s et de la Province de
Québec .
Chaque paroisse acadi enne (ou groupe d ’
Acadien s ) est autor i sée et pri ée d ’envoyer quatre délégués spéciaux au Congrès ; et chaque succursale de la Société Mutuelle l ’As som ption
,d
’
e 1 1 envoyer deux .
Le Congrès s ’
0uvr i ra par le saint sacr ifice de la messe “
; puisles commissions se m ettr
_
on t'
à l ’œuvre,chacune séparément
Il y. aura,pour l ’as semb lée générale , des di scour s _
'
pronon
cés par les pr inc ipaux orateurs de l ’Acadie et du Canada ,
entre autres par M . Henri Bourassa , présentement enEurope .
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 36 1
Vie Franco-Amé r ica ine .— L
’
hou. A. J. Poth ie r , de Woon
s oc ket , R.
Au banquet de la Chambre de Commerce F ranco—Am ér icaine donné à. Boyden-Heights (Rhode -Island ) l ’honorab leM Aram —J Pothier
,ancien lieutenant-gouverneur , a pro
non cé un important di scours .On en li ra avec intérêt et profit les principaux passages , que
nous reprodui sons ci—‘dessous , parce qu’
i ls donnent la note
Nous avons besoin,beaucoup besoin de ces réunions qu l
perm ettent aux é lém ents les plus sér i eux de notre populati onde se rencontrer . Jusqu ’ ici le sentiment a gouverné , i llusionné m ême
,n os groupes .
Nous avons chanté sur tous les tons la note patrioti que ;i l le fallai t et nous devons continuer la note patrioti que vrai e ;ma i s cette note ne suffit plus i l faut la discussi on loyale desprob lèm es qu i nous concernent parti cu li èrement , et des problèmes politiques ou sociaux qui absorbent la pensée am ér i
caine .
Tout en restant attashées aux traditions nati onales , i l n efaut p as oub l i er que nous sommes Amér icains , que la patrieaméri caine est b i en notre patrie et ce lle de nos descendants ,que le civi sme nous impose des ob ligations , qu ’ i l faut bienrempli r .
“
I l ne faut pas oub li er que notre situati on a changé depuisquarante ans : que de pauvres émigrés que nous étions alors ,nous sommes devenus des propri étai res
,que notre propriété
paroi ss iale et autre se chiffre dans les millions , que nos
groupes sont plus stab les,plus cons idérés et que nous devons
,
à cause de ce progrès , entrer sérieusement dans la vie amér icaine
,protéger nos intérêts tont en travaillant à. la grandeur
de la R épubl ique .
La démocratie américaine repose sur l ’ordre,et l ’ordre
découle des cœurs fiers et croyants . Un peuple qui travail le,
qui cro i t et espère est un peuple heureux et prospère . Travai l et Foi ; n ’est— ce point la devise des Canadi ens— français ,
de cette race de pionniers qui , les premiers , creusèrent le sil londe la civi li sation sur ce continent ? En restant fidè les à cettedevi se , ne comptons-nous pas parm i les citoyens les plus dés ir rbles de cette R épub lique de —travai lleurs
,de cetteR épub lique
qui ne reconnaît d’autre ar istocratie que cel le du mér ite parle travai l ?
362 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Honorons le travai lleur , respectons le bras qui frappel ’ ,enclume mai s encourageons davant age le cerveau organisateur qui di r igera ce bras et fera jai lli r les étince lles du gé ni ecanadien . Tous les e fforts des hommes d ’affai res doiventtendre à. l ’organisation des forces réelles
,mai s incohérentes
de notre race en Amérique .
I l faut d ’abord savo i r appréci er le talent,la capaci té des
nôtres dans toutes les spheres ou carri ères et s ’un i r ensui tepour fai re fructifier ce ta lent et cette capaci té en leur apportant le secours de notre influence personnelle et de nos cap itaux .
Nous avons 1 educati on industrie lle depui s 40 an s, et pour
avoir de s chefs d ’ industri e,i l faut m ain ten an t
'
un e concentration de capi taux . Les sommes considérab les enfoui es ou perdues dans les m ines i n conues ou dans les '
spéculati ons hasardeuses du marché de Panurge , aurai ent suffi pour doter laNouve l le-Angleterre d ’ industr i es profitables
,di rigées par les
n otres .Comment profiter de cette éducation ou expérience tech
nique des nôtres,n ’ est-ce point là., messi eu rs des Chambres
de Comm erce franco -améri caines de l ’E st,un sujet qui mérite
votre considération ?”
La f rate rn it é lat ine — Le Me s s age r de S . Paulo, (Bré s i l) .
Le M es sager de S . Paulo (Bresi l ) j ournal françai s ,grand format
,célébrait
,le 1 4 juillet
,le neuvième an n iver
saire de sa fondation . Son numéro -anniversa i re qui nousarri ve avec sa toi lette toute fraîche , première page aux troi scouleurs françaises , est remplie des témoignages d ’
approbationet d ’ estime adressés d ’un peu partout à son di recteur
,M .
Hollender Il suffit de li re ces bi llets de fête pour se convaincre que notre confrère ne se contente pas d
’
exercer autourde lui une influence marquée
,mai s qu ’
i l a su,de plus , s ’atti rer
de solides amitiés,ce dont nous le félici tons très sincèrement .
Nous sommes un lecteur assidu du M es sager qui , soi tdi t en passent
,a fait a la “
R evue Franco-Amér i caine unaccuei l chaleureux pour lequel i l voudra bien agreer nos sentim en ts de profonde gratitu .de Sa lecture nous a fai t devinerle rôle important , m ai s peu connu chez nous , joué par lapresse de langue française sud amér i caine ; e lle nous fai tpresque espérer la réalisation d ’un des artic les de notre pro
364 LA REVUE FRANCO —AM ÉRICAINEDans la même correspondance, Monseigneur di sai t qu ’
i l
v avai t deux classes de françai s dans l ’école séparée de NorthBay. Ic i
,j ’a ime m ieux croi re que Sa G randeur s ’ est mal
expr imée ou que la correspondance a été ma l traduite enfrançais
,car tout le monde sai t que la langue françai se ‘ est
banni e de l ecole de North Bay , qu i a pour président Mgr .
Scol lard ; comme syndi cs , Mgr . Sco llard comm e s er rétai re ,
Mgr . Sco llard et comme trésori er , Mgr . Scollard !La comm i s s ion scolai re 0 1 1 1 se compose exclusivement deMgr . Scol lard ne veut pas perm ettre aux enfants canadi ensfran ç ai s d ’apprendre le catéch i sme dans leur propre langue .
On leur impose le catéch i sm e an glai s . Tout récemment , unbrave père de fami lle a dû déch i rer un caté ch i sme anglai squ ’on avai t imposé ‘a s o n fils qu i n e comprenai t goutte de lalangue anglai se .
E t l’
on pour ra i t êtr e ass ez na 1 f pour cro i re que Mgr .
Scollard a im e les Canadi en s —franca 1 s jusqu ’au point de leuraccorder ce que la justi ce la plus élém entai re— quand elle estexempte de préjugé s ne saurai t refuser ?
L’ardeur de l" ‘
i r i shificat ion de Mgr . Scollard ne s ’arrête pas la. Supprimer le franç a i s dan s l ’égl i se et dansl ’école
,voi là qu i est autan t de pri s
,m ai s i l faut s ’occuper
d ’autre chose . Monse igneur fa i t des e ff orts en ce momentpour qu ’un compatriote
,un Irlanda i s
,soi t nommé juge a
Sudbury,pour le nouveau di stri ct judi cia i re composé presque
exc lusivemen t de Canad i ens — fra‘nca i s . On voit le j eu d ’
i c i .Il faut espérer que les hommes pol itiques d ’
Ottawa ouvri rontles yeux à temps et qu ’
i ls ne sou ffri ront pas que l ’on vi enneperpétrer une mon strueuse i n justi ce . Que l ’on nomme u n
canadi en -fran çai s comm e juge a Sudbury et que le candidatde Mgr . Sco l lard ai lle à London On t
,étudi er le français du
bi - l ingues du Nouvel-Ontar io .
Nous avons pu constater nous mêmes pendant notre séjourà Ottawa , l
’
exactitude de q uelq ue s —uns des faits ci tés parAlexi s . Qu ’
i l nous su ffise pour le mom ent de ci ter l ’art i cleque le rédacteur du “ Tem ps ” à con sacré a cette question etqu ’ il a publ i e le m êm e jour que la correspondance c i tée plushaut Vo i c i commen t s ’ exp rim a it le “ Temps ’
Mgr . Scollard,évêque du diocèse du Sault-Sainte-Mari e
,
et curé de North —Bay,explique à sa façon
,d ’après leG lobe
le Canada et le Ci tizen , l ’ in cident m alheureux de la cé lébration de la fête Saint—Jean —Bapt i sté
‘
a North Bay .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 365
Le moins que nous puiss ions di re , après avoir puisé nosrenseignements
,à source abso lum ent sûre , ,
c’
es t qu ’ i l j ouesur les mots
,ne dit pas toute la véri té , et emploi e des ex
pressions ma lheureuses et même b lessantes a l ’adresse desCanadi ens —français de North Bay .
Dans sa lettre en réponse a la protestation des cent vingtCanadiens-français de North -Bay
,l ’ évêque qualifie l ’ incident
de m alentendu trop ins ignifiant pour justifier la pub licitéqu ’on lui a donnée .
Comm ent ! Mgr . Sco llard aurait— i l vou lu que les Canadien s -françai s de North Bay eussent enduré l ’ insulte sansprotester et proteste r pub l iquement . Car c ’ est une insulterée lle qu on leur a faite et non pas un simple malentenduqui a eu li eu .
Voi ci des fa its qui contredi sent les dires de Mgr . Scollard . Les Canadi ens-français n ’ont pas célébré leur fête ledimanche
,et avai ent préparé une be lle messe en musique .
Tout était rgélé entre Sa G randeur , son premi er vi cai re , quiest i rlanda i s . et son deuxi ème vi caire qui est Canadiens— francai s .
Mais voici que pendant la semaine Sa G randeur s ’
absen te
de North Bay . Le dimanche,28 le chœur -français se pré
sente au jubé de l ’orgue pour executer la mes se qu ’
i l avai tpréparée et les autres chants religi eux de circonstance , mai s
i l s ’en vo it refuser l ’ entrée par M . Hughes,le directeur du
chœur ordinaire,qui di t n ’avo i r pas reçu d
’ordres . Les Canadi ene—français indignés sortent de l ’égl i e , et le vicai re irlandais monte en cha ire et fai t une sort i e virulente contre lesCanadi ens — français qu ’
i l qual i fie d ’
ignoran ts et de malappris Il s ’ en est fallu peu qu ’
i l ne les ait traités de parens .
Mgr . Scollard a beau fai re,i l y a la plus qu ’une rivali té
entre deux chœurs a insi qu ’ il le dit dan s sa lettre au G lobe
et au Canada Tout prouve qu ’
i l y a de la part de s Irlandai sune grande in imiti é a l ’égard des Canadi ens —françai s dans lediocèse de Mgr . Scollard , comm e dans les autres diocèsesd
’
On tar i o ou les évêques sont i rlandai s . Tous sont an imésdu m êm e espr it la haine de la langue fran çai se et son écrasement
,non seulement dan s l ’ exerc ice du culte ,
mai s dans lesécoles . Les exem ples foisonnent . Ici on pers ‘écute un instituteur fran cai s comm e à Warren
,d ’où on veut le fa i re
chasser ; la on défend d ’ense ign er aux petits Canadi en s lec atéch i sme en fran çai s ; à Toronto ,
on défend aux élèves
366 LA REVUE FRANCO —AM ÉRICAINEfrançai ses d ’un couvent d ecri re à;
\
leur s par ents en françai s ;et a Sturgeon —F alls , i l ya deux ans , Mgr . Scollard lui-même
a fai t tout ce qu ’
i l a pu pour empêcher l ’ établi ssement d ’uneécole séparée b i li ngue par des sœurs parlant la langue françai se . Mai s les Canadi ens —françai s de Sturgeon-Falls ontrés isté
,pers i sté
,et ont gagné laur point .
L a même lutte va se répéter à North -Bay où les Canadien s —françai s ont déc idé d ’ établ i r une école séparée bi lingue .
Mgr . Scollard a commen cé par vouloi r les décourager . Illeur a di t qu ’
i ls ne pourrai ent pas trouver les institutri cesmun ies des certificats nécessai res
,que le gouvernement ne
voyait pas d ’un bon œi l l’
établi sem en t de ces sorte s d ’éco lesoù l
’
e‘
n sei gnem en t se donnai t surtout en françai s , etc . Ma i sles Canadi en s — françai s de North-Bay se sont adressés à laSupér i eure de s fi lle » de la Sagesse
, qu i di r ige l’
école desCanadi ens -françai s a Sturgeon Fa lls , et ce lle -c i a fai t répondre qu ’e lle pourrai t fourn i r tou s les suj ets qual ifiés dont onaura it besoin
,pourvu que l ‘évêque ne fa sse pas d ’
object ion al ’établi ssement de l ’ école .
Les choses en sont la, et s i nous avi ons un avi s a don
ner a nos compatriotes,c ’est ce lu i de teni r ferme , et i ls
réussi ront a gagner leur point . D ’a i lleurs,i l n ’y a pas que
des Sœurs,ob ligées de se soumettre aux -volonté s de l ’ évêque
du diocèse pour en seigner dans les écoles bi - lingues d ’
On tar io
i l y a des institutr i ces la 1 ques qu i possèdent toutes les qualitéset tous les certificats voulus . M . le curé Desjardins de Sudbury
,a b i en su en trouver pour les écoles de cette paroi sse .
De tous ces faits et i n cidents qu i se passent depui squelques années dan s le nord d ’
On tar io,i l res sort évi dem
m ent que la lutte est engagée'
pour la prédominance danscette parti e du p ays en tre l ’ élément canadi en -f ran ça1 s etl ’ élém ent i rlandais catholi que . Ce lui -c i est infiniment moin snombreux
,m ai s beaucoup plus agress i f et haineux de tout
ce qu i sent le françai s . A n os compatri otes de rés i sterpai sib lement mai s fermem ent . A eux de m ainteni r en fondant des école s et des égl i ses où l ’on parle la langue françai s e ,
les positi on s défen sives qu ’
i ls occupent déjà , et par den ouveaux e f forts en gagn er de nouve l les .
De leur fermeté à défendre leur langue dépendra leurinfluence auprès des gouvern ements et dans l ’adm ini strati ondu pay s .
L es deux articles qui précèdent dem andent des oommen
368 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINEdans le passé . Ma i s on ne peut demander une profession def o i à chaque nouve l immigrant . Une immigration considerable am ènerait très problablem en t —un lot de mécréants !Ensui te les Combe : et les C lémenceau ont réussi a donnerun si mauvai s renom . a la F rance auprès de l etranger l
Même les bons Français sont soupçonnés d etre infectés,
sans qu ’
i ls s ’ en douten t , _
du mi crobe révolutionnaire . Aj outez que bon nombre de Canadi ens
,surtout dans les sphères
gouvernementales et les classes instru ites,ne répugnent pas
tellement à certaines idées anticléri cales .Un afflux d ’
imm igrants Françai s menacerai t de fai reprogresser l ’ espr i t d ’
i n subordin ation,peut-être l ’esprit de
scepti ci sme et d ’
in créduli té,sinon de haine à l ’Egli se .
Pour toutes ces raisons,et d ’autres
,que j e ne pui s
déve lopper i ci , m a convi ction est que les immigrants françai s ,
i n spireraient de la défiance dans la province de Québec,
et auraient beaucoup de déboi res . Ils seraient peut-êtremi eux dans l ’Ouest
,où i ls pourraient former des groupements
homogènes , quelque chose comme des paroisses ou des comm unes . Mais réussirai ent-i ls
Le t ro i s ième centena i re de Qué bec
I l faudra assez de temps pour tirer les conclusions qu i sed égagent des m anifestations qui viennent d
’
avoir lieu a Québ ec . Deux questions se posent à celui qu i a suivi de prèsl ’organ isation des fêtes ou qu i a pu coudoyer les personnagesqui ont été mê lés a l ‘
engren age officie l . Le troi sième centen ai re
O
a—t-i l été la dem onstration impériali ste vou lue parLord G rey ? Les Canadiens-français ont— ils réussi à sauver ,à travers les étreintes du proto cole , le caractère dont ils voulai ent orn er l ’hommage preparé a la mémoire du fondateurde Québec ?Au fond
,des deux côtés ,
on a raison de se déclarer satisfait .E t le journal i ste anglai s qui a dit que deux fêtes avai ent étéc élébrées simultanément à Québec est bien près d ’
avoi r donnéla note juste . D ’ai lleurs
,i l fallai t s ’attendre un peu a cela .
L es un s ont glor ifié Champlain et les héros Canadi en françai s tandis que les autres , dans les di scours offici el s ,
ontproclamé la nai ssance du “
G reater Empi re . Comm e quest ion de fait
,le troisième centenaire a laissé tout le monde ce
qu’
i l était,les Canadi ens -an glai s plus anglai s
,les Canadiens
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 369
français plus français,tous plus canadiens
,si c ’ est possible
,
mais personnes plus impérialiste qu ’ i l n ’était auparavant .Nous parlons en généra l
,car i l y a bien eu que lques excep
tions qu ’
i l faut chercher parm i ceux qui , occupant des postesplus en vue , ont cru qu ’ ils devai ent fai re preuve d ’une coudescendan ce voi s ine de la faib lesse . C ’est ainsi que certainspersonnage s qu i n
’ont pas trouvé un bout de ruban ou dedrapeau pour décorer leurs maisons aux fêtes pourtant biennationales de Mgr . de Laval , ont fait beaucoup de frais dedécorations pour l ’ inauguration des Champs de Batail les .Mai s ce sont la des questions de détail sur lesque lles nousreviendrons .
Lé on Kemne r .
V ieux articles et vieux ouvrages
Pages Oubl ié es .— Voi c i quelques pages dé li cieuses , cho i s ies
dans l ’ oeuvre d ’A rmand S i lves tre , et qui m ettent en lum ière
ses qual i tés de conteur et de poète
L E CL AV EC IN
Je le revoi s encore dans le grand salon de G randbourg ,
en l ’hospi tali ère mai son où j e passai s mes vacances d’
écolier
d ’où l ’on descendai t jusqu a la Seine,en face de Soisy—sous
E tioles,par un long jardin en pente
,aux charmilles paral
lèles au fleuve,savamment étagées par un élève de Le Nôtre ,
une grotte i ci toute nacrée intéri eurement de coqu i llages , unbe lvédère la aux vitraux de couleur interrompant seulementla be lle harmon i e des parterres
,paradi s automnal où j e volais
des rai sins aux tre i lles , où la petite Eve brune qu ’ étai t déjàma cousine Marthe m ’
atten dai t déjà sous les pommi ers .Je le revoi s fai sant
,près d ’une large fenêtre aux rideaux
a ramages d ’
un ton dél i c i eusement fané,s i bien partie du
mob i li er vi ei llot dont des housse cachai ent,par endroi ts
,la
ruine,étoff e s usées aux coins dan s des ossatures dédorées ,
leclavecin qu ’on n ’avait pas ouvert depui s que notre grand ’
tante Paule étai t morte,le clavecin dont les notes aigrelettes
perlai ent pén ib lement sous les doigts maigres et blancs ,ve inés de b leu jusqu ’aux ongles
,de la chère trépassée
,quand
de Lul li ou de R ameau elle réve i llai t les cadences douces etsurannées , rythmant son propre rêve au caprice de sa mémoi re , l ’ore i lle tendue a sa propre musique comme s i le souffle des anc i ens aveux y passai t encore
,adorab le vraiment la
petite viei lle dont les yeux se ral lumai ent et qu i , vaguement ,souriai t a d ’
invi s ibles images,comme s i des absents chers
étai ent accourus pour la veni r entendre .
Quand on l ’avai t emportée,a travers le grand jardin ,
jusqu a la porte cochère tendue de noi r,i l nous avait sem
blé , à Marthe et am oi,que le clavecin avait gémi tout seul ,
372 LA REVUE FRANCO —AM ÉRICAINE
de fai re captif l ’oiseau éperdu ,mais de d’
ai der à recouvrer saliberté .
Malheureusement de plus en plus effarouché , i l secognai t maintenant au plafond ou se pendait aux rideaux ,
haletant,les peti tes flammes de son gosier palpitant comme
celle d ’un flambeau au vent du soir . Marthe eut l ’ idée qu ’i l
le fal lai t délicatem ent sai si r dans un fi let à papillon , dontle tissu léger ne lui pouvai t fai re aucun mal , et de l ’emporterensu ite dans le jardin où le grand ai r rouvrirait bientôt sesai les lassées . E t
,tous les deux
,nous courûmes dans le ves
t ibule pour chercher le fi let . Mai s,quand nous revînmes ,
le rouge -gorge,sans doute mi eux avisé quand nous l ’eûm es
débarrassé de notre présence , étai t certainement parti par lacroisée toujours grande ouverte , car dans aucun angle de lamurai lle
,dans le pli d ’aucun rideau nous ne le pûmes dé
couvrir .
E t ayant refermé la fenêtre,cette f ois -là
,afin que la
tentation ne le prit pas de revenir , nous all ions nous remettreau clavecin
,quand le roulement de deux carrosses bondés
sur la route,nous avertit que les amateurs de la fête d ’
E s
sonnes allai ent rentrer . Brusquement nous recouvrîmes lestouches jaunes et grises du vieil instrument et nous rabattimes le dessus
,avec un peti t nuage de poussière .semblant
l’
halein e des petits amours jou fflus que ce mouvement insoliteavai t es soufflés . Il étai t temps .
Le salon étai t plein,un instant après , de toilettes pou
dreuses,aff alées sur les housses des fauteuils , d ’une gaieté
évidemment destinée à augmenter notre regret,et d ’une
odeur de pain d ’épice qui nous donnai t faim . Il était tard ,
d ’ai lleurs,déjà . Le solei l
,incendiant les vitres de la large
fenêtre,se couchait derri ère Drave i l
,traînant de grands fils
d ’or rouge sur la Seine,où des chalands aux cabines fleuries
descendaient lentement dans une buée roseOr
,cette nuit-là j e ne dormi s pas . Ma cous ine Marthe
m ’avait fai t de la peine en me quittant . J ’en étais déjàtrès amoureux et i l ne m ’ en fallai t pas beaucoup , d
’ e lle ,pour me fai re sou ffri r . Peut-être avait—elle retiré trop tôtsa petite main de la mi enne
,ou le bonsoir qu ’el le m ’avai t di t
avait— i l eu moins de tendresse qu’
à l’
accoutum ée : enfin ,
j ’étai s très m alheureux .
LA REVUE FRANCO -AMERICAINE 373
Le sommeil fuyant mes paupières , j e quittai ma chambre sans fai re de bru i t , et , nu —pieds , j e descendi s dans legrand salon
,sans flambeau
,sachant qu
’
à cette heure , 1 1
étai t largement illuminé par la lune . Cel le-ci , en effet , ytendait comme une grande nappe blanche sur le parquet ,te lle une fée pour le repas mystérieux des E lfes qui rouvrentles corol les c lose des volub i li s pour y boire . Et des rayonsperdus
,comme des flèches d ’argent , se piquaient , çà et la,
dans les rideaux ,aux an gles des meub les usés , des lueurs
plus attendries,plus vivantes semblant courir sur le
clavec in .
Mai s,a pe ine entré , une émotion e ff royab le , inattendue ,
tenant autant de la peur que de la surpri se , me prit à lagorge
,pendant que le poids de m es cheveux semb lai t s ’al
léger arr-dessus de mon front . Le clavecin jouai t : il j ouaittout seul ! Un air
,non . Mais beaucoup d
’
ai r s qui semblaien t se croiser et s ’
in terrom pre les uns les autres , lescordes gém i ssant dans toutes leur longueur sous un gl i ssement subtil
,un brui t étranger à ce lui des cordes , un frôle
ment douloureux et saccadé contre le boi s accompagnant leségratignures de cuivre
,tous ces sons se mêlant , se renflan t ,
s’
am oi ndr i s san t suivant des harmon i es bizarres , en une mélodi e etoujour s commencée , toujours interrompue , comme onen entend dans les rêves qui vous angoissent .
J etai s bien sûr que ma cousine Marthe et moi nous avionsfermé le piano . Si que lqu ’un en eût joué
,d ’ai lleurs
, jel’
eus se aperçu dans cette obscure clarté qui venait de la lune .
L ’ombre de la tante Paule ,— nous nous imaginons les om
bres transparentes dans la nui t me hantait . Nousl ’avions peut-être gravement offensée
,la bonne petite vieil le
en touchant à son clavecin !Parfoi s , cette musique étrange se taisait , et j
’en epronvai s comm e un soulagement . Mai s j e n
’
osai s m ’en aller .Je voulai s être sûr qu ’ e lle était bien fini e et ne recommençaitpas . Mai s e lle recommençait avec des s tr i deur s plus éperdues , avec des caresses plus douloureuses sur le bois et ungrincement plus aigu des cordes . Et j e restais toujours la.
Et ce fut seulement au matin , quand ,dans le grand salon
,
les tentures se rosèrent doucement,le réveil semb lant mon
ter , des eaux de la Seine , sur l ’onde tremblante des vapeurs
374 LA REVUE FRANCO -AM ÉRICAINE
que le c lavecin se tut,s i longtemps que j e me sentis dé livré
du charme .
Quand j e contai,le lendemain la chose a ma cousine
Marthe,e lle se signa et jugea , comme moi , qu ’ e lle étai t
grave et que nous ferions b i en de nous con fés ser quand lecuré d ’
Evry vi endrai t déj euner a la maison . Or , il vint lej our même
,et pour une demande qui , vraiment , touchait a
la fatali té . L’
harm on ium d e sa petite égli se étant en r épa
rations,i l venai t voi r si le vi eux clavecin de notre grand ’
tante Paule ne pourrai t servi r à accompagner les vêpres dulendemain
, qui étai t jour féri é . Marthe et moi,nous nous
regardions avec stupeur .Comme on lui fai sai t observer
,tout en lu i accordant de
grand cœur , que l ’ instrument était en b i en mauvai s état , lebonhomme demanda la perm i ssion de l ’ouvri r pour juger luimême de l ’état des cordes . A peine l ’eût-i l fait
,qu ’ il poussa
un cri d ‘
éton nem en t .
Venez voi r ! fit -i l .Sur les cordes
,étendu
,un petit oiseau mort
,aux ai les con
vulsées,aux pattes raidi es
,Marthe et moi nous com
preni ons seuls . Nous avions enfermé le malheureux rougegorge dans le clavecin où i l s etai t abattu pendant que nouscherch ions un fi let à papi llons . C etai t son agonie dans cecercuei l sonore que j ’avai s entendue toute la nuit !Quand , après l ’avoi r reti ré on posa le peti t cadavre sur
le rebord de la large fenêtre où le vent souffla,inutile
,dans
ses ai les inertes , j e ne sais mais i l nous semb la,a
Marthe et a m oi, que notre grand
’
tan te Paule mourait uneseconde fois et que d ’
i nvi s ibles prêtres chantai ent dans legrand jardin .
376 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
Au froid contact , au bruit sini stre des ciseauxCoupant brutalement tes boucles parfumées ,Que se passera-t-i l dans les âmes gourméesDe ces heureux du jour , de tous ces contentés ,Qui , jusqu
’aux pi eds de D i eu ,traînent leurs vanités ?
De que l enseignement sera ton sacrifice ?L ’un a que lque folie et l ’autre a que lque viceR etourneront sans doute au sorti r de ce lieu
,
Pauvre fi lle,où tu vi ens de di re au s i ècle adieu .
Ce soi r,lorsque
,ayant bu jusqu ’au fond le calice
,
Lasse d ’ être à genoux,saignant sous ton c i li ce
,
E t lai ssan t jusqu ’au so l tes mains jo intes tomberTu frémi ras
,craignant un jour de succomber
Sous le faix écrasant de tes saintes fatigues,
Ces hommes replongés déjà dans leurs intrigues,
Ces femmes se parant pour un plaisir nouveau,
T’
oubl ieron t dans ton c loître ains i qu ’ en un tombeau '
Ma i s j’
ai tort 0 ma sœur ! mon âm e peu chréti enneNe sai t pa s e lever au niveau de la ti enne .
C ’est parce que le monde est justement ‘ainsiQue ta j eunesse en fleur va se faner i ci .Pour tout le mal comm i s par les hommes impi es ,Tu t ’
o ff res en victime innocente et l ’exp ies .
Dans la tri ste balance,au dernier jugement
,
Tu croi s qu ’
i l suffira peut—être seu lement,
Pour voi r se re lever le plateau des scandales,
Du poids de tes cheveux répandus sur les dalles .
Tu vas veil ler,j eûner
,languir
,mais tu le veux .
Dans toute leur rigueur accompli s donc tes vœux .
Le fardeau des péchés du monde est rude et grave ,Ma pauvre sœur ! Pour tous les tyrans soi s esclave ;Sois chaste
,ô sainte enfant pour
,tous les corrompus .Franç o i s Coppé .
(R éci ts et élégi es )
Quarante minutes de Retard
En gare des Aubrais,vers six heures du so r
,en ét é . : Sur
le quai,une dizaine de personnes attendent . Un emp oyé
passe et dit à. haute voix Le tr ain de Paris a quaranteminutes de retard .
” Les voyageurs se dispersent alors avecennui . Deux dames
,qui se d r igent chacune de son côt é vers
la salle d ’attente arrivent ensemble a la porte . Elles se regardent l ’une s écrie Jeannette l ’autre r épondNoémi Et
,apr ès une seconde d ’
hésitat ion,elles tom
bent dans les bras l ’une de l ’autre .NOEM I.— Comment c ’est toiJEANNETTE .
— Oui . Je ne crois pas encore que ce soitnous J ’ai besoin de m ’y faire .
NOEM I .— Est-ce que tu me trouves chang éeJEANNETTE .
— Je te trouve tout de même . Et toiNOEM I .— M0 i
,j e t ’aurais reconnue à. cinquante pas . Oh
crois—tu Ce hasardJEANNETTE .
— Efi effet Ah,méchante fil le
NOEMI .— POŒ quoi me dis—tu çaJEANNETTE .
—Tu le demandes Toi qui devais m écrireTo'us les mois
NOEM 1 .— Eh bien,et toi Toutes les semaines ! L ’
as —tufaitJEANNETTE .
— Oui . Trois semaines .NOEM I . — Et apr ès .JEANNETTE .
— Ah dame Apr ès Mais moi,tu sa1 s qu ’
é
cr ire ça 1 1’a jamais ét é mon fort . Toi , au contraire , tu adorais
faire les lettres . Aussi,tu es bien plus coupable !
NOEM I. —Enfin,laissons ça . Te voilà dônc
JEANNETTE .— Nous voic i
,dans cette gare , apr ès
combien d éjàNOEM I .— Attends que j e calcule . Tu avais
,toi
,a la fin
de ta classe supérieureJEANNETTE .
— Se’
ze ans et demi . Et toi dix—sept .NOEM I. — Nous avons quitt é le couvent ensemble . ça
nous fait . d ix—sept . vingt— sept . trente—sept . et puis . çanous fait .
378 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
JEANNETTE .— Vingt-quatre ans
,ma ch érie
NOEM I .— Vingt—quatre ans Oui . Mais alors tu en as quaranteJEANNETTE .
— Et toi quarante et un,ma bonne petite.
N0 EM 1 .— Comme c ’est arrivé viteJEANNEŒT E .
— TYÈS vi te . Plus que le rapide de Paris .NOEM I — Nous sommes deux presque vieilles dames .JEANNETTE .
— J’en ai peur . Qu ’es—tu devenue
NOEM I .— Tu ne le sais pasJEANNETTE….Mais non Et toi aussi
,tu n ’es pas au
courant de mes affaires,j ’en suis sûre Nous nous sommes
quitt ées en nous jurant de nous écrire,de ne j amais nousper
dre de vue . . Et pu i s…rien . Personne n ’a donné signe devie.
NOEM I .— C ’est vr ai . Eh bien,j e suis mari ée .
JEANNETTE .— MOÏ aussi . As —tu des enfants
NOEM I.— Une fille .JEANNETTE .
— MOÏ,un garçon. Je devrais avoir aussi une
Je l ’ai perdue .NOEM I. — Pauvre amie Comment t ’appelles-tuJEANNETTE — Madame Leroux . Et toiNOEM I . — Comtesse de Pr écy. Où demeures—tuJEANNETTE .
— Impasse des Jacobins .NOEM I.— Où prends—tu ça Du côt é de PassyJEANNETTE .
— C ’est à Angers .NOEM I . — Tu n
’habites pas Paris
JEANNETTE .— Non . Ça t
’étonne
NOEM I.— Que fait donc monsieur Leroux C’eSt le pr éfet
Tu es la pr éfèteJEANNETTE .
— Non . Il est professeur de rhétorique aulycée d
’Angers , mons ieur Leroux.NOEMI.— Tu m ’en diras tantJEANNEŒT E .
— TOÎ,tu habites Par is
,alors
NOEM I .— Six mois seulement,Cours—la-Reine . Le reste
du temps aPrecy,la terre de ma belle-mère
,dans l ’Orne. Ou
bien nous nous offrons un Voyage ; L’année derni ère , nous
avons fait le Mont énégro . Tr ès curieux. Je te le conseille ,quand tu auras un moment de libreJEANNETTE .
— Tu ne te moques pas de moiNOEMI. — Oh
,Jeannette
JEANNETTE .— Je croyais . Le Monténégro Ah
, Seigneur Nous avons bien d ’autres choses à penser .
NOEM I .— Tu n’es pas heureuse
380 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
NOEM I .— Quelles sont vos distractions,à Angers
JEANNETTE .
— NOS t * avaux .
NOEM I . — Mais en deho s du t* avai]JEANNETTE .
— Il ne nous 1 este gu ère de loisir . Tu n ’imagines po
'
nt ce que c ’est qu ’une classe,et une rhétorique ! à
bien faire,quand on pi end son métier à cœur , comme Hen1 i
C ’est bien absorbant,va .
NOEM I .— Continue .JEANNETTE . Les leçons les devoi * s à corriger . . la pr é
parat ion des textes . J’ai beau l ’aider un peu .
NOEM I . —Tu l ’aidesJEANNETTE .
— Oh l si ça peut s ’appeler aider C’est—à
dire que j e co r
1 ige la composition des él èves . Pas toutes . IlV en a qui sont tr0 p fo tes pour moi
NOEM 1 .— Vous faites ça le soirJEANNETTE .
— GéE é alement,oui
,apr ès le d îner . On
allume la petite lampe .
NOEM I .— Une fois que tu as couch é l ’enfant . Je vois çaJEANNETTE .
— Oh l Il se couche bien tout seul . Gastona seize ans .
NOEM I .— Seize ans Déj à ! Tu as un fil s de seize ansJEANNETTE .
— Mais dame Tu nous vois donc toujou 1 sau couvent des Anges Et ta fill e
,quel âge a—t—elle
NOEM I . —Douze ans et demi . Elle est venue un peu tard .
Elle ne pouvait pas se décide “
.
JEANNETTE .
—Elle te donne de la satisfactionNOEM I .— ‘ Oh
,t r ès m ignonne cha : mante
JE…NETTE .
—Comment l ’as—tu appeléeNOEM 1 . — Madeleine . Raconte—moi donc encore . A1 0 1 s
vous corrigez les devoirs des él èves,sous l ’abat—jour , à côt é
l ’un de l ’autr eJEANNETTE .
— Oui . On ma que les barbarismes au crayonrouge . Ou bien Hen1 i me fait la lecture .
NOEM 1 .— Des romans q ui viennent de paraîtreJEANNETTE .
— Non . Il n ’aime pas beaucoup ça . Moij e n ’
_
eu suis pas folle . Il me lit de l ’hist oire . Du Michelet .Tu connais
NOEM I . — J’ai peu . Un j our
,aux bains de
me“,dans la biblioth èque de l’hôtel , il y avait un tome depa
rei ll é . C ’est t r ès fo: t et,dis-moi
,les vacan ces
JEANNETTE .— Nous voyageons .
NOEM I . — A la bonne heu 1 e As—tu ét é en Espagne
LA REVUE FRANCO -AMERICAINE 38 1
JEANNETTE .
— Non . N ous ne quittons pas la France .
NOEM 1 .
— C ’est ce que tu appelles voyage“
JEANNETTE .
— Tout de même . L ’an pass é nous avons ét éau mont St—Michel . Tu connais .
N OEM 1 .
— Non . Mais j e connais les Bal éares,la Su ède
,
JEANNETTE .
— Et purs,quelquefois l et é
,quand il ne fait
pas tr 0 p chaud , nous allons à Pa is , comme des étrangers .Hen r i
,m e p omène dans les vieux qua tiers , — i l sait beaucoup,
nous .etv
ouvons les de me c s t aces du pass é . C ’est bienint ér essant Et puis
, ça fo me l’
esp it de Gas ton . Il ado eson pè e , cet enfant
NOEM I .— POŒ'
QUOi n’est— i l pas avec toi
JEANNETTE .
— Il est inte ne à Pa i s .
NOEM I .— Tu t ’en es s épa r ée ? Depuis quand ?JEANNETTE .
— L’
ann ée de n ie e . Henri l ’a voulu . Pourqu ’il fit une bonne rh étorique et une solide philosophie . Là.
bas,au lyc ée d ’
Angers , avec le nom de son père , il était t ropgât é . Tandis qu ’
à Par is,a Louis— le—Grand
,il n ’est plus un
privil égi é c ’est un él ève comme tout le monde . Oh ! çanous a ét é t è s dur Et à lui au ssi . Mais il le fallait
NOEM 1 . —Qui est-ce qui le p o m ène ce g r and gar çon , lesj ou r s de congéJEANNETTE .
— NOUS avons de vieux amis dans l ’Un iver s it é .
NOEM I . —Oui,mais en dehe s de l ’Un ivers it é
,veux— tu
que j ’aille le voir et que j e m ’en occupe un peuJEANNETTE .
— Tu es t o p bonne .
NOEM I . -Ca me fer a plai s i *
. Tu di s qu ’il est gentilJEANNETTE .
— La perfection . Une âme cha r mante .
NOEM 1 . -Eh bien ale s,c ’est un bonheur ! Je te ferai
connaît r e mon petit Madelon aussi . Tu ver ras quelle b : avepetite nature de femme ça p omet . Oh elle ne tient pas deson pè c ,
celle— là ! Ma bonne ch é r ie ! Si tu savais commej e suis contente de t ’avoir r et e nvée
JEANNETTE .
— M0 i aussi,va
NOEM I . —Il me semble que c’est une nouvelle p ér iode
dans ma vie , comme si not e vieille am iti é de petites fillesallait reprend r e et recommencer pour ne plus j amais cesser
,
ni s ’
interrompre.
JEANNETTE .
— Ah ! j e le veux bien ! Te rappelles— tu lesSaints-Anges
NOEM I .— Oui .
382 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
JEANNETTE .— La cour du cloître avec son beau c èdre
,
les pots de fleurs des reposoirs .
NOEM I .— La classe de coutureJEANNETTE .
—La maîtres se de solfège et de chant sacr éNOEM 1 .— La mère générale , si âgée qu
’elle avait l ’air d ’unevieille fée en cornette
,. et qu ’on allait la voir dans sa chambre
parce qu ’elle ne bougeait plus de son fauteuilJEANNETTE .
-Oui Et toutes nos anciennes amiesNOEM I . —Les ”deux petites sœurs de la Guadeloupe
,qui
étaient si j oliesJEANNETTE .
— ROSG et Bertha Apr ès toi,c ’étaient celles
que j ’aimais le mieux . Je ne sais pas ce qu ’elles sont devenues,
NOEM I . — Ii y avait aussi une petite fille .
JEANNETTE .— OUÎ. Enfin
,tout ça est bien loin !
NOEM I .— Et b ien pr ès aussi . Je n ’ai qu’
à descendre dansmon cœur
,les j ours de tristesse
,pour retrouver tout comme
autrefois . Je ferme les yeux,j e me retiens de vivr e et j ’y suis .
Je revois la couleur spéciale du ciel entrevu,le matin
,par les
vasistas du dortoir,le soleil qui venait quotidiennement
,à
la même heure caresser,la statue de la Vierge
,dans sa niche
étoil ée d ’or . Je me rappelle le bruit de mes pas le long descorridors frais
,le silence éternel de toute la grande maison
a de certaines heures Tout au plus,par— ci par—là
,entendait
on la petite gamm e lointaine d ’une classe de piano . .um coupde cloche
,ou le soupir d ’un harm omum .
JEANNETTE .— Oh oui .
NOEM I . -Est— ce qu ’il ne t ’est pas arriv é,dans ce temps
là,quand tu étais seule et que tu traversais une des cours
d ésertes,ou un des parloir s vides . . de t ’arr êter
,toute frisson
nante et saisie,émue
,sans savoir pourquoi
,et d ’écouter
,dans
l ’attente,comme s ’il allait tout acoup se passer quelque chose
Quoi ? On n ’en sait rien . Mais,dans ces minutes—là , on vi t
doublement,on éprouve des émotions instinctives
,délicates
et profondes . J ’y ai r éfl échi depuis . Je crois bien qu ’à ces
minutes,c ’est notre âme d ’enfant qui se dégage et se r évèle
à nous—mêmes . Il nous passe une étincelle divine .JEANNETTE . J’ai senti cela . Et souvent Et j e vais
plus loin que toi . J ’ai eu alors la perception myst érieuse etins tantanée
,moi
,que j e me regretterais plus tard telle que
j ’étais à cette seconde . J’avais beau dire et pens er s érieusement que ça n ’était pas bien gai d ’être au couvent
,et r êver
ardemment d ’en sortir . . et pleurer parfois la nuit dans monlit . .Ça ne fait rien . .J
’ai senti maintes fois,mieux que cel a ,
LA REVUE FRANCO —AM ÉRICAINE
JEANNETT E .
— Tu es tr ès r iche .
NOEM I .— Et toiJEANNETTE .
— Pas du tout .NOEM I . -Tant mieux pour ton fils
,alors . Il fait un beau
JEANNETTE . Et toi,qu ’est-ce que tu fais
,en ce cas
NOEM I .— Le bonheur‘
de ma fille .
'
Ça vaut bien un peud ’argent . Voilà qui est entendu .
JEANNETTE, qui ne peut s
’
empêcher de souri re.
— Tu vas,
tu vasNOEM I . —Me r efuses— tu Ah p: ends ga: deJEANNETTE .
— Non . Mais .
NOEM I . — Quand tu aur as vu Madelon,tu en raffoleras .
Aussitôt de retour à Paris,j e vais conqu ér ir ton fils
,il devient
l ’enfant de la maison . . et j e l ’él ève en sezre chaude pour mafillette . (S ifilet.) Tiens . Je crois que voilà mon t ain . Tune le prends pasJEANNETTE .
— Non,j e viens de Par is . Je vais à Orl éans
,
voir une vieille tante .NOEM I . — Alors on t ’écr it Madame Le: oux
,impasse des
Jacobins,Angers
JEANNETTE .
— Parfaitement . Et toi
NOEM I .— Soixante— sept,Cours — la-Roine . Embrasse—moi
,
chérie . Que j e t ’aime Cette cause ie m ’a fait du bien . Rappelle— toi ce que j e te pr édi s Nos enfants s ’
épouseront .
JEANNETTE .
— NOU. S en repa* le ons . En tous cas,à bien
tôt . J ’irai te voir à mon prochain voyage .NOEM I . — AV é 0 ton mar iJEANNETTE .
— Bien entendu .
L’EMPLOYE .
— PI GHGZ garde,mesdames . Un peu en arr i ere
s ’il vous plaitNOEM I .— IIS s
’
épouseront . D ’ailleurs,c ’est mon id ée .
JEANNETTE .
— Mais . . et ton mar iNOEM I . — l l faudra bien qu ’il en passe par où j e veux .
JEANNETTE .
— POLU tant .
NOEM I .— C ’est moi qui ai la fortune .L
’
EMPLOYE .
— L é S voyageur s pour Par is en voitur eJEANNETTE .
-AH revoirNOEM I . — Au revoir
HENRI LAVEDAN,
de l’Academ i e françai se.
Laquelle des D eux 3
(Saynète pour la Sainte-Cather ine)
LOUISE,26 an s .
ANNETTE,1 7 an s .
L oui se es t en t rée san s br ui t dan s la cham b re d’
Annet te , e t elle s’
a r rête ,
in te rd i te , en voyan t s a sœur en la rm es .
LOU I SE — Que st—Ce que tu as ? Pourquoi pleures -tu ?ANNETTE
,tr ès emwyée d
’
étr e surpr i s e .
— Ça n’ est r i en .
L a c”
ê s t fin i .
LOUI SE .
— D i s -m oi pourquo i tu p leures,mon chéri ?
ANNETTE .
— Je ne sai s pas . C ’est . .nerveux . C ’est letemps .
LOUI SE — Allons donc ! Je va i s te le di re,m o i . C ’ est
pour h i er .
ANNETTE .
— H i erLOUI SE— N é cherche pas a me tromper . C ’ est a cause
de la réponse que papa et maman ont donnée h i er a.
ANNETTE ,avec pr e
'
cipi tation .
— A ce j eune homme ? Ma i snon . jamai s de la vie .
LOUI SE— Parfa itement M . Pau l R avn aud, qu i
t ’ava it demandée .
ANNETTE .
— Je te jure .
LOU 1 8E .
— Ne jure donc pas . C ’ est b i en inuti le de fe indre avec moi , va , avec ta grande sœur . Ai — je deviné juste ?
ANNETTE , avec effor t , et bras .
— Oui , j e l ’aurai s pari é( L a pr enan t par le cou . Embrasse vite
,et plus fort que
ça . C ’e st absolument bête et n igaud,tu sais
,de te fa i re du
chagrin pour des mach ines pare i lles,pour un peti t mon
s reur .
ANNETTE .
— Un mari !LOU 1 8E .
— La belle h i sto i re ! Un m ari de perdu,dix de
retrouvés .
ANNETTE .— Pas tant que ça ! Tu es bonne
, toi , tu enparles a ton a i se !
LOUI SE — Que veux-tu d ire ?ANNETTE — R ien . S inon que j e commen ce a en avo i r
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
assez (Sa voix trem ble . ) Je suis humiliée . (E lle
pleure. )LOUISE .
— Qu ’ est-ce qui t ’
hum i lie ?
ANNETTE .— Cela
,tiens ! D ’être toujours demandée et
j amai s accordée . On finit par le savoir dans le monde .
partout,à Pari s
,et même en province . et ça me fait du
tort ; on n’y comprend rien ,
on se dit : Qu ’ est-ce qu ’ i l y a ?Que lque chose d ’
énorm e ,évidemment . On croit peut
être que j ’ai des infir . des infirm i tés cachées ! (Elle
pleure . )
L OUI SE,la câlinan t .
— Es —tu sotte,mon gros chat ! Tou
jours demandée . E t tu te plains ! Qu ’ est-ce que tu dirai sdonc s i tu étais à ma place , moi qu ’on ne demande jamais ,qu i passe inaperçue , comme si j e n
’
exi stai s pas ? Hein ? Tune trouves rien à répondre ?
ANNETTE .—J e pleurerais dix foi s p lus si j ’étais toi , voi là
tout !L OUI SE — Ç a m
’
avancerai t bien ! Crois -tu que c ’ est çaqu i me fera i t monter plus tôt à l ’aute l ? Allons , ne te tracasse pas
, et es suie tes yeux . D ’
i ci très peu de temps— re
ti ens ce que j e te dis— t out ça va changer .ANNETTE
,in er édule .
— Oh !L OUISE — Il n ’y a pas de oh Ça va changer , parce que
j ’ai pri s un grand parti . Quand j e sui s entrée tout a l ’heuredans ta chambre
,j e vena i s justement pour te l ’annon cer .
E s -tu plus calme ?ANNETTE .
— Oui,mais j e ne devine pas .
LOUI SE — Ecoute . Je t ’aime de tout mon cœur , tu lesais ?
ANNETTE .— E t moi , donc !
LOUISE . Tu es b i en sûre que j e ne suis pas jalouse dem a peti te Nette ? Tout ce qui t ’arrive d ’
heureux,même si
c ’est un peu à mes dépens,ah ! Seigneur ! j ’en suis plus
contente encore que si ça m’
ar r ivai t a moi !ANNETTE .
— TU es bonne .
L OUI SE — J e ne sui s pas bonne,tu m
’
en nuies . Eh
bien ! malgré ça , j ’ai remarqué , depuis quelques années , unechose qui me vexe beaucoup . Oh ! mais beaucoup . .C ’estqu ’on te demande toujours en mariage
, toi , m ât ine , et j amaism oi . On t ’a demandé onze foi s depui s deux an s et demi .
ANNETTE .— T0 i aussi
,sois juste ?
LA REVUE FRANCO -AMERICAINE
dupe ? A notre époque , voi s —tu , quah d les messi eurs préf èren t la conversation d ’une j eune fille au plai s i r de la ten i rdans leurs bras , c ’ est pas b i en bon s igne pour e lle ! Bref ,voi là ce que j e me sui s di t “ Pourquo i père et mère s
’
obs t i
nent- i ls a refuser Annette a tous ceux qi 1 i la leur demandent ? — Parce qu ’
i ls pensent que ça me fera i t du tort s i
Annette se mariai t avant m o i,et que j ’aurai s encore plus de
mal,ensui te
,à trouver , E s t -ce ça ?
ANNETTE .
— Qi i an d ce serait , i ls ont bi en ra i son . Tu esl’
aîn ée . C ’ est to i qu ’on doi t épouser d ’abord .
LOUI SE . Oui . Ma i s a une condi tion : c ’ est que j eplai se . Or
,j e dépla i s .
ANNETTE . Peux-tu dire ? .
LOUI SE — Je dépla i s , pu rsqu ’
on me la i s s e pour compte ,et que j e su i s déjà à la fin de ma vingt — s ixième année !
ANNETTE .
— Aux dern i ers l es bons !LOUI SE .
— Non . Je ne m ’
i llus ion n e pas . Auss i , le seu lmoyen d ’ en sort i r , ai —je pensé ,
c ’ est de ne pas me marier .j ’y su i s désormai s résolue .
ANNETTE .
— T0 i
LOUI SE — Mon D i eu,ou i . A quo i bon m ’
en têter ? Jeme sens l ’étoff e d ’une vi e i lle fille . Tout à l ’heure , après ledin er
,j e vai s annoncer la chose à papa et à maman . Ils i n
s i s teron t un‘ peu,par affection, par pol ites s e , parce qu ’
i lsm
’
aim en t b i en dans le fond ; ma is , en eux-mêmes,i ls m ’ap
prouveront,et d ’
i c i une semaine au plus,n os am i s
,nos re
lat ion s,tout le monde saura que Lou i s e Durocher a renoncé
a être une dame .
ANNETTE .
— Tu es folle . Je sui s suff oquée !LOUI SE .
— AloI‘ S ma petite . alors,les onze j eunes gens
qu i dépéri ssent depu i s deux ans qu’
i ls ont été s i mal reçus( sans parler du douz i ème d ’h i er
,de ce Paul R aynaud
, qu i net ’ est pas i ndi ff érent , s i j ’en croi s mon peti t do igt de grandesœur ) ,
avant quinze jours i ls vont rappl iquer tous a la m ai
son pour te redemander . Tu n ’auras plus que l ’ embarrasdu choix , et père et mère seront forcés de te lacher . Voi là ,
mon chou . Tu voi s que tu étai s une peti te cruche de pleurer ? Eh b i en ! tu n ’ouvre pas la bouche ? Tu ne m ’embrasse pas ? A quoi penses -tu ?
ANNETTE,tr ès émue — Je pense . . j e pense que c
’ esttellement beau . . tellement subl ime et genti l .
LOUI SE .
— Vas -tu recommencer à fai re l ’oi e ?
LA REVUE FRA NCO -AMERICAINE 389
ANNETTE . j e ne le veux pas . Non , j e n’ac
cepte pas que tu te sacrifice ainsi pour m oi .
LOUI SE — Mais j e ne me sacrifie pas !ANNETTE .
— J e serai s une m i s érab le s i j e te laissai s .
L OU ISE Ï— Zufl Bonsoi r . (F aus s e s or ti e . )
ANNETTE — Ne t ’ en va pas .LOUI SE .
— AloI‘S,cesse de di re des bêti ses .
ANNETTE .
— J e ne sui s pas s i gam ine que tu penses , va ,Lou i son Je su i s capab le , m o i aussi , de bien des choses
LOU I SE — Mai s j ’ en sui s sûre , mon poulet . Je connaiston cœur . Si tu étai s à ma place , j e paries que tu agi rais demême .
ANNETTE .
— OUi . Oh ! certainement .LOUI SE — TU vois b i en ? C ’ est s i nature l ! Je suis un
obstacle,un em pêtro . Je su i s laide , et tu es j olie .
ANNETTE .— Pas vrai .' Tu as des cheveux superbes et
le coi f feur t ’en ‘
a offert deux cent francs .LOU ISE — J e suis vi e i lle et tu es jeune .
ANNETTE .— J e te ratrapperai bien vite ,
LOUI SE . Tu as cinquante m i lle francs de plus que moi ,de notre oncle André . Enfin
,tu as tout et moi rien .
ANNETTE .
— Je proteste .
LOUISE — R ien . ou pas grand’
chose . A quoi bon tebarrer la route ? Ce que j e fais est tout simple , et i l n ’y amême pas à me remerc i er . N ’ en parlons plus .
ANNETTE .— Si
,parlons-en . E t sai s —tu la vérité ? Veux
tu la savoir ? S’
i l y en a une de nous deux qui doit se sacrifier . eh bien ! c ’est moi !
LOUI SE — Allons,bon !
ANNETTE,eæa, ltée .
— Oui,moi !
LOUISE .— V 0 i là une autre aff aire
,a présent !
ANNETTE .— Mais ,
dame ! voi s : puisque c ’ est toujoursm oi qu ’on demande et jamai s toi
,c ’est donc ma présence
seule qui est cause de tout le mal . Je t ’
éclipse ,j e te porte
ombrage .
LOU ISE — Tu es folle !ANNETTE .
— Si j e disais , moi , de mon côté , que j e refusede me marier , que j e veux rester fi lle
, ça remettrait tout enplace , et ils serai ent bien forcés , eux ,
la,les douze qui son
pi ren t , de se rabattre alors sur toiLOUISE — OU sur une autre . Ah ! ma pauvre petite
naïve !
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
ANNETTE .— Narve ou non , je n
’ en démords plus . C ’estmoi qui tiens a ne pas me marier . Est-œ clair ?
LOUISE .— NOD
,c ’ est moi l ’aînée .
ANNETTE .— Moi
,la cadette .
LOUISE — E coute,veux-tu ? Nous allons tirer à pile
ou face ?ANNETTE .
— Oh ! non ! Ce n ’est pas le sort et le hasardqui doivent régler des choses aussi graves .
LOUISE — L e sort et le hasard , c ’ est le bon Dieu ! LaProvidence peut aussi bien nous éclairer avec un petit sou .
(E lle a s or ti un s ou de sa poche . )ANNETTE .
— Tu as raison . Pile,c ’ est moi qui doit rester
LOU ISE — Par c onséquent , moi , c’ est face . (Elle s
’
ap
prête à lan cer le s ou . )ANNETTE .
— AÈÙGD dS Ï (E lle fai t un s igne de croiæ. )Va ! (L e sou es t lancé . )
LOUI SE, qui a cu
_
la prem i ère.— Face ! J ’ai gagné . Je
ne me marierai jamais !ANNETTE ,
tr i s te .— Oh , ma pauvre petite . (E lle a les
larm es aux yeux. )LOUISE , f ébr i le ,
l’
embrassant avec; un peu trop de n er
vos i té — Mais ris donc Nette ; c ’est la première fois que j ’aide la chance !
HENRI LAVEDAN,
de l’
Académ ie français e.
LA REVUE FRANCO -AMER ICAINE
m o ignen t de l’
i nfin ie pui ssance du.
\ Cr éateur du ci e l et de laterre ; cet ai r fluide qu i enve loppe tout , qu ’on sent sans le
voi r et qui passe sur vous comme une caresse cette lumi èrequi descend du c i e l b leu et éclai re toute s choses en lai ssantque lques part i es dans l ’ombre comme pour m i eux fai re ad
m i rer son éc lat la Où e lle paraît . . Oh,que c ’ est beau tout
ce la,et que D i eu est grand de l ’avoi r fa i t et bon de nous en
fa i re joui rIl s ’ arrêta
,haletant
,le vi sage inspi ré , les mains jointes ,
semb lant continuer dans une pri ère s i len c i euse son hymne,
d ’admirat ion émue .
M . Saint-Yves se garda de le troub ler . Il le regardai tplongé dans son exta'se
,les narines frém i ss ante s
,l ’ai r ray
on n an t , vraiment beau— une révé lation.
— E s t-oè donc , se d i sait-i l , que l ’œuvre de Jeanne seraitencore plus grande qu ’on ne croyait ! Aurait—e l le fait naîtreun penseur , un poète ou un arti ste ? . .Et tu dis que tu ne saispas parler , mon Pierre ! murmura—t— i l .Ce mot , prononcé à m i -voix ,
révei lla le j eune homm e . L a
flamme de ses regards tomba . sourit doucement et,se
levant :— Il faud rai t , di t— i l , ranger notre petit couvert .Paisiblement , il se m it à son humb le besogne sans plus
ri en ajouter . On eût dit un autre homme . Vainement M .
Saint-Yves essaya de le fa i re causer encore . I l répondit desparo le s bana les
,in s ign ifian tes ,
prononcée s d ’une voix redevenue hési tante . A un seul moment
,le peintre ayant pro
non cé le nom de Jeanne,Pierre s ecr i ra :
— Oh ! M ademoise lleIl ne jo igni t même pas son nom . Mais
,en articulant ce
m ot,i l y m i t une express ion d ’une incroyable intens ité .
Toute son âme semb lait s ’y concentrer . L a même flammeque tout a l ’heure i llumina un . instant ses yeux . Puis denouveau tout s
’
éteign i t .
M . Saint—Yves rentra au château p rofondément ému ,son
geur . Il ne par la a personne de la scène des boi s .
‘Il étai trésolu à tenter une épreuve , mais préférait , pour le cas d ’
un
échec n’
in i t-ier personne à son entrepri se et a son espérance .
P ie rre le devança dans son projet . Le lendemain,l ’artis te
avait annoncé qu ’ i l irait pa sser la j ourn ée a L yon pour '
yvisiter le Musée de peinture
,col lection magnifique digne
de la seconde vil le de France, qu i a vu naître Mei s sonn ier
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 393
et Puvi s de Chavannes . Pierre demeura seul . I l étaitagité , tourmenté , nerveuxfixe et troublante . L e 1 1 1
résisteret onhonnê te , se
SaintL a porte c lose , i l prit un panneau de bois parmi ceux
dont le peintre S approvisionnait pour ses esui sses , le mi tle chevalet , saisi t le palette encore prête de la veil
qu ’ il était chargé de nettoyer et , sans hésiter , commepar une force invisib le , i l posa sur le bois le pinceaude cou leur . Ce fut alors comme un accès de fievre , une crrsed ’ha llucination . Quatre heures durant , sans s
’arrêter uninstant , sans détourner la tête , Pierre peignit,‘ peignit . Seùssa brosse inhabi le , dont i l ne connai ssait le maniement quepour avoir vu travai ller M . Saint Yves , les tons se mélangcai n t heurtes , incohérents , les l ignes 8 ’ en'chevêtraient dansun desordre inextricab le , c ‘était un affreux gâchis dont i leut été impossible de démê ler l ’ intention et le sens . Maistout a coup dans ce chaos
,véritab le produit d ’une imagina
tion en déli re ,la lumi ère se fit
,les lignes se des sinèrent , les
t ;r; 1 s Se fondirent . Du barboui llage informe sortit un siteéci s qui peu a peu s a ffirma
,la C lair ière des fées ”
éclai rée d’un jour rose , invraisemb lab le et cependant délicieux. Au mi li eu du c i e l étonnamment léger et diaphaneune forme blanche passai t qui avait des ai les d ’ange . .C
’
étaitune œuvre d’une audac i euse incorre ction . L a progres s ien
des plans n’était pas observée , le feuillage était presqi1 e bleu ,
dans certains endroits les herbes se dressaient droites commedes piquets , le tronc dés arbres avait des prOf Ondeirr s nOireSbrutales ; et pourtant tout cela vivai t , sentait l ’ inspiration ,
disait la Nature comprise et Surtout , par une précieuse tradition du Maître étudié à son insu , était noyé dans l
’air '
pur
Pierre était absorbe, perdu dans son travai l aqu
’
il nentendit n i la porte s ’ouvrir, ni M. Saint Yves s’
cher de son escabeau. Le pe i ntre eut unbras au ciel , stup,e
' fait et ravi . Buis i l resdu p
ied . Que lque temps après , i l revi
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Viviers et de Jeanne . Cette fois leur entrée fit du bruit etPierre tressailli t , brusquement révei llé . Il se dressa d ’unmouvement effaré , épouvanté , comme un crimine l surpris aumilieu de l ’accompli s sem en t de son forfait . Mai s il n ’ eut letemps de rien dire . M . Saint-Yves l ’avait pri s dans ses braset , l ’y serrant , s ’
écri ait— Oh ! mon enfant .mon enfant ! Tu seras un grand arti ste , et la gloire de ma carri ère sera d ’ être ton maître.Puis , se tournant vers Jeanne .
Soi s bénie , Jeanne , dit-i l . . c ’est ton œuvre !Jeanne pleurait et M . Viviers s ’était détourné pour qu ’onne vi t pas qu
’ il en faisait autant .L e tableau fut tran sporté au chateau et exposé au s alon .
— Qu’est-ce que c ’
e st que ça ? di t du bout des lèvres Casim i r quand i l le vi t .
— Ca ? répondit M . Saint-Yves , c ’ est le premier chefd
’
œuvre de mon fi ls dans l ’art . Z euxis , qui vivait du tempsde Péri clès ,
l ’aura it trouvé ce qu ’ il est , dans son incorrecti onadmirab le .
Quatre ans après,la famil le Viviers se trouvait un soir
réuni e dans le salon attendant l ’annonce imminente dudîner .Il y avait un assez grand changement chez la plupart de
ses membres . Si M . Viviers avait toujours sa même figurecalm e et douce , gracieuse et sér ieuse , sa barbe et sa chevelure étaient passées du b lond ,
longtemps gardé,à un gris pré
curseur du b lanc , qui s ’approchait . M lle Marois avait faitde notable progrès dans les voies de la rotondité .
Henry devenait un be l adolescent dont les traits prenaient ,comme dessin et comme express ion , une grande similitudeavec ceux de son père , et c
’est bien ce qu ’ il avait de mieuxa faire . C ’ était un brave garçon
‘
qui se conservait "intactdans sa vie f amiliale et laborieuse , au point de vue industriel s ’ entend . Car s
’
i l connaissait"
à. fond les mystères dutissage et du brochage , l ’art de mé langer intel ligemmentdans les trames les fils de soie , et savait déjà parfaitementm anœuvrer un métier Jacquard , on doit reconnaître qu ’aupoint de vue class ique i l n ’avait pas acquis un très gros bagage aux leçons de M . Casimir Lom bre . Peut-être bien
LA REVUEERANCO-AM ÉRICAINE-.n .
avait sans rien di re acheté des crayonsl’eur’
s et s etait’mise a cop i er
’’
des’
fleurs ,qu
’”elle avait SOUS seS yeux .
’
Sans’
mai ttinct
,elle faisait des aquarel les charmantes que son
par prendre comme rn
’
Odèles’
pour l’
ateliér . Maiselle se
’
rebiffa’ et’
déclaraqu ’ e lle ne voulai t pas travai l ler pourr ién
"èt entendai t
’ ’
figufer’
par r’
r
’
ri les’
ouvriers de’ la fabrique .
Viviers ’ ’
a’
c’
céda en sour iant . Chaque samed i , dès lors ,
e lle allaa ’
la paye , avec feS a ii très ,fièré et j oye
use,et
,chaque
d1m an che M. fe Curé pori vàit compter jusqu’au‘ derriier cen
’
tiffi’
e’
d1 i’”salai re de
’
la dé s s i frat’
r iciä qui lui était fidè lementrê
’
ni i s pour les paii vrès .
Ces travaux remplissaient le temps de Jeanne , et il letemps lui para i ssait quelquefois b
’
ien long .
Pl1 i s d ’uri e fo i s , seule , e lle allai t par le parc , gagnai t la’Clai rièredes fées ’ et y resta i t de Ioirgs
’
instants à rêver , Sse souveni r , à espérer peut-être Pui s chaque sem arne , a
un jour fiXe’
et a l ’heure d i1’ facteur,e lle allait chez Dubreui l
avec ufr intérêt ému . c ’ était le jour où’
arrivai t une lettré dePierre N ’était i l pas b i en nature l qu’ el le suivi t avec syriqpathie le progrès de celui que , dans une inspiration cha i rtab le, e lle avai t appe lé
‘a la vi e de l ’ i n telligen èe ?…D. é l ’oi rieri
’ lo in même, c’éta i t pour el le iin e j ore qu ’ e lle ne cachait
pas— pourquoi l ’aurai t e lle cachée ?— e l le recevait des ’
nou’
ve lles d i rectes du j eune Dubreu i l adressées "à ‘
Sa chèrebienf ai tr i ce .
’ Pu i s c ’ étai ent des b i llets bf efs— oh’ ! très bref s,
tro brefs Sa int Yves : Pierre gagne tous les j ours .
Pierre se développe étonnamment…. P i erré sera un grand,
grand art i ste , b i en plus fort que mOi . . S i Oe l’a cOn tinuè , j’
e_
serai j aloux de Pierre . . J ’
a i montré des essais de i erréJules Breton et aH arpi
’
gn ies : i ls n’
en reviennent pas’
ét neveulent pas croi re qu ’
i l y a deux ans notre enfant ne sava 1 tpas li re .
Deux fois , dans de courte s vacances,Pierre était revenu
a‘ Mo n t el’
,m éèOnn
‘
a
un grand beau j eune homguéé , a la fine démarche,
r ien du P i erre d ’
ai i trefOi S,
de Sori regard qi 1 i di sa it laEn cela i lméri tai t
,mars
qu’on lui donna it
’
jadis : c ’Com r
’
f1 e i l’
y a cep endant d ’
'
1 }À SSVUÉ ÊSÂNbÔ-ÀMÉRIC -1 INE
monde ! Il y avait éñtre l ’artiSté débutant ét la f i l le dé M.
Viviers un liéii rompre L'
abienfaitrice
pas plus que lé uvaient ou r le serv1 co
rendu,et quand juvénile
e t j oyeuse qu ’on aurait en téndüë ,i ls étaient restés en face
l’
un de l ’autre r0uges , i n t i ’
nî idés,troub lés , n ’osant presque
rien se dire et ne se parlant que des yeux , quand de loin enloin ils os '
a.ient les lever l ’ 1 1 n sur l ’autre . On serait mêmedescendu au plus profond de ces deux cœurS na 1 fs et S implesqu ’on n ’y aurait pas trouvé l ’ expl i cation de ce phénomènesingulier . Jeanne ne reprenait sa vivacité de pensées quequand le vvagon emportai t P i erre vers Par is et alors e lle luidisait
,ma i s trop tard et sans que maintenant il pût rien en
tendré, tout ce qu’ e lle s ’ était promi s de lui d 1 re ; et Pierre ,
pendarit que la locomotive rou lait , se Souvenait avec désesp0 1 r de tout ce qu
’ il avait proj eté de conter à Jeanne et qui ,elle préSen té ,
S’ était envolé de son esprit . Des banalités
seu les avaient fai t leur entretien et,par un facile accord , ils
avaient soigneusement évité de jamais causer isolé 'mentensemb le , comme s i l
’
un et l ’autre renfermait en lui unSecret qu ’ il eût craint de lai sser échapper dans le tête àAu moment même où on a nnonça le dîner , un domestique
remit un té légramme a M . Viviers . C ’était un fait trop f réquent pour troub ler personn e . Mais après avoir lu
,M .
V 1 v1 er s s’
écr ia— Ah ! mon Dieu
—
Qù’y
’
a-t i l ? fit Jeanne inquiète.
Pour toute réponse,son père lut :
“ Pierre prem i è re médaille au Salon . Suis fou de joie .
Arriverons tous deux demain . Saint Yves ’
— i —Vite , Henri , cours chez’ D iibi‘ é u i l lui annoncer .
Mais Henry 1 1 était déja pl us la. On l ’aperçut qui bondissait sur la pelouse , f raii ’chi s san t d ’un élan les par terreSfleuris , courant comme un faon échappé vers lama i son dusurvei llant .M . V iviers s ’
exclam a, M lle Marois fit chorus . Casimir ne
dit rien . Mai s comme il pinça p’lus violemment ses lèvres ,son menton et son nez se
’
mb lèrent essayer de se donner l ’accolade : c ’était encore prématuré . Jeanne ne fut pas plusloquace et l ’on aurait pu croire qu ’e lle n ’avait pas entendula grande nouvel le , si e lle n ’étai t pas devenue toute pale ason annonce . Ellé était pourtant très émue
,très nerveuse
398 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
m ême : car,après dîner
,e lle saisit dans ses bras , du moins
autant qu ’ elle le put,M lle Maroi s qui ne compr i t rien a ce
sub i t besoin d ’ expansion,et e lle l ’embrassa avec une in
croyable ardeur, _ en disant fébrilement :—Oh l ma chérie ! ma chérie !Après quoi e lle d i sparut…Mais quand e lle revm t , e lle
avai t les yeux rouges .
Comme on était au b i llard,Casimir et Henry
,M lle Marois
et Jeanne,M : Vivi ers s ’ étan t é loigné
,Henry
, qu i vo lonti ers rempli ssai t le rôle d ’ enfant terrib le
,demanda brusque
ment a M . Lombre :Monsi eur
,quand on a une première médaille au Salon ,
c ’est qu ’on est ou qu ’on sera un grand peintre,n ’ est-ce pas ?
Oh ! dit sèchement le précepteur,ces récompenses-là ne
signifient pas grand’
chose ,au fond . . Le mérite peut y être
pour quelque chose,mai s les recomm endations y sont aussi
pour beaucoup .
Enfin , continua‘ le jeune Viviers
,qui tenait à son idée
,
mettons que ce soit le mérite qui soit justement récom
pensé . P i erre sera don c un grand peintre . Etre un grandpe intre , c
’est une fameuse posi tion . On gagne beaucoupd ’argent ?
— Ce la dépend , répondi t Casimi r avec un air de dédain .
Oui , s i l’
on a du talent et surtout de la vogue . Car ,pour
les art i stes , la vogue , tout est la. On ne leur demande pascomme dans les belles— lettres d ’avoir de l ’acqui s , de longuesétudes préalab les , de la vra1 e sc i ence . Etre à la mode
,pour
eux, c
’est l ’essenti e l .— Alors , reprit Henry persistant , on devient un homme
célèbre , un grand homme . . comme M . Saint-Yves .
O ffic i er de la Légion d ’honneur,Membre de l ’In sti tut
,c ’est»
rudem ent chic .
— Oui , fit encore le précepteur d ’un ton rageur,il y a des
a rtistes qui ont de la chance .
— E t quand un artiste a de la chance,il peut f aire un beau
beau Pierre , quand i l sera un grand peintre— Tais -toi l . Tai s-toi donc ! s ’
écri a Jeanne qui se leva,
écarlate , et mit la main sur la bouche de son frère .
— Vous êtes fou , Henry ,dit sévèrement le précepteur
.
400
dans un seul sentiment qui les résumait tous : le grand ,le
s aint , le pur amour .
E t . comme les deux marcheuses. étaient am vées a laC lai rière des fées , Jeanne incapable de se contenir plus
longtemp s , dit , cria presque a M lle Marois :—Je l ’aime ! j e l ’aime !Emotion de lasurprise , émotion de la course , M lleMaroi s
n e put rien répondreMais au meme moment
, un large rayon de lune passa autravers des arbres et vint envelopper l
’
angélique tête deJeanne , caresse du cie l qui avait entendu et béni ssai t son
aveu,et
,au même instant , dans le fourr é vois in ,
un ross ignollança , au mili eu du s i lerice ,
sa modulation la plus barmon i euse ,
moins pure et moins douce encore que la pr ière quijaillissait du coeur de la j eune fi lleL ’
impression de M . Casimi r L ombre fut beaucoup moinssentimentale . Il ne demanda point pour faire ses réflexionsni la romanesque hospital ité d ’une claimerè des bois , ni lemélodi eux accompagnement du rossignol . Il allui
'
n zi pro
s aïquém en t un cigare , s’ étendit dans sa cham bre sur un vaste
c anapé et se m i t à songer avec quelque inquiétude .
Casi mir L ombre étai t amb itieux , très ambitieux , autantque personne l , et ce n ’ est pas peu dire . Depuis longtempsi l caressait un rêve ; oh ! non un rêve d ’amour— son cœurn ’ était susceptib le dé tendresse que pour lui mê 'me— m a1 s unrêve de fortune . I l nourrissait l ’espo i r d ’ épouser Jeanne etsurtout sa dot . Les charmes de la jeune fil le le laissaientfort indifférent , mais non ceux de sa cassette .
Assurément,i l y avait que lque e ffort a fai re , et i l y avait
une assez grande distance entre la fille du grand industrie lde Mon tbuel et un simple précepteur a250 francs d ’
appoin te
ments mensuels . Mai s cette di stance était comb lée,aux
yeux de Casimir , d’abord par sa vanité prétentieuse
,ensuite
par Péri clès . Personnellement,il n ’
hés i tai t pas a se considérer comm e i rrési stib le le jour où il daignerait se déclareret , si les avantages de sa personne ne ‘
suffisaien t pas , i l yjoindrai t ceux de la cé lébrité . Car
,avant peu
,i l allait être
cé lèbre : cela étai t immanquab le . L ’h i stoi re de l ’ i llustreAthén ien touchait a son terme . Il avait même déjà corrigéles épreuves de l ’ introduction . Le volume paraîtrai t avanttrois mois . Le remettre à l ’Académ ie des Inscri ptions etBelles —Lettres et obteni r le grand prix réservé au travail
LA REVUE FRANCO—AM ÉRÏ CAINE 40 1
d’histoire le plus remarquable , c é’ tait
p orte de 1’Institut entr ’ouverte pour lui . I l la
a fait par quelque autre ouvrage . I l pensaitCimon , fils de Mi ltiade , rival de Pér i clès .
membre de l ’Académi e. C ’ était une assez jolie perspectivea offrir à la fi lle d ’un simple fabri cant de soieries qui , en défin i tive ,
avai t été ouvri er dans sa j eunesse et ne savait pas unmot de grec .
Une un i on avec M lle Viviers lu i paraissait donc , son immense arhour propre aidant , une chose fort simple a réaliserquand il le voudrait
,et i l étai t a cet égard d ’autant plus
tranquille qu ’aucun concurrent ne paraissait a l ’horizon .
Jeanne avait dix-neuf ans et jamais du moins a sa connaissance
,i l ne s ’ était présenté aucun candidat a sa main . Si ,
pourtant,il avait été question d ’un , quelque temps avant .
Mais M lle Viviers l ’avait écarté aussitôt , presque sans examen
,et même Casimir s ’ était demandé s ’ il n ’ était pas , pour
que lque chose dans cette résolution rapide . Hé héVraiment
,i l n ’étai t pas mal dans ce portrait de face , qu ’ i l
avait devant lui,mi eux encore dans cet autre de trois
quarts . .M lle Viviers n ’aurait pas mauvais goût . Toute sles j eunes fi lles n ’ont pas le pr ivilège d ’avoir sous la mainl ’auteur de la vie de Pér i clès !… Justement i l était visibleque les dispositions de Jeanne avaient changé du tout au toutdepuis quelques années . E lle lui épargnait ses moquer iesd ’autrefois
,simples boutades d ’enfant gatée Si e lle ne lui
témoignait pas,encore aujourd ’hui , une sympathie très vive ,
c ’était le résultat d ’une “réserve toute naturelle . Allons !la chose irait toute seule .
Et voi là que tout a coup ce petit barbouil leur de tableaux ,
c et idiot— car enfin il n ’ en démordrait pas ,ma lgré l ’appa
r ence cettemaladie était incurab le— ce Pierre Dubreuil , fils*d
’un gendarme , d ’un port ier , venait se mettre a la traversed
’
un projet qui pourrait le faire . r iche à francs der ente ! Halte ,la, mon maître ! A nous deux !Du reste , ces craintes étaient certainement chimériques .
'
M . Viviers avait trop de bon sens pour commettre unepareille folie . Tout cela venait d ’un mot échappé à ungamin , et Casimir s
’
endorm it pai siblement , bercé par undoux rêve où i l se voyai t conduisant Jeanne à. la Mair ie
’
l’
égl i se lui était bien égale — avec,comme témoins
,Pér i clès
.et Cimon , les deux ennemies , réunies dans une touchante
402 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
réconciliation,autour de M . Lombre , membre de l
’
Académ ie
des Inscriptions et Bel les-Lettres .Quoi qu ’ il en fût , Casimi r jugea‘ prudent de tâter un peu
lc terrain auprès de M . Vivi ers et , le lendemain , le trouvantjustement seu l qui réfléchi ssai t , assis sur un banc du parc , i ls ’
,approcha décidé a aborder la question avec sa profondediplomati e emprunté aux hommes politiques de la G rèce .
I l ne pouvai t m i eux tomber . M . Vivier était de l ’humeurla plus charmante et la plus expansive . La pensée qu ’
i l
allai t revoir son vieil am i toujours cher et P i erre triomphantle mettai t tout en joie . Peut-être même ava it-il d ’autressuj ets de satisfaction plus intime .
L ’ entretien s ’ engagea donc très cordi al et pri t tou t desuite un tour qui ne pouvait que plaire infiniment a Casimir .Sans qu ’ il sût que l propos
,M . Vivier s se mit à faire une
lo gue théorie pour lui démontrer l ’ in an i té de certains préjugés sociaux .
—I l serai t ridi cule a notre époque,dit-il suivant une pen
sée que le précepteur ne pouvai t pas diviner , de créer uneari stocrati e d ’argent alors que l ’ari stocrati e de naissance estdépouil lée de ses privi lèges . Que suis — je donc , moi qui vous .
parle ? Un ouvri er,
fi ls d ’ouvr i ers . S imple canuts, mon
grand—père et mon père . J ’ai débuté canut comme eux ,
bien heureux les jours où j e gagnai s 8 fr . 50 . J’
ai eu plusde chance , même , s i l ’on veut
,un peu plus de talent que
d ’autres . C ’est un moti f 21 m oi de remercier D i eu ,mai s non
une rai son de faire le fier . Ne sui s — je pas l ’égale de m es
ouvriers ? Henry est leur camarade,Jeanne gagne comme
les autres j eunes fi lles du village son salaire hebdomadaire .
Voi là ce qu ’
i l faut , voi là ce qu i honore : le travai l !Casimi r approuvai t de la tête et du geste , faute de mieux .
Ces doct rines libérales répondai ent a mervei l le à ses propresvues . M . Vivi ers
,qui les émettait s i nettement , ne pourr ait
plus lui obj ecter sa f ortune ou son rang quand i l lui parleraitde sa fi lle et
,voyant le terrain ains i préparé
,Casimir allait
serrer la question,se lancer sur une grande oeuvre , sur Péri
clès , l ’aveni r qu i l ’attendai t , pui s indiquer , tout au moins ,ses espérances matrimoni ales
,quand M . Vivi ers reprit , con
tinuan t le cours de ses idées intimes :— Ce peti t Pierre ! le voi là. sacré grand art iste ! Vous rappe lez -vous
,Mons i eur Lombre
,le jour de l ’arrivée des Du
breui l,quand nous avons vu pour la première fois ce pauvre
LA REVUE FRANCO—AMERICAINE
E t Jeanne fit V iv1 ers .Bllé i ié iii’a f i eri (M
— O fabr 1 caht b , peijdu dans les soiér iés, pèré aveugle ,
t ii_
n’
as donc pas su lire dans les yeux de notre Jeannette ,
and Pierre est arrivé tout a l’
heure ? Tié1 i s‘
, _
r
voi la qu i traverse la pelouse , allant cherC ’est l ’amour qui passe . . Mais i l n ’y a que nous autres ,les artistes , qui apercevi ons ces choses—là .
— Crois-tu, dit M . Viv1 ers en sour 1 an t . J…e su i s donc un
art1 ste aussi , car i l y a longtemps que j ’ai mi et compris.
Mais j ’attendais l ’heure. Et,quoique aveugle , je vois ce
que tu ne voi s pas : c’ est le rayon de soleil qui descend
là haut sur ma Jeanne . C ’est le bénédiction de Dieu qui sepose sur mon enfant .
PAR CHAMPOL
MON S IEUR URBAIN DE LAM OTHE
Ca is s i er Ban que de F rance ,8
,7711 6 Vdncau ,
Kecho (Tonkin ) 1 2 juillet , 1 89 .
Je t ’ai toujours di t que tu as_
la vocation de la pou lequr.
cc 1 ve des can ards . Te vo i la agité,a ffolé
,aux cent coups , tu
passes des nui ts sans somme i l ; tu m ’
écri s hui t pages de reproches , 1 out cé l
_
aparce que j ’ai fai t une excellente traversée et .
que j’
ai négl igé de t ’
en informer en ar ri vant ici Mais,mon am i
,cela allait de spi ! Nous n’
en sommes plus autemps patriarcal où l ’on fai sait son testament avant de monter en di li gence .
Que di ra 1 s -tu donc si tu voya1 s les Pavi llon s —Noirs dé»boucher derri ère moi dans les bambous pendant que j e surveille mon poste ? Allons
,mon V 1 eux
,ducourage ! Je fais
.
de mon_m i eux pour tegarder tonpet it Henri , malgré les :
pièges é nnern i s et les 1 n conven 1 en ts du climat .
“Notre cuisine est large et soignée ; j e ne m ’ennu i e pastrop , car j
’
ai de bons camarades , et i c i on se l ie vi te avec tout”
ce qu i ést Européen Onparlé de fièvres dans la provincevoi i qui m ’ en moque , avec mon hygiène
sagesse a faire peur !que j e de ma sagesse du j our , n
’oublieies de Veil le. Passe chez le banquier deet tac de payer . Surtout , ne donne pas
1 a le don de t ’oœ uper , et_
j e t ’ en f éli ci té ,
car tu ne sa1 s pas être seul . C ’est une man i e chez toi , mai senfin on ne se r é faj _t pas . Si mon père pouvait m
’ envoyer °
406 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
quelques subsides , je ne les refuserais pas . I l le peut , et
toi,mon cher aîné , tu es une vraie mèr e . Un père et une
m ère,ce la facilite bien des choses .Vu ta qualité de mère
,j ’ai des petites nouve lles confiden
t ielles‘a te donner , ce que j e ferai avant le départ du paque
bot . Après cette lettre ci , écr is , si tu veux , mais n’
attends
pas de m oi une prose rég1ilière ni surtout fréquente ; on ne
peut s ’assuj ettir au travail supp lémentaire dans les conditionso ù nous sommes ici : le loi sir est notre hygiène nécessai re .
1 4 jui llet . .J e voulais continuer le chapitre du odeur ette demander‘ de m ’ éclairer de ta haute raison , mon vieil ami .C ette maudite fête nationale est venue se mettre au traversde mes bonnes intentions . Je crois que j e vai s‘ devoir agi rd ’
après m es propres lumières pourtant le cas est grave .Bon On me dit qu ’ i l est temps de livrer m es pattes de
m oùche au paquebot . Vite , mi lle tendresses .
”
Un pâté suivai t,puis un paraphe i llisib le , témoignant de
la hâte avec laquelle le sous-lieutenant Henri de Lamothea vait dû couper court à ses épanchements épistolaires .Urbain en fut d ’autant plus con trai r ié qu ’ i l pouvait rai
s onnablem en t espérer la suite au prochain numéro . Sonj eune frère avait horreur de la corresmndance qu i’ 1 con s i dérait comme une marque de souvenir et d ’amitié tout a faits uperflue ,
et,lorsque Henri de Lamothe trouvait une chose
ennuyeuse et gênante,i l "vait l ’habitude de s ’ en débarrasser ,
sans plus ample réflexion et surtout sans se demander si Desautres seraien t de son sms .
Pauvre enfant ! il n ’a pas de tê te di sa1 t avec un mélange d ’admiration et de pitié le modeste et pacifique Urbainqui n
’avait d ’autre espérance,d ’autre souci dans la vie que!
ce frère , plus j eune que lui de quinze ans , auss i beau , auss ibri llant , aussi léger qu ’ il était lui—même sérieux
,tranquille,
s ans éclat et sans prétention .
Il avait remplacé auprè s d ’Henri leur m ère , morte depuislongtemps : i l l ’avait gat
_
é,couvé
, surveillé , sermonné , cons ei llé depuis son bas age jusqu ’au jour où le j eune sons -lieute
.e etait , sur sa demande,embarqué pour le Tonki n ,
laiss ant le pauvre Urbain seu l au monde , seul derrière son guichetde la Banque d e France , sans autre consolation quede songerl’
absen t et de payer , sur ses économies , les petites dette sque son j eune frère lai ssait toujours un peu partout .
Cher enfant , il n ’
a pas de tête ! répétait le bon Urbain ,
408 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
C ’est lui qui est mon avenir , mon bonheur ! c’ est a lui
que j ’appartiens . Il se trouvera bien dans sa vie des mo
ments où i l aura besoin de moi . I l se mari era , i l aura desenfants , et j_e _
ne mourrai seul,abandonné dans mon
coin comme une V 1 eilleA t Urbairi se (1
,sans oser esperer de plus
reviendrai t —i 1 , s’ i l revi ent ?
Sonpère, après s’être un peu agité de ne plus voir Henr i ,
comme i l en avait l ’hab itude , avai t épr_
ouvé Un e grande consolation
_
a fai re” s on cab inet de toi lette de la chambre del’
absent i l était , du reste , trop occupé de SC S rhumatismespour se tourmenter d autre chose.
D ix-huit moi s s’ étaient cependant écou lés sans apporterd ’autres nouvelles du sous-l i eutenant , et Urbain ,
rongé d’an
go 1 sse . tachait de se mettre en colèreen se répétant que lanégligence seule de son frère étai t la cause de ses i riqpi études .
Quel sans-cœur ! se di sai t—i l . C est vrai qu’ i l ma’ vait
prévenu de son Si lence . Mai s '
n ie lai sser dix hui t moi ssans un mot ! Peut être une lettre s -est e lle perdueChaque f oi s que les j ournaux parlaient de
_
so ulèvements auTonkin , de choléra ,
de fièvre pern i c i euse , lessan'g d ’Urbain se
glaçai t dans ses veines , ses yeux se fai sai ent hagards en dévorant les noms des vx1 cfzim es
,et une j o 1 e apre l
’
_ étre ignai t e_
n
n ’y Voyant qué des 1 n conn us . Il avai t fin i par ne p lus oserli re u n journal .
D u pes te,se di sait—i l
,j e serais prévenu '
s i mai s non .
Parb leu les militai re s en font b i en d ’autres,et reviennent
sam s et sau f s f Je su 1 s une poule moui llée , déc idé in en t .
’
A suivre.)
LA SO C IETE D E
LA REVUEERANC _O;AMERICAINE
aaa
L’
I L L U S T R A T IO NSupplément de La Revue Franco—Américaine
Première Année , No. 6 . Septembre—octobre , 1 908.
È È GËW È W ŒŒÈ Ê ŒCÈ ŒQËÈ Ê È W È ÊCGË
LE MARECHA L D E LEV IS…È W ŒCOÈÈ SÈÈ Ê È QËOÈÊ CDÈÈ Ê GÈGÈ Ê GËÈ Ê
A nos abonnés
Le pr ésent numéro compl ète le Ier volume de la RevueF ranco—Améri cai ne et est publi é pour les mois de septembreet d ’octobre .Nous prenons cette mesure afin d ’
obvi er aux retards tr0 pconsid érab les apport és dans la publication des deux derni èreslivraisons de la Revue
,et dûs à des circonstances absolument
en dehors de notre volont é,accident , surcroît d ’ouvrage chez
nos imprimeurs,etc .
Cependant nos abonnés ne perdront rien au changement ;ils y gagneront , d
’autre part,une livraison plus prompte .
L’
abonnnement de l ’année comprendra les douze numéros
composant des deux volumes de la Revue. Les abonnementsau lieu d ’être renouvelab les le l er avr il ne le seront que le 1 ermai .
Entre temps , nous allons faire subir à. notre revue certaines:améli orations proj et ées depuis quelques
'
mois qui la rendrontplus digne encore de l ’encouragement tr ès généreux qui lui aété donné jusqu ’ici.
L’Admi n i s trati on .
After the Winter(Le Renouveau)
C ’est l ’hiver,hélas ! et sur la nature
L e givre a j eté son linceul glacé .
Au morne hori zon de la plaine obscure ,Le ci e l , pâle et sombre , est comme affaissé .Toute voix se tait
,aucun bruit 1 1 evei lle
La forêt muette en ses profondeurs :Comme en un tombeau la terre sommei lle ,Et pas un rayon ne vient des hauteurs .
Le temps fait un pas— Avril nait— la vie
R eprend sous l ’azur son vol glor ieux ;Tout n ’est que parfum
,lumière
,harmonie ,
Tout vit,tout sourit de la terr e aux cieux .
E t pour opérer ces métamorphoses,
R endre son si llon a l ’épi vermeil ,Ses chants a l ’oiseau ,
leur éclat aux roses,
I l n ’a ri en fallu . .qu’
un peu de so lei l .
Un plus rude h iver atteint l ame humaineQuand sous ses regrets tout s ’échappe et fuit ,Qu
’elle cherche en vain sa route incertaine ,Perdant au hasard ses pas dans la nuit .
Sentir a tout vent chanceler s on être ,De vivre ou mouri r n ’avoir nu l émoi ,Se dire a tout mot : Que sais—je ?
”ou Peut—être
Vivre sans espoir et mourir sans Foi .
E st-i l rien qui soit plus lourd en ce mondeQue porter ainsi le poids de son cœurSans avoir d ’appui s où l ’âme se fonde .
Proie insouciante du destin moqueur ?
426 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
L ame ne meurt pas . Un jour,ô surprise !
L ’
aube lui t p lus b lanche en un c i e l p lus purLe flot
,moins ému
,t«iédi t sous la bri se ,
L ’hori zon lointain s ’ouvre dans l ’azur .Durant de longs moi s la terre endormieSe réveille et chante avec le zéphyr ;L ’arbre qu ’on croyai t maudi t pour la vie
R eprend s a couronne et va refleuri r .
E t j ’ entends frémir avec un brui t d ’ai les,
A l ’ombre que font ses rameaux touff usLes nob les espoi rs , les amours fidè lesL
’
essaim lumineux et pur des Vertus .
Au souffle puissant des grandes pensées ,Comme un luth touché par un archet d ’or
,
S ’ il retrouve un jour ses cordes brisées,
Le cœur,raj euni
,bat et vibre encore .
Et pour qu ’au foyer rena1 sse la flammeQui doit ral lumer le feu sur l ’autel
,
Pour qu ’e lle revi ve,i l ne faut à l ’âme
Qu ’un rayon de Dieu , soleil éternel !
Maur ice de Prade l.
428 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
en des jours de paix et d ’union que seuls des malentendusregrettab les ou un e fausse ‘ conception des intérêts nationauxavai ent pu retarder jusqu a ce j our.. Ce resultat seul serai tdéj à un digne couronnement de fêtes comme ce lles auxquel lesnous venons de participer .Aussi , afin de mi eux graver dan s la mémoi re des lecteursde la R evue le souvenir de cette page de notre h i sto ire .
résumant toutes les autres et lue devant nous,avons -nous cru
Opportun de réuni r en que lques pages,declarati ons et
opini ons,comptes -rendus et anecdotes dont le groupement
est de nature a donner une expression b i en nette et b i enVivante a ce qui a été fait et di t .
Les fêtes de Laval ont débuté par une mani festationcomme i l n e s ’ en est vu nulle part de plus grandes oude plusbe lles . M . P i erre G erli er
,le sympatique et bri llant délégué
de la j eunesse catho lique françai se au congrès des Jeunescatholi ques canadi ens —françai s en fai t la descr iption suivante
L a semaine qui s ’ est écoulée du 21 au 28 juin marqueraune date mémorable dans les annales de Qu ébec
,et les évèn e
ments qu i l ’ont rempli e , de l ’aveu de tous ceux qui en furenttémoins
,ajouteront une be lle page à l ’hi stoi re dé] a si glo
r i euse de la race Canadi enne -Françai se . Ce ne fut pas
seulement en e ff et,une succession de fêtes splendides et de
grandioses c ér émonies . Le décor sans doute était mer
veilleux,l ’apparei l extérieur émouvant . Mai s ce qui faisai t
par dessus tout la beauté de ces solennités inoub li ab les , c ’ estque l ’on y sentait palpiter le cœur de tout un peuple ; carel les éta i ent par essence la manifestation ,
l’
exaltation des
deux sentiments qui résument l ’ âme canadienne : la foi et lepatr iotisme .
C ’ est sa foi,robuste et touchante
,que la cité de Québec
affirmait le 21 juin dans l ’adm i rable procession de la FêteDieu ; c ’est son patriotisme , inspiré de la foi , qu
’ e lle tém oi
gnai t en célébrant magn ifiquement le 28 juin la fête deSaint Jean-Baptiste
,fête nationale des Canadi ens—Françai s ;
c ’est tout ensemb le son patr iotisme et sa foi qu ’e lle manif estai t en i naugurant , le 25 juin ,
au mili eu de féeries in croyab les
,la statue du Vén érab le F rançois de Montmorency-Laval
premier évêque de Québec , et apôtr e de la Nouve lle—France .
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 429
Je n ’oub lierai jamais l ’ impression que j ’ai ressentie en
débarquant à Québec le dimanche matin . L ’arrivée par leSaint-Laurent es t ravi ssante , et l ’accueil de nos camaradesQuébecquoi s avait été si sincèrement cordia l que j ’ étais émuavant même de pénétrer dans la ville de Champlain . Maiscette émotion ne fit que croître lorsque
,ayant gravi les
rues escarpées et pittoresques du vi eux quartier,nous arri
vames dans la cité haute, où déjà. s ’organisait la procession
du Très Saint-Sacrement .L a ville tout entière était somptueusement décorée . Ce
n etait que tentures, or iflamm es
,arcs de tri omphe , bande
rolles où s e li saient de touchantes invocations . Pas unemaison qui ne fut ornée : les plus modestes rivalisaient avecles plus riches
,et
,détail frappant
,les protestants eux-mêmes
avaient tenu à embelli r leurs demeures . Aj outez a cela que ,pour la premi ère fois depui s mon arrivée en Amérique
,j e
n ’ entendais autour de mo i que du françai s,
— ce joli langagecanadien
,émail lé d ’express i ons normandes
,qui résonne si
délicieusement a nos oreil les ,— et que , dans la profusion dedrapeaux qui flottai en t sur cette foule immense , j e voyaisdominer le drapeau tri colore
,dont on saisit avec une si vive
intensi té le symboli sme lorsqu ’on l ’aperço i t hors de chez vous ,et vous devinerez tous les sentiments qui se pressaient dansmon âme en présence d ’un te l spectacle .
Il faut renoncer à décrire ce que fut la procession . L a
cité tout entière était réunie,et
,plus encore que le nombre
incommensurab le des fidèles,l ’unanimité de sentiment que
l ’on sentai t en eux donnait à cette assemb lée j e ne sais quoide sai s s i s san t et de grandiose . Tous les é léments de lasociété étaient représentés : l ’autorité religieu se par seizearchevêques et évêques , venus de toutes les provinces canadiennes , l ’autorité civile par le premi er mini stre du Dominion ,
que l ’on voyait au premier rang derrière le dais,escorté de
tous les mi nistres de la province , des membres de la mag i strature ,
de la municipalité , de l ’Un ivers i té et des grandscorps pub lics ; pui s la foule , où toutes les c lasses et tous lesâges étaient confondus dans un même sentiment de recueil lement et d ’
adoration ; c ’était bien le peuple chrétien vivantsa foi , et faisant à Jésus-Hostie le plus tri omphant cortègeque l ’on pût imaginer .Durant quatre heures , le maj estueux défi lé se déroula
dans les rues de Québec sur une longueur de plus de trois
LA REVUE FRANCO —AM ÉRICAINE
ki lomètres . Il était une heure environ lorsque le dais, sort i à.
9 heures précises,rentrait dans la cathédrale .
Ce fut l ’ instant le plus émoti onnant . L a foule étaitrassemblée sur l ’ immense place de l
’
H ôte l de Vi lle . Soudain , sous la coupole étin cellan te de lumi ère qui surmontai tle porche de la basi lique , l ’osten soi r apparut , porté par MgrSbaretti
, délégué apo stolique L e peuple enti er tomba a
genoux ; tous les fronts s ’
in clin èren t , et i l y_
eut une minutede s i lence d ’une incomparable solenni té . Pui s
,spontané
ment , de toutes les poi trines un chant jai llit , impressionnantet grave : Te D eum laudamus .
”
Le lendemain c ’ est le dévoi lement de la statue de Mgr . deLaval par Son Exce l lence lord G rey
,gouverneur —général du
Canada . Pui s , après le dévoi lement , les di scours com
m en cen t, chaleureux , où l ’on entend les voix renn i es de la
France catholique et de la généreuse Angleterre chanter àl ’ envi e le patron des canadiens —françai s et le premier évêquede la Nouvelle France .
Mgr R oy ,l’
éloquen t coadjuteur de l evêque de Québec ,j ette à. la foule frémissante réuni e à ses pieds
,ces paroles
de fière eSpéran ce ou se résume la pensée des siens :De quoi se réjouit cette grande âme
,que nous sentons
planer en ce momen t sur le rocher de Québec ?N ‘est-ce pas de retrouver i c i , après deux si ècles , une race
qu i n’a pas menti a ses nob les origines ? Un peuple qu i ,
dans les vi ri les ardeurs d ’une matur i té qui approche,reste a
genoux aux pieds du D i eu qu i a béni son berceau ,et qui garde
au cœur la généreuse et sainte amb ition d ’ être toujours , dansles terres du Nouveau -Monde
,le loyal et intrépide chevali er
du Chri st ?“ Il me semb le
,qu a cette heure mémorable , le saint
évêque , du haut de ce Cap D i amant , où la nature et la P rovidence lui avai ent tai l lé dans le roc un trône colossal , et oùi l planta d ’un geste s i fier et s i énergique la houlette du vraipasteur
,embrasse d ’un regard joyeux et d ’un cœur recon
nai s san t l’
imm en se domaine que son zèle d ’
apôtre soumi tjadi s a l ’empi re de Jésu s —Chri st .
De l ’Atlan tique au Pacifique , de l’
Ocean G lacial au Golfedu Mexique
,la croix s ’est promenée triomphante , et e l le
dessine aujourd ’hui partout sur ces hori zons i nfin i s le s ignesalutai re de l ’espérance . P lus de cent boulettes se sont ajoutées a la houlette de Laval , jalonnant ces routes glor i euses
432 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINEvotre part , j e me plai s a le reconnaître , une loyauté inaltérab le envers la Couronne britannique .
Nous vivons dans une confédération où catholiques etprote stants sont véritab lement sur un pied de parfaite égalité .Je forme des vœux pour que tous les éducateurs du Ca
nada enseignent s. la génération de demain la grande leçonde tolérance et de paix
,sans lesquel les aucune société ne sau
rait subsi ster . C ’est,d ’
ai lleurs,cette leçon salutaire de con
corde et d ’harmonie qui devra se dégager des grandes fêtesdu tr oisième centenaire dont celle-ci est l ’heureux pré lude .
C ’est tous les évêques de Québec que l ’on croi t entendrelorsque Mgr Bégi n
,leur vénéré successeur
,dans cette élo
quen ce de s ereine beauté qui est comme un reflet de son âme,
fai t l ’ éloge du grand apôtre . L a métropole ne devra pas
oub lier ce di scret averti s sement tombé de ses lèvres :“
L’
Egli se de Québec , mère de toutes ce lles qui ont surgide l ’ immense di ocèse où travai lla Mgr de Laval
,n
’
a
cessé de donner l ’ exemp le de la fidélité que nousdevons a Dieu
,a nous-mêmes et a nos rois . Mgr de
L aval avait i ci trop activement collaboré a l ’œuvre politiqueet rel igeuse que la France avai t entrepr i s e sur cette terred
’
Am ér ique ,pour qu ’ i l ne nous appr i t pas , dès l ’origine , et
pour toujours , a uni r dans nos âmes canadiennes l ’amour del’
Egli se et l ’amour de la patr ie ,le respect de l ’autori té divine
et ce lui de l ’autorité roya le . Ces lecon s ,nous n e les avons
pas oub liées . Les évêques s i n ombreux,accourus aujourd ’hui
à Québec,au berceau de leurs égli ses
,n ’ont cess é de faire
revivre,après leur s courageux prédéces seur s ,
les sentimentstrès nobles que leur inspi re l ’ exemple de Mgr de Laval ; ilsn ’ont cessé de répandre , avec la foi dont i ls sont les apôtres ,les vertus civiques que leur a laissées en héritage le prem i erévêque de Québec .
Si le clergé can adien fut si loyal pendant les années quisuivirent la douloureuse séparation ,
et s ’ i l fut le plus fermeappui de l ’autorité nouve lle qui s
’
exerçai t sur des citoyens ,sur des fils du sol dont aucun e
_
épreuve ne pouvait abattre lafierté
,c ’ est que ,
lui aussi,ce clergé patriote
,recue i llait comme
un legs précieux les fortes inspirations qui on t passé du cœurde Laval dans l ’âme vai llante de nos générations secerdo
tales .
”
Après le représentant du roi,après le représentant de
l’
Egl i se ,après M . Turgeon parlant au nom du peuple cana
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 433
dien —françai s , c’est la voix de la France cathol ique que l ’on
entend,M . G erlier :
Comment , dit-i l , ne serais—je pas ému jusqu’au fond de
l ame au spectac le des sentiments que j e sens palpiter danstout un peup le
,et lorsque
,dans le mervei lleux déploiement
d’
or iflamm es dont se pare la vil le dé Québec,hier pour
adorer son Dieu , aujourd’hui pour acclam er son Ponti fe , j e
vois,à côté du drapeau britannique
,emb lème du loyalisme
des Canadiens-français,
flotter le drapeau tricolore,symbole
de leur gratitude touj ours fid èle et de leur indéfectibleamour .Peut-être cette affirmation vous surprendra —t e lle
,et
j ’entends déjà votre reproche . Ne saviez -vous pas , me direzvous qu ’ il en était ainsi ? Avez —vous pu douter un jour ducœur des fi ls de Champlain ?Oh ! non
,Messi eurs . La France n ’a pas cette ingrati
tude de répondre a leur attachement par de l ’oub l i . E l le saitqu ’
i ls partagent ses joies,ses tristesses
,e lle sait que leur cœur
bat avec le sien . Mais,si forte que soit cette convicti on dans
nos âmes,elle prend en des heures comme celle-ci une am
pleur inusitée qui les subjugue . Car autre chose est la
connai ssance qui persuade , autre chose la vi sion qui émeut .Et j e l ’éprouve b i en aujourd
’hui,où
,sans doute
,j e ne sai s
pas avec plus de certitude,mai s où j e sens avec plus d ’
ém o
tion, que partout où a passé la France , rien ne saurait effacer
de l ’histoire le prestige chevaleresque de sa figure et la tracelumineuse de son géni e .
Aussi b i en tout dans cette fête concourt - i l a nous rap «
peler la doub le communauté de nos origines et de notre foi .C ’est d ’abord le nom seul de celui que nous exaltons
,le
vénérab le F rançoi s de Montmorency-Laval , grand surtout parl’
ardeur de son zèle apostolique et par 1 é clat de sa vertu ,mais
illustre aussi par la lignée a laque lle i l se rattache,et par
tout ce qu’
évoque de valeur française le b lason des Montmorency .
Et,lorsque
,parmi les dél égations accourues pour solen
miser ces assises , j’
aperçoi s l ’uniforme a jamai s glori eux deszouaves pon tificaux ,
pu i s —je oub lier qu ’aux heures sombresde 1 867
,répondant à l ’appel du pape , qu ’avec un égal en
thous iasm e i ls saluai ent comme leur chef et leur père , les filsde la vi eil le et de la Nouvel le France mê lèrent joyeusementsur les champs de batai lle 1 1 1 1 sang également généreux et
pur !
434 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
Cette union — là , Mess i eurs , celle que crée l ’unité de lafoi catho lique , e lle demeurera indestructible entre nous .Ces fêtes qui ont dur é trois j ours se terminent par unedern i ère mani festation où se mêlent les prières ardentes etles ai rs nationaux .
E lles sont suivi du congrès de s jeunes catho liques canadien s -françai s , superbe man i festation où se dess inent déjà.,dans les accents de voix plus j eunes et plus fraîches
,les é s
po i r s de la race en de glori eux lendemains . E t ce sont lesj eunes
,on le sai t
, qu i , après avo i r chanté les dern i ers chantsdes grandes mani festati ons de juin
,devaient ouvri r
,par de
solennelles affirmations prononcées au pi ed du monumentChamplain
,les fêtes inoubl iab les préparées a la mémoi re du
Père de la patri e canadi enne .
L es fêtes du Troi si ème Centenai re ont eu un caractèretout-â-fai t di fférent de celui des fêtes de Laval . Cela se
comprend as sez fac i lement lorsqu ’on se rappelle la tournurequ ’on leur a données a la derni ère m inute , au but pol itiqueajouté a ce lui qu ’ el les devai ent avoi r dans la pensée de leursorgani sateurs . Du troi si ème centenai re de la fondation deQuébec
,d ’une fête préparée a la mémo i re de Samue l de
Champlai n,un amour sub i tement empressé et venu de haut
l i eu a voulu fai re une man i festat ion conviant a d ’
im pér iales
agapes les races qu i composent la population canadi enne .
Tout d ’abord,on a voulu plus que cela . nous le couvert
d ’un vaste projet de nationali sation des Champs de batai llesdes P laines d ’
Abraham et de Sainte Foye , lord G rey , un impér i al i ste anglai s très hab i le et souvent très a imab le , comptai tj eter les bases d ’une entente resserrant plus étroi tement lesli ens qui uni ssent les coloni es britann iques à la _métropole , etinaugurer ce qu ’
i l ap pelait déjà. lu i -même avec sati s facti on legreater empi re . A son avi s , ce n
’était plus Champ lain ,
ce n ’ était plus la fondation de Québec qu ’
i l fallait cé lébrer ,mai s b i en la nai ssan ce de la nation canadi enne . C ’ est aufond ce qu i est arrivé ,
mai s pas avant que l ’on ai t réus s i amettre de côté
,en face d ’
énergiques protestations , l ’ idéesaugrenue de couve ti“ to°rte la celeb ation en une ap othéosede la conquête de 1 759 du triomphe de W olfe sur Montca lmet de Mur ray sur Lévis. Et tout ce qui es t resté des proj ets
436 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINErab le dévouement et de notre unanime et ferm e intention defaire notre part pour favori ser les intérêts du grand empir eauque l nous nous glorifion s d ’apparteni r . ”E t le prince— le Prince Charmant” comme on l ’appelaitpendant les fêtes— de répondre :J ’
apprécie hautement l ’honneur et la responsabili té quim
’
incom ben t comme représentant du souverain qui , ayantsans cesse présent a l ’ espri t l ’attachement inébranlab le deses suj ets canadi ens
,suit ave c un intérêt affectueux tout ce
qui touche a la prospér ité et au développem en t'
de leur pays .Je me fai s une véri tab le joie d ’avoir en cette occasion ledoub le privi lège de me joindre a vous
,d ’abord comme repré
sentant du roi , pui s en mon nom personne l,afin de cé lébrer
le 300èm e anniversaire de la fondation de votre glor ieuseci té par Samue l de Champlain . Avec que l intérêt profondj e viens prendre part avec vous aux cérémoni es imposantesdes que lques jours qui vont suivre
,fêtes au cours desquel les
le passé et le présent vont nous apparaître sur un théâtred ’une beauté nature lle incomparab le .Comme au temps de mes précédentes visites au Canada ,
j e trouve ici aQuébec les preuves non-équivoques de l ’attachement profond des suj ets franco-canadi ens pour le roi . Leurfidéli té éprouvée dans les j ours sombres et di fficiles , joursheureusement b i en loin de nous
,est un des plus éclatan ts
hommages qu ’ il soit possib le de rendre au géni e politi que dugouvernement de l ’Angleterre Sa Maj e sté
,ainsi que tous
ceux qui s’
inté ressent a l ’heureux développement des institution s br itanniques , éprouve une sati sfaction extrême a lapensée que les Canadiens d ’origine françai se travaillent deconcert avec leurs compatriotes d ’origine britannique pourassurer la prospéri té et le br i llant avenir du Domini on .
Moi aussi j e suis d ’avis qu ’
i l convi ent de préserver ,comme un souveni r impéri ssab le pour les générati ons présentes et futures
,les P laines d ’
Abraham consacrées par lamémoi re des temps passés , et j e félicite cordialement du succès qui a couronné leurs patriotiques e f forts tous ceux qui sesont employés a cette œuvre pieuse .
C ’ est le premier échange de graci eux procédés ,la première
note donnée dans ce concert d ’entente cordi ale et de commune al légresse qui va durer dix jours . Le pr ince a du coupconqui s tous les cœurs . '
E t nous n’
oubli ron s j amai s , pournotre part
,la figure rejou i e d
’un brave compatriote que les
LA REVUE FRANCO —AM ÉRICAINE 437
préparati fs des fêtes alarmaient un peu , quand i l ar riva auxquarti ers-généraux des journali stes
,que lques minutes après
le débarquement du Prince,en s
’
écr ian t : Le Pr ince aparlé f rançais La nouve lle
,répandue dans toute la ville
,
dér ide tous les fronts , di ssipe toutes les inquiétudes , et i l mesemb le que le soir , dans ces inombrables parades des personn ages h i storiques , les voix chantaien t les airs nationauxavec p lus de douceur , avec une émotion plus profonde etplus confian te .
Le lendemain on entre dans le vif de la fête . Arrivée duD on de D i eu
,démonstration officie lle au pied du monument
Champlain . Cette fois,c ’est la ville qui présente ses hom
mages au Prince , pui s viennent les représentants de laF rance
,des Etats-Unis
,du Canada . M . Garneau dit :
R éunis au pieds du monument du glorieux fondateur dela patrie Canad ienne
,le cœur rempl i des souvenirs héroïques
de troi s siècles d ’une existence qui ressemb le plus souvent al’ épopée qu
’
a l ’histoire,les Canadiens—français éprouvent un
sentiment inexprimab le d ’
orguei l patr iotique et de reconnaissance envers les deux grandes nations qu i ont tour ‘a tourprésidé a nos destinées : la France toujours aim ée , a qui i lssont redevab les de la V i e et de leurs grandes traditions :l’
Angleter re ,qui les a lai ssés libres de grandi r en gardant leur
foi , leur langue et leurs institutions et qui les a dotés d ’unrégime constitutionne l fondé sur la plus grande somme delibertés
,et qui est sans contredit , le plus beau et le plus par
fait au monde .
Pour nous tous Canadiens,de toutes les origines , ce sen
tim en t s ’accroît encore en présence de ce déploiementfastueux a l ’honneur de l ’ imm ortel Champlain , en présencede cet hommage rendu a la j eune et ,
vi goureuse nation qui ,n ée d ’
hi er,grandit a vue d ’œil dans des espaces immenses ,
assez vastes pour contenir un empire nouveau .
”
Le prince,avec une grâce toute roya le ,
répond’éprouve une satisfaction profonde a célébrer avec vous
le 300ème anniversaire de la fondation de Québec par l ’ immorte l explorateur dont la statue , éri gée a si juste titre en ce
lieu,commande un panorama que son ardente imagination
elle-m ême eût en pein e à concevoir .Tout en me plaisant à reconnaître que nous cé lébrons
tout part i culièrement en ce jour la fête de Québec , j e ne
perds cependant pas de vue que cette célébration intéresse
438 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINEaussi la nation canadi enne qui toute entière prend sa part denos réj oui ssances . Que di s —je , ce n
’est pas ce vaste Dominion seu l qu i vi ent en ce jour honorer la m ém orr e dugrand Champlain . La Mère Patri e elle aussi revendiquel’honneur de s ’associ er a cet hommage
,et des points les plus
reculés de l ’empire,nos compatriotes
,a l ’ e ff et de cé lébrer son
immorte l souveni r , ont député des représentants que je suisheureux de voi r aujourd ’hui parmi nous .D ’
autres terres également sont justement fières de larenommée de Champlain .
“
Entre toutes,le grande nation
à laquelle i l devai t allégéan ce ,qu ’
i l aimait passionnément,a
dé légué pour assister a vos imposantes cérémoni es l ’un desp lus b 1 1 1 1ants de ses représentants .
Le vi ce-président des Etats Uni s,M . Fai rbanks :
La célébration du troi s i ème centenaire de Québec estun fait qui intéresse tous les Etats-Uni s , profondément . DeQuébec
,de nombreux explorateurs ont pris la route des im
m enses étendues de l ’Oues t , pour explorer un terr itoire quifait maintenant part i e des Etats-Un i s . Ils ont lai ssé commevestiges de leur passage sur notre terri toi re une empreinteindéléb i le sur notre pays .Troi s cents ans
,c ’ est court
,pour la France et l ’Angle
terre : et cependant , dans cette période , ti ent toute l ’histoiredu Canada et ce lle de l ’Am ér ique anglo -saxonne . Ic i onteu lieu de grandes batai l les , mai s aujord
’
hui, les navires de
guerre ancrés dans ce port , appartenant a troi s diversesnation s , témoi gnent de la paix qui les réunit en ce j our grandiose
,et de leur ami ti é sincère .
Je vous apporte les féli ci tations du Président et dupeup le des Etats-Un i s
, qu i se réjoui ssent des progrès duCanada .
Pui s c ’ est le représentant de la France qu i prend la paroleAu nom de la France j ’adres se le plus respectueux !hom
mage â la mémo i re des morts glorieux qui ont fondé le Canada
,contri bué a sa grandeur et su fai re épanoui r les mêmes
vertus qui atti reront aux Canadi ens l ’estime universel .De l ’autre côté de l ’Atlan ti que , nous applaudi ssons avec
un e ardente sympathie a l ’union qui dans le Canada s ’estr éalis ée entre deux races faites pour s ’entendre , chacune appor tan t âa
’
l œuvre commune les qual ités qui lu i sont propres .En France , comm e au -Canada
,on c i te avec une légi time
fierté‘
le nom de Champlain qui fut vai llant soldat , adm in i s
440 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
La nature impérialiste de ce dîner repose surtout dans le faitqu ’il a r éuni à une même table
,sous les yeux du fils du roi
,
en présence des repr ésentants de puissances amies , les délégués de tous les gouvernements a utonomes de l ’empire britanni que . C ’était comme une revanche
,discrète et timide ,
de l ’échec subi par l ’ impéri alisme a la conférence colonialede Londres . On y a plutôt l ’air de sauver les apparencesqu
’
affirm er nettement une idée .
C ’est , en somme , le Prince de Gal les qui a touché de plusprès l ’ idée chère a lord G rey lorsqu ’ il a ditL e troi s-centième anniversai re de la fondation de Qué
bec a pris une importance,non seulement locale
,mais i l a
occasionné une démonstration d ’une im portance nationale ,m ême impériale . Nous nous réjoui ssons que
,de
tous les points de la terre,des grandes pui ssances autonomes
,
de l ’Au stralie de la Nouve lle -Z é lande,de l ’Af ri que ,
on sesoit i ntéressé au tro i si ème centenaire de Québec .
Si r W i lfri d Lauri er porte un toast aux co loni es autonomes,
a chacune desquelles i l adresse que lques mots d ’ éloges,puis
i l adresse des paroles graci euses aux nations ami es de l ’Angleter r e qui ont tenu a être represen tées aux fêtes de Québec . Il proclame la douceur du régime br itan ique
P lus j e vi e i lli s,et plus j ’appréci e la sagesse de cette con
sti tution anglai se sous laque lle j e suis né et j ’ai grandi , etsous laque lle j ’ai vi ei lli , et qui donne aux différentes partiesde l ’ empi re leurs ‘ gouvernements libres et individuels .(Appl . ) C ’est notre fierté de di re que le Canada est le paysle plus libre du monde . (App l . ) C ’est notre orguei l de direque
,dans n otre pays
,fleur i t au plus haut degré la liberté
sous toutes ses formes,la liber té civi le
,la liberté religieuse .
Cela peut n etre pas apparent , a qui ne regarde que superfici ellem en t ce qui se passe ici . Le fait que le Canada estune colonie ne diminue pas la véracité de ce que j e viens dedire . Le m ot coloni e ne renferme désorm ais aucun sensd
’
in f ér i or i té . Nous reconnaissons l ’autori té de la Couronne Anglaise
,et nulle autre . Ce privi lège n ’ est pas toute
fois le nôtre seulement , i l est aussi celui d ’autres coloniesautonomes
,qui ont ce soir des représentants ici , et qui nous
ont dépêché des envoyés afin d e nous aider a cé lébrer les glorieux exploits des fondateurs de cette colonie , ainsi que lesfaits d ’armes de W olfe et de Montcalm , de Murr ay et deIJ éVIS .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 441
I l n ’y a que deux seules man i ères de gouverner un peup le .
L ’une en foulant aux pi eds toutes ses l ibertés l ’autre, en
sachant s ’atti rer la confiance du peuple par l ’appe l a ses sentiments de justi ce et de l iberté : la pol iti que de la conci liationE t c ’ est cette derni ère qui fut la po li tique de l ’Angleterre .
Après Si r W i lfrid Laurier des di scours sont prononcés parlord Dudley , pour l’
Australie ,le comte de R an f ur ley ,
pourla Ncuve lle —Z é lande , Si r Henri de Vi l li ers pour la Colonie duCap (Afr i que du sud ) S i r Lomer Gouin
,premi er m in i stre
de la Province le Québec, Si r James Wh i tney ,
premi ermini stre de la Province d ’
On tar io . C ’est a lors que ce dern i er , rappelant le mot cé lèbre d ’un homme d
’
E tat canadiens ’est écri é Je su i s un Canadi en-françai s parlant anglai s !Le dîner s e term ine par le toast au gouverneur-général que
propose le Prince de Gal les . Lord G rey a donc le derni ermot . I l en profite pour affirmer une derni ère fois l ’ idée quilui est chère . Il remerc i e avec e ffusion toutes les parti es despossess ions bri tanniques qu i ont voulu souscr i re a son œuvreet pour l ’ intérêt port é à la conservation des champs debata i lle Québecoi s ,
comme terre sacrée de l ’ empire .
”
Que l ’ idée impérial i ste ne soit pas,tout le long des fêtes
,
ouvertement très intense cela est évident . Mais nous la
trouvons partout mê lée a tant de sent iments qui lui sontétrangers tout en ne la repoussant pas , qu ’ e lle peut se vanter ,en somme , d
’être dans tout cela vivante et tenace . Ceux quila prônent ; s
’ i ls ne peuvent pas se vanter de lui avoir faitfaire beaucoup dechem i n ,
peuvent au mo ins se flatter d ’avoirpu la mêler à la fête nationale de ceux-là. mêmes qui jusqu ’
i cilui avai ent témoigné le plus d ’
i ndi ff éren ce . Et ce fait seu l ,pour des gens qu i savent attendre tout aussi b i en qu
’ ils saven tconserver le terrain gagné What we have , we hold ) n ’ estpas un mince encouragement pour le tenants d ’une politiquegrosse de surprises sinon de confli ts sang lants ou de violentesrécriminations . On a peut-être compris que le temps n ’estpas enco re venu de mettre a réal i sation le grand projet d ’
u
ni on rêvé par l’
Angleter re qui se sent un peu fatiguée de
porter seule le riche mais lourd fardeau de ses conquêtesa travers le monde . Mais si l ’on admet cela ,
c ’est très certainement tout ce que l ’on veut encore admettre ;et nous entendrons b i entôt parler encore de cette idée impér iali ste que désormais l ’on voudra accl imater chez nousaprès l ’y avoir introdu ite sous le haut patronage de l ’héri tierdu Trône .
442 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
Ceux qu i ne vi rent tout d’abord dans l ’ i dée de Chamber
lain qu ’un bal lon d ’essai , et ne s’
i nqu i étèren t pas davantagedes résultats qu ’ e lle pourrai t avoir n ’ont pas compté avec cecôté du caractère anglai s qui le trouve éterne llement ac cessible aux appe ls du chauvini sme
,même s i ce dern i er ava 1 t
pour s eul e ff et de donner a la métropo le un e pri se plus fermesur des possessi ons qui sont pourtant siennes déjà. et que personne n e lui dispute plus .Il a passé beaucoup d’eau sous les ponts de Londres depu i s
la conquête du Canada . Le peuple anglais n ’a pas changéet ses parlements sont encore soucieux de poursu ivre les tradi tion s de la nation conquérante
,de conserver l ’ idéal national
qui semb le se complai re ,même de nos jours
,
‘a revoi r sonauguste or igm e jusque dans la vi e i lle et poudreuse solenni téde son mécan i sme administrati f . Of fici el lem en t l
’
Angleterre
a gardé ses perruques b lanches comme e lle a gardé ses lords .Les moyens d ’act ion seuls ont changé .
En 1 755,c ’ est a coup de crosse de fusil que l ’on a chassé
les Acadiens de leurs foyers. E t c ’ est un désir de sécur itéanglo — saxonne qu i avai t inspi ré ce crime .
P lus tard,les différents modes de gouvernement donnés
au Canada,toujours avec la même idée en vue
,n ’ont pas tous
té également paternels . Si,avec le temps
,la main de fer
s ’est gantée de velours e lle n ’ en est pas moins restée trèsferme . Si le langage est devenu plus courtoi s i l ne tend pasmoins aux m êmes fin s , et nous doutons fort que le mot colon re soit interprété en Angleterre comme Sir W i lfrid Lauri er a eu le courage de l ’ i n terpr éter pendant les fêtes dutroisième centenaire .
Un des meil leurs résultats des f êtes ‘
de Québec aura encoretout
,de mettre en contact plus i ntime deux é lé
ments ’de notre population ne .
se connai ssant q1 i e très peu outrès
'
fi1 al, et que des intérêts politi ques mesquins avaient trop
souvén t’
l‘
an cés l’
un cont re l ’antre. Et s i , même en poursuivant unautre but , on a cree une union plus parfai te entrenos
'
_p0 pulation s françai ses et anglaises , on a
'
as suré pourl ’avenir'
,dans notre patrie
,le règne d ’une justice plus large
et d ’une concorde plus complète— des réj oui ssances de notrepeuple n ’auront pas été vaines , et les -sacr ifices qu ’ i l aurafai ts auront contribué a un e œuvre vraiment patriotique .
J. L. K.-Laf lamme .
.
444 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINEtant regagnant son logi s un s0 1 r où la brise australe souffleavec la plus exqui se douceur et ou s epanden t sur les champsb londs les derni ers rayons du solei l de s ix heures . Le romanromanesque a di sparu pour fai re place au roman rée l
,com
b i en plus beau et plus intéressant !C ’est le roman du travai l le plus persévérant
,de l ’effort le
plus pati ent et le p lus énerg ique pour la pr i se de possession
d ’une terre farouche et sauvage qu i rési ste et qui s’entête
c’ est le roman du colon qui lutte sans merci avec la forêt etqui fin i t par nous ouvri r ce pays a force de travai l et de privations ; c
’est le roman de tous les champions de la colonisation en notre pays , ces martyrs , oserons-nous di re , qu i on t
arrosé le sol que nous foulons de leurs sueurs et de leurslarmes souvent qu i , sens ib les comme nous pourtant , n ’ontpas craint
,pour nous donner un bri llant héri tage
,de s ’en
foncer dans les forêts,a plus i eurs l i eues des grands centres ,
sans chemins,sans aucun moyen de communi cation sans
vo i sin s ; de vivre loin du médec in ,loin du prêtre . C est le
roman de l energi e,c ’ est le roman du travai l ; c ’ est aussi le
roman de la f oi et de l ’ espérance . D i tes,en est— i l un plus
beau ?Ce sera l ’honneur de la colonisation françai se , di t M .
Gabrie l Hanotaux,de l ’Académ i e Française
,d ’avo i r été
surtout agr i cole . Partout où l ’é lément franç ai s s ’ est implanté dans le monde : au Canada
,a la Loui siane , i l a
subs i sté par l ’agri culture ; i l a recu lé ou di sparu avec e lle .
On trouverait,i c i
,mati ère a de longues di scus sions
,s i l ’on
étab lissait un parallè le entre la coloni sat ion françai se et lacoloni sation bri tann ique . D i sons que si les Anglai s entendent mieux peut-être que les F ran çais le commerce auxcolonies ces dern i ers , par contre , prennent mieux et plusvi te solide attache au sol dans les pays nouveaux . C ’ est auCanada surtout , où se déve loppèrent ensemble coloni e françai se et colonie anglaise que nous. pouvons fai re fac i lement lacomparaison . L es Franç ai s
,au Canada , furent s i prompte
ment ass imi lés aux exigences de leur situation , au m i leu dela nature sauvage , qu
’on eût pu cro i re qu ’
i ls avaient étéformés tout exprès pour être les découvreurs
_
de ce pay s et lespionniers de la civi lisation en ces contrées barbares . L e
colon anglai s,au contrai re plus froid , d
’un caractère pluscasani er et mercanti le , a éte gauche et em barra’
ssé devant labrutal ité de la forêt . Il n ’a en d
’
expan s 1 on et de puissance ,
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 445
a vra i di re , que lorsqu ’
i l réuss i t à créer autour de lui cetteatm osphn ère britannique , ce hom e
,sans leque l l ’Anglai s ne
peut ri en fai re . P lacés dans les mêmes ci rconstances,les
deux co lons , anglais et françai s , sont également industrieuxet labori eux . Seulement , le françai s a plus d ’espri t de ressource et se défend m i eux contre les d i fficultés et les misèresde l ’ imprévu .
Avec cette nature souple , ce feu géné reux ,cet esprit
audaci eux qui caractéri sent le colon français,le travai l ne
langui t pas et bientôt surgi ssent les œuvres .
Aussi , a peine Champlain venait-i l de fai re son apparitiondans les forêts séculai res du Canada
,qu ’une soci été d ’hommes
vai llants et industrieux , actifs et entreprenants , surgirent detous les points de la France pour fonder cette colonie quisans trop tarder
,devait
,di t un économiste
,atti rer les
regards des grandes puissances du monde .”
Les progrès du défrichement furent considérables,malgré
les luttes que ces premiers co lons eurent a soutenir con tre
les attaques incessantes des aborigènes . Mais,amesure quela civi l i sation pénétrai t
,abr i tée par l etendard de la cro ix ,
l ’ imm igration françai se se fa i sait plus -nombreuse et les générations se succédaient en se transmettant religieusementl ’hér itage tradit ionn e l de la foi cathol ique et de la possess iondu sol . Bientôt
,le dif fici le étai t fait . Il s ’était cree une
génération née dans la contrée,familiarisée avec ses di fficul
tés et ses dangers comme avec ses ressources . Il n ’y avaitplus donc qu ’
à avancer,car
,dès que les fami lles commencent
a se dédoub ler et a envoyer dans des terres nouvelles desenfants du pays , la colonisation prend une assiette sol ide , uncours régulier de développement .I l faut dire auss i que l ’ installation des imm igrants , opéra
tion difficile et compliquée dans la plupart des co lon i e s , étai t ,au Can ada ,
heureusement très simpl ifiée . La salubrité dupays
,l ’abondance des boi s de construction
,sur toutes les
terres,la facilité du défrichement de ces bois
,la s implicité
rustique même des mœurs et des besoins des immigran ts ,tout concourait -â facil iter l ’opération .
En outre , chacun apportait généreusement sa pierre a1 edifice national . Tout le monde s
’
adonn a à l ’agriculture .
Depui s le temps que l ’on fondai t des provin ces , des colon 1 esen mettant â contri bution toutes les branches du commerce ,i l étai t urgent de savoir si , pour le même obj et , le laboureur
446 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINEpouvai t remplacer le commi s ou le colporteur . Les grandsseigneurs de ce terr itoi re donnèrent l ’ exemple en se mettanteux-mêmes aux travaux des champs . Ils formèrent
,chacun
autour de soi , un noyau de société , et b i entôt , on vit surgirsur les bords du Saint—Laurent un nombre de pi ttoresques etbeaux vi llages qui sont aujourd hui comme autant de trophéesattestant nos droits a revendiquer le sol colon i sé par nos pè reset que nous tenons d ’eux a titre d
’héri tage national . Ceserai t ce sol que l ’
on verrai t. n e plus .n ous appartenir ? L a
patrie , la _patr i e vivante , ce lle ,que c hacun porte en son cœur ,est indestructib le comme l ’âme humaine ; e lle renaît commel le. et
,parti cipant a
,sa sub lime nature
,elle —s ’
échappe imm or
te lle ’
de l ’ étrein te .de la tyranni e et des détours de la pol itique .
N ous gardons notre patr ie en conservant re ligi eusement ennos cœurs le souveni r de nos - pieux ancêtres . Ils en sontdignes et nous avons rai son ,
certes , d’ en être fiers .
Car la…population de la provin ce de Québec n ’a pas eu pourorigine
,comm e .on l ’a prétendu que lquefois
,des aventur i ers
,
des hommes de hasard ,des individus déclassés qui avaient
aa choi s i r,dans leur pays
,entre la prison perpétue lle et le
Can ada _
où on les _dépor tai t . Nous en avons déja trop de
cette légende . Nous t enons notre origine d ’une imm i grati on saine
,d ’un élément intégral —de la nat ion françai se . Nos
ancêtres étai ent des paysans , des soldats , des bourgeoi s et desseigneurs . Ils formai ent une colonie dans le sens vrai dumot et cette co loni e étai t formée de paysans emportant aveceux les mœurs
,les habitudes
, la langue et les croyances deleur canton paternel ; de mili tai res , offici ers et soldats qui ,une fois l i cenciés , venaient s ’établir sur le sol , apport ant unsurplus de force , de courage et de vertus chevaleresques qu i
rendai t a ce peti t peuple l ’ espri t de sacrifice chose s i s imple ,s i na turel le
,que nu l n ’
en e st surpris , ne s’ en prévaut et ne
s ’ en flatte . Ah ! il serai t heureux que l ’on pri t aujourd ’huiautant de soin a recruter les imm igrants que l ’On va chercherpour peupler n os centres colon i sateurs .
La colonie canadienne est fondée . Il ne reste plus maintenant qu
’
a la voir prospérer et grandir . Tous y m etten t,la
. main généreusement . Mais une classe d ’hommes se surpasse , i ci , eu dévouement et en abnégation . C ’ est le c lergé
448 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINEcomba devant cette honnêteté s imple mai s ferme d ’uneconsci ence droite et convaincue .
”
E t le même écrivain ajoute plus loin : On ne saura i taccorder trop d ’éloges au clergé canadi en
,et quoi qu ’
i larrivé , sa mémoi re est désormai s inséparab le de l ’h i stoi rede ce peuple dont i l es t un des principaux fondateurs
, e t
dont i l a été incontestab lement le souti en et sauveur dansles temps modernes .
— (La France aux coloni es,E .
Rameau ) .
“ Partout , di t a son tour M . Lefebvre de Bel lefeui l le,le
prêtre a su ivi le prem i er colon et que lquefoi s l ’a devancé .
le prêtre pénètre toute la soc iété canadi enne,toute l ’hi stoi re
du Canada ; ses œuvres se retrouven t partout,et avec lu i
,
on voit l ’Egli se Catholique qui , après avo i r fondé notrepeuple le conserve encore et le protège dans les luttes qu ’
i lsouti ent — (R evue Canadi enne T .V I . p .
Aussi , dans cette œuvre sacrée de la coloni sation,le curé
ne continuai t-i l pas l ’œuvre commencée par les r eli geux
J ésu ites ? Ces dern i ers furent aus si les colon i sateurs duCanada . A côté des forts qu i garanti ssai ent la sécuri té descolons et de leurs prem i ères moi ssons sur le so l canadi en
,les
miss ionnai res s ’
appliquaien t à fixer aux travaux de l ’agr i culture et les tribus vagabondes des sauvages et les familles desimmigrés franç ai s .
Le Père Buleux,arrivé aux Troi s -R iv ières dans les pre
mi ers jours de jui llet 1 685,n
’
eût ri en de plus pressé , aprèsavoi r fondé l ’égli se de la Conception ,
que d ’appliquer ses
nouveaux paroi ss i ens a la culture de la terre . I l écr ivai t,peu
de temps après son arrivéeS i Capi tanas vivait encore (Capi tan as étai t un chef
indi en,
am i des Françai s ) i l favor i sera i t san s doute ceque nous allon s entreprendre ce printemps pour pouvo irrendre les sauvages s édentai res peti t a petit . Comm e ces
pauvres barbares sont dès longtemps accoutumés a être.fainéants
,i l est di ffic i le qu ’
i ls s ’arrêtent à cultiver la terres ’ i ls ne son t secourus . Nous avons donc dessein de vo irs i que lque fami lle veut qui tter s es courses ; s ’
i l s ’ en trouvequelqu
’
un e,n ous em ployeron s ,
au renouveau , tro i s hommesa
_
planter du b lé d ’
inde proche de la nouvelle hab itation de
Troi s -R ivières où ce peuple se plai t grandement . Quantaux homm es que nous dés i rons employer pour leur ass i stance
,M . de Champlain n ous a prom i s qu ’
i l nous en aecom
LA REVUE FRANCO —AM ÉRICAINE 449
modera de ceux qu i sont en l ’hab i tation des Troi s-R ivi ères .Nous satisferons pour les gages et pour la nourri ture deces ouvr i ers a proport ion du temps que nous les occuperonsa défri cher et culti ver avec les sauvages . S i j e pouva i s enentreteni r une douzaine
,ce serai t le vra i moyen de g agnerles sauvages . ” — (R elations de 1 685 ,
p .
Ce que les Jésu i tes firent aux rÉm i s -R ivi ères d ’autres m i s
s ionn ai res non moins m éri tants,le firent à Québec
,a Tadou
sac , aMontréa l , tout le long du Saint-Laurent et ail leurs au
Mi ss i ssipi jusqu ’à la Nouve lle-Orléans . Dans le vi euxR oyaume du Saguenay les seuls défri chements qu i
:s ont fai ts dans l ’espace de deux siècles,où tout ce domaine
était l ivré au monopole et au privi lège des traiteurs , ont é téf aits par les Jésuites . Ces rel igeux ,
du reste,ne furent— i ls
p as les premiers m eun i ers du Canada ?Un jour , a Subiaco , en Ital i e , un Goth qui travai llai t , mal
h ab i le à son méti er,lai ssa tomber sa cognée au fond d ’un lac .
S aint B enoi t était la. Il fait un miracle et la cognée revint«du fond du lac se remettre entre les mains de l ’ouvri er :“ Prends ton fer
,di t Benoi t
,au bûcheron barbare
,prends ,
“ travail le et corisole toi . ’
Paroles symbol iques,sécr ie M . de Monta ,
lembert où l ’on‘aime à voir comme un abrégé des préceptes et des exemplesprodigués par l ’ordre m onastique a tant de générations etde races conquérantes . ”
P 1 ends ton fer,travaille et console toi ont pu dire
à chacun de nos colons de la Nouve l le —F rance les re ligieuxJésuites et les prêtres
,humb les curés de nos compagnes
Lorsque l ’on constate d ’une m an ière si vive dans le passé denotre pays et encore aujourd ’
hui , cette un i on si parfai te dup rêtre et du colon ,
la bonne enten te qui a toujours existée ntre eux
,on est ten té de prendre pour devise a notre pays ,
ces m ots em pruntés aux mo ines : Crucé et aratro ,par la
«c roix et la charrue
Nous sommes en 1 700 .
C ’est dans lcs comtés actue ls de Québec,Mon tm or cn cy et
Portneuf que se trouva it alors le foyer princ ipal de la colon is at ion . La vi lle de Québec était entourée de s c igue 1u ies
t lcs seigneuries qu i se trouvaien t ren fermée s dan s le comté
450 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
de Kamouraska consti tuaient le groupe de co lons le plus important . L z
‘
i, résidai t essenti ellement ‘
l a force de la nation ;ce comté comptait à lui .seu l plus de âm es
,les deux tiers
alors de toute la populati on . En remontant le Saint—Laurent , déjà auss i des établi ssements impo rtants commençai entà. s
’
échelonn er sur les deux rives , tout le long du fleuve . L a
rive sud , où de grandes se i gneuri es étai ent s i tuées , formai tun pays très ferti le qui att ira immédiatement un grandnombre de colons , malgr é le voi sinage des Iroquoi s qu i ,dz
‘
1 n s_l_a s ui te , firent sub i r de grave désa stres à ces établi sse
n,1 .ents . Toujours en remontant le fleuve
,un peu au nord
ouest ,de —
.ces seign euri es , on trouvait,enfin
,la coloni e s ul
pici enne . de Montréal — qu i , déjà , voyait le pays se peupler aunord et
_au sud du fleuve . Montréal éta it alors le point ex
tr êm e de la A lors éclata cette sanglan te
guerre anglo- f rança1 se q ui , p endant plus de qu inze ans , eût
des effets désastreux_pour
'
-la . oolorfie . La fata le conséquencede cette guerre fut de paralyser et même de ruiner la colonisation dans les districts avancés qu i , par la douceur du cl imatet la ferti lité du sol
,offraient précisément au pays le plus
d’avantages . Les Iroquoi s poussés par les An glais , j alouxet inquiets des établi s ssem en ts françai s ,
détruisirent,dans
leurs di fférentes incursions,non. seulement les cultures et les
hab i tati ons,mai s même une parti e de la population . Les
seigneuries de tout le distri ct de Montréal souffri rent considerablem en t de ces désastres . Heureusement le di strict deQuébec
,abrité par la luttte même de ses poste s avancés jou it
d ’une grande tranqui lité et vit se reporter sur lui le peu d ’
es
sor que pri t le Canada durant ces fâcheuses années . - Néan
m oins sous M . de Calli ères qui se montra non m oi n s sérieuxet inte ll igent que M . de Frontenac aqui i l venait de succéder ,le pays c ommença à réparer ses pertes . Assurés désormai sdu calme et de la s écurité
,les hab i tants des se igneur ies du
pays dévast—é rentrèrent dan s leurs héri tages ravagés . Ils
repri rent leurs travaux avec opin i âtreté et ramenèrent aprèsque lques années leurs paroi sses au po int de développement oùel les étaient vingt ans avant la guerre .
Néanmoins,si l ’on jouissai t de que lque tranqui llité de la
part des sauvages , on conservai t plus d ’une inqui étude ducôté des Anglai s avec qui la France étai t toujours en gue rL e trai té d ’
Utrecht , en 1 71 8, assura , enfin , après vingt-hu it
ans de troubles , une paix com plète au Can ada . Mais autre
452 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
mêm e jamai s, chez les colons , dans l ’ interva lle des deux
guerres . Cette paix ne fut,en Amérique
,qu ’
une trève
a 1 mee , et le Canada ne vit point renaître l ’heureux essor qu ’ ilavait commencé à prendre .
On comprend que la coloni sati on devai t souffri r de cettepén ible cri se . Tout de même
,de 1 789 a 1 754
,on concède
encore quinze se igneuries nouve lles et s ix augmentationsd ’anc i ennes . Ce lle qui avai t été accordée en 1 754 a M . dela Corne , dans le comté actue l d ’
Yam aska,est la derni ère
que créa l ’admini stration françai se . Désormais d ’autressoins et de terrib les souci s n e lai sseront plus de temps pourles pai sibles occupations du déve loppement colonial .Au mom ent de la lutte finale
,en 1 755
,le Canada pouvai t
compter âm es,plus envi ron 4 ou colons
,Voya
geur s , chasseurs et trai teurs , répandus dans les colonies del’
Ouest et parm i les nations sauvages .Les Anglais
,eux
,se préparai ent derechef a la lutte .
Jamai s on n e vi t en Amérique un déploi ement de force etun acharn ement comparables à leurs e fforts . En France
,on
ne voyai t rien ; on ne voulut ri en voir , et les forces que l ’ondaigna envoyer en Améri que furent il lusoires en présencedes armements immenses de l ’Angleterre .
Vo i là le b i lan de la situation de la colonie francai se aumoment où commence la grande guer re . Il n ’entre pas dansle plan de notre travai l de relater i c i les dern i ers instants decette coloni e
,la plus be lle
,m ai s
,hélas ! la plus négligée que
la F rance ai t jam ai s eue entre les mains . Deux ans après ,en 1 760
,on cédai t la Lou i s iann e à l ’E spagn e et la pui ssance
f rançai se ç
di sparai s sai t de l’
Am ér ique du Nord pour toujours .
Une superbe incur i e vient de fai re perdre à la France l ’occas ion la plus favorab le d ’agrandi ssement et de pui ssance . D 1
.
ec tte belle colon i e ,tout lui est enlevé en un jour . Le beau
rêve de R i che li eu,de Colbert et de Vauban de fai re un e
nouvelle France forte et heureuse n ’
a pas été réal i sé .
Lorsque l ’on r efiéch i t a toute cette pui ssance perdue , ditM . E . R ameau ,
lorsque 1 ’on étudi e dans notre h i stoi re lesvi sées creuses
,les amb itions i rrationne lles , les passions
mi sérab les auquelles en a sacrifié à grands fra i s ce magni
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 453
figue avenir ,le cœur s e soulève de regret et d ’
indignation
contre la politique et le système qui ruinèrent les forces dela France et la contraignirent aux tristes nécessités de larévoluti on .
Les Anglais sont désormai s nos maîtres . Notre rési stancea été héroïque ; de suprêmes et patriotiques e ff orts ont épui séle dern i er homme et le dernier écu . Que vont deveni rma intenant les pauvres co lons canadi ens-français s i brusquement séparés de la mère —patrie ? Ah ! e lles sont b i en loinaujourd ’hui la douce Bretagn e et la grasse N ormandi eL a Providence ve i lle . C ’ est alors qu ’ entre en action le clergécanadi en qu i commence son œuvre de paix et de consolation .
Nous l ’avons di t,les colons françai s
,abandonnés par leur
mère nourric i ère,m altraités d ’abord par leurs nouveaux
maîtres,se tournent vers l ’Egli se et identifient pour ainsi
di re leur vie nationale avec leur vie rel igi euse . C ’est l ’b i sto i re du pauvre malheureux dont la vie est brisée par le sdeui ls et les souffrances et qui va pui ser la force et la consolat ion à la source de toute force et de toute con solation . D c
cette identificat ion sorti ra la paroisse canadienne-françai se .
E t alors,auss itôt
,se révèle la fin providenti e l le de ce change
m ent de domination :“
Si la race française ,dit Don Paul
Benoi t,avait pris
,sans contradi cti on
,cette expans ion que
semblait annoncer ses débuts de colonisation sur le SaintLaurent et sur le Missi ssipi , e lle aurait acquis une puissance magnifique
,mais croyons —nous
, _
toute humaine etterrestre
,comme peut l etre ce lle des nations qu i ont une
vocation moins haute,
une puissance brillante maiscaduque et éphémère
, parcequ’
el le n ’aurait pas répondu asa mission particulière . Dieu veut que la nation françaiseait un splendide essor dans 1 ’Amér ique du Nord ,
i l lui a di tcomme à Abraham : Vous vous mu ltiplierez comme leséto iles du ciel . Mais cette multipl ication , comme ce lled
’
Abraham et de Jacob , aura,l ieu en Egypte et sous le . j oug
de Pharaon ,nous voulons dire sous la domin ation d ’une
rac e étrangère qui a des destinées moins haute s .”
Les fami lles canadiennes,une fois rem i ses des secousses
de la guerre , se multipl i èrent et s’
étendi ren t dans les seigneuri es où el les étai ent clairsemées . Les plus anci ens cantons cont inuèrent de déverser leur jeunnes se dans les seigneur ies m oins peuplées et, pendant que les Anglai s s
’
éver
tuai ent à inven ter de petites roueries vexato ires pour absorber
454 LA REVUE FRANCO : AMË RICAINË
leur national ité , les Canadi ens la consolidèrent de la man i ère la plus sûre et la plus forte
,en formant une masse
serrée , homogène incessamment croi ssante par une progress ion irrés i stib le .
La population française devint compacte sur les bords duSaint Laurent et forma
, sur chaque r i ve , deux chaînes bienliées de solides établi s s ém en ts .
Tout allai t donc b i en pour_nos colons . La fin du dix
hui tième s i ècle,s i orageuse en Europe
,fut au contraire
,très
calme au Canada jusqu ’
à‘
la guerre des Etats-Unis,en 1 8 1 2.
L’
Angleterre ne pouvait di sposer à cette époque que de forcestrès restreintes . E l le chercha donc a s ’attacher les Canadien s
, à s ’assurer leur concours et e l le y réussit . Les mi li ce scanadiennes se levèrent avec zèle et
,presque étrangères
depui s plus d ’un demi -si ècle au métier des armes,e l les retrou
vèren t toute l ’énergi e et la verve m i l i taire qui les avai enti llustrées naguère et qu i semb lai ent être naturelles au sangfrançai s . L a paix suivi t
,en Amérique
,celle qui fut conclue
dans toute l ’Europe après la chute de Napoléon .
Jusque là.,on peut dire que les colons canadiens -français
s ’ étaient parfaitement conservés eux—mêmes . La plupartignorai ent comp lètement la langue du vai nqueur qu ’on avaitsongé d ’
abord a leur imposer . Ils étai ent arrivés en se '
mult iplian t et en se poussant à rempli r tout le cadre des anci ennesseigneuri es . Mais en ce moment , i ls se trouvèrent arrêtés parde funestes préjugés Ils se tenai ent attachés non seulementa leur langue et a leur usages , mai s jusqu ’
a la tenure sei
gneur i ale avec sens et ren tes . Ils préférai ent subdiviser àl ’ infini avec leur s enfants les propriétés qu ils possédaientdans les '
seigneuries , plutôt que ' d ’aller se tai ller quelque domaine dans les townships , c ir conscr iptions territori ales étab li es par les Anglais .
dans les di stri cts encore inhabitées .C ’éta i t assurément une me sure fâcheuse d ans un pays
’
oùl’
hiVer ,long et rigoureux ,
r énd’
n éce‘
s sai re , pour la‘ culture
de chaque ferme , une plus grande étendue de terrain .
0 1 1 ne connai ssait pas le pays au delade la ligne seigneur iale de sa paroisse , et , di sons— 1e, le gouvernement , en outre ,n a’ vait encore rien fai t pour la colon i sai n. Il vint d0n cun temps où ces lacun es ,
j ointes à une—
suite de mauvai sesrécoltes
,forcèrent les enfants a s eloigne ‘r
_
et a chercher del ' espace , si l ’on ne voulait pas voi r la gêne se f aire sentirdans la proportion de l ’accroissement de la population rurale .
456 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
breux colons de ce vaste terri toire et un important mémo i refut préparé par eux pour être transmis ensui te au gouvern ement . Chaque page de ce mémoi re est frappée au coin dupatriotisme le plus pur . On demandai t au gouvernement denouveaux chem ins pour la colonisation
,les moyens de pro
curer a la jeune sse canadi enne des terres ‘a des conditionsavantageuses ; on le pr 1 ai t d ’écarter les obstacles qu i empêchai ent l ’étab l i ssement des terres nouvelles
, d’amél iorer
les voi es déja ouvertes et d ’
v étab li r même un système permanent de voiri e . Le gouvernement pri t la chose au séri euxet insti tua un comité spécial pour s
’
enquér i r des caùses
qui empêchent et retardent la colon i sation .
” L ’on m i t
peu de temps a les trouver . Les principales étai ent : lemanque de communi cations
,le mauvai s système de voi rie
qu i exista i t et , par dessus tout , le système anti -national dela vente d ’
immenses quanti tés de terre a de s parti cul iers quine voulaient pas la coloni sation du pays
,mai s seulement l ’ ex
ploi tat ion du peuple coloni sateur .En même temps
,de nombreuses entreprises particul ières
venai ent s’
adjoindre aux e ff orts du gouvernement pour détourner le courant d ’
ém igration a l ’ étranger . Une sociétéopéra sur les —imm n ses ter ri to i res du Saguenay et du L acSt . Jean . B i entôt
,une fou le de j eunes gens forts et vigou
reux' se frayèrent courageusement la route et , en peu detemps
,un commencement d ’établ i ssement s
’
off r i t, dans ces
sol i tudes,aux regards étonnés des paroisses d
’
alen tour .
L’
élan étai t donné ; l ’œuvre coloni satri ce ne fit qu’
avan cer
en cette contrée . Aujourd ’hui,la vallée du Lac Saint-Jean
est un vaste territoire peuplé de 50 ,000 âmes .
Une opérati on analogue fut aussi e ffectuée en même tempsdans le sud du comté de Dorchester . Le séminaire de Québec ouvrit auss i à grands frai s des chem ins dans l ’ intéri eurdes montagnes de Montmorency . Pendant ce temps , la
presse canadi enne ne restait pas en arri ère ; el le s’
eff orçai t
de fai re ressortir combien i l y avai t d’
incertitudes , d’ i llusions ,
dans l em igrat ion _
aux Etats—Uni s . On souleva la questiondes amé liorations agricoles ; on étudia avec plus de sympathieles méthodes agr i coles apportées par les Anglais . Les soci é»tés d ’
agriculture se créèrent et se multiplièrent si rapidementqu ’
i l est peu de localités aujourd ’hui qui n ’aient pas les leursl ’enseignement agrico le
,jusque là fort négl igé , entra dans
le cours usuel des études . Aj outons que la création de nom
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 457
breuses sociétés de colon i sati on datant de cette époque ,
témoigna hautement de l ’ imp0rtan ce que toute la populationaccordait au défri chement et a la culture des terres incultes .R i en ,
a coup sûr , n’ est plus propre a seconder les e fforts de
l ’administration et a fai re avancer rapidement la colonisationque la for mation de ces sociétés pour venir en aide au 0 0
lons pauvres . Car ce n ’ est pas tout pour nos défricheurs depouvoir pénétrer faci lement dans la forêt . I ls s ’y rendentpour la plupart dans un état voi sin du dénuement . C ’ est làque se fai t sentir le besoin du secours ; et c ’ est la que l ’onpeut appréc i er la char itab le influence des soci étés de colonisation , quand e lles sont b i en dirigées . Le gouvernement a
toujours contribué à la formation de ces soc i étés de secours .
E t les vrai s am i s de la colonisat ion ont vu la un motif d ’ encouragem en t suffisant pour forcer les c lasses aisées a part ic iper a cette œuvre de ph i lanthropi e et de patrioti sme .
Nous avons cru bon de donner ces détails pour f ai re voirco mmen t s ’opère le trava i l du progrès chez ces peuples dontl ’accroi ssement rapide nous étonne . Sans doute
,les cir
constances part i cul i ères de leur s ituation,la grande étendue
de terre dont ils d i sposen t leur vi ennent singul i èrement enaide ; mai s i l est bon que l ’on sache comment l ’activi té dechacun s ’y emp 1 0 1 e avec une énergi e qu i laisse loin derrièree lle l
’
apathie et l i ndi ff eren ce des' société s engourdies du
vieux monde . Dans notre développement , nous avons emprun té un peu de l ’ intel l igen ce des Améri ca ins , laquelle estmarquée
,i l est vrai , d
’un peu de particularisme,mais qui se
donne toute ave c zèle aux a ff aires générales . Et c ’ est pourquoi notre développem ent a été si rapide .
Aujourd ’hu i,nous récoltons le fru it des travaux de tous ces
pionni ers qu i ont parcouru tout le continent semant partoutl ’amour du sol natal . Le champ , qu
’
i l s ont ouvert a notreactivité est vaste et , comun e i ls nous ont fait les travaux plusfaci les et plus rémunérateurs , avec de l ’ énergie et de la prévoyance
,l ’avenir est plein de promesses .
On ne peut n i er que la conquête de l ’ai san ce qui représente ,en Europe , les travaux réun i s d
’
une fam i lle pendan t plusi eursgén érations . est i c i , la plupar t du temps , l ’œuvre d ’un seuli nd ividu . Voyons ces bel les fermes s i j olies qu ’e lles res semb lent a de r i ches vi llas de c itad in s , qui entourent nos
.
vi l les et
qu i apparai ssen t ça et l‘
a dans les campagn es les plus reculées ;inform on s -n ous quels en
‘ son t les propr iéta i res et n ous‘ seron s
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
étonnés d ’apprendre comb i en il y en a qui apparti ennent adesnouveaux venus arrivés sans autre capital que leur s deuxbras . Ceux-là , comme nos pères , n
’on t pas eu peur du travai l et du Canada . B i en qu ’
i l re ste encore,dans la province
de Québec,d ’
immenses pans de forêt a défricher , i l ne fautpas s ’ imaginer qu ’el le est un pays encore sauvage
,ré parée
d’
i ndien s an then t i ques et des bêtes sauvages , sorte de S ibér ie ,comme le croi ent certa ins Européens a l ’ imagination faci leet a l ’épiderme frileux . La civili sation du vieux monde ,transp lantée i c i
,i l y a plus de deux s iècles
, s’
y est déve loppée et , a mesure que la population s ’ est multipliée
,que
l ’éducation s’ est répandue ,
que les communi cations transatlantiques sont devenues plus fréquentes , l ’Europe nous atransm i s se s hab i tudes , ses goûts et jusqu
’à son luxe . Nousn e sommes donc pas des Peaux—R ouges ; nous sommes lesfi ls des pionn i ers de la Nouve lle —France , agri culteurs pardroi t de nais sance
,vivant de la terre de qui nous attendons
richesse et prospérité .
La terre,1’
agri cult 1 i re !Oui ; s ’écrie le recorder de Montigny qui a écri t tant dejo lies choses sur la colonisation
,ou i
, l ’agri culture est l ’étatde ce peuple qui s ’ est implanté si mystérieusement dansces quelques arpen ts de n eige !
”
C ’ est une nob le vocation que ce lle de mouri r le genre humainen travai l lant en soci été avec l ’auteur de la nature qui exécute même la partie la plus di fficile de l ’œuvre . Le Canadaes t un pays agrico le et toute l ’histoi re de sa co lonisation consti tue un beau panégyrique de l ’agr iculture . C ’ est pourquoi onse plai t à présager pour le Canada , pour la province de Québecen particuli er
,un heureux avenir . Chez nous , chacun peut
di re sans honte : Pe ter m eus agr i cola . L e même so l quinous d0 nne ses trésors , les refusai t autrefois aux sauvagesparceque les sauvages ne voulai ent pas le culti ver ; aussi ,aujourd ’hui
,le plat de sagam i te
‘ des Algonguin s et des Iroquoi s a été remplacé par du bon pain et du beurre qui sentbon avec auss i du fromage que l ’Europe nous di spute .
L es peuples adonnés ala culturedu se l dit-on , ont poureux la richesse
,le nombre et la durée .
460 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
moines , qui a grandi et prospéré a côté de sa rivale , et quisera pu i ssan te aussi longtemps que chez elle l ’agri culturerestera flori ssante . Un de ses mi ni stres
,Sully
,n
’
aim ai t-i l
pas à répéter «souvent ce mot bien connu : Paturage etlabourage sont les mame lles de la France .
Bref toutes les autres nations modernes qui,dans les deux
m ondes , ont aujourd’hui la plus grande prospér ité
,sont des
nations adonnées à l ’agri culture . L a Belgique est cultivéecomme un jardin
,et il n ’ es-t pas de pays plus prospère peut
être que la peti te Belgi que . L à,les laboureurs
,qui sont la
m ajorité , sont la gar anti e du pays et de la rel igion . L ’agricu lture fait de même la fortune de l ’Allem agne et de laRuss i e où le peuple des campagnes demeure s i simple et s i
robuste,s i attaché au sol et s i labor i eux . C ’est donc l ’agri
culture qui a fait les peuples de l ’antiquité ; c ’ est e lle qui estla mère de nos grands états modernes . Ce n ’ est pas le seulde ses b i enfai ts .Tout le monde s ’ accorde avec l ’ expér ience pour affirmer
que l ’agri culture est la nourr i c i ère nature lle des races fortes .
E lle constitue aussi le m i l i eu le plus favorab le au développement d ’une santé robuste . Cherchons où se trouvent lestempéraments de fer
,les types de haute stature ; cherchons
où se trouve et le sang vi f et les joues roses et le te int verm ei l ; cette santé qui af fleure dans une peau fine , cette vie
qu i péti lle dans les yeux ,cette âme forte chevi llée au corps
qu ’e lle an ime , nous trouverons que tout cela réside surtoutà la campagne ,
chez les populations agricoles . E t s i la '
vie
des champs fai t des hommes de tempérament robuste , e llefai t des générations fortes , capables de concevoir et d ’agi ravec vigueur , de revêti r même la cu i rasse et de por ter avechonneur l ’étiquette nationale . Salut
,d i sai t Vi rgi le
,salut
“ terre d ’
Ital ie ,mère féconde et des mo i ssons et des héros !
Salve,magna parens f rugum saturnia tellus magna
vi rum
(G eorg . L i t . II .
Mai s,a D i eu ne plai se , que nous restre ignions le per
f ect ion n em en t de l ’homme au développement physique . Au
dessus de l ’ ordre m atér i el s e superpose l ’ordre inte l lectue l etm oral et nous osons affirmer , s i l
’
on entend l ’agri culturecomm e i l faut , et s i l ’on n ’ exige point non plus , une culturetrop spéc iale de l ’ espri t , que la vi e du laboureur est favorab le
I A REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
au développement des facultés inte l lectue lles . Si le labourem ,
dit le P . Herbreteau,S .J .
,n
’
est pas plus savant queles autres trava i lleurs , s i même i l a mo i ns de cette facondecitadin e que l
’on rencontre dans les grands centres,
en
revanche , i l semb le garder le privi lège de la droiture d ’ espri tet du bon sens . L equi libre des facultés se perd plusa i sément dans le tumu lte des vi l les ; la juste pondérationdes humeurs , au contraire , et les solutions toujours égalesse conservent mieux dens les campagnes . Enfin
,s ’ il es t
vrai , selon l ’ant ique adage que la perfection de l ’hommecomporte une âme sai ne dans un corps sa in
,m en s sana in
comm e sano, il ne semb le pas que nul le part en dehors del ’agriculture on en trouve mieux et les é léments et les con
di tion s .
Prouverons-nous,en outre que l ’agriculture est un mi li eu
spécialement favorable au deve loppement du sens mora l etreligeux d
’un peuple ? Tout est ple in de Dieu a la campagne
,a dit un poete païen ; c
’est l ’action divine que l ’oncroi t sentir et entendre dans cette germinat ion profondesous nos pieds dans les guérêts et sur nos têtes dans les
bourgeons . ” Le laboureur sème et Di eu arrose et faitpousser . Tous deux travai llent en commun . Prouveronsnous encore que l ’agriculture est la gardienne de la foi etde s bonne s mœurs ? Le poète de Mantoue disait encoreLa sainte pudeur
,chassée de partout
,avait pr is demeure à
la campagne .
”
Cas ta pudi tiam servat domus .
(Georg. L i b. II . pE t Colume l le disait à son tour : La vie des champs est
proche parente de la sagesse si même elle n ’ en est pas lasœur . ”
Ah ! aimons donc la vie des champs , aimons l’agriculture .
Laboureurs,aimez vos laborieux travaux et surtout l ’agri
culture instituée par le Très-Haut disait Salomon danssa sagesseAimons notre cher Canada ,
aimons notre be lle province deQuébec que l ’agriculture a fa ite ce qu ’ el le est aujourd ’hui .N ’en désertons jamai s le sol . Tandi s que la vie vagabondeet instable des ouvr ier s es t une école d ’
i rré ligion et de vices ,une désorganisat ion de la famille , la désunion entre ceux qui
462 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
sont fai ts pour s ’a imer,la vie de fami lle
,a la campagne , fai t
l ’éducati on des enfants , garde leur j eunesse et prépare leuraveri ir .
F ils , reste z chez vous ! Que ce chez vous soit la fermetoute blanche et coquette ou la modeste cabane de boi s rond .
R estez chez vous ! L e Chez vous de vos pères,plus tard
,le
chez vous de vos enfants et de vos arrière -petits —enfants .
Pères,gardez vos fi ls ! conduisez -les souvent
,là-bas
,en haut
du champ et , en remettant a chacun d’ eux
,la pioche , la
charrue ou la faucille , dites-lui , comme Saint—Benoit aubûcheron barbare : Prends ton fer , mon fils
,travaille et
console Voici ton gagne-paix ; fais comme moi ettu seras heureux . Vois —tu cette terre ? e lle sera a toilorsque mes vieux membres tremb lants ne me permettrontplus de la cu ltiver . Alor s , ne la laisse pas mourir , cettepauvre grande amie ; ne vas pas la lai sser dormir au bonsole i l
,tandis que nos outils des champs se rouilleront .
G arde,mon fils
,toute ta vie , comme moi , ton titre d
’habitant les goûts simples
,l ’amour de Dieu et la paix du
cœur .Damas e Potvin.
464 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
C ’est une œuvre de p arti pri s que Ak ins a faite , et non pasune compi lat ion h i storique impartiale , te l le que le demandai tl e vote de la Chambre .
L ui même l ’avoue presque .
Quoiqu ’on ai t écri t volum ineusem en t , di t i l a la pagede sa préface , au suj et de l ’ expuls ion dés Acadi ens , cettequestion ,
jusqu a ce s derni ers temps , a fait l ’obj et de peu derecherches et i l en est résulté que la nécess i té de leur dépor tat ion n ’a pas été clai rement sai si e , et que les ra i sonsqui l ’ont détermi n ée ont été souvent ma l compri ses . ( 1 )
C’ est en suivant ce plan b ien ar rêté , et dans ces di sposi tions
d ’espri t que Aki n s a préparé pu i s pub lié , en 1 869 ,son recue i l
de Select-ions from the Pub li c Documents of the P rovinceo f Nova Scotia m i eux connu sous la rubrique de NovaScotia Arch ives .Or ,cette compi lation renferme
,on peut d ire
,à peu près
toute la source h i storique où les écriva in s de langue angla i sevont
,la plupart de bonne f o i
,pui se r les données qu i leur
s ervent à. écrire l ’h i stoi re du grand Dérangement .Dans l ’ intérêt de la véri té h i storique
,i l eût
,m i eux va lu
ne ri en pub l ier du tout que de donner au jury,au pub lic , un
plaidoyer,un e su ite de faits
,ex parte
L ’ espri t de parti pr i s a mani festement guidé Akins danstout le cours de ses recherches et a présidé au choix despièces qu ’
i l a pub li ées . Nous 1 avons vu déclarer lui -mêmedan s sa préfac e que ,
jusqu a lui,la néces sité de la dépor
tation des Acadi ens n ’a pas été clai rement compri se then ecess ity for the i r remova l has not been clearly perce ived .
C ’ est pour la falire per cevoi r a sa façon qu’
i l a,ou publ i é
,ou
omi s ou é lim iné , suivant le besoin de sa thèse , les documentspublics qu ’
il a trouvés aHalifax .
Sans y être autori sé par la Légi s lature , de compi lateurqu ’
i l avait été nommé,il s ’est fait lui-même docteur en his
Quelques exemples feron t voi r quel compi lateur i l est , etquel docteur en histoire i l fait .Il omet , dans la pub li cation des documents qu i se rapportent au trai té d ’
Utrecht,une ce rtai ne lettre t rès impor
( 1 )“ Although m uch has been u r itten on the s ubject , yet , un t i l lately ,
i t has indergone l it tle actual inves t igat‘on . and in c
*
n sequen ce , the n eces
s i ty f or thei r rem oval has n ot been clear lv perceived , and the m ot ives whi chled to i t s en forcem en t have been o f ten n i isunders tcod
P 1 1 .
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 465
t ante de Cos tabel le a N i cholson et les ordres souverains , del a re ine Anne au gouverneur de la Nouve l le-Ecosse , dont del a R onde éta i t porteur .Ces ordres
,arrêtées entre Loui s XIV de France et la reine
Anne d’
Angleterre ,m odifient essenti e l lement le traité
d’
Utrecht,quant a la si tuat ion des Acadi ens et au droi t qui
l eur y est accordé de se reti rer de la Nouve l le-E cosse ; i lsc onsti tuai ent la magna charta de nos malheureux a 1 eUX ,
laque l le fut ign orée,quarante deux ans plus tard
,par L aw
rence et Be lche r .S ix documents d ’une extrême importance se rapportant aux
t entatives qu i furent fai tes , en 1 720,sous le gouverneur
Ph i l l ips,pour fa i re prendre aux Acadi ens le serment d ’
allé:geance a la couronne d ’
Angleter re ,et qu i cons i stent en deux
m émoi res des Acadiens d ’
An n apoli s et de'
G rand Pré,en
u ne lettre du père Justin i en,en une lettre du gouverneur de
Lou i sbourg , en une lettre col lective des Acadiens au gouvern eur de Loui sbourg
,ne para i ssent pas dans les Selections
“from pub l ic Documents d ’Ak in s ; i ls en on t été intentionnellem en t om i s . La preuve
,c ’est que quatre de ces pi èces
«
s e trouvai ent,en 1 769
,et se trouvent encore
,aujourd
’hu i , aL ondres
,à côté d ’
autres qui furent copiées et pub l i ées par lecomp i lateur néo -éco ssais . Par exemple
,en n ’ en trouve
p lus une trace à Hal i faxA Ph i llips succéda
,en 1 722
,Doucet au gouvernement (1
’
la Nouve lle -Ecosse . Ce fut une pér iode de paix ét , jusqu’
à
un certa in po int,de bonne entente : Doucet , homme juste,
quo ique sévère , ne trouve guère de plaintes à adresser auxL ords du Commerce au sujet des Acadiens . C ’ est plutôt lec on traire . Akins dont elle ne fai sait apparemment pas l ’
af
f ai re , passe sous silence toute la correspondan ce officie l leéchangée entre Doucet et Londres .
Autre exemple,Akins reproduit quinze lettres du général
-Amer st , cinq du gouverneur Pownal , trois du gouverneurPh ip s ,
toutes adressées au gouverneur L awren ce , toutes dela plus haute importance , pu i squ ’e lles se rapportent à l ’expuls ion des Acadiens et aux événements de cette époque , mai si l ne publ i e aucune des réponses de Lawrence a ces lettres .
Pourquo i cela ? Ces répon ses ne se retrouvent plus nu llepart . Qui les a fa it disparaître ?Q.ui les a détruit e s ?L es événements de 1 755 ,
les plus pass ionnants pour l ’h i st or ien
,sont presque entièrement passés par le comp ilateur .
466 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Il lai sse dan s les ténèbres des faits histor iques et sociauxdu plus haut intérêt .Les instructions données à. Akins par la législature étaient
de fai re une compilation des pi èces et documen ts les pluspropres à faire connaître l ’histoire et les progrès sociaux dela province de la Nouve l le -Ecosse .
’
Ce n ’étai t pas une h i sto i re de l ’Acadie qu ’
i l éta i t chargéde fa i re ; mais de ramasser des maté r iaux servant à cette hi sto ire .
°
Un des points princ ipaux à é clai r c i r est la questiondu serm ent prêté par les Acadiens a la couronne d ’
Angleterr e ,
question di ffici le a résoudre . Akin s la résout san s hésitationaucune et pour la résoudre i l sort tout a fai t de son rôle decomp i lateur ob l igato .
Jusqu a cette période ( 1 780 ) écri t-i l en note au bas dela page 266 , les habitants .de l ’Acadie n ’avai ent prêté ab solument aucun serment
,sauf ceux des envi rons de Port -R oyal ,
qu i avai ent pr 1 s un serment d’
allégcan ce sans cond ition .
”
Voi là une proposi tion qu ’ il »serai t b i en mala i sé de prouve r ;de même que ce lle -ci : Le gouverneur Ph i lipps
,a son re
tour a Annapoli s,
‘ en 1 780, amena enfin le peuple à prêter
spontanément un serment sans restri ction G overnor Ph i lipps ,
on his return to Annapol i s , i n 1 780 ,brought the people ,
at last, to take an unconditional oath wi ll ingly qu i est con
tredi te par tout le monde , les Lords du Commerce , les Acadieus et les gouverneurs anglai s eux-mêmes
,y compri s Law
rence .
L’
assef tion suivante rentre dans la même catégorie de
faits allégués sans preuve e t plutôt à l ’ encontre des p reuvesLe nom de Français Neutres ( french neutrals ) si souvent
donné aux Acadiens dan s les documents publics ; leur dén égat ion constante d
’avoir jamais prêté un serment s ans restr i ct ion
,dénégation souvent confirmée par leurs prêtres ,
firent tomber les gouverneurs de Hal i fax,en 1 749
,et a di f
f éren te s autres époques , dans l ’ erreur de croire , que les Acadieu s
,en e ff et
,n ’
avai ent j amai s prêté à. la couronne br itannique qu ’un serment d ’
allégeance conditionne l . ”R i en
,dans tout le volume des Nova Scoti a Arch ives
n e justifie cette assertion,et cependant Akins , pour les besoins
de sa thèse , l’
affirm e hardiment .Comme la p lupart des pièces of fic ielles qu i se rapportent
aux Acadiens à. p arti r de 1 71 0 . sont de provenan ce an g lai se ,
par conséquen t , bien su jettes à aucune p artial ité vi s -à-vi s des
468 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
rique — h i stoires de l ’Acadie l’une et l ’autre— adressée à
l ’abbé Casgrain en 1 860 ,j ette quelque lum i ère sur les ag i sse
ments des gardi ens des arch ives de Hali fax .
J’
arr ivai en septembre a Ha li fax . Mon am i,M Bea
m i sh Murdock ,m
’
obti n t la permi ssion de consulter les arch ives du gouvernement , et on m
’
as s igna un rendez -vouspour le lendem ai n . Je m e
_ présen tai a l ’heure di te ; on memontra sur une tab le un certa in nombre de r égi stres et devolumes mai s on me prévint qu ’
i l m ’éta it interdi t d ’ en prendre aucune copie n i extrai t . En conséquence j e n e devaisavo i r , n i plume , n i crayon . On me plaça près d ’une tablequi étai t au m i l ieu d 'une salle dan s laque lle travai llai ent huitou dix comm i s ; on ne me donna aucun siège , afin que j e nepu i sse pas m
’
as seoi r,et qu ’aucun de mes mouvements ne put
échapper aux employés .R ameau de Saint-Pèr e
,introduit par l
’historien BeamishMurdock
,était venu de F 1 ance à Halifax compulser les docu
m ents officiels devant servir à son histoire de l ’Acadie.
L ’abb é Casgrain ,l ’auteur d ’un Pèle1 inage au pays d
’E
vangeline et de plusieurs autres ouvrages histm iques cousid é
r
ables,ayant à traiter de la dispersion des Acadiens fut frap
p é,comme Halibu1 ton et R ameau
,par le nombre et l ’impor
t ance des lacunes qui émai llent les Nova—Scotia ArchivesIl se rendit à Londres pour y faire des études comparatives auBr itish Museum et au Public Record Office Laissonslui la parole .
Le Choix des Documents (Selections from PublicDocuments or Nova—Scotia Archives) a été é videmment faiten vue de justifier le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse dela dépœ tat ion des Acadiens . Pour cela on a éliminé syst é
mat iquement et laiss é dans l ’ombre les pi èces les plus compr om ettantes
,celles qui pouvaient le mieux établir les droits des
Acadiens . Qu ’on 1 emarque bien que le compilateur n’a pas
d 1 0 it de plaider ignor ance,car il indique lui-même
,en plus ieu 1 s
end1 0 1ts,qu ’il a étudi é les pi èces officielles du Pub lic Record
Off ice afin de les confronter avec celles d ’Hali fax.
J ’ai confronté à mon tour la compilation d ’Hali fax avecles oziginaux du Public Reco d Office et j ’ai constat é desomissions conside ables et tellement essentielles qu ’elleschangent complètement la face des choses . J
’ai acquis lapreuve que nos soupçons n
’étaient que trop fondés . ( 1 )
( l ) Un pèlerin age au pays d ’
Evangel ine , p . 39 .
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 469
Enfin,R ichard n ’est pas moins explicite . A la page 1 3
,
vol . 1 , de son grand ouvrage , il d éclare qu ’il n ’hésite pas àaffirmer que les documents (contenus dans les Nova—ScotiaArchives) ont ét é choisis avec la plus grande partialit é , et dansle dessin
,mal d éguis é dans la pr éface même
,de collectionner
toutes les pi èces qui peuvent justifier la d éportation desAcadiens .” ( 1 )
Pas ca l Po i r ie r
(2) Ce m ém oi re fut su ivi par l’
adopt ion à. l ’unan im i té des voix du congrèsdes résolut i on s su i vantes
Il est roposé par le sénateur Poi r ier et secondé par le sénateur Corneau :Atten i l qu
’
i l es t jus te et dés i rable que l ’hi sto i re de not re pays soit écr i teselon les fai ts , et qu ’
à cette fin, ,
les pi èces et docum en ts où les h i stori ensvon t pui ser soien t fidèles , impart iaux et , autan t que poss ible ,
com plets .
Et attendu que le recuei l connu sous le t i t re Selection s from thepubl i c documen ts of the Province o f Nova Scot ia ,ou s im plem ent
,Nova
Scot ia A rchives , recuei l collect ionn é , ordonn é et publié , en 1 869,sous l
’
au
tori té de la légi slature de la Nouvelle—Ecosse,et dans lequel les hi s torien s
qu i t rai ten t le sujet du Grand Dérangem en t”de 1 755 , pr i ren t presque
tous leurs ren seignemen ts , es t , (ain s i qu’
i l appert par le Mém oi re c i —con t re)de part i pri s , part ial et in com plet , quan t à la pé r iode h i s tor ique qu ’
i l couvre ;R ésolu —
“
Le congrès acad ien pr ie respectueusem en t Son Hon neur lelieutenan t—gouverneur en Con sei l , l ’honorable Consei l L égislati f et la m ai son
d’
assem blée de la Nouvelle—Ecc s se . de vouloi r b ien in st i tuer une comm i s s ion
chargée de revi ser et de com pléter san s part i pr is ,impa r t ialem en t , s ans
om iss ion de pièces essen t ielles et dan s un large espr i t de vé r i té h i s to r ique ,le recuei l des Nova—Scot ia Archives .
"
Revue des faits et des œuvres
Acad iens et Canad iens -França i s .
Un dis cours de Mgr Mathieu.
Nous parlons ai lleurs de l ’uni on des groupes acadi ens etc anadi ens—françai s qui a été applaudie au récent congrès deSt-Basile . Nos lecteurs nous sauront gré de leur donner i c iles principaux passages du di scours prononcé a cette occas ionet sur ce sujet
, par Mgr O . E . Mathieu,de l
’
Un iver s i té
L aval °
Nous avons la meme origine . Nous sommes les descendants de cette be lle race d ’hommes qui quittèrent
,il y a
déjà des siècles le beau pays de France pour venir sur lesrives inhospi talieres de nos fleuves et de nos rivières
,lever le
s igne de la R édemption , la croix du Christ qui partout où e l lea été plantée et respecté e a toujours abrité des peuples civil iséset heureux .
Nous sommes les fils de la France,de ce peup le , f ou
sub lime, qui seul conserve le privi lège de verser son sang
généreux pour une idée ; nous sommes les fi ls de la F rancequi
,même a l ’époque de ses malheurs
,arrachait a un em
pereur teuton cet é loge : Si j ’éta is Dieu et si j ’avais deuxfi ls
,,j e ferai l ’aîné D i eu et l ’autre roi de France ; qui malgré
ses misères,donne son or
,soutient à e l le seule autant et plus
encore que toutes les nations catholiques réunies , les grandesœuvres de l ’Egl i se ,
qui donne à Jésus le sang de ses enfantspour la prédication de l ’Evangi le dans les pays infidèles dansun e proportion unique , puisque sur cent missionnai res al ’étranger
,quatre—vingt sont français .
Non seulement nous avons la même origine ; nous avonsla même religion
,nous sommes les enfants de la même Eglise
et nous sommes également fiers de lui apparteni r . De tousles drapeaux
,ce lui de l ’Egli se , notre Mère , est le plus glo
rieux . Voi là vingt siècles qu ’ i l mène l ’humanité a tous leshérorsm es ; i l la mène à toutes les gloi res de la terre ; il lamène à la g loi re éternelle . Notre h i stoi re de fami l le , l ’hi s
472 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
a se lever tous,oubliant les quere l les particuli ères
,chaque
fois qu ’une main sacrilège tenterait de la violer .L ’un i té morale d ’un peuple
, el le e st dans la croyance et
le dévouement de ce peuple a la patrie . Quand un peuple sa i ttout ce que ce mot de patri e veut di re ; quand chacun dansun pays se sent prêt dès que la patri e s era menacée , a sacrifier ses inté rêts les plus chers
,sa vie
,ce lle de ses enfants ;
quand chacun a f oi en el le , quand chacun a pour elle un amourpoussé jusqu a l ’abnégation et au suprême holocauste ; quandtous ont cette idée profondément gravée dans la tête et ce sentim en t profondém ent ancré dans le cœur
,i ls peuvent en
dehors de la penser ce qu ’
i ls voudront,parler comme i ls le
désireront ils possèdent l ’un i té morale et forment une nati on .
E t voyez ce qu i se passe dans l’
Em pi re bri tannique .
Dans la parti e septentriona le de l ’E co s se ,on ne parle que le
gaéique . Et ces écossai s sont— ils mo ins loyaux que lesirlanda i s qu i font usage de la langue anglaise ?
“ Dans le pays de G alles,on parle deux langues à peu près
égalemen t . Mai s ceux qu i parlent le Gal lois ne sont pasmo ins loyaux que les habitants des di str icts où l ’anglai s es t enus age .
“ Dans les Iles de la Manche,le frança i s prédomine et nulle
part»ai lleurs le R oi n’
a de plus fidè les suj ets .“
Ainsi en est—i l au Canada . Nous,nous sommes loyaux
parceque d ’abord c ’ est notre devo i r et ensu ite parce c ’ estnotre intérêt .
“ C ’ est la du reste ce que comprennent bien tous ceux quinous conn aissent .
Ain s i , i l y a c inquante an s,quand les évêques de la Pro
vince de Québec voulurent fonder une Un iversi té,Lord E lgin
consenti t a le s a ider . Savez -vous que lles sont les deux rai son sque ce di stingué G ouverneur donna au Parlement angla i s etprotestant de notre mère patr i e pour obteni r une charte aux
pouvoi rs les plus étendus ? Il di t a s es conci toyens que nou svoulions fonder‘ une un ivers ité pour pourvoi r conserver n os
enfants f rançai s et cathol iques . E t ces anglai s compri rentque plus nous ser ions fidèles à notre f oi et a notre sang . plusn ous s erion s fidèles à la cause de l ’Angleter re .
Ce gouverneur , aux vues larges et éclai rées ,savai t peut
être le mot de l ’ empereur romain qu i voulait fai re apostas i erdes chréti ens . La plupart avai t refusé d ’o ffri r de l ’en cen saux idoles
,mai s quelques un s avai ent fiéch i devant les tour
LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE 473
ments et l ’Empereur commanda de les mettre a mort car ,d 1 sa1 t- 1 l : Ce lui qui est infidèle à son Dieu ne sera jama 1 sfidè le à son R oi .
Ce gouverneur connaissait notre histo i re ; i l savai t ce
qui s’étai t passé ici en 1 775 et en 1 8 1 2 i l savait que si le
drapeau anglais flotte encore aujourd ’hui sur le Canada,c ’ est
aux fran çais du Canada qu ’on le doit . I l sava i t qu ’ en 1 775,
quand —des anglo-saxons du Sud se di ri gèrent vers Québecdont a peu près toute la population était française
,Carleton
lança une proclamation ordonnant a tous ceux qui ne voulaient pas combattre pour le Roi de sorti r de la ville . E t pas
un seu l français ne sortit tous prirent les arme s et la coloniefut sauvée .
Ce G ouverneur savait qu ’en 1 8 1 2 que lqu ’un vint trouverle G énéra l américain pour lui tenir ce langage : Prenezgarde
,ces franç ai s sont de braves soldats . Bah ! répon
dit avec dédain le général,j e les connais ; i ls ont été é levés
par des prêtres ; ils ne savent que prier . La bataille s ’ engagea et de Salabe rry
,nouve l Epaminondas
,repoussa avec
éclat une armée beaucoup plus nombreuse que la sienne . Ces
canadiens savaient pr ier , san s doute , et -ils avaient besoin desavoir prier pour lutter comme des l ions à l ’ombre d ’undrapeau encore te int du sang de leurs ancêtres . Ils avaientété formés par des prêtres qui leur avaient enseigné surtouta respecter l ’autor ité , même quand el le a tort .Ce G ouverneur se rappe lait pen t—être ces paroles que le
généra l Murray adressait au Parlement d ’
Angleterre : Je
m e glor ifie de l ’accusation portée contre mo i d ’avoir protégéchaudement et avec fermeté les sujets canadiens du Roi etd ’avoir gagné à son Souverain l ’ aff ection de ce peuple braveet intel ligent dont l ’émigration , si e lle arrivait jamais , cau serait un e perte irréparab le à l ’Empi re .
”
E t ce qu etai ent nos ancêtres , nous le sommes , nous francais et cathol iques . E t
,Dieu merci , le Roi le sait . Il y a
trois ou quatre ans , un homme d ’
E tat anglais quittait sonpays pour venir vi siter le Canada et i l di sait à Edouard VITavant de partir : Je vai s al ler visiter le Canada et , a mon
retour,j e vous dirai ce qu ’
i l faut penser de la loyauté desfrançai s canadiens . ” Le Roi sourit a ces paroles et réponditNe perdez pas votre temps a cela ; ces français canadiens ,
je les conn a1 s ; ce sont les m ei lleurs suj ets de l ’Empi re .
474 LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE
Nous pouvons donc continuer a parler le françai s et àpratiquer notre religion . E t plus nous seron s
’
fidèles a cesdeux devoirs sacrés
,plus nous mériterons l ’ estime
,le respect
de nos concitoyens au jugement sain,au cœur bien n é , de
ceux en un mot qui sont capab les de connaître leurs intérêtset les nôtres .
“
E t pour qu ’
i l en soit ainsi,continuez a envelopper vos
prêtres de votre affection,a les entourer de respect , a leur
témoigner votre confiance . Ils vous aiment sincèrement ;ils ne montent chaque jour à l ’aute l que pour vous bénir ,pour attirer sur vous la grâce qui coule du ci e l avec le sang del’
Agn eau‘
; ils ne montent en chaire que pour di stiller sur vousla vérité que J . C . est venu apporter au monde . Ils n ’
appar
t iennent a aucun part i . Leur ministère est haut et m i sér icordieux comme la croix qui domine tout ce qui pas se etj ette ses bras à droite et a gauche afin d ’amener tous leshommes à Jésus-Christ . Si quelqu ’un leur demande de que lparti i ls sont
,tous vous répondront
,avec St . Vincent de
Paul : Nous somm es du parti de Dieu et des pauvres .
”
“
Et pour qu ’ il en soit ains i,aimez vos maisons d ’éducati on
aidez à leur déve loppement par un attachement sincère , parun entier dévouement
,par vos prières . Et rappe lez -vous
que c ’est a vos prêtres que vous devez ces maisons d ’
éduca
tion dont vous êtes fiers parce qu ’ el les sont la force et la gloirede notre race au Canada .
“ Où serait le Séminaire de Québec sans Mgr de Laval , oùserait le collège de Lévis sans Mgr D éz iel ? Où serait leco l lège de Ste-Anne sans M . l ’abbé Pain chaud ? Où seraitle séminaire de R imouski sans Mgr Tanguay ? Où seraitle co llège de Caraquet sans Mgr Allard ? Où - serait le col
lège de Memramcook sans le bon Père L efebvre ? - Où
seraient la plupart des .œ uven ts et des écoles dans la Province de Québec et dans les Provinces Maritimes sansl’
Egl i se ? A la première page de l ’histoire de toutes ‘
ces
mai sons d ’éducation se trouve écrit en lettres d ’or le nomd ’un prêtre qui en est le fondateur . Ce nom parfoi s est inconnu de ceux qui bénéfi cient de l ’œuvre mais i l est connude Dieu qui donne a ses fidè les suj ets la récompense promisea ceux qui usent leur vie a la formation des enfants F n lge
hun t s icut s tellae in perpetuas aetern i tates .
”
476 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
Donnons un souvenir tout plein d ’affection a nos bienaimés Acadi ens du Madawaska américain : p lus de c inquantepour cent de la population de Van Buren et plus de quatrevingt—dix pour cent de ce lle de la G rande-Ile , Me .
,on t pris
part a nos grandes assi ses et ce fai t touchait profondément .Les Canadi ens— françai s du Madawaska suivirent les déli
bération s avec le même intérêt que les Acadiens .Par tout ce qui s
’ est fai t ou passé a Saint-Basi le,nous
pouvons répéter ce que nous avons dit plus haut :Le Congrès du Madawaska
, en 1 908,a cimenté pour
jamais l ’union des deux grands peuples françai s de l ’Am érique du Nord
,dont la devi se un ique a été toujours , est
aujourd ’hui et sera a j amai s sur ce sol l ibre : GE STA D EI
PER FRANCOS
La Macé do ine et les capitulat ions
Sous ce titre M . L . Nemours G odré fa it,dans “
l’
Un iver s
de Paris , les reflexions su ivantes sur les récents événementspol i tiques que sont déroulés en Turqu ie .
Le programme des Jeunes Turcs comme ce lui detous les parti s j eunes
,est assez amb iti eux. Deux de ses arti
cles mettent en légi time émoi les chance lleries européen es ,
ce sont , d’abord : ce lui qui prétend écarte r toute ingérence
étrangère pour les réformes de la Macédoine , ét , ensuite ,celu i qu i demande l ’abol iti on des capitulations .On comprend fort bien la susceptib i lité du parti national
des Jeunes Turcs sur cette doub le question . Il noussemble pourtant que c ’ est al ler bien vi te en besogne . L es
réformes obtenues en Macédoine et qui sont d ’ai lleurs apeinecommencées
,m algré le tem ps qu ’on y a m i s
,ont été arra
chées au gouvernem ent d’
Abd—u l—Hamid par l ’accord un a
nime des Pui ssances,pour remédier aux troubles endémiques
et profonds de cette province de l ’em pire turc . Quant aux
capi tulations,toute s les Puissances chrétiennes sont inté
ressées a leur mainti en à cause du peu de confiance qu ’
i n spi
ra i t la justi ce du despotisme ottoman . C ’ est une garan ti eséculai re pour les Européens résidant au mi l ieu ”
de l ’ empi re;turc et a laquelle ni la France n i les autres Pu i ssance s ne
renonceront que le jour où elles seront conva incue s de la sin
LA REVUE FRANCO —AMÉRICAINE 477
c ér i té et de la durée de la transformation qui paraît devoirs
’
accompli r en Turqui e . C ’est donc par la que les JeunesTurcs doivent commencer . Qu ’ i ls prouvent à l ’Europequ ’
i ls sont véritab lement dés i reux ’
et capab les de donner aleur pays le gouvernement juste et libéral qu ’ ils annoncent .E t devant l ’évidence du fai t
,i l n ’y aura plus lieu de mainte
n i r ces garanti es que le régime des sultans rendaient légit imes et nécessaires .
Nous le di sons d ’
autant plus vo lontiers qu ’au point devue catholique i l y a peu de pays où la liberté re ligeuse so i tplus respectée qu ’ en Turqui e . Nos m issionnai res
,nos cou
vents jou i ssent là—bas d ’un respect et d ’une tolérance qui fonthonte au régime persécuteur de notre R épub lique maçonn 1 que . Mais cet état de fai t n ’al lait point sans des except ions qui ont été célèbres et qui pouvai ent légitimer d ’
h i sto
r iques précautions . N ’oub lions pas qu ’
Abd-ul-Hamid,qui a
touj ours été très favorab le personne llement aux œuvres catholiques frança i ses , et qu i fut toujours très respectueux des
privi lèges du Saint — Siège,a c ependant dans son histoire la
tache rouge du massacre de Arm én 1 en s .
l.a grève gé né ra le en France
Vo i ci la seconde partie d ’un remarquab le arti cle que lecomt e A . de Mun ,
de l’
Académ ie françai se , pub lie dansl’
Echo de Par i s :
Sans doute , la grève générale a échoué jusqu ’ i ci . Le referendum des ouvriers boulangers vient encore de tromper lesespérances de la Confédération . Sur votants , i l y a eu848 vo ix pour la grève , contre . Il a dépendu de 200ouvriers que Paris fût sans pain . On se rassure avec ce la ;mm
,j e trouve que c ’ est très e ff rayant .Les minorités
,résolues et dirigées ,
viennent toujours àbout des majorités . On le sai t bien a la Confédération gén érale
,e t c ’est pourquoi , dit M .. Pouget , l ’organ i sati on syndi
cale doi t être la négation du système des major ités . Car ,di t—i l , s i on voulait tenir compte des majorité s , le mouvementouvrier pourrait prendre une autre direction que cel le que luidonn ent les syndi cats révolutionnaires . ”
478 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Qu ’ i l y ait , parmi les ouvr iers , un grand nombre de bonstravail leurs , ennem i s des grèves politiques , j ’ en suis très convaincu . Mais , comme ils n ’
ont pas de véritable organisationcorporative qui
,en leur donnant la force morale et écom i que ,
permette l ’ entente entre eux et les patrons,ils von t na
turellem en t’a la seule organisation qui existe
,et qui est une
organisation de guerre sociale . L à, on leur fera bien voir ,
en dépi t de leurs votes , que , sui vant le mot de M . Pouget ,on n
’
adm et pas pour le mouvement ouvr ier d ’
autre direct i on que ce lle des syndicats révo lutionnaires .”
La F éderation des mineurs du Nord et du Pas -de—Calais ,très puissante , très bien organisée et -très raisonnab le
,y es t
venue comme les autres,avec ses membres . Mon
col lègue Basly a beau dire qu ’ ils ne se laisseront pas fa ire laloi , c
’est une i l lusion de révolutionnaire assagi . L ’ influencede la majorité sera annulée par le despotisme de la minor ité .
Les typographes donnaient,hier
,un bien frappant exem
ple de cette tyrannie des violents . Leur Fédération a poursecrétaire général un homme de haute valeur
,que j ’ai le
plaisir de connaître , et avec qui , malgré les profonds dissent im en ts qui nous séparent
, j’
ai eu les mei lleures re lations .C ’est M . Keuf er . Comm e le comité central de la Fédérationdu livre a refusé de prendre part à la grève de protestationcontre les événem ents de Vi lleneuve Saint—Georges , son secré
tai re général a été aussitôt exécuté dans une réunion de laBourse du travail . On lui a dit brutalement : Nous nepouvons garder à notre tête une momie : laissez la place ad
’autres .Toute l ’histoir e des journées de la R évolution n ’ est pas
autre chose que la victoire d ’
une minorité audacieuse sur desmajorites passives .
Ainsi,quand j ’ entends dire que la bourgeoisie se défendra ,
qu’el le ne se laissera pas expropr ier , comme la nob lesse de
l ’anc i en régime,j e me permets de n ’ en r ien croire . E lle
ne se défendra pas , d’abord parce qu ’ elle n ’
a et ne veut avoirni chefs
,ni discipline
,ni organisation , rien , enfin , de ce
qu ’ont ses adversai res ,et puis ,
pour une autre raison , plusprofonde et plus déci s iv
“ C ’ est que,comm-e la noblesse , e lle a , en grande maj orité ,
failli à sa mission . Maîtresse . du pouvoir industriel , e l le ena usé pour étab lir sa puissance économique , non pour donnersatisfaction aux jus tes revendications des ouvri ers pour secon
480 LA REVUE FRANCO—AMÉRICAINE
t imes de la Couronne les pri ères de l ’Egli se et ne se sera i tnu llement trouvé gêné d ’
y assi ster . Mai s c ’ est la présenceoffici el le du clergé dans le convoi funèbre qu i lui a par u i nacceptable . Pourquoi ? Quand M . Thompson assi ste à un
enterrement privé,la présence du c lergé ne le met pas en
fui te , i l ti ent a nous l’
as surer . C ’ est fort b i en . Mais pourquoi les choses changent—e l les d ’aspect et revêtent—e lles un
caractère tragique,s
’
i l s ’agi t d ’ob sèques fai tes aux frai s del’
E tat ? Du contact de l ’Egli se et de l’
E tat doi t-i l jai llir uneétince lle capable d ’
électrocuter un mini stre ? Cette catastrophe pourrai t se produi re , en effet , par le temps d ’ant i clér i cali sm e maladi f où nous vivons . Ma i s e l le est de ce llesqu ’ il faut savoi r affronter . La peur
,peut —être justifiée
,de
M . le m in i stre de la marine ne fai t honneur n i à son couragecivique ni à l ’ inte ll igence pol itique dont i l cro i t la Chambrecapab le .
”
Les é lec t ions f é dé ra les
La dissolution des chamb: es f édézales°
et les électionsgénérales qui auront lieu dans tout le pays le 26 octobre vontpendant quelques semaines mettr e beaucoup d ’activit é dansnotre vie publique .
Le peuple écoutera nombre d ’
orateurs lui parler de programmes nouveaux
,d ’ œuvres accomplies
,tous se proclamant
également soucieux de l ’int érêt du pays . Les conditions part icu li ères ou se tr ouve la population du Canada
,par suite de
la diversit é des r aces qui la composent,rend parfois assez di ff i
cile la tâche de se retrouver au milieu de tant de harrangues ,de discerner le faux du vrai
,d ’apprécier avec justice les actes
des gouvernements ou les promesses de ceux qui aspirent à lad irection des affaires . Pourtant
,c ’est le peuple qui jugera
en de 1 nier ressor et c ’est sur lui que retombera,en somme ,
toute la responsabilit é d ’avoir choisi un bon ou un mauvaisgouvernement . Et s ’il est vrai que les peuples ont les gouvernement
‘
s qu ’ils méritent l ’électeur canadien devra biens onger à la gravit é de l ’acte qu ’i l va accomplir lorsqu ’il deporera son bulletin dans l ’urne électorale .
Au fond,il importe moins que le parti au pouvoir soi t
rouge,bleu ou de toute autre couleur que d ’avoir à. Ottawa
des d éput és de valeur,des hommes de caract ère qui repr é
s entent non seulement les int érêts immédiats de leurs com
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 48 1
m ettants mais encore et surtout les int érêts de toute leur province
,et s ’il en est besoin
,les aspirations de leur race . Ce
devoir est,pour les d éput és de la province de Québec d ’une
importance exceptionnelle,parce qu ’ils repr ésentent
,en dépit
de l ’influence du présent ou des gloires du pass é,un él ément
national qui est en minor it é dans la con f édé1 at ion . Il nousfaut à Ottawa des d éputés avertis
,courageux
,capables de
d éj ouer toutes les surprises,capables de maintenir les solides
traditions parlementaires qui de Car tier aLaur ier ont fait j ouerle premier rôle à notre p rovince dans les conseils de la nation .
Dans tous les pays de r égime constitutionnel l ’opiniondevient de plus en plus ind épendante ; cette tendance est mêmet r ès sensible dans notre pays depuis quelques années . Celaveut dire que si les victoires électorales deviennent plus di ffic iles , plus onéreuse également dement la tâche de l ’hommepubli c , soucieux de remplir tous les devoirs de sa charge .Nous formons des vœux pour que le sc1 ut in du 26 octobre
s oit digne de notre peuple et donne une nouvel élan au progr ès ph énoménal qui a ét é le lot du Canada depuis les derni èresannées .
Lé on Kemne r.
V ieux articles et vieux ouvrages
Mémo i re s ur la s ituat ion des Canad iens -Franca i s aux
Et at s —Un i s de l’
Amé rique du Nord, par M on seigneur A .
R ac ine , évêque de Sherbrook e.— Pari s
, L ibrai rie de 1 ’Œuvre
de Saint-Paul , 6 rue Cass ette , 1 892.
ROME,29 février 1 892.
A Son Em inence le Cardinal L EDOCHOW SKI,Préfet de la
S . C . de la Propagande .
I .— La question de savoir comment doivent être tra i tés
les Canadiens aux Etats-Unis de l ’Am ér ique du Nord dansl’ intérêt de leur foi et ce lui de la religion en général occupeactuellement bien des esprits .Voici quelle est sur ce point notre op1mon
,que nous savons
sincère , que nous croyons modérée . Fai sant taire toutes lesvoix de la sympathie
,laissant de côté toutes les raisons de
détail , nous n’
envi sageron s que la plus grande somm e debien a obtenir .II . — Nous ne parlerons pas i ci de l ’opportunité de la con
venan ce ou de la nécessité qu ’
i l y aurait de nommer auxEtats —Unis des É vêques de leur origine dans les diocèses oùles Canadiens sont la grande majorité de la population catho
lique : c ’est un poin t dé licat , gros de di fficultés ,présentant
des aspects divers,que nous lai sson s à l ’étude des inté ressés ,
en particulier au zèle apostolique de ceux qui ont reçu dansce vaste pays la miss ion de régi r l ’Egli se de Dieu , et surtout a la sagesse , a la clairvoyance et a la prudence du SaintSiège .
Que les É vêques soient sympathiques a leurs ouailles canadiennes
,qu ’
i ls ne heurtent en rien leurs usage légi times , on
ne peut demander davan tage .A la r igueur , i l n’
e st pas mêmenécessaire qu ’ ils possèdent leur lan gue . Mai s , dan s ce dernier cas , i l nous semble qu ’
i l sera i t plus que convenable qu ’ i ly eût auprès d ’ eux un grand vi cai re ou un prêtre important
484 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
tecteur de ses vieilles coutumes,i l en est de lui
,pouvons
nous dire,comme de Samson : i l est déjà au pouvoi r de l ’ en
nem i .Les exemples de cette tri ste expéri ence ne sont que trop
f réquents . Lorsque les C an adien s —françai s n ’ont pas dansl eur voi s inage de prêtres qui leur adm ini strent les sacrementse t leur donnent l ’ instruction dans leur langue
,trop souvent
i ls cessent de fréquenter ‘l egl i se réguli èrement,et petit a
p eti t i ls gli ssent dans l ’ indi ff érence la plus complète .
l mposez —leur des prêtres qui sen t adverses ’a leurs t raditions ,i ls deviennent mécontents
,insubordo
}
nnés,incon trôlab les ; et
l eur cœur se trouve ouvert aux plus mauvai ses influences del
’
hérés i e . Pour ces causes , avant qu’
i l n ’y eût un évêque àBurl ington
,le Vermont a vu
,parlant l ’anglais et protes
tantes,de nombreuses fami lles dont les pères étai ent fran
çais et cathol iques . Le ma l une foi s causé est irréparab le .
Au contrai re,donnez —leur des prêtres z élés qu i parlent leur
langue et qu i conna i ssent leurs mœurs,et vous aurez
,comme
on le voi t aujourd ’hu i dans nu ' très grand nombre de centresm anu facturiers de la nouve lle Angleterre
,des Congrégations
f ewen tes,généreuses , qu i bâti ssent des égli ses superbes , des
écoles catholiques séparées,des couvents , des insti tution s de
b i enfaisance et de charité,fai sant fleuri r la foi au m i li eu des
c i rconstances que lquefoi s très di ffici les . Un mode d ’être quiprodui t d
’auss i bons effets mérite d etre conservé .
IV .
— L ’homme échappe di ffic i lement aux influences dum i li eu dans leque l i l vi t ; comme malgré lu i , i l en subit lesdoctrines et les hab itudes .Que lles sont les doctrines qui ont généralement cours , pour
la grande masse de la population ,dans le monde inte llectue l
e t moral des Etats-Uni s ? les doctrines du protestanti sme , del ’ indi ff érence re ligi euse ou de l ’athéi sm e . La so i f de l ’ordomine tout
,la fièvre des richesses envah i t presque toutes les
âm es : et ce courant matérial i ste est favori sé p ar ce qu ’on yvoi t
,par ce qu ’on y entend ,
par le système des écoles communes qui est de s o i pour la j eunesse catholi que une cause deruine ou d
’
a lf ai bli s sem en t de la foi . S’
i l y a de noblesexceptions
,c ’ est le cas de di re que l ’exception prouve la
règle générale .
Quelles sont, gen erali ter loqucndo ,
les habitudes du pays ?des hab itudes de confortable , de vie ai sée et faci le , de jouis
LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE 485
sances matériel les,ou de travai l fiévreux a la poursuite de la
fortun e . Vi r tus pos t numm os .
Ayant a se mouvoi r au sein d ’une parei lle atmosphère , i lest bien di ffici le pour les catholiques de n ’ en pas sub i r les influen ces dé létères au moins qu e lque peu , et tout en conservant l ’ intégri té de la foi , même un zè le très vi f pour lare ligi on
,de ne pas se lai sser al ler inconsc i emment aux mœurs
pratiques et aux tendances intel lectuelles de leurs compatriotes . N
’
arr ive-t -i l pas que lquefoi s que , loin de chercher a.
se défendre contre ces tendances,i ls ne les favorisent par la
trop grande sympath i e qu ’
i ls professent pour les manièresd
’être de la soci été amér i caine,imprégnée après tout de la
morale protestante et d ’un toléranti sme énervant . Oncompte par m i lli ers le s âm es que cet indi ff éren ti sm e enm ati ère de croyance re l igieuse a enlevées , aux Etat s-Unis , ala vrai e foi . E t s i , dans ces derniers temps , la re ligion apris un grand accroissement
,cela *n ’est pas dû précisément
aux conversions qu i se sont fai tes dans l ’ é lément protestant ,ma i s bien
,plutôt
,à l ’ immigration catholique qui arrivait
,a
flots pressés,de l ’Ir lande
,de l ’Allem agn e ,
du Canada et,
depu i s que lques années,de l ’Italie . L ’
o rgani sation rapidede ces forces éparses par un épi scopat habi le et la constatationretenti ssante de cette im portance numérique jusqu ’ ici in connue
,ont pu fai re cro i re a la propagande envah i ssante de
l’
Egli se au sein des populations américaines mai s m alheu
reusem en t,on ne peut se le cacher
,le nombre des perversions
dépasse de beaucoup celui des conversions .
Or , contre l ’envahi s sem en t de ces influence s pernic i euses .
leurs coutumes et leur langue pour les Canadi ens français,en
les tenant à l ’écart,sont un rempart
,une d igue pui ssante
,
digne et rempart qu i l es t sage de m ainten i r et de fortifier ,bien loin de travai ller a les abattre . On voit se produire
,
chez eux , pour les m êmes causes , les mêm es résultats quel
’
on cons tate chez les Maronites du L iban ,ou chez les fidèles
Polonais de la Prus se ou de la Russi e .
V . Mais,dit-on
,si tous les catholiques parlaient l ’an
glai s aux Etats-Un i s , la desserte serait bien plus fac ile .
Peut-être , m ais ils ne le parlent pas . Va —t—ou exposer leurfoi , pour une plus grande facil ité de desserte ? Le SaintEspr i t a accordé le don des langues aux apôtres , et non auxnation s . C ’ est au prêtre a apprendre la langue des popu
486 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
lation s que son zè le porte a évangé liser , et non aux populations à apprendre ce lle du prêtre . Chaque jour on voit lesm i ss ionai res s ’ initier aux idiomes des tri bus chez lesque l lesils ont entrepri s de porter la bonne nouve lle i ls attendraientlongtemps leur conversion ,
s ’ ils exigeaient que ces tr ibus ,pour entendre les vér ité“ du salut , apprissent leur proprelangue
,que ce fût ou le françai s ou l ’anglais . L
’
Egli se apour but principal de former des citoyens pour le cie l , et nond ’ entreprendre de fusionner pour des motifs d ’ intérêt tempore l , en une seule , les diverses nationalités , qui peuventexister dans un même pays .
Mais,ajoute—t on
,fatalement l ’anglais doit devenir la
langue de l ’Am ér ique du Nord . I l vaut autant commencer’a le parler dès maintenant .Eh b i en ! dans ce cas-là ,
laissons fai re le t emps . N ’allezpas plus vite que l ’ évolution naturel le des idées . D ’ ici la, enne heurtant pas imprudemment les sentiments de la génération présente
,en se pliant a ses goûts
,conservez sa foi , afin
que cetté seconde ,ou cette troi s i ème génération qui
,d ’
aprèsquelques —uns
,doit nécessairement parler l ’anglais
,professe
encore le catholicisme . Dans tous les cas,tan t que l ’ ém i gra
tion du Canada aux Etats—Unis durera sur une éche l le aussiconsidérab le qu ’aujourd ’hui
,i l est impossib le d ’amener la
masse de la population canadienne a parler l ’anglais . R é
uss i r iez -vous a angl ici ser la j eune génération,vous resteriez
toujours en face des personnes âgées et des nouveaux arrivants ; et le prob lème a résoudre serait toujours a recomm en
cer , avec les mêmes di fficultés , avec les même s dangers pourla foi . Allons ; sachons prendre les choses comme e lles sont ,laissons à l ’avenir ses énigmes
,et pour le mom ent employons
les moyens les plus efficaces pour sauver les âmes .Lorsque , vers 1 820 ,
les Irlandais,forcés par la maladie et
la fam ine de quitter leur patrie,émigrèrent au Canada , les
Evêques de Québec et de Montréal s ’
empressèren t de leurdonner des prêtres de leur nation ,
ou au moins des prêtresqui savaient bien leur langue ; car alors les prêtre sirlandais étaient rares dans notre pays . E t depuis
,les
que lques paroi sses anglaises qui existent dans le Canada françai s , ont continué a être desservies par des curés de langueanglaise ; dans leurs écoles le catéchisme est enseigné enanglais l ’anglais est prêché dans leurs églises et ces groupes ,de population hétérogène , enclavés dans une majori té fran
488 LA REVUE FRANCO—AM ÉRICAINE
5. Enfin,les sentiments profondément cathol iques et
romains des Canadiens — frança i s, qu i ont échappé par le bon
heur de circonstances providenti e lles ; aux erreurs galli canesainsi qu ’aux influences du jansén i sme , du protestanti sme etde l ’athéi sm e moderne , a un moment donné , dans des conjon ctures diffici les que pourrai t faire naître l ’avenir en Am ér ique
,certai nement serai ent d ’un grand secou rs au triomphe
des vues,de la poli tique et des di rections de la Curie R o
ma1 ne .
VII .
— Pour toutes ces ra i sons , nous conc luons qu ’ i l importe , tant pour le bien de la re ligion en général que pource lui des Canadi ens en parti cu li er :1 . Qu ’on lai sse les Canadi ens des É tats-Uni s se déve lopper
avec leur langue , leurs coutumes et leurs tradi tions‘2. M ême qu ’
i l serait à souhaiter que l ’on f avor i sat ce développem en t tradi tionne l
,vu qu ’ i l est chez eux une sauve
garde et une protection pour leur foi ;8 . Que
,pour atteindre ce but , on leur donne des curés ou
des missionnaires qu i sachent b i en leur langue , qu i c onnaissent leurs mœurs
,et qui soient sympathiques a leurs ma
nieres de faire ;4 . Enfin que
,autant qu ’ il sera possib le
,ces curés ou ces
mi ssionnai res appartiennent a leur n ationali te ° nous ne con
sidérons pas ce dernier p oint comme étant d une n écess itéabsolue
,mai s bien d ’une importance très grande . En e ffet ,
s i,en général
,les Canadiens n ’ava i ent pas a la tête de leurs
paroi sses des prêtres de leur ra ce,la défiance finirait par se
mettre parm i eux ; de la une source de m i sères inte rminableset pour les supéri eurs ecclés iastiques et pour les subordon
nés .
Dans l ’ espérance que Votre Eminence trouvera réservé etmodéré cet exposé de notre man i ere de voir sur cette question complexe et dé licate , nous demeurons avec la con s idé
ration la plus haute et le plus profond respect,
De Votre EminenceEm inenti ssime Seigneur
,
L es très humbles et très dévoués serviteurs .ANTOINE
,Eu . de Sherbrooke.
J .—B . PROULX , pr s ec .
Entre Chien et Loup
Comédin en un acte
PERSONNAGES
D iane de L imeui l, jeune veuve , 27 ans MLLES MARTHE BRANDESUne femme de chambre MARGUERITE CARONGuy de L ustrac , célibatai re , 32 an s . M. DUMENY
A Paris , de nos jours.
La scène représen te un et it boudoi r très élégan t . Abondan ce de m euble.bas et capi tonnés , e paraven ts
,de plan tes , de tables chargées de oibe
lots . Au fond une chem inée avec pendule et therm om ètre accroché
près de la glace.— A droi te
,une chaise longue .
— A gauche un fauteui lv ide.
— Le jour comm en ce à baisser.
SCENE PREMIERE
DIANE, pui s UNE FEMME DE CHAMBRE
DIANE . (Elle est à dem i étendue sur la chai se longue et
semble rêver .) — Ah ! Dieu .Cet apr ès-midi m ’a paru interminable .Quelle heure peut—i l bien être (Elle s
’éti re ner
veusement et sonne.)LA FEMME D E CHAMBRE
,entran t — Madame la comtesm£âsonné
D IANE — Apportez la lampe on n ’y voit plus pour lire .LA FEMME D E CHAMBRE — Bien
,madame . (F ausse sortie.)D IANE — Au fait , non n
’éclairez pas encore . Est-il venu
des visitesLA FEMME D E CHAMBRE .
— Quelques—unes,madame
.
D IANE — VOUS avez r épondu que j e suis souffranteLA FEMME D E CHAMBRE
,di ss imulant une légère i roni e, sous
une apparence de respect i rréprochable.— J
’ai r épondu quemadame a une migraine épouvantable .
D IANE ,s’asseyant sur la chai se longue et haus sant les
épaules .— Qui vous a chargée de dire épouvantable
Comme vous avez peu d ’intelligence J’
ai donné l ’ordre derecevoir dans le cas où . q uelq u
’un insisterait.Naturelle
ment , si vous racontez que j e suis à l ’agonie . . (D’un ton plus
doux.) P ersonne n ’a insist é
490 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
LA FEMME D E CHAMBRE — Pardon,madame .
DIANE, vi vement.— Ah vous voyez Et qui donc , jevous prie
LA FEMME D E CHAMBRE — Mme la ba1 cune de Vernantes .Mais j ’ai pens é .
D IANE , rassurée — Oh ma chère,comme vous avez bien
fait Elle m ’aurait tu ée avec sa voix glapissante . .Qui estvenu encore
LA FEMME D E CHAMBRE,à part, froi sseb .
— Ah j e n ’ai pasd ’intelligence (Haut ) Les cartes sont dans l ’anti chambre, simadame veut les voir .
D IANE — Hé mon Dieu,tâchez de vous en souveni r .
(La femme de chambre fai t semblan t de se creuser la mémoi re)Voyons Mme de Tautavel (S igne négati f .) Mme de Pontussan
LA FEMME D E CHAMBRE — Elle est venue.
D IANE — Mme de Saint-ArmelLA FEMME D E CHAMBRE — Venue aussi .D IANE
, feignon t de chercher .
— Monsieur . M . deLustracLA FEMME D E CHAMBRE
,à part, voulan t se venger ,
— OufNous y voi là
,enfin ! (Haut ) M . le marquis de Lustrac
Voyons donc . (Elle joi nt aus s i de chercher .)DIANE — Eh bienLA FEMME D E CHAMBRE
,à part, de même.
— Non Je nesuis qu ’une sotte (Haut.) Il est peut— être bien venu .
D IANE,avec dépi t
— Franchement,mademoiselle
,vous avez
la mémoire bien courte . Allez chercher les‘ cartes . (Seule )C ’était bien la peine de fermer ma porte a tout le monde pourlui r éserver son tête—à— tête . Au reste
,de la façon dont il en
profite (Six heures sonnent.)LA FEMME D E CHAMBRE
,apportant des cartes .
— M. le marquis n ’est pas venu . Je le confondais avec M . de Pragn ère.
DIANE,haussan t les épaules .
— Jolie ressemblance — Quelleheure vient de sonner ? Six heures ? (A part.) Je ne leverrai pas ce soir
LA FEMME D E CHAMBRE,s’adonci ssan t.— Oh ! la pendule
avance de vingt minutes .D IANE
,mouvemen t de sati sfacti on .
— Vous croyez (Signeafii rmati f .) Allons ! j e vais rester un peu tranquille . C ’estbien
,ma petite .LA FEMME D E CHAMBRE
, part.— Bon la voi là radoucie .
Mais pourvu que M . de Lustrac VienneD IANE — (Elle va s
’asseoi r dans le fauteui l vi de, de l
’
autre
492 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
DIANE, lui tendan t un de ses gants de Suède.
— Vous n ’aimezpas cette odeur (M de Lus trac
,après s
’
être assuré qu’
on ne
le voi t pas , bai se le gant avec une tendresse pass ionnée. )
GUY,rendan t le gan t, très froi demen t) .— Non .
DIANE,un peu tr i ste
— C ’est pourtant vous qui me l ’avezrapport ée d ’
Or ient . Vous ne vous en souvenez plus (Il fai ts igne que non .) Enfin
,mon pauvre ami
,allez—vous-eu
,si vous
avez peur d ’être malade .GUY
,s’i nstallant dans le fauteui l.— Chère madame , quand
j ’ai visit é les Indes,il y a trois ans
,le chol éra emportait plusieurs
milliers de personnes par j our . Cela ne m ’a point fait partirune heure plus vite .
D IANE,avec i ron ie — Allons ! décidément
,les fléaux ne
vous effraient pas . Seulement,puisque vous restez
,j e vous
prierais de sonner pour qu ’on apporte une lampe . Cette demiobscurit é n ’est pas convenable .
GUY.— Oh . pas convenable . Avec un autre c ’est pos
sible . Mais,avec un bon camarade comme moi . (Mme de
L imeui l fai t un geste de dépi t.) Voyons n’êtes-vous pas de
mon avis D ’ailleurs,j e ne connais pas
,pour causer
,d ’heure
comparable à celle qu ’on nomme ENTRE CH IEN ET LOUP .
D IANE — Cela dépend beaucoup du suj et de la causerie .En principe
,j ’aime voir la figure des gens qui me parlent . Et
puis . . ENTRE CH IEN ET LOUP (Elle fr i sonne légèremen t) , cesmots sinistres m ’ont touj ours donné un frisson . Il me semblevoir une grosse b ête
,avec des oreilles pointues
,de longues
dents et des yeux qui brillent dans l ’ombre .
GUY s’
oubliant un peu .
— Oui,voi là pour le loup . Mais le
chien . le chien vigilant,fidèle
,prêt à mourir pour prot éger
celle qu ’il aime,ne demandant rien qu ’une pauvre petite caresse
,
de temps en temps (Mme de Limeui l , légèremen t émue, luitend la mai n
, qu’
i l serre en rés i stant à l ’envie de la bai ser .)D IANE — Il va sans dire que cet an imal désint éress é est
votre symbole,d ’après vous
GUY,d ebout devant la chemi n ée.
— Esu—ce que vous netrouvez pasDIANE — Que vous êtes le modèle de l ’espèce Ah non
,
par exemple Vous n ’avez qu ’une idée en tête me fairecroquer par le loup .
GUY,cherchant à comprendre.
— Croquer par le loupAh vous parlez de ce pauvre Roger d’
On cieux,que vous faites
mourir de chagrin
LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE 493
DIANE,imi tant M . de Lus trac Ce pauvr e Roger d ’
Ou
cieux Dirait—on pas qu ’un sort injuste l ’accable,parce
que,dès son premier mot
,j e ne me suis pas évanouie de j oie
,à la pensée de devenir Mme R oger d ’
Oncieux
GUY.— Oh dès le premier mot . .Nous n ’en demandions
pas tant . Mais voilà dix—huit mois qu ’il est dit,ce premier
mot Et vous êtes touj ours veuve .D IANE
,s’éti ran t avec ennui — Mon cher monsieur de Lus
trac,s ’il vous plaît
,donnez —moi vacance pour auj ourd ’hui .
Vous êtes un charmant . camarade un habile rh éteur,et
,
par votre esprit,vous communiquez de l ’int érêt aux causes les
plus ingrates . Mais franchement , dans vos visites à peu pr èsquotidiennes .
GUY,vi vemen t.— Si vous trouvez que j e viens trop .
DIANE,de . même.
— Oh non . (Plus froidement.) Vousm ’avez mal comprise . Continuez vos visites . Mais si vouspouviez— quelquefois— me parler d ’autre chose que . . de l ’amour immense que votre ami ressent pour moi
Gur — C ’est le meilleur des hommes ce serait tout justement le mari qu ’il vous faut . I l vous adore (S ’
an iman t) avecune sorte de crainte
,comme on adore l ’être tout—puissant qui
peut faire,d ’un mot
,le bonheur ou le malheur de notre vie .
(Avec une passion con tenue.) Vous êtes si s éduisante et sibelleD IANE
,étonnée — Ah
GUY,reprenan t son f legme.
— Voilà comment il parle de vous .DIANE
,avec i ron i e — Ah c ’est votre ami qui parle .
Je lui en ai une obligation extrême.GUY.
— Mais,quand il est pr ès de vous
,le pauvre garçon
devient incapable d’art i culer une phrase qui ait le sens commun .
D IANE — Et,pour se dédommager
,il m ’
assass ine de seslettres .
Guru— Dame En certains ‘cas,il vaut mieux écrire .
D IANE — Surtout quand un confident z él é se trouve là,
juste à point pour lire la prose de l ’absent et en faire valoir lesqualit és . . incendiaires . Si vous croyez que votre manègem
’
échappe .Tenez,voulez—vous que j e vous dise Eh bien !
c ’est un imb écile,votre ami
GUY.— Pourquoi
DIANE — Je m ’
entends .
GUY,soupi rant avec convi ction .
— Ah . comme j e comprends que certaines femmes rendent imb éciles ceux qui lesapprochent
'LA REVUE FRANCO-AMÉRICAINE
DIANE — Il faut croire que j e ne fais point partie de cescertaines femmes car
,vous conservez plemement votre
libert é d ’esprit en ma présence .GUY.
— Peuh .Moi,j e ne compte pas j e suis un sau
DIANE .—Un sauvage . un sauvage . Vous n ’
ét iez pointsi sauvage
,dans le temps
,avec Mme d’
Ingrande
GUY.— (Ï l se met amarcher de long en large, les mai ns dans
ses poches ) .— Ce n’était pas la même chose .
DIANE,s’accoudan t sur une chai se longue.
— Ah ! ou1Elle était irr ésistible
,celle-là tandis que moi .
GUY,marchant toujours .
— Allons pas tant de malice]Vous savez bien que vous avez fait dix fois plus de victimesque Mme d’
Ingrande.
D IANE — Seulement,elle r éalisait mieux que moi votre
type idéal voilà ce que vous voulez dire Mon Dieu! ceschoses-là ne se discutent point .
GUY,s’arrêtan t devan t Mme de L imeui l et s
’
an imant àmesure qu
’
i l par le.
— Mme d ’Ingrande n
’
approche pas de votrebeaut é de votre esprit
,encore moins . Quant a l ’él égance et
au charme naturel,j e ne vous compare même pas l ’une à l ’autre .
Chacun de .vos mouvements est une grâce . Vous êtes plusqu ’une femme séduisante vous êtes la s éduction .
D IANE,étonnée — Ah
GUY. (Sans en tendre,i l lai sse tomber ses bras d
’un ai r
découragé, regarde dan s le vide devan t lui , et murmure, comme se
par lan t lui —méme.) —MalheureusementD IANE
,l’observan t. — Il y a un ma i s Vous avez découvert
en moi quelque monstruosit é physique ou morale qui vous glace ?GUY
,s’asseyan t dans le fauteui l et
‘
ti sonnant.— Si j ’avaisd écouvert . . ce que vous dites
,croyez-vous que j ’aurais pa
tronn é,comme j ’ai fait
,la candidature de mon meilleur ami
Plus qu ’un ami Je ne connais pas de nom pour exprimer ledévouement que j ’ai pour ce brave cœur .D IANE
,très an imée
, prenan t la pose ass i se— Bon Nous y
voilà encore Mais,j e vous prie
,laissons là.M . d
’
Oncieux etveuillez m ’expliquer pourquoi vous avez dit tout à l ’heure(L
’
imi tan t) MalheureusementGUY.
— Si vou s comptez gu érir votre migraine en mettantvos nerfs dans cet état
D IANE — Le meilleur moyen de les calmer,c ’est de me
r épondre .
496 LA REVUE FRANCO-AM ÉRICAINE
Je lui ai juré,sur l ’honneur , que . .que j e serai touj ours un
fr ère pour vous .D ANE
,outrée
,mai s se con tenan t — Vraiment Vous avez
fait cela ! (Un s i lence.) Eh bien ! politesse pour politesse .Vous pourrez lui dire tout à. l ’heure
,de ma part
,que
,selon
toute apparence,j e serai touj ours une sœur pour lui .
GUY.— Jè ne pourra1 pas lui faire la commission ce soir
il est chez lui,a la campagne .
SCENE IIILES MEMES
,LA FEMME D E CHAMBRE
LA FEMME D E CHAMBRE . Elle entre et pr ésente à sa maitresse une lettre sur un plateau .
— Le courrier de madame lacomtesse .
D IANE, prenan t la lettre et la posant sur le guéridon
— Bien(La femme de chambre fai t m i ne de se reti rer . )
GUY,à part.— C ’est de lui
,peut-être . (Haut, à Mme de
Limeui l .) Vous ne demandez pas une lampeLA FEMME D E CHAMBRE — A l ’instant
,monsieur le marquis .
D IANE,sévèrement — Monsieur le marquis me permettra
de vous dire devant lui,mademoiselle
,que vous êtes à mon
service et non pas au sien . Vous apporterez la lampe quandje sonnerai .
LA FEMME D E CHAMBRE,à part, après avoi r cons i déré les
deux autres personnages d’
un ai r de pi ti é— C
’est pourtant d ’yvoir clair qui leur manque
,a ces deux—là . Et c ’est sur moi
que madame détend ses nerfs Oh les maîtres (Elle sort.)
SCENE IVGUY
,DIANE
GUY,après un si lence.
— Vous n ’êtes pas curieuse de voirqui vous écritDIANE
,à part.— Avec quel plaisir j e le battrais (Haut,
tâtant la lettre dans tous les sen s .) Votre cœur ne vous le ditpas (Iron iquement.) C
’est LUI C ’est le seul être que vousaimez au monde
,c ’est Roger d ’
Oncieux
GŒ .— Comment le savez—vous
DIANE — Oh soyez tranquille,ce n ’est pas mon cœur .
Je sens le cachet sous mes doigts . Votre ami est le seul hommeen France qui se serve encore de cire pour fermer ses lettres .
LA REVUE FRANC0 -AMERICAINE 497
Gur — J’
espère que vous voudrez bien me donner de sesnouvelles
,avant que j e vous quitte .
D IANE,i ron i quemen t.
— Quoi vous ne le voyez pas tous lesj ours
GUY.— J
’ai eu l ’honneur de vous dire qu ’il est chez lui ,à la campagne . Depuis son départ
,il ne m ’a pas écrit .
DIANE,de même.
— Alors,j e comprends vos angoisses .
Nous allons les calmer . Sonnez pour qu ’on éclaire . (Il pressele bouton .) Mais , d
’abord,veuillez r épondre à une derni ère
question . . de simple étude psychologique . (Après avoi r pré
paré sa phrase.) Depuis que vous travaillez au bonheur d ’unautre
,
— Dieu ‘ sait avec quel noble d ésint éressement,
— vousn ’avez pas . . regrett é une seule fois . . de ne point travaillerpour votre compte . (M de Lustrac s
’ass i ed dan s le faueui l
et reprend les pi ncettes . Au même i nstant, la femme de chambre
apporte une lampe, la pose sur le guér i don ,bai sse le s tore de la
glace sans tai n et se reti re,tout cela pendant un s i lence.) Allons
r épondez . Je vous promets de ne plus vous fatiguer j amaisavec ma psychologie .
GUY,ti sonnan t toujours .
— Eh bien ! voilà une question !Vous ferez sagement de ne pas la poser à tout le monde .
DIANE — Mais d ’abord j e ne puis la poser qu‘à vous , qui
êtes seul dans ce cas . Ensuite,croyez—vous que j e resterais
une demi—heure avec tout le monde,
” dans un salon a peineéclair é Qu ’est—ce que vous disiez vous-mêmes
,tout a
l ’heure C ’est précis ément parce que vous n ’êtes pas tout lem onde , que vous m
’int éressez et que j e vous étudie . Je tâche
de d écouvrir en quoi vous êtes moins . .mettons moins bêteque les autres . Allons j ’écoute .
GUY,après un court si lence.
— Je vais vous r épondre parun apologue . Vous passez tous les j ours dans la rue de la Paix .
En voyant les saphirs et les perles à. la devanture des bij outierssongez-vous à. les mettre dans votre poche
DIANE,avec convi cti on .
— Ah ça , oui , par exempleGUY
,cachan t son trouble sous un ton de galanter ie banale.
Allons mon apologue tourne contre moi . I l était mal choisi ,d ’ailleurs , car les pierres les plus précieuses sont faites pourvotre beaut é , tandis que j e serais le dernier des fous d ’élevermon r êve jusqu ’
à la comtesse de Limeuil,tout serment à part .
DIANE ,d
’
abord très séri euse, pui s affectant de ri re.
— C ’estbien me voilà fixée . Mon Dieu quel j oli madrigal ! Ahah ah .Et quelle modestie Ah ah ah .C ’est àm ourir de rire . . (Sa voix change, et elle se met à sangloter dan s
s on mouchoi r . M . de Lustrac,éperdu, la contemple en se fa i
498 LA REVUE FRANCO-AMERICAINEsant vi olence pour ne pas tomber à ses pieds .) Je vous demandepardon . (Elle s
’essuie les yeux rapi demen t.) Cette maudite
migraine m ’a mis les nerfs dans un état .Et puis,voilà ce
que c ’est que de causer entre chien et loup . (Elle tend àGuy la lettre qu
’
elle vi en t de recevoi r .) Tenez , mon ami,prenez
vous-mêmes les nouvelles qui vous int éressent . (M de Lus
trac hés i te. ) Oh il n ’y a pas d ’
indi scr ét ion . Vous êtes son
confident . . et mon .Allons,lisez
GUY,li san t tout haut. Madame
,quand vous recevrez
ces lignes,j e ne serai plus . (Il s
’
i n terrompt brusquemen t.)DIANE
,effrayée — Grand Dieu ! il s ’est tu é ?
GUY,très troublé — Non . (Il conti nue à li re tout bas , et
,
subi temen t,tombe aux genoux de Mme de Limeui l .) Oh Diane
comme j e vous aime . et comme il y a longtempsDIANE
,confondue — Vous m ’
aimez .VousGUY.
-Ell€ ne le’
voyait pasDIANE
,très s implemen t, un peu bas .
— J’
avai s cru le voir,
plus d ’une fois . Mais,depuis un instant
,j ’étais certaine de
m ’être d éçue . Quand on fait de si belles phr ases , c’est qu ’on
a le cœur parfaitement libre .GUY
,couvran t de «bai sers la mai n de Mme de Limeui l .
Et voi là ce qui vous a fait pleurer — Oh chères larmesDIANE
,reti ran t sa mai n .
— Vous perdez la tête,monsieur
Vous oublier la devanture du bij outier,c ’est—à-dire vos serments
à.Roger d ’
Oucieux.
GUY,se relevan t, et reprenan t la lecture de la lettre.
— Ecoutez
ce qu ’i l écrit Quand vous recevrez ces lignes,j e ne serai
plus en France . Dans la solitude où j e me suis enfermé ,j ’ai pu réfléchir
,et j ’ai vu clair . Vous ne m ’
aimerez j amais ,parce que vous en aimez un autre . Lust r ac vous dira
'
Ê lenom de cet homme heureux . Pauvre excellent ami ! Jelui écris par le même courrier pour lui rendre certaine parolequ ’il m ’a donnée . (Pendan t cette lecture, Mme de Limeui l
s’es t levée et s
’es t approchée de M . de Lus trac, pour li re en même
temps que lui . Aux dern i ers mots , i l passe doucemen t son bras
autour de la tai lle de la jeune femme.)DIANE
,le repoussan t avec i ndignati on
— Monsieur Quivous permet
GUY,retomban t aux genoux de Mme de L imeui l,
— Oh !
Diane j e vous aime tant .Pardonnez-moiDIANE — Jamais j amais j e ne vous pa: donne ai . de
n ’avoir pas manqu é à votre sermentGUY.
— Ma chè. e femme bien aiméeLo D E TINSEAU .
500 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE
sans cesse appe lés ici pour la moindre chose . On veut prohablem en t vous demander un rense ignement . . ou vous direque le j eune homme a fait que lque bêti se .
Ce s paroles semb lèrent réveiller Urbain . I l passa le mainsur son front
, comme que lqu ’un qui a fai t un mauvais rêve ,en balbutiant :Vous croyez ? Moi je pensais qu
’ il était .
Il ne put prononcer le mot de mort,ce mot qui ne sem
b lait pouvoir s ’appliquer à ce beau garçon, s i gai , s i heureux
de vivre auque l i l avait di t adieu deux ans auparavant , maisdont l ’ image radieuse ne l ’avai t pas quitté .
— Mais non ! mai s non ! continuai t le con salateur . Approchez -vous du feu j e vai s a ller demander s i on peut vous recevoir . Al lons
,prenez ce fauteui l .
Urbain gre lottai t . L a chaleur du feu le rappe lait a lui ,mai s Il crut défaillir de nouveau quand l ’huiss i er , œ uvrantla porte
,lui dit :
— Veuillez me suivre .
Il hési ta a se lever , à qui tter cette dern ière ombre d ’espoirqu i lui restait pour se trouver en face de la réalité terr 1 ble .
— Voulez -vous un verre d ’ eau ? lui demanda le vieil huissier
,le voyant pale comme un homme qui va 8
’ évanouir .— Non , merc i , j e vous sui s .Urbain se maîtrisa par un te l e ffort gu ’
i r entra presquecalme dans le cabinet où l ’attendai t , assis derri ère un grandbureau
,un colone l aux cheveux blanc , a la figure très rouge ,
à. l ’ai r a la fois rébarbatif et bienveillant d ’un homme peusen s 1 ble ,
ennuyé d ’avoir une mauvaise nouvel le à annoncer .— Vous êtes M . de Lamothe ?Urbain baissa affirm ativem en t la tête . Il n ’avait pas la
force de répondre .
— Vous avez un fi ls au Tonkin , M . Henr i de Lamothe ?Il acquiesca de nouveau . N etai t-i l pas le vrai père
d’
Henr i ?— Lieutenant au— Non ! Monsieur
,s ecr ia vivement Urbai n ,
entrevoyantune espérance . Sous-li eutenant .
Ah ! dit le co lone l étonné . Vous êtes sûr ? . Il y aeu dernièrem ent ? .
— Derni èrement . murmura Urbain . Je n’
ai pas lu lesjournaux .
— Sa nomination date du 1 4 novembre dernier .
LA REVUE FRANCO-AMERICAINE 50 1
— C ’est possib le,soupira douloureusement Urbain , voyant
sa dern i ère il lusion en déroute .
— J’ai le regret de vous informer que nous venons de rece
vo i r un télégramme contenant de fâcheuses nouve lles .Urbain écarqui lla les yeux
,hébété
,comme un condamné
qui regarde le couperet .— Mon si eur , votre fils est tombé j eudi dans une embuscade ,i l a été grièvement blessé .
Urbain se redressa, s
’
avan ça sur son interlocuteur , et d ’unevo ix stridente qui le fit sursauter :
— Il est mort ! Al lons ! dites—le ! Je ne puis plus supporter !
— C ’est vra i , dit brusquement le colone l . I l faut bien quevous sachiez la vér i té : I l est mort .Urbain chancela
,comme assommé
,et n ’
en tendi t que va
guem en t le colone l qur lui di sait , après quelques paroles decon solation toutes militaires
— L a veuve et l ’enfant de votre frère s ’
embarqueron t dansque lques j ours pour la France .
Urbain ava i t des éb loui ssements i l s ’
appuyai t sur le bureaupo u r ne pas tomber et restait immobile , sans voix ,
oub liantcomplètement l ’ existence du colone l , et n ’ayant de la siennepropre qu ’une noti on très con fuse .
Au bout d ’un moment,le colone l commença à s
’
agi ter ,a
tousser ; puis , ne voyant aucune fin probab le a cette scène,
appuya le doigt sur un timbreL
’
hu i s s i er repar ut,annonçant un autre vi siteur .
— Ah ! pardon ! bégaya Urbain,cherchant instinctivement
son chapeau .
L’
hu i s s ier le lui remit sur la tête ,et le remorqua jusqu a
la sorti e .
Une fois la porte refermée sur eux,Urbain s ’arrêta et dit
d ’une voix sourde— Vous savez . . il est mortPui s i l retombe. dans son absorption douloureuse
,sai sis
sant au hasard ces lambeaux de phrase :— Je vous comprends . Pauvre Monsieur ! . moi aussi.mon fils unique . . tué a G ravelotte .
On le m i t dans un fiacre et i l se retrouva dans sa maison .
_
L e Co cher ouvr i t la portière . Urbain descendit et lui tendi t , sans regarder , la première pièce de monnaie qu ’ il trouvadans sa poche .
502 LA REVUE FRANCO-AMERICAINE— Il manque dix sous ! réclama gri ncheusem en t le cocher .Urbain prit au hasard une autre pi èce , la lui donna et ,
sans remarquer son salut satisfai t , se précipi ta sous la portecochère et grimpa quatre à quatre son escalier
— Qu ’est-cc qu ’
i l a ? observa le conci erge , qu’
ùn e maladied ’ estomac avait rendu très malvei llant . On lui aura flanquéun suif
,a la Banque . Qui sait s ’ il n ’a pas fait que lque
détournement ? I l a l ’air de que lqu ’un qui a perdu labou le . C ’est grave ! Ca sonne très mal !
Arrivé chez lui , Urbain courut dans sa chambre et s’
yenferma . Son cœur gonflé lui semblait sortir de sa poitrine .
Sa douleur immense , inconsolab le , put enfin éclater . Ce futterrible
,i l cria
,i l pleura , i l se roula sur son lit , il heurta sa
tête contre les murs . Les ardeurs , les énergies , les révoltesde sa j eunesse
,les forces , les regrets , les espérances de son
âge mûr les tendresses de son cœur , les rêves de son esprit ,son passe sans joie , son avenir sans but , ses souvenirs amersou joyeux
,tout ce qui dormait depuis si longtemps presque
inconnu de lui-même , au fond de son cœur , tout ce qu ’ i lavait étouff é , apaisé , oublié , comprimé jusque—là avec tant depeine , se révei llait soudain , hurlait , se tordait , rugissait ,brisait le frein
,bondi ssait hors de lui , s
’
exhalai t en plaintesdésespérées
,en cris de fureur
,en appe ls déchirants de mère
qui a perdu son enfant .La tempête se rassasia enfin de sa propre violence et s ’
a
pai sa quand e lle eut entièrement dévasté cette âm e en endéracinant toutes les il lusions , toutes les tendresse et la laissant vide
,désolée , aride comme un désert . Le calme qui
suivit fut encore plus affreux .
Farouche , Urbain regarda en face sa destinée , et se ditavec un ricanement de désespéré :
— Heureusement que quand on n ’a p lus rien en ce monde,
on peut le quitter !La voix de son père , aigue et gémissante vint l ’arracher
a lui-même . Le vieillard réc lamai t impen eusem en t sondéj euner et s etonn ai t du retard de son fils .Le vieux Laurent , qui pressentait une catastrophe
,vint
frapper timidement a la porte d ’
Urbain en l ’averti ssan t queM . de Lamothe était a tab le .
504 LA REVUE FRANCO-AMERICAINEFroid
,navré
, écœuré , Urbain laiss ai t passer ce torrentd
’
égorsm e . De tout ce qu ’avai t di t son père , i l ne retint queles derniers mots .
— C ’ est Vrai , dit—i l , j e n’ai su aucun détail . Je retournerai
demain au mini stère , a moins que vous ne vouliez bien yaller vous-même .
Le vie i llard repartit de plus be lle— A son âge ! avec sa bronch i te ! l
’
exposer aux émoti onsd ’une course parei lle ! aux courants d ’air ! Lui refuser le
moindre des égards qu ’on accorderait au dernier des étrangers dans une si tuation aussi douloureuse ! Ah ! l ’on étaitbien malheureux d ’être vieux
,malade , abandonné à. la merci
d ’un fils sans dé licatesse !Urbain ne put retourner au m inistère que le surlendemain .
Une fièvre violente l ’avait sai si e,mais la prostration qui suc
céda lui procura que lques heures de repos forcé,au sort ir
desque lles il se trouva plus calme . Son malheur l ’écf asai t ,mais ne le surprenait plus . L
’
hu i ss ier le reconnut a peine .
Pendant ces deux jours , ses tempes avaient grisonné , son
corps maigre s ’était voût é ; des p lis amers formés dans sonvisage et l ’accent brisé de sa voix lui donnaient dix an s deplus .Le même colone l le reçut et lui communiqua la dépêche
officiel le annonçant le décès du lieutenant Henri de Lamothe ,mort en arrivant ‘a l ’hôpi ta l de Hanoï d ’une b lessure reçuedans une escarmouche contre les pirates . La dépêche se
terminai t ainsi : “ La veuve et l ’ enfant_
du lieutenant deLamothe seront prochainement embarqués a destination deMarsei lle a bord du Sydn ey ,
sur leque l leur passage est
assuré .
”
Cette derni ère phrase plongea Urbain dans une profondestupéfaction .
— Mai s , objecta—t—i l , le lieutenant de Lamothe n ’a 1 ama 1 sété marié !Le colone l re lut la phrase .
— Vous êtes sûr que Monsieur votre fils ? .
_
Ce n ’est pas mon fi ls , c ’est mon frère . Il n etait pasmar i e .
(A suivre.
TABLE DES MATIERES
TOME PREMIER
( Nos. 1 à V! )
Anti alcooli sme— Cc que boiven t les savan ts , les écrivains , les art istes . 72
75
24 1
367
425
Acadiens et Canadiens—f rançai s, discours de Mgr O . E . Mathieu 470
Bi bliographie Hull,son or igine , ses progr ès , son aven i r 237
Dict ionn ai re hi storique des Canadien s et des m ét is f rançais de l ’Ouest . 239
Chron ique arti stique— Le concert de Berthe Roy à Québec
Cen tena i re (Le IIIe) de Québec .
Commen t se développe une provi nce par l’
agri culture
D i scour s (Un ) franco—am ér icai n — M Pothier , de Woonsocket , R . I . 1 79
PAGE
Espagne (L’
) catholique et le progr ès 329
E lection s f édérales . 480
En tre chien et loup , (Nouvelle) 489
En deux mots (Rom an ) 405 a408,499 à 504
F oresti ers Indépendan ts— Quest ion de taux et de garan t ies
F rançoi s Coppée .
F réchette (Loui s )
F êtes (L es ) de 1 908 à Québec et l'i mpéri a li sme angla i s
Grève (La ) gén éra le en F rance
Hallo, Sam (Revue fan tai s i ste )Hi stoi re des acadi en s (L
’
) — Comm en t on l’
a écr ite
Idée de M lle J eanne (R om an )
65 a 71,1 50 a 1 60
,220 a236
,321 a328
,39 1 a404
Inci den t de Toulon (L’
) 479
J ourna li sme Canadi en -françai s , (I)
(II)
La li ttérature canadi enne et les F ranco—Am éri ca i ns
La religi on et les assim i la teurs,dan s la N -A .
L’
Indépendance du Canada f rançai s — Un beau et bon l ivre
La pui s sance de l’
as soci ation et la fai blesse des cla sses labor ieuses
L e prem ier phonographe (Nouvell e)
L es ten tatives d’
ass im i lation dans la N ouvelle Angleterre et leurs résultats
La soci été neutre au double poi n t de vue na tiona l et religieux
L’
Envers de l’
amour (un art icle du Sun
Laquelle des deux (Sayn ète)
PAGE
Troi si ème (L e) Cen tena i re de Québec et le proj et de Grey
Vieux arti cles et vi eux ouvrages— La dette des Etats-Un i s envers les
Canadien s—fran çai s , 54 Etude sur les Acadien s,62 les Canadiens
de l’
Ouest,1 31
,207 Notes hi stor iques sur l
’
Eglise catholique dans
l’
Or égon ,1 36 Notre—Dame des Canadien s et les Canadiens des
Etats—Un is , 1 39 Un_
art icle d e L’
Abei lle publi é en. 1 849 sur
l’
imm igrat ion des Can adien s-f ran çai s aux Etats—Un i s,31 5 ; Les
Canadiens —françai s de l ’Etat de New-York, (discours , 349
Mém oire sur la s i tuat ion des Canadien s-f ran çai s aux Etats—Un is de
l’
Am ér ique du Nord ,
Vi e f ranco—amér ica i ne — L’
hou . A. J. Pothier , de Woonsocket
Z ola au Panthéon