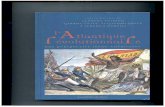Chateaubriand: la couleur américaine ou la tentation panthéiste
-
Upload
xn--universit-lyon3-jnb -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Chateaubriand: la couleur américaine ou la tentation panthéiste
La couleur américaine ou la tentation panthéiste
Par Olivier Catel
Le jeune breton, élevé sous un climat balayé par lesvents et les marées, sensible aux brumes et aux tempêtesossianiques, éprouve un véritable choc esthétiquelorsqu’il découvre l’Amérique, une Amérique qu’il neconnaît que par les récits de voyage1. La couleur, signevisible et frappant de l’expérience exotique, permet aujeune philosophe de découvrir sa vocation d’écrivain etde vivre sa philosophie rousseauiste sur le terrain. Lestableaux que Chateaubriand dresse de ce Nouveau Mondesont mêlés de références religieuses, littéraires etphilosophiques. Les couleurs jouent un rôle primordialdans la naissance esthétique de l’écrivain : il ne s’agitpas de seulement s’intéresser à leur emploi mais aussi decomprendre quelles valeurs elles prennent et en quoielles participent d’une inspiration esthético-religieusequi associe les rêves panthéistes d’une religionprimitive à une tradition et une culture catholiques dontl’auteur s’est éloigné sans jamais les renier.
La couleur : la marque d’un espace édénique
Le Nouveau Monde, dans la pensée de la fin du XVIIIe
siècle, apparaissait aux yeux de beaucoup comme un NouvelÉden, une nouvelle nature vierge où l’homme civilisépouvait retrouver la douceur du bon sauvage. Ce paradoxedu sauvage et du civilisé est la pierre angulaire destrois grands récits américains : René le civilisé veut sefaire sauvage tandis que Chactas le sauvage essaied’avoir accès au monde civilisé de l’homme blanc.Chateaubriand, souffrant des horreurs de l’ancien mondequ’il présente comme l’empire des démons, veut « voyager àtravers ces pays que les prospectus de marchands de terrains sans pudeurappelaient le Nouvel Éden (p. 29)».
L’Éden de Chateaubriand est à mi-chemin entre l’Édenbiblique et la reconstruction poétique et philosophiquedes penseurs des Lumières mais reste très globalement
orthodoxe. L’ouverture d’Atala construit un espaceédénique parfait et renouvelé, et inscrit au cœur dutexte l’espace paradisiaque perdu :
Quatre grands fleuves, ayant leurs sources dans lesmêmes montagnes, divisaient ces régions immenses : lefleuve Saint-Laurent, qui se perd à l'est dans le golfede son nom ; la rivière de l'Ouest, qui porte ses eaux àdes mers inconnues ; le fleuve Bourbon, qui se précipitedu midi au nord dans la baie d'Hudson, et le Meschacebé[Vrai nom du Mississippi ou Meschassipi. (N.d.A.)] quitombe du nord au midi dans le golfe du Mexique.Ce dernier fleuve, dans un cours de plus de mille lieues,arrose une délicieuse contrée, que les habitants desEtats-Unis appellent le nouvel Eden, et à laquelle lesFrançais ont laissé le doux nom de Louisiane (Atala, 33-34).
Conformément à la géographie biblique2, Chateaubriandinstalle un jardin au cœur du pays d’Éden. Chateaubriandimite le style biblique, calque sa description sur cepassage bien connu de la Genèse pour installer uneanalogie qui, dans ce nouvel occident, devient le pendantde la Terre sainte orientale. Il insiste sur le chiffrede quatre, qu’il met en début de paragraphe, pourprovoquer chez son lecteur une vision paradisiaque liée àla tradition culturelle3. Chateaubriand s’inspire donc icide la Bible mais aussi des descriptions poétiques deMilton ou de Dante4. Cette géographie montre la doubleorigine culturelle de cette mythification : les nomsfrançais, européens, civilisés, se mêlentinextricablement aux noms indiens, à la culture despremiers habitants. L’homme blanc impose à une naturevierge ses catégories culturelles et transforme lepaysage, le moralise pour exprimer ses ressentis etdonner à la nature la forme qu’il veut : Chateaubriand,par la peinture et les descriptions, donne à ce NouveauMonde les caractères symboliques importés de l’AncienMonde. Si l’on continue le récit biblique de la Genèse(II, 15) : « Yahvé Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Édenpour le cultiver et le garder », il est aisé d’envisager la placede cet espace religieux et artistique dans l’économie de
l’œuvre. Le romancier Chateaubriand, une fois le décorinitial installé, va montrer la subtile interaction entrecet espace édénique et les personnages qui l’habitent5.
Les personnages, plongés dans ce monde premier,encore marqué par le souffle de la création divine, fontl’expérience d’une renaissance, d’une complèterégénération qui tend à effacer les acquis d’une culturepour faire ressortir l’être originel, comme au jour de sanaissance. L’éveil de René, au début des Natchez, tient decette exaltation adamique du premier homme s’éveillant lepremier jour dans le jardin originel :
Le visage tourné vers le dôme azuré, le jeuneétranger enfonçait ses regards dans ce dôme qui luiparaissait d'une immense profondeur et transparent commele verre. Un sentiment confus de bonheur, trop inconnu àRené, reposait au fond de son âme, en même temps que lefrère d'Amélie croyait sentir son sang rafraîchidescendre de son cœur dans ses veines et par un longdétour remonter à sa source : telle l'antiquité nouspeint des ruisseaux de lait s'égarant au sein de laterre, lorsque les hommes avaient leur innocence et quele soleil de l'âge d'or se levait aux chants d'un peuplede pasteurs (Natchez, 183).
Ici, l’auteur installe une comparaison complexe quiassocie le microcosme du corps humain au macrocosmenaturel. René est proprement régénéré, son sang est« rafraîchi » et la vision paradisiaque que Chateaubriandchoisit est celle de la nature arcadienne de l’âge d’or6.Le « dôme » fonctionne comme un élément protecteur, unesorte de berceau qui recueille l’enfant nouveau-né. Larenaissance de René ne peut être qualifiée dechrétienne : nulle mention du péché ici. L’homme n’ajamais, dans la tradition biblique, été un élément de lanature : Dieu l’a installé pour « le garder et le cultiver ».Chateaubriand cède ici aux rêveries rousseauistes et pourRené, renaître, « c’est se fondre dans le paysage, c’est devenir lepaysage7 ». La comparaison, qui identifie René au paysagearcadien, devient la forge dans laquelle se fondentpersonnage et décor. En termes d’esthétique religieuse,l’auteur préfère un panthéisme diffus à une tradition
chrétienne, ou peut-être ce que Jean-Pierre Richard nomme« une immanence ouverte8 ». L’animisme des Indiens, leurrapport avec un Grand Tout influent sur la peinture queChateaubriand peut faire des impressions et des ressentismétaphysiques de ses héros9. La vision du « dôme azuré »,et l’insistance sur ce ciel sans limites, témoigne d’unereligion primitive, en harmonie totale avec la nature.Chateaubriand paraît fasciné par les infiniespossibilités picturales de ce paysage américain, par sa1 Cf. la longue étude de Gilbert Chinard sur les sourceslivresques des romans américains : L’Exotisme américain dans l’œuvre deChateaubriand (Paris, Hachette, 1918).2 Cf. Genèse II, 10-14, Bible de Jérusalem (Paris, Desclée deBrrouwer, 1998) : « 10 : Un fleuve sortait d’Éden pour arroser le jardin et de làil se divisait pour former quatre bras. 11 : Le premier s’appelait le Pishôn : ilcontourne tout le pays de Havila, où il y a de l’or ; 12 : l’or de ce pays est pur et là setrouvent le bdellium et la pierre de cornaline. 13 : Le deuxième fleuve s’appelle leGihôn : il contourne tout le pays de Kush. 14 : Le troisième fleuve s’appelle le Tigre : ilcoule à l’orient d’Assur. Le quatrième fleuve est l’Euphrate ».3 Chateaubriand connaît très exactement ce détail biblique desquatre fleuves ; on retrouve cette mention dans le Génie,« Fragments », p. 1301 : « Ici, à la source de quatre grandsfleuves, Adam se promène avec Dieu et avec son épouse dans lesberceaux d’Éden » et aussi dans Les Martyrs, p. 140 : « Desjardins délicieux s'étendent autour de la radieuse Jérusalem.Un fleuve découle du trône du Tout-Puissant [On lisait dansles premières éditions quatre fleuves. J'avais voulu rappelerle paradis terrestre. Je suis revenu à une image plus fidèle àla lettre de l'Écriture." Et ostendit mihi fluvium aquaevitae, splendidum tanquam crystallum, procedentem de sede Deiet Agni. " ( Apocal ., cap. XXII, v. 1.) - N.d.A.] ; il arrosele céleste Éden, et roule dans ses flots l'amour pur et lasapience de Dieu. L'onde mystérieuse se partage en diverscanaux qui s'enchaînent, se divisent, se rejoignent, sequittent encore, et font croître, avec la vigne immortelle… »4 Cf. Dennis Spinninger, « The Paradise Setting ofChateaubriand’s Atala », PMLA, Vol. 89, n°3, mai 1974, p. 530:“by a carefully designed series of motifs he adapted theexotic atmosphere of a virtually unknown America to thetradition of garden paradises through his acquaintance withMilton’s Paradise Lost”. Traduction : « grâce à une série demotifs soigneusement choisis, il a adapté l’atmosphèreexotique d’une Amérique que, de fait, personne ne connaissait,à une tradition des jardins paradisiaques grâce à saconnaissance du Paradis perdu de Milton ».
richesse et sa palette qui n’attendent plus que lepinceau d’un peintre pour les transformer en fresquesmulticolores : « La nuit régnait : des nuages brisés ressemblaient, dansleur désordre sur le firmament, aux ébauches d'un peintre dont le pinceau seserait essayé au hasard sur une toile azurée. Des langues de feu livides etmouvantes léchaient la voûte du ciel (Natchez, 186-187) ».
Chateaubriand, en ce début de roman, installe, commepour Atala, un décor qui donne sens et vie auxpersonnages. Le décor peint et décrit est proprementpremier et participe à la caractérisation du personnage.Chateaubriand installe ainsi par avance une théorie desmilieux où le paysage et l’environnement déterminent lepersonnage et ses affects.
Lorsqu’il met en scène un couple dans ce paysageoriginel, ce paysage de l’origine de l’homme et de lacréation artistique, il en va de même, tout se fond dansune expression de couleur. Atala et Chactas, vivant dansles bois, ressemblent à Adam et Ève. Chateaubriand peintun tableau tout en légères touches de couleur, entouchants détails qui rappellent la simplicité de la viedes premiers hommes :
5 Cf. Balzac et ses descriptions inaugurales dans OlivierBonard, La peinture dans la création balzacienne. Invention et vision picturales deLa Maison du Chat-qui-pelote au Père Goriot (Droz, Genève,1969).6 Gilbert Chinard, L’Exotisme américain dans l’œuvre de Chateaubriand, op.cit., p. 207 : « les premières impressions de René furentdélicieuses : comme tant de voyageurs depuis Christophe Colombjusqu’à Bougainville, il se crut transporté dans un Edenretrouvé ; il se sent régénéré, purifié, exalté et croit pourun moment à la possibilité de renaître à une nouvelle vie. »7 Philippe Moisan, « Le Nouveau Monde de Chateaubriand : desalluvions à l’érosion », Chateaubriand 98, (Comité breton du cent-cinquantenaire de la mort de F.R. de Chateaubriand, 1999), p.119.8 Jean-Pierre Richard, Paysage de Chateaubriand, (Paris, Seuil,1967), p. 31.9 Nicolas Perot, Discours sur la musique à l’époque de Chateaubriand,(Paris, PUF, 2000), p. 182-183 : « le panthéisme estapparemment une des grandes tentations du séjour en Amérique,peut-être sous l’influence de la découverte d’une naturesauvage et d’une spiritualité indienne animiste ».
Tantôt je lui mettais sur la tête une couronne de ces mauves bleues que noustrouvions sur notre route, dans des cimetières indiens abandonnés ; tantôt jelui faisais des colliers avec des graines rouges d'azalea, et puis je me prenaisà sourire en contemplant sa merveilleuse beauté (Atala, 56).
Dans une composition extrêmement simple maisfrappante, l’écrivain réutilise, dans cet espace exotiqueet premier, les deux couleurs traditionnelles de lanouvelle Ève qu’est la Vierge. Le bleu et le rouge de larobe mariale sont ici redynamisés dans la personned’Atala qui se trouve investie d’une tradition culturellemais aussi d’une élégance sauvage. Le peintre utilise icides couleurs primaires, des couleurs de base qu’iljuxtapose et qui envahissent le portrait lui-même : levisage d’Atala disparaît entre la couronne bleue et lecollier rouge et tout ne devient finalement que pureexpérience visuelle de la couleur.
Chateaubriand crée l’effet visuel par la simpleévocation des couleurs, appliquées ici comme deux largesaplats. Les textes américains regorgent de ces détailscolorés qui envahissent rapidement l’espace mental dulecteur. Mais ici, le force des couleurs rompt avec legoût classique et Chateaubriand peintre entre déjà dansune véritable modernité artistique.
L’auteur, dans ses peintures et sa sanctification dupaysage, ne s’intéresse pas qu’aux personnages, à leursimpressions, il métamorphose cette nature et lui donne,par le seule force de son pinceau, une forme nouvelle.Atala illustre superbement une grande idée de l’auteur duGénie : les cathédrales sont nées de la forêt, « les forêts ontété les premiers temples de la Divinité, et les hommes ont pris dans les forêtsles premières idées de l’architecture (Génie, 801) ». Dans unedescription en forme d’ecphrase, l’auteur dépeint, dansles forêts où errent Chactas et Atala, un temple naturelque la nature a élevé pour chanter la gloire de laDivinité :
Les troncs de ces arbres, rouge marbré de vert, montantsans branches jusqu'à leurs cimes, ressemblaient à dehautes colonnes, et formaient le péristyle de ce templede la mort ; il y régnait un bruit religieux, semblableau sourd mugissement de l'orgue sous les voûtes d'une
église ; mais lorsqu'on pénétrait au fond du sanctuaire,on n'entendait plus que les hymnes des oiseaux quicélébraient à la mémoire des morts une fête éternelle(Atala, 70).
La nature américaine, dans sa virginité qui rappellel’âge d’or, prend les formes d’un temple grec, comme lemontre bien « péristyle », puis d’une « église ». Cettepeinture, proprement cyclique car elle commence avec lanature et finit avec la nature, possède une grandeprofondeur : en effet, elle ressemble, à s’y méprendre, àun palimpseste culturel et imagier. À la nature premièrese superpose l’image du temple grec puis celle del’église et finalement une vision édénique originelle quirenvoie à un ordre du monde ancien. Cette étonnantedescription où le peintre photographe a pris plusieursphotos sur un même morceau de pellicule appartientcependant assurément à l’espace américain comme entémoigne la mention, en tête de paragraphe, des couleurs.Chateaubriand ne reproduit pas les tableaux du XIXe
siècle, il renouvelle l’idée religieuse par un jeufrappant de couleur. L’alliance du vert, couleur végétales’il en est, avec le rouge souvent associé à la pompe dela religion et au sang versé du Christ, élargit etredynamise le symbolisme de cette associationnature/temple. La couleur constitue l’élément primordialde cette recréation : de même que René se trouve régénérédans cette nature première, le jeune écrivain, et saculture classique, se trouvent revivifiés par ladécouverte de cette couleur.
Cependant, il ne faut pas s’y tromper, cet espaceédénique n’est qu’une réplique terrestre, et parconséquent imparfaite, du Paradis biblique quin’appartient pas à la réalité de notre monde. Au cœur decette nature luxuriante, dans le débordement d’une natureexubérante, la mort rôde. Les arbres multicolores de cetemple de la nature ne peuvent cacher la mort, ce « templede la mort ». Au centre de ce décor arcadien s’élève unetombe naturelle, majestueuse, qui vient rappeler celledes Bergers d’Arcadie : « In Arcadia ego ». Ce paradis estlittéralement hors d’atteinte, c’est le monde des morts,le monde paternel à tout jamais perdu10. Dans le Paradis
de Yahvé, la mort n’existe pas et l’arbre est l’Arbre dela Vie ; ici, les arbres servent de structure à unimmense mausolée ou bien sont emportés par les délugessuccessifs : « quand tous ces fleuves se sont gonflés des déluges del’hiver, […] les arbres déracinés s’assemblent sur les sources (Atala, 33) ».Dans la Bible, le Déluge n’arrive que du fait de lacorruption morale des hommes qui habitent la terre ;point de destruction dans la Jardin primitif tout sous lesigne du luxe, calme et volupté, baigné de la lumière del’âge d’or. Le récit américain, Atala, finit avec leschutes du Niagara11 qui marquent symboliquement la fin detoute illusion paradisiaque12, la Chute. Dans les Mémoiresd'outre-tombe, Chateaubriand rappelle le sens de ces« grandes eaux » : « L’Écriture compare souvent un peuple aux grandeseaux13 ; c’était ici un peuple mourant, qui, privé de la voix par l’agonie, allaitse précipiter dans l’abîme de l’éternité14 ». Le peuple sauvage,primitif se trouve emporté dans la destruction de sonjardin. Chactas et Atala, pris dans la tempête, chassésdu Paradis, rencontrent le Père Aubry : seule la religionpeut sauver l’Homme chassé du Paradis. Le paysagedisparaît alors pour que l’Homme revienne au premierplan : la forêt américaine, ambiguë, double etcontradictoire, reflète en fait la contradiction du cœurde l’homme pris entre un désir d’harmonie et de paix, etla marque du péché originel qui le mène à la mort.
L’espace édénique américain, fruit d’une longuetradition antique et chrétienne, paradis imparfait,acquiert toute son originalité par la technique dupeintre et par l’usage d’une couleur nouvelle en peintureet en littérature. La couleur apparaît comme étant unsigne de vie face aux tons plus estompés des sièclesprécédents mais ne parvient pas à cacher complètement laChute : la couleur montre la vie et cache mal la mort. Cesymbolisme fort étant donné, il reste à déployer lesgrandes fresques américaines qui traduisent le goûtpassionné de l’auteur pour la couleur locale etl’exotisme.
La recherche du pittoresque et de la couleurlocale : l’exotisme
L’Amérique, au XVIIIe siècle, reste par excellence lepays de l’exotisme, de l’étrange et de l’étranger.Chateaubriand, dans les forêts américaines, au bord deschutes du Niagara et dans son expérience floridienne -qu’elle soit d’ailleurs réelle ou simplement livresque-découvre le Nouveau Monde et ses richesses. On peutimaginer le choc que peut provoquer cette nouvelle terrepour un jeune breton qui n’a vu que Paris et son paysnatal : cette expérience apporte avec elle son lotd’impressions et va avoir une influence considérable surun esprit ultra-sensible comme celui de Chateaubriand.L’œil de peintre, de l’auteur découvre une nouvellepalette qui lui permet de créer un tout nouvel espaceimaginaire, littéraire et pictural : il va user de cesnouvelles couleurs pour exprimer l’exotisme édénique dece monde.
10 Cf. Shaun Irlam, « Gerrymandered Geographies : Exoticism inThomson and Chateaubriand », MLN, éditions Johns HopkinsUniversity, Baltimore, 1993, vol. 108, p. 902: « butChateaubriand’s America, this « Nouvel Eden » is, in addition,a forbidding, and forbidden, paternal landscape : the habitatof the dead, inaccessible father. » Traduction : « maisl’Amérique de Chateaubriand, ce « Nouvel Eden » est, de plus,un paysage interdit et qui interdit, un paysage paternal :c’est là qu’habite le père mort, inaccessible. »11 Gilbert Chinard, L’Exotisme américain dans l’œuvre de Chateaubriand,op. cit., p. 244 : « Atala est comme encadrée entre deuxdescriptions grandioses : le tableau du Mississipi au début,et celui de la cataracte du Niagara qui termine l’ouvrage »12 Cf. Mémoires d'outre-tombe, I, p. 244 : « qu’est-ce qu’unecascade qui tombe éternellement à l’aspect insensible de laterre et du ciel, si la nature humaine n’est là avec sesdestinées et ses malheurs ? »13 Bible de Jérusalem, op. cit., Jérémie, LI, 55 : « Car Yahvé dévasteBabylone, il fait cesser son grand bruit, celui des flots quigrondaient comme les grandes eaux quand le tumulte de leurvoix retentissait ».14 Mémoires d'outre-tombe, I, p. 243.
Les débats ont été nombreux pour savoir si lapeinture que Chateaubriand a fait des déserts américains,avec sa faune, sa flore et ses couleurs, était conforme àla réalité du terrain15. Ces querelles de critiquesappartiennent à un autre temps et ne tiennent pas comptede la dimension éminemment poétique et artistique de cesdescriptions dont l’ouverture d’Atala constitue le pointd’orgue. Saint-Beuve, qui pourtant n’épargne que rarementle grand auteur, resitue avec raison le débat et insistesur le talent de peintre de Chateaubriand :
Les critiques qu’on a faites des premières pages d’Atala,quant au peu de fidélité du dessin et des couleurs, nousdémontrent que l’auteur n’a pas cherché l’exactitudepittoresque réelle ; qu’après une vue générale et rapide,il a remanié d’autorité ses souvenirs et disposé à songré les riches images, réfléchies moins encore dans samémoire que dans son imagination […] ; il a fait acte depoète et créateur16.
Les récits américains de Chateaubriand, celui d’Atalaou de René, ne cherchent pas à établir une descriptionprécise du paysage américain, de nommer parfaitement lafaune et la flore locales17. Ces récits, éminemmentpoétiques, se fixent au contraire pour objectif de narrerles amours tragiques de deux sauvages prisonniers de leur
15 Cf. Décade philosophique, littéraire et politique, du 10 floréal an IX,Lettres de Mersenne citées par M. Bédier dans Études critiques(Paris, éd. Diderot, 1903), p. 134 : « il faut donc confesserque les hérons bleus de M. de Chateaubriand, ses flamantsroses, ses perroquets à tête jaune voyageant de compagnie avecdes crocodiles et des serpents verts sur des îles flottantesde pistia et de nénuphar (…) ; plus les mille merveilles deces bords, qui font du Meschacébé l’un des quatre fleuves duparadis terrestre, sont des contes à dormir debout, et que lesbords de ma Garonne eux-mêmes, n’auraient pu inspirer ».16 Charles-Augustin Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe littérairesous l’Empire, (Paris, Garnier, 1848), p. 167.17 Chateaubriand ne fait pas œuvre de naturaliste alors mêmequ’il était parti dans un esprit proche de Bernardin de Saint-Pierre et s’était entendu avec Malesherbes pour recenser lesespèces animales et végétales qu’ils rencontrerait lors de sonexpédition.
passion et de leur religion. Chateaubriand met sonpinceau au service de cette grande fresque sauvage.Chateaubriand, si l’on veut utiliser une terminologiepicturale, ne fait pas partie des peintres en plein air :il ne prend pas son chevalet, comme de nombreux peintresen cette fin de XVIIIe siècle, mais il restitue, grâce àsa mémoire et à son imagination, les images saisiespendant ses courses et ses voyages ; il reste en celafidèle aux peintres classiques. Chateaubriand n’est pasun scientifique qui, dans un essai de réalisme, copiefidèlement la nature, il est « poète et créateur », c'est-à-dire qu’il crée un espace nouveau qui se veutl’expression personnelle d’un lieu réel. Le tableau qu’ilen fait se trouve alors être un tableau pittoresque, oupour le dire différemment, un tableau qui se dit commeœuvre picturale et non comme représentation fidèle de laréalité.
L’exotisme réel du paysage américain qui est déjàfacteur d’éloignement, qui place la représentationpicturale dans un ailleurs imaginaire, voit son effetredoublé par l’éloignement dû à la poétisation : lepaysage américain, tel qu’il est peint par Chateaubriand,appartient ainsi réellement au monde auto-référent del’art, à un espace pictural et proprement littéraire.Cette distance est sans doute la plus à même d’évoquerl’espace paradisiaque qui renvoie, du fait de latradition, à un ailleurs absolu en dehors de tout tempset de tout espace.
La peinture des paysages américains envahitlittéralement le texte au point qu’ils deviennent aussiimportants que les personnages eux-mêmes. La célèbreouverture d’Atala plante, sur plusieurs pages, un décorimpressionnant et inspiré : la longueur et la richesse decette fresque monumentale témoigne de la luxuriance et del’abondance de la forêt américaine :
Suspendus sur le cours des eaux, groupés sur les rochers et sur lesmontagnes, dispersés dans les vallées, des arbres de toutes les formes, detoutes les couleurs, de tous les parfums, se mêlent, croissent ensemble,montent dans les airs à des hauteurs qui fatiguent les regards. Les vignessauvages, les bignonias, les coloquintes, s'entrelacent au pied de ces arbres,escaladent leurs rameaux, grimpent à l'extrémité des branches, s'élancent de
l'érable au tulipier, du tulipier à l'alcée, en formant mille grottes, mille voûtes,mille portiques. Souvent, égarées d'arbre en arbre, ces lianes traversent desbras de rivière sur lesquels elles jettent des ponts de fleurs. Du sein de cesmassifs le magnolia élève son cône immobile ; surmonté de ses larges rosesblanches, il domine toute la forêt, et n'a d'autre rival que le palmier, quibalance légèrement auprès de lui ses éventails de verdure.
Une multitude d'animaux placés dans ces retraites par la main duCréateur y répandent l'enchantement et la vie. De l'extrémité des avenues onaperçoit des ours, enivrés de raisins, qui chancellent sur les branches desormeaux ; des cariboux se baignent dans un lac ; des écureuils noirs se jouentdans l'épaisseur des feuillages ; des oiseaux moqueurs, des colombes deVirginie, de la grosseur d'un passereau, descendent sur les gazons rougis parles fraises ; des perroquets verts à têtes jaunes, des piverts empourprés, descardinaux de feu, grimpent en circulant au haut des cyprès ; des colibrisétincellent sur le jasmin des Florides, et des serpents-oiseleurs sifflentsuspendus aux dômes des bois en s'y balançant comme des lianes (Atala,34).
Cette ouverture, qui a donné lieu a d’innombrablescommentaires, présente tous les aspects de l’art dupeintre. Dans un premier paragraphe, Chateaubriand traitedéjà de la flore et de ses richesses, des couleurs et descontrastes tandis que dans un second paragraphe, ildécrit la faune qui est tout aussi étincelante etbrillante. Tout, dans cette description dit l’ivresse dessens, des arbres « de toutes les couleurs, de tous les parfums »,tout invite au vertige, « des hauteurs qui fatiguent les regards ».L’harmonie, l’équilibre vertigineux de cet ensemble,transparaît à chaque étape de cette toile : « des oursenivrés de raisins, qui chancellent ». Dans cette terre « de lait et de miel »,Chateaubriand, comme « la main du Créateur », installe etdispose un univers entier, protégé de toute influence,« dans ces retraites ». En reconnaissant l’action du Créateur,l’écrivain compare implicitement sa propre activité àcelle de la divinité et le tableau qu’il réalise prendune dimension éminemment religieuse, mythique.
Mais ce qui frappe réellement ici, outre l’abondancedes espèces, c’est la vision multicolore qui éblouit leregard du peintre et du lecteur. Le tableau devient eneffet proprement poétique car les plantes et les animauxdisparaissent sous la profusion des couleurs : tout faitcontraste. Le magnolia « blanc » rivalise avec la « verdure »
des palmiers. En ce qui concerne les animaux, l’écureuil« noir » se perd dans « l’épaisseur du feuillage » vert foncé ;les perroquets sont « verts à têtes jaunes » ; les piverts nesont pas verts, comme en Europe18, mais « empourprés », cequi amène une note proprement pittoresque et exotique,exotique parce qu’elle mêle le connu et l’étranger. De la« pourpre » du pivert, on passe au « cardinal » qui doit sonnom à la robe du dignitaire religieux : elle n’est pas« pourpre », elle devient « de feu » car dans cet espaceexotique tout est régénéré, plus brillant. Dans cettegradation vers une couleur qui n’appartient pas à cemonde mais à l’imagination du peintre, arrivent lescolibris : leur couleur est tellement puissante qu’elledevient lumière ; ils « étincellent ». Cette descriptionexotique transforme la réalité et désoriente les sens :les perceptions se brouillent et les repèresdisparaissent. Le gazon, dans ce Nouveau Monde, nesaurait être vert comme de coutume : il est « rougi » parles fraises. Dans cette toile, tout éloigne le lecteur-spectateur d’un quelconque référent. Tout d’abord, lelecteur du XIXe siècle ne connaît pas tous les animaux etles plantes décrites ; les grandes serres dans les grandsparcs publics datent du Second Empire. À cette difficultéde savoir à quoi peut ressembler un « caribou » ou un« serpent-oiseleur » s’ajoute la poétisation pittoresque durécit : les animaux, surtout, ont des couleurs étrangesqui les rendent proprement irréels et fantastiques. Lafaune exotique, contrairement à la faune européenne,emprunte des couleurs vives, inconnues : en Europe, lesoiseaux ne sont pas « de feu », ils « n’étincellent » pas.Chateaubriand fait découvrir une couleur locale, un mondehors de notre connaissance, proprement exotique quiresplendit encore des couleurs de l’âge d’or et despremiers temps contrairement à l’Ancien Monde où cesmêmes couleurs se sont ternies19.
Dans un passage du Voyage en Amérique, Chateaubriandinstalle la même ambiguïté proprement irréelle en mêlantl’espace marin et animal à l’espace terrestre etvégétal : « Le soleil approchait de son couchant : sur le premier plan del'île paraissaient des chênes verts, dont les branches horizontales formaient leparasol, et des azaléas qui brillaient comme des réseaux de corail (728-729) ». Les azaléas, avec leur couleur vive, déréalisent
l’espace végétal et se mêlent aux profondeurs de la mer.L’auteur, en usant de cette comparaison, provoque unepure expérience de la couleur, inhabituelle, nouvelle etqui exprime poétiquement l’expérience exotique.
Roger de Piles explique, au XVIIe siècle, ce qu’estet ce que doit être la couleur locale qui deviendra unedes caractéristiques essentielles de l’esthétiqueromantique :
La couleur locale est celle qui, par rapport au lieu qu’elle occupe et par lesecours de quelque autre couleur, représente un objet singulier ; comme unecarnation, un objet, une étoffe, ou quelque objet distingué des autres. Elle estappelée locale parce que le lieu qu’elle occupe l’exige telle, pour donner unplus grand caractère de vérité aux autres couleurs qui leur sont voisines20.
Les couleurs qu’utilise Chateaubriand permettent eneffet de « représenter un objet singulier », objet tout à la foisréel, exotique, et irréel, pittoresque. Le Nouveau Mondeexigeait une couleur différente, une vision renouvelée dela nature et de ses charmes ; l’auteur utilise ici unetoute nouvelle palette qui n’a plus grand chose affaireavec celle des peintres classiques et qui annonce déjà lanouvelle esthétique romantique et ses débordements.Chateaubriand, qui « voit en familier de la forme et de lacouleur21 » installe au cœur de sa littérature un nouvelunivers poétique et pictural dont la couleur est le moyend’expression. Si la forêt offre un tableau étourdissant,la campagne elle aussi ne devient qu’un immense tableaucoloré : « nous campâmes dans des prairies peinturées de papillons et de
18 « Pivert » vient de « pic vert ». TLF : « Oiseau du genre picà plumage jaune et vert et à tête rouge et noir. »19 Cf. Gilbert Chinard, L’Exotisme américain dans l’œuvre deChateaubriand, op. cit., p. 298 : « Le Mississipi, le Niagara, laforêt vierge aux arbres étincelants de fleurs, d’oiseaux et depapillons, les marais tout grouillants de vies obscures, unenature éternelle et en transformation perpétuelle, ce sont làdes visions qui font paraître bien petits nos paysages oùl’homme a lassé sa marque, et où à chaque pas nous pouvonsévoquer le souvenir des vies humaines qui s’y sont écoulées ».20 Roger de Piles, Cours de peinture par principes, (Paris, Gallimard,1989), p. 149.21 Alice Poirier, Les idées artistiques de Chateaubriand, (Paris, PUF,1930) p. 193.
fleurs( MOT, I, 241) ». Là encore, le référent bien réelqu’est la campagne se dématérialise pour devenir un objetd’art ; la création de ce néologisme attire l’attentiondu lecteur, crée un effet proprement exotique et étrangeau cœur même du langage et apparaît alors dans l’espacedu texte une toile réelle avec son épaisseur et sesaplats de peinture.
Le peintre, conscient de la difficulté à peindre cestableaux et à susciter une représentation visuelle chezson lecteur22 finit dans un vertige où toutes les couleursde la palette se mêlent pour ne devenir qu’uneabstraction colorée :
Mais quand une brise vient à animer ces solitudes, à balancer ces corpsflottants, à confondre ces masses de blanc, d'azur, de vert, de rose, à mêlertoutes les couleurs, à réunir tous les murmures, alors il sort de tels bruits dufond des forêts, il se passe de telles choses aux yeux, que j'essayerais en vainde les décrire à ceux qui n'ont point parcouru ces champs primitifs de lanature (Atala, 35).
Le peintre joue des synesthésies et donne de lacouleur aux bruits de la forêt, ces bruits qui assurentun charme tout poétique et donnent vie à la couleur.Chateaubriand semble ici atteindre, dans l’évocation dece monde à part, les limites du langage. Pour conserverune certaine lisibilité à son art, l’auteur place toutecette entreprise littéraire sous le patronage de lacomposition picturale et décrit précisément son activitéen utilisant un référent artisanal immédiatementcompréhensible pour son lecteur :
La scène n'est pas moins pittoresque au grand jour, car une foule depapillons, de mouches brillantes, de colibris, de perruches vertes, de geaisd'azur, vient s'accrocher à ces mousses, qui produisent alors l'effet d'une
22 Dans la préface des Natchez, l’écrivain souligne ladifficulté à mêler le connu et l’exotique, le poétique et leréférentiel ; p. 163 : « Partout, dans cet immense tableau,des difficultés considérables se sont présentées au peintre :il n'était tout à fait aisé, par exemple, de mêler à descombats, à des dénombrements de troupes à la manière desanciens, de mêler, dis-je, des descriptions de batailles, derevues, de manoeuvres, d'uniformes et d'armes modernes.
tapisserie en laine blanche où l'ouvrier européen aurait brodé des insectes etdes oiseaux éclatants (Atala, 56).
Conscient de la difficulté de son lecteur àcomprendre son esthétique et son activité, il use d’uneanalogie très ancrée dans la culture de ses lecteurs ; ilpense ainsi rendre compréhensible son entrepriselittéraire. Choisir la tapisserie pour exprimer son art,c’est tenter de réduire les distances imposées parl’exotisme et le pittoresque. On reconnaît, sous lestraits de « l’ouvrier européen », Chateaubriand qui découvrele Nouveau Monde. Le contraste de la tapisserie « blanche »avec les « oiseaux éclatants » fournit le modèle minimal auxgrandes descriptions lyriques de la forêt américaine. Ilfait ainsi comprendre qu’il s’inscrit dans une démarcheartistique connue et que même si son art peut semblerétrange il reste conforme à des pratiquestraditionnelles. Il n’en reste pas moins que, dans cettetapisserie, la couleur domine toujours et constitue lecentre d’intérêt principal de cette réalisationartistique.
La poésie des grands espaces vierges semble devenirart abstrait, le figuratif passe au second plan et lescouleurs envahissent l’espace tout entier commetémoignage, peut-être, d’une foi retrouvée en lalittérature et en la religion, ou tout du moins une foien une nature première telle que Rousseau la chante.
Le fauvisme de Chateaubriand : onirisme etcroyance
L’abondance des couleurs témoigne d’une âmeproprement exaltée, hypersensible et qui rend compte d’unanimisme religieux assez prégnant, en contact avec lanature. Outre leur charge symbolique indéniable, outreleur caractère édénique revendiqué, les paysagesdématérialisés deviennent proprement oniriques etévoquent les rêveries d’une âme qui se perd dans un mondeexotique hors du monde réel. François Bergot, en abordantl’ouverture d’Atala sur un monde pictural constate :
Les tons purs, choisis pour leur intensité ; leurs applications par touchesfranches, sans recherches de nuances ; une profusion à la limite de l’outranceet d’autre part l’ampleur des rythmes liés à la simplicité apparente de lacomposition rapprochent ces descriptions de tableaux évocateurs des forêtstropicales extravagantes comme les rêves, naïves comme des images, tellesque les a peintes le douanier Rousseau23.
Dans cette description inaugurale d’Atala, point denuances ou de teintes diffuses, Chateaubriand parle de «roses jaunes [qui] s'élèvent comme de petits pavillons. Des serpents verts, deshérons bleus, des flamants roses, (Atala, 33)… » Le jaune n’est pas« vif », le bleu « azur » ou le rose « brillant », non ce sontdes couleurs « franches », de larges aplats que l’écrivain-peintre dépose sur sa toile dans une composition quirappelle en effet l’œuvre, bien plus tardive certes, duDouanier Rousseau24. Contrairement à ce dernier,Chateaubriand a vu et visité la forêt tropicale qu’ilpeint. Les couleurs entrent en contact direct et l’œil dupeintre opère un balayage complet du cercle chromatique :du jaune, il passe au vert -mélange de jaune et de bleu-puis au bleu ; en se rapprochant du rouge, le bleudevient rose. L’œil du peintre décompose ces couleurs etrefuse de les fondre : ici, rien n’est estompé, tout faitcontraste, un contraste violent. L’« extravagance » sauvagede la composition reflète la conception brute et pure,libérée de tout dogme, des Indiens : la nature leurapparaît dans sa simplicité la plus évidente : ce que lesEuropéens peuvent percevoir comme de la naïvetécorrespond en fait à une saisie phénoménologique d’unautre type, c’est « l’expression d’une totalité superlative, polymorphe,presque hystérisée25 ». L’onirisme et la vision intérieures’imposent, la raison et la mesure classique s’effacent,il ne reste que le sentiment et le rêve de l’esprit etdes sens. Ici point de dessin, de courbes savamment
23 François Bergot, « Poussin et Chateaubriand sur les cheminsde l’Arcadie », Bulletin de la Société Chateaubriand, n°38, p. 47.24 Cf. Marc Fumaroli, « Ut pictura poesis », Chateaubriand et lesarts, (Paris, Fallois, 1999)., p. 34 : « il avait vu le paysagepar les yeux du Douanier Rousseau, avant de voir ceux de Turnerou de Poussin. »25 Jean-Pierre Richard, Paysage de Chateaubriand, op. cit., p. 31.
tracées mais une ivresse de couleurs qui témoigne d’unesensation. Le dessin et la pensée disparaissentabsolument dans certaines de ces descriptions pour n’êtreplus que couleur et sensation. Chateaubriand, qui a tiréAtala du manuscrit des Natchez, un manuscrit très largementrédigé pendant la période de « philosophe rousseauiste » del’auteur, reflète cette fascination de l’auteur pour ungrand Créateur, primitif, et une appréhension directe etspontanée de la Création par l’émotion.
On ne trouve pas encore la lumière d’un Lesueur oud’un Poussin qui apaise toutes les sensations, quirenvoie à une lumière intérieure, et qui n’apparaîtraqu’après le voyage italien et méditerranéen ; il« s’abandonne ici à une ivresse de fauve26 », une ivresse proprementdionysiaque. Il ne s’agit pas de trop jouer del’anachronisme évident de ce rapprochement et d’entrer endétails dans les ressemblances de l’art de Chateaubriandavec celui des fauves mais en prenant une simpledéfinition, on se rend aisément compte de la pertinencede cette analogie : le peintre fauve se caractérise « parson goût des couleurs pures, violemment contrastées (notamment le jaune etle rouge), des lignes stylisées, d'une composition personnelle, exprimantvigoureusement des sensations intenses, une vision brute et subjective duréel27 ». Dans tous ces qualificatifs, on retrouve nombredes remarques concernant l’esthétique de Chateaubriand.Le goût pour les « couleurs pures », pour les « contrastes » etpour la « composition personnelle » et poétique libérée desexigences de la référentialité montre la possible parentéesthétique entre l’auteur du début du XIXe et les fauvesdu début du XXe siècle28. Par ailleurs, Fontanes frémissaitsouvent devant la violence sauvage du nouveau style de26 François Bergot, « Poussin et Chateaubriand sur les cheminsde l’Arcadie », Bulletin de la Société Chateaubriand, n°38, op. cit., p.47.27 TLF, article « fauve ».28 Cf. Thomas Walker, Chateaubriand’s Natural Scenery, (JHU & BellesLettres, 1946), p. 171: “in his use of colors and shades, aswell as in his keen sense of light and form, a definitekinship between his art and that of painting can bediscerned.” Traduction: « dans son utilisation des couleurs etdes nuances, aussi bien que dans son sens aigu de la lumièreet de la forme, on peut discerner, sans conteste, une parentéentre son art et celui de la peinture. »
Chateaubriand, le traitant de « sauvage ». Cette abondancede couleurs va à l’encontre de principes philosophiquesesthétiques que Chateaubriand connaît bien, à savoir ceuxde Burke en particulier ; le philosophe anglaisrecommande les couleurs douces et déconseille fortementles couleurs trop vives : « elles ne doivent pas être du genre leplus prononcé : celles qui semblent s’allier le mieux avec la beauté, sont lesplus douces de chaque sorte ; les verts légers, les bleus tendres, les blancsaffaiblis, les incarnats, les violets29 ». La beauté ne saurait naîtrede rouge et de blanc « vifs et tranchants » d’après lephilosophe qui préconise que « les couleurs se mêlent », et« s’allient par des gradations insensibles (211) ». Il faut ainsimêler insensiblement les couleurs, les estomper peut-être, les choisir avec soin et en user parcimonieusement.Ces réserves quant à l’utilisation des couleurs n’est pasneuve, elle fait au contraire partie intégrante d’unecertaine histoire de l’art qui s’est toujours méfiée descoloristes et qui a toujours préféré ceux quiprivilégiaient le dessin30. L’explosion colorée desdescriptions américaines enfreint délibérément cetterègle et ne répond plus à ces canons esthétiques, eninstitue d’autres. Point de « gradations insensibles », lerouge des azaléas tranchent avec le blanc des magnolias,rien ne se mêle, tout fait contraste. Cette précellencede l’émotion sur la raison fait définitivement rentrerChateaubriand dans la modernité.
Cette furie fauve appartient seulement à la jeunesseexaltée et non à l’âge mûr. Il est ainsi frappantd’étudier l’évocation que Chateaubriand fait du paradisaméricain en 1822 dans les Mémoires d'outre-tombe31, plus detrente ans après son voyage en Amérique :
29 Edmund Burke, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublimeet du beau, (Paris, Librairie Pichon, 1803), p. 210-211, SectionXVII : « de la Beauté par rapport aux Couleurs ».30 Cf. Bruno Foucart, Le renouveau de la peinture religieuse en France (1800-1860)), (Paris, Arthéna, 1987), p. 239 : « cette défiance estcelle d’une peinture où, par la couleur, s’exprimerait tropvolontiers le sentiment personnel sans grand souci del’orthodoxie, celle d’une histoire de l’art chrétien qui placeRubens et Rembrandt avant l’Angelico ou Raphaël. »31 Le livre VIII date en effet de son ambassade à Londres etfurent donc rédigés entre « avril et septembre 1822 ».
Le soleil tomba derrière ce rideau : un rayon glissant à travers le dôme d'unefutaie, scintillait comme une escarboucle enchâssée dans le feuillage sombre ;la lumière divergeant entre les troncs et les branches, projetait sur les gazonsdes colonnes croissantes et des arabesques mobiles. En bas, c'étaient deslilas, des azaléas, des lianes annelées, aux gerbes gigantesques ; en haut, desnuages, les uns fixes, promontoires ou vieilles tours, les autres flottants,fumées de rose ou cardées de soie. Par des transformations successives, onvoyait dans ces nues s'ouvrir des gueules de four, s'amonceler des tas debraise, couler des rivières de lave : tout était éclatant, radieux, doré, opulent,saturé de lumière (MOT, I, 263-264).
Point de mention de la couleur, on ne retrouve pasla palette enivrante des romans américains mais bienplutôt la lumière : dans ce passage, tout est lumière,rien n’est couleur. Cette dernière a disparu avec lechangement radical de la conversion au christianisme etde l’expérience méditerranéenne. L’auteur, semble-t-il,ne croit plus à cette pureté originelle qui pouvaitconvenir à un sauvage. Les « azaléas », toujours rougesdans les romans américains, ont perdu leur couleur. Lefeuillage n’est pas « vert sombre » mais seulement« sombre » : le peintre préfère le clair-obscur aucontraste des couleurs. Les « gueules de four », la « braise »,la « lave » servent à dire la lumière et non la couleurcomme le montrent l’accumulation des adjectifs quirenvoient tous à une expérience de la lumière : « éclatant,radieux, doré, opulent, saturé de lumière », « lumière » venant clorele paragraphe et donner le thème directeur. De même, sila couleur s’estompe au profit de la lumière, ladescription retrouve une linéarité qui vient casser lesaplats francs de couleur, en larges taches sans limites ;Chateaubriand use d’expressions comme « des colonnescroissantes et des arabesques mobiles » ou « annelées » quiréinstallent la ligne et la beauté de la forme dans lepaysage, autant dire la raison. L’émotion se fait moinsvive et la description se vit moins comme une expériencepure que comme une méditation esthétique des formes etdes jeux de lumière. La religion de Chateaubriand, commeen témoigne sa peinture des paysages et ses choixpicturaux, a changé.
La transe poétique du jeune poète devant la forêtaméricaine rappelle cette phrase de Kandinsky : « la couleur
provoque donc une vibration psychique32 ». L’abondance descouleurs dans les descriptions provoquent donc chez lelecteur, mais aussi chez le poète, une ivresse, un étatd’esprit de fusion dans le Grand Tout, autant dire uneforme de panthéisme que Rousseau n’aurait pas renié etqui correspond encore plus précisément à cette religiondes Indiens. Il faut imaginer quelles pouvaient être lespensées religieuses de Chateaubriand avant sa conversion,avant qu’il devienne l’auteur du Génie et des Mémoiresd'outre-tombe et rien d’autre. Dans ses lettres, il n’a decesse de se nommer lui-même « sauvage » de s’identifier àRené, Chactas ou bien de rêver à Atala ou Céluta33. S’ilreste de culture chrétienne, son éloignement de l’Églisecatholique et son besoin inné de spiritualité trouventune possible expression dans cette littératurepanthéiste, primitiviste, qui chante la communion avec lanature où règnent l’émotion et la couleur. L’utilisationsauvage de la couleur révèle un choix esthétique, bienentendu, mais aussi un choix métaphysique etintellectuel ; cette prédilection pour ces grandes toilesviolemment colorées révèle non seulement la fougue etl’éblouissement d’un jeune auteur devant un monde nouveaumais révèle aussi un sentiment religieux nouveau,primitif qui va donner, dans cet état régénéré, naissanceà un nouveau sentiment en littérature, à une nouvelleesthétique qui définit ses propres canons. Dans LesNatchez, il l’a précisé dans la préface, tout se mêle, lareligion primitive et la religion révélée. Par lescouleurs, il opère une fusion des croyances, unsyncrétisme religieux et esthétique qui est proprementnouveau : « Ainsi donc, dans le premier volume des Natchez on trouverale merveilleux, et le merveilleux de toutes les espèces : le merveilleux chrétien ,le merveilleux mythologique, le merveilleux indien (Natchez, 163) … »La couleur permet d’écraser toutes les différences sousla puissance de leur force visuelle, ce que les teintesdouces et apaisées des Martyrs permirent mal. Le sentimentprimitif, teinté d’une forte dimension chrétienne quiannonce déjà son retour, use donc de la couleur, de laviolence d’une palette neuve pour s’exprimer.
L’Amérique et ses couleurs appartiennent à lajeunesse philosophique, esthétique et métaphysique del’auteur, une jeunesse rousseauiste, fauve et volontierspanthéiste. L’ivresse provoquée par l’exotisme radical duNouveau Monde, le sentiment absolu de « libertéprimitive » commande une pratique picturale novatrice etexpressive : le jeune peintre emploie une palette que peud’auteurs avant lui ont utilisée, une palette qui paraîtsurchargée à ses amis et à l’auteur lui-même quelquesannées plus tard. Les romans américains se situent à unmoment-clé de l’évolution de l’auteur, au moment même deson retour à la foi chrétienne, au moment où il quittel’habit du sauvage, plein de croyances panthéistes etd’idéaux politiques, pour adopter l’habit de l’hommeblanc, volontiers désabusé et profondément ancré dans uneculture aux dimensions de l’Histoire. L’expérienceaméricaine, si intense soit-elle, montre vite ses limiteset la nouvelle culture que Chateaubriand voudraitadopter, celle des sauvages, se heurte rapidement à sesconvictions métaphysiques les plus profondes, « cetterésignation stoïque à se fondre dans la nature, une nature qui pendant notrevie même semble pénétrer en nous et nous absorber dans son sein, révolteson amour de la vie et les habitudes sentimentales qu’il tient de sesancêtres34. » La couleur exprime cette fusion, cetteexpérience primitive qui correspond à la pensée indienne,une perte de l’individualité et du sentiment propre quis’oppose à ce qui fonde par excellence la penséeoccidentale. Chateaubriand, qui a baigné dans la cultureclassique, sent le besoin irrépressible d’y retourner.L’Angleterre, puis l’Italie, l’Europe, lui ouvrent ànouveau les portes de la culture. Il faut que la natureelle-même dise le passé, l’Histoire de l’Homme : illaisse ainsi les jardins du Nouveau Monde et leurscouleurs grandioses pour aller chercher les jardinshabités de l’Ancien Monde où joue la lumière35.
Le sacré primitif, édénique et arcadien du NouveauMonde cède la pas au sacré ancien, celui de la Chute etde la religion catholique, un sacré qu’il retrouve dans
32 Wassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier,(éd. de Beaune, 1954), p. 43.33 Cf. Chateaubriand, Correspondance générale 1789-1807, tome I, op.cit., lettres XXXI, XXXVI, XXXVII.
sa totalité à Rome et dans sa lumière : « Au sacré tout neuf,sauvage, illimité et euphorique du Nouveau Monde, se substitue le sacrésécrété goutte à goutte par le temps, les travaux et les souffrances historiquesde l’Ancien monde, résumé et concentré dans son nombril, Rome36. »Goethe pensait que « la couleur est la souffrance de lalumière » ; il faut alors remonter à cette sourcepremière, la lumière, et abandonner la palette coloréequi n’en est, de fait, qu’une expression seconde.
34 Gilbert Chinard, L’Exotisme américain dans l’œuvre de Chateaubriand,op. cit., p. 300.35 Cf. Chateaubriand, Correspondance générale, tome I, op. cit.,Lettre CCXLIII (1804), p. 307 : « Aujourd’hui je m’aperçoisque je suis beaucoup moins sensibles aux charmes de la nature,et je doute que la cataracte même de Niagara me causât la mêmeadmiration qu’autrefois. Quand on est très jeune, la naturemuette parle beaucoup, parce qu’il y a surabondance dans lecœur de l’homme ; tout son avenir est devant lui (si monAristarque veut me passer cette expression) ; il espèrereporter ses sensations au monde et se nourrit de millechimères ; mais dans un âge plus avancé, lorsque laperspective que nous avions devant nous passe derrière, quenous sommes détrompés sur une foule d’illusions, alors lanature seule devient plus froide et moins parlante, les jardinsparlent peu. Il faut pour qu’elle nous intéresse encore, qu’ils’y attache des souvenirs de la société, parce que nous noussuffisons moins à nous-mêmes ; la solitude absolue nouspèse… »36 Marc Fumaroli, Poésie et terreur, op. cit., p. 391.