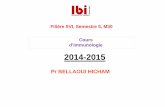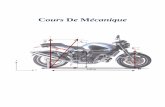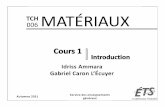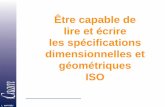MEC/ISEG PARIS/BFS1 -‐ C_AUSTRUY ISEG BUSINESS & FINANCE SCHOOL 1 ère ANNEE Christophe AUSTRUY...
Transcript of MEC/ISEG PARIS/BFS1 -‐ C_AUSTRUY ISEG BUSINESS & FINANCE SCHOOL 1 ère ANNEE Christophe AUSTRUY...
MEC/ISEG PARIS/BFS1 -‐ C_AUSTRUY
ISEG BUSINESS & FINANCE SCHOOL 1ère ANNEE Christophe AUSTRUY Semestre 2
§ COURS MACRO ECONOMIE CONTEMPORAINE § POWER POINT DU COURS
§ BFS 1 § ANNEE 2013 – 2014 § Attention ce power point ne remplace pas le cours et les explications qui y ont été données
§ Le programme détaillé des révisions a été donné en cours
§ (Le chapitre 1 est censé avoir été étudié au S1 et n’est pas au programme du partiel)
PLAN DU COURS Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 1/ Les origines de l’analyse économique 2/ Les grandes variables et représentations de l’économie Chapitre 2 : « La croissance » 1/ Définitions, méthodes et évolutions du calcul de la richesse produite 2/ Secteurs et branches en France : définitions, et structure de l’appareil productif 3/ Les modèles explicatifs de la croissance Chapitre 3 : « La consommation : un phénomène économique et social » 1/ De la consommation/destruction (biens durables/non durables) aux postes de consommation : alimentation/habillement/transports télécommunications/logement/loisirs 2/ La consommation en théories : prix relatifs, « filière inversée », modes de vie, « effet démonstration/imitation », etc. 3/ « Epargne résiduelle » (Keynes) contre « Epargne primordiale » (Néo-‐classiques). Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production et les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique : autoproduction, normes sociales, travail versus chômage (les mesures) 2/ Arbitrage travail/loisirs, chômage involontaire, K humain, insiders/outsiders, « segmentation intern/externe » 3/ Le travail & la population active : facteurs essentiels des cycles économiques (politique de lutte/formation/crises) Chapitre 5 : « Les revenus, les ménages, les entreprises et l’Etat » 1/ Revenus et leur diversité : primaire/secondaire, du travail, du capital, etc. 2/ La formation théorique des revenus : classique, néoclassique, marxiste et kéynésien 3/ Répartitions (partage de la VA/unité de consommation) et inégalités (dispersion/discrimination/fordisme) Chapitre 6 : « L’investissement » 1/ La conception générale : le pourquoi et le comment de l’investissement des entreprises 2/ L’investissement matériel et l’investissement immatériel : la classification comptable 3/ FBCF et flux d’investissements au cours des dernières années : la panne sèche. Chapitre 7 : « L’Etat, l’économie et la société » 1/ Les périmètres de l’Etat : intervention directe/indirecte, budgets et fiscalité 2/ Le débat théorique sur l’intervention de l’Etat : agir ou laisser faire Chapitre 9 : « La protection sociale » 1/ Acteurs, budgets et rôles des différents acteurs 2/ Les mécanismes de protection sociale dans les sociétés : histoire et repères
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 1/ Les origines de l’analyse économique Les pages qui suivent sont destinés à approfondir le cours qui a été donné sur ces thèmes et ne constitue pas l’ensemble des thèmes à retenir Seules les idées principales données en cours sont à retenir Tableau de synthèse de la notion de valeur (http://pdalzotto.fr/tag/co-‐creation/)
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 1/ Les origines de l’analyse économique Les auteurs grecs (Les pages qui suivent sont extraites du site http://ses.ens-‐lyon.fr/les-‐auteurs-‐29764.kjsp?RH=620) Du milieu du Ve siècle au IVe siècle avant J. C., dans la Grèce antique, le commerce de gros et de détail se développe dans la région contrôlée par Athènes et l'usage de la monnaie, du change et du crédit est déjà répandue. On frappe des monnaies d'or et de bronze. Le commerce maritime lointain est financé surtout par de riches citoyens. Il existe des accords bilatéraux d'échange de surplus de produits (vin contre blé) entre Athènes et quelques cités pour s'assurer d'avantages réciproques (Athènes doit importer au moins 50 % de son grain). Au IVe siècle avant J. C., des réflexions sur les questions économiques apparaissent chez les disciples de Socrate, avec les contributions de Xénophon, de Platon et d'Aristote. Les auteurs se situent dans la problématique de la Cité-‐Etat et proposent des normes de conduite à une minorité de citoyens dans une société où les esclaves assurent l'essentiel de la production des biens et où le travail se trouve méprisé. Xénophon (environ 428-‐354 av. J. C.), disciple de Socrate, est l'auteur de la première utilisation du vocable "Economique". Dans L'Economique (390 av. J. C.), il expose les règles d'une bonne gestion de la grande propriété foncière. Il affirme notamment : "Lorsque l'agriculture prospère, tous les autres arts fleurissent avec elle mais quand on abandonne la culture, par quelque cause que ce soit, tous les autres travaux, tant sur terre que sur mer, s'anéantissent en même temps". Dans la Cyropédie (environ 378-‐362 av. J. C.), Xénophon présente les avantages de la spécialisation des métiers qui améliore la qualité des produits dans la Cité. Dans Les revenus (355 av. J. C.), il se préoccupe plutôt d'accroître les recettes fiscales d'Athènes et d'assurer son ravitaillement en céréales.
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 1/ Les origines de l’analyse économique § Les auteurs grecs (Les pages qui suivent sont extraites du site http://ses.ens-‐lyon.fr/les-‐auteurs-‐29764.kjsp?
RH=620)
§ Platon (environ 427-‐347 av. J. C.), lui aussi disciple de Socrate, est l'auteur de La République (384-‐377 av. J. C.). Platon s'intéresse à l'organisation idéale et à la taille optimale de la Cité. La population de la Cité idéale est divisée en trois castes, les philosophes et magistrats (gardiens de la Loi), les guerriers (gardiens de la Cité), et les artisans. Les deux premières castes sont soumises à la communauté des femmes, des enfants et des biens. Platon s'approche de la thématique de la division du travail : "on produit toutes choses en plus grand nombre, mieux et plus facilement, lorsque chacun, selon ses aptitudes et dans le temps convenable, se livre à un seul travail, étant dispensé de tous les autres". Platon anticipe les principaux thèmes qui seront développés par
§ Aristote sur les questions économiques : méfiance vis-‐à-‐vis du commerce et mise en garde contre l'accumulation des richesses comme une fin en soi. Aristote (384-‐322 av. J. C.), disciple de Platon, expose ses réflexions sur les questions économiques dans l'Ethique à Nicomaque (335-‐332 av. J. C.) et dans La Politique (335-‐322 av. J. C.). Dans le texte intitulé Les Economiques et publié sous son nom, seule la première partie (qui rejoint des thèmes de la Politique) a pu lui être attribuée par certains spécialistes. "La chrématistique naturelle relève de l'économie domestique, tandis que le commerce est l'art de créer des richesses, non pas de toute façon, mais seulement par le moyen d'échange de biens" (Aristote : La Politique, traduction de Jules Tricot, Paris : J. Vrin, 1962, p. 60).
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 1/ Les origines de l’analyse économique § Les auteurs grecs (Les pages qui suivent sont extraites du site http://ses.ens-‐lyon.fr/les-‐auteurs-‐29764.kjsp?RH=620)
§ Extraits de La Politique : "Or que l'art d'acquérir des richesses ne soit pas identique à l'art d'administrer une maison, c'est là une chose évidente (en effet, le premier a pour objet de se procurer des ressources, et le second de les employer : quel pourrait être l'art de faire usage des ressources familiales si on ne veut pas que ce soit l'économie domestique ?). Quant à savoir si l'art d'acquérir les richesses est une branche de l'économie domestique, ou si c'est un art d'une espèce toute différente, le débat reste ouvert." (Aristote : La Politique, traduction de Jules Tricot, Paris : J. Vrin, 1962, p. 50). "Ainsi, il existe une espèce de l'art d'acquérir qui par nature est une branche de l'économie domestique, dans la mesure où celle-‐ci doit, ou bien avoir sous la main, ou bien procurer, de façon à les rendre disponibles, les richesses dont il est possible de constituer des approvisionnements, quand elles sont nécessaires à la vie et utiles à la communauté politique ou familiale " (Aristote : La Politique, traduction de Jules Tricot, Paris : J. Vrin, 1962, p. 54). "Mais il existe un autre genre de l'art d'acquérir qui est spécialement appelé, et appelé à bon droit, chrématistique ; c'est à ce mode d'acquisition qu'est due l'opinion qu'il n'y a aucune limite à la richesse et à la propriété" (Aristote : La Politique, traduction de Jules Tricot, Paris : J. Vrin, 1962, p. 55).
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 1/ Les origines de l’analyse économique § La Scolastique (Les pages qui suivent sont extraites du site http://ses.ens-‐lyon.fr/les-‐auteurs-‐29764.kjsp?RH=620)
§ A partir du XIe siècle, on constate en Europe un phénomène de croissance économique qui atteindra son apogée au milieu du XIIIe siècle. Grâce aux défrichements et à l'assolement triennal, les rendements agricoles augmentent. La production artisanale (textile, par exemple) augmente. Cet essor va de pair avec une croissance démographique (de 1000 à 1300, la population européenne serait passée approximativement de 40 à 70 millions. Certaines régions (Flandres, Italie du Nord) se développent et ont des effets d'entraînement sur la campagne. Des villes telles que Gênes, Venise, Florence, Gand ou Bruges deviennent prospères. En outre, entre les villages et les villes se multiplient les bourgs, sièges de l'administration, de la justice et du commerce (artisanat, marchés hebdomadaires, foires durant quelques semaines). Le commerce de gros à longue distance se développe non seulement grâce aux ports, mais aussi aux foires (Champagne). Peu à peu la société se monétarise et le crédit se développe à partir du XIIIe siècle : on prête aux paysans, aux ouvriers et aux artisans. Cette croissance extensive atteindra ses limites au XIVe siècle et l'Europe va connaître les famines, les guerres, et aussi la Peste noire qui décimera entre 30 et 40 % de la population (1348-‐1349).
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 1/ Les origines de l’analyse économique § La Scolastique (Les pages qui suivent sont extraites du site http://ses.ens-‐lyon.fr/les-‐auteurs-‐29764.kjsp?RH=620)
§ Entre le XIe et le XIIIe siècle, les débats sur les questions économiques sont animés par trois catégories d'intellectuels : les juristes de droit romain, qui vont, par exemple, assez vite reconnaître le caractère licite du prêt à intérêt ;
§ les scolastiques "canonistes", ou juristes de droit canon, qui construisent une législation à partir des décisions des conciles et des lettres pontificales, et en même temps rédigent des commentaires sur cette législation. Par exemple, le Decretum (Décret) du moine Gratien, publié à Bologne en 1140 et la Summa decretalium (écrite entre 1250 et 1261) d'Henri de Suse, connu sous le nom du cardinal Hostiensis [d'Ostie] (vers 1200-‐1271).
§ les scolastiques "théologiens". Au XIIIe siècle, apparaissent des théologiens importants, commentateurs de la pensée aristotélicienne, les dominicains Albert le Grand (1193-‐1280) et son élève Thomas d'Aquin (1225-‐1274).
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 1/ Les origines de l’analyse économique § La Scolastique (Les pages qui suivent sont extraites du site http://ses.ens-‐lyon.fr/les-‐auteurs-‐29764.kjsp?RH=620)
§ A l'encontre de la tradition augustinienne, fondée exclusivement sur la foi, va s'engager une entreprise de construction d'un savoir unifié qui concilie la foi et la raison et dont les fondements sont empruntés en grande partie à la pensée d'Aristote. Si durant la seconde moitié du XIIe siècle, les idées d'Aristote commencent à être diffusées auprès des intellectuels occidentaux par l'intermédiaire de commentateurs arabes tels qu'Averroès (1126-‐1198), la grande vague de diffusion de sa pensée apparaît au XIIIe siècle. Ainsi, Guillaume de Moerbeke (1215-‐1286) de l'ordre des dominicains, va-‐t-‐il traduire en latin plus d'une quinzaine d'écrits d'Aristote, dont La Politique et l'Ethique à Nicomaque, traductions, certes, interprétatives. Les premières traductions françaises, à partir des versions latines, des principales oeuvres d'Aristote n'apparaîtront qu'au XIVe siècle (voir infra Nicolas Oresme).
§ Entre le XIIe et le XIIIe siècle, la pensée des théologiens connaît un essor important en Occident, à partir de foyers tels que Paris et Bologne. Toutefois, l'Eglise catholique était au départ très réticente à la diffusion de la philosophie grecque dans les universités qui se trouvaient sous son contrôle. Ces interdictions seront progressivement levées durant la première moitié du XIIIe siècle. Thomas d'Aquin va s'efforcer de concilier le dogme catholique avec la philosophie d'Aristote. Au XIVe siècle, il se produit une scission dans la pensée scolastique, à la suite de la célèbre querelle dite des "Universaux".
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 1/ Les origines de l’analyse économique La Scolastique (Les pages qui suivent sont extraites du site http://ses.ens-‐lyon.fr/les-‐auteurs-‐29764.kjsp?RH=620) § Ceux qui entendent poursuivre strictement l'enseignement de Thomas d'Aquin estiment
que la science, la raison, est liée complètement à la foi. La science traite donc du général, de l'universel. Par exemple, il est possible de découvrir les preuves de l'existence de Dieu par la raison. Les thomistes ont une confiance absolue en la raison ; en même temps, ils défendent l'union du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, fondement du système féodal. Ceux qui défendent la ligne nominaliste de Guillaume d'Ockham ne pensent pas de la même façon. Guillaume d'Ockham (1280-‐90-‐1350), théologien franciscain d'Oxford, veut séparer radicalement le domaine de la foi, de l'universel, de l'essence, et le domaine de la raison, de la science, de la philosophie. Pour lui, l'universel, le général reste impénétrable à la connaissance. Seul le particulier peut être appréhendé au moyen de la connaissance sensible ou expérimentale. Guillaume d'Ockham va remettre en cause l'infaillibilité du pape dans les questions non strictement religieuses et même le pouvoir temporel de l'Eglise.
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 1/ Les origines de l’analyse économique (Encyclopedia Universalis)
ÉCONOMIE Histoire de la pensée économique - Les grands courants
Article écrit par Jérôme de BOYER
Prise de vue
L'économie est une discipline jeune. En faisant abstraction des mentions du juste prix, de la monnaie oude l'usure qu'on rencontre dans la Bible, chez Aristote ou saint Thomas d'Aquin, on peut considérer que lespremiers écrits économiques datent du XVIe siècle, avec les mercantilistes. Au XVIIIe siècle, l'économie estrevendiquée en tant que science nouvelle par l'école physiocratique, qui, en France, regroupe les premierslibéraux. Les classiques la désignent par « économie politique » et le terme de science économique,aujourd'hui communément employé pour qualifier cette discipline, apparaît à la fin du XIXe siècle, sous laplume des marginalistes.
Les intuitions fortes, les hypothèses de travail, les idées directrices des économistes ont donc été forgéesau cours des quatre siècles derniers. L'histoire de la pensée économique est ainsi relativement courte. Cettehistoire révèle l'existence de courants de pensée qui diffèrent à la fois sur la place qu'ils accordent à telle outelle question (la monnaie, la valeur, les inégalités sociales, l'équilibre, l'emploi, le revenu, la finance,l'information...) et sur les réponses qu'ils apportent. Certains courants, tels que le mercantilisme ou laphysiocratie, ont quasi disparu. D'autres, qui ont été dominants, telle l'école classique, ou très influents,comme le marxisme, sont aujourd'hui marginalisés. Quant à l'école néo-classique, qui a supplanté à la fin duXIXe siècle l'école classique, elle abrite des approches divergentes.
I- L'émergence du libéralisme
Les premiers économistes ne sont pas libéraux. Ceux qu'on désigne par le terme « mercantilistes »prônent l'intervention de l'État et l'activisme monétaire. C'est en réaction et comme alternative aumercantilisme que la pensée libérale naît au XVIIIe siècle. En France, notamment, ce mouvement apparaîtsous la plume des physiocrates.
Le mercantilisme
Le mercantilisme recouvre un ensemble de doctrines et de pratiques politiques et économiques quis'étend du milieu du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle, qui sépare la Renaissance de la révolutionindustrielle, et qui a accompagné la formation et la consolidation des États modernes d'Europe. Jean Bodin(1576, De la République ; 1578, La Response de maistre Jean Bodin... paradoxe de Monsieur de Malestroict),Antoine de Montchrestien (1615, Traité de l'oeconomie politique), Sébastien Vauban (1707, Projet d'une dîme
royale) ou John Law (1704, Essay on a Land Bank ; 1705, Considérations sur la monnaie et le commerce) enFrance, Martin de Azpilcueta (1556, Comentario resolutorio de usuras) ou Tomas de Mercado (1568, Summa
de tratos y contretatos de mercaderes) en Espagne, Bernardo Davanzati (1588, Lezione delle monete) ouGeminiano Montanari (1683, Della moneta) en Italie, William Potter (1650, The Key of Wealth), John Locke(1691, Some Consequences of the Lowering of Interest and Raising the Value of Money), Dudley North (1691,Discourses upon Trade) ou Josiah Child (1693, Traité sur le commerce et sur l'intérêt de l'argent) enAngleterre sont des figures emblématiques de ce courant. Mentionnons également Thomas Gresham(1519-1578), grand financier de la couronne britannique, qui fonda la Bourse de Londres en 1566-1568, etJean-Baptiste Colbert (1619-1683), ministre des Finances de Louis XIV, qui encouragea en 1664 la créationde manufactures d'État, de manufactures privées et de grandes compagnies commerciales sur le modèlehollandais de sociétés par actions, et qui créa la Caisse des emprunts en 1674.
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 1/ Les origines de l’analyse économique
La pensée mercantiliste est loin de former un ensemble homogène et cohérent. Néanmoins un certainnombre de thèmes rassemblent ces auteurs. D'abord, la puissance de l'État résulte de (et favorise)l'enrichissement de la nation et de ses sujets ; ensuite, l'enrichissement est obtenu par le développement del'industrie et du commerce qui doivent se traduire par un excédent commercial et, en conséquence, par uneaccumulation de métaux précieux ; enfin, la création de colonies et de comptoirs de commerce, la protectiondes industries et des marchés extérieurs, ainsi que les innovations financières telles que l'institution debourses et de banques sont les outils de cette politique. Le mercantilisme prône donc la puissance militairede l'État, son intervention dans l'économie, la réforme fiscale, le contrôle des prix et les protectionsdouanières, les monopoles et l'activisme monétaire.
Le libéralisme s'est constitué en opposition à ces conceptions. Le terme « système mercantile » apparaîtd'ailleurs en 1776, sous la plume d'Adam Smith, qui qualifie ainsi la pensée économique qui précède lapensée libérale.
La physiocratie
Au XVIIIe siècle, en France, l'agriculture est fragilisée par la politique colbertiste de bas prix des biensagricoles, l'État est incapable de prélever l'impôt et de limiter son endettement et on garde le souvenir de labanqueroute du système de Law en 1720. C'est dans ce contexte que la pensée libérale s'est forgée, au seinde l'école physiocratique menée par François Quesnay (1756-1757, articles de l'Encyclopédie : « Fermiers »,« Grains », « Hommes », « Impôts » ; 1766, Analyse de la formule arithmétique du Tableau économique),médecin du roi. Influencés par l'analyse du marché de Pierre de Boisguillebert (1695, Le Détail de la France ;1707, Factum de la France) et l'analyse du circuit de Richard Cantillon (1730, Essai sur la nature ducommerce en général), les écrits des physiocrates s'étalent sur seize années, de 1756 à 1772.
Quesnay construit un Tableau économique qui décrit dans quelles proportions le revenu doit êtredépensé pour assurer la circulation de toute la richesse produite, en même temps que le renouvellement ducapital nécessaire à la pérennité de cette production. Les enseignements du tableau sont multiples. Enpremier lieu, il faut stabiliser le prix des grains à un niveau satisfaisant. Il faut que le prix de la productionagricole soit suffisant pour permettre au fermier de payer la rente et d'acheter à l'industrie les outilsnécessaires à son activité, tout en conservant assez de biens agricoles pour sa propre consommation et pourle renouvellement de son cheptel et de ses semences. Il faut aussi éviter l'alternance de périodes marquéespar un antagonisme entre, d'une part, les fermiers, qui profitent de prix élevés et ne peuvent résister à desprix trop bas, et, d'autre part, les consommateurs et les rentiers, dont les revenus ne sont pas indexés surles prix.
Tableau économique de François Quesnay
Première représentation abstraite d'un circuitmacroéconomique, le tableau décrit, à partir de cinqflux d'échange entre trois pôles (classe despropriétaires, classe productive, classe stérile), lacirculation de la richesse nécessaire à lareproduction des conditions de laproduction.(Encyclopaedia Universalis)
Le deuxième enseignement est qu'il est nécessaire d'élargir le marché des grains afin qu'il puisseabsorber les surplus de production des années de bonne récolte, au lieu d'assister à une baisse des prixexcessive, et alimenter le pays les années de mauvaise récolte, ce qui permet d'éviter disette et hausseexcessive des prix. Bref, ouvrir le marché aux exportations et aux importations.
Le troisième enseignement est que la dépense doit être maîtrisée et que l'impôt ne doit être payé quepar les propriétaires fonciers qui vivent de la rente. Car l'impôt ne peut être prélevé que sur le revenu ; or,dans le tableau de Quesnay, la rente est l'unique revenu. Anne Robert Jacques Turgot, contrôleur général desFinances de 1774 à 1776, échouera dans la mise en œuvre d'une politique libérale inspirée de ces principes.
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
La pensée mercantiliste est loin de former un ensemble homogène et cohérent. Néanmoins un certainnombre de thèmes rassemblent ces auteurs. D'abord, la puissance de l'État résulte de (et favorise)l'enrichissement de la nation et de ses sujets ; ensuite, l'enrichissement est obtenu par le développement del'industrie et du commerce qui doivent se traduire par un excédent commercial et, en conséquence, par uneaccumulation de métaux précieux ; enfin, la création de colonies et de comptoirs de commerce, la protectiondes industries et des marchés extérieurs, ainsi que les innovations financières telles que l'institution debourses et de banques sont les outils de cette politique. Le mercantilisme prône donc la puissance militairede l'État, son intervention dans l'économie, la réforme fiscale, le contrôle des prix et les protectionsdouanières, les monopoles et l'activisme monétaire.
Le libéralisme s'est constitué en opposition à ces conceptions. Le terme « système mercantile » apparaîtd'ailleurs en 1776, sous la plume d'Adam Smith, qui qualifie ainsi la pensée économique qui précède lapensée libérale.
La physiocratie
Au XVIIIe siècle, en France, l'agriculture est fragilisée par la politique colbertiste de bas prix des biensagricoles, l'État est incapable de prélever l'impôt et de limiter son endettement et on garde le souvenir de labanqueroute du système de Law en 1720. C'est dans ce contexte que la pensée libérale s'est forgée, au seinde l'école physiocratique menée par François Quesnay (1756-1757, articles de l'Encyclopédie : « Fermiers »,« Grains », « Hommes », « Impôts » ; 1766, Analyse de la formule arithmétique du Tableau économique),médecin du roi. Influencés par l'analyse du marché de Pierre de Boisguillebert (1695, Le Détail de la France ;1707, Factum de la France) et l'analyse du circuit de Richard Cantillon (1730, Essai sur la nature ducommerce en général), les écrits des physiocrates s'étalent sur seize années, de 1756 à 1772.
Quesnay construit un Tableau économique qui décrit dans quelles proportions le revenu doit êtredépensé pour assurer la circulation de toute la richesse produite, en même temps que le renouvellement ducapital nécessaire à la pérennité de cette production. Les enseignements du tableau sont multiples. Enpremier lieu, il faut stabiliser le prix des grains à un niveau satisfaisant. Il faut que le prix de la productionagricole soit suffisant pour permettre au fermier de payer la rente et d'acheter à l'industrie les outilsnécessaires à son activité, tout en conservant assez de biens agricoles pour sa propre consommation et pourle renouvellement de son cheptel et de ses semences. Il faut aussi éviter l'alternance de périodes marquéespar un antagonisme entre, d'une part, les fermiers, qui profitent de prix élevés et ne peuvent résister à desprix trop bas, et, d'autre part, les consommateurs et les rentiers, dont les revenus ne sont pas indexés surles prix.
Tableau économique de François Quesnay
Première représentation abstraite d'un circuitmacroéconomique, le tableau décrit, à partir de cinqflux d'échange entre trois pôles (classe despropriétaires, classe productive, classe stérile), lacirculation de la richesse nécessaire à lareproduction des conditions de laproduction.(Encyclopaedia Universalis)
Le deuxième enseignement est qu'il est nécessaire d'élargir le marché des grains afin qu'il puisseabsorber les surplus de production des années de bonne récolte, au lieu d'assister à une baisse des prixexcessive, et alimenter le pays les années de mauvaise récolte, ce qui permet d'éviter disette et hausseexcessive des prix. Bref, ouvrir le marché aux exportations et aux importations.
Le troisième enseignement est que la dépense doit être maîtrisée et que l'impôt ne doit être payé quepar les propriétaires fonciers qui vivent de la rente. Car l'impôt ne peut être prélevé que sur le revenu ; or,dans le tableau de Quesnay, la rente est l'unique revenu. Anne Robert Jacques Turgot, contrôleur général desFinances de 1774 à 1776, échouera dans la mise en œuvre d'une politique libérale inspirée de ces principes.
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
La pensée mercantiliste est loin de former un ensemble homogène et cohérent. Néanmoins un certainnombre de thèmes rassemblent ces auteurs. D'abord, la puissance de l'État résulte de (et favorise)l'enrichissement de la nation et de ses sujets ; ensuite, l'enrichissement est obtenu par le développement del'industrie et du commerce qui doivent se traduire par un excédent commercial et, en conséquence, par uneaccumulation de métaux précieux ; enfin, la création de colonies et de comptoirs de commerce, la protectiondes industries et des marchés extérieurs, ainsi que les innovations financières telles que l'institution debourses et de banques sont les outils de cette politique. Le mercantilisme prône donc la puissance militairede l'État, son intervention dans l'économie, la réforme fiscale, le contrôle des prix et les protectionsdouanières, les monopoles et l'activisme monétaire.
Le libéralisme s'est constitué en opposition à ces conceptions. Le terme « système mercantile » apparaîtd'ailleurs en 1776, sous la plume d'Adam Smith, qui qualifie ainsi la pensée économique qui précède lapensée libérale.
La physiocratie
Au XVIIIe siècle, en France, l'agriculture est fragilisée par la politique colbertiste de bas prix des biensagricoles, l'État est incapable de prélever l'impôt et de limiter son endettement et on garde le souvenir de labanqueroute du système de Law en 1720. C'est dans ce contexte que la pensée libérale s'est forgée, au seinde l'école physiocratique menée par François Quesnay (1756-1757, articles de l'Encyclopédie : « Fermiers »,« Grains », « Hommes », « Impôts » ; 1766, Analyse de la formule arithmétique du Tableau économique),médecin du roi. Influencés par l'analyse du marché de Pierre de Boisguillebert (1695, Le Détail de la France ;1707, Factum de la France) et l'analyse du circuit de Richard Cantillon (1730, Essai sur la nature ducommerce en général), les écrits des physiocrates s'étalent sur seize années, de 1756 à 1772.
Quesnay construit un Tableau économique qui décrit dans quelles proportions le revenu doit êtredépensé pour assurer la circulation de toute la richesse produite, en même temps que le renouvellement ducapital nécessaire à la pérennité de cette production. Les enseignements du tableau sont multiples. Enpremier lieu, il faut stabiliser le prix des grains à un niveau satisfaisant. Il faut que le prix de la productionagricole soit suffisant pour permettre au fermier de payer la rente et d'acheter à l'industrie les outilsnécessaires à son activité, tout en conservant assez de biens agricoles pour sa propre consommation et pourle renouvellement de son cheptel et de ses semences. Il faut aussi éviter l'alternance de périodes marquéespar un antagonisme entre, d'une part, les fermiers, qui profitent de prix élevés et ne peuvent résister à desprix trop bas, et, d'autre part, les consommateurs et les rentiers, dont les revenus ne sont pas indexés surles prix.
Tableau économique de François Quesnay
Première représentation abstraite d'un circuitmacroéconomique, le tableau décrit, à partir de cinqflux d'échange entre trois pôles (classe despropriétaires, classe productive, classe stérile), lacirculation de la richesse nécessaire à lareproduction des conditions de laproduction.(Encyclopaedia Universalis)
Le deuxième enseignement est qu'il est nécessaire d'élargir le marché des grains afin qu'il puisseabsorber les surplus de production des années de bonne récolte, au lieu d'assister à une baisse des prixexcessive, et alimenter le pays les années de mauvaise récolte, ce qui permet d'éviter disette et hausseexcessive des prix. Bref, ouvrir le marché aux exportations et aux importations.
Le troisième enseignement est que la dépense doit être maîtrisée et que l'impôt ne doit être payé quepar les propriétaires fonciers qui vivent de la rente. Car l'impôt ne peut être prélevé que sur le revenu ; or,dans le tableau de Quesnay, la rente est l'unique revenu. Anne Robert Jacques Turgot, contrôleur général desFinances de 1774 à 1776, échouera dans la mise en œuvre d'une politique libérale inspirée de ces principes.
Au niveau analytique, la thèse physiocratique présente trois caractéristiques qui contribuèrent à sondéclin accéléré : en premier lieu, elle postulait que seule l'agriculture était productive, à l'exclusion del'industrie, avec pour corollaire l'idée que seule la rente, et non le profit, était un revenu net ; en second lieu,elle ne développait aucune théorie de la valeur et des prix à l'appui de ces idées ; enfin, elle n'offrait pasd'analyse monétaire. À cet égard, Turgot (1766, Réflexions sur la formation et la distribution des richesses ;1769, Valeurs et monnaies), influencé également par Ferdinando Galiani (1751, De la monnaie ; 1770,Dialogues sur le commerce des blés), Vincent de Gournay (1758, Considérations sur le commerce) et laphilosophie sensualiste d'Étienne Bonnot de Condillac (1776, Le Commerce et le gouvernement), sedémarquait des physiocrates et esquissa une théorie de la valeur-utilité et du marchandage ; mais celles-cine déboucheront qu'un siècle plus tard. À la fin du XVIIIe siècle, c'est la théorie britannique de la valeurtravail qui allait s'imposer.
II- Les classiques
La parution en 1776 de l'Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations d'Adam Smith (le« père de l'économie politique ») marque le début de l'école classique qui allait dominer la penséeéconomique durant un siècle. Pour Smith, la nature de la richesse est réelle ; la monnaie n'est que le moyende sa circulation : la richesse se compose des marchandises tant industrielles qu'agricoles, qui sont produitespar le travail. Le travail étant la source de la valeur, il constitue l'unité de mesure dans les échanges :l'échange des marchandises est réglé par la proportion des quantités de travail que leur productionnécessite. La cause de la richesse réside dans la division du travail qui décuple la force productive dutravail ; division du travail qui prend de l'ampleur avec les échanges, l'épargne et l'investissement descapitaux dans l'agriculture, l'industrie, le commerce ou la banque. Smith élabore un ensemble cohérentd'analyses qui structurera les débats au sein de l'école classique : ceux-ci porteront, d'une part, dans lesannées 1815-1820 sur la valeur, la répartition et la croissance ; d'autre part, dans les années 1801-1811,puis 1836-1848, sur la monnaie et le crédit.
Valeur, répartition et croissance
La valeur fournit le centre de gravitation des mouvements du prix de marché sous l'effet des forces del'offre et de la demande. Si la demande est égale à l'offre, le prix de marché coïncide avec la valeur : lavente de la marchandise permet au producteur à la fois de récupérer les coûts en matières premières et dedistribuer aux salariés, capitalistes et rentiers les salaires, profits et rentes à leur niveau naturel. Si lademande augmente et excède l'offre, le prix de marché augmente et s'établit à un niveau supérieur à lavaleur. Dans ce cas, le producteur réalise un profit plus élevé qui l'incite à accroître sa production. Au fur et àmesure qu'il ajuste ainsi l'offre sur la demande, le prix de marché redescend au niveau de la valeur.Réciproquement, si la demande est inférieure à l'offre, le prix de marché diminue, s'inscrit au-dessous de lavaleur et génère des pertes qui incitent le producteur à baisser la production. Le prix remonte et s'ajuste surla valeur au fur et à mesure que l'offre s'ajuste sur la demande. C'est ainsi que la valeur, qui estindépendante du jeu de l'offre et de la demande, sert de point d'ancrage aux prix. En conséquence, l'utilitéet la demande n'ont d'effet sur le prix qu'à court terme. À long terme, le prix s'ajuste sur la valeur qui, elle,est indépendante de l'utilité. L'utilité joue néanmoins un rôle dans la mesure où elle oriente la demande etdonc les quantités produites.
À partir de cette base commune, les classiques vont évoluer sur l'analyse de la valeur, et diverger surcelles de la croissance et de la monnaie. Concernant la valeur, un consensus se dégage autour de l'analysede David Ricardo (1817, Principes de l'économie politique et de l'impôt) qui met en évidence que la valeurn'est pas fonction de la seule quantité de travail dépensée à la production, mais également du montant descapitaux engagés, de la règle d'uniformité du taux de profit et du rapport salaire/profit. Complétée parRobert Torrens (1821, An Essay on the Production of Wealth), cette analyse est approfondie, bien plus tard,par Piero Sraffa (1960, Production de marchandises par des marchandises). Karl Marx reprochera à l'analysericardienne de la valeur d'occulter la nature du profit. Les néo-classiques la rejetteront.
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
Au niveau analytique, la thèse physiocratique présente trois caractéristiques qui contribuèrent à sondéclin accéléré : en premier lieu, elle postulait que seule l'agriculture était productive, à l'exclusion del'industrie, avec pour corollaire l'idée que seule la rente, et non le profit, était un revenu net ; en second lieu,elle ne développait aucune théorie de la valeur et des prix à l'appui de ces idées ; enfin, elle n'offrait pasd'analyse monétaire. À cet égard, Turgot (1766, Réflexions sur la formation et la distribution des richesses ;1769, Valeurs et monnaies), influencé également par Ferdinando Galiani (1751, De la monnaie ; 1770,Dialogues sur le commerce des blés), Vincent de Gournay (1758, Considérations sur le commerce) et laphilosophie sensualiste d'Étienne Bonnot de Condillac (1776, Le Commerce et le gouvernement), sedémarquait des physiocrates et esquissa une théorie de la valeur-utilité et du marchandage ; mais celles-cine déboucheront qu'un siècle plus tard. À la fin du XVIIIe siècle, c'est la théorie britannique de la valeurtravail qui allait s'imposer.
II- Les classiques
La parution en 1776 de l'Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations d'Adam Smith (le« père de l'économie politique ») marque le début de l'école classique qui allait dominer la penséeéconomique durant un siècle. Pour Smith, la nature de la richesse est réelle ; la monnaie n'est que le moyende sa circulation : la richesse se compose des marchandises tant industrielles qu'agricoles, qui sont produitespar le travail. Le travail étant la source de la valeur, il constitue l'unité de mesure dans les échanges :l'échange des marchandises est réglé par la proportion des quantités de travail que leur productionnécessite. La cause de la richesse réside dans la division du travail qui décuple la force productive dutravail ; division du travail qui prend de l'ampleur avec les échanges, l'épargne et l'investissement descapitaux dans l'agriculture, l'industrie, le commerce ou la banque. Smith élabore un ensemble cohérentd'analyses qui structurera les débats au sein de l'école classique : ceux-ci porteront, d'une part, dans lesannées 1815-1820 sur la valeur, la répartition et la croissance ; d'autre part, dans les années 1801-1811,puis 1836-1848, sur la monnaie et le crédit.
Valeur, répartition et croissance
La valeur fournit le centre de gravitation des mouvements du prix de marché sous l'effet des forces del'offre et de la demande. Si la demande est égale à l'offre, le prix de marché coïncide avec la valeur : lavente de la marchandise permet au producteur à la fois de récupérer les coûts en matières premières et dedistribuer aux salariés, capitalistes et rentiers les salaires, profits et rentes à leur niveau naturel. Si lademande augmente et excède l'offre, le prix de marché augmente et s'établit à un niveau supérieur à lavaleur. Dans ce cas, le producteur réalise un profit plus élevé qui l'incite à accroître sa production. Au fur et àmesure qu'il ajuste ainsi l'offre sur la demande, le prix de marché redescend au niveau de la valeur.Réciproquement, si la demande est inférieure à l'offre, le prix de marché diminue, s'inscrit au-dessous de lavaleur et génère des pertes qui incitent le producteur à baisser la production. Le prix remonte et s'ajuste surla valeur au fur et à mesure que l'offre s'ajuste sur la demande. C'est ainsi que la valeur, qui estindépendante du jeu de l'offre et de la demande, sert de point d'ancrage aux prix. En conséquence, l'utilitéet la demande n'ont d'effet sur le prix qu'à court terme. À long terme, le prix s'ajuste sur la valeur qui, elle,est indépendante de l'utilité. L'utilité joue néanmoins un rôle dans la mesure où elle oriente la demande etdonc les quantités produites.
À partir de cette base commune, les classiques vont évoluer sur l'analyse de la valeur, et diverger surcelles de la croissance et de la monnaie. Concernant la valeur, un consensus se dégage autour de l'analysede David Ricardo (1817, Principes de l'économie politique et de l'impôt) qui met en évidence que la valeurn'est pas fonction de la seule quantité de travail dépensée à la production, mais également du montant descapitaux engagés, de la règle d'uniformité du taux de profit et du rapport salaire/profit. Complétée parRobert Torrens (1821, An Essay on the Production of Wealth), cette analyse est approfondie, bien plus tard,par Piero Sraffa (1960, Production de marchandises par des marchandises). Karl Marx reprochera à l'analysericardienne de la valeur d'occulter la nature du profit. Les néo-classiques la rejetteront.
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
Au niveau analytique, la thèse physiocratique présente trois caractéristiques qui contribuèrent à sondéclin accéléré : en premier lieu, elle postulait que seule l'agriculture était productive, à l'exclusion del'industrie, avec pour corollaire l'idée que seule la rente, et non le profit, était un revenu net ; en second lieu,elle ne développait aucune théorie de la valeur et des prix à l'appui de ces idées ; enfin, elle n'offrait pasd'analyse monétaire. À cet égard, Turgot (1766, Réflexions sur la formation et la distribution des richesses ;1769, Valeurs et monnaies), influencé également par Ferdinando Galiani (1751, De la monnaie ; 1770,Dialogues sur le commerce des blés), Vincent de Gournay (1758, Considérations sur le commerce) et laphilosophie sensualiste d'Étienne Bonnot de Condillac (1776, Le Commerce et le gouvernement), sedémarquait des physiocrates et esquissa une théorie de la valeur-utilité et du marchandage ; mais celles-cine déboucheront qu'un siècle plus tard. À la fin du XVIIIe siècle, c'est la théorie britannique de la valeurtravail qui allait s'imposer.
II- Les classiques
La parution en 1776 de l'Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations d'Adam Smith (le« père de l'économie politique ») marque le début de l'école classique qui allait dominer la penséeéconomique durant un siècle. Pour Smith, la nature de la richesse est réelle ; la monnaie n'est que le moyende sa circulation : la richesse se compose des marchandises tant industrielles qu'agricoles, qui sont produitespar le travail. Le travail étant la source de la valeur, il constitue l'unité de mesure dans les échanges :l'échange des marchandises est réglé par la proportion des quantités de travail que leur productionnécessite. La cause de la richesse réside dans la division du travail qui décuple la force productive dutravail ; division du travail qui prend de l'ampleur avec les échanges, l'épargne et l'investissement descapitaux dans l'agriculture, l'industrie, le commerce ou la banque. Smith élabore un ensemble cohérentd'analyses qui structurera les débats au sein de l'école classique : ceux-ci porteront, d'une part, dans lesannées 1815-1820 sur la valeur, la répartition et la croissance ; d'autre part, dans les années 1801-1811,puis 1836-1848, sur la monnaie et le crédit.
Valeur, répartition et croissance
La valeur fournit le centre de gravitation des mouvements du prix de marché sous l'effet des forces del'offre et de la demande. Si la demande est égale à l'offre, le prix de marché coïncide avec la valeur : lavente de la marchandise permet au producteur à la fois de récupérer les coûts en matières premières et dedistribuer aux salariés, capitalistes et rentiers les salaires, profits et rentes à leur niveau naturel. Si lademande augmente et excède l'offre, le prix de marché augmente et s'établit à un niveau supérieur à lavaleur. Dans ce cas, le producteur réalise un profit plus élevé qui l'incite à accroître sa production. Au fur et àmesure qu'il ajuste ainsi l'offre sur la demande, le prix de marché redescend au niveau de la valeur.Réciproquement, si la demande est inférieure à l'offre, le prix de marché diminue, s'inscrit au-dessous de lavaleur et génère des pertes qui incitent le producteur à baisser la production. Le prix remonte et s'ajuste surla valeur au fur et à mesure que l'offre s'ajuste sur la demande. C'est ainsi que la valeur, qui estindépendante du jeu de l'offre et de la demande, sert de point d'ancrage aux prix. En conséquence, l'utilitéet la demande n'ont d'effet sur le prix qu'à court terme. À long terme, le prix s'ajuste sur la valeur qui, elle,est indépendante de l'utilité. L'utilité joue néanmoins un rôle dans la mesure où elle oriente la demande etdonc les quantités produites.
À partir de cette base commune, les classiques vont évoluer sur l'analyse de la valeur, et diverger surcelles de la croissance et de la monnaie. Concernant la valeur, un consensus se dégage autour de l'analysede David Ricardo (1817, Principes de l'économie politique et de l'impôt) qui met en évidence que la valeurn'est pas fonction de la seule quantité de travail dépensée à la production, mais également du montant descapitaux engagés, de la règle d'uniformité du taux de profit et du rapport salaire/profit. Complétée parRobert Torrens (1821, An Essay on the Production of Wealth), cette analyse est approfondie, bien plus tard,par Piero Sraffa (1960, Production de marchandises par des marchandises). Karl Marx reprochera à l'analysericardienne de la valeur d'occulter la nature du profit. Les néo-classiques la rejetteront.
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
David Ricardo
David Ricardo (1772-1823). Économiste anglais,éminent représentant de l'école classique, auteur desPrincipes de l'économie politique et de l'impôt(1817). Son adhésion au principe de population deRobert Malthus et son analyse du salaire naturel(salaire de subsistance des travailleurs) l'amènent àsouligner les limites de l'accumulation du capital et àprévoir un «état stationnaire».(AKG)
L'analyse de la demande et de la croissance divise les classiques. Pour Smith, Jean-Baptiste Say (1803,Traité d'économie politique) et Ricardo, la demande peut différer de l'offre sur les différents marchés, maisau niveau global, la demande résulte du revenu. Qu'il soit consommé ou investi, le revenu est lui-même égalà la valeur de la production, donc de l'offre : ainsi « l'offre crée la demande ». Pour Jean Charles LéonardSismonde de Sismondi (1803, De la richesse commerciale ; 1819, Nouveaux Principes d'économie politique)ou Robert Malthus (1820, Principes d'économie politique), au contraire, une mauvaise répartition du revenuou une mauvaise gestion de la dépense publique et de l'impôt, trop favorables à l'épargne, peuvent setraduire par un déficit global de la demande, avec pour effet de faire baisser les prix et de compromettre lacroissance. Selon Smith, les obstacles à la croissance résident du côté de l'investissement. En effet, lacroissance du revenu nécessite une accumulation du capital. Or cette dernière exacerbe la concurrence, quiengendre la baisse du taux de profit, laquelle provoque la baisse de l'investissement. Pessimiste, le père del'économie politique explique ainsi la tendance des capitalistes et des entrepreneurs à entraver laconcurrence. Ricardo pense que le risque de stagnation réside moins dans le mobile de l'investissement, àsavoir la profitabilité, que dans le pouvoir d'accumulation des capitalistes (leur épargne) qui diminue enmême temps que le taux de profit. Or la croissance nécessite la mise en culture de terres moins fertiles, cequi renchérit le prix des biens agricoles. Ceux-ci constituant la composante essentielle des biens deconsommation ouvrière, il en résulte une hausse du taux de salaire qui provoque la baisse du taux de profit.Pour éviter ce scénario et faire baisser le prix du blé, Ricardo plaide pour qu'on puisse l'importer, au granddam de Malthus qui craint l'effet dépressif sur la demande qu'entraînerait la baisse de la rente despropriétaires fonciers. L'abolition, en 1846, des Corn Laws rejoint la vision ricardienne qui s'imposa tout aulong du XIXe siècle, et au-delà, jusqu'à la « révolution » provoquée par John Maynard Keynes.
En outre, les classiques convergent sur les mérites du développement du commerce international,moteur d'une division internationale du travail. Selon Smith, chaque pays se spécialise dans la productiondes biens pour lesquels il dispose des coûts de production les plus faibles (théorie de l'avantage absolu).Ricardo approfondit l'analyse en montrant que le commerce peut également être avantageux entre deuxpays même si l'un des deux dispose de coûts de production plus faibles pour tous les biens (théorie del'avantage relatif). Ainsi, si l'Angleterre a besoin de douze heures et de dix heures pour produirerespectivement le vin et le drap, alors qu'il faut respectivement huit heures et neuf heures au Portugal, lesdeux pays ont intérêt à se spécialiser, l'Angleterre dans la production du drap et le Portugal dans celle duvin, et à échanger leurs produits. Au total, la richesse produite et disponible pour chaque pays seraaugmentée.
La politique monétaire
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
David Ricardo
David Ricardo (1772-1823). Économiste anglais,éminent représentant de l'école classique, auteur desPrincipes de l'économie politique et de l'impôt(1817). Son adhésion au principe de population deRobert Malthus et son analyse du salaire naturel(salaire de subsistance des travailleurs) l'amènent àsouligner les limites de l'accumulation du capital et àprévoir un «état stationnaire».(AKG)
L'analyse de la demande et de la croissance divise les classiques. Pour Smith, Jean-Baptiste Say (1803,Traité d'économie politique) et Ricardo, la demande peut différer de l'offre sur les différents marchés, maisau niveau global, la demande résulte du revenu. Qu'il soit consommé ou investi, le revenu est lui-même égalà la valeur de la production, donc de l'offre : ainsi « l'offre crée la demande ». Pour Jean Charles LéonardSismonde de Sismondi (1803, De la richesse commerciale ; 1819, Nouveaux Principes d'économie politique)ou Robert Malthus (1820, Principes d'économie politique), au contraire, une mauvaise répartition du revenuou une mauvaise gestion de la dépense publique et de l'impôt, trop favorables à l'épargne, peuvent setraduire par un déficit global de la demande, avec pour effet de faire baisser les prix et de compromettre lacroissance. Selon Smith, les obstacles à la croissance résident du côté de l'investissement. En effet, lacroissance du revenu nécessite une accumulation du capital. Or cette dernière exacerbe la concurrence, quiengendre la baisse du taux de profit, laquelle provoque la baisse de l'investissement. Pessimiste, le père del'économie politique explique ainsi la tendance des capitalistes et des entrepreneurs à entraver laconcurrence. Ricardo pense que le risque de stagnation réside moins dans le mobile de l'investissement, àsavoir la profitabilité, que dans le pouvoir d'accumulation des capitalistes (leur épargne) qui diminue enmême temps que le taux de profit. Or la croissance nécessite la mise en culture de terres moins fertiles, cequi renchérit le prix des biens agricoles. Ceux-ci constituant la composante essentielle des biens deconsommation ouvrière, il en résulte une hausse du taux de salaire qui provoque la baisse du taux de profit.Pour éviter ce scénario et faire baisser le prix du blé, Ricardo plaide pour qu'on puisse l'importer, au granddam de Malthus qui craint l'effet dépressif sur la demande qu'entraînerait la baisse de la rente despropriétaires fonciers. L'abolition, en 1846, des Corn Laws rejoint la vision ricardienne qui s'imposa tout aulong du XIXe siècle, et au-delà, jusqu'à la « révolution » provoquée par John Maynard Keynes.
En outre, les classiques convergent sur les mérites du développement du commerce international,moteur d'une division internationale du travail. Selon Smith, chaque pays se spécialise dans la productiondes biens pour lesquels il dispose des coûts de production les plus faibles (théorie de l'avantage absolu).Ricardo approfondit l'analyse en montrant que le commerce peut également être avantageux entre deuxpays même si l'un des deux dispose de coûts de production plus faibles pour tous les biens (théorie del'avantage relatif). Ainsi, si l'Angleterre a besoin de douze heures et de dix heures pour produirerespectivement le vin et le drap, alors qu'il faut respectivement huit heures et neuf heures au Portugal, lesdeux pays ont intérêt à se spécialiser, l'Angleterre dans la production du drap et le Portugal dans celle duvin, et à échanger leurs produits. Au total, la richesse produite et disponible pour chaque pays seraaugmentée.
La politique monétaire
Sur la monnaie, les économistes classiques se partagent en deux camps. Tous sont hostiles aumercantilisme et développent l'idée selon laquelle la monnaie doit échapper au prince et obéir à desmécanismes de marché. Cependant les uns se méfient du pouvoir de création monétaire des banques,veulent soit l'interdire, soit la soumettre à des règles strictes, et développent la théorie quantitative de lamonnaie. Selon eux, la valeur de la monnaie est inversement proportionnelle à sa quantité : si la massemonétaire double, le niveau des prix double, la valeur de la monnaie est donc divisée par deux. Les autresrejettent, ou nuancent, cette même théorie, plaident en faveur du crédit et du papier-monnaie et soutiennentles politiques discrétionnaires de la Banque d'Angleterre.
Cantillon, David Hume (1752, Essai sur le commerce, le luxe, l'argent, l'intérêt...), Ricardo (1810, Le HautPrix du lingot ; 1823, Plan pour l'établissement d'une banque nationale) et les membres de la CurrencySchool (1836-1844) forment le premier groupe. Pour eux, la monnaie se confond avec les métaux précieux etsa valeur s'ajuste automatiquement en fonction de sa quantité et du volume des transactions réelles àeffectuer. En conséquence, la monnaie est toujours en quantité suffisante et l'émission de billets, via lesopérations de crédit, a pour seul effet de faire monter les prix, de provoquer un déficit commercial, de fairesortir l'or du pays, donc du coffre des banques, ce qui rend ces dernières illiquides, c'est-à-dire incapablesd'assurer la convertibilité en or de leurs billets. L'absence de maîtrise des émissions des banques est àl'origine des crises monétaires et bancaires, puis financières et commerciales qui perturbent la croissance del'économie britannique. Pour les partisans de la Currency School, la « solution » réside dans l'ajustement desémissions sur les flux de métaux entre les pays : les augmenter en cas d'excédent de la balance despaiements, les réduire en cas de déficit. Ainsi, la Banque centrale doit-elle réduire ses émissions lorsque sonencaisse métallique diminue.
David Hume
Critiquant les notions de substance et de causalité,David Hume (1711-1776) voit dans l'expérience etson instrument conceptuel, la critique, la source denotre savoir: une mise en question de lamétaphysique qui fait de lui un des fondateurs de laphilosophie moderne. Allan Ramsay, Portrait deHume, Scottish National Portrait Gallery,Édimbourg.(AKG)
Au contraire, Smith, Henry Thornton (1802, Recherches sur la nature et les effets du crédit du papier dans la Grande-Bretagne), Malthus (1811, Publications on the Depreciation of Paper Currency) et les membres de la Banking School (1836-1844) voient dans l'essor du crédit bancaire, et l'émission de monnaie qui l'accompagne, un facteur favorable à l'activité économique. Au moyen de l'escompte, les banques proposent de remplacer, dans la circulation, les dettes privées des marchands, payables à terme, par leur propre dette, le billet de banque. Or celui-ci est payable à vue et offre au détenteur une meilleure garantie de solvabilité. En améliorant ainsi la qualité du crédit commercial et en créant de la liquidité, les banques favorisent les échanges. Ce courant, sans exclure les risques de surémission de monnaie, envisage également les causes réelles, voire psychologiques, des déséquilibres monétaires, des difficultés bancaires et des déficits de la balance des paiements. En conséquence, ces auteurs critiquent les recommandations ricardiennes qui leur semblent inappropriées, voire de nature à aggraver la situation. Par exemple, si une situation de guerre est à l'origine d'une panique et qu'on assiste à une ruée aux guichets des banques des
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
déposants qui demandent le remboursement de leurs avoirs en espèces et en billets de la Banqued'Angleterre, cette dernière doit, même si son encaisse est faible, fournir ces billets. Ce faisant, elle restaurela confiance et enraye la crise. En tant que prêteur en dernier ressort, alors que son encaisse diminue, labanque centrale doit accroître ses émissions et non les réduire. Dans d'autres circonstances, le déficit de labalance des paiements appelle également ce type de solution contraire aux idées quantitativistes. En outre,ces auteurs recommandent de jouer sur le taux d'escompte pour orienter les capitaux extérieurs et stabiliserl'encaisse.
Les controverses entre partisans de ces deux approches alternatives de la monnaie culminent avec laréforme en 1844 de la Banque d'Angleterre qui consacre, à nouveau, la victoire de Ricardo. Le succès decette réforme et la domination, jusqu'en 1914, de la livre sterling sur la finance internationale vont accréditerle bien-fondé de la théorie quantitative et la vision ricardienne du système monétaire international. Làencore, c'est Keynes qui rompra le consensus ricardien.
III- La critique marxiste
Philosophe de formation, Marx adhère aux idées communistes et, au contact de Friedrich Engels,s'intéresse à partir de 1844 à l'économie politique. Ses travaux (1847, Misère de la philosophie ; 1867-1883,Le Capital) sont solitaires et se situent à un moment où l'école classique ne produit guère d'idée nouvelle etavant que les premières analyses néo-classiques (1870-1880) ne sortent des milieux académiques. Marxfustige les thèses des socialistes et des anarchistes, notamment celles de Pierre Joseph Proudhon, ens'appuyant sur Ricardo. Puis il reproche à l'économie politique ricardienne d'être un discours bourgeois, sansaucune réflexion critique sur le système capitaliste. Ainsi le taux de profit est-il appréhendé comme unenorme, non discutée, sur laquelle est construite la théorie des prix. L'origine du profit n'est pas expliquée.Outre la construction de l'Internationale, Marx consacre sa vie à l'élaboration d'une critique de l'économiepolitique. Il vise à mettre en évidence la nature du système capitaliste (une société de classes), montrer soncaractère historique, et mettre au jour ses contradictions. Son œuvre, inachevée, sera poursuivie par sesdisciples de la IIe Internationale.
Karl Marx
Philosophe de formation, c'est au contact deFriedrich Engels que Karl Marx en vient à s'intéresserà l'économie politique, à partir de 1844. Il reprochealors à l'économie politique ricardienne d'être latraduction de l'idéologie bourgeoise, sans aucuneréflexion critique sur le système capitaliste. Ilexposera cette critique dans «Le Capital», son œuvreéconomique majeure.(Courtesy of the trustees of theBritish Museum)
S'inspirant de la logique hégélienne, Marx adopte une approche des échanges différente de celle des classiques et centre son analyse sur la circulation monétaire de telle sorte que, contrairement à Ricardo, il pose la question du profit indépendamment de la question des valeurs relatives des marchandises. Cela le
déposants qui demandent le remboursement de leurs avoirs en espèces et en billets de la Banqued'Angleterre, cette dernière doit, même si son encaisse est faible, fournir ces billets. Ce faisant, elle restaurela confiance et enraye la crise. En tant que prêteur en dernier ressort, alors que son encaisse diminue, labanque centrale doit accroître ses émissions et non les réduire. Dans d'autres circonstances, le déficit de labalance des paiements appelle également ce type de solution contraire aux idées quantitativistes. En outre,ces auteurs recommandent de jouer sur le taux d'escompte pour orienter les capitaux extérieurs et stabiliserl'encaisse.
Les controverses entre partisans de ces deux approches alternatives de la monnaie culminent avec laréforme en 1844 de la Banque d'Angleterre qui consacre, à nouveau, la victoire de Ricardo. Le succès decette réforme et la domination, jusqu'en 1914, de la livre sterling sur la finance internationale vont accréditerle bien-fondé de la théorie quantitative et la vision ricardienne du système monétaire international. Làencore, c'est Keynes qui rompra le consensus ricardien.
III- La critique marxiste
Philosophe de formation, Marx adhère aux idées communistes et, au contact de Friedrich Engels,s'intéresse à partir de 1844 à l'économie politique. Ses travaux (1847, Misère de la philosophie ; 1867-1883,Le Capital) sont solitaires et se situent à un moment où l'école classique ne produit guère d'idée nouvelle etavant que les premières analyses néo-classiques (1870-1880) ne sortent des milieux académiques. Marxfustige les thèses des socialistes et des anarchistes, notamment celles de Pierre Joseph Proudhon, ens'appuyant sur Ricardo. Puis il reproche à l'économie politique ricardienne d'être un discours bourgeois, sansaucune réflexion critique sur le système capitaliste. Ainsi le taux de profit est-il appréhendé comme unenorme, non discutée, sur laquelle est construite la théorie des prix. L'origine du profit n'est pas expliquée.Outre la construction de l'Internationale, Marx consacre sa vie à l'élaboration d'une critique de l'économiepolitique. Il vise à mettre en évidence la nature du système capitaliste (une société de classes), montrer soncaractère historique, et mettre au jour ses contradictions. Son œuvre, inachevée, sera poursuivie par sesdisciples de la IIe Internationale.
Karl Marx
Philosophe de formation, c'est au contact deFriedrich Engels que Karl Marx en vient à s'intéresserà l'économie politique, à partir de 1844. Il reprochealors à l'économie politique ricardienne d'être latraduction de l'idéologie bourgeoise, sans aucuneréflexion critique sur le système capitaliste. Ilexposera cette critique dans «Le Capital», son œuvreéconomique majeure.(Courtesy of the trustees of theBritish Museum)
S'inspirant de la logique hégélienne, Marx adopte une approche des échanges différente de celle des classiques et centre son analyse sur la circulation monétaire de telle sorte que, contrairement à Ricardo, il pose la question du profit indépendamment de la question des valeurs relatives des marchandises. Cela le
conduit au concept de plus-value qu'il explique par l'existence d'un écart quantitatif entre la valeur d'usagede la force de travail (le temps durant lequel elle est employée par le capitaliste) et la valeur d'échange de laforce de travail (le temps de travail dépensé pour produire les biens de consommation que l'ouvrier achèteavec le salaire monétaire que lui verse le capitaliste). Ainsi Marx considère-t-il avoir découvert le secret duprofit et de la dynamique du capitalisme : l'exploitation du travailleur, qui possède la force de travail, par lecapitaliste, qui achète cette force de travail.
Outre son caractère contestable, parce que inégalitaire, aliénant, oppresseur, appauvrissant etliberticide, le capitalisme est historiquement condamné. Encore faut-il que la classe ouvrière puisse saisir lesopportunités politiques que lui offre l'instabilité du capitalisme, source des crises périodiques que Marxcherche à expliquer. S'inspirant du tableau de Quesnay, Marx établit des proportions d'équilibremacroéconomique entre production, investissement et consommation (les schémas de reproduction) etdoute de la capacité du capitalisme à respecter ces proportions (rigidité des structures productives,sous-consommation due à la baisse des salaires, anarchie du marché). Il s'intéresse aux cycles et élaboreune théorie de la baisse tendancielle du taux de profit liée à l'accumulation (au progrès technique) et y voitune cause des chutes périodiques de l'investissement. Il avance également, comme autre facteur explicatifdes crises, la question monétaire et, notamment, la tendance à l'autonomie du crédit et de la financevis-à-vis des lois de l'échange et de l'activité productive. L'essentiel de ces analyses figure dans desmanuscrits inachevés qui, contrairement à l'opinion d'Engels qui les publia à titre posthume, présentent descontradictions. La plus nette, mise en évidence par Ladislaus von Bortkiewicz (1907, Wertrechnung unePreisrechnung im Marxschen System), réside dans la solution proposée par Marx au problème de la« transformation des valeurs en prix de production ».
Rudolf Hilferding (1910, Le Capital financier), Rosa Luxemburg (1913, L'Accumulation du capital) etLénine (1917, L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme), tout en contestant tel ou tel aspect de lapensée de Marx, approfondiront ses analyses en vue d'expliquer la tendance du capitalisme à l'impérialismeet à la guerre. Ces analyses, dont la qualité supporte aisément la comparaison avec ce que produisait alorsla pensée libérale, exerceront une influence notable tout au long du XXe siècle, en particulier, mais passeulement, dans les rangs sociaux-démocrates.
Rosa Luxemburg
Révolutionnaire allemande, Rosa Luxemburg(1870-1919) fut l'une des plus importantesthéoriciennes de la pensée marxiste. Elle meurtassassinée lors de l'insurrection spartakiste, àBerlin.(Hulton Getty)
Après la révolution bolchevique et la défaite spartakiste, avec la montée des fascismes en Europe, le marxisme décline et se laisse envahir par l'idéologie stalinienne. On doit cependant mentionner l'existence de travaux originaux qui font le lien avec le keynésianisme naissant tels que ceux de Paul Sweezy (1942, The Theory of Capitalism Development), de Paul Baran (1957, Économie politique de la croissance) ou de Paul
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
conduit au concept de plus-value qu'il explique par l'existence d'un écart quantitatif entre la valeur d'usagede la force de travail (le temps durant lequel elle est employée par le capitaliste) et la valeur d'échange de laforce de travail (le temps de travail dépensé pour produire les biens de consommation que l'ouvrier achèteavec le salaire monétaire que lui verse le capitaliste). Ainsi Marx considère-t-il avoir découvert le secret duprofit et de la dynamique du capitalisme : l'exploitation du travailleur, qui possède la force de travail, par lecapitaliste, qui achète cette force de travail.
Outre son caractère contestable, parce que inégalitaire, aliénant, oppresseur, appauvrissant etliberticide, le capitalisme est historiquement condamné. Encore faut-il que la classe ouvrière puisse saisir lesopportunités politiques que lui offre l'instabilité du capitalisme, source des crises périodiques que Marxcherche à expliquer. S'inspirant du tableau de Quesnay, Marx établit des proportions d'équilibremacroéconomique entre production, investissement et consommation (les schémas de reproduction) etdoute de la capacité du capitalisme à respecter ces proportions (rigidité des structures productives,sous-consommation due à la baisse des salaires, anarchie du marché). Il s'intéresse aux cycles et élaboreune théorie de la baisse tendancielle du taux de profit liée à l'accumulation (au progrès technique) et y voitune cause des chutes périodiques de l'investissement. Il avance également, comme autre facteur explicatifdes crises, la question monétaire et, notamment, la tendance à l'autonomie du crédit et de la financevis-à-vis des lois de l'échange et de l'activité productive. L'essentiel de ces analyses figure dans desmanuscrits inachevés qui, contrairement à l'opinion d'Engels qui les publia à titre posthume, présentent descontradictions. La plus nette, mise en évidence par Ladislaus von Bortkiewicz (1907, Wertrechnung unePreisrechnung im Marxschen System), réside dans la solution proposée par Marx au problème de la« transformation des valeurs en prix de production ».
Rudolf Hilferding (1910, Le Capital financier), Rosa Luxemburg (1913, L'Accumulation du capital) etLénine (1917, L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme), tout en contestant tel ou tel aspect de lapensée de Marx, approfondiront ses analyses en vue d'expliquer la tendance du capitalisme à l'impérialismeet à la guerre. Ces analyses, dont la qualité supporte aisément la comparaison avec ce que produisait alorsla pensée libérale, exerceront une influence notable tout au long du XXe siècle, en particulier, mais passeulement, dans les rangs sociaux-démocrates.
Rosa Luxemburg
Révolutionnaire allemande, Rosa Luxemburg(1870-1919) fut l'une des plus importantesthéoriciennes de la pensée marxiste. Elle meurtassassinée lors de l'insurrection spartakiste, àBerlin.(Hulton Getty)
Après la révolution bolchevique et la défaite spartakiste, avec la montée des fascismes en Europe, le marxisme décline et se laisse envahir par l'idéologie stalinienne. On doit cependant mentionner l'existence de travaux originaux qui font le lien avec le keynésianisme naissant tels que ceux de Paul Sweezy (1942, The Theory of Capitalism Development), de Paul Baran (1957, Économie politique de la croissance) ou de Paul
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
Mattick (1969, Marx et Keynes) aux États-Unis, de Mario Tronti (1966, Ouvriers et capital) ou d'Antonio Negri(1968-1978, La Classe ouvrière contre l'État) en Italie, de Michel Aglietta (1976, Régulation et crise ducapitalisme) ou de Suzanne de Brunhoff (1976, Les Rapports d'argent) en France, mais aussi les recherches,plus critiques à l'égard de Marx, d'historiens de la pensée économique, dont, en France, Carlo Benetti et JeanCartelier (1980, Marchands, salariat et capitalistes) ou Gilbert Faccarello (1983, Travail, valeur et prix).
IV- Le courant néo-classique
À partir du dernier quart du XIXe siècle, et tout au long du XXe siècle, le courant dit « néo-classique » vaprogressivement devenir dominant. Si les thèmes de rupture avec les classiques rassemblent les auteurs dece courant, celui-ci est traversé par de nombreuses écoles qui divergent sur l'analyse de la valeur, del'emploi, de la politique économique et, de façon générale, sur l'efficacité des marchés.
La révolution marginaliste
Parallèlement, en Angleterre avec Stanley Jevons (1871, Théorie de l'économie politique), en Autricheavec Carl Menger (1871, Grundzätze der Volkswirtschaftslehre [Principes d'économie politique]) et en Franceavec Léon Walras (1874, Éléments d'économie politique pure), on assiste à une révolution dans l'analyse dela valeur. L'utilité marginale du bien, c'est-à-dire l'utilité de la dernière unité consommée, qui décroît au furet à mesure de la consommation, est perçue comme le facteur déterminant de la valeur. Les prix d'équilibresont tels qu'il y a égalisation des utilités marginales (pondérées par les prix) des différents biensconsommés. Ce principe s'applique autant aux biens qui n'ont pas de coût de production, mais qui sontlimités en quantité, qu'à ceux qui font l'objet d'une production. Contrairement à la vision des classiques, lademande fournit le facteur explicatif de la valeur.
William Stanley Jevons
Portrait de l'économiste anglais William StanleyJevons (1835-1882), l'un des artisans de la révolutionmarginaliste à l'origine de la théorie économiquenéo-classique(Hulton Getty)
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
Carl Menger
Carl Menger (1840-1921). Économiste autrichien, l'undes fondateurs de l'analyse marginaliste au sein del'école de Vienne (branche autrichienne del'économie néo-classique), auteur de Principles ofEconomics (1871).(AKG)
Alfred Marshall (1890, Principes d'économie politique) opéra une synthèse entre cette révolution del'analyse de la demande et la théorie classique de l'offre, elle-même modifiée par la prise en compte derendements d'échelle décroissants, ou croissants. Outre le consensus sur le rôle de la demande, lesmarginalistes convergent pour abandonner toute référence à l'antagonisme entre salariés, capitalistes etrentiers qui caractérise les analyses ricardiennes et marxistes : le capital et la terre, au même titre que letravail, sont des facteurs productifs ; l'intérêt, la rente et le salaire en sont les prix d'équilibre. Le marchéassure l'harmonie sociale.
Le changement d'optique dans l'analyse de la valeur s'accompagne d'un renouvellement de l'analyse dumarché et de l'équilibre. Ainsi, assiste-t-on à l'éclosion de conceptions différentes qui subsistent au début duXXIe siècle. D'un côté, les travaux d'Antoine Cournot (1838, Recherches sur les principes mathématiques dela richesse sociale), Francis Ysidro Edgeworth (1881, Mathematical Psychics) et Joseph Bertrand (1883,Théorie mathématique de la richesse sociale) concluent à l'existence de plusieurs prix d'équilibre quidépendent à la fois du nombre d'agents (le degré de concurrence), de leurs stratégies, de leurs statuts. Ilsintroduisent les approches d'équilibres multiples que l'on retrouvera dans le cadre de la théorie des jeux(John Forbes Nash, 1950, Equilibrium Points in N-Person Games). Pour sa part, Walras assimile la concurrenceau tâtonnement qui conduit à l'unicité du prix d'équilibre, et ce dans une perspective d'équilibre général.Largement négligée alors, l'analyse walrassienne sera redécouverte et enrichie par Gérard Debreu (1959,Théorie de la valeur), Kenneth Arrow et Frank Hahn (1971, General Competitive Analysis) dans les années1950-1970 et imposera son cadre au débat macroéconomique des années 1970-1990.
À la fin du XIXe siècle, et au début du XXe siècle, c'est une troisième approche, introduite par Marshall,qui dominait la pensée néo-classique. Développant une méthodologie d'équilibre partiel qui analyse chaquemarché en l'isolant de l'influence exercée par les autres marchés, elle introduit ou renouvelle l'analyse denombreux problèmes comme le bien-être, la justice, l'entreprise, la concurrence monopolistique, lecommerce international. Cependant, dans l'entre-deux-guerres, elle ne parvient à expliquer ni l'instabilitémonétaire et financière, ni la montée du chômage.
La révolution keynésienne
Keynes (1930, A Treatise on Money ; 1936, Théorie générale de l'emploi, l'intérêt et la monnaie), élève de Marshall, propose de changer de perspective. Selon Keynes, marshalliens et ricardiens commettent l'erreur commune de raisonner sur un niveau de revenu d'équilibre donné et ne se distinguent qu'à propos
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
Carl Menger
Carl Menger (1840-1921). Économiste autrichien, l'undes fondateurs de l'analyse marginaliste au sein del'école de Vienne (branche autrichienne del'économie néo-classique), auteur de Principles ofEconomics (1871).(AKG)
Alfred Marshall (1890, Principes d'économie politique) opéra une synthèse entre cette révolution del'analyse de la demande et la théorie classique de l'offre, elle-même modifiée par la prise en compte derendements d'échelle décroissants, ou croissants. Outre le consensus sur le rôle de la demande, lesmarginalistes convergent pour abandonner toute référence à l'antagonisme entre salariés, capitalistes etrentiers qui caractérise les analyses ricardiennes et marxistes : le capital et la terre, au même titre que letravail, sont des facteurs productifs ; l'intérêt, la rente et le salaire en sont les prix d'équilibre. Le marchéassure l'harmonie sociale.
Le changement d'optique dans l'analyse de la valeur s'accompagne d'un renouvellement de l'analyse dumarché et de l'équilibre. Ainsi, assiste-t-on à l'éclosion de conceptions différentes qui subsistent au début duXXIe siècle. D'un côté, les travaux d'Antoine Cournot (1838, Recherches sur les principes mathématiques dela richesse sociale), Francis Ysidro Edgeworth (1881, Mathematical Psychics) et Joseph Bertrand (1883,Théorie mathématique de la richesse sociale) concluent à l'existence de plusieurs prix d'équilibre quidépendent à la fois du nombre d'agents (le degré de concurrence), de leurs stratégies, de leurs statuts. Ilsintroduisent les approches d'équilibres multiples que l'on retrouvera dans le cadre de la théorie des jeux(John Forbes Nash, 1950, Equilibrium Points in N-Person Games). Pour sa part, Walras assimile la concurrenceau tâtonnement qui conduit à l'unicité du prix d'équilibre, et ce dans une perspective d'équilibre général.Largement négligée alors, l'analyse walrassienne sera redécouverte et enrichie par Gérard Debreu (1959,Théorie de la valeur), Kenneth Arrow et Frank Hahn (1971, General Competitive Analysis) dans les années1950-1970 et imposera son cadre au débat macroéconomique des années 1970-1990.
À la fin du XIXe siècle, et au début du XXe siècle, c'est une troisième approche, introduite par Marshall,qui dominait la pensée néo-classique. Développant une méthodologie d'équilibre partiel qui analyse chaquemarché en l'isolant de l'influence exercée par les autres marchés, elle introduit ou renouvelle l'analyse denombreux problèmes comme le bien-être, la justice, l'entreprise, la concurrence monopolistique, lecommerce international. Cependant, dans l'entre-deux-guerres, elle ne parvient à expliquer ni l'instabilitémonétaire et financière, ni la montée du chômage.
La révolution keynésienne
Keynes (1930, A Treatise on Money ; 1936, Théorie générale de l'emploi, l'intérêt et la monnaie), élève de Marshall, propose de changer de perspective. Selon Keynes, marshalliens et ricardiens commettent l'erreur commune de raisonner sur un niveau de revenu d'équilibre donné et ne se distinguent qu'à propos
de l'analyse de la répartition de ce revenu. Il propose quant à lui de s'intéresser aux déterminants du revenuglobal et renouvelle, à cet effet, l'analyse de l'offre et de la demande : celle-ci acquiert une dimensionmacroéconomique. Il ne s'agit plus d'expliquer les prix relatifs des biens mais les déterminants des agrégatsglobaux de l'économie : le niveau général des prix, le revenu, l'emploi, le taux d'intérêt. La Théorie généralede Keynes analyse la détermination simultanée de l'équilibre de l'offre et de la demande sur les marchés desbiens, des titres et de la monnaie.
L'étude de l'équilibre du marché des biens est renouvelée par la théorie du multiplicateur. Selon cettedernière, l'offre de biens s'ajuste sur la demande, la production répond aux commandes, la distribution durevenu résulte de la dépense. Or une partie de la dépense, en l'occurrence la consommation, résulte durevenu si bien qu'il existe un effet cumulatif, dit « multiplicateur », entre revenu et dépense ; effetmultiplicateur qui trouve sa limite dans le fait qu'une fraction du revenu est épargnée, et non dépensée.L'autre partie de la dépense, à savoir l'investissement privé et la dépense publique, n'est pas liée au revenu.Son montant dépend, pour l'investissement privé de la rentabilité des investissements comparée à leur coûtde financement, et pour la dépense publique de la politique budgétaire et financière de l'État. Ce qui conduitKeynes à s'intéresser au marché des titres. À ce niveau également il renouvelle complètement l'analyse ennotant que les prix des titres et les taux d'intérêt sur le marché financier résultent non pas des fluxd'épargne courante, mais des choix relatifs à l'ensemble des stocks d'actifs financiers détenus par lesagents : leurs stratégies de réallocation de portefeuille renvoient à des comportements spéculatifs et à desphénomènes d'incertitude et de liquidité qui sont soulignés par Keynes. Ce faisant, l'argumentationkeynésienne fait jouer aux encaisses monétaires, par nature plus liquides que les titres, un rôle essentieldans la formation de l'équilibre global de l'économie. Ainsi Keynes renouvelle-t-il une théorie monétaire qui,malgré les efforts de Knut Wicksell (1898, Interest and Prices ; 1901-1906, Lectures d'économie politique) etd'Irving Fisher (1911, Le Pouvoir d'achat de la monnaie), avait peu évolué depuis les années 1840. Aprèssoixante ans, il dotait la théorie néo-classique d'une théorie de la demande applicable à la monnaie et apte àconcevoir un équilibre sur un marché de la monnaie.
Muni de ces outils, Keynes explique le chômage par l'insuffisance de la demande et propose d'utiliser lapolitique économique pour modifier les niveaux du taux d'intérêt, de production et d'emploi. La politique qu'ilpréconise contraste avec celle des idéologies totalitaires : il ne s'agit ni de contrôler la production (l'offre debiens), laissée à l'initiative des entrepreneurs, ni de contraindre les choix spéculatifs ou de consommationdes ménages ; mais de jouer sur la dépense publique et l'offre de monnaie. L'augmentation de la dépensepublique crée un supplément de demande de biens, donc une production et une distribution de revenus quienclenche le processus multiplicateur du revenu ; la politique monétaire vise à faire baisser les taux d'intérêtpour stimuler l'investissement qui, lui aussi, enclenche le processus multiplicateur. Le libéralisme keynésienn'exclut pas l'action de l'État ; il allait dominer durant les Trente Glorieuses qui suivirent la Seconde Guerremondiale. Bien que Keynes ait déclaré ne pas reconnaître sa théorie dans le modèle IS-LM présenté par JohnHicks (1937, Mr. Keynes and the Classics), c'est au moyen d'une version modifiée par Alvin Hansen (1953,Introduction à la pensée keynésienne) de ce modèle que la pensée keynésienne a principalement étédiffusée et discutée. Ce modèle a fourni le cadre à l'essentiel des débats macroéconomiques qui allaientsuivre.
Par contre, concernant le système monétaire international, Keynes eut peu d'écho. Il proposa, en vued'assurer la stabilité des taux de change, la mise en place d'une banque « internationale » qui émettrait unemonnaie, le bancor, utilisée pour régler les déséquilibres des balances des paiements, et gérée de telle sorteque la charge des ajustements pèse à la fois sur les pays présentant un déficit des paiements et sur ceuxdégageant un excédent. La conférence de Bretton-Woods (1944) a abouti à une architecture différente,centrée sur le dollar convertible en or, de changes fixes, mais révisables, où l'effort d'ajustements repose surle seul pays déficitaire. La crise du dollar en 1971, les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979-1981, leralentissement de la croissance, l'inflation montante et la renaissance du chômage à partir des années 1970,ont accru l'audience des critiques monétaristes et néo-libérales qui sont apparues dès les années 1950.
Monétarisme et néo-libéralisme
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
de l'analyse de la répartition de ce revenu. Il propose quant à lui de s'intéresser aux déterminants du revenuglobal et renouvelle, à cet effet, l'analyse de l'offre et de la demande : celle-ci acquiert une dimensionmacroéconomique. Il ne s'agit plus d'expliquer les prix relatifs des biens mais les déterminants des agrégatsglobaux de l'économie : le niveau général des prix, le revenu, l'emploi, le taux d'intérêt. La Théorie généralede Keynes analyse la détermination simultanée de l'équilibre de l'offre et de la demande sur les marchés desbiens, des titres et de la monnaie.
L'étude de l'équilibre du marché des biens est renouvelée par la théorie du multiplicateur. Selon cettedernière, l'offre de biens s'ajuste sur la demande, la production répond aux commandes, la distribution durevenu résulte de la dépense. Or une partie de la dépense, en l'occurrence la consommation, résulte durevenu si bien qu'il existe un effet cumulatif, dit « multiplicateur », entre revenu et dépense ; effetmultiplicateur qui trouve sa limite dans le fait qu'une fraction du revenu est épargnée, et non dépensée.L'autre partie de la dépense, à savoir l'investissement privé et la dépense publique, n'est pas liée au revenu.Son montant dépend, pour l'investissement privé de la rentabilité des investissements comparée à leur coûtde financement, et pour la dépense publique de la politique budgétaire et financière de l'État. Ce qui conduitKeynes à s'intéresser au marché des titres. À ce niveau également il renouvelle complètement l'analyse ennotant que les prix des titres et les taux d'intérêt sur le marché financier résultent non pas des fluxd'épargne courante, mais des choix relatifs à l'ensemble des stocks d'actifs financiers détenus par lesagents : leurs stratégies de réallocation de portefeuille renvoient à des comportements spéculatifs et à desphénomènes d'incertitude et de liquidité qui sont soulignés par Keynes. Ce faisant, l'argumentationkeynésienne fait jouer aux encaisses monétaires, par nature plus liquides que les titres, un rôle essentieldans la formation de l'équilibre global de l'économie. Ainsi Keynes renouvelle-t-il une théorie monétaire qui,malgré les efforts de Knut Wicksell (1898, Interest and Prices ; 1901-1906, Lectures d'économie politique) etd'Irving Fisher (1911, Le Pouvoir d'achat de la monnaie), avait peu évolué depuis les années 1840. Aprèssoixante ans, il dotait la théorie néo-classique d'une théorie de la demande applicable à la monnaie et apte àconcevoir un équilibre sur un marché de la monnaie.
Muni de ces outils, Keynes explique le chômage par l'insuffisance de la demande et propose d'utiliser lapolitique économique pour modifier les niveaux du taux d'intérêt, de production et d'emploi. La politique qu'ilpréconise contraste avec celle des idéologies totalitaires : il ne s'agit ni de contrôler la production (l'offre debiens), laissée à l'initiative des entrepreneurs, ni de contraindre les choix spéculatifs ou de consommationdes ménages ; mais de jouer sur la dépense publique et l'offre de monnaie. L'augmentation de la dépensepublique crée un supplément de demande de biens, donc une production et une distribution de revenus quienclenche le processus multiplicateur du revenu ; la politique monétaire vise à faire baisser les taux d'intérêtpour stimuler l'investissement qui, lui aussi, enclenche le processus multiplicateur. Le libéralisme keynésienn'exclut pas l'action de l'État ; il allait dominer durant les Trente Glorieuses qui suivirent la Seconde Guerremondiale. Bien que Keynes ait déclaré ne pas reconnaître sa théorie dans le modèle IS-LM présenté par JohnHicks (1937, Mr. Keynes and the Classics), c'est au moyen d'une version modifiée par Alvin Hansen (1953,Introduction à la pensée keynésienne) de ce modèle que la pensée keynésienne a principalement étédiffusée et discutée. Ce modèle a fourni le cadre à l'essentiel des débats macroéconomiques qui allaientsuivre.
Par contre, concernant le système monétaire international, Keynes eut peu d'écho. Il proposa, en vued'assurer la stabilité des taux de change, la mise en place d'une banque « internationale » qui émettrait unemonnaie, le bancor, utilisée pour régler les déséquilibres des balances des paiements, et gérée de telle sorteque la charge des ajustements pèse à la fois sur les pays présentant un déficit des paiements et sur ceuxdégageant un excédent. La conférence de Bretton-Woods (1944) a abouti à une architecture différente,centrée sur le dollar convertible en or, de changes fixes, mais révisables, où l'effort d'ajustements repose surle seul pays déficitaire. La crise du dollar en 1971, les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979-1981, leralentissement de la croissance, l'inflation montante et la renaissance du chômage à partir des années 1970,ont accru l'audience des critiques monétaristes et néo-libérales qui sont apparues dès les années 1950.
Monétarisme et néo-libéralisme
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
de l'analyse de la répartition de ce revenu. Il propose quant à lui de s'intéresser aux déterminants du revenuglobal et renouvelle, à cet effet, l'analyse de l'offre et de la demande : celle-ci acquiert une dimensionmacroéconomique. Il ne s'agit plus d'expliquer les prix relatifs des biens mais les déterminants des agrégatsglobaux de l'économie : le niveau général des prix, le revenu, l'emploi, le taux d'intérêt. La Théorie généralede Keynes analyse la détermination simultanée de l'équilibre de l'offre et de la demande sur les marchés desbiens, des titres et de la monnaie.
L'étude de l'équilibre du marché des biens est renouvelée par la théorie du multiplicateur. Selon cettedernière, l'offre de biens s'ajuste sur la demande, la production répond aux commandes, la distribution durevenu résulte de la dépense. Or une partie de la dépense, en l'occurrence la consommation, résulte durevenu si bien qu'il existe un effet cumulatif, dit « multiplicateur », entre revenu et dépense ; effetmultiplicateur qui trouve sa limite dans le fait qu'une fraction du revenu est épargnée, et non dépensée.L'autre partie de la dépense, à savoir l'investissement privé et la dépense publique, n'est pas liée au revenu.Son montant dépend, pour l'investissement privé de la rentabilité des investissements comparée à leur coûtde financement, et pour la dépense publique de la politique budgétaire et financière de l'État. Ce qui conduitKeynes à s'intéresser au marché des titres. À ce niveau également il renouvelle complètement l'analyse ennotant que les prix des titres et les taux d'intérêt sur le marché financier résultent non pas des fluxd'épargne courante, mais des choix relatifs à l'ensemble des stocks d'actifs financiers détenus par lesagents : leurs stratégies de réallocation de portefeuille renvoient à des comportements spéculatifs et à desphénomènes d'incertitude et de liquidité qui sont soulignés par Keynes. Ce faisant, l'argumentationkeynésienne fait jouer aux encaisses monétaires, par nature plus liquides que les titres, un rôle essentieldans la formation de l'équilibre global de l'économie. Ainsi Keynes renouvelle-t-il une théorie monétaire qui,malgré les efforts de Knut Wicksell (1898, Interest and Prices ; 1901-1906, Lectures d'économie politique) etd'Irving Fisher (1911, Le Pouvoir d'achat de la monnaie), avait peu évolué depuis les années 1840. Aprèssoixante ans, il dotait la théorie néo-classique d'une théorie de la demande applicable à la monnaie et apte àconcevoir un équilibre sur un marché de la monnaie.
Muni de ces outils, Keynes explique le chômage par l'insuffisance de la demande et propose d'utiliser lapolitique économique pour modifier les niveaux du taux d'intérêt, de production et d'emploi. La politique qu'ilpréconise contraste avec celle des idéologies totalitaires : il ne s'agit ni de contrôler la production (l'offre debiens), laissée à l'initiative des entrepreneurs, ni de contraindre les choix spéculatifs ou de consommationdes ménages ; mais de jouer sur la dépense publique et l'offre de monnaie. L'augmentation de la dépensepublique crée un supplément de demande de biens, donc une production et une distribution de revenus quienclenche le processus multiplicateur du revenu ; la politique monétaire vise à faire baisser les taux d'intérêtpour stimuler l'investissement qui, lui aussi, enclenche le processus multiplicateur. Le libéralisme keynésienn'exclut pas l'action de l'État ; il allait dominer durant les Trente Glorieuses qui suivirent la Seconde Guerremondiale. Bien que Keynes ait déclaré ne pas reconnaître sa théorie dans le modèle IS-LM présenté par JohnHicks (1937, Mr. Keynes and the Classics), c'est au moyen d'une version modifiée par Alvin Hansen (1953,Introduction à la pensée keynésienne) de ce modèle que la pensée keynésienne a principalement étédiffusée et discutée. Ce modèle a fourni le cadre à l'essentiel des débats macroéconomiques qui allaientsuivre.
Par contre, concernant le système monétaire international, Keynes eut peu d'écho. Il proposa, en vued'assurer la stabilité des taux de change, la mise en place d'une banque « internationale » qui émettrait unemonnaie, le bancor, utilisée pour régler les déséquilibres des balances des paiements, et gérée de telle sorteque la charge des ajustements pèse à la fois sur les pays présentant un déficit des paiements et sur ceuxdégageant un excédent. La conférence de Bretton-Woods (1944) a abouti à une architecture différente,centrée sur le dollar convertible en or, de changes fixes, mais révisables, où l'effort d'ajustements repose surle seul pays déficitaire. La crise du dollar en 1971, les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979-1981, leralentissement de la croissance, l'inflation montante et la renaissance du chômage à partir des années 1970,ont accru l'audience des critiques monétaristes et néo-libérales qui sont apparues dès les années 1950.
Monétarisme et néo-libéralisme
L'école monétariste est menée par Friedman (1953, Essays in Positive Economics ; 1956, The Quantity
Theory. A Restatement ; 1963, avec Anna Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867-1960 ;
1969, The Optimum Quantity of Money and Other Essays) qui, dans les années 1950 et 1960, critique le
système de taux de change fixes de Bretton-Woods et les politiques inspirées du keynésianisme. De façon
générale, Milton Friedman conteste la possibilité pour les autorités économiques de modifier l'équilibre,
d'atteindre des situations supérieures à celles obtenues par le libre fonctionnement des marchés. Ainsi le
taux de change est-il un prix d'équilibre dont le niveau est mieux déterminé par le jeu de l'offre et de la
demande dans un régime de changes flexibles que par les calculs et les analyses des économistes relayés
par des interventions inefficaces des banques centrales. En cas de déséquilibre durable des balances des
paiements, ces dernières sont incapables de contrer les spéculateurs qui anticipent et obtiennent les
changements de parité.
Milton Friedman
Milton Friedman (1912-2006) a construit son œuvre
en s'opposant presque systématiquement à celle de
John Maynard Keynes. Seule les réunit la profonde
influence exercée par chacune de celles-ci sur
l'action des gouvernants: les politiques de relance de
l'après-guerre pour le keynésianisme, la lutte contre
l'inflation, à partir des années 1980, pour le
monétarisme.(G. Rose/ Getty)
De même, les politiques keynésiennes de soutien de la demande se heurtent au comportement de long
terme des ménages qui ne changent ni leur dépense, ni leurs choix monétaire et financier lorsque l'État
change de politique monétaire ou budgétaire. Sans effet durable sur l'emploi, ces politiques ne réussissent
qu'à substituer la dépense publique à l'investissement privé ou à créer de l'inflation – à relier au débat sur la
courbe de Philips (1958, The Relation Between Unemployment and the Rate of Exchange of Money Wage in
the United Kingdom) – et à déstabiliser les taux de change. Inefficaces, elles ne sont pas souhaitables.
Adoptant, comme Don Patinkin (1965, La Monnaie, l'intérêt et les prix), une méthodologie walrassienne
d'équilibre général, et, à la suite de John Muth (1961, Rational Expectations and the Theory of Price
Movements), l'hypothèse d'anticipations rationnelles qui conduit à penser que les salariés vont
rationnellement anticiper le jeu de l'autorité monétaire et donc prévoir correctement l'inflation future, les
monétaristes de la seconde génération – Robert Lucas (1972, Expectations and the Neutrality of Money ;
1981, Rational Expectations and Econometrics Practice, en collaboration avec Thomas Sargent), Thomas
Sargent et Neil Wallace (1975, Rational Expectations, The Optimal Monetary Instrument and the Optimal
Money Supply Rule) ou Robert Mundell (1968, Barter Theory and the Monetary Mechanism of Adjustment) –
vont systématiser les conclusions de Friedman.
Paradoxalement, le renouveau des recherches sur le modèle d'équilibre général va déboucher sur des
résultats inattendus : l'existence de pluralités d'équilibres et d'instabilité de ces équilibres (Hugo
Sonnenschein, 1973, Do Walras Identity and Continuity Characterize the Class of Excess Demand
Functions ?) ; l'absence d'explication satisfaisante de la valeur de la monnaie (Frank Hahn, 1965, On Some
Problems of Proving the Existence of an Equilibrium in a Monetary Economy) ; l'instabilité et le surajustement
du taux de change en régime de changes flexibles (Rudiger Dornbush, 1980, Open Economy
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique
L'école monétariste est menée par Friedman (1953, Essays in Positive Economics ; 1956, The Quantity
Theory. A Restatement ; 1963, avec Anna Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867-1960 ;
1969, The Optimum Quantity of Money and Other Essays) qui, dans les années 1950 et 1960, critique le
système de taux de change fixes de Bretton-Woods et les politiques inspirées du keynésianisme. De façon
générale, Milton Friedman conteste la possibilité pour les autorités économiques de modifier l'équilibre,
d'atteindre des situations supérieures à celles obtenues par le libre fonctionnement des marchés. Ainsi le
taux de change est-il un prix d'équilibre dont le niveau est mieux déterminé par le jeu de l'offre et de la
demande dans un régime de changes flexibles que par les calculs et les analyses des économistes relayés
par des interventions inefficaces des banques centrales. En cas de déséquilibre durable des balances des
paiements, ces dernières sont incapables de contrer les spéculateurs qui anticipent et obtiennent les
changements de parité.
Milton Friedman
Milton Friedman (1912-2006) a construit son œuvre
en s'opposant presque systématiquement à celle de
John Maynard Keynes. Seule les réunit la profonde
influence exercée par chacune de celles-ci sur
l'action des gouvernants: les politiques de relance de
l'après-guerre pour le keynésianisme, la lutte contre
l'inflation, à partir des années 1980, pour le
monétarisme.(G. Rose/ Getty)
De même, les politiques keynésiennes de soutien de la demande se heurtent au comportement de long
terme des ménages qui ne changent ni leur dépense, ni leurs choix monétaire et financier lorsque l'État
change de politique monétaire ou budgétaire. Sans effet durable sur l'emploi, ces politiques ne réussissent
qu'à substituer la dépense publique à l'investissement privé ou à créer de l'inflation – à relier au débat sur la
courbe de Philips (1958, The Relation Between Unemployment and the Rate of Exchange of Money Wage in
the United Kingdom) – et à déstabiliser les taux de change. Inefficaces, elles ne sont pas souhaitables.
Adoptant, comme Don Patinkin (1965, La Monnaie, l'intérêt et les prix), une méthodologie walrassienne
d'équilibre général, et, à la suite de John Muth (1961, Rational Expectations and the Theory of Price
Movements), l'hypothèse d'anticipations rationnelles qui conduit à penser que les salariés vont
rationnellement anticiper le jeu de l'autorité monétaire et donc prévoir correctement l'inflation future, les
monétaristes de la seconde génération – Robert Lucas (1972, Expectations and the Neutrality of Money ;
1981, Rational Expectations and Econometrics Practice, en collaboration avec Thomas Sargent), Thomas
Sargent et Neil Wallace (1975, Rational Expectations, The Optimal Monetary Instrument and the Optimal
Money Supply Rule) ou Robert Mundell (1968, Barter Theory and the Monetary Mechanism of Adjustment) –
vont systématiser les conclusions de Friedman.
Paradoxalement, le renouveau des recherches sur le modèle d'équilibre général va déboucher sur des
résultats inattendus : l'existence de pluralités d'équilibres et d'instabilité de ces équilibres (Hugo
Sonnenschein, 1973, Do Walras Identity and Continuity Characterize the Class of Excess Demand
Functions ?) ; l'absence d'explication satisfaisante de la valeur de la monnaie (Frank Hahn, 1965, On Some
Problems of Proving the Existence of an Equilibrium in a Monetary Economy) ; l'instabilité et le surajustement
du taux de change en régime de changes flexibles (Rudiger Dornbush, 1980, Open Economy
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique Macroeconomics).
Fondamentalement, le monétarisme postule l'hypothèse de plein-emploi. Il y a donc une rigidité de l'offre
qui explique l'incapacité de la politique keynésienne à modifier le niveau de revenu. Les néo-libéraux, qui se
réfèrent à Friedrich von Hayek (1944, La Route de la servitude ; 1973, Droit, législation et liberté), poussent
le diagnostic en attribuant la rigidité de l'offre au « trop d'État » et de réglementation : la pression fiscale et
l'indemnisation du chômage encouragent l'oisiveté et diminuent l'offre de travail, le salaire minimum et le
droit du travail paralysent l'embauche ; la dépense publique, les services et monopoles publics limitent la
liberté de choix des consommateurs, et la concurrence entre les prestataires de services, les
réglementations de toutes sortes empêchent les agents de nouer les contrats optimaux et entravent
l'initiative privée. Ce courant néo-libéral, dont on trouve les prémisses chez les libéraux français du
XIXe siècle hostiles à toute réglementation du droit du travail des enfants, postule le fonctionnement
harmonieux des marchés, nous renvoie à des discussions philosophiques et, de façon générale, tient peu
compte des développements récents du reste de la théorie néo-classique, que ce soit en macroéconomie ou
en microéconomie.
Coûts de transaction, incertitude, asymétries d'information...
L'introduction de nouvelles notions, telles que les coûts de transaction, l'incertitude, l'acquisition et les
asymétries d'information, modifie nombre des a priori de l'analyse néo-classique. Ainsi Frank Knight (1921,
Risk, Uncertainty and Profit) explique que si les salariés choisissent d'être dans un rapport de subordination à
l'égard de l'entrepreneur, c'est en vue de lui transférer les risques liés à la vente du produit de leur travail.
Pour Ronald Coase (1937, La Nature de la firme), c'est pour réduire les coûts de transaction du produit de ce
travail. De même est-ce pour limiter les coûts de transaction que les firmes intègrent verticalement la
production plutôt que d'avoir recours à la sous-traitance. Oliver Williamson (1985, The Economic Institutionsof Capitalism) généralise l'argumentation et montre que les organisations peuvent s'avérer plus efficaces
que le marché pour faire circuler les biens, le travail et les capitaux.
Oliver E. Williamson
L'approche néo-institutionnaliste fondée par Oliver
E. Williamson marque une véritable rupture
analytique avec l'approche microéconomique
standard du rôle des firmes dans une économie de
marché.(University of California, Haas School of
Business/ DR)
De même, la prise en compte de l'incertitude et le problème de l'information, coûteuse à acquérir et
inégalement distribuée entre les agents, conduisent-ils à s'interroger sur la flexibilité des marchés et
l'efficacité de la loi de l'offre et de la demande : par exemple pour assurer les échanges de biens (George
Akerlof, 1970, The Market for Lemons), pour allouer le crédit (Joseph Stiglitz et Andrew Weiss, 1981, Credit Rationing in Markets with Imperfect Information), pour déterminer le salaire de plein-emploi (Akerlof et Janet
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 1/ Les origines de l’analyse économique Vous pouvez vous référez au site suivant : http://touteconomie.org/ressourceco/ Les ressources sont nombreuses et de différents niveaux. Egalement Jacques Valier « Brève histoire de la pensée économique d'Aristote à nos jours » Champs Flammarion disponible sur les sites marchands
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 2/ Les grandes variables et représentations de l’économie
Circuit économique à 4 acteurs
Sources: Maxi-‐cours
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 2/ Les grandes variables et représentations de l’économie Le fonctionnement des grandes variables économiques
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 2/ Les grandes variables et représentations de l’économie § Deux approches du circuit économique § Piriou Jean-‐Paul , La comptabilité nationale, La découverte « Repères », 2008, p. 3-‐3.
www.cairn.info/la-‐comptabilite-‐nationale-‐-‐9782707156600-‐page-‐3.htm.
§ 16La Comptabilité Nationale CN ne représente pas l’économie nationale comme un ensemble de marchés, mais comme un circuit.
§ 17La production est à l’origine de l’activité économique (voir le schéma). Elle est la source des biens et services, mais aussi des revenus (salaires, profits…)dont la dépense doit permettre l’achat des produits. Le circuit économique ne peut évidemment pas demeurer aussi simple. S’agissant des produits (biens et services), il faut prendre en compte les importations qui augmentent les ressources en produits, et les exportations qui sont une des utilisations possibles des produits disponibles (à côté de la consommation et de l’investissement). Quant aux revenus, ils ne sont pas dépensés tels quels par ceux qui
§ 18Le sont reçus de la production. Leur répartition entre les agents économiques est modifiée par des opérations de redistribution du revenu (impôts, cotisations, prestations sociales…)et par des transferts de revenus avec le reste du monde.
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 2/ Les grandes variables et représentations de l’économie § Deux approches du circuit économique
§ 19Les dépenses des agents économiques ne sont qu’exceptionnellement identiques à leurs revenus. Pour certains, les premières sont inférieures aux seconds. Ils ont alors une capacité de financement qui leur permet d’augmenter leurs créances, par exemple en prêtant. D’autres, au contraire, ont un besoin de financement parce que leurs dépenses excèdent leurs revenus. Ils doivent alors augmenter leurs dettes, par exemple en empruntant. Des opérations financières permettent ainsi à la capacité de financement des uns de combler le besoin de financement des autres. Elles peuvent aussi avoir lieu entre les unités résidentes (l’économie nationale) et des unités non résidentes (le reste du monde).
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 2/ Les grandes variables et représentations de l’économie § 20Le circuit économique
§ 21Toutes les opérations économiques que nous venons d’évoquer sont regroupées par la CN en quatre grandes catégories.
§ 22 Les opérations sur produits
§ Elles décrivent l’origine des biens et services (production, importations), et leurs différentes utilisations (consommation, investissement…). Leur prise en considération permet une approche de l’économie nationale par les produits (chap. I) dont la synthèse est le tableau des entrées-‐sorties (TES). Le TES représente le système productif comme un ensemble de branches (une branche est l’ensemble des unités qui produisent le même produit).
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 2/ Les grandes variables et représentations de l’économie § 23 Les opérations de répartition
§ Elles décrivent la formation du revenu des agents (distribution et redistribution). Leur prise en compte permet une approche par les revenus (chap. II et III) qui conduit à une représentation de l’économie nationale dont les sujets ne sont plus les branches mais les secteurs institutionnels, c’est-‐à-‐dire des regroupements d’unités qui ont un comportement économique analogue (par exemple, les ménages, les sociétés).
§ 24 Les opérations financières
§ Elles décrivent les créances acquises ou cédées et les dettes contractées ou remboursées. Toutes ces opérations sont synthétisées nous le verrons au chapitre V dans des agrégats (produit intérieur brut ou PIB, revenu national…)utilisés pour les comparaisons internationales ; elles sont aussi reprises dans les comptes économiques intégrés (CEI, appelés aussi tableau économique d’ensemble, TEE) qui rassemblent toutes les opérations des secteurs institutionnels.
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 2/ Les grandes variables et représentations de l’économie
§ 25 Les opérations sur les patrimoines
§ Pendant longtemps, la CN a limité son ambition à la mise en ordre des opérations relatives à des flux. Avec le SCN 93, elle confirme nettement son ambition d’être plus exhaustive en prenant en compte aussi les stocks, qu’ils soient non financiers (valeur du stock de logements, de machines…) ou financiers (valeur des actions détenues, endettement total…). Cette volonté ne se traduit pas seulement par l’élaboration de comptes de patrimoine (chapitre IV)qui décrivent les stocks détenus par chacun des secteurs, mais aussi par des comptes qui permettent de montrer comment les changements de valeur des stocks découlent à la fois de flux de l’année (les achats d’actions par les ménages augmentent leur stock d’actions, les ventes les diminuent) et de changements de prix (la variation des cours des actions suffit à modifier la valeur de leur stock, même en l’absence de transactions). Tout ceci est aussi repris dans le TEE.
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 2/ Les grandes variables et représentations de l’économie
§ 26La CN regroupe toutes ces opérations sur la base de l’année civile er janvier au 31 décembre). Ce choix ne présente pas que des avantages. Compte tenu des délais d’établissement des comptes, une première évaluation des flux de l’année est connue avec un retard moyen de douze mois (voir chapitre VI). En outre, des comptes annuels ne permettent de calculer que des évolutions de flux en moyenne annuelle et sont donc impropres à décrire la conjoncture. C’est ainsi que l’affirmation « en 2000, les salaires ont augmenté de 3 % » ne signifie pas que les salaires ont augmenté de 3 % du début à la fin de l’année, mais que le total des salaires en 2000 est supérieur de 3 % au total des salaires en 1999. Or une telle évolution est possible en l’absence de toute hausse en glissement annuel en 2000 (c’est-‐à-‐dire entre le début et la fin de 2000) : il suffit simplement que les salaires aient augmenté entre le début et la fin de 1999. La publication de comptes nationaux trimestriels moins détaillés atténue ces inconvénients (encadré page 92). Leur importance ne cesse de croître en raison du renforcement des préoccupations pour le court terme qui accompagne les économies contemporaines exposées aux mouvements souvent erratiques des marchés financiers. Les principaux résultats des comptes trimestriels sont publiés soixante jours après la fin du trimestre et suivis de résultats plus détaillés quarante jours plus tard.
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 2/ Les grandes variables et représentations de l’économie
Chapitre 1 : Rappels grands courants et variables de l’analyse économique 2/ Les grandes variables et représentations de l’économie Passage de 4 à 2 acteurs
Chapitre 2 : « La croissance » 1/ Définitions, méthodes et évolutions du calcul de la richesse produite 2/ Secteurs et branches en France : définitions, et structure de l’appareil productif 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
ISEG BUSINESS SCHOOL 1ère ANNEE Christophe AUSTRUY Semestre 2
1/ Définitions, méthodes et évolutions du calcul de la richesse produite • Rappel = Production et VA (cf cours 1er semestre) • Produit intérieur brut (PIB) : agrégat représentant le résultat final de
l’activité de production des unités productrices résidentes. Il peut se définir de trois manières :
• la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d’activite, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches d’activite) ;
• VA = CA – CI (si non on compte deux ou x fois) • la somme des emplois finals intérieurs de biens et de services
(consommation finale effective, formation brute de capital fixe, variations de stocks), plus les exportations, moins les importations ; la somme des emplois des comptes d’exploitation des secteurs institutionnels (rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations moins les subventions, excédent brut d’exploitation et revenu mixte).
Chapitre 2 : « La croissance » 1/ Définitions, méthodes, évolutions du calcul de la richesse produite
1/ Définitions, méthodes et évolutions du calcul de la richesse produite • (A) PiB courants & (B) PiB constants & (C) PiB en PPA • Trois manières d’estimer la production nationale & mondiale
• => enjeu majeur les stats • => place, prestige, financement, notes internationales, aides,
décisions de localisation ou pour être leader • A/ PiB courants en € ou $ courants
• PiB aux prix de l’année en cours • Intégration de l’augmentation des px (inflation d’une année sur
l’autre) • Production réelle reste la même mais le PIB en valeur augmente
(illusion optique monétaire)
Chapitre 2 : « La croissance » 1/ Définitions, méthodes, évolutions du calcul de la richesse produite
Chapitre 2 : « La croissance » 1/ Définitions, méthodes, évolutions du calcul de la richesse produite
Panorama de l’économie mondiale
M. Fouquin, H. Guimbard, C. Herzog & D. Ünal Décembre 2012
Produit intérieur brut courant
7
Structure en pourcentage Variation
2013 1960 1970 1980 1990 2000 2013 2013-1960
Amérique du Nord 19 389 42,2 38,6 29,0 30,3 35,0 25,5 -16,7 Etats-Unis 16 246 38,1 34,3 24,6 26,4 30,8 21,4 -16,7 Canada 1 870 3,0 2,9 2,4 2,7 2,2 2,5 -0,5 Mexique 1 273 1,2 1,4 2,0 1,3 2,0 1,7 0,5Amérique du Sud 4 908 4,8 4,5 5,0 4,0 4,6 6,5 1,7 Brésil 2 456 1,1 1,4 2,1 2,1 2,0 3,2 2,1Union européenne (27) 17 593 25,7 28,6 33,4 33,3 26,2 23,2 -2,5 Union européenne (15)* 16 144 22,4 25,7 31,0 31,3 25,0 21,3 -1,2 Zone euro* 12 859 15,6 19,8 24,4 25,1 19,3 16,9 1,3 Allemagne* 3 578 4,0 6,1 7,3 7,0 5,8 4,7 0,7 France 2 793 4,5 4,9 6,1 5,7 4,1 3,7 -0,8 Italie 2 090 2,9 3,6 4,1 5,2 3,4 2,8 -0,2 Royaume-Uni 2 575 5,3 4,2 4,8 4,6 4,6 3,4 -1,9Autres Europe 2 458 3,0 2,7 3,1 3,1 2,7 3,2 0,3 Turquie 872 1,4 0,8 0,8 0,9 0,8 1,1 -0,3CEI 3 006 1,7 1,1 4,0 4,0 Russie 2 299 0,9 0,8 3,0 3,0 Ukraine 199 0,4 0,1 0,3 0,3Moyen-orient, Maghreb 3 085 1,6 1,7 4,8 2,6 2,5 4,1 2,5 Arabie saoudite 642 0,2 0,2 1,5 0,5 0,6 0,8 0,7 Egypte 254 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0Afrique sub-saharienne 1 460 2,3 2,2 2,4 1,4 1,1 1,9 -0,4 Afrique du Sud 478 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 0,6 0,1 Nigéria 298 0,3 0,4 0,6 0,1 0,1 0,4 0,1Japon 6 062 3,3 7,0 9,6 14,1 14,6 8,0 4,7Asie de l'Est et du Sud-Est 13 313 7,2 5,6 5,8 5,7 8,7 17,5 10,3 ASEAN 10 2 494 2,2 1,9 1,9 1,6 1,9 3,3 1,1 Chine 8 777 4,5 3,1 2,7 1,8 3,7 11,6 7,1 Corée du Sud 1 243 0,3 0,3 0,6 1,2 1,6 1,6 1,4 Taiwan 520 0,1 0,2 0,4 0,8 1,0 0,7 0,6Océanie et autres Asie 4 679 5,7 5,0 4,2 3,8 3,5 6,2 0,5 Australie/Nelle-Zélande 1 877 1,8 1,7 1,8 1,7 1,4 2,5 0,6
Inde 2 120 2,7 2,0 1,6 1,4 1,4 2,8 0,1 Asie et Océanie nda 683 1,2 1,2 0,8 0,7 0,7 0,9 -0,3Monde 75 937 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
Source : CEPII, base de données CHELEM-PIB* y.c. l'Allemagne de l'Est à partir de 1991
PIB exprimé en milliards de dollars aux prix nationaux
et taux de change courants
Chapitre 2 : « La croissance » 1/ Définitions, méthodes, évolutions du calcul de la richesse produite
• B/ PiB constants en € ou $ • PiB aux prix d’une seule année de référence (base 2000 ou
base 2005) • Pas intégration de l’augmentation des px (pas d’inflation) • Seule la production réelle fait varier le PiB • Pas d’illusion d’optique monétaire • Toutes les productions de toutes les années sont estimées
avec les prix de l’année de référence
Chapitre 2 : « La croissance » 1/ Définitions, méthodes, évolutions du calcul de la richesse produite
• C/ PiB en Parité de Pouvoir d’Achat • Question de savoir ce que l’on peut acheter avec l’argent gagné • Salaires très hauts => Niveaux de vie très élevés ? • => NON • Salaires très hauts & Prix très haut = Pouvoir Achat Identique • Salaires très bas & Prix très bas = Pouvoir achat identique • PPA de la parité de la monnaie à partir du prix des biens dans les
pays que l’on compare • Choix 1 panier de biens de consommation • = PB France = (1 taxi / 1 pain / 1 stylo / 1 repas / 1 McDo) = 100 € • = PB USA = (1 taxi / 1 pain / 1 stylo / 1 repas / 1 McDo) = 120 $
• TAUX REEL = PB USA / PB RF = 120/100 = 1,2 $ = 1 € • Alors que sur le marché 1€ = 1,35$ • => DIFFERENCE REMARQUABLE ENTRE le 1er Slide et le 2ème Slide
Chapitre 2 : « La croissance » 1/ Définitions, méthodes, évolutions du calcul de la richesse produite
Panorama de l’économie mondiale
M. Fouquin, H. Guimbard, C. Herzog & D. Ünal Décembre 2012
Produit intérieur brut à parité de pouvoir d’achat 2005**
8
Variation
2013 1960 1970 1980 1990 2000 2013 2013-1960
Amérique du Nord 16 798 30,1 27,7 26,2 26,5 27,8 22,2 -7,9 Etats-Unis 13 944 26,2 23,6 21,5 22,2 23,3 18,4 -7,8 Canada 1 284 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 1,7 -0,5 Mexique 1 570 1,8 2,1 2,6 2,3 2,4 2,1 0,3Amérique du Sud 5 025 6,5 6,4 7,3 6,2 6,3 6,6 0,2 Brésil 2 161 2,1 2,3 3,4 3,0 2,9 2,9 0,8Union européenne (27) 14 316 31,1 30,2 28,1 26,7 24,9 18,9 -12,2 Union européenne (15)* 12 478 27,5 26,9 24,4 23,3 22,4 16,5 -11,0 Zone euro* 10 066 20,5 21,1 19,7 18,9 18,2 13,3 -7,2 Allemagne* 2 873 6,4 6,2 5,5 5,2 5,2 3,8 -2,6 France 1 985 4,2 4,3 4,1 3,9 3,6 2,6 -1,6 Italie 1 610 3,9 4,1 3,9 3,7 3,3 2,1 -1,8 Royaume-Uni 2 093 5,7 4,5 3,6 3,6 3,5 2,8 -2,9Autres Europe 2 075 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,7 -0,4 Turquie 1 047 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,4 0,4CEI 3 235 7,3 3,5 4,3 4,3 Russie 2 265 5,2 2,6 3,0 3,0 Ukraine 310 1,2 0,4 0,4 0,4Moyen-orient, Maghreb 3 758 4,0 5,0 6,4 4,5 4,6 5,0 1,0 Arabie saoudite 659 0,4 0,5 1,2 0,9 0,8 0,9 0,5 Egypte 480 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,3Afrique sub-saharienne 1 976 3,0 2,7 2,5 2,3 2,2 2,6 -0,4 Afrique du Sud 571 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 -0,2 Nigéria 417 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,1Japon 4 065 4,9 7,5 7,7 9,1 7,6 5,4 0,4Asie de l'Est et du Sud-Est 17 544 4,2 4,2 5,5 8,8 13,7 23,2 19,0 ASEAN 10 3 192 1,7 1,8 2,2 2,9 3,5 4,2 2,5 Chine 11 710 1,9 1,6 1,9 3,5 7,0 15,5 13,6 Corée du Sud 1 474 0,3 0,4 0,7 1,3 1,8 1,9 1,6 Taiwan 838 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,1 0,9Océanie et autres Asie 6 892 5,0 5,2 4,8 5,7 6,6 9,1 4,1 Australie/Nelle-Zélande 1 016 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 -0,3 Inde 4 627 2,3 2,5 2,3 2,9 3,7 6,1 3,8 Asie et Océanie nda 1 249 1,1 1,1 1,2 1,5 1,4 1,7 0,6Monde 75 665 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
Source : CEPII, base de données CHELEM-PIB* y.c. l'Allemagne de l'Est à partir de 1991
**Le PIB PPA est le produit intérieur brut converti en dollars internationaux en utilisant les taux de parité de pouvoir d'achat; un dollar international a le même pouvoir d'achat que le dollar américain aux Etats-Unis; les données sont exprimées en milliards de dollars internationaux constants de 2005.
PIB en milliards de dollars internationaux constants Structure en pourcentage
et parités de pouvoir d'achat de 2005
Chapitre 2 : « La croissance » 1/ Définitions, méthodes, évolutions du calcul de la richesse produite
Panorama de l’économie mondiale
M. Fouquin, H. Guimbard, C. Herzog & D. Ünal Décembre 2012
Evolution des parts dans le PIB mondial en parité de pouvoir d’achat 2005*
1960 – 2013(en % du PIB PPA mondial)
9
Source : CEPII, base de données CHELEM-PIB*Voir page 8
%%%
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12
Europe Afrique Moyen-orient
Amérique
Asie Océanie
13
Chapitre 2 : « La croissance » 1/ Définitions, méthodes, évolutions du calcul de la richesse produite
Panorama de l’économie mondiale
M. Fouquin, H. Guimbard, C. Herzog & D. Ünal Décembre 2012
Evolution des parts dans le PIB mondial en parité de pouvoir d’achat 2005*
1960 – 2013(en % du PIB PPA mondial)
10
Source : CEPII, base de données CHELEM-PIB*Voir page 8
Un demi siècle de déclin lent et régulier de l’union européenne masqué par les vagues successives d’élargissement.
Un demi siècle de déclin lent et régulier de l’union européenne masqué par les vagues successives d’élargissement
Un demi siècle de déclin lent et régulier de l’union européenne masqué par les vagues successives d’élargissement.
Un déclin lent et régulier de l’union européenne masquépar les vagues successives d’élargissement.
0
5
10
15
20
25
30
35
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Chine
UE 6 UE 9
UE 12 UE 15
Union européenne à 27
Etats-Unis
Chapitre 2 : « La croissance » 1/ Définitions, méthodes, évolutions du calcul de la richesse produite
Investissement par secteur institutionnel
2011en
milliardsd'euros
Évolutionen valeur en %
Évolutionen volume en %
10/09 11/10 10/09 11/10
Entreprises non financières 213,4 7,2 7,5 6,3 5,1Entreprises financières 13,6 – 12,1 10,2 … …Administrations publiques 61,4 – 6,1 1,6 – 8,1 – 1,9Ménages 108,9 1,3 7,1 – 0,4 3,1ISBLSM 4,0 4,1 3,2 … …Total 401,2 2,5 6,5 1,2 3,5
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
Capacité ou besoin de financement des secteursinstitutionnels
en milliards d'euros
2009 (r) 2010 (r) 2011
Sociétés non financières – 15,8 – 17,1 – 64,9Sociétés financières 31,2 27,6 28,7Administrations publiques – 142,6 – 137,4 – 103,9
Administrations centrales – 121,7 – 112,7 – 90,2État – 117,1 – 121,8 – 87,5ODAC – 4,6 9,1 – 2,7Administrations locales – 5,9 – 1,4 – 0,9Administrations de sécurité sociale – 15,0 – 23,3 – 12,7
Ménages1 93,8 89,7 89,8ISBLSM 0,5 0,0 – 0,7Nation – 32,9 – 37,1 – 51,0
1. Y compris entrepreneurs individuels.Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
Principaux agrégats de la comptabilité nationalepar habitant en euros courants par habitant
2010 (r) 2011(p)
Produit intérieur brut 29 885 30 634Revenu disponible brut des ménages 19 898 20 307
Dépense de consom. finale indiv. des ménages 16 731 17 032Épargne brute des ménages 3 167 3 275
Capacité de financement des ménages 1 384 1 377
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
PIB par habitant dans l'Union européenneen indice base 100 pour l'UE à 27
2010 (r) 2011 (p) 2010 (r) 2011 (p)
Allemagne 118 120 Lettonie1 55 58Autriche 126 129 Lituanie 57 62Belgique 119 118 Luxembourg 271 274Bulgarie 44 45 Malte 82 83Chypre 95 92 Pays-Bas 133 131Danemark 127 125 Pologne 63 65Espagne 100 99 Portugal 80 77Estonie 64 67 Rép. tchèque 80 80Finlande 115 116 Roumanie 47 49France 108 107 Royaume-Uni 112 108Grèce (p) 90 82 Slovaquie 73 73Hongrie 65 66 Slovénie 85 84Irlande 127 127 Suède 124 126Italie 100 101 UE à 27 100 100
1. Ruptures de série en 2010.Champ : les chiffres de base sont exprimés en standards de pouvoir d'achat(SPA), c'est-à-dire dans une monnaie commune qui élimine les différences deniveaux de prix entre les pays, permettant des comparaisons significatives. Cetindice est destiné aux comparaisons internationales plutôt qu'aux comparaisonstemporelles.Source : Eurostat.
Principaux indicateurs économiques 11.1
Économie générale 111
Taux de marge et taux d'investissement des sociétésnon financières de 1950 à 2011
15
20
25
30
35
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
en %
Taux de marge(EBE / VA brute)
Taux d'investissement(FBCF / VA brute)
Champ : sociétés non financières hors entreprises individuelles.Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
en valeuren volume
-4
0
4
8
12
16
20
24
28
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Évolution du PIB en France de 1950 à 2011évolution par rapport à l'année précédente en %
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
Ressources et emplois de biens et services à prix courants en milliards d’euros
Ressources 2010 (r) 2011 Emplois 2010 (r) 2011
Produit intérieur brut (PIB) 1 937,3 1 996,6 Consommation finale 1 606,2 1 640,6Valeur ajoutée au prix de base 1 741,5 1 789,0 Ménages 1 084,6 1 110,1Impôts sur les produits 210,9 222,6 Administrations publiques 481,8 489,3Subventions sur les produits – 15,1 – 15,0 ISBLSM 39,8 41,2
Importations 537,4 594,3 Formation Brute de Capital Fixe 376,7 401,2Acquisitions, nettes de cessions, d'objets de valeur 0,7 0,8Variation de stocks – 4,2 10,1
Total des ressources et des emplois 2 474,7 2 590,9 Exportations 495,3 538,2
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
Chapitre 2 : « La croissance » 1/ Définitions, méthodes, évolutions du calcul de la richesse produite
• Analyse de l’évolution de l’UE, des USA et de la Chine • L’UE passe 33% à 20% • => Perte de 12 points dans le PiB mondial
• Les USA passent 26% à 18% • => Perte de 8 points dans le PiB mondial
• => UE + USA = Perte de 20 points • La Chine passe de 3% à 15% • => Gain de 14 points dans le PiB mondial
• L’Asie et l’Océanie (Inde + Chine + etc) passe de 9% à 32% • => Asie + Océanie = Gain de 23 points
Chapitre 2 : « La croissance » 2/ Secteurs et branches en France : définitions, et structure de
l’appareil productif
2/ Secteurs et branches en France : définitions, et structure de l’appareil productif Secteur d’activite : regroupe des entreprises qui ont la même activité principale (au regard de la nomenclature d’activite économique considérée). L’activite d’un secteur n’est donc pas tout à fait homogène et comprend des productions secondaires qui relèveraient d’autres codes de la nomenclature que celui du secteur considére. Au contraire, une branche regroupe des unités de production homogènes. Branche d’activite : regroupe des unités de production homogènes, c’est-‐à-‐dire qui fabriquent des produits (ou rendent des services) qui appartiennent au même item de la nomenclature d’activite économique considérée. Au contraire, un secteur regroupe des entreprises classées selon leur activite principale. Définition INSEE
Chapitre 2 : « La croissance » 2/ Secteurs et branches en France : définitions, et structure de
l’appareil productif
Un « secteur S » est formé de toutes les unités légales ayant l’activité principale S alors qu’une « branche d’activité B » décrit de façon conceptuelle une « activité B », que celle-‐ci soit réalisée à titre principal ou à titre secondaire par des unités légales. Participent ainsi à une « branche B » toutes les unités légales qui fabriquent des produits (ou rendent des services) correspondant à la « sous-‐classe B » quelle que soit la part, même très faible, de ces produits (ou services) dans leur chiffre d’affaires. Sources : INSEE
Chapitre 2 : « La croissance » 2/ Secteurs et branches en France : définitions, et structure de
l’appareil productif
2/ Secteurs et branches en France : définitions, et structure de l’appareil productif Classement plus ou moins agrégé: De de plusieurs centaines de branches (code NAF) à 3 secteurs Secteur primaire : recouvre le champ des activités liées à l’exploitation directe des ressources naturelles : pêche, mines, sylviculture, agriculture, extraction, etc. Secteur secondaire : recouvre le champ des activités liées à la transformation des ressources du secteur primaire : industrie, industrie agro-‐alimentaire, pétro-‐chimie, etc. Secteur tertiaire : recouvre un vaste champ d’activités qui va du commerce à l’administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l’éducation, la santé et l’action sociale. Le périmètre du secteur tertiaire est de fait défini par complémentarite avec les activités agricoles et industrielles (secteurs primaire et secondaire).
Chapitre 2 : « La croissance » 2/ Secteurs et branches en France : définitions, et structure de
l’appareil productif
Économie générale 115
Production des branches 11.3
Valeur ajoutée brute par branche d’activité
Valeur ajoutéeen milliards d’euros courants
Évolution en volumeaux prix de l’année précédente en %
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 (r) 2011 (p) 2009 (r) 2010 (r) 2011 (p)
Agriculture, sylviculture et pêche 2,5 5,1 8,6 17,0 34,4 31,8 31,8 32,8 0,0 – 5,7 3,9Ind. manufacturière, ind. extractives et autres 3,7 11,3 27,4 94,4 190,2 229,7 222,9 224,6 – 7,5 3,3 0,5Ind. extractives, énergie, eau,gestion des déchets et dépollution 0,3 1,0 2,8 12,7 27,3 33,5 43,5 43,8 – 8,3 1,2 – 0,6Fabr. de denrées alimentaires, de boissonset de produits à base de tabac 0,6 1,4 3,4 12,4 26,8 30,7 30,1 30,1 0,9 – 1,6 – 0,8Cokéfaction et raffinage 0,1 0,3 0,5 2,4 1,6 2,2 2,5 3,5 – 32,0 27,7 – 0,3Fabr. de machines et d’équip. électriques1 0,5 1,6 4,2 13,6 26,0 32,5 23,9 25,5 – 18,4 6,8 6,4Fabrication de matériels de transport 0,2 0,7 1,9 6,7 13,9 19,1 17,5 13,8 – 22,7 19,4 – 15,6Fabrication d’autres produits industriels 2,0 6,3 14,7 46,7 94,6 111,6 105,4 107,9 – 4,2 2,3 2,6Construction 0,7 2,7 8,8 30,2 59,8 64,5 106,4 110,1 – 6,0 – 4,8 0,0Services principalement marchands 5,0 16,1 48,5 181,8 462,0 693,3 987,1 1 017,2 – 3,4 2,2 2,4Commerce, transports, héb. et restauration 2,8 8,3 21,0 73,3 172,9 234,1 320,3 332,0 – 5,3 3,0 3,0Information et communication 0,3 1,0 3,4 15,0 40,7 63,5 86,5 86,1 – 4,3 3,1 2,5Activités financières et d’assurance 0,3 1,2 4,1 15,7 43,7 57,7 83,7 83,3 5,0 – 0,9 3,4Activités immobilières 0,5 2,2 8,8 31,8 90,9 150,9 229,1 236,7 0,9 1,3 1,1Act. scient. et tech. ; serv. adm. et de soutien 0,6 2,3 8,6 36,1 90,6 146,0 208,1 218,8 – 7,9 3,4 3,5Autres services 0,3 1,0 2,6 9,8 23,3 41,0 59,4 60,2 – 0,3 0,7 0,0Services principalement non marchands2 1,7 5,4 16,0 72,8 177,6 269,8 393,3 404,3 1,1 0,9 1,2Total des branches 13,5 40,6 109,3 396,2 924,0 1 289,1 1 741,5 1 789,0 – 3,0 1,5 1,8
1. Y compris fabrication d’équipements électroniques et informatiques. 2. Correspond au regroupement « Administration publique », « Enseignement », « Santé humaine et action sociale ».Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
Production par branche d’activité
Productionen milliards d’euros courants
Évolution en volumeaux prix de l’année précédente en %
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 (r) 2011 (p) 2009 (r) 2010 (r) 2011 (p)
Agriculture, sylviculture et pêche 4,3 9,1 15,3 39,4 71,9 75,9 80,3 85,7 0,4 – 2,2 2,2Ind. manufacturière, ind. extractives et autres 14,3 38,5 87,6 307,0 569,9 772,5 871,9 929,6 – 10,0 4,8 2,0Ind. extractives, énergie, eau,gestion des déchets et dépollution 1,0 3,0 6,6 28,0 55,6 76,1 144,7 148,0 – 2,1 5,5 – 3,9Fabr. de denrées alimentaires, de boissonset de produits à base de tabac 4,5 9,1 17,4 52,8 105,9 122,4 141,8 151,1
– 1,7 0,9 1,9
Cokéfaction et raffinage 0,4 1,2 3,2 23,6 19,5 34,5 40,8 50,6 – 14,9 – 7,9 0,0Fabr. de machines et d’équip. électriques1 1,3 4,4 11,9 39,9 73,2 107,2 86,2 91,2 – 18,4 8,8 5,1Fabrication de matériels de transport 0,8 2,9 7,2 27,5 65,3 110,2 117,5 127,0 – 16,9 11,9 5,6Fabrication d’autres produits industriels 6,4 17,9 41,4 135,1 250,5 322,3 340,8 361,7 – 10,9 4,4 2,8Construction 1,8 7,0 22,2 73,6 142,2 169,2 256,2 269,8 – 6,8 – 5,2 1,4Services principalement marchands 9,2 28,9 83,0 323,0 800,9 1 228,2 1 766,9 1 827,1 – 4,0 2,3 2,4Commerce, transports, héb. et restauration 5,2 15,3 37,3 133,4 305,2 442,2 611,7 640,4 – 5,9 2,9 2,8Information et communication 0,7 2,0 6,0 26,3 69,5 123,3 179,3 181,0 – 2,0 3,4 2,4Activités financières et d’assurance 0,6 2,3 8,5 39,1 107,9 133,5 187,8 186,2 1,2 – 0,8 0,3Activités immobilières 0,6 2,5 10,6 41,0 115,9 186,3 282,9 289,5 – 0,9 1,3 1,2Act. scient. et tech. ; serv. adm. et de soutien 1,5 5,0 16,4 67,4 165,8 279,9 410,7 433,3 – 7,2 3,1 4,0Autres services 0,6 1,7 4,3 15,9 36,7 63,0 94,5 96,8 1,2 1,9 0,5Services principalement non marchands2 2,7 8,1 23,8 103,0 242,5 358,9 525,3 535,1 1,9 1,7 0,2Total des branches 32,3 91,5 232,0 846,1 1 827,4 2 604,8 3 500,7 3 647,4 – 4,9 2,1 1,9
1. Y compris fabrication d’équipements électroniques et informatiques. 2. Correspond au regroupement « Administration publique », « Enseignement », « Santé humaine et action sociale ».Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011Note : valeur ajoutée brute par branche en volume aux prix de l'année précédente chaînés.Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
Contribution des principales branches d'activité à l'évolution de la valeur ajoutéeen points
Agriculture, sylviculture et pêcheIndustrieConstructionServices principalement marchandsServices principalement non marchands
Chapitre 2 : « La croissance » 2/ Secteurs et branches en France : définitions, et structure de
l’appareil productif
Économie générale 115
Production des branches 11.3
Valeur ajoutée brute par branche d’activité
Valeur ajoutéeen milliards d’euros courants
Évolution en volumeaux prix de l’année précédente en %
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 (r) 2011 (p) 2009 (r) 2010 (r) 2011 (p)
Agriculture, sylviculture et pêche 2,5 5,1 8,6 17,0 34,4 31,8 31,8 32,8 0,0 – 5,7 3,9Ind. manufacturière, ind. extractives et autres 3,7 11,3 27,4 94,4 190,2 229,7 222,9 224,6 – 7,5 3,3 0,5Ind. extractives, énergie, eau,gestion des déchets et dépollution 0,3 1,0 2,8 12,7 27,3 33,5 43,5 43,8 – 8,3 1,2 – 0,6Fabr. de denrées alimentaires, de boissonset de produits à base de tabac 0,6 1,4 3,4 12,4 26,8 30,7 30,1 30,1 0,9 – 1,6 – 0,8Cokéfaction et raffinage 0,1 0,3 0,5 2,4 1,6 2,2 2,5 3,5 – 32,0 27,7 – 0,3Fabr. de machines et d’équip. électriques1 0,5 1,6 4,2 13,6 26,0 32,5 23,9 25,5 – 18,4 6,8 6,4Fabrication de matériels de transport 0,2 0,7 1,9 6,7 13,9 19,1 17,5 13,8 – 22,7 19,4 – 15,6Fabrication d’autres produits industriels 2,0 6,3 14,7 46,7 94,6 111,6 105,4 107,9 – 4,2 2,3 2,6Construction 0,7 2,7 8,8 30,2 59,8 64,5 106,4 110,1 – 6,0 – 4,8 0,0Services principalement marchands 5,0 16,1 48,5 181,8 462,0 693,3 987,1 1 017,2 – 3,4 2,2 2,4Commerce, transports, héb. et restauration 2,8 8,3 21,0 73,3 172,9 234,1 320,3 332,0 – 5,3 3,0 3,0Information et communication 0,3 1,0 3,4 15,0 40,7 63,5 86,5 86,1 – 4,3 3,1 2,5Activités financières et d’assurance 0,3 1,2 4,1 15,7 43,7 57,7 83,7 83,3 5,0 – 0,9 3,4Activités immobilières 0,5 2,2 8,8 31,8 90,9 150,9 229,1 236,7 0,9 1,3 1,1Act. scient. et tech. ; serv. adm. et de soutien 0,6 2,3 8,6 36,1 90,6 146,0 208,1 218,8 – 7,9 3,4 3,5Autres services 0,3 1,0 2,6 9,8 23,3 41,0 59,4 60,2 – 0,3 0,7 0,0Services principalement non marchands2 1,7 5,4 16,0 72,8 177,6 269,8 393,3 404,3 1,1 0,9 1,2Total des branches 13,5 40,6 109,3 396,2 924,0 1 289,1 1 741,5 1 789,0 – 3,0 1,5 1,8
1. Y compris fabrication d’équipements électroniques et informatiques. 2. Correspond au regroupement « Administration publique », « Enseignement », « Santé humaine et action sociale ».Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
Production par branche d’activité
Productionen milliards d’euros courants
Évolution en volumeaux prix de l’année précédente en %
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 (r) 2011 (p) 2009 (r) 2010 (r) 2011 (p)
Agriculture, sylviculture et pêche 4,3 9,1 15,3 39,4 71,9 75,9 80,3 85,7 0,4 – 2,2 2,2Ind. manufacturière, ind. extractives et autres 14,3 38,5 87,6 307,0 569,9 772,5 871,9 929,6 – 10,0 4,8 2,0Ind. extractives, énergie, eau,gestion des déchets et dépollution 1,0 3,0 6,6 28,0 55,6 76,1 144,7 148,0 – 2,1 5,5 – 3,9Fabr. de denrées alimentaires, de boissonset de produits à base de tabac 4,5 9,1 17,4 52,8 105,9 122,4 141,8 151,1
– 1,7 0,9 1,9
Cokéfaction et raffinage 0,4 1,2 3,2 23,6 19,5 34,5 40,8 50,6 – 14,9 – 7,9 0,0Fabr. de machines et d’équip. électriques1 1,3 4,4 11,9 39,9 73,2 107,2 86,2 91,2 – 18,4 8,8 5,1Fabrication de matériels de transport 0,8 2,9 7,2 27,5 65,3 110,2 117,5 127,0 – 16,9 11,9 5,6Fabrication d’autres produits industriels 6,4 17,9 41,4 135,1 250,5 322,3 340,8 361,7 – 10,9 4,4 2,8Construction 1,8 7,0 22,2 73,6 142,2 169,2 256,2 269,8 – 6,8 – 5,2 1,4Services principalement marchands 9,2 28,9 83,0 323,0 800,9 1 228,2 1 766,9 1 827,1 – 4,0 2,3 2,4Commerce, transports, héb. et restauration 5,2 15,3 37,3 133,4 305,2 442,2 611,7 640,4 – 5,9 2,9 2,8Information et communication 0,7 2,0 6,0 26,3 69,5 123,3 179,3 181,0 – 2,0 3,4 2,4Activités financières et d’assurance 0,6 2,3 8,5 39,1 107,9 133,5 187,8 186,2 1,2 – 0,8 0,3Activités immobilières 0,6 2,5 10,6 41,0 115,9 186,3 282,9 289,5 – 0,9 1,3 1,2Act. scient. et tech. ; serv. adm. et de soutien 1,5 5,0 16,4 67,4 165,8 279,9 410,7 433,3 – 7,2 3,1 4,0Autres services 0,6 1,7 4,3 15,9 36,7 63,0 94,5 96,8 1,2 1,9 0,5Services principalement non marchands2 2,7 8,1 23,8 103,0 242,5 358,9 525,3 535,1 1,9 1,7 0,2Total des branches 32,3 91,5 232,0 846,1 1 827,4 2 604,8 3 500,7 3 647,4 – 4,9 2,1 1,9
1. Y compris fabrication d’équipements électroniques et informatiques. 2. Correspond au regroupement « Administration publique », « Enseignement », « Santé humaine et action sociale ».Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011Note : valeur ajoutée brute par branche en volume aux prix de l'année précédente chaînés.Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
Contribution des principales branches d'activité à l'évolution de la valeur ajoutéeen points
Agriculture, sylviculture et pêcheIndustrieConstructionServices principalement marchandsServices principalement non marchands
Chapitre 2 : « La croissance » 2/ Secteurs et branches en France : définitions, et structure de
l’appareil productif Parts de marché du commerce de détail selon laforme de vente en % de la valeur TTC
Formes de vente1 Produitsalimentaires(hors tabac)
Produits nonalimentaires
2010 (p) 2011(p) 2010 (p) 2011(p)
Alimentation spécialisée2 17,8 17,8Boulangeries-pâtisseries 6,5 6,5Boucheries-charcuteries 4,6 4,6Autres magasins d'alim. spécialisée 6,5 6,5
Petites surfaces d’alim. généraleet magasins de produits surgelés 6,6 6,7Grandes surfaces d’alim. générale 65,8 64,5 17,1 17,7dont : supermarchés 30,4 29,7 6,4 7,1
hypermarchés 34,0 33,4 10,4 10,4Grands magasins et autres magasinsnon alim. non spécialisés 0,1 0,1 1,9 1,9Magasins non alimentairesspécialisés (y c. pharmacies) 1,0 1,2 55,8 55,8
Carburant 0,4 0,5 4,0 4,3Pharmacies3 0,3 0,3 11,2 11,1Autres 0,7 0,7 40,6 40,4
Commerce hors magasin 5,5 5,9 5,0 4,8Éventaire et marché 2,9 3,0 0,7 0,7Vente à distance 1,2 1,5 3,6 3,5Autres formes 1,4 1,4 0,7 0,7
Com. de détail et artisanat com. 96,8 96,3 80,7 80,9Ventes au détail du com. automobile4 0,0 0,0 10,8 10,7Autres ventes au détail5 3,2 3,7 8,6 8,4Ensemble des ventes au détail 100,0 100,0 100,0 100,01. L'activité de certaines grandes entreprises peut relever de plusieurs formes devente : hypermarchés, supermarchés et petites surfaces d'alimentation.2. Y compris artisanat commercial.3. Pharmacies et commerce d'articles médicaux et orthopédiques.4. Ne comprend pas les ventes et réparations automobiles, inclut seulement lesventes et réparations de motocycles et les ventes de produits liés à l'automobile.5. Commerce de gros, prestataires de services et ventes directes des producteurs.Source : Insee, comptes du commerce.
Emploi salarié dans le commerce en milliers
2000 (r) 2010 (r) 2011 (p)
Commerce et réparation automobiles 380,8 380,0 378,4Commerce de gros 984,5 960,0 967,3Commerce de détail 1 490,9 1 664,3 1 680,0Total 2 856,2 3 004,3 3 025,7Champ : emploi (hors artisanat commercial) en France métropolitaine ; donnéesCVS, en NAF rév.2, au 31 décembre ; les activités de réparations sont exclues ducommerce de détail.Source : Insee, estimations d'emploi.
Activité commerciale selon la forme de vente en 2011
Formes de vente Valeuren milliards
d'euros
Évolutiondes ventes
en volume en %
2011 (p) 10/09 (r) 11/10 (p)
Alimentation spéc. et artisanat comm. 41,2 – 1,1 0,1Petites surf. d’alim. gén. et mag. deprod. surg. 13,4 0,9 0,3Grandes surfaces d’alim. générale 178,7 – 0,4 0,0Grands mag. et autres mag. non alim.non spéc. 7,4 7,3 2,2Magasins non alim. spécialisés (y c.pharmacie) 210,1 3,2 2,4
Carburants 16,7 1,0 – 0,7Technologie de l'info. et de la comm. 8,1 8,6 10,2Equipement du foyer 54,9 3,7 2,6Culture, loisirs 19,1 1,1 1,4Autres comm. de détail en magasin spéc. 111,2 3,2 2,3
Habillement-chaussures 34,3 4,2 0,5Autres équip. de la personne 17,4 4,8 4,4Pharmacies, articles médicaux et orthop. 41,1 3,6 3,4Autres magasins spécialisés 18,3 – 0,9 1,2
Commerce hors magasin 28,1 1,9 2,6Commerce de détail1 2 478,7 1,4 1,3Comm. de véhicules automobiles 83,5 1,2 2,2Entretien et réparation automobile 26,8 – 0,2 – 2,4Comm. de gros d’équip. automobiles 1,2 5,2 7,2Comm. de détail d’équip. automobiles 8,3 2,6 – 0,5Comm. et réparation de motocycles 2,8 – 0,7 1,2Comm. et réparation automobiles1 122,6 0,9 1,0Produits agricoles bruts 70,9 – 3,8 3,5Produits alim., de boissons et de tabac 123,1 3,0 5,5Biens domestiques 133,8 5,9 6,9Equipements de l'info. et de la comm. 40,9 12,3 2,8Autres équipements industriels 79,2 2,4 8,0Autres commerces de gros spécialisés 153,3 2,4 – 0,1Commerce de gros non spécialisé 14,2 4,5 0,8Commerce de gros3 615,4 3,5 4,3Intermédiaires du commerce 112,4 – 1,8 1,2
1. Ventes de marchandises TTC.2. Ventes de marchandises au détail aux ménages y compris ventes de l'artisanatcommercial : boulangeries, pâtisseries, charcuteries.3. Ventes de marchandises HT ; y compris secteurs du commerce de gros deproduits divers.Source : Insee, comptes du commerce.
Commerce - Services 179
Commerce 20.1
Chiffre d'affaires du commerce selon le secteur d'activité au sein de l'Union européenne en 2010 en milliards d'euros
Pays Commerceautomobile
Commercede gros
Commercede détail
Total Pays Commerceautomobile
Commercede gros
Commercede détail
Total
Allemagne (r) 182,1 1 014,1 474,4 1 670,5 Lettonie 1,1 11,4 5,4 17,9Autriche 26,5 135,5 54,9 216,8 Lituanie 1,9 11,9 7,3 21,1Belgique 68,1 224,5 83,4 376,0 Malte (p)1 0,3 2,7 1,5 4,5Bulgarie 2,3 29,3 9,7 41,2 Luxembourg 3,4 54,3 16,4 74,1Chypre 1,0 5,5 5,6 12,1 Pays-Bas 57,8 378,6 100,4 536,8Danemark 33,7 99,1 40,4 173,2 Pologne 26,9 176,9 96,7 300,4Espagne 70,4 366,6 221,4 658,3 Portugal 19,1 66,7 47,2 133,0Estonie 1,4 9,3 4,5 15,2 Rép. tchèque 13,5 80,1 35,5 129,1Finlande 15,4 65,1 35,5 116,0 Roumanie 7,5 50,0 27,3 84,7France 154,6 718,2 419,3 1 292,1 Royaume-Uni 154,1 881,9 385,9 1 421,9Grèce (p) 10,2 80,2 57,8 148,2 Slovaquie 4,2 27,1 16,2 47,5Hongrie 7,9 42,5 24,7 75,1 Slovénie 3,7 12,4 11,2 27,3Irlande 8,5 59,8 33,3 101,6 Suède1 23,7 111,2 56,4 191,3Italie 115,2 506,0 295,7 917,01. Données 2009. Champ : données selon la Nace rév. 2.Source : Eurostat.
0,8 0,6
Chapitre 2 : « La croissance » 2/ Secteurs et branches en France : définitions, et structure de
l’appareil productif
Entreprises 149
Entreprises 15.3
Principales caractéristiques des entreprises par catégorie au sens du décret 2008-1354, en 2010en milliers
Grandesentreprises
Entreprises detaille intermédiaire
(ETI)
Petites et moyennesentreprises (PME)
hors microentreprises
Microentreprises(MIC)
Total dont ensemblePME et MIC
Nombre d’entreprises 0,2 4,5 134,3 2 896,3 3 035,3 3 030,6Nombre d’unités légales situées en France 18,3 43,4 198,1 2 906,2 3 166,0 3 104,3Effectif salarié 3 481,8 2 836,4 3 539,9 2 508,4 12 366,3 6 048,2
Note de lecture : dans ce tableau, l’entreprise désigne « le groupe y compris ses filiales financières » ou « l’unité légale indépendante ». Ce concept nouveau se rapprochede celui d’« acteur économique ».Champ : entreprises (y compris microentreprises et autoentrepreneurs ) dont l’activité principale est non financière, non agricole et hors administrations publiques. Seulesles entreprises ayant un chiffre d’affaires strictement positif dans l’année sont retenues (ce qui écarte environ 140 000 unités légales, comme les unités légales en cours dereprise ou de cessation ou autres cas éventuels qui portent environ 55 000 emplois).Source : Insee, Esane, Clap, Lifi.
Principaux résultats par secteur des entreprises au sens du décret 2008-1354 en 2010en millions d’euros
Secteur d’activité (NAF rév. 2) Nombred’entreprises(en milliers)
Chiffred’affaires
Valeur ajoutéehors taxes
Excédent brutd’exploitation
Valeur ajoutéepar salarié
(en milliers d’euros)
Part d’entreprisesexportatrices
(en %)
Industrie manufacturière, industries extractives et autres 212,9 1 203 635 288 860 75 824 87,5 19,8dont industrie manufacturière 194,7 1 026 465 243 876 57 360 83,9 20,9Construction 435,5 272 158 97 306 22 290 70,3 10,4Commerce, transports, hébergement et restauration 955,6 1 451 378 308 874 69 303 67,2 16,3dont : commerce, réparation d’automobiles et motocycles 645,3 1 135 224 193 364 48 110 72,4 18,5
transports et entreposage 81,4 229 970 77 352 12 404 65,5 16,3hébergement et restauration 228,9 86 184 38 158 8 789 51,1 10,2
Information et communication 95,8 164 491 72 475 25 301 114,7 23,5Activités immobilières 124,5 59 181 30 923 17 706 171,4 16,6Act. spéc., scient. et tech. et act. de serv. adm. et de soutien 509,1 268 859 136 130 32 232 89,6 13,7Enseignement, santé humaine et action sociale 442,1 79 948 54 014 25 024 195,0 1,9Autres activités de services 189,5 24 816 11 228 2 729 52,4 6,8Total 3 035,3 3 549 836 1 005 887 271 641 81,3 12,6
Note de lecture : dans ce tableau, l’entreprise désigne « le groupe y compris ses filiales financières » ou « l’unité légale indépendante ». Ce concept nouveau se rapprochede celui d’« acteur économique ».Champ : entreprises dont l’activité principale est non financière, non agricole et hors administrations publiques, y compris les microentreprises. Seules les entreprisesayant un chiffre d’affaires strictement positif dans l’année sont retenues (ce qui écarte environ 140 000 unités légales, comme les unités légales en cours de reprise ou decessation ou autres cas éventuels qui portent environ 55 000 emplois).Source : Insee Lifi, Clap et Esane.
Effectifs salariés par secteur et catégorie d’entreprises au sens du décret 2008-1354, en 2010en milliers
Secteur d’activité (NAF rév. 2) Catégorie d’entreprises Total
Grandes entreprises Entreprises de tailleintermédiaire
Petites et moyennesentreprises
Micro-entreprises
Industrie manufacturière, industries extractives et autres 1 128,0 1 062,5 828,7 281,6 3 300,8dont industrie manufacturière 814,9 1 029,9 794,5 269,0 2 908,4Construction 277,7 112,8 505,8 488,2 1 384,4Commerce, transports, hébergement et restauration 1 438,1 905,3 1 237,8 1 015,9 4 597,0dont : commerce, réparation d’automobiles et motocycles 616,7 629,2 793,6 630,0 2 669,5
transports et entreposage 687,3 189,7 226,8 76,4 1 180,2hébergement et restauration 134,1 86,4 217,4 309,5 747,3
Information et communication 247,3 183,4 143,0 57,9 631,7Activités immobilières 0,0 65,7 55,4 59,3 180,4Act. spéc., scient. et tech. et act. de serv. adm. et de soutien 289,6 364,2 524,1 341,9 1 519,8Enseignement, santé humaine et action sociale 64,6 99,9 167,1 115,4 447,0Autres activités de services1 … 41,9 46,8 125,4 214,2Total 3 481,8 2 836,4 3 539,9 2 508,4 12 366,3
1. Pour des raisons de secret statistique, les grandes entreprises (GE) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) ont été regroupées.Note de lecture : dans ce tableau, l’entreprise désigne « le groupe y compris ses filiales financières » ou « l’unité légale indépendante ». Ce concept nouveau se rapprochede celui d’« acteur économique ».Champ : entreprises dont l’activité principale est non financière, non agricole et hors administrations publiques, y compris les microentreprises.Seules les entreprisesayant un chiffre d’affaires strictement positif dans l’année sont retenues (ce qui écarte environ 140 000 unités légales, comme les unités légales en cours de reprise ou decessation ou autres cas éventuels qui portent environ 55 000 emplois).Source : Insee Lifi, Clap et Esane.
Chapitre 2 : « La croissance » 2/ Secteurs et branches en France : définitions, et structure de
l’appareil productif
Entreprises 149
Entreprises 15.3
Principales caractéristiques des entreprises par catégorie au sens du décret 2008-1354, en 2010en milliers
Grandesentreprises
Entreprises detaille intermédiaire
(ETI)
Petites et moyennesentreprises (PME)
hors microentreprises
Microentreprises(MIC)
Total dont ensemblePME et MIC
Nombre d’entreprises 0,2 4,5 134,3 2 896,3 3 035,3 3 030,6Nombre d’unités légales situées en France 18,3 43,4 198,1 2 906,2 3 166,0 3 104,3Effectif salarié 3 481,8 2 836,4 3 539,9 2 508,4 12 366,3 6 048,2
Note de lecture : dans ce tableau, l’entreprise désigne « le groupe y compris ses filiales financières » ou « l’unité légale indépendante ». Ce concept nouveau se rapprochede celui d’« acteur économique ».Champ : entreprises (y compris microentreprises et autoentrepreneurs ) dont l’activité principale est non financière, non agricole et hors administrations publiques. Seulesles entreprises ayant un chiffre d’affaires strictement positif dans l’année sont retenues (ce qui écarte environ 140 000 unités légales, comme les unités légales en cours dereprise ou de cessation ou autres cas éventuels qui portent environ 55 000 emplois).Source : Insee, Esane, Clap, Lifi.
Principaux résultats par secteur des entreprises au sens du décret 2008-1354 en 2010en millions d’euros
Secteur d’activité (NAF rév. 2) Nombred’entreprises(en milliers)
Chiffred’affaires
Valeur ajoutéehors taxes
Excédent brutd’exploitation
Valeur ajoutéepar salarié
(en milliers d’euros)
Part d’entreprisesexportatrices
(en %)
Industrie manufacturière, industries extractives et autres 212,9 1 203 635 288 860 75 824 87,5 19,8dont industrie manufacturière 194,7 1 026 465 243 876 57 360 83,9 20,9Construction 435,5 272 158 97 306 22 290 70,3 10,4Commerce, transports, hébergement et restauration 955,6 1 451 378 308 874 69 303 67,2 16,3dont : commerce, réparation d’automobiles et motocycles 645,3 1 135 224 193 364 48 110 72,4 18,5
transports et entreposage 81,4 229 970 77 352 12 404 65,5 16,3hébergement et restauration 228,9 86 184 38 158 8 789 51,1 10,2
Information et communication 95,8 164 491 72 475 25 301 114,7 23,5Activités immobilières 124,5 59 181 30 923 17 706 171,4 16,6Act. spéc., scient. et tech. et act. de serv. adm. et de soutien 509,1 268 859 136 130 32 232 89,6 13,7Enseignement, santé humaine et action sociale 442,1 79 948 54 014 25 024 195,0 1,9Autres activités de services 189,5 24 816 11 228 2 729 52,4 6,8Total 3 035,3 3 549 836 1 005 887 271 641 81,3 12,6
Note de lecture : dans ce tableau, l’entreprise désigne « le groupe y compris ses filiales financières » ou « l’unité légale indépendante ». Ce concept nouveau se rapprochede celui d’« acteur économique ».Champ : entreprises dont l’activité principale est non financière, non agricole et hors administrations publiques, y compris les microentreprises. Seules les entreprisesayant un chiffre d’affaires strictement positif dans l’année sont retenues (ce qui écarte environ 140 000 unités légales, comme les unités légales en cours de reprise ou decessation ou autres cas éventuels qui portent environ 55 000 emplois).Source : Insee Lifi, Clap et Esane.
Effectifs salariés par secteur et catégorie d’entreprises au sens du décret 2008-1354, en 2010en milliers
Secteur d’activité (NAF rév. 2) Catégorie d’entreprises Total
Grandes entreprises Entreprises de tailleintermédiaire
Petites et moyennesentreprises
Micro-entreprises
Industrie manufacturière, industries extractives et autres 1 128,0 1 062,5 828,7 281,6 3 300,8dont industrie manufacturière 814,9 1 029,9 794,5 269,0 2 908,4Construction 277,7 112,8 505,8 488,2 1 384,4Commerce, transports, hébergement et restauration 1 438,1 905,3 1 237,8 1 015,9 4 597,0dont : commerce, réparation d’automobiles et motocycles 616,7 629,2 793,6 630,0 2 669,5
transports et entreposage 687,3 189,7 226,8 76,4 1 180,2hébergement et restauration 134,1 86,4 217,4 309,5 747,3
Information et communication 247,3 183,4 143,0 57,9 631,7Activités immobilières 0,0 65,7 55,4 59,3 180,4Act. spéc., scient. et tech. et act. de serv. adm. et de soutien 289,6 364,2 524,1 341,9 1 519,8Enseignement, santé humaine et action sociale 64,6 99,9 167,1 115,4 447,0Autres activités de services1 … 41,9 46,8 125,4 214,2Total 3 481,8 2 836,4 3 539,9 2 508,4 12 366,3
1. Pour des raisons de secret statistique, les grandes entreprises (GE) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) ont été regroupées.Note de lecture : dans ce tableau, l’entreprise désigne « le groupe y compris ses filiales financières » ou « l’unité légale indépendante ». Ce concept nouveau se rapprochede celui d’« acteur économique ».Champ : entreprises dont l’activité principale est non financière, non agricole et hors administrations publiques, y compris les microentreprises.Seules les entreprisesayant un chiffre d’affaires strictement positif dans l’année sont retenues (ce qui écarte environ 140 000 unités légales, comme les unités légales en cours de reprise ou decessation ou autres cas éventuels qui portent environ 55 000 emplois).Source : Insee Lifi, Clap et Esane.
Chapitre 2 : « La croissance » 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
§ 3-‐A / Le problème principal § => Expliquer pourquoi on a de la croissance dans un pays, à un
époque donnée § => D’où vient-‐elle ? § => Quels en sont les facteurs explicatifs ? § => Comment comprendre ?
§ En t = pas d’augmentation de la production § En t+1 = augmentation de la production
§ => Effets conjoncturels ou structurels ? CT ou LT ? § => Chine, USA, France, etc.
Chapitre 2 : « La croissance » 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
§ 3-‐B/ Caractérisation de la croissance § => Facteurs de production = type, qualité, identification
§ K, L, T, N, Stock Savoirs, Innovation, etc.
§ => Croissance intensive ou extensive = type de croissance § Extensive = recours à des quantités plus grandes
§ => Ex = de 100 à 200 travailleurs / de 5 à 10 machines § Intensive = même quantité de facteurs mais + intensive
§ Ex = En t : 100 travailleurs pour 10 machines => Prod = 1 M § En t+1 : 100 travailleurs pour 10 machines => Prod = 1,5 M
§ => Croissance endogène ou exogène = facteurs explicatifs § Endogène => Facteurs éco expliquent tout (même progrès
technique, dépenses Gouvernementales, connaissances) § Exogène = Facteurs externes non liés aux facteurs économiques
(le progrès technique, le stock de connaissances « tombe du ciel »).
Chapitre 2 : « La croissance » 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
3-‐C/ Le problème des rendements d’échelle § Les Rendements d’échelle =
§ => Formalisation de la croissance de la production par rapport aux facteurs de production (quantité de FP) § => Attention = différence fondamentale entre RE et EE § Rendements d’Echelle ≠ Economies d’Echelle
§ Quantité produite = Q = F(K,L) § Multiplication par m de la quantité de Facteurs de production
=> mK et mL § Question = comparaison entre
§ => F(mK, mL) et mQ = mF(K,L) § Ex : 2 fois plus de K et de L => 2K et 2L § 2 fois plus de production = 2 Q = 2 F(K,L) ? § => F(2K,2L) /// 2 Q = 2 F(K,L) = ?
§ Comparaison = plus grand ou moins ou égal ?
Chapitre 2 : « La croissance » 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
§ On distingue trois cas de RE § Cas 1 = Rendements d’Echelle Constants =
§ => F( mK ; mL ) = m F(K;L) => prod croît même vitesse que les FP
§ Cas 2 = Rendements d’Echelle Croissants = § => F( mK ; mL ) > m F(K;L) => prod croît plus vite que celle des FP
§ Cas 3 = Rendements d’Echelle Décroissants = § => F( mK ; mL ) < m F(K;L) => prod croît moins vite que celle FP
§ Importance pour les modèles théoriques origine libéral § Formulation Q = a KαLβ = Cobb-‐Douglas § F( mK, mL) = a (mK)α (mL)β = a mαmβ KαLβ= mα+β (a KαLβ) § <=> F(mK, mL) = mα+β F(K;L) = mα+β Q
§ Question => α+β Combien ? = α+β = 0 ; α+β = 1 ; α+β = 2 ; etc. § Vers O => pas d’effet de croissance de la production (décroissants) § Vers 2, 3, 10, etc. => effet très grand sur la production (croissants)
Chapitre 2 : « La croissance » 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
3-‐D/ Des interprétations théoriques 1/ Interprétation néoclassique ou néolibéral § Interprétation Solow = « A Contribution to the Theory of Economic
Growth » (1956) Quarterly Journal of Economics
§ Principes de la CPP & rendements décroissants & Cobb § Origine de la croissance = Rôle du capital technique/tête
§ => Effet + sur la productivité du travail § => + de K. technique = + de productivité = + production § => Pourquoi les pays pauvres vont rattraper les pays riches
car comme pivité faible; intro de K tech => croissance rapide
§ Solow = à LT § Croissance fonction du progrès technique § PL = Progrès technique est exogène au modèle, c'est-‐à-‐dire
qu'il ne l'explique pas mais le considère comme donné (telle une « manne tombée du ciel »)
Chapitre 2 : « La croissance » 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
3-‐D/ Des interprétations théoriques 1/ Interprétation néoclassique ou néolibéral § Croissance endogène = 80’S = Romer (1986), Lucas (1988), Becker &
Schultz(1960’s), Barro (1998), etc. § Mouvement large = variations importantes mais
§ Principes de la CPP & rendements décroissants & Cobb § => réponses aux critiques (convergence des modèles de
Solow pour les pays riches et pauvres & Progrès Tech, etc.)
§ Pl = Croissance phénomène autoentretenu par 4 Fact § F1= Stock de capital physiques (externalités + int & ext+) § F2= Technologie (RD = B&S nouveaux et Idées nouvelles) § F3= Stock capital humain (Stock connaissances => Pivité+) § F4= Capital Public (I Pub – Educ/Infrastructures => Pivité+)
Chapitre 2 : « La croissance » 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
3-‐D/ Des interprétations théoriques 2/ Interprétation Keynésienne et PostKeynésienne = § Base = Circuit économique Keynésien vertueux
§ Z (C+I+G) => Q => N => Y è Z (C+I) => Q => N => Y è etc. § Cycle 1 Cycle 2 § => Keynes = Multiplicateur d’investissement = moteur de la
croissance § = k = ΔY/ΔI = Variation de revenu provoqué par variation d’Invt
§ => k = 1/1-‐c => Plus la conso est forte => plus K augmente § => c = propension marginale à consommer
Chapitre 2 : « La croissance » 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
DEMANDE =Z CONSOMMATION (C) INVESTISSEMENT (I)
DÉPENSES PUBLIQUES (G)
PRODUCTION = Q ACTIVITÉ ENTREPRISES = EMPLOI = N ACTIVITÉ ETAT (GD TR) = EMPLOI = N
REVENUS = Y REVENUS MÉNAGES
REVENUS ENTREPRISES REVENUS ETAT
CONSOMMATION = C EPARGNE = S
Chapitre 2 : « La croissance » 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
3-‐D/ Des interprétations théoriques 2/ Interprétation Keynésienne et PostKeynésienne = R. Harrod (1939) = § Pl = Croissance équilibrée = égalité entre 3 taux
§ tC1 = croissance naturel avec 100% pop active occupée => § tC2 = croissance garanti compatible avec équilibre sur
marché des biens et entre I=S (ss spécul, thésaurisation) § tC3 = croissance effectif = tx de croissance réel
Domar(1947) = § Pl = variation de la demande = variation de la prod ? § Pl = variation de l’Invt initial va-‐t-‐il produire un variation
de la production égale ? § Condition = Croissance équilibrée § => Revenus supplémentaires engendrés par l’effet
multiplicateur permettent d’absorber la production supplémentaire obtenue
Chapitre 2 : « La croissance » 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
3-‐D/ Des interprétations théoriques 3/ Interprétation Schumpeter § « Capitalisme, Socialisme et démocratie » (1942)
§ « L’impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de la consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés (vente), les nouveaux types d’organisation industrielle – tous éléments créés par l’initiative capitaliste »
§ – « Business cycle » (1939) § Innovation n’est pas un processus continu = Production par
grappes des innovations § Phases sans et phases avec = phases de décollages =
croissance § Phases de diffusion ponctuelle, large => progrès global § Nouveaux secteurs = anciens secteurs
§ => Concept du passage d’ancien au nouveau = Destruction créatrice
Chapitre 2 : « La croissance » 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
3-‐D/ Des interprétations théoriques 4/ Interprétation institutionnaliste North = § Causes de la croissance sont dans = § -‐ « Les incitations à une organisation efficace » § -‐ Aptitude aux « arrangements institutionnels profitables à tous » § -‐ « Institutions ont été imaginées par les êtres humaines pour
créer de l’ordre et réduire l’incertitude dans l’échange » § => Principes de la pensée néo-‐classique = CPP
§ Insistance sur l’ordre, la propriété, la loi, etc. § => Indistinction dans les institutions, lesquelles ?
§ Le droit >>> la justice >>> l’Etat>>> la morale ? § La famille >>> L’école ?
Chapitre 2 : « La croissance » 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
3-‐D/ Des interprétations théoriques 4/ Interprétation par les Systèmes-‐Monde Braudel & Wallerstein & Frank & Arrighi & etc. § Question du capitalisme = XIXe ou XVIIIe ou avant ? § SM = manière d’organiser les relations économiques,
politiques et militaires au sein d’un ensemble territorial ou espace territorial
§ Economie-‐Monde = § -‐ Structure économique dépasse et joue sur les organisations
politiques territoriales § -‐ Division du travail est répartie sur plusieurs territoires &mobil
§ Empire-‐Monde § -‐ Structure économique recouvre un ensemble territorial qui est
unifié d’un point de vue politique § -‐ Division du travail dans un seul bloc politique
§ SM suppose ou permet des changements de centre hégémonique § => Venise, PB, Angl, USA, Chine ?
Chapitre 2 : « La croissance » 3/ Les modèles explicatifs de la croissance
3-‐D/ Des interprétations théoriques 4/ Interprétation institutionnaliste Simon Kuznets = § -‐ « La croissance économique d'un pays peut-‐être définie comme
étant une hausse sur longue période de sa capacité d'offrir à sa population une gamme sans cesse élargie de biens économiques. »
§ -‐ « Cette capacité croissante est fondée sur le progrès technique et les ajustements institutionnels et idéologiques qu'elle requiert. »
§ -‐ « Les fruits de la croissance s'étendent par suite aux autres secteurs de l'économie.»
§ => Insistance sur le rôle de l’offre >>> à la demande § => Rôle du progrès technique § => Fruits = sens de distribution après la prod pas avant…
107
4. Le capital public Il correspond aux infrastructures de communication et de transport. Elles sont au cœur du modèle élaboré par R.J Barro. En théorie, le capital public n’est qu’une forme de capital physique. Il résulte des investissements opérés par l’Etat et les collectivités locales. Le capital public comprend également les investissements dans les secteurs de l’éducation et la recherche. En mettant en avant le capital public, cette nouvelle théorie de la croissance souligne les imperfections du marché. Outre l’existence de situations de monopole, ces imperfections tiennent aux problèmes de l’appropriation de l’innovation. Du fait de l’existence d’externalités entre les firmes, une innovation, comme il a été dit précédemment, se diffuse d’une façon ou d’une autre dans la société. La moindre rentabilité de l’innovation qui en résulte, dissuade l’agent économique d’investir dans la recherche-développement. Dans ce contexte, il pourra incomber à l’Etat de créer des structures institutionnelles qui soutiennent la rentabilité des investissements privés et de subventionner les activités insuffisamment rentables pour les agents économiques et pourtant indispensables à la société (exemple du Génoplante4 initié par l’Etat français).
Tous ces travaux ont été poursuivis par Grossman et Helpman (1991), Aghion et Howitt (1992), Barro et Sala-i-Martin (1995)…Le progrès technique résulte ainsi d’un objectif fixé en recherche-développement, activité récompensée selon Schumpeter (1934) par la détention d’une forme de pouvoir monopolistique ex-post. S’il n’y a pas de tendance à l’épuisement de ces découvertes, les taux de croissance peuvent rester positifs à long terme. Dans ce cas, le taux de croissance à long terme dépend des actions des gouvernements (politique fiscale, respect des lois, fourniture de biens collectifs, marchés financiers…). Le gouvernement a un pouvoir d’infléchissement du taux de croissance à long terme ! Les théories de la croissance endogène reposeraient donc sur l’idée que la concurrence parfaite est mortifère, et que l’activité économique a besoin de concurrence imparfaite et d’intervention publique. En même temps, elles réitèrent l’idée selon laquelle, sur le long terme, ni le taux d’investissement, ni l’effort de formation ne suffisent à assurer une réduction des écarts de développement entre pays. Ces modèles ont été relancés ces dernières années grâce à l’intégration de nouvelles variables explicatives (régime politique, démocratie…), de nouvelles relations (dépassement de la croissance trop restrictive afin d’intégrer les analyses en termes de développement, IDH de Armatya Sen) et du principe de convergence conditionnelle (Barro). Ainsi alors que l’analyse des découvertes renvoient au rythme du progrès technologique dans les économies de pointe, l’étude de la diffusion de ces découvertes renvoie à la manière dont les économies suiveuses se partageront par imitation ces découvertes (possibilité de convergence proche du modèle néoclassique car l’imitation coûte moins cher que l’innovation).
Tableau 1 : Les théories de la croissance
LES THEORIES DE LA CROISSANCE
ORIGINE DE LA CROISSANCE
CARACTERISTIQUES
Adam Smith (1776) Division du travail Croissance illimitée Robert Malthus (1798) Réinvestissement productif du
surplus Croissance limitée en raison de la loi
de population
4 Cette stratégie de regroupement (Biogemma, Bioplante, Génoplante) a un double objectif (1) fédérer un certain nombre de projets de recherche en biotechnologie dans le but de constituer un portefeuille de brevets qui permette d’être en position plus favorable pour négocier l’accès à certaines innovations en biotechnologie détenues par des firmes de biotechnologies concurrentes ; (2) améliorer les conditions d’accès à certaines innovations en biotechnologies en négociant au nom de plusieurs semenciers.
108
David Ricardo (1817) Réinvestissement productif du surplus
Croissance limitée en raison du rendement décroissant des terres
Karl Marx (1867) Accumulation du capital Croissance limitée dans le monde de production capitaliste en raison de la baisse tendancielle du taux de profit
Joseph Schumpeter (1911), (1939)
Rôle de l’entrepreneur Grappes d’innovations
Instabilité de la croissance, théorie explicative du cycle long de type
Kondratief Harrod (1936, 1948, 1960)
Domar (1946, 1957) Modèle post-keynésien
Le taux de croissance est fonction du rapport entre le
taux d’épargne et le taux d’investissement
Instabilité de la croissance
Solow (1956, 1957, 1966)
Modèle néo-classique
Population et progrès technique exogène
Caractère transitoire de la croissance en l’absence de progrès technique
Rapport Meadows (1972)
Modèle du Club de Rome
Croissance exponentielle de 5
variables
La croissance est finie en raison de l’explosion démographique, de la pollution et de l’épuisement des
ressources naturelles Michel Aglietta (1976)
Boyer et Mistral E. (1978) Robert Boyer (1986)
Théorie de la régulation
Articulation entre régime de
productivité et régime de demande
Diversité dans le temps et dans l’espace des types de croissance
P. Romer (1986) R.E Lucas (1988) R. Barro (1990
Greenwood et Jovanovic (1990) Théories de la croissance
endogène
Capital physique, technologie, capital humain, capital public,
intermédiaires financiers
Caractère endogène de la croissance, réhabilitation de l’Etat, prise en
compte de l’histoire.
G. Becattini (1991)
Modèle des districts industriels
Forme d’organisation industrielle et territoriale
Explications des inégalités régionales de la croissance
II. LES ANALYSES EMPIRIQUES DE LA CROISSANCE Les analyses empiriques cherchent d’une part à rendre compte de la dimension historique de la croissance, d’autre part à revenir sur les déterminants de cette croissance (productivité du travail, productivité du capital et progrès technique).
A. Les étapes de la croissance de Rostow (1960) Dans les premières pages de son ouvrage Les étapes de la croissance économiques, William Rostow (1963) a précisé l’objet de son travail, il s’agissait d’une part d’exposer aux étudiants ses vues sur le processus d’industrialisation, et d’autre part, de se consacrer à l’étude de deux problèmes : l’un consistait à considérer l’histoire de l’économie du point de vue des théories économiques modernes, le second, à établir un lien entre les forces économiques et les forces sociales et politiques observables dans les sociétés étudiées. Ces objectifs étant précisés, Rostow s’empressera de poser les limites de son étude : « Je ne saurais trop souligner, dès le début, que la théorie des étapes de la croissance est une conception arbitraire et limitée de l’histoire moderne ; et on ne peut dire non plus qu’elle soit exacte dans l’absolu » (1963, p. 9). En fait, cette théorie est destinée à illustrer non seulement les caractéristiques uniformes de la modernisation des sociétés mais aussi à offrir une explication qui pourrait remplacer la
Sources : Diemer – IUFM Auvergne
Chapitre 3 : « La consommation : un phénomène économique et social » 1/ De la consommation/destruction (biens durables/non durables) aux postes de consommation : alimentation/habillement/transports télécommunications/logement/loisirs
2/ La consommation en théories : prix relatifs, « filière inversée », modes de vie, « effet démonstration/imitation », etc.
3/ « Epargne résiduelle » (Keynes) contre « Epargne primordiale » (Néo-‐classiques).
Chapitre 3 : « La consommation » 1/ De la consommation/destruction aux postes de consommation
1/ De la consommation/destruction (biens durables/non durables) aux postes de consommation : alimentation/habillement/transports télécommunications/logement/loisirs 1-‐A/ Définitions de la consommation § Consommation = utilisation/détention/destruction d’un Bien ou
Service à Ct ou Lt qui produit des effets individuels ou collectifs recherchés § => Nourriture, vêtements, transports, cultures, drogues, logt, etc. § => Satisfaction, plaisir-‐déplaisir, garantie, prévention, etc. § => B & S sont usés ou détruits en général dans le processus de
consommation § Attention consommation et satisfaction ne sont pas linéaires § => au delà x B&S consommés => prod de déplaisir § Acte de consommation ≠ acte d’achat § Consommation Finale (Ménages ou des Administrations) ≠
Consommation Intermédiaire (Entreprise)
Chapitre 3 : « La consommation » 1/ De la consommation/destruction aux postes de consommation
1-‐B/ Postes de consommation Classements = en fonction du type de B&S § => Biens durables ou Biens non durables
§ BD = Biens détruits lentement dans le processus de Conso => l’équipement électro-‐ménager, matériel info, auto, etc.
§ BND = Biens détruits rapidement dans le processus de Conso => les biens alimentaires, l’électricité, etc.
§ => Postes de consommation des ménages = nomenclature § => Codification moderne en Europe : XVIIe (Vauban 1660), XVIIIe (Davies
1795), Engel (1857), 1930-‐1960: USA = Katona Columbia University § => Grandes rubriques = grands postes de dépenses § R1/ Alimentation § R2/ Habillement § R3/ Transports et télécommunications § R4/ Lgt § R5/ Loisirs et cultures
Chapitre 3 : « La consommation » 1/ De la consommation/destruction aux postes de consommation
1-‐B/ Postes de consommation Consommation effective des ménages : elle inclut tous les biens et les services acquis par les ménages résidents pour la satisfaction de leurs besoins, que ces acquisitions aient fait, ou non, l’objet d’une dépense de leur part. La consommation effective des ménages comprend donc, en plus des biens et des services acquis par leurs propres dépenses de consommation finale, les biens et les services qui, ayant fait l’objet de dépenses de consommation individuelle des administrations publiques ou des ISBLSM, donnent lieu à des transferts sociaux en nature de leur part vers les ménages (Définition INSEE-‐ TE2013)
Coefficients Bugétaires : rôles et explications (Travaux de Engel) § => Coeff Budgétaire = Part du poste de consommation dans le Revenu (part
de l’alimentation, du logement, transports, etc. dans le Revenu des Ménag) § => Pl : Qd le revenu ì => le poste de consommation î ou ì § => 3 tendances = T1 stable, T2 augmente plus vite, T3 diminue plus vite
T1: Transports et télécommunications T2: Logement, Loisirs, Cultures T3: Alimentation, Habillement, etc.
Chapitre 3 : « La consommation » 1/ De la consommation/destruction aux postes de consommation
Consommation 75
Consommation des ménages 6.1
Consommation des ménages par fonction en 2011
Consommationen milliards d'euros
Variation annuelle en volumeen %
Poids dans la valeur de laconsommation effective en %
2011 2009 2010 2011 2001 2011
Alimentation et boissons non alcoolisées 150,8 0,2 1,1 1,0 11,1 10,2Produits alimentaires 137,6 0,0 1,0 0,9 10,2 9,3dont : pains et céréales 21,9 0,9 1,9 3,6 1,5 1,5
viandes 38,7 – 2,0 0,8 – 0,4 3,1 2,6poissons et crustacés 9,8 0,3 0,0 – 2,3 0,8 0,7lait, fromages et oeufs 21,8 1,5 2,4 1,8 1,5 1,5fruits et légumes 24,4 1,2 – 0,7 0,1 1,9 1,7
Boissons non alcoolisées 13,2 2,3 3,3 2,3 0,8 0,9Boissons alcoolisées et tabac 35,8 0,8 – 0,2 0,0 2,8 2,4Boissons alcoolisées 16,7 – 0,3 – 0,4 0,7 1,4 1,1Tabac 19,1 1,9 0,1 – 0,6 1,4 1,3Articles d'habillement et chaussures 47,7 – 3,4 0,8 – 1,2 4,0 3,2Logement, chauffage, éclairage 281,2 0,4 1,4 – 1,0 18,0 19,1dont : location de logement 204,5 1,0 1,1 1,1 13,1 13,9
chauffage, éclairage 43,4 – 0,3 4,9 – 11,2 2,9 2,9Équipement du logement 64,8 – 3,0 2,4 1,1 4,6 4,4Santé 43,3 3,0 2,1 3,9 2,6 2,9Transport 160,6 – 1,0 – 0,3 0,7 11,3 10,9Achats de véhicules 40,3 6,5 – 2,7 0,2 3,5 2,7Carburants, lubrifiants 42,1 – 1,6 – 1,1 – 0,7 2,8 2,9Services de transports 25,4 – 1,6 2,3 4,9 1,5 1,7Communications 29,1 0,5 1,9 0,3 1,9 2,0Loisirs et culture 93,6 0,8 2,8 2,4 6,8 6,4Éducation 9,2 – 5,5 – 0,9 – 1,4 0,5 0,6Hôtels, cafés et restaurants 79,0 – 3,4 1,5 1,0 5,5 5,4Autres biens et services 123,9 2,9 1,2 0,6 9,0 8,4dont : soins personnels 24,8 – 1,4 3,4 3,5 1,7 1,7
assurances 38,7 12,9 – 0,1 – 0,9 2,2 2,6Correction territoriale – 8,8 – 22,1 – 25,3 41,3 – 1,0 – 0,6Dépense de consommation des ménages 1 110,1 0,1 1,4 0,3 77,1 75,4Dépense de consommation des ISBLSM1 41,2 4,4 3,8 1,9 2,7 2,8Dépense de consommation des APU2 320,7 2,2 1,7 1,5 20,2 21,8dont : santé 141,6 3,4 2,8 1,7 8,9 9,6
éducation 95,5 – 0,2 0,3 0,5 6,7 6,5Consommation effective des ménages 1 471,9 0,7 1,5 0,6 100,0 100,0
1. Institutions sans but lucratif au service des ménages.2. Dépenses de consommation des administrations publiques en biens et services individualisables.Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
Évolution de la dépense et du pouvoir d'achatdes ménages
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
2008 2009 2010 2011
en %
1. Évolution déflatée à l'aide de l'indice du prix des dépenses de consommation finaledes ménages.2. L'évolution calculée est déflatée à l'aide de l'indice du prix des dépenses deconsommation non « pré-engagées » des ménages.Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
1
2
Dépense de consommation finale en volumePouvoir d'achat du revenu disponible brutPouvoir d'achat du revenu « arbitrable »
Dépense de consommation des ménages par fonctionde consommation dans quelques pays de l'UE27 en2010
en %
Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni
Produits alimentaires etboissons non alcoolisées 11,0 14,1 13,5 14,4 9,1Boissons alcoolisées,tabac et narcotiques 3,1 3,0 3,1 2,7 3,6Articles d'habillement etarticles chaussants 5,1 5,2 4,4 7,7 5,8Logement, eau, électricité,gaz et autres combustibles 24,6 20,2 25,4 22,2 23,4Ameubl., équip. ménager etentretien courant de la maison 6,2 4,8 5,8 7,1 5,2Santé 5,1 3,5 3,8 3,0 1,8Transports 13,4 11,6 13,9 12,9 14,5Communications 2,7 2,8 2,7 2,4 2,1Loisirs et culture 9,2 8,2 8,5 7,2 11,0Enseignement 1,0 1,4 0,8 1,0 1,5Hôtels, cafés et restaurants 5,8 16,9 7,0 9,8 9,9Autres biens et services 12,8 8,1 11,0 9,6 12,1Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Eurostat.
1-‐B/ Postes de consommation
Chapitre 3 : « La consommation » 1/ De la consommation/destruction aux postes de consommation
1-‐B/ Postes de consommation en UE (2010)
Consommation 75
Consommation des ménages 6.1
Consommation des ménages par fonction en 2011
Consommationen milliards d'euros
Variation annuelle en volumeen %
Poids dans la valeur de laconsommation effective en %
2011 2009 2010 2011 2001 2011
Alimentation et boissons non alcoolisées 150,8 0,2 1,1 1,0 11,1 10,2Produits alimentaires 137,6 0,0 1,0 0,9 10,2 9,3dont : pains et céréales 21,9 0,9 1,9 3,6 1,5 1,5
viandes 38,7 – 2,0 0,8 – 0,4 3,1 2,6poissons et crustacés 9,8 0,3 0,0 – 2,3 0,8 0,7lait, fromages et oeufs 21,8 1,5 2,4 1,8 1,5 1,5fruits et légumes 24,4 1,2 – 0,7 0,1 1,9 1,7
Boissons non alcoolisées 13,2 2,3 3,3 2,3 0,8 0,9Boissons alcoolisées et tabac 35,8 0,8 – 0,2 0,0 2,8 2,4Boissons alcoolisées 16,7 – 0,3 – 0,4 0,7 1,4 1,1Tabac 19,1 1,9 0,1 – 0,6 1,4 1,3Articles d'habillement et chaussures 47,7 – 3,4 0,8 – 1,2 4,0 3,2Logement, chauffage, éclairage 281,2 0,4 1,4 – 1,0 18,0 19,1dont : location de logement 204,5 1,0 1,1 1,1 13,1 13,9
chauffage, éclairage 43,4 – 0,3 4,9 – 11,2 2,9 2,9Équipement du logement 64,8 – 3,0 2,4 1,1 4,6 4,4Santé 43,3 3,0 2,1 3,9 2,6 2,9Transport 160,6 – 1,0 – 0,3 0,7 11,3 10,9Achats de véhicules 40,3 6,5 – 2,7 0,2 3,5 2,7Carburants, lubrifiants 42,1 – 1,6 – 1,1 – 0,7 2,8 2,9Services de transports 25,4 – 1,6 2,3 4,9 1,5 1,7Communications 29,1 0,5 1,9 0,3 1,9 2,0Loisirs et culture 93,6 0,8 2,8 2,4 6,8 6,4Éducation 9,2 – 5,5 – 0,9 – 1,4 0,5 0,6Hôtels, cafés et restaurants 79,0 – 3,4 1,5 1,0 5,5 5,4Autres biens et services 123,9 2,9 1,2 0,6 9,0 8,4dont : soins personnels 24,8 – 1,4 3,4 3,5 1,7 1,7
assurances 38,7 12,9 – 0,1 – 0,9 2,2 2,6Correction territoriale – 8,8 – 22,1 – 25,3 41,3 – 1,0 – 0,6Dépense de consommation des ménages 1 110,1 0,1 1,4 0,3 77,1 75,4Dépense de consommation des ISBLSM1 41,2 4,4 3,8 1,9 2,7 2,8Dépense de consommation des APU2 320,7 2,2 1,7 1,5 20,2 21,8dont : santé 141,6 3,4 2,8 1,7 8,9 9,6
éducation 95,5 – 0,2 0,3 0,5 6,7 6,5Consommation effective des ménages 1 471,9 0,7 1,5 0,6 100,0 100,0
1. Institutions sans but lucratif au service des ménages.2. Dépenses de consommation des administrations publiques en biens et services individualisables.Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
Évolution de la dépense et du pouvoir d'achatdes ménages
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
2008 2009 2010 2011
en %
1. Évolution déflatée à l'aide de l'indice du prix des dépenses de consommation finaledes ménages.2. L'évolution calculée est déflatée à l'aide de l'indice du prix des dépenses deconsommation non « pré-engagées » des ménages.Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
1
2
Dépense de consommation finale en volumePouvoir d'achat du revenu disponible brutPouvoir d'achat du revenu « arbitrable »
Dépense de consommation des ménages par fonctionde consommation dans quelques pays de l'UE27 en2010
en %
Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni
Produits alimentaires etboissons non alcoolisées 11,0 14,1 13,5 14,4 9,1Boissons alcoolisées,tabac et narcotiques 3,1 3,0 3,1 2,7 3,6Articles d'habillement etarticles chaussants 5,1 5,2 4,4 7,7 5,8Logement, eau, électricité,gaz et autres combustibles 24,6 20,2 25,4 22,2 23,4Ameubl., équip. ménager etentretien courant de la maison 6,2 4,8 5,8 7,1 5,2Santé 5,1 3,5 3,8 3,0 1,8Transports 13,4 11,6 13,9 12,9 14,5Communications 2,7 2,8 2,7 2,4 2,1Loisirs et culture 9,2 8,2 8,5 7,2 11,0Enseignement 1,0 1,4 0,8 1,0 1,5Hôtels, cafés et restaurants 5,8 16,9 7,0 9,8 9,9Autres biens et services 12,8 8,1 11,0 9,6 12,1Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Eurostat.
Chapitre 3 : « La consommation » 2/ La consommation et ses facteurs explicatifs
2/ La consommation et ses facteurs explicatifs : prix relatifs, « filière inversée », modes de vie, « effet démonstration/imitation », etc. 2-‐A/ Les prix relatifs La structure des prix relatifs change qd les prix se modifient => baisse de certains prix / autres prix (px avion/train = +avion-‐ train?) Pourquoi ? = rôle de l’offre = Eco Echelle et innovations § Rôle des économies d’échelle = prix baisse avec l’ìde la prod.
§ => Cout total = CV/unitaire ne change pas mais le CF/unitaire baisse § => Phases d’EE et phases de DE = effet taille de l’Ent = Paliers de coût
§ Pourquoi = rôle de l’innovation = baisse des prix (Thèse Schump) § Innovation => méthodes de fabrication, de vente, procédés, etc. § Productivité ++ ou diminution de coûts => Baisse de prix
Chapitre 3 : « La consommation » 2/ La consommation et ses facteurs explicatifs
2/ La consommation et ses facteurs explicatifs : prix relatifs, « filière inversée », modes de vie, « effet démonstration/imitation », etc. 2-‐B/ « La filière inversée » de JK Galbraith («Le nouvel état industriel») § Economies occidentales à Eco marché => marchés oligopolistiques
§ => Tendance à la concentration = nb. Ent. baisse et consommateurs = § => Accroissement du pouvoir des firmes >>> consommateurs § => Imposer aux conso les choix de production (quantité, qualité, etc.) § => Filière normal = choix des conso => passage à filière inversée
2-‐C/ « La consommation symbolique » de T. Veblen (« La théorie de la classe de loisir » 1889) § Rôle de la classe sociale dans la consommation
§ Effets de démonstrations sociales pour légitimer le statut = B & S 2-‐D/ « Le rôle des capitaux dans la consommation » de P. Bourdieu § C. Culturel + C. Economique + C. Social = pas uniquement le C. éco § => C éco n’explique pas les différences de conso mais le C. culturel ou
le C. social ; ex = bourgeois bio et bourgeois pas bio
Chapitre 3 : « La consommation » 2/ La consommation et ses facteurs explicatifs
2/ La consommation et ses facteurs explicatifs : prix relatifs, « filière inversée », modes de vie, « effet démonstration/imitation », etc. 2-‐E/ « La consommation comme effet de signe, effet d’imitation » § => Effet de signe = consommation d’un B & S permet d’acquérir les
éléments symboliques contenus : qualité, réputation, genre, appartenance
§ => Effet d’imitation = volonté d’imiter un consommateur qui détient le produit et joue un rôle de prescripteur pour d’autres consommateurs § Effet de génération, de clubs, des stars, etc. tendance vestimentaire,
automobile, etc.
Chapitre 3 : « La consommation » 3/ « Consommation primordiale » contre « Consommation différée »
3/ « Consommation primordiale et Epargne résiduelle » (Keynes) contre « Consommation différée et Epargne primordiale » (Néo-‐classiques). 3-‐A/ « Consommation primordiale et Epargne résiduelle » (Keynes) Ménages répartissent leur revenu entre consommation et épargne § Ménages => Consommation domine & Epargne est résiduelle § Ménages = Pas d’arbitrage = les ménages satisfont leur
consommation et ensuite épargnent si le Y le permet § Effet fondamental = la demande
3-‐B/ « Consommation différée et Epargne primordiale » (NCL) Ménages arbitre entre consommation et épargne en f(tx d’int) § Qd tx intérêt augmente => ì des placements => î consommation § Qd tx intérêt baisse => ì consommation § Effet de l’inflation = qd px ì => monnaie pouvoir achat baisse § => pas détenir d’argent mais des biens (consomations)
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production et les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique : autoproduction, normes sociales, travail versus chômage (les mesures) 2/ Arbitrage travail/loisirs, chômage involontaire, K humain, insiders/outsiders, « segmentation interne/externe » 3/ Le travail & la population active : facteurs essentiels des cycles économiques (politique de lutte/formation/crises)
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1/ Le travail et l’activité économique : autoproduction, normes sociales, travail versus chômage (les mesures) 1-‐A/ Le Travail dans l’autoproduction & autoconsommation § La définition du travail = définition large § Toutes les activités qui vont participer au processus de production § Activités qui sont marchandes et d’autres non marchandes § A quel moment = travail payant ou travail gratuit § Zones d’ indistinction entre travail gratuit et travail marchand
§ Ex = faire un cours gratuit pour aider un entrepreneur qui vend un Bien ou S § Travail social et travail économique = sans salaire, salaire différé, etc. § Formes de travail qui excèdent de beaucoup les contrats de travail § Formes sans et sous contrat
§ Travail sans contrat de travail = sous contrainte ou sans contrainte § Travail avec contrat = stage, apprentissage § Travail avec contrat précaire = Temps partiel de 1h à 3j/semaine § Travail avec contrat CDD à CDI
§ Le travail en libéral = artisans, professions libérales, etc. § Travail dont les profits sont les seuls résultats = travail sans/avec résultats ( pas
d’assurance des proftis) § Les cercles
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1/ Le travail et l’activité économique : autoproduction, normes sociales, travail versus chômage (les mesures) 1-‐A/ Le Travail dans l’autoproduction & autoconsommation
Travail marchand
Travail réel effectué global
-‐ Passages entre les deux cercles -‐ Rôle de la Loi (trafics, etc.) -‐ Rôle de l’éducation -‐ Rôle des femmes
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐A/ Le Travail dans l’autoproduction & autoconsommation § Le halo du chômage selon Jacques Freyssinet
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1/ Le travail et l’activité économique : autoproduction, normes sociales, travail versus chômage (les mesures) 1-‐A/ Le Travail dans l’autoproduction & autoconsommation § Définition de l’autoproduction : production qui est destinée à être
consommée intégralement par les producteurs § Les producteurs ajustent leurs productions en fonction de leurs niveaux de
satisfaction désirée § Attention 1= pas réductible aux sociétés dites arriérées ou en retard, peu être très
utile à des communautés techniques, marchandes, financières (production d’un B & S pour une utilité particulière, ex= les artisans sui doivent fabriqués leurs outils)
§ Attention 2 = Phénomène d’apprentissage = année t = X => année t+1 = X + 100 § On parle de production à échelle domestique => les Potagers, mais cela
ne suffit pas parfois à équilibrer les besoins (manques => commerce) § Travail marchand(TM) et Travail non marchand(TNM) sont insérés tout au
long de la chaîne de production => différentes étapes de production § 1ère étape = TNM, 2ème étape = TM, 2ème étape = TNM, 3ème étape = TNM, etc.
§ TM et TNM renvoient à Eco marchande et non marchande
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1/ Le travail et l’activité économique : autoproduction, normes sociales, travail versus chômage (les mesures) 1-‐B/ La mesure du chômage Les formes du travail sont évolutives : ce sont autant des constructions sociales que statistiques (Dominique Meda 1999).
Tableau à partir des Typologies des formes de travail selon J. Freyssinet (sauf mixte).
Modes de travail
Travail Libre Travail Salarié Travail Forcé
Types Activités
Activités non-‐marchandes Travail domestique
Travail Militant
Salariés des Administrations Salariés des Ménages
Esclavage, Corvées.
Activités marchandes Travail indépendant Salariés des
entreprises privées Peines de travail Obligatoire TIC
Mixte Travail Mixte
(partie rémunérée ou différée ou non)
Mixte (Emploi public/privé)
Travail Mixte (Forcé & Gains)
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐B/ La mesure du chômage § Population active occupée au sens du BIT : elle comprend les personnes (âgées
de 15 ans ou plus) ayant travaillé (ne serait-‐ce qu’une heure) au cours d’une semaine de référence, qu’elles soient salariées, à leur compte, employeurs ou aides dans l’entreprise ou l’exploitation familiale. Elle comprend aussi les personnes pourvues d’un emploi mais qui en sont temporairement absentes pour un motif tel qu’une maladie (moins d’un an), des congés payés, un congé de maternité, un conflit du travail, une formation, une intempérie,…. Les militaires du contingent, les apprentis, les membres du clergé en activité et les stagiaires rémunérés font partie de la population active occupée (INSEE TEF 2014).
§ Population inactive : Les inactifs sont ceux qui n’ont pas d’emploi (définition par la négative/population totale), pas d’indemnités chômage. Ils comprennent : enfants de moins de 15 ans, étudiants (sans travail), retraités (sans travail), personnes allocataires RSA, allocataires Adulte Handicapé, Affections de Longue durée, oisifs (sans travail), SDF (sans travail/sans allocation, etc.) , etc.
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐B/ La mesure du chômage
§ Population active => PA = PAO + PAI § Population totale => PT = PA + PI = PAO + PAI + PI
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐B/ La mesure du chômage
Une photographie du marché du travail en 2012Fabien Guggemos et Joëlle Vidalenc, division Emploi, Insee
Résumé
En 2012, 25,8 millions de personnes ont un travail et 2,8 millions sont au chômage au sens du BIT. Sur dix personnes quitravaillent, on compte un non-salarié, cinq ouvriers ou employés et quatre cadres ou professions intermédiaires. 5,3 %des personnes ayant un emploi sont en situation de sous-emploi. Cette situation est plus courante parmi les jeunes, lesemployés et les femmes.
Après avoir progressé de 2008 à 2010, puis connu une légère baisse en 2011, le chômage augmente de nouveau en 2012et atteint son plus haut niveau depuis 1999. Toutes les classes d’âge sont concernées par cette dégradation, qui affecteprincipalement les ouvriers et les employés, mais également les professions intermédiaires, plutôt épargnéesles deux années précédentes.
En 2012, 25,8 millions de personnes ont un travail et 2,8 millions sont au chômage au sens du BIT
Neuf personnes sur dix travaillant en France sont salariées
Trois quarts des emplois dans le tertiaire, les autres secteurs peu féminisés
86,5 % des salariés sont en CDI
Le sous-emploi concerne 5,3 % des actifs occupés
Hausse du chômage de 0,6 point en 2012
Encadrés
Après une légère accalmie en 2010 et 2011, la situation des jeunes sur le marché du travail se dégrade ànouveau en 2012
La participation des plus âgés au marché du travail s’accélère en 2012
Publication
En 2012, 25,8 millions de personnes ont un travail et 2,8 millions sont au chômage ausens du BIT
En moyenne en 2012, 28,6 millions de personnes de 15 ans ou plus vivant en France métropolitaine sont actives :25,8 millions ont un emploi et 2,8 millions sont au chômage au sens du BIT ; 21,8 millions de personnes sontinactives, c’est-à-dire ne travaillent pas et ne recherchent pas activement un emploi ou ne sont pas disponibles pour enoccuper un (tableau 1).
Depuis 2005, la population active a augmenté de près de 1,2 million de personnes. Cette hausse est en grande partie dueà la participation croissante des femmes au marché du travail. Le nombre de femmes actives a augmenté en moyenne de110 000 par an depuis 2005, contre seulement 60 000 pour les hommes. L’augmentation de la population active s’estamplifiée en 2012 après deux années consécutives de décélération.
Le nombre d’actifs âgés de 50 à 64 ans a fortement progressé (+ 1 280 000 par rapport à 2005), tout particulièrement en2012 (+ 310 000 par rapport à 2011). La tendance générale au vieillissement de la population française se conjugue avecune participation accrue des plus âgés au marché du travail : la part des 50-64 ans parmi les actifs de 15-64 ansaugmente régulièrement (27,7 % en 2005 et 30,5 % en 2012) et leur taux d’activité sous-jacent passe de 51,7 % en2005 à 60,6 % en 2012.
Tableau 1 - Population âgée de 15 ans ou plus
Champ : population des ménages de 15 ans ou plus, vivant en France métropolitaine, hors communautés.
Source : Insee, enquête Emploi 2012.
Ensemble Femmes (milliers) Hommes (milliers)
(milliers) ( %)
Actifs 28 566 56,7 13 639 14 927
Actifs ayant un emploi 25 754 51,1 12 278 13 476
Chômeurs 2 811 5,6 1 361 1 451
Insee Première N° 1466 -septembre 2013
Insee - Travail-Emploi - Une photographie du marché du trava... http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1466
1 sur 6 23/04/14 12:08Champ : population des ménages de 15 ans ou plus, vivant en France métropolitaine, hors communautés.
Source : Insee, enquête Emploi 2012.
Inactifs 21 847 43,3 12 666 9 181
dont inactifs de 60 ans ou plus 13 285 26,4 7 520 5 765
Ensemble 50 412 100,0 26 305 24 107
Retour au sommaire
Neuf personnes sur dix travaillant en France sont salariées
Un peu plus d’une personne sur dix (11,5 %) occupant un emploi en 2012 est non salariée, proportion qui s’est stabiliséedepuis le début des années 2000 (tableau 2). Parmi elles, un tiers sont des femmes. Les non-salariés demeurentsensiblement plus âgés que les salariés : un sur deux a plus de 46 ans alors que la moitié des salariés a moins de41 ans.
Les salariés représentent donc 88,5 % des actifs occupés en France métropolitaine. Parmi les actifs occupés, près d’unsur deux est ouvrier ou employé et deux sur cinq occupent une profession intermédiaire ou sont cadres. Depuis 2005, lapart des cadres parmi les actifs occupés a progressé (+ 2,1 points à 16,1 %), ainsi que celle des professionsintermédiaires (+ 1,2 point à 23,5 %) ; dans le même temps, la part d’ouvriers et d’employés a diminué (respectivementde - 2,7 points à 20,8 % et - 1,2 point à 28,1 %).
Sur les 12,3 millions de femmes qui travaillent, 5,6 millions d’entre elles sont des employées, soit plus des trois quarts decette catégorie socioprofessionnelle. En revanche, les femmes ne représentent que 11,8 % des ouvriers qualifiés et33,0 % des ouvriers non qualifiés (tableau 2). La part des femmes progresse parmi les cadres (+ 3,1 points depuis 2005à 40,2 %) et les professions intermédiaires (+ 1,7 point à 51,2 %).
Tableau 2 - Statut d'emploi et groupe socioprofessionnel des personnes en emploiselon le sexe
Champ : population en emploi de 15 ans ou plus, vivant en France métropolitaine, hors communautés.
Source : Insee, enquête Emploi 2012.
Effectif total (milliers) Répartition ( %) Part de femmes
Ensemble Femmes Hommes ( %)
Non-salariés 2 956 11,5 7,7 14,9 31,8
Salariés 22 799 88,5 92,3 85,1 49,7
Dont :
Cadres 4 153 16,1 13,6 18,4 40,2
Professions intermédiaires 6 051 23,5 25,2 21,9 51,2
Employés qualifiés 3 739 14,5 22,8 7,0 74,8
Employés non qualifiés 3 508 13,6 22,5 5,6 78,6
Ouvriers qualifiés 3 520 13,7 3,4 23,0 11,8
Ouvriers non qualifiés 1 827 7,1 4,9 9,1 33,0
Ensemble 25 754 100,0 100,0 100,0 47,7
Retour au sommaire
Trois quarts des emplois dans le tertiaire, les autres secteurs peu féminisés
En 2012, 76,1 % des personnes ayant un emploi (salarié ou non) travaillent dans le secteur tertiaire, 13,7 % dansl’industrie, 6,9 % dans la construction et 2,9 % dans l’agriculture (tableau 3). Comparés à l’ensemble de la population enemploi, les jeunes de moins de 25 ans sont davantage présents dans la construction et moins dans les secteurs industrielet agricole (9,4 % contre 6,9 %). A contrario, la proportion des 50-64 ans travaillant dans l’agriculture est sensiblementplus élevée que dans le reste de la population en emploi (4,1 % contre 2,5 %).
Dans le secteur tertiaire, 55,1 % des emplois sont occupés par des femmes. Ces dernières sont notamment majoritairesdans le secteur de la finance, de l’assurance et de l’immobilier (55,7 %) et représentent plus des deux tiers des effectifsdans l’administration publique, l’éducation, la santé et l’action sociale (67,4 %). Inversement, dans les secteurs del’industrie et de l’agriculture, seuls trois emplois sur dix sont occupés par des femmes et un sur dix dans celui de laconstruction.
Insee - Travail-Emploi - Une photographie du marché du trava... http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1466
2 sur 6 23/04/14 12:08
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐B/ La mesure du chômage Taux d'activité selon le sexe et l'âge
en %
1990 2000 2010 (r) 2011
Hommes de 15 ans ou plus 65,6 63,2 62,1 61,815 à 24 ans 47,4 40,4 42,7 41,625 à 49 ans 96,4 95,2 94,8 94,450 à 64 ans 57,3 59,4 61,2 62,2dont 55 à 64 ans 41,0 36,0 45,3 47,265 ans ou plus 3,7 2,0 2,2 2,7Femmes de 15 ans ou plus 47,3 49,5 51,7 51,715 à 24 ans 40,3 33,2 35,5 34,925 à 49 ans 75,5 80,6 84,2 83,950 à 64 ans 38,3 46,8 54,2 55,2dont 55 à 64 ans 27,6 28,2 40,0 41,865 ans ou plus 1,4 0,8 1,0 1,4Population de 15 ans ou plus 56,1 56,1 56,7 56,5
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ouplus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Projection de population active
2010 (p) 2020 2040 2060
Nombre d'actifs (en millions) 28,3 29,6 30,4 31,2Part des femmes (en %) 47,7 48,1 47,3 46,9Part des 15-24 ans (en %) 10,3 9,9 10,1 10,1Part des 25-54 ans (en %) 77,2 73,3 72,2 72,0Part des 55 ans ou plus (en %) 12,5 16,8 17,7 17,9Taux d'activité des 15-69 ans (en %) 66,6 67,7 69,4 69,7Nombre d'actifs rapporté au nombred'inactifs de 60 ans ou plus1 2,1 1,9 1,6 1,5
1. Ratio calculé sur la population totale qui intègre les personnes vivant dans deshabitations mobiles ou résidant en collectivité.Champ : population des ménages de 15 ans ou plus de France métropolitaine enâge courant, scénario central.Source : Insee, enquêtes Emploi, projections de population active 2010-2060.
Population active par sexe et âge en 2011en milliers
Hommes Femmes Total
15 à 24 ans 1 555 1 290 2 84625 à 49 ans 9 503 8 711 18 21450 à 64 ans 3 662 3 469 7 132dont 55 à 64 ans 1 823 1 735 3 55865 ans ou plus 117 81 198Population de 15 ans ou plus 14 838 13 552 28 390dont 15 à 64 ans 14 721 13 471 28 192
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ouplus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Population active et population active occupée
2009 2010 2011
Population active (en millions) 28,2 28,3 28,4Population active occupée (en millions) 25,6 25,7 25,8dont femmes (en %) 47,5 47,5 47,5dont non salariés (en %) 11,0 11,5 11,7Part des actifs occupés en sous-emploi (en %) 5,6 5,9 5,1
Part des employés en sous-emploi (en %) 10,1 10,6 9,7Part des ouvriers en sous-emploi (en %) 5,6 5,7 4,5Part des femmes en sous-emploi (en %) 8,4 8,8 7,9
Lecture : en moyenne en 2011, 4,5 % des ouvriers sont en situation de sous-emploi.Champ : données en moyenne annuelle ; France métropolitaine, population desménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Taux d'activité et taux d'emploi dans l'Unioneuropéenne en 2011
Populationactive
Tauxd'activité
Taux d'emploien %
en millions en % Hommes Femmes Ensemble
Allemagne 42,2 77,2 77,3 67,7 72,5Autriche 4,3 75,3 77,8 66,5 72,1Belgique 4,9 66,7 67,1 56,7 61,9Bulgarie 3,3 66,0 60,9 56,2 58,5Chypre 0,4 74,0 74,7 61,6 68,1Danemark 2,9 79,3 75,9 70,4 73,1Espagne 23,1 73,7 63,2 52,0 57,7Estonie 0,7 74,7 67,7 62,8 65,1Finlande 2,7 74,9 70,6 67,4 69,0France 28,6 70,4 68,1 59,7 63,8Grèce 5,0 67,7 65,9 45,1 55,6Hongrie 4,3 62,7 61,2 50,6 55,8Irlande 2,1 69,4 63,1 55,4 59,2Italie 25,1 62,2 67,5 46,5 56,9Lettonie 1,1 73,3 62,9 60,8 61,8Lituanie 1,6 72,0 60,9 60,5 60,7Luxembourg 0,2 67,9 72,1 56,9 64,6Malte 0,2 61,6 73,6 41,0 57,6Pays-Bas 8,8 78,4 79,8 69,9 74,9Pologne 17,9 66,1 66,3 53,1 59,7Portugal1 5,5 74,1 68,1 60,4 64,2Rép. tchèque 5,3 70,5 74,0 57,2 65,7Roumanie 9,9 63,3 65,0 52,0 58,5Royaume-Uni 31,6 75,7 74,5 64,5 69,5Slovaquie 2,7 68,9 66,3 52,7 59,5Slovénie 1,0 70,3 67,7 60,9 64,4Suède 5,0 80,2 76,3 71,8 74,1UE à 27 240,4 71,2 70,1 58,5 64,3
1. Rupture de série.Champ : données en moyenne annuelle, population des 15-64 ans.Source : Eurostat.
Travail - Emploi 45
Population active 4.1
0
5
10
15
20
25
30
35
Agriculteursexploitants
Artisans,comm. et
chefsd'entreprise
Cadres et prof.intellect.
supérieures
Professionsinterméd.
Employés Ouvriers
2005 2011
Personnes en emploi selon la catégoriesocioprofessionnelle
en %
Champ : population des ménages en France métropolitaine, personnes en emploi de15 ans ou plus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Taux d'activité selon le sexe et l'âgeen %
1990 2000 2010 (r) 2011
Hommes de 15 ans ou plus 65,6 63,2 62,1 61,815 à 24 ans 47,4 40,4 42,7 41,625 à 49 ans 96,4 95,2 94,8 94,450 à 64 ans 57,3 59,4 61,2 62,2dont 55 à 64 ans 41,0 36,0 45,3 47,265 ans ou plus 3,7 2,0 2,2 2,7Femmes de 15 ans ou plus 47,3 49,5 51,7 51,715 à 24 ans 40,3 33,2 35,5 34,925 à 49 ans 75,5 80,6 84,2 83,950 à 64 ans 38,3 46,8 54,2 55,2dont 55 à 64 ans 27,6 28,2 40,0 41,865 ans ou plus 1,4 0,8 1,0 1,4Population de 15 ans ou plus 56,1 56,1 56,7 56,5
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ouplus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Projection de population active
2010 (p) 2020 2040 2060
Nombre d'actifs (en millions) 28,3 29,6 30,4 31,2Part des femmes (en %) 47,7 48,1 47,3 46,9Part des 15-24 ans (en %) 10,3 9,9 10,1 10,1Part des 25-54 ans (en %) 77,2 73,3 72,2 72,0Part des 55 ans ou plus (en %) 12,5 16,8 17,7 17,9Taux d'activité des 15-69 ans (en %) 66,6 67,7 69,4 69,7Nombre d'actifs rapporté au nombred'inactifs de 60 ans ou plus1 2,1 1,9 1,6 1,5
1. Ratio calculé sur la population totale qui intègre les personnes vivant dans deshabitations mobiles ou résidant en collectivité.Champ : population des ménages de 15 ans ou plus de France métropolitaine enâge courant, scénario central.Source : Insee, enquêtes Emploi, projections de population active 2010-2060.
Population active par sexe et âge en 2011en milliers
Hommes Femmes Total
15 à 24 ans 1 555 1 290 2 84625 à 49 ans 9 503 8 711 18 21450 à 64 ans 3 662 3 469 7 132dont 55 à 64 ans 1 823 1 735 3 55865 ans ou plus 117 81 198Population de 15 ans ou plus 14 838 13 552 28 390dont 15 à 64 ans 14 721 13 471 28 192
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ouplus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Population active et population active occupée
2009 2010 2011
Population active (en millions) 28,2 28,3 28,4Population active occupée (en millions) 25,6 25,7 25,8dont femmes (en %) 47,5 47,5 47,5dont non salariés (en %) 11,0 11,5 11,7Part des actifs occupés en sous-emploi (en %) 5,6 5,9 5,1
Part des employés en sous-emploi (en %) 10,1 10,6 9,7Part des ouvriers en sous-emploi (en %) 5,6 5,7 4,5Part des femmes en sous-emploi (en %) 8,4 8,8 7,9
Lecture : en moyenne en 2011, 4,5 % des ouvriers sont en situation de sous-emploi.Champ : données en moyenne annuelle ; France métropolitaine, population desménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Taux d'activité et taux d'emploi dans l'Unioneuropéenne en 2011
Populationactive
Tauxd'activité
Taux d'emploien %
en millions en % Hommes Femmes Ensemble
Allemagne 42,2 77,2 77,3 67,7 72,5Autriche 4,3 75,3 77,8 66,5 72,1Belgique 4,9 66,7 67,1 56,7 61,9Bulgarie 3,3 66,0 60,9 56,2 58,5Chypre 0,4 74,0 74,7 61,6 68,1Danemark 2,9 79,3 75,9 70,4 73,1Espagne 23,1 73,7 63,2 52,0 57,7Estonie 0,7 74,7 67,7 62,8 65,1Finlande 2,7 74,9 70,6 67,4 69,0France 28,6 70,4 68,1 59,7 63,8Grèce 5,0 67,7 65,9 45,1 55,6Hongrie 4,3 62,7 61,2 50,6 55,8Irlande 2,1 69,4 63,1 55,4 59,2Italie 25,1 62,2 67,5 46,5 56,9Lettonie 1,1 73,3 62,9 60,8 61,8Lituanie 1,6 72,0 60,9 60,5 60,7Luxembourg 0,2 67,9 72,1 56,9 64,6Malte 0,2 61,6 73,6 41,0 57,6Pays-Bas 8,8 78,4 79,8 69,9 74,9Pologne 17,9 66,1 66,3 53,1 59,7Portugal1 5,5 74,1 68,1 60,4 64,2Rép. tchèque 5,3 70,5 74,0 57,2 65,7Roumanie 9,9 63,3 65,0 52,0 58,5Royaume-Uni 31,6 75,7 74,5 64,5 69,5Slovaquie 2,7 68,9 66,3 52,7 59,5Slovénie 1,0 70,3 67,7 60,9 64,4Suède 5,0 80,2 76,3 71,8 74,1UE à 27 240,4 71,2 70,1 58,5 64,3
1. Rupture de série.Champ : données en moyenne annuelle, population des 15-64 ans.Source : Eurostat.
Travail - Emploi 45
Population active 4.1
0
5
10
15
20
25
30
35
Agriculteursexploitants
Artisans,comm. et
chefsd'entreprise
Cadres et prof.intellect.
supérieures
Professionsinterméd.
Employés Ouvriers
2005 2011
Personnes en emploi selon la catégoriesocioprofessionnelle
en %
Champ : population des ménages en France métropolitaine, personnes en emploi de15 ans ou plus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐B/ La mesure du chômage
Taux d'activité selon le sexe et l'âgeen %
1990 2000 2010 (r) 2011
Hommes de 15 ans ou plus 65,6 63,2 62,1 61,815 à 24 ans 47,4 40,4 42,7 41,625 à 49 ans 96,4 95,2 94,8 94,450 à 64 ans 57,3 59,4 61,2 62,2dont 55 à 64 ans 41,0 36,0 45,3 47,265 ans ou plus 3,7 2,0 2,2 2,7Femmes de 15 ans ou plus 47,3 49,5 51,7 51,715 à 24 ans 40,3 33,2 35,5 34,925 à 49 ans 75,5 80,6 84,2 83,950 à 64 ans 38,3 46,8 54,2 55,2dont 55 à 64 ans 27,6 28,2 40,0 41,865 ans ou plus 1,4 0,8 1,0 1,4Population de 15 ans ou plus 56,1 56,1 56,7 56,5
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ouplus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Projection de population active
2010 (p) 2020 2040 2060
Nombre d'actifs (en millions) 28,3 29,6 30,4 31,2Part des femmes (en %) 47,7 48,1 47,3 46,9Part des 15-24 ans (en %) 10,3 9,9 10,1 10,1Part des 25-54 ans (en %) 77,2 73,3 72,2 72,0Part des 55 ans ou plus (en %) 12,5 16,8 17,7 17,9Taux d'activité des 15-69 ans (en %) 66,6 67,7 69,4 69,7Nombre d'actifs rapporté au nombred'inactifs de 60 ans ou plus1 2,1 1,9 1,6 1,5
1. Ratio calculé sur la population totale qui intègre les personnes vivant dans deshabitations mobiles ou résidant en collectivité.Champ : population des ménages de 15 ans ou plus de France métropolitaine enâge courant, scénario central.Source : Insee, enquêtes Emploi, projections de population active 2010-2060.
Population active par sexe et âge en 2011en milliers
Hommes Femmes Total
15 à 24 ans 1 555 1 290 2 84625 à 49 ans 9 503 8 711 18 21450 à 64 ans 3 662 3 469 7 132dont 55 à 64 ans 1 823 1 735 3 55865 ans ou plus 117 81 198Population de 15 ans ou plus 14 838 13 552 28 390dont 15 à 64 ans 14 721 13 471 28 192
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ouplus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Population active et population active occupée
2009 2010 2011
Population active (en millions) 28,2 28,3 28,4Population active occupée (en millions) 25,6 25,7 25,8dont femmes (en %) 47,5 47,5 47,5dont non salariés (en %) 11,0 11,5 11,7Part des actifs occupés en sous-emploi (en %) 5,6 5,9 5,1
Part des employés en sous-emploi (en %) 10,1 10,6 9,7Part des ouvriers en sous-emploi (en %) 5,6 5,7 4,5Part des femmes en sous-emploi (en %) 8,4 8,8 7,9
Lecture : en moyenne en 2011, 4,5 % des ouvriers sont en situation de sous-emploi.Champ : données en moyenne annuelle ; France métropolitaine, population desménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Taux d'activité et taux d'emploi dans l'Unioneuropéenne en 2011
Populationactive
Tauxd'activité
Taux d'emploien %
en millions en % Hommes Femmes Ensemble
Allemagne 42,2 77,2 77,3 67,7 72,5Autriche 4,3 75,3 77,8 66,5 72,1Belgique 4,9 66,7 67,1 56,7 61,9Bulgarie 3,3 66,0 60,9 56,2 58,5Chypre 0,4 74,0 74,7 61,6 68,1Danemark 2,9 79,3 75,9 70,4 73,1Espagne 23,1 73,7 63,2 52,0 57,7Estonie 0,7 74,7 67,7 62,8 65,1Finlande 2,7 74,9 70,6 67,4 69,0France 28,6 70,4 68,1 59,7 63,8Grèce 5,0 67,7 65,9 45,1 55,6Hongrie 4,3 62,7 61,2 50,6 55,8Irlande 2,1 69,4 63,1 55,4 59,2Italie 25,1 62,2 67,5 46,5 56,9Lettonie 1,1 73,3 62,9 60,8 61,8Lituanie 1,6 72,0 60,9 60,5 60,7Luxembourg 0,2 67,9 72,1 56,9 64,6Malte 0,2 61,6 73,6 41,0 57,6Pays-Bas 8,8 78,4 79,8 69,9 74,9Pologne 17,9 66,1 66,3 53,1 59,7Portugal1 5,5 74,1 68,1 60,4 64,2Rép. tchèque 5,3 70,5 74,0 57,2 65,7Roumanie 9,9 63,3 65,0 52,0 58,5Royaume-Uni 31,6 75,7 74,5 64,5 69,5Slovaquie 2,7 68,9 66,3 52,7 59,5Slovénie 1,0 70,3 67,7 60,9 64,4Suède 5,0 80,2 76,3 71,8 74,1UE à 27 240,4 71,2 70,1 58,5 64,3
1. Rupture de série.Champ : données en moyenne annuelle, population des 15-64 ans.Source : Eurostat.
Travail - Emploi 45
Population active 4.1
0
5
10
15
20
25
30
35
Agriculteursexploitants
Artisans,comm. et
chefsd'entreprise
Cadres et prof.intellect.
supérieures
Professionsinterméd.
Employés Ouvriers
2005 2011
Personnes en emploi selon la catégoriesocioprofessionnelle
en %
Champ : population des ménages en France métropolitaine, personnes en emploi de15 ans ou plus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐B/ La mesure du chômage § Définition du chômage est conventionnelle = elle est mesurée par l’emploi qui
est lui même conventionnel. Deux définitions correspondent à celle de l’INSEE/BIT et de l’Administration (Pole Emploi, Ministère du travail, etc.).
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
�
www.insee.fr�:�l’accès�pour�tous�aux�données�de�l’Insee��
�
Combien�y�aͲtͲil�de�chômeurs�en�France��? 2
2,8�millions�:�c’est�le�nombre�de�chômeurs�au�sens�du�Bureau�international�du�travail�(BIT)�au�deuxième�trimestre�2012�en�France�métropolitaine
Sont�comptées�comme�chômeurs�les�personnes�:��
Ͳ�sans�emploi��Ͳ�immédiatement�disponibles�pour�travailler�Ͳ�à�la�recherche�d’emploi�La�définition�du�BIT�précise�quand�une�personne�remplit�ces�trois�critères.���Le�nombre�de�chômeurs�est�calculé�par�l’Insee�tous�les�trimestres�dans�l’enquête�Emploi.���
Le�nombre�de�chômeurs�et�le�nombre�de�demandeurs�d’emploi�en�fin�de�mois�ne�coïncident�pas�:�par�exemple,�un�chômeur�au�sens�du�BIT�non�inscrit�à�Pôle�emploi�n’est�pas�comptabilisé�comme�demandeur�d’emploi�
���
Près�de�3�millions,�c’est�le�nombre�de�demandeurs�d’emploi�en�fin�de�mois��n’ayant�pas�du�tout�travaillé�au�cours�du�mois�passé,�disponibles�pour�travailler�et�inscrits�à�Pôle�emploi�fin�juillet�2012�;�ils�sont�dits�de�catégorie�A1.�Les�critères�d’appartenance�à�la�catégorie�A�sont�proches�de�ceux�de�la�définition�du�BIT,�mais�ne�lui�correspondent�pas�tout�à�fait.�Si�l’on�ajoute�à�ces�demandeurs�d’emploi�ceux�qui�ont�exercé�dans�le�mois�une�activité�professionnelle�réduite,�courte�ou�longue�(de�moins�ou�de�plus�de�78�heures),�on�chiffre�à�près�de��4,5�millions�le�nombre�de�demandeurs�d’emploi�en�fin�de�mois�inscrits�à�Pôle�emploi�(catégories�A+B+C)�en�juillet�2012.�Ce�nombre,�actualisé�tous�les�mois,�est�largement�repris�par�les�medias.�Le�chiffrage�est�effectué�par�la�Dares,�la�Direction�de�l’animation�de�la�recherche,�des�études�et�des�statistiques,�service�statistique�du�ministère�en�charge�du�travail�et�Pôle�emploi.�
1.�en�moyenne�au�deuxième�trimestre�2012,�ce�nombre�de�demandeurs�d’emploi�en��fin�de��mois�de�catégorie�A�est�de�2,9�millions.�
Pour�en�savoir�plus��.�
�.�
Une�photographie�du�marché�du�travail�en�2010Les�demandeurs�d’emploi�inscrits�à�Pôle�emploi
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐B/ La mesure du chômage § La publication des effectifs de demandeurs d'emploi = POLE EMPLOI:
-‐ catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ; -‐ catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) ; -‐ catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. plus de 78 heures au cours du mois) ; -‐ catégorie D : demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (en raison d'un stage, d'une formation, d'une maladie…), y compris les demandeurs d'emploi en convention de reclassement personnalisé (CRP), en contrat de transition professionnelle (CTP), sans emploi et en contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ; -‐ catégorie E : demandeurs d'emploi non tenus de faire de actes positifs de recherche d'emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés). http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/categor-‐demandes-‐emploi-‐anpe.htm
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐B/ La mesure du chômage § La notion de chômage renvoie à celle d’emploi ou de travail qui
peut faire lui aussi l’objet d’un marché = le marché du travail ou de l’emploi.
§ Le marché du travail comme fiction théorique => A.Barrère(1910-‐1995) considère que le marché du travail est simplement une nécessité théorique commode pour les néo-‐classiques pour construire leur théorie des marchés et de leur autorégulation.
§ Pour les institutionnalistes et les keynésiens le travail n’est pas un Bien et Service comme les autres mais plutôt est lié aux différentes institutions/normes/règles/conventions sociales, politiques, économiques etc.
§ Le travail est utilisé comme l’emploi pour décrire les mêmes réalités malgré leur histoire différente (Offre/Demande L = Dde/Offre de Empl).
§ Emploi apparaît avec la crise éco de l’année 1929 et symbole « théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie » de JM Keynes
§ Cf Beitone & al. « dictionnaire de science économique » Armand Colin, 2010, p. 280 et S.
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐B/ La mesure du chômage § Mutations du système productif depuis les années 1880/1900 =
relations du travail sont moins individualisées et plus collectives, droits nouveaux pour les travailleurs.
§ Rôle de l’Etat = Droit du travail + protection collective § Différence entre Emploi, Travail et Poste de travail
§ Emploi = définition plus stable (avec des qualités particulières, durée particulière, localisation, occupation régulière, etc.) => Enquête emploi de l’INSEE
§ Travail = BIT = Concept plus large, moins stable = toutes les heures travaillées comptent (emplois occasionnels sont intégrés ≠ avec INSEE)
§ Evolution des formes d’emploi => CDI au CDD ? § Norme d’emploi actuel reste le CDI = Durée, rémunération,
formation, évolution, etc. § => Accord entre les Entreprises et les Syndicats (soutenu par l’Etat)
§ Législation du travail, conventions collectives, etc. § Cf Beitone & al. « dictionnaire de science économique » Armand Colin, 2010, p. 280 et S.
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐B/ La mesure du chômage § Normes d’emploi atypique = formes particulières nouvelles de
l’Emploi § => Moins grande intégration dans l’entreprise « formes précaires » § => Souplesse/Flexibilité dans l’organisation de la production § => Normes flexibles conduisent au maintien des CDI mais comme fin de
parcours après CDD § => Salariat se maintient mais sous des formes nouvelles = contrat multi-‐
employeurs, contrat de sous-‐traitance, CDI à durée hebdomadaire variable, etc.
§ => Question = les différences entre les CDI = vidage du contenu ? § Chômage & Travail & Emploi § « Le chômage n’est une catégorie innée mais est un produit
historique daté qui dépend des représentations du travail et de l’inactivité » Robert Salais, Nicolas Baverez et Bénédicte Reynaud, « L’invention du chômage : histoire et transformations d’une catégorie en France des années 1890 aux années 1980, Paris, PUF, 1986 »
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐B/ La mesure du chômage § Trois mécanismes à l’œuvre expliquent l’apparition au XXe de
formes spécifiques de l’emploi et du chômage (source: Beitone & al. « dictionnaire de science économique » Armand Colin, 2010, p.281) § M1 = Destruction des formes précapitalistes de l’emploi (agriculture,
artisanat, commerce, etc.), des normes du travail organisées par les corporations, les commerçants => libération de main d’œuvre disponible pour le travail salarié
§ M2 = Diminution du pouvoir d’achat/salaire réel, volonté d’enrichissement, émancipation, etc. => Membres de la famille au travail = femmes, enfants, etc.
§ M3 = Cycles d’innovation du K technique qui font émerger de nouvelles technologies, nouveaux cycles des affaires => chômage lié à la conjoncture du capital et technique
§ => Force de travail libre & volant de chômage permanent peuvent être interprétés comme « une armée de réserve de travailleurs » selon la célèbre formule de Marx.
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐B/ La mesure du chômage § Le chômage n’apparaît que dans la généralisation du salariat et dans les sociétés qui
veulent maintenir coûte que coûte le plein emploi « Histoire de la définition du chômage » -‐ Ingrid Liebeskind Sauthier, Courrier des statistiques n° 127, mai-‐août 2009, p8 et s.
§ La définition du chômage selon Christian Topalov est une « révolution scientifique » grâce à deux ouvrages parus en 1909: « Unemployment: a Problem of Industry » William Beveridge et « Le chômage et la profession du sociologue » durkheimien Max Lazard.
§ Chômage = apparaît comme fait social § => norme de travail moderne est le salariat à l’usine § => Abandon des formes contractuelles de celles des ateliers artisanaux et
commerciaux ou exploitations agricoles § => Association internationale pour la lutte contre le chômage involontaire, fondée
en 1910 § => Thème du chômage est abordé dans le deuxième point de l’ordre du jour dès la
première Conférence de l’OIT qui se tient à Washington en 1919. Il s’agit d’étudier les moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences.
§ La seconde Convention n°44 -‐ OIT « assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations» => le 4 juin 1934.
§ => Entre 19-‐39 = Droits aux travailleurs réguliers qui sont définis juridiquement, quant ils appartiennent à la catégorie nouvelle, le chômeur «authentique» ou «involontaire ».
§ => Institutions spécialisées => assurance-‐chômage = qui indemnisent sur la base de droits et devoirs (acceptation du salariat)
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
1-‐B/ La mesure du chômage § 1ère étape construction = tournant des XIXe et XXe siècles, période durant
laquelle est élaboré lentement le concept de chômage moderne par les réformateurs sociaux anglais et USA
§ Années 1880 => passage dans le classement des sans-‐emploi dans la catégorie « chômeurs » à la détermination des causes du chômage en distinguant des catégories de phénomènes et de populations.
§ 1880’s => Charles Booth ≠ répartit les sans-‐emplois en 2 catégories = vrais chômeurs et inaptes à l’emploi.
§ Techniquement => distinguer les pauvres des sans emploi – qui jusque-‐là se confondaient – en définissant selon un critère incontestable « la disposition d’un individu à travailler » § => 1896 = 1ère enquête d’ampleur pour distinguer PAO et les autres travailleurs § => Le terme « population active » apparaît pour la première fois au
recensement de 1896 § Rôle des statisticiens = emploi des indices permettant de mesurer le
chômage sans compter (un à un) les chômeurs. § =>Au XIXe beaucoup de chômeurs mais incapacité à les compter par les
méthodes traditionnelles. § Sources =Fouquet Annie, « L'invention de l'inactivité », Travail, genre et sociétés 1/ 2004 (N° 11), p. 47-‐62URL www.cairn.info/revue-‐travail-‐genre-‐et-‐societes-‐2004-‐1-‐page-‐47.htm. § « Histoire de la définition du chômage » -‐ Ingrid Liebeskind Sauthier, Courrier des statistiques n° 127, mai-‐août 2009, p8 et s
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 2/ Arbitrage travail/loisirs, chômage involontaire, etc.
2/ Arbitrage travail/loisirs, chômage involontaire, K humain, insiders/outsiders, « segmentation interne/externe » Plusieurs théories expliquent pourquoi on a du chômage, pourquoi il apparaît et disparaît, qui le produit ou quels processus l’expliquent. 2-‐A/ Arbitrage travail/loisirs § Théorie d’inspiration libérale ou néolibérale qui met l’accent sur le
chômage volontaire § Individus producteurs et consommateurs, demandeurs ou offreurs
de travail sont tout le temps responsables de leurs actions volontaires. Ils ont des niveaux de production et d’effort connus.
§ Axe principal 1 = lié le travail à l’effort à la rémunération => les individus ne travaillent que s’ils sont motivés par des rémunérations intéressantes (pouvoir d’achat)
§ => Sinon les individus se mettent au chômage volontaire § Axe principal 2 = les entreprises sont incitées à l’embauche si les
salaires sont bas – présence d’incitations/motivations § => Sinon les entreprises n’embauchent pas ou désembauchent
volontairement(salaires trop hauts)=> chômage
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 2/ Arbitrage travail/loisirs, chômage involontaire, etc.
2-‐A/ Arbitrage travail/loisirs(suite) § Conséquences :
§ C1=> Individus préfèrent les vacances/loisirs quand les salaires ne sont pas assez hauts et stimulants (arbitrage travail/loisirs)
§ => Offre de travail est croissante quand le salaire réel augmente (et vice et versa quand le salaire réel décroît)
§ C2=> Entreprises préfèrent ne pas embaucher quand les salaires sont hauts (desincitation à l’embauche)
§ => Demande de travail est décroissante qd le salaire réel augmente (et vice versa quand le salaire réel diminue)
§ Equilibre sur le marché est réalisé quand on trouve un salaire réel qui permet à la fois d’exprimer une quantité X d’offre de travail et une quantité Y de demande de travail = égales (X=Y) § Pour un salaire (noté w en anglais) = w réel alors => X =Y
§ Les agents économiques font leurs calculs et expriment une quantité donnée
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 2/ Arbitrage travail/loisirs, chômage involontaire, etc.
2-‐A/ Arbitrage travail/loisirs(suite)
Marché du travail Source : http://www.cairn.info/ [5] ERHEL C., Les Politiques de l’emploi, PUF, coll. « Que sais-‐je ? », 2008.
Modèle général Néo-‐Classique Source: Surfeco21.com
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 2/ Arbitrage travail/loisirs, chômage involontaire, etc.
2-‐B/ Chômage involontaire : Théorie keynésienne de l’emploi § Théorie proposée par Keynes (mais d’autres aussi avant lui) § Individus producteurs et consommateurs, demandeurs ou offreurs de
travail ne sont pas tout le temps responsables de leurs actions. => leur situation peut être liée à des facteurs non maîtrisables et notamment sur d’autres marchés
§ Axe principal 1 : Entreprises sont les seules à déterminer le volume de l’emploi. Volume de l’emploi dépend des carnets de commande => Qd entreprises ont des commandes => Embauche
=> Qd entreprises pas de commandes => Suppression de postes § Axe principal 2 : Rôle fondamental du marché des Biens et Services dans
la détermination de la situation de celui de l’emploi => Qd ìdemande de B&S => ì Prod => ì Emploi (vice et versa) § Rôle du marché de la monnaie : Qd les tx d’i ì => î des projets
d’investissement => îprojets d’embauche => Licenciement/Chômage § Conséquence : Chômage involontaire et embauches involontaires sur le
marché de l’emploi § Rôle des politiques de relance de la consommation => cercle vertueux
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 2/ Arbitrage travail/loisirs, chômage involontaire, etc.
2-‐C/ Théorie du Capital Humain : § Théorie proposée par S. Becker 1964 Human capital: A theoretical and empirical
analysis (mais d’autres aussi avant lui) § Théorie fondée (& revendiquée) sur l’analyse libérale néo-‐classique – homo
oeconomicus rationnel § Théorie adapte les principes du capital physique au capital humain = le stock de
capital humain est régi par les mêmes règles que le capital physique (productivité, durée de vie, etc.)
§ Axe principal 1 : Individu détient un stock de K humain = capcités intellectuelles § Le stock de connaissances & capacités est donné au départ (innées) mais aussi
acquises par la formation, éducation, le « learning by doing » en entreprise § Axe principal 2: Individu gère son stock K humain comme une entreprise § Opportunité d’investir en KH en comparant le coût de l'investissement aux gains actualisés
(avec valeur de la monnaie au fil du temps)* qu'il pourra ensuite en retirer ensuite en entreprise = dépenses en formation / Salaires actualisés futurs
§ Conséquences : § => Dépenses d’éducation générale et spécifique fi famille et Etat favorables au KH
(discrimination entre les individus des différentes classes sociales) § => L'accumulation du capital humain se poursuit au cours de la vie tant que le
rendement marginal de l'investissement en capital humain (mesuré par les salaires actualisés perçus) dépasse le taux d'intérêt -‐ toute hausse du salaire élève le coût d'opportunité -‐ le rendement diminue avec l'âge, le nombre d'années pour amortir l'investissement se réduisant -‐ (*Monique Abellard, « Alternatives Economiques Poche » n° 021 – novembre 2005)
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 2/ Arbitrage travail/loisirs, chômage involontaire, etc.
2-‐D/ Théorie « insiders/outsiders » § Théorie non libérale & courant institutionaliste Lindbeck et Snower 1988 § Les salariés intégrés dans l’entreprise (insiders) ont un pouvoir de
négociation supérieur aux chômeurs et salariés en position défavorable (outsiders) qui cherchent à intégrer l’entreprise.
§ Axe principal 1 : Insiders § => Pouvoir d’influencer les salaires (grille de salaires basse) § => Pouvoir de fixer des normes de qualification (formation +++) § => Pouvoir de grève, blocage de la prod, etc. § => Coûts de licenciement/remplacement très forts (prime, formation,etc
§ (surtout dans les grandes entreprises) § Axe principal 2 : Outsiders § => Les outsiders sont prêts à accepter des salaires moins chers que les
insiders = le problème principal n’est pas le salaire. § => Vice et versa avec les insiders § Conséquences : Dysfonctionnements sur le marché du travail => Salaires rigides (ne baissent pas) => Chômage peut rester à des niveaux élevés => Entreprises peuvent hésiter à embaucher Théorie qui explique les rigidités sur le marché du travail et donc sa non flexibilité parfaite (contraire des conceptions libérales)
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 2/ Arbitrage travail/loisirs, chômage involontaire, etc.
2-‐E/ Théorie « segmentation interne/externe » & « Primaire/secondaire » § Théorie non libérale & institutionaliste P.B. Doeringer et M.J. Piore (Internai Labor
Markets and Manpower Analysis, 1971). § Le marché du travail se décompose en deux sous marchés qui fonctionnent
complètement différemment = un marché interne, protégé, avec informations réservées/cachées, réseaux, procédures fixées, etc. avec salaires hauts et peu flexibles et un marché externe, ouvert, concurrentiel, etc. avec salaires plus faibles et très flexibles
§ Axe principal 1 : Marché interne § Le marché interne est « une unité administrative à l’intérieur de laquelle la
rémunération et l’affectation du travail sont déterminées par un ensemble de règles et procédures administratives » (Doeringer et Piore) => pas de logique de marché
§ Rôle des groupes et des partenaires identifiés, procédures, règles construites § Axe principal 2 : Marché externe § Le marché externe fonctionne selon la « théorie économique conventionnelle »
les règles du marché concurrentiel, informations non réservées, accessibles à tous, gratuitement (pas d’effet de réseau, etc.) => logique de marché
§ Conséquences : Dysfonctionnements sur LE marché du travail => Chômage peut rester à des niveaux élevés => Théorie qui explique les rigidités sur le marché du travail non flexible => Théorie qui explique la non centralité et unicité du marché du travail réglé par la variable d’ajustement qui est le salaires (contraire des conceptions libérales)
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 3/ Le travail & la population active
3/ Le travail & la population active : facteurs essentiels des cycles économiques (politique de lutte/formation/crises) 3-‐A/ Lien entre population active et production § Lien entre la population générale, la population active et la croissance
économique est une variable importante en économie § Pas de règles prédéterminées => pas de garantie
§ Cas 1 : 1 pop importante = prod. importante § Cas 2 : 1 pop importante ≠ prod. Importante § Exemples Comparaison entre USA et Chine en termes relatifs
§ Facteur de la productivité par tête ou par actif mais attention ce facteur peut être compensé au niveau national par le nb…
§ Importance des autres facteurs de prod. = K financier, technique, des ressources naturelles, etc;
§ Population générale à la population active (cf Slide supra) § Population active dépend de nb facteurs : durée des études, âge légal de
la scolarités, taux de scolarisation, retraite, statut des femmes & enfants, dynamique économique, etc.
§ Rôle de l’immigration/émigration => Variation très forte de la population active. Cas des USA = croissance ininterrompue de la population depuis 2 siècles – de 2000 à 2014 de 300 millions à 330 => Compensation de la faiblesse de la natalité = Italie, Espagne dans les années 1990 – 2000, actuellement Allemagne
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 3/ Le travail & la population active
3-‐A/ Lien entre population active et production § => 3 cercles = représentent les liens entre la population active, le
système productif et la production.
Population Active • Quantité • Formation • Rémunération • Cirières légaux • Etc.
Système Productif • Nb entreprises • Innovation • Réseaux • Etc.
Production • Résultat quantitatif
• Résultat qualitatif • Etc.
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 3/ Le travail & la population active
3-‐A/ Lien entre population active et production § Condition nécessaire préalable = Croissance et taille de la population =>
préalable à la condition de croissance (sans individus = pas de production même si on peut mobiliser des réseaux à l’étranger). Condition relative aux forces des autres pays.
§ Conditions de système politico-‐économique = Besoin d’1 cadre § Triptyque occidental = Droits de l’homme (individuel), économie de marché et
démocratie § Mais Chine et Inde présente d’autres caractéristiques : système centralisé PPC,
système de castes, etc. § Conditions stabilité du système = Stabilité & Résolution des Pb politiques
§ Paix sur le territoire de production, pays dans lequel s’établit système production § Historiquement : guerres/crises régionales ou de grande ampleur provoquent
souvent des déplacements de centre de production § Attention : La guerre profitable quant elle n’est pas localisée sur le territoire et
qu’elle ne provoque pas de dégâts (cas des USA en 39-‐45) § En tout cas = sans stabilité, les entreprises et les affaires sont affectées =
déplacement ailleurs ou baisse des profits/production § Conditions sur les ressources naturelles =
§ Disposition de ressources naturelles mobilisables ou transformables, directement disponibles sur le sol (ou à inventer PaysBas, Venise, etc.)
§ Capacité à maîtriser les réseaux d’approvisionnement (Japon, PaysBas) qd on ne dispose pas de ressources
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 3/ Le travail & la population active
3-‐B/ Les critères déterminants l’évolution de la population § 1/ Tx natalité et tx mortalité = tx accroissement naturel (tx de natalité – tx de mortalité)
§ => Qd tx accroissement naturel est > 0 => pop. augmente § => Qd tx accroissement naturel est < 0 => pop. diminue
§ 2/ Santé/maladie = médecine, prévention, maladie, etc. § => Maladies = Epidémies (extension locale) Pandémies (extension continentale) § => Rôle de la Médecine préventive (contraception) § => Rôle de la Médecine curative (Avancées médicales suivent les sociétés dominantes)
§ 3/ Alimentation/famine = quantité et qualité § => Question du bol alimentaire équilibré = légumes secs-‐Féculents /légumes verts/Fruits, etc. § => Mais quantité ne signifie pas qualité = risques => obésité, maladie cardio-‐vasculaires
§ 4/ Guerre/Paix = périodes CT ou LT (1ère Guerre Mondiale = 20M de victimes , la 2ème GM => provoque 20 M de morts en Russie mais Rwanda => 800 000 morts en 2 semaines)
§ 5/ Circonstances exceptionnelles = nature, catastrophes naturelles => petit âge glaciaire tremblements de terre, volcans, inondations, tsunami (300 000 morts Indonésie)
§ 6/ Facteurs socio-‐culturels et politiques § => Rôle de l’éducation (sexuelle/contraception), l’intégration des femmes dans la société =
émancipation => tx de natalité UE du Sud faibles § => Rôle des facteurs politiques = pol favorables aux naissances dans certaines conditions et puis
défavorables (ex = Chine après pol. Nataliste => pol enfant unique)
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 3/ Le travail & la population active
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § Dynamique du taux d’emploi § Les évolutions de la population et de la population active ne se
recouvrent pas => la population totale peut diminuer et la PA peut augmenter (cf tab)
§ => La population française va continuer à augmenter mais le taux d’emploi va diminuer si on le prend entre 15 et 65 ans.
§ Le tableau ci-‐dessous suivant montre que le taux d’activité va monter si on le prend jusqu’à 69 ans… § Rôle des facteurs légaux (âge limites), socio-‐culturels (enfants/femmes),
etc.
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage Taux d'activité selon le sexe et l'âge
en %
1990 2000 2010 (r) 2011
Hommes de 15 ans ou plus 65,6 63,2 62,1 61,815 à 24 ans 47,4 40,4 42,7 41,625 à 49 ans 96,4 95,2 94,8 94,450 à 64 ans 57,3 59,4 61,2 62,2dont 55 à 64 ans 41,0 36,0 45,3 47,265 ans ou plus 3,7 2,0 2,2 2,7Femmes de 15 ans ou plus 47,3 49,5 51,7 51,715 à 24 ans 40,3 33,2 35,5 34,925 à 49 ans 75,5 80,6 84,2 83,950 à 64 ans 38,3 46,8 54,2 55,2dont 55 à 64 ans 27,6 28,2 40,0 41,865 ans ou plus 1,4 0,8 1,0 1,4Population de 15 ans ou plus 56,1 56,1 56,7 56,5
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ouplus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Projection de population active
2010 (p) 2020 2040 2060
Nombre d'actifs (en millions) 28,3 29,6 30,4 31,2Part des femmes (en %) 47,7 48,1 47,3 46,9Part des 15-24 ans (en %) 10,3 9,9 10,1 10,1Part des 25-54 ans (en %) 77,2 73,3 72,2 72,0Part des 55 ans ou plus (en %) 12,5 16,8 17,7 17,9Taux d'activité des 15-69 ans (en %) 66,6 67,7 69,4 69,7Nombre d'actifs rapporté au nombred'inactifs de 60 ans ou plus1 2,1 1,9 1,6 1,5
1. Ratio calculé sur la population totale qui intègre les personnes vivant dans deshabitations mobiles ou résidant en collectivité.Champ : population des ménages de 15 ans ou plus de France métropolitaine enâge courant, scénario central.Source : Insee, enquêtes Emploi, projections de population active 2010-2060.
Population active par sexe et âge en 2011en milliers
Hommes Femmes Total
15 à 24 ans 1 555 1 290 2 84625 à 49 ans 9 503 8 711 18 21450 à 64 ans 3 662 3 469 7 132dont 55 à 64 ans 1 823 1 735 3 55865 ans ou plus 117 81 198Population de 15 ans ou plus 14 838 13 552 28 390dont 15 à 64 ans 14 721 13 471 28 192
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ouplus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Population active et population active occupée
2009 2010 2011
Population active (en millions) 28,2 28,3 28,4Population active occupée (en millions) 25,6 25,7 25,8dont femmes (en %) 47,5 47,5 47,5dont non salariés (en %) 11,0 11,5 11,7Part des actifs occupés en sous-emploi (en %) 5,6 5,9 5,1
Part des employés en sous-emploi (en %) 10,1 10,6 9,7Part des ouvriers en sous-emploi (en %) 5,6 5,7 4,5Part des femmes en sous-emploi (en %) 8,4 8,8 7,9
Lecture : en moyenne en 2011, 4,5 % des ouvriers sont en situation de sous-emploi.Champ : données en moyenne annuelle ; France métropolitaine, population desménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Taux d'activité et taux d'emploi dans l'Unioneuropéenne en 2011
Populationactive
Tauxd'activité
Taux d'emploien %
en millions en % Hommes Femmes Ensemble
Allemagne 42,2 77,2 77,3 67,7 72,5Autriche 4,3 75,3 77,8 66,5 72,1Belgique 4,9 66,7 67,1 56,7 61,9Bulgarie 3,3 66,0 60,9 56,2 58,5Chypre 0,4 74,0 74,7 61,6 68,1Danemark 2,9 79,3 75,9 70,4 73,1Espagne 23,1 73,7 63,2 52,0 57,7Estonie 0,7 74,7 67,7 62,8 65,1Finlande 2,7 74,9 70,6 67,4 69,0France 28,6 70,4 68,1 59,7 63,8Grèce 5,0 67,7 65,9 45,1 55,6Hongrie 4,3 62,7 61,2 50,6 55,8Irlande 2,1 69,4 63,1 55,4 59,2Italie 25,1 62,2 67,5 46,5 56,9Lettonie 1,1 73,3 62,9 60,8 61,8Lituanie 1,6 72,0 60,9 60,5 60,7Luxembourg 0,2 67,9 72,1 56,9 64,6Malte 0,2 61,6 73,6 41,0 57,6Pays-Bas 8,8 78,4 79,8 69,9 74,9Pologne 17,9 66,1 66,3 53,1 59,7Portugal1 5,5 74,1 68,1 60,4 64,2Rép. tchèque 5,3 70,5 74,0 57,2 65,7Roumanie 9,9 63,3 65,0 52,0 58,5Royaume-Uni 31,6 75,7 74,5 64,5 69,5Slovaquie 2,7 68,9 66,3 52,7 59,5Slovénie 1,0 70,3 67,7 60,9 64,4Suède 5,0 80,2 76,3 71,8 74,1UE à 27 240,4 71,2 70,1 58,5 64,3
1. Rupture de série.Champ : données en moyenne annuelle, population des 15-64 ans.Source : Eurostat.
Travail - Emploi 45
Population active 4.1
0
5
10
15
20
25
30
35
Agriculteursexploitants
Artisans,comm. et
chefsd'entreprise
Cadres et prof.intellect.
supérieures
Professionsinterméd.
Employés Ouvriers
2005 2011
Personnes en emploi selon la catégoriesocioprofessionnelle
en %
Champ : population des ménages en France métropolitaine, personnes en emploi de15 ans ou plus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Taux d'activité selon le sexe et l'âgeen %
1990 2000 2010 (r) 2011
Hommes de 15 ans ou plus 65,6 63,2 62,1 61,815 à 24 ans 47,4 40,4 42,7 41,625 à 49 ans 96,4 95,2 94,8 94,450 à 64 ans 57,3 59,4 61,2 62,2dont 55 à 64 ans 41,0 36,0 45,3 47,265 ans ou plus 3,7 2,0 2,2 2,7Femmes de 15 ans ou plus 47,3 49,5 51,7 51,715 à 24 ans 40,3 33,2 35,5 34,925 à 49 ans 75,5 80,6 84,2 83,950 à 64 ans 38,3 46,8 54,2 55,2dont 55 à 64 ans 27,6 28,2 40,0 41,865 ans ou plus 1,4 0,8 1,0 1,4Population de 15 ans ou plus 56,1 56,1 56,7 56,5
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ouplus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Projection de population active
2010 (p) 2020 2040 2060
Nombre d'actifs (en millions) 28,3 29,6 30,4 31,2Part des femmes (en %) 47,7 48,1 47,3 46,9Part des 15-24 ans (en %) 10,3 9,9 10,1 10,1Part des 25-54 ans (en %) 77,2 73,3 72,2 72,0Part des 55 ans ou plus (en %) 12,5 16,8 17,7 17,9Taux d'activité des 15-69 ans (en %) 66,6 67,7 69,4 69,7Nombre d'actifs rapporté au nombred'inactifs de 60 ans ou plus1 2,1 1,9 1,6 1,5
1. Ratio calculé sur la population totale qui intègre les personnes vivant dans deshabitations mobiles ou résidant en collectivité.Champ : population des ménages de 15 ans ou plus de France métropolitaine enâge courant, scénario central.Source : Insee, enquêtes Emploi, projections de population active 2010-2060.
Population active par sexe et âge en 2011en milliers
Hommes Femmes Total
15 à 24 ans 1 555 1 290 2 84625 à 49 ans 9 503 8 711 18 21450 à 64 ans 3 662 3 469 7 132dont 55 à 64 ans 1 823 1 735 3 55865 ans ou plus 117 81 198Population de 15 ans ou plus 14 838 13 552 28 390dont 15 à 64 ans 14 721 13 471 28 192
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ouplus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Population active et population active occupée
2009 2010 2011
Population active (en millions) 28,2 28,3 28,4Population active occupée (en millions) 25,6 25,7 25,8dont femmes (en %) 47,5 47,5 47,5dont non salariés (en %) 11,0 11,5 11,7Part des actifs occupés en sous-emploi (en %) 5,6 5,9 5,1
Part des employés en sous-emploi (en %) 10,1 10,6 9,7Part des ouvriers en sous-emploi (en %) 5,6 5,7 4,5Part des femmes en sous-emploi (en %) 8,4 8,8 7,9
Lecture : en moyenne en 2011, 4,5 % des ouvriers sont en situation de sous-emploi.Champ : données en moyenne annuelle ; France métropolitaine, population desménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Taux d'activité et taux d'emploi dans l'Unioneuropéenne en 2011
Populationactive
Tauxd'activité
Taux d'emploien %
en millions en % Hommes Femmes Ensemble
Allemagne 42,2 77,2 77,3 67,7 72,5Autriche 4,3 75,3 77,8 66,5 72,1Belgique 4,9 66,7 67,1 56,7 61,9Bulgarie 3,3 66,0 60,9 56,2 58,5Chypre 0,4 74,0 74,7 61,6 68,1Danemark 2,9 79,3 75,9 70,4 73,1Espagne 23,1 73,7 63,2 52,0 57,7Estonie 0,7 74,7 67,7 62,8 65,1Finlande 2,7 74,9 70,6 67,4 69,0France 28,6 70,4 68,1 59,7 63,8Grèce 5,0 67,7 65,9 45,1 55,6Hongrie 4,3 62,7 61,2 50,6 55,8Irlande 2,1 69,4 63,1 55,4 59,2Italie 25,1 62,2 67,5 46,5 56,9Lettonie 1,1 73,3 62,9 60,8 61,8Lituanie 1,6 72,0 60,9 60,5 60,7Luxembourg 0,2 67,9 72,1 56,9 64,6Malte 0,2 61,6 73,6 41,0 57,6Pays-Bas 8,8 78,4 79,8 69,9 74,9Pologne 17,9 66,1 66,3 53,1 59,7Portugal1 5,5 74,1 68,1 60,4 64,2Rép. tchèque 5,3 70,5 74,0 57,2 65,7Roumanie 9,9 63,3 65,0 52,0 58,5Royaume-Uni 31,6 75,7 74,5 64,5 69,5Slovaquie 2,7 68,9 66,3 52,7 59,5Slovénie 1,0 70,3 67,7 60,9 64,4Suède 5,0 80,2 76,3 71,8 74,1UE à 27 240,4 71,2 70,1 58,5 64,3
1. Rupture de série.Champ : données en moyenne annuelle, population des 15-64 ans.Source : Eurostat.
Travail - Emploi 45
Population active 4.1
0
5
10
15
20
25
30
35
Agriculteursexploitants
Artisans,comm. et
chefsd'entreprise
Cadres et prof.intellect.
supérieures
Professionsinterméd.
Employés Ouvriers
2005 2011
Personnes en emploi selon la catégoriesocioprofessionnelle
en %
Champ : population des ménages en France métropolitaine, personnes en emploi de15 ans ou plus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 3/ Le travail & la population active
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § Dynamique du taux d’emploi § Depuis les années 1960 la PA =augmentation rapide
§ F1 => Baby Boom (période 45-‐55) § F2 => Travail des femmes (émancipation féminine) § F3 => Demande de travail augmente
§ Années 70 PA = Stabilise § F1 => Ralentissement de la demande de travail § F2=> Allongement de la durée du travail § F3=> Effet des crises (73/79) = § F4=> Abaissement de l’âge de la retraite
§ Années 80 et 90 = PA stabilisation/légère décroissance § F1=> Effet des crises = chute de la demande de travail § F2=> Diminution de la population globale => baisse de la PA § F3=> Départ des seniors => PA concentré sur les 30-‐50 ans
§ Années 2000 = PA croissance légère § F1=> Croissance de la population générale (tx de natalité repart) § F2=> Age de départ légal augmente § F3=> Demande de travail faible § F4=> Jeunes plus tôt sur le marché du travail
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 3/ Le travail & la population active
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § Dynamique du taux d’emploi § France => taux d’emploi est faible § Stratégie de Lisbonne 2000= objectifs de redressement du taux
§ => 50% pour les 55-‐64 ans (réel 37%) § Rapport du CAE (D’Autune, Betbèze, Hairault) = Analyse
§ => Pacte Social implicite entre les salariés, employeurs et pouvoirs pub. § =>Pas de difficulté pour les seniors à s’adapter au progrès technique § => Explications =
§ => Retraite à 60 ans § => Dispositif de préretraite généreux § => Arrangement entre les 3 catégories
§ => Conséquences = emploi s’adapte = pas d’horizon pour les plus de 50 ans qui ne sont pas préparés pour après (pas de formation, pas de réorganisation du travail et des postes, pas évolution des rémunérations)
Sources : Beitone & al. « Dictionnaire de science économique » Armand Colin, 2010, p. 284 et S.
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 3/ Le travail & la population active
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § Dynamique du taux d’emploi § CAE = propose une réforme = carrières plus longues § R1=> Allongement de la durée de vie active et favoriser la retraite choisie
(emploi des plus de 60 ans et ceux de 55-‐60) § R2=> création d’un marché du travail des seniors en interdisant les départs
anticipés (préretraites,chômage indemnisé entre 50 et 60 ans) § R3=> Changement des comportements des entreprises en matière de
gestion des âges et des carrières = droit à la formation, prévention des risques sanitaires et d’invalidité ou organisation des conditions de travail en fin de carrière
§ Evolution de la PA (cf supra) depuis les années 80 et 90 ne correspond pas vraiment à cette stratégie en France
§ Paramètres qui influent sur cette stratégie = § P1 croissance économique
§ => pays avec fort tx d’emploi = pays à forte croissance éco= USA, Danemark, Suède § => pays avec faibel tx d’emploi = pays à faible croissance éco = France, Italie, Espagne
§ P2 facteurs socio politiques § => pays à fort couverture et flexibilité= Danemark, Suède § Sources : Beitone & al. « Dictionnaire de science économique » Armand Colin, 2010, p. 284 et S
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage
Taux d'activité selon le sexe et l'âgeen %
1990 2000 2010 (r) 2011
Hommes de 15 ans ou plus 65,6 63,2 62,1 61,815 à 24 ans 47,4 40,4 42,7 41,625 à 49 ans 96,4 95,2 94,8 94,450 à 64 ans 57,3 59,4 61,2 62,2dont 55 à 64 ans 41,0 36,0 45,3 47,265 ans ou plus 3,7 2,0 2,2 2,7Femmes de 15 ans ou plus 47,3 49,5 51,7 51,715 à 24 ans 40,3 33,2 35,5 34,925 à 49 ans 75,5 80,6 84,2 83,950 à 64 ans 38,3 46,8 54,2 55,2dont 55 à 64 ans 27,6 28,2 40,0 41,865 ans ou plus 1,4 0,8 1,0 1,4Population de 15 ans ou plus 56,1 56,1 56,7 56,5
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ouplus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Projection de population active
2010 (p) 2020 2040 2060
Nombre d'actifs (en millions) 28,3 29,6 30,4 31,2Part des femmes (en %) 47,7 48,1 47,3 46,9Part des 15-24 ans (en %) 10,3 9,9 10,1 10,1Part des 25-54 ans (en %) 77,2 73,3 72,2 72,0Part des 55 ans ou plus (en %) 12,5 16,8 17,7 17,9Taux d'activité des 15-69 ans (en %) 66,6 67,7 69,4 69,7Nombre d'actifs rapporté au nombred'inactifs de 60 ans ou plus1 2,1 1,9 1,6 1,5
1. Ratio calculé sur la population totale qui intègre les personnes vivant dans deshabitations mobiles ou résidant en collectivité.Champ : population des ménages de 15 ans ou plus de France métropolitaine enâge courant, scénario central.Source : Insee, enquêtes Emploi, projections de population active 2010-2060.
Population active par sexe et âge en 2011en milliers
Hommes Femmes Total
15 à 24 ans 1 555 1 290 2 84625 à 49 ans 9 503 8 711 18 21450 à 64 ans 3 662 3 469 7 132dont 55 à 64 ans 1 823 1 735 3 55865 ans ou plus 117 81 198Population de 15 ans ou plus 14 838 13 552 28 390dont 15 à 64 ans 14 721 13 471 28 192
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ouplus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Population active et population active occupée
2009 2010 2011
Population active (en millions) 28,2 28,3 28,4Population active occupée (en millions) 25,6 25,7 25,8dont femmes (en %) 47,5 47,5 47,5dont non salariés (en %) 11,0 11,5 11,7Part des actifs occupés en sous-emploi (en %) 5,6 5,9 5,1
Part des employés en sous-emploi (en %) 10,1 10,6 9,7Part des ouvriers en sous-emploi (en %) 5,6 5,7 4,5Part des femmes en sous-emploi (en %) 8,4 8,8 7,9
Lecture : en moyenne en 2011, 4,5 % des ouvriers sont en situation de sous-emploi.Champ : données en moyenne annuelle ; France métropolitaine, population desménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Taux d'activité et taux d'emploi dans l'Unioneuropéenne en 2011
Populationactive
Tauxd'activité
Taux d'emploien %
en millions en % Hommes Femmes Ensemble
Allemagne 42,2 77,2 77,3 67,7 72,5Autriche 4,3 75,3 77,8 66,5 72,1Belgique 4,9 66,7 67,1 56,7 61,9Bulgarie 3,3 66,0 60,9 56,2 58,5Chypre 0,4 74,0 74,7 61,6 68,1Danemark 2,9 79,3 75,9 70,4 73,1Espagne 23,1 73,7 63,2 52,0 57,7Estonie 0,7 74,7 67,7 62,8 65,1Finlande 2,7 74,9 70,6 67,4 69,0France 28,6 70,4 68,1 59,7 63,8Grèce 5,0 67,7 65,9 45,1 55,6Hongrie 4,3 62,7 61,2 50,6 55,8Irlande 2,1 69,4 63,1 55,4 59,2Italie 25,1 62,2 67,5 46,5 56,9Lettonie 1,1 73,3 62,9 60,8 61,8Lituanie 1,6 72,0 60,9 60,5 60,7Luxembourg 0,2 67,9 72,1 56,9 64,6Malte 0,2 61,6 73,6 41,0 57,6Pays-Bas 8,8 78,4 79,8 69,9 74,9Pologne 17,9 66,1 66,3 53,1 59,7Portugal1 5,5 74,1 68,1 60,4 64,2Rép. tchèque 5,3 70,5 74,0 57,2 65,7Roumanie 9,9 63,3 65,0 52,0 58,5Royaume-Uni 31,6 75,7 74,5 64,5 69,5Slovaquie 2,7 68,9 66,3 52,7 59,5Slovénie 1,0 70,3 67,7 60,9 64,4Suède 5,0 80,2 76,3 71,8 74,1UE à 27 240,4 71,2 70,1 58,5 64,3
1. Rupture de série.Champ : données en moyenne annuelle, population des 15-64 ans.Source : Eurostat.
Travail - Emploi 45
Population active 4.1
0
5
10
15
20
25
30
35
Agriculteursexploitants
Artisans,comm. et
chefsd'entreprise
Cadres et prof.intellect.
supérieures
Professionsinterméd.
Employés Ouvriers
2005 2011
Personnes en emploi selon la catégoriesocioprofessionnelle
en %
Champ : population des ménages en France métropolitaine, personnes en emploi de15 ans ou plus (âge courant).Source : Insee, enquêtes Emploi.
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § La dynamique du chômage § La crise économique des années 30’s => chômage de masse produit très
rapidement entre les années 30 et 36 en occident § Après 45 => Régulation fordiste + modèle de politique économique keynésien
§ =>Les 30 glorieuses = croissance de la production+ redistribution de gains de productivité + embauche + plein emploi (quasi)
§ Crises des années 73/74 et 79/80 = augmentation du chômage (chômage croissant de masse) + 1ère remises en cause du modèle fordiste (politiques libérales mises en place dans les tous les pays occidentaux Reagan/Thatcher/Mitterrand(82/83)
§ Croissance plus forte aux USA qu’en Europe dans les 90’s et jusqu’en 2008 => tx de chômage augmente plus vite en UE qu’aux USA § => Mais entre 2007 et 2008 = taux de chômage a baissé
§ Crise de 2009 => Chocs très forts sur toutes les économies occidentales = USA, UE, Japon mais Asie touchée mais seulement ralentissement de la croissance en Chine
§ Depuis la crise = reprise aux USA baisse du chômage plus rapide qu’en UE § Les pays scandinaves proposent un modèle alternatif = modèle social très
protecteur = chômage faible et fort niveau de protection sociale (taux d’imposition les plus élevés au monde)
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § La dynamique du chômage
§ Taux de chômage à long terme comparaison UE/USA/JAPON § en % (moyenne annuelle par période)
Années 1970
Années 1980
Années 1990-‐1995
Années 1996-‐2000
Années 2001-‐2005
2009
UE 3,7 9,0 9,5 9,6 8,5 9,0
USA 6,1 7,3 6,4 4,6 5,4 9,3
JAPON 1,7 2,5 2,5 4,1 5,0 5,0
Sources : Beitone & al. « Dictionnaire de science économique » Armand Colin, 2010, p. 285
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § La dynamique du chômage
5Chapitre 1 – Un tour du monde
Comment réduire le chômage ?La lutte contre le chômage est la première des priorités des gouvernements. Un taux de chômage élevé n’est pas une donnée intangible de l’histoire européenne. La !gure 1.3, qui représente l’évolution des taux de chômage dans l’Union européenne et aux États-Unis, montre à quel point le chômage européen était faible dans les années 1960. À cette époque, les Américains parlaient du « miracle européen », et certains macroéconomistes améri-cains venaient en Europe dans l’espoir de découvrir le secret de ce miracle ! En France, le chômage était de 1,3 % en 1961, de 2,7 % en 1971. Ce n’est qu’à partir des années 1970 que les taux décollent, passant à 7,3 % en 1981, à 9,5 % en 1990. Depuis cette date, le taux de chômage français a connu des #uctuations conjoncturelles relativement importantes, sans jamais être durablement passé en dessous de 8 %. Le « miracle » européen a donc disparu. On parle d’un « chômage structurel » dans le cas européen, c’est-à-dire d’un niveau de chômage qui n’est pas le résultat d’une bonne ou d’une mauvaise conjoncture, mais dont les racines sont plus profondes.
Figure 1.3 – Taux de chômage : l’Europe et les États-Unis.
0
2
4
6
8
10
12
Taux
de
chôm
age
(en
%)
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
États-Unis
Union européenne des 15
Union européenne des 25 / 27
à partir de 2007
Le taux de chômage européen, d’abord beaucoup plus faible que le taux américain, l’a dépassé dans les années 1980.
Sources : OCDE et Eurostat.
De nombreuses théories cherchent à expliquer pourquoi le « chômage structurel » est élevé en Europe et quels sont les moyens de le réduire. À l’un des extrêmes se trouvent ceux qui incriminent ce qu’ils appellent les « rigidités du marché du travail ». Selon eux, l’Europe sou$re d’un niveau d’allocations chômage trop élevé, d’un salaire minimum trop élevé et d’une trop grande protection des travailleurs. Pour eux, la solution serait donc de lever ces rigidités pour rendre le marché du travail plus #exible, à l’image du marché du travail américain. À l’autre extrême se trouvent ceux selon lesquels ces soi-disant rigidités ne sont pas excessives, mais pour qui le chômage élevé résulte avant tout de mauvaises mesures de politique macroéconomique. Pour eux, un changement d’in#exion de la politique – par exemple une politique monétaire plus expansionniste entraînant une baisse des taux d’in-térêt – pourrait relancer la demande, et ainsi ramener les taux de chômage à des niveaux
© 2010 Pearson Education France – Macroéconomie, 5e éd. – Olivier Blanchard, Daniel Cohen
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § La dynamique du chômage
§ Graphique de l’évolution du taux de chômage en France à LT
§ Sources : INSEE et http://france-‐inflation.com/graph_chomage.php#graphique_chomage
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § La dynamique du chômage § Recommandations de l’OCDE => lutte contre le Chômage
§ => Les jeunes doivent quitter le syst. d’enseignement avec une qualification (2007 = 18% des 20/24 ans – 130 000 sans diplôme)
§ => Cibler les aides publiques pour l’apprentissage pour jeunes non qualifiés
§ => Bénéfice des aides pour les PME pour les jeunes non qualifiés § => Stages obligatoires à l’université dès la licence § => Réduire la segmentation du marché du travail = CDD n’est plus un
passage vers CDI mais CDD = situation définitive (16% en CDI…slt) § => « filet de sécurité » pour les moins de 26 ans les plus défavorisés
(extension du RSA aux moins de 25 ans) § Sources : Beitone & al. « Dictionnaire de science économique » Armand Colin, 2010, p. 280 et S
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § Les politiques actuelles de lutte contre le chômage § Typologies des politiques de l’OCDE = proposition d’un mix de
mesures § =>Mesures actives =
§ 1-‐ accompagnement et aide à la recherche d’emploi § 2-‐ spécifiques pour l’emploi des catégories de chômeurs ciblés (longue durée et
jeunes) § 2-‐ mesures de formation
§ => Mesures passives = § 1-‐ Indemnisation du chômage § 2-‐ préretraite § 3-‐ Diminution de la durée du travail Sources : Beitone & al. « Dictionnaire de science économique » Armand Colin, 2010, p. 285 et S
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § Les politiques actuelles de lutte contre le chômage § Selon Yannick L’Horty § Analyse du chômage modifiée =
§ =>Chômage pas seulement la conséquence d’une demande insuffisante de travail des entreprises (faute d’activité) mais aussi d’une offre de travail inadapté
§ => Chômage structurel => empêche offre de s’adapter à la demande § 1-‐ Subventionner les employeurs pour baisser le coût du travail et
augmenter l’emploi non qualifié (20 Milliards en France) § 2-‐ Mise en place d’incitations monétaires au travail = diminuer l’écart entre
les revenus sociaux des inactifs et les revenus touchés par les actifs (intérêts monétaires au travail) ex prime pour l’emploi (cumul des rémunérations, RSA, etc.)
§ 3-‐ Développement d’incitations non monétaires = suppression des formalités administratives, freins à l’embauche, etc.
Sources : Beitone & al. « Dictionnaire de science économique » Armand Colin, 2010, p. 285 et S
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § Les politiques actuelles de lutte contre le chômage
Les dispositifs spécifiques de la politique del’emploi prennent la forme d’aides à l’emploi,de stages de formation professionnelle ou demesures de retrait d’activité anticipé. En 2011,le nombre total d’entrées dans ces dispositifsest en baisse, la hausse des entrées dans lescontrats en alternance ne suffisant pas àcompenser le repli de celles en contrats aidéshors alternance et dans les mesures de retraitd’activité.
Le contrat unique d’insertion (CUI), contratà durée déterminée ou indéterminée destiné àfaciliter l’insertion professionnelle des personnessans emploi rencontrant des difficultés particu-lières d’accès à l’emploi, est entré en vigueuren France métropolitaine le 1er janvier 2010.Ce contrat prend la forme du contrat initiativeemploi (CIE) dans le secteur marchand et ducontrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)dans le secteur non marchand. Les contrats spé-cifiques aux bénéficiaires de minima sociaux– le contrat insertion-revenu minimum d’ac-tivité (CI-RMA) et le contrat d’avenir – ont étéabrogés. Après avoir fortement crû en 2009 et2010, les entrées en emplois aidés nonmarchands se sont élevées à 356 000 en 2011(– 21 000 en un an), malgré des moyens sup-plémentaires dégagés en cours d’année etl’implication des conseils généraux pouraccroître le nombre de contrats conclus avecdes bénéficiaires du RSA socle. En 2011, lesentrées en CUI-CIE ont diminué de moitié parrapport à 2010 (53 000 après 113 000) en lien
avec la réduction de l’enveloppe financièreaffectée à ces contrats. Les entrées en contratsen alternance ont en revanche augmenté de7 %.
Au total, en 2011, plus de 1 957 000personnes sont entrées dans les dispositifs spé-cifiques de la politique de l’emploi (– 5 % enun an). Le nombre de bénéficiaires présentsfin 2011 est en baisse par rapport à fin 2010 ets’établit à 1 773 000.
En 2010, les dépenses pour les politiquesdu marché du travail (PMT) s’élèvent à50,1 milliards d’euros après 45,7 milliardsd’euros en 2009. Après la forte hausse observéeen 2009 dans un contexte de crise écono-mique majeure et de dégradation du marchédu travail (+ 17 % en volume), elles augmen-tent encore en 2010 (+ 8 %). Les dépensesd’indemnisation du chômage en constituentla principale composante avec 28 milliardsd’euros. Les moyens affectés au Service publicde l’emploi s’élèvent à 5,9 milliards d’euros.La hausse globale des dépenses PMT provientprincipalement de celle des dépenses pour lesmesures actives, qui atteignent 16,1 milliardsd’euros en 2010.
En 2010, la France a consacré 2,6 % de sonproduit intérieur brut (PIB) aux interventionssur le marché du travail. Elle se situe au7ème rang des pays de l’Union européenne,derrière l’Espagne, l’Irlande, la Belgique, leDanemark, les Pays-Bas et la Finlande. !
4.3 Politiques d'emploi
48 TEF, édition 2013
Définitions
Contrat en alternance : contrat d’apprentissage qui permet à des 16-25 ans de travailler et de suivre un enseigne-ment en alternance conduisant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle ; contrat deprofessionnalisation qui vise à permettre l’acquisition, par les 16-25 ans et les demandeurs d’emploi de 26 ans ouplus, d’une qualification professionnelle en relation avec les besoins identifiés par les branches professionnelles.Contrat aidé ou emploi aidé, contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrat d’avenir (CAV), contrat initia-tive emploi (CIE), contrat insertion – revenu minimum d’activité (CI-RMA), contrat unique d’insertion (CUI),dépenses pour les politiques du marché du travail (PMT), mesures de retrait d’activité : voir rubrique « définitions »en annexes.
! « Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2010 », Dares Analyses, Dares, janvier 2013.! « Les contrats d’aide à l’emploi en 2011 : des entrées en baisse, mais des contrats plus ciblés sur les publics en
difficulté », Dares Analyses no 88, Dares, novembre 2012.! « L’apprentissage en 2011 : hausse des entrées, surtout dans les entreprises d ’au moins 50 salariés », Dares
Analyses no 80, Dares, novembre 2012.! « Labour market policy – expenditure and participants – Data 2010 », Statistical books, Eurostat, septembre 2012.
Pour en savoir plus
Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
Sources TEF INSEE 2012
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § Les politiques actuelles de lutte contre le chômage § => Objectifs = concilier une flexibilité suffisante pour les
entreprises, pour favoriser la croissance de la production, la productivité, la maîtrise des coûts et dans le même temps favoriser la cohésion sociale, l’implication des salariés et aussi soutenir la demande au niveau global
§ => Politiques = multidimensionnelles = tous les aspects de l’offre et de la demande de travail/emploi
§ Modèles nordiques servent d’exemples = Suède, Danemark, etc. § Flexsécurité danoise = concilier avantages sociaux (prestations
sociales) et pour les individus et flexibilité pour les entreprises § => tx de chômage passe de 12% à 4,8% entre 1994 et 2005 § => taux d’imposition forts + accompagnement personnalisé + flexibilité
§ Sources : Beitone & al. « Dictionnaire de science économique » Armand Colin, 2010, p. 285 et S
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § Les politiques actuelles de lutte contre le chômage § Modèle danois selon Robert Boyer Sources : Beitone & al. « Dictionnaire de science économique » Armand Colin, 2010, p. 286 et S
Chapitre 4 : « Le travail : activité, facteur de production & les Marchés du travail » 1/ Le travail et l’activité économique
3-‐C/ Les politiques de lutte contre le chômage § Les politiques actuelles de lutte contre le chômage § Modèle danois selon Robert Boyer
réformé (tx de chômage passe de 3,8% à 5,5% puis à 7,6% entre 2007, 2009 et 2010). La réforme consiste à décentraliser la gestion de l’emploi au niveau des communes à adopter des démarches plus incitatives à la reprise d ’emploi, à réduire le Hinancement étatique des indemnités de chômage Sources : Beitone & al. « Dictionnaire de science économique » Armand Colin, 2010, p. 286 et S