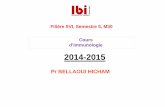Polycopiés des cours en ligne
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Polycopiés des cours en ligne
Département des Langues Étrangères
Sémio
Deuxième année Master
Université Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des Lettres et des Langues
Département des Langues Étrangères
Division de Français
Sémiologie de l’image
COURS
Deuxième année Master
(Sciences du langage)
Enseignante : Dr. Dalila Abadi
de l’image
Deuxième année Master
: Dr. Dalila Abadi
Table des matières
1- SEMIOLOGIE OU SEMIOTIQUE ?
1-1- Définition
2- SEMIOLOGIE ET SIGNE
2-1- Qu’est-ce qu’un signe ?
2-1-1- Le signe selon F .de Saussure
2-1-2- Le signe selon Hjelmslev
2-1-3- Le signe selon C. S. Peirce
2-2- Classification de signes
2-2-1- Catégorie de symbole
2-2-2- Catégorie d’indice
2-2-3- Catégorie d’icône
2-3-Le degré d’iconicité selon A. Moles
3-SEMIOLOGIE DE L’IMAGE
3-1-Rappel : qu’est ce qu’une image ?
3-2-L’image et la sémiologie : quel(s) rapport(s)
3-3Lesdifférents types d’images
3-3-1-Typologie d’images et quelques définitions
3-4- Des images pédagogiques
3-5- Image et représentation du réel
4- IMAGE : ENTRE CONSTRUCTION ET LECTURE-ANALYSE
4- 1-L'image comme un objet
5- Les aspects morphologiques de L’IMAGE
6-L'image comme un signe
7-L'image-communication
8-L'image et le texte : quel(s) rapport(s) ?
9-Lire une image
9-1-Comment lire une photographie?
9-2Modèle d'analyse d’une image et application
Bibliographie et Sitographie
Objectifs :
• Saisir les fondements théoriques de la sémiologie pour comprendre en quoi celle-
ci pourrait nous être utile pour appréhender la spécificité de l'image ;
• Saisir le rôle de la sémiologie pour aborder l’image sous l'angle de la signification.
• saisir le signe selon ses différentes fonctionnalités ;
• saisir l’image comme signe;
• Connaitre les différents usages de l’image ;
• Approcher les différents types d’image.
• Comprendre la construction d’une image ;
• Lire une image ;
• Saisir les rapports qui peuvent s’établir entre deux messages : linguistique et
iconique sur une image.
1-SEMIOLOGIE OU SEMIOTIQUE ?
1-1- Définition
En sciences humaines, la sémiotique est une discipline relativement récente en
comparaison avec la philosophie ou les sciences dites «dures ». Ses origines
remontent à l'Antiquité grecque.
La sémiotique s’est développée dès 1867-68, à partir des travaux du philosophe,
logicien et épistémologue américain Charles Sanders Peirce (1839 –1914). Selon
lui, la sémiotique est l’autre nom de la logique : « La doctrine quasi nécessaire
ou formelle des signes. »
La sémiologie s’est développée en Europe à l’instigation du linguiste et
philologue Suisse Ferdinand de Saussure (1857-1913) aux alentours de 1908-09.
Selon son expression « C’est une science qui étudie la vie des signes au sein de
la vie sociale ; elle formerait une partie de la psychologie sociale.».
La sémiotique (ou sémiologie) est, pour faire bref, la discipline qui étudie les
signes et/ou la signification (processus de la production du sens).
Mais attention
Le terme "sémiotique" comme celui de "sémiologie" ne sont pas pour autant
des synonymes, Joly Martine, dans son œuvre « Introduction à l'analyse de
l'image » a largement fait la démonstration et a précisé que:
« Le premier (sémiotique) d'origine américain, est le terme
canonique qui désigne la sémiotique comme philosophie des
langages. L'usage du second (sémiologie), d'origine
européenne, est plutôt compris comme l'étude de langages
particuliers (image, gestuelle, théâtre, etc.) »1 .
A retenir :
Sémiotique Sémiologie
• d’origine américaine ;
• prend en charge l’étude de
tous les signes y compris le
signe linguistique ;
• privilégie l’étude des signes en
situation ;
• d'origine européenne ;
• prend en charge l’étude des
signes ayant un aspect
particuliers, non linguistiques ;
• privilégie l’étude des signes
organisés en systèmes ;
1 M. Joly, Introduction à l'analyse de l'image, Editions Nathan, Paris, 1993, p.22.
• sa paternité revient à Charles
Sanders Peirce (1839 –1914) ;
• Ses auteurs les plus connus
sont:
Thomas Sebeok, , Gérard Deledalle,
David Savan, Eliseo Veron, Claudine
Tiercelin, etc
• sa paternité revient à
Ferdinand de Saussure (1857-
1913) ;
• Ses auteurs les plus connus
sont:
Roman Jakobson, Louis Hjelmslev,
Roland Barthes, Umberto Eco,
Algirdas Julien Greimas (fondateur de
l’Ecole de Paris).
NB :
Relativement à l’enseignement de ce module, nous conservons « sémiotique »
et « sémiologie » comme étant synonyme.
2- SEMIOLOGIE ET SIGNE
2-1- Qu’est-ce qu’un signe ?
« Un signe a une matérialité que l'on perçoit avec l'un ou plusieurs de nos
perceptions (langage articulé, cri, musique, bruit), le sentir (odeurs diverses:
parfum, fumée), On peut le voir (un objet, une couleur, un geste), l'entendre le
toucher, ou encore le goûter.
Cette chose que l'on perçoit tient lieu de quelque chose d'autre : c'est la
particularité essentielle du signe : être là, pour désigner ou signaler autre
chose d'absent, concret ou abstrait2 ».
Le signe se reconnaît de plusieurs manières. Il existe des définitions
fonctionnelles. Ainsi, la définition la plus générale, et l'une des plus anciennes,
fait du signe ce qui est mis à la place de quelque chose d'autre.
Il existe aussi des définitions qui reposent sur la présence des éléments
constitutifs du signe, lesquels varient d'une théorie à l'autre.
D'un point de vue général, un signe est l'indice d'une chose ou d'un
phénomène qu'il exprime de manière plus ou moins explicite.
Mais d’ordre général, on peut dire qu’un signe est un objet porteur d’une
signification. Par exemple, un feu rouge signifie que l’on doit s’arrêter.
2-1-1-Le signe selon F .de Saussure :
Saussure commence par définir le signe comme une «entité psychique à deux
faces» qui «unit un concept et une image acoustique».
Le signe se décompose en signifiant, la partie perceptible du signe (par
exemple, les lettres v-a-i-s-s-e-a-u) et signifié, la partie intelligible du signe.
2 M. Joly, Introduction à l'analyse de l'image, Editions Nathan, Paris, 1993, p.25.
Le signifiant et le signifié sont indissociables : ils ne peuvent pas être séparés.
Le signifiant est une association de lettres formant des sons. C’est, en quelque
sorte, le contenant.
Le signifié est le sens, la définition du signe. C’est le contenu.
Le mot chien est un signe parce que c’est une forme composée de lettres (le c,
le h, le i, etc.) et parce qu’il est doté d’une signification (un animal domestiqué
par l’homme).
En somme, un signe est une association de lettres pourvue d’une signification.
Raison pour laquelle ce modèle de signe est dit dyadique, puisqu'il comprend
deux éléments
2-1-2-Le signe selon Hjelmslev :
Dans son principal ouvrage, Prolégomènes à une théorie du langage(1646),
Hjelmslev propose une approche influencée par la logique formelle (qui vise à
donner une description abstraite des systèmes sémiotiques)
Il calque le modèle de F. de Saussure en distinguant, sur le plan de
l'expression (le signifiant) et du contenu (le signifié), la forme—ce qui
structure—et la substance—ce qui est structuré.
En d’autres termes :
La forme de l'expression correspond aux règles phonologiques propres à
chaque langue. La forme du contenu correspond aux règles selon lesquelles
la réalité perçue est découpée en unités de sens
La substance de l'expression correspond aux phonèmes effectifs qui résultent
de ces paramètres. La substance du contenu est constituée par ces unités .Ce
modèle de signe est dit tétradique.
2-1-3-Le signe selon C. S. Peirce
Le signe selon Peirce est constitué par la relation de trois composantes que l'on
peut rapprocher du modèle triadique.
Pour CH. S. Peirce, un signe est « quelque chose tenant lieu de quelque chose
pour quelqu'un, sous quelque rapport, ou à quelque titre »3. Cette définition
peircienne met en évidence la relation qu'entretient le signe avec ses trois
pôles: interprétant, représentamen et objet (c'est-à-dire un référent au sens
strict, fixé, sans lequel le signe n'existerait pas).
Pour comprendre ce modèle, nous illustrons avec l’exemple4 médical suivant
pris de N. Houser, en voici :
1. un patient se présente chez le médecin avec de la fièvre et la gorge
enflammée, symptômes qui constituent le signe (ou représentamen).
2. Le médecin, connaissant un certain nombre de maladies qui provoquent ces
symptômes, formule d'emblée un diagnostic: par ex., «c'est un rhume». Le
rhume (maladie la plus facilement associée à ces symptômes) constitue l'objet
immédiat, alors que le diagnostic lui-même constitue l’interprétant immédiat.
3. Le médecin donne alors une ordonnance («reposez-vous et buvez
beaucoup») et un pronostic («Ça ira beaucoup mieux dans trois jours»), qui
constituent l'interprétant dynamique. Dans ce cas, l'objet dynamique serait la
maladie qui a véritablement causé les symptômes—qu'il s'agisse de celle
diagnostiquée par le médecin ou d'une autre présentant les mêmes
symptômes—tandis que l’interprétant final serait le diagnostic correct.
2-2-Classification de signes
3CH. S. Peirce in M. Joly, Ibid. 4 L’exemple est cité par Charles Bally / LaP@ge de Guy,//www9 .georgetown.edu/faculty/spielmag/citation.htm
Plusieurs classifications de signes ont été proposées, mais nous retiendrons
que celle élaborée par CH. S. Peirce parce qu’elle peut nous être utile pour
connaitre le fonctionnement de l'image perçue comme signe.
Sachant, d’emblé, que cette classification dépendent du type de relation qui
s'établie entre le « signifiant » et le « référent » et non le signifié.
Alors, Peirce envisage trois grandes catégories de signes à savoir : le symbole,
l'indice, et l’icône.
2-2-1-Catégorie de symbole :(fonctionne par convention)
« Le symbole entretient avec ce qu'il représente une relation arbitraire,
conventionnelle. Entrent dans cette catégorie les symboles au sens usuel du
terme tels que les anneaux olympiques, différents drapeaux »5 .
Cela veut dire que le signe linguistique est selon la conception peircienne un
symbole dans la mesure où le langage verbal est conçu comme « système de
signes conventionnels ».
2-2-2-Catégorie d'indice :(contigüe de faits)
« L'indice est un signe qui entretient un lien physique avec l'objet qu'il
indique; c'est le cas lorsqu'un doigt est pointé sur un objet, lorsqu'une
girouette indique la direction du vent, ou une fumée la présence du feu »6.
Sous la catégorie d'indice, Peirce a regroupé les signes qui entretiennent une
relation de « contiguïté physique » avec ce qu'ils représentent. Tel est le
fameux exemple de la fumé pour le feu ou encore les nuages pour la pluie.
2-2-3-Catégorie d 'icône :(similitude)
5 U. Eco, Le signe, Labor, Bruxelles, 1988, p.31. 6 Ibid, p.75.
« Correspond à la classe de signes dont le signifiant entre en relation
d'analogie avec ce qu'il représente, c'est à dire, avec son référent : un dessin
figuratif, une image de synthèse représentant un arbre ou une maison sont des
icônes dans la mesure où ils "ressemblent" à un arbre ou à une maison »7 .
De ce fait, l’image est classée sous cette catégorie du fait qu’il y ait un rapport
d’analogie entre le signifiant et le référent.
Remarque :
Peirce explique que la ressemblance n'est pas forcement que visuelle. Exemple
l « 'enregistrement » ou « l'imitation » du galop d'un cheval est aussi icône.
2-3-Le degré d’iconicité selon A. Moles:
Le degré d’iconicité est la valeur iconale: « la quantité de réalisme, d’imagerie
immédiate contenue dans la représentation ».
On peut dresser une «échelle d’iconicité» qui souligne le rapport analogique
qui existe entre un type d’image (signifiant) et son référent. Il y en a 12
niveaux :
Premier niveau: Iconicité maximale (l’objet lui-même). Exemple la photo
d’identité.
Dernier niveau: Iconicité nulle (description en mots normalisés). Exemple la
métaphore.
7 M .Joly, op, cit, p. 27.
C'est-à-dire :
ICONICITE MAXIMUM
- PHOTOS
- SCHEMAS
- GRAPHIQUES
- TABLEAUX
- LANGAGE VERBAL
- LANGAGE MATHÉMATIQUE
ARBITRAIRE MAXIMUM
3-SEMIOTIQUE DE L’IMAGE
3-1-Rappel : qu’est ce qu’une image ?
Plusieurs significations et définitions recouvrent le terme image :
Platon:« J'appelle images d'abord les ombres ensuite les reflets qu'on voit dans
les eaux, ou à la surface des corps opaques, polis et brillants et toutes les
représentations de ce genre » 8 Dans ce cas, l’image est un objet second par
rapport à un autre qu'elle représente.
Pour Michel Tardy9 l'image entretient un rapport avec le réel du monde ou
d’imaginaire.
8 Platon in M. Joly, op, cit, p.8 9 M, Tardy, Image et pédagogie, in Revue Média, n° 7, Paris, Novembre 1969.
D'après le dictionnaire historique de la langue française, le Robert, "image" est
une modification linguistique de la forme imagine, empruntée au latin
imaginéin accusatif d’imago image ce qui ressemble, ce qui est de la
représentation10 .
L'usage contemporain du mot renvoie le plus souvent à l'image médiatique et
est devenu synonyme de télévision et de publicité.
Un autre emploi à signaler celui de l'image de la femme (par exemple) dans les
romans de Mohamed Dib, ou encore l’image de la guerre chez tel ou tel
cinéaste.
Le terme est employé pour désigner les activités psychiques, par exemple, les
représentations mentales, le rêve.
Dans la langue, nous utiliserons le principe de la métaphore qui consiste à
remplacer un mot par un autre en raison de leur rapport analogique ou de
comparaison.
L’image est employée dans le secteur scientifique (astronomie, mathématique,
médecine, informatique, biologie … etc.)
A retenir :
• On voit donc, avec ces quelques exemples, que divers emplois du terme
image renvoient à un sens commun : la représentation visuelle.
• L’image est quelque chose qui ressemble à quelque chose d’autre.
3-2-L’image et la sémiologie : quel(s) rapport(s) ?
Une image est un ensemble de signes distribués dans un espace clôturé. Ces
signes sont déterminés sur la base d'une sélection au moyen de jugements 10 Voir le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, 1993, pp.996 -997.
perceptuels visuels. Les relations qu'ils entretiennent résultent de leurs
qualités propres et/ou sont de nature topologique. La méthodologie générale
peircienne s'applique à l'image comme au texte ou à un mélange des deux.
Une image est toujours donnée comme un tout, par construction ou par
convention, ayant une signification globale.
Une image est en réalité un ensemble de signe qu’il convient d’interpréter.
3-3-Les différents types d’image :
Il est important de connaître la typologie des images afin de mieux en
maîtriser la compréhension.
Une image peut être fixe (peinture, photographie…) ou animé (vidéos,
cinéma…). Elle peut être créée par des moyens graphiques.
3-3-1-Typologie d’images et quelques définitions :
� Image : reproduction exacte ou analogique (établie par l’imagination)
d’un être, d’une chose.
� Tableau : œuvre picturale exécutée sur un support rigide et autonome.
� Dessin : représentation ou suggestion des objets sur une surface à l’aide
de moyens graphiques.
� Croquis : esquisse rapide (le plus souvent au crayon ou à la plume).
� Ébauche : première forme, encore imparfaite donnée à une œuvre
picturale.
� Esquisse : première forme d’un dessin. Servant de guide à l’artiste lors
de l’exécution définitive.
� Graphique : technique de représentation par des lignes joignant des
points caractéristiques.
� Hologramme : image en relief obtenue par interférence de rayons laser.
� Schéma : figure donnant une représentation simplifiée, fonctionnelle
d’un objet.
� Photographie : image obtenue par l’action de la lumière sur une surface
sensible.
� Reflet : image obtenue par le changement de direction des ondes
lumineuses rencontrant un corps interposé.
� Art : expression d’un idéal esthétique au travers des créations humaines
(architecture, peinture, musique, danse, cinéma, sculpture,
photographie, la télévision, la bande dessinée).
3-4- Des images pédagogiques :
Il existe différents types d’images utilisées à des fins pédagogiques :
3-4-1- La photographie
De toutes les représentations (présentées sur un support papier) la photo est la
plus ressemblante. Cependant, une trop grande ressemblance ne facilite pas
toujours la reconnaissance de l'objet représenté. Trop de détails par exemple,
peuvent nuire à l'identification d’une forme générale.
3-4- 2-Les schémas
Nous regroupons dans cette catégorie les dessins, les croquis et les schémas.
Ces derniers Les uns et les autres sont le résultat d'un processus de
schématisation. Ils sont une figuration
simplifiée, fonctionnelle et modélisante du réel.
3-4-3- Les graphiques
Les graphiques sont des représentations essentiellement conventionnelles de
phénomènes quantitatifs.
3-4-4- Les tableaux
Ils présentent des données chiffrées ou verbales dans une forme visuelle qui en
rend la lecture facile.
3-5- Image et représentation du réel
Quel que soit le degré de sa ressemblance avec le réel, l’image reste une
représentation de ce dernier.
-Les images dites figurative représentent un élément du réel auquel elle
ressemble par imitation.
-Les images dites abstraites n’ont pas de rapport immédiat avec des objets du
réel directement reconnaissables.
-Une photographie est une image qui semble reproduire la réalité, pourtant
elle n’est qu’une représentation.
4- Image : entre construction et lecture-analyse
Comment lire l'image ? A l'aide de quels mots parler de ce langage iconique ?
Pour répondre à ces questions, nous sommes dans l’obligation de ré-approcher
les multiples constituants de l'image.
En effet pour décoder des informations et les interpréter, le cerveau humain
utilise deux de deux types de lectures
fondamentales (analogique ou digitale) déterminant ainsi la manière de
percevoir les signes :
• La lecture analogique : décode les éléments d'une façon immédiate,
globale (hémisphère droit)
• La lecture digitale : décode les éléments les uns après les autres, de
manière analytique, progressive (, hémisphère gauche).
De plus, l’image (langage iconique), comme le texte (langage verbal), offre
deux types de significations: les dénotations et les connotations.
-Les significations dénotées sont répertoriées dans les dictionnaires et sont
pratiquement communes à tous les utilisateurs de la même langue.
Exemple :
La plage : endroit plat et bas d'un rivage où les vagues déferlent, et qui est
constitué de débris minéraux plus ou moins fins (limon, sable, galets).
- Les significations connotées, elles font écho en notre imaginaire et réveillent
des notions qui dépendent du contexte, qui sont fondées sur des références
culturelles ou qui relèvent de l'histoire personnelle de chacun.
Exemple :
Le mot "plage" peut évoquer le salut (pour un naufragé), les vacances, le soleil,
l'amour, les bonnes affaires (un marchand ambulant), une plaine de jeux...
Remarque : l’image peut être perçue comme : un objet, un signe, une
communication. En d’autres termes : elle peut représenter un objet, une
personne, elle peut aussi connoter des concepts. Et cela de manière très souple
car il est rare qu'une image impose un sens unique (polysémie).
4- 1-L'image comme un objet
Une image comme un objet, permet d'en décrire la géométrie.
Le cadre
L'image inscrit le réel dans un cadre plus ou moins souligné rectangulaire,
carré, losangé, ovale, circulaire. Lorsque le cadre est souligné, on parle de
bordure.
Exercices d’application :
Exercice n°1
Retrouvez l(es)’histoire (s)possible(s)
Image 1 : une infirmière ouvre la porte de la chambre
Image 2 : elle s’approche du malade qui est dans le lit
Image 3 : elle l’installe dans un fauteuil
Image 4 : elle l’emmène
Chaque dessinateur a illustré à sa façon, et cela donne trois histoires très
différentes, racontant une ambiance différente. Rien que par le jeu du cadrage,
on se retrouve avec trois histoires …
N°1
N°2
N°3
Pour chaque histoire :
1 –nommer quel est le cadrage utilisé pour chaque case
(par exemple plan américain, contre plongée, angle de vue, etc.)
2 –décrire et qualifier l’ambiance que vous ressentez pour chaque histoire,
comment vous l’interprétez.
3 –expliquer en quoi, à votre avis, le cadrage a contribué à créer cette
ambiance.
Exercice n° 2
Recadrer une image réduit le champ de l'image. Souvent réalisé dans un but
esthétique de composition, le recadrage, parfois appelé rognage, peut
fortement modifier la signification de l'image.
Ce procédé est parfois utilisé par la presse ou la propagande politique pour
modifier le sens de l'image et manipuler l'opinion. Il convient de rester vigilant
!
Regardez par exemple cet homme : que fait-il ? Il a marqué un panier au
basket ? Il danse car Il vient de gagner au loto ?.....
Regardez l'image avant son recadrage :
Exercice n°3
Observez cette page de publicité (ci-dessous) et répondez aux questions :
1) Qui communique ? (= quelle marque)
2) Décrivez la première photo : Que voit-on ?
3) Comparez maintenant la 1ère et la 2è photo : qu'ont-elles de différent ?
Qu'ont-elles en commun ?
4) Comment peut-on passer d'une photo à l'autre ? Tracez sur la photo n°1 le
cadre correspondant à la photo n°2.
5) Analysez, pour chacune des deux photos, ce que nous comprenons du
personnage : qui est-il, que fait-il ?
6) Que nous vend exactement cette publicité ?
Les lignes de fuite
Dans la perspective classique, elles peuvent être tracées dans l'image ou
virtuellement reconstituées en prolongeant les segments ou les directions
indiquées. Elles déterminent le point de fuite, même s'il se situe hors de
l'espace de représentation. L'espace sera ainsi ouvert ou fermé.
Les axes et structures
Les lignes verticales, horizontales, courbes, droites, brisées, spirales,
constituent des formes. Leur tracé est précis, net ou flou.
Les masses
Des surfaces sont définies par les contours des formes en fonction des couleurs
et du rapport des ombres et de la lumière. Le dessin est dit figuratif (quand il
s'attache à représenter des objets ou des personnes), non
figuratif ou abstrait dans le cas contraire.
D'autres mots permettent d'identifier les couleurs et leurs relations : nuances,
dégradés, contrastes. Noir et blanc, camaïeu (peinture où l'on n'emploie
qu'une couleur avec des tons différents), polychromie, évoquent le nombre de
couleurs utilisées. Les nuances : variations de tonalité, claires ou foncées.
Couleurs que l'on peut aussi différencier : Couleurs primaires ou secondaires,
Couleurs chaudes ou froides11.
NB/ Les couleurs
11 Nous ferons référence à CADET Christiane, CHARLES René & GALUS Jean-Luc, La
communication par l'image, Repères pratiques Nathan, Paris, 1990.
Il existe une symbolique des couleurs (et aussi des formes : tels que le carré, le
rectangle ….), que l’on peut utiliser à des fins expressives, à titre illustratif,
nous citons :
• Blanc : vie, naissance, pureté, vertu, silence ;
• Jaune : joie, stimulation (mais aussi vanité, gène, maladie) ;
• Orange : expansion, attention, stimulation ;
• Rouge : fougue, excitation, passion, exubérance, danger, agressivité ;
• Vert : détente, espérance, destin, hasard, jeunesse, nature ;
• Violet : mystère, richesse (mais aussi malaise, trouble) ;
• Bleu : calme, sérieux, spiritualité, fraicheur, hygiène ;
• Noir : austérité, pouvoir, menace, ténèbres, mélancolie, mort.
Exercices d’application (et consolidation)
Exercice n° 1
Q1 : Quelle est la couleur complémentaire du rouge ?
a vert
b jaune
c orange
Q2 : Qu’appelle-t-on une couleur chaude ?
a le jaune
b les couleurs claires
c les couleurs entre le jaune et le rouge
Q3 : Combien y a t'il de couleurs primaires ?
a 7
b 9
c 3
Q4 : Quelle est la couleur complémentaire de l'orange
a le bleu
b le jaune
c le vert
Q5 : Où trouve-t-on une couleur complémentaire d'une autre sur le cercle
chromatique ?
a juste à coté
b diamétralement à son opposé
c elle n'y est pas
Q6 : Qu’obtient-on en mélangeant trois couleurs primaires ?
a du gris
b du noir
c du marron
Q7 : Quel est le complémentaire du violet?
a le rouge
b le vert
c le jaune
Q8 : Que signifie la valeur d'une couleur ?
a caractérise son degré de clarté ou d'obscurité.
b son prix
c son efficacité
Q9 : Comment dégrade-t-on une couleur pour la rendre plus claire ?
a en y ajoutant du blanc
b en y ajoutant du jaune
c en y ajoutant du noir
Q10 : Comment rabat-on une couleur pour la rendre plus foncée ?
a en y ajoutant du bleu
b en y ajoutant du noir
c en y ajoutant du blanc
Q11 : Comment obtient-on une couleur rompue ?
a en y ajoutant du rouge
b en y ajoutant du noir
c en y ajoutant sa complémentaire
Q12 : Quel est le contraste maximum entre deux couleurs ?
a entre le bleu et vert
b entre deux complémentaires.
c entre le jaune et l'orange
Q13: Quelles couleurs marquent le plus fort contraste du clair-obscur ?
a Le rouge et le bleu
b le blanc et le noir
c le violet et le vert
Q14 : À partir de quel mélange à part égal crée-t-on un Gris Neutre ?
a du blanc et du noir
b du rouge et du vert
c du violet et du jaune
Q15 : À partir de quel mélange crée-t-on un Gris Coloré ?
a du noir et du blanc
b du vert de l'orange et du violet
c des trois couleurs primaires
Q16 : Comment se nomme la reproduction imprimée en deux couleurs ?
a monochromie
b dualomanie
c bichromie
Q17 : Comment appelle-t-on la capacité d'un corps à s'opposer à la
transmission des rayons lumineux ?
a l'opacité
b l'antiluminosité
c la noireté
Q18 : Qu’appelle-t-on une harmonie ?
a un ensemble de couleur réunies selon une loi commune
b un couple de couleurs complémentaires
c la différence entre deux couleurs
Q19 : Qu’appelle-t-on un camaïeu ?
a une harmonie de couleurs claires
b l’ensemble des valeurs d’une couleur
c un contraste de couleurs
Q20 : Comment appelle-t-on une harmonie de couleur claires ?
a une gamme de couleurs vives
b une gamme de couleurs pastels
c une gamme de couleurs contrastées
Exercice n°2
Créez des harmonies colorées à la gouache. Pour chacune d’entre elle,
indiquez pour quels types de vêtements ces harmonies colorées seraient
adaptées selon vous (circonstances, saison, clientèle, tendance…)
Gamme de couleurs rabattues :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
Gamme de couleurs pastels :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
Gamme de couleurs chaudes :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………..
5- Les aspects morphologiques de L’IMAGE
L'image se présente dans une échelle des plans :
5-1- Ensemble : Le plan d'ensemble cadre le décor et les personnages dans leur
environnement global.
5-2- Moyen : Le plan moyen (ou plan en pieds) cadre le personnage en entier.
Ce plan donne un rôle à tout le corps, en évacuant le contexte dans lequel
évolue le personnage.
5-3- Américain : Le plan américain prend le personnage à mi-cuisses : son
nom vient du fait qu'il a été beaucoup utilisé dans les westerns.
5-4- Rapproché : Le plan rapproché cadre le personnage à la taille ou à la
poitrine.
Le regard du spectateur est de plus en centré sur le personnage mais le
spectateur n'entre pas dans son intimité.
5-5- Gros plan : Ce plan attire l'attention du spectateur sur un visage, une
expression, un objet particulier. L'image envahit le regard.
5-6- Très gros plan (insert): est un très gros plan qui capte un détail. Ce
détail est exagérément grossi : on insiste donc sur son importance. C’est le plan
dramatique par excellence.
L'image se présente selon un certain point de vue :
Frontal : c'est à dire de face. La vue de face a une fonction de contact. Elle
donne l'impression que le personnage représenté s'adresse directement à la
personne qui regarde la photo.
Plongée : Ce type de prise de vue crée un effet d'écrasement du sujet. Elle
permet de souligner la fragilité d'un personnage, de donner une impression de
solitude et de détresse, de créer une tension ou d'amplifier la grandeur d'un
lieu.
Contre-plongée : Cet angle est fréquemment utilisé pour magnifier, glorifier
le sujet observé, qui domine l'observateur. Cela rend le personnage plus
imposant.
Elle offre, en outre, une certaine profondeur de champ .
La profondeur de champ est la distance entre le premier et le dernier plan net
d'une image
(Avant-plan, Second plan, Arrière-plan ….).
Un hors-champ, espace non représenté mais susceptible d'entretenir une
relation avec le visible, le champ.
6-L'image comme un signe
L’image est un signe complexe qui peut obtenir trois types de signifiants. Elle
renvoie le regardant à la réalité qu'elle signifie :
Un signifiant figuratif ou iconique
On peut généralement décrire le contenu d’une image, de ce qu’elle
représente.
Un signifiant plastique
Une image contient, outre ce qu’elle représente, un ensemble de signifiants
souvent mêlés les uns aux autres : formes, couleurs, traits, matières… auxquels
on peut associer un signifié souvent difficilement traduisible par des mots.
Un signifiant symbolique
Le symbole et l’allégorie font correspondre une idée abstraite, un concept, à
un objet concret ou à sa représentation par une image. Les images contiennent
ainsi souvent plus ou constitue en entier des signifiants symboliques. Ces
symboles peuvent prendre différents aspects. Pour les formes, par exemple, en
voici :
Principes d'assemblages de plusieurs éléments
Exercice
Cet exercice est à réaliser sur une page Word, à l'aide de la boîte à outils
dessin.
En utilisant seulement les trois formes simples suivantes
En faisant varier le nombre, la taille et surtout la disposition de ces éléments,
créez des compositions expressives.
a) Utilisez au moins une des formes pour exprimer les idées suivantes :
Stabilité – légèreté - dynamisme – équilibre instable
b) Utilisez toutes les formes pour réaliser les organisations suivantes :
Centré – ascendant – symétrique – divergent
c) Utilisez les formes à volonté pour exprimer les sentiments suivants :
Solitude – joie – colère – sérénité
Remarque 1/ La Symbolique des formes
Voici pour les chiffres quelques fondamentaux des particularités des formes.
La droite horizontale : Elle représente notre plan terrestre, "plat" par son
horizon et sa stabilité apparente. C'est une structure d'accueil de notre matière
dont elle est le symbole.
La droite verticale : Elle représente l'Esprit Divin. Elle est une descente de ce
"qui est en haut" en reliant le supérieur et l'inférieur. Ce qui est debout, à
l'image de l'humain, est ce qui est doué d'esprit, d'intelligence, étant le lien
entre le monde divin et les mondes inférieurs. Regardez la symbolique de
l'arbre, ce pilier vertical qui est dans les traditions le lien entre le ciel et la terre
et vénéré comme tel.
La diagonale : Elle désigne un mouvement, qui est une progression ou une
ascension selon le sens du tracé. Ce mouvement peut être un mouvement
temporel ou une capacité d'action, de faire.
La demi-sphère : Matrice.
Le demi carré : Ce carré que l'on devine, c'est son coté cartésien, "carré", et
pourtant tronqué de moitié car il lui manque son autre moitié.
Le cercle : Il représente un tout fini, complet et parfait, autonome, et
pourtant cerné par sa propre limite. Il contient son propre espace, c'est un
contenant et un contenu.
Remarque 2 /La Symbolique des formes géométriques
Les symboles ont plusieurs sens (parfois même contraires), parce que ‘ils
changent de sens selon les cultures, parce que le sens d'un symbole n'est
jamais indépendant des symboles qui l'entourent (le carré comme symbole
change de sens selon qu'il est confronté au cercle ou au rectangle). En voici
quelques exemples :
• Carré : l'imperfection du monde terrestre, la matérialité.
• Cercle : la perfection, l'absolu, l'infini, le divin.
• Losange : la vie, le passage, l'échange.
• Triangle : la sainte trinité, l'unité.
A retenir :
Les aspects sémiotiques de l'image concernent les codes sociaux, les
connotations, les références culturelles et symboliques, la rhétorique des
signes.
Repérage des codes sociaux
Toute image a été réalisée dans certaines conditions socio-économiques, elle
en porte les traces.
Exploration des connotations
Polysémique , l'image offre, au delà du sens dénoté, un vaste champ
de connotations qui dépendent, d'une part du lecteur, de son expérience, de sa
culture, de sa pratique sociale, de son inconscient, de son imaginaire.
Références culturelles et symboliques
Il s'agit de reconnaître les codes propres à une culture : codes techniques et
ornementaux du corps (vêtement,...) et de l'espace (architecture,...); les codes
symboliques …..
De ce fait, pour lire une image, il faut prendre en considération:-
l’identification du sujet, - la situation dans le temps - le contexte historique,
le socio-économique, le culturel, la biographique,…
7-L'image-communication
Le support est peut-être ce qui se voit le moins et ce qui compte le plus. (R.
DEBRAY)
Objet et signe, l'image ne prend son sens que par l'œil d'un regardant. Entre
eux une relation particulière s'établit.
On peut donc, devant chaque image, s'interroger sur la façon dont elle
interpelle le regardant.
8-L'image et le texte : quel(s) rapport(s) ?
Enfin l'on peut s'interroger sur la relation entre l'image et le texte
(titre, légende,...) qui exerce
• tantôt une fonction d'ancrage lorsqu'il impose parmi la masse de
significations possibles, un sens unique de lecture;
• tantôt une fonction de relais lorsqu'il apporte ce que l'image ne dit pas.
• Parfois le texte est décalé par rapport à l'image, il acquiert à ce moment
une valeur poétique et incite le lecteur à un effort d'imagination tel est
l’exemple de ("Ceci n'est pas une pipe " Magritte).
Remarque
� La fonction d'ancrage selon R. Barthes : « […] le message
linguistique guide non plus l’identification, mais l’interprétation, il
constitue une sorte d’étau qui empêche les sens connotés de
proliférer soit vers des régions trop individuelles (c’est à dire qu’il
limite le pouvoir projectif de l’image), soit vers des valeurs
dysphoriques ; […]. Le texte dirige le lecteur entre les signifiés de
l’image, lui en fait éviter certains et en recevoir d’autres »13 .
� La fonction de relais selon R. Barthes : « […] plus rare (du
moins en ce qui concerne l’image fixe) ; on la trouve souvent
surtout dans les dessins humoristiques et les B D. Ici, la parole (le
plus souvent un morceau de dialogue) et l’image sont dans un
rapport de complémentaire »14.
Remarque15
13 R. Barthes, Rhétorique de l’image, Communication, N°4, Seuil, 1964, pp.43-44. 14 R. Barthes, op, cit, P.45. 15 Les exemples sont extrait de l’Internet
En rapprochant une image d'une autre image, on suggère une nouvelle
interprétation. De même une légende peut influencer le sens perçu de l'image.
Ci dessus, l'homme qui déguste son camembert est perçu très
différemment selon le contexte dans lequel cette photo est employée.
9-Lire une image
Rappel
Analyser un objet, une image, nécessite tout d’abord de faire l’inventaire le
plus objectivement possible de ses composants, sans jamais l’interpréter. C’est
ce qu’on appelle la dénotation.
Analyser un objet, une image, c’est également l’interpréter, chercher ses
références, l’impression qu’il donne, ses significations possibles. C’est ce que
l’on appelle la connotation.
Aucune interprétation ne doit être donnée sans s’appuyer sur une dénotation
précise.
I - Analyser une image nécessite d’abord de faire l’inventaire le plus
objectivement possible des composants de cette image sans l’interpréter : c’est
ce qu’on appelle la dénotation.
Pour faire une dénotation la plus objective possible, imaginez que vous
décriviez par téléphone une image à quelqu’un qui ne la voit pas : il doit
pouvoir l’imaginer précisément.
Présentez le sujet : origine et destination de l’image (magazine, affiche,
illustration...)
Décrivez le sujet : personnages, objets, décors (en général et dans le détail de
ces éléments)
Analysez les différents composants plastiques en mettant en évidence les effets
de contrastes et de dominantes de toutes sortes :
Composition et organisation de la page :
Format à la française, à l’italienne... cadrage, plan général, plan américain, gros
plan ... angle de vue... premier plan, arrière plan ...
Ligne(s) de force horizontale, verticale ascendante ou descendante, oblique,
triangulaire, en spirale convergente ou divergente...point fort
Hiérarchie des éléments qui composent la page, pleins/vide, fond/formes...
Symétrie, perspective, rythmes...
Graphisme :
Ligne souple, anguleuse, orthogonale...
Trait haché, hésitant, affirmé, gestuel, rigoureux, rectiligne...
Formes souples, rigides, fermées ouvertes, mouvementées, éclatées...rectangle,
carré, cercle, triangle, cube, sphère, pyramide...
Volumes et valeurs : espace, profondeur, ombre, lumière, clair/obscur,
noir/blanc...
Couleurs : primaires, secondaires, chaudes, froides, complémentaires, vives,
toniques, lumineuses, ternes, pastels, rabattues...
Matières : aplat, dégradé... surface et effet moucheté, granité, froissé, rugueux,
lisse, brillant, métallique...
- Typographie :
Centrée, justifiée, ferrée, en habillage....
Expressive, fine, grasse, lourde....
II - Analyser une image, c’est ensuite interpréter et donner du sens à ce qui
n’est que dénoté : c’est ce qu’on appelle la connotation.
Toute connotation doit s'appuyer sur un ou plusieurs éléments dénotés.
Indiquez l’annonceur et la cible (le public visé, le destinataire) du
message publicitaire.
Interpréter une image, c’est chercher ses significations possibles, qui sont
multiples. Ces significations dérivent les unes des autres, sont d’abord
immédiates puis s’entraînent et s’enchaînent, de plus en plus subtiles.
Essayez de vous mettre à la place du photographe ou du publicitaire qui a
conçu l’image.
Recherchez des références dans différents domaines.
Donnez votre interprétation en vous appuyant sur une description précise.
Vous pouvez utiliser les mots suivants :
(Élément dénoté) .... symbolise ...
exemple : signifie
la forme souple ... suggère
le personnage isolé ... donne l’impression que
la dominante de bleu ... exprime un sentiment de
le graphisme anguleux ... fait référence à
le rythme saccadé .... rappelle
le thème de l’eau ... évoque
l’équilibre de noir et blanc ... produit l’effet de
la typographie employée ... accentue l’effet de
l’importance du texte ... minimise l’effet de
Dans une image publicitaire par exemple, le texte est en relation avec le visuel
par le contenu de son message mais aussi par sa composition et l’expressivité
de son graphisme. Le rapport texte / image doit lui aussi être connoté.
Mettez en évidence la manière de communiquer : construire une image
s’apparente à construire une image ou un discours. Les procédés employés
pour communiquer, persuader, convaincre ou impliquer le destinataire sont
comparables.
Faites la différence entre ce qui est dit ou montré et ce qui est suggéré.
Vous pouvez ainsi rencontrer des messages qui utilisent des figures de style :
La polysémie (plusieurs sens)
La redondance (répétition de formes ou de mots)
La métonymie (fragments d’un corps ou d’un objet, notre imagination
reconstitue le tout)
L’ellipse (suppression d’un élément ou d’un moment de l’action, l’imagination
reconstitue les faits)
La litote (ou fausse modestie, dire moins pour faire entendre plus)
La métaphore (substitution par analogie d’un objet ou d’une idée par un autre)
L’allégorie (représentation imaginée d’une idée, d’un sentiment)
9-1-Comment lire une photographie?(à titre indicatif)
Etape 1: Impression générale
Quelques termes qui qualifient ce que l'on ressent à la vue de l'image.
Etape 2: Procédés techniques: analyse et description
- la composition (sujet, détails, cadrage, point-de-vue, netteté, flou)
- les lignes principales
- les formes
- les couleurs, les nuances
- la lumière (contrastes, jeux de lumière)
- la matière (effets de texture)
Etape 3: Contexte culturel
- identification du sujet,
- situation dans le temps
- contexte historique, socio-économique, culturel, biographique,…
Etape 4: Effets recherchés
- Quelle est l'atmosphère? Comment est-elle rendue?
- Quels sont les rapports entre la lumière et le sujet, entre le cadrage et le
sujet,…?
- Y a-t-il un rythme, un mouvement? Comment s'exprime-t-il?
Etape 5: Interprétation et jugement
- Quel est le message de l'image?
- Y a-t-il adéquation entre le message et l'impression générale?
- Pensez-vous que le photographe a atteint son but?
- Y a-t-il une unité dans l'image?
9-2- Modèle d'analyse16 d’une image et application...
L'Image qui a choqué le monde
Photo des quelques uns des 158 prisonniers du camp de détention américain X-
Ray,
implanté sur la base militaire de Guantanamo Bay, à Cuba.
Identifier l’œuvre:
Image d'art, photo de presse, publicité... (Fiche signalétique)
Nature de l’œuvre : type (photo de presse, dessin/caricature, publicité...),
support et titre.
16 Stéphanie Dansereau, professeure, Éducation à l'image et aux médias, UQAM [email protected]
Il s'agit d'une photo numérique de presse sur page écran, prise par Shane T.
McCoy, U.S. Navy REUTERS, le 11 janvier 2002; son titre est L'image qui a
choqué le monde.
Contexte (où se trouve-t-elle) et époque : nom, date et lieu du canal de
diffusion
Magazine, journal, mur (affiche), écran télé (mise en scène réaliste, fictive...),
écran de cinéma
cette image, ainsi que l'article lié, ont été diffusés sur la page web
intitulée:Actualités, sur le site Internet Yahoo- France, mardi le 22 janvier 2002
(http://fr.news.yahoo.com/).
Le sujet abordé (résumé du contenu) et thèmes
détenus agenouillés, pieds et poings liés, portant bâillons, casques et masques,
dans l'attente, surveillés par des militaires dans un espace dénudé et grillagé,
entouré de barbelés.
thèmes : domination, rapports dominé/dominant.
Légende complémentaire sous la photo de presse
L'image de ces détenus agenouillés pieds et poings liés, portant bâillons,
casques antibruit et masques aveuglant, dans l'attente de leur transfert vers les
cellules, a soulevé une vague d'indignation à travers le monde. Le secrétaire
américain a démenti tout mauvais traitement de ces hommes.
Première exploitation
Effet produit : choc, malaise, peur, colère
L'image est choquante par différents procédés: la couleur rouge des uniformes
accroche tout d'abord notre œil ; les accessoires qui caractérisent l'état
d'asservissement des détenus et le dépouillement du décor accentuent l'effet
de malaise, d'injustice.
Problèmes de compréhension du message
Y a t-il un texte/légende/slogan pour compléter le message ?
L'image est réaliste, riche en significations mais polysémique. La légende qui
accompagne l'image aide à réduire cette polysémie de la photo et la
contextualiser. Sans la légende, nous ne pouvons pas savoir où l'action se
passe, à quelle époque et la problématique soulevée. L'ancrage linguistique
complète l'information transmise par la photo et donne des repères sur
certains éléments narratifs dans l'image: les sujets impliqués et le contexte
carcéral.
Le taux d'iconicité du sujet de l'information* est élevé, car l'image permet aux
lecteurs de reconnaître, d'identifier puis de comprendre ce qui se passe pour
ces prisonniers et le rapport de force inéquitable.
A. Aspects extérieurs
La construction ou itinéraire de lecture: lecture horizontale (statique/paysage),
verticale (dynamique/portrait)
Les lignes obliques dominent la photo.
La lecture de la photo se fait en suivant un parcours en Z (le titre, l'image et la
légende).
Le cadrage: l’échelle du plan: gros plan, plan moyen, plan général, plan
d'ensemble .... L’angle de vision: normal (hauteur des yeux), plongée (du haut
vers le bas= effet d'écrasement), contre plongée (du bas vers le haut=effet de
puissance) ; l'éclairage : jour, nuit, pénombre... effets techniques (avant plan
clair et arrière plan flou), trucages (grossissement d'un objet, disproportion
de...)
L'image est cadrée à la verticale et les éléments qui la composent sont
organisés en trois paliers: le grillage en avant-plan, hors foyer, les personnages
en deuxième plan et le décor en troisième plan (géographie des lieux et du
temps).
Le photographe est placé à gauche par rapport à la scène photographiée;
l'angle de prise de vue est en légère plongée, ce qui produit un certain effet
d'écrasement des sujets, surtout ceux en état d'infériorité, accroupis.
B. Analyse de la mise en œuvre
Les références culturelles
La photo est réaliste et objective, elle a une fonction notionnelle et c'est une
photo de reportage.
L'image permet de faire une première référence à des soldats américains à
cause de leur uniforme typique (couleur kaki simulant les sous-bois) . Les
barbelés et clôture renvoient à la réalité carcérale des prisons.
L'expression des sentiments
Ces images des détenus immobilisés à genoux, avec les pieds et les poings liés,
portant des casques antibruits et des masques, suggèrent à la fois le danger et
l'humiliation.
La photo étonne le spectateur et l'émeut par la mise en situation inattendue et
le rapport de force démesuré.
Le dit (ce qui est montré) et le non-dit (ce qui est suggéré)
Le format de la clôture à l'avant-plan crée l'effet d'une loupe à travers laquelle
le spectateur/lecteur regarde, examine, découvre une réalité ...
La photo joue le rôle de preuve, elle est descriptive : elle montre d’abord un
environnement clos par un grillage dans un lieu désertiques ; elle va aussi
témoigner de conditions de vie de sujets détenus par des militaires.
Procédés
Les procédés d’expression, la rhétorique visuelle
Y a-t-il un effet recherché : métaphore, analogie, contraste ou opposition pour
faire réfléchir, provoquer, comprendre des liens ...?
L'effet d'opposition est bien mis en évidence par le rouge qui contraste avec le
gris et avec les zones d'éclairage entre l'avant- plan sombre et l'arrière plan
clair. Les couleurs très saturées des uniformes des détenus sont en contraste
aussi avec celles des soldats. Un procédé stylistique d'antithèse met en valeur
ce rapport de force entre dominés et dominants (les gens debout VS les gens
accroupis).
Le grillage hors foyer au premier plan a une valeur métonymique, suggérant la
prison (la partie pour le tout).
Les outils
Choix d'une technique particulière, d'un procédé graphique ou de couleurs, de
textures pour favoriser cette rhétorique ou symbolique...?
Le photographe a dû faire cette photo avec un téléobjectif : le foyer s'est
fait sur l'arrière-plan, donnant ainsi une bonne profondeur de champ à
l'image tout en créant un flou en avant-plan. Peu d'effets sont observables car
le but de la photo est de témoigner d'une réalité et non d'être esthétique.
Contextualiser si possible
A. Analyse du contexte dans lequel l’œuvre a été élaborée
Contexte historique: voir plus haut
Contexte artistique
Contexte biographique (auteur si connu ou origine du diffuseur)
B. Recherches savantes dans le cas de certaines images artistiques ou
politiques
Genèse de l’œuvre : La réception de l’œuvre : diffusion grand public ou non
Pour conclure
Que pouvez-vous dire à partir des différents paramètres relevés et impressions
dégagées ?
La photo ici est à la fois descriptive (informe sur une situation) et symbolique
(joue sur les codes gestuels, chromatique et rhétorique entre militaires et
prisonniers). L'action photographiée semble avoir été saisie sur le vif, pas de
trucages techniques et veut attester ainsi de l'authenticité de l'événement. Le
grand public ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme sont
les destinataires visés. Enfin, l'image, par sa sobriété et sa légende, montre sans
artifices une situation d'humiliation inacceptable en démocratie, ce qui vient
confirmer le rôle émotif que peut jouer une image qui informe certes, mais qui
cherche aussi à faire réagir, à susciter la réflexion et éventuellement
l’engagement.
En fin
Bien que constitué de signes souvent continus (difficiles à segmenter), l’image
se prête toutefois, comme le langage verbal, aux tests de permutation ou de
présence/absence. Une couleur a été choisie plutôt qu’une autre (vert plutôt
que rouge), une forme a été préférée à une autre (rond plutôt que carré). Cette
sélection (ou permutation) est porteuse de sens. D la même manière, la
BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE
ALMASY, Paul et coll .1990. Le PHOTO-JOURNALISME, informer en écrivant
des photos.Paris: éditions du CFPJ (Centre de formation et de
perfectionnement des journalistes). France
Barthes Roland. - Mythologies. - Points Seuil, 1957
C. BREMOND, « Le message narratif », in Communications, 4, 1964.
CADET, C. & GALUS, La communication par l'image
CLEMI. 1999. Apprendre avec la presse. Paris: éditions Retz, France
COCULA B. & PEYROUTET C., Sémantique de l'image, pour une approche
méthodique des messages visuels
COMAR (Philippe) et ROUSSE (Georges), L'invention de la perspective ou le
compas dans l'oeil- France Culture - 60mn – 2011.
Didi-Huberman Georges. Ecorces. Paris, Editions de Minuit, 2011
EVERAERT-DESMEDT, N, Interpréter l’art contemporain. La sémiotique
peircienne appliquée aux œuvres de Magritte, Klein, Duras, Wenders, Chávez,
Parant et Corillon, De Boeck ,Bruxelles, 2006.
EVERAERT-DESMEDT, N, Le processus interprétatif. Introduction à la
sémiotique de Ch.S. Peirce, Liège, Mardaga, 1990.
Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale. (1916) Publié par Charles
Bally et Albert Sèchehaye. Éd. Tullio de Mauro. Paris, Payot, 1978.
FOZZA J.-C., GARAT A.-M. & PARFAIT F., Petite fabrique de l'image.
http://www.dissertationsgratuites.com/dissertations/Semiologie-De-
l%27Image-Cours/259174.html
Lambert Frédéric. - Je sais bien mais quand même ; essai pour une sémiotique
des images et de la croyance. - éditions Non-Standard, 2013
LEVY (Francine), Image - De la perspective au point de vue : une compression
de l'espace-temps - sur le site Eduscol - 2003
VAYER (Marc) - Petite histoire de la perspective à la Renaissance .
Louis Hjelmslev (1946). Prolégomènes à une théorie du langage, Bloomington,
Indiana U.P., 1953. Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Éditions de
Minuit, 1971.
M. Joly, Introduction à l'analyse de l'image, Editions Nathan, Paris, 1993.
N. Everaert-Desmedt (2011), « La sémiotique de Peirce », dans Louis Hébert
(dir.), Signo [en ligne], Rimouski
Québec, http://www.signosemio.com/peirce/semiotique.asp
PONT – HUMBERT(C), Dictionnaire des symboles, des rites et des croyances,
Hachette, 1995.
R. BARTHES, Rhétorique de l’image, Communication, N°4, Seuil, 1964
SERRE FLORSHEIM (D), Quand les images vous prennent ou comment
décrypter les images, Les éditions d’organisation, Paris, 1993.
U. Eco, Le signe, Labor, Bruxelles, 1988.