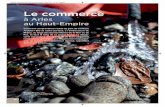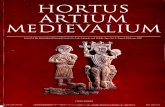M. Heijmans, Les fouilles de l’église paléochrétienne de l’enclos Saint-Césaire à Arles,...
Transcript of M. Heijmans, Les fouilles de l’église paléochrétienne de l’enclos Saint-Césaire à Arles,...
NOTE D’INFORMATION
LES FOUILLES DE L’ÉGLISE PALÉOCHRÉTIENNE DE L’ENCLOS SAINT-CÉSAIRE À ARLES,
PAR M. MARC HEIJMANS
Découverte en 2003, l’église paléochrétienne de l’enclos Saint-Césaire, ancienne abbaye transformée au XIXe siècle en asile pour des personnes âgées, a dès lors attiré toute l’attention des spécia-listes de l’architecture chrétienne. Après quelques années d’hésita-tions quant à la façon de poursuivre l’exploration du site, en même temps que la rénovation des anciens bâtiments, abandonnés depuis 1995, le site fait l’objet d’un projet collectif de recherche trisan-nuel (2006-2008), sous la direction de M. Heijmans (CNRS). Cette communication rend compte de l’un des aspects de ce projet, l’étude de l’église proprement dit, après trois ans de fouilles programmées. Les dimensions exceptionnelles de cet édifi ce de culte posent de nombreuses questions à la fois architecturales, historiques que topo-graphiques, qui nous obligent à revoir notre vision de l’Arles paléo-chrétienne et de son évolution et qui demandent, au préalable, une présentation rapide de l’histoire de la ville et un état de la question avant la reprise de la fouille1.
Rappel historique
Implantée sur une butte rocheuse de faible hauteur, Arles a attiré une occupation humaine au moins dès le VIe siècle avant J.-C., dont on peut suivre l’évolution à partir du Ve siècle jusqu’à l’implantation
1. Le PCR « Enclos Saint-Césaire à Arles : du groupe épiscopal primitif au couvent médiéval » a été initié par le Ministère de la Culture (SRA-PACA), qui le fi nance pour moitié, l’autre moitié étant couvert par la municipalité d’Arles, propriétaire des lieux. Je tiens à remercier X. Delestre, Conservateur régional de l’archéologie et B. Bizot, conservateur chargé de la ville d’Arles au sein du SRA-PACA, ainsi que B. Sabeg, directeur du patrimoine de la ville d’Arles. Le projet regroupe non seulement des archéologues, mais aussi des historiens, antiquisants et médiévistes. Je cite en parti-culier P. Rigaud, qui a fait le dépouillement des archives et V. Eggert, qui s’est occupée de l’étude du bâti médiéval. La fouille proprement dite a été réalisée avec l’aide de T. Navarro, en 2006, puis de A. Genot (MDAA) en 2007 et 2008. Les relevés sont dus à E. Dantec. L’association « Le Céraphin » a assuré la gestion fi nancière du dossier.
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1191SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1191 07/06/2010 16:34:4607/06/2010 16:34:46
1192 COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
de la colonie de droit romain, sur l’ordre de César, en 46/45 avant J.-C2. Dotée par Auguste de monuments importants, comme l’en-ceinte, le théâtre ou encore le forum avec les cryptoportiques au centre d’une voirie orthonormée, en partie héritière de la trame protohistorique, la ville se développe rapidement, grâce à la richesse de son vaste territoire ainsi qu’à sa position stratégique à l’entrée de la voie de communication vers l’intérieur des Gaules qu’était le Rhône. Les quartiers résidentiels s’organisent de part et d’autre du fl euve et les nombreuses inscriptions témoignent des activités commerciales aux IIe et IIIe siècles. C’est dans ce contexte prospère et cosmopolite, qu’il faut situer l’arrivée du christianisme à Arles, dont on trouve le premier témoignage en la personne de l’évêque Marcianus, connu par la correspondance de Cyprien de Carthage, au milieu du IIIe siècle ; c’est donc l’un des plus anciens évêchés attestés en Gaule.
Les événements du troisième quart du IIIe siècle, qui ont causé la destruction puis l’abandon des quartiers périphériques, restent encore sujets à des débats, mais ils n’ont pas atteint durablement la vitalité de la ville, qui accueille dès le début du IVe siècle l’empereur Maximien, peut-être accompagné par son gendre Constantin. Ce dernier est en tout cas responsable du transfert de l’atelier moné-taire d’Ostie vers Arles en 313, de l’organisation dans cette ville du premier grand concile d’Occident, en août 314, sans parler de l’embellissement de la ville, dont témoignent encore les thermes dit de Constantin et sans doute la reconstruction de la façade nord du forum. De l’importance et la richesse de l’Église arlésienne nais-sante témoigne également la fameuse collection de sarcophages de marbre, décorés de scènes bibliques, la plus riche collection de ce genre après celle du Vatican. Il est donc probable que cette commu-nauté n’a pas attendu longtemps avant de s’offrir une cathédrale digne de l’importance de cette cité, toutefois juridiquement simple chef-lieu de cité dans la vaste province de la Viennoise.
Considérée, grâce à l’importance économique de son port, comme la seconde ville des Gaules, après Trèves, résidence des empereurs et
2. Afi n de ne pas alourdir les notes, je renvoie pour une présentation générale de l’histoire de la ville à M. Heijmans, C. Sintes et J.-M Rouqette, Arles antique, Paris, 2006 (Guides archéolo giques de la France, 41) ; voir également les différentes contributions à J.-M. Rouquette (dir.), Arles, histoire, territoires et cultures, Paris, 2008 et à M.-P. Rothé, M. Heijmans, Carte Archéologique de la Gaule, 13/5, Arles, Camargue, Crau, Paris, 2008. Pour l’Antiquité tardive, en particulier : M. Heijmans, Arles durant l’Antiquité tardive. De la Duplex Arelas à l’Urbs Genesii, Rome, 2004 (Collection de l’École Française de Rome, 324).
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1192SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1192 07/06/2010 16:34:4607/06/2010 16:34:46
LES FOUILLES DE L’ÉGLISE PALÉOCHRÉTIENNE À ARLES 1193
siège du préfet du prétoire, Arles accueille cette dernière administra-tion, à une date discutée autour des années 400. On peut peut-être lier à cette préfecture la construction d’une vaste salle basilicale, encore bien conservée à l’intérieur des murs de l’actuel hôtel d’Arlatan. Toujours est-il que l’importance accrue de la ville rejaillissait sur son évêque qui essaie de plus en plus à dominer ses collègues voisins, puis arrive, grâce à des prélats énergiques comme Hilaire (430-449) ou Césaire (502-542), à imposer sa suprématie dans les provinces de Viennoise du Sud et de Narbonnaise Seconde, voire, en tout cas théoriquement, dans l’ensemble des Gaules. Passée sous domination wisigothique en 476, Arles fait partie du royaume ostrogoth de 508 à 536, avant d’être cédée aux Francs.
Le site de l’enclos Saint-Césaire : l’état de la question avant le début de la fouille
La présence d’un premier groupe épiscopal dans l’angle sud-est de la ville est basée sur le témoignage de deux textes du début du VIe siècle quand l’évêque Césaire fonde un monastère féminin à côté d’une église préexistante (in latere ecclesiae)3 (fi g. 1) ; d’autre part, la Règle monastique qu’il rédige pour ses moniales ordonne la fermeture des portes du « vieux baptistère » (vetus baptisterium)4. On en déduit donc l’existence d’un premier groupe épiscopal, anté-rieur au VIe siècle, et plus probablement construit dans le courant du IVe siècle. On suppose d’autre part jusqu’à présent que cette église avait été transférée vers l’emplacement de l’église médiévale Saint-Trophime, plus près du forum, probablement dès la première moitié du Ve siècle, au moment où apparaît pour la première fois le vocable de l’église paléochrétienne, Saint-Étienne5. La cathédrale Saint-Étienne apparaît de nouveau à plusieurs reprises dans la Vita de Césaire, et, dans l’hypothèse d’un transfert de la cathédrale au Ve siècle, ces mentions concerneraient donc la nouvelle église. La Règle que Césaire a rédigée pour ses moniales ne mentionne pas Saint-Étienne ; elle parle en revanche à plusieurs reprises d’une basilica anonyme, mitoyenne du monastère, et à laquelle l’accès
3. Vita s. Caesarii, I, 35.4. Caes., Regula ad Virgines, 73.5. F. Benoit, « Le premier baptistère d’Arles et l’abbaye Saint-Césaire. Nouvelles recherches
sur la topographie paléochrétienne d’Arles du IVe au VIe siècles », Cahiers Archéologiques V, 1951, p. 54-66.
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1193SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1193 07/06/2010 16:34:4707/06/2010 16:34:47
1194 COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
était interdit aux moniales, puisqu’elle servait encore pour les offi ces publics. Il est très probable qu’il s’agit de l’ecclesia à côte de laquelle Césaire avait construit son monastère. D’après certaines hypothèses, notamment émise par les éditeurs des écrits de Césaire, M.-J. Delage et A. de Vogüé, il s’agirait en fait de la cathédrale Saint-Étienne, dont le transfert aurait eu lieu plus tardivement que ce qu’on pense d’habitude6.
Enfi n, sans doute vers 524, Césaire décide de faire construire une basilique dédiée à la Vierge, destinée aux sépultures des moniales ainsi qu’à son propre tombeau7. Longtemps considérée comme une église située à l’intérieur du couvent, et donc comme le premier cas offi ciellement autorisé de sépultures intra muros, cet édifi ce se trouvait plus probablement, en accord avec les coutumes anti-ques, à l’extérieur de l’enceinte urbaine, peut-être à l’emplacement de l’église Saint-Césaire-le-Vieux, dans la partie occidentale des Alyscamps, qui appartenait encore au Moyen-Âge au couvent.
6. J. Hubert, Recherches sur la topographie religieuse d’Arles au Ve siècle, Cahiers Archéolo-giques 2, 1947, p. 20-21 ; M.-J. Delage, Césaire, Sermons au peuple, I., Paris, 1971 (SC 175), p. 22 ; A. de Vogüé, J. Courreau, Césaire, Œuvres pour les moniales, Paris, 1988 (Sources Chrétiennes 345), p. 98-99.
7. Vita s. Caesari, I, 57.
FIG. 1. – Plan de la localisation du site.
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1194SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1194 07/06/2010 16:34:4707/06/2010 16:34:47
LES FOUILLES DE L’ÉGLISE PALÉOCHRÉTIENNE À ARLES 1195
Ce monastère, dédié d’abord à saint Jean, avant d’être consacré à Césaire au Moyen Âge, est resté utilisé jusqu’à la Révolution. Des mentions anciennes de découvertes lapidaires (colonnes ; chapi-teaux) sont nombreuses, mais pas localisées avec précision. Dans les années 1943, F. Benoit a fait des sondages dans la cour et une partie d’une abside paléochrétienne a été mise au jour en 19478.
Après différentes utilisations et d’importants travaux au XIXe siècle, l’ensemble des bâtiments fait depuis 1995 l’objet d’une rénovation. En 2003, après la démolition des plusieurs bâti-ments monastiques, sont apparus des restes d’une grande abside, qui ont par la suite fait l’objet d’un diagnostic archéologique (dir. F. Raynaud, INRAP) ; d’autres sondages ont eu lieu en 2004 (dir. M. Heijmans, CNRS) ; depuis 2006, le site fait l’objet d’une fouille programmée9.
Les résultats des fouilles récentes (fi g. 2)
LES VESTIGES ANTÉRIEURS À L’ANTIQUITÉ TARDIVE
Faute d’avoir pu réaliser des sondages en profondeur, nos connaissances de l’évolution du quartier avant le VIe siècle demeu-rent très lacunaires. Il a toutefois été possible d’atteindre à plusieurs reprises le rocher. On constate alors clairement qu’au nord comme au sud de l’axe de l’église paléochrétienne, le rocher est bien plus profond (au nord, 22,04 NGF ; au sud, 21,53 m NGF) qu’au centre (à 22,53 NGF). À cet endroit, le sol de l’église paléochrétienne est établi à environ 70 cm au-dessus du niveau du rocher ; les niveaux antérieurs à l’Antiquité tardive ont donc été détruits, ce qui explique en partie la quantité de céramique résiduelle dans les remblais plus tardifs.
8. F. Benoit, Le premier baptistère d’Arles et l’abbaye Saint-Césaire, p. 46-49.9. Plusieurs notices ont été consacrées à cette découverte : F. Raynaud, « Une cathédrale à
Arles », dans La France archéologique. Vingt ans d’aménagements et de découvertes, Paris, 2004, p. 165 ; M. Heijmans, « L’église paléochrétienne de l’enclos Saint-Césaire, à Arles », dans 15 ans d’archéologie en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Aix, 2005, p. 212-213 ; Id., « Données nouvelles sur le groupe épiscopal d’Arles (Bouches-du-Rhône, France) et l’enclos Saint-Césaire, des origines jusqu’à la fi n du Moyen-Âge », Rendiconti. Atti della Pontifi cia Accademia Romana di archeo-logia LXXVIII (2005-2006), p. 321-347 ; Id., « L’église paléochrétienne de l’enclos Saint-Césaire à Arles (Bouches-du-Rhône) », Gallia 63, 2006, p. 121-124 ; voir en dernier lieu, la notice dans M.-P. Rothé, M. Heijmans, Carte Archéologique de la Gaule, 13/5, Arles, Camargue, Crau, Paris, 2008, 47*, p. 320-334 [notice M. Heijmans].
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1195SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1195 07/06/2010 16:34:4807/06/2010 16:34:48
1196 COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
L’époque protohistorique
Étant donne les observations faites plus haut, il n’est pas surpre-nant que c’est aux extrémités nord et sud qu’ont été découverts des vestiges que l’on peut rattacher à la période protohistorique. Il s’agit de deux murs en pierres sèches, distants de 35 m, qui ont été observés très partiellement. Dans ces conditions, l’interprétation de ces constructions demeure délicate, ainsi que leur datation précise.
Le Haut-Empire
En ce qui concerne les vestiges du Haut-Empire, les fouilles ont révélé à plusieurs endroits la présence d’un sol en béton de tuileau d’excellente qualité, à la cote 23,12 m NGF environ. Il s’agit en particulier du bas-côté nord de l’église paléochrétienne, qui aurait donc réutilisé un sol antérieur. Bien que le contact physique n’ait pas pu être établi entre ces différents éléments, il est possible qu’il s’agisse du même sol, que l’on avait daté provisoirement de la fi n du Ier siècle, sur la base de la céramique trouvée sous ce sol.
FIG. 2. – Plan schématique des vestiges de l’église paléochrétienne.
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1196SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1196 07/06/2010 16:34:4807/06/2010 16:34:48
LES FOUILLES DE L’ÉGLISE PALÉOCHRÉTIENNE À ARLES 1197
Il faut également rattacher au Haut-Empire une citerne, déjà observée en 1943 par F. Benoit10 et qui a été remise au jour en 2008 ; elle est recouverte par le sol en béton de tuileau et alimentée par un caniveau est-ouest. La présence d’une citerne dans ce quartier s’explique aisément par le fait que ce secteur se trouve à un niveau supérieur à celui de l’aqueduc, qui entre en ville à environ 60 m au nord ; d’ailleurs, les mentions de citernes sont fréquentes dans ce quartier, à commencer par celle de la Vita de Césaire.
Enfi n, dans la partie sud du chantier, ont été observés, sur des superfi cies très limitées, d’autres lambeaux de sols, des niveaux de rues ou, en tout cas, des espaces de circulation à ciel ouvert ainsi qu’un mur nord-sud.
Ces points de découvertes montrent que le site de la future église était déjà occupé par des constructions importantes, dont témoignent également les chapiteaux, colonnes et autres éléments lapidaires trouvés anciennement et plus récemment dans ce quartier.
L’ÉPOQUE PALÉOCHRÉTIENNE
De bouleversements importants interviennent durant l’Antiquité tardive, liés à la construction à cet endroit de la cathédrale primi-tive, dont la date de construction est généralement située au cours du IVe siècle. Les résultats obtenus lors de la campagne de fouille 2006-2008 ont donné pour la première fois des indications archéo-logiques plus précises, mais la quantité de céramique est très faible et les datations sont donc approximatives.
Un état du IVe siècle ?
En effet, on cherche toujours vainement à quoi pourrait ressem-bler cette éventuelle église primitive. On a d’abord mis au jour un mur nord-sud, large d’un mètre. Construit en petit appareil avec des arases de briques, il a été reconnu sur une longueur de 40 m, sans que les limites n’aient été atteintes11 (fi g. 3). Contre son parement ouest s’appuie un sol en béton de tuileau, datable du courant du IVe siècle ; le mur est d’autre part antérieur à la grande abside. Plus à l’Ouest, a été reconnu très partiellement un sol en mortier rose, qui peut être
10. F. Benoit, Le premier baptistère d’Arles et l’abbaye Saint-Césaire, p. 35.11. Les travaux réalisés en mai 2009 ont en effet permis de constater que la partie nord de ce
mur, c’est-à-dire au nord de l’abside qui s’y appuie dans un second temps, était également pourvue d’arases de briques ; il s’agit donc bien de la même construction que la partie déjà connue au Sud.
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1197SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1197 07/06/2010 16:34:4907/06/2010 16:34:49
1198 COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
daté du milieu du IVe siècle. D’autre part, il est probable que certains sols du Haut-Empire aient encore été utilisés durant l’Antiquité tardive. Évidemment, rien ne prouve que ces constructions fassent partie d’une église paléochrétienne.
Une construction du VIe s.
L’essentiel des constructions mises au jour depuis 2003 semble se rapporter, dans l’état actuel du dossier, au VIe siècle et plus parti-culièrement à la première moitié du siècle, donc durant l’épiscopat de Césaire. Cette datation n’est certes pas assurée pour toutes les parties de l’église, mais les vestiges mis au jour forment, malgré les problèmes de restitution, un ensemble cohérent ; nous suppo-sons provisoirement que l’ensemble est uniforme et contemporain,
FIG. 3. – Vue du mur de « transept » (cl. M. Heijmans, CNRS, 2007).
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1198SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1198 07/06/2010 16:34:4907/06/2010 16:34:49
LES FOUILLES DE L’ÉGLISE PALÉOCHRÉTIENNE À ARLES 1199
d’autant plus que des traces de reprises ou de modifi cations sont très rares. Si la partie centrale de l’église et ses installations liturgiques sont en effet désormais assez bien connues, le reste du plan de l’édi-fi ce demeure énigmatique, bien qu’une surface de 450 m2 ait déjà été explorée. Il faut dire que la construction surprend à la fois par ses dimensions, par son état de conservation ainsi que par son plan.
L’église dans son état du VIe siècle se présente de la façon suivante : à l’Est, une grande abside, d’une ouverture de 19,80 m, s’appuie contre le mur nord-sud préexistant ; conservé par endroits sur une hauteur de près de 3 m, l’abside était pourvue à l’extérieur de plusieurs contreforts. Une porte au Nord, et une deuxième au Sud donnaient accès à des espaces annexes, peut-être le secretarium ou le sacrarium. On note en particulier parmi les annexes un espace construit sur hypocauste, avec des pilettes en pierres, que l’on peut dater de la première moitié du VIe siècle.
À l’intérieur de cette vaste abside se trouve une seconde abside (diam. 9,60 m), que l’on interprète comme le banc presbytéral ou synthronos, détaché du mur de l’abside, comme on connaît dans d’autres cas. Dans l’espace entre les deux absides, sont conservés des restes d’une mosaïque polychrome. Le synthronos lui-même était pavé d’un sol en marbre, partiellement conservé, légèrement surélevé par rapport à cette mosaïque (fi g. 4).
Comme on a dit, l’abside extérieure s’appuie contre le mur nord-sud antérieur ; ce dernier, dont on ne peut pas savoir pour l’ins-tant s’il délimite un transept ou des nefs, a été poursuivi vers le Sud sur une longueur de 17 m, à partir du contact avec le chevet, sans qu’un retour n’ait été observé. Par symétrie, on peut restituer une largeur d’au moins 55 m ; si l’on tient compte de la présence d’une autre église paléochrétienne plus au sud, découverte anciennement, la largeur de cette partie de l’édifi ce doit être de l’ordre de 60 m.
Cette largeur suppose évidemment une division entre une nef centrale et les collatéraux. Les éléments disponibles pour comprendre l’organisation sont toutefois ténus, bien qu’imposants. Les fouilles ont en effet mis au jour dans la partie sud, un pilier de grandes dimensions (3,40 m x 3,70 m) (fi g. 5), auquel répond, au Nord, un pilier comparable. La distance entre ces deux piliers est d’environ 31 m d’axe en axe. À 9 m à l’Ouest du pilier sud, d’axe en axe, a été trouvé un stylobate, sur lequel on voit encore la trace d’une colonne. Ce dispositif n’a pas encore été rencontré du côté nord, où il est à priori en dehors de la zone fouillée. En tout cas, ces
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1199SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1199 07/06/2010 16:34:5007/06/2010 16:34:50
1200 COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
FIG. 4. – Vue du dallage de marbre du synthronos (cl. M. Heijmans, CNRS, 2004).
FIG. 5. – Vue du piler sud (cl. M. Heijmans, CNRS, 2006).
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1200SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1200 07/06/2010 16:34:5007/06/2010 16:34:50
LES FOUILLES DE L’ÉGLISE PALÉOCHRÉTIENNE À ARLES 1201
supports ne marquent pas une séparation nette entre la nef centrale et les bas-côtés, puisque l’on trouve le même sol de part et d’autre. En effet, du côté sud, le sol antique a été observé sur une vaste étendue ; de médiocre qualité, il montre de nombreuses traces de recharges, ce qui prouve que l’édifi ce, en tout cas en partie, a bien été achevé et utilisé sans doute sur une période assez longue.
Ce sol est en revanche de bien moindre qualité que celui de chœur, qui, large de 10 m, s’étend sur une longueur d’au moins 25 m d’est en ouest, depuis le synthronos jusqu’à la limite occidentale de la fouille. Cette partie de l’édifi ce est désormais assez bien connue. Devant le synthronos, s’étend un espace carré, pavé de grandes dalles de marbre, dont on peut estimer la superfi cie à 100 m2, le presbyterium. Cet espace est limité au Sud, et sans doute également au Nord et à l’Ouest, par une barrière de chancel, dont les fondations sont encore bien conservées ; cette construction a connu plusieurs états, dont l’étude n’est pas encore achevée (fi g. 6).
Le presbyterium domine à l’Ouest un autre espace, pourvu d’un sol en béton de tuileau de bonne qualité, situé légèrement en contrebas (20 cm) ; il faut sans doute restituer une marche entre le presbyte-rium et cet espace. Large de 10 m, comme les autres éléments du chœur, sa longueur doit se situer vers 4 m.
Encore plus à l’Ouest, se trouve un troisième espace, égale-ment pourvu d’un sol en béton de tuileau, de la même qualité, mais encore 40 cm plus bas. Il faut donc à nouveau restituer un mur ou des marches. Ce dernier sol se trouvait d’autre part à environ 20 cm au-dessus des bas-côtés. Entre les deux, on observe un dallage en pierres de taille, partiellement récupéré.
La particularité de ce sol est qu’on y observe les traces d’une construction arrondie, de 6,85 m de diamètre, dans l’axe de l’église (fi g. 7) ; il s’agit selon toute probabilité des fondations d’un ambon, ou en tout cas d’une construction ayant supporté un ambon, relié au presbyterium, qui se situe donc environ 60 cm plus haut, par la solea, Il s’agit d’une installation liturgique assez peu attestée en Occident, puisqu’un inventaire récent en décompte moins d’une dizaine12. Contrairement à ces autres exemples, souvent observés très partiel-lement, l’ambon arlésien est remarquablement bien conservé ; en effet, un élément de la solea a également été observé ; il est égale-ment délimité par une barrière de chancel. La fouille a montré que
12. Voir en dernier lieu, S. Ristow, « Ambonen und Soleae in Gallien, Germanien, Raetien und Noricum im Frühmittelalter », Rivista di archeologia cristiana LXXX, 2004, p. 289-312.
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1201SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1201 07/06/2010 16:34:5107/06/2010 16:34:51
1202 COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
cette construction n’est pas parfaitement circulaire, mais qu’elle montre du côté ouest une partie rectiligne perpendiculaire à l’axe de l’église. On peut penser qu’il y avait des marches qui permet-taient de descendre de l’ambon jusqu’au sol en béton, dont on ignore jusqu’où il se poursuit.
En effet, le plan de la partie occidentale de l’église demeure inconnu. La présence, à un niveau nettement inférieur, d’un sol en béton de tuileau dans la partie est de l’église Saint-Blaise, appuyé contre un mur est-ouest, oblige à priori à imaginer une partie moins large. Toutefois, en l’absence de données vérifi ables, il vaut mieux s’abstenir pour l’instant à proposer des hypothèses pour la reconstruction de cet édifi ce, manifestement hors normes.
FIG. 6. – Vue de la barrière de chancel, prise de l’Ouest (cl. M. Heijmans, CNRS, 2006).
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1202SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1202 07/06/2010 16:34:5107/06/2010 16:34:51
LES FOUILLES DE L’ÉGLISE PALÉOCHRÉTIENNE À ARLES 1203
En guise de conclusion
Les fouilles en cours confi rment, comme on vient de voir, large-ment le caractère exceptionnel de ce site, déjà pressenti dès 2003. Loin d’avoir livré tous ses secrets, le site nous surprend tous les jours et pose un grand nombre de questions.
La première question soulevée par cette fouille est purement architecturale : comment s’imaginer le plan de l’église, avec une largeur de 60 m, au moins en partie ? Comment se faisait-elle la division entre la nef et les bas-côtés ? Comment couvrir la largeur de 30 m entre les deux piliers monumentaux, qui « encadrent » parfai-tement l’ambon ? Quel plan pour la partie occidentale ? Quelle longueur faut-il imaginer ? etc., etc.
La deuxième question touche à l’interprétation de cet édifi ce et l’idée que l’on se faisait de la topographie d’Arles durant l’Antiquité tardive, et en particulier de ce quartier. Je rappelle qu’au moment où il faut situer la construction de cette église, la cathédrale était présumée transférée vers les parties basses de la ville, et ce quartier était censé abriter le monastère Saint-Jean. Or, les dimensions de
FIG. 7. – Vue de l’ambon (cl. A. Genot, MDAA, 2008).
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1203SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1203 07/06/2010 16:34:5207/06/2010 16:34:52
1204 COMPTES RENDUS DE L’ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
cette église et la qualité de sa construction paraissent peu compa-tibles avec celles d’une simple église conventuelle. Il s’agit sans doute de la basilica anonyme de la règle monastique de Césaire, et il faut se demander s’il ne s’agit pas aussi de la cathédrale Saint-Étienne qui aurait donc été reconstruite sous son épiscopat, bien qu’aucun texte ne mentionne de ces travaux colossaux. Et, s’il s’agit bien de la cathédrale, il faut aussi placer ici le baptistère, l’atrium, l’hospice, les cellae des clercs et les autres constructions mention-nées par nos sources qui font partie du groupe épiscopal. Il reste bien peu de place pour le monastère Saint-Jean, qu’il faut sans doute chercher ailleurs. Cette découverte incite à une relecture des écrits de Césaire.
Dernière question, plus historique : pourquoi et comment Césaire, si c’est bien lui, a-t-il fait construire cet énorme édifi ce, dont les dimensions dépassent de loin celles des plus grandes églises paléo-chrétiennes connues jusqu’à présent en Gaule, comme Saint-Just II et Saint-Laurent-de-Choulans, toutes les deux à Lyon, qui mesuraient 56 et 50 m de longueur13 ? Si les datations se confi rment, on est bien dans la période où Arles faisait partie du royaume ostrogoth de Théodoric, dont on connaît certes l’intérêt qu’il portât à la Provence et en particulier à Arles ; la restauration des remparts de la ville ; le rétablissement de la préfecture des Gaules ; l’accueil très favorable qu’a reçu Césaire en 512 à la cour de Théodoric, pourtant arien ; mais est-ce suffi sant pour expliquer cette construction, plus impo-sante que ce qui se faisait en même temps à Ravenne même ? Il faut sans doute chercher une partie de l’explication dans la présence des constructions antérieures, assez importantes, comme le montre le mur nord-sud du transept.
Venu à terme de ce premier programme de fouille, on ne peut que conclure que toutes ces questions forment autant d’arguments pour poursuivre l’étude de ce site qui, par ses dimensions et son état de conservation nous livre un témoignage unique de l’archi-tecture paléo chrétienne en Occident ; en même temps, cette fouille confi rme la place prépondérante qu’occupe Arles dans l’histoire du christianisme naissant, que l’on connaissait jusqu’à présent uniquement par les sources. De ce fait, Arles, considérée il y a quel-ques années encore comme une « grande absente d’une enquête
13. N. Duval, « L’architecture cultuelle », dans Naissance des arts chrétiens, Paris, 1991, p. 193.
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1204SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1204 07/06/2010 16:34:5307/06/2010 16:34:53
LES FOUILLES DE L’ÉGLISE PALÉOCHRÉTIENNE À ARLES 1205
archéologique », a largement comblé ce retard et peut retrouver, grâce à l’étude de site, la place qu’elle mérite dans l’histoire et l’archéologie des premiers temps chrétiens.
** *
MM Jean-François JARRIGE, André VAUCHEZ, Jean-Pierre CALLU et Jean-Pierre Sodini, correspondant de l’Académie, interviennent après cette note d’information.
SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1205SE05_17octobre_CRAI08_3.indd 1205 07/06/2010 16:34:5307/06/2010 16:34:53