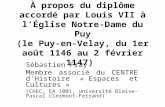"Le chevet de l’église Saint-Sulpice de Chars : un effet de style ?", Ex quadris lapidibus. La...
-
Upload
u-picardie -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of "Le chevet de l’église Saint-Sulpice de Chars : un effet de style ?", Ex quadris lapidibus. La...
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT
BE DISTRIBUTED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
HEx quadris lapidibus
La pierre et sa mise en œuvre dans l’art médiévalMélanges d’Histoire de l’art offerts à Éliane Vergnolle
Yves Gallet (éd.)
FHEx quadris lapidibusLa pierre et sa m
ise en œuvre dans l’art m
édiévalYves G
allet (éd.)
La pierre et sa mise en œuvre dans l’art du Moyen Age : autour de ce thème, plus de quarante spécialistes français et étrangers, historiens de l’art, archéologues, conservateurs ou architectes, se sont associés pour rendre hommage à Éliane Vergnolle, dont les travaux sur l’art et l’architecture de la période romane font aujourd’hui autorité. Le domaine de recherche d’Éliane Vergnolle et ses études sur les techniques de taille de la pierre ont dicté les thèmes explorés dans ce volume, qui couvre un large champ. De nombreuses contributions abordent la question du travail de la pierre dans la sculpture et dans l’architecture romane ou gothique, ainsi que dans la création artistique des périodes plus récentes. Plusieurs études sont consacrées aux rapports entre la pierre et les arts de la couleur (enluminure, peinture, vitrail), aux questions de méthode d’analyse, à l’archéologie du bâti, à la pratique du réemploi, aux comptabilités des chantiers, aux modes de transmission des formes et des connaissances, aux tailleurs de pierre eux-mêmes, ainsi qu’à la pierre « rêvée », celle des représentations et de l’imaginaire médiéval. Au total, cet ouvrage offre, sous un angle original, un panorama complet des principales orientations de la recherche actuelle autour des arts monumentaux à l’époque médiévale.
ISBN 978-2-503-53563-0
9 782503 535630
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT
BE DISTRIBUTED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
HEx Quadris Lapidibus, éd. par Yves Gallet, Turnhout, 2011, pp. 255-264© F H G DOI 10.148/M.STA-EB.1.100203
Le chevet de l’église Saint-Sulpice de Chars :un effet de style ?
Arnaud Timbert
Les monuments fondateurs du premier gothique ne se succèdent pas à rythme régulier, l’un suscitant l’autre dans une progression linéaire. Au contraire, les monuments francigènes du XIIe siècle surgissent de terre dans une contemporanéité confuse parcourue d’une tension d’autant plus fébrile qu’elle touche une géographie limitée et qu’elle intéresse un petit groupe d’hommes. Entre 1140 et 1190 des édifices sont édifiés dans une frénésie d’invention formelle et d’innovation technique sans précé-dents pour l’Occident. L’émulation est telle qu’un monument de peu achevé est déjà démodé 1.
Dans ce paysage où la nouveauté est quotidienne le chevet de l’église Saint-Sulpice de Chars, à la fin du XIIe siècle, présente des formes et une technicité en grande partie empruntées aux édifices des premières générations du gothique et à Saint-Germer-de-Fly en particulier 2. Grâce à la diversité des recherches offertes sur Chars depuis le début du XXe siècle sa datation, des années 1190-1200, ne soulève guère de problèmes 3. À l’inverse, sa place dans le paysage architectural n’a jamais été définie que dans les grandes lignes et aucune interprétation de « l’archaïsme » qui le caractérise n’a été propo-sée.
Sans prétendre à une iconologie dont l’intérêt a récemment été rappelé 4, comment solliciter ce monument et mieux comprendre les hommes qui furent à son origine sans tomber, faute de sources, dans la spéculation et l’abus de subjectivité ? L’entreprise, périlleuse, n’est que l’essai d’une première approche.
Le monument et son paysage architectural
Dans le prolongement d’un transept non saillant, les parties orientales de l’église Saint-Sulpice de Chars se composent, en plan (fig. 1), d’une travée droite de chœur de tracé trapézoïdal auquel font écho des espaces de même plan dans les bas-côtés. Le sanctuaire est délimité par un rond-point qui adopte le schéma à cinq pans d’un demi décagone en usage à Pontigny et Saint-Yved de Braine (vers 1180) et dans les chevets des cathédrales de Chartres et de Soissons durant les décennies suivantes 5. Au-delà se déploie un déambulatoire à cinq travées trapézoïdales desservant autant de chapelles rayon-nantes, initialement de plan segmentaire 6. Le tracé trapézoïdal de la partie droite de chœur ouvre la
1 Sur cette réalité : Roland Recht, « Le monde des cathé-drales et ses explorateurs », Le monde des cathédrales, Paris, La documentation française, 2003, p. 200. Du même : Le croire et le voir. L’art des cathédrales (XIIe-XVe siècle), Paris, 1999, p. 146-251.2 Jacques Henriet, « Un édifice de la première génération gothique : l’abbatiale de Saint-Germer-de-Fly », Bulletin Monumental, 1985, p. 93-142, réédité dans À l’aube de l’ar-chitecture gothique, Besançon, 2005, p. 101-155.3 Eugène Lefèvre-Pontalis, « L’église de Chars », Bulletin Monumental, 1901, p. 7-29 ; Maryse Bideault et Claudine Lautier, Ile-de-France gothique, Paris, 1987, p. 153-163 ; Dieter Kimpel et Robert Suckale, L’architecture gothique en France 1130-1270, Paris, 1990, p. 119. La datation de
1170 proposée par Lindy Grant n’a pas été argumentée : Lindy Grant, Architecture and Society in Normandy (1120-1270), New Haven et Londres, 2005, p. 47. En dernier lieu il conviendra de consulter, pour la critique d’authenticité et l’analyse archéologique : Juliette Duboc, Le chevet de l’église Saint-Sulpice de Chars, mémoire de Maîtrise, dir. Arnaud Timbert, Univ. Lille 3, 2004, 2 vol.4 Wolfgang Schenkluhn, « Iconographie et iconologie de l’architecture médiévale », dans Paolo Piva, (dir.), L’esprit des pierres, Paris, 2008, p. 65-92.5 Dany Sandron, La cathédrale de Soissons. Architecture du pouvoir, Paris, 1998, p. 102.6 Bideault & Lautier, Ile-de-France gothique (cf. note 3), p. 153-163.
lapidibus.indd 255 1/02/12 15:32
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT
BE DISTRIBUTED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
H
arnaud timbert
256
Fig. 1. Chars, église Saint-Sulpice de Chars, plan au sol (d’après M. Bideault et Cl. Lautier, 1987).
lapidibus.indd 256 1/02/12 15:32
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT
BE DISTRIBUTED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
H
le chevet de l’église saint-sulpice de chars
257
Fig. 2. Chars, église Saint-Sulpice, élévation du sanctuaire (cl. H. Heuzé).
lapidibus.indd 257 1/02/12 15:32
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT
BE DISTRIBUTED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
H
arnaud timbert
258
perspective vers le sanctuaire selon un modèle adopté dès 1150 à la cathédrale de Senlis 7 tandis que le parti à chapelles rayonnantes, s’il renvoie au même monument, est également à mettre en relation avec les chevets de Saint-Germer-de-Fly et Saint-Leu-d’Esserent 8.
En élévation, le haut vaisseau est doté de trois niveaux : grandes arcades, ouvertures-sur-combles à double percement et fenêtres hautes (fig. 2). Les grandes arcades en arc brisé surhaussé sont agrémentées de bâtons brisés, communs dans l’Ile-de-France du XIIe siècle 9, et d’une mouluration disposée sur le nu du mur dans une parenté étroite avec Saint-Germer-de-Fly et les tribunes orientales de la cathédrale de Noyon. Les profils choisis pour cette mouluration sont, pour l’intrados, une large scotie entre une tablette et un tore - assimilable à la modénature du second quart du XIIe siècle – tan-dis qu’à l’extrados règne un tore supérieur surcreusé d’une scotie étroite que dissimule un tore de petit diamètre – propre à l’écriture discrète des années 1190 10. Les arcades s’appuient sur les colonnes à tambours du rond-point par le biais de tailloirs polygonaux. Ceux-ci se composent, sous une tablette, d’une baguette entre deux scoties dont l’inférieure est soulignée d’un filet, écriture usuelle dans la dernière décennie du XIIe siècle. Ces tailloirs surmontent des chapiteaux à crochets ornés de feuilles côtelées et de fruits grenus – parfois balayés par le vent – similaires au décor de Santeuil ou de Mont-geroult 11. Là où le maître de Saint-Germer-de-Fly avait opté pour la pile, comme celui de Sens 12, le maître de Chars, faute de place, privilégia les colonnes à tambours de Saint-Germain-des-Prés, Saint-Quiriace de Provins, Domont ou Saint-Maclou de Pontoise et rejeta les supports en délit à l’étage médian.
Ce dernier niveau se distingue du précédent par un bandeau horizontal à hauteur duquel sont implantées des bagues décoratives, dépourvues de la fonction technique communément dévolue à cet organe 13. En limitant la bague à cette hauteur, la transition entre les niveaux est accentuée tandis que les supports se prolongent sans rupture ni scansion jusqu’à la racine des nervures, unifiant ainsi d’un seul trait cet étage à double percement. Pour les parties droites, la composition à baies géminées en plein cintre et tympan orné d’un oculus circonscrit d’un arc de même tracé est directement empruntée à Saint-Germer-de-Fly. À l’inverse, la faible largeur des travées du rond-point, a imposé des baies uniques, en plein cintre, surmontées d’un premier oculus que domine un arc brisé surhaussé dont la mouluration glisse sur le nu du mur. Cette disposition, rare, reproduit les baies extérieures du chevet de Saint-Denis 14, les grandes arcades de Saint-Martin d’Etampes 15 et, plus particulièrement, les tri-bunes du rond-point de la collégiale de Mantes-la-Jolie 16. Au-dessus, la paroi est percée d’un second
7 Delphine Christophe, Notre-Dame de Senlis, une cathé-drale au cœur de la cité, Beauvais, 2006, p. 78 et s.8 Les chapelles rayonnantes des chevets de Saint-Germain-des-Prés, Noyon, Saint-Maclou et Saint-Martin de Pontoise sont semi-circulaires. Pour Saint-Leu-d’Esserent, dont la date du début du chantier a récemment été rehaussée vers 1150 : Delphine Hanquiez, L’église prieurale de Saint-Leu-d’Esserent : analyse architecturale et archéologique, thèse de doctorat, dir. Christian Heck, Univ. Lille 3, 2008.9 Arnaud Timbert, « Le chevet de la collégiale Saint-Quiriace de Provins : l’œuvre d’Henri Ier le Libéral », Bulletin Monumental, 2006, p. 260, note 106.10 Arnaud Timbert, « Documents pour l’histoire de l’ar-chitecture médiévale : propos de Pierre Rousseau sur la modénature de Notre-Dame de Chartres, de Saint-Julien du Mans et Saint-Germer-de-Fly », Bulletin de la Société des Fouilles archéologiques et des Monuments historiques de l’Yonne, n° 24, 2007, p. 9-40.11 Bideault & Lautier, Ile-de-France gothique (cf. note
3), p. 344 (Santeuil).12 Jacques Henriet, « La cathédrale Saint-Étienne de Sens : le parti du premier maître et les campagnes du XIIe siècle », Bulletin Monumental, 1982, p. 81-174, réédité dans À l’aube de l’architecture gothique (cf. note 2), p. 173-267.13 Arnaud Timbert, « Technique et esthétique de la bague dans l’architecture gothique du XIIe siècle au Nord de la France », Archéologie Médiévale, n° 35, 2005, p. 39-50.14 Sumner McK. Crosby, The Royal Abbey of Saint-Denis from Its Beginnings to the Death of Suger, 475-1151, New Haven et Londres, 1987, p 215 et s.15 Jacques Henriet, « Recherches sur les premiers arcs-boutants . Un jalon : Saint-Martin d’Etampes », Bulletin Monumental, 1978, p. 309-323, réédité dans À l’aube de l’architecture gothique (cf. note 2), p. 157-172.16 Paul Frankl, Gothic Architecture, New Haven et Londres, 1962, éd. revue et corrigée par Paul Crossley, 2000, p. 68-69.
lapidibus.indd 258 1/02/12 15:32
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT
BE DISTRIBUTED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
H
le chevet de l’église saint-sulpice de chars
259
oculus, tantôt vide tantôt polylobé, qu’il serait abusif de renvoyer uniquement à Notre-Dame de Paris 17 quand il entretient aussi des rapports avec des réalisations normandes de l’extrême fin du XIIe siècle telles que Fécamp (nef) ou Saint-Étienne de Caen (sanctuaire) 18. Dans les travées de l’hémicycle qui sont mitoyennes aux parties droites, les baies ne sont pas disposées à l’aplomb des grandes arcades mais s’en détachent par un retrait de 30° de leurs piédroits occidentaux. Il en résulte une disposition biaise qui, associée au tracé du sanctuaire, favorise la dilatation visuelle de celui-ci. Ce type de jeu savant, tendant à mettre le regard dans l’illusion d’un espace plus grand qu’il n’est en réalité, n’est pas éloigné des recherches du début du XIIe siècle 19 et s’apparente aux essais contemporains des maîtres de Sois-sons (bras sud du transept), Vézelay (chevet) et Bourges (haut-vaisseau) 20.
17 Louis Grodecki et alii, Architecture gothique, Paris, 1ère éd. 1978, rééd. 1992, p. 36.18 En dernier lieu : Katrin Brockhaus, « Fécamp, ancienne abbatiale de la Trinité. Les campagnes des XIIe-XIIIe siècles », Congrès Archéologique de France (Rouen et Pays de Caux, 2003), Paris, 2006, p. 57-64 ; Lindy Grant, « Caen : abba-tiale Saint-Étienne », dans Maylis Baylé (dir.), L’architecture normande au Moyen Âge, Caen, vol. 2, 1997, p. 156-158.
19 Raymond Oursel, Haut-Poitou roman, Paris, 1984, p. 368.20 Roland Recht, Le croire et le voir (cf. note 1), p. 171 ; Arnaud Timbert, Vézelay, le chevet de la Madeleine et le premier gothique bourguignon, Rennes, à paraître ; Laurence Brügger & Yves Christe, Bourges, la cathédrale, Paris, 2000, p. 111.
Fig. 3. Chars, église Saint-Sulpice, le chevet (cl. E. Lefèvre-Pontalis).
lapidibus.indd 259 1/02/12 15:32
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT
BE DISTRIBUTED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
H
arnaud timbert
260
Le clair étage de Saint-Sulpice, inspiré de Saint-Germer-de-Fly, se déploie par le truche-ment d’une corniche saillante de plan semi-cir-culaire – en contraste avec le tracé à pans coupés des étages inférieurs – reposant sur des modil-lons. À l’intérieur, les baies sont repoussées à l’aplomb du mur gouttereaux. Ce parti favorise la réalisation d’un passage dans l’épaisseur du mur tandis que les nervures du haut vaisseau s’appuient à la base des baies selon une disposi-tion abandonnée à partir 1170-1180 21.
En partie basse, le déambulatoire com-munique avec les chapelles périphériques par de larges ouvertures en arc brisé à méplat entre deux tores – évocation de Senlis et Saint-Leu-d’Esserent. Les piles composées recevant les nervures des deux espaces sont dotées de douze supports cylin-driques ; celui destiné à recevoir les ogives du cou-loir annulaire et des chapelles est implanté à 45°, ce qui permet de les assimiler aux piles de Saint-Germer-de-Fly et de Noyon. L’écriture seule est originale : entre les fûts, l’arête du ressaut présente sa face favorisant la pleine confrontation du cylin-dre et de l’arête dans une composition commune avec les piles de la crypte de Saint-Étienne de Bourges, du sanctuaire de la Madeleine de Vézelay et de la cathédrale de Canterbury 22.
À l’extérieur, comme à Saint-Germer-de-Fly, l’ornementation offre un dépouillement en contraste avec le décor intérieur. Au-delà des chapelles reprises à la fin du Moyen Âge 23, se déploie la paroi de l’étage médian percé d’oculi
ornés de pointes de diamants identiques à celles des baies circulaires de Notre-Dame de Paris, Mantes et Moret-sur-Loing (fig. 3) 24. La corniche disposée, à l’intérieur, entre le niveau intermédiaire et les fenêtres hautes se retrouve, à l’extérieur, à la racine des fenêtres mais oppose au tracé semi-circulaire celui d’un pan coupé. Enfin, les fenêtres hautes sont simplement soulignées d’une sobre archivolte.
L’équilibre du monument (hauteur 16 m, largeur 5 m) est assuré, à l’intérieur, par la disposition, à hauteur de l’étage médian, d’un étrésillon sommé de tas de charges au droit des supports recevant les nervures et d’une volée d’arcs-boutants-sous-combles (fig. 4), ce qui invite à un parallèle avec Saint-Germer-de-Fly 25. À l’extérieur, des arcs-boutants viennent renforcer ce dispositif (fig. 3). Leur dessin
21 Entre autres, voir des monuments tels que Gonesse (che-vet), Mantes-la-Jolie (chevet), Noyon (transept), Pontigny (chevet), Vézelay (chevet), etc.22 Christopher Wilson, « Lausanne and Canterbury : A ‘Special Relationship’ Re-considered », dans Peter Kurmann et Martin Rohde (dir.), Die Kathedrale von Lausanne und ihr Marienportal im Kontexte des europöishen Gotik, Berlin et New York, 2004, p. 89-124.23 Bideault & Lautier, Ile-de-France gothique (cf. note
3), p. 157.24 Anne Prache, « La place de la collégiale dans l’archi-tecture gothique du XIIe siècle », dans Mantes médiévale, la collégiale au cœur de la ville, Paris, 2000, p. 90-95 ; Suzanne Krone, Histoire architecturale de l’église Notre-Dame de Moret-sur-Loing, mémoire de Maîtrise, dir. Anne Prache, Univ. Paris IV-Sorbonne, 1993-1994.25 Jacques Henriet, dans À l’aube de l’architecture gothique (cf. note 2), p. 130.
Fig. 4. Chars, église Saint-sulpice, vue intérieure de l’étage médian (cl. Molinard).
lapidibus.indd 260 1/02/12 15:32
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT
BE DISTRIBUTED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
H
le chevet de l’église saint-sulpice de chars
261
à volée en quart de cercle et extrados plan orné de pointes de diamants, inspiré de Saint-Leu-d’Esserent, au même titre que les doubles larmiers enveloppant les culées et le passage ménagé dans le contrefort qui les reçoit, suggèrent des comparaisons avec des monuments des années 1190-1200 26.
Le choix de l’arc-boutant-sous-combles n’a rien d’archaïque. La longévité de son emploi à travers les XIIe (Creil, Laon) 27 et XIIIe siècles (Avila) 28, jusqu’aux XVe et XVIe siècles 29, à l’instar de sa dissimulation partielle (Arras, Cambrai, Domont, Laval) 30, est plutôt révélateur d’une ac-ceptation relative de l’arc-boutant extérieur 31. Ce qui étonne à Chars relève de l’emploi cumulé de l’arc-boutant-sous-combles, de l’étrésillon et de l’arc-boutant dans un monument dont les men-surations et la structure ne justifiaient pas un tel surcroît de précaution. Tout au plus pouvons-nous imaginer que l’importante humidité du terrain 32, responsable du rehaussement du sol de la nef, a entraîné cette multiplication des moyens de contrebutement. Reste qu’en la matière, le che-vet de Saint-Sulpice cumule toutes les solutions du moment comme il agrège les références formel-les.
Le maître de Chars cultive ainsi, dans un esprit « baroque » guère éloigné du sanctuaire de la cathédrale de Noyon 33, des contrastes d’écriture entre l’avers et le revers, des oppositions nuancées où se superposent et s’alignent les tracés semi-circulaires et à pans coupés, des variations équilibrées entre modénature ancienne et contemporaine, entre un décor sculpté novateur et une écriture architecturale révolue, tout en favorisant, dans un même esprit de concrétion, l’emploi de contrebutement divers. À l’inverse de ce que voudraient des jugements subjectifs – et parfois sans nuances – ce chevet n’est donc pas l’œuvre « médiocre » 34, « maladroite » 35, « sans imagination et même grossière » 36 d’un maître sans talent. Au contraire, cet édifice relie la fin du siècle à son début tout en en faisant la somme. Il se présente comme une remarquable synthèse formelle et technique que parcourent des renvois à Saint-Germer-de-Fly. La mauvaise perception de ce monument par l’historiographie est là : l’attachement à un édifice des années 1135 – « incunable de l’architecture gothique » 37 – n’est pas sans suggérer « un archaïsme intentionnel » dont la finalité est déroutante.
26 En dernier lieu : Andrew J. Tallon, Experiments in Early Gothic Structure : the Flying Buttress, these de doctorat, dir. Stephen Murray, Columbia University, 2007.27 Delphine Hanquiez, « Les pièces d’architecture de la collégiale Saint-Evremond de Creil », dans L’architecture en objets : les dépôts lapidaires de la France du Nord, Actes de la Journée d’études, INHA, 12 décembre 2008, à paraître. William Clark, Laon Cathedral. Architecture (1), Londres, 1983, p. 25-36.28 Ignacio Hernandez Garcia de la Berreda, José-Luis Gutierrez Robledo, « La catedral : fortior abulensis », Enciclopedia del Romanico en Castilla y Leon, Aguilar del campoo, 2002, p. 216-224.29 Entre autres, voir notamment les exemples de Baron, Versigny, Raray et Ver-sur-Launette. Judith Aycard, Le chantier flamboyant de la cathédrale Notre-Dame de Senlis, thèse de doctorat, dir. Philippe Racinet, Univ. Amiens, en cours.30 Philippe Plagnieux, « Les arcs-boutants du XIIe siècle dans l’église de Domont », Bulletin Monumental, 1992, p. 209-222. Pour complément, du même : « Arc-boutant »,
Dictionnaire d’histoire de l’art du Moyen Âge occidental, Paris, 2009, p. 51-52. Pour Laval, en dernier lieu : Angeline Savarre, Le chevet de la basilique Notre-Dame d’Avénières près de Laval, mémoire de Master 1, dir. Arnaud Timbert, Univ. Lille 3, 2006. 31 Arnaud Timbert et Andrew J. Tallon, « Les arcs-boutants du chevet de l’abbatiale de Pontigny : nouvelles observations », Bulletin Monumental, 2008, p. 99-104.32 Lefèvre-Pontalis, « L’église de Chars », (cf. note 3), p. 9.33 Timbert, « Technique et esthétique de la bague » (cf. note 13), p. 39-50.34 Henriet, « Saint-Germer-de-Fly » (cf. note 2), p. 138, note 104.35 Frédérique-Anne Costantini, « Chars, église Saint-Sulpice », Dictionnaire des Monuments d’Ile-de-France, Paris, 1999, p. 191.36 Bideault & Lautier, Ile-de-France gothique (cf. note 3), p. 163.37 Plagnieux, « Arc-boutant » (cf. note 30), p. 51-52.
lapidibus.indd 261 1/02/12 15:32
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT
BE DISTRIBUTED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
H
arnaud timbert
262
38 Beat Brenk, « Spolien und ihre Wirkung auf die Ästhetik der varietas. Zum Problem alternierender Kapitelltypen », dans Joachim Poeschke (éd.), Antike Spolien in der Architektur des Mittelaters und der Renaissance, Munich, 1996, p. 49-92. Yves Pauwels, « Varietas et ordo en archi-tecture : lecture de l’Antique et rhétorique de la créa-tion », Dominique de Courcelles (dir.), La varietas à la Renaissance (Études et rencontres de l’École des chartes), Paris, 2001, p. 57-80.39 Grant, « Caen : abbatiale Saint-Étienne » (cf. note 18), p. 158; Anne Prache, « Les constructions gothiques de l’an-cienne église abbatiale de Montier-en-Der », Les Moines du Der (673-1790), Actes du colloque international d’histoire (Joinville – Montier-en-Der, 1er-3 octobre 1998), Langres, 2000, p. 433-442.40 Richard Krautheimer, Introduction à une iconographie de l’architecture médiévale, Paris, 1993.41 Dany Sandron (D.), « La cathédrale de Laon, un monu-ment à l’échelle du diocèse (vers 1150-1350) », La Sauvegarde de l’art français, 13, 2000, p. 22-39.42 Nicolas Reveyron, « La priorale du XIIe siècle : l’esthéti-que clunisienne », Paray-le-Monial, Paris, 2004, p. 175-203.43 Eugène Lefèvre-Pontalis, Monographie de l’église Saint-Maclou de Pontoise, Pontoise, 1888, p. 34.44 Aliette de Maillé, Provins. Les monuments religieux, Paris, t. 1, 1939, p. 163 et s.45 Lefèvre-Pontalis, « L’église de Chars », (cf. note 3),
p. 7-8. Annick Pegeon, « L’abbaye de Saint-Martin de Pontoise. Le temporel au Moyen Âge, du XIe au XIVe siè-cle », Mémoires de la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d’Oise et du Vexin, 1994-1995, t. LXXVIII, p. 35.46 Il existe en effet des exemples « d’archaïsmes intention-nels » pour refus d’un présent conjectural comme l’exprime, entre autres cas, l’élévation de la nef de la Madeleine de Vézelay. Dans les années 1130, l’écriture choisie pour cette dernière est délibérément passéiste au regard du modèle proposé par la Maior ecclesia (Éliane Vergnolle, L’art roman en France, Paris, 1994, p. 214). En revenant à des formes riches de références à l’œuvre antérieure, les moines de Vézelay ne se contentaient pas de légitimer la nouvelle, ils revendiquaient le droit à l’indépendance vis-à-vis d’une ingérence clunisienne ressentie comme une atteinte à leur liberté. Sur cette question : René Louis, Girart, comte de Vienne (…819-877) et ses fondations monastiques, Auxerre, 1946, p. 180.47 Bruno Klein, « Convenientia et cohaerentia antiqui et novi operis : ancien et nouveau aux débuts de l’architecture gothique », dans Fabienne Joubert et Dany Sandron (dir.), Pierre, lumière, couleur. Études d’histoire de l’art du Moyen Âge, Paris, 1999, p. 19-32.48 Philippe Plagnieux, « L’abbatiale de Saint-Germain-des-Prés et les débuts de l’architecture gothique », Bulletin Monumental, 2000, p. 5-86.
Comment interpréter l’œuvre ?
Le chevet de Saint-Sulpice de Chars s’impose comme l’expression même de la richesse née de la varietas chère au langage architectural gothique à partir du XIIe siècle 38. Cette période est en effet jalonnée de monuments synthétiques : le chevet de Saint-Martin-des-Champs est un catalogue de formes et de motifs empruntés à la Normandie, à la Picardie et à la Bourgogne. De même, pour men-tionner des monuments contemporains, ceux de Saint-Étienne de Caen et de Montier-en-Der présen-tent un « amalgame » de références à Sens, Saint-Denis, Vézelay, Notre-Dame de Paris, Noyon et Saint-Remi de Reims 39. L’esprit dans lequel fut conçu le chevet de Chars n’est guère éloigné de celui-ci. Il apparaît cependant que l’ancienneté du modèle prédominant laisse perplexe.
La reproduction, par de petits édifices, de modèles prestigieux soit par phénomène de mode soit par nécessité d’expression visuelle d’un lien de dépendance est une réalité récurrente du Moyen Âge 40. Ainsi le modèle cathédral se digresse-t-il en une diversité de modi dans son diocèse – voir notamment l’exemple de Laon 41 – au même titre que l’abbatiale et la collégiale influent sur leurs dépendances comme pourraient l’illustrer l’étroite parenté entre la Maior ecclesia et Paray-le-Monial 42, entre Saint-Denis et Saint-Maclou de Pontoise 43, ou encore entre Saint-Quiriace de Provins et Voul-ton 44. Or, l’église Saint-Sulpice de Chars, un temps dans la dépendance de l’abbaye Saint-Martin de Pontoise, fut rattachée, dès 1176, à l’abbaye de Saint-Denis 45. Si ce lien peut être éventuellement sol-licité pour expliquer le choix du plan, les références à Saint-Germer-de-Fly pour l’élévation, la plastique et la technique restent sans réponse. Par ailleurs, les monuments cités plus haut sont contemporains, ils appartiennent à une ambiance stylistique commune quand celui de Chars convoque des formes vieilles d’une soixantaine d’années.
À Chars, il y a incontestablement le désir de faire ancien plus que de revendiquer une parenté, de formaliser un contexte 46 ou de créer un lien esthétique avec la nef dans la perspective de suggérer une harmonie entre l’ancien et le nouveau comme à Saint-Denis 47, Saint-Germain-des-Prés 48,
lapidibus.indd 262 1/02/12 15:32
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY. THIS DOCUMENT MAY NOT
BE DISTRIBUTED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER
H
le chevet de l’église saint-sulpice de chars
263
49 Peter Kurmann et Éliane Vergnolle, « Ebreuil. L’ancienne église abbatiale Saint-Léger », Congrès Archéologique de France (Bourbonnais, 1988), Paris, 1991, p. 190-198.50 Stéphanie Zweifel, Le prieuré de Saint-Loup-de-Naud, mémoire de Maîtrise, dir. Anne Prache, Univ. Paris IV-Sorbonne, 1995.51 Lefèvre-Pontalis, « L’église de Chars », (cf. note 3), p. 9-16 ; Bideault & Lautier, Ile-de-France gothique (cf. note 3), p. 153-157.52 Aaron J. Gourevitch, Les catégories de la culture médié-
vale, Paris, 1983, p. 94.53 Arnaud Timbert, « Spatium et locus. L’architecture gothi-que et sa syntaxe. Le cas du XIIe siècle », Actes du colloque international Espaces et Mondes au Moyen Âge, Bucarest, 17-18 octobre 2008, Presses universitaires de Bucarest-New Europe College, 2009, p. 316-326.54 Christopher Wilson, The Gothic Cathedral (1130-1530), Londres, 1991, p. 17-18.55 Gourevitch, Les catégories (cf. note 52), p. 34.
Ebreuil 49 ou Saint-Loup-de-Naud 50. Rien de tel à Chars où, au contraire, le sanctuaire tranche avec la nef construite dans un premier gothique inspiré de Paris (Saint-Germain-de-Prés) et de sa proche région (Pontoise et Melun) 51. La rupture stylistique entre la nef et le sanctuaire de Saint-Sulpice ne semblerait avoir d’autres perspectives que de magnifier le chœur, de l’individualiser et de l’affirmer comme un lieu (locus) dans l’espace unifié (spatium) 52. L’effet serait donc plus soucieux du regard que du sens 53.
Toutefois, par sa référence à Saint-Germer-de-Fly, dont le modèle fut adopté dans l’avant-nef de Cluny III 54, le maître de Saint-Sulpice reproduit un modèle à la fois ancien et consacré tout en semblant faire état d’un refus et d’une résistance, d’une pondération de l’émulation, d’une envie d’apaisement et de synthèse dans l’invention architecturale, quotidiennement renouvelée de cette se-conde moitié du XIIe siècle.
Comment expliquer autrement cet « archaïsme intentionnel » ? Comment ne pas entrevoir ici « un effet de style » qui serait à la fois la somme du passé et le fondement de l’avenir ? Il n’y a rien, là, qui serait contraire à la culture médiévale 55.
lapidibus.indd 263 1/02/12 15:32