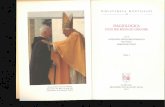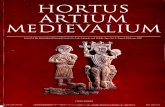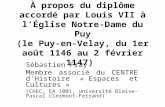Théophanie et liturgie : les odeurs de la dédicace de l’église Sainte-Agathe selon Grégoire...
Transcript of Théophanie et liturgie : les odeurs de la dédicace de l’église Sainte-Agathe selon Grégoire...
Théophanie et liturgie :
les odeurs de la dédicace de l’église Sainte-Agathe
selon Grégoire le Grand (Dial., III, 30, 1-7)1
Introduction
Les rites de la dédicace d’église font intervenir lesdifférents sens, successivement ou simultanément2 : Didier Méhuparle ainsi d’« un spectacle anagogique multisensoriel3». Onsonge immédiatement à la vue et à l’ouïe, mais, pour peu quel’on y réfléchisse, il devient évident que les autres senssont aussi concernés. Ils le sont toutefois à différentsdegrés : selon les rites effectués, mais également selon laposition des protagonistes. Ainsi, les sujets des diversesperceptions liées au déroulement du rituel ne sont pastoujours identiques : si la vue ou l’ouïe sont, à un moment oul’autre, « activées » par quiconque des présents, le toucherapparaît l’apanage de l’évêque et des clercs qui manient lesmatières sacrées (chrême, particules eucharistiques, reliques,etc.).
Mais qu’en est-il de l’odorat ? Ce sens, généralementconsidéré inférieur, joue pourtant un rôle non négligeabledans la vie humaine4, et ce n’est pas parce que nombre d’odeurs
1 Nous remercions Didier Méhu pour son invitation à prendre part à la table-ronde d’Auxerre, ainsi que pour les observations dont il nous a fait part.Cette étude reprend des éléments d’une thèse de doctorat (dir.F. Morenzoni) qui doit être soutenue auprès de l’université de Genève dansle courant 2006.2 Il s’agit d’ailleurs d’un caractère général du culte chrétien (cf.H. REIFENBERG, « Duft – Wohlgeruch als Gottesdienstliches Symbol. Liturgisch-phänomenologische Aspekte des odoratischen Elementes », dans Archiv fürLiturgiewissenschaft, 29, 1987, p. 322-323).3 Cf. .4 Cf. A. HOLLEY, Éloge de l’odorat, Paris, 1999.
ont été supprimées, aseptisées ou dissimulées à l’époquemoderne5 qu’il en a été ainsi toujours et partout6. Il est doncheureux que, depuis une ou deux décennies, des étudescommencent à se pencher sur le sens olfactif et sur les odeursdans l’Antiquité tardive et le Moyen Âge, autrement dit dansun cadre culturel progressivement imprégné d’un discours et decatégories développés à partir de la foi et des pratiqueschrétiennes7.
Divers types de sources sont susceptibles d’éclairer ce champd’études. On mentionnera en premier lieu les commentairespatristiques sur l’Écriture, qui ont développé très tôtdiverses interprétations sur les odeurs : il suffit deconsidérer, par exemple, le volumineux corpus exégétiqueconsacré au Cantique des cantiques, le livre biblique le plusriche en parfums8. Les traités et les sermons consacrés aubaptême ont également contribué à enrichir l’interprétation etla symbolique chrétiennes des odeurs à partir de l’association
5 Cf. A. CORBIN, Le miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, XVIIIe-XIXe siècles,Paris, 1982.6 Il y a soixante ans déjà, LUCIEN FEBVRE avait évoqué la dimension historiquede l’odorat en décrivant le XVIe siècle comme un monde « qui ne voit pasd’abord, qui entend et qui flaire, qui hume les souffles et capte lesbruits… » (Le problème de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, (1ère éd.Paris, 1942), Paris, 1968, p. 399). Pour le monde grec antique, on seréférera à l’ouvrage de M. DÉTIENNE, Les jardins d’Adonis. La mythologie des aromates enGrèce, Paris, 1972. Dans une perspective anthropologique plutôt questrictement historique, voir C. CLASSEN, D. HOWES, A. SYNNOTT, Aroma. The CulturalHistory of Smell, London-New York, 1994 ; A. LE GUÉRER, Les pouvoirs de l’odeur, nlleéd. rev. et augm., Paris, 1998.7 On trouvera une vue d’ensemble de cette évolution, principalement àl’égard de l’emploi liturgique de l’encens, dans la thèse inédite deB. CASEAU, ‘Evodia’. The Use and Meaning of Fragrances in the Ancient World and theirChristianization (100-900 AD), Princeton, 1994. SUSAN ASHBROOK HARVEY a publiéplusieurs études sur ces questions : voir par exemple « Olfactory Knowing :Signs of Smell in the ‘Vitae’ of Simeon Stylites », dans G.J. REININK,A.C. KLUGKIST, éd., After Bardaisan. Studies on Continuity and Change in Syriac Christianity inHonour of Professor Han J.W.Drijvers, Leuven, 1999, p. 23-34 ; « St Ephrem on theScent of Salvation », Journal of Theological Studies, 49, 1998, p. 109-128. 8 Entre le IIe et le VIe siècles, au moins trente commentaires (treizegrecs, dix-sept latins) ont été écrits sur le seul verset 1,3 du Cantique :oleum effusum nomen tuum (cf. P. MELONI, Il profumo dell’immortalità. L’interpretazionepatristica di Cantico 1,3, Roma, 1975). Sur le Cantique en général pendant l’époquemédiévale, cf. E.A. MATTER, The Voice of my Beloved. The Song of Songs in Western MedievalChristianity, Philadelphia, 1990 ; J.-L. CHRÉTIEN, Symbolique du corps. La traditionchrétienne du ‘Cantique des cantiques’, Paris, 2005.
« Christus, id est unctus9 », et donc de l’usage du chrême10.Cependant, il est indispensable de recourir à d’autresdocuments si l’on veut saisir la manière dont les élémentsdégagés par les théologiens s’articulent avec la pratique,l’action, mais aussi les représentations. C’est principalementdans les sources narratives11 que, entre métaphores ettémoignages, nous pouvons chercher à saisir sinon l’expériencesensorielle des odeurs, du moins un discours qui se présentecomme un récit d’expériences.
À l’époque où se mettent en place les rituels de dédicace enOccident, la plupart des odeurs mentionnées dans des sourcesnarratives sont des odeurs extra-ordinaires, délicieuses, et liéesà des saints, hommes ou femmes12. Ces personnages perçoiventparfois eux-mêmes de prodigieuses odeurs13, et certains d’entreeux sont capables de discerner par l’odorat le statutreligieux d’autres individus14 ; des saints meurent en exhalantun doux parfum15 ; il arrive aussi qu’une fragrancemerveilleuse se dégage, longtemps après leur mort, soit aumoment de la découverte (inventio) de leur corps, soit lors de satranslation (translatio) ou de son élévation (elevatio)16.
Dans de nombreux récits, le contexte des phénomènes olfactifsextraordinaires est, dans un sens large, liturgique : ils seproduisent dans des églises, ou durant un rituel (la messe,par exemple17). C’est par ce biais que ces récits peuvent serévéler utiles pour une recherche portant sur les9 Cf. JÉRÔME, In Marcum homilia X.10 Cf. p.ex. TERTULLIEN, De baptismo, VII, 1. Sur l’imaginaire du chrême dansla culture médiévale, cf. J.-P. ALBERT, Odeurs de sainteté. La mythologie chrétienne desaromates, Paris, 1990. Malgré son titre, l’ouvrage traite bien de l’onctionde chrême, et non des odeurs. 11 Nous utilisons à dessein ce terme général, car les récits qui intéressentl’étude de l’olfaction se trouvent dans des textes ressortissant à diversgenres littéraires (homélies, histoires, Vies de saints, etc.).12 La mauvaise odeur du diable et des pécheurs est nettement moins présentedans les textes que « l’odeur de sainteté », et ce au moins jusqu’àl’époque carolingienne.13 Cf. Vita Eligii, I, 8, éd. B. KRUSCH, dans MGH SRM IV, p. 675.14 Cf. Vitae patrum Iurensium : vita s.Eugendi, 167, éd. F. MARTINE, Paris, SC 1968, p.418. 15 Cf. Vita Guthlaci, 50, éd. B. COLGRAVE, Felix’s Life of Saint Guthlac, Cambridge, 1956,p. 156-160.16 Quelques exemples : EUGIPPE, Vita sancti Severini, 44,6, éd. PH. RÉGERAT, Paris,SC 1991, p. 290 ; GRÉGOIRE DE TOURS, Liber in gloria confessorum, 83, éd. B. KRUSCH,dans MGH SRM I/2, p. 352 ; Vita Eligii, II, 6, cit., p. 699.
consécrations d’églises, et ce d’autant plus si l’on considèreles liens, concrets aussi bien que théologiques etimaginaires, unissant corps saints (reliquiae, corpus, pignora,etc.) et autels/églises.
Toutefois, pour défricher le terrain recouvrant la dimensionolfactive des consécrations d’églises, un texte de Grégoire leGrand (vers 540-604) peut constituer un point de départ plusdirect, car plus explicite sur le sujet. En effet, dans unchapitre de ses Dialogues18, Grégoire relate les prodiges quisont survenus lors de la dédicace d’une église romaine. Cetexte est fréquemment cité19, mais il ne semble pas avoir étéétudié dans la perspective qui nous intéresse ici.
Dans la première partie de ce travail, nous nous pencheronsessentiellement sur le récit de Grégoire le Grand en cherchantà en préciser la portée dans le domaine des odeurs. Dans laseconde partie, nous le confronterons à des sourcesliturgiques concernant la dédicace des églises. Enfin, nouschercherons à en éclairer certains aspects olfactifs à l’aidede quelques récits hagiographiques du haut Moyen Âge.
1. Le récit de Grégoire le Grand
17 Translatio et elevatio constituent eux-mêmes des rituels, qui sont à leur tourcommémorés par des messes (cf. M. HEINZELMANN, Translationsberichte und andere Quellendes Reliquienskultes, Typologie des sources du Moyen Âge occidental 33,Turnhout, 1979 ; É. GRIFFE, « Une Messe du Ve siècle en l’honneur de saintSaturnin de Toulouse », dans Revue du Moyen Âge latin, 7, 1951, p. 5-18).18 L’attribution des Dialogues à Grégoire a été remise en cause depuis unevingtaine d’années par FRANCIS CLARK (cf. The Pseudo-Gregorian Dialogues, Leiden,1987). L’accueil des chercheurs a généralement été réservé. Il n’y a paslieu de débattre de cette question ici ; c’est pourquoi nous continuerons àparler des « Dialogues de Grégoire le Grand ».19 Encore récemment, une étude s’appuie sur lui pour tenter de reconstruirela « réidentification » – effectuée une vingtaine d’années plus tôt – deSant’Apollinare Nuovo à Ravenne, c’est-à-dire la transformation de labasilique arienne en un espace catholique (cf. A. URBANO, « Donation,Dedication, and Damnatio Memoriae : The Catholic Reconciliation of Ravennaand the Church of Sant’Apollinare Nuovo », Journal of Early Christian Studies, 13,2005, p. 71-110. Voir en particulier p. 86-92).
Nous savons par une lettre de Grégoire (datée de 59420) ainsique par la notice que lui consacre le Liber pontificalis21, qu’en 591ou 592 il a procédé à la dédicace pour le culte catholiqued’une ancienne église des Ariens22, située sur le Quirinal, eny déposant des reliques de sainte Agathe et de saintSébastien23. Il s’agit de l’actuelle église Sainte-Agathe (ouSainte-Agathe-des-Goths).
Mais c’est dans ses Dialogues (écrits environ deux ans après ladédicace) que Grégoire relate le plus longuement lesévénements. En effet, selon son récit, le rituel avait étéaccompagné de manifestations prodigieuses, en présence denombreux fidèles. Cela justifie l’insertion de ce chapitredans un ouvrage rédigé dans le but d’attester la présenceactuelle et agissante de Dieu dans l’Italie de l’époque. Cetteprésence bénéfique est d’ailleurs affirmée à la fin du récitpar le diacre Pierre, interlocuteur du pontife :
« Quoique nous nous trouvions dans de grandestribulations, nous ne sommes pas tout à fait négligés parnotre Créateur : ses étonnants miracles que j’entendsl’attestent24 ».
Le contenu du texte que nous allons lire ne peut vraiment secomprendre qu’en lien avec les « grandes tribulations »auxquelles Pierre fait allusion. Il faut donc situer dans leurcontexte historique et les « étonnants miracles » et larédaction des Dialogues. Depuis 568, l’Italie était en bonne20 Cf. Registrum Epistularum, IV, 19, éd. D. NORBERG, dans CC Ser. Lat. 140-140A,Turnhout, 1982, p. 237. La lettre est adressée à un accolyte du nom deLéon, par ailleurs inconnu (cf. Gregorio Magno : Lettere, a cura di V. RECCHIA,Roma, 1996, vol. 2, p. 52).21 Cf. Liber pontificalis, LXVI, éd. L. DUCHESNE, Paris, 1886-1892, vol.1, p. 312.Cette notice consacrée à Grégoire Ier est « de beaucoup la plus ancienne detoutes les vies de saint Grégoire » (ibid. ; note 1). Or, bien que trèssuccincte – 14 lignes dans l’édition citée –, elle mentionne la dédicace del’ecclesia Gothorum, signe que celle-ci était considérée comme un événementd’importance parmi toutes les activités du pontife.22 Une communauté arienne l’avait édifiée, ou occupée, dans le troisièmequart du Ve siècle (cf. J. ZEILLER, « Les églises ariennes de Rome àl’époque de la domination gothique », dans Mélanges d’archéologie et d’histoire del’École française de Rome, 24, 1904, p. 19-23).23 Cf. GRÉGOIRE LE GRAND, Dialogues, III, 30, 2, éd. A. DE VOGÜÉ, Paris, SC 1978-1980, p. 380, ainsi que le commentaire de l’éditeur, p. 380-381, note 2-3. 24 Etsi in magnis sumus tribulationibus positi, quia tamen a conditore nostro non sumus omninodespecti, testantur ea quae audio eius stupenda miracula (ibid., III, 30, 7).
partie occupée par les Lombards, des « Ariens militants25 »,dont le pouvoir s’exerçait de manière violente en de nombreuxendroits, ce que témoignent divers chapitres des Dialogues26.Comme ses prédécesseurs, Grégoire le Grand eut constamment àfaire face à leurs menaces ; et Rome elle-même devaitaccueillir des réfugiés accourus des régions voisines passéessous contrôle lombard. Le conflit avec les Ariens n’était doncpas du tout une affaire du passé ; il était, au contraire,d’une brûlante actualité, et la papauté s’y trouvaitdirectement confrontée27.
Dans la perspective qui nous occupe, on peut dégager du récitde Grégoire deux volets. En voici le premier :
[…] nous décidâmes de consacrer [l’église] dans la foicatholique en y introduisant des reliques du bienheureuxSébastien et de sainte Agathe martyrs. Ce qui fut fait.Venant avec une grande foule de gens et chantant deslouanges au Seigneur tout-puissant, nous entrâmes danscette église. Comme on y célébrait déjà la messesolennelle et que, en raison de l’exiguïté du lieu, lafoule des gens s’entassait, quelques-uns de ceux qui setenaient hors du sanctuaire sentirent (senserunt) soudain unporc entre leurs pieds qui se faufilait ça et là. Pendantque chacun le sentait (sentiret) et prévenait ceux qui setenaient à côté, ce porc gagna les portes de l’église.Chez tous ceux entre lesquels il se glissait, il provoqual’ahurissement, mais il ne put nullement être vu, bienqu’il pût être senti (sentiri). Ceci, la divine bonté lemontra, pour qu’à tous fût ainsi dévoilé que, de ce lieu,l’immonde habitant sortait28.
25 W.D. MCCREADY, Signs of Sanctity. Miracles in the Thought of Gregory the Great, Toronto,1989, p.43.26 Justement, le chapitre précédant celui qui nous intéresse ici relate lesvains efforts des Ariens pour occuper une église catholique ; le récit seconclut par l’affirmation que « les Lombards de la région […] n’osèrentplus dorénavant profaner les lieux catholiques » : […] Langobardi in eademregione positi […] nequaquam ulterius praesumpserunt catholica loca temerare (Dial., III, 29,4, trad. P. ANTIN, p. 378-379).27 Sur les Lombards et les rapports de Grégoire avec eux comme avec d’autrespeuples barbares, cf. P. RICHÉ, L’Europe barbare de 476 à 774, 2e éd., Paris 1989 ;p. 107-115, et p. 119-134. Le témoignage des Dialogues sur ce point estétudié par W.D. MCCREADY, cit., p. 42-46.
Pendant deux nuits, l’église fut encore le théâtre de bruitsterrifiants, signes, pour Grégoire, que « le vieil ennemi »(antiquus hostis) ne s’en allait que sous la contrainte29.
On remarque que Grégoire ne raconte presque rien du rituel dela dédicace : il mentionne simplement, et sans les détailler,l’introduction des reliques des martyrs, une procession, deschants, et la messe. Sans nous attarder sur ces points,soulevons dès à présent la question de l’existence d’unedimension olfactive dans le passage cité.
Nous avons signalé dans la transcription de ce passage latriple répétition du verbe sentire, un mot manifestementimportant pour Grégoire. Mais cette mise en évidence doitaussi nous inciter à nous demander comment les fidèles –certains d’entre eux seulement30 – « sentent » le porc mis enfuite, puisque celui-ci est invisible. Notons par ailleurs quele pontife, quoique présent, semble n’avoir en rien perçul’animal, sans doute parce que lui-même se trouvait dans lesacrarium31.
Le porc représente évidemment aussi bien le diable que lesAriens, hérétiques voués à la damnation. En lien avec cettereprésentation, mentionnons que de nombreux auteurs chrétiensde l’Antiquité et du Moyen Âge reprennent l’information de
28 […] placuit ut in fide catholica, introductis illic beati Sebastiani et sanctae Agathae martyrumreliquiis, dedicari debuisset. Quod factum est. Nam cum magna populi multitudine venientes atqueomnipotenti Domino laudes canentes, eandem ecclesiam ingressi sumus. Cumque in ea iammissarum sollemnia celebrarentur et prae eiusdem loci angustia populi se turba conprimeret, quidamex his qui extra sacrarium stabant, porcum subito intra suos pedes huc illucque discurrere senserunt.Quem dum unusquisque sentiret et iuxta se stantibus indicaret, isdem porcus ecclesiae ianuas petiit etomnes per quos transiit in admirationem conmovit, sed videri nil potuit, quamvis sentiri potuisset.Quod idcirco divina pietas ostendit, ut cunctis patesceret, quia de loco eodem inmundus habitatorexiret (Dial., III, 30, 2-3, cit., p. 380. Nous modifions quelque peu la trad.publiée par P. ANTIN dans cette même édition).29 Cf. ibid., III, 30, 4, p. 380-382.30 […] quidam ex his qui extra sacrarium stabant (ibid., III, 30, 3, p. 380). Grégoireannonce par ailleurs que les prodiges qu’il rapporte ici ont été constatéspar différentes catégories de personnes : Ex his quippe quae narro, aliud populusagnovit, alia autem sacerdos et custodes ecclesiae se audisse, se vidisse testantur (ibid., III, 30,1, p. 378). Sur ces divers témoins, voir les observations de S. BOESCHGAJANO, « Dislivelli culturali e mediazioni ecclesiastiche nei ‘Dialogi’ diGregorio Magno », Quaderni storici, 41, 1979, p. 400 et 412, note 24.31 On le déduit par sa mention que le porc a été « senti » seulement par desfidèles qui se trouvaient extra sacrarium (cf. J.M. PETERSEN, The ‘Dialogues’ ofGregory the Great in their Late Antique Cultural Background, Toronto, 1984, p. 15).
Rufin voulant qu’Arius lui-même ait subi une mort honteuse,dans la puanteur de ses propres excréments32. On considérait,par conséquent, que les hérétiques étaient destinés au mêmegenre de châtiment ou dégageaient des odeurs fétides33.
Dans son commentaire à l’édition des Sources chrétiennes,A. de Vogüé indique que sentire se réfère ici au toucher34. C’esten soi une interprétation tout à fait plausible, car le verbesentire est polysémique et concerne également diversesperceptions sensorielles, dont celle du toucher35. Mais sonemploi dans ce texte ne désignerait-il pas plutôt, ou aussi,la perception olfactive ? « Sentir une odeur » est en effetune autre acception, dans le domaine sensoriel, de sentire –mêmesi ce n’est, semble-t-il, qu’au IXe siècle qu’elle deviendra32 RUFIN D’AQUILÉE, Hist.eccl., X, 14. Sur ce texte, cf. P.R. AMIDON (transl.), The‘Church History’ of Rufinus of Aquileia : Books 10 and 11, New York-Oxford, 1997, p. 25-26et p. 50, note 25. Sur la pensée de Grégoire au sujet des hérésies et deshérétiques, voir C. MORESCHINI, « Gregorio Magno e le eresie », dans Grégoire leGrand, Actes du colloque international, Chantilly 15-19 septembre 1982, éd.J. FONTAINE, R. GILLET, S. PELLISTRANDI, Paris, 1986, p. 337-346. Entre le VIeet le VIIIe siècles en Occident, la mort d’Arius est citée, entre autres,dans : GRÉGOIRE DE TOURS, Hist., II, 23, éd. B. KRUSCH, W. LEVISON, dans MGH SRMI/1, p. 68 ; BAUDONIVIE, Vita sanctae Radegundis, 7, éd. B. KRUSCH, MGH SRM II, p.382 ; Vita Filiberti abbatis Gemeticensis et Heriensis, 4, éd. W. LEVISON, MGH SRM V, p.586-587.33 C’est la raison de la puanteur perçue par saint Pachôme chez desanachorètes de passage : coepit sanctus odorem sentire teterrimum. Videbat enim eos excultosatis uti sermone et in Scripturis sanctis paratos exsistere, nec poterat de intolerantia foetoris aliquidvel cogitare vel dicere (DENYS LE PETIT, Vita sancti Pachomii, 44 ; éd. H. VAN CRANENBURGH,La vie latine de saint Pachôme traduite du grec par Denys le Petit, Bruxelles, 1969, p. 194).Une conception identique se lit chez Jean Moschus, qui écrit à Rome, audébut du VIIe siècle (cf. JEAN MOSCHUS, Le Pré spirituel, 106). Voir égalementGRÉGOIRE DE TOURS, Hist., II, 2.34 Cf. A. DE VOGÜÉ, cit., p.381, note 4. Implicitement, de Vogüé exclut aussique le porc soit entendu : le diable ne se ferait donc entendre qu’àtravers le fracas causé les nuits suivantes.35 La traduction de P. Antin dans le même ouvrage, en recourant au verbefrançais « sentir », parvient à conserver une partie de la polysémie duverbe latin. Sur ce dernier, on consultera la thèse de P. MORILLON, ‘Sentire’,‘sensus’, ‘sententia’. Recherche sur le vocabulaire de la vie intellectuelle, affective et physiologique enlatin, Lille, 1974. Voir aussi la rubrique « Sentio » dans E. FORCELLINI etal., Lexicon totius latinitatis, Padova, 1864-1887 ; A. BLAISE, Dictionnaire latin-françaisdes auteurs chrétiens, Turnhout, 1954. On peut également comparer le cas duverbe « sapere, sapio », dont les acceptions portent aussi bien sur le goûtet sa perception que sur la sagesse ou la connaissance : sur son emploidans la théologie patristique de l’union mystique, cf. L. DUPRÉ, « TheChristian Experience of Mystical Union », dans The Journal of Religion, 69, 1989,p. 1.
prépondérante36. L’image traditionnelle du porc, animal sale etnauséabond, symbole de l’impur dans la Bible et dans la Romepaïenne37, laisse penser que l’odorat des fidèles réunis pour ladédicace peut fort bien en être affecté. Certes, cela n’exclutpas que le porc soit « senti » au toucher38, ou même que sesgrognements soient « entendus » (autre acception de sentire).Pour vérifier l’existence d’associations entre « porc » et« odeur (mauvaise) », il faut nous tourner vers un autretexte, comparable à celui de Grégoire le Grand, mais antérieurd’un siècle.
Vers 488/489, Victor de Vita39 rédigeait son Histoire de lapersécution vandale en Afrique. Il y décrit des événements auxquels ila assisté quelques années auparavant à Carthage (en 481/48240).
[…] avant même la tempête de la persécution, le malheurqui nous menaçait avait été annoncé par de nombreuxsignes précurseurs et de multiples visions. Car, deux ansà peu près avant qu’elle ne survînt, quelqu’un vitl’église de Faustus dans l’éclat de sa parure habituelle,resplendissante des cierges allumés, des tentures qui larevêtaient et des flambeaux. Et tandis qu’il seréjouissait de l’éblouissement d’une telle lumière, toutà coup, dit-il, l’éclat de cette lumière si attirantes’éteignit et, au milieu des ténèbres qui luisuccédèrent, une odeur répugnante frappa ses narines ; ettoute la foule des bienheureux fut chassée dehors par desÉthiopiens qui la poussaient, et ils se lamentaient sansdiscontinuer à la pensée de ne plus jamais revoir leuréglise dans sa splendeur primitive ; cette vision, il larapporta au vénérable Eugenius en notre présence. Un
36 Cf. H.F. MULLER, L’époque mérovingienne. Essai de synthèse de philologie et d’histoire, NewYork, 1945, p. 253.37 Cf. « Porc », dans X. LÉON-DUFOUR, Dictionnaire du Nouveau Testament¸ 2e éd.rev., Paris, 1975. J.M. PETERSEN fait remarquer que, dans la religionromaine païenne, un porc était sacrifié dans des sacrifices de purification(cf. The ‘Dialogues’ of Gregory the Great, cit., p. 52). On notera que Grégoireassocie ensuite au porc diabolique l’adjectif immundus, qui exprime la mêmeconception.38 Le texte précise d’ailleurs que les fidèles « sentent » le porc intra suospedes.39 Sur Victor de Vita, cf. S. LANCEL (éd., trad., comm.), Victor de Vita : Histoire dela persécution vandale en Afrique, Paris 2002.40 Cf. ibid., p. 130. Chronologie quelque peu différente dans S. COSTANZA,« Victor de Vita », dans A. DI BERARDINO (dir.), adaptation française F.VIAL(dir.), Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien, vol.2, Paris, 1990.
prêtre vit aussi cette même basilique de Faustus pleined’une foule innombrable de fidèles, et peu de temps aprèsvidée de ceux-ci et remplie d’une multitude de porcs etde chèvres41.
Dans ces visions dramatiques annonciatrices de la persécutiondes Ariens à Carthage, on lit le déroulement inverse desévénements narrés par Grégoire le Grand à Rome. Dans l’Histoirede Victor de Vita, la basilique de Faustus passe de la lumièreaux ténèbres, de la présence des « bienheureux » àl’occupation par des « Éthiopiens », des foules de fidèles auxtroupeaux de porcs et de chèvres. Dans les ténèbresremplissant l’église, un adversarius… fetor se répand. Si l’onconsidère globalement ce texte, on voit donc que les signesdiaboliques comprennent cette puanteur tout autant que lesporcs, bien que les deux éléments ne soient pas directementliés (ils se trouvent dans deux visions distinctes).
À la lecture de l’Histoire de Victor de Vita, il semble hautementprobable que, lorsque Grégoire le Grand emploie dans son récitle verbe sentire à propos du porc invisible mis en fuite,l’élément foetor est également – sinon exclusivement – évoquépar sa description. À l’appui de cette hypothèse, on sesouviendra de la triple répétition du verbe sentire : ne faut-ilpas y voir l’intention de désigner la succession deperceptions différentes : le toucher, l’olfaction, peut-êtrel’ouïe ? Ainsi, il paraît raisonnable d’avancer dès maintenantque la dimension olfactive est présente – certes, commeexpérience négative – dès le début du récit de Grégoire.
Cette interprétation est rendue encore plus plausible par lasuite de son récit :
Quelques jours après, dans un ciel parfaitement serein,une nuée descendit du ciel sur l’autel de cette église,
41 Ante persecutionis tamen tempestatem multis praeeuntibus visionibus et signis inminensdemonstratum fuerat malum. Nam ferme ante biennium quam fieret, vidit quidam Fausti ecclesiamsolito in ornatu fulgentem, cereis quoque fulgentibus palleisque velaminum ac lampadibusrutilantem ; et dum laetaretur tanti fulgoris candore, subito, ait, luminis illius concupiscibilis extinctusest fulgor ac tenebris succedentibus adversarius naribus natus est fetor ; omnisque illa beatorumturba expellentibus quibusdam Aethiopibus minata est foras, ob hoc iugiter lamentantum quod eamin claritate pristina nequaquam viderit iterum restitutam. Nam visionem istam nobis praesentibussancto rettulit Eugenio. Vidit et quidam presbyter ipsam Fausti refertam turbis innumerabiliumpopulorum et post paululum evacuatam et repletam porcorum multitudine atque caprarum (VICTORDE VITA, cit., II, 6, p.129-130).
le couvrit de son voile, et remplit toute l’église d’uneatmosphère de terreur si grande ainsi que d’un parfum sisuave que, les portes étant ouvertes, personne n’osait yentrer ; et le prêtre et les gardiens, et ceux quiétaient venus célébrer la messe, voyaient la chose [mais]ne pouvaient pas du tout entrer, et ils respiraient lasuavité du merveilleux parfum42.
En outre, les jours suivants, les lampes de l’églises’allument plusieurs fois « grâce à une lumière envoyée deDieu43 », montrant ainsi que « ce lieu était passé des ténèbresà la lumière44 ».
Ce second volet du récit décrit une véritable théophanie :après avoir expulsé le diable de l’ancienne basilique desAriens, Dieu lui-même manifeste qu’Il en prend possession et yinstalle sa demeure. C’est d’ailleurs l’objet de la prière dela dédicace conservée dans le Sacramentaire grégorien :
Domum tuam quaesumus domine clementer ingredere et in tuorum tibi cordafidelium perpetuam constitue mansionem45...
Certes, dans le passage des Dialogues, Dieu n’est pasexplicitement nommé, mais le sens du texte est sans équivoque,comme le prouve le commentaire conclusif du diacre Pierre :
[…] nous ne sommes pas tout à fait négligés par notreCréateur : ses étonnants miracles que j’entendsl’attestent46.
42 Post paucos vero dies in magna serenitate aeris super altare eiusdem ecclesiae nubes caelitusdescendit, suoque illud velamine operuit, omnemque ecclesiam tanto terrore ac suavitate odorisreplevit, ut patentibus ianuis nullus illic praesumeret intrare, et sacerdos atque custodes, vel hi qui adcelebranda missarum sollemnia venerant, rem videbant, ingredi minime poterant, et suavitatemmirifici odoris trahebant (Dial., III, 30, 5, cit., p. 382). 43 […] emisso divinitus lumine (ibid., III, 30, 6, p. 382).44 […] quia locus ille de tenebris ad lucem venisset (ibid.). 45 Le sacramentaire grégorien (Hadrianum), 195, éd. J. DESHUSSES, Fribourg, 1971,vol.1, p. 303. L’ouvrage est daté de la 2e moitié du VIIe s., mais ilcomprend de nombreuses pièces bien plus anciennes, dont certaines précèdentmême le pontificat de Grégoire (cf. J. DESHUSSES, « Grégoire et lesacramentaire grégorien », dans Grégoire le Grand, cit., p. 637-644).46 Etsi in magnis sumus tribulationibus positi, quia tamen a conditore nostro non sumus omninodespecti, testantur ea quae audio eius stupenda miracula (Dial., III, 30, 7, cit., p.382).
On reconnaît également dans le texte de Grégoire des élémentsdes théophanies bibliques : en premier lieu, celui de lanuée47. On peut ainsi confronter, par exemple, cette page desDialogues à un passage du premier Livre des Rois48 :
Or, lorsque les prêtres furent sortis du lieu saint, lanuée remplit la Maison du SEIGNEUR et les prêtres nepouvaient pas s’y tenir pour leur service à cause decette nuée, car la gloire du SEIGNEUR remplissait laMaison du SEIGNEUR49.
La « terreur » mentionnée par Grégoire est un autre aspect desthéophanies bibliques50. Associée ici à la venue de la nubesdans l’église, elle est la réaction typique de l’hommeconfronté à la manifestation du divin ou du sacré, mysteriumtremendum et fascinans51.
Point remarquable pour notre propos, cette nuée est odorante :elle remplit l’église d’un suave parfum. Dans le mondeméditerranéen et dans l’Orient anciens, les parfums étaientessentiellement liés au monde divin52. Il en allait de même
47 Cf. « Nuée », in X. LÉON-DUFOUR, cit. 48 Il était tentant de vouloir comparer le récit de Grégoire le Grand aucommentaire sur I Regum qui lui était traditionnellement attribué. Or cetteattribution a été remise en question par A. de Vogüé, alors même qu’ilpubliait le troisième tome de ce gros ouvrage pour les Sources chrétiennes(1998) : ce commentaire, quoique imprégné de la pensée et du stylegrégoriens, serait en fait de la main de Pierre de Cava, un moine italiendu XIIe siècle. Nous renonçons donc à poursuivre l’analyse dans cettedirection (cf. GRÉGOIRE LE GRAND, Commentaire sur le premier livre des Rois, éd.,intro., trad., notes A. DE VOGÜÉ, Paris, SC 1989-2004).49 1 R 8, 10-11 (Traduction œcuménique de la Bible, désormais TOB, Paris, 1988).Voir aussi 2 Ch 5, 13-14 ; 7, 1-3.50 On ne soulignera jamais trop à quel point l’Écriture sainte imprègne lapensée et l’expression de Grégoire, y compris dans la rédaction des Dialogues(cf. J.M. PETERSEN, The ‘Dialogues’ of Gregory the Great, cit., p. 25-55). « Gregorylived in an expanding Bible » (W.D. MCCREADY, Signs of Sanctity, cit., p. 243).Voir également l’ensemble de l’ouvrage de C. DAGENS, Saint Grégoire le Grand.Culture et expérience chrétiennes, Paris, 1977.51 C’est sous ce double aspect que se manifeste fondamentalement le sacré,selon l’ouvrage classique de R. OTTO, Le Sacré (Das Heilige, 1917). Sur le sacréet ses interprétations, particulièrement en rapport avec la liturgie, voirl’article de A.N. TERRIN, « Sacré », dans D. SARTORE, A.M. TRIACCA, dir.,Dictionnaire encyclopédique de la Liturgie, adaptation française dirigée parH. DELHOUGNE, Turnhout, 1992 et 2002 (désormais DEL), vol.2, p. 338-346. 52 Nous en avons une étude exemplaire dans l’ouvrage de M. DÉTIENNE, Les jardinsd’Adonis, cit. Sur les emplois d’aromates dans l’Antiquité en général, cf.
dans la culture biblique, où les aromates étaient utilisésdans le culte sous forme d’encensements ou d’onctions53. Lalittérature patristique a elle-même approfondi, mais aussirépandu, les associations faites entre Dieu et les bonnesodeurs, surtout entre le Christ et le parfum divin :
Il vint imprégné d’onguents : il ne pouvait venir d’uneautre manière à son Épouse, et il ne convenait pas nonplus que le Père envoyât d’une autre manière le Fils àses noces. Il l’oignit d’onguents variés, il le fitChrist. Celui-ci vint en exhalant des parfums divers54…
Les Pères reprirent également à leur compte lesreprésentations du Paradis comme terre des aromates55.
C’est donc aussi en raison de son parfum suave que la nuéedécrite dans les Dialogues constituait une manifestation divine,une théophanie56.
Si l’on considère à présent la totalité du récit de Grégoirele Grand, on observe une nette opposition entre le statut del’ancienne église des Ariens avant et après la dédicace in fide
P. FAURE, Parfums et aromates de l’Antiquité, Paris, 1987.53 Cf. É. COTHENET, « Parfums », Dictionnaire de la Bible, 6, 1291-1331, Paris,1960 ; E. FEHRENBACH, « Encens », DACL, 5, 2-21, Paris, 1922 ; C. HOUTMAN, « Onthe Function of the Holy Incense (Exodus XXX 34-8) and the Sacred AnointingOil (Exodus XXX 22-33) », dans Vetus Testamentum, 42, 1992, p. 458-465.54 Venit delibutus « unguentis » nec aliter ad sponsam poterat venire nec decebat aliter patrem adnuptias filium destinare. Variis eum unxit unguentis, fecit illum Christum. Venit diversis odoribusspirans… (ORIGÈNE, Homélies sur le Cantique des Cantiques, I, 3, intro., trad., notesO. ROUSSEAU, Paris, SC 1954, p. 66).55 Cf. J. BURTON RUSSELL, A History of Heaven. The Singing Silence, Princeton, 1997 ;J. DELUMEAU, Une histoire du paradis. T.I :Le jardin des délices, Paris, 1992 ; J.-P. ALBERT,cit., passim.56 On notera que la suavitas de l’odeur de la nuée fait contraste avec le terrorqu’elle inspire : si les fidèles n’osent entrer dans l’église, ilsrespirent certainement avec plaisir la suavitatem mirifici odoris. On pourraitinterpréter cette odeur comme le deuxième terme du mysterium tremendum etfascinans évoqué plus haut. Dans un autre chapitre des Dialogues, c’est leparfum miraculeux qui a pour fonction d’apaiser et de consoler les espritsterrorisés par une prodigieuse lumière (cf. Dial., IV, 16, 1-7, cit., vol.3,p. 62-68). Quant à l’association de la fragrantia à la présence divine – duChrist en l’occurrence –, elle est avancée par Grégoire dans un ultérieurrécit de sainte mort (cf. Dial., IV, 17, 2, cit., p. 68-70). Des parfumsextraordinaires, tous liés à la mort, sont encore rapportés dans Dial., IV,15, 1-5 ; 16, 1-7 ; 28, 1-5 ; 37, 7-10 ; 49, 4-5. Certains de ces récits setrouvent également dans les Homélies sur l’Évangile.
catholica – ce qu’illustre la structure bipartite de la narration.Dans cette perspective, le suave parfum envahissant labasilique après la dédicace se substitue symboliquement àl’odeur diabolique qui, sans doute, y régnait auparavant57 –d’autres indices le confirmeront.
2. Le récit de Grégoire et le rituel de la dédicace
Comme on l’a vu, les événements extraordinaires décrits parGrégoire ont pour contexte immédiat le rituel de la dédicacede la basilique, la théophanie sous forme d’une nuée odoranteintervient « quelques jours après » celle-ci. Mais est-ilpossible d’articuler plus clairement cette manifestationprodigieuse avec les rites de consécration58 ? Pour répondre àcette question, il nous faut revenir sur différents points durécit, et ce toujours dans la perspective des odeurs et del’olfaction.
On peut lire le déroulement du rituel de dédicace dans l’Ordoromanus 42, certainement composé et utilisé d’abord à Rome. Lesrites que cet ordo décrit sont les suivants : l’autel étaitlustré d’eau bénite ; les reliques y étaient déposées dans unecavité (confessio) avec trois fragments d’hostie consacrée ettrois grains d’encens59 ; la « confession » était scellée etdes onctions étaient effectuées sur elle et sur l’autel ; cedernier recevait ensuite la velatio ; l’église était alors57 Notons que, à la même époque, dans les sources gallicanes ou espagnoles,le rite d’admission dans l’Église catholique des hérétiques convertis necomporte pas un nouveau baptême, mais exige en revanche de conférerl’onction de chrême : pour l’individu aussi, le parfum de la foi catholiquese substitue, implicitement au moins, à l’odeur de l’hérésie (cf. GRÉGOIRE DETOURS, Hist., IX, 15 ; ILDEFONSE DE TOLÈDE, De cognitione baptismi, 121 ;L.L. MITCHELL, Baptismal Anointing, London, 1966, p. 121 sq. ; L. DUCHESNE, Originesdu culte chrétien. Étude sur la liturgie latine avant Charlemagne, 5e éd. rev. et augm.,Paris, 1920, p. 359-360, note 4).58 Pour une présentation synthétique du rituel de dédicace jusqu’à nosjours, cf. P. JOUNEL, « Dédicace des églises et des autels », DEL, vol.1, p.261-271.59 Ils représentaient les aromates employés dans la sépulture. Sur lecaractère funéraire de cet Ordo, cf. M. ANDRIEU, Les ‘Ordines romani’ du haut MoyenÂge, Louvain-Paris, 1931-1961, vol. 4, p. 373-374, 387-389, 392 ;L. DUCHESNE, Origines du culte chrétien, cit., p. 427-428.
aspergée d’eau bénite ; enfin, la messe y était célébréependant huit jours d’affilée60. Certes, les rites ainsi décritsne se sont fixés que vers le début ou le milieu du VIIIesiècle61. Néanmoins, en dehors d’un certain développement durituel – manifeste surtout dans la consécration de l’autel –,l’Ordo romanus 42 s’inscrit à l’évidence dans une traditionproprement romaine : selon M. Andrieu, « il est bien dans laligne du rituel qui apparaît encore embryonnaire dans leslettres des papes du VIe siècle. On n’y peut déceler aucuntrait spécifiquement gallican62 ». En outre, il s’accorde avecles éléments de la messe de dédicace contenue dans leSacramentaire grégorien63, datable de la première moitié duVIIe siècle. En dépit, donc, de sa rédaction nettement plustardive, il s’agit d’un document que nous pouvons, avec desprécautions, confronter avec le texte des Dialogues.
Dans son récit, Grégoire mentionne en premier lieul’introduction dans la basilique des reliques des martyrs.Dans l’Église romaine, c’était là le cœur du rituel dedédicace : il suffit de se rapporter aux éléments cités dansOR 42 ; l’importance de la déposition des reliques est aussiindiquée, par exemple, par les oraisons du Sacramentairegrégorien64. Sur ce point, les deux sources concordent sansambiguïté.
Outre la déposition des reliques, le récit de Grégoire faitsans doute allusion à un rite d’exorcisme quand il décrit leporc démoniaque chassé de l’église – peut-être songe-t-il à
60 Cf. OR 42, 1-20, dans M. ANDRIEU, Les ‘Ordines romani’, cit., p. 395-402.61 Cf. M. ANDRIEU, ibid., p. 393-394. C’est vers 610, peu d’années après lamort de Grégoire le Grand, que fut fixé le formulaire romain pour la messede la dédicace (cf. P. JOUNEL, « Dédicace… », cit., p. 263). Notons que laplus ancienne description du rituel byzantin de la dédicace est elle aussirelativement tardive, puisqu’elle se trouve dans l’Euchologe Barberini, daté duVIIIe siècle (cf. ibid., p. 264).62 Les ‘Ordines romani’, cit., p. 393.63 Cf. ibid., p. 385.64 Cf. Le sacramentaire grégorien, 194 (« Orationes quando levantur reliquiae »), éd. J.DESHUSSES, cit., p. 303.Voir aussi P. DE PUNIET, « Dédicace des églises »,DACL, 4, 391, Paris, 1921 ; L. DUCHESNE, Origines du culte chrétien, cit., p. 426-428. Sur les sacramentaires et les autres livresliturgiques, voir É. PALAZZO, Histoire des livres liturgiques. Le Moyen Âge, des origines auXIIIe siècle, Paris, 1993.
l’exorcisme effectué lors du baptême, le rituel par excellencede la transformation65. Dans le cas de Sainte-Agathe, ce riteétait d’autant plus nécessaire que l’église avait d’abord étéoccupée par les hérétiques. Grégoire lui-même le recommandedans une de ses lettres, à propos de la consécration destemples païens pour le culte chrétien66.
Or l’Ordo 42 mentionne également un exorcisme, sous la formed’aspersion d’eau bénite. Celle-ci était préparée par l’évêqueau début du rituel de dédicace67. La prière d’exorcisme del’eau est des plus intéressantes, car voici en quels termeselle indique l’esprit mauvais que l’eau bénite devra chasserdes divers lieux : […] non illic resedeat spiritus pestilens, non auracorrumpens…68. L’eau bénite est donc utilisée pour expulser de
65 Cf. A. URBANO, « Donation, Dedication, and Damnatio Memoriae », cit., p. 90.Il est aussi possible que l’on se trouve ici devant des images remontantaux temps païens : nous avons mentionné que des porcs y étaient sacrifiéslors de rites de purification. De telles images ont pu se représenter auxfidèles présents, ou du moins marquer le récit des informateurs de Grégoire(cf. J.M. PETERSEN, The ‘Dialogues’ of Gregory the Great, cit., p. 52). Cependant,J.M. PETERSEN ne fait pas le rapport avec le rite chrétien de l’exorcismedans la dédicace. De plus, elle relie la fuite du porc à l’entrée desreliques dans l’église ; or le texte ne semble établir nulle part ce lien,et indique au contraire : Cumque in ea [=ecclesia] iam missarum sollemnia celebrarentur…(Dial., III, 30, 3, cit., p. 380).66 Aqua benedicta fiat, in eisdem fanis aspargatur, altaria construantur, reliquiae ponantur, quia, sifana eadem bene constructa sunt, necesse est ut a cultu daemonum in obsequio veri Dei debeantcommutari… (Registrum Epistularum, XI, 56, éd. D. NORBERG, cit., p. 961. Lalettre, datée de 601, est adressée à l’abbé Mellitus en route pourl’Angleterre).67 Il est toutefois probable que le rite de l’aspersion d’eau bénite indiquédans cet Ordo ne remonte pas jusqu’au pontificat de Grégoire le Grand (cf.M. ANDRIEU, Les ‘Ordines romani’, cit., p. 392). 68 Cf. OR 42, 4, p. 399. Elle est reprise telle quelle dans les additions auSacramentaire grégorien (cf. Le sacramentaire grégorien, 207, éd. J. DESHUSSES,cit., p. 337), et dans le Sacramentaire de Gellone (fin VIIIe) : Libersacramentorum Gellonensis, 2416, éd. A. DUMAS, dans CC Ser. Lat., 159, Turnhout,1981, p. 360. L’oraison fait écho à des notions médicales généralisées dansl’Antiquité (cf. M.D. GRMEK, « Les vicissitudes des notions d’infection, decontagion et de germe dans la médecine antique », dans G. SABBAH, éd.,Mémoires V. Textes médicaux latins antiques, Saint-Étienne, 1984, p. 53-70). Pourl’emploi de ces notions par un écrivain chrétien de l’Antiquité, cf.D. GROUT-GERLETTI, « Le vocabulaire de la contagion chez l’évêque Cyprien deCarthage (249-258) : de l’idée à l’utilisation », dans Maladie et maladies dansles textes latins antiques et médiévaux, Actes du colloque international « Textesmédicaux latins », Bruxelles 1995, éd. C. DEROUX, Bruxelles, 1998, p. 228-246.
l’église la pollution et la puanteur démoniaques69. Cet élémentsemble confirmer les analyses proposées plus haut au sujet del’odeur du mystérieux porc : pour les fidèles assistant auxdifférents rites de la dédicace de Sainte-Agathe, le porc« senti » devait incarner la présence et le départ du spirituspestilens mentionné dans la prière d’exorcisme ; c’était donc(aussi) son odeur nauséabonde qui était « sentie ». Sur unautre plan, on constate qu’à travers les paroles et les gestesde l’exorcisme, on retrouve dans le rituel de la dédicacel’opposition entre la condition hérétique (diabolique) et lacondition catholique (divine) de l’église – ce que les Dialoguesexpriment de manière narrative70.
Si nous passons à la description de la nuée qui descendit surl’autel et « le couvrit de son voile » (suoque illud velamineoperuit), nous pouvons peut-être y discerner un autre rite de ladédicace, celui de la velatio de l’autel : Et tunc velat altare, portel’Ordo 4271 – notons le vocabulaire commun. Et l’Ordo transcritde la manière suivante l’oraison devant accompagner la velatio :
Descendat, quaesumus, domine Deus noster, spiritus sanctus tuus super hocaltare, qui et populi tui dona sanctificet et sumentium corda emundet72.
La « descente » de l’Esprit Saint implorée dans cette prièren’est-elle pas évoquée, dans le texte des Dialogues, par « lanuée qui descendit du ciel sur l’autel » de la basilique ?Outre les formulations analogues, cette hypothèse s’appuie surle fait que la nuée en question est parfumée. Or, selon desécrits patristiques, l’Esprit Saint est aussi parfumé –Grégoire lui-même l’atteste dans d’autres ouvrages73. En toutcas, comme nous l’avons déjà vu, il n’y a aucun doute que lanuée odorante est le signe de la présence divine qui prend
69 Même si l’Ordo 42 a dans l’ensemble le caractère funéraire d’uneinhumation de corps saints, cet exorcisme, ajouté au « baptême » et à la« confirmation » de l’autel, n’est pas sans évoquer les rites del’initiation chrétienne (cf. M. ANDRIEU, Les ‘Ordines romani’, cit., p.393).70 Une observation analogue est faite par C.D. FONSECA, « La dedicazione dichiese e altari tra paradigmi ideologici e strutture istituzionali », dansSanti e demoni nell’alto medioevo occidentale, Settimane di studio…, 36 (Spoleto,1988), Spoleto, 1989, p. 939-940.71 Cf. OR 42, 16, cit., p. 401.72 Ibid. La même « oratio post velandum altare » se trouve dans le Sacramentairegrégorien (éd. J. DESHUSSES, cit., 196, p. 304).73 Cf. In Cant., XIV ; Moralia, IX, 17.
possession de l’église : la nature impalpable et quasiimmatérielle du phénomène peut bien évoquer le spiritum sanctum74.
Dans le texte des Dialogues, le lien entre cette théophanie etla liturgie apparaît encore dans la manière dont l’autel estmis en évidence : super altare eiusdem ecclesiae nubes caelitus descendit,suoque illud velamine operuit. Or « l’autel est, par le rôle qu’iljoue dans la célébration de la liturgie, la partie la plusimportante de l’église ; c’est vers lui que convergent tousles regards durant le sacrifice même lorsque des voiles lecachent à la vue des fidèles75 ». La centralité de l’autel estd’autant plus manifeste que, pendant longtemps, saconsécration était suffisante pour que l’église entière fûtconsacrée76 – de même que la célébration de l’Eucharistiesuffisait à consacrer l’autel en l’absence de reliques77. Onnotera d’ailleurs que, dans le récit de Grégoire, c’estjustement vers l’autel enveloppé dans la nuée qu’est dirigéel’attention des présents.
74 Notons en outre que, dans la langue classique, spiritus peut aussi indiquerune exhalaison, une odeur (cf. P. FLOBERT (dir.), Le Grand Gaffiot. Dictionnaire latin-français, nlle éd. rev. et aug., Paris, 2000). Voici un exemple del’association entre « esprit » et « parfum » (onction parfumée) chez saintAmbroise : […] cum ipse Filius Dei dicat : ‘Spiritus domini super me, propter quod unxit me’,spiritale signat unguentum. Ergo unguentum Christi est Spiritus (AMBROISE DE MILAN, De Spiritusancto, I, 103, PL 16, 759).75 P. DE PUNIET, « Dédicace des églises », cit., col. 380. Selon l’Ordoromanus 41, composé dans le troisième quart du VIIIe siècle en pays deliturgie gallicane, un voile est tendu entre les ministres et le peuple aumoment où la déposition des reliques dans l’autel est effectuée avec desencensements : faut-il voir dans cette pratique une signification analogueà celle de la nuée dans les Dialogues, c’est-à-dire la délimitation visuelleet olfactive d’un espace sacré autour de l’autel et de ses reliques ? (cf.OR 41, 29, éd. M. ANDRIEU, Les ‘Ordines romani’, cit., p. 347). C.D. FONSECA voitdans cette rubrique de l’OR 41 une évocation du voile du sanctuairementionné dans Lv 4, 6 (cf. « La dedicazione di chiese e altari », cit., p.937). Dans la liturgie byzantine, un voile cache l’autel jusqu’au moment oùles catéchumènes et les non-communiants sont sortis ; alors seulementcommence la célébration des mystères (cf. L. DUCHESNE, Origines du culte chrétien,cit. p. 87).76 Les sources liturgiques montrent que, à Rome, c’était encore le cas auVIIIe s. (cf. P. DE PUNIET, « Dédicace des églises », cit., col. 387-388).77 Doctrine exprimée dans le plus ancien document de l’usage romain au sujetdes dédicaces : une lettre écrite en 538 par le pape Vigile à Profuturus deBraga (cf. ibid., col. 381 ; L. DUCHESNE, Origines du culte chrétien, cit., p. 424-425).
De plus, l’autel n’est pas seulement le centre symbolique del’église, mais aussi le lieu où, dans les Dialogues, descenditla nuée « qui remplit toute l’église […] d’un parfum si suave… ».Cela nous rappelle que, dans les rituels de dédicace, l’autelfaisait l’objet d’onctions parfumées et d’encensements. Il estvrai que ces usages furent introduits à Rome plus tardivementqu’en Orient, en Gaule ou en Espagne : l’Ordo 42 est le premiertémoin des onctions de l’autel78 ; et l’encensement de cedernier, mentionné dans l’Ordo romanus 41 (composé en paysfrancs vers 750-77579), ne sera sans doute adopté de laliturgie gallicane qu’au cours du IXe siècle80. Cependant,Grégoire le Grand n’ignorait certainement pas que, à sonépoque, d’autres Églises pratiquaient depuis longtempsl’onction de l’autel lors de la dédicace81, ainsi que sonencensement abondant82. Rappelons seulement que, avant son
78 Cf. M. ANDRIEU, Les ‘Ordines romani’, cit., p. 324, 386-387.79 Cf. ibid., p. 336. Rédigée en 743-750, la Vie de saint Hubert de Liège faitmention de l’encensement de l’autel lors de la messe de dédicace d’uneéglise (cf. Vita Hugberti episcopi Traiectensis, 11, éd. W. LEVISON, dans MGH SRM VI,p. 489).80 C’est d’abord dans les rites de dédicace que l’encensement s’introduiradans la liturgie romaine, avant d’être adopté lors des messes solennelles,probablement dans le courant du IXe siècle (cf. R. LESAGE, « Encensement »,dans G. JACQUEMET, dir., Catholicisme. Hier, aujourd’hui, demain, 4, 106, Paris,1956). Toujours au sujet des usages romains, notons d’un point de vuematériel que, jusqu’au IXe siècle, l’encensoir portatif n’apparaît que dansles descriptions de processions (cf. L. DUCHESNE, Origines du culte chrétien, cit., p.173, note 1).81 Les canons des conciles d’Agde (506) et d’Épaone (517), p.ex.,mentionnent cet usage. L’onction de l’autel avec du chrême est aussipratiquée en Espagne, comme l’indique le concile de Séville (619) (cf.C.D. FONSECA, « La dedicazione di chiese e altari », cit., p. 931-932 ; P. DEPUNIET, « Dédicace des églises », cit., col. 386-387).82 L’influence byzantine est ici manifeste : onctions et encensements sont,en effet, caractéristiques des rites byzantins de la dédicace : cetteinfluence se voit clairement dans l’Ordo romanus 41 (cf. M. ANDRIEU, Les ‘Ordinesromani’, cit., p. 324-336. Voir aussi P. JOUNEL, « Dédicace… », cit., p.264-265 ; P. DE PUNIET, « Dédicace des églises », cit., col. 398). Sur unplan général, rappelons que l’introduction de l’encens dans le cultechrétien a été tardive, qu’elle a varié selon les régions, et a étéjustifiée de manières diverses (cf. B. CASEAU, ‘Evodia’, cit., passim). Enaccord avec ces gestes rituels, l’offrande eucharistique était elle-mêmeconçue comme offrande « de bonne odeur » qui montait vers Dieu, commel’illustre une prière de bénédiction du sacramentaire de Gellone : Dominesancte pater omnipotens eterne deus, clemens et propitius, precis nostre humilitatis exaudi, et respicead hoc altaris tui holocaustum quod non tam igne probatur, sed infusa sancti spiritus tui gratia[m] inhodorem suavitatis ascendat… (Liber sacr. Gell., 2438, éd. A. DUMAS, cit., p.
élection pontificale, il séjourna lui-même à Constantinople,comme apocrisiaire, de 579 à 58583 ; même si nous avons fortpeu d’informations sur ce séjour, il est possible qu’il y aitassisté à des consécrations d’églises84. C’est également lorsde cette mission qu’il se lia d’amitié avec Léandre deSéville, qui a pu lui décrire les rites en vigueur dansl’Église d’Espagne85. Plus tard, durant son pontificat, c’estmême presque au seuil de Rome que Grégoire trouvait lechristianisme byzantin, puisque celui-ci était bien enracinéen Sicile et dans le sud de l’Italie86. Il est donc trèsprobable que Grégoire le Grand connaissait, soit directement,soit par ouï-dire, au moins certains rites des liturgies nonromaines.
En tout cas, l’Ordo romanus 42, bien que de composition plustardive que l’époque de Grégoire, nous permet de mettre enévidence le lien, assurément plus ancien, que nouait le rituelde dédicace entre autel et odeurs suaves, sinon dans lapratique, du moins dans les représentations, et ce même àRome. Notons d’ailleurs que, même si nous ne sommes pas enmesure de l’affirmer catégoriquement pour le rituel dedédicace, l’usage d’encens et d’aromates dans les basiliquesromaines est bien attesté dès le IVe siècle87.
Quels sont donc les usages d’aromates décrits par l’Ordo 42 enrapport avec l’autel ? Celui-ci était d’abord lavé avec del’eau bénite à laquelle l’évêque avait mélangé du chrême88 ;
366).83 Cf. C. DAGENS, « Grégoire le Grand et le monde oriental », dans Rivista distoria e letteratura religiosa, 17, 1981, p. 244-245.84 Durant le VIe siècle, sous Justinien en particulier, de nombreuseséglises furent édifiées à Constantinople et dans ses alentours (cf.C. MANGO, Le développement urbain de Constantinople (IVe-VIIe siècle), Paris, 1985, p.52-53 ; P. MAGDALINO, Constantinople médiévale. Études sur l’évolution des structures urbaines,Paris, 1996, p.25-28).85 Cf. C. DAGENS, « Grégoire le Grand et le monde oriental », cit., p. 244.86 Cf. L. CRACCO RUGGINI, « Grégoire le Grand et le monde byzantin », dansGrégoire le Grand, cit., p. 83-93.87 Voir p.ex. les rubriques du Liber pontificalis mentionnant des encensoirs etdes offrandes d’aromates : XXXIV, 11-13 ; 18-20 (Silvester : 314-335) ;XLIV, 5 (Bonifatius : 418-422) ; LIV, 10 (Hormisdas : 514-523). Cespassages ont été rédigés dans la première moitié du VIe siècle (cf.L. DUCHESNE, cit., p. CCXXX sq.). Plus tard, Serge I (687-701) fera encoreplacer un grand encensoir d’or dans Saint-Pierre (cf. LXXXVI, 11). 88 Cf. OR 42, 4-6, éd. M. ANDRIEU, cit., p. 398-399.
avant d’y placer les reliques, le célébrant oignait de chrêmela « confession89 » ; trois grains d’encens étaient déposésdans cette dernière avec les reliques et trois hostiesconsacrées90 ; l’évêque effectuait ensuite une nouvelle onctionde chrême sur la plaque fermant la « confession », puisd’autres encore au centre et aux quatre coins de l’autel91. Ensomme, même en l’absence d’une nuée parfumée apparue parmiracle lors de la dédicace d’une église, l’autel constituaiten soi le « centre aromatique » de celle-ci : il était,concrètement et symboliquement, le lieu d’où montait la suaveodeur du sacrifice. C’est d’ailleurs ce qu’exprime l’antiennechantée au moment de la chrismation d’un nouvel autel : Ecceodor filii mei92…
La confrontation du texte des Dialogues et des sourcesliturgiques – l’Ordo romanus 42 surtout – permet donc de mettreen lumière la fondamentale congruence, dans ce cas-ci, deséléments contenus dans ces deux types de documents. Il n’estguère possible, ni prudent, de pousser plus loin l’exercice etd’avancer des conclusions sur leurs éventuels rapports, ou surdes usages d’aromates pour lesquels nous manquons detémoignages proprement romains à l’époque de Grégoire leGrand. Ce qui ressort néanmoins de ces analyses, c’estl’existence de liens entre le texte des Dialogues et laliturgie. De ce point de vue, le récit de Grégoire ne devraitpas être réduit au rang d’une simple anecdote. En outre, lalecture des rites indiqués par OR 42 nous paraît montrer leréel intérêt de ce récit, exceptionnel à cette époque, pourquiconque travaille sur la dimension olfactive du rituel dedédicace des églises.
3. Parfum divin et odeurs des saints
89 Cf. ibid., 10, p. 400.90 Cf. ibid., 11, p. 400.91 Cf. ibid., 15, p. 401.92 Gn 27, 27. Cf. Sacramentaire grégorien, 557 ; Ordo romanus 41, 21.
Nous avons fait remarquer que le récit de la dédicace del’église Sainte-Agathe est apparemment un exemple rare, voireunique, dans les sources du très haut Moyen Âge. Il fallaitdonc chercher à le confronter avec d’autres types de sources,liturgiques d’abord. Cependant, la dimension olfactive durécit de Grégoire ne peut être bien comprise que si l’onéclaire ce dernier par des textes narratifs. Nous avons déjàfait appel à l’Histoire de la persécution vandale de Victor de Vita. Ilfaut à présent considérer d’autres récits, hagiographiquessurtout – leur l’importance pour l’étude des odeurs et del’olfaction a déjà été signalée. Ici aussi, l’état de notredocumentation nous contraint à recourir en partie à dessources plus tardives que les Dialogues ; cependant, lesrecherches que nous avons menées ailleurs autour de lathématique des odeurs miraculeuses montrent que les élémentsdu discours de l’olfaction ne changent guère entre le VIe et leVIIIe siècle et que, avec des précautions, des documentsrelativement éloignés peuvent être utilisés, au moins à titrede comparaison. Nous le ferons en nous limitant à deux aspectsdu récit de Grégoire le Grand.
L’odeur très douce des églises
Pratiquement contemporain de Grégoire le Grand, Grégoire deTours décrit, dans un chapitre des Histoires, la nouvelle église,édifiée intra muros à Clermont, par l’évêque Namatius, vers lemilieu du Ve siècle. L’édifice cruciforme était long de 150pieds, large de 60 ; il comprenait deux bas-côtés, ainsiqu’une abside arrondie, décorée de mosaïques. Grégoire ydénombre encore 70 colonnes, 42 fenêtres et 8 portes93. Ilajoute :
on y éprouve la terreur de Dieu et une grande clarté ; etvraiment, le plus souvent une odeur très douce, commecelle d’aromates, y est perçue par les gens pieux94.
Cette église, Grégoire la connaissait bien, lui qui étaitoriginaire de l’Auvergne et qui fut élevé par son oncle Gall
93 Cf. Hist., II, 16, éd. B. KRUSCH, W. LEVISON, cit., p. 64.94 Terror namque ibidem Dei et claritas magna conspicitur, et vere plerumque inibi odor suavissimusquasi aromatum advenire a religiosis sentitur (ibid.).
(Gallus), évêque de Clermont : « elle existe encore et est laprincipale à l’intérieur des murs de la cité95 ».
Dans son Liber in gloria martyrum, Grégoire a relaté l’arrivée àClermont du prêtre chargé de ramener pour la nouvelle églisedes reliques des martyrs bolognais Vital et Agricole96. À cetteoccasion, les reliques et la procession avaient étémiraculeusement épargnées par un violent orage. Le texte desHistoires mentionne simplement, quant à lui, la déposition desreliques sans évoquer de miracle. Toutefois, selon les Histoires,c’est la présence de Dieu lui-même qui se laisse sentir dansle sanctuaire, comme le souligne l’extrait cité plus haut. Ona déjà observé que « terror Dei » et « claritas magna » désignentdes sensations fréquemment associées aux manifestationsdivines. En outre, elles s’accompagnent dans l’ecclesia deNamatius d’une « odor suavissimus quasi aromatum » : autre signe dela présence divine. À la lumière du texte des Dialogues, il estpermis de penser que cette suave fragrance ait pour effetd’apaiser l’effroi et l’éblouissement d’abord éprouvés97.
Une différence notable semble pourtant séparer ces deux textesquasi-contemporains : dans l’église de Clermont, l’expériencedu divin paraît habituelle ; dans l’église romaine, elle a eulieu une seule fois, lors de la dédicace de l’édifice. Il estcependant évident que les deux types de perceptions olfactivessont en rapport, puisque l’on peut dire que ce sont lesparfums de la dédicace qui rendent l’église à jamais odorante.Par ailleurs, on note que, dans les deux cas, seules certainespersonnes sont en mesure de percevoir les merveilleusesodeurs : selon Grégoire le Grand, la nuée parfumée fut vue etsentie par « le prêtre et les gardiens, et ceux qui étaientvenus célébrer la messe98 » ; et Grégoire de Tours écrit queseuls les religiosi – des personnes pieuses plutôt que des« religieux99 » – perçoivent l’odorem suavissimum. Selon ces deux
95 [… ecclesiam], qui nunc constat et senior infra murus civitatis habetur (ibid.). 96 Cf. GRÉGOIRE DE TOURS, Liber in gloria martyrum, 43, éd. B. KRUSCH, MGH SRM I/2,p. 67.97 Sur la fonction réconfortante des parfums célestes, cf. Dial., IV, 16, 5,cit. supra, note 56.98 Cf. supra, p. . Au sujet des différents nivaux de témoignagesprésentés dans le récit des Dialogues, cf. supra, note 30.99 Bien que l’on ait ici le substantif religiosus, dont l’acception de« religieux, moine » est connue à l’époque (cf. A. Blaise, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Strasbourg, 1954), nous l’interprétons de façon
auteurs, les odeurs extraordinaires des églises dessineraientdonc des catégories sociales à l’intérieur même de lacommunauté chrétienne100.
Nous avons indiqué que, à l’époque, les odeurs miraculeusessont le plus souvent associées à de saints personnages : lessaints intervenant dans la dédicace de l’église de Clermont nejoueraient-ils aucun rôle dans l’exhalaison de l’« odeur trèsdouce » ? Mentionnées dans les dernières lignes du chapitredes Histoires, les reliques de Vital et d’Agricole n’apparaissentpas directement associées à l’atmosphère sacrée perceptibledans l’édifice101. En revanche, le statut de Namatius estdifférent. En effet, celui-ci « a construit par ses soins »(« suo studio fabricavit ») l’église-mère de Clermont : il s’estappliqué avec ardeur à ce projet – les détails fournis parGrégoire de Tours au sujet des dimensions, de la forme et dela décoration de l’édifice illustrent le studium de l’évêque. Deplus, Grégoire parle de ce dernier comme d’un saint : « sanctusNamatius102 ». On pourrait donc conclure que c’est l’œuvre et lezèle du saint évêque qui ont permis de réaliser un sanctuaireplus large sur la base d’éléments présentés dans la note suivante.100 Ce n’est pas le cas de toutes les perceptions d’odeurs extraordinaires.Ainsi, dans un chapitre de son Liber in gloria martyrum, Grégoire de Tours relatequ’une piscine baptismale en Espagne est chaque année miraculeusementremplie d’eau ; et il écrit que c’est l’ensemble de la population du lieuqui sent à l’avance le parfum qui emplira le baptistère : conveniunt in loco illocum pontifice cives, iam odorem sacri praesentientes aromatis (Liber in gloria martyrum, 23, éd.B. KRUSCH, cit., p. 52). De même, dans le récit du baptême de Clovis, cesont « les présents », sans distinctions précises, qui perçoivent une odeurdivine et se croient « installés au milieu des parfums du Paradis : […]totumque templum baptistirii divino respergetur ab odore, talemque ibi gratiam adstantibus Deustribuit, ut aestimarent se paradisi odoribus collocari (Hist., II, 31, éd. B. KRUSCH,W. LEVISON, cit., p. 77). Quant à la bonne odeur perçue lors de la mort decertains saints ou auprès de leurs reliques, elle n’est pas toujoursréservée à une élite religieuse (cf. GRÉGOIRE LE GRAND, Dial., IV, 17 ; GRÉGOIREDE TOURS, Liber in gloria confessorum, 102). 101 On connaît pourtant l’attention portée par Grégoire de Tours à l’égarddes virtutes manifestes dans les reliques. Dans un récit présentant desressemblances avec celui de Grégoire le Grand, il raconte qu’une éclatantelumière fut aperçue alors qu’il entrait un soir dans la basilique Saint-Martin à Tours pour y placer temporairement des reliques du martyr Juliende Brioude ; celles-ci furent ensuite déposées dans la nouvelle basilica sanctiIuliani ; lors de la cérémonie, un possédé fut libéré du démon (cf. Liber devirtutibus s. Iuliani, 34-35, éd. B. KRUSCH, dans MGH SRM I/2, p. 128-129. Surcette église, cf. L. PIETRI, La ville de Tours du IVe au VIe siècle. Naissance d’une citéchrétienne, Rome, 1983 (Collection de l’École française de Rome, 69), p. 417-420).
tel que la présence de Dieu y est perceptible par les sens :comme dans bien des récits, c’est à travers ou dans les saintsque Dieu se manifeste, mais il le fait ici par l’intermédiaired’un saint vivant plutôt que par celui des reliques demartyrs.
Nuée odorante, odeur vaporeuse
Dans le récit de la dédicace de Sainte-Agathe, les termes nubeset suavitas odoris sont intimement liés. On a déjà vu que chacun deces éléments pouvait, dans un contexte liturgique, être reliéà la présence divine. Il est cependant possible d’en compléterl’analyse. En effet, l’association entre l’odeur et la fuméeou la vapeur (fumus, nebula, vapor) est présente dans d’autrestextes narratifs du haut Moyen Âge103. Il est possible que cettesorte de « visualisation » des odeurs soit due à ladifficulté, en latin comme dans nos langues modernes, d’endécrire la nature et les processus104. Mais il est égalementpossible que cela soit lié au contexte et à la significationdes exhalaisons, c’est-à-dire à leur dimension liturgique.Pour illustrer cette hypothèse, nous devons recourir à desexemples assez tardifs par rapport aux Dialogues, mais qui, dupoint de vue des odeurs extraordinaires, partagent avec cet ouvrage desconceptions et un discours tout à fait similaires105.
La Vie de saint Wynnebald (écrite vers 778) décrit des événementssurvenus dans les jours qui suivirent l’enterrement du saint :102 Ibid., II, 16, p. 64. Il est vrai que, au VIe siècle, le titre de sanctusest encore fréquemment employé comme marque d’honneur envers un évêque (cf.GRÉGOIRE DE TOURS, Liber in gloria confessorum, 40 ; éd. B. KRUSCH, dans MGH SRM I/2,p. 323). Notons toutefois que Grégoire n’écrit pas ici sanctus pontifex, maisbien sanctus Namatius, ce qui s’explique aussi par le fait que Namatius estmort depuis longtemps et peut en toute sécurité être qualifié de « saint ».Sur cette appellation, cf. H. DELEHAYE, Sanctus. Essai sur le culte des saints dansl’Antiquité, Bruxelles, 1927 (Subsidia hagiographica, 17), p. 38-41.103 L’odeur peut d’ailleurs y être bonne ou mauvaise. Étant donné que letexte de Grégoire le Grand parle d’une nuée d’agréable odeur, nous nouslimiterons à cet aspect.104 Cf. A. HOLLEY, Éloge de l’odorat, cit., p. 128 sq. ; S. LILJA, The Treatment ofOdours in the Poetry of Antiquity, Helsinki, 1972. Au sujet de la « visualisation »des odeurs, voir aussi infra, note 108.105 Étant donné la réputation et la diffusion de l’ouvrage de Grégoire leGrand, il est d’ailleurs fort possible que les auteurs de ces textes aientlu les Dialogues (voir les notes suivantes).
Comme un jour, très tôt le matin, l’un [de ses disciples]entrait dans l’église pour y accomplir la messe, il ouvritla porte ; quand il entra, rapidement, un parfum de laplus suave odeur s’avança vers lui […] ; il était siabondant et si prodigieux qu’il se répandait à traverstoute l’église comme une bouffée chaude de fumée106.
La Vie de saint Trond (rédigée entre 784-791) décrit de manièreencore plus détaillée l’épaisse vapeur parfumée qui remplit lelieu des funérailles du saint :
Comme était venu le moment, parmi les pleurs de tous lesprésents, de confier le précieux corps à la sépulture, unparfum d’une indicible douceur remplit l’église d’uneépaisse vapeur, qui subsista encore l’espace d’une heureenviron. Cette vapeur était, comme nous l’avons dit, siépaisse et mêlée du plus doux parfum, qu’à peinequelqu’un des présents était-il capable de voir sonvoisin107.
Sans analyser ces textes en détail, on remarquera que, danschaque cas, le contexte de la prodigieuse odeur estliturgique : la messe, la mise en terre108. C’est évidemment un106 Cumque una die valde diluculo unus intrabit in aecclesiam missam facere, ianuam aperuit, et citout intravit, tam magna et tam miranda suavissimi odoris nectar obviam illo […] veniebat, et per totamaecclesiam quasi fumi vapor calidus conspargebatur (HUGEBURC DE HEIDENHEIM, Vita Wynnebaldi,10, éd. O. HOLDER-EGGER, dans MGH Script. XV, p. 114). Sur ce texte et sonauteur, cf. F. VITRONE, « Hugeburc di Heidenheim e le ‘Vitae Willibaldi etWynnebaldi’ », Hagiographica, 1, 1994, p. 43-79. Hugeburc semble connaîtrel’œuvre de Grégoire le Grand, en particulier la Regula pastoralis et lesDialogues (cf. O. HOLDER-EGGER, cit., p.110, notes 3 et 5, etc. ; F. VITRONE,cit., p. 65, note 89, et p. 74) ; on sait que le saint pontife étaitparticulièrement vénéré dans la patrie d’Hugeburc, l’Angleterre, où futd’ailleurs rédigée la première véritable Vie du pape, en 704-714 (cf. TheEarliest Life of Gregory the Great, By an Anonymous Monk of Whitby, text, transl., notes B.COLGRAVE, Cambridge etc., 1968). 107 Cum igitur tempus adesset, quo pretiosum corpus, flentibus cunctis qui aderant, sepulturaetraderetur, inenarrabilis suavitatis odor illam aecclesiam cum densissima nebula replevit, quae etiamper unius fere horae spatium perduravit. Erat autem, ut diximus, illa nebula tam densa cumsuavissimo odore permixta, ut vix ullus ex eis existentibus proximum suum videre potuerat (VitaTrudonis confessoris Hasbaniensis auctore Donato, 21, éd. W. LEVISON, dans MGH SRM VI,p. 292). Certaines expressions de l’hagiographe pourraient provenir desDialogues de Grégoire le Grand (cf. ibid,, p. 291, note 2, et p. 292, note 1).108 Même dans des contextes non liturgiques, une odeur prodigieuse peut êtredécrite sur le modèle d’une fumée (d’encens par exemple). Ainsi, un moinequi fut transporté au Paradis raconte avoir été « enveloppé » par unmerveilleux parfum : operuit me odor nimiae suavitatis (GRÉGOIRE DE TOURS, Hist., VII,1, éd. B. KRUSCH, W. LEVISON, cit., p. 325).
point de contact important avec le récit de la dédicace deSainte-Agathe, bien que les deux Vitae se distinguent de celui-ci en reliant la nuée odorante aux saints, qu’elles visent àglorifier. Il est toutefois manifeste que, dans cesdifférentes situations, les odeurs miraculeuses sontreprésentées à l’instar de fumées d’encens109.
Si l’on veut cerner au plus près la signification de cesdifférents textes, il faut nécessairement se tourner vers laBible. Une enquête sommaire, limitée à la Vulgate, révèle defréquentes associations entre odeur et fumée ; elles’expliquent en général par la mention d’encens. Ainsi, dansle Lévitique, où il est prescrit à Aaron de n’entrer dans latente de la rencontre, au-delà du voile, que protégé par unnuage d’encens :
[…] ut positis super ignem aromatibus nebula eorum et vapor operiatoraculum quod est super testimonium et non moriatur110…
Il semble donc évident que, dans la culture biblique, lebinôme odeur-fumée évoquait avant tout l’offrande d’encens.
En élargissant de la sorte le champ documentaire de notrerecherche, nous constatons donc que la description d’une nuéeodorante remplissant une église n’apparaît pas uniquement dansle récit de Grégoire, mais aussi dans d’autres textesnarratifs, en lien toutefois avec les saints. En outre, étantdonné la culture des milieux de production littéraire du hautMoyen Âge, il est plus que probable que, dans ces différentstextes, ce type de description reprenne des formulesbibliques, en particulier celles qui interviennent dans descontextes cultuels. Considéré dans cette perspective plusvaste, le récit de Grégoire est donc moins exceptionnel qu’iln’apparaissait de prime abord : en particulier, sa descriptionde la nuée odorante présente des aspects que nous observonsailleurs. Dans ces représentations communes, on discerne que
109 Ce qui ne signifie absolument pas qu’elles proviennent tout bonnementdes encensoirs utilisés dans les rites : si c’était le cas, les auteursn’en auraient pas parlé comme ils l’ont fait ! Les encensoirs et lebrûlement d’encens sont néanmoins fréquemment mentionnés, par exemple dansles descriptions de processions : cum turibulis et timiamatibus, cum odoribus magnis,cum turibus, etc. On voit bien la différence de traitement entre les odeursconsidérées comme miraculeuses et celles d’usage rituel.110 Lv 16, 13. Voir le commentaire de la TOB, cit.
les perceptions d’odeurs miraculeuses racontées dans lessources narratives correspondent, par un jeu d’analogies, auxperceptions sensorielles qui étaient, dans le cadreliturgique, suscitées et éprouvées (encensements), et mêmeracontées (lectures bibliques et homélies, oraisons).
Conclusion
Le cadre liturgique de la théophanie racontée par Grégoire leGrand est apparent en plusieurs points de son récit. Aucaractère rituel et « objectif » de la dédicace se superposel’événement extraordinaire, voire unique, de l’irruption,sensible et sans intermédiaire humain, du divin dansl’existence de l’ecclesia – l’édifice, mais aussi la communautécroyante. Il est d’ailleurs fort possible que Grégoire, touten distinguant dans son récit le moment du rituel deconsécration de celui de la venue de la nuée odorante,considère que le rituel est en réalité lui-même le lieu et letemps de la théophanie111 : comme l’écrivent Ph. Oliviéro etT. Orel, le rite religieux peut aussi être expérimenté comme« l’action de Dieu vers l’homme. En ce sens, le rite est unethéophanie112 ».
Dans la liturgie ancienne en général, dans le rituel de ladédicace en l’occurrence, la dimension olfactive avaitcertainement une signification, une présence sensible etsignifiante, que nous avons de la peine à nous représenteraujourd’hui. Les odeurs de l’encens, du chrême, mais aussi decierges parfumés, des fleurs répandues dans les sanctuaires,étaient toujours associées aux notions et aux images de vie, àla fois de santé et de salut, et donc au monde divin. Enretour, les odeurs rituelles permettaient de discerner etd’interpréter d’autres expériences olfactives. On en trouve un
111 Cela expliquerait pourquoi ce récit de théophanie est unique dans lesDialogues, alors que les miracles accomplis par des saints y abondent : cerécit est unique non parce que ce prodige n’a eu lieu que cette fois-là,mais au contraire parce qu’il est paradigmatique d’une réalité continuelle,à savoir que Dieu lui-même se manifeste dans le rite religieux.112 P. OLIVIÉRO, T. OREL, « L’expérience rituelle », dans Recherches de sciencereligieuse, 78, 1990, p. 348 (nous soulignons).
témoignage particulièrement éloquent dans les écrits, remplisd’images olfactives, du plus important théologien de l’Églisesyriaque, saint Éphrem (IVe s.)113. S. A. Harvey a montré que« Éphrem interprétait les expériences sensorielles en fonctiond’éléments analogues dans le rituel religieux, et spécialementla liturgie, dans laquelle les sensations physiques étaientagencées et expliquées pour la communauté cultuelle114 » ;c’était le cas en particulier pour les odeurs : celles desrites constituaient pour lui des « odeurs paradigmatiques115 ».En Occident comme en Orient, il semble donc bien que lesparfums, qu’ils fussent d’origine humaine ou céleste, étaientaffectés d’une fonction médiatrice entre le monde visible etle monde invisible116.
Par là, la signification des odeurs s’étendait à la dimensionsociale117. Nous en voyons un exemple dans le parfum del’onction de chrême : on peut dire qu’il avait aussi pourfonction de délimiter la communauté catholique par rapport auxhérétiques. On considérait, en effet, que ces derniersdégageaient de mauvaises odeurs118 ; il est donc significatifd’observer que, lorsqu’ils demandaient à être reçus dansl’Église catholique, ils devaient recevoir non pas un nouveaubaptême, mais l’onction de chrême119, qui leur conférait labonne odeur de la foi catholique. Par ailleurs, rappelons-nous113 Des œuvres d’Ephrem ont circulé en latin dès le haut Moyen Âge (cf.« Ephraem latinus », dans E. DEKKERS, Clavis Patrum Latinorum, 3e éd.,Steenbruge-Turnhout, 1995, p. 373 sq. ; D. HEMMERDINGER-ILIADOU, « Éphremlatin », dans DS, 4, 815-819, Paris, 1960 ; G. BARDY, « Le souvenir de saintÉphrem dans le haut Moyen Âge latin », dans Revue du Moyen Âge latin, 2, 1946,p. 297-300 ; J. STEVENSON, « Ephraim the Syrian in Anglo-Saxon England »,dans Hugoye : Journal of Syriac Studies, vol.1, 2, 1998[http://syrcom.cua.edu/syrcom/Hugoye] ; D. GANZ, « Knowledge of Ephraim’sWritings in the Merovingian and Carolingian Ages », dans Hugoye : Journal ofSyriac Studies, vol.2, 1, 1999 [http://syrcom.cua.edu/syrcom/Hugoye]).114 Nous traduisons à partir de son article « St Ephrem on the Scent ofSalvation », cit., p. 115.115 Ibid.116 Cf. B. CASEAU, ‘Evodia’, cit., p. 255.117 Cf. B. CASEAU, « Christian bodies : : the senses and early ByzantineChristianity », dans Desire and Denial in Byzantium, Papers from the thirty-firstSpring Symposium of Byzantine Studies, University of Sussex, Brighton,March 1997, éd. L. JAMES, Aldershot, 1999, p. 107.118 Cf. supra, notes 32-33.119 Cf. ILDEFONSE DE TOLÈDE, De cognitione baptismi, 121, PL 96, 161. Lorsqu’une dessœurs de Clovis se convertit de la foi arienne, elle fut simplement ointede chrême (cf. GRÉGOIRE DE TOURS, Hist., II, 31). Voir aussi supra, note 57.
l’antienne Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni, chantée lors de lachrismation de l’autel : dans une de ses homélies, Grégoire leGrand explique ce verset de la Genèse comme constituantl’annonce prophétique de la constitution d’un peuple à partirdes nations païennes ; et c’est son odor qui distinguera cepeuple à travers le monde120. Le récit que nous avons lu dansles Dialogues nous permet justement d’entrevoir cette dimension,et ce d’autant plus que nous savons que la dédicace de Sainte-Agathe s’est effectuée dans un contexte historique de conflitavec les Lombards ariens. Or notons que le retour à l’Églisecatholique de l’ancienne basilique des Ariens ne signalaitnullement la fin de la présence des hérétiques en Italie. Oncomprend donc que la théophanie survenue au cœur de Romeprenait une signification qui dépassait celle de l’occasionimmédiate (la dédicace), et concernait le soutien que Dieuaccordait aux Catholiques contre leurs ennemis121, alimentantsans doute l’espoir que les Lombards, comme peu de tempsauparavant les Wisigoths, se convertissent à la foicatholique122.
Enfin, l’étude des éléments olfactifs présents dans le récitde Grégoire le Grand nous amène à proposer une remarque deportée générale. Les sciences modernes observent que lesodeurs, ou plutôt leurs perceptions, ne sont pas statiques,neutres, objectives ; au contraire, elles sont instables,subjectives, et étroitement liées non seulement à la conditionpsychique et physique du sujet, mais aussi à son « outillage »d’images et de notions culturelles et religieuses : « commedans de nombreux domaines sensoriels, la perception[olfactive] est conforme à ce que vous attendez de l’objet,avant même qu’il ne soit perçu123 ». Sur la base de ces120 Cf. GRÉGOIRE LE GRAND, Homiliae in Hiezechihelem prophetam, VI, 3-4, éd.M. ADRIAEN, CC Ser. Lat.142, Turnhout, 1971, p. 68-69.121 Une situation très comparable à celle de l’Afrique sous l’occupationvandale (cf. supra, p. ). Les Dialogues dans leur ensemble présententune forte tonalité anti-hérétique (cf. W.D. MCCREADY, op.cit. ; p.46).122 C’est en 589 que fut officialisée la conversion à la foi catholique duroi Reccarède. En 599, Grégoire le Grand écrira à celui-ci que cettedécision fut un « miracle » : Audita quippe novi diebus nostris virtute miraculi, quod perexcellentiam tuam cuncta Gothorum gens ab errore haereseos Arrianae in fidei rectae soliditatetranslata est, exclamare cum propheta libet : ‘Haec est immutatio dexterae excelsi’ (RegistrumEpistularum, IX, 229, éd. D. NORBERG, cit., p. 805-806). 123 F. BROCHET, G. MORROT, « La couleur des odeurs », dans Pour la science, dossierhors-série, avril/juin 2003, p.117. Sur l’odorat et les odeurs en général,cf. A. HOLLEY, Éloge de l’odorat, cit.
constatations, l’étude des odeurs dans le christianisme ancienet médiéval doit, certes, nécessairement s’appuyer sur lessources liturgiques, mais aussi sur les sermons et homélies,sans négliger les textes bibliques qui inspirent tous cesécrits. Cependant, à côté de ces documents, il estindispensable de recourir aux sources narratives – telles quecelles que nous avons étudiées – pour parvenir à comprendrecomment les odeurs se manifestent, comment elles sont perçues,la manière dont elles agissent, leurs effets124, etc. : alorsseulement, la question de leur fonction « anagogique » dans lerituel de dédicace pourra être affrontée de manièresatisfaisante.
En fin de compte, plus d’un aspect olfactif des récits du hautMoyen Âge trouve des échos, sinon des vérifications, dans lesrecherches actuelles des sciences de l’homme. C’est pourquoi,ayant soulevé la question de la fonction anagogique desodeurs, il nous semble approprié de conclure avec cesréflexions du philosophe Merleau-Ponty sur la perception engénéral :
La perception est non perception de choses d’abord, maisperception […] de rayons de
monde, de choses qui sont des dimensions, qui sont desmondes, je glisse sur ces
‘éléments’ et me voilà dans le ‘monde’, je glisse du‘subjectif’ à l’Être125 ».
124 On peut même dire que les odeurs « agissent » : sans entrer dans ledétail de cette question, il faut signaler que, dans les sources narrativesque nous avons étudiées dans notre thèse, on ne rencontre que 4-5substantifs d’odeurs (odor, fragrantia, foetor, etc.), une vingtaine d’adjectifsqualificatifs (suavis, immensus, intolerabilis, etc.) ; on trouve en revanche unecentaine de verbes différents, qui expriment à divers degrés les procès desexhalaisons, des perceptions olfactives, mais également les représentationssous-jacentes aux unes et aux autres. L’analyse de ces verbes met justementen lumière le dynamisme des odeurs et de leurs perceptions.
125 Le visible et l’Invisible, Paris, 1964, p. 271, cité dans R. BARBARAS, La perception.Essai sur le sensible, Paris, 1994, p. 71.



































![[Maia Grégoire, Odile Thiévenaz] Grammaire progr(Book Za org)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63160980fc260b710210455c/maia-gregoire-odile-thievenaz-grammaire-progrbook-za-org.jpg)