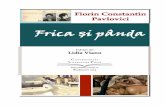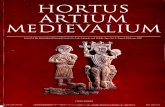« À Antioche sur l’Oronte, l’église de Constantin entre histoire et mémoire », Antiquité...
-
Upload
univ-paris8 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of « À Antioche sur l’Oronte, l’église de Constantin entre histoire et mémoire », Antiquité...
AnTard , 22, 2014, p . 125-136 DOI 10.1484/J.AT.5.103182
À ANTIOCHE SUR L’ORONTE, L’ÉGLISE DE CONSTANTIN ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE
Constantine’s church at Antioch, between history and memory
This article is devoted to the church built by Constantine in Antioch. It is mentioned twice by Eusebius and appears in numerous texts, but it has not yet been recognized in the field. The names given to the church in the texts are examined: the original name seems to have been “The Golden Church”. However, already under Julian’s reign the church was com-monly called “The Great Church” or even simply “The Church”. This name implies that the building was the main church of the Christian community. Its topographical situation is unknown. Due to the ambiguities of the architectural vocabulary used by Eusebius, any speculation about the architectural appearance of the church must be taken with great caution. Constantine’s decision to build this church must be interpreted as an act of recognition of the importance of Antioch as “Metropolis of the East”. Although the dedication of the church took place in 341, in the presence of Constantius, the church maintained the memory of Constantine until the beginning of the 6th century. In Malalas’ Chronicle, the narrative of its construction is associated with the appointment of the first Comes Orientis, the foundation of his praetorium and, anachronistically, the destruction of a temple and its replacement by Rufinus’ basilica, which played an important role in Antiochean urban space until at least the reign of Justinian. [Author, with the help of Luke Lavan]
L’église élevée à Antioche sur l’Oronte par décision de Constantin a été brièvement évoquée par Eusèbe de Césarée à deux reprises et dans des termes presque identiques, dans les Louanges de Constantin, discours prononcé lors des Tricennales de l’empereur le 25 juillet 3361, puis dans la Vie de Constantin, rédigée entre
Abréviations : – Burgess, Studies = R.W. Burgess, Studies in Eusebian and post-Eusebian chronography, Stuttgart, 1999. – Deichmann, Das Oktogon = F. W. Deichmann, Das Oktogon von Antiocheia: Heroon-Martyrion, Palastkirche oder Kathedrale?, dans Byzantinische Zeitschrift, 65, 1972, p. 40-56. – Downey, Antioch = Gl. Downey, A history of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Conquest, Princeton (N.J.), 1961. – Fournet, Thermes = Th. Fournet, Thermes impériaux et monumentaux de Syrie du Sud et du Proche-Orient, dans J. Jouanna, P. Toubert, M. Zink (dir.), L’eau en Méditerranée de l’Antiquité au Moyen Âge, Paris, 2011, p. 185-246. – Goilav, Proposal = A.-M. Goilav, Proposal for the reconstruction of the Golden Octagon, dans Les sources de l’histoire du paysage urbain d’Antioche sur l’Oronte (Actes des Journées d’études des 20 et 21 septembre 2010), http://www.bibliotheque-numerique-paris8.fr/fre/ref/146505/COLN1/ (consulté le 8 mai 2014), p. 159-177. – Kleinbauer, Antioch = W. E. Kleinbauer, Antioch, Jerusalem and Rome. The patronage of Emperor Constantius II and architectural
335/336 et la mort de son auteur en 3392 (annexe 1). Ces deux descriptions ont été rédigées avant la dédicace de
aient la valeur de témoignages oculaires. L’église n’a pas
invention, dans Gesta, 45, 2006, p. 125-144. – Maraval, Théologie politique = P. Maraval, Eusèbe de Césarée, la théologie politique de l’Empire chrétien : louanges de Constantin (Triakontaétérikos), Paris, 2001. – Martin, Sources = A. Martin, Des sources pour la topographie d’Antioche : les Histoires ecclésiastiques de la première moitié du e siècle, dans Topoi, 17/2, 2011, p. 413-420. – Mayer, Allen, Churches = W. Mayer, P. Allen, The Churches of Syrian Antioch (300-638 CE), Leuven / Paris / Walpole (Mass.), 2012. – Recherches = S. Agusta-Boularot, J. Beaucamp, A.-M. Bernardi, E. Caire (dir.), Recherches sur la Chronique de Jean Malalas, 2, Paris, 2006. – Studies = E. Jeffreys, B. Croke, Studies in John Malalas, Sydney, 1990. – Voelkl, Kirchenbauten = L. Voelkl, Die Konstantinischen Kirchenbauten nach Eusebius, dans RAC, 29, 1953, p. 49-66 et 187-206.
1. Eus., LC IX, 15 ; cf. Maraval, Théologie politique, p. 22-24, pour la date et les circonstances du discours.
2. Eus., VC III, 50, 2 ; cf. L. Pietri, M.-J. Rondeau, Vie de Constantin, Paris, 2013 (SC 559), p. 13-20 pour la date et les modalités d’élaboration de l’ouvrage.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
CATHERINE SALIOU AnTard , 22, 2014126
été retrouvée sur le terrain mais des sources textuelles 3 fournissent des éléments
d’information sur son architecture et son histoire4. Dans
littéraires, il importe tout d’abord d’établir les conditions
à-dire de s’interroger sur la façon dont il y est nommé ou évoqué. On dressera ensuite le bilan de ce que l’on peut savoir de sa forme architecturale et de la chronologie comme des motivations de sa construction. Cette église
Constantin. Au e siècle, dans son Histoire universelle, Malalas attribue à Constantin plusieurs initiatives aussi bien institutionnelles qu’édilitaires (annexe 25). L’analyse de son récit permettra de mettre en évidence quelques traits de la mémoire antiochéenne de Constantin et de préciser le rôle qu’y jouait l’église, avant de s’interroger
De l’Église d’Or à la Grande Église
L’église fondée par Constantin est désignée par Eusèbe
6. Dans sa Chronique, mise au point entre 379 et 3807, Jérôme utilise, lorsqu’il évoque le
dominicum8. Dans la sienne, Théophane, à la charnière du e et du e siècle, emploie à propos des mêmes épisodes
3. On exclura de ces sources le discours de Bémarchios évoqué de façon méchamment ironique par Libanios (Or. I, 39 et 41) et qui, contrairement à ce que l’on a cru longtemps, ne concerne pas cette église (cf. M. Raimondi, Bemarchio di Cesarea, panegirista di Costantino e Costantinopoli: per une reinterpretazione di Libanio, Or. I 39; 41, dans Rivista storica dell’antichità, 33, 2003, p. 171-199 ; D. Woods, Libanius, Bemarchius and the Mausoleum of Constantine I, dans C. Deroux [dir.], Studies in Latin Literature and Roman History, 13, Bruxelles, 2006, p. 428-439). De même les passages de Chrysostome parfois allégués à propos de l’architecture ou du décor intérieur de l’église ne la concernent peut-être pas (cf. Mayer, Allen, Churches, p. 71), ils seront donc également exclus de la présente étude.
4. Une synthèse en a récemment été proposée par W. Mayer et P. Allen dans leur ouvrage sur les églises d’Antioche (Mayer, Allen, Churches, p. 68-80). Cette synthèse, très utile, peut toutefois être complétée, et surtout précisée, voire discutée sur plusieurs points. Nous nous appuierons également sur l’inventaire des sources proposé par A. Martin dans sa contribution aux journées d’études sur Les sources de l’histoire du paysage urbain d’Antioche sur l’Oronte (http://www.bibliotheque-numerique-paris8.fr/fre/ref/146505/COLN1/), p. 117-118.
5. Une analyse de ce passage a été proposée par Gl. Downey (Antioch, p. 650-653) ; voir aussi ses utiles remarques p. 348, n. 138 et p. 349-350.
6. Sur ce vocabulaire, cf. Voelkl, Kirchenbauten, p. 51-54. Les mots
soucieux d’utiliser un langage élevé et de se démarquer des usages plus communs (ex. : Théodoret, HE
7. Cf. B. Jeanjean, B. Lançon (dir.), Saint Jérôme, « Chronique » : continuation de la « Chronique » d’Eusèbe, années 326-378, Rennes, 2004, p. 20-26.
8. Jérôme, Chron. a. 327, p. 231, l. 26 Helm ; a. 342, p. 235, l. 20 Helm.
9 – dont le mot dominicum est 10.
Jérôme et Théophane s’appuient sur une source commune reconstruite par R. W. Burgess sous le titre de Continuatio Antiochensis Eusebii11. En latin comme en grec, le mot dominicum– antérieur à la Paix de l’Église – et populaire12, même si l’explication qu’en a donné Eusèbe13 lui a en quelque sorte conféré ses lettres de noblesse. R. W. Burgess, dans sa reconstruction de la Continuatio, a donné avec raison
celui qui concerne la dédicace14. Dans la Chronique de Jérôme comme dans celle
est accompagné d’un adjectif. Jérôme emploie aureum
était orné « d’une profusion d’or »15
16) » puis de « sphéroïde 17) ». Plusieurs éléments font penser que le
qu’indique Jérôme, c’est-à-dire l’Église d’Or18 : Jérôme écrit au e siècle, il utilise la même expression aussi bien à propos du début de la construction qu’à propos de la dédicace, il a vécu à Antioche et en connaît bien la topographie et les monuments ; de plus, lors de sa première occurrence, le groupe dominicum aureum est explicitement présenté comme une appellation (dominicum, quod uocatur aureumconstituer dans la Chronique de Théophane des anachro-nismes, témoignant de désignations attribuées à l’église postérieurement au e siècle19.
9. Théophane, a. 5819, p. 28, l. 16 De Boor.10. Théophane, a. 5833, p. 36, l. 27, l. 29 De Boor.11. Burgess, Studies.12. Cf. F. J. Dölger, „Kirche“ als Name für den christlichen Kultbau,
dans Idem, Antike und Christentum, VI, 3, Münster, 1941, p. 161-195 ; Chr. Mohrmann, grec et en latin au cours des premiers siècles chrétiens, dans Revue des sciences religieuses, 36/2, 1962, p. 155-174 (repris dans Études sur le latin des Chrétiens, 4, Rome, 1977, p. 211-230) : p. 165-167.
13. Eus., LC XVII, 4. Ce développement s’inscrit dans la deuxième partie de l’ouvrage d’Eusèbe (LC XI-XVIII), qui correspond, non au discours prononcé lors des Tricennales, mais à un exposé doctrinal présenté sans doute à Constantinople devant Constantin entre novembre 335 et 336 (Maraval, Théologie politique, p. 29-34).
14. Burgess, Studies, p. 166, p. 170. 15. Eus., VC III, 50, 2. 16. Théophane, a. 5819, p. 28, l. 16 De Boor.17. Théophane, a. 5833, p. 36, l. 29 De Boor. Cf. Chronicon miscellaneum
ad AD 724, dans Burgess, Studies, p. 158 ; Michel le Syrien, VII, 4 (trad. Chabot, 1, Paris, 1899, p. 270).
18. Le groupe nominal dominicum aureum est lui-même la transcription
attestée dans les textes à propos de la fondation de Constantin.19. La restitution de l’expression « église octogonale » dans la Continuatio
Antiochensis (Burgess, Studies, p. 166-167) paraît donc contestable.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
AnTard , 22, 2014 À ANTIOCHE SUR L’ORONTE, L’ÉGLISE DE CONSTANTIN ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE 127
Dans le récit par Malalas du tremblement de terre de
Église construite par Constantin le grand souverain20 ». Malalas désigne l’église de Constantin comme la Grande
du récit du règne de Constantin21, ainsi qu’à propos de la dédicace de l’église22, mais il peut s’agir d’anachro-
signale la fermeture par Julien de « la Grande Église, construite par Constantin23 ». Théodoret écrit au e siècle, mais Ammien Marcellin, témoin oculaire des événements, mentionne lui aussi à propos du même épisode l’ecclesia maior24. Au plus tard à partir du règne de Julien, l’Église d’Or est donc désignée comme la Grande Église25. Plutôt
son statut d’église principale de la ville26. C’est ce que montre le rôle que la Grande Église joue dans l’histoire tourmentée du christianisme antiochéen : la faction qui l’occupe est celle qui jouit des faveurs du pouvoir impérial et peut se dire majoritaire ou légitime27. On trouve aussi quelques mentions28
sans autre précision, en particulier à propos de l’épisode du pillage et de la fermeture de l’église par Julien29. Ces dernières occurrences montrent que l’Église doit être
simplement comme l’Église à la fois parce qu’elle n’a pas de titulaire particulier et parce qu’elle est l’église principale, l’église par excellence, de la ville. « La très sainte église » mentionnée dans les Actes du synode présidé par l’évêque Domnos en 44430 doit aussi lui être
31.
20. Malalas XVII, 16, p. 347, l. 26-27 Thurn.21. Malalas XIII, 14, p. 249, l. 63-64 Thurn. 22. Malalas XIII, 17, p. 250, l. 83-92 Thurn. 23. Théodoret, HE
24. Ammien Marcellin XXII, 13, 2 : maiorem ecclesiam Antiochiae.
la fermeture par Julien (a. 5854, p. 50, l. 15 De Boor).26. Voir déjà en ce sens Downey, Antioch, p. 345, et Deichmann, Das
Oktogon, p. 48. 27. Voir à ce propos Mayer, Allen, Churches, p. 77-78. 28. Outre les textes cités à la note suivante, voir aussi Socrate, HE V,
22, 53.29. Jérôme, Chron. a. 363, p. 243, l. 4 Helm ; Philostorge, HE VII, 10,
l. 28 (SC 564).30. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, VII,
31. L’expression peut avoir un sens institutionnel et désigner l’Église, la communauté chrétienne (cf. Évagre le Scholastique, HE II, 8, l. 59-60 ; II, 18b, l. 195-196 ; II, 18c, l. 142 [SC 542] ; Chronique Paschale,concret, il doit s’agir de l’église principale de la ville, celle qui constitue précisément le lieu de rassemblement de la communauté dans son ensemble (cf. Malalas, XIII, 45a, fragment de Tusculum, p. 270, l. 59 Thurn ; Malalas XVIII, 143, p. 429, l. 81-82 Thurn ; Jean
Il n’est pas certain en revanche, contrairement à ce qui a pu être écrit32, que l’Église d’Or ait été désignée comme l’Église Neuve. Lorsque Sozomène mentionne la dédicace
à une expression lexicalisée33. Théodoret évoque quant à lui « l’église nouvellement construite34 » dont Jovien avait donné l’usage aux Méléciens : dans la mesure où l’on sait par ailleurs que ces derniers se rassemblaient auparavant dans la Vieille Église tandis que la Grande Église était occupée, sous le règne de Julien en tout cas, par ceux que Théodoret appelle les Ariens, l’on peut admettre que la périphrase désigne bien l’église dédicacée en 341, sans que cela implique qu’il s’agisse de sa désignation usuelle. Comme le souligne W. Mayer, il peut au reste s’agir d’une autre église plus récente35
une homélie dans la Vieille Église, après une précédente synaxe tenue « dans l’Église Neuve » à laquelle il avait participé conjointement avec l’évêque36. Il semble bien ici que l’expression « Église Neuve » ait la valeur d’un
désigné avec l’Église d’Or ne s’impose pas.Un manuscrit de la Vie grecque de Syméon Stylite
l’Ancien signale, dans le cadre du récit du transfert à Antioche de la dépouille du saint en 459, que la Grande
37. Dans les versions latines de la VieConcordia Poenitentiae, Concordia et poenitentia ou Concordia Poenitentalis38, et un manuscrit du martyro-logue hiéronymien daté du xe siècle comporte la mention de la déposition du corps de Syméon in Antiochia in ecclesia quae uocatur Poenitentia, ou Concordia d’après une seconde main39. Comme le souligne W. Mayer, l’impor-tance parfois attachée au nom de Concordia, qui n’est attesté que dans ces adaptations latines, est démesurée40. Le
Moschos, Pré Spirituel 185, PG 87, 3, col. 3060, l. 15-16 ; Chronique Pascale, p. 411, l. 18 ; p. 569, l. 17-18 ; p. 727, l. 11 Dindorf).
32. Deichmann, Das Oktogon, p. 49.33. Sozomène HE 34. Théodoret HE35. Mayer, Allen, Churches, p. 77. 36. Jean Chrysostome Hom. « In faciem ei restitui », titulus, PG 51,
37. Cf. H. Lietzmann, Das Leben des hl. Symeon Stylites, dans Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 32/4, 1908, p. 77, ms
C. Saliou, À propos de la Taurianè pulè. Remarques sur la localisation présumée de la Grande Église d’Antioche de Syrie, dans Syria, 77, 2000, p. 217-226.
38. Cf. H. Lietzmann, Das Leben, cit. (n. 37), p. 209. 39. Martyrologium Hieronymianum, dans AA. SS nov., II, p. 26 : addition
du manuscrit S. Sur ce manuscrit, voir AA. SS nov., II, p. XI, et R. Aigrain, R. Godding, L’hagiographie : ses sources, ses méthodes, son histoire, Bruxelles, 2000, p. 41-42.
40. Mayer, Allen, Churches Concordia serait une traduction, est attesté comme nom d’église à Constantinople et à Antinoupolis (cf. J. Gascou, Encore une fois sur l’onomastique
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
CATHERINE SALIOU AnTard , 22, 2014128
toutefois rien n’indique que cette désignation remonte à la fondation ou à la dédicace de la Grande Église, et elle peut lui avoir été attribuée postérieurement, on y reviendra.
Sur la localisation de la Grande Église, les informations dont on peut disposer sont malheureusement ténues41. Au début du e siècle, la ville d’Antioche se développait sur les deux rives de l’Oronte : la « Vieille Ville » s’allongeait entre
que sur une île formée par un bras de l’Oronte aujourd’hui disparu se trouvait la « Ville Neuve », dotée de ses propres remparts et abritant notamment le palais impérial ( ). Théodoret, dans son récit de la grande manifestation de
intervenue au début du e siècle, localise explicitement la 42.
Cette dernière indication pourrait être décisive, à condition
espace, qui serait l’unique place publique de la ville. Or on ne peut pas exclure que le mot soit employé ici non comme un toponyme mais comme un terme générique. Théodoret mentionne également une « poterne occidentale », dont la
clé du problème. Pour l’instant mieux vaut rester prudent et se contenter d’enregistrer la mention de la proximité par rapport à l’Oronte. Le fait que la Grande Église n’ait apparemment pas été atteinte par le séisme de 458, qui a frappé essentiellement la Ville Neuve, peut être un indice d’une localisation dans la Vieille Ville43. D’après Malalas, l’église aurait été construite à l’emplacement
que soit le « témoignage » de Malas sur les constructions constantiniennes (voir infra), cette indication n’est pas invraisemblable44.
ecclésiale ancienne, dans M.-A. Vannier, O. Wermelinger, Gr. Wurst [dir.], Anthropos Laikos. Mélanges Alexandre Faivre, Fribourg, 2000, p. 119-130 : p. 128), mais il ne l’est pas à Antioche. Sur l’introduction du nom de Concordia dans la tradition occidentale latine, voir Deichmann, Das Oktogon, p. 43-44 et p. 50-52.
41. Contrairement à ce que pourrait laisser croire une note de la récente traduction commentée de la Vie de Constantin parue aux Sources Chrétiennes (note à III, 50, 2, p. 415) qu’il faut corriger sur ce point,
de l’Oronte et jouxtait le palais impérial, et la mosaïque dite de Yaqto ne peut être invoquée à l’appui de cette thèse. Les pages consacrés par Gl. Downey à la localisation de l’église (Antioch, p. 346-349) forment un savant tissu d’erreurs et d’interprétations abusives. Voir en dernier lieu Mayer, Allen, Churches, p. 72, avec la bibliographie antérieure.
42. Théodoret, HE V, 37, 4. Cf. Martin, Sources, p. 418, Mayer, Allen, Churches, p. 73.
43. Mayer, Allen, Churches, p. 152. 44. La « Grande Église » d’Alexandrie, aménagée sous le règne de
Constance (pour la chronologie des travaux, cf. A. Martin, Athanase d’Alexandrie et l’Église d’Égypte au e siècle (328-373), Rome, 1996, p. 148) succèderait d’après Épiphane à un bain désigné d’abord comme « (bain d’) Hadrien » puis « de Licinius » ou encore « impérial » (Épiphane, Panarion 69, 2, 2, GCS 37, p. 153, l. 16-23, cf. J. Gascou, Les églises d’Alexandrie : questions de méthode, dans Alexandrie
D’après les évocations brièvement esquissées qu’en a données Eusèbe – qui sont antérieures de cinq ans pour l’une, de deux au moins pour l’autre, à la dédicace de
délimitant un vaste espace clos, et comportait lui-même un noyau central entouré d’espaces annexes45. Le noyau
46. Dans ses autres occurrences
le Temple de Jérusalem47, soit une salle d’un palais48. Le choix de ce mot renvoie donc à une représentation
associée à une conception théologique exaltant la souve-raineté du Christ49 50.
médiévale, 1, Le Caire, 1998, p. 23-44 : p. 32-33). La popularité constante, voire croissante, des pratiques thermales à Antioche et plus généralement dans le Levant romain durant l’Antiquité tardive est bien attestée (Fournet, Thermes, p. 218-220) et l’on ne tirera de cette substitution éventuelle d’une église à un bain aucune conclusion en termes d’évolution des pratiques corporelles et des comportements.
En revanche, on ne saurait surestimer l’importance symbolique de la
il s’agit d’un signal fort de reconnaissance de cette communauté, induisant en elle-même une forme de marginalisation des tenants des autres religions. C’est ce qui peut au reste expliquer que Malalas ait pris soin d’enregistrer cette circonstance, s’il ne l’a pas inventée.
45. L’interprétation architecturale de ces deux descriptions est l’objet de débats et les comparaisons avec des réalisations architecturales observables permettent surtout de préciser les enjeux de ces discussions en termes d’effet visuel et spatial (cf. p. ex. Goilav, Proposal, avec la bibliographie antérieure). Nous nous cantonnerons à la mise en
46. Dans chacun des deux passages, la syntaxe du texte montre clairement
G. J. M. Bartelink (Maison de prière comme dénomination de l’église en , dans RÉG, 84, 1971,
p. 101-118 : p. 115) à l’égard des propositions de L. Voelkl (Kirchenbauten, p. 56-67) sont, en ce qui concerne ce passage précis, irrecevables.
47. Préparation évangélique IX, 34, 13.48. Eus.,VC III, 15, 2, VC III, 49, 1, LC prologue, 4 (dans ces trois cas,
le mot est au pluriel). 49. Cf. Voelkl, Kirchenbauten, p. 191-199. 50.W. E. Kleinbauer (The Origin and Functions of the aisled tetraconchs
Churches in Syria and Northern Mesopotamia, dans DOP, 27, 1973,
principe à un volume, non à une surface, mais il faut ici le comprendre dans son sens étymologique de « à huit faces » : en élévation – soit dès le niveau du sol soit au-dessus des volumes des espaces annexes, et
parois verticales visibles. Sur ce choix planimétrique, voir Deichmann, Das Oktogon, 1972, p. 55-56 ; sur les précédents constitués par les salles d’apparat à plan centré ou plus précisément octogonal, attestées
Early Christian and Byzantine Architecture, 4e éd, New Haven, 1986, p. 77. Le plan octogonal est également attesté dans le domaine de l’architecture thermale, en particulier pour les grandes salles froides, lieux de rencontre et d’apparat (ex. : Thermes du Sud à Bostra ; bains d’Adraha/Deraa ; « bains de Zénobie » à Palmyre ; « Bath C », à Antioche, dans
e s. ; cf. Fournet, Thermes, p. 193, p. 209-210, p. 229, p. 232). Comme on l’a vu supra, Malalas signale que la Grande Église a été substituée à un complexe thermal désaffecté
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
AnTard , 22, 2014 À ANTIOCHE SUR L’ORONTE, L’ÉGLISE DE CONSTANTIN ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE 129
Autour se développaient des espaces annexes. L’ambiguïté des descriptions d’Eusèbe doit ici être soulignée. Le mot
ou non, largement ouvert sur un autre51. Il n’est pas possible de savoir, à la lecture de la seule description, si les annexes sont des éléments constitutifs de l’espace ecclésial proprement dit, qu’il faudrait imaginer, par exemple, d’après l’église San Vitale de Ravenne52, ou s’il
précédée par le démantèlement de ces bains, mais on peut se demander s’il ne s’agit pas d’une transformation réutilisant le gros œuvre d’une salle octogonale.
51. Eusèbe l’emploie pour désigner des aménagements de l’atrium de la Basilique du Saint-Sépulcre (VC III, 39).
52. Cf. Goilav, Proposal, p. 169-170.
s’agit de locaux adjacents, spatialement distincts du corps central53. Pour mémoire et pour bien mettre en évidence l’ambiguïté du texte, on rappellera aussi qu’à Antioche
e siècle, le mot désigner les bras de l’église cruciforme mise au jour sur le site de Kaoussié54.
53.Dans son éloge descriptif de la basilique de Tyr, Eusèbe utilise également
des aménagements extérieurs à l’église, mais communiquant avec elle. En effet l’église est de plan basilical et les collatéraux, désignés comme des « portiques », ont été décrits, de même que la nef centrale,
communiquent avec la basilique par des passages (HE X, 4, 45). 54. IGLS III, 1, 774 (mars 387) ; IGLS III, 1, 776 ; IGLS III, 1, 777. Sur
Churches, p. 32-49
nous paraît cependant très douteuse).
Fig. 1 – Antioche dans l’Antiquité tardive (G. Poccardi, d’après R. Stillwell [dir.], Antioch-
on-the-Orontes II – excavations of 1933-1936, Princeton, 1938, p. 215, pl. I).
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
CATHERINE SALIOU AnTard , 22, 2014130
Vie de Constantin est encore plus vague. L’apport de cette seconde description réside dans l’indication de deux niveaux superposés d’espaces annexes, mettant en évidence la grande hauteur de l’octogone central, dont on doit supposer que sa couverture au moins dominait l’ensemble du complexe. Un espace octogonal peut être couvert soit par un comble à huit pans – c’est ainsi qu’est restituée la couverture de la salle centrale octogonale de l’église de pèlerinage du monastère de Syméon Stylite l’Ancien55
« sphéroïde » suppose une couverture en coupole56, mais comme on l’a vu, il est probablement entré dans l’usage postérieurement au e siècle, et il peut donc s’appliquer
il était couvert dans son premier état57. On ignore aussi si l’autel se trouvait dans l’espace central octogonal ou dans un des espaces annexes. On sait en revanche que cet autel était tourné non vers l’est, mais vers l’ouest58, conformément à une tendance caractéristique du e siècle et des fondations constantiniennes59.
La Continuatio Antiochensis Eusebii date le début des travaux de 32760. D. Woods, toutefois, a fait remarquer qu’un certain nombre d’événements signalés dans cette chronique le sont avec une erreur de deux ans61, on ne peut donc pas exclure que les travaux aient commencé dès 325. La dédicace eut lieu le 6 janvier 34162, et intervint d’après Théophane six ans après le début du chantier, qu’il faudrait alors situer en 334/335. S’appuyant comme Théophane sur la Continuatio, la Chronique ad annum 724 mentionne une durée de 15 ans pour les travaux63, ce qui s’accorde avec un début des travaux en 327. Toutefois, il pourrait s’agir d’une correction de sa source de la part du
55. Cf. J.-P. Sodini, J.-L. Biscop, Qal‘at Sem‘an et Deir Sem‘an : naissance et développement d’un lieu de pèlerinage durant l’Antiquité tardive, dans J.-M. Spieser (dir.), Architecture paléochrétienne, Gollion, 2011, p. 11-59 : p. 44-51.
On some post-classical Greek architectural terms, dans Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 77, 1946, p. 22-34 : p. 23-26.
57. Comme le signale Gl. Downey (Antioch, p. 344, n. 113), l’indication de Malalas selon laquelle l’église fut détruite en 526 non par les secousses du séisme mais par l’incendie qui suivit suggère une couverture en bois.
58. Socrate HE V, 22, 53. 59. S. De Blaauw, Konstantin als Kirchenstifter, dans A. Demandt,
J. Engemann (dir.), Konstantin der Größe. Geschichte, Archäologie, Rezeption, Trèves, 2007, p. 163-172 : p. 166-168. Voir aussi, à propos de la basilique du Saint-Sépulcre, Eus. VC III, 35, 1.
60. Cf. Burgess, Studies, p. 166. 61. D. Woods, , dans Irish
Theological Quarterly, 67, 3, 2002, p. 195-223 : p. 196, n. 3. 62. Sur cette date et les discussions auxquelles elle peut donner lieu, cf.
Burgess, Studies, p. 138-139 et p. 239, n. 62 ; S. Parvis, Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy, 325-345, New York / Oxford, 2006, p. 160-161.
63. Cf. Burgess, Studies, p. 158.
sur ces diverses indications pour préciser la chronologie des travaux. Une indication fâcheusement ambiguë est fournie par Socrate :
« …l’église, que le père des Augustes avait commencé
mort, neuf ans après qu’on en eut jeté les fondations64 ».
commencé en 33165 – interprétation incompatible avec les autres témoignages dont on dispose –, soit que la mort de Constantin est intervenue durant la dixième année
32766. Sozomène précise que le projet était bien un projet constantinien et que sa réalisation fut le fait de Constance, agissant en tant que subordonné de son père et son vivant, donc en tant que César67. Tel est le sens d’une épigramme citée par Malalas comme se rapportant à la Grande Église68. De fait, Constance a séjourné en tant que César à Antioche, peut-être dès 33369. Les deux évocations d’Eusèbe sont trop vagues pour qu’on puisse en déduire l’état du chantier en 336 et 337. Les travaux se sont certai-
64. Socrate, HE II, 8, 2 (trad. P. Péruchon, P. Maraval, SC 493).65. Cf. Downey, Antioch, p. 343, n. 106 ; Mayer, Allen, Churches, p. 133. 66. Cf. Martin, Sources, p. 403-404.67. Sozomène, HE
et comme l’église de ce lieu [scil. Antioche], que Constantin avait commencé à faire construire, surnaturelle de grandeur et de beauté,
achevée… ».68. Malalas XIII, 17, p. 250, l. 85-88 Thurn. Cf. S. Agusta-Boularot,
Malalas épigraphiste ? Nature et fonction des citations épigraphiques dans la Chronique, dans Recherches, p. 97-135 : p. 127-129, avec la bibliographie antérieure. L’attribution de cette épigramme à la Grande Église a été contestée par D. Woods, (Malalas, Constantin and a church inscription from Antioch, dans Vigiliae Christianae, 69, 2005, p. 54-62). En effet, le texte même de cette épigramme a été très maltraité par la traduction manuscrite, et la mention de l’empereur Constantin dépend en fait d’une correction de la leçon de l’unique manuscrit. Toutefois, si l’on admet l’interprétation proposée par D. Woods, selon laquelle l’épigramme se rapporterait en fait à une église construite à l’initiative de Constance II sous la supervision de Gallus, il faut alors rendre compte de ce que Malalas ou sa source associe bien l’inscription
aisée (cf. Mayer, Allen, Churches, p. 116-117). Comme le signale A. Martin (Sourcesêtre rapprochée des indications d’Eusèbe selon lesquelles les églises
VC III, 50, 2 ; LC dans la dédicace. Il faut donc suivre D. Feissel qui, dans sa contribution aux actes du XVIe Congresso Internazionale di Archeologia Christiana (à paraître), conclut qu’il faut conserver la correction du nom de Constance en Constantin, en s’appuyant notamment sur la proximité entre le contenu de cette épigramme et la formule de Sozomène.
69. Cf. Downey, Antioch, p. 334. Voir aussi P. Maraval, Constantin, Paris, 2013, p. 22, avec les références aux sources.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
AnTard , 22, 2014 À ANTIOCHE SUR L’ORONTE, L’ÉGLISE DE CONSTANTIN ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE 131
nement poursuivis après la mort de Constantin puisque la dédicace n’eut lieu qu’en 34170. Constance a pu prendre une part plus ou moins active à la mise en œuvre archi-tecturale du projet, ou du moins le superviser. Toutefois la responsabilité effective des travaux, d’après l’épigramme citée par Malalas, aurait été le fait, non de Constance lui-même, mais de son cubiculaire Gorgonios71.
La décision même de la construction de l’Église d’Or relève quant à elle de la volonté de Constantin. D’après Eusèbe, qui emploie exactement les mêmes termes dans son discours des Tricennales et dans la Vie de Constantin, c’est en tant que « métropole de l’Orient », « placée à la
d’une telle faveur (cf. annexe 1). La construction de l’Église d’Or signale donc la reconnaissance par le pouvoir impérial de la prévalence de la ville d’Antioche sur l’ensemble du diocèse d’Orient72. Elle apparaît ainsi comme une conséquence de la mise en place en 314 de l’organisation diocésaine73. L’inventaire des fondations constantiniennes74 ne permet cependant pas de parler d’une politique systématique de la part de Constantin d’évergé-tisme religieux à l’égard des capitales de diocèses. Il est possible que l’empereur n’ait fait que répondre favora-blement à une demande de l’évêque d’Antioche, par exemple, qui aurait lui-même mis en avant le statut supra-provincial d’Antioche dans sa pétition.
Dans le cours du e siècle, l’église fut pillée et fermée au culte par Julien, puis servit d’enjeu entre les divers groupes chrétiens de la ville jusqu’au début du e siècle75. Les sources fournissent quelques points de repère sur
70. Dans la Vie prémétaphrastique de Paul le confesseur, évêque de Constantinople (BHG 1472), à la tonalité anti-arienne très marquée, le rôle de Constance est réduit à l’organisation de la dédicace (PG 104, col.121 B = Photius cod. 257, 474b Bekker).
71. On ne peut donc qu’exprimer les plus grandes réserves à l’égard d’entreprises comme celle de W. E. Kleinbauer dans son article Antioch : dans la mesure où la part prise par Constance dans l’élaboration du projet n’est pas aisée à déterminer et peut avoir été
de façon assurée, il paraît extrêmement périlleux d’utiliser la Grande Église d’Antioche dans le cadre d’une démonstration de l’inventivité architecturale de Constance.
72. Cette primauté fonde celle de l’évêque d’Antioche sur l’ensemble des évêques du diocèse, à l’exception de ceux d’Égypte. La prééminence de l’église d’Alexandrie sur les églises d’Égypte, de Lybie et la Pentapole
reconnaît en revanche apparemment à Antioche que les privilèges d’une métropole provinciale. Cf. G. Alberigo, J.A. Dossetti, P.-P. Joannou (dir.), Les conciles œcuméniques (trad. A. Duval et alii), Paris, 1994, II, 1, p. 40-42.
73. Cf. C. Zuckerman, Sur la liste de Vérone et la province de Grande Arménie, la division de l’empire et la date de création des diocèses, dans V. Déroche, D. Feissel, C. Morrisson, C. Zuckerman (dir.), Mélanges Gilbert Dagron = T&Mbyz, 14, Paris, 2002, p. 617-637.
74. Cf. G.T. Armstrong, Constantine’s Churches, dans Gesta, 6, 1967, p. 1-9 : l’évergétisme religieux de Constantin a concerné en Occident Rome, Aquilée, Trèves et Cirta, en Orient, outre Constantinople, Nicomédie, la Palestine, Héliopolis de Phénicie et Antioche.
75. Cf. Mayer, Allen, Churches, p. 77-78.
un complexe épiscopal dont on peut supposer qu’il s’est développé progressivement autour de l’église, comportant un hospice76, un secretarium d’été77 attesté en 444, une résidence dotée d’un secteur thermal, divers autres locaux administratifs78. La dépouille de Syméon le Stylite y fut déposée en 45979, avant d’être transférée dans son propre martyrion – qui n’était peut-être toutefois en réalité qu’une chapelle martyriale ajoutée à la Grande Église80. Dans la Vie syriaque du saint, datée par son colophon du 24 avril 473, la Grande Église est désignée comme « la sainte et grande église que Constantin avait construite », ce qui montre qu’elle continuait à porter la mémoire de
e siècle81
pour le premier tiers du e siècle encore, la Chronique de Malalas.
De l’église de Constantin à l’église d’Ephrem
Dans sa Chronique, Malalas consacre un long dévelop-pement au règne de Constantin, dont il évoque notamment un séjour qu’il aurait effectué à Antioche82 (annexe 2). L’accumulation de confusions et d’erreurs présentée par ce
83. De plus, Malalas situe le supposé séjour de Constantin à Antioche à l’issue d’une expédition contre les Perses qu’il préparait, certes, avant de mourir, mais qui n’a jamais eu lieu, et fournit deux indications de datation – une date consulaire à peine écorchée84 et une date dans l’ère d’Antioche85 – corres-pondant toutes deux à 335, tout en plaçant l’épisode,
76. Voir annexe 2 et nos remarques dans la suite de l’article.77. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, VII,
p. 325 Cf. Downey, Antioch, n. 76 p. 467 et supra, n. 31. 78. Le corpus sévérien est particulièrement riche pour la connaissance de
ce complexe épiscopal : cf. Fr. Alpi, La Route royale, Beyrouth, 2009, p. 150. Sur le secteur thermal de la résidence, cf. Vie anonyme de Sévère, dans S. Brock, B. Fitzgerald, Two Early Lives of Severos, Patriarch of Antioch, Liverpool, 2013, p. 126, § 58. Sur l’apport de la version syriaque de la Vie de Pélagie la Pénitente, voir Mayer, Allen, Churches, p. 78.
79. Mayer, Allen, Churches, p. 74. 80. Voir la discussion de Mayer, Allen, Churches, p. 104-106. 81. Cf. R. Doran, The Lives of Simeon Stylites, Kalamazoo, 1992, p. 193. 82. En réalité, Constantin n’a jamais séjourné à Antioche (cf. P. Maraval,
Constantin le Grand, empereur romain, empereur chrétien, 306-337, Paris, 2011, p. 292).
d’un second comitatus (XIII, 4) est obscure, peut-être Malalas pense-t-il à une seconde comitiua, ou dignité de comte (de second rang ?). Ce
dignité du représentant de l’État rejaillit sur la cité dans son ensemble. La mention des delegatores attend aussi aussi d’être expliquée.
Iulius Constantius (cf. E. Jeffreys Chronological structures in the chronicle, dans Studies, p. 111-166 : p. 146 ; R.S. Bagnall, A. Cameron, S.R. Schwartz, K.A. Worp, Consuls of the Later Roman Empire, Atlanta, 1987, p. 204-205).
85. L’an 383 dans l’ère d’Antioche correspond au e s. à la période qui s’étend du 1er octobre 334 au 30 septembre 335. E. Jeffreys, Chronological structures in the chronicle, dans Studies, p. 151.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
CATHERINE SALIOU AnTard , 22, 2014132
dans son récit, avant le voyage d’Hélène en Palestine et la fondation de Constantinople. La date de 335 est celle que Théophane semble indiquer pour le début des travaux de la Grande Église (supra) : soit cette date est issue de la lecture de Malalas par Théophane ou ses sources, soit Malalas et Théophane sont deux témoins distincts d’une tradition plus ancienne dont la valeur historique serait d’autant plus grande. L’analyse du passage de Malalas ne
parties en effet s’y distinguent. La première est consacrée avant tout aux monuments de Constantin à Antioche avec quelques références à des événements pseudo-histo-riques, sans aucune indication explicite de datation ; la phrase « cette statue se dresse encore de nos jours » signale, plutôt qu’une intervention d’auteur de Malalas en tant que témoin oculaire, l’utilisation d’une source écrite qui comportait déjà cette mention86. La deuxième partie,
signalées, est consacrée à la nomination du premier comte d’Orient87, et s’inscrit ainsi dans un ensemble de références dont la présence dans la Chronographie fait penser que Malalas faisait partie à Antioche de l’du comte d’Orient88. Il semble que le chronographe ait combiné en réalité deux notices différentes, provenant de sources distinctes, et ait inséré le développement ainsi constitué dans son récit sans tenir compte des données chronologiques qu’il pouvait contenir, puisqu’il le place avant le voyage d’Hélène en Terre Sainte en 326. Quoi qu’il en soit, on se gardera d’en tirer argument, dans un sens ou dans l’autre, pour la datation du début des travaux de la Grande Église.
Un premier groupe d’activités relevant de l’aména-gement et de l’embellissement urbain est lié directement à la construction de l’Église d’Or. Le premier gouverneur chrétien de la province de Syrie – non attesté par ailleurs et dont l’historicité est fort douteuse, mais ce n’est pas le problème ici – est chargé par Constantin de suivre les chantiers de construction de l’église et de l’hospice qui lui est associé. Ce détail n’a aucune valeur chrono-logique, il montre simplement qu’aux yeux de Malalas ou de sa source Grande Église et hospice constituaient un ensemble fonctionnel indissociable, et devaient donc avoir été fondés en même temps. Lors des travaux de construction de l’hospice, le gouverneur fait fondre une statue de Poséidon qui assurait la fonction de talisman contre les séismes – comme de nombreuses statues dans
86. Cf. C. Saliou, Statues d’Antioche de Syrie dans la Chronographie de Malalas, dans Recherches, p. 69-95 : p. 72.
87. La référence à Félicianus, premier comte d’Orient en 335, est extrêmement douteuse, même si l’on connaît un Felicianus consul en 337 (cf. T. D. Barnes, The New Empire of Diocletian and Constantine, Cambridge Mass, 1982, p. 142 ; E. Jeffreys, Chronological structures in the chronicle, dans Studies, p. 161).
88. B. Croke, Malalas’life, dans Studies, p. 1-25 : p. 10-11.
la Chronique de Malalas89 – et la transforme en une statue de Constantin. L’existence d’une statue de Constantin à Antioche n’est certes pas douteuse90, mais l’épisode en lui-même n’a aucune raison d’être authentique. Sa fonction est de marquer le début de la dépaganisation du paysage urbain antiochéen, dans une perspective apolo-gétique d’un point de vue chrétien, mais peut-être aussi dans une perspective polémique et critique du point de vue des tenants des religions traditionnelles, puisque la suite de l’histoire de la ville, marquée par une série de tremblements de terre dévastateurs, montre qu’elle avait bien besoin d’une protection contre les séismes.
Les autres opérations édilitaires mentionnées par Malalas sont liées à la nomination du premier comte d’Orient, associée à la transformation du sanctuaire des Muses en prétoire. Malalas attribue de plus à un
« basilique » portant son nom à un sanctuaire d’Hermès. Or d’après Libanios le culte d’Hermès était encore célébré à Antioche au temps de Julien91. De fait, comme le soulignait déjà Gl. Downey92, on ne connaît pas par
Constantin93 94, préfet du prétoire
95 à Antioche96. Malalas commet
mentionnée à plusieurs reprises dans les récits relatifs à l’histoire de la ville. Évagre, qui écrit à l’extrême
e siècle, rappelle, parmi d’autres construc-tions attribuées à des hauts fonctionnaires du règne de Théodose II, la construction par Zoïlos, d’un « portique
89. A. Mofatt, A record of public buildings and monuments, dans Studies, p. 87-109 : p. 107-108.
90. La mention de l’inscription Bono Constantino pourrait correspondre à la transcription tronquée d’une inscription latine de l’époque constantinienne comportant la formule bono rei publicae (sur ce type d’inscription, cf. Y. Maligorne, « Bono reipublicae natus » : une louange impériale sur quelques monuments de l’Antiquité tardive (à propos d’une inscription de Lancieux : CIL, XIII, 8994 = XVII-2, 420a), dans Revue archéologique de l’Ouest, 25, 2010, p. 291-304, mais il s’agit plus probablement d’une citation légèrement déformée d’une formule d’acclamation d’origine latine transcrite en grec dont l’usage est attesté au e s. en Orient ; Malalas ou sa source aurait soit inventé une inscription dans le style de son temps soit lu une inscription (ou un ) tracée en au e ou au e s. sur la base de la statue (cf. D. Feissel, Bulletin Épigraphique, dans RÉG, 119, 2006, no 529, p. 749-750, avec les références aux sources).
91. Cf. Libanios, Or. XV, 79. 92. Downey, Antioch, p. 651-653.
Le origini della prefettura del pretorio tardoantica, Rome, 2003, p. 356-371.
94. Cf. PLRE 95. Sur cette périphrase, cf. C. Saliou, Dire l’espace basilical, de
Vitruve aux gens de Nabha, à paraître dans les actes du colloque Dire l’architecture (Aix-en-Provence, 2010).
96. Downey, Antioch, p. 433-434. Cf. Zosime, Histoire nouvelle V, 2, 8.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
AnTard , 22, 2014 À ANTIOCHE SUR L’ORONTE, L’ÉGLISE DE CONSTANTIN ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE 133
97. Sous le règne d’Anastase,
émeute, on apprend à cette occasion qu’elle jouxtait le prétoire du comte d’Orient, puisque le feu allumé par les émeutiers se communiqua de la « basilique » au prétoire98. Anastase la reconstruisit99. Dans le récit par Malalas de la campagne de reconstruction consécutive au séisme de
un point de repère permettent de localiser l’église de la Théotokos100. Quelles que soient sa forme architec-turale exacte et les fonctions qu’elle pouvait assurer101,
la ville de l’Antiquité tardive, étroitement lié au prétoire du comte d’Orient. L’anachronisme commis par Malalas ou sa source remplit au moins deux fonctions : la plus obvie est d’attribuer le début du processus de dépagani-sation de l’espace urbain antiochéen au règne du premier empereur chrétien, en ce sens l’épisode est cohérent avec celui de la fonte de la statue de Poséidon ; il s’agit aussi de faire remonter à cette époque et à la création des diocèses l’origine d’un des principaux monuments d’Antioche aux e- e siècles, étroitement lié au prétoire du comte
deux fois, dans chacune des deux parties du passage : on aimerait pouvoir déterminer si cette répétition montre que
à notre sens par Malalas, ce qui soulignerait l’importance
elle est le fait du compilateur, dans un effort de mise en cohérence de son propre récit.
Le récit de Malalas, tout entaché d’anachronismes et
certains éléments de l’espace urbain antiochéen ont pu porter la mémoire de Constantin et de l’époque constan-tinienne au moins jusqu’au début du règne de Justinien. Eusèbe signalait déjà que la décision de construire l’Église d’Or marquait la reconnaissance par Constantin de la position éminente de la ville dans le cadre de la nouvelle organisation de l’empire en diocèses. Le récit de Malalas met en évidence l’importance aux yeux des Antiochéens du statut de capitale supra-provinciale que leur a valu la création des diocèses et du prestige supplé-mentaire qu’ils pouvaient tirer du titre de comte d’Orient
97. Évagre, HE I, 18. Les traducteurs de la collection SC écrivent « Portique royal », ce qui implique qu’il s’agit du nom propre de
SC 542, p. 184). Il faut préférer sur ce point la traduction de M. Whitby (The Ecclesiastical History of Evagrius Scholasticus, Liverpool, 2000, p. 45) qui rend la périphrase par le mot basilica.
98. Malalas, XVI, 6, p. 325 l. 10-17 Thurn.99. Malalas, XVI, 8, p. 325, l. 30-31 Thurn.100. Malalas, XVII, 19, p. 351, l. 49-51 Thurn.
de plan basilical ou à un simple portique. Cf. Gl. Downey, The
Classical Literature, dans AJA, 41, 1937, p. 194-211.
porté par le représentant du pouvoir impérial. À cet égard la Grande Église apparaît comme un élément au sein d’un ensemble progressivement constitué, comportant une statue et son inscription, le prétoire du comte d’Orient et une « basilique » associée topographiquement à ce prétoire et, au prix d’un anachronisme, narrativement au règne de Constantin.
La Grande Église de Constantin fut détruite lors du tremblement de terre de 526. Dans la Chronique du pseudo-Zacharie est mentionnée la dédicace, après sa reconstruction par l’évêque Ephrem, d’une église désignée comme « the church that is rounded in face »102. Cette épithète est la traduction littérale de l’épithète
Elle peut être simplement descriptive, ou avoir une valeur
103, ce qui n’exclut pas au reste que cette désignation ne lui ait été donnée qu’après sa reconstruction, puisqu’elle n’est connue que par des sources elles-mêmes posté-rieures à cette reconstruction104. Cette église assure en tout cas la fonction d’église principale de la ville, elle est à ce titre susceptible d’être désignée comme la « très sainte église105 », voire comme l’Église par excellence,
106
suppose quant à lui une couverture en coupole107. De fait, à propos de la « très sainte église » d’Ephrem, Évagre
108. Cette église, en usage durant tout le e siècle, après la reconstruction de la ville par Justinien, devait donc se trouver dans les limites de l’enceinte de Justinien ( ), c’est-à-dire en rive gauche. Le témoignage de Procope
indique que Chosroès descendit de la Citadelle, sur la montagne d’Antioche, pour parvenir à l’Église, mais non
102. Ps. Zach. X, 5a, cf. G. Greatrex (dir.), The Chronicle of Pseudo-Zachariah Rhetor: Church and War in Late Antiquity, Liverpool (Royaume-Uni), 2011, p. 412-413. Cf. Michel le Syrien, IX, 24, trad. Chabot, 2, Paris, 1901, p. 207.
103. Contra Mayer, Allen, Churches, p. 74-75. Une étude philologique précise des sources en langue syriaque devrait permettre de trancher la question.
104. Cf. supra, n. 17.105.Évagre, HE106. Au e s., Procope remarque que « Église » est le nom propre d’un des
lieux de culte antiochéens (Bell.
de la citadelle vers le lieu de culte que l’on appelle “Église” »), cf. ibid. 9, 17 ; 10, 6 ; Évagre le Scholastique, HE IV, 25, d’après Procope.
107. Cf. supra, n. 56. 108. Évagre, HE VI, 8. Évagre évoque dans ce passage l’utilisation de
bois, pour étayer la construction, mais peut-être aussi dans la mise en
de ce passage, cf. M. Whitby, The Ecclesiastical History of Evagrius Scholasticus, Liverpool, 2000, p. 298-299 et note 29.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
CATHERINE SALIOU AnTard , 22, 2014134
qu’il franchit l’Oronte109. La reconstruction de l’église a été suivie d’une nouvelle dédicace, qui a peut-être
Vie
e et peut-être même au début du e siècle110, n’est attesté à notre connaissance par aucune source plus ancienne, en sorte que l’on peut se demander s’il ne s’agit pas d’un anachronisme de la part du rédacteur de la Vie : le nom de « Pénitence » pourrait être celui que portait l’église reconstruite par Ephrem111. Une dédicace est un bon moment pour le choix d’un nouvelle désignation et un tel
109. Procope, Bell. II, 9, 14 (cité supra, n. 106).110. Cf. Mayer, Allen, Churches, p. 106.111. J. Gascou, dans un article fondateur consacré à l’onomastique
ecclésiale, a rassemblé plusieurs exemples tendant à montrer que les noms propres renvoyant à des abstractions sont un trait archaïque, et que ces désignations, au e s., n’étaient plus comprises pour ce qu’elles étaient (J. Gascou, Notes d’onomastique ecclésiale ancienne, dans ZPE, 96, 1993, p. 135- 140 : p. 138-139). Certaines de ces désignations, toutefois, ne sont attestées qu’à une époque relativement tardive (« Paix et Bénédiction » à Arsinoé en 477, « Madame et Lumineuse » ou « Madame » et « Lumineuse » à Hermopolis en 498, « Anastasia » à Hermopolis à partir de 493), ce qui peut bien être évidemment le résultat du hasard des sources, et le nom de Sophie pour la Grande Église de Constantinople n’est devenu courant qu’au e s. (ibid.). Il faut aussi faire la part d’éventuelles différenciations régionales : il n’est pas impossible qu’une pratique onomastique devenue désuète à Constantinople soit toujours vivante ou susceptible d’être remise en vigueur à Antioche.
nom, pour une église reconstruite après un séisme, serait cohérent avec l’interprétation des catastrophes subies par Antioche en termes de châtiment divin pour idolâtrie attestées par ailleurs112. De fait, c’est après le séisme de 528, et sous l’épiscopat d’Ephrem, que la décision fut prise de changer le nom de la ville en Théoupolis, celui d’Antioche ayant le tort de conserver la mémoire d’un souverain païen113. Quoi qu’il en soit, même si l’église reconstruite par Ephrem était bien celle qu’avait fondée Constantin, sa nouvelle dédicace avait dû lui conférer une nouvelle identité et contribuer ainsi à oblitérer quelque peu à Antioche la mémoire du premier empereur chrétien.
Univerité Paris 8 / EPHE
ville par les Perses dans la Vie ancienne de Syméon Stylite le Jeune (P. Van den Ven, La Vie ancienne de s. Syméon Stylite le Jeune : 521-592,
de conversion est attestée par l’exemple du monastère pachômien de Canope qui, installé à l’emplacement de sanctuaires païens dans un faubourg d’Alexandrie à la réputation sulfureuse, portait précisemént ce nom, attesté pour la première fois à son propos en 404 (cf. J. Gascou, Le monastère de la métanoia, disponible en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00001111/en/ [dernière consultation le 8 mai 2014]).
113. Downey, Antioch, p. 529-530.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
AnTard , 22, 2014 À ANTIOCHE SUR L’ORONTE, L’ÉGLISE DE CONSTANTIN ENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE 135
1- Les deux descriptions de l’église constantinienne d’Antioche par Eusèbe
Les termes identiques dans les deux descriptions sont en gras.
Eusèbe de Césarée, Triakontaetérikos IX, 14-15, GCS 7, p. 200-221 Eusèbe de Césarée, Vita Constantini III, 50, 1-2
. [Constantin faisait surgir des églises], parant la ville qui porte son nom de diverses églises de Dieu, honorant la capitale de la Bithynie d’une très grande et très splendide église,
Tels sont les monuments dont il embellit sa ville. Et il honora de même la capitale de la Bithynie de l’offrande d’une immense et admirable église […]
1
[…]
il ornait des mêmes (genres
plus puissantes des autres provinces
Et il mettait en valeur les
cités les plus puissantes des autres provinces grâce à aux beautés des oratoires (qu’il construisait),
Ayant distingué deux parties éminentes de l’Orient, l’un dans la province de Palestine,
l’autre dans la métropole orientale qui honore l’appellation tirée du nom d’Antiochos, dans cette dernière, parce qu’elle est à la tête de toutes les provinces de la région,
comme dans la métropole orientale à laquelle est échue l’appellation tirée du nom d’Antiochos : dans cette dernière, puisqu’elle est à la tête des provinces de la région,
,
il consacrait une chose divine et singulière, par sa taille et sa beauté
il consacrait une église qui était une chose singulière par sa taille et sa beauté
,
à l’extérieur, entourant l’ensemble du temple par de longs périboles, ,
à l’extérieur, après avoir entouré l’ensemble du temple par de longs périboles,
à l’intérieur, élevant la demeure du Seigneur à une hauteur prodigieuse en une
d’un décor chatoyant,
,
à l’intérieur, après avoir élevé à une hauteur prodigieuse le lieu de prière, formant une
,
et l’ayant enveloppée circu-lairement de pièces fort nombreuses et d’exèdres, il la couronnait de toutes sortes de beautés. .
enveloppé circulairement d’espaces, à l’étage et au sol, de tous côtés, qu’il couronnait aussi d’une abondance d’or en grande quantité, de bronze et aussi de toutes les autres sortes de matériaux luxueux.
.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
CATHERINE SALIOU AnTard , 22, 2014136
2- Constantin et Antioche dans le récit de Malalas
Des alinéas ont été introduits pour faciliter la lisibilité de l’ensemble.
Malalas XIII, 3-4 p. 244 l. 33-p. 245, l. 62 Thurn
Grande Église, gigantesque construction, après avoir fait abattre le bain dit du souverain Philippe : il s’agissait en effet d’un bain
construire d’autre part un hospice à proximité.
fut demandé par ce dernier de rester à Antioche et il acheva cette même basilique, alors que le souverain s’en retournait à Rome. Alors que le souverain Constantin s’apprêtait à quitter Antioche,
chrétien du nom de Ploutarchos. Ce dernier reçut l’ordre de suivre les travaux de construction de l’église et de la basilique. Ce même Ploutarchos, ayant trouvé pendant la construction de l’hospice la statue de bronze de Poséidon qui avait été érigée comme
du souverain Constantin, la faisant ériger à l’extérieur de son prétoire et faisant écrire au-dessous d’elle : « Bono Constantino ». Cette statue de bronze se dresse encore de nos jours.
Le même souverain promut pour la première fois dans la même grande cité des Antiochéens sous le consulat d’Illos et Albinos, en faisant pour lui du sanctuaire des Muses un prétoire, un comte d’Orient jouant en Orient le rôle du préfet des prétoires, un chrétien du nom de Félicianus, faisant grâcieusement don à cette cité des
Antiochéens, par sa divine décision, de la dignité d’un second comitatus, l’an 383 de la grande cité des Antiochéens. En effet auparavant il n’y avait pas de comte d’Orient en résidence à Antioche la Grande, mais quand la guerre commençait un delegatordelegator était dégagé de cette fonction. Le souverain Constantin quitta Antioche, en y laissant le préfet
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.