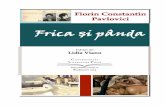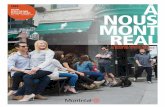Caseau Constantin à Byzance
-
Upload
sorbonne-fr -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Caseau Constantin à Byzance
1
@82. La trasmissione nel rituale costantinopolitano, � Béatrice Caseau (Sorbonne) B. Caseau Constantin à Byzance Constantin a joué à Byzance un rôle majeur en tant que premier empereur chrétien et
fondateur de Constantinople et il a été associé à de nombreux rituels et célébrations dans la
cité qu’il a fondée. Son prénom a été choisi par plusieurs empereurs pour le fils dont ils
espéraient qu’il leur succédât1. Il apparaît dans les généalogies fictives d’usurpateurs qui
veulent redorer leur blason, comme Basile le Macédonien2. Ses hauts-faits ont été rappelés à
chaque concile, en l’honneur de sa convocation du premier concile de Nicée3. Sa conversion
comme ses mesures en faveur du christianisme lui ont valu une place importante dans les
histoires ecclésiastiques tandis que les chroniqueurs comme Théophane ont enregistré tout
autant ses contributions à l’histoire religieuse que ses victoires, ses constructions et d’autres
évènements survenus durant son règne. Son règne figure comme le point de départ de
l’empire romain d’Orient, appelé empire byzantin par les historiens occidentaux depuis la
Renaissance. Sa stature est telle que tant en Orient qu’en Occident, on lui attribue des
constructions, comme Sainte-Sophie, qui ne datent pas de son règne. Le Constantin byzantin a
donc une identité particulière qui est faite de tout ce qui a été retenu de son règne ou lui a été
attribué. Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur les lieux de mémoire de Constantin
dans la cité qu’il a fondée et sur les rituels auxquels il est associé au Moyen âge. Certes la cité
elle-même est toute entière un lieu de mémoire puisque Constantin avait fait de
Constantinople une cité éponyme, imitant Alexandre et plusieurs empereurs romains4.
L’historien de la fin du 11e siècle, Jean Skylitzès parle parfois de « la ville de Constantin »
1 P . Magdalino éd. , New Constant ines : the Rhythm of Imperial renewal in Byzantium, 4th-13th centuries , Papers f rom the Twenty-Sixth Spring Symposium of Byzantine Studies , (St Andrews, March 1992), Aldershot 1994 ; compte-rendu par J . -Cl . Cheynet dans la Revue des é tudes byzantines , 53, 1995, pp. 372-373, où l ’auteur soul igne que les empereurs usurpateurs f i rent plus appel à l ’ image tutéla ire de Constant in pour leur f i ls que les empereurs sûrs de la f idél i té à leur dynast ie , comme les Comnènes. 2 A. Markopoulos , « Constant ine the Great in Macedonian Histor iography: Models and Approaches » , in P. Magdalino éd. , New Constant ines : the Rhythm of Imperial renewal in Byzantium, 4th-13th centuries , Papers f rom the Twenty-Sixth Spring Symposium of Byzantine Studies , (St Andrews, March 1992), Aldershot 1994, pp. 159-170. 3 Ch. Walter , L’iconographie des conci les dans la tradi t ion byzantine , Par is 1970; K. Corr igan, Visual Polemics in the Ninth-Century Byzantine Psal ters , Cambridge, 1992, p . 115. 4 G. Dagron, Naissance d’une capitale , Constant inople e t ses inst i tu t ions de 330 à 451 , Par is 1974 .
2
pour évoquer Constantinople5. Ses travaux d’extension et d’embellissement de la petite cité
de Byzance ont laissé leur marque sur la ville. On les retrouve mentionnées tant dans les
sources de la fin de l’Antiquité que dans la littérature patriographique du Moyen âge. Il fit
ainsi élargir le périmètre urbain et enserrer le nouvel espace dans une muraille qui était
toujours debout au Moyen âge et qui porte son nom6. Il fit construire des places publiques et
des monuments à sa gloire et qui portent son nom : un forum circulaire au centre duquel une
statue de lui-même surplombe une colonne monumentale, un palais, un mausolée à l’intérieur
des murs. Il n’oublia pas d’honorer aussi sa famille en renommant une place pour sa mère, en
établissant des statues des membres de sa famille comme le fameux groupe statuaire de ses
fils plus tard identifiés comme les tétrarques… Sa présence à l’intérieur de la ville médiévale
fut donc grande, grâce à ces investissements en monuments et ornements urbains auxquels
son nom est associé. Les images de Constantin, soit sculptées, soit peintes ou en mosaïques
étaient nombreuses dans la ville : toute personne passant par le forum le voyait en haut de sa
colonne ; il était présent à Saint-Sophie aux côtés de Justinien dans une mosaïque datant de
l’époque médio-byzantine, de 944, portant l’inscription : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, Constantin, le grand empereur parmi les saints7.
Plus durables encore que les bâtiments et les sculptures furent les rituels en l’honneur de
l’empereur fondateur. Ils ont permis au mythe constantinien d’évoluer et de se maintenir en
s’adaptant aux changements culturels. Certains de ces rituels remontent à Constantin lui-
même, d’autres ont été créés après sa mort. Conscient de sa grandeur, il n’est guère étonnant
qu’il ait mis en place des cérémonies pour rappeler son rôle dans l’histoire aux générations
futures et immortaliser la mémoire de son règne. Constantinople était naturellement le lieu
privilégié de certaines d’entre elles. Il choisit en particulier l’hippodrome, lieu traditionnel de
l’arrivée des triomphes et l’un des lieux des acclamations impériales pour faire commémorer
à la fois la dédicace de la cité et son rôle de fondateur.
Sur le chemin entre la porte Dorée et l'hippodrome, il fit construire une superbe place, au
milieu de laquelle s'élevait une colonne triomphale dans l'esprit de celles qui étaient élevées à
Rome. Des cérémonies, comme les grandes processions impériales ou religieuses utilisèrent
5 Ioannis Scyl i tzae Synopsis Historiarum , éd . I . Thurn, Berl in 1973, p . 239 ; t rad. Fr . par B. Flusin , annotée par J . -Cl . Cheynet , Jean Skyli tzès , Empereurs de Constant inople , Par is 2003, p . 202. 6 R. Janin, Constant inople byzantine. Développement urbain e t répertoire topographique , Par is , 1964, pp. 26-31 7 R. Mark et A. S . Cakmak, Hagia Sophia from the Age of Just inian to the Present , Cambridge 1992; R. Cormack, “The Emperor a t Saint-Sophia: v iewer and viewed”, in Byzance et les images , éds . A. Guil lou, J . Durand, Paris 1994, pp. 223-253.
3
cet espace.
Constantin avait pu envisager la cérémonie d’apothéose qu’il eut, comme nombre
d’empereurs romains, l’honneur de recevoir8 mais il ne pouvait pas entrevoir sa propre
canonisation et sa transformation médiévale en un saint byzantin. Il fournit cependant le cadre
de cette évolution en faisant construire un splendide mausolée à l'intérieur des murs
nouvellement établis. Il y fit placer sa tombe au milieu des cénotaphes des apôtres. Ce
mausolée transformé en église devient au Moyen Age un espace commémoratif, lieu de
célébrations liturgiques. Le mausolée servit de lieu de sépulture à la majorité des empereurs
jusqu'à Constantin VIII et un bref moment d’église cathédrale après la confiscation de Sainte-
Sophie par Mehmet II.9 Avant même que les icônes du couple mère fils de Constantin et
Hélène ne viennent embellir les églises byzantines, il s’est formé autour de la mémoire de
Constantin une série de rituels liturgiques dont on peut souligner l'importance tant pour la
notion de sainteté impériale que pour le mythe constantinien.
Suivons donc les rituels qui eurent lieu en ces trois lieux principaux de célébration de la
mémoire de Constantin, que furent l’hippodrome, la colonne monumentale du forum de
Constantin et le mausolée de l’empereur. Il conviendra d'ajouter quelques références aux
rituels liturgiques célébrés, à Constantinople comme ailleurs dans l'empire, à la mémoire de
l'empereur que l’histoire a parfois retenu sous le nom de Constantin le Grand.
I L'hippodrome Même si Constantin est associé à de nombreux bâtiments, encore au Moyen âge, à
commencer par la muraille qui était toujours visible, et par le Grand Palais dont plusieurs
bâtiments remontait à son époque, le principal et le plus ancien lieu de célébration ritualisée
de sa mémoire fut l’hippodrome. Si l’on se fie au témoignage de Jean Malalas, Constantin lui-
même aurait mis au point un cérémonial permettant de fixer pour les siècles suivants son rôle
de fondateur de la cité.
« Durant le règne [de Constantin], sous le consulat de Gallikanos et de Symmachos, la
Byzance d’autrefois fut rénovée. Le même empereur Constantin fit une longue procession,
allant de Rome à Byzance. Il restaura aussi le mur de jadis de cette cité, celui de Byzas, il
ajouta au mur une grande extension et l’ayant relié à l’ancien mur de cette cité, il ordonna
8 G. Fowden, "The Last Days of Constant ine: Opposi t ional Versions and Their Inf luence." The Journal of Roman Studies 84, 1994, pp. 146–170 ; S . Pr ice , « From Noble Funerals to Divine Cult : the Consecrat ion of Roman Emperors » , D. Cannadine, S . Pr ice éds. , Rituals of Royalty . Power and Ceremonial in Tradit ional Societ ies , Cambridge 1987, pp. 56-105. 9 Ph. Grierson, « Tombs and Obits of the Byzantine Emperors (337-1042), Dumbarton Oaks Papers , 16, 1962, pp. 1-63.
4
qu’elle soit appelée Constantinople. Il acheva également l’hippodrome, il l’orna d’ouvrages
de bronze et de toutes sortes, il y bâtit aussi un kathisma, semblable à celui de Rome, pour
que l’empereur puisse regarder [les courses]. […] Lorsqu’il eut tout achevé, il célébra une
course qu’il fut le premier à regarder. Pour l’occasion, il porta pour la première fois sur sa tête
un diadème orné de perles et de pierres précieuses, voulant accomplir la prophétie qui disait :
« Tu as porté sur ta tête une couronne de pierre précieuse10 ». En effet aucun empereur avant
lui n’a porté rien de tel. Il célébra une grande fête le 11 du mois de mai et d’Artémision,
l’année 378 suivant l’ère d’Antioche la grande, et il ordonna par un divin décret que le même
jour soit célébrée la fête anniversaire de sa cité et que l’on ouvre le 11 mai le bain public de
Zeuxippe près de l’hippodrome, de la Rhégia et du palais. Il fit de lui-même une autre image
en bois doré, portant dans sa main droite la Fortune de cette cité, elle-même dorée, qu’il
appela Anthousa, il ordonna que le jour même de la course de la dédicace cette statue de bois
entre [dans l’hippodrome] escortée par des soldats revêtus de chlamydes et de kampagia, tous
avec des cierges, et que le char suive le virage supérieur et aille jusqu’au stama en face du
kathisma impérial et que l’empereur du moment se lève et s’agenouille pour regarder l’image
de Constantin et de la Fortune de la cité. Cette coutume a été conservée jusqu’à
maintenant11. »
Cet extrait de la Chronographie qui montre ce qu’on retenait du règne de Constantin
quelques deux siècles après la mort de l’empereur, date les évènements de l’ère d’Antioche12.
Né vers 490 et mort vers 578, Jean Malalas était en effet originaire d’Antioche, mais il a vécu
à Constantinople à partir des années 530. Il a donc pu assister plus d’une fois à la cérémonie
de la dédicace dans l’hippodrome et il est un témoin important du cérémonial autour de la
statue dorée de Constantin dans l’hippodrome au VIe siècle. Selon ce rituel, Constantin aurait
ainsi forcé ses successeurs à lui rendre hommage, en s’agenouillant devant sa statue au
moment où ils rendaient hommage à la Tyche de la cité. Combien de temps cette cérémonie
dura-t-elle ? Les courses nombreuses durant la période antique ont certainement vu leur
nombre diminuer. Il est possible qu’il y ait eu une éclipse complète pendant les périodes les
plus sombres du début du Moyen âge, puis une reprise de courses organisées par l’empereur
10 Ps . 20 (21) :4 11 Ioannis Malalae Chronographia , XIII , 7-8, éd. I . Thurn, Berl in 2000 (CFHB XXXV, Series Berol inensis) , pp. 245-247. 12 R. Scot t , « The Image of Constant ine in Malalas and Theophanes » , in P . Magdalino éd. , New Constant ines : the Rhythm of Imperial renewal in Byzantium, 4th-13th centuries , Papers f rom the Twenty-Sixth Spring Symposium of Byzantine Studies , (St Andrews, March 1992), Aldershot 1994, p . 55-71.
5
aux 9e et 10 e siècles13. Au Moyen âge, les courses sont clairement sous le contrôle impérial14.
La célébration de la dédicace perdure au Moyen âge mais la procession et la vénération de la
statue dorée de Constantin décrite par Jean Malalas ne se retrouve pas dans le Livre des
Cérémonies, un ouvrage sur les rituels de la cour byzantine composé vers 945, mais
comportant différentes strates plus anciennes. Un chapitre du livre II s’intitule « au mois de
Mai, le 11, la course hippique en l’honneur de l’anniversaire de cette ville impériale gardée de
Dieu et capitale de l’empire a lieu ainsi. » Dans la description qui suit, il y a des mentions de
cheveux magnifiquement ornés de belles housses, de chants, de mimes, mais non d’une
procession de la statue de Constantin. L’empereur du moment est acclamé « pour de
nombreuses et bonnes années », mais on ne le voit pas se mettre à genoux devant le fondateur
de la cité dont on célèbre pourtant la dédicace. La fête décrite est agrémentée non seulement
de courses de chevaux, mais aussi de distributions alimentaires et de danses: « Lorsque les
acclamations ont pris fin, l’empereur envoie aux cochers victorieux des couronnes par
l’intermédiaire de l’actuarios et du second. … La faction demande la permission de sortir (de
l’hippodrome) et de danser sur la place, et ayant reçu la permission de l’empereur, ils s’en
vont sur la Mésè. L’empereur se lève ensuite et lorsqu’il est levé, la foule du peuple descend
et s’empare des légumes et des friandises mis en monceaux. En même temps, on apporte un
vaisseau porté sur un char et rempli de poissons et on jette le tout sur le sol dans
l’Hippodrome et la foule s’en empare aussi15. » Les courses ont pris le nom de « courses des
légumes » en raison de cette distribution alimentaire16. Les dernières courses ont eu lieu en
1200, l’hippodrome fut ensuite incendié et laissé en piteux état. A la suite de la quatrième
croisade, le pillage des statues que Constantin puis ses successeurs avaient fait venir effaça
quelque peu le souvenir de l’empereur en cet endroit. C’est en un autre lieu que la mémoire de
Constantin fut plus durablement entretenue : le forum et surtout la colonne qui portait un
temps sa statue.
II Le forum de Constantin et la colonne triomphale Lors de l’extension de la cité de Byzance sur ordre de Constantin, un déplacement du centre 13 C. Mango, « A History of the Hippodrome of Constant inople » , dans Hippodrom / Atmeydanı : I̊ s tanbul’un Tarih Sahnesi = Hippodrome - Atmeydani : a s tage for Is tanbul’s his tory, éd. Brigi t te Pi tarakis , Is tanbul , Pera Museum 2010, pp. 36-43. 14 G. Dagron, avec la col laborat ion d’A. Binggeli , M. Feathers tone et B. Flusin , « L’organisat ion et le déroulement des courses d’après le Livre des cérémonies » , in Travaux et Mémoires , 13, Paris 2000, pp. 1-200. 15 Constant in Porphyrogénète , Livre des Cérémonies , I I , 79, texte é tabl i e t t raduit par A. Vogt , Paris , 1967, p . 147. 16 G. Dagron, L’hippodrome de Constant inople . Jeux, peuple e t pol i t ique , Par is 2011, pp. 123-124.
6
de gravité de la ville fut opéré du nord vers le sud. Le nouveau centre névralgique était
désormais constitué du grand palais, que jouxtait l’hippodrome, de bains et d’une artère
monumentale, dotée de portiques et orientée est-ouest, la Mésè17. Sur cet axe, un grand forum
elliptique fut construit. Il était bordé de portiques et deux arcs monumentaux marquaient
l’entrée et la sortie de la place18. Au centre de cette vaste place, une colonne monumentale en
porphyre fut érigée19, au sommet de laquelle une monumentale statue de Constantin sous les
traits d’Apollon fut placée. La dimension solaire ne pouvait échapper aux visiteurs puisque la
tête de la statue portait des rayons du soleil. La colonne devint rapidement un repère spatial et
le centre de cérémonies, à commencer par celles de la dédicace. Jean Malalas rappelle ces
travaux opérés par Constantin et certaines des cérémonies qui ont eu lieu lors de la dédicace :
« Il bâtit encore un grand et beau palais semblable à celui de Rome, près de l’hippodrome,
avec le chemin du palais au kathisma de l’hippodrome par ce que l’on appelle le Kochlias, il
bâtit aussi un grand et très beau forum au milieu duquel il érigea une colonne admirable toute
de porphyre et, à son sommet, une statue de lui-même avec sept rayons à la tête, œuvre de
bronze qu’il avait apportée alors qu’elle se trouvait à Ilion, ville de Phrygie. Ce même
Constantin importa secrètement de Rome une statue de bois appelée Palladion et il la plaça
sur le forum qu’il avait bâti au bas de la colonne de sa statue, puisque certains habitants de
Byzance affirment qu’elle se trouve là. Il fit à la divinité un sacrifice non sanglant et il appela
Anthousa la Fortune de la cité rénovée par lui et bâtie à son nom20. » Jean Malalas nous
transmet une vision de Constantin différente de celle que fournit Eusèbe de Césarée. Loin
d’en faire le modèle de l’empereur chrétien, comme l’auteur de la Vita Constantini, il nous
livre une figure plus ambiguë, faisant venir une statue magique, le Palladion, offrant un
sacrifice qui pour n’être pas sanglant n’en était pas moins une pratique réprouvée par les
autorités chrétiennes comme idolâtrique.
Nous savons par Philostorge († vers 430) que de son temps, la statue de Constantin sise au
sommet de la colonne de porphyre recevait des hommages fort proches de ceux associés au
culte impérial : des sacrifices de lumières et d’encens. Ces offrandes sont interprétées comme
17 A. Berger , “Streets and Public Places in Constant inople » , Dumbarton Oaks Papers , 54, 2000, pp. 161-172. 18 R. Janin, Constant inople byzantine. Développement urbain e t répertoire topographique , Par is 1964, p . 63 ; S . Basset t , The Urban Image of Late Antique Constant inople , Cambridge 2004, pp. 29-31. 19 G. Fowden, « Constant ine’s Porphyry Column : the Earl ies t Allusion », JRS, 81, 1991, pp. 119-131. 20 Jean Malalas , Ioannis Malalae Chronographia , XIII , 7 , éd. I . Thurn, Berl in 2000 (CFHB XXXV, Series Berol inensis) , p . 246.
7
des sacrifices par Philostorge, un auteur arien qui pouvait en vouloir à Constantin d’avoir
promulgué les canons du concile de Nicée, excommuniant Arius et anathématisant sa
doctrine. Mais Constantin n’était pas opposé à certaines formes du culte impérial comme le
montre le rescrit d’Hispellum21. Il abhorrait les sacrifices sanglants mais non les offrandes de
lumière et d’encens. Il est donc probable que Philostorge a raison et que la statue de
Constantin recevait par ces gestes de vénération les éléments traditionnels du culte impérial.
Le côté délibérément ambigu de la statue, ou plutôt son interprétation païenne n’échappa pas
aux Constantinopolitains, qui en furent gênés au Moyen âge22. Dans les Patria23, pour gommer
cet aspect peu acceptable de la figure de Constantin, un texte explique que les rayons auraient
été faits des clous utilisés lors de la crucifixion de Jésus24. Une christianisation similaire de la
petite reproduction en bois dorée, utilisée à l’hippodrome lors des courses du 11 Mai fut
opérée dans la littérature patriographique : selon Malalas, elle portait la Tychè de la ville et
selon les Patria, une croix que l’empereur Julien aurait jetée à terre25. Encore à l’époque
d’Anne Comnène, on se souvenait de l’ambigüité de la statue du forum de Constantin : «au
milieu du forum de Constantin, il y avait une statue de bronze qui regardait vers l’Orient et
qui s’élevait sur une colonne de porphyre remarquable ; elle tenait un sceptre dans la main
droite, et dans la gauche une sphère coulée de en bronze. On disait que c’était une statue
d’Apollon ; mais les habitants de Constantinople l’appelaient Anthélios, je crois. A ce nom le
basileus Constantin le grand, père et seigneur de la ville, substitua le sien et appela [ce
monument] la statue de l’autocrator Constantin. Cependant la première dénomination prévalut
et tous continuèrent de dire la statue d’Anélios ou d’Anthélios. Soudain une très violente
bourrasque souffla d’Afrique et jeta à terre cette statue, quand le soleil était dans le signe du
Taureau. La plupart interprétèrent cela comme un mauvais présage26. » La christianisation de
la statue ne fut donc jamais complète jusqu’à sa chute en 110527 et elle fut remplacée par une
21 G. Gascou, « Le rescr i t d’Hispel lum », Mélanges d’Archéologie e t d’Histoire de l ’Ecole Française de Rome, 79, 1967, p . 600-659. 22 Discussion sur ce point dans J . Bardi l l , Constant ine, Divine Emperor of the Chris t ian Golden Age , Cambridge 2012, p . 109. 23 G. Dagron, Constant inople imaginaire . Etudes sur le recuei l des « Patr ia » , Par is 1984. 24 Th. Preger , Scriptores originum constant inopoli tanarum , Leipzig 1901-1907, I I , 45, p . 174 25 Th. Preger , Scriptores originum constant inopoli tanarum , Leipzig 1901-1907, I I , 42, p . 173. 26 Anne Comnène, Alexiade , XII , IV, 5 , texte é tabl i e t t raduit par B. Leib, Paris 1989, t . I I I , p . 66. 27 Michel Glykas, Annales , éd . G. Niebuhr, Bonn 1836, p . 617.
8
croix28. Comme souvent dans les sources byzantines médiévales, la chute de la statue est
interprétée comme théosemeia, c’est-à-dire comme un présage, un signe envoyé par Dieu et à
interpréter, ce que refuse de faire l’empereur Alexis Comnène au témoignage de sa fille. Pour
christianiser pleinement le forum, et effacer ou, au moins, atténuer les traces du passé païen
de Constantin, il fallait donc davantage d’effort, ce qui fut fait par la construction d’une
chapelle à la base de la colonne et par l’apport de reliques.
Au témoignage des pèlerins, la colonne était devenue un reliquaire. Alors qu’à l’époque
antique, on pensait qu’elle abritait le Palladion secrètement enlevé à Rome, au Moyen âge, on
croit que les douze paniers utilisés par le Christ et ses disciples pour la multiplication des
pains sont déposés sous la base de la colonne. La hache avec laquelle Noé construisit l’arche,
les deux croix des Larrons, le vase de parfum qui servit à oindre les pieds du Christ font partie
d’une liste de précieuses reliques que les pèlerins supposaient avoir été déposés dans la
colonne. Comme souvent avec les reliques, leur bilocation est attestée dans les sources, mais
le souvenir de leur présence suffisait. Ainsi la littérature patriographique avait-elle réussi à
associer la statue avec les clous de la crucifixion et même après la chute de la statue, la
légende persista, malgré la dispersion des clous à travers différents lieux de la ville. Un
pèlerin russe du 15e siècle pensait encore que l’un d’eux était scellé en haut de la colonne29.
A une date postérieure au 4e siècle, antérieure au règne de Léon VI (886-912) mais difficile
à établir, une chapelle connue sous le nom de chapelle de Constantin fut donc construite à la
pour servir de cadre à des cérémonies désormais christianisées et probablement aussi à
certains reliquaires. Selon C. Mango, elle daterait de la période iconoclaste et aurait été
construite sur les gradins entourant la colonne, pour abriter des reliques30. Elle semble avoir
été fort petite car lors des cérémonies, seul le patriarche et quelques diacres et chantres y
pénétraient, tandis que l’empereur se tenait en haut des marches qui y conduisaient, tout près
de la porte d’entrée31. Du Livre des cérémonies, on apprend que l’empereur se rendait à la
chapelle de Saint-Constantin avec le patriarche et le clergé pour les fêtes suivantes : la
28 Pseudo-Kodinos, Traité des of f ices , in troduct ion, texte e t t raduct ion par Jean Verpeaux, Paris 1976, p . 242. 29 G. Majeska, Russian Travelers to Constant inople in the Fourteenth and Fif teenth centuries , Washington 1984, pp. 144-145. (Dumbarton Oaks Studies , 19) 30 C. Mango, « Constant ine’s Column », Studies on Constant inople , I I I , p . 1-6, id . « Constant ine’s Porphyry Column and the Chapel of Saint Constant ine » , ib idem , IV, pp. 103-110. 31 A. Vogt , Constant in VII Porphyrogénète , Le Livre des Cérémonies . Commentaire (Livre I . – chapitre 1-46 (37) , Par is 1967, p . 74 ; J . Ebersol t , « Les anciens sanctuaires de Constant inople » , dans Constant inople . Recuei l d’études, d’archéologie e t d’his toire , Par is 1951, pp. 71-72.
9
Nativité de la Vierge32, le Lundi de Pâques33, le jour de l’annonciation34, le jour de célébration
d’un triomphe sur le forum (en l’occurrence un triomphe sur les Sarrazins)35. La procession
impériale indépendante de celle du clergé la précédait, à chacune des étapes ou stations
prévues.
La place du forum sur la Mésè faisait de la colonne et de sa chapelle une station liturgique
pratiquement obligatoire lors des processions organisées en direction de l’une ou l’autre des
églises de la capitale où la liturgie devait être célébrée. La liturgie stationale était pratiquée à
Constantinople ce qui signifie que pour de nombreuses fêtes, la cérémonie religieuse
commençait à Sainte-Sophie et se terminait dans une autre église de la ville, après une
procession des clercs et des fidèles (de certains au moins des fidèles ; les autres participant sur
le chemin de la procession) qui s’arrêtait régulièrement pour des prières et des
encensements36.
L’empereur participait à certaines de ces cérémonies liturgiques mais non à toutes37. Le Livre
des cérémonies au 10e siècle comme le Traité des offices du pseudo-Kodinos au 14e siècle,
incluent des passages sur la présence de l’empereur et du patriarche à diverses fêtes qui ont
lieu à la colonne de Constantin. On apprend ainsi dans le pseudo-Kodinos que: « le premier
septembre, le patriarche se rend en procession avec les saintes images à la colonne de
porphyre sur laquelle se dresse une croix, endroit qui était appelé autrefois forum : l’empereur
s’y rend et y entend la cérémonie qui y est célébrée selon l’usage38. » On aimerait en savoir
plus sur « l’usage » mais le Typikon de la Grande Eglise, document du 10e siècle qui
enregistre jour après jour les lieux de célébration des diverses fêtes ne signale aucune
procession jusqu’à la colonne pour le 1er Septembre, ce qui peut faire penser qu’il s’agit d’un
rituel postérieur.
32 Livre des cérémonies , I , 1 , éd. e t t rad. A. Vogt , Paris 1935, pp. 22-24. 33 Livre des cérémonies , I , 10, ib idem, pp. 67-68. 34 Livre des cérémonies , I , 39 (30) , ib idem, p . 153. 35 Livre des cérémonies , éd. I . Reiske, Constant ini Porphyrogenit i imperatoris De ceremoniis aulae Byzantinae , Bonn, 1829, I I , 19, pp. 609-611 36 J . F . Baldovin, The Urban Character of Chris t ian Worship. The Origins , Development and Meaning of S tat ional Li turgy , Rome 1987 (col l . “Oriental ia Chris t iana Analecta” 228); Le Typicon de la Grande Église , Ms. Sainte-Croix n . 40, X e s iècle , éd . t rad. J . Mateos, Rome 1962. 37 J . Baldovin, “Worship in Urban Life: the Example of Medieval Constant inople”, in City , Church and Renewal , Washington 1991, pp. 18-20: i l y avai t environ 68 processions re l igieuses chaque année, l ’empereur e t sa sui te par t ic ipaient à 26 d’entre e l les , dont 17 le conduisaient vers une autre égl ise que Sainte-Sophie . 38 Pseudo-Kodinos, Traité des of f ices , in troduct ion, texte e t t raduct ion par Jean Verpeaux, Paris 1976, p . 242.
10
Deux fêtes importantes liées à Constantin entraînaient une procession de l’empereur et du
clergé jusqu’au forum : la fête de la dédicace de la cité et la saint Constantin et Hélène. Le 11
Mai, « dies natalis de cette ville impériale et gardée de dieu », la cérémonie commençait à
Sainte Sophie, se déplaçait jusqu’au forum où un service de chants et de lectures avait lieu
dans et autour de la chapelle de saint Constantin, et s’achevait par liturgie eucharistique qui
avait lieu à Sainte-Sophie39. Le lien entre la ville et son fondateur était de nouveau affirmé le
21 Mai, jour de célébration de la « mémoire de nos premiers empereurs Constantin et
Hélène ». La prière suivante était adressée au Christ: « Ayant vu dans le ciel l’image de ta
Croix et ayant reçu, comme Paul, un appel non humain, ton apôtre parmi les empereurs,
Seigneur a placé dans ta main la ville impériale: garde-la toujours dans la paix par les prières
de la Theotokos, et aie pitié de nous. » Cette prière rappelle que Constantin s’était fait enterrer
parmi les apôtres, se considérant comme l’un des apôtres du Christ. Au 10e siècle, la
célébration de sa fête commençait à Sainte-Sophie et se rendait aux Saints Apôtres puis à son
sanctuaire près de la citerne de Bonus, une église remontant au règne de Léon VI et dont la
fondation est attribuée à sa première épouse Théophanô40. Comme il s’agissait d’une fête
solennelle, l’empereur et le sénat y participaient, la procession impériale précédant la
procession ecclésiastique. C’était toujours le cas au temps du pseudo-Kodinos : « pour la fête
de Constantin le grand, l’empereur se rend à l’église des Saints-Apôtres, là où repose sa
dépouille41. » Ce dernier lieu de mémoire, que fut le mausolée de Constantin est d’autant plus
important qu’il a contribué à la métamorphose de Constantin l’empereur en saint Constantin.
III Le mausolée de Constantin et l’église des Saints-Apôtres L’origine du bâtiment remonte à Constantin lui-même qui comme Galère et d’autres
empereurs avant lui se fit construire un mausolée probablement circulaire pour y établir sa
tombe. Mais si le modèle architectural était déjà connu en plusieurs exemplaires, le projet
Constantinien n’avait pas de précédent : selon Eusèbe, il décida d’établir des cénotaphes pour
les douze apôtres et de se placer au milieu d’eux. Il se fit donc construire un lieu de sépulture
original, à la hauteur de l’image qu’il avait de lui-même, comme isapostolos, égal aux
apôtres. Plus étonnant encore, il fit établir une table d’autel, transformant donc le mausolée en
église « pour bénéficier des prières qui seraient offertes en ce lieu en l’honneur des
39 Le Typicon de la Grande Église , Ms. Sainte-Croix n .40, X e s iècle , éd . t rad. J . Mateos, Rome 1962, p . 289. 40 Le Typicon de la Grande Église , Ms. Sainte-Croix n .40, X e s iècle , éd . t rad. J . Mateos, Rome 1962, p . 297. 41 Pseudo Kodinos, Traité des of f ices , ib idem , p . 244
11
apôtres »42. Au moment de son décès, il n’y avait que des cénotaphes autour de sa tombe,
placée au fond du bâtiment en face de l’entrée. Ses successeurs, en particulier Constance à qui
une tradition attribue la construction des Saints-Apôtres, feront des travaux importants liés au
tremblement de terre de 359 qui avait endommagé la structure. Il est possible de réconcilier
les deux traditions contradictoires qui attribuent l’une à Constantin et l’autre à son fils les
Saints-Apôtres, en acceptant le patronage de Constantin sur le mausolée et celui de Constance
sur l’église qui fut adjointe au mausolée circulaire. Selon C. Mango, la manière dont
Constantin s’était placé au milieu des apôtres, en faisait non pas tant un isapostolos qu’un
égal du Christ43. En séparant le mausolée et l’église, et en plaçant sous l’autel de la nouvelle
église des reliques de certains des apôtres - celles de Timothée, puis celles de Luc et d’André
en 356 et 35744 - Constance et surtout l’évêque de Constantinople Macedonius réorganisaient
l’espace, séparant la zone des tombes impériales, avec Constantin au centre, et la zone de la
sacralité eucharistique et des reliques, une façon de rétablir une hiérarchie de la sainteté plus
acceptable que celle qui semblait subordonner les apôtres du Christ à l’empereur défunt. De
chaque côté du sarcophage de Constantin seront placés ceux de Constance II, de Théodose I,
de Marcien et Pulchérie, de Léon Ier, Zénon et Anastase Ier. Le mausolée fut alors plein de
sarcophages et un second mausolée dut être construit par Justinien pour abriter sa tombe et
celle de ses successeurs. Justinien Ier fit aussi reconstruire l’église, créant un monument vanté
pour sa beauté, une somptueuse basilique à coupoles, dont les mosaïques brillaient encore aux
yeux de Constantin le Rhodien qui écrivit un poème sur le bâtiment au 10e siècle45. C’est
dans le cadre du mausolée de Constantin au sein du complexe des Saints-Apôtres que se mit
en place un culte de saint Constantin.
Un premier témoignage d'une vénération à la tombe de Constantin est fourni par Théodoret de
Cyr, dans son Histoire ecclésiastique46. Dans son témoignage, il inclut à la fois la tombe et la
statue de Constantin, donc tout ensemble le forum et les Saints-Apôtres. La vénération au
42 Eusèbe de Césarée, Vita Constant ini , 4 . 60, éd. F. Winkelmann, Über das Leben des Kaisers Konstant ins , Berl in 1975, rev. 1992. (GCS 1/1) , p . 144. 43 C. Mango, « Constant ine’s Mausoleum and the Translat ion of Rel ics » , Byzantinische Zei tschri f t , 83, 1990, pp. 51-61, 44 R. Janin, La géographie ecclésiast ique de l 'empire byzantin . Ière part ie . Le s iège de Constant inople e t le patr iarcat œcuménique . I I I Les égl ises e t les monastères , Par is 19692, p . 42. 45 L. James, Constant ine of Rhodes, On Constant inople and the Church of the Apost les , (à paraî t re) 46 Théodoret de Cyr, Histoire ecclésiast ique , I , 34, 3 , éd. L. Parmentier , revue par G. Ch. Hansen, Berl in 1998, p . 90.
12
forum relevait des gestes propres au culte impérial et n’avait rien de spécifiquement chrétien.
De même, apporter lumières et encens sur une tombe était un geste courant pour honorer les
morts durant l’Antiquité romaine. Les morts réclamaient pour leur tombe, dans leurs
testaments, des lumières et des parfums. Pour les vivants, venir avec de l’encens et de la
lumière revenait à se protéger de l’odeur et des ténèbres de la mort. Une christianisation de
ces offrandes s’est produite entre le 5e et le 6e siècle, au cours de laquelle l’encens comme la
lumière ont été présentés comme des éléments du Paradis dans lequel les saints jouissaient de
la lumière divine et des exquises senteurs du jardin d’Eden. Dans le cadre du culte des saints,
apporter de l’encens et des lumières sur une tombe sise dans une église revenait à proclamer
le mort comme étant au Paradis tout en lui offrant une offrande acceptable. Les offrandes de
lumières avaient aussi la fonction symbolique de maintenir la prière au delà même de la
présence du fidèle venu vénérer une tombe. Les offrandes d’encens portaient les prières du
fidèle jusqu’au ciel. Le défunt empereur a bénéficié de ce transfert culturel et religieux. Privé
des manifestations du culte impérial tel qu’il avait été pratiqué dans les siècles précédant son
règne, il fut assimilé aux saints auxquels les fidèles confiaient leurs prières. L’empereur
vivant avait reçu des pétitions, l’empereur canonisé recevait au Paradis les requêtes des
fidèles. Il n’est pas facile de retracer avec précision la chronologie de cette transformation
d’éléments du culte impérial en rituels propres au culte des saints, mais l’évolution est claire
qui transforme Constantin le grand en saint Constantin.
On aimerait davantage de témoignages sur les visites que faisaient les Constantinopolitains
comme les étrangers à la tombe de Constantin47. Le témoignage des pèlerins russes de la
période Paléologue prouve que l’église et les mausolées impériaux étaient toujours visités à la
fin du Moyen âge48. Etienne de Novgorod commente le fait que les pèlerins, au nombre
desquels il se compte, embrassent les tombes des empereurs dans le mausolée de Constantin
alors même que ce ne sont pas des saints. Le transfert de nombreuses reliques en Occident
après 1204 n’avait pas affecté les sarcophages impériaux qui ne seront profanés que par les
Turcs musulmans qui détruisent l’église en 1461. Même si elle avait déjà perdu de son lustre
au 14e siècle, l’église contenait encore des trésors et laissait transparaître sa splendeur passée.
L’église a connu son heure de gloire sous la dynastie macédonienne. Basile Ier a en effet
entrepris des travaux de restauration et d’embellissements des Saints-Apôtres dont le culte de
47 J . P . A. Ven der Vin, Travel lers to Greece and Constant inople . Ancient Monuments and Old Tradit ions in Medieval Travel lers’ Tales , Leyde 1980. 48 G. P . Majeska, Russian Travelers to Constant inople in the Fourteenth and Fif teenth centuries , Washington 1984, p . 299-306. (Dumbarton Oaks Studies , 19)
13
saint Constantin va bénéficier. Le mausolée a été de nouveau ouvert en 886 pour y enterrer les
empereurs défunts de la nouvelle dynastie. De nouvelles cérémonies incluant la tombe de
Constantin furent organisées, en particulier sous Constantin VII. Par exemple, le lundi de
Pâques, l’empereur se rend d’abord au Forum et à la chapelle à la base de la colonne, puis aux
Saints-Apôtres. « Ayant prié sur la tombe de notre père Chrysostome et de Saint Grégoire le
théologien et ayant allumé des cierges, l’empereur et le patriarche sortent tous deux par le
côté gauche du sanctuaire et vont au sarcophage de Constantin et là, ayant prié et allumé des
cierges, ils sortent et vont sur les tombes des très saints patriarches Nicéphore et Méthode49. »
La tombe de Constantin Ier était ainsi l’objet de vénération lors des rituels quotidiens
organisés par le clergé attaché à l’église et plus particulièrement encensée lors des grandes
fêtes réunissant les empereurs, la cour et le clergé de Sainte-Sophie à l’église des Saints-
Apôtres. Desservie par un important nombre de clercs, parmi lesquels des chantres pour
chanter les offices de la liturgie, l’église des Saints-Apôtres était le lieu de fêtes liturgiques
brillantes à cette époque. L’attention du Livre des cérémonies pour les rituels qui se déroulent
dans ce sanctuaire est probablement liée au fait que plusieurs d’entre eux ont été modifiés ou
amplifiés à l’époque des premiers macédoniens. Basile Ier aurait souhaité faire canoniser
Constantin son fils aîné mort brutalement en 879, ce qui affecta grandement son père, qui
aurait orchestré une relance du culte de Constantin Ier en profitant de l’homonymie50. Léon VI
y fit enterrer sa première épouse Théophanô, avec laquelle il ne s’entendait pas et qu’il fit
canoniser51. Une chapelle fut bâtie pour elle par Léon VI, achevée ou réaménagée par
Constantin VII pour Théophanô, qui à défaut d’avoir donné un héritier mâle à la dynastie lui
fournissait un élément de sainteté fort prisé à cette époque52. Cette chapelle appelée église de
Tous-les-saints était accessible depuis le bèma de l’église principale : les souverains s’y
recueillaient un moment avant la lecture de l’évangile lors de la fête des Tous-les-saints, selon
un passage du Livre des cérémonies qui fait état d’un rituel récemment mis au point53. Ce
49 Livre des cérémonies , I , 10, éd. e t t rad. A. Vogt , op. c i t . , p . 69. 50 G. Dagron, G. Dagron, “Théophanô, les Saints-Apôtres e t l ’égl ise de Tous-les-Saints » , Symmeikta , 9 , 1994, pp. 201-218, à p . 210-211. 51 Vie anonyme de sainte Théophanô (BHG 1794) , éd. E. Kurtz , “Zwei gr iechische Texte über die Hl . Theophano die Gemahlin Kaisers Leo VI”, Mémoires de l ’Académie impériale des sciences de Saint Petersbourg , 8 e sér ie , 3 , 2 , 1898, pp. 1-24. 52 G. Dagron, Empereur e t prêtre . Etude sur le “césaropapisme” byzantin , Par is 1996, pp. 209-210; E. Pat lagean, « Sainteté e t pouvoir » , The Byzantine Saint , éd . S . Hackel , Londres 1981, p . 88- 105, repris dans ead. , Figures du pouvoir à Byzance ( ix e-x i i e siècle) (Collectanea 13) , Spolète 2001, pp. 173-195 53 Livre des cérémonies , I I , 7 , éd. Reiske, pp. 535-538.
14
sanctuaire des Saints-Apôtres avait la particularité d’abriter non seulement la tombe de
Constantin, mais aussi celle de nombreux empereurs jusqu’à Constantin VIII, avec quelques
exceptions comme celle de Romain Lécapène qui préféra être inhumé dans le monastère du
Myrelaion qu’il avait fondé. Plusieurs membres de la famille de Constantin VII sont enterrés
aux Saints-Apôtres : Basile Ier son grand-père et Léon VI son père. Le Livre des Cérémonies
conserve un rituel pour les funérailles d’un empereur dans lequel l’empereur défunt est
« invité » à sortir du palais, puis à entrer aux Saints-Apôtres où un sarcophage a été préparé
pour lui. Toutes ces annonces de sortie et d’entrée sont fait au nom du Christ, rois des rois, et
seigneur des seigneurs qui appelle l’empereur défunt à la cour céleste54. Il était attendu que les
empereurs établissent leur tombe dans cette église. Ils s’y trouvaient en excellente compagnie
puisque étaient aussi enterrés en ce lieu des évêques de Constantinople comme saint Jean
Chrysostome (dont les restes furent ramenés en 438), et des patriarches canonisés comme
saint Nicéphore et saint Méthode. Le sanctuaire avait vu arriver en 946, donc très récemment
par rapport à la date du Livre des cérémonies, les reliques d’un autre évêque de
Constantinople connu pour son orthodoxie et pour ses écrits : Saint Grégoire de Nazianze55.
Comme l’a montré B. Flusin, dans ce cérémonial aux Saints-Apôtres, l’empereur et le
patriarche ont chacun des droits sur l’espace. Parce que c’est une église, l’empereur doit se
retirer du sanctuaire pour la liturgie eucharistique, mais parce que c’est un mausolée impérial
et qu’il a (pendant la dynastie macédonienne) des membres de sa famille enterrés sur place,
l’empereur a aussi le sentiment d’un espace privilégié, dans lequel il est le grand organisateur
du culte des saints et des hommages rendus, sans doute par l’encensement, à ses
prédécesseurs. Dans ce contexte, la visite de la tombe de saint Constantin représente un point
d’orgue. Il est tout à la fois le fondateur de la cité, le premier empereur de l’empire chrétien
mais aussi un lointain membre de la parenté selon la généalogie fictive qui faisait descendre
Basile Ier de cet empereur. Cette parenté appuie la légitimité de la dynastie macédonienne qui
a commencé dans le sang, avec l’assassinat de Michel III et qui continue à connaître des
54 Sur les funérai l les impéria les , P . Karl in-Hayter , « L’adieu à l ’empereur » , Byzantion , 61, 1991, pp. 112-155 ; J . -P . Sodini , Ri tes funéraires e t tombeaux impériaux », in La mort du souverain entre Antiqui té e t Haut Moyen âge , textes réunis par Brigi t te Boissavi t-Camus, François Chausson et Hervé Inglebert , Par is 2006, pp. 167-182. 55 B. Flusin , “L’empereur e t le théologien. A propos du Retour des re l iques de Grégoire de Nazianze (BHG 728), Aetos : S tudies in honour of Cyri l Mango presented to him on Apri l 14, 1998 , éds . I . Sevcenko et I . Hutter , Stut tgar t / Leipzig 1998, pp. 137-153; Idem, “Le Panégyrique de Constant in VII Porphyrogénète pour la t ransla t ion des re l iques de Grégoire le Théologien (BHG 728)”, Revue des é tudes byzantines , 57, 1999, pp. 5-97.
15
difficultés avec la crise de la tétragamie et la naissance illégitime de Constantin VII.
Constantin le grand est à l’intersection des deux groupes, des saints et des empereurs et tient
donc une place doublement essentielle dans le rituel.
Le lundi de Pâques, au 10e siècle Constantin était commémoré en deux lieux: une double
procession, impériale d’abord, cléricale ensuite, partait de Sainte-Sophie, s’arrêtait d’abord à
la chapelle de Saint-Constantin sur le forum avant de se rendre ultimement à l’église des
Saints-Apôtres où Constantin était spécialement honoré, par le recueillement de l’empereur
régnant sur sa tombe. La fête fut plus tard simplifiée, l’empereur se rendant à cheval aux
Saints-Apôtres, sans s’arrêter sur le forum ou passer par Sainte-Sophie.
Pour la fête de la saint Constantin le grand, à laquelle le Livre des cérémonies consacre un
chapitre, les empereurs se rendent directement aux Saints-Apôtres : ils pénètrent dans le
bèma, vont encenser l’autel, puis les tombes de différents défunts, honorant ainsi la mémoire
de Léon VI, Théophanô, Basile Ier puis finalement celle de Constantin56. Le tropaire qui est
chanté fait allusion à la vision de Constantin avant la bataille du pont de Milvius : "Ayant vu
au ciel le signe de ta croix..." La fête combine ainsi une célébration de Constantin, lointain
ancêtre de la dynastie macédonienne, et des prédécesseurs immédiats de Constantin VII sur le
trône: son père et son grand-père. La fête de Constantin est devenue une fête célébrant la
dynastie macédonienne et la sainteté impériale. Sainte Théophanô est intégrée à ce rituel de
deux manières : par un encensement de sa tombe aux Saints-Apôtres57 et par la poursuite de la
fête au palais de Bônos, situé non loin des Saints-Apôtres et que ladite Théophanô avait fait
transformer en monastère58. Dans les sources plus tardives, il porte le nom de couvent de
Saint-Constantin59. C’est en ce lieu que s’achève la fête de saint Constantin qui est aussi la
fête pour « la dédicace des précieuses croix érigées dans le nouveau palais de Bônos ». Selon
56 Livre des cérémonies , I I , 6 , éd. Reiske, pp. 533. 57 Discussion sur la configurat ion des l ieux dans G. Dagron, “Théophanô, les Saints-Apôtres e t l ’égl ise de Tous-les-Saints » , Symmeikta , 9 , 1994, pp. 201-218 à pp. 208-209 et 213. 58 Les re l iques de sainte Théophanô y seront f inalement t ransférées , G. Majeska, « The Body of St . Theophano the Empress and the Convent of St . Constant ine » , Byzantinoslavica , 38, 1977, pp. 14-21. 59 G. Majeska, Russian Travelers to Constant inople in the Fourteenth and Fif teenth centuries , Washington 1984, p . 296-298. (Dumbarton Oaks Studies , 19); R. Janin é tabl i t deux entrées dans son catalogue des sanctuaires mais propose de rapprocher l ’égl ise de Saint-Constant in dans le palais de Bônos ci tée dans le Livre des cérémonies e t le couvent de Saint-Constant in s i tué près de la c i terne de Bônos, c i té par des voyageurs e t par le pseudo-Kodinos, R. Janin, La géographie ecclésiast ique de l 'empire byzantin . Ière part ie . Le s iège de Constant inople e t le patr iarcat œcuménique . I I I Les égl ises e t les monastères , Par is 19692, pp. 295-297.
16
les Patria, ces deux croix datent de l’empereur Justin60. Les deux saints Constantin et Hélène
sont vénérés dans l’église, où se trouvent deux bèmata, l’un au nom de sainte Hélène et
l’autre au nom de saint Constantin qui était surmonté d’un ciborum en argent. Leur fête est
toujours liée au culte de la croix dont ils sont les protagonistes.
IV De la légende au culte : De Constantin l’empereur à saint Constantin Le Constantin que retiennent les sources byzantines est l’empereur qui a eu une vision de la
Croix, qui a convoqué le concile de Nicée et qui a fondé Constantinople61. C’est à partir des
deux premiers éléments, et surtout de la vision de la croix que s’établit le culte de saint
Constantin. Avant de prendre une indépendance relative, liée au culte sur sa tombe aux
Saints-Apôtres, le culte de Constantin était combiné avec celui d’Hélène car il était
foncièrement un culte de la croix.
Transformer Constantin en un saint n’allait pas de soi et ne fut pas simple. Dans les
chroniques protobyzantines, il est qualifié de grand ou de divin, mais non de saint. Malalas et
la Chronique pascale utilisent l’adjectif theiotatos pour le qualifier, ce qui n’est pas
l’équivalent de hagios, saint. Certains éléments de sa biographie comme ses activités
militaires, et plus encore sa vie privée, la condamnation à mort de son fils Priscus et
l’assassinat de sa femme Fausta étaient connus et peu propices à une canonisation. Ces
épisodes tragiques sont cités dans la littérature patriographique62. Les activités militaires et le
fait de faire couler le sang étaient incompatibles avec la sainteté telle que la comprenaient tant
les évêques de l’Antiquité que ceux de la période médiobyzantine, comme l’échec du culte de
Nicéphore Phocas le montre63. Si les légendes autour de Constantin et d’Hélène se
développent dès la fin du 4e siècle ou le début du 5e siècle, le développement d’un culte
organisé par l’Eglise de Constantinople n’intervient que plus tard, au début du Moyen âge.
Constantin et plus encore sa mère sont associés à l’invention de la croix et à sa vénération,
60 Patr ia , I I , Preger , op. c i t , p . 267. Sur Just in II e t la croix , H/ A. Klein , “Constant ine, Helena, and the Cult of the True Cross in Constant inople”, in Byzance et les re l iques du Chris t , éds . J . Durand, B. Flusin , Paris , 2004, pp.31-59, à pp. 39-41. 61 Kazdhan “Constant in imaginaire” , Byzantine Legends of the Ninth century about Constant ine the Great” , Byzantion , 67, 1987, pp. 196-250, à p . 196. 62 Constant inople in the Early Eighth Century. The Parastaseis syntomoi chronikai: in troduct ion, translat ion, and commentary , éds . Averi l Cameron et Judi th Herr in (avec Alan Cameron, Robin Cormack, e t Charlot te Roueche) , Leiden 1984. 63 B. Caseau, J . -Cl . Cheynet , “La communion du soldat e t les r i tes re l igieux sur le champ de batai l le” , Pèlerinages e t Lieux saints dans l 'Ant iqui té e t le Moyen Âge. Mélanges of fer ts à Pierre Maraval , éds . B. Caseau, J .-Cl . Cheynet , V. Déroche, Paris 2006, p . 101-119.
17
même si les textes traitant de cette implication ne sont pas antérieurs à la fin du 4e siècle dans
le cas d’Hélène64. A Jérusalem, une fête célébrant Constantin avait lieu au 5e siècle en lien
avec la fête de la dédicace du martyrium, la basilique que Constantin avait fondée65, en même
temps qu’une chapelle bâtie autour du tombeau du Christ66. La fête est citée dans les livres
liturgiques géorgiens et arméniens de Jérusalem à la date du 22 Mai, date de la mort de
Constantin, le dimanche de Pentecôte 33767. Le culte se serait donc développé en Palestine
avant de gagner Constantinople dans la période d’exaltation qui a suivi le retour de la Vraie
croix opéré par Héraclius. Marlia Mundell Mango signale l’image de saint Constantin sur un
encensoir en argent provenant de Syrie ou du Liban et daté du 7e siècle. L’inscription ne laisse
pas de doute et qualifie Constantin de saint. L’empereur porte un vêtement militaire, il est
armé non d’une lance mais de la croix (portée au même endroit que la lance). Ce serait le
premier témoignage iconographique d’un culte de saint Constantin68. Le Récit de la Prise de
Jérusalem, dans sa version géorgienne, utilise aussi le titre de saint Constantin69 .
A Constantinople, le culte de Constantin connaît un important essor entre le 7e et le 10e siècle,
favorisé à plusieurs reprises par les empereurs : les Héraclides à cause du retour de la Croix ;
les Isauriens parce que la dynastie isaurienne renoue avec les victoires militaires et encourage
le culte de la croix au détriment de celui des images figurées des saints, de la Vierge ou du
Christ ; les Macédoniens parce que Basile Ier dit descendre de Constantin et cultive la notion
de sainteté impériale pour légitimer son pouvoir70. Mais le développement d’un culte requiert
plus que le soutien impérial. Il s’appuie sur la rédaction de Vies de saints, et l’insertion d’une
fête liturgique dans le calendrier de l’Eglise. Au moment où la croix resurgit comme le
symbole de la victoire des empereurs byzantins, le souvenir de Constantin et d’Hélène et leur
64 J . W. Dri jver , Helena Augusta: the Mother of Constantine the Great and the Legend of her Finding of the True Cross , Leyde 1992. 65 P . Maraval , Lieux saints e t pèlerinages d’Orient , Par is 20042, p . 252-257. 66 G. Shurgaia , “Santo imperatore . Costant ino i l Grande nel la t radizione l i turgica di Gerusalemme”, in P. Bonamente , A. Cari le éds . , Costant ino i l grande nel é tà bizant ina , Bizantinis t ica , 5 , 2003, pp. 217-260. 67 G. Gari t te , Le calendrier palest ino-géorgien du Sinai t icus 34 (X e s iècle) , Bruxel les , 1958 (Subsidia Hagiographica 30) , p . 230; A. Renoux, Un manuscri t du lect ionnaire arménien de Jérusalem (cod. Jérus . Arm. 121)”, Le Muséon , 74, 1961, pp. 361-285. 68 M. Mundell Mango, “Imperial Art in the Seventh Century”, New Constant ines , op. c i t . , pp. 109-138, à p . 135 (photo p . 137) 69 La Prise de Jérusalem par les Perses en 614 , t raduct ion la t ine par G. Gari t te , VI, 8 , CSCO 203, scriptores iberic i 12, Louvain 1960, p . 12 : tum ascendit to tus populus ad Catholicam, quae est Sanctus Constant inus, ubi inventum est l ignum venerandae Crucis . 70 L. Brubacker , “To Legit imize an Emperor: Constant ine and Visual Autori ty in the Eighth and Ninth Centuries” , New Constant ines , pp. 139-158, à p . 142.
18
rôle dans la naissance du culte de la Croix est ravivé. La littérature patriographique signale les
images présentes dans la ville et qui illustrent ce lien entre Constantin, Hélène et la croix. Sur
le forum, les Parastaseis, au milieu du 8e siècle, signalent deux statues, l’une de Constantin et
l’autre d’Hélène à gauche et à droite d’anges et plusieurs croix dont l’une porte le mot
« hagios » à l’intersection des branches de la croix71. Selon les Patria, au Milion se trouvait
aussi des images72 de Constantin et d’Hélène de part et d’autre de la croix73. On retrouve là un
modèle iconographique qui sera ensuite repris dans les icônes, ou les peintures et mosaïques
représentant Hélène et Constantin tenant la croix74. Plusieurs Vies de saint Constantin sont
écrites entre le 7e et le 9e siècle qui ne s’inspirent pas de la Vita Constantini d’Eusèbe75. Elles
permettent de façonner un saint Constantin selon les modèles des saints medio-byzantins.
Samuel Lieu a recensé ces différentes Vies byzantines de saint Constantin, leurs spécificités
dans l’intégration ou non de certains points de la légende constantinienne comme sa guérison
miraculeuse et le lieu de son baptême 76. Les ménologes et les synaxaires s’appuient sur ces
Vies de saints plus longues pour créer leur version courte à usage liturgique. Dans les versions
les plus anciennes du synaxaire de Constantinople, la notice de Constantin ne comporte pas la
légende du baptême à Rome, alors même que Théophane et à sa suite la plupart des
chroniqueurs affirment que Constantin a été baptisé à Rome à la suite d’une lèpre dont le
baptême donné par Sylvestre le guérit. Dans la version datant du règne de Constantin VII77 et
dans les versions suivantes, la légende du baptême à Rome est clairement exposée78.
71 The Parastaseis syntomoi chronikai , 16, op. c i t . , p . 78-80. 72 στῆλαι donc peut-être un bas-rel ief plutôt que des s ta tues . 73 Patr ia , I I , 29, éd. Th. Preger , Scriptores Originum Constant inopoli tanarum , Leipzig, 1901, p . 166. 74 N. Teter ia tnikov, “The True Cross Flanked by Constant ine and Helena. A Study in the Light of the Post- iconoclast ic re-evaluat ion of the Cross”, Δελτίον , 1995, pp. 169-188; L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges e t la peinture byzantine du XIIe s iècle , Bruxel les , 1975, pp. 245-251 (qui soul ignai t que l ’ iconographie de ces deux saints res te à é tudier) . Je remercie S. Brodbeck pour cet te référence; C. L. Connor, Women of Byzantium , New Haven 2004, pp. 190-198. 75 F . Winkelmann, “Das hagiographische Bild Konstant ins I . im mit te lbyzantinischer Zei t” , in V. Vavrinek éd. , Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.-11. Jahrundert , Prague 1978, p . 179-208. 76 S . N. Lieu, “Constant ine in Legendary Literature”, in The Cambridge Companion to Constant ine , éd . N. Lenski , Cambridge 2006, p . 298-321. 77 A. Luzzi , « Note sul la recensione del Sinassar io di Costant inopoli patrocinata da Costant ino VII Porphyrogenito » , Rivis ta di S tudi bizant ini e neohel lenici , n .s . 26, 1989, pp. 139-186. 78 Synaxarium Ecclesiae Constant inopoli tanae e codice Sirmondiano nunc Berol inensi adiect is synaxari is select is opera et s tudioSynaxarium Ecclesiae Constant inopoli tanae e codice Sirmondiano nunc Berol inensi adiect is synaxari is se lect is opera et s tudio , éd . H. Delehaye, Bruxel les 1902, p . 698-699.
19
A Constantinople, Constantin est fêté lors des fêtes de la croix, mais dispose aussi d’une fête
partagée avec sainte Hélène le 21 Mai. Le manque de sources liturgiques pour la haute époque
rend difficile de dater avec précision son introduction dans le calendrier liturgique de Sainte-
Sophie, mais on sait que l’influence des pratiques liturgiques de Jérusalem s’est fait sentir à
partir du 7e siècle79. Le plus ancien témoignage liturgique d’une fête commune à Constantin et
Hélène, remonte au 8e siècle et se trouve dans un manuscrit qui contient des textes
hagiographiques utilisés lors des commémoraisons liturgiques des fêtes entre le 9 Mai et le 8
Juin. On apprend ainsi que, à cette époque, Constantin et Hélène partagent encore leur fête
avec une martyre80. On peut se demander pourquoi Constantin est honoré avec sa mère et non
seul. A. Luzzi y voit le souci des autorités ecclésiastiques de ne pas trop donner d’importance
à Constantin dans le culte. De fait, dans plusieurs typika, Constantin et Hélène partagent leur
fête avec d’autres saints, comme Marcus et Héraclius dans le Typikon de Patmos. Mais
l’association de deux saints vient peut-être plutôt ce que leur fête est une autre célébration de
la croix. Constantin et Hélène ont une entrée dans le synaxaire de Constantinople, dont une
première recension a été rédigée par Evaristos à l’instigation de Constantin VII.81 Le rédacteur
s’est appuyé sur des Vies de saint Constantin (BHG 366 et 363) pour faire sa propre
synthèse82.
Saint Constantin et la Croix: une figure et un symbole partagés par l’empereur et le patriarche L’Eglise avait donc canonisé Constantin, lui avait donné un jour de fête en association avec sa
mère Hélène, mais il n’en demeurait pas moins l’empereur Constantin, un empereur
victorieux, ayant rétabli sous son seul pouvoir l’unité de l’empire, une figure prestigieuse de
79 M. Arranz, “Les grandes étapes de la l i turgie byzantine: Pales t ine-Byzance-Russie . Essai d’aperçu his tor ique”, in Liturgie de l ’Eglise part icul ière e t l i turgie de l ’Eglise universel le , éds . A. Pis toia , A. Triacca, Rome 1976, p . 43-72; R. Taft , Le r i te byzantin . Bref h is torique , Par is 1996. 80 Pal impseste du ms Add. 4489 de l ’univers i té de Cambridge, daté de la f in du 8e s iècle , A. Luzzi , “I l Dies Festus d i Costant ino i l grande e di sua Madre Elena nei Libri l i turgici del la Chiesa Greca”, in Costant ino i l Grande dal l ' ant ichi tà al l 'umanesimo, Colloquio sul Cris t ianesimo nel mondo ant ico (Macerata 18-20 Dicembre 1990) , éds . G. Bonamente e t F . Fusco, t . I I , Macerata 1993, pp. 585-643. 81 A. Luzzi , Studi sul Sinassar io di Costant inopoli , Rome 1995 (Test i e Studi Bizant ino-Neoellenici , 8) , pp. 5-7 : La recension du synaxaire qui remonte à Constant in VII es t connue par deux manuscri ts le Hierosolymitanus Sanctae Crucis 40 (H de Delehaye) du 10e-11e s . e t le Sinai t icus 548, du 11e s . ; id . , « Precisazioni sul l ’epoca di formazione del Sinassar io di Costant inopoli » , Rivis ta di Studi Bizant ini e Neoel lenici , n . s . , 36, 1999, p . 75-91. 82 A. Luzzi , Studi sul S inassario di Costant inopoli , Rome 1995 (Test i e Studi Bizant ino-Neoellenici , 8) , p . 84-85.
20
l’histoire politique et militaire de l’empire. La figure de Constantin l’empereur conquérant
faisait donc concurrence à celle du premier empereur chrétien, œuvrant pour le bien de
l’Eglise. Tant l’empereur que le patriarche pouvaient vouloir se référer à Constantin comme
figure tutélaire et protectrice, et exploiter le prestige de la légende constantinienne. Le
patriarche pouvait l’évoquer comme modèle pour son rôle de protecteur des chrétiens et
surtout de bienfaiteur de l’Eglise. A chaque concile, sa convocation du premier concile de
Nicée était rappelée, comme un geste fondateur. L’empereur, de son côté, pouvait aussi
souligner ce rôle du premier empereur chrétien dans les affaires de l’Eglise, et sa participation
à la mise en place de cultes comme celui de la Vraie croix83. Il pouvait naturellement exploiter
l’héritage politique de Constantin et se placer à sa suite dans la continuité du pouvoir
impérial. Ainsi l’empereur victorieux venait-il célébrer autour de la colonne de Constantin ses
prouesses militaires.
Il y avait donc une concurrence pour l’exploitation de la figure de Constantin entre l’Eglise et
le pouvoir civil, entre le patriarche et l’empereur. On en trouve une trace dans le Livre des
Cérémonies. On peut suivre certains aspects de cette concurrence lors des transformations que
subit l’espace autour de la colonne de Constantin, sur le forum. La statue de Constantin au
sommet de la colonne du forum se voulait être un symbole de pouvoir. Elle portait une lance
qui fut remplacée par un sceptre, quand la lance tomba. Il s’agissait dans les deux cas
d’insignes militaires ou de pouvoir. Après la chute de la statue, toutefois, elle fut remplacée
par une croix, symbole impérial mais aussi symbole religieux. On peut comprendre cette
évolution comme naturelle à une époque où la fabrication de statues de bronze en ronde bosse
a cessé, mais elle est significative du remplacement d’une image politique par un symbole
religieux ou politico-religieux. L’espace du forum était en premier lieu un espace civique, très
peu marqué par le christianisme en ses débuts, dans la tradition romaine, mais il devint
chrétien par l’adjonction de la chapelle et des reliques sur les gradins à la base de la colonne.
Dans cette christianisation de l’espace, les empereurs avaient toutefois la main haute : ce sont
eux qui avaient les moyens de construire les églises et de faire venir des reliques. On ignore
qui a fait construire la chapelle de saint Constantin au forum mais, compte-tenu de ce qui a été
dit plus haut sur l’importance de Constantin pour la dynastie macédonienne, et sachant qu’on
n’entend guère parler de ce lieu avant le 9e siècle, il semble possible d’attribuer la
construction à l’un ou l’autre des deux premiers empereurs macédoniens. Dans cette dynastie
macédonienne, un empereur en particulier, Constantin VII a eu à cœur de valoriser les rituels 83 G. Dagron, Empereur e t prêtre . Etude sur le “césaropapisme” byzantin , Par is 1996.
21
autour de Constantin Ier, son prestigieux homonyme. A. Schminck parle même de liturgie
impériale imitant et rehaussant la liturgie ecclésiastique, tout en soulignant le lien direct entre
le Christ et l’empereur et la sainteté impériale84.
Le patriarche avait la haute main sur la liturgie dans les églises, tout autant la chapelle de
Saint-Constantin au forum et celle des Saints-Apôtres, mais l’empereur avait un rôle
privilégié à jouer quand il participait aux cérémonies qui s’y déroulaient85. Ce rôle est
particulièrement clair dans les encensements qui lui sont confiés dans le sanctuaire à Sainte-
Sophie où il encense en particulier une croix et par ceux des tombes ou des reliquaires dans le
sanctuaire des Saints-Apôtres. Dans tous ces exemples, toutefois, c’est le clergé qui lui remet
l’encensoir. L’empereur a toutefois une indépendance relative lors de ces cérémonies. Il a
déjà été noté que l’empereur organisait sa propre procession pour se rendre sur les lieux de
célébration. Il ne suivait pas celle organisée par le patriarche. Il disposait aussi d’insignes
religieux prestigieux qui l’accompagnaient. Parmi ces objets, il convient de citer la croix de
Constantin, et la relique de la sainte croix, qui étaient gardées au Palais impérial.
L’empereur et la croix de Constantin La croix de Constantin était conservée avec d’autres insignes du pouvoir impérial dans la
chapelle palatiale dédiée à saint Etienne86. L’empereur venait la vénérer lorsqu’il sortait du
palais pour se rendre à une cérémonie religieuse. Il l’emportait avec lui lorsqu’il allait
célébrer la liturgie à Sainte-Sophie. Portée par un préposite, la croix de Constantin était placée
du côté droit du sanctuaire où elle restait pendant la liturgie, repartant en même temps que
l’empereur. Il s’agissait bien d’un objet de prestige, associant l’empereur régnant avec la
figure tutélaire de Constantin. Les historiens d’art discutent pour savoir si cet objet avait un
lien avec la crux gemmata, une croix sertie de bijoux, comportant une relique de la Vraie
Croix associée à Constantin par Théodore Anagnostes, qui affirme au 6e siècle, que cet objet
84 A. Schminck, “ “ In hoc s igno vinces”. Aspects du “césaropapisme” à l ’époque de Constant in VII Porphyrogénète”, in Constant in VII Porphyrogenitus and his Age , Second Internat ional Byzantine Conference, Delphi 22-26 July 1987, éd. A. Markopoulos , Athènes, 1989, pp.103-116, à p . 107: Constant in VII aurai t “ introduit une “l i turgie impéria le” qui imite e t rehausse la l i turgie ecclésiast ique, en fa isant éclater la sainteté de l ’empereur sans jamais la isser percer aucun doute sur le fa i t que le souverain , dans les cérémonies re l igieuses , n’en soi t le protagonis te , tandis que le patr iarche, même à Sainte-Sophie , n’est pas maître chez lui mais es t , tout au plus , l ’égal de l ’empereur .” 85 A. Luzzi , “L’ “ ideologia constant iniana”, nel la l i turgia del l ’e tà di Costant ino VII Porf irogenito”, Rivis ta di S tudi Bizantini e neoel lenici , 28, 1991, pp. 113-124. 86 Livre des Cérémonies , I I , 40, éd. Reiske, op. c i t . , p . 640. Une croix de Constant in VII Porphyrogénète est c i tée dans le même chapitre dans l ’égl ise palat iale de la Vierge du Pharos
22
précieux était sorti lors des processions festives des empereurs87. Malheureusement, le Livre
des cérémonies, évoque le rôle de la croix de Constantin mais ne la décrit pas, ce qui ne
permet pas d’identifier les deux objets et d’établir une continuité temporelle (qui ne
remonterait guère à Constantin de toute manière)88. Que l’objet ait été ou non le même
importe peu, si les gens de l’époque du Livre des cérémonies, pendaient qu’il s’agissait de la
Croix de Constantin. Avant de devenir un symbole ecclésiastique, la croix avait été un
symbole impérial: la Notitia dignitatum au 5e s (421) dit qu’une croix processionnelle est un
privilège impérial. Lors d’un adventus, mais aussi lors des sorties solennelles, les empereurs
étaient précédés d’une croix processionnelle, objet en or, parfois serti de pierres précieuses,
dont l’usage est décrit par Eusèbe de Césarée dans la Vita Constantini89. Certes, à l’époque
medio-byzantine, il y avait une concurrence entre les différentes croix. L’empereur ne
vénérait pas moins de sept croix sur son chemin jusqu’à la cathédrale, y compris la croix
portée par le patriarche, mais aucune de ces croix ne pouvaient se prévaloir d’une association
directe avec Constantin. La croix de Constantin fonctionnait donc comme un insigne impérial,
comme un signe de victoire90, celle obtenue par les empereurs face aux ennemis terrestres de
l’empire, celle obtenue par le Christ sur la mort. Elle permettait à l’empereur de garder le
contrôle sur l’image polymorphe de Constantin et d’en tirer légitimité et prestige. Chaque
dynastie a su mettre en valeur certains aspects de cette image : le fondateur de la cité pour
l’époque protobyzantine, le fondateur des Lieux Saints qui a envoyé sa mère à Jérusalem où la
Vraie Croix a été découverte, à partir de l’époque d’Héraclius au 7e siècle, l’empereur
victorieux à l’époque isaurienne où la Croix joue un rôle majeur comme symbole de victoire,
l’empereur saint à l’époque macédonienne, l’empereur protecteur des chrétiens à l’époque
87 Théodore Anagnostes , Kirchengeschichte , éd . G. Hansen, Berl in 1971, p . 13. 88 Pour une tentative d’identification de l’objet: J . Koder , « ᾽Ο Κωνσταντῖνος Πορφυρογέννητος καὶ ἡ σταυροθήκη τοῦ Λιµπούργη » , in Constant ine VII Porphyrogenitus and his Age , op. c i t . , pp. 165-184. 89 J . A. Cotsonis , Byzantine Figural Processional Crosses , Washington 1994 (Dumbarton Oaks Byzantine Collect ion Publicat ions, N. 10) ; K. Sandin, Middle Byzantine Bronze Crosses of Intermediate Size: Form, Use and Meaning , Phd diss Rutgers Universi ty 1992. 90 J . Gagé, “Σταυρος νικοποιος . La victoire impériale dans l ’empire chrét ien » , Revue d’his toire e t de phi losophie rel igieuses , 13, 1933, p . 370-400. Constant in VII a commandité une croix nikopoios, « vic tor ieuse » , conservée dans une s taurothèque à Limbourg. El le mentionne les empereurs Constant in e t Romain, soi t Constant in VII e t Romain II qui sont co-empereurs entre 945 et 959, soi t Romain I e r Lécapène et Constant in VII , A. Frolow, La rel ique de la Vraie Croix , Par is 1961, pp. 233-236 ; J . Koder , « ᾽Ο Κωνσταντῖνος Πορφυρογέννητος καὶ ἡ σταυροθήκη τοῦ Λιµπούργη » , in Constant ine VII Porphyrogenitus and his Age , op. c i t . , pp. 165-184.
23
Paléologue. Les empereurs pouvaient conjurer ces différentes images et les exploiter tour à
tour. Par leur participation à différents rituels urbains, ils ont insufflé vie au mythe
constantinien qui semble avoir connu très peu d’éclipses. Pendant la période latine,
l’empereur Baudoin reprend les rituels byzantins pour son couronnement qui eut lieu le 16
Mai 1204, et s’installe au Grand Palais sur le trône de Constantin91 pour y recevoir la
proskynèse: « Quand il eut sis en la chaire de Constantin, tous le tinrent pour empereur, et les
Grecs qui étaient là l’adoraient tous comme saint empereur »92. Au-delà des rituels urbains qui
ont contribué à maintenir vive le souvenir du fondateur, l’ombre de Constantin a plané sur
l’ensemble de l’histoire de l’empire. Le dernier empereur ne portait-il pas le prénom de
Constantin, comme dix autres de ses prédécesseurs ?
91 G. Dagron, « Trônes pour un empereur » , Byzantio , kratos kai koinônia : mnêmê Nikou Oikonomides , Athènes 2003, pp. 179-203. 92 Robert de Clar i , De ceux qui se croisèrent , §96-97, t rad. Jean Longnon, Paris , 1974, p . 254, éd. P . Lauer , La conquête de Constant inople , Paris 1924; F. Van Tricht , The Latin Renovatio of Byzantium. The Empire of Constant inople (1204-1228) , Leyde 2011.