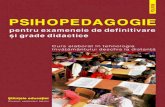The Actor's body. Constantin Stanislavski's Cinematic Theatre
Un Rum aux pays des Hellènes. Constantin Musurus
-
Upload
cnrs-bellevue -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Un Rum aux pays des Hellènes. Constantin Musurus
11
Un Rum aux pays des Hellènes.ConstantinMusurus, premier représentantpermanent de la Sublime Porte à Athènes
(1840-1848)*
Olivier Bouquet
Introduction: Musurus, entre études néo-helléniques
et ottomanes
Autant prévenir tout de suite les spécialistes de l’histoire grecque du
XIXe siècle, je vais parler d’un lieu historique dont j’ignore à peu près
tout: la monarchie hellénique des années 1840. Ma contribution est
essentiellement d’ordre archivistique. Elle porte sur l’exploitation
d’une source longtemps négligée: les papiers personnels de Constantin
Musurus (1807-1891).1 Ce diplomate ottoman est peu cité dans les
* Cet article est le résultat d’un travail de recherche soutenu et financé parl’ANR TRANSTUR (Ordonner et transiger: modalités de gouvernement et d’admi-nistration en Turquie et dans l’Empire ottoman du XIXe siècle à nos jours). Il estdédié à Sinan Kuneralp. Je remercie chaleureusement le personnel de la bibliothèqueGennadios d’Athènes qui m’accueille régulièrement depuis dix ans, ainsi qu’AnneCouderc pour ses précieuses suggestions.1 Le FondMusurus (dorénavant FM) fut vendu à la bibliothèque Gennadios en1972. Il est composé de 5 300 documents rédigés en français, en grec, en anglais eten ottoman. Il regroupe les papiers personnels et les télégrammes diplomatiques deConstantin Musurus. On y trouve aussi bien des dépêches produites par sahiérarchie, que ses courriers adressés aux chancelleries européennes, des lettres deses enfants, des actes notariés, des écrits sur la poésie grecque, des rapports sur lesactivités philanthropiques de l’ambassadeur, quelques photographies et coupures depresse. Nous préparons, Sinan Kuneralp et moi-même, l’édition commentée d’unepartie de ce fonds, à savoir ce qui concerne la correspondance de Musurus à ses
classiques.2 Il est pourtant connu des historiens, au moins au titre de l’
‘affaire Musurus’.3 Cet épisode retentissant – le roi Othon avait désavoué
en public l’action du représentant de la Porte – fit couler beaucoup
d’encre dans la presse athénienne; il fut à l’origine de la rupture des
relations diplomatiques entre la nouvelle monarchie et le vieil empire, en
1847-1848.
C’est une première raison de parler de Musurus. Une autre tient au
souhait exprimé par plusieurs collègues et amis néo-hellénistes: aborder
l’histoire des premières décennies de l’État grec sous l’angle des réalités
ottomanes, de ‘l’autre côté’, comme le dit Christos Loukos.4 C’est de ce
côté que je me situe, sur le versant ottoman, occupé entre 1840 et 1848
338 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
parents, amis et alliés, en langue anglaise et française (à paraître aux éditions Isis,Istanbul). On trouvera des exemples d’exploitation de ce fonds dans Nikolaos Vafeas,Pouvoir et conflits dans l’Empire ottoman. La révolte de 1849-1850 dans laPrincipauté de Samos, Thèse de doctorat d’histoire, Florence: European UniversityInstitute, 1998; Olivier Bouquet, ‘Être Prince de Samos. Désir de légation,imaginaire dynastique et ordre de la carrière chez Étienne et Constantin Musurus’,dans Nicolas Vatin et Gilles Veinstein (dirs), Insularités ottomanes, Istanbul et Paris:Maisonneuve & Larose, 2004, pp. 277-293; idem, Les Pachas du sultan. Essai surles agents supérieurs de l’État ottoman, 1839-1909, Louvain: Peeters, 2007;Christine Philliou, ‘The Paradox of Perceptions. Interpreting the Ottoman Pastthrough the National Present’, Middle Eastern Studies, 44/5, 2008, pp. 661-675;idem, ‘Communities on the Verge. Unraveling the Phanariot Ascendancy in OttomanGovernance’, Comparative Studies in Society and History, 51/1, 2009, pp. 151-181.Je crois savoir que Dimitris Stamatopoulos a également exploité le fonds.2 Dans l’un des ouvrages de référence sur la période, les diplomates européenssont abondamment cités. Musurus, lui, n’apparaît qu’à deux reprises, en note de basde page (John A. Petropoulos, Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece,1833-1843, Princeton: Princeton University Press, 1968, p. 343, p. 425).3 Τα κατά Μουσούρον ή Ελληνοτουρκική διαφορά [Affaire Musurus ou ledifférend gréco-turc], Athènes: Antoniádis, 1847. Pour une autre version, voir IoannisCh. Poulos, Το επεισόδιον Μουσούρου. Η ελληνοτουρκική διένεξις του 1847[L’incidentMusurus. Le conflit gréco-turc de 1847], Athènes: [s.n.], 1958.4 Cet auteur invite les historiens grecs qui traitent de la période révolutionnaireà abandonner l’‘hellénocentrisme’ de leur perspective, et à se doter d’un ‘substantialknowledge of the Ottoman Empire’ (Christos Loukos, ‘Some Suggestions for aBolder Incorporation of the Greek Revolution of 1821 into their Ottoman Context’,dans Antonis Anastasopoulos et Elias Kolovos (dirs), Ottoman Rule in the Balkans,1760-1850, Rethymno: Crete University Press, 2007, pp. 195-203, p. 199). Desottomanistes recommandent tout autant à leurs collègues de ne pas s’en tenir auxarchives centrales, de ne pas tout voir à partir d’Istanbul.
par un fonctionnaire grec-orthodoxe, premier représentant de la Sublime
Porte à Athènes. On pourrait adresser à cette étude tous les reproches
qu’il est de bon ton d’adresser à l’histoire diplomatique (analyse superfi-
cielle et orientée de la situation du pays, non-prise en compte des réalités
socio-économiques…). Pour parer à la critique, j’apporte d’emblée trois
précisions:
Le diplomate dont il est ici question n’est pas de ces voyageurs ou
ambassadeurs qui n’ont qu’une approche superficielle des réalités
locales:5 le grec est sa langue maternelle; il lit quotidiennement la presse
nationale; sa culture hellénique classique est riche; il est en contact direct
avec les habitants du nouvel État – les démarches qu’il entreprend auprès
des autorités et les enquêtes approfondies qu’il mène en témoignent.
Il ne s’agit pas d’étudier son point de vue sur les événements
principaux de l’histoire politique grecque entre 1840 et 1848 – aucune
révélation sur tel ou tel dossier n’est à attendre de cette contribution. Il
s’agit de décrire ce qu’est le métier de diplomate dans un nouvel État-
nation de l’Europe du Sud-Est, et d’éclairer les prémisses d’une relation
gréco-turque complexe jusqu’à ce jour.
Il s’agit surtout de délimiter les contours d’une personnalité gréco-
ottomane qui, loin de tenir la monarchie hellénique pour l’expérience,
originale et donc intéressante, d’une greffe politique en Europe du Sud-
Est, la conçoit comme une sorte d’aberration. On lit chez Musurus
l’arrogance affichée de l’aristocrate phanariote qui s’estime être plus en
mesure d’embrasser l’avenir du philhellénisme que les élites helléniques
elles-mêmes, qu’elles soient implantées localement ou issues d’autres
pays d’Europe – notre homme n’ignore pas que les secondes sont
largement plus représentées que les premières à l’Assemblée nationale
de 1844.6 Nous avons affaire à un diplomate occidentalisé, parfaitement
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 339
5 On trouvera une bibliographie dans Shirley HowardWeber (comp.) Voyagesand Travels in the Near East Made during the Nineteenth Century, Princeton: TheAmerican School of Classical Studies at Athens, 1952. Pour une anthologie, voirJohn L. Tomkinson, Travellers’ Greece. Memories of an Enchanted Land, Athènes:Anagnosis, 2006 (2me édition).6 Sur cette question, voir Elpida Vogli, ‘National Centre and TransnationalPeriphery. A Greece for Greeks by Descent? 19th-Century Policy on Integrating the
francophone, en contact avec les libraires parisiens, versé dans les
traductions de la littérature antique ou humaniste, qui porte un regard
sans concession (‘orientaliste’ à plus d’un titre, on le verra) sur le
nouveau pays.7 Nous avons affaire à un hellénophone, un Rum au pays
des Hellènes, une étoile diplomatique qui présente toutes les dispositions
pour être ‘the right man for the job’, et qui, pourtant, s’estime peu à son
aise dans un pays où il se sent étranger, et une ville, Athènes, qu’il dit
détester. Sans doute Musurus est-il avant tout l’homme d’une société
d’Empire, un impérial, disons-le, dont l’imaginaire politique n’est pas
outillé pour percevoir l’entière nature de l’expérience grecque, la radicale
nouveauté du processus de construction d’un État-nation. Pourquoi?
C’est ce que je voudrais comprendre.
Préambule. Mai 1840: qui donc est Musurus?
Lorsqu’il débarque au Pirée en mai 1840,Musurus est un homme de
trente-trois ans, brillant, jeune mais déjà expérimenté:8 au service du
ministère des Affaires étrangères depuis 1839, il fut, entre 1834 et 1837,
le représentant officiel du prince de Samos, le très influent Stéphane
Vogorides, dont il devint le gendre en 1839.9 Musurus fut l’artisan
340 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
Greek Diaspora’, dans Dimitris Tziovas (dir.), Greek Diaspora andMigration since1700. Society, Politics and Culture, Surrey: Ashgate, 2009, pp. 99-110. Je remerciel’auteur dem’avoir communiqué cet article.7 Il s’est notamment distingué à la fin de sa vie par la traduction de l’œuvre deDante en grec: Dante’s Inferno, Purgatorio, and Paradisio, translated into Greekverse by Musurus Pasha, Londres et Edinburg: Williams & Norgate, 1890 (2meédition). Sur ses lectures et le soin qu’il accorde à sa bibliothèque, voir FM, 10-61.8 FM, 1-94. On trouvera des éléments biographiques sur Constantin (Kostaki)Musurus dans Sinan Kuneralp, ‘Bir Osmanlı diplomatıKostakiMusurus Paşa, 1807-1891’ [Un diplomat ottoman: Kostaki Musurus Pacha, 1807-1891], Belleten,XXXIV/135, octobre 1970, pp. 421-437; idem, ‘Musurus Paşa’, Osmanlılar Ansiklo-pedisi, vol. II, Istanbul: YapıKredi, 1999, pp. 326-327.9 FM, 26-95. Pour une biographie de la trajectoire de Vogorides, voir ChristinePhilliou,Worlds, Old and New. Phanariot Networks and The Remaking of OttomanGovernance in the First Half of the Nineteenth Century, PhD Thesis, Princeton:Princeton University, 2004, pp. 290-302.
principal, côté ottoman, de la mise en place des statuts de l’île, devenue
autonome en 1834, administrée par une chambre de députés élus par le
peuple des Samiens, et dotée d’un sénat présidé par le Prince.10 Ministre
résident à Athènes au début de son séjour, Musurus devient ministre
plénipotentiaire en 1846. Il fait partie de la petite douzaine de diplomates
grecs placés à la tête demissions diplomatiques entre 1840 et 1912.
C’est un membre de la ‘communauté grecque orthodoxe’,11 très
largement représentée dans le quartier d’Arnavudköy, à Istanbul, où il
naquit et où réside son beau-père. Sur cette communauté, les avancées
(tantôt séparées, tantôt conjointes) des historiographies ottomaniste et
néo-hellénique nous ont beaucoup appris ces dernières années, qu’il
s’agisse des relations politiques entretenues avec la Sublime Porte ou du
profil socio-culturel de ses représentants (thème plus novateur sans
doute).12
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 341
10 Sur le statut de Samos, voir Gabriel Efendi Noradounghian, Recueil d’Actesinternationaux relatifs à l’Empire ottoman, Paris: Cotillon; Leipzig: Breitkopf &Haertel; Neuchâtel: Attinger, 1897-1903, vol. II, pp. 207-217; Ali Fuad Örenç,Yakın Dönem Tarihimizde Sisam Adası, 1821-1923 [L’île de Sisam dans notrehistoire contemporaine, 1821-1923], Yüksek Lisans Tezi, Istanbul: IstanbulÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. Voir également Nikolaos Vafeas,Pouvoir..., op. cit., pp. 87-103.11 Sur les problèmes liés à l’usage de ce terme, voir Haris Exertzoglou, ‘Reconsti-tuting Community. Cultural Differentiation and Identity Politics in ChristianOrthodox Communities during the late Ottoman Era’, dans Minna Rozen (dir.),Homelands and Diasporas. Greeks, Jews and their Migrations, Londres: IB Tauris,2008, pp. 139-159, p. 141. Voir également Christine Philliou qui rappelle que leterme Grec est (au moins jusqu’à la Révolution de 1821) plus un concept imaginéqu’une réalité socio-politique circonscrite (‘Breaking the Tetrachia and Saving theKaymakam. To Be an Ambitious Ottoman Christian in 1821’, dans Antonis Anasta-sopoulos et Elias Kolovos (dirs), Ottoman Rule..., op. cit., pp. 181-194, p. 183).12 Alexis Alexandris, The Greek Minority of Istanbul and Greek-TurkishRelations, Athènes: Centre for Asia Minor Studies, 1983; Dimitri Gondicas etCharles Issawi (dirs), Ottoman Greeks in the Age of Nationalism. Politics, Economy,and Society in the Nineteenth Century, Princeton: Darwin Press, 1999; MeropiAnastassiadou, ‘De la paroisse à la communauté. Les Grecs orthodoxes deStavrodromi (Beyoğlu-Istanbul)’, Anatolia Moderna, X, 2001, pp. 149-165; Ce futaussi le sujet du colloque Communautés, ‘nations’, minorités. Grecs orthodoxes dela Méditerranée ottomane et post-ottomane (XIXe-XXIe siècles), Colloque organisépar l’UMR 8032, Études turques et ottomanes (CNRS/EHESS), 25-26 juin 2009;Ariadni Moutafidou, ‘Greek Merchant Families Perceiving theWorld. The Case of
Musurus n’est pas à proprement parler un Phanariote. Rappelons en
deux mots que sont appelés ainsi les aristocrates originaires du quartier
stambouliote du Phanar, placés au service du patriarche;13 que les
Ottomans s’appuient sur les Phanariotes pour, d’une part, exercer le
gouvernement des provinces de Valachie et de Moldavie – le XVIIIe siècle
est ainsi marqué par des alliances entre seigneurs boyards roumains et
grandes familles phanariotes; pour, d’autre part, s’assurer le concours de
traducteurs compétents (drogmans) dans les négociations interna-
tionales. Musurus correspond davantage à un ‘néo-phanariote’ ou
‘newlymade phanariote’:14 s’il se dit d’une noblesse médiévale, son père
fut un Crétois installé à Istanbul dans la seconde moitié du XVIIIe siècle;
342 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
Demetrius Vikelas’, Mediterranean Historical Review, 23/2, Dec. 2008, pp. 143-164. On se reportera également aux travaux de Sia Anagnostopoulou.13 Ce terme, très utilisé au XVIIIe siècle, apparaît en Europe occidentale au XIXesiècle (Andrei Pippidi, Hommes et idées du Sud-Est européen à l’aube de l’âgemoderne, Bucarest: Academiei RSR; Paris: CNRS, 1980, pp. 342-350). Cet auteurmontre que le terme peut désigner trois catégories: l’élite très mélangée qui habitaitle Phanar avant 1821, c’est-à-dire la seule aristocratie qu’ait connue la sociétégrecque post-byzantine; les princes de Moldavie et de Valachie; tout membre de laclasse dirigeante des pays du Sud-Est européen dont l’origine et l’éducation sontgrecques. Christine Philliou propose une définition plus englobante encore: ‘aloosely defined group (…) – not just the few prominent families who held andfought for official posisitions as hospodars (…) but the hundreds and perhapsthousands of subjects who had become part of their retinues and patronage systemby the early nineteenth century’ (‘Breaking...’, op. cit., p. 186). On trouvera uneliste de quelques-unes des plus grandes familles dans Mihail Dimitri Sturdza,Dictionnaire historique et généalogique des grandes familles de Grèce, d’Albanie etde Constantinople, Paris: M.-D. Sturdza, 1983; qu’on complétera avec la lecture deEugène R. Rhangabé, Livre d’or de la noblesse Phanariote en Grece, en Roumanie,en Russie et en Turquie par un phanariote, Athènes: S.G. Vlastos, 1892. Voirégalement Symposium L’Époque Phanariote, 21-25 Octobre 1970, Thessaloniki:Institute for Balkan Studies, 1974; Socrate Zervos, Recherches sur les phanariotes etleur idéologie politique, 1666-1821, Thèse de doctorat d’histoire, Paris: EHESS,1990; Zeynep Sözen, Fenerli Beyler. 110 Yılın Oykusu [Les Princes phanariotes.Une histoire de 110 ans], Istanbul: Aybay, 2000.14 Je renvoie en particulier aux travaux précités de Christine Philliou. Voirégalement Maria Georgiadou, ‘Expert Knowledge between Tradition and Reform.The Carathéodorys: A Neo-Phanariot Family in 19th Century Constantinople’, dansMeropi Anastassiadou-Dumont (dir.), Médecins et ingénieurs ottomans à l’âge desnationalismes, Paris: Maisonneuve& Larose; Istanbul: IFEA, 2003, pp. 243-294.
Constantin tire surtout son influence des alliances avec les familles
bulgares ou roumaines hellénisées qui ont le vent en poupe depuis la fin
de l’époque phanariote en 1821.
Musurus est un serviteur du sultan. Il clame, en tous lieux possibles,
son indéfectible loyauté au Grand Seigneur; dans ses courriers adressés à
sa hiérarchie – l’usage veut qu’on ne loue jamais assez la personne du
souverain –, mais aussi à ses proches – gage supérieur, sans doute, de la
sincérité de son engagement. Il ne voit aucune contradiction entre le
service de la Porte et son identité rum. Des historiens de la Grèce contem-
poraine l’ont bien compris.15 Il faut cependant souligner que cette
loyauté est le résultat d’un positionnement conjoncturel, et qu’elle ne
coule pas de source. C’est une réponse au soupçon qui pèse encore sur les
élites grecques depuis 1821, et qui conduit Musurus à des postures de
surcorrection rhétorique dans l’expression de son ethos de serviteur.
C’est une stratégie chez les ‘néo-phanariotes’ qui considèrent avoir plus
à gagner du renforcement de leurs positions dans les provinces ottomanes
de Valachie et deMoldavie, et à Samos, que d’une disparition de l’Empire
ottoman au profit d’une enosis qui les inclurait. Mais si Musurus et son
beau-père ont toutes les raisons de se vouloir résolument Ottomans,
nombreux sont les Rum qui ont choisi une autre destinée politique liée
au devenir de la monarchie hellénique: jusqu’au propre frère de Stéphane
Vogorides, Athanasios Vogorides, qui a rejoint le patriote Adamantios
Korais à Paris.16À Athènes, Musurus en croise plus qu’ailleurs de cesralliés, de la première ou de la dernière heure, qui le renvoient à la
fragilité de sa condition, à ses choix, à sa propre image. À Athènes, iln’est pas si évident, au bout du compte, d’associer service du sultan et
identité rum.
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 343
15 Richard Clogg le cite comme exemple aux côtés d’Alexandre Karateodori:‘Such men found no conflict between their ethnic identity and their acting as loyalservants of the Ottoman Porte’ (A Short History of Modern Greece, Cambridge:Cambridge University Press, 1979, p. 78).À noter cependant que l’identité rum deMusurus n’est pas seulement ethnique, qu’elle est surtout socio-confessionnelle. S’ilse dit et se pense Grec, c’est surtout comme Rum phanariote.16 Christine Philliou, ‘Breaking...’, op. cit., p. 184.
La mission Musurus ou le métier de diplomate
Les objectifspoursuivis
À la lecture de la correspondance, on croit repérer quelques constantesde l’action diplomatique ottomane (hors des grands dossiers historiques
bien connus, comme l’insurrection crétoise de 1841, les problèmes de
délimitation des frontières, la ratification des traités…). Je m’en tiendrai
à quatre d’entre elles.17
Premier objectif de Musurus: faire pression auprès des autorités
helléniques afin qu’elles empêchent les sujets grecs engagés dans les
comités ‘révolutionnaires’ de se rendre dans les provinces ottomanes
limitrophes, entre autres raisons pour y organiser des coups de main
destinés à soulever les populations contre les autorités locales. On
rapportera les pièces du dossier constitué par Musurus à celles
regroupées, à partir des archives grecques, notamment par John
Koliopoulos.18
Second objectif: obtenir l’extradition des auteurs des crimes et délits
(notamment des actes de torture) contre des sujets du sultan, afin qu’ils
soient jugés par les autorités ottomanes.19 Le ministère grec avance
344 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
17 Pour situer l’action deMusurus dans son contexte diplomatique, voir EdouardDriault et Michel Lhéritier, Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours,Paris: PUF, 1925; John A. Petropoulos, Politics..., op. cit. Sur les oppositions entreles deux chancelleries (reconnaissance de la nationalité, devenir des propriétésottomanes), voir Sinan Kuneralp, ‘The Establishment of Diplomatic Relationsbetween the Ottoman Empire and the Kingdom of Greece, 1834-1840’, dans idem(dir.), Studies on Ottoman Diplomatic History, vol. I, Istanbul: Isis, 1987, pp. 73-76. Sur les principes et les méthodes de la diplomatie ottomane à l’époque, voirRoderic H. Davison, ‘The Modernization of Ottoman Diplomacy in the TanzimatPeriod’, IX. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 21-25 eylül 1981, Bildiriler, vol. II,Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1988, pp. 1141-1151.18 Le capitaine Ioannis Velentzas est la bête noire de Musurus tout au long de samission, de sa fuite vers la Thessalie en octobre 1840 à la tête d’une bande armée, àd’autres coups demain en avril 1848. Les dépêches envoyées d’Athènes donnent uneidée précise de la position ottomane sur cette question (FM, 1-144, 1-138, 2-31, 2-90, 2-122, 3-62, 6-169). Pour ce qui est de Velentzas, voir John Koliopoulos,Brigands with a Cause. Brigandage and Irredentism inModern Greece, 1821-1912,Oxford: Oxford University Press, 1987, pp. 116-118.19 FM, 1-113.
généralement le principe du ‘droit des nations’.20 Musurus ne jure que
par la supériorité du ‘droit des gens’.21 Il est intéressant de noter que
dans une situation symétriquement inverse – lorsque par exemple les
autorités ottomanes exigent que leur soit livré l’auteur de l’attentat
contre Musurus en avril 1848, un citoyen grec, mais qui a agi au sein de
la légation –, ce sont les Ottomans qui invoquent à leur tour le ‘droit des
nations’, alors que les Grecs se font à l’occasion les opiniâtres défenseurs
du ‘droit des gens’.22
Troisième objectif: veiller à la juste indemnisation des biens ottomans
(notamment vakf ou biens de mainmorte) et propriétés sur le sol
hellénique, sujet de contentieux permanent surtout pour les propriétés
proches d’une frontière dont la délimitation n’est pas encore achevée. Un
débat oppose continûment les deux parties. En deux mots, les autorités
helléniques avancent l’argument selon lequel la ligne de combat pendant
la Guerre d’indépendance doit déterminer les droits à la propriété au
lendemain de la guerre. Musurus conteste la validité de cette position: il
part du principe qu’occuper un territoire ne vaut pas droit d’en
déposséder les propriétaires.23 Il en veut pour preuve les protocoles
signés sous l’autorité des trois puissances protectrices, lors de la consti-
tution de l’État hellénique.24 En 1844, le représentant ottoman obtient
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 345
20 FM, 1-108.21 Musurus fait souvent référence au Précis du droit des gens modernes del’Europe de Georg Friedrich von Martens, 2 vols, Paris: Guillaumin & Cie, 1858-1864.22 FM, 6-172.23 FM, 2-142.24 ‘Un terme de dix-huit mois, à dater du jour où les travaux de la démarcationauront été achevés, est accordé aux particuliers qui voudraient quitter les territoiresqui font l’objet du présent arrangement et vendre leurs propriétés (…) Il est entenduque ces particuliers pourront également disposer, et dans le même terme, desintérêts utiles qu’ils auraient, soit comme usufruitiers, soit comme administrateurshéréditaires, dans les vacoufs, dont la totalité passe à l’État grec’ (art. 7 du Traité du9/21 Juillet 1832, signé à Constantinople (Gabriel Efendi Noradounghian,Recueil..., op. cit., p. 210; FM, 2-129; Karl Strupp, La situation internationale de laGrèce, 1821-1917. Recueil de documents, Zurich: Die Verbindung, 1918, p. 143).Protocole de la Convention du 9 juillet 1933 (FM, 2-16). Sur la délimitation de lafrontière, on consultera les travaux d’Anne Couderc, notamment sa thèse État,nations et territoires dans les Balkans au XIXe siècle. Histoire de la première frontière
cependant ce qu’il exigeait depuis 1840: le remboursement des intérêts à
hauteur de 8 % sur douze années.25
Quatrième objectif: limiter le plus possible l’émigration (la ‘fuite’
pour reprendre les termes deMusurus) des sujets ottomans chrétiens qui
veulent rejoindre le nouvel État hellénique.26 La Porte veut absolument
résorber les pertes de population: les campagnes ont été en partie vidées
depuis le XVIIe siècle par les ravages des famines, de la peste, du choléra,
et par les guerres; l’Empire a perdu autant de ressources fiscales que de
populations, alors même que les gouvernants ottomans sont convaincus
qu’une population importante est la condition première du dévelop-
pement économique du pays et du maintien de son intégrité
territoriale.27 Porteur de cette conception, Musurus agit sur plusieurs
fronts: il fait tout son possible pour limiter les départs et favoriser les
arrivées; il encourage le ‘retour’ de sujets soi-disant ottomans et
s’emploie à les empêcher d’obtenir la nationalité hellénique, qu’ils
sollicitent afin d’échapper ainsi à la juridiction ottomane lors de leur
retour dans l’Empire.
D’où une autre bataille, celle des passeports: sujets ottomans comme
helléniques doivent faire la preuve de leur nationalité auprès des
autorités consulaires. À de multiples reprises, Musurus refuse
346 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
gréco-ottomane, 1827-1881, Thèse de doctorat d’histoire, Paris: Université de ParisI-Sorbonne, 2001.25 Sinan Kuneralp, ‘Bir Osmanlı...’, op. cit., p. 428.26 FM, 3-43.27 Cette politique ottomane s’impose pour les décennies suivantes. En mars1857, le Haut conseil des réformes met au point un décret sur l’immigration ratifiépar le sultan: il dispose que l’immigration dans l’Empire est ouverte à quiconque estdisposé à prêter allégeance au sultan, à en devenir sujet et à se plier aux lois du pays.L’article 3 dispose que la liberté de religion des immigrants sera respectée; si leslieux de culte n’existent pas sur les sites d’installation, permission est donnée d’enconstruire; des terres arables sont attribuées contre la condition de devoir lesconserver vingt ans. Malgré ces dispositions d’accueil, l’Empire ottoman n’estjamais devenu un lieu d’attrait pour l’immigration volontaire (Kemal Karpat,Ottoman Population, 1830-1914. Demographic and Social Characteristics,Madison: University of Wisconsin Press, 1985, p. 62). Côté grec, on trouvera uneanalyse de la politique de naturalisation hellénique et de l’influence du CodeNapoléon dans Elpida Vogli, ‘National...’, op. cit., pp. 107-110.
d’accorder quantité de visas au motif, tantôt que la déclaration orale
d’identité ne suffit pas, tantôt que la preuve écrite (le passeport) ne
prouve rien. Qui a droit d’obtenir la nationalité grecque selon la
chancellerie ottomane? Uniquement les sujets grecs des territoires
frappés par l’insurrection nationale, et ceux qui, à Istanbul ou en Asie
Mineure, auraient subi les dommages de la guerre.28 Musurus, lui-même
accusé de refuser de viser les passeports de sujets helléniques,29 reproche
aux autorités grecques de brouiller les pistes de l’origine de ces derniers,
en inscrivant sur le passeport non plus le territoire ottoman d’origine,
mais la commune grecque de résidence.30 Les études d’E. Vogli
confirment, côté grec, la validité des arguments deMusurus sur aumoins
deux points: d’une part, ‘among the “new subjects” of the Greek
Kingdom who were “christened” as Greeks through the protection of
consulates in European towns, most were natives of the Ottoman Empire
rather than Greek provincials and, in formal terms, they did not have the
“Greek qualities” which the law prescribed. Many of them had not only
never visited the territory of free Greece, but also had a foreign passport
and a second nationality, despite the fact that Greek law had no
provisions for allowing Greek citizens to acquire a second nationality’.
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 347
28 Musurus renvoie à l’article 3 du Protocole du 30 janvier 1836 (FM, 3-43). Surles ‘droits d’émigration réciproques’, voir Gabriel Efendi Noradounghian, Recueil...,op. cit., p. 236. Pour une présentation de la réglementation ottomane en matière depasseports, voir Musa Çadırcı, ‘Tanzimat Döneminde Çıkarılan Men’-i Mürûr vePasaport Nizamnameleri’ [Les règlements relatifs aux interdictions de passage etaux passeports produits à l’époque des Tanzimat], Belgeler, 15/19, 1993, pp. 169-181. Pour une mise en perspective du débat de l’identification par les passeports,voir John C. Torpey, The Invention of the Passport. Surveillance, Citizenship, and theState, New York: Cambridge University Press, 2000.29 Voici sa position: ‘Les passeports helléniques que j’ai constamment refusé deviser, sont ceux qui me sont présentés soit par des individus connus pour avoir été àla tête des expéditions hostiles dirigées en 1841 contre la Crète, la Thessalie et laMacédoine ou pour être membres des Hétéries ou sociétés révolutionnaires, soit parles sujets ottomans qui viennent journellement se munir en Grèce de passeportshelléniques, à l’aide desquels ils prétendent, à leur retour en Turquie, se soustraire àla juridiction des Autorités Impériales’ (FM, 6-197).30 Dans le protocole du 30 janvier 1836 (FM, 3-43), il est en effet question des‘Grecs natifs du territoire Ottoman’ (Gabriel Efendi Noradounghian, Recueil..., op.cit., p. 236).
D’autre part, les autorités consulaires helléniques avaient rarement les
moyens de vérifier la validité des critères de citoyenneté requis.31
Si ce sujet, complexe, devait être exploré plus en avant, les
informations tirées de la correspondance de Musurus devraient être
rapportées à l’historiographie grecque largement renouvelée en la
matière,32 autant qu’aux réflexions en cours sur les thématiques de
l’identification.33 Ici, comme ailleurs, l’identification administrative
opère selon des logiques diverses et contradictoires, sous l’effet de
l’absence d’un consensus juridique établi autour de ce qui fait foi. Une
opposition juridique fondamentale oppose en effet les deux parties: la
Porte se réfère aux protocoles de la Conférence de Londres et à ceux qui
en découlent;34 elle en appelle à la ‘souveraineté’ du sultan sur ses
sujets.35 Le ministère grec invoque ‘la loi hellénique sur l’indigénat’ qui
stipule que tout étranger qui, venant en Grèce dans le but de s’y
348 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
31 Elpida Vogli, ‘National...’, op. cit., p. 105.32 Les débats sur la citoyenneté des Rums partis en Grèce (mais pour certainsrevenus dans l’Empire) durant les années 1833-1870 ont fait l’objet de diverstravaux: George Georgis,Η πρώτη µακροχρόνια ελληνοτουρκική διένεξη. Tο ζήτηµατης εθνικότητας, 1830-1869 [La première confrontation gréco-ottomane. Laquestion de la nationalité, 1830-1869], Athènes: Kastaniotis, 1996; idem, Στιςαπαρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής [Aux origines de la politique étrangèregrecque], Athènes: Kastaniotis, 1995. Une autre monographie a été récemmentpubliée par Elpida Vogli sur la question de la mise en place d’une législationconcernant la citoyenneté en Grèce.À noter que ces travaux reposent sur l’exploi-tation de sources grecques et occidentales. Je remercie Tassos Anastassiadis pour cesindications bibliographiques.33 Charles Steinwedel, ‘Making Social Groups, One Person at a Time. The Identi-fication of Individuals by Estate, Religious Confession, and Ethnicity in late ImperialRussia’, dans Jane Caplan et John Torpey (dirs), Documenting Individual Identity.The Development of State Practices since the French Revolution, Princeton:Princeton University Press, 2000; David Shearer, ‘Elements Near and Alien.Passportization, Policing, and Identity in the Stalinist State, 1932-1952’, TheJournal of Modern History, 76, 2004, pp. 835-881; Gerard Noiriel (dir.), L’identifi-cation. Genèse d’un travail d’État, Paris: Belin, 2007; Vincent Denis, Une histoire del’identité. France, 1715-1815, Seyssel: Champ Vallon, 2008.34 Protocoles du 3 février 1830, du 21 juillet 1832 et du 18/30 janvier 1836 (FM,3-43; FM, 6-62). On trouvera le contenu des protocoles dans Gabriel EfendiNoradounghian, Recueil..., op. cit., pp. 177-181, pp. 211-212, pp. 235-237.35 FM, 1-113.
naturaliser, y reste trois ans consécutifs, acquiert le droit de citoyen
hellène36 – je suppose qu’il s’agit du Code de nationalité grecque de mai
1835. Cependant, E. Vogli confirme qu’à cette époque, le ministère et les
fonctionnaires consulaires helléniques estimaient qu’un court séjour
suffisait pour permettre l’attribution d’un passeport grec autorisant un
retour dans l’Empire.37
Il faut également noter que ce débat sur les fondements du droit traduit
une opposition sur les critères de l’appartenance nationale: Musurus
parle d’attachement au ‘pays’38 et de fidélité au sultan; il articule des
principes de légitimité dynastique et impériale à des vecteurs d’identifi-
cation locale. Colettis défend, quant à lui, le principe de citoyenneté à la
française, effectif dans unmodèle parlementaire à l’anglaise.
Le style diplomatique ottoman en territoire hellénique
Musurus opère sur le modèle des missions précédentes: les sultans et
leurs vizirs ont toujours rappelé à leurs agents diplomatiques qu’ils
devaient espionner et prendre des contacts avec les populations locales.39
Musurus s’y emploie. Il multiplie les démarches, officielles et moins
officielles, auprès des autres légations. Avec, je dois dire, une ténacité
réelle, il fait le siège permanent des ministères; il bat le pavé chaque jour:
lorsque sont déposées des plaintes de torture contre les sujets ottomans,
c’est Musurus qui se rend en personne au commissariat du Pirée où ont
été emprisonnés ces sujets. Il faut dire que le personnel de l’ambassade
est à la fois peu fourni et modérément compétent.40 On n’y trouve alors
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 349
36 FM, 1-114.37 Elpida Vogli, ‘National...’, op. cit, pp. 103-104.38 FM, 16-36.39 Gilles Veinstein, ‘Les missions diplomatiques ottomanes en Europe avantl’instauration des ambassades permanentes’, Cours et travaux du Collège de France,Résumés 2006-2007, Paris: Collège de France, 2008, pp. 749-770. Voir aussi AzmiSüslü, ‘Un aperçu sur les ambassadeurs ottomans et leurs sefaretnames’, TarihAraştırmaları Dergisi, XIV/25, 1981/82, pp. 233-260; Faik Reşit Unat, OsmanlıSefirleri ve Sefaretnâmeleri [Les ambassadeurs et les rapports d’ambassadeottomans], Ankara: TTK, 1968.40 Sur le mode de fonctionnement des nouvelles ambassades ottomanes, voirBetül Demir, II Mahmud Devrinde Berlin Sefarethanesi’nin Yeniden Açılması ve Elçi
aucun ‘conseiller presse’: Musurus consulte régulièrement le Journal du
gouvernement, s’approvisionne en cartes et en documents géographiques
de toutes sortes, surtout pour ce qui concerne les questions de délimi-
tation des frontières, et fait venir d’Europe des précis de droit.41
Le nouveau ministère des Affaires étrangères a été créé, entre autre
raisons, pour bloquer le long ‘reflux’ territorial dont a parlé feu S.
Yerasimos:42 depuis un siècle et demi, l’Empire ne cesse de perdre des
territoires; les diplomates doivent tenir coûte que coûte les positions que
les militaires n’ont pas su défendre. Musurus est donc au front. Il cultive
avec méthode deux vecteurs d’efficacité: une mémorisation optimale des
pièces du dossier; la répétition constante et inlassable des mêmes
arguments. Il proclame, bien sûr, les meilleures intentions du monde,
mais sait bien que sa hiérarchie fonctionne sur le mode des ripostes
graduées, pour employer un anachronisme. C’est toujours la même
histoire: une partie s’estime offensée; elle organise aussitôt des
représailles. Lorsque par exemple le ministère grec annule, en 1840, le
Traité de commerce gréco-turc, sous prétexte que le plénipotentiaire qui
l’aurait signé alors, Zographos, n’avait pas les pouvoirs de le faire, la
Porte, en représailles, interdit le cabotage sur ses côtes et surtaxe les
produits grecs à l’importation.43 Résultat: en 1843, le traité n’est
toujours pas ratifié.
350 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
Olarak Atanan Kamil Paşa’nın Faaliyetleri [L’ouverture de la nouvelle ambassade deBerlin et les activités de Kamil Pacha nommé ambassadeur à l’époque de MahmudII], Yüksek Lisans Tezi, Istanbul: Istanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,2000. Les chefs de mission se plaignent souvent de ne pas disposer d’assez desecrétaires (Roderic H. Davison, ‘Ottoman Embassies in Europe in the NineteenthCentury’, XII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-16 Eylül 1994, vol. IV, Ankara:TTK, 1999, pp. 1421-1441, p. 1436).41 Par exemple, Emer de Vattel, Le Droit des gens ou Principes de la loi naturelleappliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, Paris: Janet &Cotelle, 1820, qu’il dit avoir consulté (FM, 1-139).42 Stéphane Yerasimos, ‘L’obsession territoriale ou la douleur des membresfantômes’, dans Semih Vaner (dir.), La Turquie, Paris: Fayard, 2005, pp. 39-60.43 FM, 1-143. On trouvera un historique complet des négociations et une analyseprécise des enjeux du traité dans John A. Petropoulos, Politics..., op. cit., pp. 348-356; Sinan Kuneralp, ‘The Establishment...’, op. cit., pp. 71-73.
Des réseaux d’influence entrecroisés
Ils fonctionnent à plusieurs échelles.
1/ D’abord, le dispositif ottoman auquel Musurus recourt largement:
sa hiérarchie (d’où il tire instructions et informations), le réseau des
légations en voie de constitution à l’époque (au premier chef, Paris,
Londres, puis Vienne, Saint-Pétersbourg), les consulats qui l’informent
de la situation sur le terrain (surtout pour ce qui est des incidents de
frontière ou des appropriations illégales) – Musurus cherche à en créer
de nouveaux pour se doter de marges de manœuvre supplémentaires;44
les commandants militaires dans les provinces limitrophes, en Thessalie
notamment (Namık Pacha).2/ Il dispose d’informateurs au sein des populations locales. La
connaissance qu’a Musurus du grec l’aide considérablement à prendre
des contacts parmi les Athéniens.
3/ Dans les dossiers qu’il a à traiter, Musurus en appelle réguliè-
rement à l’arbitrage des trois puissances protectrices, surtout de la
Grande-Bretagne. Ses liens avec les autres membres du corps diploma-
tiques lui sont donc précieux. Il dispose sur place d’un allié de poids, le
baron Prokesch, représentant autrichien: Constantin fut son secrétaire-
interprète au tournant des années 1830, lors d’une tournée dans les
Balkans; il partage avec lui la passion des inscriptions gréco-latines.45 Il
est heureux pourMusurus que Prokesch ait pour instruction de coopérer
avec le second des alliés de Musurus:46 Edmund Lyons, ministre
britannique, farouchement opposé à la politique de Colettis. Musurus
alpague les diplomates de passage à Athènes: Stratford Canning, qui a
œuvré à la nomination de Vogorides comme prince de Samos, et qui,
disons-le, fait la pluie et le beau temps à Stamboul;47 le Baron de Stürmer,
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 351
44 FM, 5-111; Roderic H. Davison, ‘Ottoman...’, op. cit.45 Au sujet de ce diplomate et de ses relations avec Musurus, voir Daniel Bertsch,Anton Prokesch von Osten, 1795-1876. Ein Diplomat Österreichs in Athen und ander Hohen Pforte. Beiträge zur Wahrnehmung des Orients im Europa des 19.Jahrhunderts, Munich: R. Oldenbourg, 2005, p. 305, pp. 632-633.46 John A. Petropoulos, Politics..., op. cit., pp. 362-369. Notamment sur lesrelations conflictuelles entre Lyons et Colettis.47 FM, 3-1.
internonce à la Sublime Porte, que Musurus sollicite lorsqu’il grenouille
dans l’espoir d’une mutation.48 Au-delà du cercle fermé des ministres
plénipotentiaires, le diplomate s’appuie sur tout un réseau de consuls
généraux européens, réseau qu’il cultive avec soin, étoffe année après
année, et qu’il utilise largement dans la suite de sa carrière, à Vienne,
puis à Londres.
Est également mobilisée la galaxie relationnelle constituée par
Musurus à Samos, actualisée depuis lors par l’épais carnet d’adresses de
Vogorides.49 À eux deux, ils sont alliés aux plus grandes famillesphanariotes et néophanariotes (les Sturdza, Aristarchi ou Photiades),
mais également aux boyards roumains hellénisés (les Konaki, par
exemple). Dans un espace européen encore largement transnational,
Vogorides et ses alliés se révèlent indispensables au bon fonctionnement
de la ‘gouvernance’ ottomane.50 Les réseaux phanariotes sont ainsi
directement connectés aux plus hauts niveaux de la Sublime Porte:
Vogorides a utilisé ses excellentes relations avec le ministre des Affaires
étrangères, Mustafa Rechid Pacha, pour placer son gendre en 1839, et
toute une série de protégés et alliés dans les nouvelles légations
permanentes.51 Les réseaux de Vogorides sont opérationnels non
seulement à Istanbul, dans les provinces roumaines, dans les îles de la
mer Égée, mais également – et de plus en plus – hors de l’Empire, à
Vienne par exemple où la ‘diaspora’ grecque renforce sa présence: le cas
bien connu des Baltazzi, originaires de Chios, n’est pas isolé.52
352 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
48 FM, 2-95.49 Sur le réseau ‘samien’ des anciens gouverneurs et adjoints de Musurus(Gabriel Crestides, Alexandre Photiades, Ioannis Adamantides), voir NikolaosVafeas, Pouvoir..., op. cit., pp. 122-123.50 Chrisine Philliou,Worlds..., op. cit.; idem, ‘Communities...’, op. cit.51 Sur la mise en place des ambassades permanentes, voir Roderic H. Davison,‘Ottoman...’, op. cit.52 Marie-Carmen Smyrnelis, ‘La Diaspora marchande grecque méditerranéenne(XVIIIe-XIXe siècles) à travers le parcours d’une famille: les Baltazzi’, Actes ducolloque sur les Arméniens et les Grecs en diaspora. Approches comparatives,Athènes: École française d’Athènes, 2007, pp. 85-92.
Un Rum au pays des Hellènes
Un aristocrate phanariote
Musurus est un aristocrate et se perçoit comme tel. Dans l’une de ses
notices autobiographiques, il associe noblesse lignagère (il se dit issu
d’une lignée crétoise du XIe siècle) et filiation intellectuelle (descendant
de l’humaniste MarcoMusurus).53 Tout ceci est sans doute inventé: chez
bien des néo-phanariotes, le discours sur les origines est un instrument
de carrière. Mais c’est assez pour nourrir chez le diplomate un fort
sentiment de supériorité. Il croit ne rien avoir à apprendre des Grecs du
royaume hellénique; il méprise ‘la jactance habituelle des journalistes
hellènes’;54 il taxe les poésies écrites à l’occasion de la célébration de
l’anniversaire de l’insurrection de ‘nauséabondes’.55 Les travaux scienti-
fiques qui sont publiés à Athènes sont pour lui ‘insignifiants’.
Pragmatique, il ne s’intéresse qu’aux documents logistiques et
militaires:
… j’ai remarqué une grande Carte du Petit Royaume de la Grèce,
dressée d’après les triangulations et les levés des Officiers d’État-
major de l’Armée Française, et qui est la meilleure de toutes les Cartes
de la Grèce publiées jusqu’à ce jour ; croyant qu’elle mériterait d’être
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 353
53 MarcoMusurus (v. 1470-1517), professeur de langue grecque à Padoue, puis àVenise, publié par Alde Manuce. Voici un extrait du discours auto-généalogique deConstantin: ‘En 1839, il épousa Anne, née Princesse Vogoridès, seconde fille duPrince de Samos Étienne Vogoridès (…) Par cemariage, il est devenu allié à la famillede Son Altesse Michel Stourza, Prince régnant de Moldavie, marié à la fille aînée duPrince de Samos, et qui déjà depuis 1838, lui avait conféré le rang de Hetman ougénéral de Moldavie. La famille de Musurus est établie en Crète depuis le XIe siècle.Léon Musurus fut un des douze patriciens qui, à cette époque y ont été envoyés deConstantinople pour maintenir l’île dans l’obéissance, et à qui des terres considé-rables ont été concédées. Leurs descendants ont conservé leur influence et leurspossessions jusqu’à l’époque où la Crète, donnée à Boniface Marquis deMontferrat,fut vendue par celui-ci aux Vénitiens. À cette famille appartient le savant MarcMusurus, natif de Retimno en Crète, connu par des travaux littéraires ; il vécut vers lafin du quinzième et le commencement du seizième siècle et fut un des Grecs quicontribuèrent le plus à répandre en Europe le goût des lettres grecques’ (FM, 26-95).54 FM, 1-95.55 FM, 3-16.
possédée par Votre Altesse, j’ose prendre la liberté de lui en envoyer
un exemplaire.56
C’est sa conviction: rien de bien ne se dit, ne se pense, ne s’écrit à
Athènes qui ne soit mieux dit, pensé, et écrit dans les cercles grecs
d’Istanbul, Alexandrie ou Smyrne.57 L’historiographie a largement
abordé le néo-hellénisme des élites Rum stambouliotes.58 Je parlerais
chez Musurus de néo-hellénocentrisme, à mille lieux de l’imaginaire
culturel bipolaire de sa bête noire, Colettis, pour lequel Athènes est la
capitale de la monarchie, et Constantinople la ville vers laquelle tend le
cœur de tous les Grecs.59 Athènes, c’est pour Musurus un gros village de
pêcheurs et de paysans.60 Rien d’autre. Ce n’est pas la terre des
philosophes et des savants. C’est le pays des reaya, des parvenus et des
brigands sans cause, pour inverser les termes de J. Koliopoulos; non celui
qui accueille la nouvelle École française,61 mais celui qui offre refuge aux
fuyards qui répudient leur citoyenneté ottomane.
354 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
56 FM, 1-98.57 C’est un sentiment largement partagé par de nombreuses grandes familles dela diaspora. Voir ainsi Katerina Trimi, ‘La famille Benakis: un paradigme de labourgeoisie grecque alexandrine’, dans Meropi Anastassiadou et Bernard Heyberger(dirs), Figures anonymes, figures d’élite. Pour une anatomie de l’Homoottomanicus, Istanbul: Isis, 1999, pp. 83-102, p. 98.58 Haris Exertzoglou, Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα.Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, 1861-1912 [Identiténationale à Constantinople au XIXe siècle. Le syllogue littéraire hellénique deConstantinople], Athènes: Nepheli, 1996; Johann Strauss, ‘The Millets and theOttoman Language. The Contribution of Ottoman Greeks to Ottoman Letters (19th-20th Centuries)’, DieWelt Des Islams, XXXV/1-2, 1995, pp. 189-249; idem, ‘Lesvoies de la transmission du savoir dans un milieu cosmopolite. Lettrés et savants àIstanbul au XIXe siècle’, dans Floreal Sanagustin (dir.), Les intellectuels en Orientmusulman. Statut et fonction, Le Caire: IFAO, 1999, pp. 109-125.59 K.E. Fleming, ‘Athens, Constantinople, “Istambol”. Urban Paradigms andNineteenth-Century Greek National Identity’, New Perspectives on Turkey, 22,2000, pp. 1-23.60 Les descriptions de l’époque lui donnent raison, même si plusieurs voyageursse disent impressionnés par la rapidité de l’expansion urbaine (John L. Tomkinson,Travellers..., op. cit., pp. 253-255).61 Il craint au contraire que cette école soit la base arrière de l’influence françaisesur des populations grecques de l’Empire ottoman (FM, 6-10).
Vision orientaliste d’un Rum, d’un oriental qui s’appuie sur une
culture occidentale pour orientaliser l’entre-deux balkanique, d’un
occidentaliste que le passé antique d’Athènes n’intéresse que de très
loin. Musurus n’a rien d’un romantique, rien de ces occidentaux qui se
veulent les héritiers du monde grec ancien.62 C’est sans doute l’une des
raisons qui lui rendent l’expérience hellénique difficilement compré-
hensible: il n’éprouve rien du vertige des poètes, tels son fils Paul,
Parnassien qui, un demi-siècle plus tard, rêve du Parthénon, bien
davantage que de Constantinople.
Je viens de voyager dans le pays des Dieux,
J’ai vu le Parthénon à l’heure coutumière
Où Phébus, redoublant son ardente lumière,
Au Temple qu’il quittait prolongeait ses adieux.63
Paul rêve de Parthénon à une époque où le nationalisme est idéologi-
quement constitué et compris des Musurus: il perçoit une réalité
politique – la construction des États-nations – qui échappait à son
père.64
L’Empire contre la monarchie
On note également chez Musurus une forme (moins affichée que la
précédente) d’intolérance impériale vis-à-vis du nouveau système
monarchique, une réelle incompréhension de l’expérience politique
hellénique. Il n’est pas certain que soit ici en cause le caractère
autocratique ou bavarois du régime. Je crois plutôt à l’empreinte d’une
vision panhellénique, comme barrage opposé à la ‘Grande idée’ défendue
notamment par Colettis, et ce dès 1834 – Anne Couderc l’a montré:65 la
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 355
62 D.A. Sakkis, ‘Cultural Patriotism in the Southern Balkans. The Case ofGreece, 1833-1848’, Balkan Studies, 41/1-2, 2000, pp. 43-81.63 Paul Musurus, Sonnets et stances, Paris: Alphonse Lemerre, 1929, pp. 5-6.64 On trouvera dans ses Sonnets (ibid.), de nombreuses illustrations d’unesynthèse poético-nationaliste.65 Il était auparavant d’usage de la dater de 1844. (Anne Couderc, ‘Nation etcirconscription. Construire et nommer’, dans Gilles de Rapper et Pierre Sintès
monarchie grecque perçue comme un État-nation accompli, mais
comme la partie fragmentaire d’une entité éternelle et primordiale, dont
le cœur (Constantinople) est aliéné à un pouvoir étranger.66 Musurus,
dès cette époque, semble se faire avec d’autres élites rum, le défenseur
d’un nouvel ‘hégémonisme’: il ne le dit pas dans sa correspondance
diplomatique, mais dans le secret de sa conscience peut-être se
surprend-t-il à appeler de ses vœux une reconquête du pouvoir
phanariote anéanti depuis 1821, à esquisser un programme politique
dont l’instrument culturel serait une hellénisation progressive, par
l’intérieur, de l’Empire ottoman autour du patriarcat et de l’intelligentsia
constantinopolitaine. Et puis, il y a chezMusurus, la marque d’un regard
contre-révolutionnaire sur un régime issu, selon l’Ottoman, de la révolte
de quelques-uns. Sa dénonciation de ce qu’il appelle ‘l’esprit révolu-
tionnaire des Grecs’ rappelle à bien des égards la rhétorique d’un Louis
de Bonald, ou d’un Joseph deMaistre.67
Je rappelle ici l’un des axes de recherche du colloque:
There has always been a negative image attached to South-Eastern
European politics and polities and rarely has it been widely
acknowledged (Mazower) that the process of state formation in the
region was not just a pale and gruesome caricature of Western
European models but rather a complicated affair involving juggling
with various institutional models (local as well as imported ones),
coping with societies of a sometimes inextricable ethnoreligious
diversity and varying degrees of political allegiance to central power,
dealing with foreign interference and tampering.
J’abonde dans ce sens pour ce qui est de la caricature dumodèle importé.
J’ajoute cependant que cette caricature n’est pas seulement construite par
les Européens occidentaux, mais également reprise et transformée par
356 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
(dirs), Nommer et classer dans les Balkans, Athènes: École française d’Athènes,2008, pp. 234-235).66 À ce sujet, voir K.E. Fleming, ‘Athens...’, op. cit.67 FM, 3-16.
des orientaux occidentalistes tels Musurus. Et pour d’autres raisons:
Musurus ne situe pas le problème dans le champ de la diversité ethno-
religieuse ou de l’allégeance centraliste, mais au niveau de l’incapacité à
convertir une expérience de révolte de reaya en modélisation constitu-
tionnelle. Il a ainsi beau jeu de rappeler – à tout le moins jusqu’en 1844 –,
que la Grèce n’est pas la Belgique, qu’elle n’a pas de Constitution. Il ne
regarde absolument pas la monarchie hellénique comme un laboratoire
étatique en Europe du Sud-Est. En voici un exemple:
À plusieurs occasions, la presse hellénique condamne la politique dela Sublime Porte. Le ministre des Affaires étrangères, Rechid Pacha, s’en
plaint à son homologue Païcos. Ce dernier lui oppose le principe de
liberté de la presse, et se pique de lui rappeler que puisque Mustafa
Rechid pacha a vécu à Londres, comme représentant ottoman, il ne peut
ignorer ce principe ! Voici ce queMusurus répond à Païcos:
S.A. Rechid-Pacha sait bien que dans les États constitutionnels la
presse est plus ou moins libre ; mais il sait aussi bien que le gouver-
nement hellénique n’est pas constitutionnel, et de même que ce
gouvernement, sans consulter personne, a octroyé la liberté de la
presse, de même il peut en modifier l’étendue, en défendant aux
écrits périodiques d’offenser impunément les Puissances amies.
Enfin, au lieu de vous assimiler à la France et à la Grande Bretagne, à
des Puissances aussi colossales, veuillez me dire de grâce si les feuilles
périodiques de la Suisse, Nation Indépendante, constitutionnelle et
bien plus antique que la Grèce (sic), osent insulter ainsi la Nation
Française et son Gouvernement.68
Comme si les lois et les constitutions de la période révolutionnaire
n’avaient conféré aucune tradition constitutionnelle à la Grèce!69 La
rhétorique comparatiste dont Musurus est un amateur invétéré alimente
la cascade des mépris qui irrigue la géopolitique européenne de l’époque:
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 357
68 FM, 1-116.69 On trouvera une présentation de ces lois sur le site www.parliament.gr/paligenesia (consulté le 15 mars 2010). Voir aussi Elpida Vogli, ‘National...’, op.cit., pp. 101-102.
une puissance déconsidérée et perçue comme déclinante, et qui s’efforce
de se faire une place dans le concert européen par une politique d’occi-
dentalisation affichée, dénie à un ensemble anciennement placé sous sa
domination d’imaginer une possibilité occidentale comparable ou d’une
autre nature.
L’arrogance du diplomate, la xeniteia du Rum
Cette arrogance deMusurus ne lui vient pas de sa fierté de servir la Porte,
qu’il dit ressentir dans ses courriers, surtout quand il s’adresse à sa
hiérarchie. Dans le balai diplomatique européen de l’époque, le fez turc
est loin d’impressionner autant que le bicorne français. La diplomatie
turque cherche ses lettres de noblesse, avance difficilement dans sa
bataille pour la reconnaissance. Les années 1840 sont une période
diplomatique aussi cruciale que difficile pour les Ottomans: la crise
d’Orient dont Muhammad Ali est l’épicentre en 1839-1841 se situe
exactement entre Vienne en 1815 – les Ottomans n’étaient pas conviés et
n’avaient aucune partition à jouer dans le concert chrétien orchestré par
Metternich –, et Berlin en 1878: Alexandre Karateodori Pacha, le
plénipotentiaire ottoman, un autre Phanariote et allié des Musurus, fut
traité par Bismarck à peine mieux qu’un valet de pied.70 Il s’agit pour les
Ottomans d’éviter à tout prix une guerre. Résultat: l’outil diplomatique
est ‘bellicisé’: les ‘éléments de langage’ (pour reprendre une expression
diplomatique actuelle) qui sont transmis à Musurus par sa hiérarchie le
portent à la limite même des ressources du langage. Au-delà de ces
limites, ce serait la guerre, option que les Ottomans n’ont pas les moyens
d’envisager.71 C’est un style diplomatique – adaptation de la notion de
style comme expérience de la limite selon G. Deleuze – qui, je crois,
caractérise la diplomatie ottomane pour les décennies à venir.
358 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
70 Edwin Pears, Forty Years in Constantinople. The Recollections of Sir EdwinPears, 1873-1913, Londes: Ayer Co., 1916, p. 82.71 Je nuancerais le point de vue de Kostas Kostis (‘The Formation of the State inGreece, 1830-1914’, dans Faruk Birtek et Thalia Dragonas (dirs), Citizenship andthe Nation-State in Greece and Turkey, Londres et New York: Routledge, 2005, pp.18-36, p. 28). S’il est vrai que ‘the Ottomans were totally reorganizing their militarysystem’, la réforme était loin d’avoir produit ses premiers résultats, et la ‘militarystrength’ des Ottomans était considérablement affaiblie.
Cette posture deMusurus lui vient moins de la position de l’État qu’il
sert que de la conscience qu’il a de ses qualités propres: de son extraor-
dinaire maîtrise du français, de sa remarquable culture classique, de son
carnet d’adresses européen. Musurus, c’est l’équivalent du diplomate
anglais pour qui l’Afrique commence à Dunkerque.72 C’est aussi un
artistocrate venu à la politique par les lettres, sur le modèle de son quasi-
contemporain Nicolas Soutzo (1798-1871), exemple phanariote par
excellence du politique avisé et financier adroit, incarnation du grand
seigneur, écrivain et voyageur.73 Pour cette génération comme pour celles
du XVIIIe siècle, la politique des intrigues et la recherche des anciens
textes vont encore de pair – Pipiddi l’a bien montré: les lettres, loin de
répondre à la satisfaction d’une quête purement esthétique, sont un
instrument destiné à conquérir le monde et les biens matériels.74 Il en va
différemment des élites de la fin du XIXe siècle, souvent écartelées entre
les exigences de leurs activités professionnelles et les aspirations à une
vie littéraire productive.75
Cette conscience de la supériorité phanariote trouve cependant ses
limites. Musurus glisse dans une ère nouvelle qui fait de lui, malgré son
jeune âge, l’homme d’un autre temps: celle des ‘États-nations’, à la
logique desquels il ne veut rien entendre. Nous savons bien que personne
n’emploie alors l’expression à Athènes. Pourtant, Anne Couderc a bien
compris que des logiques de construction territoriale inédites dans les
Balkans et une ‘pédagogie à l’usage de la nation’ sont à l’œuvre en Grèce
qui permettent de repérer, au sein de la monarchie hellénique de
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 359
72 On pourra le comparer à une autre figure occidentale de la diplomatieottomane, successeur de Musurus à Athènes, avant d’être ambassadeur à Paris(Roderic H. Davison, ‘Halil Şerif Paşa: Ottoman Diplomat and Statesman’, OsmanlıAraştırmaları, II, 1981, pp. 203-221; idem, ‘Halil Şerif Paşa: The Influence of Parisand theWest on an Ottoman Diplomat’, Osmanlı Araştırmaları, VI, 1986, pp. 47-65).73 Andrei Pippidi, Hommes..., op. cit., pp. 315-319. Il a écrit ses mémoires:Mémoires du Prince Nicolas Soutzo, Grand logothète de Moldavie, 1798-1871,publiées par Panaioti Rizos, Vienne: Gérold&Cie, 1899.74 Andrei Pipiddi, Hommes..., op. cit., pp. 133-159.75 Le grand négociant et homme de lettres Demetrius Vikelas, l’un des pionniersde la nouvelle grecque, s’en plaint dans son autobiographie rédigée au tournant duXXe siècle (Ariadni Moutafidou, ‘GreekMerchant...’, op. cit., p. 146).
l’époque, des traits de formation de l’État-nation.76 Les historiens nous
disent aujourd’hui ce que les acteurs du temps ne percevaient pas. Mais il
y a chez Musurus comme le revers d’un sentiment plus diffus et moins
avoué: un mal-être qu’on croit deviner sous sa plume, qui mêle un
sentiment d’étrangeté bien différent de celui qu’éprouverait un
diplomate non rum (une sorte de xeniteia), à une appréhension
croissante d’une menace à venir – il ne cesse de demander son rappel. Ce
mal-être finit par se transformer en paranoïa, en partie fondée: en avril
1848, il est la victime des balles d’un nationaliste grec.77 Il en réchappe.
La patrie ottomane lui est reconnaissante: Musurus reçoit du souverain
une tabatière ornée de brillants et du chiffre impérial;78 il obtient, enfin,
ce qu’il voulait: un retour à Istanbul. Et mieux encore: un poste dans une
ville qu’il considère pour le coup comme résolument occidentale, dans
une formation politique impériale ancienne, légitime à ses yeux, plus
adaptée à sa nature de Rum d’ancien régime. En 1849, Musurus part
pour Vienne.
Conclusion
À ces vœux ose joindre les siens l’herbe frêle et reconnaissante queVotre Altesse a daigné planter sur le sol hellénique, si fécond en
épines et en désagréments. Cette herbe, Monseigneur, invoque
aujourd’hui la bienveillante protection de Votre Altesse, et lui adresse
de vives instances pour qu’avant son entier desséchement, Elle daigne
360 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
76 Anne Couderc, ‘Nation...’, op. cit., pp. 233-235.77 ‘Le 23 (…) un domestique des secrétaires de la Légation (…) entrabrusquement dans ma chambre et tira de bien près sur moi un coup de pistoletdestiné à traverser ma poitrine, mais qui, par un effet miraculeux de la Divineprovidence, m’atteignit à l’articulation du coude du bras droit; ayant ensuite jeté àterre l’arme meurtrière, il cria “Vive la Grèce” et prit la fuite. Mon premiermouvement fut de répondre à son acclamation par celle de “Vive le Sultan”, et ayantà peine porté un regard sur la blessure, j’ai couru après l’assassin, mais il était déjàparti (…). L’homme fut ensuite arrêté aumoment où il criait: “J’ai sauvé la liberté dela Grèce, j’ai tué le tyran”’ (FM, 6-170).78 FM, 6-175.
la transplanter dans un meilleur terrain, où elle pourra prospérer et
rendre plus productifs son zèle et son dévouement
(Musurus à Mustafa Rechid Pacha, ministre des Affaires étrangères
ottoman [FM, 2-98, 8/20-8-1841]).
Et vous, mon cher Bey (…), comment allez-vous là-bas? Quelle sorte
de vie menez-vous? Trouvez-vous dans l’antique ville de Solon, les
mêmes jouissances que dans le Paris moderne? En fait d’esprit et
d’amabilité les Grecques ne le cèdent pas aux parisiennes.
(Ali Pacha à Halil Şerif Pacha, ministre à Athènes, 15 déc. 1856).79
Je rappelle les limites de l’exercice: apporter un éclairage ottoman sur
des relations internationales qui touchent peut-être autant les Ottomans
que les Grecs, mais à partir d’un lieu d’observation sur lequel les études
néo-helléniques auront toujours l’avantage: la monarchie grecque des
années 1840. Au moins, la figure dont il est question ne manque pas
d’intérêt: le premier représentant permanent de la Porte à Athènes, un
grec-orthodoxe, certainement plus ‘exposé’ à Athènes que ne l’aurait été
un musulman. Musurus aurait pu être de ces Grecs venus d’ailleurs,
présents en grand nombre sur les bancs de l’Assemblée nationale de
1844. Il aurait pu s’identifier au sentiment de supériorité culturelle
qu’éprouvaient certains patriotes, et faire sienne une autre vision
cosmopolite, qui liait les Grecs aux autres nations.80 On dira cependant
que l’occasion ne s’est pas présentée, que Musurus avait, dès les années
1830, pris une orientation qui l’engageait du côté de l’Empire. La Porte
ne s’y était pas trompée. Par le passé, elle avait pu soupçonner des
tentations de ‘double jeu’ chez certains de ses représentants.81 Mais elle
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 361
79 Cité en anglais par Roderic H. Davison, ‘Halil Şerif Paşa: The Influence...’, op.cit., pp. 59-60. Je remercie Sinan Kuneralp de m’avoir aidé à retrouver la citationoriginale. Nous ne disposons malheureusement pas de la réponse du successeur deMusurus.80 Sur les ressorts idéologiques du patriotisme grec, voir D.A. Sakkis, ‘Cultural...’,op. cit., pp. 45-51.81 Surtout lorsque ces représentants (Vénitiens ou Polonais par exemple) étaientissus des territoires où ils étaient envoyés (Gilles Veinstein, ‘Les missions...’, op. cit.,pp. 753-754).
savait qu’en envoyant Musurus, jeune diplomate en début de carrière, lié
aux réseaux néo-phanariotes, elle ne prenait aucun risque.À Athènes,Musurus ne cessa de cultiver sa condition d’étranger. L’homme se
considérait comme Ottoman avant tout. Pour autant, il ne se sentait pas
moins Grec que les Grecs de la nouvelle monarchie. Curieuse identité, à
nos yeux très contemporains, que cette identité impériale des années
1840, à la veille des engagements nationalistes du demi-siècle suivant.
J’insiste pour finir sur la personnalité du diplomate. Musurus est un
moderne, mais non au sens où l’historiographie ottomaniste l’aurait
situé, c’est-à-dire comme homme d’État, réformateur, anti-tradition-
naliste par excellence, que l’ensemble de ses attributs (diplomate,
Phanariote, francophone, amateur de lettres classiques et familier des
hautes figures occidentales) situerait idéalement sur le niveau supérieur
de l’échelle de la modernité.82 Plutôt au sens où il sait intervenir, agir et
communiquer à diverses échelles, manipuler plusieurs réseaux parallè-
lement, passer d’un monde à l’autre avec facilité, parfois même sans en
avoir conscience, s’adresser aussi bien à des villageois samiotes qu’aux
ambassadeurs britanniques, parcourir la presse européenne avec la
même aisance qu’il déchiffre l’épigraphie antique, écrire en grec quand il
s’adresse à son beau-père et en français quand il s’instruit auprès de sa
hiérarchie. Cette modernité, Musurus l’expérimente quotidiennement à
Istanbul. Il est parfaitement à son aise dans des quartiers où l’on trouve
plus d’hellénophones que de turcophones. C’est unmoderne heureux, au
cœur du renouveau philhellénique. C’est un dignitaire en ascension à la
Sublime Porte, où sa maîtrise du français le distingue davantage que son
ignorance de l’ottoman l’isole.
362 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
82 Roderic H. Davison, ‘Halil Şerif Paşa: Ottoman...’, op. cit., p. 221; CarterVaughn Findley, Ottoman Civil Officialdom. A Social History, Princeton: PrincetonUniversity Press, 1989, p. 131; Şerif Mardin, ‘SuperWesternization in Urban Lifein the Ottoman Empire in the last quarter of the Nineteenth Century’, dans PeterBenedict, Erol Tumertekin et FatmaMansur (dirs), Turkey: Geographic and SocialPerspectives, Leiden: Brill, 1974, pp. 403-446; Roderic H. Davison, ‘WesternizedEducation in Ottoman Empire’, The Middle East Journal, Summer 1961, pp. 289-301; Benjamin Fortna, ‘Islamic Morality in late Ottoman “Secular” Schools’,International Journal of Middle East Studies, 32/3, August 2000, pp. 369-393.
À Athènes, la modernité de Musurus est comme désactivée. Il estétranger partout, heureux nulle part, homme d’ancien régime, serviteur
du Grand Turc, diplomate qui ne comprend rien aux évolutions du Sud-
Est balkanique, aumouvement des nationalités, au fait révolutionnaire. Il
n’admet pas la réalité de l’‘Helladic turn’ (J.S. Koliopoulos),83 de la part
croissante prise par la référence à la monarchie hellénique dans l’espace
identitaire des Grecs méditerranéens. Il lui faut vivre à Vienne, puis à
Londres pendant plus de trente ans, pour évoluer dans ses jugements ; il
lui faut regarder de plus loin la scène balkanique, après les événements
de 1848-1849, la création de la Roumanie puis de la Bulgarie, et la
mutation des mouvements patriotiques en idéologies nationalistes. C’est
alors que Musurus reconnaît que les Grecs n’étaient pas les seuls à
penser leur destinée politique au sein d’un État indépendant. C’est alors
qu’il retrouve un horizon européen qui l’inscrit de nouveau dans la
modernité de son temps.
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 363
83 John Koliopoulos, Brigands..., op. cit., p. 9.
Bibliographie
SOURCES PRIMAIRES
Le FondMusurus (FM).
SOURCES SECONDAIRES
Alexandris, Alexis (1983), The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations, Athènes: Centre for Asia Minor Studies.
Alighieri, Dante (1890), Dante’s Inferno, Purgatorio, and Paradisio,translated into Greek verse by Musurus Pasha, Londres et Edinburg:Williams&Norgate (2me édition).
Anastassiadou, Meropi (2001), ‘De la paroisse à la communauté. Les Grecsorthodoxes de Stavrodromi (Beyoğlu-Istanbul)’, Anatolia Moderna, X,pp. 149-165.
Bertsch, Daniel (2005), Anton Prokesch von Osten, 1795-1876. EinDiplomat Österreichs in Athen und an der Hohen Pforte. Beiträge zurWahrnehmung des Orients im Europa des 19. Jahrhunderts, Munich: R.Oldenbourg.
Bouquet, Olivier (2004), ‘Être Prince de Samos. Désir de légation,imaginaire dynastique et ordre de la carrière chez Étienne et ConstantinMusurus’, dans Nicolas Vatin et Gilles Veinstein (dirs), Insularitésottomanes, Istanbul et Paris: Maisonneuve& Larose, pp. 277-293.
Bouquet, Olivier (2007), Les Pachas du sultan. Essai sur les agentssupérieurs de l’État ottoman, 1839-1909, Louvain: Peeters.
Çadırcı, Musa (1993), ‘Tanzimat Döneminde Çıkarılan Men’-i Mürûr vePasaport Nizamnameleri’ [Les règlements relatifs aux interdictions depassage et aux passeports produits à l’époque des Tanzimat], Belgeler,15/19, pp. 169-181.
Communautés, ‘nations’, minorités. Grecs orthodoxes de la Méditerranéeottomane et post-ottomane (XIXe-XXIe siècles), Colloque organisé parl’UMR 8032, Études turques et ottomanes (CNRS/EHESS), 25-26 juin2009.
Couderc, Anne (2001), État, nations et territoires dans les Balkans au XIXesiècle. Histoire de la première frontière gréco-ottomane, 1827-1881,Thèse de doctorat d’histoire, Paris: Université de Paris I-Sorbonne.
Couderc, Anne (2008), ‘Nation et circonscription. Construire et nommer’,dans Gilles de Rapper et Pierre Sintès (dirs), Nommer et classer dans lesBalkans, Athènes: École française d’Athènes, pp. 217-235.
Davison, Roderic H. (1961), ‘Westernized Education in Ottoman Empire’,TheMiddle East Journal, pp. 289-301.
364 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
Davison, Roderic H. (1981), ‘Halil Şerif Paşa: Ottoman Diplomat andStatesman’, Osmanlı Araştırmaları, II, pp. 203-221.
Davison, Roderic H. (1986), ‘Halil Şerif Paşa: The Influence of Paris and theWest on an Ottoman Diplomat’, Osmanlı Araştırmaları, VI, pp. 47-65.
Davison, Roderic H. (1988), ‘TheModernization of Ottoman Diplomacy inthe Tanzimat Period’, IX. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 21-25 eylül1981, Bildiriler, vol. II, Ankara: Türk Tarih Kurumu, pp. 1141-1151.
Davison, Roderic H. (1999), ‘Ottoman Embassies in Europe in theNineteenth Century’, XII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-16 Eylül1994, vol. IV, Ankara: TTK, pp. 1421-1441.
Demir, Betül (2000), II Mahmud Devrinde Berlin Sefarethanesi’nin YenidenAçılması ve Elçi Olarak Atanan Kamil Paşa’nın Faaliyetleri [L’ouverturede la nouvelle ambassade de Berlin et les activités de Kamil Pachanommé ambassadeur à l’époque de Mahmud II], Yüksek Lisans Tezi,Istanbul: Istanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Denis, Vincent (2008), Une histoire de l’identité. France, 1715-1815,Seyssel: Champ Vallon.
Driault, Edouard et Michel Lhéritier (1925), Histoire diplomatique de laGrèce de 1821 à nos jours, Paris: PUF.
Exertzoglou, Haris (1996), Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον19ο αιώνα. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως,1861-1912 [Identité nationale à Constantinople au XIXe siècle. Lesyllogue littéraire hellénique de Constantinople], Athènes: Nepheli.
Exertzoglou, Haris (2008), ‘Reconstituting Community. Cultural Differen-tiation and Identity Politics in Christian Orthodox Communities duringthe late Ottoman Era’, dans Minna Rozen (dir.), Homelands andDiasporas. Greeks, Jews and their Migrations, Londres: IB Tauris, pp.139-159.
Findley, Carter Vaughn (1989), Ottoman Civil Officialdom. A SocialHistory, Princeton: Princeton University Press.
Fleming, K.E. (2000), ‘Athens, Constantinople, “Istambol”. UrbanParadigms and Nineteenth-Century Greek National Identity’, NewPerspectives on Turkey, 22, pp. 1-23.
Fortna, Benjamin (2000), ‘Islamic Morality in late Ottoman “Secular”Schools’, International Journal ofMiddle East Studies, 32/3, pp. 369-393.
Georgiadou, Maria (2003), ‘Expert Knowledge between Tradition andReform. The Carathéodorys: A Neo-Phanariot Family in 19th CenturyConstantinople’, dans Meropi Anastassiadou-Dumont (dir.), Médecinset ingénieurs ottomans à l’âge des nationalismes, Paris: Maisonneuve &Larose; Istanbul: IFEA, pp. 243-294.
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 365
Georgis, George (1995), Στις απαρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής[Aux origines de la politique étrangère grecque], Athènes: Kastaniotis.
Georgis, George (1996),Η πρώτη µακροχρόνια ελληνοτουρκική διένεξη. Tοζήτηµα της εθνικότητας, 1830-1869 [La première confrontation gréco-ottomane. La question de la nationalité, 1830-1869], Athènes:Kastaniotis.
Gondicas, Dimitri et Charles Issawi (dirs) (1999), Ottoman Greeks in theAge of Nationalism. Politics, Economy, and Society in the NineteenthCentury, Princeton: Darwin Press.
Karpat, Kemal (1985), Ottoman Population, 1830-1914. Demographic andSocial Characteristics, Madison: University ofWiskonsin Press.
Koliopoulos, John (1987), Brigands with a Cause. Brigandage andIrredentism in Modern Greece, 1821-1912, Oxford: Oxford UniversityPress.
Kostis, Kostas (2005), ‘The Formation of the State in Greece, 1830-1914’,dans Faruk Birtek et Thalia Dragonas (dirs), Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey, Londres et New York: Routledge, pp. 18-36.
Kuneralp, Sinan (1970), ‘Bir Osmanlı diplomatı Kostaki Musurus Paşa,1807-1891’ [Un diplomat ottoman: Kostaki Musurus Pacha, 1807-1891], Belleten, XXXIV/135, pp.421-437.
Kuneralp, Sinan (1987), ‘The Establishment of Diplomatic Relationsbetween the Ottoman Empire and the Kingdom of Greece, 1834-1840’,dans idem (dir.), Studies on Ottoman Diplomatic History, vol. I,Istanbul: Isis, pp. 73-76.
Kuneralp, Sinan (1999), ‘Musurus Paşa’, Osmanlılar Ansiklopedisi, vol. II,Istanbul: YapıKredi, pp.326-327.
Loukos, Christos (2007) ‘Some Suggestions for a Bolder Incorporation ofthe Greek Revolution of 1821 into their Ottoman Context’, dans AntonisAnastasopoulos et Elias Kolovos (dirs), Ottoman Rule in the Balkans,1760-1850, Rethymno: Crete University Press, pp. 195-203.
Mardin, Şerif (1974), ‘SuperWesternization in Urban Life in the OttomanEmpire in the last quarter of the Nineteenth Century’, dans PeterBenedict, Erol Tumertekin et FatmaMansur (dirs), Turkey: Geographicand Social Perspectives, Leiden: Brill, pp. 403-446.
Moutafidou, Ariadni (2008), ‘Greek Merchant Families Perceiving theWorld. The Case of Demetrius Vikelas’, Mediterranean HistoricalReview, 23/2, pp. 143-164.
Musurus, Paul (1929), Sonnets et stances, Paris: Alphonse Lemerre.Noiriel, Gérard (dir.) (2007), L’identification. Genèse d’un travail d’État,Paris: Belin.
366 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
Noradounghian, Gabriel Efendi (1897-1903), Recueil d’Actes interna-tionaux relatifs à l’Empire ottoman, 4 vols, Paris: Cotillon; Leipzig:Breitkopf &Haertel; Neuchâtel: Attinger.
Örenç, Ali Fuad (1995), Yakın Dönem Tarihimizde Sisam Adası, 1821-1923 [L’île de Sisam dans notre histoire contemporaine, 1821-1923],Yüksek Lisans Tezi, Istanbul: Istanbul Üniversitesi, Sosyal BilimlerEnstitüsü.
Pears, Edwin (1916), Forty Years in Constantinople. The Recollections ofSir Edwin Pears, 1873-1913, Londres: Ayer Co.
Petropoulos, John A. (1968), Politics and Statecraft in the Kingdom ofGreece, 1833-1843, Princeton: Princeton University Press.
Philliou, Christine (2004), Worlds, Old and New. Phanariot Networks andthe Remaking of Ottoman Governance in the First Half of the NineteenthCentury, PhD Thesis, Princeton: Princeton University.
Philliou, Christine (2007) ‘Breaking the Tetrachia and Saving theKaymakam. To Be an Ambitious Ottoman Christian in 1821’, dansAntonis Anastasopoulos et Elias Kolovos (dirs), Ottoman Rule in theBalkans, 1760-1850, Rethymno: Crete University Press, pp. 181-194.
Philliou, Christine (2008), ‘The Paradox of Perceptions. Interpreting theOttoman Past through the National Present’, Middle Eastern Studies,44/5, pp. 661-675.
Philliou, Christine (2009), ‘Communities on the Verge. Unraveling thePhanariot Ascendancy in Ottoman Governance’, Comparative Studies inSociety and History, 51/1, pp. 151-181.
Pippidi, Andrei (1980), Hommes et idées du Sud-Est européen à l’aube del’âge moderne, Bucarest: Academiei RSR; Paris: CNRS.
Poulos, Ioannis Ch. (1958), Το επεισόδιον Μουσούρου. Η ελληνοτουρκικήδιένεξις του 1847 [L’incident Musurus. Le conflit gréco-turc de 1847],Athènes: [s.n.]
Rhangabé, Eugène R. (1892), Livre d’or de la noblesse Phanariote en Grece,en Roumanie, en Russie et en Turquie par un phanariote, Athènes: S.G.Vlastos.
Sakkis, D.A. (2000), ‘Cultural Patriotism in the Southern Balkans. TheCase of Greece, 1833-1848’, Balkan Studies, 41/1-2, pp. 43-81.
Shearer, David (2004), ‘Elements Near and Alien. Passportization, Policing,and Identity in the Stalinist State, 1932-1952’, The Journal of ModernHistory, 76, pp. 835-881.
Smyrnelis, Marie-Carmen (2007), ‘La Diaspora marchande grecqueméditerranéenne (XVIIIe-XIXe siècles) à travers le parcours d’une famille:les Baltazzi’, Actes du colloque sur les Arméniens et les Grecs en
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 367
diaspora. Approches comparatives, Athènes: École française d’Athènes,pp. 85-92.
[Soutzo, Nicolas] (1899), Mémoires du Prince Nicolas Soutzo, grandlogothète de Moldavie, 1798-1871, publiées par Panaioti Rizos, Vienne:Gérold&Cie.
Sözen, Zeynep (2000), Fenerli Beyler. 110 Yılın Oykusu [Les Princesphanariotes. Une histoire de 110 ans], Istanbul: Aybay.
Steinwedel, Charles (2000), ‘Making Social Groups, One Person at a Time.The Identification of Individuals by Estate, Religious Confession, andEthnicity in late Imperial Russia’, dans Jane Caplan et John Torpey(dirs), Documenting Individual Identity. The Development of StatePractices since the French Revolution, Princeton: Princeton UniversityPress, pp. 67-82.
Strauss, Johann (1995), ‘The Millets and the Ottoman Language. TheContribution of Ottoman Greeks to Ottoman Letters (19th-20thCenturies)’, DieWelt Des Islams, XXXV/1-2, pp. 189-249.
Strauss, Johann (1999), ‘Les voies de la transmission du savoir dans unmilieu cosmopolite. Lettrés et savants à Istanbul au XIXe siècle’, dansFloréal Sanagustin (dir.), Les intellectuels en Orient musulman. Statutet fonction, Le Caire: IFAO, pp. 109-125.
Strupp, Karl (1918), La situation internationale de la Grèce, 1821-1917.Recueil de documents, Zurich: Die Verbindung.
Sturdza, Mihail-Dimitri (1983), Dictionnaire historique et généalogiquedes grandes familles de Grèce, d’Albanie et de Constantinople, Paris: M.-D. Sturdza.
Süslü, Azmi (1981/82), ‘Un aperçu sur les ambassadeurs ottomans et leurssefaretnames’, Tarih AraştırmalarıDergisi, XIV/25, pp. 233-260.
Symposium L’Époque Phanariote, 21-25 Octobre 1970 (1974), Thessa-loniki: Institute for Balkan Studies.Τα κατά Μουσούρον ή Ελληνοτουρκική διαφορά [Affaire Musurus ou ledifférend gréco-turc] (1847), Athènes: Antoniádis.
Tomkinson, John L. (2006), Travellers’ Greece. Memories of an EnchantedLand, Athènes: Anagnosis (2me édition).
Torpey, John C. (2000), The Invention of the Passport. Surveillance,Citizenship, and the State, New York: Cambridge University Press.
Trimi, Katerina (1999), ‘La famille Benakis: un paradigme de la bourgeoisiegrecque alexandrine’, dans Meropi Anastassiadou et Bernard Heyberger(dirs), Figures anonymes, figures d’élite. Pour une anatomie de l’Homoottomanicus, Istanbul: Isis, pp. 83-102.
368 SOCIETY, POLITICS AND STATE-FORMATION IN SOUTHEASTERN EUROPEDURING THE 19th c.
Unat, Faik Reşit (1968), Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnâmeleri [Lesambassadeurs et les rapports d’ambassade ottomans], Ankara: TTK.
Vafeas, Nikolaos (1998), Pouvoir et conflits dans l’Empire ottoman. Larévolte de 1849-1850 dans la Principauté de Samos, Thèse de doctoratd’histoire, Florence: European University Institute.
Vattel, Emer de (1820), Le Droit des gens ou Principes de la loi naturelleappliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, Paris:Janet & Cotelle.
Veinstein, Gilles (2008), ‘Les missions diplomatiques ottomanes en Europeavant l’instauration des ambassades permanentes’, Cours et travaux duCollège de France, Résumés 2006-2007, Paris: Collège de France, pp.749-770.
Vogli, Elpida (2009), ‘National Centre and Transnational Periphery. AGreece for Greeks by Descent? 19th-Century Policy on Integrating theGreek Diaspora’, in Dimitris Tziovas (dir.), Greek Diaspora andMigration since 1700. Society, Politics and Culture, Surrey: Ashgate, pp.99-110.
Weber, Shirley Howard (comp.) (1952), Voyages and Travels in the NearEast Made during the Nineteenth Century, Princeton: The AmericanSchool of Classical Studies at Athens.
Yerasimos, Stéphane (2005), ‘L’obsession territoriale ou la douleur desmembres fantômes’, dans Semih Vaner (dir.), La Turquie, Paris: Fayard,pp. 39-60.
Zervos, Socrate (1990), Recherches sur les phanariotes et leur idéologiepolitique, 1666-1821, Thèse de doctorat d’histoire, Paris: EHESS.
UNRUMAUX PAYS DES HELLÈNES 369