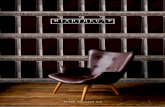iss A tp O m ng iss A i m it p O ro fs m el bo rP tn e m ... - Aaltodoc
M. Christol, M. Heijmans, De la Gaule méridionale à Rome, un chevalier arlésien et sa famille :...
Transcript of M. Christol, M. Heijmans, De la Gaule méridionale à Rome, un chevalier arlésien et sa famille :...
Michel ChristolMarc Heijmans
De la Gaule méridionale à Rome, un chevalier arlésien et safamille: P(ublius) Propertius Pater[culus]In: L'antiquité classique, Tome 71, 2002. pp. 93-102.
RésuméMichel Christol, M. Heijmans (Paris-Sorbonne), De la Gaule méridionale à Rome, un chevalier artésien et sa famille : P(ublius)Propertius Pater [culus], - La publication d'une nouvelle inscription d'Arles fait connaître un personnage de rang équestre,s'appelant P(ublius) Propertius Pater[culus]. Sa carrière peut être restituée avec suffisamment de précision jusqu'au tribunatmilitaire. On le rapprochera de NScav., 1923, p. 376, qui fait connaître Ingenuus, P(ubli) Properti Paterculi dispensator. Cetesclave s'occupait de la gestion des biens d'un grand personnage, chevalier ou sénateur, établi à Rome. Ceci pourrait signifierl'entrée de cette famille arlésienne dans l'aristocratie impériale.
Citer ce document / Cite this document :
Christol Michel, Heijmans Marc. De la Gaule méridionale à Rome, un chevalier arlésien et sa famille: P(ublius) PropertiusPater[culus]. In: L'antiquité classique, Tome 71, 2002. pp. 93-102.
doi : 10.3406/antiq.2002.2480
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/antiq_0770-2817_2002_num_71_1_2480
De la Gaule méridionale à Rome, un chevalier arlésien et sa famille : P(ublius) Propertius Pater [culus]
Lors des fouilles de J. Formigé au cœur de la ville d'Arles, dans les galeries des cryptoportiques1, de nombreux documents épigraphiques furent mis au jour. Certains furent à peine signalés et ne reçurent pas alors l'honneur de la publication. Ainsi, dans un des secteurs les plus productifs en documents d'époque romaine, le dépotoir de la galerie nord du site, en 1952 plusieurs fragments de marbre
à une plaque inscrite furent exhumés (CRY 52.00.06)2. Ils étaient mêlés au clipeus virtutis et à d'autres inscriptions honorifiques du Ier siècle ap. J.-C, ainsi qu'à des éléments de sculptures provenant des monuments du forum. Ils avaient été rassemblés là afin d'alimenter un four à chaux, au début du Ve siècle.
Ces fragments, une fois rapprochés, apportent la partie gauche d'une composée de quatre lignes au moins. L'écriture est de belle facture, avec des Ρ à
la boucle non fermée, un O de forme parfaitement circulaire, le recours à des lettres qui parfois surplombent la ligne (le Τ à la 1. 2) ou qui parfois se caractérisent par une taille réduite. La gravure permet de comparer cette inscription à celle que supporte une autre plaque, trouvée dans le même lieu et, elle aussi, reconstituée à partir des fragments mis au jour durant les diverses campagnes de fouille. Elle avait été
apposée sur une base de statue : elle portait le cursus d'un chevalier arlésien3. Cette dernière appartient à l'époque augustéenne, alors que l'inscription qui nous intéresse principalement ici ne peut être datée qu'un peu plus largement : à l'époque
1 Mise au point : M. Heijmans, "Nouvelles recherches sur les cryptoportiques d'Arles et la topographie du centre de la colonie", RAN 24 (1991), p. 162-199 ; pour le dépotoir, partie, p. 169-170. Informations succinctes par F. Benoit, "Informations archéologiques", Gallia 8 (1950), p. 120.
2 F. Benoit, "Informations archéologiques", Gallia 11 (1953), p. 109 : « deux duumvirs arlésiens de la tribu Teretina : l'une encore incomplète portant le nom de P. Propefrtius ?] ; l'autre complétant le cursus de [T. Iulijus, Ilvir et Augustalis, précédemment signalée » ; sur cette dernière, voir n. suiv. L'inscription qui nous intéresse fut omise dansai? 1954, p. 30 qui ne reprenait que celle du chevalier romain déjà mentionné par AE 1952, 109. Il n'en est rien dit non plus dans F. Benoit, "Le sanctuaire d'Auguste et les cryptoportiques d'Arles", RA (1952), p. 31-67.
3 Benoit, "Cryptoportiques d'Arles...", p. 55 (d'où AE 1952, 169) ; Id., "Informations archéologiques", Gallia 11 (1953), p. 110 (d'où AE 1954, 104); M. Christol, "Notes d'épigraphie, 1. Un chevalier d'Arles, prêtre du culte impérial", CCG 7 (1996), p. 307-312 (d'où AE 1996, 1008). D'une bibliographie abondante retenons H.-G. Pflaum, Les fastes de la province de Narbonnaise, Paris, 1978, p. 196, n° 2, ainsi que p. 197 et 257 ; B. Dobson, Die Primipilares, Köln, 1978, p. 172 ; H. Devuver, Prosopographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum (= PME), I, Louvain, 1976, p. 433-434, I 13 ; IV
I), Louvain, 1987, p. 1591 et V (Supplément II), Louvain, 1993, p. 2130 ; S. Demougin, Prosopographie des chevaliers romains julio-claudiens, Rome, 1992, p. 80-81, n° 70.
L 'Antiquité classique 71 (2002), p. 93-102.
94 M. CHRISTOL M. HEIJMANS
augustéenne ou peu après, mais sans dépasser vraisemblablement le milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Dimensions (conservées) - Hauteur: 45; largeur: 26; épaisseur: 1,5. Hauteur des lettres - L. 1 : 6,3 ; L. 2 : 5,7 (T : 7 ; R : 4,1) : L. 3 : 5,4 ; L. 4 : 4,8.
Le texte se présente ainsi (fig. 1) :
1 P-PROPE+— 2 TER-PATE+— 3 II-VIR-P+— 4 FABR·—
Fig. 1. L'inscription d'Arles (cliché Chèné, centre Camille Jullian, Aix-en-Provence).
UN CHEVALIER ARLÉSIEN ET SA FAMILLE 95
Aux lignes 1 et 3 ne subsiste plus de la dernière lettre conservée qu'une partie de haste verticale, marquant le début de la lettre. À la 1. 2, il reste suffisamment d'éléments pour reconnaître le R, appelé par la restitution vraisemblable. À la ligne 4, le point séparatif, sous forme d'une délicate hederá, montre que le mot fabr(um) avait été abrégé. Les points séparatifs sont triangulaires aux lignes 1, 2 et 3 ; puis ils prennent la forme de Y hederá à partir de la ligne 3. On notera aussi les empattements des hastes, très larges, et la grande qualité de la gravure.
Aux lignes 1 et 2 se développait la dénomination du personnage. On restituera à la fin de la ligne 1 le gentilice Propertius, comme l'avait déjà proposé F. Benoît, et la filiation, puisqu'à la ligne 2 la mention de la tribu Teretina fait admettre que la dénomination du personnage comportait tous les éléments caractéristiques de celle d'un citoyen romain.
L'identification du gentilice Propertius s'impose, si l'on se réfère aux listes compilées dans l'ouvrage de H. Solin et d'O. Salomies4. Mais ce gentilice est nouveau dans l'anthroponymie de la colonie d'Arles. Il s'agit d'un gentilice italien, attesté à Rome et dans plusieurs cités de la péninsule. Mais il est surtout concentré dans la cité d'Assise5. Dans cette cité on peut suivre le destin de ce nom de famille depuis la fin du IIe s. av. J.-C.6, et constater que le gentilice du poète, né vers 47 av. J.-C, puis établi à Rome, n'était pas isolé.
C'est principalement l'Ombrie qui fournit les indications les plus denses, dans la mesure où le foyer constitué à Assise s'est particulièrement développé. Il est remarquable par le nombre des attestations (20 selon les inventaires de G. Forni), et par la présence de personnages de bon niveau social, le decurión Cn(aeus) Propertius T. f. Scaeva7 et surtout le chevalier romain C(aius) Passenus C. f. Serg. Paullus Propertius Blaesus8. À proximité de cette cité on relèvera, à Mevania, le chevalier romain Sex(tus) Caesius Sex. f. Propertianus9. Mais on pourrait également mettre en évidence, quoiqu'à un degré moindre, le Latium adiectum, puisqu'à Abella, en particulier, ce gentilice apparaît aussi dans les familles de notables10.
4 H. Solin, O. Salomies, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum (éd. nova), Hildesheim/Zurich/New York, 1994, p. 144.
5 G. Forni, "I Properzi nel mondo romano : indagine prosopografïca", Atti délia Accademia nazionale dei Lincei, S. VIII. Rendiconti, Cl. di se. morali, storiche e filologiche, XL, 5-6 (1985), p. 205-223 ; pour les inscriptions d'Assise: G. Forni, Epigrafï lapidarle romane di Assisi (= Assisi), Perouse, 1987. Voir aussi M. Gaggiotti-L. Sensi, "Ascesa al senato e rapport! con i territori d'origine. Italia : regio VI (Umbría)", in Epigrafía e ordine senatorio II, Rome, 1982 {Tituli, 5), p. 262-263.
6 Forni, "I Properzi...", p. 219-220. 7 AE 1978, 294 (= Assisi, 565). 8 CIL XI, 5405 (= Assisi, 47) ; ILS, 2925 ; Forni, "I Properzi...", p. 212-213, 220. C'est
un correspondant de Pline le Jeune (Ep. VI, 15, 1 et IX, 22, 1) ; R. Syme, Roman Papers VII, Oxford, 1991, p. 495.
9 CIL IX, 5028 ; Devijver, PME I, p. 207, C 44 ; V, p. 2044. Mevania est un municipe d'Ombrie.
10 T(itus) Propertius T. f. Thor[— ] (duumvir) : CIL I2, 1609 = X, 1218 = ILLRP, 519 ; M. Cebeillac, Les magistrats des cités italiennes de la seconde guerre punique à Auguste. Le Latium et la Campante, Rome, 1998, p. 76-77. C'est pourquoi la mention passim, pour
96 M. CHRISTOL M. HEIJMANS
Parmi les porteurs de ce gentilice le personnage le plus connu est le poète, originaire d'Assise". Quant au sénateur C(aius) Propertius Postumus, qui épousa Aelia Galla, filie d'Aelius Gallus qui aurait pu être le père adoptif de Séjan, issu lui- même de Volsinies en Étrurie12, on ne saurait pour l'instant lui attribuer, en Italie, une origine précise13, mais ce que l'on sait de la diffusion du gentilice oriente tout de même vers l'Étrurie et l'Ombrie14. Il en est de même pour le sénateur Propertius Celer qui, apauvri, fut aidé par Tibère15 : on ne peut toutefois lui attribuer une origine précise16.
En Narbonnaise on ne trouve que peu de témoignages complémentaires. Isolé à Nîmes apparaît G(aius) Propertius Epapra (= Epaphra), au IIe siècle17. Isolé aussi, à Hyères, apparaît C(aius) Propertius A[— ]18. Cela faisait en tout deux exemples avant que ne soit mise au jour l'inscription d'Arles. Mais pour l'instant, dans la colonie des Sextani, ce nom de famille demeure unique lui aussi, ce qui laisse en suspens la question de l'enracinement local de la famille et celle de son possible rayonnement, même s'il est bien évident qu'il s'agit d'une importante famille de notables, honorée dans l'un des lieux publics essentiels de la cité, à peu de distance de sa fondation pour les vétérans de César19.
Si l'on peut avancer que l'origine tusco-ombrienne apparaît comme dominante, on pourrait insérer les Propertii arlésiens dans un groupe de
qualifier la répartition de ce gentilice, dans Solin et Salomies, Repertorium, p. 149, semble peu appropriée.
11 T.P. WISEMAN, New men in the Senate, 139 B.C.-14 A.D., Oxford, 1971, p. 52 ; R. Syme, La révolution romaine (tr. fr.), Paris, 1967, p. 442. Retenons, à son propos et à propos d'Ovide, le jugement de R. Syme, The Augustan Aristocracy, Oxford, 1986, p. 359 : « They belonged to the class of "domi nobiles", the men of substance and repute in the towns of Italy » ; voir aussi J.-P. Boucher, Études sur Properce. Problèmes d'inspiration et d'art, Paris, 1965, p. 105-111.
12 Demougin, Prosopographie, p. 57 (n° 42 : Aelius Gallus), p. 236-237 (n° 272 : L. Aelius Seianus).
Syme, Révolution romaine, p. 442-443, admet une parenté entre le poète et C(aius) Propertius Postumus (C(aius) Propertius Q.f. T.n. Fab. Postumus); de même Id., Augustan Aristocracy, p. 359, en se fondant sur la rareté du gentilice ; Wiseman, New men, p. 254, n° 345, fait remarquer que la tribu Fabia n'est pas attestée en Ombrie. Assise pour sa part se trouve dans la tribu Sergia. Mais à ce propos on retiendra les observations de Forni, "I Properzi...", p. 214-215, qui trouve que cet argument n'est pas aussi fort qu'on pourrait le croire. Enfin Gaggiotti-Sensi, in Epigrafía e ordine senatorio II, p. 263.
14 Ce serait au moins le cas de son épouse : Demougin, Prosopographie, p. 236. 15 Tac, Ann. I, 75, 3 ; Syme, Roman Papers VII, p. 495. 16 Wiseman, New men, p. 254, n° 344, ne lui attribue une origine ombrienne qu'avec une
très grande réticence ; Gaggiotti-Sensi, in Epigrafía e ordine senatorio II, p. 263, sont également évasifs.
17 CIL XII, 3891, revue par M. Christol, D. Darde, A. Magioncalda, A. Daguet, S. Lefebvre, in Archéologie à Nîmes. Bilan de 40 années de recherches et de découvertes, 1 950-1 990, Nîmes, 1990, p. 179, n° 5 (d'où A Ε 1995, 1056).
lx CIL XII, 387 ; ILGN, 47. 19 Outre le mise au point de M. Heijmans citée ci-dessus (n. 1), P. Gros, "Un programme
augustéen : le centre monumental de la colonie d'Arles", JDAI 102 (1987), p. 339-363.
UN CHEVALIER ARLÉSIEN ET SA FAMILLE 97
familles manifestement issues. de cette partie de l'Italie, qui profitèrent de de la colonie de vétérans à la fin de l'époque césarienne. Déjà H. -G. Pflaum
avait mis en valeur que la famille du sénateur A(ulus) Annius Camars pourrait être originaire d'Étrurie en raison de la conservation du surnom Camars au fil des generations .
Un autre exemple remarquable est fourni par une inscription incomplète, enregistrée par Hirschfeld et actuellement conservée dans les réserves du Musée21. Hirschfeld estimait qu'elle présentait des lettres caractéristiques du début du Ier siècle ap. J.-C, ce qui signifie qu'elle appartient aux plus anciennes inscriptions de la colonie et que l'on peut même envisager, sans hésiter, une date un peu plus haute que celle que postulait le savant éditeur du CIL. Ce dernier attribuait aux personnes connues par ce texte le gentilice Ubilatro / Ubilatronia, qui apparaissait ainsi comme exemple unique22. Pourtant, dans son étude sur les gentilices latins, W. Schulze n'a pas retenu la lecture de son prédécesseur. Il a préféré lire dans l'inscription le gentilice Viblatro/Viblatronia, attesté aussi dans une inscription d'Arna en Ombrie23. Il s'agit d'un gentilice très rare, formé sur le modèle de Commeatro/Commeatronia24 . L'erreur de Hirschfeld s'explique par l'abondance des ligatures dans la partie conservée de l'inscription d'Arles. Mais il faut rendre hommage à la perspicacité de Schulze et faire disparaître de l'index des gentilices du CIL ce nom de famille qui n'a plus de raison de s'y trouver25.
Un autre cas, comparable, est fourni par la dénomination de M(arcus) Saenius M. f. Ter. Secundus, dont l'inscription appartient aussi à une haute époque26. Ce nom de famille est aussi bien concentré en Étrurie, comme l'a souligné W.V. Harris27.
20 H. -G. Pflaum, "Une famille artésienne à la fin du Fr siècle et au IIe siècle de notre ère", BSNAF (1970), p. 265-272 (= La Gaule et l'Empire romain. Scripta varia II, Paris, 1981, p. 4-11). Sur les Annii en Étrurie, W. Harris, Rome in Etruria and Umbría, Oxford, 1971, p. 199-200.
21 CIL XII, 906. 22 D'où l'index, CIL XII, p. 884. 23 W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin, 1904, p. 299. CIL X,
5611 : Fortunae Bon(ae). L(ucius) Viblatro Clemens v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Voir aussi Solin, Salomies, Repertorium, p. 207 (pour Viblatro ; Ubilatro n'apparaît donc pas dans ce recueil). Voir aussi M. Christol, BSNAF (1913), p. 117-118 (d'où AE 1975, 585).
24 Schulze, Eigennamen, p. 342, 380 ; Solin, Salomies, Repertorium, p. 59. CIL X, 6556, 6557.
25 Dans AE 1975, 585 (voir ci-dessus n. 23) la lecture alternative Vib(ia) Latronia est proposée dans le commentaire qui complète la notice (d'où l'index p. 284), mais elle ne peut être retenue, car fallacieuse. Pourtant elle a été validée dans les Tables générales de l 'Année épigraphique, VIIIe série (1961-1980), établies par J.-M. LASSERE : p. 197 pour Vib(ia) Latronia, dans l'index des gentilices, puis p. 259 où apparaît Latronia, dans l'index des cognomina (en revanche aucune mention de l'authentique Viblatro parmi les gentilices). Il faut corriger cette indexation hasardeuse et trompeuse.
26 CIL XII, 609. 27 Harris, Rome in Etruria, p. 322-324. Le gentilice Saenius est attesté en particulier
dans l'Étrurie du centre et du nord ainsi qu'en Ombrie (Florence, Clusium, Asisium, Volaterrae ; cf. les index du CIL XI) ; de là il s'est diffusé vers l'Italie et ailleurs : Schulze, Eigennamen, p. 93, 228.
M. CHRISTOL M. HEIJMANS
L'inscription de ce nouveau notable arlésien s'insère bien dans le contexte des déplacements de populations italiennes par la colonisation militaire césarienne.
L'inscription est malheureusement incomplète, en sorte qu'une partie des restitutions demeure sujette à caution.
Toutefois on n'hésitera pas à compléter la ligne 1 par la fin du gentilice et par la filiation, ce qui nous fournit au moins six lettres supplémentaires, en comptant le R. On verra que la restitution d'un prénom paternel abrégé par plus d'une lettre pourrait également convenir (TI ou SEX), mais c'est peut-être le mot filio qui n'était pas fortement abrégé (FIL). La ligne 1 comportait donc a priori entre 12 et 14 lettres. Cette dernière évaluation semble vraisemblable, à la lumière des observations sur la ligne 3.
À la ligne 2, après la mention de la tribu Ter(etina) se trouvait le surnom. On envisagera à première vue la restitution du surnom Paternus, qui est très bien attesté dans l'épigraphie de la province, y compris chez les notables, mais Pater dus ou Paterculus pourraient également convenir : en ce domaine aussi, les inventaires de H. Solin et d'O. Salomies sont très précieux28. Mais on tiendra compte qu'existe à Rome un témoignage sur un personnage d'une certaine importance sociale, s'appelant P(ublius) Propertius Paterculus29. C'est pourquoi on n'écartera pas le surnom Paterculus, même s'il est nettement moins fréquemment attesté que Paternus30. Comme on va le voir plus bas, c'est la solution qui, dans l'état de nos connaissances, doit avoir la préférence.
En tenant compte que le premier mot de cette ligne 2 comporte une petite lettre, le nombre total de signes pourrait à cette ligne osciller entre 13 et 15. Or, en ajoutant le surnom Paterno nous ne parvenons qu'à dix lettres. En ajoutant le surnom Paterculo nous parvenons à douze lettres, mais il existe une possibilité d'inclusion de l'V dans le C. De plus à cette ligne il devait se trouver, à droite, la place pour un autre mot, si l'on accepte les observations générales que nous venons d'effectuer. Mais nous quittons alors, sans aucun doute, la dénomination du personnage pour aborder son cursus.
Celui-ci devait d'abord comporter les éléments municipaux. Puis il se par ce que l'on appellera la carrière impériale. La transition de l'une à l'autre
s'effectue à la ligne 3. Ici, à la ligne 2, avant la mention du duumvirat on sera tenté d'insérer d'autres éléments de la carrière municipale. On pourrait envisager la
Solin et Salomies, Repertorium, p. 376. 29 Not. Scav. (1923), p. 376 (le texte est transcrit plus bas). L'inscription est signalée par
Forni, "I Properzi...", p. 218, mais ce savant lui a consacré peu d'attention, en particulier à la p. 209 lorsqu'il examine les prénoms utilisés par les divers rameaux gentilices desPropertii.
30 Près d'Arles, CIL XII, 983 : Kareia Karei f(ilia) Patercla ; dans l'épigraphie locale surtout C. Statius Paterclus (CIL XII, 882). D'autres attestations à Nîmes : CIL XII, 3683 {Paterculus), AE 1982, 690 {Patercla). Voir I. K.A.IANTO, The Latin cognomina, Helsinki, 1965, p. 304.
UN CHEVALIER ARLÉSIEN ET SA FAMILLE 99
mention des premières magistratures31, soit q(uaestori) ou aed(ili). Toutefois ceci créerait dans l'épigraphie arlésienne une séquence, certes possible, mais nouvelle, car il ne semble pas habituel de mentionner dans son intégralité le cursus municipal, ni même, lorsque l'on fait partie de l'élite municipale, l'appartenance à Yordo des décurions32. Il est donc préférable d'envisager la mention d'un sacerdoce
: on restituera soit aug(uri) soit pont(ifici). À la ligne 3, après la mention du duumvirat, il faut restituer sans hésiter le mot
praefecto. Si l'on opte pour la restitution courte, on abrégera en praefect(o). Mais peut-être faut-il préférer la restitution la plus longue, et ajouter un O prenant assez de place. En tout cela fait quatorze lettres. Nous ajouterons ainsi le personnage au groupe des duumvirs arlésiens, dont J. Gascou a récemment dressé la liste34. De même faudra-t-il l'ajouter aux groupe des préfets des ouvriers issus de cette colonie. Ils sont au nombre de trois : l'anonyme dont la carrière a été évoquée plus haut, notre personnage, et un dernier anonyme dont le mausolée a été mis au jour dans la nécropole du cirque35. Un quatrième exemple pourrait être ajouté : il s'agit d'un quasi-anonyme, M(arcus) Te[— ], dont toutefois la fonction de préfet des ouvriers fait l'objet d'une restitution qui demeure hypothétique36.
31 J. Gascou, "Magistratures et sacerdoces municipaux dans les cités de Gaule Narbon- naise", in M. Christol, O. Masson, Actes du )£' congrès international d'épigraphie grecque et latine (Nîmes, 4-9 octobre 1992), Paris, 1997, p. 82. La questure n'est pour l'instant attestée que par une restitution aléatoire de Herzog, abandonnée par Hirschfeld, cf. CIL XII, p. 932 et 941 (à propos de CIL XII, 712). Mais son existence dans une colonie est indubitable. L'édilité est plus régulièrement attestée : voir Gascou, p. 82, n. 43.
D'où la correction à CIL XII, 701 : au lieu de [decurio] ni, Arelatenses municipes, comme l'envisageait Hirschfeld, on devrait préférer [Sextajni Arelatenses municipes. Cette solution a été formulée par M. Christol, M. Heijmans, "Nouvelles inscriptions d'Arles ", Documents d'arch. méridionale 14 (1991), p. 360, n. 14 : elle n'est pas prise en compte par Gascou, "Magistratures...", p. 83, n. 54, même s'il estime que la mention du décurionat dans les inscriptions de notables n'est pas courante.
33 Sur les sacerdoces arlésiens, Gascou, "Magistratures", p. 82-83. L'augurât doit être restitué dans l'inscription AE 1954, 104 (voir ci-dessus n. 3).
34 Gascou, "Magistratures", p. 83 : CIL XII, 692 ; CIL XII, 698 ; CIL XII, 701. 3" Pour le premier anonyme, voir ci-dessus (n. 3). Pour le dernier anonyme, qui pourrait
appartenir à la tribu Voltinia, et donc ne serait arlésien que par alliance, l'inscription a été gravée sur un mausolée, dont subsistent quelques fragments architecturaux :
"Du nouveau sur l'Arles antique", Revue de V Arles antique 1 (1987), p. 112-113. À présent, S. Demougin, "Un préfet des ouvriers d'Arles", in Epigrafía romana in area adriatica. Actes de la IXe rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Macerata, 10-11 nov. 1995), Macerata, 1998, p. 333-341, d'où AE 1998, 886. Le premier de ces personnages ne figure pas dans la liste de R. Sablayrolles, "Les praefecti fabrum de Narbonnaise", RAN 17 (1984), p. 241-243, ni dans celle de L. Lamoine, "C. Gresius Domitus, un praefectus fabrum à Béziers ?", CCG 10 (1999), p. 144-146.
36 CIL XII, 671 et Mémoires de l'Institut historique de Provence 9 (1932), p. 132-135 ; H. -G. Pflaum, Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut Empire romain, Paris, 1960, p. 118-123, n° 52 ; Id., Fastes, p. 125-129, n° 7 ; brève mention chez Sablayrolles, "Les praefecti fabrum de Narbonnaise", p. 240, n. 10. Hirschfeld, ad CIL XII, 571 et index p. 923, qui le premier proposa de restituer cette fonction, était conscient de son caractère aléatoire.
100 M. CHRISTOL M. HEIJMANS
À la ligne 4 on pourrait légitimement hésiter avant de restituer une dernière fonction. Mais on sera tenté de restituer la fonction équestre par excellence, celle de tribun des soldats : la restitution des abréviations trib. milit. ferait ajouter neuf lettres, celle des abréviations trib. militum onze lettres. En retenant cette dernière on parviendrait en tout à quinze signes dans la ligne. Ainsi la carrière de P(ublius) Propertius Pater[culus] s'accordait bien avec quelques autres carrières de chevaliers romains de Narbonnaise37.
S'il y avait une ligne 5, elle pouvait marquer, entre deux retraits, dont celui de gauche est bien visible, l'hommage de la cité, vraisemblablement sous la forme d'un décret des décurions. Cette plaque aurait donc porté un texte dont le contenu', quoique moins abondant, était assez proche de l'autre hommage mis au jour dans les fouilles des cryptoportiques.
On parvient ainsi au texte suivant :
P»PROPER[TK> + 1 à 3 l.-F] TER»PATER[CVLO·— ] II«VIR'PR[AEFECTO] FABR-[TRIB»MILITVM]
Soit : P(ublio) Properftio — f(Mo) / Ter(etina) Pater [culo— ] / (duo)vir(o), prfaefecto] /fabr(um), [trib(uno) militum] /[—].
Cette carrière d'un notable arlésien, membre de la partie la plus élevée de l'élite municipale, a peut-être été interrompue par la mort et n'a donc pu s'épanouir totalement. Car nous manque le flaminat impérial qui, en règle générale, revenait à ces dignitaires pour couronner la carrière municipale. Mais on peut envisager aussi que l'hommage n'ait pas été nécessairement rendu à ce Properce arlésien lors de sa disparition. Membre de l'ordre équestre, il devait jouir dans sa cité d'une position eminente, ce qui faisait entrer dans le domaine du possible qu'un hommage lui ait été rendu de son vivant. Malheureusement aucun autre témoignage ne vient pour l'instant éclairer le rôle ou la place de sa famille dans la cité.
Selon une forte vraisemblance c'est de Rome que pourrait provenir le meilleur éclairage du document arlésien que nous venons de mettre en évidence, en élargissant la perspective d'interprétation. En effet, y a été découverte l'inscription suivante, dont la publication est demeurée plutôt confidentielle jusqu'à ce que G. Forai la remette en honneur38 : Ingenuus / P(ubli) Properti Paterculi / dispensator / vix(it) afnnis — ] / Lyris cofntubernali] / merenftissimo ffecit)] . On est frappé par un grand
37 Pour tous ces cas, voir Sablayrolles, "Les praefecti fabrum de Narbonnaise", p. 239- 247.
38 Voir ci-dessus n. 29. Pas de mention dans VAE 1924, dans laquelle les Notizie degli Scavi ont pourtant fait l'objet d'un dépouillement, p. 29 et suiv. (partie, p. 30-31 pour la nécropole de la via Salaria). L'inscription peut appartenir au Ier s. ap. J.-C. d'une façon large.
UN CHEVALIER ARLÉSIEN ET SA FAMILLE 101
nombre de rencontres entre les deux dénominations : d'abord et surtout par le recours au prénom P(ublius) qui n'apparaît nullement chez les Properce d'Italie39 ; mais aussi par la possibilité de retrouver le surnom Paterculus dans l'une comme dans l'autre.
Il faut peut-être se rendre à l'évidence et admettre l'existence d'un lien la seule rencontre onomastique entre l'inscription d'Arles et l'inscription de
Rome, ville dans laquelle se trouve l'esentiel de la documentation relative aux tores40. Il convient en effet de tenir compte que le contenu même de l'inscription de
Rome, par tous les rapprochements qui sont possibles, est riche d'enseignements sur le statut socio-politique de P(ublius) Propertius Paterculus, le maître du dispensator. Ils sont compatibles avec les données de l'inscription d'Arles, même si l'homonymie n'impose pas nécessairement une identification. Elle peut tout aussi bien signifier qu'il s'agit du père (en Arles) et d'un descendant, peut-être un enfant (à Rome).
Sans aucun doute, Ingenuus, esclave dispensator dans une maison romaine, est attaché à une famille de très bon niveau41. Son maître, établi à Rome, devait disposer d'une belle fortune, car ce type de gestion des biens est caractéristique des strates élevées des classes possédantes42. Nous ne nous avancerons guère en
que P(ublius) Propertius Paterculus est à Rome un homme d'importance. Quand on dénombre les personnages révélés par les inscriptions des dispensator es, si l'on
Listes compilées par Forni, "I Properzi...", p. 2 1 8-22 1 . En Gaule Narbonnaise la documentation est très réduite. On signalera, provenant
d'Arles, l'inscription de Peregrinus, Antistiae Piae dispensator (CIL XII, 856), à rapprocher de l'inscription de St-Paul-Trois-Châteaux qui mentionnait Antistia Pia Quintilla, flaminica colonia Flavia Tricas tinorum (AE 1962, 143) : L. WlERCHOWSKI, Die Regionale Mobilität in Gallien nach den Inschriften des 1. bis 3. Jahrhunderts n. Chr., Stuttgart, 1995, p. 86, n. 41, p. 264.
Sur le rôle des dispensator es, personnages importants pour la gestion des affaires et hommes de confiance au sein de la familia urbana, voir G. Bloch, s.u. dispensator, in Diet, des Antiquités, II, Paris, 1892, p. 280-286. On tiendra compte de J. Muniz Coello, "Officium dispensatoris", Gerion 7 (1989), p. 108-119, avec un rapide examen de l'épigraphie p. 110, n. 6 ; J.J. Aubert, Business Managers in Ancient Rome. A Social and Economie Study of Institores, 200 BC-AD 250, Leiden/New York/Köln, 1996, p. 196-198.
42 CIL IX, 3375 (ILS, 3530) : dispensator qui accomplit une dédicace en compagnie de l'affranchi procurateur de son maître ; CIL IX, 4644 (ILS, 3857) ; CIL VI, 2187 (ILS, 4973) : dispensator d'un lunius Silanus ; CIL X, 7893 (ILS, 5409); CIL XI, 5418 (ILS, 5459): dispensator de Poppaea Sabina; CIL VI, 9341 (ILS, 7379); CIL, 9357 (ILS, 7380): dispensator de Caepio Hispo; CIL VI, 33472 (ILS, 7381) et CIL VI, 33849 (ILS, 7381a) : dispensatores de la grande famille des Norbani ; CIL VI, 9327 (ILS, 7382) : qui dispensavit Volusio Torquato Luci filio ; CIL VI, 9325 (M. Buonocore, Schiavi e liberti dei Volusi Saturnini. Le iscrizioni del colombario sulla via Appia antica, Rome, 1984, p. 68, n° 10) : dispensator de L. Volusius Saturninus ; CIL VI, 9355 (ILS, 7382; Buonocore, Schiavi..., p. 140-141, n° 1 11) : moratus in dispensatione Boioniae Procillae et Aureli Fulvi; CIL VI, 9343 (Buonocore, Schiavi ..., p. 13, n° 109) : dispensator de Q. Volusius Saturninus et de Cornelia ; CIL VI, 9349 (ILS, 7383) : dispensator de Valeria Polla ; CIL VI, 9321 (ILS, 7853) :
dispensator des Vitellii ; CIL VI, 9326 (ILS, 7864; Buonocore, Schiavi..., p. 135-137, n° 106) : dispensator de Q. Volusius Saturninus ; CIL VI, 6275 (ILS, 8418) : dispensator des Statilii; CIL VI, 9331 AE 1992, 98; AE 1992, 196; AE 1984, 291 ; AE 1945, 107: dispensator de L. Aelius Lamia.
102 M. CHRISTOL M. HEIJMANS
trouve P(ublius) Propertius Paterculus en compagnie des gens de la plus haute aristocratie, ces derniers ne constituent pas toutefois son milieu d'appartenance. En effet il y avait aussi dans le groupe mis en évidence des sénateurs d'une réputation moins illustre, à qui leur statut imposait le domicile romain43, ainsi que des chevaliers de bon niveau, qui suivaient en particulier la carrière procuratorienne44. C'est dans l'un ou l'autre de ces sous-ensembles qu'il convient certainement de placer P(ublius) Propertius Paterculus, connu à Rome par l'épitaphe de son dispensator Ingenuus45.,
Il conviendrait donc d'envisager que la famille du chevalier arlésien s'est engagée dans la voie du service impérial, qui offrait de belles perspectives
sociale et de promotion dans l'élite politique romaine, à l'image du destin qui échut aux ancêtres d'Agricola, procurateurs impériaux, puis membres de l'ordre sénatorial46. Il semble donc, sans même attendre l'apparition d'une documentation plus explicite, que l'inscription d'Arles relative à ce nouveau chevalier romain, permet aussi d'éclairer l'ascension des notables des cités de Narbonnaise durant le Ier siècle ap. J.-C.47
Michel CHRISTOL et Marc HEIJMANS
43 C'est pour cette raison que d'une façon assez régulière on a rapproché les maîtres de ces dispensatores de membres de l'ordre sénatorial : par exemple dans l'inscription CIL VI, 9351, à propos de laquelle Servaeus Innocens est rapproché d'un consul de 101 ap.J.-C. (Q. Servaeus Innocens). Régulièrement, l'information sur ces dispensatores a été intégrée aux notices de la Prosopographia impertí Romani par Groag et Stein.
44 On citera CIL VI, 9363, inscription de Quietus, dispensator, qui fait composer l'épitaphe de Diocharis, Iuli Classiciani ser(vi) : ils appartiennent tous deux à la même familia servile urbaine : PIR2 I 145.
45 On s'appuiera sur les dénombrements de I. Kajanto, The latin cognomina, Helsinki, 1985, p. 314, qui naturellement rapproche l'usage de ce surnom de l'anthroponymie des citoyens. Cet auteur relève toutefois qu'en face de 559 hommes libres apparaissent 36
relatives à des esclaves ou affranchis : 4 proviennent de Narbonnaise, où l'on trouve par ailleurs l'usage de ce surnom comme nom individuel (CIL XII, 1310). Le dispensator de Rome ne serait-il pas un esclave d'origine provinciale, ayant suivi la famille de son maître au cours de son ascension politique et sociale ?
46 M.-Th. Raepsaet-Charlier, "Cn. Iulius Agrícola : mise au point prosopographique", ANRW II, 33.3 (1991), p. 1820. Voir aussi Demougin, Prosopographie, p. 105, n° 103. Rappelons aussi que c'est de Rome que provient l'inscription faisant connaître le père et l'oncle d'Agricola : AE 1946, 94. Dans le même contexte de l'ascension sociale des notables des cités de Narbonnaise au sein de l'aristocratie impériale, on mentionnera l'exemple des Iulii de Nîmes : M. Christol, "De la notabilité locale à l'ordre sénatorial : les Iulii de Nîmes", Latomus 60 (2001), p. 613-630.
47 M. Christol, "Les colonies de Narbonnaise et l'histoire sociale de la province", in Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der kaiserzeitlichen Prosopographie (Köln, 24.-26. nov. 1991), Köln/Wien/Graz, 1993, p. 277-291.












![Đi u 1 [Thành l p m t Liên hi p] Đi u 2](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631aa776bb40f9952b021ace/di-u-1-thanh-l-p-m-t-lien-hi-p-di-u-2.jpg)