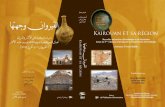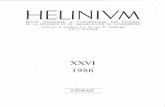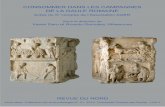L’industrie lithique de deux Rammadiya d’Aïn Afia (Jebel Hamzet-Kairouan ; Tunisie Centrale)
CATTELAIN P., BELLIER C. - 2014. Objets décorés pris sur stylohyoïde. In Fiches typologiques de...
Transcript of CATTELAIN P., BELLIER C. - 2014. Objets décorés pris sur stylohyoïde. In Fiches typologiques de...
1. TYPE DE SUPPORT
Cette �che envisage les objets décorés pris sur une partie précise de l’appareil hyoïdien des chevaux, bovidés et cervidés : le stylohyoideum (�g. 1), auquel nous donnerons dans la suite de cette �che son nom français de stylohyoïde.
L’appareil hyoïdien, communément appelé « os hyoïde » (Os hyoideum), est situé dans la partie supérieure du cou, juste sous le crâne. Il « est formé d’un ensemble de pièces osseuses ou
�bro-cartilagineuses attaché aux os temporaux et appendu à la base du crâne entre les branches des deux mandibules… Cet ensemble soutient de façon souple et mobile la langue, le pharynx et le larynx » (Barone, 1999, p. 189). L’os hyoïde est considéré comme un os crânien, puisque ses tympanohyoideum s’unissent aux processus hyoïdes de l’os temporal (Cattelain, 2007a, p. 21).
FICHE 4. STYLOHYOIDEUMPierre CATTELAIN* - Claire BELLIER**
Figure 1. Appareil hyoïdien de cheval. D’après Barone, 1999, pl. 69.
fiche4-stylohyoideum.indd 1 12/11/12 17:02
2 Fiche 4. Stylohyoideum
1.1. Description anatomique
En réalité, ce sont seulement deux des neuf os de l’appareil hyoïdien, les stylohyoïdes gauche et droit (autrefois appelés stylohyals, – Barone, 1976, pl. 55 –, et non pas grandes cornes, comme l’écrivaient certains auteurs… – Saint-Périer, 1930, p. 93 ; Péré, 1988, p. 169), qui ont servi de support aux artistes magdaléniens (Bellier, 1982a, 1982b, 1984 et 1991b). Le stylohyoïde, entièrement constitué de tissu compact (Barone, 1999), se présente sous la forme d’une lame osseuse plate et allongée, relativement fragile, qui s’évase du côté du proximum, pour former, vers le bas, une expansion caractéristique appelée angle styloïdien ou talon de l’os hyoïde (�g. 2). A�n d’éviter tout amalgame et dans un esprit de nomenclature systématique, à l’inverse de certains de nos collègues qui préfèrent la synecdoque (Buisson et al., 1996a, b et c), nous utiliserons donc le terme stylohyoïde, même s’il est quelque peu ingrat, en lieu et place d’os hyoïde, que nous considérons comme impropre, voire abusif.
1.2. Taxons identi�és
L’échantillon étudié comporte 145 objets (voir infra 2.1.) parmi lesquels, provenant d’Isturitz et conservés au MAN, 5 fragments de supports plus ou moins bruts présentant quelques aménagements (DVD : �g. 3 à 7) et 4 fragments mésiaux de stylohyoïde (DVD : �g. 8 à 11) présentant des traces de découpe et donc probablement des déchets de façonnage. L’échantillon comporte également 5 stylohyoïdes simplement perforés
(voir infra 1.4.). Cet échantillon nous permet de con�rmer que plus de 80 % des stylohyoïdes utilisés comme supports de témoins esthétiques paléolithiques proviennent du cheval, ce qui avait déjà été constaté (Delporte, 1990, p. 114). Dans deux cas au moins, une pièce a été façonnée sur os de boviné (Bellier, 1991b, p. 11 ; Buisson et al., 1996a ; communication personnelle d’Ingmar M. Braun). De plus, il semblerait, en raison de leur épaisseur relativement importante, qu’une partie au moins des têtes d’isards de Labastide ait été prise sur stylohyoïde de boviné (Fritz et Simonnet, 1996, p. 64-65). Par ailleurs, deux pendeloques provenant du Magdalénien des Asturies ont été prises sur os de cerf (Menéndez, 2004, p. 147 et �g. 9) ; trois autres provenant de la grotte de La Marche, ont été prises sur os de renne (Lwo�, 1943, p. 175 et pl. III, G-H-I). Nous devons cependant rappeler que plusieurs fragments, non vus et non retenus dans l’échantillon de référence, n’ont pas été déterminés avec précision (Bellier, 1982a, 1991b1 ; Buisson et al., 1996a).
1.3. Surfaces disponibles du support
La totalité des objets retenus dans cette �che a été façonnée sur le proximum du stylohyoïde, que ce dernier soit gauche ou droit. Cette partie de l’os montre, chez le cheval, une section très mince, partiellement concave-convexe et un angle styloïdien large et arrondi. Chez les bovinés, le stylohyoïde est plus court, plus étroit en son milieu et sa section est un peu plus épaisse. L’angle styloïdien est long, plus étranglé et s’élargit à l’extrémité, quasiment rectiligne. Chez les cervidés, qu’il s’agisse du cerf ou du renne, il se développe en une véritable branche, longue et étroite. Il en va de même pour les capridés.
1.4. Degré de transformation du support
Dans plus de 80 % des cas, le support a pu être déterminé au niveau anatomique (stylohyoïde) et générique (Equus, Bos, Cervus, Rangifer). Son degré de transformation ne l’a donc pas trop modi�é. L’angle styloïdien, relativement discriminant, a été souvent non ou à peine régularisé sur les os de cheval, de même que, dans une nettement moindre mesure, sur la branche opposée montant vers le tympanohyoïde. De manière générale,
1 Dans la �che typologique de 1991, une partie de la détermination des supports était issue de la bibliographie, sans véri�cation. Depuis, un nombre important de pièces a été revu par divers spécialistes. De plus, de nouveaux objets ont été découverts, que ce soit dans les anciennes collections ou dans de nouvelles fouilles. Les chi�res relatifs présentés dans les tableaux ont donc évolué en fonction.
Figure 2. Comparaison des stylohyoïdes de cheval (1), boviné (2) et de renne (3). D’après Buisson et al., 1996a, �g. 3.
fiche4-stylohyoideum.indd 2 12/11/12 17:02
Fiche 4. Stylohyoideum 3
l’intervention de l’artiste a consisté, dans un premier temps, à formater le support, comme en témoigne toute une série d’ébauches (DVD : �g. 12 à 17), c’est-à-dire à le sectionner transversalement du côté du distum de l’os, de manière à lui donner la longueur souhaitée, assez variable, puis à mettre en forme le segment restant, par rainurage et raclage, s’il trouvait nécessaire de modi�er la silhouette de l’os. Les bords sont ensuite le plus souvent parfaitement régularisés. Cette opération n’est pas obligatoirement envahissante : dans plusieurs cas, nous pouvons encore observer certaines portions du contour de l’os peu ou pas modi�ées. Encore faudrait-il savoir si toutes les traces observées sont le résultat d’une action anthropique ou, parfois, d’autres phénomènes taphonomiques… Dans de nombreux cas, avant la mise en place des détails gravés, les surfaces sont soigneusement préparées par une �ne abrasion.
L’esquisse de quelques détails, indiquant la position de la bouche, de l’œil, de l’oreille, de même qu’une perforation, sont parfois présents sur des ébauches, avant même leur découpage dé�nitif (�g. 18). La perforation peut aussi intervenir après la réalisation du décor, en toute dernière étape de la chaîne opératoire : c’est notamment le cas pour les contours découpés en forme de tête d’isard de Labastide (Fritz et Simonnet, 1996, p. 72).
Les perforations, �guratives ou non, ont été le plus souvent obtenues par rotation circulaire à partir des deux faces (« percussion circulaire », Leroi-Gourhan, 1971a, p. 55). Dans quelques cas, une rotation semi-circulaire a été associée à l’approfondissement d’une rainure d’attaque (Buisson et al., 1996a, p. 101).
1.5. Types de cadrages
Le choix du cadrage en fonction de la morphologie du support osseux est ici presque évident. L’artiste, ou l’artisan magdalénien, a probablement été in�uencé par la forme naturelle du support pour façonner son œuvre, notamment par la silhouette de l’angle styloïdien du cheval, qui évoque naturellement celle d’une mandibule (�g. 19).
Les stylohyoïdes de cheval et, dans une moindre mesure, de boviné, ont été essentiellement utilisés comme support pour la confection des contours découpés en forme de tête d’herbivore provenant des niveaux du Magdalénien moyen des Pyrénées, des Cantabres et du Jura suisse (bien que, pour cette dernière région, nous ne disposions que de supports perforés). Dans ce cas, le cadrage est concordant, « rimant » et « intégrant » selon les dé�nitions proposées par les maîtres d’œuvre de ce cahier. Notons que trois contours découpés au moins en forme de tête de cheval n’ont pas été pris sur os hyoïde. il s’agit d’un exemplaire d’Arudy « Saint-Michel », pris sur omoplate (Bellier, 1991b, p. 11), d’un exemplaire de Bruniquel « Montastruc », pris sur « os » (Sieveking, 1987c, p. 76) et d’un exemplaire de Gazel, pris sur bois de renne (Sacchi, 1976, �g. 138).
2. ÉCHANTILLON DE RÉFÉRENCE
2.1. Répartition chrono-stratigraphique et géographique
Presque toutes les pièces envisagées ici appartiennent au Magdalénien moyen franco-cantabrique. 130 sur 145 proviennent plus précisément des Pyrénées françaises (�g. 20, tabl. 1, 2 et 3). Cependant, 4 stylohyoïdes perforés proviennent du Magdalénien moyen ou supérieur suisse (communication personnelle d’Ingmar Braun).
2.2. État de conservation et types d’objets
Le stylohyoïde est un os fragile, délicat à prélever sur les carcasses abattues, en raison de sa minceur. De �nes stries, longitudinales et subparallèles, attestent du travail de décharnement préalable à la mise en forme et au décor. Les objets façonnés sur ce support gardent bien entendu cette fragilité, parfois accentuée par la mise en place même du décor, qui peut parfois le perforer, intentionnellement ou non.
Sur les 145 objets retenus, il y a 123 contours découpés, dont au moins 13 à l’état d’ébauche. Au
Figure 18. Stylohyoïde de cheval perforé. Isturitz, couche FII. D’après Passemard, 1944, �g. 19.
Figure 19. Stylohyoïde de cheval avec emplacement d’un contour découpé. D’après Bellier, 1984, �g. 4.
fiche4-stylohyoideum.indd 3 12/11/12 17:02
4 Fiche 4. Stylohyoideum
Figure 20. Localisation des sites ayant livré des objets décorés pris sur stylohyoïde : 1. Las Caldas ; 2. La Cueva de la Güelga ; 3. La Viña ; 4. Tito Bustillo ; 5. La Garma ; 6. Abauntz ; 7. Bédeilhac ; 8. Le Mas d’Azil ; 9. Le Portel ; 10. Enlène ; 11. Le Tuc d’Audoubert ; 12. Canecaude I ; 13. Gazel ; 14. La Crouzade ; 15. Laugerie-Basse ; 16. Gourdan ; 17. Labastide ; 18. Lorthet ; 19. Lourdes « Espélugues » ; 20. Brassempouy ; 21. Arudy « Espalungue » ; 22. Arudy « Saint-Michel » ; 23. Isturitz ; 24. La Marche ; 25. Kohlerhöhle ; 26. Schweizersbild.
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
GISEMENT CD Cheval
CD Bouquetin
CD Isard
CD Biche
CD Bison
CD Indét.
CD ébauche
CD Déchets de fabrication
Pendeloques Os gravé Stylohyoïdes travaillés
Stylohyoïdes perforés
Total
ESPAGNEAsturies Las Caldas 2 1 3
La Cueva de la Güelga 1 1La Viña 3 3Tito Bustillo 1 1 2
Cantabrie La Garma, Galerie inférieure 1 1Navarre Abauntz 1 1FRANCEAriège Bédeilhac 3 3
Le Mas d'Azil 23 1 2 26Le Portel 1 1Enlène 10 1 11Tuc d'Audoubert 1 1
Aude Canecaude I 1 1La Crouzade 1 1Gazel 1 1
Dordogne Laugerie-Basse 5 1 6Haute-Garonne Gourdan 2 2Hautes-Pyrénées Labastide 1 18 1 20
Lorthet 1 1Lourdes "Espélugues” 3 1 4
Landes Brassempouy 1 1Pyrénées-Atl. Arudy “Espalungue” 7 4 11
Arudy "Saint-Michel" 1 1Isturitz 19 1 6 4 5 1 36La Marche 3 3
SUISSEBâle-Campagne Kohlerhöhle 2 2Schaffhouse Schweizersbild 2 2TOTAL 83 4 18 1 2 2 13 4 7 1 145
Tableau 1. Nombre et types d’objets fabriqués sur stylohyoïde. CD = contour découpé (Álvarez Fernández, 2004a et b ; Balbin Behrmann, 2004, p. 33-34 ; Bellier, 1982a et 1991b ; Buisson et al., 1996a, b et c ; Corchón Rodríguez, 2004, p. 113-119 ; Fortea et al., 1990 ; Fritz, 2004 ; Lwo�, 1943 ; Menéndez, 2004, p. 145-146 ; I. M. Braun, communication personnelle).
fiche4-stylohyoideum.indd 4 12/11/12 17:02
Fiche 4. Stylohyoideum 5
ORIGINE GÉO. GISEMENT N Lieu de conservationESPAGNEAsturies Las Caldas 3 Museo arqueológico de Asturias, Oviedo
La Cueva de la Güelga 1 Museo arqueológico de Asturias, OviedoLa Viña 3 Museo arqueológico de Asturias, OviedoTito Bustillo 2 Museo arqueológico de Asturias, Oviedo
Cantabrie La Garma, Galerie inférieure 1 Museo de preistoria y arqueologia de Cantabria, SantanderNavarre Abauntz 1 Museo de Navarra, PamplonaFRANCEAriège Bédeilhac 3 Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en Laye
Le Mas d'Azil 26 Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en Laye Musée du Mas d'Azil, Le Mas d'Azil
Le Portel 1 Collection Vézian, ToulouseEnlène 11 Musée de l'Homme, Paris Musée
départemental de l'Ariège, Foix Collection Begouen, Musée de Pujol
Tuc d'Audoubert 1 Musée de l'Homme, ParisAude Canecaude I 1 Dépôt de fouilles de Carcassonne
La Crouzade 1 Musée archéologique, Palais des Archevèques, NarbonneGazel 1 Collection Durand
Dordogne Laugerie-Basse 6 Musée de l'Homme, Paris Musée national de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac
Haute-Garonne Gourdan 2 Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en LayeHautes-Pyrénées Labastide 20 Musée de l'Homme, Paris Collection
Simonnet, ToulouseLorthet 1 Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en LayeLourdes “Espélugues” 4 Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en Laye
Landes Brassempouy 1 Musée archéologique Dubalen, Mont-de-MarsanPyrénées-Atl. Arudy “Espalungue” 11 Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en Laye
Arudy "Saint-Michel" 1 Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en LayeIsturitz 36 Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en Laye
Vienne La Marche 3 ?SUISSEBâle-Campagne Kohlerhöhle 2 Réserves du Service Cantonal d'Archéologie de Bâle-Campagne Schaffhouse Schweizersbild 2 Collection Nüesch, Musée National Suisse, ZurichTOTAL 145
Tableau 2. Localisation muséologique des objets fabriqués sur stylohyoïde (Álvarez Fernández, 2004a et b ; Balbin Behrmann, 2004, p. 33-34 ; Bellier, 1982a et 1991b ; Buisson et al., 1996a, b et c ; Corchón Rodríguez, 2004, p. 113-119 ; Fortea et al., 1990 ; Menéndez, 2004, p. 145-146 ; I. M. Braun, communication personnelle).
fiche4-stylohyoideum.indd 5 12/11/12 17:02
6 Fiche 4. Stylohyoideum
No Inventaire Site Attribution Princeps Dimensions Description supplémentaire Figure
MAN Ist.II-1930-1 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer en 1930 dans la couche II de la Grande Salle
Lc : 66 mm ; l : 17 mm fig. 3
MAN Ist.II-1935-1 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer en 1935 dans la couche II de la Grande Salle
Lc : 87 mm ; l : 29 mm fig. 4
MAN Ist.II-sd-2 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer dans la couche II de la Grande Salle
Lc : 57 mm ; lc : 42 mm fig. 5
MAN 84783 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer entre 1930 et 1935 dans la couche II de la Grande Salle
Lc : 79,3 mm ; l : 20,5 mm
Tête de cheval fragmentaire : l’oreille, le bout du chanfrein, les naseaux et le plat de la joue sont perdus. Elle présente une trace de perforation à l’arrière de la joue. La bouche et l’œil sont à peine marqués. Une série de hachures et de stries suggèrent la robe et la limite du nez. La barbe est indiquée par une bande de courtes incisions parallèles. Le nez est prolongé par un appendice aux bords arrondis et polis : selon Saint-Périer (1937, p. 118-119), il pourrait représenter le souffle de l’animal, ou un objet saisi dans la bouche
fig. 6
MAN Ist S.I-1929-1 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer en 1929 dans la couche S.I. de la salle de Saint-Martin
Lc : 58 mm ; lc : 25 mm fig. 7
MAN Ist S.I-1929-3 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer en 1929, dans la couche S.I. de la salle de Saint-Martin
Lc : 40 mm ; lc : 12 mm fig. 8
MAN Ist S.I-29 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer en 1929 dans la couche S.I. de la salle de Saint-Martin
Lc : 47 mm ; lc : 15 mm fig. 9
MAN Ist S.I-1929-4 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer en 1929, dans la couche S.I. de la salle de Saint-Martin
Lc : 29 mm ; lc : 14 mm fig. 10
MAN 84775 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer entre 1930 et 1935 dans la couche II de la Grande Salle
L : 67,5 mm ; l : 22 mm
Ébauche ? Tête de cheval fine et allongée presque complète : l’arrière de la joue est perdu. La forme générale a été obtenue par découpage partiel du support. La pièce semble inachevée : sur la face gauche, seuls l’œil, l’oreille et la bouche sont indiqués par quelques traits gravés, sur la face droite, seuls l’œil et la limite du nez sont légèrement marqués
fig. 11
MAN 84807 Ist II Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer en 1935 dans la couche II de la Grande Salle
Lc : 80 mm ; lc : 38 mm fig. 12
MAN 84808 Isturitz R. et S. de Saint-Périer Lc : 49 mm ; lc : 28 mm fig. 13
MAN 83886y Ist.II 1930 Isturitz Magdalénien
moyenR. et S. de Saint-Périer en 1930 dans la couche II de la Grande Salle
Lc : 73 mm ; lc : 30 mm fig. 14
MAN Ist S.I-1929-2 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer en 1929 dans la couche S.I. de la salle de Saint-Martin
Lc : 38 mm ; lc : 14 mm fig. 15
MAN Ist.II-sd-1 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer dans la couche II de la Grande Salle
Lc : 57 mm ; lc : 25 mm fig. 16
MAN Ist.II-sd-3 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer dans la couche II de la Grande Salle
Lc : 53,1 mm ; lc : 35 mm fig. 17
MAN couche FII Isturitz Stylohyoïde de cheval perforé fig. 18n°? La Marche Pendeloques à bords encochés prises sur stylohyoïde de renne fig. 21MAN 84775 Isturitz Ebauche au contour peu découpé : seul le menton et le relief du toupet ont été dégagés fig. 22-01
MAN 84774 Isturitz Ebauche ou pièce terminée ? Assez semblable à la précédente, avec deux perforations : seuls la bouche et les naseaux sont gravés fig. 22-02
MAN 84670 IsturitzDécoupe limitée, une perforation, œil linéaire, appendice naturel en guise d'oreille, contour du naseau indiqué par de courtes hachures, narine indiquée par un trait légèrement arqué, bouche fermée linéaire, bande hachurée allant de l'œil vers la bouche
fig. 22-03
MAN 84780 Isturitz Contour plus découpé, deux perforations, œil linéaire, bouche linéaire, narine incurvée, ganache légèrement hachurée fig. 22-04
MAN 74840 IsturitzContour relativement découpé, une perforation, œil avec caroncule et paupières, oreille et toupet découpés, délimitation des naseaux, bouche rectiligne et naseau incurvé, nombreux éléments de remplissage
fig. 22-05
MAN 84777 Isturitz Contour très découpé, une perforation, absence d'œil, oreille et narine très détaillées, toupet et ganache hachurés, délimitation de naseaux, bouche fermée linéaire fig. 22-06
MAN 84781 IsturitzContour très découpé, deux perforations, œil avec caroncule, commissures et paupière, oreille découpée, naseaux bien délimités par un trait courbe, narine détaillée, bouche en crochet, nombreux éléments de partition et zones hachurées
fig. 22-07
MAN 84773 Isturitz Contour très découpé, détails et éléments de remplissage très abondants fig. 22-08
MAN 84666 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer, entre 1928 et 1930 dans la couche S.I. de la salle de Saint-Martin
Lc : 43 mm ; lc : 16 mm
Fragment de tête de cheval. Le fragment présente une oreille gravée sur chaque face, avec l'indication du conduit auditif sous la forme de traits gravés linéaires. Des incisions parallèles ornent le bord supérieur, sur les deux faces, de part et d'autre de l'oreille. Il s'agit incontestablement d'une représentation de crinière de cheval, reconnaissable à son toupet, plus serré. Quoi qu'il en soit, la taille relativement importante de ce fragment et la présence de la crinière permettent de penser qu'il a dû appartenir à un contour découpé d'assez grandes dimensions. Il serait sans doute utile de revérifier la nature exacte du support
fig. 23
MAN 84667 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer, entre 1928 et 1930 dans la couche S.I. de la salle de Saint-Martin
L : 76 mm ; l : 27 mm
Tête de cheval presque complète : le front, l'œil et la nuque sont perdus. Elle présente deux perforations, l'une à hauteur de la tempe, l'autre au centre du plat de la joue. La forme a été obtenue par découpage partiel du support. La bouche, le naseau et la limite du nez sont indiqués sur les deux faces par des traits gravés. Le toupet est indiqué par un léger renflement, hachuré, situé en avant de l'oreille, bien détaillée. Des lignes de petites ponctuations suggèrent la robe. De courtes hachures, surlignées d'une ligne continue, le long de la ganache, figurent la barbe
fig. 24
MAN 84668 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer, entre 1928 et 1930 dans la couche S.I. de la salle de Saint-Martin
L : 70 mm ; l : 24,4 mm
Tête de cheval fine et allongée, presque complète : la lèvre inférieure et le menton sont perdus. Elle présente une perforation à la naissance de l'oreille. La forme générale a été obtenue par découpage partiel du support, donnant des contours modelés. La bouche, le naseau, la limite du nez, le contour de l'œil, la caroncule et la paupière sont indiqués, sur les deux faces, par des traits gravés. Un faible relief suggère l'oreille sur la face droite. La robe est figurée par diverses fines incisions sur le chanfrein, et la barbe par de courtes incisions parallèles, le long de la ganache
fig. 25
MAN 84669 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer, entre 1928 et 1930 dans la couche S.I. de la salle de Saint-Martin
L : 61,5 mm ; l : 27,5 mm
Tête de cheval complète. Elle présente une perforation en arrière de l'œil. La forme générale a été obtenue par découpage partiel du support. La bouche, le naseau et l'œil sont assez sommairement indiqués, sur les deux faces, par des traits gravés linéaires. Des lignes de petites hachures figurent la limite du nez et, sur la face gauche, les paupières. De nombreuses hachures, gravées sur le chanfrein, suggèrent la robe. Le rendu assez schématique des détails gravés contraste avec le découpage soigné des naseaux et du menton. En guise d'oreille, la représentation se limite à l'appendice naturel supportant le tympanohyoïde
fig. 26
MAN 84670 Isturitz Magdalénien moyen
R. et S. de Saint-Périer, entre 1928 et 1930 dans la couche S.I. de la salle de Saint-Martin
L : 67 mm ; l : 29,3 mm
Tête de cheval presque complète, abîmée sur la face gauche. Une partie du front et le bout du nez sont perdus. Elle présente une perforation en arrière de l'œil. La forme générale a été obtenue par découpage partiel du support. La bouche, le naseau et l'œil sont assez sommairement indiqués, sur les deux faces, par des traits gravés linéaires. Des lignes de petites hachures figurent la limite du nez et, sur la face gauche, les paupières. De nombreuses hachures, gravées sur le chanfrein, suggèrent la robe. Le rendu assez schématique des détails gravés contraste avec le découpage soigné des naseaux et du menton. En guise d'oreille, la représentation se limite à l'appendice naturel supportant le tympanohyoïde
fig. 27
MAN 84671 Isturitz R. et S. de Saint-Périer Lc : 29 mm ; lc : 12 mm
Fragment de tête de cheval limité au nez, à la bouche et au chanfrein sur la face gauche. La face droite est très abîmée. La forme générale a été obtenue par découpage partiel du support. La bouche, le naseau et la limite du nez sont assez sommairement indiqués, sur les deux faces, par des traits linéaires assez profondément gravés. Sur la face gauche, la barbe est suggérée par deux rangs très lâches de courtes incisions, le long de la ganache
fig. 28
Tableau 3. Récapitulatif du corpus illustré des stylohyoïdes gravés.
fiche4-stylohyoideum.indd 6 12/11/12 17:02
Fiche 4. Stylohyoideum 7
sein de cet ensemble, nous dénombrons 27 objets entiers (22 %), 26 presque entiers (21 %), et 70 fragmentaires ou très fragmentaires (57 %). Les six pendeloques sont entières, ou peut s’en faut, et l’os gravé d’une tête de bison sur chaque face de Las Caldas semble brisé vers le distum.
Étant donnée la fragilité du support, la proportion d’objets bien ou très bien conservés est étonnante : parmi ceux-ci, il faut toutefois signaler la présence des 19 contours découpés découverts « rangés en paquet » dans une cache à Labastide (Simonnet, 1952 ; Fritz et Simonnet, 1996, p. 64). Quoi qu’il en soit, le bon état de conservation général de ces objets, et leur présence, dans un cas au moins, dans une cache, suggère qu’ils étaient probablement chargés d’une haute valeur.
Les parties les plus souvent détériorées des contours découpés se situent à l’arrière de la tête et dans l’angle de la mandibule, qui correspond à l’angle styloïdien de l’os, et à sa partie la plus mince. On note également de nombreuses fractures au niveau de la branche montante de l’os, qui correspond à l’emplacement de la �guration de l’oreille, ainsi qu’au niveau des perforations et, beaucoup plus rarement, des naseaux.
2.3. Nature des décors
À l’exception des deux pendeloques prises sur stylohyoïde de cerf provenant de La Cueva de la Güelga et de Tito Bustillo, dont le décor consiste en petites encoches transversales parallèles sur les bords et en une ligne en zigzag sur une face (Menéndez, 2004, �g. 9), de celle sur stylohyoïde de cheval provenant d’Abauntz, considérée au même titre que les deux précédentes comme faisant référence à un éventuel calendrier lunaire (Mazo et al,. 2008) et des trois pendeloques prises sur stylohyoïde de renne provenant de La Marche, au décor d’encoches très semblable (Lwo�, 1943, pl. III ; ici : �g. 21), tous les autres objets montrent un décor exclusivement �guratif, correspondant aux détails anatomiques des têtes d’herbivores.
Certains contours découpés montrent des enlèvements de matière qui s’apparentent plus à la sculpture qu’à la gravure, comme cela a été montré par C. Fritz, notamment à Labastide et au Mas d’Azil, où une oreille a été traitée en bas-relief (1999, p. 150).
Figure 21. Pendeloques perforées à bords encochés prises sur stylohyoïdes de cerf (1-2), de cheval (3) et de renne (4-6). 1. Cueva de la Güelga ; 2. Tito Bustillo ; 3. Abauntz. D’après Sauvet et al., 2008, �g. 4 ; 4- 6. La Marche. D’après Lwo�, 1943, pl. III, G-H-I.
fiche4-stylohyoideum.indd 7 12/11/12 17:02
8 Fiche 4. Stylohyoideum
Bien qu’au premier coup d’œil, les contours découpés apparaissent comme un ensemble très homogène, il existe des di�érences sensibles d’une pièce à l’autre, comme l’a démontré l’analyse formelle réalisée par D. Buisson et al. en 1996. En revanche, les deux faces de chaque objet ont en général été traitées de manière similaire (Delporte, 1990, p. 114).
Ainsi, dans un même site, nous pouvons avoir des têtes de cheval plutôt allongées ou plutôt courtes et trapues, ainsi que les formes intermédiaires. Le contour peut suivre en grande partie celui, naturel, de l’os, avec peu de détails internes et notamment l’absence d’indication de l’œil et de l’oreille, ou bien être très découpé, avec une profusion de détails : bouche, nez, ganache, barbe, œil, paupières, oreille, toupet de la crinière, di�érences de pelage… Tous les stades intermédiaires entre ces deux extrêmes sont bien représentés (�g. 22 et DVD : �g. 23 à 41). Certaines di�érences morphométriques, assez marquées, sont visiblement dues à la taille du support choisi, liée à l’âge et éventuellement au sexe de l’animal d’origine.
D’autre part, certains contours découpés mis au jour dans des gisements parfois relativement éloignés témoignent d’une grande parenté, qu’il s’agisse de leur silhouette ou de leurs proportions générales, de la répartition et des détails de l’ornementation gravée, ainsi que des techniques mises en œuvre (�g. 42).
Pour l’obtention des détails internes, mise à part la technique du bas-relief déjà évoquée, c’est quasi exclusivement la gravure, plus ou moins profonde, qui a été utilisée. La profondeur de chaque trait gravé a été néanmoins limitée par la spéci�cité de l’os, dont l’épaisseur peut varier de 1 à 9 mm : il s’agissait de ne pas transpercer l’os de part en part (Fritz et Simonnet, 1996, p. 69).
Sur les 110 contours découpés « achevés », 84 (76 %) représentent des têtes de chevaux, 18 (16 %) des isards provenant tous de Labastide, le reste �gurant 4 bouquetins (dont un protomé, DVD : �g. 43), 2 bisons, 1 biche (�g. 44, n° 1 à 4) et un renne (DVD : �g. 45). Les 18 isards ont été découverts groupés, et montrent entre eux de fortes ressemblances. Ils ont été pris, selon les exemplaires, sur stylohyoïde de cheval ou de boviné : ceux pris sur os de cheval ont nécessité une découpe plus importante sous la ganache, ceux prix sur os de boviné une découpe plus importante de l’angle styloïdien, pour dessiner le contour de la mandibule. Dans les deux cas, la branche montante a dû être découpée pour suivre la courbure antérieure de la corne (�g. 46).
Un objet se singularise, véritablement unique en son genre : il s’agit d’un stylohyoïde de cheval directement identi�able, mais non découpé. Provenant de Las Caldas, gisement dans lequel deux contours découpés « classiques », �gurant des têtes de cheval ont été découverts, il présente, sur chaque face, une très belle tête de bison (�g. 44, n° 5). La ganache et l’angle arrière de la mandibule suivent �dèlement le contour naturel de l’os, mais le reste, très soigneusement gravé, rimant partiellement avec la forme générale du support, ne la suit pour autant pas sur tout le contour. Si certains choix de représentations de détails sont communs avec les �gurations sur contour découpé, tels les yeux en accolade, la délimitation des naseaux, les plages hachurées…, l’orientation de la tête sur le support est inversée par rapport à la totalité des contours découpés : le museau se trouve du côté de la branche montante, et l’oreille et la corne du côté de la lame principale.
PAGE DE DROITEFigure 22. Contours découpés en forme de tête de cheval d’Isturitz. 1. MAN 84775. Ébauche au contour peu découpé : seul le menton et le relief du toupet ont été dégagés ; 2. MAN 84774. Ebauche ou pièce terminée ? Assez semblable à la précédente, avec deux perforations : seuls la bouche et les naseaux sont gravés ; 3. MAN 84670. Découpe limitée, une perforation, œil linéaire, appendice naturel en guise d’oreille, contour du naseau indiqué par de courtes hachures, narine indiquée par un trait légèrement arqué, bouche fermée linéaire, bande hachurée allant de l’œil vers la bouche ; 4. MAN 84780. Contour plus découpé, deux perforations, œil linéaire, bouche linéaire, narine incurvée, ganache légèrement hachurée ; 5. MAN 74840. Contour relativement découpé, une perforation, œil avec caroncule et paupières, oreille et toupet découpés, délimitation des naseaux, bouche rectiligne et naseau incurvé, nombreux éléments de remplissage ; 6. MAN 84777. Contour très découpé, une perforation, absence d’œil, oreille et narine très détaillées, toupet et ganache hachurés, délimitation de naseaux, bouche fermée linéaire ; 7. MAN 84781. Contour très découpé, deux perforations, œil avec caroncule, commissures et paupière, oreille découpée, naseaux bien délimités par un trait courbe, narine détaillée, bouche en crochet, nombreux éléments de partition et zones hachurées ; 8. MAN 84673. Contour très découpé, détails et éléments de remplissage très abondants. D’après Buisson et al., 1996a, �g. 26, 9, 10, 14, 22, 23 et 25, sauf 5, d’après Bellier, 1982a, �g. 51.
fiche4-stylohyoideum.indd 8 12/11/12 17:02
10 Fiche 4. Stylohyoideum
Figure 42. Contours découpés en forme de tête de cheval. 1. MAN 84669 Isturitz et 2. MAN 47192 Mas d’Azil : contours courts et trapus, à découpe limitée, une perforation, œil linéaire, appendice naturel en guise d’oreille, contour du naseau indiqué par de courtes hachures, narine indiquée par un trait rectiligne ou arqué, bouche fermée linéaire avec lèvre inférieure marquée, bande hachurée oblique allant de l’œil vers la bouche ; 3. Mas 709 Mas d’Azil et 4. MH 38.189.1364 Laugerie-Basse : contours allongés très découpés, une perforation, œil avec caroncule et paupières, oreille découpée, naseaux bien délimités par une ligne hachurée, narine détaillée, bouche en crochet, ganache hachurée. D’après Buisson et al., 1996a, �g. 10, 23 et 22.
fiche4-stylohyoideum.indd 10 12/11/12 17:02
Fiche 4. Stylohyoideum 11
Figure 44. Contours découpés en forme de tête d’herbivore et gravure de tête de bison sur stylohyoïde. 1. Tête de bison, Labastide, collection Simonnet, Foix : contour totalement découpé (l’angle styloïdien n’est même plus identi�able), narine perforée et soulignée, perforation non �gurative à l’arrière de la mandibule, corne très découpée, surtout sur le bord inférieur, œil rond précédé d’un trait suggérant la caroncule, ganache et crinière hachurées. 2. Tête de biche, Enlène, MH 55.33.6. : contour allongé, à découpe presque totale, absence d’œil, oreille spéci�que totalement découpée, contour du naseau indiqué par une ligne partielle, narine perforée, bouche fermée arquée très étirée, ligne parallèle à la mandibule soulignant soit une nuance de pelage, soit une saillie musculaire ; 3. Tête d’isard, Labastide, collection Simonnet, Foix : contour très découpé, narine marquée d’un U ouvert souligné, bouche marquée par un trait sinueux, deux perforations, dont une sépare la corne de l’oreille, corne très découpée, surtout sur le bord supérieur (le bord inférieur est en champlevé par rapport au pavillon de l’oreille), œil rond avec amorce de caroncule, lignes jugales caractéristiques de l’espèce, pas de zones hachurées. 4. Tête de bouquetin, Gourdan, MAN 47052 : contour fortement découpé, notamment pour la partie basse de la mandibule et le dégagement de la corne, bouche ouverte, narine incurvée, marque multi incisée de la limite des naseaux, œil rond avec caroncule et commissure, lignes jugales bien indiquées, pas de zones hachurées. 5. Stylohyoïde de cheval gravé, sur les deux faces, d’une tête de bison, Las Caldas, Museo Arqueológico de Asturias, Oviedo : dans ce cas-ci, pour l’instant unique, la découpe ne suit le sujet que sur le tracé de l’angle arrière bas de la mandibule, très bien cadré dans une orientation opposée à tous les contours découpés connus : dans ce cas exceptionnel, le museau, non découpé, est dessiné sur la branche montante, et le sommet de la tête se développe sur la lame allongée, non sectionnée mais brisée, du stylohyoïde : la corne est joliment sinueuse, libre de toute contrainte, l’œil, linéaire, se trouve « entre parenthèses », la pilosité est marquée par un hachurage quelque peu « craché », que ce soit sur la ganache, le chanfrein ou le toupet. D’après Bellier, 1984, �g. 3c, 3b, 2c et 2e, sauf 5, d’après Fortea et al., 1990, p. 230, �g. 11, 3.
fiche4-stylohyoideum.indd 11 12/11/12 17:02
12 Fiche 4. Stylohyoideum
2.4. Hypothèses d’utilisation
L’examen, à la loupe binoculaire, de quelques perforations de type �guratif et non �guratif montre des bords bruts de façonnage sur les premières, contrastant avec les bords émoussés, voire polis, des secondes. Les perforations �guratives sembleraient donc ne pas avoir servi de trous de suspension ou de �xation, à la di�érence des perforations non �guratives. Ces dernières, présentes sur la quasi totalité des objets, permettent de les classer sans trop de risque parmi les objets de parures, qu’ils soient suspendus ou cousus (Bellier, 1982, p. 42 et 1991b, p. 11 ; Buisson et al., 1996a, p. 102 ; Delporte, 1990, p. 114 ; ici : �g. 47). L’ensemble de Labastide a même été considéré, non sans raison, comme la composante d’un véritable collier (Fritz et Simonnet, 1996, p. 64). Pour mémoire, certains exemplaires ont visiblement été ocrés.
3. SYNTHÈSE
L’utilisation du stylohyoïde de grand herbivore au Paléolithique apparaît singulièrement réduite dans le temps et dans l’espace. Encore faut-il préciser qu’il s’agit majoritairement d’os prélevés sur des chevaux, minoritairement sur des bovinés, et, exceptionnellement, dans les Asturies et dans la Vienne, sur des cervidés.
À notre connaissance, et pour autant que notre interprétation soit exacte, ce type d’os a été exclusivement utilisé pour la confection de parures suspendues ou cousues au Magdalénien moyen et supérieur (Schweizersbild), dans les zones montagneuses et sub-montagneuses contiguës de la Montagne Noire, des Pyrénées, Cantabres et Asturies, avec les notables exceptions des cinq exemplaires provenant de Laugerie-Basse, en Dordogne, et des possibles ébauches découvertes en Suisse.
Pendant une période limitée, les chasseurs-cueilleurs magdaléniens d’une zone géographique bien délimitée semblent donc avoir cherché à récupérer un os bien particulier d’une (ou deux) espèce(s) bien dé�nie(s), pas toujours dominante(s) dans leur tableau de chasse. Toutes enquêtes (bouchers, chevilleurs, chasseurs, zoologistes…) confondues, cet os n’est pas le plus évident à récupérer. L’intentionnalité apparaît donc ici comme évidente : les Magdaléniens ont volontairement recherché cet os, pour réaliser un objet précis, plus que probablement une parure, dans la plupart des cas une tête de cheval façonnée sur un os de cheval.
Oui, bien sûr, l’ensemble cohérent de Labastide est l’exemple remarquable qui in�rme la règle : des têtes d’isards et une tête de bison réalisées sur os de cheval et de boviné : ce n’est pas toujours une représentation de cheval sur de l’ossement de
Figure 47. Mode de suspension des contours découpés à une ou deux perforations. Ces objets pouvaient aussi être cousus sur divers supports, dans des positions variées. (Arudy « Espalungue » MAN 47112 et Isturitz MAN 84669). D’après Buisson et al., 1996a, �g. 4.
Figure 46. Emplacement des contours découpés en forme de tête d’isard sur stylohyoïde de cheval, à gauche, de boviné, à droite. D’après Fritz et Simonnet, 1996, �g. 4b.
fiche4-stylohyoideum.indd 12 12/11/12 17:02
Fiche 4. Stylohyoideum 13
Figure 48. Fragment de métatarsien droit de renne décoré de deux contours découpés en forme de tête de cheval (Le Mas d’Azil MAN 47076). Photo. P. Cattelain, 2007.
cheval. Peu importe, la très belle analyse de C. Fritz montre que cet ensemble a plus que probablement été l’œuvre d’une seule personne, avec peut-être un léger doute pour la représentation du bison. Les ensembles relativement importants d’Arudy, d’Enlène, d’Isturitz et du Mas d’Azil comportent peut-être aussi des éléments d’un même collier, mais sans doute tout autant des pendeloques ou des « décorations cousues » isolées.
Même en incluant les cinq pendeloques des Asturies et de La Marche (ces dernières attribuées au Magdalénien III de Breuil, qui pourrait correspondre au Magdalénien à navettes), ainsi que l’étonnante pièce aux bisons de Las Caldas, rares ou unique et donc plus di�ciles à interpréter, les objets façonnés sur stylohyoïde, essentiellement des contours découpés en forme de têtes d’herbivores, nous apparaissent, malgré leurs subtiles ou vives di�érences, comme l’expression d’un véritable et même ensemble culturel. Sur plusieurs centaines de kilomètres, des groupes subcontemporains ont dû partager, évidemment le même mode de vie, mais très certainement aussi un univers mythique et symbolique cohérent, associé à des modes de représentations su�samment communs pour que leur interprétation particulière ne suscite pas l’incompréhension. Nous devons d’ailleurs signaler ici un fragment de métatarsien droit de renne du Mas d’Azil sur lequel nous reconnaissons la représentation de deux contours découpés en forme de tête de cheval, ainsi que l’arrière d’un troisième, plutôt que de têtes de cheval proprement dites. Cette impression est confortée par les deux lignes gravées subparallèles reliant les représentations, qui suggèrent la présence d’un bandeau… (�g. 48 et DVD : �g. 49 ; voir aussi David et al., ce volume : �g. 31). On montre ici une représentation d’animal, plutôt que l’animal lui-même…
Les objets pris sur stylohyoïde, à la fois très semblables et variés, dans leur niche spatio-temporelle bien dé�nie, nous semblent très révélateurs de l’existence de véritables groupes identitaires (peuples ? - nations ? - tribus ? ), à la �n du Tardiglaciaire.
REMERCIEMENTS
Nous remercions nos amis Claire Letourneux, Marylène Patou-Mathis et Jean-Marc Pétillon d’avoir bien voulu relire cette �che et de nous avoir ainsi permis d’y apporter quelques améliorations, ainsi qu’Ingmar M. Braun (Bettingen, Suisse), qui nous a signalé les objets suisses sur lesquels il prépare un article.
fiche4-stylohyoideum.indd 13 12/11/12 17:02