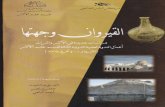L’industrie lithique de deux Rammadiya d’Aïn Afia (Jebel Hamzet-Kairouan ; Tunisie Centrale)
Transcript of L’industrie lithique de deux Rammadiya d’Aïn Afia (Jebel Hamzet-Kairouan ; Tunisie Centrale)
Kairouan et sa Région : Nouvelles Recherches
d’Archéologie et de Patrimoine
Actes du Colloque International
du département d’Archéologie
1-4 Avril 2009
Textes réunis par :
Nouri Boukhchim
Jaafar Ben Nasr
Ahmed El Bahi
Université de Kairouan
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Département d’Archéologie
Centre de Publication Universitaire
2013
Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays. © Centre de Publication Universitaire, Manouba, 2013. Campus Universitaire de la Manouba. 2010 - TUNISIE Tél : (216) 71 600 025 Fax : (216) 71 601 266
Sommaire
Partie française
Avant-propos
Sadok Ben Baaziz Rapport final du colloque I-IV
Rym Khedhaier-El Asmi,
Lotfi Belhouchet et
Nabiha Aouadi-Abdeljaouad
L’analyse fonctionnelle de l’outillage lithique du niveau
Moustérien d’Aïn el-Guettar de Meknassy : résultats
préliminaires…………………………………………………….
01
Jaâfar Ben Nasr et
Marwa Marnaoui
L’industrie lithique de deux rammadiya d’AïnAfia
(JebelHamzet-Kairouan : Tunisie Centrale)…………………….
17
Zied Jeddi L’occupation préhistorique aux alentours de Sebkhet Sidi El
Hani (Tunisie) : deux escargotières inédites……………………..
29
Jaafar Ben Nasr et
Najib Mejbri
Technique de ramassage au GPS appliquée à un site
préhistorique : la rammadiya d’AïnAfia (Kairouan : Tunisie
Centrale)…………………………………………………………
43
Mansour Ghaki et
François Paris
Les monuments mégalithiques du sud tunisien : état de la
question………………………………………………………….
49
Moncef Ben Moussa Céramique, huile et céréales dans la région de Souine-Bayoudh
(Tunisie Centrale)……………………………………………….
67
Tarek Mani A propos d’amphores africaines timbrées mentionnant la cité de
Sullecthum(Tunisie)…………………………………………….
103
Mohammed Abid Nouvelles épitaphes latines païennes de la cité latine de Capsa et
ses environs……………………………………………………..
145
Mohammed Abid Les mentions de l’olivier, de l’oléastre, de l’huile et des olearii
dans l’épigraphie latine africaine………………………………...
157
Arbia Hlali La place des dieux puniques dans le panthéon des militaires en
Afrique romaine………………………………………………….
187
Slah Selmi Remarques sur la titulature des empereurs morts………………... 197
Hédi Fareh, Anis Hajlaoui et
Lotfi Lahmar
Prospection archéologique dans la région de Laswda à Sidi
Bouzid (carte de Djebel Es-Souda n : 086) : résultats
préliminaires……………………………………………………..
205
Faouzi Abdellaoui Le pressoir à levier à vis dans l’antiquité : l’exemple d’Oued
Rmel (Tunisie)…………………………………………………..
231
Michel Terrasse Fatimides et zirides dans l’aménagement et l’art du pays
kairouanais : des émirs oubliés ?....................................................
245
Mouna Taamallah Le réseau hydrographique de la plaine de Kairouan au Moyen
Âge : essai de reconstitution……………………………………
253
Bouthaeina Ben Baaziz
Gharbi
Les portes coudées de l’enceinte de Kairouan…………………... 267
Patrice Cressier et Mourad
Rammah
Sabra al-Mansūriyya : éléments de chronologie. ……………... 287
Mohamed Ali Hbaieb Notes préliminaires à propos d’un système de captage et de
partage d’eau dans les environs de Kairouan : la foggara de Sidi
Ali Ben Nasrallah……………………………………………….
301
Sondes Gragueb Chatti Le vert et le brun de Sabra al-Mansūriyya. …………………….. 317
Aïda Ladhari Les coupoles de Kairouan : essai d’étude et de classification
typologique………………………………………………………
331
Sylvie Bourgouin Approche d’une étude comparative entre la Grande Mosquée de
Kairouan et la Grande Mosquée de Mahdia. …………………….
355
Mohamed Ghodhbane Un nouvel essai pour expliquer le type monétaire d’al-
Muc
izzLidin Allah………………………………………………………
375
Fathi Jarray Notes préliminaires sur deux miswala-s méconnues de la ville de
Kairouan. ………………………………………………………..
391
Khaoula Saddem Maalej Les fanadiqs et les wikalets de la villeau milieu du XIXème siècle
à travers les documents d’archives. …………………………......
401
Avant-propos
Fort de l’immense succès de son deuxième colloque international « Kairouan et sa région : nouvelles
découvertes, nouvelles approches » (au mois de mars 2006), le Département d’Archéologie de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan, vous présente avec toute la satisfaction ressentie, les actes de cette troisième édition (avril 2009) intitulée : « Kairouan et sa région : nouvelles recherches
d’Archéologie et de Patrimoine ». L’idée de reprendre le thème directeur de l’édition précédente a été considérée par le conseil de département comme une nécessité car il y avait de fortes attentes à la suite du précédent colloque.
La présente édition avait pour objectifs de réunir les chercheurs intéressés par le "Kairouanais", présenter les nouvelles découvertes et approches diverses, dresser un bilan des recherches historiques et archéologiques dans la région mais aussi susciter de nouvelles problématiques et interrogations.
Nos collègues de différentes universités et institutions tunisiennes et étrangères nous ont offert une contribution intellectuelle de premier ordre par la qualité de leurs interventions et l’originalité de leurs apports. De nombreux travaux récents ont été exposés tant au niveau des sciences archéologiques que du questionnement des textes historiques. Plusieurs résultats marquants en sont ressortis.Voici donc un ouvrage qui manifeste le dynamisme fécond des recherches sur Kairouan et sa régions de la Préhistoire jusqu’aux périodes modernes et contemporaines. La variété des questions, des hypothèses et des approches des différentes contributions, montrent encore une fois l’importance et la richesse de cette thématique.
Parvenir à publier ces actes, était pour nous, comité d’organisation, une entreprise de longue haleine. Plusieurs facteurs se sont conjugués pour retarder cette parution. Nous témoignons notre gratitude à tous ceux qui ont, spontanément, donné de leur temps et de leur énergie pour assurer l’organisation de ce colloque et la publication de ses actes.
Nous exprimons en premier lieu notre appréciation sincère à notre institution, la faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan. Qui, sans le soutien matériel et logistique qu’elle a prodigué, l’organisation et la publication de ce colloque n’auraient été possibles.
Je prie, les membres du comité scientifique, messieurs : Ahmed M’charek, Abdellatif M’rabet, Faouzi Mahfoudh et Mourad Rammeh de trouver ici l'expression de notre reconnaissance.
Nous adressons également tous nos remerciements à monsieur Sadok Ben Baaziz pour avoir accepté la lourde et la fatigante tâche de rapporteur du colloque.
Que soient aussi remerciés tous les participants (intervenants, présidents de séances et assistance) auxquels nous dûmes quatre journées de passionnantes et fructueuses discussions.
Le comité d’organisation était secondé par une solide équipe d’étudiants dont l’efficacité et l’enthousiasme sont toujours une joie à constater. Qu’ils trouvent ici tous nos remerciements.
Nous sommes très heureux qu’après une longue attente cet ouvrage paraisse, en coédition avec le Centre de Publication Universitaire, et que le lecteur puisse prendre connaissance des ses nombreux apports. Ces actes nous invitent à continuer et à persévérer dans cette quête de l’inédit de la révision de nos connaissances sur le patrimoine historique et archéologique de la Tunisie.
Kairouan, le 31 décembre 2012
Les coordinateurs
Nouri Boukhchim
Jaâfar Ben Nasr
Ahmed el Bahi
Rapport final
Sadok Ben Baaziz
(Institut National du Patrimoine)
Les organisateurs du colloque ont voulu me punir en me confiant la présentation de la synthèse de ce colloque parce que je ne me suis pas proposé pour présenter une communication. Par ailleurs ils m’ont fait l’honneur et le plaisir de me charger de la clôture d’un aussi important colloque avec autant d’illustres participants enseignants chercheurs de cette université et leurs invités.
Je dois avouer la difficulté que j’ai rencontré à mener à bout cette tâche, car comment le faire et être au niveau de ces communications aussi intéressantes et savantes les unes que les autres, présentées par des chercheurs enthousiastes sur des thèmes originaux, des monuments ou des documents de grande importance pour l’histoire ou le patrimoine de cette ville et sa région.
La principale difficulté est le temps imparti à cette présentation, après quatre journées de travaux présentés par 44 chercheurs.
Je vais essayer de faire de mon mieux Je ne nommerai personne mais tous les participants vont se reconnaître dans ce texte.
Au cours des trois séances de la première journée nous avons écouté des communications sur trois thèmes de recherches importants :
- sur la préhistoire
- de la préhistoire à l’époque punique
- et des études épigraphiques sur la période romaine.
Dans ces communications intéressantes nous avons eu droit à des nouveautés, à des découvertes résultats de prospections ou des fouilles sur des sites qui m’intéressent et me tiennent à cœur pour des raisons personnelles à Meknassi Aïn el Guettar ou sebkhet Sidi el Hani où de jeunes chercheurs ont su attirer notre attention sur ces richesses, sur le développement et le renouvellement de nos méthodes de recherche pour aborder les sites préhistoriques escargotières ou peintures rupestres,
Nous avons également vu et écouté des exposés de méthodologie avec l’utilisation des nouvelles techniques comme le travail à Aïn el Afia. Toute l’assistance comme moi-même je suis sûr a apprécié l’intérêt de ces travaux sur les sites mégalithiques du Sud et ce que cela soulève comme questions sur l’occupation humaine de ces périodes allant de la protohistoire jusqu’au second siècle de notre ère et ce que cela suppose au moins au niveau des sites funéraires ou de l’habitat.
La présence punique bien que difficile à cerner, l’intervention sur ce thème a eu au moins le mérite d’attirer l’attention sur cette période. Qu’y a-t-il dans cette région avant la présence manifeste de la présence romaine ? Oui le communiquant a raison le pays n’était pas vide, la région a au moins subit l’influence carthaginoise car Sidi el Hani n’est pas très loin de Sousse.
Les études épigraphiques présentées par les trois jeunes chercheurs enthousiastes qu’il faut féliciter, constituent avec d’autres l’avenir de notre recherche. Ils n’ont manqué ni d’audace ni de courage pour
II Kairouan et sa Région : Nouvelles Recherches d’Archéologie et de Patrimoine
aborder les thèmes qu’ils ont traités, que ce soit les titulatures de Carthage ou impériales, ou même les subtilités des religions antiques. Ou pour faire une synthèse sur la céramique et le commerce à partir de l’importante collection de timbre de Salakta.
La quatrième séance avec laquelle on a entamé la deuxième journée avait pour thème : prospection archéologique et étude du matériel antique. Les quatre interventions confirment l’importance de cette discipline pour le progrès de la recherche archéologique et historique. Faute de moyen et de soutien matériel ou financier de la part des structures officielles en charge de ce secteur ces quatre collègues ont mené des travaux et obtenu des résultats importants, comme la relation intime entre la production de la céramique et l’oléiculture dans l’évolution de ces régions où la richesse patrimoniale de J. es Souda. L’analyse du matériel oléicole et la discussion quelle a déclenché et l’intérêt porté par les différents intervenants au cours de celle-ci, prouve la pertinence de cette présentation sur Oued er Rmal. Cette séance s’est achevée par une brillante communication toujours d’un jeune chercheur et collègue sur la société antique de la région à travers une analyse fine et minutieuse de l’onomastique antique.
On a repris les travaux de la cinquième séance avec les travaux sur l’occupation du sol de l’antiquité à l’époque médiévale ce fut une séance riche avec des thèmes variés et très pointus qui ne peuvent être traité que par des chercheurs des savants chevronnés avec une longue expérience car il le faut pour traiter de la signification de l’indulgence (impériale) du prince ou de localisation d’un site qui continuera a faire couler beaucoup d’encre ou du tableau sur la zone avant la fondation de Kairouan ou si l’on veut avant l’intervention de OKba et la géographie historique. En fait beaucoup de réponses et d’explications sur cette question peuvent être trouvées dans la communication sur la dépression à l’Est de Kairouan.
La sixième séance fut consacré à la ville et aux monuments de Kairouan entamé par une lecture savante des sources sur les massajeds et la spécificité du masjid un dossier complet et intéressant allant des sources jusqu’aux archives Une étude comparé sur les deux monuments phares des deux capitales Mahdia et Kairouan même en l’absence d’illustration, le chercheur a bien montré la pertinence et l’intérêt de cette approche.
Evidemment les portes constituent un élément important pour la compréhension de l’histoire et l’évolution de la ville de Kairouan, ces monuments sont un exemple de la complexité des études archéologiques en l’absence de fouille ou la non disponibilité de la documentation, mais cela ne diminue en rien la qualité qui en a été faite.
C’est vrai l’intérêt que des chercheurs issu d’un autre milieu, d’une autre formation que sont par exemple les architectes comme on l’a vu sur l’étude des coupoles de Tunis et Kairouan sont très important et a toujours encourager
Au cours de la septième séance un grand archéologue venu de loin (Egypte) mais si proche de nous
pour l’amour qu’il porte au patrimoine Kairouanais. a souligné à juste titre la faiblesse des études sur
Kairouan, dont nous somme tous conscient, mais il a constaté lui-même en assistant à ce colloque que c’est
du passé, que les recherches sur Kairouan ne connaîtront plus d’hibernation dans l’avenir avec ces
chercheurs et ces étudiants aussi assidus. Au cours de cette séance nous avons écoutés trois communications
aussi brillantes l’une que l’autre montrant l’originalité de l’architecture civile, des massajeds à coté de
l’architecture officielle. C’est un éclairage nouveau que de jeunes chercheurs tunisiens ont entamé comme
nous l’avons constaté au cours de la discussion qui s’en suivi. La lecture des sources sur l’enceinte de la ville
et les techniques de construction de celle-ci complète et enrichie les études déjà publiées ou présentées au
cours de ce colloque. Je ne reviens pas sur la belle comparaison entre les coupoles qui une fois publié sera un
document de base pour plusieurs analyses de la part des historiens et des archéologues.
Rapport final du 3ème colloque de kairouan III
La huitième séance nous a ramené à un travail de prospection et à un retour chronologique à une richesse patrimoniale de ces régions que sont les escargotières et abri sous roche et ce que cela implique comme minutie pour les aborder et d’effort pour leur sauvegarde.
Toutes ces communications n’ont pas manqué d’analyses pertinentes qui montrent la qualité de notre recherche tunisienne comme celle qu’on a écoutée sur les itinéraires les routes la géographie historique où chacun essaie d’apporter son interprétation, ce qui nous permettra d’éviter l’approche unique de ces questions ardus et épineuses.
Les monuments hydrauliques constituent une composante importante de notre patrimoine et nous saisissons tous leur poids dans l’histoire de notre pays bien que j’ai abordé ce thème au cours de ma carrière sous ses aspects religieux et archéologiques, je continue à apprendre à chaque fois qu’une communication est présenté sur ce sujet et je prend conscience de notre ignorance, pour dire l’intérêt que j’ai eu à suivre la présentation sur cette foggara de Nasrallah, seul le débat qu’elle a suscité confirme mon appréciation.
Avec la neuvième séance on est revenu à Kairouan avec la présentation des fouilles de Sabra el Mansouria, avec cette communication on a pu saisir de visu la complexité, la difficulté du travail sur ce site oh combien prestigieux on doit tirer le chapeau à l’équipe qui a étudié ce monument aussi complexe et si fragile. C’est avec impatience qu’on attendra la publication sur l’ensemble des travaux où l’on pourrait apprécier encore plus tous les fragments et échantillons qu’on nous a présentés sur l’art Ifriquien de l’époque. Cette importance a été confirmée par la richesse de la céramique le vert et le brun. Toute cette archéologie fine, minutieuse nous l’avons vu a apporté des résultats importants malgré la dégradation des vestiges. C’est une leçon à tirer pour entamer au plus vite une archéologie urbaine de sauvetage dans nos villes historiques Tunis, Sousse, Bizerte ou Sfax. On a vu au cours de cette séance que même la numismatique de l’époque est chargée d’histoire et beaucoup d’idéologie, ces pièces d’or continuent a faire couler beaucoup d’encre la communication a déclenché un long débat sur les fatimides qui méritent à eux seul un colloque et non une simple communication tant le sujet est passionnant.
La dixième séance a porté sur le thème, sites et monuments islamiques, je dirai l’archéologie des montagnes ou des hauteurs pour dire combien elle est intéressante et constitue un éclairage important, qui nous révèle la réalité de notre pays et nous rapproche de notre histoire. C’est une révolution que cette démarche constitue elle équivaut à la révolution que fut l’archéologie rurale pour l’Antiquité entamée ou déclenchée par les Anglais les années 60-70 en Europe Que mes collègues antiquisants pratiquent aujourd’hui avec brio, avec les routes la géographie historique, l’oléiculture ou les domaines impériaux. Jbel Ouslat et avec la passion avec laquelle il nous est chaque fois présenté a fait école, mais il risque d’occulter l’originalité des autres types de ce pan de notre patrimoine des hauteurs. Kesra et ce type de vestiges est une mine d’or placée dans son contexte avec les autres sites de la Dorsale méridionale.
La communication de la medersa de Matmata et son Cheikh est une étude je dirai modèle du genre car le jeune collègue allie l’étude archéologique monumentale, archivistique, culturelle et sociale, ce fut un dossier complet c’est un rêve pour tout chercheur de disposer d’un filon aussi précieux, tant de chercheurs sont passés a coté de ces lieux sans y prêter attention sur la valeur de ce dossier, eh bien bravo.
L’analyse des archives sur le palais de Mhamdia nous a montré avec le document analysé un véritable trésor qui dépasse dans son intérêt comme l’a montré le communiquant. Le simple document de gestion ou comptable d’une administration mais on y trouve un véritable tableau de société qu’on peut dresser à partir de ce document, c’est un témoignage de première main sur une réalité insoupçonnée tellement l’histoire évènementielle, colonisation mouvement national, ou syndicalisme ont figé, sclérosé notre histoire enseignée dans nos lycées et nos universités Merci et encore merci c’est la vie quotidienne
IV Kairouan et sa Région : Nouvelles Recherches d’Archéologie et de Patrimoine
qu’on saisit avec cette communication sur les métiers, la vie des gens, leur hiérarchie et non seulement sur un grand chantier beylical qui fut un fiasco dans sa réalisation.
Cette communication a été suivi par celle qui a porté sur les oukala et fondouk également à partir de documents d’archives, elle est tellement intéressante qu’elle va ouvrir je l’espère l’analyse des documents civil de la ville de Kairouan, ce document d’archive montre déjà l’importance économique de cette ville, car aucune autre ville ne dispose d’autant de ce type de document. Je pense à Gabes par exemple bien que située sur un axe commercial indéniable ne dispose pas d’autant de témoignage sur la vitalité du commerce, des échanges et de l’artisanat La communication sur el Fikh (l’exégèse) ismaélite est précise, savante et bien documentée, elle ouvre des perspectives intéressantes pour l’analyse des sites fatimides.
La dernière séance on peut dire que c’est la séance des archives au service de l’histoire et de l’archéologie kairouanaise avec quatre communications intéressantes, d’abord :
- sur la Zaouïa el Ghariania et son rôle dans l’histoire politique de Kairouan et le rôle joué dans l’enracinement d’une culture d’allégeance au pouvoir établi.
-puis celle concernant les blidets bien localisées sans conteste du point de vue topographique et qui demandent un éclairage archéologique qui ne tardera pas à venir avec des recherches futures.
Ce panorama s’est enrichi avec clarté grâce à l’étude sur les habous et leur impact économique du kairouanais.
- L’analyse des sources de l’historiographie de la ville de Kairouan a été faite de façon méthodique et avec succès.
Avec la dernière séance on voit que l’archéologie est une science au service de l’histoire, avec les inscriptions funéraires présentées de façon magistrale et qui nous renseignent sur les épidémies. La communication présentée sur les deux cadrans solaires analysés de façon experte indique la continuité du savoir avec l’Antiquité et ces documents apportent également un nouvel éclairage pour l’histoire de la ville de Kairouan.
Pour achever une œuvre d’art l’artiste pose sa signature, cette tache pour signer si l’on veut ce colloque est revenue à une excellente présentation d’une collection métallique Kairouanaise par un jeune chercheur.
L’industrie lithique de deux Rammadiya d’Aïn Afia
(Jebel Hamzet-Kairouan ; Tunisie Centrale)
Jaâfar BEN NASR
Marwa MARNAOUI**
Introduction
Les deux rammadiya d’Aïn Afia (ou Aouinet El Afia selon le toponyme local) sont situées à 21,5 km à vol d’oiseau à l’ouest de la ville de Kairouan et appartiennent administrativement à la localité de "Jwawda - sidi Abdallah". Les deux gisements sont localisés dans une zone montagneuse de modeste altitude (180 m) entre Jebel Afaïr et Jebel Hogaf Es Sfèïa dans l’axe de la vallée d’Aïn Afia à un lieu dit "Jebel Hamzet" (coordonnées 263, 800 N / 497, 400 E) (Fig.1).
Fig. 1 : La vallée d’Aïn Afia (les flèches indiquent l’emplacement des deux rammadiya par rapport à la source d’eau)
Le rammadiya n°2 a été découverte lors d’une prospection pédestre menée par M. Abdelletif M’RABET et son équipe en 2000. Elle porte le numéro 118 dans l’inventaire des sites archéologiques de la carte de Kairouan au 1/50.000 (n° : 63).
1. La rammadiya d’Aïn Afia 1
Cette première rammadiya se trouve à une dizaine de mètres à l’est de la source d’eau. Elle est située en flanc de pente, en contrebas d’une série d’abris effondrés. Elle est en mauvais état de conservation et en grande partie détruite par l’Oued.
Le matériel lithique ramassé sur cette première rammadiya est partagé en deux séries. La première provient d’un ramassage localisé opéré à l'intérieur d’un carroyage effectué sur toute la surface de la rammadiya (la superficie est d’environ 10 sur 8 mètres). La seconde correspond au matériel diffus ramassé tout autour de la zone quadrillée sur toute la pente qui fini dans l’Oued (Fig.2).
Jaâfar BEN NASR (Département d’Archéologie ; Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan)
** Marwa MARNAOUI (Doctorante,Universitat Rovira i Virgili de Tarragona).
18 Kairouan et sa Région : Nouvelles Recherches d’Archéologie et de Patrimoine
Fig. 2 : La rammadiya d’Aïn Afia 1.
1. 1. Ramassage localisé
Le ramassage localisé a donné 81 pièces majoritairement en silex brun-gris et 6 éclats en calcaire
gris-rouge. Nous y distinguons d’abord 5 nucleus à éclats dont un de grandes dimensions (L : 70 mm ; 52
mm ; 46 mm) débité sur silex brun opaque de mauvaise qualité (pas assez silicifié) provenant
vraisemblablement d’un nodule suggéré par sa forme et par la présence sur la partie dorsale d’un résidu
cortical argileux et granuleux. Les fragments de nucleus sont au nombre de 4. Nous comptons également
une lame et 35 éclats bruts de taille. Uniquement 7 éclats ont conservé une partie corticale. Ils peuvent
provenir de la phase de mise en forme. Le cortex a un aspect granuleux peu épais ou crayeux lessivé de
couleur beige. 26 éclats sont de plein débitage. Les négatifs observés sur leurs faces supérieures
indiquent un débitage non organisé d’éclats. Nous avons aussi 3 éclats de préparation de plan de frappe.
La série compte deux éclats Levallois, dont une pointe non retouchée, débités sur calcaire gris. Notons
enfin la présence d’une chute de burin.
L’effectif des pièces retouchées est très faible (n=9). Nous distinguons :
Outils Effectifs
II. Burins
17. Burin dièdre 1
19. Burin d’angle sur cassure 1
VII. Coches
74. Eclat à coches 2
75. Eclat denticulé 2
77. Lamelle denticulée 1
VIII. Troncatures
80. Pièce à troncature 1
XI. Divers
105. pièce à retouche continue 1
Total 9
L’industrie lithique de deux Rammadiya d’Aïn Afia 19
1. 2. Ramassage diffus
Un ramassage diffus a permis de recueillir 87 pièces en silex brun-gris. Nous y comptons quatre
nucléus (deux globuleux de petites dimensions et deux à débitage organisé de lamelles en état d’épuisement),
une lame et 32 éclats dont 8 éclats corticaux, 11 éclats de préparation du plan de frappe et 17 éclats de plein
débitage avec une longueur comprise entre 13 et 30 mm et une longueur moyenne de 19,64 mm. La nature
du cortex varie entre le granuleux, le crayeux et le roulé. Les cassons sont au nombre de 39. Quant aux
pièces retouchées, elles peuvent être dénombrées comme ci-après :
Outils Effectifs
I. Grattoir
1. Grattoir simple sur éclat : 3
III. Burin
24. Burin d’angle sur troncature convexe 1
VI. Lamelles à bord abattu
54. chute de burin à retouches abruptes 1
VII. Coches
74. éclat à coche 2
79. pièce à coche et retouche continue 1
XI. Divers
105. pièce à retouche continue 2
Total 10
1. 3. Conclusion
Les 174 pièces livrées par cette rammadiya (ramassage localisé et ramassage diffus) sont
principalement en silex gris-brun. Le ramassage compte uniquement 19 pièces retouchées
majoritairement sur éclats. Presque la moitié des outils ramassés sont des coches dont deux sont sur
calcaire. Nous n’avons que 3 grattoirs (ramassés tous à l’extérieur de la rammadiya), 3 burins, 2 pièces
retouchées comptées parmi les "Divers" et une chute de burin transformée en une lamelle à bord abattu
par retouches abruptes. D’après Jacques Tixier, « les industries capsiennes sont les seules connues au
monde présentant comme particularité la présence de nombreuses "lamelles de coup de burin"reprises
systématiquement en lamelles à dos » (Tixier 1963, p. 29). La faiblesse numérique des pièces retouchées
ne permet pas de procéder à des calculs d’indices afin de rapprocher ou comparer le stock lithique à une
culture ou à un faciès quelconque.
Les nucléus sont également très peu représentés (n=9). Ils sont dans un état résiduel et tendent pour
la plupart vers une morphologie globuleuse. Uniquement deux nucléus montrent les négatifs d’enlèvements
lamellaires plus ou moins réguliers (Fig. 3).
Enfin, les produits bruts de débitage sont presque exclusivement des éclats. L’observation de leurs
faces supérieures montre que le mode de débitage le plus présent est celui d’éclats.
20 Kairouan et sa Région : Nouvelles Recherches d’Archéologie et de Patrimoine
Fig. 3 - Rammadiya Aïn Afia 1 ; outils : 1: grattoir simple sur éclat ; 2 : Burin d’angle sur
cassure ; 3 : Burin d’angle sur troncature convexe ; 4 : éclat à coches ; 5 : éclat à coche ;
6 : éclat denticulé ; 7 : Lamelle denticulée ; 8 : pièce à coche et retouche continue ;
9 : Pièce à retouche continue ; nucleus : 10 : nucleus à débitage non organisé ;
11-12 : nucleus à débitage organisé.
2. La rammadiya d’Aïn Afia 2
En quittant la première rammadiya pour regagner la vallée, nous rencontrons sur la berge gauche de
l’Oued el Aïn, à 300 mètre à peu près de la source, une deuxième rammadiya située à l’abri d’un
escarpement rocheux haut de 15 m. Elle est mieux conservée et plus étendue que la première (elle s’étale sur
une longueur de 30 m et une largeur de 40 m environ) (Fig.4).
L’industrie lithique de deux Rammadiya d’Aïn Afia 21
Fig. 4 : La rammadiya d’Aïn Afia 2 (détail).
2. 1. Etude du matériel
La série compte 355 pièces (fig. 5). Outre les vestiges lithiques, le ramassage1 contient quelques fragments d’œufs d’autruches, des fragments de céramique modelée et des fragments d’os d’animaux.
Fig.5 -Composition du matériel lithique.
Type de produits Effectifs %
Produits retouchés 92 25,91
Supports de débitage Nucléus 30 8,45
Fragments de nucléus 10 2,81
Produits bruts de débitage Eclats 132 37,18
Lames 8 2,25
Lamelles 6 1,69
Déchets techniques 2 0,56
Débris 75 21,12
Total 355
Les pièces débitées sur silex sont les plus nombreuses (326 pièces, soit 91,83% du total). Par contre,
celles débitées sur calcaire (gris-orangé) ne présentent qu’un pourcentage de 8,16% de l’ensemble lithique
ramassé sur site (29 pièces : 6 outils et 23 éclats bruts). Le silex brun-gris, vraisemblablement d’origine
locale, reste la matière première privilégiée pour le débitage. D’autres types rares comme le silex "crème" ou
"caramel" peuvent être estimés allochtones dans l’attente d’une prospection centrée sur la lithologie de la
région.
1 La technique de ramassage appliquée sur cette rammadiya fait intervenir le GPS (Global Positioning System). Une note publiée
dans le présent ouvrage expose la technique et la démarche.
22 Kairouan et sa Région : Nouvelles Recherches d’Archéologie et de Patrimoine
Les nucléus
La série compte 40 nucléus, soit 11,26% de l’ensemble des pièces ramassées. Ils se partagent entre
nucléus globuleux (n=6) et nucléus à débitage organisé (n=24) (Fig.6). Dans cette deuxième catégorie nous
distinguons :
- 13 nucléus montrant un seul plan de frappe et une surface débitée semi-tournante.
- 2 nucleus à un seul plan de frappe et une surface débitée frontale.
- 1 nucleus à un seul plan de frappe et une surface débitée tournante.
- 2 nucleus à deux plans de frappes opposés.
- 1 nucleus "cylindrique" à deux plans de frappes opposés.
- 2 nucleus "croisés" (à deux plans de frappes orthogonaux).
- 3 nucleus "cannelés" à enlèvements lamellaires réguliers et parallèles obtenus par pression.
L’examen des nucléus montre que les supports de débitage étaient essentiellement des rognons et
occasionnellement des plaquettes. Il peut s’agir de rognons qui n’ont pas roulé, extraits en position primaire
(cortex crayeux et poudreux), ou collectés en position secondaire (néocortex alluvial ou cortex mince altéré
qui a probablement roulé).
La quasi-totalité des nucleus a été exploitée jusqu’à un stade très avancé. Il s’agit généralement de
nucleus résiduels de dimensions très réduites. Les longueurs sont comprises entre 41 et 12 mm, les largeurs
entre 13 et 35 mm et les épaisseurs entre 10 et 31 mm. Cela peut traduire une volonté d’exploiter au
maximum les supports de débitage avant leur mise au rebut, vraisemblablement à cause de la rareté ou
l’éloignement d’une matière première de bonne qualité. Il se peut aussi que c’est pour faciliter leur
déplacement, que les tailleurs d’Aïn Afia ont fait le choix de ne transporter sur site qu’un volume réduit de
matière première à exploiter de façon optimale. La rareté de produits bruts de débitage de grandes tailles est
un autre argument qui plaide en faveur de cette hypothèse.
Nous remarquons une tendance vers un débitage organisé dont la finalité essentielle est l’obtention
de lamelles à l’image des derniers produits de débitage donnés. La présence à l’intérieur de cette série de
nucleus cannelés peut permettre des rapprochements chronologiques puisque ces nucléus sont le produit d’une
« technique [par pression] uniquement capsienne et néolithique» (Tixier 1963, p. 94).
L’industrie lithique de deux Rammadiya d’Aïn Afia 23
Fig. 6 –Rammadiya Aïn Afia 2 : 1 à 3 : nucleus à un seul plan de frappe et une surface débitée semi-tournante ; 4 : nucleus à un seul plan de frappe et une surface débitée frontale ; 5 : nucleus à deux
plans de frappes opposés ; 6 : nucleus « croisés » (à deux plans de frappes orthogonaux) ; 8 à 10 : nucleus « cannelés ».
Les produits bruts de débitage
Le ramassage compte 148 produits bruts de débitage (soit 41,69% de l’ensemble lithique), répartis en 134 éclats (dont 23 en calcaire), 8 lames et 6 lamelles.
Les pièces corticales sont peu nombreuses (n=14) ; rares sont les éclats d’entames (n=1). Il est possible que les nodules de silex fussent ramenés sur site sous forme de nucléus préformés. Le cortex est lessivé, sableux, crayeux ou encore granuleux.
Les éclats de plein débitage (n= 72) sont de différentes dimensions. La longueur moyenne des pièces est de 24 mm, la largeur est de 18 mm et l’épaisseur est de 7,50 mm. L’observation des talons donne 43 talons lisses, 12 facettés, 3 punctiformes et 2 linéaires. Pour le reste des éclats, la détermination est difficile.
24 Kairouan et sa Région : Nouvelles Recherches d’Archéologie et de Patrimoine
Les talons et les points d’impacts sont très réduits, voire même diffus. En écartant les éclats de
petites dimensions dont l’observation des faces supérieures ne peut pas nous informer sur les enlèvements et
le mode de débitage, seulement 9 pièces montrent des négatifs d’enlèvements parallèles et organisés de
lames ou de lamelles à partir d’un seul plan de frappe. Enfin, la série compte 22 éclats d’aménagement du
plan de frappe.
Les lames et les lamelles sont sous représentées dans cette série. Nous n’avons dénombré que 8
lames à bords irréguliers et à profil plat ou légèrement concave. L’aspect diffus des bulbes suggère une
technique de taille par pression ou percussion indirecte à l’aide d’un percuteur tendre. Leurs faces
supérieures montrent des négatifs d’enlèvements laminaires parallèles à partir d’un plan de frappe unique.
Les lamelles (n= 6) sont également irrégulières et de profil plat. Enfin, nous avons collecté deux déchets
bruts de taille présentant toutes les caractéristiques d’un éclat au sens large. Il s’agit de deux chutes de burins
brutes à section triangulaire.
Les produits retouchés
Cette deuxième rammadiya a livré 85 pièces retouchées en silex (Fig.7). Nous pouvons en donner le
décompte suivant :
Type Effectifs % Cumulés
I. Grattoir
1. Grattoir simple sur éclat 3 3,5 3,5
2. Grattoir sur éclat retouché 3 3,5 7,0
5. Grattoir denticulé 1 1,17 8,2
6. Grattoir à épaulement ou à museau 1 1,17 9,3
7. Grattoir à coches 1 1,17 10,5
8. Grattoir simple sur lame 2 2,35 12,9
10. Grattoir sur lame à bord abattu 1 1,17 14,0
III. Burin
22. Burin d’angle sur troncature rectiligne oblique 1 1,17 15,2
23. Burin d’angle sur troncature concave 1 1,17 16,4
24. Burin d’angle sur troncature convexe 2 2,35 18,7
IV. Éclats et lames à bord abattu
34. Éclats à bord abattu 5 5,88 24,6
35. Lame à bord abattu rectiligne 1 1,17 25,8
37. Lame à bord abattu arqué 1 1,17 26,9
V. Outils composites
44. Grattoir-burin 2 2,35 29,3
VI. Lamelles à bord abattu
63. Lamelles à bord partiel 2 2,35 31,6
66. Fragment de lamelle à bord abattu 1 1,17 32,8
VII. Coches
74. Eclat à coche (s) 6 7,05 39,9
L’industrie lithique de deux Rammadiya d’Aïn Afia 25
75. Eclat denticulé 5 5,88 45,7
76. Lame ou lamelle à coche 7 8,23 54,0
77. Lame ou lamelle denticulée 4 4,70 58,7
79. Pièce à coche (s) ou denticulation et retouche continue 7 8,23 66,9
VIII. Troncatures
80. Pièce à troncature (s) 5 5,88 72,8
IX. Microlithes géométriques
82. Segment ou demi-cercle 1 1,17 73,9
XI. Divers
105. Pièce à retouche continue 20 23,52 97,5
112. Divers 2 2,35 100,0
TOTAL 85
L’outillage est principalement débité sur éclats (2/3 de l’ensemble des outils). Généralement, les
supports sont des produits de plein débitage. Les produits d’entretien du débitage étant délaissés.
Les pièces à coche(s) sont le type le plus représenté (n=32, soit le tiers de l’ensemble de l’outillage).
Les coches peuvent être retouchées ou "clactoniennes" obtenues d’un seul coup de percuteur. Les « Divers »
viennent en deuxième position avec 24 pièces. Les grattoirs sont moins nombreux ; la collection n’en compte
que 12 dont 9 sont sur éclats simples, retouchés, denticulés, à coche(s) ou à épaulement. Les trois autres sont
sur lames dont une à bord abattu. Rappelant, suite à Jacques Tixier, que les grattoirs sur lame à bord abattu
sont « l’une des plus notables caractéristiques des industries capsiennes » (1963, p. 61). Les pièces à bord
abattu occupent la troisième place avec 10 objets (5 éclats, 3 lamelles et 2 lames). Notons aussi que l’éclat à
bord abattu est « présent surtout dans les industries capsiennes (et particulièrement au Capsien typique) »
(1963, p. 83). Les troncatures sont peu nombreuses (n=5). L’effectif des burins est également très faible (1
burin d’angle sur troncature rectiligne oblique, 1 burin sur troncature concave et 2 burins sur troncature
convexe).
Notons enfin la présence de deux outils composites : grattoir-burin et un microlithe géométrique sous
forme d’un segment, un outil qui « existe chronologiquement tout au long de l’Epipaléolithique du Maghreb
et peut être tenu pour la seule forme géométrique existant dans le capsien typique ancien » (Tixier 1963, p.
128).
Concernant le type de la retouche appliquée sur les produits bruts de débitage afin de les transformer
en outils, nous remarquons que la technique de la retouche abrupte, qui peut bien paraître caractéristique du
Capsien typique, est la plus dominante, d’ailleurs sur les deux sites. Dans les autres cas les retouches sont
courtes ou même consistent à un simple grignotage suffisant pour transformer et traiter le bord.
Le ramassage de surface effectué sur la rammadiya d’Aïn Afia 2 nous a fourni également 6 outils sur
calcaire. Il s’agit d’un burin d’angle sur cassure fait sur éclat denticulé à deux coches adjacentes, un éclat à
coche clactonienne, deux éclats denticulés sur les deux bords et deux éclats à retouches continues.
26 Kairouan et sa Région : Nouvelles Recherches d’Archéologie et de Patrimoine
Fig. 7 –Rammadiya Aïn Afia 2 ; outils : 1 : grattoir à coches ; 2 : grattoir sur lame à bord abattu ; 3 : burin d’angle sur troncature convexe ; 4 : éclats à bord abattu ; 5 : lame à bord abattu rectiligne ; 6 : lame à bord abattu arqué ; 7 : grattoir-burin ; 8 : éclat à coche ; 9 : éclat
denticulé ; 10 : lame à coche ; 11 : pièce à coche (s) ou denticulation et retouche continue ; 12 : segment ou demi-cercle ; 13 : pièce à retouche continue ; 15 – 16 : divers.
2. 2. Analyse de la structure du stock lithique
Une caractérisation des comportements atypiques de l’outillage est effectuée en appliquant la représentation graphique du diagramme rayonnant (radar). L’outillage est d’abord comparé aux outils caractéristiques des variations du stock lithique (grattoirs, burins, lamelles à dos et coches) du Néolithique de Tradition Capsienne de l’Algérie Orientale (NTC DZ). Nous observons deux différences mineures : un léger excès des burins et une baisse de l’indice des lamelles à dos (Fig.8). Une deuxième comparaison a été faite par rapport aux indices du Néolithique de tradition Capsienne de la Libye (Fig.9). Ici les affinités paraissent très fortes ; relativement aucune différence n’est attestée. Les préhistoriques qui ont occupé la rammadiya d’Aïn
L’industrie li
Afia 2 ont
néolithiques
Fig
orien
trait
aux
Fig.
Lib
ithique de deu
produit une
s de la Libye
g. 8 - Aïn Af
ntal (Néolith
ts noirs corr
x cultures co
- données
9 -Aïn Afia
bye. L’aire e
L
- données
ux Rammadiya
industrie de
e.
fia 2 : Comp
hique de Tra
respond aux
onsidérées. L
s Gabriel Ca
2 : Compar
entre les deu
d’outils de
Le trait roug
s Gabriel Ca
7 - Coche
a d’Aïn Afia
tradition cap
paraison du
adition Cap
x valeurs mo
Le trait rou
amps (1974)
raison du sto
ux traits noi
es séries app
e rend comp
amps (1974)
es & Dent
psienne très
stock indus
psienne de l’A
oyennes des
uge rend com
) rectifiées p
ock industri
irs correspo
artenant au
pte des valeu
) rectifiées p
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1 - Grattoir
6 - Lamelles à
proche cultu
triel d’Aïn A
Algérie orie
groupes d’o
mpte des val
par Robert C
el d’Aïn Afi
ond aux vale
ux cultures c
urs propres
par Robert C
rs
dos
NTC Dz Orie
urellement d
Afia avec ce
entale). L’air
outils des sér
leurs propre
Chenorkian
ia avec celui
eurs moyenn
considérées.
au site étud
Chenorkian
3 - Burins
e ntal
de celles de
elui du NTC
re entre les
ries apparte
es au site étu
n (1996) - .
i du NTC de
nes des grou
dié
n (1996) - .
27
es gisements
DZ
deux
enant
udié
e type
pes
7
s
28 Kairouan et sa Région : Nouvelles Recherches d’Archéologie et de Patrimoine
Conclusion
Dans l’ensemble, l’examen du matériel lithique a permis d’avancer certaines observations et constatations d’ordres techniques et culturels. Pour la première station, la faiblesse numérique du matériel rend toute attribution culturelle très difficile. L’analyse comparative de la structure du stock lithique rapporte les restes industriels de la deuxième station au Néolithique de Tradition capsienne tout particulièrement celui de la Libye. Mais, ce qui manque dans ce matériel ce sont les pièces typiquement néolithiques, excepté une seule ébauche de pointe de flèche. Il est possible que cette absence soit liée à la qualité du ramassage ou à une perturbation des dépôts liée au phénomène d’érosion. En effet, la provenance de ce matériel d’un ramassage de surface, c'est-à-dire de la partie du site la plus remaniée et la plus exposée aux destructions naturelles et anthropiques, pose un problème de représentativité et d’interprétation. Donc, les conclusions ne sont que préliminaires et les hypothèses ne peuvent être que relatives dans l’attente d’une étude plus approfondie et plus fine basée sur les résultats d’une fouille pluridisciplinaire.
Références bibliographiques
- Camps (G.), Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du Nord, Paris, éd. Doin, 1974, pp. 210.
- Chenorkian (R.), Pratique archéologique : Statistique et graphique, Paris, Errance, 1996, pp.162.
- Tixier (J.), Typologie de l’Epipaléolithique du Maghreb, Paris, éd. Arts et Métiers Graphiques, 1963, 212 p. (Mémoire du Centre de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographique ; 2).