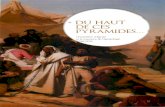« Forme et méthode du commentaire d’Héracléon sur Jean », Adamantius 15, 2009, p. 150-176.
CATTELAIN P., BELLIER C. - 2002. La Chasse dans la Préhistoire. Guides archéologiques du...
Transcript of CATTELAIN P., BELLIER C. - 2002. La Chasse dans la Préhistoire. Guides archéologiques du...
1
Éditions du CEDARC, 28 rue de la Gare, B-5670 Treignes, Belgique2002
La Chasse dans la Préhistoiredu Paléolithique au Néolithique
en Europe... et ailleurs
Pierre Cattelain - Claire Bellier
GUIDES ARCHÉOLOGIQUES DU MALGRÉ-TOUT
Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée
3
"Tant que nous ne serons pas fixéssur ce que nous sommes, et non sur ce quenous croyons être, alors les origines del’homme continueront à osciller comme lependule de Foucault qui, à force de balan-cement, finit par détruire tous les fragilesremparts de nos certitudes."
Pascal Picq, 2001
4
ISBN 2-87149-042-2
Dépôt légal : D/2002/4357/1
© CEDARC 2002
Ouvrage édité par le CEDARC avec l’aide du Ministère de laCommunauté Française, Direction générale de la Culture, Service géné-ral du Patrimoine et Service de la Recherche Scientifique, du Ministèrede la Région Wallonne, Division du Patrimoine et de la Maison des Jeu-nes de Viroinval. Il a été réalisé dans le cadre des programmes PRIMEn°31207 et 30336 accordés par la Région Wallonne.
Le présent ouvrage constitue une nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de celui publié à l'occasiondu Colloque international et de l'exposition "La Chasse dans la Préhistoire", organisés à Treignes en 1990.Il accompagne une nouvelle présentation de cette exposition, mise à jour, proposée au public du 27 janvierau 20 mai 2002.
L’exposition "La Chasse dans la Préhistoire" a été conçue et réalisée par le Centre d’Études et deDocumentation Archéologiques (CEDARC) / Musée du Malgré-Tout.
Commissaires de l’exposition : Claire Bellier, Pierre Cattelain
Cette exposition a été mise sur pied grâce à l’aimable collaboration de l'Institut Royal des Sciences Naturellesde Belgique (Mmes Laurence Cammaert et Anne Hauzeur, MM. Ivan Jadin et Patrick Semal), que noustenons à remercier chaleureusement, ainsi que Messieurs Jean-Marie Brams, Philippe Dumont, ClaudeRobert, Michel Jorand, Wladimir Lozovski, Achilles Trotin et Philippe Vogrig, qui ont mis en dépôt ou offertune partie de leurs collections au Musée.
Les moulages qui complètent la collection de pièces originales provenant du fonds du Malgré-Tout (MMT)et de l'IRSNB ont été gracieusement déposés au Musée du Malgré-Tout par :
- Le Centre de Documentation Alpine de Grenoble (France)- Le Dépôt de Fouilles Préhistoriques de Carcassonne (France)- La Direction des Antiquités Préhistoriques d'Aquitaine (France)- L'Institut archéologique de Cracovie (Pologne)- L'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles - (IRSNB)- Le National Museet, Copenhague (Danemark)- Le Natural History Museum, Londres (Grande-Bretagne)- Le Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (Allemagne) - (N.L. Hannover)- Le Moravske Museum, Brno (République Tchèque)- Le Musée de l'Homme, Paris (France)- Le Musée de Pincevent (France)- Le Musée de Préhistoire de l'Université de Liège (Belgique) - (ULg)- Le Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye (France) - (MAN)- Les Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles (Belgique) - (MRAH)- Le Museu de Preistoria de Valencià (Espagne)- Le Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, Weimar (Allemagne)- Le Service Archéologique Cantonal, Fribourg (Suisse) - (SACF)
Maquettes de l’exposition : Jean-Louis Delsipée
Réalisation technique :Claire Bellier, Pierre Cattelain, Saskia Bott, Christine Broodhaers, Bernadette Carlier, Dany Colin, GéraldineDubois, Claudy Dursin, Alain Sellekaerts, Sonja Souvenir et Pascal Wauthier
Dessin de l’affiche de l’exposition et de la couverture du catalogue : Benoît Clarys
Catalogue : Maquette et mise en page de Claire Bellier, Bernadette Carlier et Pierre Cattelain. Sauf men-tion contraire, les photographies ont été réalisées par Pierre Cattelain, les dessins par Claire Bellier.
Traduction de la version néerlandaise : Saskia Bott
5
Introduction
Depuis ses origines, l’Homme témoi-gne, notamment par les caractéristiques deson appareil masticateur, d’un régime ali-mentaire omnivore, dans lequel la consom-mation de viande tient une place plus oumoins importante. Nous en avons pourpreuve les ossements d’animaux retrouvésdans les campements préhistoriques, quimontrent des traces de dépeçage (dé-coupe de l’animal), de décarnisation (pré-lèvement de la viande) et de fracturationintentionnelle (consommation de lamoelle). Il n’est pas toujours facile de dé-terminer, en l’absence d’autres élémentstels qu’un assemblage sélectif d’animaux,des traces d’écorchement ou encore desarmes de chasse bien identifiables, si laviande consommée provient d’une activitéde charognage ou d’une chasse, les deuxpouvant coexister. Par ailleurs, la part vé-gétale de l’alimentation, qui ne laisse guèrede trace pour le Paléolithique, est loind’être à sous-estimer. Quoi qu’il en soit,des preuves de pratiques de chasse appa-raissent dès le Paléolithique inférieur, chezHomo ergaster et chez ses successeurs,Homo rhodesiensis en Afrique, Homoerectus en Asie, et Homo heidelbergensisen Europe.
Pour la quasi-totalité de la Préhis-toire, nos connaissances se limitent néan-moins, dans le meilleur des cas, au choixdu gibier (espèce, âge, sexe), aux pério-des de chasse, à la finalité de la chasse (ac-quisition de viande, peau, fourrure, ramu-res, ...) et aux armes en pierre et en ma-tière dure animale (os, bois de cervidés,ivoire) utilisées.
En effet, les stratégies de chasse uti-
lisées ne nous laissent que très rarementdes traces interprétables, et nous sont es-sentiellement connues par l’étude des peu-ples chasseurs des XIXe et XXe siècles. Demême, l’équipement en matériaux péris-sables (bois, corne, plumes, ligatures, col-les...) est presque toujours inconnu, saufpour des périodes relativement récentestelles le Mésolithique scandinave et le Néo-lithique alpin, où des conditions de con-servation très particulières (tourbières, mi-lieux lacustres) ont permis sa conservation.
L’étude ethnographique des peuplesvivant, soit dans un passé récent, soit ac-tuellement, de la chasse, de la pêche et dela cueillette, nous fournit de nombreux élé-ments qui peuvent nous aider à reconsti-tuer les morceaux manquants de ce puzzle.Toutes les communautés de chasseurs-cueilleurs ont en commun leur mode derelation avec l’environnement basé sur laprédation et non sur la production de res-sources alimentaires. Celles-ci sont géné-ralement consommées rapidement et plusrarement stockées pour une utilisation ul-térieure. On peut distinguer cinq grandesstratégies de chasse, qui coexistent fré-quemment et peuvent se combiner :
- la poursuite, qui consiste à forcerla proie à la course, seul ou en groupe ;
- l’approche, le plus souvent indivi-duelle et qui nécessite des techniques decamouflage, ainsi qu’une excellente con-naissance du milieu et du comportementdu gibier ;
- l’affût, qui consiste à attendre legibier près d’un point d’eau ou de passage,et qui peut faire usage de leurres. Cettetechnique, comme la précédente, fait sou-vent appel au camouflage ;
6
- le rabattage, chasse collective, aucours de laquelle on exploite généralementles particularités du terrain (pièges et obs-tacles naturels) ;
- le piégeage, individuel ou engroupe, qui peut combiner des techniquesde poursuite et de rabattage, et faire ap-pel à des moyens très variés, du plus sim-ple (collet) au plus compliqué (longs cou-loirs bordés de branchages et d’épineuxconstruits, entre autres, par les Aborigè-nes australiens).
Ces diverses techniques impliquentdans tous les cas une connaissance appro-fondie du terrain, du comportement, del’anatomie ainsi que des rythmes saison-niers du gibier et nécessitent souvent uneorganisation collective.
La plupart des groupes de chasseurs-cueilleurs circulent dans un territoire assezvaste et se rendent d’un point à l’autre se-lon l’abondance locale et saisonnière desressources. L’équipement et les abris sontde ce fait généralement faciles à transpor-ter ou à fabriquer sur place au moment
même. En principe, tous les membres dela communauté doivent prendre part quo-tidiennement aux tâches assurant le bien-être du groupe, ce qui explique une cer-taine division du travail en fonction de lamobilité des individus. Les enfants, lesvieillards et les jeunes mères se chargenten général de la cueillette ou de la chasseau petit gibier à proximité du campement,tandis que les autres s’éloignent plus pourla chasse (hommes) ou la cueillette à lon-gue distance (femmes). Lors des grandesbattues, tous les membres du groupe sontgénéralement sollicités.
Ces quelques généralités peuventsans doute s’appliquer, à des degrés di-vers selon le lieu ou l’époque, aux popula-tions préhistoriques. À côté de ces analo-gies ethnographiques, à manipuler toujoursavec prudence, de nouvelles approchesarchéozoologiques, l’étude des tracesd’utilisation présentes sur l’équipement etles reconstitutions expérimentales appor-tent progressivement de nouveaux élé-ments de connaissance sur la chasse pré-historique.
7
Les recherches paléoanthropolo-giques des années 1990 ont révélé de nom-breux nouveaux fossiles qui complètent etcomplexifient la vision que l’on peut avoirde nos origines. Le plus ancien hominidébipède actuellement découvert, Orrorintugenensis, mis au jour au Kenya en 2000,remonte à 6 millions d’années : il est en-core mal connu.
Le groupe des australopithèques sedéveloppe en Afrique entre -4,2 et -2,5 MA(millions d’années) : il s’agit égalementd’hominidés plus ou moins bien adaptés àla bipédie, mais encore partiellement ar-boricoles. Ce groupe comprend au moinscinq espèces, au sein desquelles se trou-vent des ancêtres possibles du genreHomo. Les australopithèques vivent dansl’environnement relativement diversifié dela savane arborée humide, aux marges dela grande forêt tropicale.
L’étude de leurs mâchoires et denti-tions montre qu’ils se caractérisent par unrégime alimentaire essentiellement d’ori-gine végétale, orienté d’une part vers lesfruits et les feuilles (de consistance géné-ralement tendre), d’autre part vers les par-ties enterrées des plantes (de consistanceplus coriace) : racines, rhizomes, tubercu-les, oignons et bulbes. Comme les ba-bouins et les chimpanzés actuels, les aus-tralopithèques consommaient probable-ment des insectes et, occasionnellement,de la viande (chez les babouins et chim-panzés, cette consommation n’atteint ja-mais 5 %). En effet, les restes de l’un d’en-
Aux origines de l’humanité :les premiers hominidés,
plus charognards que chasseurs
tre eux, Australopithecus garhi, daté de 2,6MA, semblent associés à des éclats tran-chants en silex et à des ossements d’anti-lopes et de chevaux qui montrent des tra-ces de décarnisation, des écrasements etfractures liés à l’extraction de la moelle, cequi témoigne d’un régime déjà en partieomnivore, suggéré également par certainsaspects de leur dentition.
Si l’on ne peut exclure, dès cetteépoque, la chasse directe de petits ani-maux, il est plus que probable que les res-tes de mammifères de taille moyenne ougrande qui interviennent dans l’alimenta-tion proviennent d’une activité decharognage : prélèvement de viande et demoelle sur des animaux morts naturelle-ment ou victimes des fauves.
Entre -3 et -2,5 MA, un bouleverse-ment climatique mondial provoque unelongue sécheresse dans une grande partiede l’Afrique. Cette modification écologi-que correspond à l’émergence de nouvel-les séries d’hominidés : les paranthropeset les premiers représentants du genreHomo.
Homo habilis se distingue des aus-tralopithèques par un cerveau plus grandet plus complexe, et une réduction de lataille de l’appareil masticateur : en revan-che, sa bipédie n’est encore que moyenne,et il est toujours partiellement arboricole.Homo rudolfensis, par contre, est plus cor-pulent, meilleur bipède, semble affranchidu milieu arboricole et possède un cerveau
8
Fig. 1 Chronologie des différentes espèces d'hominidésA. : Australopithecus ; P. : Paranthropus ; H. : Homo
9
légèrement plus grand mais une dentitionrobuste qui reste proche de celle des aus-tralopithèques.
Contemporains de ces premiershommes, les paranthropes (anciennementappelés australopithèques robustes), àpeine plus grands, possèdent une face etdes dents d’une taille impressionnante. Ilssont moins arboricoles et meilleurs bipè-des que les australopithèques.
Vivant au sein d’une savane plusouverte et plus sèche, premiers hommes etparanthropes, très bien adaptés à leur envi-ronnement, consommaient des alimentscoriaces provenant essentiellement des par-ties souterraines des plantes. Les pa-ranthropes de Swartkrans (Afrique du Sud)sont d’ailleurs associés à des fragments debâtons à fouir en os. Bien que particulière-ment adaptés à des aliments végétaux trèscoriaces (racines, noix…), les paranthropes,comme les premiers hommes, témoignentd’un régime alimentaire omnivore.
Dès cette époque, de nombreux si-tes montrent en effet des accumulationsd’os de petits et grands animaux, fractu-
rés intentionnellement, parfois étroitementassociés à des outils sur galets (silex, quartz,basalte), fabriqués dans de véritables ate-liers de taille, comme à Lokalelei (Kenya).L’outillage comporte des éclats tranchants,des choppers et des boules polyédriques.Aucun de ces outils ne suggère l’existenced’armes capables d’abattre de grands her-bivores, mais l’équipement en bois nousfait complètement défaut. En revanche,certains d’entre eux ont servi à la découpede la viande, d’autres à la préparation desvégétaux. Les restes animaux retrouvés(beaucoup de jeunes et d’adultes âgés)semblent encore toujours correspondrepour la plupart à des activités de charo-gnage. Ce charognage était pratiqué sansdoute surtout par Homo habilis, mais éga-lement à des degrés divers par Homorudolfensis et par les paranthropes, et sansdoute principalement pendant la saisonsèche, qui voit mourir naturellement denombreux herbivores. Par ailleurs, on nepeut exclure des pratiques de chasse vi-sant le petit et le moyen gibier, commec’est encore le cas chez les babouins etchimpanzés. Dès cette époque, des pois-sons ont été capturés, peut-être pris aupiège naturel de mares peu profondes.
10
Fig. 21. Éclats retouchés, nucléus et galet aménagé. Olduvai DK 2,1, Tanzanie. D'après M.D. Leakey, 1975
2. Éclat retouché, chopping-tool et biface. La Belle-Roche, Sprimont, Belgique. D'après J.-M. Cordy et al, 19923. Biface acheuléen. Petit-Spiennes, Belgique. Dessin D. Cahen
1
2 3
11
Le Paléolithique inférieur
Il y a environ 1,9 MA, un nouveauvenu apparaît en Afrique de l’Est aux cô-tés des premiers Homo et desparanthropes : Homo ergaster. Il marquele début du Paléolithique inférieur ou an-cien. Homo ergaster se développe plus queprobablement à partir d’Homo habilis oud’Homo rudolfensis et présente un rema-niement physiologique et anatomique con-sidérable. Ces modifications sont sansdoute liées à une augmentation de l’ari-dité de son environnement et des contras-tes saisonniers.
Homme véritable, Homo ergasterpossède un squelette post-crânien trèsproche de celui de l’Homme actuel : il adéfinitivement abandonné la locomotionarboricole et est un parfait bipède. Sonrégime est tout à fait omnivore, incluantune part de viande importante. Par rapportà ses prédécesseurs, il a un cerveau plusgrand, une face et des mâchoires réduites,une dentition très humaine, un torse plusréduit et des jambes très longues. Le di-morphisme sexuel est beaucoup moinsmarqué.
Bien adapté à des milieux ouverts,voire arides, sa mobilité accrue va très vitelui permettre de se disperser hors d’Afri-que. Dès -1,8 MA, il est sans doute déjàprésent en Asie orientale, où il va donnernaissance à Homo erectus, individu plusrobuste qui perdurera jusqu’il y a environ300 000 ans, avant de probablement dis-paraître. Homo ergaster apparaît aux con-fins de l’Europe, en Géorgie, aux environsde -1,7 MA. On le retrouve par la suite dansle reste de l’Europe, sous la forme d’Homoheidelbergensis, qui évolue, entre -500 000
et -200 000 ans, vers Homo neander-thalensis. Jusque vers -500 000 ans, la plu-part des fossiles humains retrouvés en Eu-rope datent de périodes interglaciaires. Àcette époque, la maîtrise du feu n’est en-core que très rarement attestée. En Afri-que même, nous disposons de très peu defossiles humains datant d’entre -1,3 MA et-600 000 ans. Sur ce continent, Homoergaster semble évoluer directement versdes formes qui annoncent Homo sapiens,c’est-à-dire l’Homme moderne. Le crâne deKabwé ou Broken Hill, appelé Homorhodesiensis, daté de -400 000 ans, est undes jalons de cette évolution.
À partir du Paléolithique inférieur, lesrestes de grands mammifères sont souventabondants dans les campements, simplesbivouacs ou véritables camps de base, té-moignant d’une véritable gestion de l’es-pace environnant et de ses ressources, ainsique d’une bonne organisation sociale.Cette faune comprend des carnivores(loup, renard, ours, lynx, panthère, lion...),des herbivores (éléphant, hippopotame,rhinocéros, cheval, cerf, renne, daim,aurochs, boeuf musqué...) ainsi que desrongeurs et des oiseaux. Les ossementsmontrent des traces de décarnisation et ontété brisés pour l’extraction de la moelle.Les restes de poissons, bien que présents,restent relativement rares.
Au début, les très grands mammifè-res ne semblent pas avoir été véritablementchassés. Les restes, souvent incomplets,associés à des outils de boucherie, provien-nent presque toujours de la carcasse d’unseul individu, retrouvé sur une plage oudans un marécage. Après consommation
12
Fig. 31 à 3. Javelots et bâton de jet (?) (épicéa)Schöningen, Allemagne. D'après H. Thieme, 1996-400 0004. Pointe d’épieu (if)Clacton-on-Sea, Grande-Bretagne (Natural History Mu-seum, Londres)Interglaciaire Hoxnien, -350 000/-300 000
1 2 3
4
4
13
des parties les plus fragiles, les Hommesont prélevé de grands quartiers de vian-des qu’ils ont emmenés ailleurs. En Afri-que, à partir de l’Acheuléen, vers -1,4 MA,certains très gros animaux, empêtrés dansdes pièges naturels, semblent avoir étéabattus intentionnellement.
Pour la plus grande partie du Paléo-lithique inférieur, les preuves directes dela pratique de la chasse et de la pêche res-tent quasiment inexistantes. La proportiond’animaux juvéniles et de jeunes adultesest relativement importante et certainesespèces sont particulièrement bien repré-sentées dans les vestiges étudiés, mêmesi la faune est assez variée : cela suggèreune pratique de chasse effective, parallè-lement au charognage, stratégie opportu-niste qui se poursuivra durant toute la Pré-histoire et est encore pratiquée par desgroupes de chasseurs-cueilleurs actuels,comme les San du Kalahari, par exemple.
Dans l’outillage lithique africain, pro-che-oriental et européen, seuls quelquespetits bifaces bien symétriques, minces etpointus, dont la base montre des traces quisuggèrent un emmanchement au boutd’une hampe, semblent avoir pu servir d’ar-mes de chasse. Il faut attendre la dernièrepartie du Paléolithique inférieur pour quequelques éléments en bois, miraculeuse-ment conservés, viennent incontestable-ment témoigner de l’existence d’armes de
chasse. Il s’agit notamment de trois jave-lots entiers en bois d’épicéa, vieux de 400000 ans, découverts en 1995 dans une mineà ciel ouvert à Schöningen, près deHannovre, dans le nord de l’Allemagne.Dégagés au milieu d’un ensemble de silextaillés et d’ossements de chevaux, ces ja-velots fusiformes, longs de 1,82 à 2,30 m,équilibrés aux 2/3 de leur longueur, sontde véritables projectiles. Ils montrent queles Hommes qui les ont confectionnés pos-sédaient déjà d’excellentes connaissancestechniques et balistiques. Ces trois jave-lots étaient accompagnés d’un bâtonbipointe, long de 78 cm dont la fonctionest moins claire : épieu court ou bâton dejet ? L’épieu en if de Clacton-on-Sea (G-B)n’a conservé que sa pointe. Celle-ci, tailléeau silex dans du bois de cœur frais, nemontre aucune trace de durcissement parle feu. Très aiguë, elle présente un aspectpoli relativement soigné. L’outillage et lafaune associés à cet objet permettent dele situer dans l’interglaciaire Hoxnien (-350000/-300 000 ans). Le site de Kalambo Falls,au Kenya, daté d’entre -300 000 et -200000 ans, a livré quant à lui plusieurs grandsépieux en bois. D’autres fragments ont étéretrouvés à Stuttgart-Bad Cannstatt,Bilzingsleben (Allemagne) et Torralba (Es-pagne). Quelques rares fragments osseuxdu Paléolithique inférieur montrent desstigmates qui pourraient également corres-pondre à des coups d’épieux, comme àLunel-Viel (France), par exemple.
14
Fig. 41. Épieu (if); 1'. Détail de la pointe; 1". Détail du talonLehringen, Allemagne (N.L. Hannover)Interglaciaire Eémien, -125 0002. Épieu ou sagaie pour le lancer à la main (bois)Australie (Musée Royal d'Afrique Centrale, Tervuren)XIXe siècle3. Pointes barbelées (os)Katanda, République Démocratique du Congo-90 000 ? D'après J. E. Yellen, 1998
1
1' 1"
2
3
15
Le Paléolithique moyen
Il y a environ 500 000 ans, le rythmed’alternance des phases glaciaires et inter-glaciaires s’intensifie, avec des amplitudesparticulièrement marquées : des périodesrelativement chaudes succèdent ainsi ré-gulièrement à des périodes de froid trèssévère. Ces interglaciaires tempéréschauds ont sans doute favorisé la coloni-sation par l’Homme des latitudes moyen-nes de l’Eurasie. La maîtrise du feu lui asans doute permis d’y rester lors du retourdes grands froids.
Le Paléolithique moyen (-300 000/-40 000) voit l’émergence, en Afrique et enAsie, d’Homo sapiens, probablement àpartir d’une seule souche africaine. En Eu-rope, Homo heidelbergensis évolue versHomo neanderthalensis, individu robusteparticulièrement bien adapté au climat gla-ciaire, qui sera définitivement supplantépar Homo sapiens, il y a un peu plus de 30000 ans. Homo neanderthalensis et uneforme archaïque d’Homo sapiens (Proto-Cro-Magnon) coexistent déjà au Proche-Orient il y a environ 100 000 ans. Dans l’étatactuel de nos connaissances, leur culturematérielle, le Moustérien, est quasimentidentique. En l’absence de fossiles hu-mains, il n’est guère possible d’attribuerprécisément les vestiges retrouvés à l’uneou l’autre de ces espèces.
L’étude des vestiges fauniques aban-donnés dans les sites d’abattage, haltes dechasse et habitats de cette période mon-tre la prédominance de certaines espèces,alors que, dans la phase précédente, legibier était généralement plus varié et laproportion des diverses espèces plus ho-mogène. La chasse devient donc, dans cer-
tains cas du moins, plus spécialisée et orien-tée vers quelques espèces seulement, se-lon les régions : le cheval, le bouquetin, lechamois, l’aurochs, le dromadaire... En cequi concerne les très grands mammifères(éléphants, rhinocéros), les jeunes sontencore toujours particulièrement nom-breux (leur proportion relative peut attein-dre 70%). De nombreux sites témoignentd’une activité saisonnière, comme, parexemple, la chasse aux bouquetins de jan-vier à mai, et la chasse aux chevaux pen-dant l’été. Dans ce cas, les autres animauxne sont chassés qu’occasionnellement.
Les pratiques de pêche et de con-sommation du poisson deviennent claire-ment attestées : divers gisements, notam-ment en France et en Espagne, livrent desrestes de poissons qui, sans être très abon-dants, sont suffisamment nombreux pourtémoigner d’une pêche en eau douce etsur le littoral marin. À Saint-Germain-les-Vaux (France), quelques vertèbres brûléesdécouvertes dans un foyer moustérienprouvent la cuisson de poissons et, dans legisement de Cingle-Vermel (Espagne), plu-sieurs outils en silex portent desmicrotraces dues à l’écaillage des poissons.À Katanda (R.D. Congo) de grandes poin-tes en os larges et épaisses, à barbeluresunilatérales, associées à de très nombreuxrestes de poissons (essentiellement dupoisson-chat), pourraient remonter à -90000 ans… (les multiples méthodes de da-tations utilisées pour dater ce site sont ce-pendant encore expérimentales). Les ba-ses de certaines de ces pointes montrentdes encoches bilatérales qui suggèrent unefixation ferme à la hampe. D’autres mon-trent des bourrelets circulaires permettant
16
la fixation d’une ligne : il s’agirait là de poin-tes de harpons. D'autres armatures en os,non barbelées, datées de -70 000 ans, ontété mises au jour à Blombos Cave, en Afri-que du Sud.
L’épieu en bois est sans doute unedes armes les plus communes. D’aprèsl’outillage en pierre retrouvé et les analy-ses tracéologiques, l’équipement en boisétait probablement très important, bienqu’il ait presque complètement disparu.L’épieu le mieux conservé provient deLehringen (Allemagne). Daté de -125 000ans, il a été retrouvé complet, cassé en 11morceaux, entre les côtes d’un éléphantantique, près des rives d’un ancien lac. Ilétait accompagné d’un outillage en silexqui a probablement servi au dépeçage.L’épieu, long de 2,38 m, a été façonné surun tronc d’if assez fin, qui a été soigneuse-ment raclé sur toute sa surface, notammentpour enlever les nœuds. La pointe est vo-lontairement asymétrique de manière àêtre taillée tout près du cœur, plus résis-tant. Elle est particulièrement bien polie,et a été durcie au feu. La base, moins soi-gnée, montre des traces d’abrasion quiproviennent peut-être de l’utilisation decette partie comme bâton à fouir. Le cen-tre de gravité de l’objet, décalé vers sabase, semble exclure son utilisation commeprojectile, il devait être utilisé d’estoc.Lehringen pourrait suggérer une tactiquede chasse recherchant la proximité depoints d’eau et des milieux boueux, han-dicapant le gibier, comme cela semble déjàavoir été le cas dans plusieurs sites du Pa-léolithique inférieur. La position de l’épieudans le corps de l’éléphant semble indi-quer qu’il a été blessé avant de s’abattredans le lac. Dans d’autres sites, la poursuitedu charognage, notamment pour les trèsgrands mammifères, est vraisemblable.
Un certain nombre de pièces lithi-ques appointées (petits bifaces, pointes
Levallois, moustériennes, foliacées, etmême certains racloirs convergents) pré-sentent des parentés morphologiquesétroites avec des armatures de lances etde sagaies connues par l’ethnographie.Cette interprétation ne fait cependant pasl’unanimité des chercheurs : certains d’en-tre eux considèrent une partie de ces poin-tes comme trop épaisses pour pouvoir êtreemmanchées sur une hampe, ou trop peuperforantes, ce qui est totalement en con-tradiction avec nombre d’exemples ethno-graphiques. En réalité, seule l’étude desfractures et des microtraces d’usure duesà l’utilisation peut apporter des élémentsde réponses fiables à ce problème. Ce typede recherche nécessite cependant la fabri-cation d’un grand nombre de copies, ainsique la mise sur pied d’expérimentationsmultiples : coups portés à la main (lances),tirs à distances variées, avec des hampestout aussi variées (projectiles) et sur diffé-rents types de gibier... Tout cela fait queces expérimentations n’ont pas encore ététrès nombreuses, et qu’il est dangereuxd’extrapoler leurs résultats.
Ainsi, l’étude effectuée sur le maté-riel lithique du site moustérien de Kebara(Israël, -60 000/-50 000) montre qu’envi-ron 7% des objets portant des traces d’uti-lisation possèdent des stigmates caracté-ristiques des armatures de projectiles : ils’agit de traces d’impact localisées vers lapointe, qui se présentent sous la forme defractures scalariformes (en escalier) plus oumoins rebroussées et envahissantes. Cer-taines de ces fractures sont très sembla-bles à des coups de burin. Ces objets sontpour la plupart des pointes Levallois, despointes moustériennes et des éclats trian-gulaires non retouchés. Plusieurs d’entreeux montrent en outre des stigmates ca-ractéristiques de leur emmanchement àl’extrémité d’une hampe. Des traces sem-blables ont été observées sur le matérielmoustérien de deux autres sites israéliens :
17
Hayonim et Qafzeh. Par ailleurs, d’autresobjets du même type montrent des tracesrésultant de l’utilisation pour la boucherie,le travail du bois et de l’os.
Une des couches moustériennes dugisement d’Umm el Tlel (Syrie) a livré unfragment de pointe Levallois fiché dans unevertèbre d’âne. Quelques exemplaires dela même couche montrent des aménage-ments qui suggèrent l’emmanchement aubout d’une hampe, associés à des fractu-res qui pourraient résulter d’un impact. Iciaussi, d’autres pointes Levallois montrentdes traces d’emmanchement et d’utilisa-tion liées à d’autres tâches, comme la bou-cherie par exemple.
En revanche, l’étude du matérielmoustérien de Warwasi et Bisitun (Iran)donne un résultat inverse. L’analyse desfractures observées sur les pointes mous-tériennes, comparées à celles présentes surdes pointes de projectiles paléoindiennes,semble réfuter l’utilisation des premièrescomme armatures.
Les pointes pédonculées del’Atérien, en Afrique du Nord montrentégalement une morphologie, des tracesd’usure et des fractures qui prouvent l’uti-lisation de nombre d’entre elles commepointes de projectile.
Plusieurs sites du Paléolithiquemoyen ont également livré des boules depierre de diamètre variable, façonnées parpiquetage, qui ont peut-être servi commeéléments de bolas, arme de jet composéede boules réunies par des cordelettes, quel’on lance dans les pattes du gibier pourl’entraver. Les plus petites ont aussi pu ser-vir de pierres de fronde. Ce genre d’arme,réalisé en matériaux périssables, ne laissemalheureusement aucune trace.
Fig. 51. Sagaie (bambou, silex, cordelette, résine)Australie du Nord (IRSNB)XIXe siècle2. Sagaie (bois, obsidienne, résine, pigments)Iles de l’Amirauté, Océanie (Musée Royald'Afrique Centrale, Tervuren)XIXe siècle 1
2
19
Fig. 61, 2. Bifaces cordiformes (silex)Pièces taillées sur les deux faces, de forme régulière, àbase large et extrémité pointueSolesmes, France (Coll. et dessins B. Clarys)Moustérien3, 4. Pointes Levallois retouchées (silex)Éclats triangulaires obtenus d’un seul coup sur un nucléusspécialement préparé dans ce but. Elles sont régulariséespar des retouches sur les bordsSolesmes, France (Coll. et dessins B. Clarys)Moustérien5 à 9. Pointes moustériennes (silex)Pièces triangulaires, parfois losangiques à pointe mince etaiguë, obtenues par retouches importantes à partir d’unéclat quelconque5, 6. Solesmes, France (Coll. et dessins B. Clarys) - 7, 8.Busigny, France (Coll. M. Jorand, dessins J.-M. Brams) - 9.Spy, Belgique (IRSNB, dessin J.-M. Brams)Moustérien
2
5Fig. 71. Pointes foliacées bifaces (silex)Couvin, Belgique (MMT, dessins M. Otte).Moustérien final2 à 5. Pointes atériennes (silex)Pointes Levallois, pointes moustériennes, ou pointesbifaciales, toutes pédonculées2. Beni-Abbès, Algérie - 3 et 5. Oued Djebanna, Algérie -4. Tit Mellil, Maroc. D'après Bordes, 1988Moustérien final d'Afrique du Nord
1
2
3
4
20
Fig. 81 à 3. Boules de pierreRégularisées par piquetage, généralement interprétéescomme éléments de bolas ou comme pierres de fronde,selon la taille1. Goyet, Belgique (IRSNB) - 2, 3. Spy, Belgique (IRSNB)Moustérien4. Fronde (fibres végétales peintes)Nouvelle-Bretagne, Océanie (MMT)XIXe siècle
5. Bolas (pierre, scrotum de veau, cordelettes)Arme de jet, composée de boules réunies par des corde-lettes, qui est lancée sur le gibier pour l’entraverBrésil (Coll. M. Godoy)XXe siècle
1 2
5
3
4
5
21
Le Paléolithique supérieur,le Mésolithique, le Néolithique
L’avènement du Paléolithique supé-rieur, qui marque l’émergence de l’hommemoderne aux alentours de 40 000 ans avantnotre ère et la colonisation progressive del’ensemble de la planète, voit la diversifi-cation progressive de l’équipement duchasseur : armatures de sagaies et de flè-ches en silex, os, bois de cervidé et ivoire,propulseurs, arcs, foënes, harpons, boome-rangs... Les reconstitutions expérimentaleset l’étude des traces d’utilisation, complé-tées par la comparaison ethnographique,permettent souvent une interprétation fia-ble de leur fonction. La présence de rainu-res sur des pointes de sagaies en bois derenne a parfois suggéré l’utilisation de poi-sons. Pour être efficaces, ceux-ci doiventagir rapidement et rester inoffensifs lors dela consommation de la viande. En Europe,ce type de produit semble rare, bien quecertaines sécrétions végétales (aconide) etanimales (batraciens) aient pu être utilisées.
La diversification des armes dechasse va de pair avec une spécialisationde plus en plus poussée de la chasse. EnEurope occidentale, pendant les phases lesplus froides, le renne occupe une placeprépondérante : au Magdalénien (-17 500/-10 000), il représente parfois jusqu’à 90%du tableau de chasse. Le renne est une vé-ritable provende : viande et moelle pourl’alimentation, bois et os pour la confec-tion des outils, des armes et des supportsd’œuvres d’art, dents pour les parures,peau et fourrure pour les vêtements et lestentes, tendons pour les ligatures, graissepour les lampes… Durant les phasesinterstadiaires de la dernière glaciation,plus tempérées, le cheval ou l’aurochs ontparfois tendance à remplacer le renne. La
chasse spécialisée peut aussi s’orienter versd’autres espèces telles les bouquetins dansles régions montagneuses, ou certains car-nivores, surtout recherchés pour leur four-rure. En Europe centrale et orientale, l’es-pèce chassée dominante est le mammouth,recherché pour sa viande, mais égalementpour l’ivoire (armes, outils, œuvres d’art),les os (armes, outils, combustible, matériaude construction pour les abris), la graisse,la peau, la toison… Néanmoins, une partconsidérable des ossements de mam-mouths utilisés dans la construction de ceshabitations provient du ramassage de par-ties de squelettes d’animaux morts natu-rellement. La chasse au mammouth étaitégalement pratiquée en Amérique duNord, dans les plaines du Centre et del’Ouest, pendant la phase Llano duPaléoindien (-12 000/-11 000), caractériséepar les pointes de Clovis ; dans les régionscontiguës, on chassait mastodontes, cari-bous, camélidés, chevaux sauvages et an-tilopes, sans oublier le petit gibier. Dansles régions plus chaudes, le gibier est biensûr différent : cerfs et sangliers en Espa-gne, antilopes en Afrique du Nord, émeuset kangourous en Australie…
Parallèlement à la chasse, la pêche,déjà bien présente au Paléolithique moyen,est attestée tout au long de Paléolithiquesupérieur, tout en semblant ne constituerqu’une activité d’appoint. Jusqu’à ladeuxième moitié du Magdalénien, le ma-tériel clairement associé à la pêche est trèsrare : un hameçon courbe, en os, daté de -25 000, découvert dans un niveau gravet-tien de Predmost (République Tchèque), etles pointes barbelées d’Ishango (R.D.Congo), datées de -21 000 ans. En Europe
22
occidentale, à partir de -12 500, les restesde poissons deviennent plus nombreux,ainsi que les pointes barbelées associéesau milieu aquatique. Les hameçons restentrelativement rares.
À côté des camps de base, qui cor-respondent à des habitats de moyenne oulongue durée, on connaît pour le Paléoli-thique supérieur toute une série de haltesde chasse qui témoignent d’activités sai-sonnières liées au comportement du gi-bier : certains de ces campements, parexemple, sont établis sur les bords de ri-vière, à proximité de gués, passages obli-gés des grands troupeaux lors des migra-tions. Toutes les techniques de chassementionnées dans l’introduction semblentavoir été mises en pratique. Dès -14 000,en différents points d’Eurasie, le loup estdomestiqué. Le chien ainsi créé a sansdoute servi, dès cette époque, de parte-naire de chasse. Un peu plus tard, à la findu Paléolithique supérieur, des os frontauxde crânes de cervidés, encore munis deleurs bois, ont peut-être servi de masquesde camouflage, permettant une meilleureapproche.
À la fin de la dernière glaciation, il y aenviron 10 000 ans, des modifications pro-gressives se font jour dans l’environnement :la toundra et la steppe régressent au profitde la grande forêt mixte, les grands trou-peaux d’herbivores remontent vers le Nordet cèdent la place aux hardes de cerfs et desangliers, au chevreuil et à l’élan. Cette pé-riode, le Mésolithique, voit la généralisationde l’arc, attesté avec certitude grâce auxdécouvertes des tourbières. Les groupeshumains semblent plus réduits et la chasseindividuelle occupe sans doute une placeplus importante qu’auparavant.
Au même moment, les activités depêche en eau douce ou le long des litto-raux marins s’intensifient, ainsi que la col-
lecte des mollusques et crustacés. Il fautcependant tenir compte du fait que, suiteà la remontée du niveau marin ayant suivila fin de la dernière glaciation, la plupartdes sites littoraux paléolithiques sont à pré-sent sous plusieurs mètres d’eau. Certainssites mésolithiques, comme Zamostje enRussie, situé le long d’une rivière, sont devéritables sites de pêche spécialisée, com-prenant hameçons, harpons, pointes bar-belées et nasses. Il en va de même pournombre de sites africains, riches en poin-tes barbelées et en restes de poissons,couvrant le Sahara, le Sahel, la vallée duNil et la région des Grands Lacs, datantd’entre -10 000 et -1 000. C’est égalementdu Mésolithique que datent les plus an-ciens filets et les plus anciennes embarca-tions retrouvées, sous la forme de piroguescreusées dans des troncs d’arbre. D’autresauraient pu posséder une coque en peautendue sur une armature de bois, commele suggèrent quelques découvertes mal-heureusement très fragmentaires. Les ac-tivités de pêche se poursuivent au Néoli-thique, notamment sur le bord des lacs al-pins, où les nasses et les pointes barbe-lées sont bien représentées, mais les ha-meçons rares. En Europe, ces derniers neredeviendront courants qu’à l’Âge duBronze, il y a moins de 4 000 ans.
La domestication de la chèvre, dumouton, du porc et du bœuf (du lama etde l’alpaca en Amérique du Sud), au Néo-lithique, à des époques variables selon lesrégions, réduit le rôle primordial de lachasse dans l’apport de protéines anima-les au sein de l’alimentation. À partir de cemoment, la chasse constitue surtout unappoint, d’autant plus que le développe-ment de l’agriculture accroît considérable-ment la part végétale de l’alimentation. Elleconstituera souvent, bien plus tard, un pri-vilège de classe, sauf, bien sûr, dans lesrégions où les chasseurs-cueilleurs ont sur-vécu jusqu’à nos jours.
23
Les armatures en pierre
Pendant les phases les plus ancien-nes du Paléolithique supérieur, les pointessur support lithique sont relativement peudiversifiées et peu nombreuses. Certainespointes foliacées bifaces ou unifaces, despointes à dos de Châtelperron et des la-mes appointées ont pu servir d’armatures,comme l’attestent nombre d’objets ethno-graphiques morphologiquement très pro-ches, et comme le suggèrent certainesmacrotraces de fracturation. Néanmoins,en l’absence d’analyses approfondies deces objets, la question reste ouverte.
La phase gravettienne (-27 000/-20000) voit la multiplication de pointes dontla morphologie suggère sans guère d’équi-voque l’utilisation comme armatures : poin-tes de la Gravette et microgravettes (poin-tes à dos), pointes pédonculées ou à cran,fléchettes, pointes d’Europe centrale etorientale (notamment les pointes deKostienki), sans compter les lamelles à dosou non, qui ont pu faire partie d’armaturescomposites. Ici, les études tracéologiqueset l’expérimentation, bien qu’encore peunombreuses, éclairent déjà la question. Bonnombre de ces objets montrent des frac-tures de la pointe, sous forme de grandsenlèvements longitudinaux, de coups deburin ou de cassures par flexion qui résul-tent pour la plupart d’impacts violents, etque l’on retrouve notamment sur les poin-tes de flèches néolithiques et ethnographi-ques dont l’utilisation ne fait aucun doute.Les expérimentations récentes montrentaussi que ces stigmates sont en tout pointsemblables à ceux résultant de l’utilisationde ces objets comme pointes de projecti-les. De plus, certains outils pédonculés, telsles grattoirs, pourraient résulter d’un réa-
ménagement d’armatures cassées. Lagrande diversité dans les dimensions deces pointes atteste des types de projecti-les allant de la sagaie à la flèche.
Le Solutréen (-20 000/-17 300) voitle développement des pointes à face plane,puis des feuilles de laurier et des pointes àcran. Les très grandes feuilles de laurier,relativement fragiles, ont peut-être servid’armatures pour des armes d’apparat oude danse, comme on en connaît de nom-breux exemples dans l’ethnographie, sansque l’on puisse écarter, pour l’instant, desutilisations tout à fait différentes (cou-teaux...). Des expérimentations récentes,dans le cadre du projet Combe-Saunière(France), ont montré que les stigmatesobservés sur les reconstitutions de poin-tes à cran utilisées comme armatures deflèche et de sagaie se rapprochaient trèsfort de ceux étudiés sur le matériel archéo-logique, surtout pour les reconstitutions deflèches. D’autre part, plusieurs sites de lapéninsule ibérique ont livré, dans les ni-veaux du Solutréen supérieur (-19 000/-17300), des pointes à pédoncule et aileronsqui offrent des parentés frappantes, tantdu point de vue de la forme que des di-mensions, avec les pointes de flèche duNéolithique et de l’Âge du Bronze.
À partir du Magdalénien (-17 500/-9000), les pièces géométriques de petitetaille se multiplient pour devenir abondan-tes dans les diverses cultures du Paléoli-thique final, et tout à fait dominantes auMésolithique (-8 500/-4 000). Pour ces pé-riodes, la documentation est plus parlante :des lamelles ont été retrouvées enchâsséesdans des pointes en bois de cervidé ou en
24
os, les études tracéologiques ont prouvél’utilisation des pointes à dos comme ar-matures et certaines pointes ont même étéretrouvées encore montées sur leur hampede flèche, notamment à Stellmoor (Allema-gne, -10 000). Certaines de ces pointes ontnéanmoins pu servir de couteau. Une sim-ple lame naturellement appointée peutégalement constituer une armature redou-table, comme en témoigne la vertèbre derenne transpercée par une telle lame, dé-couverte à Monfort (France, Magdaléniensupérieur, -12 600/-10 000).
Par ailleurs, de nouveaux types depointes à dos et des pointes à troncaturese multiplient à la fin du Magdalénien etdans diverses cultures du Paléolithique fi-nal du Nord de l’Europe : pointes à doscourbe (pointes aziliennes et tjongé-riennes), à dos anguleux (pointes cres-welliennes), à cran (pointes hambour-giennes) ou à pédoncule (pointesahrensbourgiennes), pour ne citer quequelques exemples : elles ont pour la plu-
part servi à armer des flèches.
Les quelques données exposées ci-dessus ne concernent que l’Europe. Depuisau moins 15 000 ans, l’Amérique du Nordlivre également de multiples pointes en si-lex, notamment à cannelure centrale, tel-les les pointes de Clovis et de Folsom, té-moignant de l’usage de divers types deprojectiles, lancés à la main ou tirés à l’aidedu propulseur ou de l’arc. Il en va de mêmepour les autres parties du monde : Afrique,Asie et Océanie.
Au Néolithique, dans les diverses ré-gions du monde, la gamme des armaturesen pierre devient incroyablement riche etvariée. Les formes peuvent être trapézoïda-les, triangulaires, foliacées, crantées, pédon-culées, à base étranglée…, les sections pla-tes, biconvexes, convexe-concave, triangu-laires, subcirculaires… et les dimensions trèsvariables. Si les flèches en constituent l’im-mense majorité des supports, lances et sa-gaies sont toujours bien présentes.
Fig. 91 à 6. Pointes pédonculées, dites de la "Font-Robert"(silex)1 à 5. Maisières-Canal, Belgique (IRSNB)6. Laussel, France (IRSNB)1 à 4 : dessins J. de Heinzelin; 5, 6 : M. OtteGravettien7 à 9. Pointes de la "Font-Robert" (silex)Ces pointes présentent divers types de fractures résultantprobablement d’impacts violentsMaisières-Canal, Belgique (IRSNB)7 et 9 : dessins J. de Heinzelin; 8 : M. OtteGravettien10 à 15. Pointes de la Gravette (silex)Pointes à dos rectiligne, façonnées par retouche abruptesur un des bords, et dont les extrémités sont aménagéespar retouches directes ou inverses. Certaines présententune base tronquée10. Spy, Belgique (MRAH) - 11,12. Engis, Belgique (ULg) -13 à 15. Goyet, Belgique (IRSNB). Dessins M. OtteGravettien16, 17. Microgravettes (silex)10. Engis, Belgique (ULg) - 11. Spy, Belgique (IRSNB). Des-sins M. OtteGravettien
26
Fig. 101. Pointe à cran (silex)Laussel, France, d’après G. Camps, 1979Gravettien2. Fléchettes (silex)Pointes foliacées façonnées sur lame, par retouche directeou inverse, courte et semi abrupteLa Gravette, France, dessins F. LacorreGravettien3. Pointe à face plane (silex)Pointe foliacée façonnée par retouche couvrante sur unefaceLaugerie-Haute, France (ULg), dessin J.-M. BramsSolutréen4 à 8. Pointes à cran (silex)4. Hypothèse d’emmanchement, d’après J.-M. Geneste etH. Plisson, 1986 - 5. Laugerie-Haute, France (IRSNB), des-sin J.-M. Brams - 6 à 8. Le Fourneau du Diable, France (6 :d’après D. de Sonneville-Bordes, 1960 - 7, 8 : d’après P.Smith et P. Laurent, 1966)Solutréen moyen et supérieur
Fig. 111. Pointes à cran (silex)Cova del Parpallo, Espagne (Museu de Prehistoria, Valencià)D'après H. Müller-Karpe, 1966Solutréen moyen et supérieur2 à 6. Feuilles de laurier (silex)Pointes foliacées subovulaires ou sublosangiques, façon-nées par retouche couvrante bifaciale totale2. Le Fourneau du Diable, France, d’après D. de Sonneville-Bordes, 1960 - 3 à 5. Laugerie-Haute, France (3 : d’aprèsG. Camps, 1979 - 4 : ULg - 5 : IRSNB, dessins J.-M. Brams)-6. Sainte-Barbe, France (IRSNB, dessin J.-M. Brams)Solutréen moyen et supérieur7. Pointes à pédoncule et ailerons (silex)Cova del Parpallo, Espagne (Museu de Prehistoria, Valencià)D'après A. Leroi-Gourhan et al, 1968 et H. Müller-Karpe, 1966Solutréen moyen et supérieur
12
3
4
5
6
7
8
28
Fig. 121. Pointes de Laugerie-Basse (silex)Pointes ovalaires façonnées par retouche directe ou inverse,semi-abrupteLaugerie-Basse, France. D’après D. de Sonneville-Bordes,1960Magdalénien final, -11 500/-10 0002 à 4. Pointes à dos courbe (silex)Pointes aziliennes ou de Tjonger; l’étude tracéologique decertains de ces objets a prouvé qu’il s’agissait de pointesde projectiles2. Le Mas d’Azil, France (MAN, dessin St-J. Péquart) - 3, 4.Vaucelles, Belgique (MMT)Paléolithique final, -12 500/-10 0005 à 8. Pointes de Creswell (silex)Pointes à dos anguleux5, 6. Presles, Belgique (ULg, d'après M. Dewez, 1987) - 7,8. Vaucelles, Belgique (MMT)Paléolithique final, -12 500/-10 000
Fig. 131. Pointes hambourgiennes (silex)Pointes à cran et troncature obliqueDeimern, Allemagne (N.L. Hannover, dessins S. Veil)Hambourgien, groupe de Teltwisch, -13 000/-11 7502. Pointes pédonculées de type "Havelte" (silex)Dörgener Moor, Allemagne (N.L. Hannover, dessins S. Veil)Hambourgien, groupe de Havelte, -13 000/-11 7503. Pointes à dos (silex)Wehlen, Allemagne (N.L. Hannover, dessins S. Veil)Culture des Federmesser, -11 800/-10 0004. Pointe de Wehlen (silex)Wehlen, Allemagne (N.L. Hannover, dessin S. Veil)Culture des Federmesser, -11 800/-10 0005. Lamelles à dos (silex)Wehlen, Allemagne (N.L. Hannover, dessins S. Veil)Culture des Federmesser, -11 800/-10 0006 à 8. Pointes ahrensbourgiennes (silex)Pointes pédonculées à troncature oblique6, 7. Hypothèses d’emmanchement. D’après A. Fischer,1985 - 8. Deimern, Allemagne (N.L. Hannover, dessins S.Veil)Ahrensbourgien, -11 500/-9 5009. Pointes de Zonhoven (silex)Pointes à cran opposé à une troncature oblique, de formesublosangiqueDeimern, Allemagne (N.L. Hannover, dessins S. Veil)Ahrensbourgien, -11 500/-9 50010. Triangles (silex)Deimern, Allemagne (N.L. Hannover, dessins S. Veil)Ahrensbourgien, -11 500/-9 50011. Vertèbre de renne transpercée par une lame nonretouchée et détail de la lame (os, silex)Montfort, France (Museum d’Histoire Naturelle, Toulouse)Magdalénien supérieur, -12 600/-10 000
1
2
3
4
5
6
7
8
30
Fig. 14Gravure de chasseur armé d'une sagaie empennée. Grotte des Combarelles, France. D'après C. Barrière, 1997
Magdalénien
Fig. 15Peinture de chasseur "renversé" et bison "éventré" (?) par une sagaie ou une lance"Scène du puits", Grotte de Lascaux, France. D'après G. Bataille, 1955. Magdalénien
31
Les armaturesen matière dure animale
Dès le début du Paléolithique supé-rieur (-38 000), l’outillage en matière dureanimale (bois de cervidé, ivoire, os...) con-naît un essor considérable. Au sein de ce-lui-ci, les armatures de lances et de projec-tiles occupent une place particulièrementimportante. Elles sont le plus souvent réa-lisées en bois de renne. Des analyses ap-profondies, complétées par de nombreu-ses expérimentations, ont démontré que cematériau était, à l’époque, si l’on ne tientpas compte des bois végétaux, non retrou-vés, le mieux adapté à cette fonction. Il étaitlargement disponible, plus élastique et plusrésistant à la rupture que l’os, plus facile àtravailler que l’ivoire, et possède une corti-cale (partie dure et résistante) beaucoupplus épaisse que les autres bois de cervi-dés (cerf, élan, chevreuil...). Il est d’ailleurscaractéristique que, lorsque le renne dis-paraît des régions actuellement tempéréesde l’Europe, suite au réchauffement mar-quant la fin de la dernière glaciation (-10000), les armatures en pierre connaissentun développement sans précédent.
Les armatures en matière dure ani-male apparaissent dès le Châtelperronien,culture encore néandertalienne qui marquela transition entre les Paléolithique moyenet supérieur, sous forme de quelques piè-ces biconiques. Pendant l’Aurignacien (-38 000/-27 000), partiellement contempo-rain du Châtelperronnien, et qui l’a peut-être influencé par "contacts de culture", laplupart des pointes ont une forme géné-rale sublosangique ou foliacée : au début,elles présentent le plus souvent une basefendue, qui témoigne d’un type d’em-manchement soit "enveloppant", soit "en-veloppé", puis une base simple, massive.
Si beaucoup de ces objets sont d’assezgrandes dimensions, et suggèrent une fixa-tion à des hampes de lances ou de sagaies,on en connaît de beaucoup plus petits quipourraient, dès cette époque, suggérer deshampes légères du type flèche... La grandevariabilité des dimensions est d’ailleurs uneconstante de la plupart des armatures duPaléolithique supérieur.
L’équipement "osseux" gravettien (-27 000/-20 000) est dominé par les arma-tures bipointes ou à base raccourcie. Lesbipointes se retrouvent durant le Solutréen(-20 000/-17 000) et sont encore nombreu-ses au Magdalénien (-17 500/-10 000). L’in-dustrie magdalénienne est cependant do-minée par les pointes de sagaies à biseausimple ou double dont l’origine remonte àl’Aurignacien.
Les longues pointes de sagaies à bi-seau simple lancéolé et strié sont plutôtcaractéristiques du début du Magdalénienmoyen (-15 500), de même que les poin-tes de Lussac-Angles, plus courtes, rainu-rées et au long biseau non strié. Ces der-nières ont également pu servir, non pasd’armatures au sens strict, mais debarbelures ligaturées sur une pointe enbois ou en matière dure animale, commele suggère l’existence d’objets du mêmetype en Australie aborigène. Les armatu-res à biseau double deviennent fréquen-tes dès la deuxième moitié du Magdalé-nien moyen, et perdurent jusqu’à la fin duMagdalénien supérieur. Elles coexistentavec des armatures bipointes, à base enbiseau simple, à base fourchue ou à baseraccourcie. Quelques pointes à biseau dou-ble de très petites dimensions font penser
32
Fig. 161 à 4. Pointes de sagaie à base fendue (bois de renne)1. La Quina, France (MAN) - 2. Trou al’Wesse, Petit Modave,Belgique (ULg) - 3. Trou du Sureau, Montaigle, Belgique(IRSNB) - 4. Goyet, Belgique (IRSNB) (2 à 4 : dessins M.Otte) - 5. Hypothèses d’emmanchement, d’après J. Hahn,1983. Aurignacien typique
Fig. 171 à 6. Pointes de sagaie à base simple (1 à 4 : bois derenne; 5 : ivoire de mammouth)1. Marches-les-Dames, Belgique (MRAH) - 2, 3. La Ferras-sie, France (MAN, d'après H. Camps-Fabrer (dir.), 1988) -4. Goyet, Belgique (IRSNB) - 5. Fond-de-Forêt, Belgique(ULg) - 6. Hypothèse d’emmanchement, d’après J. Hahn,1983. Aurignacien7. Pointe de javelot (ivoire de mammouth)Dolni Vestonice, Rép. Tchèque (Moravské Museum, Brno)Gravettien8. Pointe de sagaie d’Isturitz (bois de renne)Armature large, appointée aux deux extrémités, dont l'uneest incisée de fines stries groupées, disposées transversa-lement à l'axe du fûtIsturitz, France (MAN). Gravettien9 à 14. Pointes de sagaie à base raccourcie (9 : ivoire demammouth; 10 à 14 : bois de renne)9. Maisières-Canal, Belgique (IRSNB) - 10 à 12. TrouMagrite, Belgique (IRSNB) (9 à 11 : dessins M. Otte). Gra-vettien13. Le Placard, France (ULg) - 14. Trou de Chaleux, Belgi-que (IRSNB). Magdalénien15. Sagaie (bois de renne, cuir)Netsilik, Penny Bay, Canada arctique (Musée Royal d'Afri-que Centrale, Tervuren). XIXe siècle
à des armatures de flèches plutôt que desagaies. Il est cependant très souvent dif-ficile de distinguer les pointes de sagaiesdes pointes de flèches : l’ethnographienous fournit en effet nombre d’exemplesde pointes de sagaies relativement peti-tes et légères, et de pointes de flèches re-lativement grandes et lourdes.
Des armatures massives, plus oumoins bipointes, en bois de cerf ou en os,se retrouvent dans le Mésolithique nordi-que (-8 500/-5 200) et dans le Néolithiquealpin (-3 400/-2 500). Les conditions de con-servation exceptionnelles de certains sitespermettent de connaître leur moded’emmanchement : elles étaient fixées à deshampes en bois à l’aide de liber et de braide bouleau. Il apparaît cependant que cer-tains objets de forme très semblable ont étéinsérés dans des manches courts et desti-nés à un autre usage, encore mal défini.
1
4
2
3
5
34
Fig. 181. Flèche ( bambou, bois, rotin)Cette flèche est armée d’une bipointe rainurée en boisHautes-Terres, Nouvelle-Guinée, Océanie (Coll. privée)XIXe siècle2 à 7. Bipointes (2 : ivoire de mammouth, 3 à 6 : bois derenne)2. Maisières-Canal, Belgique (IRSNB, dessin M. Otte) - 3.Goyet, Belgique (MRAH) - 4. Trou Magrite, Belgique(IRSNB, dessin M. Otte)Gravettien5, 6 : Le Placard, France (MAN)Magdalénien7. Hypothèse d’emmanchement
Fig. 191. Pointe de sagaie rainurée à biseau double encore en-gagée dans une pièce intermédiaire (bois de renne)Pekarna, Rép. Tchèque (Moravské Museum, Brno)Magdalénien supérieur2 à 6. Pièces intermédiaires d’emmanchement? (bois derenne)2 à 5. Fontalès, France (Museum d’Histoire Naturelle, Tou-louse, dessins A.-C. Welté)6. Hypothèse d’emmanchementMagdalénien supérieur7. Bâton percé décoré de poissons gravés (bois de renne)Ce type d’objet a probablement servi à redresser la cour-bure naturelle des pointes de sagaie en bois de renne.Goyet, Belgique (IRSNB, d'après F. Twisselmann, 1951)Magdalénien supérieur
2
3
5
6
1
4
7
36
Fig. 201 à 5. Pointes de sagaie à biseau simple (bois de renne)1, 2. Le Placard, France (MAN) (2 : d'après H. Camps-Fabrer,1988)Magdalénien moyen3, 4. Goyet, Belgique (IRSNB)Magdalénien supérieur5. Hypothèse d’emmanchement
Fig. 211, 2. Pointes de sagaie de Lussac-Angles (bois de renne)Petites pointes de sagaie à biseau simple, courtes et lar-ges, de forme lancéolée. L’extrémité est tranchante, le bi-seau est long et non strié, et elles portent toujours unerainure sur une face et souvent sur les deux1. Le Placard, France (MAN)2. Hypothèses d’emmanchementMagdalénien moyen3 à 10. Pointes de sagaie à biseau double (bois de renne)3. Nova Dratenicka, Rép. Tchèque (Moravské Museum,Brno) - 4 à 6 et 8, 9. Trou de Chaleux , Belgique (IRSNB) - 7.Goyet, Belgique (IRSNB)10. Hypothèse d’emmanchementMagdalénien supérieur11 à 14. Pointes de sagaie à base fourchue (bois de renne)11, 12. Isturitz, France (MAN) (12 : d'après H. Camps-Fabrer(dir.), 1988) - 13. Spy, Belgique, (MRAH, dessin M. Otte)14. Hypothèse d’emmanchementMagdalénien moyen et supérieur
1
2
3
4
5
38
Fig. 221. Pointe de sagaie à biseau double décorée d’un batra-cien, et déroulé du décor (bois de renne)Fontalès, France (Museum d’Histoire Naturelle, Toulouse,dessin A.-C. Welté)Magdalénien supérieur2. Baguette demi-ronde décorée de 2 têtes de chevaux(os)Élément d'armature de sagaie ?Fontalès, France (Museum d’Histoire Naturelle, Toulouse,dessin A.-C. Welté)Magdalénien supérieur3 à 5. Fléchettes (bois de renne)3, 4. Trou de Chaleux, Belgique (IRSNB) - 5. Spy, Belgique(IRSNB)Magdalénien supérieur
Fig. 231, 1’. Bipointe ayant conservé son emmanchement (os,liber et brai de bouleau, bois)Friesack, Allemagne (Museum für Ur- und Frühgeschichte,Potsdam, d'après B. Gramsch, 1987)1'. Détail des matériaux : pointillé = os, hachuré = bois,noir = liber et brai de bouleauMésolithique2 à 6. Pointes de sagaie à base massive et bipointes(bois de cerf, os et brai de bouleau)2, 3, 5 et 6. Montilier, Suisse (SACF) - 4. Portalban, Suisse(SACF) (d'après D. Ramseyer, 1985)Néolithique, culture de Horgen, -3 200/-3 1007. Flèche (bambou, os, tapa)Marindanim, Irian Jaya, Nouvelle-Guinée, Océanie (MMT)XXe siècle
1
25
4
3
40
Fig. 24Pointes de harpon. Ishango, République Démocratique du Congo (IRSNB, d'après J. de Heinzelin, 1957)
1, 2. Pointes de harpon à barbelures bilatérales, niveau fossilifère principal, -23 000/-21 0003. Pointes de harpons à barbelures unilatérales, niveau tufacé, -21 000/-20 000
1
2
3
41
Les pointes barbelées
Les projectiles à armatures barbeléessont très répandus chez les peuples chas-seurs. Ces projectiles, de formes très va-riées, se divisent en quatre grandes caté-gories : les sagaies, les flèches, les foëneset les harpons :
- Les sagaies et les flèches à pointebarbelée fixe servent parfois pour lachasse, mais semblent surtout desti-nées à la pêche ou au combat : lesbarbelures permettent de retenir lepoisson plus aisément et, lors descombats, handicapent sérieusementl’adversaire blessé en l’empêchant deretirer facilement le projectile, effetmoins recherché lors de la chasse, sice n’est en milieu aquatique, où il fautramener le gibier en le halant.
- Les foënes, caractérisées par une ar-mature fixe composée de plusieurspointes légèrement divergentes,sont réservées à la capture des pois-sons et des oiseaux aquatiques.
- Les harpons, qui possèdent une ar-mature détachable reliée à la hampepar une ligne, sont pour la plupartdestinés à la pêche ou à la chasse enmilieu aquatique. Ils permettent, parl’usage simultané de flotteurs, d’êtreen mesure de récupérer le gibier.
Au Congo, des pointes barbelées enos, détachables ou fixes, sont présentes àIshango, en milieu lacustre, entre -23 000et -20 000 ans. Ces pointes présentent desbarbelures d’abord bilatérales, ensuite uni-latérales. Elles sont associées à d’abon-dants restes de poissons.
Abondantes au Magdalénien maisdéjà présentes plus tôt, les lamelles en si-
lex, dont certaines ont été retrouvées en-châssées dans des pointes en bois decervidé, peuvent suggérer l’existence d’ar-matures barbelées, fixes ou non, dès leGravettien (-27 000/-20 000). À partir duMagdalénien moyen (-15 500), quelques ar-matures barbelées sont entièrement façon-nées en bois de renne. Les plus anciens deces objets ne possèdent encore que desbarbelures très réduites, peu dégagées dufût. Certains montrent des bases fourchuesou en biseau, qui semblent indiquer unefixation ferme à la hampe.
Le début du Magdalénien supérieur(-12 500) voit le développement d’armatu-res en bois de cervidé aux barbelures biendégagées, unilatérales ou bilatérales. La plu-part de ces objets ont en commun la pré-sence, à leur base, d’un dispositif de réten-tion (échancrure, épaulement, protubérance,perforation) permettant la fixation d’une li-gne, qui permet de les classer parmi lespointes de harpons. L’abondance nouvellede ces objets témoigne probablement denouvelles techniques de prédation visant lafaune aquatique, et donc d’une nouvelle re-lation à l’environnement et à ses ressources.
Les pointes de harpons magdalénien-nes présentent des variations dans laforme, la taille et le nombre de barbelures,ainsi que dans le dispositif de rétention,qui témoignent, dans certains cas, d’uneévolution locale, peut-être liée au type deproies recherchées. En Périgord, les poin-tes de harpons magdaléniennes à barbe-lures unilatérales se développent pratique-ment seules jusque vers -11 500, momentoù elles sont remplacées par les bilatéra-les, qui perdurent jusque vers -10 500.
42
Ailleurs, les deux types coexistent dès ledépart, jusque vers -11 500. Certains ob-jets à barbelures unilatérales, sans dispo-sitif de rétention, ont peut-être été utiliséscomme armatures fixes ou comme élé-ments de foënes.
Des pointes de harpons d’aspect plusplat, à grandes barbelures assez larges,presque toujours perforées à la base, ap-paraissent dans le Magdalénien des Can-tabres et des Pyrénées dès -12 000. Cespointes de harpons, dites aziliennes, y sup-plantent les pointes de harpons magdalé-niennes dès -11 500, et sont présentes jus-que vers -9 000, à la fin de la dernière gla-ciation. Elles existent également dansl’Ahrensbourgien, culture plus nordique, àla même époque. De grandes pointes deharpons à barbelures unilatérales sont éga-lement fréquentes dans le Paléolithique fi-nal du Nord de l’Europe (Culture deBromme : -11 000/-8 400).
Des pointes barbelées en bois de cerfou en os, presque toujours sans dispositifde rétention, sont très répandues dans leMésolithique du Nord de l’Europe(Maglemosien : -7 500/-6 000). C’est assezcurieux dans la mesure où l’on dispose alorsde véritables sites côtiers d’époque : lecaractère d’armatures à destination aqua-tique semble moins évident… Les bar-belures sont presque toujours unilatéraleset peu dégagées. Certaines pointes mon-trent encore leur système de fixation fermeà une hampe en bois, réalisée à l’aide debrai de bouleau. Dans la phase suivante(Kongemosien : -6 000/-5 200), les barbe-lures sont parfois constituées de petiteslamelles de silex enchâssées dans de larésine, technique déjà attestée au Magda-lénien. Certaines de ces pointes ont étéretrouvées dans des squelettes d’élans, decerf mégacéros et d’ours, ou associées àdu brochet. À l’Est, en Russie, de nombreu-ses variantes existent : grandes ou petites
pointes en bois de cervidés, à une ou plu-sieurs barbelures, uni- ou bilatérales, sanstraces de dispositif de rétention, bien queretrouvées en milieu proche de l’eau, etdans des gisements où la consommationde poisson est bien attestée…
Les armatures barbelées plates enbois de cerf, attestées au Mésolithique ré-cent, rares au Néolithique ancien, sont ànouveau abondantes au Néolithiquemoyen des palafittes. Dans la culture deHorgen (-3 400/-2 950), elles sont toujoursperforées, et pourraient donc être liées àune activité de prédation en milieu aquati-que. Dans la phase suivante de Lüscherz (-2 950/-2 600), les bases sont non perfo-rées et rectangulaires. En Europe, les ar-matures barbelées en bois de cervidé sem-blent disparaître au Néolithique final. EnAfrique, les armatures barbelées en matièredure animale perdurent au moins jusqu’àl’Âge du Fer, mais comme en Océanie eten Amérique, elles sont parfois encore pré-sentes au siècle dernier.
Fig. 251, 2. Pointes à barbelures peu dégagées (bois de renne)1. Gazel, France (Laboratoire de Préhistoire, Carcassonne)- 2. Laugerie-Basse, France (MAN)Magdalénien moyen3 à 9. Pointes à barbelures unilatérales (bois de renne)3 à 7. Grotte du Coléoptère, Belgique (3 : ULg, 4 à 7 :MRAH) - 8. La Madeleine, France (MAN) - 9. Hypothèsesd’emmanchement, d’après M. Julien, 1982Magdalénien supérieur10 à 13. Pointes de harpon à barbelures bilatérales (boisde renne)10. La Vache, France (MAN) - 11. Isturitz, France (MAN) -12. Goyet, Belgique (IRSNB, dessin M. Otte) - 13. Pekarna,Rép. Tchèque (Moravské Museum, Brno)Magdalénien supérieur14. Pointe de sagaie à biseau double décorée d’unepointe de harpon à barbelures bilatérales (bois de renne)Fontalès, France (Museum d’Histoire Naturelle, Toulouse,dessin A.-C. Welté)Magdalénien supérieur
44
Fig. 261 à 6. Pointes de foëne ou "fléchette à oiseaux" (bois derenne)Pièces présentant une ou plusieurs pointes et/ou barbeluresopposées à une extrémité amincie. Ces objets ont pu ser-vir d’armatures perforantes (pointes dirigées vers la cible -système assez peu efficace mais attesté par l’ethnographie)ou d’éléments intermédiaires supportant une armaturefixée sur la partie amincie (pointes dirigées vers l’arrière -également attesté par l’ethnographie). Certains de cesobjets ont parfois été interprétés comme éléments de ha-meçons1 à 5. Fontalès, France (Museum d’Histoire Naturelle, Tou-louse, dessins A.-C. Welté) - 6. La Vache, France (MAN)Magdalénien supérieur
Fig. 271 à 6. Pointes de harpon et pointes barbelées "nordi-ques" (1, 3 et 4 : os; 2 : bois de cerf; 5 : bois de cerf, liberet brai de bouleau; 6 : bois de cerf, bois et fibres végéta-les)1. Frederikssund, Danemark (National Museet, Copenha-gue) - 2. Wichelen, Belgique (MRAH) - 3. Vibygard, Dane-mark (National Museet, Copenhague) - 4. TorbenfeldtMose, Danemark (National Museet, Copenhague) - 5.Friesack, Allemagne (Museum für Ur- und FrühgeschichtePotsdam, d'après B. Gramsch, 1987) - 6. Ulkestrup Lyng,Danemark (d’après K. Andersen et al., 1982)1, 2 : Paléolithique final, -12 500/-9 5003 à 6 : Maglemosien, -9 500/-8 000
1
2
3 4
56
46
Fig. 281 à 5. Pointes barbelées composites et lamelles à dos(1 : bois de renne, résine et silex; 2 à 4 : silex; 5 : os, brai debouleau et silex)1. Pincevent, France (Musée de Pincevent, d'après J.-L.Piel-Desruisseaux, 1986) - 2. Vaucelles, Belgique (MMT) -3, 4. Couze-Lalinde, France (Coll. et dessins J.-M. Brams) -5. Hormsherred, Danemark (National Museet, Copen-hague)2 : Magdalénien moyen1, 3 et 4 : Magdalénien supérieur5 : Kongemosien, -8 000/-6 0006 à 8. Pointes de harpon plates (6 : bois de renne; 7, 8 :bois de cerf)6. Lorthet, France (MAN) - 7, 8. Le Mas d’Azil, France (MAN)6 : Magdalénien supérieur7, 8 : Azilien
Fig. 291 à 5. Pointes de harpon plates (bois de cerf)1, 3. Estavayer, Suisse (SACF) - 2. Montilier, Suisse (SACF) -4. Portalban, Suisse (SACF) (d'après D. Ramseyer, 1990 etH. Camps-Fabrer (dir), 1995)1, 2 : Néolithique, culture de Horgen, -3 400/-2 9503, 4 : Néolithique, culture de Lüscherz, -2 950/-2 6005. Hypothèses d’emmanchement, d’après J.-G. Rozoy, 1978
6
7
5
8
43
21
48
Fig. 301 à 3. Pointes à barbelure basale (bois de cerf, brai debouleau)1, 2. Portalban, Suisse (SACF, d'après H. Camps-Fabrer (dir),1995)3. Hypothèses d’emmanchement, d’après J.-G. Rozoy, 1978Néolithique, culture de Horgen, -3 400/-2 9504. Pointes à barbelure(s) distale(s) (os, bois de cervidé)Zamostje 2, Russie (d'après V. Lozovski,1996)Mésolithique, Néolithique ancien
Fig. 311, 2. Pointe de harpon (os)Terre de Feu, Argentine (IRSNB)XIXe siècle2. Système d’emmanchement, d’après M. Julien, 1982.3. Foëne de guerre (bois)Australie du Nord (Musée Royal d'Afrique Centrale,Tervuren)XIXe siècle4. Harpon (bois de renne, bois)Netsilik, Penny Bay, Canada arctique (Musée Royal d'Afri-que Centrale, Tervuren)XIXe siècle5. Flèche à pointe barbelée (bambou et bois)Hautes-Terres, Nouvelle-Guinée, Océanie (MMT)XIXe siècle
1
2
4
3
50
Les propulseurs
Le propulseur est une arme de jetdestinée à la chasse, à la pêche ou au com-bat. Il est constitué d’une baguette oud’une planchette rigide, de forme et dedimensions variables, munie d’un crochetou d’une gouttière avec ou sans éperon,sur ou dans lesquels vient s’insérer un pro-jectile du type sagaie, harpon ou longueflèche, empenné ou non.
Le propulseur a pour but essentield’augmenter la vitesse initiale du projec-tile, et donc en principe son efficacité. Al-longeant la main, il s’intègre dans un sys-tème complexe de leviers, dont les pivotsprincipaux sont le bassin et l’épaule, puisle coude et surtout le poignet qui, en finde mouvement, donne, grâce à une rota-tion très rapide, l’impulsion déterminante.Le but recherché peut être soit un impactpuissant et précis à courte distance (utili-sation d’un projectile plutôt long et lourd,pour la chasse et la pêche), soit un tir àlongue distance (utilisation d’un projectileléger, pour le combat, par exemple).
Le propulseur a été ou est encoreutilisé en Océanie, dans la zone arctiqueet l’Amérique tropicale. L’étude des pro-pulseurs provenant de ces régions nousrenseigne sur leur forme, leurs conditionset leurs traces d’utilisation, et leur rôle so-ciologique. L’analyse des objets, des tex-tes, des photos et des films montre notam-ment que la longueur des propulseurs eth-nographiques varie de 40 cm à 1,20 m, avecune moyenne de 75 cm, et que le propul-seur s’utilise le plus souvent, pour la chasseet la pêche, à une distance de tir inférieureà 30 m, avec des projectiles relativementlongs, pesant moins de 500 g, et dont la
longueur varie le plus souvent de 2,10 à3,20 m. Pour le combat, les projectiles sontsouvent plus courts (1,30 à 1,80 m) et lé-gers (50 à 100 g), et tirés à des distancesplus élevées. De plus, cette arme s’utilisedans la plupart des cas en milieu ouvert.
Le propulseur est attesté au Paléoli-thique, du Solutréen supérieur (-19 000)jusqu’au début du Magdalénien supérieur(-12 000), dans le Sud-Ouest de la France,en Suisse, en Allemagne de l’Est et en Es-pagne. Il figure également dans les pein-tures rupestres paléolithiques d’Australieet de la Cordillère des Andes, encore maldatées. Les éléments retrouvés en Europe,en bois de renne, os et ivoire, ne sont queles extrémités de propulseurs dont lesmanches, en bois, n’ont pas été retrouvés.Les exemplaires intacts présentent desaménagements (biseau, perforation...) té-moignant de cet emmanchement. Ces ob-jets montrent souvent des traces d’utilisa-tion caractéristiques semblables à cellesobservées sur les propulseurs ethnographi-ques et expérimentaux.
Dans l’état actuel des connaissances,les propulseurs paléolithiques européenspeuvent être divisés en 4 "types" : les pro-pulseurs "androgynes", dont la face supé-rieure est creusée d’une gouttière munied’un éperon, les propulseurs "mâles", à cro-chet, non décorés ou simplement gravés,qui semblent être le type le plus ancien, lespropulseurs "mâles" en baguette décorésd’une tête ou d’un avant-train d’herbivore,et les propulseurs "mâles" ornés d’une fi-guration traitée en ronde-bosse le plus sou-vent aplatie, qui comptent parmi les chefs-d’œuvre de l’art préhistorique.
51
Fig. 321, 2. Propulseurs "mâles" non décorés ou simplementgravés (bois de renne)1. Combe-Saunière, France (Direction des Antiquités Pré-historiques d’Aquitaine) - 2. Le Placard, France (MAN))1. Solutréen supérieur2. Solutréen ou Magdalénien moyen3. Propulseur "androgyne", à gouttière et éperon (os)Le Flageolet II, France (Direction des Antiquités Préhisto-riques d’Aquitaine)Magdalénien moyen
L’expérimentation montre que lesreconstitutions de propulseurs paléolithi-ques européens sont parfaitement effica-ces, et permettent d’abattre un animal dela taille d’un capridé à une distance d’en-viron 20 m à l’aide d’un projectile munid’une pointe en silex, en os, en bois derenne ou en ivoire. Le projectile perforetotalement l’animal lorsqu’il le frappe dansles parties molles, et pénètre dans l’os lors-que ce dernier l’arrête.
Des exemplaires archéologiquescomplets, vieux de plus de 4 000 ans, ontété retrouvés sur la côte ouest de l’Améri-que du Sud (Chili, Pérou), d’autres, un peuplus récents, proviennent de la région duGrand Bassin, dans le Sud-Ouest des États-Unis. Ils sont essentiellement constitués debois, avec parfois des parties rapportéesen pierre et en os. Des exemplaires andinsplus récents comportent des éléments depoignée et des crochets en cuivre.
1
2
3
52
Fig. 33Propulseurs "mâles" en baguette décorés (bois de renne)1 à 4, 6. Chevaux - 5. Bouquetin1. Abri Courbet, Bruniquel, France (British Museum) - 2. LaCrouzade, France (Laboratoire de Préhistoire de Carcas-sonne, dessin D. Sacchi) - 3. Isturitz, France (MAN) - 4.Teufelsbrücke, Allemagne (Museum für Ur- undFrühgeschichte, Thüringens, Weimar) - 5. Le Mas d’Azil,France (MAN) - 6. Laugerie-Basse, France (MAN, dessin D.Buisson)Magdalénien moyen
1
2
3
4
5
6
53
Fig. 34Propulseurs "mâles" ornés d’une figuration sculptée enronde-bosse le plus souvent aplatie (bois de renne)1. Faon aux oiseaux, Le Mas d'Azil, France (MAN, dessin F.Lebrun) - 2 et 4. Oiseaux et bouquetins affrontés, Enlène,France (Musée de l’Homme) - 3. Renne broutant, Arudy,Espalungue, France (MAN) - 5. Tête humaine, Gourdan,France (MAN)Magdalénien moyen
1
2
3
45
54
Fig. 351. Propulseur-jouet "femelle" pour enfant (bambou, bois,rotin)Sépik, Nouvelle-Guinée, Océanie (Coll. privée)XIXe siècle2. Propulseur "femelle" (bambou, bois, rotin)Sépik, Nouvelle-Guinée, Océanie (Coll. privée)Début XXe siècle3. Propulseur "mâle" (bois, tendon, résine)Australie centrale (MMT)XIXe siècle4. Propulseur "mâle" (bois, tendon, résine, coquille)Péninsule du Cape York, Queensland, Australie (Coll. pri-vée)XIXe siècle5. Tir au propulseur dans le North QueenslandQueensland, Australie (d’après N. W. Thomas, 1906)Début XXe siècle
Fig. 361. Sagaie pour le tir au propulseur (bois, tendon, os)Australie (Musée Royal d'Afrique Centrale, Tervuren)XIXe siècle2. Scène de chasse, dessinée par "Yertabrida Solomon",aborigène de Coorong, en 1876. Le chasseur effectue sonapproche à l’abri d’un "bouclier" de feuillage (d’après R.G. Taplin, 1879)XIXe siècle3. La chasse au propulseurIl s’agit de la plus ancienne illustration connue de tir aupropulseur, gravée par Frobischer en 1580, Groënland(d’après Houben, 1927)XVIe siècle
1
2
3
4
5
56
Les arcs
Quand on pense aux peuples chas-seurs, l’arc est peut-être l’arme qui vienten tout premier lieu à l’esprit de chacun. Ilest difficile de déterminer avec certitudequand l’arc est apparu. Il est en effet réa-lisé le plus souvent en bois, de même queles hampes des flèches, et ne se conserveque dans des milieux tout à fait particu-liers, tels les tourbières et les milieux la-custres. Certaines armatures en silex, enbois de cervidé ou en os suggèrent, dèsles phases anciennes du Paléolithique su-périeur, un emmanchement sur des ham-pes fines et une vitesse de propulsion éle-vée qui font penser à l’arc. Il faudrait mul-tiplier les expérimentations et les étudestracéologiques pour éclaircir ce problème,pour autant que ce soit nécessaire.
Quoi qu’il en soit, les fragmentsd’arcs et de flèches les plus anciens ont étédécouverts dans la tourbière de Stellmoor(Allemagne), site ahrensbourgien daté duDryas, c’est-à-dire du Paléolithique final (-10 000). Ces arcs ont été taillés dans dubois de cœur de pin, de même que les flè-ches, dont on a retrouvé une centained’exemplaires, munis d’une pré-hampedont certaines portaient encore des frag-ments d’armatures en silex (pointesd’Ahrensbourg) ; d’autres étaient simple-ment appointées. La longueur des hampescomplètes varie principalement de 85 à 90cm et leur épaisseur de 0,5 à 1 cm. Le gi-bier chassé à Stellmoor est essentiellementdu renne, suivi par des oiseaux, du brochet,du renard, etc. Certaines omoplates derenne perforées, dont le trou correspondau diamètre des armatures et des hampes,une pointe d’Ahrensbourg découvertedans une poitrine de renne, et une pointe
massive en bois végétal retrouvée dans unevertèbre de loup témoignent de l’effica-cité de cet équipement.
À Holmegaard (Danemark), à la findu Boréal (-6 500), plusieurs arcs sont taillésdans de l’orme poussé à l’ombre, dont lescernes annuels sont très serrés, ce qui té-moigne d’un excellent choix de la matièrepremière : l’orme constitue, après l’if, undes meilleurs bois d’arc d’Europe du nord-ouest. Les arcs dits d’Holmegaard, que l’onretrouve également dans d’autres localitésdu Danemark, du sud de la Suède et enAllemagne du nord, sont longs de 1,50 à1,70 m, plats et larges, de contour généralfusiforme, étranglés à la poignée. De pro-fil, cette poignée est plus épaisse. La puis-sance de ces arcs pouvait varier de 45 à 70lbs. On connaît dans les mêmes régionsquelques arcs plus petits, destinés à desenfants ou des adolescents.
Un arc du même type, en pin, a étéretrouvé à Wis (Russie, -6 500/-5 500), demême qu’un arc à simple courbure, enépicéa, d’environ 1,50 m de long. De plus,un très grand arc, long de 3,50 m, a sansdoute fait partie d’un piège à arc.
De nombreux arcs, généralement enif, le meilleur bois d’arc d’Europe, plus ra-rement en orme ou en frêne, ont été dé-couverts dans le Mésolithique final du nordde l’Europe (culture d’Ertebølle, -5 200/-4200) ainsi que dans le Néolithique nordi-que et alpin. Ils sont de deux types : soitdroit, soit à double courbure et à branchesparfois très larges, en forme de pales. Leursection est en D, la face plane, parfois con-cave ou creusée d’une gorge, correspon-
57
dant à la face interne de l’arc. Leur allongemaximale se situait aux alentours de 70 cm.Tous témoignent d’une excellente connais-sance des principes de fabrication de l’arc,qu’il s’agisse du choix de la matière pre-mière, de sa mise en œuvre ou du choix dela forme. Les cordes des arcs ne sont mal-heureusement jamais conservées : ellespouvaient être en fibres végétales (lin, or-tie, tilleul...), en tendons, en boyaux ( ?) ouen cuir... Elles étaient fixées à l’arc à l’aided’une encoche, d’un épaulement, d’unbouton ou encore d’un anneau de serragecoulissant.
Des arcs à double courbure apparais-sent aussi dans les peintures rupestres pré-historiques du Levante espagnol, mais il estsouvent difficile de connaître leur âge pré-cis.
Fig. 371. Arc de type "Holmegaard" (orme)Holmegaard, Danemark (National Museet, Copenhague,d'après J.-G. Rozoy, 1978)Kongemosien ancien, -6 0002. Arc de type "Holmegaard" (if)Ochsenmoor, Allemagne (N.L. Hannover, d'après K.Beckhoff, 1965)Néolithique, -3 0003. Arc (bois, "corde" en éclisse de bambou)Nouvelle-Bretagne, Océanie (MMT)XIXe siècle
1
23
58
1
2
3
Fig. 381. Chasse au cerf (peinture rupestre)Cueva de los Caballos, Valtorta, Espagne, d’après J.-G.Rozoy, 1978Mésolithique/Néolithique2, 3. Arc droit à section en D (if)2. Reconstitution, d'après A. Bocquet, A. Houot, 19823. L’extrémité est taillée en poupée pour bien retenir lacorde. La poignée, située au centre, était recouverte deficelle enroulée dont on retrouve la marque sur le boisCharavines, France (Centre de Documentation de la Pré-histoire Alpine, Grenoble)Néolithique récent, -2 400/-2 300
59
Les flèches
Les plus anciennes armatures indu-bitablement associées à l’utilisation de l’arcet de la flèche remontent au Paléolithiquefinal et à l’Épipaléolithique, il y a quelque10 000 ans, moment où l’on a retrouvé desvestiges d’arc incontestables. Auparavant,toute une série d’armatures possèdent descaractéristiques proches : les étudestracéologiques et les expérimentations,bien qu’encore peu nombreuses, confor-tent déjà cette interprétation dès, au plustard, le Gravettien. Cette interprétation estpourtant encore parfois contestée… Poin-tes à dos gravettiennes de petite taille, flé-chettes, pointes à soie et à cran solutréen-nes de petit module, sans parler de nom-bre de pointes d’Afrique du Nord, pointesen bois de renne de taille très réduite da-tant de l’Aurignacien, du Gravettien, duMagdalénien, autant d’éléments qui sug-gèrent l’existence de l’arc… Cependant,on ne possède pas d’arc de ces époques,pas plus que l’on ne possède les hampesde sagaies ou les piquets de tente dontpersonne ne conteste l’existence !
Dès le début du Mésolithique, lenombre d’armatures en silex de petitetaille, les microlithes, augmente considé-rablement. Parmi ceux-ci, plusieurs caté-gories de pointes et de pièces, géométri-ques ont servi d’armatures et/ou de bar-belures de flèches : triangles, trapèzes, piè-ces foliacées… C’est attesté par les tracesd’usure et par des découvertes de pièces,soit emmanchées dans de l’os ou du bois,soit portant encore les traces de cetemmanchement (résine), soit incluses dansdes ossements (aurochs, cheval, ours,homme…). Un grand nombre de ces piè-ces portent en outre des enlèvements en
"coup de burin", provoqués par des im-pacts violents (c’est également le cas depointes de même forme beaucoup plus an-ciennes, paléolithiques…).
Au Néolithique ancien danubien (-5 500/-4 800), les armatures triangulairesasymétriques à base concave s’inscriventdans la tradition mésolithique, de mêmeque les armatures trapézoïdales à tranchanttransversal qui perdureront jusqu’au Néo-lithique final (-1 800). À partir du Néolithi-que moyen (-4 000), de nouveaux types depointes se développent : d’abord triangu-laires, foliacées ou losangiques, elles évo-lueront vers la forme classique, à pédon-cule et ailerons, qui connaîtra son apogéependant l’Âge du Bronze (-1 800/-750), viteremplacées par des exemplaires en mé-tal..., moins cassants, peut-être pas plusperforants, mais plus performants, parceque récupérables, non cassés… Certainesde ces pointes en bronze, par leursbarbelures très particulières, témoignentd’un usage plus lié à la guerre qu’à lachasse. Cependant, dès le Mésolithique,de nombreuses découvertes attestent queles conflits existaient déjà, sans que les ar-matures soient spécialisées.
Si les hampes de flèches, les plus an-ciennes, fabriquées en pin, proviennent deStellmoor (-10 000), de nombreuses flèches,plus ou moins fragmentaires, ont été retrou-vées dans les sites mésolithiques nordiques,tels Loshult, Vinkel, Wis et Holmegaard, etdans les palafittes du Néolithique alpin, telsCharavines, Portalban et Montilier.
Toutes ces flèches sont en pin ou enviorne, plus rarement en noisetier ou autres
60
Fig. 391 à 9. Armatures microlithiques (silex)1. Lamelles à dos - 2. Segments de cercle - 3. Pointes àbase non retouchée - 4. Triangles - 5. Pointes triangulaires- 6. Pointes du Tardenois - 7. Trapèzes - 8. Pointes à retou-ches couvrantes - 9. Flèche montée de Loshult, d’après J.-G. Rozoy, 19781 à 8. Province de Namur, Belgique (Coll. et dessins J.-M.Brams)1, 2. Mésolithique ancien, -8 000/-6 000 - 3 à 8. Mésolithi-que récent, -6 000/-4 00010 à 13. Pointes triangulaires asymétriques à base con-cave (silex)Vallée de l'Aisne, France, d'après M. Plateaux, 1990Néolithique ancien, Danubien, -5 500/-4 800
bois, taillées dans de grosses ou de peti-tes branches, ou dans des troncs, obtenuespar fendage, dans du bois de cœur, ou pré-levées directement et redressées, à chaud.Taillées au silex, elles ont toutes été trèssoigneusement lissées et polies, probable-ment à l’aide de blocs de grès à rainures.Les longueurs varient assez peu, autour de90 cm. Certaines flèches ont été faites endeux parties : l’une longue (hampe) d’en-viron 70 cm, l’autre courte (pré-hampe)d’environ 20 cm. Elles sont munies d’uneencoche taillée dans la masse et d’un em-pennage (dont les traces de ligatures ont
parfois été retrouvées), d’une encochepour la pointe et parfois d’une rainure pourla ou les barbelures adventices. Les arma-tures encore présentes sont fixées à la ré-sine de pin ou au brai de bouleau. Certai-nes flèches sont munies d’armatures enbois végétal ou animal, à l’extrémité arron-die ou plate, destinées à "assommer" lesoiseaux ou le petit gibier. Cela permet deretrouver le projectile et le gibier plus faci-lement, et évite, dans une certaine mesure,le bris de l’armature et la détérioration dela peau. Par contre, l’intérieur de l’animalest en général plus endommagé.
8
65
1 2 3 4
7
1011
9
12 13
61
Fig. 401 à 5. Armatures à tranchant transversal (silex)1, 2. Province de Namur, Belgique (Coll. et dessins J.-M.Brams) - 3, 4. Ottignies, Belgique (Coll. et dessins B. Clarys)- 5. Système d’emmanchement, d’après A. Fischer, 1985.Néolithique moyen et récent, -4.800/-1.8006. Pointe triangulaire massive (silex)Overijse, Belgique (Coll. et dessin B. Clarys)Néolithique moyen?7 à 9. Pointes amygdaloïdes et losangique (silex)7. Namur, Belgique (Coll. et dessin J.-M. Brams) - 8. Liège,Belgique (ULg) - 9. Portalban, Suisse (SACF, d'après D.Ramseyer, 1987)Néolithique moyen, -4.800/-2.80010 à 17. Pointes triangulaires (10 : os; 11 : silex, brai debouleau; 12 : silex, trace d’emmanchement; 13 : silex, cas-sure en coup de burin due à un impact; 14 à 17 : silex)10 à 15. Montilier, Suisse (SACF, d'après D. Ramseyer, 1990)- 16, 17. Ottignies, Belgique (Coll. et dessins B. Clarys)Néolithique moyen, -4.800/-2.800
10 11 13
14 15
12
987
3 4 5
1 2
6
16 17
62
Fig. 411, 2. Armatures non perforantes (bois de cerf, viorne)Ce type d’armature est généralement utilisé pour la chasseau petit gibierMontilier, Suisse (SACF, d'après D. Ramseyer, 1990)Néolithique moyen, culture de Horgen, -3 200/-3 1003. Flèche à armature non perforante retrouvée dans unpalafitte (hampe en viorne, armature en bois de cerf)Montilier, Suisse (SACF, d'après D. Ramseyer, 1990)Néolithique moyen, culture de Horgen, -3 200/-3 1004 à 9. Pointes à pédoncule et ailerons non récurrents (4 :silex et brai de bouleau; 5 à 9 : silex)4. Portalban, Suisse (SACF, d'après D. Ramseyer, 1990) - 5.Vaucelles, Belgique (MMT) - 6, 7. Liège, Belgique (ULg,dessins J.-M. Brams) - 8, 9. Namur, Belgique (Coll. et des-sins J.-M. Brams)Néolithique moyen et récent, -3 200/-1 80010 à 12. Pointes à pédoncule et ailerons (silex)10, 11. Overijse, Belgique (Coll. et dessins B. Clarys) - 12.Namur, Belgique (Coll. et dessin J.-M. Brams)Âge du Bronze, -1 800/-750
1
4
2
5
78 9
6
10
11
12
3
63
Boomerangs et bâtons de jet
Typique de l’Australie aborigène, leboomerang est un bâton de jet pourvu depropriétés aérodynamiques. Elles lui per-mettent une portée de tir allant de 60 jus-qu’à 200 m. La trajectoire de son vol peutêtre contrôlée par le lanceur, tant pour lesboomerangs non retournant que pour lesexemplaires capables de revenir vers le lan-ceur, s’ils n’ont touché aucun obstacle. Lemot "boomerang" dérive du mot"bumariny" des Aborigènes parlant la lan-gue Dharug, au sud de Sydney.
La notion de boomerang inclut aussibien les boomerangs retournant à leurpoint de départ qu’une grande variété debâtons de jet possédant des propriétés aé-rodynamiques. Le mot boomerang ne dé-signe donc pas uniquement les engins "re-tournant" : la grande majorité des boome-rangs australiens ne le font d’ailleurs pas.Ils étaient conçus comme des armes desti-nées à toucher une cible. Les boomerangsprésentent des formes et des dimensionstrès variées. En général, le boomerang estune planchette incurvée, mesurant entre45 cm et 1 m de long. Une de ses faces estgénéralement convexe, l’autre plate, maisil peut aussi être biconvexe, entre autres...De très grands boomerangs de combat, quine sont jamais lancés, peuvent dépasser 2m de long.
Certains boomerangs ont une formesymétrique, d’autres ont une pale plus lon-gue que l’autre; certains sont fins et légers,d’autres trapus, d’autres encore assezlourds; les extrémités peuvent être arron-dies ou pointues, plates ou légèrementvrillées.
Le plus ancien boomerang connu,probablement "non retournant", façonnéen ivoire de mammouth, a été découvert,en Pologne, à Oblazowa, dans un niveaugravettien daté d’environ -23 000 ans. Ilpossède une section plan-convexe très ca-ractéristique. Les plus anciens boomerangsen bois ont été découverts en 1973, dansune tourbière située à Wyrie Swamp, dansle sud-est de l’état de South Australia. Par-faitement bien conservés, ces boomerangsfins et légers, qui étaient sans doute "re-tournant", sont vieux de près de 10 000ans. Par ailleurs, des boomerangs sont fi-gurés dans des peintures rupestres de laTerre d’Arnhem, qui remontent à plus de 9000 ans. Ils apparaissent également dansdes peintures rupestres d’Afrique du Nordde la même époque.
Quelques boomerangs égyptiensdatent d’il y a au moins 4 000 ans. De nom-breux boomerangs ont également été dé-couverts dans la tombe du pharaon Tou-tankhamon. Certains d’entre eux étaientcapables de revenir vers leur lanceur. LeNéolithique moyen suisse livre quelquesboomerangs ou bâtons de jet en bois, no-tamment à Egolzwil. Des boomerangs enforme de V sont figurés dans les peinturesrupestres suédoises datant de l’Âge duBronze. Un exemplaire intact, daté du 1er
Âge du Fer, a été découvert dans une tour-bière de Velsen (Pays-Bas).
D’autres peuples plus récents ontutilisé des boomerangs non retournant,comme les Hopis de l’Arizona, les Inuits,ainsi que divers peuples d’Inde, d’Indoné-sie…
64
Le caractère unique du boomerangen ivoire de mammouth d’Oblazowa tientsans doute au fait que ses équivalents pa-
léolithiques étaient fabriqués en bois,comme tous les autres boomerangs dedate plus récente connus…
1 2
Fig. 421. Boomerang (ivoire de mammouth). Oblazowa, Pologne (Musée de Cracovie). Gravettien
2. Boomerang (bois). Queensland, Australie (MMT). XIXe siècle
65
1
2
3 4
Fig. 431 à 3. Bâtons de jet (bois). Egolzwil 4, Suisse. Néolithique moyen, Cortaillod, -3 900/-3 400
4. Boomerang (bois). Mörigen, Suisse (Musée Historique de Berne). Âge du Bronze final, -1 200/-750(d'après D. Ramseyer, 2000)
66
ALTUNA J. - 1989. Caza y alimentacion procedente demacromamiferos durante el Paleolitico de Amalda. LaCueva de Amalda (Zestoa, Pais Vasco). p. 149-192.
ALTUNA J. - 1990. La caza de herbivoros durante el Paleoliticoy Mesolitico del Pais Vasco. MUNIBE, 42, p. 229-240.
ANDERSEN K., JÖRGENSEN S., RICHTER J. - 1982.Maglemose bytterne ved Ulkestrup Lyng (NordiskeFortidsminder, série B).
ANDERSON P. C., BEYRIES S., OTTE M., PLISSON H. (dir.)- 1993. Traces et fonction : les gestes retrouvés. Actesdu Colloque international de Liège. 8-9-10 décembre1990. ERAUL 50, 2 Vol.
ANELL B. - 1960. Hunting and trapping methods in Australiaand Oceania. Lund, Studia Ethnographica Upsaliensa,XVIII.
BARRIERE C. - 1997. L'Art Pariétal des Grottes desCombarelles. Paléo, hors série, Angoulème.
BATAILLE G. - 1955. La Peinture préhistorique. Lascaux oula naissance de l'Art. Genève, Skira.
BAUDAIS D. - 1985. Le mobilier en bois des sites littorauxde Chalain et Clairvaux. Néolithique, Chalain-Clair-vaux, fouilles anciennes, 1. Lons-le-Saunier, MuséeArchéologique, p. 177-180.
BAR-YOSEF O. - 1987. Direct and indirect evidence forhafting in the epi-palaeolithic and neolithic of thesouthern Levant. Dans La main et l’outil. Manches etemmanchements préhistoriques (Travaux de la Mai-son de l’Orient 15), p. 155-164.
BECKHOFF K. - 1965. Eignung und Verwendungeinheimischer Holzarten für prähistorische Pfeilschäfte.Die Kunde, T. 16.
BECKHOFF K. - 1965. Die Eibenholz-Bogen vomOchsenmoor am Dümmer. Die Kunde, T. 14, p. 63-81.
BELLIER C., CATTELAIN P. (dir.) - 1998. Les grandes inven-tions de la Préhistoire. Treignes, Éd. du CEDARC.
BELLIER C., CATTELAIN P., OTTE M. (dir.) - 2000. La Chassedans la Préhistoire. Hunting in Prehistory. Actes du Col-loque international de Treignes. 3-7 octobre 1990. An-thropologie et Préhistoire 11, ERAUL 51, Artefacts 8.
BERGMAN C. A. - 1987. Hafting and use of bone and antlerpoints from Ksar Akil, Lebanon. Dans La main et l’outil.Manches et emmanchements préhistoriques (Travauxde la Maison de l’Orient 15), p. 117-126.
BINDON P., RAYNAL J.-P., SONNEVILLE-BORDES D. de -1987. Sagaies en bois d’Australie occidentale. Fabri-
cation, fixation, fonctions. Dans La main et l’outil. Man-ches et emmanchements préhistoriques (Travaux dela Maison de l’Orient, 15), p. 103-116.
BOCQUET A., HOUOT A. - 1982. La vie au Néolithique.Chavarines : un village au bord d’un lac, il y a 5.000ans. Dossier Histoire et Archéologie, 64.
BONJEAN D. (éd.) - 1996. Néandertal. Andenne, Archéo-logie Andennaise.
BORDES F. - 19885.(1967). Typologie du Paléolithique an-cien et moyen. Presses du CNRS.
BOSINSKI G. - 1990. Homo sapiens. L’histoire des chas-seurs du Paléolithique supérieur en Europe (40 000-10 000 avant J.-C.). Paris, Errance.
BROOKS A. S., SMITH C. C. – 1987. Ishango revisited :new age determinations and cultural interpretations.The African Archaeological Review, 5, p. 65-78.
BUISSON D. - 1999. À propos de trois raccords de "pro-pulseurs". Dans Préhistoire d'Os, recueil d'études surl'industrie osseuse préhistorique offert à H. Camps-Fabrer. Publications de l'Université de Provence, p.89-95.
BURDUKIEWICZ J. M., KOBUSIEWICZ M. (éd) - 1987. Lateglacial in central Europe. Culture and Environment.(Polska Akademia Nauk, 5). Wroclaw, Warszawa,Krakow, Gdansk, Lodz.
CAHEN D., CASPAR J.-P., OTTE M. - 1986. Industries lithi-ques danubiennes de Belgique. ERAUL 21.
CAMPS G. - 1979. Manuel de recherches préhistoriques.Paris, Doin.
CAMPS-FABRER H. (dir.) – 1988. Fiches typologiques del’Industrie osseuse préhistorique. Cahier I. Sagaies.Publications de l’Université de Provence.
CAMPS-FABRER H. (dir.) – 1993. Fiches typologiques del’Industrie osseuse préhistorique. Cahier VI. Élémentsrécepteurs. Treignes, Éd. du CEDARC.
CAMPS-FABRER H. (dir.) – 1995. Fiches typologiques del’Industrie osseuse préhistorique. Cahier VII. Élémentsbarbelés et apparentés. Treignes, Éd. du CEDARC.
CARTAILHAC E. - 1969. Quelques faits nouveaux du Pré-historique ancien des Pyrénées. L’Anthropologie, 7,p. 309-318.
CASPAR J.-P., OTTE M. - 1987. Les pointes de la Font Ro-bert : outils emmanchés ? Dans La main et l’outil. Man-ches et emmanchements préhistoriques (Travaux dela Maison de l’Orient 15), p. 65-74.
Bibliographie
67
CATTELAIN P. - 1979. Quelques considérations sur les pro-pulseurs magdaléniens au travers de trois pièces con-servées au Musée des Antiquités Nationales. Antiqui-tés Nationales, 11 : p.15-21.
CATTELAIN P. - 1986. Traces macroscopiques d’utilisationsur les propulseurs paléolithiques. Helinium, XXVI/2 :p. 193-205.
CATTELAIN P., OTTE M., ULRIX-CLOSSET M. - 1986. Lescavernes de l’Abîme à Couvin. La région du Viroin dutemps des cavernes au temps des châteaux. 1 : LaPréhistoire. Treignes, Éd. du CEDARC.
CATTELAIN P. - 1988. Fiches typologiques de l’Industriede l’os préhistorique. Cahier II : Propulseurs. Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence.
CATTELAIN P. - 1989. Un crochet de propulseur solutréende la grotte de Combe-Saunière 1 (Dordogne). B.S.P.F.,86, p. 213-216.
CATTELAIN P. - 1991. Les propulseurs paléolithiques : uti-lisation et traces d’utilisation. Dans Archéologie Ex-périmentale, Tome 2 - La terre, Actes du ColloqueInternational “Expérimentation en Archéologie : Bi-lan et Perspectives”, p. 74-81.
CATTELAIN P. - 1990. Les propulseurs. Dans Derniers chas-seurs, premiers agriculteurs (catalogue d’exposition).Musée de Rouen, p. 48-50.
CATTELAIN P. - 1995. La chasse : l’invention du propulseuret de l’arc. Dans Le Génie de l’Homme, des origines àl’écriture (catalogue d’exposition, J.-M. Cordy dir.). StGérard, Abbaye Saint-Gérard de Brogne, p. 173-177et 187-192.
CATTELAIN P. - 1994 (1997). La chasse au Paléolithiquesupérieur. Arc ou propulseur, ou les deux ? Archéo-Situla, 21-24, p. 5-26.
CATTELAIN P., PERPÈRE M. - 1993. Tir expérimental desagaies et de flèches emmanchées de pointes de laGravette. Archéo-Situla, 17-20, p. 5-28.
CATTELAIN P., STODIEK U. - 1996. Propulseurs paléolithi-ques inédits ou mal connus. Dans La Vie Préhistori-que. Paris, S. P. F. / Éd. Faton, p. 76-79.
CHOLLET A., BOUTIN P., CELERIER G. - 1980. Crochetsen bois de cerf de l’Azilien du Sud-Ouest de la France.B.S.P.F., 77, p. 11-16.
CLEYET-MERLE J.-J. - 1990. La Préhistoire de la pêche.Paris, Errance.
COPPENS Y. , PICQ P. (dir.) - 2001. Aux origines de l'huma-nité. Vol. 1. De l'apparition de la vie à l'homme mo-derne. Paris, Fayard
CORDY J.-M., BASTIN B., EK C., GEERAERTS R., OZERA., QUINIF Y., THOREZ J., ULRIX-CLOSSET M. - 1992.La Belle-Roche (Sprimont, Belgique) : the oldestArchaeological Site in the Benelux. A Report on a Field
Trip. Dans M. Toussaint (éd.), 5 millions d’années,l’aventure humaine, ERAUL 56, p. 287-301.
DELPORTE H. - 1983-1984 (1985). Réflexions sur la chasseà la période paléolithique. Jagen und sammeln,Jahrbuch des Bernischen Historischen Museum, 63-64, p. 69-80.
DE LUMLEY H. (dir.) - 1984. Origine et évolution del’homme. Paris, Museum National d’Histoire Naturelle.
DEWEZ M. - 1987. Le Paléolithique supérieur récent dansles grottes de Belgique. Louvain-la-Neuve, SociétéWallonne de Palethnologie asbl.
FEUSTEL R. - 1980. Magdalenienstation Teufelsbrücke, Wei-mar, Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens.
FISCHER A. - 1985. Paa jagt med stenalder-vaaben. Lejre,Historisk-Arkaeologisk Forsogscenter.
GARANGER J. (dir.) - 1992. La Préhistoire dans le monde.Paris, PUF.
GENESTE J.-M., PLISSON H. - 1986. Le Solutréen de la grottede Combe-Saunière 1 (Dordogne). Première approchepalethnologique. Gallia-Préhistoire, 29, 1, p. 9-27.
GIACOBINI G., d'ERRICO F. (dir.) - 1986. I CacciatoriNeandertaliani. Milano, Jaca Book.
GOMEZ TABANERA J.M. - 1983. Sobre cepos y trampasvenatorias en la vieja Europa y su presencia en Astu-rias. Boletin del Instituto de Estudios asturianos, 109-110, p. 403-430.
GRAMSCH B. - 1987. Ausgrabungen auf demmesolithischen Moorfundplatz bei Freisack, BezirkPotsdam. Veröffentlichungen des Museums für Ur- undFrühgeschichte Potsdam. 21, p. 75-100.
GUTHRIE R.D. - 1983. Osseous projectile points : biologicalconsiderations affecting raw material selection and designamong Palaeolithic and Paleoindian peoples. Dans Animalsand Archaeology, 1. Hunters and Their Prey, p. 273-294.
HAHN J. - 1983. Eiszeitliche Jäger zwischen 35000 und15000 jahren vor heute. Dans Urgeschichte in Baden-Württemberg, p. 273-330.
HAHN J. - 1983. Die frühe Mittelsteinzeit. DansUrgeschichte in Baden-Württemberg, p. 362-393.
HEINZELIN J. de - 1957. Les fouilles d’Ishango (Explora-tion du Parc National Albert, Fasc. 2). Bruxelles, Inst.des Parcs Nationaux du Congo Belge.
HEINZELIN J. de - 1973. L’industrie du site paléolithiquede Maisières-Canal (mémoire 171). Bruxelles, IRSNB.
HENRIKSEN B.B. - 1980. Lundby-holmen (NordiskeFortisminder, serie B).
HOLDAWAYS S. - s.d. Were there Hafted Projectile Pointsin the Mousterian ? Tiré-à-part.
68
HOUBEN H.H. - 1927. Der Ruf des Nordens. Berlin.
JELINEK J. - 1989. Sociétés de chasseurs. Ces hommesqui vivent de la nature sauvage. Paris, Gründ.
JULIEN M. - 1982. Les harpons magdaléniens (XVII suppl.à Gallia Préhistoire). Paris, CNRS.
JUNKMANNS J. - 2001. Arc et flèche. Fabrication et utili-sation au Néolithique. Musée Schwab, Bienne.
JONES Ph. - 2000. Boomerangs, échos d’Australie.Treignes, Éd. du CEDARC.
KNECHT H. (éd.) - 1997. Projectile Technology. PlenumPress, New-York
LARSEN PETERKIN G. - 1989. Small stone points of thefrench upper Palaeolithic. 54th Annual Meeting of theSociety for American Archaeology, 9 p., 3 fig.
LEAKEY M. D. - 1975. Cultural Patterns in the OlduvaiSequence. Dans K. W. Butzer & Gl. Isaac (eds), Afterthe Australopithecines. Stratigraphy, Ecology and Cul-ture in the Middle-Pleistocene.
LEROI-GOURHAN A. (dir.) - 1988. Dictionnaire de la Pré-histoire. Paris, PUF.
LEROY-PROST C. - 1975. Les pointes en matière osseusede l’Aurignacien. Caractéristiques morphologiques etessais de définitions. B.S.P.F., 71, p. 449-458.
LEROY-PROST C. - 1978. Les bases fendues d’Isturitz (Py-rénées-Atlantiques). Morphologie et traces d’utilisa-tion. B.S.P.F., 75, p. 116-120.
LOZOVSKI V. L. - 1996. Zamostje 2. Les derniers chasseurs-pêcheurs de la plaine russe. The last prehistoric Hunter-fishers of the Russian Plain. Treignes, Éd. du CEDARC.
MATHIASSEN T. - 1948. Danke Oldsager. I. AeldreStenalder. Copenhaghe, Gyldendalske Boghandel.
MÜLLER-KARPE H. - 1966. Handbuch der Vorgeschichte,1 : Altsteinzeit. München, Beck.
OAKLEY K.P., ANDREWS P., KEELEY L.H., J. DESMONDCLARK - 1977. A reappraisal of the Clacton Spearpoint.Proceedings of the Prehistoric Society, 43, p. 13-30.
OTTE M. - 1979. Le Paléolithique supérieur ancien en Bel-gique. Bruxelles, M.R.A.H., Monographies d’Archéo-logie Nationale n°5.
OTTE M. (dir.) - 1996. Nature et Culture. Actes du collo-que international de Liège, 13-17 décembre 1993.ERAUL 68, 2 Vol.
PATOU M. - 1984. Contribution à l’étude des mammifèresdes couches supérieures de la grotte du Lazaret (Nice, A-M). Paris, Univ. Pierre et Marie Curie, Thèse de Doctorat.
PATOU M. - 1989. La chasse au Paléolithique. Dans Le tempsde la Préhistoire. Paris, S.P.F. - Archeologia, p. 66-68.
PATOU-MATHIS M. (dir.) - 1997. L'alimentation des hom-mes du Paléolithique. Approche pluridisciplinaire.Actes du colloque international de la Fondation Sin-ger-Polignac. 4-5 décembre 1995. ERAUL 83.
PÉTILLON J.-M. - 1999. Les pointes à base fourchues deGourdan (Gourdan-Polignan, Haute-Garonne). Mé-moire de maîtrise, Université de Paris I.
PIEL-DESRUISSEAUX J.-L. - 1986. Outils préhistoriques :forme, fabrication, utilisation. Paris, Masson.
PININGRE J.-F. - 1985. Les industries lithiques taillées deChalain et Clairvaux. Dans Néolithique, Chalain-Clair-vaux, fouilles anciennes 1. Lons-le-Saunier, Musée Ar-chéologique, p. 145-150.
PLATEAUX M. -1990. Quelques données sur l'évolution desindustries du Néolithique danubien de la vallée del'Aisne. Dans D. Cahen et M. Otte (éd.), Rubané etCardial. Actes du Colloque de Liège, novembre 1988,ERAUL 39, 239-255.
RAMSEYER D. - 1985. Pièces emmanchées en os et en boisde cervidés. Découvertes néolithiques récentes duCanton de Fribourg, Suisse occidentale. Dans L’indus-trie en os et bois de cervidé durant le Néolithique etl’Âge des Métaux III. Paris, CNRS, p. 194-210.
RAMSEYER D. - 1987. Delley/Portalban II. Contribution àl'étude du Néolithique en Suisse occidentale. Archéo-logie Fribourgeoise, 3.
RAMSEYER D. - 2000. Les armes de chasse néolithiquesdes stations lacustres et palustres suisses. Dans C.Bellier et al. (éd), La Chasse dans la Préhistoire. Huntingin Prehistory. Actes du Colloque international deTreignes. 3-7 octobre 1990. Anthropologie et Préhis-toire 11, ERAUL 51, Artefacts 8, p. 130-142.
RAMSEYER D., MICHEL R. - 1990. Muntelier/Platzbünden.Gisement Horgen. Vol. 1 - Rapports de fouille. La Cé-ramique. Archéologie Fribourgeoise, 6.
ROZOY J.G. - 1978. Les derniers chasseurs. L’Épipaléoli-thique en France et en Belgique. Essai de synthèse(Bull. de la Soc. Archéo. Champenoise, n° spécial).Charleville, 3 vol.
SACCHI D. -1982. Catalogue de la collection ThéodoreRousseau - fouilles de la Crouzade - au Musée de Car-cassonne. Musée des Beaux-Arts de Carcassonne.
SHEA J.J. - 1988. Spear Points from the Middle Paleolithic ofthe Levant. Journal of Field Archaeology, 15, p. 441-450.
SONNEVILLE-BORDES D. de - 1960. Le Paléolithique su-périeur en Périgord. 2 vol. Bordeaux, Delmas.
STODIEK U. - 1988. Zur Schäftungsweise jung-paläolithischer Speerschleudern. ArchäologischesKorrespondenzblatt, 18/4, p. 323-327.
STODIEK U. - 1993. Zur Technologie der jung-paläolithischen Speerschleuder. Eine Studie auf der
69
Basis archäologischer, ethnologischer undexperimenteller Erkenntnisse. Tübinger Monogra-phien zur Urgeschichte, 9.
TAPLIN G. - 1879. The Narrinyeri : an account of the tribesof South Australian Arborigines, etc. Adelaïde.
THIEME H. - 1996. Altpaläolitische Wurfspeere ausShöningen, Niedersachsen - Ein Vorbericht.Archäologisches Korrespondenzblatt, 26, p. 377-393.
THIEME H., VEIL S. - 1985 Neue Untersuchungen zumeemzeitlichen Elefanten-Jagdplatz Lehringen, Ldkr.Verden Die Kunde, 36, p. 11-58.
THOMAS N.W. - 1906. Natives of Australia. Londres.
TWIESSELMANN F. - 1951. Les représentations de l’hommeet des animaux quaternaires découvertes en Belgique.Bruxelles, IRSNB, Mémoire n° 113.
VALLA F. R. - 1987. Les Natoufiens connaissaient-ils l’arc ? DansLa main et l’outil. Manches et emmanchements préhistori-ques (Travaux de la Maison de l’Orient 15), p. 166-173.
VERHART L.B.M. - 1988. Mesolithic barbed points and otherimplements from Europoort. Dans The Nederlands.Oudbeidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseumvan Oudbeden te Leiden, 68, p. 141-194.
YELLEN J. E. - 1998. Barbed Bone Points : Tradition andContinuity in Saharan and Sub-Saharan Africa. AfricanArchaeological Review, 15-3, p. 173-198.
Légendes des planches couleur
1. Abattage d'un éléphant à l'aide d'épieux en bois,Acheuléen, vers -300 000 ans. Illustration et © B. Clarys, 19902. Traque aux chevaux dans la steppe, Moustérien, vers -50 000 ans. Illustration et © B. Clarys, 19903. Abattage de rennes à l'aide de propulseurs et de sa-gaies, Magdalénien, vers -14 000 ans. Illustration et © B.Clarys, 19904. Chasse à l'arc au gibier d'eau, Néolithique, vers -3 000ans. Illustration et © B. Clarys, 19905 à 7. Pointes de sagaie à base fendue (bois de renne)5. La Quina, France (MAN) - 6. Goyet, Belgique (IRSNB) -7. Trou al’Wesse, Petit Modave, Belgique (ULg), Aurigna-cien typique8 à 12. Pointes de sagaie à base simple (8 à 11 : bois derenne; 12 : ivoire de mammouth)8, 11. La Ferrassie, France (MAN) - 9. Marches-les-Dames,Belgique (MRAH) - 10. Goyet, Belgique (IRSNB) - 12. Fond-de-Forêt, Belgique (ULg), Aurignacien13 à 17. Pointes de sagaie à base raccourcie (bois derenne)13. Le Placard, France (ULg) - 14. Trou de Chaleux, Belgi-que (IRSNB), Magdalénien15 à 17. Trou Magrite, Belgique (IRSNB), Gravettien18, 19. Armatures de flèches non perforantes (bois decerf, viorne)Montilier, Suisse (SACF), Néolithique moyen, culture deHorgen20 à 24. Pointes de sagaie à base massive et bipointes(bois de cerf, os et brai de bouleau)20, 22 à 24. Montilier, Suisse (SACF) - 21. Portalban, Suisse(SACF), Néolithique moyen, culture de Horgen25, 26. Pointes à barbelures peu dégagées (bois de renne)25. Laugerie-Basse, France (MAN) - 26. Gazel, France (La-boratoire de Préhistoire, Carcassonne), Magdalénienmoyen27 à 30. Pointes à barbelures unilatérales (bois de renne)27 à 29. Grotte du Coléoptère, Belgique (27, 28 : MRAH,29 : ULg) - 30. La Madeleine, France (MAN), Magdaléniensupérieur31 à 34. Pointes à barbelures bilatérales (bois de renne)31. Goyet, Belgique (IRSNB) - 32. La Vache, France (MAN)
- 33. Isturitz, France (MAN) - 34. Pekarna, Rép. Tchèque(Moravské Museum, Brno), Magdalénien supérieur35 à 37. Pointes de harpons plates (36 : bois de renne;35, 37 : bois de cerf)36. Lorthet, France (MAN), Magdalénien supérieur35, 37. Le Mas d’Azil, France (MAN), Azilien38. Pointe barbelée "nordique" (os)Torbenfeldt Mose, Danemark (National Museet, Copen-hague), Maglemosien39, 40. Pointes à barbelure basale (bois de cerf, brai debouleau)Portalban, Suisse (SACF), Néolithique, culture de Horgen41, 42. Pointes de harpons plates (bois de cerf)41. Estavayer, Suisse (SACF), Néolithique, culture deLüscherz - 42. Montilier, Suisse (SACF), Néolithique, cul-ture de Horgen43. Crochet de propulseur "mâle" non décoré (bois derenne)Combe-Saunière, France (Direction des Antiquités Préhis-toriques d’Aquitaine), Solutréen supérieur44. Propulseur "mâle" décoré d'une tête de cheval enronde-bosse épousant la forme de la baguette, et d'her-bivores en champlevé (bois de renne)Laugerie-Basse, France (MAN), Magdalénien moyen45. Propulseur "mâle" décoré d'une hyène en semironde-bosse (ivoire de mammouth)La Madeleine, France (MAN), Magdalénien moyen46. Propulseur "androgyne", à gouttière et éperon (boisde renne)Laugerie-Basse, France (MAN), Magdalénien moyen47. Propulseur "mâle" décoré d'un mammouth en semironde-bosse (bois de renne)Abri Montastruc, Bruniquel, France (British Museum), Mag-dalénien moyen48. Propulseur "mâle" décoré d'une tête de cheval dé-charnée en semi ronde-bosse (bois de renne)Le Mas d'Azil, France (MAN), Magdalénien moyen49. Propulseur "mâle" décoré d'un mammouth en semironde-bosse (bois de renne)Canecaude 1, France (Musée de Narbonne), Magdalénienmoyen
70
Table des matières
Introduction
Aux origines de l'humanité : les premiers hominidés, plus charo-gnards que chasseurs
Le Paléolithique inférieur
Le Paléolithique moyen
Le Paléolithique supérieur, le Mésolithique, le Néolithique
Les armatures en pierre
Les armatures en matière dure animale
Les pointes barbelées
Les propulseurs
Les arcs
Les flèches
Les boomerangs et bâtons de jet
Bibliographie
Légendes des planches couleur
5
7
10
14
21
23
31
40
50
56
59
63
66
69


















































































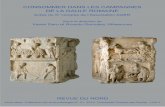
![1993 « “La Route du Sud” (Exposition à Bangkok d'art et artisanat du sud de la Thaïlande) », p. 266-272, photos [interview du journal Priuw, en thaï]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63317a178d2c463a58006943/1993-la-route-du-sud-exposition-a-bangkok-dart-et-artisanat-du-sud-de.jpg)