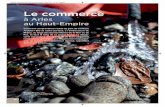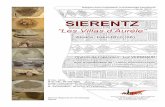L'Expédition d'Égypte, in "Du haut de ces pyramides..." (Ph. Mainterot éd.), 2013, p. 6-14
Transcript of L'Expédition d'Égypte, in "Du haut de ces pyramides..." (Ph. Mainterot éd.), 2013, p. 6-14
7x/
fi7« DU HAUTDECESPYRAMIDES... »L'Expédition d'Egypteet la naissance de l'égyptologie(1798-1850)
<iILS!
I Avant-propos |
Pierre Regnault,Maire de La Roche-sur-Yon et Président de La Roche-sur-Yon AgglomérationPhilippe Grosvalet,Président du Conseil Général de Loire-Atlantique
Fondée en 1804 par décret impérial, la ville de La Roche-sur-Yon entretientavec l'Empire et la figure de l'empereur Napoléon Ier une relation patrimonialeévidente, depuis sa fonction politique jusqu'aux spécificités de son urbanisme.
Ce rapport, elle a su depuis longtemps le questionner et permettre à ses habitantsde se l'approprier. Fin 2008, l'exposition Aux origines de la légende napoléonienneautour de l'artiste Nicolas-Toussaint Charlet analysait la construction du mythenapoléonien. Aujourd'hui, elle s'embarque dans l'expédition d'Egypte, uneaventure unique tant par sa postérité scientifique que par son exploitationpolitique.
Pour mener à bien ce projet inédit, le Musée municipal de La Roche-sur-Yonet la médiathèque Benjamin-Rabier ont pu compter sur des partenariats forts.Celui du Conseil général de Loire-Atlantique d'abord, avec l'important travailmené en étroite collaboration avec le musée Dobrée, mais aussi les contributionsde la Fondation Napoléon, du Musée de la Révolution française de Vizille, duMuseum d'Histoire Naturelle de Nantes, du Musée des Beaux-Arts de Nantes etd'Orléans, du musée Alfred-Canel de la ville de Pont-Audemer et bien d'autres.
Cette riche collaboration renouvelle la perception d'un événement majeur del'épopée napoléonienne, fondateur pour l'égyptologie, et qui continue d'inspirernotre imaginaire collectif, jusque dans la création contemporaine. Elle permetsurtout de donner accès au plus grand nombre au savoir, à la culture, en luidonnant toute sa place au cœur de la ville.
Sommaire
p. 6 | L 'Expéd i t ion d 'Egypte |Nicolas Grimai
p. 15 L'EXPEDITION D'EGYPTE. UNE EPOPEE MILITAIRE ET SCIENTIFIQUE
p. 16 | L'expédition de Bonaparte, « une conquêtedont les effets sur la civilisation et le monde sont incalculables » ? |Patrice Bret
p . 27 | Que lques repères chrono log iques |p. 32 | Petit abécédaire du bestiaire de l'expédition d'Egypte |
p. 36 | Nicolas-Jacques Conté (1755-1805), « l'homme-orchestre » de l'expédition d'EgypteHélène Jagot
p. 50 | L'argent : une « plaie d'Egypte » pour Bonaparte ? |Pierre Branda
p. 70 | « Quel bougre d'âne ! » Ou les malheurs d'un ambassadeur ottomanà Paris pendant l'Expédition d'Egypte |Sarah Chanteux
p. 77 LA NAISSANCE DE L'EGYPTOLOGIE (1798-1850)
p. 78 | La Description de l'Egypte. Trente ans de travaux. 1 798-1802-1829 |Paul-Marie Grinevald
p. 94 | Les perceptions britanniques de l'Expédition d'Egypte (1 798-1828) |Andrew Bednarski(Traduction Philippe Mainterot)
p. 110 | Le musée imaginaire de l'expédition d'Egypte :Les collections archéologiques formées de 1798 à 1801 |Patrice Bret
p. 138 | De l'égyptomanie a l'égyptologie : le role des voyageurs et des collectionneursPhilippe Mainterot
p . 172 | Le Scarabée Cai l l iaud |p. 174 | Les collections Cailliaud du Cabinet des Médailles jp. 178 | Les cartonnages Cai l l iaud |p. 182 | La couverture de momie de Khonsoumès |p. 186 ] La momie du Muséum d'Histoire naturelle de Nantes |p. 190 | Deux maquettes du Moyen Empire conservées au Musée Dobrée de Nantes
p. 192 | D'une Expédition à l'autre, de Bonaparte à Champollion (1798-1828) |Sylvie Guichard
p. 205 L'EXPEDITION EN EGYPTE. UN MODELE POUR LES ARTS
p. 206 | Le musée Charles X : un écrin pour les collections égyptiennes du Louvre |Hélène Jagot
p. 240 | L'Egypte dans les arts décoratifs au tournant du XIXe siècle :objet de fascination et outil de la propagande napoléonienne |Sébastien Quéquet
p. 262 | Jean-Léon Gérôme, Bonaparte entrant au Caire, le 21 juillet 1798 |Hélène Jagot
p. 268 | Les Champollions de l'OpéraDécors et costumes égyptiens à l'Opéra de Paris de 1789 à 1850 |Mathias Auclair
p. 280 | Présence de l'Egypte dans la musique savante européenne, du XVIIe au XXe siècleFlorence Collin
p. 296 | Or ienta l isme |
p. 305 L'EGYPTE. UN MYTHE SANS CESSE REINVENTE
p. 306 | Les mystères de l'Egypte ancienne dans la bande dessinée :petite fabrique d'un imaginaire historique |Vincent Marie
p. 334 J Liste des œuvres exposées |
p. 340 | Bibliographie selective |
p. 344 | Biographie des auteurs |
p. 348 | Remerciements |
Les œuvres exposées sont indiquées par une étoile : Fig. *
L'Expédition d'Egypte j
Nicolas GrimaiAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres
Lorsque le Directoire décida d'envoyer le général Bonaparte, auréolé de la gloiretoute fraîche de la campagne d'Italie, conquérir l'Egypte, ce n'était pas sansarrière-pensées. Vainqueur, il devenait plus que jamais le bras armé de la France ;vaincu, il était moins dangereux politiquement. Ce calcul, qui se voulait doublementgagnant s'avéra perdant sur toute la ligne : le désastre naval d'Aboukir, l'expéditionde Syrie [fig.1] et l'échec du siège de Saint-Jean d'Acre mirent un terme aux ambitions françaises sur les terres de la Sublime Porte. Malgré la victoire de la secondebataille d'Aboukir [fig. 2], la révolte gronde au Caire depuis les massacres d'octobre1798 [fig. il, et c'est un pouvoir fragile que Bonaparte remet à Kléber lorsqu'il quittel'Egypte en août 1799. Kléber assassiné en juin 1800, c'est le général Menou quicapitulera, un an plus tard, face aux Turcs et aux Anglais, après la défaire de Canope,et les débris de l'armée d'Orient seront rapatriés, sans gloire, par leurs vainqueursen septembre 1801. Entretemps, il y avait eu le 18 Brumaire et un premier consul,auréolé d'une nouvelle gloire entretenant sa légende, marchant à grands pas versl'empire [fig. 4-5-6).
Avant même que l'imagerie d'Épinal n'en diffuse, beaucoup plus tard, lesépisodes glorieux, avant même que les peintres de cour n'en figent la version officielle, la légende s'est très vite emparée de l'épopée orientale du futur empereur.On ne retient que la bataille des pyramides [fig. ?\, - du haut desquelles « quarantesiècles » étaient censés contempler une armée qui ne pouvait pas les voir depuisle champ de bataille - et la redécouverte d'un Orient lointain et mystérieux quin'est pas sans laisser, consciemment ou non, un léger arrière-goût de croisade.Plus de deux siècles d'amitié avec le pouvoir ottoman sont ainsi effacés, et c'est enlibérateur que Bonaparte débarque sur le sol égyptien. La phraséologie impérialenaissante développe ce subtil glissement de l'idéologie révolutionnaire au pouvoirdivin du futur monarque dès 1802, avec la première ébauche des Pestiférés deJaffa réalisée par Antoine-Jean Gros, puis en 1804 avec l'œuvre définitive [fig. 8),exposée le 18 septembre dans le tout nouveau musée du Louvre : dans unemosquée dominée par le drapeau tricolore, le général vainqueur, impavide, touchela poitrine d'un pestiféré, malgré la crainte d'un membre de sa suite, qui tente deretenir sa main. Le 2 décembre de la même année, Napoléon Ier est sacré empereurà Notre-Dame de Paris. Des Lumières à la Croix.
Trente ans plus tard, l'expédition de Morée procédera du même esprit,avec une référence encore plus marquée aux croisades, puisqu'il s'agira delibérer le « berceau de la civilisation européenne » - entendons les chrétiens duPéloponnèse - du joug turc.
Les deux expéditions ont un autre point en commun : les opérations de terrainse sont doublées d'une enquête scientifique, elle aussi dans l'esprit des Lumières,ne serait-ce que par son souci d'exhaustivité. Dans le cas de l'Egypte, l'espoird'une mainmise durable sur les rives du Nil avait incité Bonaparte à entreprendreun travail de fond, de façon à doter le pays de structures juridiques, administratives,
6 | L'Expédition d'Egypte
Fig. 1. Baron Gros, Combat de Nazareth, 1812Huile sur toile, 135 x 195 cmNantes, musée des Beaux-Arts, inv. 1005
Fig. 2. Baron Gros, Bataille d'Aboukir, 25 juillet 1799, 1806Huile sur toile, 578 x 968 cmVersailles, châteaux de Versailles et de Trianon, inv. MV2276
mais aussi scientifiques directement inspirées du modèle français. Cest ainsi que,à peine arrivé au Caire, il crée, le 26 août 1798, un Institut d'Egypte, sur le modèlede l'Institut de France, qui avait été mis en place trois ans plus tôt à Paris. Sesmissions, telles que définies par l'article 2 de son décret de création, étaient « leprogrès et la propagation des Lumières en Egypte, la recherche, l'étude et la publication des faits matériels, industriels et historiques de l'Egypte, de donner son avissur les différentes questions pour lesquelles il sera consulté par le gouvernement. »En quatre sections, l'Institut d'Egypte réunissait les plus brillants membres de laCommission des Sciences et des Arts, les cent cinquante six savants que le généralavait joints à l'expédition, une petite troupe inapte au combat mais aussi précieuseque les ânes, du moins si l'on en croit la légende de la bataille des pyramides !Pour la plupart ingénieurs issus des Ponts-et-Chaussées ou de Polytechnique, ilsrelevèrent, étudièrent tout ce qui, de la Méditerranée à la Cataracte, sans oublier lamer Rouge et l'Arabie, pouvait l'être, amassant, jusqu'à la défaite de Canope, unesomme immense de notes et documents, dont les soixante-deux séances de l'Institutd'Egypte, au fil de ces seulement trois années, donnent une idée vertigineuse.
Si le droit napoléonien survécut au départ des Français, tout comme la mise enplace d'une cartographie moderne ou l'imprimerie, la véritable postérité de l'Expédition fut la publication du travail des membres de la Commission des Scienceset des Arts, et ce dans les domaines les plus divers. La liste en est longue, mais onpeut évoquer la géologie avec Déodat Dieudonné Sylvain Guy Tancrède Gratet deDolomieu, qui avait publié en 1793 un Mémoire sur la constitution physique del'Egypte ; la zoologie avec Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, assisté d'Henri-JosephRedouté ; la botanique avec Al ire Raffeneau-Delile, qui introduit en France le lotuset le papyrus ; l'hydrographie par la commission Girard. Il faudrait encore ajouterles observations et études de Gaspard Monge, Claude-Louis Bertholet, Jean-JosephFourier, les relevés de monuments antiques de Jean-Baptiste Prosper Jollois etEdouard de Villiers du Terrage, les découvreurs du tombeau d'Amenhotep III àThèbes, les fouilles de Jean-Baptiste Lepère et Jean-Marie-Joseph Coutelle à Gîza etSaqqâra... L'inépuisable et inventif Nicolas-Jacques Conté fut l'homme-orchestrede l'Expédition : peintre, géomètre, hydraulicien, aérostier, chimiste, physicien,mécanicien, il approvisionne en armes et outils aussi bien les soldats que sesconfrères, les chirurgiens que les botanistes, multipliant inventions et observations,qui viendront enrichir la future Description de l'Egypte.
Il convient de réserver une place à part à Dominique Vivant Denon, extraordinaire observateur et dessinateur autant qu'habile arriviste, qui suit la campagnede pacification du delta, puis accompagne le général Desaix en Haute-Egypte àla poursuite de Mourad Bey, multipliant en treize mois, et non sans courage, aumilieu d'escarmouches et de combats incessants, relevés et plans de temples, vuesde monuments, scènes pittoresques campant aussi bien les habitants des rives duNil que les membres de la Commission au travail, détails architecturaux, voireinscriptions hiéroglyphiques. Revenu en France en même temps que Bonaparte, ilbrûle la politesse à ses collègues et publie son Voyage dans la Basse et la Haute-Egypte pendant les campagnes du général Bonaparte en 1802, soit juste aprèsle retour des derniers rescapés de l'aventure égyptienne. Les neuf volumes detextes et les 974 planches de la Description ne paraîtront que plus tard, de 1809 à
8 | L'Expédition d'Egypte
Fig. 3. * Lucien-Louis-jean-Baptiste Schmidt,d'après Horace Vernet, Le massacre des mameluks, avant 1865Huile sur toile, 98 x 109,5 cmLaval, musée du Vieux-Château, inv. 99.118.1
Fig. 4. * Anonyme, Allégorie en l'honneurdu Général Bonaparte, vers 1798Dessin à la plume, encre de Chine, aquarelleet rehauts de gouache sur traits au crayon, 36,6 x 51,4 cmVizille, musée de la Révolution française, inv. 1984.140
1 0 | L'Expédition d'Egypte
Fig. 5. * Antoine-François Callet,Tableau allégorique du 18 Brumaire an VIII, 1800Huile sur toile, 101 x 125 cmVizille, musée de la Révolution française, inv. 1995.37
I I
%éSi:k^, ^ \ J ^kV • »4W* flj. i i/flF/*4 J^>
1 '> ■ * ' • J ~ " " . ■«■ • ' r W r ^ « j b f ^
* 5 * ■ ' I - I- JK ^ ^ J l, g^ _^^fc^fc.IK ■"" ' '3b
12 | L'Expédition d'Egypte
1824, au terme de longues années de mise en forme et de rédaction, sous la féruled'Edme François Jomard, réalisées dans l'enceinte de l'Institut de France, devenuainsi l'éditeur de son frère d'Egypte, les principaux membres de la Commissionayant rejoint ses rangs.
La suite de l'histoire semble aller de soi, grâce à la géniale découverte deChampollion, qui rendit au monde l'intelligence des hiéroglyphes, jetant les basesnécessaires à la science qu'il inventait ainsi. L'ironie du sort voulut que ce soit lapierre de Rosette, saisie comme prise de guerre par l'armée britannique en 1801et exposée au British Museum dès l'année suivante, qui en devienne l'instrument.
Cet héritage scientifique et culturel valut dès lors à la France un rôle de premierplan en Egypte, aussi bien dans l'éducation que dans le domaine de la culture etdu patrimoine. C'est ainsi que la responsabilité du Service des Antiquités, créépar Auguste Mariette, fut confiée à des égyptologues français jusqu'à la révolution nassérienne. C'est sur le fonds créé par ces pionniers que notre pays restele premier partenaire de l'Egypte en matière d'archéologie et de protection dupatrimoine, jouant d'un réseau institutionnel sans équivalent, au centre duquelse trouve, depuis 1880, l'Institut français d'Archéologie orientale. La proximitéculturelle de l'Egypte et de la France est si fortement ressentie aujourd'hui encorede part et d'autre que, lorsqu'il s'est agi de célébrer le bicentenaire de l'Expédition d'Egypte en 1998, aucun des deux partenaires ne réalisa sur le moment qu'iln'était guère envisageable, du côté égyptien au moins, de fêter le souvenir d'uneinvasion et d'une conquête, même avortée, avec l'envahisseur ! Mais la diplomatiefait des miracles, et nous célébrâmes des « horizons partagés ».
Fig. 6. Jean-Pierre Franque,Allégorie de l'état de la France avant le retour d'Egypte, vers 1805Huile sur toile, 261 x 326 cmRaris, musée du Louvre, inv. 4560
Fig. 7. Baron Gros, Bonaparte haranguant l'arméeavant la bataille des Pyramides, 2 7 juillet 1798, 1810Huile sur toile, 389x311 cmVersailles, châteaux de Versailles et de Trianon, inv. MV1496
Fig. 8. Baron Gros, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, 1804Huile sur toile, 532 x 720 cmRaris, musée du Louvre, inv. 5064
13
Anne-Elisabeth Lusset, Responsables descollections.LucileTheveneau, Responsable d'éditionet d'expositions, Imprimerie Nationale, Paris.Général de division Christian Baptiste,Directeur du musée de l'Armée, Paris ;David Guillet, Directeur-adjoint en chargede la politique scientifique ; Emilie Robbe,Conservateur en charge du départementmoderne ; Thibault de Noblet, régisseur.Patrick de Carolis, Directeur du muséeMarmottan Monet ; Marianne Mathieu,Adjointe au Directeur, Chargée descollections et de la communication ; AntoninMacé de Lépinay, Aurélie Gavoille, Attachésde conservation.Mathilde Legendre, Directrice, Pont-Audemer, musée Alfred Canel.Anne Dary, Directrice du musée des Beaux-Arts de Rennes ; Anne-Laure Le Guen,régisseur.David Caméo, Directeur général, Sèvres,Cité de la Céramique ; Virigine Desrante,Conservateur ; Virginie Pays, chargée durécolement et du mouvement des œuvres.Sophie Join-Lambert, Directrice,musée des Beaux-Arts de Tours ;Véronique Moreau, Conservateur en chargedes collections XIXe' siècle.Emmanuelle Delapierre, Directrice, muséedes Beaux-Arts de Valenciennes ; MarcGoutierre, Régisseur.Alain Chevalier, Conservateur en Chef,Directeur du musée de La RévolutionFrançaise, Vizille ; Caroline Dugand, Adjointeau directeur, en charge des collections.
| C a t a l o g u e |
Direction éditoriale :Philippe Mainterot, Hélène JagotRecherches iconographiques, relecture :Hélène JagotTraduction : Philippe Mainterot.Édition : Fage éditions, LyonMaquette : 835Impression : Alpha, PeaugresFaçonnage : Alain, Felines
«IJ-L ni !Uiil- I B -Ni. MM
musée de FranceLoireAt lant ique *y Af/°~ t yLa Roche-sur-Yon
Crédits photographiques
© Arc'Antique/J.G. Aubert© Besançon, Bibliothèque municipale© Bordeaux, Mairie/L. Gauthier© Châlon-sur-Saone, musée Denon© Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, UK/The Bridgeman Art Library© Fondation Napoléon/François Doury© Fonds ancien de la bibliothèque du museum d'histoire/Patrick Jean© Laval, Musées© Londres, The British Museum, Dist. RMN-Grand Palais/The Trustees of the British Museum/Giraudon© Marseille, Musées/R. Chipault-B. Soligny© Moulins, Musée Anne-de-Beaujeu/Jérôme Mondière© Nantes, Musée des Beaux-Arts/T. Richard© Nantes, Musée Dobrée, Conseil général de Loire-Atlantique/Chantal Hémon/Christian Letertre/Hervé Neveu-Dérotrie© Nantes, Muséum/Patrick Jean© Paris, Bibliothèque Nationale de France© Raris, Les Arts Décoratifs/Jean Tholance© Paris, Mines ParisTech, Bibliothèque et Centre de recherche en informatique© Raris, Musée de l'Armée, Dist. Rmn-Grand Palais/Martine Beck-Coppola/Marie Bruggeman/Emilie Cambier/ Christian Decamps/Georges Poncet/Tony Querrec/ Etienne Revault/Fanny Reynaud© Paris, Musée Marmottan Monet/Giraudon/The Bridgeman Art Library© Raris, Muséum national d'Histoire naturelle, Dist. RMN-Grand Palais/image du MNHN,bibliothèque centrale© Paris, Rmn-Grand Palais (Château de Versailles)/Daniel Arnaudet/Jean-Gilles Berizzi/Gérard Blot//Yann Martin/Jean Schormans/Franck Raux/ Peter Willi© Paris, Rmn-Grand Palais (musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau)/Daniel Arnaudet© Raris, Rmn-Grand Palais (musée du Louvre)/ Daniel Arnaudet/Martine Beck-Coppola/Michèle Bel lot/Jean-Gilles Berizzi/Gérard Blot/Les frères Chuzeville/Christian Jean/Thierry Le Mage/Hervé Lewandowski/Stéphane Maréchal le/René-Gabriel Ojéda/ Georges Poncet/Franck Raux© Rennes, Musée des Beaux-Arts, Dist. RMN-Grand Palais/Adélaïde Beaudoin/Jean-Manuel Salingue© Rixheim, Musée du Papier Peint©Thurgovie, musée Napoléon/Arenenberg© Tours, Musée des Beaux-Arts©Vizille, Musée de la Révolution française
© Andrew Bednarski©Jacques Boulissière© Gérard Blot© Ghislaine Gendron© Hélène Jagot© François Lauginié© Philippe Mainterot© Daniel Molinier© Jean Schormans© ArnouldThenard
Tous droits réservés
© Fage éditions, Lyon, 2013Achevé d'imprimer en décembre 2013Dépôt légal décembre 2013ISBN: 978 2 84975 315 6
Lorsque le Directoire décide d'envoyer le général Bonaparte, auréolé dela gloire toute fraîche de la campagne d'Italie, conquérir l'Egypte, ce n'estpas sans arrière-pensée. Vainqueur, il devient plus que jamais le bras arméde la France ; vaincu, il est moins dangereux politiquement. Ce calcul, quise veut doublement gagnant s'avère perdant sur toute la ligne.On ne retient que la bataille des pyramides-du haut desquelles « quarantesiècles » étaient censés contempler une armée qui ne pouvait pas lesvoir depuis le champ de bataille - et la redécouverte d'un Orient lointainet mystérieux qui n'est pas sans laisser, consciemment ou non, un légerarrière-goût de croisade.Il entreprend un travail de fonds, de façon à doter le pays de structuresjuridiques, administratives, mais aussi scientifiques directement inspiréesdu modèle français. Le 26 août 1798, un Institut d'Egypte est créé surle modèle de l'Institut de France. En quatre sections, l'Institut d'Egypteréunissait les plus brillants membres de la Commission des Scienceset des Arts, les cent cinquante-six savants que le général avait joints àl'expédition, une petite troupe inapte au combat mais aussi précieuseque les ânes, du moins si l'on en croit la légende de la bataille despyramides ! Pour la plupart ingénieurs issus des Ponts-et-Chaussées ou dePolytechnique, ils relevèrent, étudièrent tout ce qui, de la Méditerranéeà la Cataracte, sans oublier la mer Rouge et l'Arabie, pouvait l'être,amassant, jusqu'à la défaite de Canope, une somme immense de notes etdocuments, dont les soixante-deux séances de l'Institut d'Egypte, au fil deces seulement trois années, donnent une idée vertigineuse.
Os^ S : P r i x : 2 5 €U . I S B N : 9 7 8 2 8 4 9 7 5 3 1 5 6 7 8 2 8 4 9 " 7 5 3 1 5 6