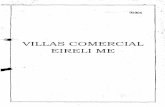Sierentz "Les Villas d'Aurèle" (Haut-Rhin, France)
Transcript of Sierentz "Les Villas d'Aurèle" (Haut-Rhin, France)
ANTEA-Archéologie 11 rue de Zurich -F- 68440 HABSHEIMTel. +333 89 65 35 80 - Fax +333 89 31 42 16
email : [email protected] 420 509 200 00036 - NAF 742 C
Avec la collaboration de :
Titulaire de l’opération : Luc VERGNAUD
Hélène BARRAND-EMAMLoïc BOURYSébastien GOEPFERT
SIERENTZ“Les Villas d’Aurèle”
Alsace, Haut-Rhin (68)
Service Régional de l’ArchéologieAlsace
N°OA : 5518N°de site : 68 309 0030Dates d’interventions : du 31/05/2010 au 15/06/2010.N° de prescription : 2010/105 du 14/04/2010N° d’autorisation : 2010/151 du 14/05/2011
Rapport final d’opération d’Archéologie préventive Avril, 2012
N°OA : 5518N°de site : 68 309 0030Dates d’interventions : du 31/05/2010 au 15/06/2010.N° de prescription : 2010/105 du 14/04/2010N° d’autorisation : 2010/151 du 14/05/2011
Avec la collaboration de :
Titulaire de l’opération : Luc VERGNAUD
Service Régional de l’ArchéologieAlsace
Rapport final d’opération d’Archéologie préventive Avril, 2012
Hélène BARRAND-EMAMLoïc BOURYSébastien GOEPFERT
SIERENTZ“Les Villas d’Aurèle”
Alsace, Haut-Rhin (68)
IDENTITÉ DU SITE
Région : AlsaceDépartement : Haut-Rhin (68)Commune : SierentzCode INSEE : 57672Dénomination : « Les Villas d’Aurèle »Lieu dit : « Rue du Monenberg »N° OA : 5518N° de site : 68 309 0030
Cadastre année : 2009 Section : 9 Parcelle(s) : 1 à 4, 8, 10 à 17, 27, 353, 355, 357 à 359.
Coordonnées Lambert II étendu :
Zone sud : A : X = 984139.580 Y = 307000.724 Z = 282.940 B : X = 983963.861 Y = 306983.172 Z = 280.198 C : X = 983957.401 Y = 306926.288 Z = 282.170 D : X = 984152.931 Y = 306886.949 Z = 288.982
Zone nord : A2 : X = 984088.269 Y = 307071.106 Z = 275.986 B2 : X = 984063.104 Y = 307064.511 Z = 276.454 C2 : X = 984068.192 Y = 307017.288 Z = 279.738 D2 : X = 984102.880 Y = 307009.160 Z = 282.411
Maître d’ouvrage des travaux : Société foncière Hugues Aurèle – 22 rue d’Issenheim – 68190 RAEDERSHEIM
OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE
Arrêté de prescription n° : 2010/105 en date du 14/04/2010Arrêté d’autorisation de la fouille n° : 2010/151 en date du 14/05/2011Responsable de l’opération : Luc VERGNAUD (ANTEA-Archéologie)Opérateur archéologique : ANTEA-Archéologie, 11 rue de Zürich, 68440 HabsheimNature du projet d’aménagement : LotissementSurface décapée : 18919,80 m²Dates d’intervention sur le terrain : du 31 mai 2010 au 15 juillet 2010.
RésultatsMots clés
Chronologie : Néolithique moyen, Néolithique récent, Néolithique final, Bronze final, Hallstatt.
Nature des vestiges immobiliers :Néolithique moyen : fosses, fentesNéolithique récent : sépultures, fosses circulaires, fosses-silosNéolithique final : sépulturesBronze final : fosses Hallstatt : fosses, fosses-silos
Nature des vestiges mobiliers :Néolithique moyen : Céramique, lithique.Néolithique récent : Céramique, lithique, outils en matière dure animale, ossements hu-
mains, ossements animaux.Néolithique final : Céramique, lithique, parure en matière dure animale, fragments de mar-
cassite, ossements humains, ossements animaux.Bronze final : Céramique, lithique, métal, ossements animaux.Hallstatt : Céramique, lithique, ossements animaux.
Notice sur la problématique de la recherche et les principaux résultats de l’opération
Le passé de Sierentz est plutôt bien connu, notamment grâce aux nombreuses fouilles réalisées depuis la fin des années 70 dans la partie nord de la commune près de la petite cha-pelle de la Hochkirch (Tiergarten, Sandgrube, Zac HOELL). Le site des « Villas d’Aurèle » est lui situé au sud, il semblait donc intéressant de documenter une zone entièrement vierge de recherche. Qui plus est, le contexte topographique et géologique est sensiblement différent du secteur de la Hochkirch : on se trouve ici dans les premiers contreforts lœssiques du Sundgau oriental. A l’issue de l’opération d’évaluation, la problématique principale était de mieux appré-hender l’occupation du Néolithique récent qui avait été repérée et qui se matérialisait princi-palement par un ensemble de fosses circulaires (dont une contenait des inhumations) et des fentes. La fouille a permis la mise au jour de plusieurs occupations datant de différentes pé-riodes, essentiellement néolithique mais aussi protohistoriques.
Le Néolithique moyen (groupe de Bruebach-Oberbergen) est représenté par trois fosses circulaires et surtout un ensemble de 34 fentes, incluant celles déjà repérées lors du diagnostic, dont l’organisation spatiale est inédite. Orientées sud-ouest / nord-est, elles sont disposées le long d’un couloir sud-est / nord-ouest d’une trentaine de mètres de large traver-sant la zone fouillée du nord au sud.
Objet principal de la problématique originelle, l’occupation du Néolithique récent repé-rée lors du diagnostic n’a été complétée que par cinq fosses circulaires dont une seule conte-nait une inhumation. L’étude de l’ensemble céramique qu’elles ont livré, associée à une série de datation au carbone 14, a permis d’alimenter la récente remise en question de la typo-chro-nologie de cette période.
La fin du Néolithique est marquée par quatre sépultures campaniformes. Disposées sur un axe nord-ouest / sud-est, elles contenaient les corps d’un enfant, d’une femme et de deux hommes. L’excellent état de conservation des tombes masculines a en outre permis la reconnaissance d’une architecture en bois. D’une manière générale, ce type de découvertes
est assez rare en Alsace, seuls deux sites de cette période ayant été mis au jour depuis la fin des années 60. Leur état de conservation et leur riche mobilier font des sépultures de Sierentz une découverte majeure de cette période dans la région.
Le site est ensuite occupé durant la Protohistoire, mais les indices qui ont pu être mis au jour lors de la fouille restent cependant assez réduits et la nature de ces occupations n’a pu être précisée.
Le Bronze final IIb est essentiellement représenté par un ensemble de 15 fosses cir-culaires et de fosses-silos. Certaines de ces fosses contenaient des dépôts de vases entiers et s’organisaient le long d’un axe sud-ouest / nord-est dans la moitié ouest de l’emprise. Six autres fosses et silos sont datés du Hallstatt D1. Il est possible que durant ces périodes, la zone d’occupation humaine principale soit plutôt à chercher dans la partie nord la commune. Enfin quelques menus indices d’occupations postérieures, éventuellement romaines, ainsi qu’une probable aspergerie d’époque Moderne et/ou Contemporaine ont été mis en évi-dence.
Lieu de conservation provisoire du mobilier pour étude : Antea-Archéologie, 11, rue de Zürich, 68440 Habsheim.Lieu de conservation présumé du mobilier à l’issue de l’opération : /Etat sanitaire du mobilier archéologique : Bon.
Composition du rapport
Nombre de volumes : 1Nombre de figures dans le texte : 133Nombre de planches hors texte : 54
Nombre d’annexes : 5
1
GENERIQUE DE L’OPERATION
Chargés scientifiques pour la DRACDominique BONNETERRE, Olivier KAYSER
Direction scientifique pour Antea ArchéologieMuriel ROTH-ZEHNER
Responsable d’opérationLuc VERGNAUD
Adjoint au responsable d’opérationSimon COUBEL
Archéologues sur le terrainSimon COUBEL, Luc VERGNAUD
avec la participation de : Sébastien GOEPFERT, Annaïg LE MARTRET, Bertrand PERRIN
Archéo-anthropologues sur le terrainHélène BARRAND-EMAM, Emilie CARTIER-MAMIE
Etudes du mobilier :- Mobilier céramique :
Néolithique : Luc VERGNAUD ; Protohistoire : Sébastien GOEPFERT- Mobilier lithiqueLuc VERGNAUD
- Mobilier en matière dure animaleLoïc BOURY (sauf Campaniforme : Luc VERGNAUD)
- Archéo-zoologieLoïc BOURY
- Archéo-anthropologieHélène BARRAND-EMAM
Réalisation des figures et des planches (D.A.O.)Loïc BOURY, Hélène BARRAND-EMAM, Sébastien GOEPFERT, Luc VERGNAUD
Topographie et réalisation des plans (D.A.O.) : Sébastien GOEPFERT, Luc VERGNAUD
Mise en page du rapport (P.A.O.)Luc VERGNAUD
Avec aussi la participation de Jérôme FRITSCHY et Laetitia SCHOTT-TOULLECMerci aussi à Anthony DENAIRE
Conditions administratives et financièresL’aménageur a mis les moyens financiers et matériels nécessaires à la réalisation des
recherches archéologiques sur le terrain.
Sauf mention contraire, toutes les illustrations photographiques sont créditées à : Antea Archeologie
2
LISTE DES ABREVIATIONS DES NOMS PROPRES
ALM : Annaïg LE MARTRETAntea-Archéologie, Archéologue, Numismate
Master 2 (Période romaine), Université de Dijon
BP : Bertrand PERRINAntea-Archéologie, Archéologue
Master 2 (Période néolithique), Université Marc Bloch, Strasbourg
ECA : Emilie CARTIER-MAMIEAntea-Archéologie, Archéologue, Anthropologue
DEA (Archéo-anthropologie (Période médiévale), Université de Dijon
HBE : Hélène BARRAND-EMAMAntea-Archéologie, Archéologue, Anthropologue
Docteur es Archéo-anthropologie (Période romaine), Université de Dijon
JFR : Jérôme FRITSCHYAntea-Archéologie, Archéologue
Master 2 (Période antique), Université de Grenoble
LB : Loïc BOURYAntea-Archéologie, Archéologue, Archéozoologue
Master 2 (Archéozoologie), Université de Strasbourg
LST : Laetitia SHOTT-TOULLECAntea-Archéologie, Archéologue
Master 2 (Période médiévale), Université de Strasbourg
LV : Luc VERGNAUDAntea-Archéologie, Archéologue
Masters 2 (Période néolithique), Université de Toulouse II-Le Mirail
SCO : Simon COUBELAntea-Archéologie, Archéologue
SGO : Sébastien GOEPFERTAntea-Archéologie, Archéologue
Master 2 (Période protohistorique), Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne
10
Projet scientifique et technique d’intervention
(PSTI) à
Commune de SIERENTZ Lotissement « Les Villas d’Aurèle »
Dénommée
« SIERENTZ – Les Villas d’Aurèle »
Site d’occupation préhistorique
Présenté par le bureau d’études ANTEA-Archéologie Sàrl
Maîtres d’ouvrage de l’opération : Opérateur archéologique :
Contrat : 2010/04/005 N° d’opération : 224
Foncière Hugues Aurèle 22 rue d’Issenheim 68190 Raedersheim
Tél. : +333.89.48.19.52 Fax. : +333.89.48.02.70
Mél : [email protected]
ANTEA Archéologie s.à.r.l. 11, rue de Zurich
F – 68440 HABSHEIM Tél. : +333.89.65.35.80 Fax. : +333.89.31.42.16
Mél : [email protected]ément en qualité d’opérateur
d’archéologie préventive délivré le 15.12.2004 (J.O. du 08/01/2005),
renouvelé et étendu le 08/01/2010 ( J.O. du 20/01/2010
Copie du projet scientifique et technique d’intervention
11
Contrat : 2010/04/005 N° d’opération : 224
Dossier déposé au titre de :
- du Livre V du Code du Patrimoine ;
-la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, texte consolidé avec la loi n° 2003-707 (NOR : MCCX9900003L) ;
- l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004, relative au code du patrimoine ;
-au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive (NOR : MCCX0400056D) ;
-la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement ;
-aux arrêtés du 25 août 2004, du 8 juillet 2004, du 16 septembre 2004, du 27 septembre 2004 précisant le décret n° 2004-490.
-à l’arrêté du 15 décembre 2004 portant agrément en qualité d’opérateur d ‘archéologie préventive de la S.à.r.l. ANTEA Sàrl, publié au Journal Officiel de la République Française n°6 du 8 janvier 2005.
-à l’arrêté du 8 janvier 2010 portant renouvellement et extension de l’agrément en qualité d’opérateur d ‘archéologie préventive de la S.à.r.l. ANTEA-Archéologie Sàrl, publié au Journal Officiel de la République Française n°16 du 20 janv ier 2010.
-à l’arrêté SRA (Alsace) n° 2010/105 en date du 14 avr il 2010, prescrivant une fouille préventive sur les terrains concernés par la présente opération, donnant suite à l’avis de la Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique (CIRA) en date du 30-31 mars 2010.
12
Projet scientifique et technique d’intervention 03/05/2010 page 3Site : SIERENTZ –Lot. Les Villas d’Aurèle Maîtres d’ouvrage : Foncière Hugues Aurèle
Sommaire du dossier
I. Présentation générale du projet p. 4
II. Projet scientifique et technique de l’intervention de terrain
p. 4
II.1 Contexte archéologique de l’opération p. 4II.2 Synthèse des connaissances et analyse critique en vue
de l’élaboration du projet de fouille p. 5
II.3 Proposition d’objectifs pour la fouille p. 6II.4 Proposition de protocole d’intervention pour la fouille p. 7
III. Projet scientifique et technique pour l’étude post-fouille
p.8
III.1 Etude du secteur de fouille p. 8III.2 Stabilisation et restauration des mobiliers p. 8III.3 Analyses et datations p. 8III.4 Synthèse du rapport p. 8
IV. Projet technique d’intervention sur le terrain p.9
V. Quantitatif prévisionnel de l’opération p.10V.1. Quantitatif prévisionnel des moyens archéologiques p.10V.2. Quantitatif prévisionnel des moyens techniques p.10
1) Logistique/base vie p.102)Terrassements p.103) Remise en état du site p.104) Sous-traitance p.115) Délais et date de démarrage p.11
VI. Personnel mobilisable pour l’intervention-Constitution prévisionnelle de l’équipe de fouille
p.12
VII. Bibliographie sommaire de référence p.13
VIII. CVs p. 14
Annexe - Cahier des charges du SRA p. 15
13
Projet scientifique et technique d’intervention 03/05/2010 page 4Site : SIERENTZ –Lot. Les Villas d’Aurèle Maîtres d’ouvrage : Foncière Hugues Aurèle
I. Présentation générale du projet
En décembre 2009, une évaluation a été réalisée sur l’emprise prévue du lotissement ‘Les Villas d’Aurèles » à Sierentz. Le projet d’aménagement de 45 257m2 est soutenu par la Foncière Hugues Aurèle. Le caractère positif du diagnostic a impliqué une prescription de fouille de sauvetage sur une partie de l’emprise du projet.
II. Projet scientifique et technique de l’intervention de terrain
II. 1 Contexte archéologique de l’opération
L’opération aura lieu dans une commune riche et assez bien connue sur le plan archéologique. La grande densité en vestiges archéologiques connus se situe principalement, près du giratoire de la route nationale, bordant la chapelle de la Hochkirch, au Nord de la commune. C’est dans ce secteur qu’ont été menées de nombreuses campagnes de fouilles entre 1977 et 1987, puis ponctuellement entre 1988 et 2003 et enfin lors d’une importante intervention en 2006 (ZAC HOELL et Bassin d’infiltration). On dispose ainsi pour ce secteur d’une bonne vision de l’occupation antique du site, puisque plusieurs hectares ont ainsi pu être décapés et fouillés intégralement.
L’occupation du site, quasi-ininterrompue entre le néolitique et le Bas-Empire romain, peut se décomposer de la manière suivante :
Pour le néolithique : on se trouve sur un site d’habitat rubané (néolithique ancien) qui se caractérise par de nombreux bâtiments qui semblent s’implanter le long de chenaux fossiles. Près d’une quinzaine de ces édifices ont été repérés, ce qui fait de Sierentz le site le mieux connu du Haut-Rhin pour cette période. Quelques tombes de la même période ont été fouillées à plusieurs centaines de mètres au Nord. Des traces d’occupation sporadique datée du Grossgartach ont également été observées.
Pour l’âge du Bronze, le site a livré des vestiges diffus mais néanmoins répartis dans tous les secteurs fouillés : il s’agit soit de fosses, soit de structures empierrées de type « fours polynésiens ». La répartition homogène des vestiges permet de penser que l’on se trouve soit en périphérie d’une occupation importante, soit directement à l’emplacement d’un site mal conservé (érosion). En 2006, la mise en évidence d’une partie d’une nécropole à incinération confirme cette hypothèse.
Pour le premier âge du fer (Hallstatt), les découvertes étaient peu représentées jusqu’en 2006 : quelques fosses et du mobilier erratique. L’intervention sur la ZAC HOELL en 2006 a permis de mettre au jour ce que l’on peut raisonnablement considéré comme une partie d’un habitat groupé, voire d’un véritable village pour le Hallstatt D3, puisque plus d’une vingtaine de bâtiments ont été étudiés. Il est par ailleurs probable qu’une nécropole tumulaire proche située dans la forêt de la HARDT, et située à quelques centaines de mètres seulement du point de découverte cité supra correspond à la zone funéraire qui lui est lié.
La fin du second âge du fer est également très bien représentée à Sierentz : on y a observé la présence d’un vaste ensemble organisé le long d’un axe routier (future voie romaine Kembs /Mandeure). De nombreux enclos fossoyés limitent des espaces occupés par des bâtiments en bois et des installations artisanales (fours de potiers). L’extension du site Laténien peut être estimée à plus d’une dizaine d’hectares. Il s’agit probablement d’une implantation de type agglomération rurale, ou éventuellement d’une importante ferme indigène.
Le vicus romain qui s’installe dans la suite directe de l’occupation laténienne en reprend ses principales caractéristiques : l’agglomération s’installe autour d’un
14
Projet scientifique et technique d’intervention 03/05/2010 page 5Site : SIERENTZ –Lot. Les Villas d’Aurèle Maîtres d’ouvrage : Foncière Hugues Aurèle
croisement routier (voie Est Ouest déjà évoquée et voie Nord Sud (Augst/Biesheim). Les fouilles ont mis au jour de nombreux bâtiments appartenant essentiellement à des installations à vocations artisanales variées. L’organisation du site semblent être centrée sur le croisement de route où une vaste aire empierrée a été ponctuellement appréhendée. L’étendue du site est globalement connue, allant du pied des coteaux à l’Ouest jusqu’au niveau de la voie ferrée Mulhouse/Bâle à l’Est, sur une largeur Nord-Sud d’environ 300m. D’un point de vue chronologique, le site prend son essor au début de notre ère et fonctionne jusqu’au Vème siècle comme en atteste une vaste nécropole à inhumations du Bas-Empire. Pour cette dernière phase, les vestiges d’habitat n’ont pas encore été réellement étudiés et doivent se trouver dans un secteur différent (probablement au Sud-ouest du giratoire). En 2006, des éléments complémentaires ont été retrouvés, notamment une partie du réseau viaire, une zone clairement cultuelle, ainsi que divers bâtiments permettant de compléter le plan du vicus.
Enfin, les quelques traces d’occupations plus tardives et mal datées entrevues avant 2006 (caves du Moyen-Age) peuvent depuis l’intervention de 2006 sur la ZAC HOELL et le secteur du Bassin d’infiltration jouxtant le giratoire, être plus précisémment qualifier : il existait effectivement dans ce secteur une agglomération entre la Xème et la XIIIème siècle, probablement organisée autour du lieu de culte de la Hochkirch. En effet, de nombreux fonds de cabanes et du mobilier caractéristique ont été analysés.
On l’a vu, les principaux vestiges connus à Sierentz se concentrent au Nord de la commune. Le diagnostic de 2009 est situé à près de 2km au sud de cette concentration et on se trouve ainsi dans une zone peu documentée (on rappellera que les premières tranches du lotissement, déjà achevées, n’ont pus être sondées) : il probable que la configuration du site n’ait rien à voir avec les schémas d’organisation connus près de la Hochkirch. C’est donc un site inédit et vierge de recherche qui doit être reconnu. Il convient également de souligner que le contexte géographique et topographique diffère sensiblement du secteur de la Hochkirch : on se trouve dans les premiers contreforts lœssiques du Sundgau Oriental.
II. 2 Synthèse des connaissances et analyse critique en vue de l’élaboration du projet de fouille
Suite au diagnostic archéologique, l’occupation ancienne des terrains semble être limitée à la période du néolithique récent. En effet, les sondages ont montré sur la quasi-totalité de l’emprise la présence de fentes, fosses et silos contenant des éléments attribuables typologiquement à la période du Munzingen. Afin de cerner au mieux le gisement, la prescription de fouille porte sur une zone centrale d’environ 12 000m2 qui englobe l’essentiel des structures circulaires (fosses ou silos avec ou sans inhumation) mais qui ne touchera pas le secteur où se concentrent les fentes.
Les acquis :La répartition spatiale des vestiges est peu éloquente, en dehors d’un secteur ou semble se concentrer les fentes (sdg, 79 à 81). L’état de conservation des vestiges semble bon pour les fosses ou silos : en effet les travaux récents montrent que la différence de profondeur des structures encavées est liée à une différence fonctionnelle et/ou morphologique et non à l’érosion : à titre d’exemple, le silo Sp 110 est excessivement bien conservé, tout comme la plupart des fentes. La seule datation pour les vestiges trouvée s’appuie sur la typologie des silos contenant des inhumations et le mobilier céramique associé : le faciès représenté s’oriente vers le Munzingen, probablement dans sa phase ancienne. L’étendue du site est assez remarquable pour la période si l’ensemble des vestiges s’avère effectivement synchrone puisque l’on s’approche d’un minimum de 2,5hectares. Pour cette période la plupart des ensembles reconnus dans le Haut-Rhin jusqu’à présent s’organisent a priori par « grappes » de silos s’étendant sur quelques dizaines d’ares au plus.
15
Projet scientifique et technique d’intervention 03/05/2010 page 6Site : SIERENTZ –Lot. Les Villas d’Aurèle Maîtres d’ouvrage : Foncière Hugues Aurèle
Les problématiques en suspens :
L’analyse des gisements du Munzingen et en général du néolithique récent a ces dernières années considérablement progressé notamment grâce à la démultiplication des sites trouvés en archéologie préventive. Cette situation est encore plus éloquente pour le sud du Haut-Rhin (ensemble de Didenheim –rocade ouest et ZAC Collines, Wittenheim-lot. Du Moulin) mais également dans le secteur de Strasbourg (fouilles liées à la LGV Est-européenne). Des avancées sont notables sur l’affinement des chronologies et sur la caractérisation des ensembles, désormais nombreux, de sites comportant des silos avec inhumation(s). Des interrogations demeurent néanmoins, et le site de Sierentz pourrait contribuer à y répondre : -En premier lieu, la fouille devra permettre de confirmer la datation et d’élaborer le plan des vestiges de ce nouveau site Munzingen, qui étend ainsi vers le sud l’aire de répartition connue de ce type de gisement. -la fouille devra permettre de vérifier une nouvelle fois la destination de nombreux silos qui reçoivent des dépôts humains (proportion, cohabitation avec des silos à comblement strictement détritiques), -la collecte d’artéfacts céramiques ou lithique de cette période contribuera certainement à la mise au point d’une typochronologie de cette étape du néolithique, permettant éventuellement la mise en évidence de groupes culturels déjà soupçonnés, et particulièrement au regard d’influences en provenance de Suisse (Cortaillod). Cette étude devra s’appuyer sur une campagne de datation 14C la plus conséquente possible, afin de faire suite aux nombreuses dates absolues déjà , ou en passe, d’être collectées sur des sites contemporains : eu égard à la relative rareté des mobiliers, il semble en effet que seule une telle approche puisse permettre de préciser les aspects chronologiques. -l’analyse fine d’une surface assez conséquente permettra peut-être enfin de dégager un plan d’aménagement interprétable, voire de constructions, lesquelles manquent encore cruellement.
II. 3 Proposition d’objectifs pour la fouille
Globalement la fouille devra permettre de répondre aux questions figurant dans le cahier des charges annexé à la prescription du 14/04/2010 ainsi qu’à celles rappelées dans le développement préalablement soulevées en II.2, et hiérarchisées comme suit :
− Recherche des traces des vestiges, − établissement du plan des vestiges − caractérisation de la nature, de la fonction et compréhension de l'organisation spatiale des
vestiges. − mise en évidence de l'évolution chronologique des vestiges, établissement du phasage de
l'occupation (essentiellement pour les recoupements éventuels permettant d'obtenir au minimum des datations relatives)
− mise en relation de l'ensemble avec des sites et établissements de la même période, dans les environs proches du secteur de fouille. Cette approche passera inévitablement par une étude typochronologique fine des mobiliers, essentiellement céramique.
− Approche paléoenvironnementale et géoarchéologique susceptibles de préciser l'environnement des occupations mises en évidence (si une telle problématique s’avère pertinente).
16
Projet scientifique et technique d’intervention 03/05/2010 page 7Site : SIERENTZ –Lot. Les Villas d’Aurèle Maîtres d’ouvrage : Foncière Hugues Aurèle
II. 4 Proposition de protocole d’intervention pour la fouille
La fouille envisagée devra permettre d’atteindre les objectifs proposés en II.3 en optimisant l’intervention technique sur le terrain.
La stratigraphie type est à peu près similaire sur l’ensemble des terrains à fouiller. La couverture végétale est plus limitée dans les secteurs amonts et les vestiges apparaissent en moyenne entre 60 et 80cm de profondeur sur le toit du substrat de loess, même si elles sont déjà perceptibles dans le revêtement de lehm intermédiaire. A l’issue du décapage, un relevé des vestiges sera réalisé au 1/100 par l’opérateur, en fonction de repères principaux installés par un géomètre (bornage du projet de lotissement). Ce plan sera immédiatement informatisé afin d’être disponible à J+1 ou 2 sur le chantier pour la gestion de la fouille.
Après décapage et relevé en plan des structures identifiées, il conviendra de vérifier au préalable la cohérence de certains ensembles (alignements évidents, répartition des diverses fosses,espaces vides, plans de maison sur poteaux, etc)
Les différents éléments feront l’objet d’un traitement « classique » : fouille partielle, relevés graphiques et photographiques, fouille complètes pour datation si nécessaire et prélèvements en fonction de l’état des sédiments ou des structures (paléo environnement, datation physique). Le recours à la mini-pelle sera privilégié pour les fosses importantes ou si le nombre de structures s’avèrerait plus important que prévu. De manière générale et hormis les précisions qui viennent d’être apportées, la fouille se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent projet.
17
Projet scientifique et technique d’intervention 03/05/2010 page 8Site : SIERENTZ –Lot. Les Villas d’Aurèle Maîtres d’ouvrage : Foncière Hugues Aurèle
III. Projet scientifique et technique pour l’étude post-fouille
La fouille générera vraisemblablement une importante masse d’informations qu’il conviendra au préalable d’ordonner : le soin apporté à l’enregistrement lors de la phase terrain et la tenue d’inventaires chantier facilitera ce travail. A l’issue de la phase terrain, une réunion permettra de définir les moyens affectés aux différents travaux et de préciser les objectifs prioritaires de l’étude s’ils risquent de différer des choix initiaux.
III. 1 Etude du secteur de fouille
La fouille projetée entre dans une typologie habituelle d’interventions : en ce sens, l’exploitation post-fouille des données ne devrait pas poser de problème particulier et n’appelle pas de moyens spécifiques à préciser dans le projet d’intervention.
Toutefois il convient d’en rappeler les principaux thèmes et objectifs :
1) Élaboration des plans masses complets de la zone étudiée et préparation des plans synthétiques de phasage permettant la compréhension des informations consignées dans le rapport.
2) Élaboration et mise au net des documents graphiques (stratigraphies, plans de détails,etc)
3) Étude du mobilier retrouvé, lavage, dessin et conditionnement. 4) Élaboration des typochronologies du mobilier ou échantillonnage. 5) Élaboration des inventaires et catalogues nécessaires (mobilier, structures, etc) 6) Études paléoenvironnementales et datation physiques éventuelles. 7) Mise en contexte de la fouille, confrontation et comparaison des résultats. 8) Élaboration du rapport final d’archéologie préventive.
L’ensemble de ces opérations sera menée conformément aux normes en vigueur, particulièrement celles définies par les arrêtés du 25 août 2004, du 8 juillet 2004, du 16 septembre 2004, du 27 septembre 2004 précisant le décret n° 2004-490.
III. 2 Stabilisation et restauration des mobiliers
Le laboratoire d’archéologie des métaux de Jarville sera pressenti pour mener les éventuels travaux de restauration et/ou de stabilisation des objets métalliques. En fonction de la quantité d’objets trouvés à l’issue du chantier, difficilement évaluable, des choix seront arrêtés quant aux éléments à traiter. S’il est certain que les objets en métaux précieux ou de grande taille seront prioritaires, l’intérêt scientifique, historique ou chronologique des autres artéfacts devra également être pris en compte. Ces choix seront arrêtés en accord avec le SRA.
III. 3 Analyses et datations
Concernant les datations physiques, en particulier les datations au radiocarbone, elles pourront aisément être mises en œuvre sur des éléments relativement bien conservés. Les dates physiques seront donc utilisées pour dater des inhumations sans mobilier ainsi que les éventuelles structures particulières afin de vérifier leur appartenance chronologique (fente) si leur fouille ne livrait aucun mobilier datant. Le centre de datation C14 de Poznan (Pologne) est pressenti pour ces travaux.
III. 4 Synthèse du rapport
Le rapport final d’archéologie préventive s’attachera à proposer un catalogue ordonné et thématique des données quantitatives, qualitatives et graphiques.
18
Projet scientifique et technique d’intervention 03/05/2010 page 10Site : SIERENTZ –Lot. Les Villas d’Aurèle Maîtres d’ouvrage : Foncière Hugues Aurèle
V. Quantitatif prévisionnel de l’opération
V.1 Quantitatif prévisionnel des moyens archéologiques
Ainsi que le prévoit le cahier des charges, une affectation prévisionnelle des moyens humains peut être envisagée comme suit, exprimée en journée/homme (j/h) :
SECTEURS 1 et 2 Préparation de l’opération : 3 journées/homme
ZONE mise hors terre des
vestiges (plan et préparation à la fouille)
fouille (phase terrain) Etude (Phase post-fouille)
Secteur 65 j/h 120 j/h 280 j/h
Dans le cadre de l’élaboration du rapport de ce secteur, l’opérateur prévoit une provision forfaitaire pour analyses, datations et stabilisation fixée à 7500,00€ HT.
V. 2 Quantitatif prévisionnel des moyens techniques
1) Logistique chantier/ base vie :
- 1 bungalow ou équivalent équipé en réfectoire/vestiaire - 1 container à outils 20 m3 ou deux containers de 8m3 - 2 blocs sanitaires chimiques hommes/femmes En fonction du phasage des travaux, un doublement de la base vie est envisagée, eu égard à l’éloignement des deux zones de fouille.
durée prévisionnelle de mise à disposition : 2 mois
2) Terrassements :
-mise à disposition d’une pelle sur chenilles équipée en curage (godet de 2 m ou plus) avec chauffeur et carburant
durée prévisionnelle de mise à disposition : 25 jours ouvrés
-mise à disposition d’un dumper ou d’un bouteur avec chauffeur et carburant
durée prévisionnelle de mise à disposition : 37 jours ouvrés pour un dumper
-mise à disposition d’un atelier midi- ou mini-pelle avec godet de curage avec chauffeur et carburant
durée prévisionnelle de mise à disposition : 10 jours ouvrés
3) Remise en état du site :
-mise à disposition d’une pelle sur chenilles
durée prévisionnelle de mise à disposition : 0 jours ouvrés (estimation)
-mise à disposition d’un chargeur sur chenille avec chauffeur et carburant ou de deux dumpers avec chauffeur et carburant
durée prévisionnelle de mise à disposition : 0 jours ouvrés (chargeur)
-mise à disposition d’un dumper avec chauffeur et carburant
19
Projet scientifique et technique d’intervention 03/05/2010 page 11Site : SIERENTZ –Lot. Les Villas d’Aurèle Maîtres d’ouvrage : Foncière Hugues Aurèle
durée prévisionnelle de mise à disposition : 0 jours ouvrés pour un dumper
4)Sous-traitance et location:
Les prestations désignées plus haut feront l’objet d’une de locations soit de matériel seul ou de matériel avec chauffeur (engins de terrassement).
5)Délais et date de démarrage :
Les prestations désignées plus haut pourront être exécutées :
Après notification du marché et suite à la réception de l’autorisation de fouille.
L’ensemble des prestations pour la phase terrain sont réalisables dans un délai de :
2 mois calendaires hors période de préparation relative au marché (temps minimum de retour des DICT)
20
Projet scientifique et technique d’intervention 03/05/2010 page 12Site : SIERENTZ –Lot. Les Villas d’Aurèle Maîtres d’ouvrage : Foncière Hugues Aurèle
VI. Personnel mobilisable pour l’intervention – constitution prévisionnelle de l’équipe de fouille
Note : en fonction de la période de réalisation de l’opération, la composition de l’équipe pourra être modulée. La constitution définitive de l’équipe sera arrêtée lorsque le calendrier précis de l’intervention sera établi et selon la disponibilité des personnels.
Responsable d’opération : Luc Vergnaud .
Adjoints au RO : Simon COUBEL (assistance à la phase terrain si nécessaire)
Spécialiste associé mobilisable pour l’étude des vestiges néolithiques :-Christian JEUNESSE
Spécialistes mobilisables pour les aspects Néolithiques :- Anthony DENAIRE - Luc VERGNAUD -Bertrand PERRIN
Spécialistes mobilisables pour les aspects protohistoriques :-Sébastien GOEPFERT : céramologie du Bronze final/Hallstatt -Muriel ZEHNER : céramologie générale, Bronze final /Hallstatt-Tène finale/Gallo-romain Ier
Spécialistes pour les aspects céramologiques :-Axelle MURER, céramologie antique (Ier-IIIème s.) périodes tardives, céramique médiéval (X-XIIème) -Sébastien GOEPFERT : céramologie du Bronze final/Hallstatt -Muriel ZEHNER : céramologie antique, (LT –Ier s.) période précoce
Spécialistes mobilisables pour les aspects anthropologiques :-Emilie CARTIER, anthropologue (inhumation) -Amandine MAUDUIT, anthropologue (inhumation) -Hélène BARRAND, anthropologues (crémations)
Spécialistes pour la période gallo-romaine :-Antoine MAMIE, établissements ruraux (villae, agglomérations secondaires). -Axelle MURER, céramologie antique (Ier-IIIème s.) -Annaïg LE MARTRET, numismatie
Etudes paléoenvironnementales : laboratoire de Bâle (pour la faune) et laboratoire d’archéobotanique de l’université de Bâle.
Datation : Laboratoire radiocarbone de Poznan (Pologne).
Topographie (Responsable): Sébastien GOEPFERT
Equipe de fouille :Simon COUBEL (archéologue technicien), Antoine MAMIE (archéologue technicien), Xavier PERRIN (archéologue technicien), Luc VERGNAUD (archéologue technicien), Laetitia TOULLEC (archéologue technicien), Olivier CHIFFLET (archéologue technicien), Jérôme FRITSCHY (archéologue technicien) Sébastien GOEPFERT (archéologue technicien) Stéphanie GUILLOTIN (archéologue technicien) Cécile GLARDON (archéologue technicien)
MOYENS TECHNIQUES : ANTEA ARCHEOLOGIE sarl,.
21
Projet scientifique et technique d’intervention 03/05/2010 page 13Site : SIERENTZ –Lot. Les Villas d’Aurèle Maîtres d’ouvrage : Foncière Hugues Aurèle
VII. Bibliographie sommaire de référence
BAKAJ B., ZEHNER M. et PELLISSIER J. 2001 = Rocade Ouest de Mulhouse. Communes de Didenheim-Mulhouse-Morschwiller-le-Bas
(Haut-Rhin).Rapport de diagnostic, SRA Alsace, Strasbourg, 2001, 29 et annexes hors-texte.
BLAIZOT F.. 2001 = Premières données sur le traitement des corps humains à la transition du Néolithique
récent et du Néolithique final dans le Bas-Rhin. GALLIA Préhistoire 43, 2001.
BOISSEAU F., COLECCHIA-LATRON A. et WIETHOLD J. 2009 = Didenheim "Kahlberg" (Haut-Rhin). Rapport de diagnostic, SRA Alsace, Strasbourg,
2009, 65 p.
DENAIRE A. à paraître = Les sépultures multiples du Néolithique récent de Didenheim/Morschwiller-le-Bas
(Haut-Rhin). In : Relations interrégionales au Néolithique entre Bassin parisien et Bassin rhénan. Actes du 26ème colloque interrégional sur le Néolithique, Luxembourg, 8-9 nov. 2003, Archeologia Mosellana, à paraître.
LEFRANC et Al. ( Lefranc P., Denaire A., Chenal F., Arbogast R-M.)à paraître = Les inhumations et les dépôts d’animaux en fosse circulaire du néolithique récent
du sud de la plaine du Rhin supérieur, GALLIA Préhistoire 2010.
ZEHNER M., DENAIRE A. et BAKAJ B. 2002 = Mulhouse – Rocade ouest (communes de Mulhouse – Didenheim – Morschwiller-le-
Bas ; Haut-Rhin). DFS de fouilles de sauvetage urgent, SRA Alsace, Strasbourg, 2002, 169 p.
25
125
130
131
135
134
126
127
132
133128
136
129
140
139
67
65
78
79
2221
19
18
11 12
171410
158
5
431
26
46
4947
66
54 50
51
52
5356
5761
63
137
81
80
87
84
85
86
122123 124
116
115
113112
111
110
6869
44
40
37
38
3364
8894
95
97
98
107
108
7172
73
74
89100
92
109
119et 142
120
105
117
106
101
102104
90
138
141
91
43
39 32
9
55
60
82
76
24 à 31(FO 125 et 126)
(FT 119)
(FS 108)
0 50 m
9183 9192
9275
9276
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9147
9148
9182
9184
9185
9186
9193
91969197
91989199
8408
8406
9149
9150
9151
9187
9188
9189
9191
8407
92049206
9210
9214
9215
8409
91789179
9180
92009201
9202
9211
9212
9213
9216
9152
9153
90769077
9081
9250
90799025
9026
9027
9082
9129
9133
9135
9137
9024
9136
9080
9247
9249
90289078
92489029
9009
9017
8334 9001 9007900890109011
9014
9016
90659066
9067
9068
90709071
90729073
9131
9132
9145
9146
9242
9243
9244
9246
90159069
9130
9012
9030
9269
9270
8401
8402
9004
9013
9018
9020
9022
9023
9036
9037
9038
9039
9055
9056
9224
9245
9019
9021
9225
9226
9060
9061
91099110
9111
9159
9251
8400
9031
9032
9035
9040
9041
9043
9044
90459046 9047 9048
9049 9050
9051
90529053
9054
90579058
90599063
9075
9083
90859086 9087
9088
9089
9091
9092
9095
9096
9097
9098
9099
9100
9101
9102
9103
91049107
9113
9114911591169117911891199120
91219122
912391249125912691279128
9230
9042
9062
9084
9090
9093
9094
8387
9105
92319232
91089106
9162 9163 9164 9165
9160
9220
9271
9272
9274
9273
9161
9177 9237
92399157
83339006 9034
9074
9134
9158
9166 9167 9168 9169 9170 91719173 9174
9176
9208
9209
9217
9218 92199221 9222 9223
9240
9241
9172
9064
9156
31
2 34
353 355
357
359810 11 12
13 1415
16
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
352 354
356358
27
28 29 30 32 33 34
35 36
37 38
39 40
212
1
Localisation de la fouille et des structures mises au jour sur fond du parcellaire
26
984
000
984
050
307 000
306 950
306 900
985
000
985
050
307 050
Plan général de la fouille inclu dans le système de coordonnées Lambert II étendu
SOMMAIRE
GENERIQUE DE L’OPERATION ………………………………………………………………………….. 1LISTE DES ABREVIATIONS DES NOMS PROPRES …………………………………………….. 2
PRELIMINAIRES ADMINISTRATIFS
Copie de l’arrêté de prescription de fouille …………………………………………………....……. 3Copie du cahier des charges scientifique …………………………………………………………… 5Projet scientifique et technique d’intervention (PSTI) …………………………………………. 10Copie de l’arrêté d’autorisation de fouille …………………………………………………………… 22Localisation de la fouille sur fond de carte IGN au 1/25000 …………………………………. 24Localisation de la fouille et des structures mises au jour sur fond du parcellaire ………………………………………………………………….. 25Plan général de la fouille inclus dans le système de coordonnées Lambert II étendu …………………………………………………….. 26
I. INTRODUCTION
I.1. Liminaire ………………………………………………………………………………………………………. 29I.2. Le contexte géographique et géologique ………………………………………………………. 29I.3. Le contexte archéologique ……………………………………………………………………………. 31I.4. Présentation générale de la fouille ………………………………………...……………………… 37I.5. Déroulement de l’opération ………………………………………...………………………………… 37
II. LE NEOLITHIQUE
II.1. LE NEOLITHIQUE MOYEN ……………………………………………………………………………. 44 II.1.1. Les structures ............................................................................................................... 44 II.1.1.1. Les fosses circulaires …………………………………………………………... 44 II.1.1.2. Les fentes …………………………………………………………………………... 44 II.1.2. Le mobilier ...................................................................................................................... 45 II.1.2.1. La céramique ……………………………………………………………………… 45 II.1.2.2. L’industrie lithique taillée ………………………………………………………... 47 II.1.2.3. L’outillage poli …………………………………………………………………….. 47 II.1.3. Discussion ……………………………………………………………………………………… 45
II.2. LE NEOLITHIQUE RECENT ……………………………………………………………………...…… 54 II.2.1. Les Structures ............................................................................................................... 54 II.2.2. Les restes humains ..................................................................................................... 55 II.2.2.1. La structure 90 (HBE) ……………………………………………………..…… 55 II.2.2.2. La structure 138 …………………………………………………………….……. 56 II.2.2.3. La structure 117 (HBE) …………………………………………………..……. 56 II.2.3. Le mobilier ...................................................................................................................... 56 II.2.3.1. La céramique ……………………………………………………………………… 56 II.2.3.2. L’outillage lithique ……………………………………………………….………. 63 II.2.3.3. L’outillage en matière dure animale (LB et LV) …………………..…… 63 II.2.3.4. Les restes de faune (LB) ............................................................................ 63 II.2.4. Discussion ...................................................................................................................... 65
II.3. LE NEOLITHIQUE FINAL ………………..……………………………………………………………... 74 II.3.1. Description ...................................................................................................................... 74 II.3.1.1. La sépulture 10 ………………………………………………………….………... 74
II.3.1.1.1. Structure ……………………...............……………………………………....…. 74 II.3.1.1.2. Individu (HBE) ……………………….................………………………..….… 74 II.3.1.1.3. Mobilier …………………………………………………………….............….…. 74
II.3.1.2. La sépulture 68 …………………………………………………………...….…... 75 II.3.1.2.1. Structure …………………………………………………..………..............…… 75
II.3.1.2.2. Architecture funéraire ……………………….…………………..… 77 II.3.1.2.3. Individu (HBE) ………………………………………….…….…...............…… 77
II.3.1.2.4. Espace de décomposition (HBE) ……………………….…….. 77 II.3.1.2.5. Matériel ………………………………………….……………...……… 77 II.3.1.3. La sépulture 69 ………………………...…………………………………….…… 86
II.3.1.3.1. Structure ……………………...…….………………………...……...............….. 86 II.3.1.3.2. Architecture funéraire ……………………………………..…….…. 86
II.3.1.3.3. Individu (HBE) ………………………………………….……...…...............….. 88 II.3.1.3.4. Espace de décomposition (HBE) …………..……………..…… 88
II.3.1.3.5. Matériel ……………………………..…………………………...............……….. 88 II.3.1.4. La sépulture 137 ………………………………………..………….…………….. 93
II.3.1.4.1. Structure ……………………………...……………………...............………….. 95 II.3.1.4.2. Architecture funéraire ………………………..………….………... 95
II.3.1.4.3. Inhumé ………………………………………...……………………..............….. 95 II.3.1.4.4. Espace de décomposition ………………………………………................ 96 II.3.1.4.5. Matériel ………………………………...…………………..............……………. 96
II.3.2. Approches synthétiques et comparaisons ……..…………………………..…… 97 II.3.2.1. Organisation spatiale de l’ensemble funéraire ………………………. 101 II.3.2.2. Les fosses ……………………………………………………………..…………. 101 II.3.2.3. Architecture funéraire ……………………………………………………..….. 102 II.3.2.4. Orientation et position des défunts ………………………………….…… 103 II.3.2.5. Aspects biologiques remarquables ……………….……………….…….. 105 II.3.2.6. Localisation des objets dans les tombes ……………..………….……. 105 II.3.2.7. Le mobilier céramique …………………………………………………..……. 105 II.3.2.8. Le mobilier en silex ………………………………………………………..…... 108 II.3.2.9. Le mobilier en pierre dure …………………………………………...……… 111 II.3.2.10. Le mobilier matière dure animale ……….………………........................ 113 II.3.2.11. Place de l’ensemble de Sierentz dans la périodisation du Campaniforme ……………..........…………… 117 II.3.3 Conclusion ……………………………………………………………………...………….…… 118
II.4. LE NEOLITHIQUE INDETERMINE ........................................................................................... 124
III. LA PROTOHISTOIRE
III.1. LE BRONZE FINAL I (SGO) …………..………………………………....…………………………... 130
III.2. LE BRONZE FINAL IIb / IIIa (Période RSFO) ……………………………………..………….. 134 III.2.1. Les structures ……………………………………………………………………………….. 134 III.2.1.1 Les silos ………………………………………………………...…………………... 134 III.2.1.2. Les fosses à fond plat …………………………………..…………………….. 136
III.2.1.3. Les autres fosses …………………………………….…………………………. 136 III.2.2. Le mobilier de la période RSFO (IIb-IIIa) ………….……………………………... 137 III.2.2.1. La céramique (SGO) ………………………………...…………………..……. 137 III.2.2.1.1. Typologie ……………………………………………………………... 138 III.2.2.1.2. Le mobilier par structure …………………………………..……. 142 III.2.2.1.3. Datation, comparaison et synthèse ..………………………... 145 III.2.2.2. Les objets en pierre ……………………………………………………..……... 147 III.2.2.3. Le métal ………………………………………………………………...………….. 149 III.2.2.4. La faune …………………………………….………………………...……………. 149 III.2.3. Discussion …………………….………………………………………………………………. 150
III.3. LE HALLSTATT D1 …………………………………………………………………………………. 156 III.3.1. Les structures ………………………………………………………………….......……….. 156 III.3.2. Le mobilier …………………………………………………………………………………. 157 III.3.2.1. La céramique (SGO) ………………………………………..…………………. 157 III.3.2.1.1. Typologie ……………………………………………………………... 157 III.3.2.1.2. Le mobilier par structure ………………………………..………. 158 III.3.2.1.3. Datation, comparaison et synthèse ……………...………….. 162 III.3.2.2. Le mobilier lithique …………………………..………………………………..... 163 III.3.2.2. La faune ……………………………………………………………………………. 163III.3.3. Discussion ……………………………………………………………………………………………….. 163
III.4. LA PROTOHISTOIRE INDETERMINEE ……………….……………………………..………….. 169
IV. LES STRUCTURES NON-DATEES
IV.1. Les structures néolithiques ou protohistoriques ……………………………...…………. 172IV.2. Les structures d’époque indéterminée …………….………………………………………….. 175
V. CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
LISTE DES FIGURES DANS LE TEXTE
PLANCHES
ANNEXES ANN.I. INVENTAIRES GENERAUX ANN.II. ETUDE ARCHEO-ANTHROPOLOGIQUE (HBE) ANN.III. ETUDE ARCHEO-ZOOLOGIQUE (LB) ANN.IV. DATATIONS RADIOCARBONES ANN.V. CATALOGUE DES SEPULTURES CAMPANIFORMES DANS LE SUD DE LA PLAINE DU RHIN SUPERIEUR ANN.VI. INVENTAIRE DU CONDITIONNEMENT DEFINITIF DU MATERIEL ANN.VII. INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION DE FOUILLE
32
I.1. Liminaire
La fouille du site de Sierentz « Les Villas d’Aurèle » fait suite à une opération de dia-gnostic réalisée par F. Latron en 2009 en vue de la construction d’un lotissement par la société Hugues Aurèle. La mise au jour de plusieurs inhumations en fosses circulaires datées du Néolithique récent a conduit à la prescription d’une fouille sur une partie de l’emprise du projet.
La fouille s’est déroulée durant les mois de juin et juillet 2010 et a permis la mise au jour de 111 structures révélant plusieurs époques d’occupation du site, essentiellement néoli-thiques et protohistoriques.
Les vestiges les plus anciens datent de la période du Néolithique moyen. Il s’agit de fosses circulaires et de fentes. L’organisation de ces dernières structures a d’ailleurs conduit, avec l’accord de l’aménageur et du SRA, à élargir la zone décapée afin de tenter de mieux appréhender l’extension de cet ensemble. Le mobilier de cette période est principalement constitué par quelques tessons décorés.La période du Néolithique récent n’est représentée que par des fosses circulaires et fosses-si-los, dont certaines ont livré des restes humains. La céramique est le mobilier le plus abondant pour cette période. Plutôt bien conservée, elle se compose d’une belle série de vases archéo-logiquement complets. La fin du Néolithique est matérialisée par quatre sépultures campaniformes, dont deux par-ticulièrement bien conservées ont permis la mise en évidence d’une architecture funéraire en bois. Elles ont livré un abondant mobilier céramique, lithique et osseux, lui aussi très bien conservé. Il s’agit là d’une découverte exceptionnelle pour cette période dans la région. L’occupation du site lors de la Protohistoire peut se décomposer en deux phases : la première date du Bronze final (pour l’essentiel de la fin de la période bien qu’un vase écrasé sur place date du début) et la seconde du Hallstatt D1. Les vestiges de cette dernière période sont cependant peu abondants. En revanche, le mobilier de l’âge du Bronze se compose d’une belle petite série de vases complets, retrouvés déposés sur le fond de plusieurs fosses circulaires peu profondes. Enfin, il existe quelques traces d’occupations à des époques plus récentes (éventuelle-ment romaines). Une probable aspergerie d’époque Moderne et/ou Contemporaine a été mise en évidence. Il ne nous est toutefois pas possible d’en préciser ni la datation ni la nature, du fait du peu d’éléments ayant pu être recueillis.
I.2. Le contexte géographique et géologique
La commune de Sierentz est établie au sommet de la basse terrasse supérieure du Rhin, à cheval sur la plaine de la Hardt et les premières collines du Sundgau, à environ 14 km de Mulhouse (Haut-Rhin) (Fig. 1).
Le terrain concerné par la fouille se situe au sud-ouest de l’agglomération, au lieu-dit Monenberg, sur le versant d’une petite colline dont la pente descend vers le nord-ouest (Fig. 2).La zone du futur aménagement, de forme triangulaire, se développe dans la continuité d’un précédent lotissement situé au nord-est. Encore cultivé en 2009, ce terrain est bordé au nord-ouest par la rue Werben et au sud par un chemin communal dénommé Hohlegasse. L’emprise fouillée se situe à peu près au centre de cette zone. Elle est traversée par un chemin commu-nal est-ouest qui la divise en deux parties.
La couverture géologique est la même sur l’ensemble de l’emprise de la fouille. Le substrat se compose de limon loessique qui apparait entre 0,30 et 1,05 m sous le niveau de sol actuel. Il est recouvert par endroits par une couche de limon lehmique, issue de l’altération du loess, dont la puissance peut atteindre 0,60 m dans la partie nord. Enfin, la couche super-
33
Mulhouse
Belfort
Basel
Freiburg
Colmar
Strasbourg
SIERENTZ
Fig. 1 : Localisation de Sierentz dans le sud de la plaine du Rhin supérieur
Fig. 2 : Localisation de la fouille sur un extrait du fond de carte IGN au 1/25000
34
ficielle est constituée d’un niveau de terre arable dont l’épaisseur varie entre 0,30 et 0,40 m.
Les structures archéologiques apparaissent au sommet de la couche de loess. Un vase écrasé sur place (St. 1) a cependant été mis au jour dans la couche de lehm sus-jacente.
I.3. Le contexte archéologique (Fig. 3, 4 et 5)
A l’emplacement actuel de la Hochkirch, on mentionne l’existence du village disparu de Hohenkirch qui est cité pour la première fois en 8701. L.-G. Werner nous dit qu’il «était situé au croisement des routes romaines de Larga-Cambes (sic) et Arialbinum-Uruncis-Mons Brisiacus. Un vieux cimetière avec une petite chapelle, dans le voisinage de laquelle jaillit une source curative, nous rappelle le souvenir de la localité. Des fondations, des pierres et diverses antiquités romaines ont été déterrées dans les alentours»2. C’est effectivement à cet endroit qu’a été découverte l’agglomération romaine décrite infra.
Le site de la Hochkirch (lieux-dits Landstrasse et Sandgrube) à Sierentz présente une durée d’occupation assez exceptionnelle. La première occupation date du Néolithique. Le site
1 Werner 1914, p. 310. 2 Werner 1920, p. 240.
Commune de SIERENTZcarte archéologique
Extrait de la carte IGN3720 ET
Occupation NéolithiqueOccupation de l’Âge du Bronze ancien
Occupation ProtohistoriqueOccupation Gallo-romaineOccupation MérovingienneOccupation Médiévale
Sondage négatif
XIVe siècleXVIIIe siècle
Occupation Néolithique, Âge du Bronze, La Tène ancienne et finale, Gallo-romaine et Médiévale
N
0 1000m
001_Sangrube, Landstrasse, Hochkirch, Scholl, Hochstraessle, Tiergarten002_rue du Chemin de Fer003_Terrain de Sport de Uffheim004_Ancienne sablière005_19, rue Poincarré/Maison Schuller006_Chapelle Ste Vierge et St Meinrad007_Place du Maréchal Joffre
008_Voie romaine Mandeure (Epomanduodurum) – Kembs (Cambete)009_Voie romaine Augst (Colonia Augusta Raurica) – Strasbourg (Argentorate)010_Village médiéval disparu d’Eschenbach011_Forêt de la Hardt_tumulus012_Les villas d’Aurèle_tombes campaniformes
001004
009
001
001
001008
ZACHoell
008
002
005
007
006
003
012
010009
011
Fig. 3 : Carte archéologique de la commune de Sierentz
35
est ensuite réoccupé partiellement à l’époque du Bronze final, pendant les périodes hallstat-tiennes et le second âge du Fer et enfin pendant l’époque romaine y compris le Bas-Empire.
Des fouilles de sauvetage ont eu lieu de 1977 à 2006. Une soixantaine d’ares ont été fouillés, plus ou moins complètement. L’étendue maximum du site est évaluée à 15 ou 20 ha.
Les premiers vestiges appartiennent à une quinzaine de maisons formant un village Rubané3. Quelques traces d’une occupation du Néolithique moyen sont matérialisées pa ddes fosses Grossgartach et une sépulture Roessen4.
L’âge du Bronze final est représenté par une série de fosses de combustion5 ainsi qu’une nécropole à crémations d’une quarantaine de tombes (ZAC Hoell)6.
Un habitat du Hallstatt D3 composé d’une vingtaine de bâtiments a été mis au jour au nord-ouest du ban communal (ZAC Hoell). Il s’agit du premier « village » de cette période découvert dans la plaine d’Alsace7.
Les quelques vestiges diffus du début de La Tène correspondent essentiellement à des objets isolés, à savoir quelques fragments de céramique et une fibule de La Tène A2. Aucune structure ne peut être rattachée à ce mobilier puisque les vestiges romains ont détruit la plu-part des éléments antérieurs8.
La Tène finale est bien représentée par des enclos formant des cours ouvertes. Les fossés ont des profils identiques avec un fond plat. Trois constructions sur poteaux n’ont livré que peu de vestiges9. Les vestiges les mieux conservés et probablement les plus intéressants sont les fours de potiers destinés à la production d’un service de table, de bouteilles et de bols. Ces céramiques peintes de bandes horizontales rouges et blanches correspondent à une phase tardive de La Tène (La Tène D2)10. Les premiers vestiges correspondant à l’agglomération gallo-romaine proprement dite sont datés de l’époque Tibère-Claude (30-40 apr. J.-C.). Il s’agit de tranchées de fondation qui limitent, autour d’une cour fermée, un espace construit.C’est durant le reste du Haut-Empire que la localité connaît un fort développement en raison de son emplacement : la localité est au carrefour de plusieurs routes dont Epomanduodurum (Mandeure) - Cambete (Kembs) et Augusta Raurica (Augst) - Argentorate (Strasbourg). Elle contrôlait ainsi l’accès à Cambete (Kembs) et soutenait probablement les interventions mili-taires de la rive droite du Rhin.
Les premiers bâtiments du village, en bois et torchis, sont détruits vers 70 apr. J.-C par un incendie. L’agglomération se développe considérablement dès le dernier tiers du Ier siècle apr. J.-C et durant tout le IIe siècle. Les fondations sont construites en dur (hérissons de galets et de calcaire), mais les élévations demeurent en matériaux légers. L’habitat s’organise alors de part et d’autre de la voie est-ouest avec au nord une zone artisanale et au sud un secteur «public». Elle forme en réalité déjà une croix avec un noyau plus important autour de la future chapelle de la Hochkirch. Près de cette dernière, de nombreux fragments de bronze doré pro-viennent probablement d’une statue monumentale.
Le secteur sud présente une vaste aire pavée de gros galets constituée de recharges allant du Ier à la fin du IIe siècle apr. J.-C. Sa superficie atteint les 1600 m². En raison de découvertes monétaires importantes, cette place a été interprétée comme un «macellum» ou place de marché en position centrale dans l’habitat. Un grand bâtiment (public?), construit sous Vespasien, s’ouvre sur cette aire pavée. Il était réalisé à l’aide de fondations de galets et de pans de bois et de torchis dont les surfaces intérieures étaient ornées d’enduits peints. Deux extensions de cette construction sont attribuées l’une au début du IIe siècle, l’autre à la 3 Lefranc et Denaire 2000. 4 Denaire 20095 Rougier 2001.6 Roth-Zehner et al. 2007.7 Roth-Zehner et al. 2007.8 Wolf et al. 1985.9 Roth-Zehner 2005.10 Zehner 1994 ; 1995 ; 2000.
36
fin du IIe-début du IIIe siècle apr. J.-C. Tous les aménagements internes de l’établissement ont disparu ; ne reste que le large portique à piliers sur sa façade est. De l’autre côté de la place, on observe des aménagements divers attribuables à la fonction de macellum : baraquements légers, silos, dépotoirs et puits.Un ensemble d’habitations a été construit le long de la chaussée du côté nord de la route : il s’agit d’une série de bâtiments également à usage artisanal. Les techniques de construction sont identiques, mais sans décor. Les différentes activités (forgerons, potiers Gannicus et Marti(us) Reg(inus), métallurgistes...) sont présentes du Ier au IIIe siècle apr. J.-C.
Un espace cultuel, découvert et fouillé en 200611, se développe dans le quart nord-ouest de la localité, au croisement des deux axes de communication cités supra. Intégré au tissu urbain, ce secteur commence à être fréquenté dès la fin de La Tène (comme sanctuaire?) mais c’est pendant la période augustéenne qu’est aménagé le péribole matérialisé par un fos-sé et une palissade suivant un axe sud-ouest/nord-est. Le sanctuaire voit se mettre en place un temple à double cella, trois temples sans galerie et un bâtiment conventuel.
L’agglomération semble avoircessée de fonctionner après le repli sur le Rhin du Limes en 260 apr. J.-C. Les habitations ont été détruites, le sanctuaire semble cesser son activité, mais certaines installations comme les puits sont encore utilisées. Le sanctuaire, après cette brève «interruption» durant la seconde moitié du IIIe siècle, semble «ressusciter» au Bas-Empire, et continue à accueillir des pèlerins jusqu’au IVe siècle apr. J.-C. Le péribole est toujours présent et le temple à double cella est toujours en activité. Par contre, les temples sans galeries sont démontés. Les puits précédemment cités et le chemin nord-sud continuent d’être utilisés jusqu’au IVe siècle apr. J.-C. comme le prouve l’alignement sur celui-ci de la nécropole du Bas-Empire.
Plus tard, cette zone cultuelle perdurera au Haut Moyen Age (la chapelle Saint Martin est citée dans les textes en 870 sous le vocable Hohenkirch), au Moyen Age (village des XII-XIIIe siècles) et jusqu’à nos jours (chapelle de la Hochkirch et son cimetière).
Aucune importante nécropole du Haut-Empire n’a été mise au jour sur le site : nous ne notons qu’une seule inhumation du IIe siècle découverte en bordure de la route, à proxi-mité des ateliers. Le corps avait été décapité et déposé sur le ventre les bras repliés vers les épaules et les jambes également pliées. De plus, sept urnes cinéraires de la première moitié du IIIe siècle apr. J.-C. ont été aménagées le long de la voie. Mais la nécropole la plus imposante découverte sur le site date du Bas-Empire. Elle devait contenir entre 150 et 200 tombes dont 54 ont pu être fouillées12. Toutes les sépultures, sauf la tombe 13 sont orientées nord-nord-ouest, la tête au sud dans 49 cas et la tête au nord dans 4 cas. La sépulture n° 13 a une orientation est-nord-est, tête à l’ouest. L’une des tombes contenait un cheval. Sur les 53 tombes fouillées, 17 sont masculines et 19 sont féminines. On constate la sous-représentation des enfants. Les défunts sont disposés les uns à côté des autres, mais la nécropole ne peut être qualifiée de «Reihengräber», c’est-à-dire de rangées de tombes, comme celles que l’on rencontre à l’époque mérovingienne. Les inhumations sont déposées dans des fosses plus ou moins rectangulaires à angles arrondis. Les fosses étaient remplies de remblais provenant du site romain voisin ou comblées à l’aide de matériaux d’ex-traction de la fosse. Dans cinq tombes, du charbon de bois avait été déposé autour des corps. Certaines inhumations étaient déposées sur ou sous un litage de galets ou de pierres cal-caires. Les pierres pouvaient également être placées de part et d’autre du défunt, ou même servir d’oreiller. Une autre a été dressée et plantée à la tête d’une tombe. Les inhumés sont couchés sur le dos, les bras le long du corps. Dans la plupart des cas, les mains reposaient sur le pubis ou les bras étaient allongés le long du corps. Huit tombes contenaient des offrandes alimentaires : ossements de volaille déposés à côté ou dans une céramique. Des vestiges de tissus conservés grâce à l’oxydation des objets en fer suggèrent la présence de vêtements et le port de chaussures, mais également de linceul. Le mobilier funéraire était composé de céra-miques, de verres et de monnaies. La céramique est entière ou volontairement brisée autour 11 Roth-Zehner (dir.) 2007.12 Heidinger et Viroulet 1986.
37
Néo
litiq
ueA
ge d
u B
ronz
eA
ge d
u Fe
rR
omai
nM
oyen
Âge
Ancien
Ancien
Moyen
Moyen
Récent
Final
Final
Hallstatt
La Tène
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000 - Village (Rubané moyen/récent, récent et final)
- Fosses et tessons (Grossgartach) dans fosses latérales rubanées
-Tombe (Roessen)
- Découverte isolée
- Fosses à combustions et nécropole (BF Ia/IIb et IIb/IIIa)
- Village (HaD3)
- Objets isolés (LTA2) et habitat (LTD1/D2)
- Vicus puis nécopole à la fin de la période
- Sépulture isolée
Première mention textuelled’un village à Sierentz
- Chapelle
- Synagogue
-Tessons (Bruebach-Oberbergen)
Fig. 4 : Périodes représentées sur la commune de Sierentz
38
nl = non localisé ind. = indéterminé N° carte 001 N° carte archéo 9, 11, 12,
13, 17, 18, 26,
27
Lieudit Sandgrube, Landstrasse, Hochkirch, Scholl, Hochstraessle,
Tiergarten
Date 1977
Chronologie Néolithique, Bronze, La Tène ancienne et finale ; Gallo-romain (Ier-IVe s.) et médiéval
Vestiges immobiliers ou mobiliers Habitat Néolithique, de La Tène ancienne et finale, vicus gallo-romain et nécropole du IVe siècle apr. J.-C. et habitat médiéval
Bibliographie et/ou inventeur : J.-J. Wolf 1978 ; 1983 ; 1985 ; 1986-1987 ; 1995a ; - Gallia 1978, p. 348 ; 1980, p.437-438, fig. 2 ; 1982,p. 354-357 ; 1984, p.268-270, fig. 18 ; - Dict. Comm. 1982, p. 1360 ; - Th. Dumez 1989 ; - A. Heidinger et J.-J. Viroulet 1986, 1989 ; - J. Schweitzer 1991a, p. 73 ; - M. Zehner 1994a ; 1995 ; 1998.
N° carte 002 N° carte archéo - Lieudit Rue du Chemin de Fer Date 1994
Chronologie Sondages négatifs Vestiges immobiliers ou mobiliers néant Bibliographie et/ou inventeur : J. Sainty, SRA N° carte 003 N° carte archéo 16 Lieudit Terrain de sport de Uffheim Date 1974
Chronologie Bronze ancien II Vestiges immobiliers ou mobiliers Découverte fortuite d'une hache à rebords Bibliographie et/ou inventeur : Information SDAHR N° carte 004 N° carte archéo 14 Lieudit Ancienne sablière Date 1995
Chronologie Néolithique Vestiges immobiliers ou mobiliers Fosse, céramique Bibliographie et/ou inventeur : Prospection au sol J.J. Wolf N° carte 005 N° carte archéo 2 Lieudit 19, rue Poincarré/Maison Schuller Date 1973
Chronologie Mérovingien (VIe-VIIe s.) Vestiges immobiliers ou mobiliers 1 sépulture (franque?) Bibliographie et/ou inventeur : L’Alsace du 07.11.1973, du 23.07.1973 et du 27.11.1973 ; - L.-G. Werner 1940-
1948, p. 8-9 ; - J.-J. Wolf 1973 ; 1975-1976 ; 1985, p. 62 ; - Gallia 1974, p. 379, fig. 15 ; M. Zehner 1998.
N° carte 006 N° carte archéo 6 Lieudit Chapelle Ste Vierge et St Meinrad Date 1789
Chronologie XIVe s. Vestiges immobiliers ou mobiliers Destruction de la chapelle après 1789. Bibliographie et/ou inventeur : Dict. Comm. 1982 N° carte 007 N° carte archéo 7 Lieudit Place du Maréchal Joffre Date -
Chronologie XVIIIe s. Vestiges immobiliers ou mobiliers Synagogue Bibliographie et/ou inventeur : Dict. Comm. 1982 N° carte 008 N° carte archéo 8 Lieudit Voie romaine Mandeure-Kembs Date -
Chronologie La Tène finale? Et gallo-romain Vestiges immobiliers ou mobiliers Voie romaine Epomanduodurum-Larga-Cambete Bibliographie et/ou inventeur : Ph. de Golbéry 1831, p. 10 ; - F.X. Kraus 1884, p. 601 ; - L.-G. Werner 1914e, p. 310
; 1920b, p. 240 ; - Ch. Munch 1968 ; - Dict. Comm. 1982, p. 1360. N° carte 009 N° carte archéo 10 Lieudit Voie romaine Augst-Strasbourg Date -
Chronologie Gallo-romain Vestiges immobiliers ou mobiliers Voie romaine Colonia Augusta Raurica - Argentorate Bibliographie et/ou inventeur : Ph. de Golbéry 1831, p. 10 ; - F.X. Kraus 1884, p. 601 ; - L.-G. Werner 1914e, p. 310
; 1920b, p. 240 ; - Ch. Munch 1968 ; - Dict. Comm. 1982, p. 1360. N° carte 011 N° carte archéo 21 Lieudit Forêt de la Hardt Date
Chronologie Protohistoire Vestiges immobiliers ou mobiliers On signale la présence de plusieurs tumulus dans la forêt de la Hardt. Bibliographie et/ou inventeur : Ph. de Golbéry 1831, p. 11 ; - Schoepflin-Ravenèz 1849-1851, III, p 60 et 401 ; - F.X.
Kraus 1884, p. 601 ; - F. Wolff 1903, p. 195, n° 90 N° carte 010 N° carte archéo 16 Lieudit Eschenbach Date -
Chronologie Médiéval Vestiges immobiliers ou mobiliers Village disparu d'Eschenbach à l'ouest de Sierentz dans les collines qui dominent le
Schlossberg. Bibliographie et/ou inventeur : L.-G. Werner 1940-1948
Fig. 5 : Liste des sites archéologiques de la commune de Sierentz
39
du défunt. Elle provient d’Argonne (Chenet 320, 323, et 348), de Mayen (Alzei 30), de Portout (forme P.37, 61b), de Jaulges-Villiers-Vineux (Chenet 323 type C) et de Pannonie et date de la seconde moitié du IVe siècle apr. J.-C. D’autres formes sont de facture locale. La verrerie est abondante dans la plupart des tombes et peut être accompagnée d’autres offrandes. Les formes sont représentatives du dernier tiers du IVe siècle apr. J.-C. (Ising 42a, 96a, 101, 106, 108, 109 et 117). Le Naulum ou l’obole à Charon est particulièrement bien représenté dans cette nécropole. Les monnaies datent généralement de la seconde moitié du IVe siècle apr. J.-C sauf quelques monnaies en argent des IIe et IIIe siècles apr. J.-C. Elles sont déposées dessus ou à proximité du crâne, sur la poitrine ou l’abdomen ou près des membres. Dans la tombe 30, 27 monnaies, des règnes de Constance II (337-361 apr. J.-C.) à Valentinien II (375-392 apr. J.-C.), étaient contenues dans une bourse en cuir déposée sur l’abdomen. D’autres objets ont également été recueillis comme une lampe à huile, un nécessaire de couture, des épingles à cheveux, des peignes en os, des bracelets en bronze et en os, des colliers de perles, un collier en argent, des torques en bronze et en argent, objets de parure que l’on retrouve plus particulièrement dans les tombes féminines. L’utilisation de cette nécropole se situerait entre 365-370 apr. J.-C. et 395-400 apr. J.-C.
A l’emplacement de la Maison Schuller, MM. Schuller et Epis ont découvert une sépul-ture franque en novembre 197313. La tombe était creusée à 0,90 m de profondeur, aménagée en pleine terre, orientée est-ouest, la tête à l’ouest. Le corps était allongé sur le dos, les bras le long du corps. Le mobilier funéraire était composé d’un collier de 8 perles en verre, d’un petit anneau en bronze découvert sur le pouce gauche de la défunte, d’un couteau en fer de 10 cm de longueur dont la pointe était brisée et d’un peigne en os à double rangés de dents. De nombreuses particules de charbons de bois se trouvaient le long du corps à droite de la morte. D’autres ossements ont été découverts à 0,40 cm au-dessus de la base de la tombe. Ils appar-tiennent à un enfant. Il s’agit donc vraisemblablement d’une tombe remaniée ou postérieure à celle de la femme, et accompagnée d’éléments en fer pouvant correspondre à un couteau et à une boucle de ceinture. Il est possible de dater cette double sépulture des VIe-VIIe siècles apr. J.-C. L.-G. Werner signalait déjà des découvertes de sépultures mérovingiennes dans la commune14.
13 Wolf 1975-1976 ; 1985, p. 62.14 Werner 1940-1948, p. 8-9.
40
I.4. Présentation générale de la fouille (Fig. 7)
La zone fouillée couvre 18919,80 m². Elle se compose de deux parties situées de part et d’autre d’un chemin communal. La principale, au sud de ce chemin, mesure 17317 m² tan-dis qu’au nord, seuls 1602,80 m² ont été fouillés.
Au total, 111 structures ont été mises au jour. 51 appartiennent à la période Néolithique dont 37 appartenant au Néolithique moyen, huit au Néolithique récent et quatre au Néolithique final. Les structures protohistoriques sont au nombre de 23. 14 sont datées du Bronze final et six du Hallstatt D1. Enfin, 37 n’ont pu être attribuées à aucune période particulière.
Le site présente une légère pente orientée sud-est / nord-ouest. Certaines structures situées près de la berme sud (et donc en haut de la pente) apparaissent assez mal conser-vées. Ce mauvais état de conservation peut-être lié à une activité plus intense dans ce sec-teur. En revanche, la faible profondeur de certaines structures situées plus au nord ne peut-être dues à la seule activité érosive, car elles côtoient d’autres structures conservées, elles, sur des profondeurs plus importantes.
I.5. Déroulement de l’opération
La fouille La fouille du site a débuté le 31 mai et s’est terminée le 16 juillet 2010. Le décapage a été réalisé par bandes en commençant le long du côté sud de la zone. Pour des raisons d’espace de stockage réduit, la terre de chaque nouvelle bande décapée a été stockée dans les zones vides de structures des bandes précédentes (Fig. 8 et 9). En cela,
Fig. 6 : Vue de la zone de fouille avant décapage
38
Hallstatt D1
Bronze final IIb
Structures non-datées
Néolithique final / Campaniforme
Néolithique récent / Munzingen
Néolithique moyen / Bruebach-Oberbergen
Néolithique indéterminé
Protohistoire indéterminée
Les n° de structure entre parenthèses et en italiquerenvoient à la numérotation du diagnostic
Bronze final I
125
130
131
135
134(FT 122)
126
127
132
133128
136
129
140(FT 121)
139(FT 120)
67(FS 124)
6578
79
22 21
19
18
11 12
171410
15 (FS 104)
8 5
431
26
46(FS 103)
49
47(FT 102)
66
54(FS 101)
50
51
52
5356 (FS 106)
5761
63
137(SP 105) 81
808784
8586
122
123 124
116
115
113112
111
110
6869
44
40(FS 108)
37
38
3364
8894
95
97
98
107
108
7172
73
74
89100(FS 111)
92
109
119et 142
120
105
117
106
101
102104
90
138(SP 110)
141(FS 107)
91(FS 123)
43
39 32
9
55
60
82
76
24 à 31(FO 125 et 126)
(FT 119)
(FS 108)
(FS 116)
(FS 117)
(FS 118)(FS 114)
(FS 115)
984
000
307 000
306 900
985
000
0 25 m
Fig. 7 : Plan phasé
général
39
le relativement faible volume de sédiment généré (due à la puissance modeste de la couche de terre arable) nous a aidés. En parallèle du décapage, les structures étaient fouillées, déga-geant ainsi de nouveaux espaces libres pour le stockage de la terre.Compte tenu de la bonne avancée des travaux et en accord avec le SRA et l’aménageur, la zone située au nord du chemin communal a débuté lors de la deuxième semaine de juillet afin d’observer le développement du complexe de fentes observé dans la zone principale.
Toutes les structures ont été fouillées intégralement, en deux temps afin de permettre la réalisation d’une coupe. Pour les structures de moyenne et grandes dimensions, la fouille a été mécanisée et s’est effectuée par passe d’environ cinq centimètres d’épaisseur.Chaque structure a été photographiée en plan et en coupe. Chacune a fait l’objet d’un relevé (plan et coupe) au 1/20ème ou, pour les plus grandes, au 1/50ème réalisé sur une fiche descriptive où sont précisées la nature du remplissage ainsi que la nature et la localisation du mobilier. Celui-ci a été intégralement prélevé et placé dans des sacs sur lesquels sont précisés le nom du chantier, sa provenance et la date. Le gros mobilier lithique a été séparé des autres caté-gories de mobilier pour ne pas les endommager. Les objets fragiles (silex, objets en os, ...) ou remarquables ont aussi été séparés du reste du mobilier et protégés.Plusieurs prélèvements de sédiment ont été effectués ponctuellement afin de retrouver d’éven-tuels macrorestes. Ils ont été réalisés soit dans des couches charbonneuses soit dans des structures particulières (Fosses-silos, sépultures et gobelets campaniformes).
La post-fouille L’intégralité du mobilier archéologique a étélavéeé puisconditionnéeé selon sa nature. Les remontages céramiques ont été poussés au maximum. Tous les objets remarquables ont été dessinés. Les relevés de terrain ont été mis au propre sur ordinateur. Les prélèvements de sédiment ont été tamisés. Ils ont fait l’objet d’une première observa-tion à l’œil nu qui n’a malheureusement permis de repérer aucun élément particulier. Ces prélèvements restent toutefois en attente d’une étude plus poussée par un spécialiste.Une série de datations 14C ont été effectuées par le laboratoire de Poznań (Pl.) Les échantil-lons envoyés proviennent de deux sépultures campaniformes (Os humain) et de deux struc-tures Munzingen (Os humain et animal).
Le diagnostic L’opération d’évaluation archéologique a été réalisée par F. Latron (INRAP) au mois de décembre 200915. Toutes les structures repérées lors de cette opération ont été retrouvées ; toutes étaient bien localisées. D’après le mobilier mis au jour dans certaines de ces structures, la majorité d’entre elles était datée du Néolithique récent. A l’issu de la fouille, il est cependant apparu que cette période n’était ni laseule, ni la principale occupation du site. Précisons que tous les indices des ces autres occupations ont ététrouvéess hors des tranchées du diagnostic et ne pouvaient donc pas être perçus lors de celui-ci.Il nous faut toutefois noter une exception à la remarque précédente. Lorsque nous avons récupéré le mobilier issu du diagnostic, il est apparu que la sépulture 105 (St. 137 dans notre numérotation) avait livré des éléments de céramique. Ceux-ci,non lavéss, portaient cependant des décors incisés quiauraientt pu amener l’attribution de cette tombe à la période campani-forme dès le diagnostic. Enfin, nous devons aussi signaler qu’aucun reste humain et de faune issu de l’opéra-tion de diagnostic ne nous a été transmis, malgré de multiples sollicitations de notre part et de celle du SRA.
15 Latron et al. 2010
43
Fig. 8 : Vue d’une bande de terrain décapée, vide de structure
Fig. 9 : Vue de la bande décapée contigüe à celle de la vue précédente, illustrant le stockage de la terre
46
Structure Bruebach-Oberbergen
0 25 m
Les n° de structure entre parenthèses et en italiquerenvoient à la numérotation du diagnostic
Structure autres périodes
Structure Bruebach-Oberbergen probable
984
000
307 000
306 900
985
000
125130
131135
134(FT 122)
127
132133
128
140(FT 121)
139(FT 120)
78 79
12
1714
6
47 (FT 102)
61
63
81
8784
85
123 124116
113
111
6488
9
55
82
76
(FT 119)
92
Fig. 10 : Localisation des structures Bruebach-Oberbergen
47
II.1. LE NEOLITHIQUE MOYEN
II.1.1. Les structures
37 structures ont été attribuées au Néolithique moyen. On distingue des fosses simples et des fentes (fig. 15 et 16). Hormis la fente 92, toutes les structures sont situées dans la moitié est de la zone de fouille (fig. 10).
II.1.1.1. Les fosses circulaires
Trois structures appartiennent à ce type : St. 88, 64A et B (fig. 15 ; Pl. V et IX). A l’origine, la structure 64 avait été vue comme une seule et même entité dont la forme évoquait un huit. Après avoir réalisé la coupe, nous nous sommes aperçus qu’il s’agissait en fait de deux fosses distinctes juxtaposées. Toutes ces structures possèdent un plan circulaire et un profil en cuvette, régulier dans un cas (St. 64A) et irrégulier dans les deux autres. Leurs profondeurs sont relativement faibles : 0,5 m au maximum. Leurs comblements sont constitués d’une unique couche de limon lehmique brun foncé. Elles se situent toutes les trois à peu près au centre de l’emprise (fig. 10). Deux d’entre elles, St. 88 et 64B, ont livré du mobilier céramique et un fragment de grès. II.1.1.2. Les fentes
Un ensemble de 33 fentes et une fente isolée ont été mis au jour (fig. 15 et16 ; Pl. I à XV).
Fig. 11 : Vue en coupe des structures 116 (ci-contre) et 123 (ci-dessous)
48
Il s’agit de structures au plan oblong ou ellipsoïdal dont les longueurs sont comprises entre 1,20 et 3,65 m pour une largeur de 0,3 à 1,16 m. Les profils sont majoritairement en V. Le fond de certaines structures est rétréci, leur donnant ainsi un profil proche d’un Y. Deux structures (St. 61 et 128 (Pl. IV et XIII)) ont cependant un profil en U qui, dans le cas de la St. 61, la rapprocherait des Sohlgraben des auteurs allemands. Les profondeurs de ces structures s’échelonnent entre 0,15 et 1, 70 m. Les différences de profondeur ne semblent pas être dues à une érosion liée à la pente. Certaines structures du haut de pente, qui auraient dû subir une érosion plus importante qu’en bas de pente, sont au moins aussi bien conservées que celles du bas de pente. Leur comblement est essentiellement constitué de limon lehmique brun foncé compact et hétérogène. Le remplissage au niveau de leurs fonds se compose souvent de limon loessique (ou d’un mélange de limon lehmique et loessique). Il s’agit sans doute là d’effondrement des parois. Cette dernière couche inclut fréquemment de petits éléments calcaires, ce qui est probablement dû à la stagnation d’eau (fig. 11). Les orientations forment un éventail autour de l’axe nord-est / sud-ouest. Une fente (St. 76 (Pl. V)) est toutefois orientée ouest-nord-ouest / est-sud-est. Ces structures sont donc disposées de manière globalement perpendiculaire à l’axe de la pente (fig. 12).
Les fentes s’organisent le long d’une bande d’une trentaine de mètres de large pour près de 170 m de long, grossièrement orienté selon un axe nord-nord-est / sud-sud-est. Il est très probable que cet ensemble de fentes se poursuive au-delà de l’emprise (fig. 10). Une structure, la fente 92, est cependant à l’écart de cet ensemble puisqu’elle se situe, isolée, dans la moitié ouest de la zone de fouille. La cohérence des orientations et de l’organisation spatiale de ces structures permet de supposer qu’elles forment un ensemble contemporain. Or, quatre de ces fentes (St. 76, 82, 113 et 116) ont livré du matériel céramique et lithique attribué au Néolithique moyen. La structure 76 est, en outre, recoupée par une fosse (St. 60) datée du Néolithique récent. Ces éléments nous ont donc amenés à considérer que l’ensemble des fentes pouvait être daté du Néolithique moyen.
II.1.2. Le mobilier
II.1.2.1. La céramique
Cinq structures ont livré du mobilier céramique : St. 64B, 82, 88, 113 et 116. La série compte 40 tessons appartenant à au moins cinq individus (fig. 17).
Les aspects technologiques de la série n’appellent que peu de commentaires. Les tessons, plutôt fins, ont des surfaces de couleur brune, bien lissée.
Un seul individu (n°1 fig. 13) est suffisamment bien conservé pour être attribué à une forme particulière. Il s’agit très probablement d’un gobelet à panse globulaire, qui est la forme la plus fréquente au sein du corpus Bruebach-Oberbergen et qui dériver du Kugelbecher de la culture de Roessen. Ce type de récipient se retrouve sur l’ensemble des sites attribués à la culture de Bruebach-Oberbergen16. Le tesson n°3 fig. 13 pourrait lui aussi appartenir à ce même type de récipient.
Un seul élément plastique, une petite anse, a été mis au jour dans la structure 82. Elle n’a toutefois pas pu être associée à une forme particulière.
Trois vases sont décorés (n°1, 2 et 3 fig. 13) : le décor du gobelet n°1 se compose d’une bande spatulée élargie vers le haut par une rangée d’impressions obliques. En dessous,
16 Lefranc 2001
49
0 25 m
278.00
279.00
280.00
281.00
282.00
283.00
284.00
285.00
286.00
287.00
288.00
0 1 m
0 1 m
Fig. 12 : Organisation spatiale et coupes des fentes
50
trois rangées de ces impressions alternent avec au moins une ligne incisée. Hormis la bande spatulée, l’ensemble des décors a été réalisé au poinçon. On peut noter que la ligne incisée pourrait, à l’origine, avoir eu pour fonction d’aider à placer et organiser le décor sur le vase.
L’ensemble des décors et des formes de la série trouvent des équivalences dans le corpus de la culture de Bruebach-Oberbergen. Le décor de l’individu n°1 fig. 13, de par l’utilisation quasi exclusive du poinçon et l’absence de décors réalisés au peigne de plus de deux dents (statistiquement très représenté dans les ensembles récents), nous amène à proposer une datation à la phase ancienne du groupe de Bruebach-Oberbergen. Toutefois, dans le cas des vases 2 et 3 de la figure N6 on ne peut exclure le Bischheim.
II.1.2.2. L’industrie lithique taillée
L’industrie lithique taillée est uniquement représentée par une armature de flèche perçante mise au jour dans la structure 76 (n°4 fig. 13 et fig. 18). Par sa forme triangulaire à base concave et ses retouches envahissantes, elle répond globalement aux caractéristiques attendues pour les armatures du Néolithique moyen. Cette pièce se distingue toutefois par son épaisseur relativement importante qui pourrait s’expliquer par son caractère opportuniste.
II.1.2.3. L’outillage poli
L’outillage poli n’est, lui aussi, représenté que par un seul artefact (Fig. 18). Il s’agit d’un fragment d’un outil de mouture en grès provenant de la structure 64B.
II.1.3. Discussion
Sur la commune de Sierentz, des indices Bruebach-Oberbergen avaient déjà été
Fig. 13 : Mobilier Bruebach-Oberbergen
20 kmN
A.Denaire, Antea-Archéologie
SIERENTZ
51
20 kmN
A.Denaire, Antea-Archéologie
SIERENTZ
Fig. 14 : Carte des sites Bruebach-Oberbergen du sud de la plaine du Rhin supérieur
52
trouvés sur le site de «Tiergarten», sous la forme de deux tessons erratiques17, attribués dans un premier temps au Rubané. Le mobilier de la fin du Néolithique moyen mis au jour aux «Villas d’Aurèle» n’est pas beaucoup plus abondant. Toutefois, il permet de confirmer l’occupation humaine de la commune à cette période et d’intégrer Sierentz au corpus de sites Bruebach-Oberbergen du sud de la plaine du Rhin supérieur (fig. 14).
A Sierentz «Les Villas d’Aurèle» la présence de ce groupe est essentiellement matérialisée par un ensemble de fentes. Les fentes sont des structures que l’on retrouve régulièrement en Alsace dans des contextes couvrant les périodes du Néolithique et de l’Age du Bronze.
Dans la région, les mieux connues, parce que les plus nombreuses, sont attribuées aux cultures danubiennes du Rubané et du Grossgartach18. Les fentes appartenant aux périodes postérieures sont beaucoup plus rares. Ainsi, aucune fente n’était, jusqu’à ce jour, datée de la fin du Néolithique moyen. Pour le Néolithique récent, les cas régionaux sont rares et de datation incertaine : une fente de Hohatzenheim (Bas-Rhin) contenait une inhumation19, une autre de ces structures recoupait la sépulture d’Eschentzwiller (Haut-Rhin)20, datée de 3900 Av. J.-C. Le Néolithique final, quant à lui, ne fournit aucun exemplaire de fente. Il faut dire que cette période est assez mal connue dans la région. Pour la période protohistorique, on trouve des fentes sur le site Bronze ancien de Rixheim (Haut-Rhin) et enfin, récemment, deux fentes datées par 14C du Bronze final ont été mises au jour à Didenheim «Karlberg»21. Dans le reste du nord de la France, ce type de structure connait un «pic» de fréquence décalé par rapport à l’Alsace. Il débute en effet au Néolithique moyen II (correspondant au Néolithique récent alsacien) et se poursuit durant le Néolithique récent et final de ces régions22. On peut se demander s’il n’y aurait pas là comme un phénomène de diffusion d’ouest en est.
La fonction de ces structures reste, depuis leur reconnaissance dans la première moitié du XXe siècle, toujours énigmatique. Les différentes explications avancées les liant au domaine de l’artisanat (tannage, tissage), de la chasse (piège) ou encore leur conférant un caractère cultuel, n’ont jamais pu être réellement prouvées. De ce point de vue, Sierentz n’apporte aucune information supplémentaire permettant d’infirmer ou de confirmer ces hypothèses. En revanche, l’organisation spatiale des fentes sur ce site est assez unique. Dans les contextes d’habitats danubiens, les fentes s’organisent en effet en «quartier» ou sont isolées (Lefranc, Bischoffsheim). Lors des périodes suivantes, on les trouve le plus souvent de manière isolée. En Allemagne, plusieurs de ces structures sont placées perpendiculairement aux entrées des enceintes du Néolithique récent23, par exemple à Bruchsal «Aue» (Kr. Karlsruhe)24, Heilbronn-Klingenberg (Kr. Heilbronn)25 ou encore sur le site éponyme de Michelsberg (Kr. Bruchsal)26.
A Sierentz, tout se passe comme si leur implantation suivait un tracé linéaire non matérialisé. Si l’on ajoute à cela le fait que le profil des fentes évoque de manière assez nette le profil des fosses composant les fossés discontinus bien connus dans le Néolithique régional, il est possible qu’il y ait là un rapport entre les deux types de structure que nous voudrions souligner ici.
17 Wolf et al. 1993 : n°20 et 21 fig 1118 Lefranc 200719 Lambach 198620 Wolf 197921 Denaire et Vergnaud, à paraitre22 Achard-Corompt et al. 201123 Perrin 200524 Behrends 198725 Biel 198626 Lüning 1968
53
N° d
e St
ruct
ure
Type
Plan
Prof
ilO
rient
atio
nR
elat
ions
Long
ueur
(m
.)La
rgeu
r (m
.)D
iam
ètre
(m.)
Prof
onde
ur
(m.)
Rem
plis
sage
Plan
che
6FT
Obl
ongu
een
VN
/S -
2,72
0,7
-0,
86lim
on le
hmiq
ueco
mpa
ct e
t lim
on lo
essi
que
com
pact
ave
c gr
ain
de c
alca
ire.
I
9FT
Obl
ongu
een
VN
E/SO
-2,
740,
66 -
1lim
on le
hmiq
ue b
run
com
pact
ave
c po
ches
de
loes
sI
12FT
Obl
ongu
een
VN
NO
/SSE
-3,
160,
8 -
1,44
limon
lehm
ique
bru
n co
mpa
ct e
t hom
ogèn
eII
14FT
Obl
ongu
een
VE/
O -
2,22
1,16
-0,
82
couc
hes
limon
lehm
ique
con
cret
ionn
é, li
mon
le
hmiq
ue b
run
com
pact
et h
omog
ène
II
17FT
Obl
ongu
een
VE/
O -
2,6
0,52
-0;
68lim
on le
hmiq
ue b
run
com
pact
et h
omog
ène.
Li
mon
lehm
ique
+ lo
ess
conc
rétio
nné
III
47FT
Obl
ongu
een
VN
NO
/SSE
-2,
960,
4 -
0;78
limon
lehm
ique
bru
n fo
ncé,
com
pact
, inc
lusi
on d
e lo
esIII
55FT
Obl
ongu
een
VN
E/SO
-1,
80,
5 -
0,63
limon
lehm
ique
bru
n co
mpa
ct e
t loe
ss a
vec
grai
n ca
lcai
re c
ompa
ctIII
61FT
Obl
ongu
een
VE/
O -
3,1
0,7
-1,
55lim
on le
hmiq
ue c
ompa
ct e
t loe
ss in
duré
ave
c gr
ain
calc
aire
IV
63FT
Rec
tilig
neen
cuv
ette
E/O
-2,
850,
35 -
0,15
limon
lehm
ique
bru
n cl
air,
com
pact
, hét
érog
ène
IV
64 A
FSC
ircul
aire
en c
uvet
te -
- -
-1,
70,
45lim
on le
hmiq
ue b
run
fonc
éV
64 B
FSC
ircul
aire
en c
uvet
te -
- -
-4,
50,
5lim
on le
hmiq
ue b
run
fonc
éV
76FT
Obl
ongu
een
VN
O/S
Ere
coup
ée p
ar S
t. 60
2,95
0,3
-1,
4lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
V
78FT
Obl
ongu
een
VN
E/SO
-2,
850,
85 -
0,45
2 co
uche
s, li
mon
lehm
ique
bru
n et
loes
s re
man
iéVI
79FT
Obl
ongu
een
VN
E/SO
-3,
10,
6 -
0,97
limon
lehm
ique
bru
n, c
ompa
ctVI
81FT
Obl
ongu
een
VN
E/SO
-3,
10,
7 -
1lim
on le
hmiq
ue b
run
fonc
é, +
lim
on lo
essi
que
com
pact
VII
82FT
Obl
ongu
een
VN
E/SO
-2,
650,
6 -
0,78
limon
lehm
ique
bru
n, +
lim
on lo
essi
que
(cal
caire
), co
mpa
ctVI
I
84FT
Obl
ongu
een
VE/
O -
30,
6 -
0,9
limon
lehm
ique
bru
n, +
lim
on lo
essi
que
conc
rétio
nné
VIII
limon
lehm
ique
bru
n, c
ompa
ct, h
omog
ène,
+
85FT
Obl
ongu
een
VN
E/SO
-3,
650,
85 -
1,5
limon
lehm
ique
bru
n, c
ompa
ct, h
omog
ène,
+
loes
s co
ncré
tionn
éVI
II
87FT
Obl
ongu
een
VE/
O -
3,1
0,75
-1,
45lim
on le
hmiq
ue b
run,
+ lo
ess
conc
rétio
nné
IX88
FSC
ircul
aire
en c
uvet
te -
-1,
51,
4 -
0,2
limon
lehm
ique
bru
n fo
ncé
IX
92FT
Obl
ongu
een
VN
E/SO
-2,
20,
5 -
0,6
limon
lehm
ique
bru
n fo
ncé,
+ li
mon
con
crét
ionn
é bl
anc,
com
pact
IX
111
FTO
blon
gue
en V
E/O
-2,
450,
8 -
0,85
4 co
uche
s, li
mon
bru
n à
brun
cla
ir, +
loes
s re
man
iéX
113
FTO
blon
gue
en V
E/O
-3,
10,
8 -
1,6
4 co
uche
s, li
mon
lehm
ique
et l
imon
loes
siqu
e br
un fo
ncé
à br
un c
lair,
+ lo
ess
rem
anié
X
116
FTO
blon
gue
en V
NE/
SO -
2,9
0,8
-1,
73
couc
hes,
lim
on b
run
com
pact
, loe
ss ja
une,
lim
on lo
essi
que
brun
très
con
cret
ionn
éXI
123
FTO
blon
gue
en V
NE/
SO -
2,6
1,1
-1,
1lim
on b
run
fonc
é trè
s co
mpa
ct,lo
ess
rem
anié
XI
124
FTO
blon
gue
en V
E/O
-1,
200,
76 -
0,46
2 co
uche
s, li
mon
lehm
ique
bru
n fo
ncé,
com
pact
et
lim
on lo
essi
que
calc
aire
XII
125
FTO
blon
gue
en V
NE/
SO -
2,46
0,60
-1,
422
couc
hes,
lim
on le
hmiq
ue b
run
avec
que
lque
s ch
arbo
ns d
e bo
isXI
I
127
FTO
blon
gue
en V
E/O
-2,
20,
5 -
0,73
2 co
uche
s, li
mon
lehm
ique
bru
n cl
air e
t lim
on
loes
siqu
e ca
lcai
reXI
I
128
FTO
blon
gue
en V
N/S
-3,
20,
35 -
0,57
2 co
uche
s, li
mon
lehm
ique
bru
n et
lim
on
lehm
ique
+ lo
ess
conc
retio
nné
XIII
130
FTO
blon
gue
en V
NE/
SO -
30,
65 -
1,15
3 co
uche
s, li
mon
lehm
ique
bru
n fo
ncé,
loes
s re
man
ié, l
imon
bru
n +
loes
s ca
lcifi
éXI
II
131
FTO
blon
gue
en V
ENE/
OSO
-3,
150,
7 -
1,1
2 co
uche
s, li
mon
lehm
ique
bru
n co
mpa
ct e
t ho
mog
ène,
lim
on le
hmiq
ue b
run
clai
r + c
oncr
etio
nXI
V
Fig. 15 : Inventaire des structures du Néolithique moyen (1/2)
54
Fig. 16 : Inventaire des structures du Néolithique moyen (2/2)
N° d
e St
ruct
ure
Type
Plan
Prof
ilO
rient
atio
nR
elat
ions
Long
ueur
(m
.)La
rgeu
r (m
.)D
iam
ètre
(m.)
Prof
onde
ur
(m.)
Rem
plis
sage
Plan
che
132
FTO
blon
gue
en V
NE/
SO -
2,3
0,65
-1,
13
couc
hes,
lim
on le
hmiq
ue b
run,
lim
on lo
essi
que
calc
aire
, lim
on b
run
clai
r, ca
lcifi
éXI
V
133
FTO
blon
gue
en V
ENE/
OSO
-2,
20,
5 -
0,5
2 co
uche
s, li
mon
lehm
ique
bru
n et
lim
on
lehm
ique
con
cret
ionn
éXI
V
134
FTO
blon
gue
en V
NE/
SO -
2,6
0,4
-0,
62
couc
hes,
lim
on le
hmiq
ue b
run
et li
mon
le
hmiq
ue c
oncr
etio
nné
XV
135
FTO
blon
gue
en V
NE/
SO -
30,
6 -
13
couc
hes,
lim
on le
hmiq
ue b
run,
loes
sXV
135
FTO
blon
gue
en V
NE/
SO -
30,
6 -
13
couc
hes,
lim
on le
hmiq
ue b
run,
loes
sXV
139
FTO
blon
gue
en V
NE/
SO -
1,30
0,42
-0,
95Li
mon
lehm
ique
bru
nXV
140
FTO
blon
gue
en V
NE/
SO -
1,70
0,34
-0,
65Li
mon
lehm
ique
bru
nXV
55
Hauteur conservée
Ø ouverture
Ø max. conservé Epaisseur
64B 64.1 9 Indet. 2,8 - - 0,6 Fragments de panse décoré d'une ligne d'impressions en forme de coin, probablement réalisé a la spatule.
82 82.1 1 Indet. 4,1 - - 1,1 Fragment de panse orné d'une petite anse.
88 88.1 20 Gobelet 6,8 12,2 12,5 0,5
Fragments de bord appartenant à un gobelet à panse globulaire décoré. De haut en bas le décor s'organise en : une rangée d'impressions obliques en forme de grains de riz ; une bande spatulée ; une ligne incisée ; une seconde rangée d'impressions obliques en forme de grains de riz ; une seconde ligne incisée ; deux rangée d'impressions obliques en forme de grains de riz. Ces impressions et les lignes incisé ont été réalisé a l'aide d'un poinçon.
113 113.1 1 Indet. - - - 0,8 Fragment de panse
116 116.1 9 Gobelet ? 3,7 - - 0,6 / 0,8
Fragments de panse pouvant appartenir à un gobelet à panse globulaire, décoré de lignes parrallèles de points imprimés réalisé au poinçon. . Deux de ces lignes sont bien lisibles, la troisième, surmontant les deux autres, n'est rerprésentée que par un partie d'une seule impression.
ObservationsStructureN°
d'inventaire
Nombre de tessons Forme
Dimensions (cm.)
Fig. 17 : Inventaire descriptif de la céramique néolithique moyen
L. l. Ep.Grès 64B 64.2 7 6,5 5,5 Fragment d'outil de mouture
Silex 76 76.1 2,1 1,8 1
Armature de flèche de forme triangulaire à base concave, avec une légère tendance asymétrique et à retouches bifaciales. Cette pièce, relativemment épaisse, a été réalisé dans un silex gris veiiné de blanc opaque. La face supérieure porte des retouches couvrantes abruptes à semi-abruptes, les retouches de la face inférieures sont, elles, convrantes, semi-abruptes à rasantes.
Nature Structure N° d'inventaire
Dimension (cm.)Description
Fig. 18 : Inventaire descriptif du matériel lithique néolithique moyen
56
0 25 m
- avec restes humains
- sans restes humains
Les n° de structure entre parenthèses et en italiquerenvoient à la numérotation du diagnostic
Structure Munzingen
Structure autres périodes
984
000
307 000
306 900
985
000
15(FS 104)
3
117
138(SP 110)
91(FS 123)
39
60
90
Fig. 19 : Localisation des structures Munzingen
57
II.2. LE NEOLITHIQUE RECENT
II.2.1. Les Structures
Huit structures ont été attribuées à la période du Néolithique récent (fig. 32 ; Pl. XVI à XXI). La localisation de ces structures au sein de l’emprise ne semble pas obéir à une organisation particulière. Tout au plus peut-on souligner que cinq d’entre elles se situent dans la moitié ouest de l’emprise (fig. 19).D’après le profil des structures, deux grands types peuvent être distingués. D’une part des fosses peu profondes à fond plat ou en cuvette et d’autre part des fosses plus profondes dont le profil possède des parois subverticales et un fond aplani.
Quatre structures appartiennent au premier type : St. 39, 60, 90 et 91 (Pl. XVIII et XIX). Toutes ont en commun leur plan, de forme circulaire dont le diamètre s’échelonne entre 1,20 et 1,85 m. Leur profil peut être en cuvette (St. 90 et 91) ou à fond plat (St. 39 et 60). Ces fosses sont peu profondes, la plus grande atteignant 0,76 m de profondeur sous le niveau de décapage (St. 39). Leur remplissage est essentiellement composé de limon lehmique compact de couleur brune. Dans deux structures (St. 90 et 91), le comblement est unique tandis que différentes couches ont été reconnues dans les remplissages des structures 39 et 60. La fosse 60 présente la particularité de recouper la fente 76, attribuée au Néolithique moyen. Toutes ces fosses ont livré du matériel, essentiellement de la céramique. Des restes osseux humains ont en outre été mis au jour dans la structure 90. Ils reposaient sur un amas de céramique, d’élément de faune, d’argile cuite et de bloc de pierre mêlés.
Les structures de la seconde catégorie sont au nombre de quatre : St. 3, 15, 117 et 138 (Pl. XVI, XVII, XX et XXI). Leur plan et leurs profils sont variables bien que toutes aient un fond que l’on peut considérer comme plat. Leurs profondeurs varient entre 1,34 et 1,95 m. La structure 3 possède un plan ovale et des parois plus ou moins rectilignes, légèrement évasées. Le plan de la structure 15 tend vers le cercle, mais une légère excroissance est présente au sud-est. Son profil ressemble à celui de la fosse 3, bien que l’aspect général soit plus trapu. Les structures 117 et 138 possèdent un plan subcirculaire. La fosse 117 a un profil en S et la structure 138, un profil en U dans sa partie inférieure s’élargissant brusquement à peu près à mi-hauteur. Toutes ces structures possèdent un comblement stratifié, essentiellement composé de limon lehmique compact de couleur brune. Le comblement de la structure 3 correspond plus ou moins au remplissage classique d’une structure de type silo. Un premier comblement s’effectue par un apport de terre assez rapide (type «en dôme»), puis une seconde phase semble, d’après l’aspect lité du sédiment, être un comblement progressif naturel. Enfin, la troisième phase correspond à un comblement terminal s’étant déroulé dans un temps assez court. Sur chaque côté, une couche de loess remanié correspond à l’effondrement des parois. La structure 15 suit de manière générale le même fonctionnement. On note cependant que le dôme a été réalisé en deux temps, séparé par un effondrement des parois. Par la suite, et jusqu’en haut, le remplissage s’est effectué de manière naturelle si l’on s’en réfère à l’aspect lité du sédiment. La fosse 117 (fig. 20) possède un remplissage plus complexe, alternant couche de loess remanié et de limon lehmique avec ou sans inclusions charbonneuses. Il semble que ce comblement se soit effectué par une succession d’apports ponctuels de sédiments, entrecoupés de périodes où la structure a été laissée ouverte, pendant lesquelles les parois se sont effondrées. Enfin, le remplissage de la structure 138, tout comme la fosse 3, se compose de trois grandes phases. Un premier comblement est constitué d’une couche de lehm incluant des
58
particules charbonneuses, puis un remplissage à l’aspect plus naturel, composé de loess et de lehm mélangé à des inclusions charbonneuses, puis enfin un comblement terminal matérialisé par une couche de lehm. Du mobilier, essentiellement composé de céramique et d’éléments de faune a été mis au jour dans le remplissage de ces quatre structures. La structure 138, fouillée par l’INRAP, a de plus livré quatre squelettes déposés sur le fond. Un fragment de calotte crânienne a aussi été mis au jour dans la structure 117.
II.2.2. Les restes humains
Trois structures ont livré des restes humains : les structures 90, 138 et 117. L’étude anthropologique détaillée se trouve dans l’annexe II.
II.2.2.1. La structure 90 (HBE) (fig. 21 et 22)
Les ossements humains mis au jour appartiennent à au moins deux individus. Ils étaient déposés sur un amas de matériel mêlant tessons, restes de faune, argile cuite et blocs de pierre. L’individu 1 est une femme dont l’âge au décès est compris entre 20 et 49 ans. Seule une partie de son squelette est présent (la partie inférieure du tronc, le bassin et les fémurs) dans la moitié est de la fosse. Un crâne et un fragment de fibula appartenant à un individu adulte sont situés l’un à côté de l’autre, au centre de la fosse. Ces éléments ne peuvent cependant pas être attribués de façon certaine au squelette 1, mais pourraient aussi bien appartenir à un troisième individu. L’individu 2 était déposé sur le coté gauche, contre la paroi sud, son crâne reposant sur un tesson de céramique. Il s’agit d’un nourrisson d’environ 9 mois.
Fig. 20 : Vue en coupe de la St 117
59
Fig. 21 : Vue en plan de la St 90
N
Individu 1
Individu 2
Amas de matériel
Niveau de dépot de l’individu 1
0 20 cm 1 m
Limon lehmique brun sombrehétérogène compact
Céramique
Pierre
Os animaux
Fig. 22 : Plan et coupe de la St 90
60
II.2.2.2. La structure 138 (fig.23)
Cette structure a été fouillée lors de l’opération de diagnostic menée par l’Inrap. Malgré plusieurs sollicitations de notre part, nous n’avons pas pu récupérer le matériel osseux de cette structure. Les données suivantes sont issues de l’étude anthropologique réalisée par A. Latron-Colecchia dans le cadre du rapport de diagnostic. Quatre squelettes ont été mis au jour au fond de la structure. L’individu 1 était déposé directement sur le fond de la structure. Il s’agit d’un enfant dont l’âge au décès est compris entre 2 et 3 ans. Il reposait sur le ventre, la tête vers le sud, son membre supérieur gauche fléchi et les membres inférieurs très écartés et fléchis. Le défunt 2 est un enfant âgé entre 6 et 8 ans qui reposait en position fléchie sur le coté gauche, sur le fond de la structure, contre la paroi ouest. Le squelette 3 appartient à un enfant de 2 ou 3 ans déposé sur le fond de la fosse, et en contact avec l’individu 1. Il est orienté selon un axe sud / nord, la tête au sud. Ses membres inférieurs et supérieurs sont fléchis. Enfin, l’individu 4 est un homme adulte dont l’âge est compris entre 20 et 39 ans. Son cadavre, orienté est / ouest, était déposé sur celui des trois enfants. La partie supérieure de son corps reposait sur le ventre, la partie inférieure, sur le côté gauche.
II.2.2.3. La structure 117 (HBE) Un petit fragment de calotte crânienne isolé a été trouvé dans le comblement cette structure, mêlé au matériel.
II.2.3. Le mobilier
II.2.3.1. La céramique
Le corpus céramique totalise 645 tessons pour 37 individus identifiés répartis dans les huit structures attribuées au Munzingen (fig. 33 et 34) .
Approche technologique Les aspects technologiques de la série appellent peu de commentaires et sont, somme toute, assez classiques dans le cadre des productions Munzingen. L’aspect de la pâte des vases n°1, 3 et 4 de la fig. 25, n°2 fig. 26 et n°3 fig. 27 indiquent cependant que ceux-ci ont subi une forte chauffe postérieure à leur cuisson. Certains de ces récipients, et en particulier l’individu 4 fig. 25, ont, en outre, subi une modification de leur forme, résultant de l’action du feu. La «cohérence» de cette déformation et la bonne préservation des cassures des tessons indiquent que la recuisson a été subie par les vases alors qu’ils étaient encore entiers.
Les formes Six types de formes identifiées. Pour la majorité (neuf individus), il s’agit de pot à profil en S (n°1 fig. 24, n°2, 3 et 4 fig. 25, n°2 fig. 26, n°2 et 4 fig. 29). Certains individus tels que les vases n°1 et 3 de la figure 26 peuvent probablement appartenir à ce type de forme. On en trouve des exemples dans le corpus des sites de Didenheim27, à Riedisheim28 ou encore dans la petite série de Wittenheim29. La série compte aussi deux jattes. L’une d’entre elles (n°4 fig. 27) possède une carène tandis que le profil de la seconde (n°1 fig. 29) est en forme de S. Ce type de forme n’est pas très courant dans les ensembles de la région mulhousienne. Un exemplaire caréné est
27 Schweitzer 198728 Scweitzer et Fulleringer 197329 Guillotin et al. 2011
61
Vue générale du dépot de corps humains
Vue de l’individu 1
Vue de l’individu 2
Vue de l’individu 3
D’après Latron et al 2010Cliché : F. Latron, INRAP
Niveau d’apparitiondes squelettes
0 20 cm 1 m
N
Limon loessique brun / jaune hétérogène compact
+ inculsions charboneuses
Limon lehmique brun hétérogène compact
Limon lehmique brun et limon loessique brun / jaune
hétérogène compact
Limon lehmique brun hétérogène compact + inclusions charboneuse
Fig. 23 : Plan, coupe et vues des squelettes de la St 138
62
présent à Didenheim «Lerchenberg»30 et un autre à Wittenheim «Le Moulin»31. Cette dernière jatte se distingue cependant de l’exemplaire de Sierentz par les dimensions plus importantes de son col. Quatre types de forme ne sont représentés que par un seul individu. Le col n°5 fig. 29 pourrait appartenir à une bouteille. Ce type de forme correspond à un vase de stockage qui se distingue par son embouchure très fermée et son col droit. On en retrouve à Didenheim «Lerchenberg»32, Didenheim/Morschwiller «Rocade Ouest»33, ou encore à Riedisheim34. L’écuelle n°2 fig. 27 appartient à un type de forme très ubiquiste que l’on peut retrouver dans l’ensemble du corpus céramique Munzingen. Enfin, le pot tronconique n°1 fig. 25 et le vase à col rentrant n°3 fig. 27 ne trouve pas d’équivalence dans le Munzingen local.
Les éléments plastiques Six individus sont ornés d’éléments plastiques. Il s’agit très majoritairement de boutons circulaires. Tous sont disposés en couronne près ou sur la lèvre des vases n°1 et 4 fig. 25, n°3 fig. 26, n°1 fig. 27 et n°2 fig. 29. Leur nombre peut varier de quatre à dix. Dans trois cas ces boutons se situent sur des pots à profil en S, dans un cas sur un pot tronconique et enfin le dernier exemplaire appartient à un récipient dont la forme n’a pu être déterminée.Les boutons disposés en couronne sous le bord sont un type d’élément décoratif que l’on retrouve dans le Munzingen de la région mulhousienne, le plus souvent sur des pots à profil
30 Jeunesse 198931 Guillotin 201132 Jeunesse 198933 Lefranc et al. 201134 Scweitzer et Fulleringer 1973
Fig. 24 : Mobilier céramique de la St 39
66
en S, par exemple à Didenheim «Lerchenberg»35 et à Wittenheim «Le Moulin»36. Le second type d’éléments plastiques est une petite anse, issue de la structure 91, qui n’a pu être associée à un type de forme particulier.
Discussion La majorité des vases de Sierentz trouvent des équivalents dans les séries Munzingen de la région de Mulhouse, en particulier les pots à profil en S portant une couronne de boutons sous la lèvre, type assez caractéristique des ensembles du sud de la Haute-Alsace. Certaines formes, telles que le pot tronconique ou le vase à bord rentrant, sont cependant uniques dans le contexte local. Ces types de récipients se retrouvent en revanche dans les séries de Basse-Alsace comme Holtzheim37 et Geispolheim «Forlen»38, ainsi que sur le site éponyme de Munzingen39, certains décorés par une couronne de boutons suborale. Le site de Geispolheim «Forlen» a, en outre, fourni un des rares autres exemplaires alsaciens de vase à bord rentrant.
II.2.3.2. L’outillage lithique
L’outillage lithique taillé se compose d’un total de six objets en silex qui ont été mis au jour dans quatre structures, mais plus particulièrement de la fosse-silo 117 (fig. 35). Trois éléments sont de simples éclat ou esquille non retouchés. Les trois autres sont des outils. Deux probables grattoirs proviennent des St. 138 et 117 (n°3 fig. 28). Le dernier outil, une probable armature de faucille, provient également de cette dernière structure (n°2 fig. 28).
L’outillage en pierre polie (fig. 36) est représenté par une petite lame d’herminette ou de ciseaux en pierre noire provenant de la St. 117 (n°1 fig. 28) et une lame d’un outil tranchant de la St. 138 (n°3 fig. 29), probablement issue, pour Ph. Lefranc, des carrières de pélite-quartz de Plancher-les-Mines (Haute-Saône)40.
Quatre structures ont livré du mobilier en grès (fig. 36), utilisé pour des activités liées à la mouture. Ce sont plus particulièrement les structures 90 et 117 qui fournissent la grande majorité de cet outillage. On peut en outre remarquer que la quasi-totalité de ces objets porte les traces d’un passage au feu.
Bien que n’étant pas à proprement parler des outils, le mobilier lithique mis au jour dans la structure 90 inclut trois galets ayant éclaté lors d’une chauffe excessive (fig. 36). Enfin, deux fragments de blocs calcaires, eux aussi chauffés, proviennent des structures 60 et 117.
II.2.3.3. L’outillage en matière dure animale (LB et LV)
Trois objets en os ont été individualisés (fig. 28 et 37). Tous les trois proviennent de la structure 117. Dans deux cas il s’agit de fragment de pointes plates, dont une probablement réalisée sur une côte (n°4 et 5 fig. 28). Le troisième est un tube formé par une épiphyse d’oiseau aux extrémités nettement coupées et dont nous ignorons la fonction (n°6 fig. 28).
II.2.3.4. Les restes de faune (LB)
L’étude archéozoologique détaillée se trouve dans l’annexe III. Il faut cependant souligner que cette étude n’a pu prendre en compte le matériel mis au jour lors de l’opération de diagnostic, celui-ci ne nous ayant pas été fourni.35 Jeunesse 198936 Guillotin et al. 201137 Kunhle et al. 200138 Lefranc et al. 201139 Maier 195840 Latron et al. 2010
67
Fig. 28 : Mobilier de la St. 117 (n°4 à 6 : dessin LB)
Fig. 29 : Mobilier issu du diagnostic (les n° de structures sont ceux du diagnostic) (Dessins et DAO : Ph. Lefranc)
68
Sept structures ont livré des restes osseux d’animaux, la plus grande contributrice étant la fosse-silo 117 avec un nombre de restes de 354 sur un total de 401 (hors structure du diagnostic) (fig. 38). Les espèces les plus fréquentes sont le bœuf et le porc qui représentent à elles deux la moitié du corpus.
II.2.4. Discussion
L’occupation humaine de Sierentz au Néolithique récent se matérialise par un ensemble de fosses circulaires. Les différences de profondeurs existant entre les structures ne semblent pas être dues à un phénomène d’érosion différentielle puisque chaque type de fosse est réparti sur l’ensemble de l’emprise. Si la fonction des fosses les moins profondes reste inconnue, le profil des structures de plus grandes dimensions évoque des silos bien qu’aucun élément ne nous permette d’être affirmatifs. Sur la plupart des sites ayant été fouillés sur une surface suffisante, les structures Munzingen s’organisent sous forme de grappes. On retrouve ce type d’organisation par exemple à Holtzheim41 ou, dans une moindre mesure, à Wittenheim42. Ce modèle ne s’applique pas à Sierentz, où les structures apparaissent assez isolées et réparties sur toute la surface fouillée.La caractérisation de la nature de cette occupation est assez difficile. Si la présence de structures potentiellement liées à l’ensilage évoquerait plutôt un habitat, la mise au jour de restes osseux humains dans les deux types de fosses pourrait faire penser à une occupation à caractère funéraire. Toutefois, seules trois structures ont livré des restes humains et dans deux cas, au sein d’un contexte qui apparait comme détritique. On peut donc considérer que l’occupation de Sierentz relève de l’habitat, au sein duquel certaines structures auraient été utilisées à des fins funéraires. Cela correspond à ce qui est habituellement évoqué pour les sites de la même période.
La datation de cette occupation pose problème. L’étude de la céramique a montré que la grande majorité du matériel trouve son équivalent sur des sites de la région mulhousienne habituellement attribués à une phase ancienne de la culture de Munzingen (Munzingen A)43. Certaines formes sont toutefois absentes de ces ensembles et ne se retrouvent que dans des séries de Basse Alsace du Kaiserstuhl, datées de la phase B. Dans le même temps, une série de quatre dates 14C ont été réalisées sur les os des structures 90 et 117. Les résultats obtenus (annexe), résumés dans la figure 30, donnent un intervalle compris entre 3773 et 3701 Av. J.-C. ce qui est beaucoup trop jeune pour la phase A. Ce décalage entre les datations proposées par l’analyse typologique des ensembles céramiques et les datations absolues au carbone 14 n’est pas particulier à Sierentz et a été constaté pour plusieurs sites Munzingen. Un récent article44 revient sur ces problèmes. Les auteurs concluent en proposant une nouvelle périodisation interne du Munzingen, particulièrement en ce qui concerne les ensembles de la région de Mulhouse. D’après les comparaisons que nous avons pu effectuer, l’occupation Munzingen de Sierentz serait donc plutôt à placer dans l’horizon A2 proposé par les auteurs de cette contribution. Cet horizon se situerait après 3850 Av. J.-C., ce qui correspond avec les dates obtenues à Sierentz. En guise de conclusion, je reviendrai sur les restes humains trouvés dans les fosses 90, 117 et 138. La structure 90 a livré les restes d’un ou deux individus adultes et d’un bébé, déposé sur un amas de matériel. Un fragment de crâne a été trouvé dans le comblement de la structure 117. Dans la fosse 138, les restes de trois enfants et d’un adulte ont été mis au jour.
41 Kunhle et al. 200142 Guillotin et al. 201143 Jeunesse 198944 Lefranc et al 2011
69
Si le plan de ces structures est circulaire, leurs profils diffèrent : les fosses 117 et 138 sont profondes et à fond plat, alors que la structure 90, peu profonde, a un profil en cuvette. La présence de restes humains dans ces deux types de structures est une constante dans les pratiques funéraires Munzingen.
Il en est de même de l’existence de dépôt sur le fond et dans le comblement des structures, ce qui pose la question de la réutilisation ou non à des fins funéraires de fosse originellement dévolues à d’autres fonctions. Ces deux modalités se retrouvent à Sierentz où les corps de la fosse 138 sont déposés sur le fond tandis que les restes issus des structures 90 et 117 ont été mis au jour dans le remplissage.
Durant le Munzingen, la sépulture plurielle est la règle. Dans la région mulhousienne, près de 70 % des inhumations attribuées au Néolithique récent sont plurielles et toutes associent en leur sein des corps d’adultes et d’enfants45, comme dans les fosses 90 et 138. Les corps de ces deux fosses ont, semble-t-il, fait l’objet de dépôts simultanés. Ce type de dépôt est bien connu dans le Munzingen régional46. De même, le dépôt de parties de corps comme celui de la fosse 90 est attesté dans de nombreux sites tels que Didenheim ZAC des collines47, Didenheim/Morschwiller-le-Bas «Rocade Ouest»48 ou encore Riedisheim «Les Violettes»49 (n°4, 5 et 9 fig. 31).
Les ossements humains isolés tels que le petit morceau de crâne de la structure 117 sont une trouvaille assez rare dans le Munzingen alsacien, mais beaucoup plus fréquente dans le Michelsberg extrarégional50. Il s’agit toutefois le plus souvent d’os entier et non de petits fragments comme à Sierentz.
La position des corps considérée comme conventionnelle pour le Néolithique récent est la position fléchie sur le côté51 que l’on retrouve, à Sierentz, pour l’individu adulte de la structure 138 et pour le bébé de la fosse 90. Les trois corps d’enfants de la fosse 138 sont en revanche dans des positions très éloignées de celle-ci. De plus l’orientation de leurs corps diffère nettement de celle l’individu adulte. Ce type de dépôt, qualifié d’asymétrique, associant un individu «correctement» déposé et plusieurs autres en position désordonnée, est bien connu dans le Néolithique récent alsacien, par exemple dans la structure 28 de la zone 3 du site de Didenheim/Morschwiller-le-Bas52. Cette pratique est actuellement interprétée selon le modèle de l’accompagnement funéraire53 qui consiste en l’inhumation d’un individu principal auquel on adjoint un ou plusieurs autres individus exécutés pour l’occasion.45 Lefranc et al. 201046 Lefranc et al 201047 Lefranc et al. 201048 Denaire 200749 Scweitzer et Fulleringer 197350 Lefranc et al.201051 Lefranc et al 201052 Denaire 200753 Lefranc et al 2010
Poz-41231 Os 4990 ± 40 BPPoz-41232 Os 4910 ± 40 BPPoz-41224 Os 4985 ± 35 BPPoz-41225 Os 4960 ± 40 BP
St. 90 3771 3701 3787 3661
St. 117 3773 3711 3895 3663
Structure Code Lab. Nature de l'échantillon Date (BP)
Cumul des prob. des dates calibrées (av. J.-C.)1σ 2σ
Fig. 30 : Tableau synthétique des datations carbone 14 des structures 90 et 117
70
Dans la pratique funéraire Munzingen, le dépôt de mobilier est relativement peu fréquent. Il est généralement constitué d’un ou deux objets, essentiellement des vases (complet ou archéologiquement complet), plus rarement des objets en matière dure animale ou du matériel de mouture. Le matériel de la structure 138 répond pleinement à ce schéma. En revanche, la fosse 90 est un cas un peu plus particulier. L’amas de mobilier sur lequel reposaient les restes humains se composait de galets, de fragments d’outil de mouture en grès, d’argile cuite, de restes osseux animaux et de tessons de céramique. Cet amas ne ressemble pas aux dépôts de matériel observé dans les inhumations en fosse circulaire «classique» telle que la structure 138. Il possède en effet un très fort aspect détritique : aucune organisation particulière pouvant évoquer un dépôt n’a été reconnue. Tout se passe comme si les différents éléments avaient bel et bien été jetés dans la fosse. On note aussi que beaucoup de ces objets ont subi une forte chauffe ayant occasionné la déformation de certains vases et l’éclatement des galets. Les os de faunes et humains ne portent, eux, aucune trace suggérant une action du feu. L’absence de sédiment au sein de l’amas et entre celui-ci et les os humains, tout comme l’homogénéité du comblement, indiqueraient que les différents dépôts (mobilier et squelette) et le scellement de la structure ont été effectués, sinon à un moment unique, pour le moins dans un laps de temps assez bref. Plusieurs hypothèses sont dès lors envisageables. Soit nous sommes ici en présence d’un rituel particulier qui aurait consisté à créer un «lit» de mobilier, au préalable volontairement détérioré à l’extérieur de la structure, sur lequel auraient été déposés les corps ou partie de corps des défunts. Soit il s’agit bel et bien d’une fosse détritique dans laquelle le corps d’un enfant et des parties de corps d’adulte ont été jetés. Il semble assez difficile de trancher entre ces deux hypothèses principales, cette fosse étant, à notre connaissance, un cas unique dans le Munzingen alsacien.
71
8
9
10
11
1
62 à 5
7
Carte : A. Denaire, Antea Archéologie
0 5 km
1-Bollwiller2-Didenheim "Kahlberg"3-Didenheim "Lerchenberg"4-Didenheim "Zac des Collines"5-Didenheim / Morschwiller "Rocade Ouest"6-Eschentzwiller "Brandstätte"7-Kleinkems "Kachelfluhhöhle"8-Riedisheim "Beau-site"9-Riedisheim "Rue des violettes"10-Soultz "Buhlfeld"11-Wittenheim "Lotissement Le Moulin"
Sierentz "Les Villas d'Aurèle"
Sites du Néolithique récentSites du Néolithique récent ayant livré des restes humains :
L'Ill
Le R
hin
Fig. 31 : Carte des sites du Néolithique récent dans le sud de l’Alsace
72
N° d
e St
ruct
ure
Type
Plan
Prof
ilO
rient
atio
nR
elat
ions
Long
ueur
(m
.)La
rgeu
r (m
.)D
iam
ètre
(m.)
Prof
onde
ur
(m.)
Rem
plis
sage
Obs
erva
tion
Plan
che
3S
IE
lliptiq
uefo
nd p
lat
- -
1,8
1,42
-1,
345
couc
hes;
alte
ranc
e de
loes
s et
lehm
, bru
n à
noir
-XV
I
15FS
Pat
atoï
defo
nd p
lat
- -
- -
2,56
1,95
6 co
uche
s al
tern
ance
de
lehm
bru
n cl
air e
t fon
cé,
loes
s et
cha
rbon
s -
XVII
39FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,54
0,76
4 co
uche
s: le
hm b
run
et c
ompa
ct, l
oess
rem
anié
, le
hm c
harb
onne
ux c
oncr
étio
n ca
lcai
res
-XV
III
60FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
-re
coup
e S
t. 76
- -
1,9
0,7
limon
lehm
ique
bru
n à
brun
/noi
r -
XIX
90S
PC
ircul
aire
en c
uvet
te -
- -
-1,
350,
25lim
on le
hmiq
ue b
run
Au
moi
ns 2
indi
vidu
s (1
ad
ulte
, 1 im
mat
ure)
XVIII
91FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,3
0,1
limon
lehm
ique
bru
n -
XVIII
117
SI
Ellip
tique
fond
pla
t -
-2,
11,
75 -
1,7
12 c
ouch
es, l
imon
lehm
ique
bru
n à
brun
cla
ir, +
lo
ess
-XX
138
SP
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
2,14
1,70
Lim
on le
hmiq
ue b
run
4 in
divi
dus
XXI
Fig. 32 : Inventaire des structures du Néolithique récent
73
Hau
teur
co
nser
vée
Ø
ouve
rtur
e Ø
max
. co
nser
vé
Epai
sseu
r
33.
17
Bord
éve
rsé
2,3
- -
0,8/
1Fr
agm
ent d
e bo
rd d
ont l
e di
amèt
re n
'a p
u et
re é
valu
é15
15.1
4In
det.
- -
-0,
5/0,
8Fr
agm
ents
de
pans
e
3939
.19
Pot à
pro
fil
en S
1619
,219
,80,
4/0,
9Fr
agm
ent d
e bo
rd a
ppar
tena
nt à
un
pot à
pro
fil e
n S
3939
.26
Inde
t. -
- -
0,5/
0,8
Frag
men
ts d
e pa
nse
6060
.113
Bord
éve
rsé
2,5
- -
0,5/
0,7
Frag
men
ts d
e bo
rd d
ont l
e di
amèt
re n
'a p
u et
re é
valu
é60
60.2
8Bo
rd d
roit
4 -
-0,
4/0,
6Fr
agm
ents
de
bord
don
t le
diam
ètre
n'a
pu
etre
éva
lué
9090
.143
Pot
tronc
oniq
ue20
,221
,2 -
1,2/
1,4
Pot t
ronc
oniq
ue p
ossé
dant
pro
babl
emen
t à l'
orig
ine
quat
re b
outo
ns c
ircul
aire
s di
spos
és s
ous
le b
ord
dont
seu
ls tr
ois
exem
plai
res
sont
con
serv
és. C
erta
ines
par
ties
de
la s
urfa
ce d
u va
se s
embl
ent a
voir
subi
une
recu
isso
n le
urs
donn
ant u
ne c
oule
ur ro
uge
et o
ccas
ionn
ant u
ne d
esqu
amat
ion.
Sur
cer
tain
es a
utre
s zo
nes
mie
ux
prés
ervé
es, d
es tr
aces
de
ce q
ui p
ourr
ait a
voir
été
du c
répi
per
sist
ent.
9090
.274
Pot à
pro
fil
en S
48,8
33,2
34,8
1/1,
4G
rand
pot
à p
rofil
en
S. L
e bo
rd lé
gere
men
t déf
orm
é et
l'as
pect
recu
it de
cer
tain
es p
artie
s év
oque
l'ac
tion
d'un
e ch
auffe
pos
térie
ure
à la
cui
sson
. Cer
tain
es z
ones
de
la
surfa
ce p
ourr
aien
t avo
ir co
nser
vé d
es tr
aces
d'u
n cr
épi.
9090
.351
Pot à
pro
fil
en S
27,2
18,4
240,
8/1,
6Va
se à
pro
fil e
n S
de fo
rme
plus
trap
ue q
ue le
pré
céde
nt. S
a su
rface
ext
erne
est
rugu
euse
et i
rrég
uliè
re.
9090
.422
Pot à
pro
fil
en S
?7,
67,
5 -
0,6/
0,8
Frag
men
ts d
e bo
rd a
ppar
tenn
ant p
roba
blem
ent à
un
petit
pot
à p
rofil
en
S.
9090
.518
Pot à
pro
fil
en S
?7,
725
-0,
8/1
Frag
men
ts d
e bo
rd re
dres
sé a
ppar
tenn
ant p
ossi
blem
ent à
un
pot à
pro
fil e
n S.
Il p
orte
3 b
outo
ns c
ircul
aire
s di
rect
emm
ent s
ous
la lè
vre.
D'a
près
leur
dis
posi
tion
il es
t pr
obab
le q
u'il
aien
t été
à l'
orig
ine
au n
ombr
e de
8.
9090
.623
Pot à
pro
fil
en S
15,1
19,2
220,
8/1,
2Fr
agm
ents
de
bord
app
arte
nnat
à u
n po
t à p
rofil
en
S. C
erta
ines
par
ties
(sou
vent
des
quam
ées)
sem
blen
t avo
ir ét
é re
cuite
s.
9090
.765
Pot à
pro
fil
en S
3420
/ 34
,8 -
0,8/
1,8
Ce
vase
a s
ubi u
ne fo
rte d
éfor
mat
ion
due
à l'a
ctio
n du
feu,
com
me
le s
uggè
rent
les
nom
breu
x te
sson
s pr
ésen
tant
un
aspe
ct re
cuit.
Cet
te d
éfor
mat
ion
a en
par
ticul
ier
touc
hée
la p
artie
sup
érie
ure
du v
ase,
qui
pos
sède
deu
x ty
pes
de p
rofil
, l'u
n av
ec u
n bo
rd tr
ès é
vers
é, l'
autre
ave
c un
bor
d dr
oit.
Il es
t pro
babl
e qu
'à l'
orig
ine
ce p
ot a
it eu
un
prof
il en
S te
l que
nou
s l'a
vons
rest
itué
sur l
a fig
ure.
Ce
réci
pien
t por
te 1
0 bo
uton
s ci
rcul
aire
s di
spos
és e
n co
uron
ne s
ous
la lè
vre.
9090
.813
Inde
t. -
- -
0,5/
0,8
Frag
men
ts d
e pa
nse
9191
.3
14Bo
utei
lle6,
211
15,3
0,6/
0,7
Frag
men
ts d
e bo
rd a
ppar
tena
nt à
une
bou
teille
9191
.46
Pot à
pro
fil
en S
7,
325
-0,
6/0,
7Fr
agm
ents
de
bord
éve
rsé
appa
rtenn
ant p
roba
blem
ent à
un
pot à
pro
fil e
n S.
9191
.53
Inde
t. -
- -
0,4/
0,5
Frag
men
ts d
e pa
nse
9191
.610
Inde
t. -
- -
0,6/
0,8
Frag
men
ts d
e pa
nse
9191
.72
Inde
t.4,
5 -
-0,
5Fr
agm
ents
de
pans
e do
nt u
n po
rte u
ne p
etite
ans
e.
117
117.
116
Jatte
ca
réné
e15
,526
,4 -
0,8/
1,1
Frag
men
ts d
e bo
rds
appa
rtenn
ant à
une
jatte
car
énée
.
117
117.
211
Pot à
bor
d re
ntra
nt10
,416
,2 -
0,6/
0,9
Frag
men
ts d
e bo
rd a
ppar
tenn
ant à
un
vase
à b
ord
rent
rant
. Sa
surfa
ce p
rése
nte
de n
ombr
euse
s zo
nes
d'as
pect
recu
it.
117
117.
119
Bord
éve
rsé
3,3
- -
1/1,
1Fr
agm
ents
de
bord
don
t le
diam
ètre
n'a
pu
etre
éva
lué
117
117.
127
Bord
dro
it2,
6 -
-0,
5/0,
6Fr
agm
ents
de
bord
don
t le
diam
ètre
n'a
pu
etre
éva
lué
117
117.
131
Bord
éve
rsé
4,2
- -
0,7/
0,8
Frag
men
ts d
e bo
rd d
ont l
e di
amèt
re n
'a p
u et
re é
valu
é11
711
7.1 4
1Fo
nd p
lat
3,7
- -
0,6/
0,8
Frag
men
ts d
'un
fond
pla
t don
t le
diam
ètre
n'a
pu
etre
éva
lué
117
117.
1528
Inde
t. -
- -
0,8/
1Fr
agm
ents
de
pans
e11
711
7.3
4Bo
rd é
vers
é4,
8 -
-0,
6/0,
9Pe
tit fr
agm
ent d
e bo
rd p
orta
nt u
n pe
tit b
outo
ns c
ircul
aire
s. S
on o
rient
atio
n es
t inc
erta
ine.
117
117.
42
Cou
pe3,
414
,1 -
0,7
Frag
men
ts d
e bo
rd a
ppar
tenn
ant à
un
coup
e.11
711
7.5
1Fo
nd p
lat
5,3
- -
1/1,
2Fr
agm
ents
d'u
n fo
nd p
lat d
ont l
e di
amèt
re n
'a p
u et
re é
valu
é11
711
7.6
7Bo
rd é
vers
é3,
1 -
-0,
8/0,
9Fr
agm
ents
de
bord
don
t le
diam
ètre
n'a
pu
etre
éva
lué
117
117.
710
Fond
pla
t6,
1 -
-0,
7Fr
agm
ents
de
bord
don
t le
diam
ètre
n'a
pu
etre
éva
lué
117
117.
837
Inde
t. -
- -
1/1,
2Fr
agm
ents
de
pans
e11
711
7.9
3Bo
rd d
roit
2,1
- -
0,9
Frag
men
ts d
e bo
rd d
ont l
e di
amèt
re n
'a p
u et
re é
valu
é
138
138.
372
Pot à
pro
fil
en S
1820
,7 -
0,8/
0,9
Frag
men
ts d
e bo
rd a
ppar
tena
t à u
ne p
ot à
pro
fil e
n S.
Deu
x bo
uton
s ci
rcul
aire
s so
nt d
ispo
sé s
ous
la lè
vre.
Ils
deva
ient
pro
babl
emen
t etre
plu
s no
mbr
eux
à l'o
rigin
e bi
en q
u'il
n'ai
t pas
été
pos
sibl
e de
pré
cise
r ce
nom
bre.
138
138.
440
Jatte
ca
réné
e13
,322
-0,
6/0,
8Ja
tte c
arén
ée à
fond
pla
t.
138
138.
53
Inde
t. -
- -
0,9/
1Fr
agm
ents
de
pans
e13
813
8.8
2In
det.
- -
-0,
8/0,
9Fr
agm
ents
de
pans
e
Stru
ctur
eD
imen
sion
s (c
m.)
Obs
erva
tions
Form
eN
ombr
e de
te
sson
s
N°
d'in
vent
aire
Fig. 33 : Inventaire descriptif de la céramique du Néolithique récent
74
Structure Bord éversé
Bord droit
Fond plat Indet.
3 1 1 715 1 1 439 1 1 1 2 1560 1 1 2 2190 4 2 6 1 1 8 30991 1 1 1 3 5 35117 1 1 1 4 2 3 2 14 137138 1 1 1 2 4 117
Total 1 1 2 1 7 2 9 1 6 3 3 10 37 645
Pot à bord
rentrant
Jatte carénéeCoupeBouteille Nombre de
tessonsTotal NMI
Forme indéterminéePot tronconique
Total Pot à profil en
S
Pot à profil en S
probable
Pot à profil en S
Fig. 34 : Tableau de comptage de la céramique du Néolithique récent
L. l. Ep.3 2 1,4 2,5 0,6 Eclat non retouché en silex gris-bleu veiné de blanc. On note la présence du talon.
15 2 1,2 0,8 0,2 Esquille non retouchée en silex gris-blanc très patiné.
117 17 3 2,2 0,7
Fragment proximal d'une lame à deux pans réalisée dans un silex brun-gris zoné. Seule la face supérieure est retouchée par des retouches abruptes à semi-abruptes. L'extrémité distale de la pièce a été brisé, probablement par un coup de burin dont les stigmates sont visibles à cet endroit. On note enfin que le talon est toujours visible en partie proximale et que la face supérieure porte ponctuellement des petites plages de lustré indiquant une probable utilisation en tant qu'armature de faucille.
117 18 2,9 4,7 0,6
Eclat retouché en silex gris-blanc très patiné. Les retouches sont abruptes à semi-abruptes sur le bord droit de la face supérieure et rasantes à semi-rasantes sur la partie distale de la même face. La face inférieure n'est pas retouchée. Cette pièce, très émoussée, pourrait avoir éventuellemment servi de grattoir.
117 19 2,2 3,3 0,8 Eclat allongé non retouché en silex blanc veiné de gris
138 2 3,3 2,9 1
Eclat trapu à tendance laminaire en silex beige. La face supérieure porte des retouches directes semi-abruptes sur le côté gauche et abruptes sur le côté droit. Les retouches de la face inférieure, directes rasantes, sont localisées sur le bord droit. Une large plage corticale occupe l'extrémité distale de la pièce. Malgré cela, les nombreuses traces de machurage dans cette zone indiquent qu'il s'agit là de la partie active de la pièce, probablement utilisé en tant que grattoir.
Dimensions (cm)DescriptionN°
d'inventaireStructure
Fig. 35 : Inventaire descriptif du matériel en silex du Néolithique récent
L. l. Ep. Ø117 21 11 1,8 0,4 - Fragment distal d'une pointe plate, probablement réalisée sur une côte d'un grand animal.117 22 3,4 0,6 0,4 - Fragment distal d'une probable pointe plate.117 23 12,9 - - 0,8 Fragment d'épiphise d'os d'oiseau. Les deux extrémités ont été coupé de façon nette.
Dimension (cm)N° d'inventaireStructure Description
75
L. l. Ep.
Pierre dure 117 16 6,8 2 1,5Petite lame d'herminette ou de ciseaux en pierre de couleur noire issue certainement de l'utilisation opportuniste d'un galet. On peut noter que la lame n'est pas disposée à angle droit vis-à-vis de l'axe longitudinal de la pièce.
Pelite Quartz 138 1 9,5 4 2,4
Lame d'un outil tranchant. Son profil, asymétrique, peut indiquer qu'il s'agit d'une herminette, comme cela avait été proposé dans le rapport de diagniostique. Cependant, en plan, le tranchant de la lame n'est pas disposé orthogonalement à l'axe longitudinal de la pièce, ce qui pourrait dès lors evoquer une hache.
Grès 60 3 15 14 4 Fragment de probable molette.
Grès 90 9 24 16 6,5 Fragment de probable meule. La surface active est très usée et piquetée. Grès 90 10 13,5 11,5 6 Fragment d'outil de probable molette. Sa face supérieure est noire et semble avoir été brulée. Grès 90 11 13 14 4,5 Fragment d'outil de mouture probalement réutilisé en tant qu'aiguisoir ou pierre à polir. Grès 90 12 7 10 5,5 Fragment d'une des extrémité d'un outil de mouture en grès brulée sur une très large partie. Grès 90 13 9 8,5 7 Fragment d'outil de mouture qui semble avoir été chauffé. Grès 90 14 13 3 5 Fragment de probable outil de mouture. Sa surface supérieure est polie.Grès 91 1 17 17 6,5 Fragment de meule.
Grès 117 24 9 8 4 Fragment d'outil de mouture. La surface inférieure semble avoir été chauffé. Des traces de poix sont présente sur la surface supérieure et sur une des cassures.
Grès 117 25 9 5 4,5 Fragment d'outil de mouture qui semble avoir été chauffé.Grès 117 26 9,5 5 6 Fragment d'outil de mouture. Grès 117 27 8 8,5 7 Fragment d'outil de mouture qui semble avoir été chauffé.Grès 117 28 5,5 5,5 1 Fragment d'outil de mouture qui semble avoir été chauffé.
Galet 90 15 9 9 7 Galet fragmenté dont l'eclatement est certainement du a une chaufe excessive.
Galet 90 16 7 4 4 Fragment de galet chauffé.Galet 90 17 8 10 5 Fragment de galet. Sa surface supérieur est aplanie et semble avoir été chauffé.
Calcaire 60 5 7 3,5 2,5 Fragment de calcaire chauffé.Calcaire 117 29 9 4,3 6 Fragment de bloc calcaire qui semble avoir été chauffé.
Out
illag
e de
mou
ture
Div
ers
DescriptionNature N° d'inventaireStructure
Dimension (cm.)O
utill
age
poli
Fig. 36 : Inventaire descriptif du matériel lithique du Néolithique récent (hors silex)
L. l. Ep. Ø117 21 11 1,8 0,4 - Fragment distal d'une pointe plate, probablement réalisée sur une côte d'un grand animal.117 22 3,4 0,6 0,4 - Fragment distal d'une probable pointe plate.117 23 12,9 - - 0,8 Fragment d'épiphise d'os d'oiseau. Les deux extrémités ont été coupé de façon nette.
Dimension (cm)N° d'inventaireStructure Description
Fig. 37 : Inventaire descriptif du matériel en matière dure animale du Néolithique récent (LB et LV)
StructureEspèces 15 39 60 90 117 Total
Boeuf 12 123 135Capriné 8 8
Porc 1 134 135Cerf 1 1
Lièvre 12 12Chat sauvage 15 15
Oiseau sp. 1 1Autres espèces 4 4
Petit mammifère 1 22 23Grand mammifère 1 21 22
Indet. 1 44 45Total général 19 1 12 15 354 401
Fig. 38 : Tableau de comptage des restes de faune dans les structures du Néolithique récent (LB)
76
0 25 m
10
137
068
069
984
000
307 000
306 900
985
000
0 10 m
St.137
St.68
St.69
St.10
Fig. 39 : Localisation et plan de l’ensemble funéraire campaniforme
77
II.3. LE NEOLITHIQUE FINAL
Dans la partie sud de l’emprise de la fouille, quatre sépultures attribuées au Campaniforme ont été mises au jour (fig. 84 et Pl. XXII à XXIV) . Cet ensemble funéraire se développe sur près de 55 m en suivant un axe nord-ouest / sud-est (fig. 39).
II.3.1. Description
II.3.1.1. La sépulture 10
II.3.1.1.1. Structure (fig. 40 et 84)
Cette structure très arasée, de forme quadrangulaire aux angles arrondis (1,5 x 1m) est conservée sur une profondeur maximale de 5 cm. Son remplissage, homogène, se compose de limon lœssique brun. Elle est orientée selon un axe nord-nord-ouest / sud-sud-est.
II.3.1.1.2. Individu (HBE ; cf. Annexe II)
La très mauvaise conservation de cette structure n’a pas permis de connaitre la position originelle du corps. Seuls quelques éléments du squelette d’un enfant d’environ cinq ans ont été mis au jour dans le quart nord-est de la fosse.
II.3.1.1.3. Mobilier
Il était accompagné de deux vases (fig. 85), certainement complets à l’origine, dont seuls les fonds, déposés au sud du corps, ont été retrouvés (du fait du très mauvais état de conservation de la structure).
Le fond concave n°1 fig.41 appartient probablement à un gobelet à profil en S. L’épiderme des surfaces conservées est beige à rouge avec quelques traces ponctuelles de couleur grise/noire probablement dues à des coups de feu à l’extérieure et de couleur rouge à grise/noire à l’intérieur. Le cœur de la pâte, gris/noir, indique une cuisson réducto-oxydante.
0 25 m
10
137
068
069
984
000
307 000
306 900
985
000
0 10 m
St.137
St.68
St.69
St.10
Limon loessique brunhomogène compact
Céramique
Localisation desrestes humains
N
0 20 cm 1 m
Fig. 40 : Plan et coupe de la sépulture 10
78
Le décor conservé consiste en une unique bande composée de huit rangées horizontales d’impressions au peigne, limitée dans sa partie supérieure par une impression de cordelette. L’outil utilisé pour réaliser ces impressions possède au moins 17 dents de section carrée.
Le fond concave n°2 de la même figure appartient probablement à un gobelet à profil en S. La surface extérieure est brune à rouge sombre avec quelques traces ponctuelles de couleur grise/noire probablement dues à des coups de feu. La surface intérieure est de couleur brune à grise/noire et le cœur de la pâte est gris/noir, indiquant une cuisson réducto-oxydante. Le décor conservé consiste en une succession de deux registres horizontaux séparés par une mince plage laissée vide.Chaque registre est composé d’un type de bande différent. De haut en bas, on distingue d’une part, une bande délimitée par des impressions de cordelette et remplie par un motif de croisillons composé par des segments imprimés au peigne, et d’autre part, une bande, délimitée par des impressions de cordelette, remplie par neuf rangées horizontales d’impressions au peigne.Les similitudes des impressions au peigne présentes sur le vase indiqueraient l’utilisation d’un outil unique, possédant une vingtaine de dents de section carrée dont parfois seule une partie est imprimée.
II.3.1.2. La sépulture 68
II.3.1.2.1. Structure (fig. 42, 43 et 84)
Cette sépulture, très bien conservée, est orientée selon un axe nord-ouest / sud-est. En plan, elle est de forme quadrangulaire, aux angles arrondis mesurant 2,30 m de long pour 1,80 m de large. On peut noter l’existence dans le coin ouest d’une légère excroissance. En coupe, ses parois sont sub-verticales et son fond, plat, se situe à 0,33 m du niveau de décapage.
Le comblement de la structure est constitué de trois types de sédiments différents. Le centre est comblé avec du loess brun plutôt compact. Sur les bords de la structure, on trouve soit un loess plus clair et plus meuble (loess remanié) soit une couche de lehm très compact.
II.3.1.2.2. Architecture funéraire
L’existence d’un aménagement en matière périssable est attestée par plusieurs éléments (fig. 46). Des traces noires ligneuses ont été découvertes sur le fond de la fosse
Fig. 41 : Mobilier céramique de la sépulture 10
79
Schiste
Grès
N
0 1 m20 cm
Céramique
Silex
Matière dure animale
Limon loessique brun clair / jaunehétérogène meuble
Limon loessique brun hétérogènecompact
Limon lehmique brun sombrehétérogène compact
Fig. 43 : Plan et coupes de la sépulture 68
Fig. 42 : Vue en plan de la sépulture 68
80
(fig. 44), essentiellement dans la moitié nord-ouest de la fosse et certaines sont présentes sous le squelette. Quatre fragments de piquets ont été mis au jour sur les longs côtés de la fosse. Ces éléments n’étaient pas visibles dans le comblement de la fosse et n’apparaissaient qu’au niveau du fond. Ils présentent tous à peu près le même module (fig. 45) : conservé sur une vingtaine de centimètres pour un diamètre compris entre 8 et 10 cm, leur extrémité est biseautée. Leur surface extérieure a été calcifiée sur une épaisseur d’environ un centimètre. L’intérieur de cette enveloppe de calcaire est rempli d’un loess brun clair compact. Une mince couche noire ligneuse est présente au contact du calcaire. Cet exemple de calcification du bois peut nous inciter à prendre en compte comme indices architecturaux les diverses traces de concrétions blanches présentes sur le fond de la fosse.
Ces différents éléments, associés aux observations effectuées sur le comblement de la fosse nous amènent donc à proposer différents effets de parois, représentés sur la figure 46. Dès lors l’hypothèse qui nous semble la plus probable est celle de l’existence d’un coffrage en bois réalisé avec un assemblage de planches (fig. 47).
La présence de piquets dans un sédiment compact comme le loess ne semble pas nécessaire pour maintenir les parois du coffrage. Cela laisse plutôt présumer qu’ils pouvaient supporter une superstructure, éventuellement subaérienne.
II.3.1.2.3. Individu (HBE ; cf. Annexe II)
Le sujet inhumé est un homme adulte dont l’âge au décès se situe entre 30 et 59 ans. Il a été déposé sur le côté gauche, en position hyperfléchie, selon un axe nord-ouest/sud-est, la tête vers le nord-ouest.
II.3.1.2.4. Espace de décomposition (HBE)
Les différentes observations anthropologiques (Annexe II) indiquent que le corps ne s’est pas totalement décomposé en espace vide. De même, la position de certains éléments du mobilier, et en particulier l’armature de flèche mise au jour de chant, suggère que, malgré la présence d’une architecture funéraire, la fosse sépulcrale a été comblée dans un laps de temps assez court après le dépôt du corps du défunt. Or la coupe sud-sud-ouest/nord-nord-est montre un comblement « en dôme » nous permettant d’envisager un comblement de l’espace vide du coffrage par infiltration du sédiment. Toutefois, certains mouvements osseux, ne sortant pas du volume initial du corps, ont été observés. Il est donc vraisemblable que le défunt portait sur lui une enveloppe en matière périssable ayant préservé un certain espace vide autour du corps permettant, tout en les limitant, ces déplacements. II.3.1.2.5. Matériel
Le défunt était accompagné de deux vases décorés (fig. 84), huit éléments en silex (dont trois armatures de flèches) (fig. 88), un aiguisoir en grès (fig. 86), un brassard d’archer en schiste (fig. 86) et un fragment de défense de suidé (fig. 87).
Les vases (fig. 48 et 84)Le vase n°1 fig. 50 est un gobelet à profil en S et fond concave. La surface extérieure
est beige à brune avec quelques traces ponctuelles noires probablement dues à des coups de feu. Sur la partie supérieure du vase, la surface est rouge sombre, brillante et polie. Il semble qu’il s’agisse là de l’aspect originel de la surface du vase qui n’est pas conservé ailleurs. La surface intérieure est également de couleur beige à brun clair. Le cœur de la pâte est noir, indiquant une cuisson réducto-oxydante. Le décor, couvrant, s’organise en une succession de sept registres horizontaux, délimités par des impressions à la cordelette et séparés par de minces plages laissées vides.
81
Fig. 44 : Traces ligneuses sur le fond de la structure 68 Fig. 45 : Fragment calcifié du piquet nord de la sépul-
ture 68
Traces noires ligneuses
Concrétions calcaires blanches
Niveau des tracesnoires ligneuses
Niveau du squelette
Effets de parois
N
0 1 m20 cm
Fig. 46 : Localisation des traces d’architecture dans la sépulture 68 et proposition d’effets de parois
82
? ? ? ?
? ? ? ?
Niveau de
décapage
?
?
?
?
?
?
?
?
Niveau dedécapage
Niveau desol actuel
Niveau de
sol actuel
N
0 1 m20 cm
Fig. 47 : Proposition de restitution de l’architecture de la sépulture 68
83
On distingue deux types de bandes. D’une part, une frise de losanges délimités et remplis par des impressions au peigne, l’espace entre les losanges étant laissé libre. D’autre part, une frise faisant alterner deux types de panneaux, l’un composé de 8 à 11 rangées d’impressions horizontales, l’autre, de 4 à 5 rangées verticales, réalisées au peigne.Le rythme du décor est, de haut en bas : une frise de losanges suivie de deux bandes remplies de panneaux puis une seconde frise de losanges, elle aussi suivie des deux bandes de panneaux. Enfin, une dernière frise de losanges est soulignée par une impression de cordelette. Les similitudes des impressions au peigne présent sur tout le vase pourraient suggérer l’utilisation d’un outil unique, possédant une dizaine de dents de section carrée dont parfois seule une partie est imprimée (entre 5 et 13).
Le vase n°2 fig. 50 est un gobelet à profil en S et fond concave, une partie de ce dernier étant ébréché. La surface extérieure est beige à brune. Certaines zones semblent avoir conservé l’aspect originel du vase. Elles sont, principalement localisées sur les endroits vides de décors et ont une couleur rouge sombre et un aspect brillant et poli. La surface interne est de couleur beige à brun clair et le cœur de la pâte est noir, indiquant une cuisson réducto-oxydante. Le décor, couvrant s’organise en une succession de quatre registres horizontaux, séparés par de minces plages laissées vides. On distingue trois types de bandes. Le premier type est délimité par deux rangées horizontales d’impressions au peigne. L’espace entre les deux est rempli par des rangées d’impressions réalisées au peigne. Dans le second type, la bande est, là aussi, remplie de rangées d’impressions au peigne, mais est délimitée par des impressions de cordelette. Enfin le troisième type, délimité par des impressions de cordelette, est rempli par une frise de petits triangles composés par de petits segments obliques réalisés au peigne. Le rythme du décor est, de haut en bas : un registre composé d’une bande du premier type. Les deuxième et troisième registres sont composés de deux bandes du second type encadrant une frise de triangle. Enfin, le quatrième registre ressemble aux deux précédents, exception faite de l’absence de l’impression de cordelette délimitant le bas de la dernière bande.
Fig. 48 : Vases de la sépulture 68
84
La similarité des impressions au peigne présentes sur les vases indiquerait l’utilisation d’un outil unique, possédant une vingtaine de dents de section rectangulaire dont parfois seule une partie est imprimée (entre 14 et 22). L’outil utilisé pour réaliser les impressions des segments formant les triangles semble différent, il semble ne compter que trois dents et laisse des impressions plus larges.
Outillage lithique taillé (fig. 49 et 88)L’objet n°3 fig. 50 est une pièce triangulaire, à base concave, côtés convexes, et
retouche bifaciale réalisée dans un silex blond semi-translucide. Les retouches de la face supérieure sont couvrantes, semi-abruptes à rasantes. La face inférieure porte des retouches uniquement sur le bord droit et la base. Longues, elles sont semi-abruptes à rasantes. Le bord droit et la base portent de nombreuses traces d’oxyde de fer et semblent de plus être dans un état d’usure plus avancé que le bord gauche. Il pourrait s’agir d’une pièce utilisée comme pierre à briquet.
L’armature de flèche n°5 fig. 50, de forme triangulaire, symétrique, à base concave dégageant deux ailerons et à retouches bifaciales, a été réalisée dans un silex gris/bleu veiné de blanc opaque. La face supérieure porte des retouches couvrantes semi-abruptes à rasantes. Les retouches de la face inférieure sont courtes, semi-abruptes à rasantes.
L’armature de flèche n°6 fig. 50, de forme triangulaire, symétrique, à base concave dégageant deux ailerons et à retouches bifaciales a été réalisée dans un silex gris-blanc opaque. Les deux faces portent des retouches couvrantes, semi-abruptes à rasantes.
L’armature de flèche n°7 fig. 50, de forme triangulaire, symétrique, à base concave dégageant deux ailerons et à retouches bifaciales a été réalisée dans un silex blond semi-translucide. Les deux faces portent des retouches couvrantes, semi-abruptes à rasantes.
L’objet n°8 fig. 50 est un éclat triangulaire en silex gris bleu opaque. La face supérieure porte quelques retouches semi-abruptes à rasantes localisées dans la partie proximale droite, distale droite et gauche de la pièce. Une plage corticale est présente en partie proximale.
L’éclat cortical à retouche bifacial n°9 fig. 50 a été fabriqué dans un silex gris-bleu translucide. La face supérieure porte des retouches envahissantes abruptes à semi-abruptes. La face inférieure porte des retouches couvrantes abruptes à semi-abruptes. La totalité de l’extrémité distale de la pièce présente des traces de machûrage pouvant indiquer une utilisation en tant que grattoir.
Fig. 49 : Armatures de flèches de la sépulture 68
86
L’objet n°10 fig. 50 est une lame épaisse à trois pans réalisée dans un silex gris-bleu opaque. La face inférieure (2) porte des retouches semi-abruptes à rasantes dans la partie distale et mésiale du bord gauche. La face droite (1) porte des retouches semi-abruptes à rasantes sur sa partie distale et sur le bord gauche de la face. Les retouches sur la face gauche (3), semi-abruptes à rasantes, se situent en partie proximale. La face inférieure porte de nombreuses traces d’oxyde de fer. Il est possible que certaines des retouches sur les bords de cette pièce cette soit le fait d’une utilisation en tant que pierre à briquet.
L’objet n°11 fig. 50 est une lame corticale à trois pans réalisée dans un silex brun à beige/orangé. Quelques retouches abruptes à semi-abruptes sont présentes de manière discontinue sur les bords de la pièce, en particulier dans la partie distale du bord droit. La face inférieure porte des retouches semi-abruptes à rasantes sur le côté gauche et sur la partie distale du bord droit. D’une manière générale, la pièce présente un aspect très « roulé », usé. Il est très probable qu’il s’agisse là d’une pièce de récupération.
Mobilier en roche dure (fig. 51, 52 et 86)Le brassard d’archer biforé (n°4 fig. 50), au profil plat et au bord non cintré, a été réalisé
dans un schiste de couleur gris-bleu. Une petite partie d’un des coins de la pièce présente une cassure ancienne.
La “pierre à rainure” en grès rose (n°13 fig. 50), de forme parallélépipédique, porte sur
Fig. 52 : «Pierre à rainures» de la sépulture 68
Fig. 51 : Brassard
d’archer de la sépulture 68 et vue de l’objet
en cours de fouille N
0 1 m20 cm
1
2
3
4
5
6 78
13
9
10
11
12
87
sa face supérieure deux rainures relativement peu profondes (entre 2 et 3 mm) se croisant quasiment à angle droit.
Objet en matière dure animale (fig. 87) L’objet n°12 fig. 50 est un fragment distal de défense de suidé dont la partie proximale a été brisée. Cet objet qui ne semble pas avoir été travaillé.
Localisation du matériel dans la tombe (fig. 53)La majorité du matériel est déposé au sud-ouest du corps, dans le dos de l’individu.
On peut noter l’existence de différents ensembles d’objets. Ainsi au contact de l’aiguisoir n°13 était déposée la pièce en silex n°9. De même les trois armatures de flèches étaient déposées ensemble. L’une (n°7) a de plus été retrouvée de chant, suggérant qu’elle était encore emmanchée lors de son dépôt. Une autre (n°5) était déposée sur l’éclat triangulaire n°8. Le brassard d’archer (n°4) a été retrouvé entre les deux os de l’avant-bras gauche, légèrement sous le radius, sa face plane vers le haut (fig. N33). Le fragment de défense de suidé était en position quasi verticale, pointe en bas, prés du genou gauche de l’individu. Cette position en équilibre instable peut indiquer qu’il était fixé sur un support, éventuellement un vêtement.
N
0 1 m20 cm
1
2
3
4
5
6 78
13
9
10
11
12
Fig. 53 : Position des objets dans la sépulture 68
88
Grès
N
0 1 m20 cm
Céramique
Silex
Limon loessique brun clair / jaunehétérogène meuble
Limon loessique brun hétérogènecompact
Limon lehmique brun sombrehétérogène compact
Marcassite
Fig. 54 : Plan et coupes de la sépulture 69
Fig. 55 : Vue en plan de la sépulture 69
89
II.3.1.3. La sépulture 69
II.3.1.3.1. Structure (fig. 54, 55 et 84)
Cette sépulture, très bien conservée, est orientée selon un axe nord-ouest / sud-est. En plan, sa forme est quadrangulaire, à angles arrondis. Elle mesure 2,25 m de long sur 1,70 m de large. Une légère excroissance se situe dans l’angle nord de la fosse. En coupe, ses parois sont subverticales et son fond, plat, présente une légère dépression d’environ 5 cm de profondeur de forme rectangulaire en plan (1,65 x 1 m). Sa profondeur maximale est de 50 cm.
Son remplissage se compose de trois types de sédiments différents. Au centre, se trouve une couche de loess brun compact alors que sur les côtés, le comblement est constitué d’un loess plus clair et meuble (remanié) ou de lehm très compact.
II.3.1.3.2. Architecture funéraire
Si elle est moins flagrante que dans le cas de la sépulture 68, l’existence d’une architecture funéraire dans cette sépulture est cependant probable.Le fait que l’ensemble du matériel se situe au sein de la légère dépression du fond de la fosse et que les limites de celle-ci correspondent, en coupe, aux limites des différentes couches (fig. 56) semble indiquer qu’il existait un contenant en matière périssable. De plus, la mise au jour, dans le quart est de la fosse, de quelques traces noires ligneuses suggérerait qu’il était en
Grès
N
0 1 m20 cm
Céramique
Silex
Limon loessique brun clair / jaunehétérogène meuble
Limon loessique brun hétérogènecompact
Limon lehmique brun sombrehétérogène compact
Marcassite
N
0 1 m20 cm
Traces noires ligneuses
Niveau des tracesnoires ligneuses
Niveau du squelette
Effets de parois
Fig. 56 : Localisation des traces ligneuses dans la sépulture 69 et proposition d’effets de parois
90
Niveau de
décapage
Niveau de
sol actuel
Niveau dedécapage
Niveau desol actuel
N
0 20 cm 1 m
Fig. 57 : Proposition de restitution de l’architecture de la sépulture 69
91
bois. Sur la base de cette hypothèse, nous proposons donc, sur la figure 57, une restitution de ce coffrage.
II.3.1.3.3. Individu (HBE ; cf. Annexe II)
Le sujet inhumé est un homme dont l’âge est compris entre 17 et 19 ans Il a été déposé au centre de la fosse, en position fléchie sur le coté gauche, selon un axe nord-ouest/sud-est, sa tête vers le nord-ouest.
II.3.1.3.4. Espace de décomposition (HBE)
L’étude anthropologique (dont le détail se trouve dans l’annexe II) montre que le corps ne s’est pas totalement décomposé en espace vide. La position du mobilier accompagnant le défunt, notamment les armatures de flèches situées dans le dos de l’individu, qui ont gardé leur position originelle, à la verticale sur le tranchant, sous-entend que l’espace interne de la tombe n’est pas resté vide longtemps. Il semblerait donc qu’un apport de sédiment sur le corps du défunt ait été réalisé dans un laps de temps assez court après son dépôt dans la fosse sépulcrale.
Dans le même temps, certains os se sont déplacés, tout en restant toutefois dans le volume initial du corps. Tout comme dans le cas de l’individu de la sépulture 68, il est possible d’envisager la présence d’une enveloppe autour ou sur le corps du défunt qui aurait permis ces mouvements.
III.3.1.3.5. Matériel
Le mobilier accompagnant le défunt est constitué par deux vases décorés (fig. 85), 13 éléments en silex (dont huit armatures de flèches) (fig. 88), un aiguisoir en grès (fig. 86), un fragment de marcassite (fig. 86) et un pendentif arciforme en os (fig. 87).
Les vases (fig. 58 et 85)Le vase n°1 fig. 59 est un gobelet à profil en S et fond concave. La surface extérieure
Niveau de
décapage
Niveau de
sol actuel
Niveau dedécapage
Niveau desol actuel
N
0 20 cm 1 m
Fig. 58 : Vases de la sépulture 69
92
est beige à brune claire. La partie inférieure du vase est rouge sombre et polie, ce qui devait probablement être l’aspect originel du vase. La surface intérieure est de couleur beige sombre à brun. Le cœur de la pâte est gris à noir, indiquant une cuisson réducto-oxydante. Le décor, couvrant, s’organise en une succession de six registres horizontaux, séparés par de minces plages laissées vides. On distingue deux types de bandes. D’une part, une frise faisant alterner deux types de panneaux, l’un composé de 7 à 10 rangées d’impressions horizontales, l’autre, de 7 à 8 rangées verticales, réalisées au peigne et délimitées par des impressions de cordelette. D’autre part, une frise de triangles suspendus à une impression de cordelette et composé par des segments obliques imprimés au peigne. L’intérieur des triangles est rempli par 5 à 7 rangées d’impressions au peigne tandis que l’extérieur est laissé vide.Le rythme du décor est, de haut en bas : cinq bandes remplies de panneaux puis une frise de triangles.Les similitudes des impressions au peigne remplissant les bandes indiqueraient l’utilisation d’un outil unique, possédant une dizaine de dents de section carrée dont parfois seule une partie est imprimée (entre 3 et 10). L’outil utilisé pour réaliser les impressions des segments formant les triangles semble différent. S’il semble posséder un nombre de dents équivalent (entre 8 et 10), les impressions qu’il laisse sont de section rectangulaire et de taille plus importante.
Le vase n°2 fig. 59 est un gobelet à profil en S et fond concave. La surface extérieure est beige à rouge avec quelques zones de couleur noire, probablement dues à des coups de feu. La partie inférieure du vase, rouge sombre et polie pourrait témoigner de ce à quoi la surface du vase ressemblait à l’origine.La surface intérieure est de couleur rouge clair à sombre et le cœur de la pâte est noir, indiquant une cuisson réducto-oxydante. Le décor, couvrant, s’organise en une succession de sept registres horizontaux, séparés par de minces plages laissées vides. On distingue deux types de bandes. D’une part, une frise, délimitée par des impressions de cordelette, de petits segments verticaux séparés par des espaces vides, formant un décor en échelle horizontale. D’autre part, une bande délimitée par des impressions de cordelette et remplies par 9 à 13 rangées horizontales d’impressions au peigne.Le rythme du décor est, de haut en bas : un premier registre composé d’une frise de segments et d’une bande d’impressions horizontales puis une succession de registres composés d’un seul type de bande et alternant frise de segments et bandes d’impressions horizontales.La quasi-totalité des impressions au peigne semble similaire, ce qui indiquerait l’utilisation d’un outil unique, possédant une vingtaine de dents de section carrée dont parfois seule une partie est imprimée (entre 7 et 22). L’outil utilisé pour réaliser les impressions des petits segments verticaux semble différent. Il ne possède que trois dents et laisse des impressions plus larges de section rectangulaire, arrondies aux extrémités des segments.
L’outillage lithique taillé (fig. 60, 88)L’objet n°4 fig. 48 est un éclat cortical issu d’un silex gris opaque portant de nombreuses
traces d’oxyde de fer. Les petits enlèvements situés en partie distale et sur le côté droit pourraient provenir d’une utilisation en tant que pierre à briquet.
L’armature de flèche n°6 fig. 59 est de forme triangulaire symétrique à base concave et retouches bifaciales, a été réalisée dans un silex gris-sombre opaque. Les retouches sur les deux faces sont couvrantes, semi-abruptes à rasantes.
L’armature de flèche n°7 fig. 59 est de forme triangulaire à pédoncule et ailerons, à retouches bifaciales, réalisée dans un silex brun-miel semi-translucide type Bassin Parisien. Les retouches sur les deux faces sont couvrantes, semi-abruptes à rasantes. L’aileron droit semble avoir été cassé tandis que le gauche est retouché. Il est possible qu’une fois le premier
94
cassé, le tailleur ait retouché le second pour donner une forme équilibrée à la pièce.
L’armature de flèche n°8 fig. 59 est de forme triangulaire à pédoncule et ailerons et à retouches bifaciales. Elle a été réalisée dans un silex brun miel semi-translucide type Bassin Parisien. L’aileron gauche est cassé. La face supérieure porte des retouches couvrantes, semi-abruptes sur le bord droit et rasantes sur le bord gauche. Les retouches de la face inférieure sont courtes et rasantes à gauche, envahissantes et semi-abruptes à droite.
L’armature de flèche n°9 fig. 59 est de forme triangulaire à pédoncule et ailerons. Seul l’aileron gauche est conservé. Le droit semble avoir été cassé par flexion. Cette pièce bifaciale a été réalisée dans un silex brun miel translucide à patine bleue et blanche type Bassin Parisien. Les retouches sur les deux faces sont couvrantes, semi-abruptes à rasantes.
L’armature de flèche n°10 fig. 59 est de forme triangulaire à tendance asymétrique, à base concave dégageant deux ailerons (le droit étant plus long) et à retouche bifaciale. Sur la face supérieure, les retouches sont courtes, semi-abruptes sur le côté droit et rasantes sur le côté gauche. La face inférieure porte, elle, des retouches couvrantes, semi-abruptes sur le côté gauche et rasantes du côté droit.
L’armature de flèche n°11 fig. 59 est de forme triangulaire à très légère tendance asymétrique, à base concave dégageant deux ailerons et à retouches bifaciales. Elle a été réalisée dans un silex semi-translucide blond. Les retouches sur les deux faces sont couvrantes, semi-abruptes à rasantes.
L’armature de flèche n°12 fig. 59 est de forme triangulaire symétrique à base concave dégageant deux ailerons et à retouches bifaciales. Cette pièce a probablement était réalisée sur un support lamellaire comme semble l’indiquer le pan non-retouché sur le coté gauche. Le matériau utilisé est un silex blond semi-translucide. La face supérieure porte des retouches envahissantes, semi-abruptes à rasantes. Sur la face inférieure, les retouches, courtes et rasantes, touchent la totalité du bord gauche, mais seulement les extrémités distale et proximale du bord droit.
L’armature de flèche n°13 fig. 59 est de forme triangulaire légèrement déjetée à droite, à base concave et à retouches bifaciales, réalisée dans un silex brun miel semi-translucide patiné bleu/blanc et lustré, de type Bassin Parisien. Les retouches, couvrantes sur la face supérieure et envahissantes sur la face inférieure sont semi-abruptes à rasantes.
Fig. 60 : Armatures de flèches de la sépulture 69
95
L’objet n°14 fig. 59 est un éclat cortical issu d’un silex gris sombre opaque. Sur la face supérieure, des retouches abruptes à semi-abruptes sont localisées sur le bord gauche et la partie distale. Sur la face inférieure, les retouches semi-abruptes à rasantes se localisent sur les parties proximale et distale.
Le fragment n°15 fig. 59 est issu d’une pièce esquillée bifaciale réalisée dans un silex gris clair semi-translucide. La pièce présente des traces d’esquillements sur sa face supérieure. Les retouches, marginales, semi-abruptes à rasantes sont localisées sur le côté droit. La face inférieure présente des retouches semi-abruptes à rasantes dans sa partie proximale. D’une manière générale, les traces d’esquillements témoignent d’une certaine violence dans les enlèvements.
L’éclat cortical n°17 fig. 59, grossièrement circulaire, est issu d’un silex brun beige à orangé opaque. Les enlèvements abrupts dans la partie proximale de la face supérieure pourraient correspondre à une préparation de plan de frappe.
L’objet n°18 fig. 59 est un éclat cortical, de forme circulaire, issu d’un silex gris bleu opaque. Les enlèvements de la face supérieure sont courts et localisés en partie proximale gauche, sur le côté droit et sur tout le bord distal. Sur la partie inférieure, les enlèvements, courts, se concentrent sur la partie distale de la pièce.
Mobilier en pierre dure (fig. 61 et 86)La pierre à rainure en grès gris (n°16 fig. 59) est de forme parallélépipédique allongée.
Sa face supérieure porte une seule rainure profonde de 4 à 5 mm.
Objet en matière dure animale (fig. 87)L’objet n°3 fig. 48 est un pendentif arciforme en os (fig. 62). Une perforation verticale
biconique se situe au centre de la pièce. Cet objet porte un décor composé de quatre séries d’incisions verticales parallèles. A chaque extrémité, quatre lignes incisées se poursuivent sur la face arrière. Au centre de la pièce, deux séries de trois lignes, disposées de part et
Fig. 61 : «Pierre à rainure» de la sépulture 69
Fig. 62 : Pendentif arciforme de la sépulture 69
96
d’autre de la perforation, s’arrêtent au niveau de celle-ci et sont absentes de la face arrière. La majorité de la surface de la pièce est polie. Cependant, sur le côté gauche, une partie porte des traces pouvant provenir d’une abrasion éventuellement liée à la fabrication de l’objet. On retrouve aussi de telles traces à l’intérieur de la perforation.
Divers (fig. 86)L’objet n°5 fig. 59 est un fragment de marcassite (fig. 63).
Localisation du matériel dans la tombe (fig. 64) Les objets étaient disposés derrière l’individu ou à ses pieds. Tous se situent dans la légère dépression du fond de la fosse. On peut distinguer trois ensembles d’objets.
Le premier se compose des deux vases et du fragment de silex n°15 et se situe derrière l’épaule gauche et la tête de l’individu.
Le deuxième se situe autour de la zone du bassin. On y retrouve les sept armatures de flèches n°6 à 12, le fragment de marcassite (n°5) et l’éclat cortical (n°4) sous l’os coxal gauche. Le pendentif arciforme (n°3) a été retrouvé en avant du bassin. Deux des armatures sont en position de chant et, de plus, toutes orientées de façon identique. On peut donc penser qu’elles étaient emmanchées lors du dépôt et que les flèches étaient éventuellement regroupées dans un carquois. Le fragment de silex et la marcassite (n°4 et 5) ont été retrouvés au contact l’un de l’autre. La proximité de ces deux objets fait penser à un kit de briquet, éventuellement contenu dans un petit sac porté à la ceinture.
Enfin, le dernier ensemble d’objets est localisé aux pieds de l’individu. Il regroupe 3 éclats de silex (n°14, 17 et 18) l’aiguisoir en grès (n°16) ainsi que l’armature de flèche n°13. Le fait que cette dernière n’ait pas été regroupée avec les autres, qu’elle présente une forte patine et que son type évoque plutôt le Néolithique moyen que final incite à penser qu’il s’agit d’une récupération d’un objet ancien, éventuellement en vue d’une réutilisation.
II.3.1.4. La sépulture 137
Cette sépulture a été fouillée lors du diagnostic effectué par l’INRAP (SP105), elle a cependant été attribuée dans un premier temps au Néolithique récent54. Lorsque nous avons récupéré le matériel, il s’est avéré que celui-ci comportait des éléments céramiques portant des décors typiques du Campaniforme. Malgré plusieurs demandes, les restes osseux issus de cette sépulture ne nous ont pas été fournis. Les observations anthropologiques sont donc issues de l’étude d’A. Latron-Colecchia effectuée dans le cadre du rapport de diagnostic.
54 Latron 2010
Fig. 63 : Fragment de marcassite et éclat de silex (Kit de briquet) de la sépulture 69
97
0 20 cm 1 m
N
1 (et 15)
2
6, 7, 8, 9,10, 11 et 12
4 et 5
161817
14
13
3
Fig. 64 : Position des objets dans la sépulture 69
Fig. 65 : Vue de la sépulture 137 (Cliché INRAP)
98
II.3.1.4.1. Structure (fig. 65, 66 et 84)
Il s’agit d’une fosse ovale (2,08 x 1,80 m) conservée sur une profondeur maximale de 0,18 m, à fond plat irrégulier, orientée selon un axe globalement nord-ouest / sud-est.Son comblement est composé de lehm sombre compact.
II.3.1.4.2. Architecture funéraire
Aucun élément ne permet d’affirmer l’existence d’une architecture funéraire. Cependant, le rapport de diagnostic fait état de la mise au jour au sein de la fosse de charbons de bois55 laissant donc penser qu’il pouvait, à l’origine, exister un contenant en bois.
II.3.1.4.3. Inhumé
Le sujet inhumé est un adulte dont l’âge et le sexe n’ont pu être déterminés du fait de la mauvaise conservation du matériel osseux. Le corps a été déposé au centre de la fosse, en position fléchie sur le côté droit, selon un axe sud-est/nord-ouest, la tête vers le sud-est.
D’après sa position, et en tenant compte de la tradition funéraire campaniforme, il est envisageable que ce sujet soit de sexe féminin.
55 A. Latron Colecchia in Latron 2010, p.34
(La localisation des objets a été effectuéd’après la description textuelle de la tombe)
N
0 20 cm 1 m
Céramique
Silex
Matière dure animale
Limon lehmique brun sombrehétérogène compact
Fig. 66 : Plan et coupe de la sépulture 137 (d’après Latron et al. 2010)
99
II.3.1.4.4. Espace de décomposition
Les observations effectuées par A. Latron-Colecchia montrent que la décomposition du corps semble s’être opérée en espace vide. Toutefois, tous les mouvements osseux sont restés confinés au volume initial du corps. Il est donc possible d’envisager que le défunt portait une enveloppe de tissu qui, tout en limitant les déplacements, a préservé pendant un certain temps un espace vide.
II.3.1.4.5. Matériel
Elle était accompagnée de deux vases en céramique (fig. 85) dont seuls les fonds ont été retrouvés ainsi qu’un élément de silex (fig. 88), un fragment d’outil de mouture (fig. 88), un petit objet en os et trois boutons perforés en V en os (fig. 87).
Céramique (fig. 85)Le fragment de fond n°1 fig. 67 appartient probablement à un gobelet à profil en S.
La surface extérieure est brune à rouge avec quelques zones de couleur grise dues à la desquamation de l’épiderme du vase. La surface intérieure est elle aussi brune à rouge et le cœur de la pâte est gris / noir, indiquant une cuisson réducto-oxydante. Le décor conservé se compose, de haut en bas, d’une bande délimitée d’impressions à la cordelette et remplie de quatre rangées horizontales d’impressions au peigne suivi d’une bande vide délimitée par des impressions de cordelette. Les deux bandes sont séparées par une mince plage vide.
Fig. 67 : Mobilier de la sépulture 137
100
L’outil utilisé pour réaliser les impressions au peigne semble posséder au moins une quinzaine de dents de section carrée.
Le fond n°2 fig. 67 appartient probablement à un gobelet à profil en S. La surface extérieure est beige à brune avec quelques zones de couleur plus jaune à grise/noire dues à la desquamation de l’épiderme du vase. La surface intérieure est de couleur brune à grise / noire et le cœur de la pâte est gris/noir, indiquant une cuisson réducto-oxydante. Le décor conservé consiste en une succession de trois registres horizontaux séparés par de minces plages laissées vides.Ces registres se composent d’un seul type de bande, délimitée par des impressions de cordelette et remplie par 5 à 6 rangées horizontales d’impressions au peigne. Une impression de cordelette supplémentaire se situe en deçà du dernier registre. Les similitudes des impressions au peigne présentes sur le vase indiqueraient l’utilisation d’un outil unique, possédant une vingtaine de dents de section carrée dont seule une partie peut être imprimée (entre 11 et 25).
Outillage lithique taillé (fig. 88)La pièce esquillée bifaciale n°7 fig. 67 est issue d’un silex brun beige opaque, et
présente une plage corticale sur le côté droit. La face supérieure présente des retouches semi-abruptes à rasantes sur les parties proximale et distale, ces dernières présentant des traces de machûrage. La face inférieure porte des stigmates d’enlèvements violents et la trace d’un coup de burin sur son bord proximal.
Matière dure animale (fig. 87) Les objets n°3, 4 et 5 fig. 67 sont des fragments de boutons hémisphériques à perforation en V.
Le fragment d’objet oblong en os n°6 fig. 67 possède une section hémisphérique. Sa face supérieure est plane tandis que se face inférieure présente deux « renflements » séparés par une légère échancrure. L’extrémité figurée en haut du dessin semble avoir été cassée, suggérant que cet objet n’est qu’un fragment d’un objet plus grand.
Outillage en pierre dure (fig. 86)L’objet n°8 fig. 67 est un fragment d’outil de mouture (molette) en grès rose.
Localisation des objets dans la tombeLe fragment de grès a été retrouvé posé sur le crâne au niveau de l’os occipital. Les
trois boutons (n°3 à 5 fig. 67) étaient situés, l’un au niveau du cou et les deux autres prés de l’avant bras gauche. Le fragment de silex était déposé à 30 cm à l’ouest du bassin. Un des deux vases était placé au nord-ouest de l’individu. Le second n’était pas mentionné dans la description de la tombe dans le rapport de diagnostic. Cependant, il est fait mention d’un vase retrouvé dans la même tranchée de diagnostic, mais dont la position est inconnue. Lorsque nous avons récupéré le matériel, il s’est avéré que des remontages ont pu être effectués entre certains tessons récoltés avec le vase trouvé dans la sépulture et celui trouvé dans la tranchée. Il est donc vraisemblable que les deux vases faisaient à l’origine partie de la dotation.
II.3.2. Approches synthétiques et comparaisons
Dans le sud de la plaine du Rhin supérieur, 24 sites ont livré un total d’au moins 41 sépultures campaniformes (fig. 68 et Annexe V). Pour la très grande majorité, il s’agit de fouilles anciennes pour lesquelles la description est le plus souvent déficiente. Depuis les années 60, seules trois tombes ont été mises au jour, sur deux sites, Hegenheim et Erstein56. 56 n°6 et 10 fig 68
101
0 20 km
1
3
5
8
9
10
11
1314
15
18
19
2022
2
4
6
712
16
17
21
23
24
Sierentz "Les villas d'aurèle"
(D'après Heyd 2000 ; Jeunesse et Denaire 2010)
1. Achenheim (Bas-Rhin, F.)2. Allschwil "Friedhof" (Kt. Baselland, CH.)3. Basel "Hörnligottsacker" ou "Im Hörnlifriedhof" (CH.)4. Colmar "Ecole normale" (Bas-Rhin, F.)5. Efringen "Im Ort" (Gde. Efringen-Kirchen, Kr. Lörrach, D.)6. Erstein "Grasweg-PAE" (Bas-Rhin, F.)7. Feldkirch "Kiesgrube speicher" (Gde. Hartheim, Kr. Breisgau-Hochschartzwald, D.)8. Gündlingen "Härtle" (Stadt Breisach-am-Rhein, Kr. Breisgau-Hochschartzwald, D.)9. Habsheim "Est" (Haut-Rhin, F.)10. Hegenheim (Haut-Rhin, F.)11. Kunheim (Haut-Rhin, F.)12. Meyenheim (Haut-Rhin, F.)
13. Munzingen "Ortsetter" (Stadt Freibourg, Stkr. Freibourg, D.)14. Nierderhergheim (Haut-Rhin, F.)15. Oberentzen "Giessen" (Haut-Rhin, F.)16. Riegel "Breite I" (Kr. Emmendingen, D.)17. Riegel "Grasäcker in der elznierderung" (Kr. Emmendingen, D.)18. Rouffach "Issenbreitfeld" (Haut-Rhin, F.)19. Saint-Louis (Haut-Rhin, F.)20. Sainte-Croix-en-Plaine (Haut-Rhin, F.)21. Sasbach "Wörthstück" (Kr. Emmendingen, D.)22. Schallstadt "Hirschackerwerg" (Gde. Schallstadt- Wolfenheimer, Kr. Breisgau-Hochschartzwald, D.)23. Urschenheim (Haut-Rhin, F.)24. Wyhl (Kr. Emmendingen, D.)
Fig. 68 : Carte des sépultures campaniformes dans le sud de la plaine du Rhin supérieur
103
Les sites se répartissent principalement dans deux zones géographiques. La zone de Colmar et du Kaizerstuhl fourni l’essentiel de la documentation avec 16 sites. Six se situent dans la région mulhousienne et du coude du Rhin et deux seulement dans le Nord de l’Alsace.
Généralement, pour chaque site, une seule tombe est signalée. Huit sites comptent cependant au moins deux tombes, pour un maximum de cinq à Sasbach (n°21 fig.68). Ces sépultures sont le plus souvent individuelles, bien que quatre d’entre elles contiennent plus d’un corps (trois sépultures doubles, une triple).
La catégorie de mobilier la plus représentée au sein de ces tombes est, de loin, la céramique non-décorée. Son pendant décoré ne représente que 14 vases, dont 12 sont des gobelets éponymes.
D’une manière générale, le sud de la plaine du Rhin supérieur s’intègre bien au sein du Campaniforme européen57. Cette entité, qui s’étend des Iles Britanniques à l’Afrique du Nord, et de la côte atlantique à la Hongrie, n’est cependant pas monolithique. Ainsi, la carte fig. 69 et 70 (réalisée à partir des principales synthèses régionales et qui ne prétend pas à l’exhaustivité), montre bien l’existence d’une zone orientale et septentrionale fortement marquée par la sépulture individuelle, au contraire de la zone méridionale, au sein de laquelle la préférence irait à la sépulture collective. Il ne s’agit là que d’un exemple des disparités existant au sein même du Campaniforme. La reconnaissance d’affinités entre les différentes régions de découverte a conduit à la mise en place de groupes suprarégionaux. Les liens privilégiés unissant le sud de la plaine du Rhin supérieure et les régions orientales sont depuis longtemps signalés, depuis Stemmermann (1933) et Kraft (1947) jusqu’à Vander Linden (2006) et Salanova (2011) en passant par Treinen (1970). Ainsi l’Alsace est intégrée à l’ «Ostprovinz» de Ch. Strahm58, ou encore «groupe oriental»59, qui regroupe les régions du Rhin supérieur, de la Bavière, de la Bohème, de la Moravie, de l’Autriche et de la Hongrie.
57 Salanova 201158 Strahm 199559 Vander Linden 2006
Allemagne1. Altdorf (Ldkr. Landshut, Nierderbayern)2. Aufhausen (Ldkr. Dingolfing-Landau, Niederbayern)3. Augsburg-Haunstetten (Stadt Augsburg, Swaben)4. Burgweinting (Stadt Regensburg, Oberpfalz)5. Dietfurt a. d. Altmülh (Ldkr. Neumarkt i. d. Oberpfalz, Oberpfalz)6. Germering «Obere Bahnhofstr» (Ldkr. Fürstenfeldbruck, Oberbayern)7. Künzing-Bruck (Ldkr. Deggendorf, Niederbayern)8. Landau-Südost (Ldkr. Dingolfing-Landau, Niederbayern)9. Mitterharthausen (Stadt. Straubing-Bogen, Niederbayern)10. München-Sendling «Wolfratshauserstr» (Stadt München, Oberbayern)11. Osterhofen-Altenmarkt (Ldkr. Deggendorf, Niederbayern)
13. Straubing-Alburg (Stadt Straubing, Niederbayern)
12. Straubing (Stadt Straubing, Niderbayern)
14. Trieching (Ldkr. Dingolfing-Landau, Niederbayern)
Autriche15. Gemeinlebarn (St. Pölten, Niederösterreich)
16. Laa a. d. Thaya (Mistelbach, Niederösterreich)17. Leopolsdorf (Wien-Umgebung, Niederösterreich)
19. La-Folie (Poitiers, Vienne)
23. Les-Petits-Prés (Léry, Eure)
20. La-Plaine-des-Poses (Poses, Eure)21. La-Sente (Mondelange, Moselle)22. Les-Gond-des-Près (Hatrize, Moselle)
18. Chèvre-Haie (Pouilly, Moselle)
France
24. Op Dem Boesh (Altwies)
Luxembourg
28. Hrdly (Litoměřice, Böhmen)
37. Radovesice I et II (Teplice, Böhmen)
36. Praha-Bubeneč (Praha, Böhmen)
38. Rosnice (Hradec Kràlové, Böhmen)
République Tchèque
29. Jezeřany-Maršovice (Znojmo, Mähren)
26. Dolní Věstonice III (Břeclav, Mähren)
33. Ostopovice I (Brno Venkov, Mähren)
27. Horní Bojanovice I (Břeclav, Mähren)
34. Pavlov I (Břeclav, Mähren)
40. Tvořihráz (Znojmo, Märhen)
31. Ledce I (Brno Venkov, Mähren)32. Ludeřov (Olomouc, Mähren)
25. Bulhary III (Břeclav, Mähren)
30. Kobylnice (Brno Venkov, Mähren)
41. Šlapanice II (Brno, Mähren)
43. Záhlinice (Kroměříž, Mähren)
42. Smolín I (Břeclav, Mähren)
35. Předmostí (Přerov,Mähren)
39. Rousínov II (Vyškov, Mähren)
Royaume-Uni44. Amesbury (Wiltshire)
Fig. 70 : Sites campaniformes mentionnés dans le texte et représentés sur la figure 69
104
II.3.2.1. Organisation spatiale de l’ensemble funéraire
La disposition des tombes de Sierentz, plus ou moins alignées, est un type d’organisation que l’on ne retrouve qu’assez rarement en France, les deux seuls autres exemples que nous avons trouvés se situent dans l’Est du pays.
A Habsheim, à quelques kilomètres au nord de Sierentz, les trois sépultures étaient alignées sur une dizaine de mètres selon un axe nord/sud60. A Pouilly, parmi les 10 sépultures campaniformes mises au jour sur ce site, cinq d’entre elles étaient disposées sur un axe nord-ouest / sud-est de 23 m61 (n°1 fig. 71).
Les exemples sont beaucoup plus nombreux lorsque l’on se déplace plus à l’est, notamment en Bavière, région où ce type d’organisation semble assez typique (n°2 à 4 fig. 71). On la retrouve par exemple sur les sites de Augsburg-Haustetten, Germering «Obere Bahnhofstr» , Künzing-Brück62 ou encore Landau-Südost63. Ces ensembles funéraires comptent généralement moins d’une dizaine de tombes. L’alignement des sépultures suit un axe nord/sud avec parfois des variations de plus ou moins 45°.
On peut aussi souligner que ce type d’organisation existe déjà dans la culture Cordé. L’exemple le plus proche (géographiquement) est celui de l’ensemble funéraire mis au jour récemment à Geispolsheim «Schlossgarten» (Haut-Rhin, F) : les quatre sépultures (orientées est / ouest) sont alignées selon un axe nord-ouest/sud-est64 . Plus tard, on retrouvera ce type de disposition dans le Bronze ancien d’Alsace, par exemple à Rixheim «ZAC du Petit Prince» (Ht-Rhin, F)65.
II.3.2.2. Les fosses
Les deux sépultures les mieux conservées (St. 68 et 69) possèdent toutes deux un plan quadrangulaire aux angles arrondis et dont les dimensions sont très semblables (2,30/2, 25 m de long pour une largeur de 1,80/1,70 m). Ce type de forme (et ces dimensions) se retrouve fréquemment au sein de Campaniforme. Ainsi, la majorité des sépultures de la moitié Nord de la France procèdent du même module66. Plus largement, on retrouve ce type de fosse dans le nord (Pays-Bas67, Ecosse68) et dans l’est (Allemagne méridionale, République tchèque)69 du domaine campaniforme.
On note aussi, à Sierentz, l’existence d’une petite excroissance, de forme arrondie, dans un angle de la fosse (ouest pour 68, nord pour 69). Cette irrégularité dans le plan peut être mise en parallèle avec celle relevée pour la tombe 67 de Jezeřany-Maršovice70. Leur caractère unique amène à rejeter l’idée d’emplacement destiné à recevoir des poteaux liés à une architecture funéraire (d’autant plus qu’à Sierentz, les poteaux ont été trouvés à l’intérieur de la fosse). On ne doit donc pas les confondre avec les excroissances (aux nombres de trois) de la sépulture 247 de Hatrize71 qui semblent bien, elles, destinées a recevoir des poteaux.
La sépulture 10, qui contenait un jeune enfant, est quant à elle ovale, et ses dimensions sont plus réduites. On pourrait éventuellement y voir là une manière de marquer le statut infantile de l’individu inhumé. Soulignons cependant le fort état d’arasement de cette structure. Enfin, la sépulture 137, mise au jour lors du diagnostic, possède une forme plus irrégulière
60 Wolf 1969 ; n°9 fig. 6861 Lefebvre 2010 ; Lefebvre et al. 2011 ; n°19 fig. 69 et 7062 Bosch 2008 : Taf. 6, 37, 46, 47, 48 et 49 ; Freundliche Mitteilung Kociumaka ; Guckenbiel und Piller 2007 ; Schmotz 1992 ; (n°3, 6 et 7 fig. 69 et 70)63 Husty 1999 ; n°8 fig. 69 et 7064 Fouille S. Goepfert - Antea Archéologie (2010) ; étude en cours. 65 Murer 2007 ; Lefranc et al. 201066 Salanova 201167 Landing et Waals 197668 Sheridan 200869 Bosch 200870 n°29 fig. 69 et 7071 n°22 fig. 69 et 70
105
sans doute due, en partie, à la lecture difficile du terrain72.
II.3.2.3. Architecture funéraire
L’étude des sépultures 68 et 69 de Sierentz nous a amenés à proposer l’existence, dans chacune de ces tombes, d’une architecture en bois de type chambre funéraire.
Les fouilles récentes effectuées dans la moitié Nord de la France tendent de plus en plus à mettre en évidence l’existence d’aménagements en matière périssable au sein des sépultures. En Lorraine par exemple, les sites de Prény «Tautencourt» (Meurthe-et-Moselle, F.)73, Montigny-les-Metz «La ferme de Blory» (Moselle, F.)74 ou encore Mondelange «La sente»75 ont fourni de tels aménagements. Les chambres funéraires, en particulier, semblent se concentrer plutôt dans le quart nord-est du pays76 (n°1 fig. 72).
A plus grande échelle, les traces d’architectures funéraires en matériaux périssables sont fréquentes aux Pays-Bas77 ou encore dans tout le groupe oriental (de la Bavière à la Moravie). Elles y sont souvent (mais pas toujours) associées à un système de fossé extérieur
72 Latron 201073 Frauciel, étude en cours ; Lefebvre et al. 201174 Bellard 1960 ; Lefebvre et al. 201175 Lefevbre 2008 ; Lefebvre et al. 2011 ; n°21 fig. 69 et 7076 Salanova 201177 Lanting et Waals 1976
1. Pouilly «ZAC Chêvre Haie» (Franck 2011) 2. Künzing-Bruck (Bosch 2008 )
3. Augsbourg-Haunstetten (Schmotz 1992) 4. Landau - Südost (Husty 1999)
Fig. 71 : Quelques exemples d’organisations spatiales des sépultures campaniformes
106
(parfois palissadé) entourant la fosse sépulcrale78 (n°2 fig. 72) (éléments que l’on retrouve à La Folie79 et à La Plaine de Poses80). Les tombes pouvaient aussi en plus être recouvertes d’un petit tumulus81 (75 sépultures sur les 105 reconnues aux Pays-Bas en possèdent un82).
Les traces de construction internes montrent souvent la présence de trous de poteau situés aux quatre coins des tombes. Dans certains cas (selon la nature du sédiment), la présence de poteaux ne semble pas nécessaire au maintien d’une chambre simple. Il n’est donc pas impossible que certaines tombes aient possédé une superstructure s’élevant hors du sol, bien que cela soit difficile à prouver en l’état de la documentation83.
Si, dans le cas des tombes de Sierentz, aucune trace de fossé extérieur n’a pu être relevée, l’existence d’une superstructure aérienne, recouverte ou non d’un petit tumulus, semble probable (en particulier la St. 68, dans une moindre mesure la St. 69).
II.3.2.4. Orientation et position des défunts
Les os des individus étaient dans deux cas, très bien conservés (St. 68 et 69), au contraire de ceux de l’individu de la tombe 137. Si la matière osseuse de l’enfant (St. 10) est bien conservée, son squelette était extrêmement lacunaire du fait de l’arasement important de la structure.
Les corps (St. 68, 69 et 137) sont tous trois déposés en position repliée, sur le côté gauche pour 68 et 69 et sur le côté droit pour l’individu 137. Les individus 68 et 69 ont la tête orientée vers le nord-ouest, tandis que celle de 137 est vers le sud-est. Tous ont donc le regard tourné vers l’est. Il s’agit là de la position classique du corps au sein des sépultures campaniformes de toute l’Europe.
La pratique funéraire campaniforme est de plus empreinte d’un fort dimorphisme sexuel, où le dépôt sur côté gauche est réservé aux hommes et le côté droit aux femmes. Cette tradition semble n’admettre que peu d’exception84. Cette pratique semble s’appliquer aussi aux enfants85 bien que dans la moitié nord de la France, ceux-ci semblent être systématiquement déposés sur le côté gauche86. A Sierentz, l’étude anthropologique a montré que les deux individus déposés sur le côté gauche étaient bien des hommes. Le sexe de l’individu 137 n’a pu être déterminé, mais, compte tenu des remarques précédentes, il est très probable qu’il s’agisse d’une femme.
L’axe nord-ouest/sud-est, privilégié à Sierentz, est lui aussi, un classique dans l’orientation des corps dans les sépultures campaniformes. Au Royaume-Uni ou dans l’Europe centrale, le dépôt des corps se fait en effet systématiquement, et durant toute la période, selon un axe nord-sud (admettant parfois une variation de plus ou moins 45°)87. Dans la moitié nord de la France (hors Alsace) et aux Pays-Bas il semble qu’il y ait, durant une étape moyenne du Campaniforme, une modification entrainant une prédominance de l’axe est-ouest88, avant de retrouver l’axe nord-sud dans une phase ultérieure.
Les sépultures de Sierentz, au même titre que les tombes alsaciennes en général, en privilégiant l’axe nord-sud, rentrent donc dans le schéma qui s’applique à l’Europe centrale.
78 Turek 2006 ; Bosch 200879 Tchérémissinoff et al. 2011 ; n°19 fig. 69 et 7080 Billard et al. 1995 ; n°20 fig. 69 et 7081 Turek 200682 Drenthe et Lohof 2005 ; Salanova 201183 Turek 2006 ; Bosch 200884 Vander Linden 2006 ; Salanova 201185 Turek 200686 Salanova 201187 Vander Linden 200688 Lanting 2008 ; Salanova 2011
107
2. Smolin I : Sépulture 13/51 et sa restitution (Bosh 2008)
1. Pouilly «ZAC Chêvre Haie» : Sépulture 2 et sa restitution (Frank 2011)
Fig. 72 : Exemples d’architectures funéraires campaniformes
108
II.3.2.5. Aspects biologiques remarquables
Un caractère discret observé sur l’individu 68 se retrouve aussi sur le squelette 69 (Annexe II). Le possible caractère génétique de cette variation nous permet d’envisager un éventuel lien de parenté entre les deux individus.
Un cas similaire est signalé en Angleterre, à Amesbury89. A côté de la célèbre tombe de l’ «archer», âgé de 35 à 45 ans, a été mise au jour une seconde sépulture, celle de son «compagnon», âgé lui de 20 à 25 ans. Les deux hommes partagent un même caractère discret sur les os des pieds et sont donc potentiellement liés. On peut aussi remarquer que, comme à Sierentz, l’un d’eux est plus vieux que l’autre.
II.3.2.6. Localisation des objets dans les tombes
Les vases sont, dans les deux sépultures masculines, déposés dans le dos de l’individu, tandis que dans la sépulture 137, ils sont situés aux pieds de la défunte.
Au sein des tombes 68 et 69, les armatures de flèches ont une position différente. Si dans 69, elles sont ordonnées de façon à évoquer l’existence d’un carquois, il est plus difficile de reconnaitre une organisation particulière pour les armatures de 68. L’une au moins (n°7 fig. 50 et 53) semble avoir été emmanchée lors du dépôt. Il est aussi possible que ce soit le cas de la n°6 de la même figure. Rien cependant n’évoque un contenant particulier
La position du brassard d’archer de la sépulture 68 indique qu’il était porté lors de l’inhumation. Nous reviendrons plus en détail sur la position particulière de cet objet et son caractère fonctionnel (ou non) dans la partie II.3.2.7.
Les «pierres à rainure» des tombes 68 et 69 sont déposées différemment. Dans la St.68, elle se situe derrière et au-dessus de la tète du défunt. Elle est associée à un probable grattoir. Dans la tombe 69, un objet du même type est déposé au pied de l’individu, en compagnie de deux éclats corticaux de silex et de l’armature de flèche n°13 fig. 59, cette dernière étant, semble-t’il, un élément de récupération.
Les objets en matière dure animale semblent avoir été portés par les individus lors de leur inhumation puisqu’ils ont été retrouvés dans les volumes des corps des défunts. On peut dès lors évoquer, pour la grande majorité de ces objets, une destination ornementale et/ou fonctionnelle.
Soulignons enfin que, dans la sépulture 68, le défunt et sa dotation (située dans le dos ou dans le volume du corps) n’occupent qu’un quart de la fosse sépulcrale, tandis que dans le cas de la tombe 69, le corps est moins contracté et les dépôts matériels sont dans le dos ou aux pieds de l’individu, le tout occupant une position centrale dans la fosse.
D’une manière générale, toutes ces positions du matériel par rapport au corps semblent se retrouver dans l’ensemble du Campaniforme européen.
II.3.2.7. Le mobilier céramique
L’ensemble funéraire de Sierentz a livré un total de huit vases (fig. 73). Quatre d’entre eux sont entiers quand seuls les fonds des quatre autres ont été retrouvés. Ils sont regroupés deux par deux à l’intérieur de chaque tombe.
Les quatre récipients entiers sont des gobelets à profil en S, décorés par une succession de bandes horizontales impressionnées. Il est raisonnable de penser que les quatre fonds, décorés eux aussi, appartiennent aussi à ce même type de forme.Dans le cas des gobelets des sépultures 68 et 69, on remarque que dans chaque couple il y a un vase dont la forme est plus élancée que l’autre.
89 Fitzpatrick 2009 ; n°44 fig. 69 et 70
109
Les formes des vases n’appellent que peu de commentaires. Très classique dans toutes les régions campaniformes proches, on en retrouve des équivalences en France90, vers le nord, le long de la vallée du Rhin (jusqu’aux Pays-Bas) ou encore vers l’est (Bavière, Moravie, Autriche)91. Localement, dans le sud de la plaine du Rhin supérieur, certains récipients possèdent des formes semblables à celles présentes à Sierentz (Wyhl92 ; Hegenheim93) Certaines tombes de Bavière et de Moravie ont cependant livré les deux types de formes remarquées plus haut (Hrdly ; Dolni Vestonice ; Ostopovice par exemple94).
Les décors fournissent, eux plus, d’informations. D’une manière générale, les gobelets de Sierentz sont richement décorés, les parties réservées étant très minces. On peut remarquer qu’il existe au sein de la série une certaine logique dans le rapport entre la forme et les décors des vases. Ainsi retrouve-t-on, sur les vases les plus élancés (n°3 et 4 fig. 73), des décors composés de larges bandes remplies d’impressions tendant à l’horizontale associées à des bandes plus minces dans lesquelles se développe une frise de petits segments, verticaux dans
90 Treinen 1970, Salanova 200091 Bosch 200892 Kraft 1947 ; (n°10 fig. 68)93 Billoin et al. 2010 ; (n°24 fig. 68)94 Bosch 2008 Taf 104, 133 et 155 ; Hajek 1966 ; Dvorak 1992 et 1996 ; n°26, 28 et 33 fig. 69 et 70
Fig. 73 : Planche récapitulative des vases décorés
110
un cas, formant des chevrons dans l’autre. Les deux autres gobelets partagent quant à eux les mêmes types de remplissage de bandes en panneaux alternant le sens des impressions (verticales / horizontales). Dans le sud de la plaine du Rhin supérieur et, d’une manière générale dans la moitié nord de la France, certains éléments particuliers des décors se retrouvent ponctuellement sur certains vases. Le motif de triangles pleins du vase n°2 fig. 73 va ainsi se retrouver en Lorraine (vase 1 de la tombe 235 de Hatrize)95, en Bretagne ou encore dans le Sud-Est de la France96. Les frises de chevrons du vase n°1 fig. 73 sont présente sur un vase de Riegel «Grasacker»97 (où elles sont d’ailleurs en association avec des bandes remplies par des impressions verticales), sur des récipients de Lorraine (Léry «Les Petits Prés – Le Chemin de Vignes»98 et en Bretagne99. Cette dernière région fournit aussi des exemples de croisillons ou de frises de segments verticaux100, motifs que l’on va aussi trouver sur un des vases de Kunheim101.
Mais le caractère «chargé» des décors de Sierentz évoque cependant assez clairement la partie orientale du Campaniforme. C’est en effet sur les vases déposés dans les tombes de Bavière, Moravie et de Bohème que l’on va trouver les équivalences les plus frappantes avec Sierentz.Que ce soit les remplissages de bandes par des impressions horizontales102 ou par des alternances d’impressions horizontales ou verticales103, les frises de losanges pleins104, de
95 Lefebvre et al. 2011 ; n°2 fig. 69 et 7096 Treinen 197097 Kraft 1947 ; n°17 fig. 6898 Lefebvre et al 2011 ; n°23 fig. 69 et 7099 Treinen 1970100 Treinen 1970101 Ulrich 1942 ; n°11 fig. 68102 Aufhausen ; Burgweinting obj.1 ; Künzing-Bruck grab 8 et 9 ; Dolní Vĕstonice III grab 44, 45/76 et 66/76 (Bosch 2008 : Taf 5, 24, 46, 49, 126 et 127 ; Kreiner et al. 1999 ; Schröter 2005 ; Schmotz 1992 ; Dvorak 1996 )103 Landau-Südost grab 9 ; Radovesice I grab 117/78 ; Dolní Vĕstonice III grab 224/77 ; Horní Bojanovice I grab 1/91 ; Pavlov I grab 513/83, 529/83, 563/84, 590/84 ; Tvořihráz grab 1/90 (Bosch 2008 : Taf 58, 111, 130, 142, 161, 164, 165, 169, 190 ; Husty 1999 ; Turek 2004 ; Dvorak 1996 ; Balek et al. 1999)104 Burgweinting obj.1 ; Landau-Südost grab 1 ; Dolní Vĕstonice III grab 44, 45/76 et 66/76 ; Ledce II grab 1/52 ; Ludeřov ; Pavlov I grab 569/84 ; Tvořihráz grab 2/91 (Bosch 2008 : Taf 24, 53, 126, 127, 152, 153, 167, 194 ; Schröter 2005 ; Husty 1999 ; Dvorak 1992 et 1996 ; Hajek 1966 ; Balek et al. 1999)
4
1
5
32
1. Pavlov I grab 569/84 (Dvorak 1996)2. Dolni Vestonice III grab 72, 73/76 (Dvorak 1996)3. Dolni Vestonice III grab 350/77 (Dvorak 1996)
5. Tvorihaz grab 2/91 (Balek et al. 1999)4. Horni Bojanovice I Grab 7/91 (Dvorak 1996)
Fig. 74 : Quelques exemples de gobelets décorés
111
triangles pleins105, de chevrons106, de segments verticaux107 ou encore les croisillons108, tous les types de motifs utilisés à Sierentz y trouvent leurs pendants (fig. 74).
C’est aussi dans cette zone géographique que l’on va retrouver certaine des associations de décors présentent à Sierentz. Un vase de la tombe 569/84 de Pavlov I109 (n°1 fig. 74) combine ainsi un remplissage de bande «alternant» et des frises de losange. Le site de Dolní Vĕestonice III en fournit aussi plusieurs exemples110 (n°2 fig. 74). Dans la sépulture 350/77 de ce même site, un vase porte une combinaison de bandes remplies horizontalement et de frises de chevrons111 (n°3 fig. 74). Enfin, sur le site de Záhlinice, dans la tombe 47/89112, un vase est décoré par une succession de bandes pleines associées à une seule frise de triangle (pointe vers le haut), rappelant le décor du vase n°2 fig. 73.
Du point de vue de la céramique, l’ensemble funéraire de Sierentz partage donc des liens étroits avec toute la région orientale du Campaniforme. Ces liens privilégiés ont souvent été signalés dans la littérature concernant le sud de la plaine du Rhin supérieur, depuis Stemmermann (1933) et Kraft (1947) jusqu’à Vander Linden (2006) et Salanova (2011) en passant par Treinen (1970).
Sierentz présente cependant une particularité quant au nombre de vases déposés dans chaque tombe, et notamment la constance de celui-ci.
Au sein du Campaniforme, le dépôt de plusieurs gobelets décorés dans une tombe n’est pas rare. Des exemples existent, tant dans le sud de la plaine du Rhin supérieur (Achenheim113, Sasbach114), qu’en France (Arenberg à Wallers (Nord, F)115, «La sente» à Mondelange116, sépulture 2 de Chèvre-Haie à Pouilly117), ou plus à l’Est118. Mais le dépôt de plus d’un gobelet décoré dans chaque sépulture d’un même ensemble est, à notre connaissance, beaucoup moins fréquent.
II.3.2.8. Le mobilier en silex
Sur les quatre tombes de l’ensemble funéraire de Sierentz, trois ont fourni des objets en silex. Il s’agit principalement des deux tombes masculines 68 et 69, la tombe 137 n’ayant livré qu’une seule pièce esquillée. La série totalise 11 armatures de flèches, deux lames, deux pièces indéterminées, cinq éclats et deux esquilles/pièces esquillées (Fig. N45).
Les matières premières utilisées semblent de nature assez diverses. On note cependant que les armatures de flèches, qui représentent numériquement la moitié du corpus, utilisent préférentiellement deux types de matériaux : un silex de couleur blonde (n°2 à 5 et 7 fig. 75) et un silex brun-miel, à patine bleue/blanche (8 à 11 fig. 75). Cette dernière variété, réputée
105 Dolní Vĕstonice III grab 303/77 (n°26 fig. 69 et 70) (Bosch 2008 : Taf 131 ; Dvorak 1992) 106 Bulhary III grab 3/77 et 28/90 ; Dolní Vĕstonice III grab 333/77 ; Horní Bojanovice I grab 1/91 ; Kobylnice I grab 22/27 ; Pav-lov I grab 513/83, 529/83, 563/84 et 590/84 ; Tvořihráz grab 2/91, 3/91 et 4/91 (n°25, 26, 27, 30, 34 et 40 fig. 69 et 70) (Bosch 2008 : Taf. 123, 124, 134, 142, 146, 161, 164, 165, 169, 195, 197, 199 ; Dvorak 1992 et 1996 ; Balek et al. 1999)107 Dietfurt a. d. Atmülhl grab I ; Trieching grab I ; Dolní Vĕstonice III grab 74/76 ; Horní Bojanovice I grab 1/91 ; Šlapanice II grab 12/34 ; Tvořihráz grab 2a/91 et 2/91 (n°5, 14, 26, 27, 40 et 41 fig. 69 et 70) (Bosch 2008 : Taf 31, 79, 128, 142, 179,192, et 195 ; Goetze 1987 ; Engelhardt 1998 ; Dvorak 1996 ; Dvorak et Hajek 1990 ; Balek et al. 1999)108 Burgweinting Obj.1 ; Gemeinlebarn Verf. 3559 ; Hrdly ; Praha-Bubeneč (n°4, 15, 28 et 36 fig. 69 et 70) (Bosch 2008 : Taf 24, 88, 104, 109 ; Schröter 2005 ; Neugebauer und Neugebauer 1993/94 ; Hajek 1966 ; Hajek 1939-46)109 Bosch 2008 : Taf 167 ; Dvorak 1996110 grab 44,45/76 et 72,73/76 (Bosch 2008 : Taf 126 et 127 ; Dvorak 1996)111 Bosch 2008 : Taf 132 ; Dvorak 1996112 Bosch 2008 : Taf 187 ; Heyd 2001113 Ulrich 1942 ; n°1 fig. 68114 Pape 1978 ; n°21 fig. 68115 Salanova 2011116 Lefebvre et al 2008 ; n°18 fig. 69 et 70117 Lefebvre et al 2011 ; n°21 fig. 69 et 70118 Kunzing-Bruck grab 9 ; Landau grab 9 et « von 1981 » ; Hrdly ; Dolni vestonice III grab 66/76, 324/77 et 333/77 ; Kostice I grab 1/66 ; Ledce grab 1/52 ; Ostopovice grab 19/70 ; Pavlov I grab 570/84 ; Smolin grab 13/51 ; Laa an der Thaya grab 8 (n°7, 8, 16, 28, 26, 31, 33, 34 et 42 fig. 69 et 70) (Bosch 2008 : Taf. 49, 58, 59, 104, 126, 133, 147, 152, 155, 167, 186 et 90 ; Schmotz 1992 ; Husty 1999 ; Hajek 1966 ; Dvorak 1992 et 1996 ; Hetzer 1949)
113
provenir du Bassin parisien, est d’ailleurs exclusive à ce type d’objet. L’armature n°11 fig. 75 présente, en outre, une forte patine blanche, couvrant entièrement la pièce et qui ne se retrouve sur aucune autre pièce dans les mêmes proportions.Notons aussi que, d’une part, la seule pièce hors armature à être fabriqué dans un silex blond semi-translucide est l’objet n°12 fig. 75. D’autre part, la matière constitutive de l’éclat n°13 fig. 75 déposé avec les trois armatures de la tombe 68, présente de fortes similarités avec celle de l’armature n°5 de la même figure.
Les armatures de flèches de Sierentz (n°1 à 11 fig. 75) sont uniquement présentes dans les sépultures masculines. On en retrouve trois exemplaires dans la tombe 68 et huit dans 69. Leur forme est majoritairement à base concave, dégageant plus (n°7 fig. 75) ou moins (n°1 fig. 75) deux ailerons. Trois exemplaires, uniquement représentés dans la sépulture 69, sont des armatures à pédoncule et ailerons (n°8 à 10 fig. 75).
Sur le graphique de la figure 76, on voit que les armatures des deux tombes se distinguent par un module différent au sein de chaque sépulture. Les armatures de la sépulture 69 apparaissent en effet plus petites que celle de la St.68. La seule exception est la pièce n°11 fig. 75. Celle-ci possède de plus une épaisseur plus importante que les autres.
D’un point de vue typologique, on retrouve à Sierentz les deux principales formes d’armatures de flèches usitées au Campaniforme. Les formes à bases concaves, majoritaires ici, sont traditionnellement considérées comme typiques de la partie orientale du domaine, tandis qu’a contrario, les exemplaires à pédoncule et ailerons se concentreraient dans la partie occidentale. Le sud de la plaine du Rhin supérieur se situant dans l’aire de contact de ces deux grands ensembles119, il n’est donc pas étonnant de les trouver au sein d’une même tombe. Plus à l’est, des exemples ponctuels montrent l’association de ces deux types de formes (sépulture B de Predmosti120. Dans le cas de Sierentz, il semble cependant qu’il s’agisse des premiers exemplaires d’armatures à pédoncule et ailerons trouvés en contexte funéraire de la région.
119 Lemercier 2011120 Bosch 2008 : Taf 173 ; Hajek 1966 ; n°35 fig. 69 et 70
Fig. 76 : Répartition des armatures de flèches en fonction de leurs proportions Longueur / Largeur
114
Le cas de l’armature n°11 de la figure 75 est plus particulier. Cet objet se démarque en effet des autres armatures par sa forme, son module et par la présence d’une importante patine blanche à sa surface. Typologiquement proche des armatures du néolithique moyen local, il est probable qu’il s’agisse là d’un objet de récupération.
Dans le reste du corpus, on peut noter la présence d’une lame à trois pans, dont l’aspect très «roulé» et émoussé évoque là aussi un objet de récupération, et de trois éclats corticaux (n°12 à 22 fig. 75).
Deux objets de la tombe 68 appellent des commentaires supplémentaires. L’éclat 13 fig. 75 pourrait, de par sa forme triangulaire et sa matière première (le rapprochant de 68.3.1), évoquer une ébauche d’armature de flèche. Celui-ci est cependant trop mince pour remplir ce rôle. Ce rôle pourrait éventuellement être envisagé en ce qui concerne l’objet n°12 fig. 75. Celui-ci, outre le fait qu’il semble contenir assez de matière pour tailler une armature, est constitué de silex blond qui, on l’a vu, ne se retrouve à Sierentz qu’au sein des armatures de flèche. Son aspect de «produit fini» peut sembler aller contre cette hypothèse, mais des exemples de préforme à l’aspect «fini» ont déjà été signalés au sein de l’industrie lithique campaniforme121. Nous devons cependant revenir sur cette hypothèse. En effet, plusieurs éléments de silex, dont fait partie la pièce précédente, portent à leur surface des traces d’oxydation rouges. Un seul (n°16 fig. 75) se situe dans la sépulture 69, et a été trouvé en association avec un fragment de marcassite (n°5 fig. 77), avec lequel il forme un kit de briquet (fig. 63). Les traces d’oxydation sur cette pièce résulteraient alors de son utilisation. Les deux autres éléments (n°12 et 14 fig. 75) ont quant à eux été retrouvés l’un contre l’autre dans la sépulture 68. Malgré l’absence à leur côté d’un fragment d’oxyde de fer, la similitude de leurs traces d’oxydation avec celle de n°16 fig. 75 pourrait indiquer que ces deux objets ont servi eux aussi de pierre à briquet.
D’une manière générale, l’industrie lithique de Sierentz s’intègre donc bien à la production campaniforme classique, avec éventuellement des liens plus particuliers avec l’est du domaine, visible au travers de la prédominance des formes d’armatures à bases concaves. Le dépôt de kit de briquet est attesté au sein du Campaniforme européen, quoiqu’il soit, semble-t’il, peu fréquent. Un exemplaire est cependant signalé dans la tombe de Riegel «Breite I»122 , au sein d’un assemblage contenant l’une des rares armatures de flèches (à base concave) trouvées en contexte funéraire dans la région. Un élément de briquet est aussi mentionné dans la tombe 1 du site d’Op dem Boesch (Lux.)123. Il ne s’agit cependant là que de la pierre à briquet et non de l’association silex et oxyde. On retrouve aussi à Sierentz le caractère opportuniste de l’approvisionnement en silex, marqué par les différentes qualités de matière première et la taille réduite des pièces, qui semble prévaloir durant le Campaniforme124.
II.3.2.9. Le mobilier en pierre dure
Trois des sépultures de Sierentz ont livré quatre objets en pierre : un brassard d’archer en schiste (St. 68), deux «pierres à rainure» en grès (St. 68 et 69) et un fragment d’outil de mouture également en grès (St. 137).
L’unique brassard d’archer biforé (n°3 fig. 77), mis au jour dans la sépulture 68, est à rapprocher des types F ou G de Sangmeister125. Ce type d’objet est relativement peu fréquent dans la moitié nord de la France, où l’on en compte que huit exemplaires. Les comparaisons les plus proches vont alors vers la tombe 515 de La Sente126 et la sépulture 3 de Kunheim127
121 Furestier 2005122 Schlencker et Stöckl 1989 ; n°16 fig. 68123 Le Brun-Ricalens et al 2011 ; n°24 fig. 69 et 70124 Furestier 2005125 Sangmeister 1974126 n°21 fig. 69 et 70127 n°11 fig. 68
115
Fig. 77 : Planche récapitulative du mobilier en pierre dure et en marcassite
1 23 4
5 6
78
1 : Oberbierbaum 12 : Münschen-Sendling 4 : Gemeinlebarn3 : Trieching 14 : Gemeinlebarn5 : Rosnice 1/596 : Predmosti B7 : Predmosti C8 : Slapanice II-5/35 bzw, 6/35(D’après Bosch 2008, Tab. 40 et 41)
Fig. 78 : Exemples de brassards d’archer biforés (ci-dessus) et reconstitution d’un brassard d’archer en position (ci contre)
(Photographie : Smith 2006)
116
bien que le profil de ce dernier soit convexe. Des exemples plus nombreux existent dans les tombes du groupe oriental (fig. 78) : Trieching (n°3), Geminlebarhn (vrf 2071 ; n°4), Rosnice (n°5), Predmosti (n°6 et 7), Slapanice II (n°8)128.
On considère traditionnellement que ces d’objets devaient servir à empêcher le frottement de la corde sur l’intérieur de l’avant-bras de l’archer lorsque celle-ci reprend sa place après la décoche (fig. 78).
A Sierentz, la position du brassard, sous le radius de l’individu 68, la face plane en haut, semblerait indiquer qu’il devait, à l’origine être porté sur l’extérieur de l’avant-bras, n’assumant ainsi aucun rôle fonctionnel. Il n’est toutefois pas impossible qu’il ait été porté en position fonctionnelle, puis qu’une rotation de l’objet sur le radius ait eu lieu, celle-ci ayant été rendue possible par l’espace vide crée par la décomposition des chairs. Ces deux hypothèses, entre lesquelles il est assez difficile de trancher, font écho à un débat qui perdure au sein de la communauté des spécialistes.
L’interprétation traditionnelle, qui est encore aujourd’hui largement admise par les archéologues, se base sur des exemples ethnographiques ou modernes. Les nombreuses critiques dont elle fait l’objet129 font cependant remarquer que, dans la littérature ethnographique, si de nombreuses sociétés utilisent des brassards d’archer en matériaux périssables (cuir le plus souvent), l’utilisation de pierre en tant que protection est inconnue. A contrario, des exemples (Navajo, Hopi) existent de brassard (en cuir) dont le côté extérieur (non-fonctionnel) est décoré avec de l’os ou du métal130.
Les deux «pierres à rainure» (n°1 et 2 fig. 77) en grès mis au jour dans les sépultures 68 et 69 semblent être les seuls exemplaires existant en France pour le Campaniforme. On en retrouve cependant beaucoup plus fréquemment en Bavière, République tchèque et Autriche (fig. 79). Il ne semble pas y avoir de règle particulière quant à la forme de ces objets, leur unique point commun étant une rainure rectiligne, généralement peu profonde131. On peut
128 Bosch 2008 : Taf 79, 87, 113, 172, 182 ; Engelhardt 1998 ; Neugebauer und Neugebauer 1993/94 ; Hajek 1966 ; Vokolek 1965 ; Dvorak/Hajek 1990 ; n°14, 15, 35 et 38 fig. 58 et 59129 par ex : Fitzpatrick 2003, Case 2004 ; Turek 2004; Smith 2006 : Fokkens et al 2008130 Fokkens et al 2008131 Bosch 2008 Abb 44 ,45 et 46
9
1 : Stehelceves I2, 3 et 4 : Mitterharthausen 19225 : Smolin I-13/516 : Künzing-Bruck 97 : Slapanice II-5/36
8 : Slapanice II-6/369 : Rousinov II grab 18/1985
(1 à 8 : Bosch 2008 ; 9 : Ruzickova 2008)
1
6
2 3 4
5
7 8
Fig. 79 : Quelques exemples de «pierre à rainures»
117
cependant rapprocher l’objet n°1 fig. 77 des exemplaires n°1 et 2 de la figure 79. L’objet n°2 fig. 77 est quant à lui plus particulier puisqu’il possède deux rainures placées en croix. Nous n’avons trouvé qu’un seul autre exemple de ce type, dans la sépulture 18/1985 de Rousínov II132 (n°9 fig. 79).
Ce type d’outil semble lié à l’archerie puisqu’on le trouve régulièrement dans les tombes à armements133. Il est interprété comme un outil servant à la fabrication des hampes de flèches (redressage du bois après chauffage, calibrage, polissage…).
Enfin, un dernier objet en pierre vient compléter ce corpus, il s’agit du fragment d’outil de mouture de la tombe 137 (n°4 fig. 77). Etonnamment, nous n’avons trouvé aucune mention de ce type de dépôt dans la littérature sur le Campaniforme que nous avons consultée. Les outils en pierre (autres que ceux précédemment cités) que l’on retrouve dans les sépultures campaniformes sont liés à la métallurgie134 (n°7 à 11 fig. 83 par exemple) , ce qui ne semble pas être le cas à Sierentz.
II.3.2.10. Le mobilier en matière dure animale
Un total de cinq objets en matière dure animale a été mis au jour à Sierentz. Quatre proviennent de la sépulture 137 et les deux derniers des tombes 68 et 69.
Le pendentif arciforme n°1 fig. 80 mis au jour dans la tombe 69 est un élément de parure typique du Campaniforme. Rares en France135, ces objets sont beaucoup plus courants dans la partie orientale du Campaniforme, où ils sont le plus souvent décorés de motifs incisés
132 Pavla Růžičková 2008 Tab. 19, n°9 ; n°39 fig. 69 et 70133 Bosch 2008134 Bosch 2008135 Salanova 2011
Fig. 80 : Planche récapitulative du mobilier en matière dure animale
118
(simples traits ou croix majoritairement). On distingue deux grands types selon l’orientation de la perforation, verticale ou horizontale. Le premier type, auquel l’exemplaire de Sierentz appartient, est moins fréquent que le second. On en retrouve cependant dans la tombe 4 de München-Sendling, dans la tombe 5 d’Osterhofen-Altenmarkt (n°1 fig. 81), à Straubing-Alburg «Stadttäcker» (n°2 fig. 81), à Schollschitz (n°3 fig. 81) et dans la tombe 3 de Samborzec136. Les pendentifs arciformes sont généralement interprétés comme des objets de parure. Deux hypothèses principales sont avancées concernant la façon dont ils étaient portés137. D’une part, ils pouvaient être cousus sur les vêtements, et servir éventuellement de boutons138. Dans ce cas cependant, on peut s’interroger sur l’intérêt des décorations présentes très fréquemment sur les deux faces de l’objet si l’une d’entre elles devait rester en permanence collée aux vêtements. D’autre part, ils pouvaient aussi être portés avec un cordon autour du cou139, soit attachés par l’extrémité, soit par la perforation. La première méthode ne peut cependant s’appliquer qu’à certaines formes particulières de pendentif (celles aux extrémités recourbées notamment) et ôte toute fonction à la perforation. On peut cependant envisager une troisième hypothèse qui ferait de ces objets des boutons de type «duffle-coat». Attaché par la perforation, libre de pivoter et de montrer ses deux faces ornées, l’objet conserverait aussi une fonction de fermoir.
Les boutons perforés en V (n°2 à 4 fig. 80) sont des objets de parure que l’on retrouve fréquemment en contexte campaniforme, mais aussi durant le Bronze ancien (sépulture de Mancenans-Lizerne (Doubs, F.) par exemple)140. Relativement rare dans la plaine du Rhin supérieur, où seule la tombe 2 du site d’Effringen «Im Ort» en a livré trois exemplaires141, ce type d’objet reste cependant assez fréquent dans l’ensemble du domaine campaniforme. Le nombre d’exemplaires déposés est très variable, certaines tombes n’en fournissent qu’un seul, mais certaines peuvent en contenir plusieurs dizaines (38 dans le cas de la sépulture 1 des Petits-Prés à Léry142. Même si ce type de parure n’est pas exclusivement féminin et que 136 Bosch 2008 : Taf. 62, 70, 76, 171, 205 ; Müller-Karpe 1961 ; Schmotz 1994 ; Engelhardt 1998 ; Schirmeisen 1934 ; Kamiens-ka / Kulczycka-Leciejewiczoma 1970 ; n°10, 11, 13 fig. 69 et 70137 Bosch 2008 abb 19138 K. Schirmeisen cité dans Bosch 2008139 K. Willvonseder cité dans Bosch 2008140 Jeunesse 2010141 Kraft 1947 ; n°5 fig. 68142 Salanova 2011
1 : Osterhofen-Altenmarkt grab 52 : Staubing-Alburg «Stadtäcker»3 : Schöllschitz(Bosch 2008)
1
2
3
Fig. 81 : Exemples de pendentifs arciformes à perforation verticale
119
l’on peut en trouver dans des tombes masculines, en association avec des armes, la majorité des trouvailles sont cependant faites dans des tombes de femmes.
L’élément de parure en os associé aux boutons perforés en V de la tombe 137 (n°5 fig. 80) est, lui, plus particulier. Nous n’avons en effet pas trouvé de comparaison satisfaisante dans la littérature. Les éléments qui s’en rapprochent le plus sont un objet issu du site de Mandolging143, daté du Bronze ancien et, si l’on prend en compte le fait que l’objet de Sierentz soit cassé, un élément de parure de la tombe de Leopoldsdorf144. Au cours d’un récent colloque s’étant tenu à Sion, un objet similaire nous a été montré par P. Courtaud au cours de sa présentation de la fouille du Tumulus des Sables (Gironde, F).
Enfin, le dernier objet en matière dure animale mis au jour dans les sépultures de Sierentz est la défense de suidé n°5 fig. 80. En France, un seul exemplaire de ce type d’objets est signalé aux Tumulus du Gendarme145. On en retrouve plus fréquemment dans la partie orientale du domaine campaniforme bien qu’il ne soit pas pour autant habituel. En Bavière, République Tchèque et Pologne, seuls dix exemplaires, répartis sur six sites ont été 143 Heyd 2000, Taf 123, n°41144 Bosch 2008 : Taf 91, n°15 ; Pittioni 1954145 Lemercier et Tcheremissinoff 2011
1 : Osterhofen-Altenmarkt grab 52 : Staubing-Alburg «Stadtäcker»3 : Schöllschitz(Bosch 2008)
1
2
3
1 et 2 : Vases en céramique3 et 4 : Outils en silex13-18 : Armatures de �èche en silex5 : Alène en cuivre6 : Brassard d’archer7 à 11 : Outillage en pierre12 : Défense de sanglier
(Schmotz 1992)
Ech. plan : 1/40Ech. Mat : 1/4
Fig. 82 : La sépulture 9 de Künzing-Bruck (Ldkr. Deggendorf, Niederbayern, D.)
120
mis au jour (Altdorf grab 2 ; Burgweinting Obj1 ; Kunzing-Bruck grab 9 ; Laa en der Thaya ; Dolni Vestonice grab 224/77 ; Predmosti)146. Quatre défenses ont aussi été trouvées dans la sépulture de l’ «archer» d’Amesbury147. Toutes se présentent sous une forme «brute», non-travaillée, ou en lamelles. Il pourrait s’agir d’une sorte de réserve de matière première pour la fabrication d’objets. Une autre hypothèse serait que ces objets aient un lien avec le domaine de la chasse, et jouent ainsi en quelque sorte le rôle de «trophées»148. Quoi qu’il en soit, on ne peut que souligner la récurrence de leur association avec des éléments de l’armement (au sens large) campaniforme.
II.3.2.11. Place de l’ensemble de Sierentz dans la périodisation du Campaniforme
Les comparaisons que nous avons pu effectuer tout au long de ce chapitre, et en particulier celles concernant le mobilier céramique, renvoient le plus souvent aux ensembles campaniformes bavarois, bohémiens et moraves.
Ces régions ont fait l’objet d’une périodisation basée sur l’évolution des assemblages de mobilier déposés dans les tombes. Bien qu’il existe certaines spécificités propres à chaque région, on peut la décomposer en trois grandes étapes. A une étape ancienne caractérisée par des gobelets aux décors «monotones» (bandes remplies d’impressions obliques) succéderait une étape de «régionalisation» marquée par une augmentation de la variété des décors et des objets décorés ainsi que par l’apparition au sein de l’assemblage de céramique non-décorée. Cette dernière devient l’unique catégorie de récipient à être déposé dans les tombes durant la dernière étape, en même temps que l’on constate une raréfaction des autres matériels149.
Concernant Sierentz, les éléments céramiques, et en particulier les associations des différents types de motif, trouvent dans la grande majorité des cas des équivalences avec du matériel issu de tombes datées des phases A2 voir A2a de Bavière et A1/A2-A2 de Moravie150. Ces différentes phases correspondent à la deuxième étape de la périodisation décrite plus haut. Le type du pendentif arciforme, de même que les dépôts de boutons perforés en V, qui sont censés apparaitre durant cette étape, semble confirmer cette datation. Le brassard d’archer biforé, de même que l’absence de dépôt de céramique non décorée, pourrait indiquer que les tombes de Sierentz se situeraient plutôt au début de cette étape151.
Une récente réévaluation des données disponibles sur les sépultures individuelles campaniformes en France a donné lieu à une proposition de périodisation du Campaniforme pour le nord du pays152. Si elle se base, tout comme la périodisation de V. Heyd, sur l’étude de l’évolution des mobiliers funéraires, la quantité de documentation disponible en France septentrionale est cependant loin d’être égale avec celle des régions orientales (fig.69 et 70). Toutefois, elle intègre les données issues des datations 14C, données qui ne sont que très rarement disponibles en Europe centrale.
Le schéma évolutif proposé est peu ou prou le même. Trois étapes sont définies. La première se caractériserait par la présence au sein des tombes de vases de style AOC ou mixtes. L’étape suivante correspondrait à un phénomène de «régionalisation» des styles et d’une augmentation dans la variété des dépôts. Enfin, la dernière étape verrait un appauvrissement du mobilier funéraire et en particulier une raréfaction des gobelets décorés.
Les éléments de comparaison entre Sierentz et les ensembles français ne permettent pas, en ne tenant compte que du matériel, de replacer celui-ci au sein des différentes étapes.
Toutefois, une série de quatre dates 14C a été effectuée sur les ossements des deux
146 Bosch 2008 : Taf. 2, 25, 50, 90, 130, 173 ; Christlein 1981 ; Schröter 2005 ; Schmotz 1992 ; Hetzer 1949 ; Dvorak 1996 ; Hajek 1966 ; n°1, 4, 7, 16, 26, 35 fig. 69 et 70147 Fitzpatrick 2009 ; n°44 fig. 69 et 70148 Bosch 2008149 Heyd 2000, Metzinger-Schmitz 2004150 Heyd 2000, Metzinger-Schmitz 2004151 Heyd 2000, Bosch 2008152 Salanova 2011
121
sépultures les mieux conservées (fig. 83). Ces dates permettent de positionner ces tombes globalement entre 2500 et 2300 Av. J.-C., ce qui les situerait entre l’étape 1 et l’étape 2, au début de la phase de «régionalisation».
Il ne semble pas possible de distinguer, ni d’après le matériel, ni d’après le carbone 14, une chronologie particulière au sein de l’ensemble funéraire, celui-ci apparaissant assez homogène de ce point de vue.
Au final, il semblerait donc que les ensembles de Sierentz relèvent d’une phase moyenne (éventuellement du début de celle-ci) au sein des évolutions du Campaniforme qui sont proposées. Dans le même temps, il serait possible d’envisager un certain synchronisme entre les débuts de l’étape 2 du Nord de la France et les débuts de la phase A2 de Heyd.
Cependant, il convient de nuancer cette conclusion. D’une part, la période de la fin du Néolithique est particulièrement affectée par un «effet plateau» des dates 14C. Recourir à cette méthode de datation dans le cadre d’une périodisation fine tel qu’attendu pour le Campaniforme peut donc se révéler dangereux. D’autre part, l’ensemble les schémas évolutifs précédemment évoqués ont pour point commun une évolution allant, d’une manière générale, dans le sens d’un appauvrissement des dépôts (que ce soit les décors des vases, qui finissent par disparaitre, ou la variété du mobilier, qui s’amoindrit) pour finalement aboutir, dans certaines régions à une disparition complète du mobilier au début du Bronze ancien. La richesse du mobilier associé au défunt est donc perçue comme un élément chronologiquement discriminant alors que l’on pourrait se demander s’il ne s’agit pas là d’un élément de distinction sociale marquant une différence de statut. Cette question, qui semble pourtant légitime, n’a que peu été évoquée par les spécialistes. Elle a cependant été récemment soulevée par Ch. Jeunesse lors d’une communication orale au Colloque de Sion d’octobre 2011. II.3.3 Conclusion
La fin du IIIe millénaire Av. J.-C. sur la commune de Sierentz est donc marquée par un ensemble de quatre sépultures attribuées au Campaniforme. Alignées, ces tombes contenaient les restes d’un enfant, d’une probable femme et de deux hommes, chacun accompagné d’offrandes.
Les hommes, déposés repliés sur le coté gauche, tête au nord-ouest, sont chacun accompagnés de deux gobelets décorés, d’éléments d’armement, d’outils et de parures en pierre et en matière dure animale. La femme était enterrée en position repliée sur le côté droit, tête au sud. Comme les hommes, elle avait à ses côtés deux vases décorés ainsi que des éléments de parures en os et un outil en pierre. Enfin, l’enfant, dont la position est inconnue, était lui aussi accompagné de deux vases décorés.
Les deux sépultures masculines, particulièrement bien conservées, ont en outre fourni des indices quant à l’existence de contenant en matière périssable. Les restes de quatre piquets calcifiés mis au jour dans la tombe 68, permettent d’imaginer la présence d’une superstructure hors-sol signalant la sépulture.
Poz-41226 Os 3875 ± 35Poz-41227 Os 3910 ± 35Poz-41228 Os 3925 ± 30Poz-41229 Os 3935 ± 35
Cumul des prob. des dates calibrées (av. J.-C.)
1σ 2σ
2310248823502474
2299246623462460St68
St69
Date (BP)Code Lab.Structure Nature de l'échantillon
Fig. 83 : Tableau récapitulatif des datations C14 des sépultures campaniformes de Sierentz
122
D’une manière générale, l’implantation des sépultures, en haut de la petite colline du Monenberg, associée à la signalisation d’au moins une des tombes, pouvait contribuer à rendre l’ensemble visible dans le paysage, éventuellement dans le but de marquer la présence de cette communauté au sein de ce territoire.
Dans la pratique funéraire campaniforme, l’identité et/ou le statut de l’individu (plus ou moins idéalisé) est marqué par le positionnement du corps dans la tombe et par le mobilier déposé à ses côtés.
A ce titre, l’identité sexuelle (biologique ou culturelle) des défunts semble jouer un rôle prépondérant puisque c’est elle qui détermine la position du corps dans la tombe, et qu’il s’agit là d’un des points du «dogme» les plus respecté à travers tout le domaine campaniforme. Dans une moindre mesure, le sexe des individus influe aussi sur la nature des dépôts matériels. Les éléments d’armement (au sens large) sont ainsi (quasi-) systématiquement associés aux inhumés de sexe masculin. Cependant, ces tombes ne représentent que moins d’un quart des sépultures individuelles campaniformes, et tous les hommes ne sont pas enterrés avec des armes. Les sépultures à armements semblent donc marquer un statut individuel particulier153.
A Sierentz, les deux tombes masculines ont livré des éléments d’armements ou pouvant être liés à celui-ci. Dans la sépulture 68, un grattoir en silex était déposé sur une «pierre à rainure», le tout semblant former une sorte de «kit» qui pouvait être destiné à la fabrication/réparation des hampes de flèche. Dans la tombe 69, un ensemble d’objets, éventuellement rassemblés dans un contenant en matière périssable, est formé d’une pierre à rainure, de trois éclats en silex et d’une armature de flèche «récupérée». Cet ensemble évoque là aussi le domaine de la fabrication de flèches : la «pierre à rainure» pour la fabrication/réparation des hampes, les trois éclats retouchés comme outils ou réserve de matière première pour de futures armatures et enfin la pièce de récupération, destinée soit à être utilisée telle quelle, soit à être retaillée. Dans les deux sépultures, on note cependant l’absence d’élément ayant pu servir pour la taille des armatures, en particulier de percuteurs. La dotation des deux individus masculins inclut en outre des éléments liés au feu qui sont, dans chaque cas, déposés aux environs du bassin. Dans le cas de la sépulture 69, il s’agit d’un kit de briquet complet, qui pourrait avoir été, à l’origine, contenu dans un petit sac, éventuellement accroché à la ceinture de l’individu. Dans le cas de la tombe 68, seules les traces d’oxyde observées sur deux pièces indiqueraient leurs utilisations comme pierres à feu.
On remarque aussi que ces deux sépultures se situent dans une position centrale au sein de l’ensemble et qu’elles ont de plus livré des éléments indiquant la présence d’une architecture funéraire. L’individu 68, le plus âgé, se singularise cependant par l’existence probable d’une superstructure en bois au-dessus de sa sépulture et par le fait qu’il possède un brassard d’archer et une défense de suidé. Ces éléments peuvent éventuellement être considérés comme des marqueurs d’un statut différent de celui de l’individu 69, plus jeune.
Que soit au travers de l’armement proprement dit (armatures), de l’équipement (brassard), de l’outillage («pierre à rainure») ou de la parure (pendentif arciforme), la quasi-totalité du mobilier (hors céramique) associé aux individus masculins de Sierentz renvoie clairement au domaine de l’archerie. D’une manière générale, l’image de l’archer est un élément culturellement important pour les populations pratiquant le rite funéraire campaniforme.
Les enfants font aussi l’objet, durant cette période, d’un traitement particulier. Certains sont mis en terre au sein de la sépulture d’un adulte alors que d’autres possèdent leur propre sépulture. Cette dernière pratique est bien documentée dans les régions orientales,154 mais existe aussi en France155. Au sein de ces sépultures, les enfants reçoivent un traitement au moins équivalent à celui des adultes, tant dans l’orientation/positionnement de leur corps que dans le mobilier déposé avec eux. La sépulture 10 de Sierentz, où l’enfant est accompagné
153 Lemercier 2011154 Turek 2000, Heyd 2007155 Salanova 2011
123
de deux vases décorés, correspond à cette pratique, affirmant ainsi l’appartenance du jeune individu à la communauté.
On a déjà souligné que le dépôt systématique de deux gobelets décorés comme seuls éléments céramiques dans chaque tombe d’un même ensemble était, à notre connaissance, un élément particulier à Sierentz. Cette particularité pourrait éventuellement se comprendre par une volonté de marquer une appartenance à une communauté plus restreinte, au caractère beaucoup plus local. Cette remarque peut être mise en parallèle avec le caractère discret partagé par les deux individus masculins dont l’origine pourrait être génétique.
Au final, les différentes caractéristiques de l’ensemble funéraire de Sierentz montrent que celui-ci s’intègre bien dans le Campaniforme européen et plus particulièrement dans le groupe oriental. Au niveau régional, les parallèles restent toutefois assez ponctuels. On peut d’ailleurs noter que Sierentz se singularise, au sein du sud de la plaine du Rhin supérieur, par l’absence de céramique non-décorée, pourtant très fréquente dans les assemblages régionaux. Toutefois, de par son bon état de conservation et la relative richesse de ses dépôts, les quatre tombes de Sierentz sont certainement appelées à devenir un des ensembles de références pour la fin du Néolithique dans la région.
124
N° d
e St
ruct
ure
Type
Plan
Prof
ilO
rient
atio
nR
elat
ions
Long
ueur
(m
.)La
rgeu
r (m
.)D
iam
ètre
(m.)
Prof
onde
ur
(m.)
Rem
plis
sage
Obs
erva
tion
Plan
che
10S
PQ
uadr
angu
laire
cuve
tteN
/S -
1,5
1 -
0,05
Lim
on lo
essi
que
brun
1 in
divi
duXX
II
68S
PQ
uadr
angu
laire
Pla
tN
NO
/SS
E -
2,30
1,80
-0,
333
couc
hes
: lim
on lo
essi
que
brun
com
pact
, lim
on
loes
siqu
e br
un c
lair
meu
ble
et li
mon
lehm
ique
br
un s
ombr
e1
indi
vidu
XXIII
69S
PQ
uadr
angu
laire
Pla
tN
O/S
E -
2,25
1,70
-50
3 co
uche
s : l
imon
loes
siqu
e br
un c
ompa
ct, l
imon
lo
essi
que
brun
cla
ir m
eubl
e et
lim
on le
hmiq
ue
brun
som
bre
1 in
divi
duXX
IV
137
SP
Obl
ongu
eC
uvet
teN
O/S
E -
2,08
1,80
-0,
18Li
mon
lehm
ique
bru
n1
indi
vidu
XXII
Fig. 84 : Inventaire des structures campaniformes
125
n° d'inventaire Conservation Hauteur
(cm)Ø ouverture
(cm)Ø maximum
(cm)Ø fond (cm)
Epaisseur (cm)
10.1 Fond 4,1 - 12 7,8 0,6 / 0,710.2 Fond 2,2 - 8,6 6 0,5 / 0,668.1 Complet 15,2 15,4 14,2 6,8 0,6 / 0,868.2 Complet 13,4 11,2 10,8 4,6 0,4 / 0,6
69.5.1 Complet 15,8 14,8 12,8 6,4 0,4 / 0,669.6 Complet 15,8 14,8 12,8 6,2 0,4 / 0,5
137.1 Fond 3,6 - 11,9 7 0,4 / 0,9137.2 Fond 3 - - - 0,6 / 0,9
Fig. 85 : Inventaire de la céramique campaniforme
Longueur (cm)
Largeur (cm)
Epaisseur (cm)
68.4.1 Aiguisoir Grès 5,6 3,6 2,2
68.6 Brassard d'archer Schiste 9,2 2,6 0,7 Biforé
69.12 Aiguisoir Grès 8,2 2,8 3,9
69.9 4,4 4 8 Partie de kit de briquet
137.5Fragment d'outil de mouture
Grès 14 12 4,4
RemarqueDimension
MatièreType d'objet
n° d'inventaire
Fragment de marcassite
Fig. 86 : Inventaire du matériel lithique campaniforme (hors silex)
Longueur (cm)
Largeur (cm)
Diamètre (cm)
Epaisseur (cm)
68.12 Elément de parure ?
Défense de suidé 7,2 1,4 - 0,8 -
69.17 Pendentif arciforme Os 4,4 1,6 - 1,6 Ø perf. = 0,6
cm
137.4.1 Bouton perforé en V Os - - 1,1 0,5 Ø perf. = 0,5
cm
137.4.2 Bouton perforé en V Os - - 1 0,4 Ø perf. = 0,2
cm
137.4.3 Bouton perforé en V Os - - 1 0,6 Ø perf. = 0,2
/ 0,3 cm
137.4.4 Elément de parure ? Os 1,4 0,7 - 0,4 -
RemarqueDimensions
MatièreTypen° d'inventaire
Fig. 87 : Inventaire du mobilier en matière dure animale
126
Couleur Opacité Longueur (cm)
Largeur (cm)
Epaisseur (cm)
68.3.1 Armature de flèche
gris/bleu veiné de blanc opaque 2,55 1,85 0,4 base concave
68.3.2 Armature de flèche gris/blanc opaque 3,5 2,1 0,4 base concave
68.3.3 Armature de flèche blond semi-
translucide 3,9 2,4 0,6 base concave
68.3.4 Eclat gris/bleu opaque 5,5 3,4 0,9 plage cortical
68.4.2 Eclat cortical gris/bleu translucide 3,4 3,2 0,6 traces de machurage
68.7.1 Indet. blond semi-translucide 3,9 5 1,15 traces d'oxyde de
fer
68.7.2Lame
épaisse à trois pans
gris/bleu opaque 4,7 1,6 1,2 traces d'oxyde de fer
68.8 Lame à trois pans
brun à beige/orangé opaque 5,2 1,8 0,6 aspect très roulé
69.5.2 Esquille gris clair semi-translucide 2 2,2 0,4
69.7.1 Armature de flèche blond translucide 2,4 1,55 0,3 base concave
69.7.2 Armature de flèche gris sombre opaque 1,8 1,6 0,35 base concave
69.7.3 Armature de flèche
brun miel à patine
bleue/blanchetranslucide 2 1,6 0,4
pédoncule et ailerons ; silex de
type Bassin parisien
69.7.3bis Armature de flèche blond semi-
translucide 2,2 1,35 0,3 base concave
69.7.4 Armature de flèche blond semi-
translucide 2,3 1,6 0,4 base concave
69.7.5 Armature de flèche
brun-miel à patine
bleue/blanche
semi-translucide 2,2 1,6 0,4
pédoncule et ailerons ; silex de
type Bassin parisien
69.7.6 Armature de flèche
brun-miel à patine
bleue/blanche
semi-translucide 1,8 1,45 0,35
pédoncule et ailerons ; silex de
type Bassin parisien
69.8 Eclat cortical gris opaque 3,6 2,6 1 traces d'oxyde de fer
69.10 Armature de flèche
brun-miel patiné
bleu/blanc
semi-translucide 3,3 2 0,7
Pièce triangulaire à tendance
asymétrique et base concave ; lustré ; silex de
type Bassin parisien ?
69.11 Eclat cortical brun-beige à orangé opaque 4,4 4 1,3
69.13 Eclat cortical gris-bleu opaque 5,1 4,9 1,4
69.14 Eclat cortical gris sombre opaque 3,9 2,1 0,6
137.3 Pièce esquillée brun beige opaque 3,6 2,2 0,6
plage corticale ; traces de
machurage
Matière DimensionsType de pièce Remarquen°
d'inventaire
Fig. 88 : Inventaire du mobilier campaniforme en silex
127
II.4. LE NEOLITHIQUE INDETERMINE
Deux structures (St. 22 et 54) n’ont pu être attribuées à une période précise du Néolithique du fait de l’absence de caractéristiques particulières de leur plan et de leur mobilier (fig. 89 et 90). Ces structures sont des fosses aux plans ovale (St. 22) ou circulaire (St. 54) et aux profils en cuvette, relativement peu profondes. Leur remplissage se compose de limon lehmique brun (Fig. N55). Toutefois, le fond de la fosse 54 est tapissé par une couche de loess remanié (Pl. XXV). La fosse 22 n’a livré qu’un éclat de silex retouché. Un second éclat et des fragments de panses d’aspect néolithiques ont été mis au jour dans la St. 54, avec, en outre, un petit fragment de grès, et des éléments de faune et d’argile cuite (fig. 91, 92 et 93).
128
984
000
307 000
306 900
985
000
0 25 m
Les n° de structure entre parenthèses et en italiquerenvoient à la numérotation du diagnosticStructure du néolithique indéterminé
Structure autres périodes
22
54(FS 101)
Fig. 89 : Localisation des structures du Néolithique indéterminé
129
N° d
e St
ruct
ure
Type
Plan
Prof
ilO
rient
atio
nR
elat
ions
Long
ueur
(m
.)La
rgeu
r (m
.)D
iam
ètre
(m.)
Prof
onde
ur
(m.)
Rem
plis
sage
Plan
che
22FS
Ova
leen
cuv
ette
N/S
-2,
11,
46 -
0,4
limon
lehm
ique
bru
n fo
ncé
XXV
54FS
Circ
ulai
reen
cuv
ette
- -
- -
1,7
0,27
limon
lehm
ique
bru
n/no
ir, in
clus
ion
de T
C. +
loes
s re
man
iéXX
V
Fig. 90 : Inventaire des structures du néolithique indéterminé
130
Hauteur conservée
Ø ouverture
Ø max. conservé Epaisseur
54 1 1 Indet. - - - 0,5 Fragment de panse54 3 3 Indet. - - - 0,,4 / 0,7 Fragments de panse (=101.001)54 4 2 Indet. - - - 0, 7 Fragments de panse (=101.002)
StructureDimensions (cm.)
ObservationsN° d'inventaire
Nombre de tessons Forme
Fig. 91 : Inventaire de la céramique du Néolithique indéterminé
L. l. Ep.
Silex 22 1 3,1 1,4 1,3 Eclat informe retouché en silex rose veiné de blanc.
Silex 54 6 3,2 2 1 Eclat retouché en silex gris clair. (=101.004)
Grès 54 7 4,5 2,8 1,9 Fragment de grès rose. (=101.005)
Nature Structure N° d'inventaire
Dimension (cm.)Description
Fig. 92 : Inventaire du matériel lithique du Néolithique indéterminée
Faune 54 2 Fragments d'espèce(s) indéterminée(s).Faune 54 8 Os brulé ? (=101.006) (Matériel non fourni)Torchis 54 5 Petit fragment d'argile cuite. (=101.003)
Nature Structure N° d'inventaire Description
Fig. 93 : Inventaire du matériel osseux et de la TCA du Néolithique indéterminé (LB et LV)
132
Fig. 94 : P1A Plan Bronze moyen.ai
Bronze final I (St. 1)
0 25 m
984
000
307 000
306 900
985
000
1
Fig. 94 : Localisation de la structure Bronze final I
133
III.1. LE BRONZE FINAL I (SGO)
Une unique structure (St. 1) est attribuée à cette période (fig. 110). Il s’agit en fait d’un grand vase (de stockage a priori) retrouvé écrasé sur place (fig. 95), dans la couche de lehm et de terre végétale située au-dessus du niveau de décapage (fig. 96 et Pl. XXVI). Il est localisé dans le quart sud-est du chantier (fig. 94).
Malgré ses grandes dimensions, la conservation du vase n’est que très partielle en raison du niveau relativement haut auquel il est apparu : une grande portion de la partie supérieure de la panse a disparu (labours, érosion…). Néanmoins les parties restantes ont permis de proposer une restitution quasi complète du profil (fig. 96). Le remontage n’a pas été aisé en raison de la qualité très médiocre de la pâte.
Le vase présente un profil très bombé dit de type «piriforme». Les dimensions ne peuvent être qu’estimées compte tenu de la très mauvaise conservation de l’ensemble. Ainsi le diamètre d’ouverture approche 40 ou 45 cm. Le diamètre maximal de la panse est compris dans une fourchette allant de 69 à 75 cm. Le fond, entièrement conservé quant à lui atteint 20 cm. La restitution proposée permet d’envisager une hauteur totale comprise entre 65 et 69 cm (fig. 111). La pâte, d’une qualité médiocre, est très friable. Son épaisseur est de 1,5 cm en moyenne. Les inclusions de dégraissant, de très grande dimension, comprennent des fragments de chamotte, de quartz et de calcaire. La jonction entre l’amorce de l’encolure et la lèvre plate (dont un seul petit fragment a été conservé) n’a pas pu être déterminée de manière précise. Cependant, l’hypothèse d’une encolure haute a été privilégiée au détriment d’un col court notamment en confrontant l’individu avec d’autres exemplaires connus par ailleurs. La panse, très irrégulière par ailleurs, est rehaussée dans sa partie supérieure d’un cordon digité relativement régulier. Notons enfin que le resserrement au niveau de l’amorce de l’encolure est marqué par une arête vive sur la surface interne du récipient.
Fig. 95 : Vue en plan et en coupe de la St. 1
134
Echelle : 1 / 5
0 5 10 cm
Niveau de décapage
Terre végétale + lehm
N
0 20 cm 1 m
Fig. 96 : Plan et coupe de la structure 1 et restitution du profil du vase
135
La position du cordon sur la partie supérieure de la panse ainsi que le profil très bombée de celle-ci rappelle fortement des récipients de grand gabarit déjà connus au Bronze ancien151. Cependant le caractère très marqué de l’encolure et le développement de celle-ci exclut totalement une appartenance à un tel horizon chronologique. Par contre quelques comparaisons intéressantes peuvent être soulignées avec des individus datés des premières phases du Bronze final (fig. 97). La comparaison la plus pertinente est sans aucun doute un vase découvert à l’occasion de la fouille d’un fond de cabane à Didenheim «Gallenberg» dans les années 1960. Le profil bombé, tout comme les grandes dimensions ou encore le cordon digité placé sur la partie supérieure de la panse ressemblent fortement à l’individu de la structure 1 de Sierentz. La présence d’autres tessons de céramique permet de dater le site de Didenheim du début du Bronze final (Bronze final I). Par ailleurs, une forme très proche est à signaler à Wittelsheim152. Le profil y est strictement identique malgré des dimensions moindres. Ce vase est issu d’un contexte funéraire puisqu’il recelait une incinération ainsi que d’autres poteries et une épée de type Rixheim intentionnellement brisée. Cette structure serait datée du début du Bronze final. Un autre exemplaire retient notre attention. Il s’agit encore d’une grande urne funéraire découverte et fouillée à Illfurth en 1988153. Là encore le profil correspond, tout comme l’emplacement d’un cordon sur la panse, à l’exemplaire de la structure 1 de Sierentz, mais ce dernier présente des dimensions plus importantes. L’encolure, particulièrement développée est bien distinguée de la panse par une nette rupture de pente. Cet ensemble est également
151 Denaire et Croutsch 2009, p.180 n°2152 Zumstein 1965, p.54, fig.64, n°443153 Lack et Voegtlin 1988, p.72, figure 3
1. – Sierentz Les Villas d’Aurèle, ST. 01, 2. – Wittelsheim (ZUMSTEIN, 1965, p.54, fig.64, n°443),
3.- Illfurth (LACK, VOEGTLIN, 1988, p.72, figure 3)4.- Meistratzheim Station d’épuration (MURER, 2009, p.83)
5.- Obernai Schulbach, Nouvel Hôpital (FERRIER, LEROY, 2010, p.46, fig.27, n°39001-1)
Fig. 97 : Quelques comparaisons régionales à l’échelle d’urnes de grand gabarit à profil piriforme et à encolure distincte et développée du début du Bronze Final
136
daté du début du Bronze final. Deux autres fragments d’un récipient, de taille plus comparable peuvent enfin être évoqués. Il s’agit d’une part de la partie supérieure d’un grand vase de stockage découvert à Meistratzheim154 dont la datation n’a pas pu être déterminée en l’absence d’autres mobiliers associés. Enfin, la partie supérieure d’un récipient de même nature a été découverte récemment dans le cadre d’une opération de diagnostic, a priori dans un contexte d’habitat155. Là encore la forme globuleuse de la panse, le positionnement du cordon ainsi que l’encolure développée oblique se rapprochent fortement de l’urne de Sierentz. Il est, là encore, daté des prémices du Bronze final.
Ces diverses comparaisons orientent donc naturellement la datation du vase de la structure 01 au début du Bronze final. Cette attribution chronologique constituerait l’unique preuve d’une occupation du début du Bronze final sur le chantier de Sierentz «les Villas d’Aurèle». Enfin il est intéressant de noter que les exemplaires de récipient de grand gabarit trouvés en contexte funéraire (urnes cinéraires) et ceux issus d’un contexte d’habitat (vases de stockage ou vases-silos) présentent une morphologie similaire, mais un module dimensionnel différent.
154 Murer 2009, p.83155 Ferrier et Leroy 2010, p.46, fig.27, n°39001-1
137
III.2. LE BRONZE FINAL IIb / IIIa (Période RSFO)
III.2.1. Les structures
4 structures sont attribuées à la période du Bronze final IIb-IIIa de façon certaine : St. 72, 73, 100 et 105 et neuf autres peuvent y êtres associé de façon très hypothétique : St. 51, 57, 65, 89, 97, 101, 102, 104 et 106 (fig. 99 et PL. XXVII à XXXII). On peut les répartir en plusieurs grandes catégories : les silos, les fosses à fond plat et les autres fosses (fig. 110).
III.2.1.1 Les silos
Deux structures appartiennent à cette catégorie : St. 51 et 89 (Pl. XXVII et XXIX). Leurs plans sont globalement circulaires, quoique celui de la structure soit un peu difforme. La structure 51 possède un profil tronconique à fond aplani. Il s’agit certainement du fond d’un silo tronconique dont la partie supérieure a été détruite. Son remplissage est constitué d’une unique couche de limon lehmique brun, suggérant un comblement assez rapide. Le silo 89 (fig. 98) est, lui, dans un bon état de conservation. Il s’agit d’un silo piriforme dont le remplissage se compose d’une succession de couches de limon lehmique brun foncé et de limon loessique brun clair. Il semble donc que son remplissage se soit effectué en trois temps, entrecoupé par des périodes où la structure a été laissée ouverte et pendant lesquelles une partie des parois s’est effondrée. La structure 51 se situe près de la berme est du chantier, la St. 89 dans la moitié ouest. Dans chacun de ces silos, des éléments de céramique et de faune ont été mis au jour.
Fig. 98 : Vue de la structure 105
138
Bronze final IIb / IIIa
Bronze final IIb / IIIa probable
0 25 m
Les n° de structure entre parenthèses et en italiquerenvoient à la numérotation du diagnostic
984
000
307 000
306 900
985
000
65
51
57
97
72 73
74
89100(FS 111)
105106
101
102104
Fig. 99 : Localisation des structures du Bronze final IIb / IIIa
139
III.2.1.2. Les fosses à fond plat
Neuf structures appartiennent à cette catégorie : St. 65, 72, 73, 74, 101, 102, 104, 105 et 106 (Fig. 110 ; Pl. XXVIII, XXIX, XXXI et XXXII). Toutes, sauf deux, possèdent un plan circulaire dont les diamètres s’échelonnent entre 1,10 et 1,55 m pour des profondeurs comprises entre 0,15 et 0,55 m. Les St. 65 et 104 ont, elles, un plan ovale. La fosse 104 est peu profonde (0,08 m) tandis que le fond de la structure 65 se situe à 0,80 m du niveau de décapage. La plupart de ces fosses ont un remplissage constitué de limon lehmique brun foncé signalant un comblement qui s’est effectué dans un laps de temps assez bref. La structure 65, elle, contenait quelques poches de loess remanié, probablement issues d’un effondrement des parois. La grande majorité de ces structures a livré du mobilier céramique avec parfois quelques éléments lithiques ou des restes osseux animaux (fig. 100). Seules les fosses 101 et 106 n’ont fourni aucun matériel archéologique. Elles ont cependant été attribuées à cette période, d’une part, du fait de la proximité de leurs plans et profils avec les fosses datées grâce au matériel, et d’autre part, du fait de leur localisation spatiale. En effet, les fosses à fond plat 72, 73, 74, 101, 102, 104, 105 et 106 sont toutes localisées dans la moitié ouest du chantier et forment un alignement d’axe sud-ouest/nord-est. La structure 65, quant à elle, se situe dans le quart sud-est de la zone fouillée.
III.2.1.3. Les autres fosses
Trois fosses n’entrent dans aucun type particulier : St. 57, 97 et 100 (fig. 110 ; Pl. XXVII et XXX).Elles possèdent toutes un plan circulaire. La fosse 57 a un profil irrégulier et son comblement se compose d’une unique couche de limon lehmique brun. Le profil de la fosse 97 est, lui, en forme de cuvette et son remplissage est constitué de limon lehmique brun incluant, dans sa partie supérieure centrale, une grande quantité de torchis. Enfin, la structure 100 possède un profil complexe qui résulte sans doute d’au moins deux creusements successifs. Le profil de ce qui apparait comme le dernier creusement évoquerait le profil d’un puits, bien que la présence d’une telle structure sur le haut de la colline du
Fig. 100 : Vue de la structure 105
140
Monenberg puisse apparaitre assez étrange, d’autant plus si l’on considère la profondeur de cette fosse, relativement faible pour un tel type d’ouvrage. Toutes ces fosses ont livré du mobilier, principalement de la céramique, mais aussi quelques éléments lithiques et des os de faune. Ces structures se répartissent diversement au sein de l’emprise. La fosse 57 se trouve dans la moitié est, la 97 au centre et la structure 100 est localisé dans la moitié ouest du chantier et semble s’intégrer à l’alignement des fosses à fond plat précédemment évoqué.
III.2.2. Le mobilier de la période RSFO (IIb-IIIa)
III.2.2.1. La céramique (SGO)
Les structures présentant des caractéristiques indéniables de cette période sont au nombre de 4. Il s’agit des structures 72, 73, 100 et 105 (fig. 111). D’autres structures pourraient éventuellement se rapprocher de cette période bien que leur attribution chronologique au sein de la Protohistoire ne puisse être déterminée de façon formelle. Il s’agit des structures 51, 57, 65, 74, 97, 100, 102 et 104 (fig. 111). Dans certains cas, aucune forme caractéristique n’a pu être distinguée, mais une parenté avec les ensembles 73 et 105 peut être envisagée grâce notamment à la qualité de la pâte. En effet, certains types de pâte employés pour la confection du mobilier issu de ces structures sont proches de ceux issus des structures citées précédemment, notamment en ce qui concerne le dégraissant de quartz.
III.2.2.1.1. Typologie
Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes appuyés à la fois sur une classification mise en place lors de l’étude du mobilier céramique du Bronze final des sites de Sierentz
Fig. 101 : Typologie céramique du Bronze final
Ecuelles à panse rectiligne (ou écuelle troncônique)
Ecuelles à panse arrondie
Bol ou tasse
Gobelet à panse simple
Gobelet à panse complexe (carène ou épaulement)
Vase bicônique
Vase à épaulement
Pot globulaire à encolure plus ou moins développé
Pot ovoïde à encolure plus ou moins développé
FO
RM
ES
BA
SS
ES
À C
OR
PS
SIM
PL
E
FO
RM
ES
BA
SS
ES
À C
OR
PS
CO
MP
LE
XE
FO
RM
ES
HA
UT
ES
À G
RA
ND
VO
LU
ME
GO
BE
LE
TS
1
2
3
3
4
5
6
a
b
c
a
b
Type UMR n°1100 A
Type UMR n°1100 B
Type UMR n°6210 ou 6220 A
Type UMR n°6210 ou 6220 B
Type UMR n°2200 C
141
Zac Hoell156, complétée avec les données du site de Colmar Jardin des Aubépines157, mais également sur des travaux non publiés de Jean-Jacques Wolf concernant le site de Uffheim Niedere Linsenberg158 distant d’à peine 2 km du site de Sierentz. (L’abréviation NP, non présent, signifie qu’aucun exemplaire de ce type n’a été reconnu dans les structures étudiées) (fig. 101)
TYPE 1. Les écuelles L’écuelle est un récipient de forme basse clairement ouverte, à corps simple. Sa définition est fondée sur des critères dimensionnels : le diamètre d’ouverture est égal à une valeur de 2,5 à 5 fois la hauteur159. Elles ont un profil plus ou moins arrondi ou rectiligne. Contrairement aux périodes postérieures, les écuelles sont confectionnées dans une pâte de facture fine ou semi-fine.Les bols,s quant à eux, sont caractérisés par leur dimension modeste ainsi que par des bords plus ou moins verticaux et non biseautés. Les exemplaires munis d’anses peuvent être qualifiés de tasses. 1.a. Ecuelle à profil rectiligne ou écuelles coniques 1.b. Ecuelle à profil arrondie (NP) 1.c. Bols ou tasses (NP)
TYPE 2. Les gobelets Ce type de récipient peut être divisé en nombreuses variantes. Ils peuvent présenter des profils ouverts ou légèrement fermés selon les cas, mais possèdent certaines caractéristiques qui leur sont communes : la très bonne qualité de leur facture, leur éventuel décor fin et soigné, et enfin leur modeste gabarit (un gobelet peut être tenu dans une seule main). Ces entités particulières font par conséquent l’objet d’une classification qui leur est propre. D’une manière objective, nous avons séparé les gobelets en deux groupes distincts : 2.a. Gobelet à profil simple (NP) 2.b. Gobelet à profil segmenté (carène ou épaulement)
TYPE 3. Les vases biconiques Ces vases se distinguent par leur forme basse associée à une carène plus ou moins marquée située sur la partie médiane ou inférieure de la panse.
TYPE 4. Les vases à épaulement Ces récipients, dont le gabarit est souvent proche de celui des vases biconiques (Type 3) se distinguent de ceux-ci par un ressaut (épaulement) plus ou moins marqué situé sur la partie médiane ou inférieure de la panse.
TYPE 5. Les grands pots globulaires Cette catégorie contient tous les récipients globulaires de forme haute clairement fermée dont le bord possède une encolure plus ou moins développée. La pâte est généralement de facture grossière.
TYPE 6. Les grands pots ovoïdes Cette catégorie contient tous les récipients ovoïdes de forme haute clairement fermée dont le bord possède une encolure plus ou moins développée. La pâte est généralement de facture grossière.
III.2.2.1.2. Le mobilier par structure (fig. 111)
Structure 72 (fig. 102 : n°72.1) La structure 72 a livré 47 tessons très finement fragmentés. Tous semblent appartenir à un même individu de type 2b (gobelet à profil segmenté). Ces fragments étant très mal 156 Roth-Zehner et al. 2007157 Roth-Zehner et al. 2008158 Wolf 1989159 Balfet 1983
142
ST. 73
ST. 72
1
4
2
3
1
Echelle : 1 / 2
0 5cm
Echelle : 1 / 2
0 5cm
Echelle : 1 / 3
0 5cm
Fig. 102 : Matériel céramique des structures 72 et 73
143
ST. 73
ST. 72
1
4
2
3
1
Echelle : 1 / 2
0 5cm
Echelle : 1 / 2
0 5cm
Echelle : 1 / 3
0 5cm
1
3
4
2
5
ST. 105
Echelle : 1 / 2
0 5cm
Fig. 103 : Matériel céramique de la structure 105
144
ST. 65
Echelle : 1 / 2
0 5cm
ST. 97
ST. 100
1
1 2
1 2
3
paroi interne
Fig. 104 : Mobilier céramique des structures 65, 97 et 100
145
conservés, le profil archéologiquement complet n’a pas pu être déterminé. Les fragments pertinents ont néanmoins permis d’envisager un récipient de taille modeste et de forme piriforme proche de l’exemplaire 73.2. En ce qui concerne le décor, trois éléments ont pu être distingués. Une série d’au moins 3 paires de filets horizontaux réalisés à l’aide d’un peigne métallique sur la partie supérieure de la panse, Une série de cannelures placées au-dessus de la carène, Une frise de courtes incisions obliques (au peigne métallique) situées immédiatement sous la dernière cannelure. Ces décors rappellent fortement ceux présents sur l’exemplaire de la structure 105 (cannelure et incisions obliques) ainsi que ceux de la structure 73 (filets horizontaux). Ces occurrences nous permettent donc d’envisager une contemporanéité probable entre ces trois structures.
Structure 73 (fig. 102 : n°73.1, 2 et 3) Cette fosse a livré un bel ensemble de 3 récipients complets ou archéologiquement complets. D’une part, deux gobelets à profil segmenté (Type 2b) ainsi qu’un pot de dimension plus importante à profil ovoïde et à col peu développé (Type 6). - 73.1 Il s’agit d’un gobelet à profil segmenté de 11,5 cm de haut. Il a été découvert entier et non fragmenté au sein de la structure. Le diamètre de l’ouverture s’élève à 7,5 cm tandis que celui au niveau de l’épaulement accuse une dimension de 11 cm. La pâte de couleur gris-noir est de facture semi-fine à fine et le dégraissant n’a pas pu être déterminé hormis des microtraces de mica. L’objet présente également une carène relativement marquée à environ 5 cm de la hauteur. Notons enfin l’absence d’assise au niveau du fond procurant à l’objet une instabilité importante. Le décor, simple, est composé d’une part de filets horizontaux (réalisés au peigne métallique) situés sur la partie supérieure du récipient. Un premier groupe, composé de 3 filets parallèles se développe entre 2,5 et 3,3 cm sous le bord. Un second groupe de 4 filets, situé à environ 2,2 cm sous le premier, se développe, quant à, lui juste avant l’importante inflexion due à la carène. D’autre part, on observe de très fines incisions obliques régulières au niveau de cette carène. Comme nous l’avions souligné plus haut, ces caractéristiques décoratives se retrouvent sur l’exemplaire retrouvé fragmenté dans la structure n°72 (cf. 72.1). Enfin, nous pouvons signaler la présence d’une trace d’impact ancienne. Celle-ci, située sur la partie inférieure de la panse, n’a pas nui à l’intégrité physique de l’objet.
- 73.2 Ce gobelet, de même type que l’exemplaire précédent, a été retrouvé fragmenté, mais il a néanmoins fait l’objet d’un remontage nous permettant d’appréhender l’ensemble de son profil. Le diamètre de l’ouverture est de 6 cm pour une hauteur totale du vase de 9 cm. Ce récipient présente également une carène (cependant moins marquée que 73.1) dont le diamètre maximal se rapproche de 8,5 cm. Contrairement au premier gobelet découvert dans cette fosse, ce récipient présentait une assise stable constituée d’un fond plat de 2,5 cm environ. Pour le décor, on observe d’une part une série de 8 filets horizontaux réalisés au peigne métallique et regroupés par paire. Ces dernières se développent de manière régulière sur la partie supérieure de la panse entre 1,2 et 3 cm sous le bord. D’autre part, en dessous de celles-ci, on observe six cannelures fines et régulières disposées sur la partie de la panse précédant la carène.
ST. 65
Echelle : 1 / 2
0 5cm
ST. 97
ST. 100
1
1 2
1 2
3
paroi interne
146
- 73.3 Ce récipient a lui aussi été retrouvé fragmenté, mais en place au sein de la structure. Il est archéologiquement complet. Il s’agit d’un pot de profil ovoïde présentant un col court. Son diamètre à l’ouverture oscille entre 14 et 15 cm pour une hauteur totale de 16 cm. Sa pâte, de facture grossière est dégraissée à l’aide d’éléments de chamotte et de mica. Le seul décor présent est une série d’impressions triangulaires franches disposée en ligne à la jonction du col et de la panse.
- 73.4 Cet objet en terre cuite massif est de forme circulaire et présence un diamètre de 12 cm. Au centre de celui-ci, une perforation de 4 ,5 à 5 cm de diamètre est à signaler. Il s’agit probablement d’un peson destiné à une activité de tissage. Une observation anecdotique est encore à signaler : la perforation centrale permet d’épouser parfaitement le fond apode du vase 73.1. Peut-être que cet objet circulaire servait d’assise à ce dernier. Cependant, sa position au sein de la structure ne permet pas de confirmer cette hypothèse, qui reste toutefois envisageable.
Structure 105 (fig. 103) Cette fosse a livré un bel exemple de dépôt de récipients complets. Il s’agit de 4 écuelles réalisées dans une pâte semi-fine à fine provenant très probablement d’un même « service ».Ces récipients font partie des écuelles à profil. Trois d’entre elles (n° 105.1, 3 et 4) possèdent une série de cannelures sur leur surface interne alors qu’une seule présente un décor au niveau du bord intérieur (n°105.4). Ce décor consiste en une frise de triangles incisés présentant une alternance continue de 3 triangles hachurés et 3 triangles vides. Les incisions contiennent d’erratiques traces de pâte blanche. En outre, le remplissage de cette fosse a également livré des fragments d’un gobelet (panse et fond) à épaulement marqué (profil anguleux) associant un décor au peigne et des cannelures (n°105.5), tout comme l’individu de la fosse 73 : n°73.2. La présence de cet élément commun permet donc d’affilier les deux fosses au sein du même horizon chronologique.
Structure 51 Cette structure a livré 17 fragments de céramique, dont 2 fragments de bord non déterminable. Un tesson de bord doit cependant attirer notre attention. Il s’agit d’un petit fragment d’un récipient fermé à la surface externe lissée. Un décor d’incisions linéaires parallèles ainsi que de petites impressions circulaires vient rehausser l’ensemble. Notons que les motifs sont incrustés de pâte blanche. La taille conservée du tesson ne permet pas d’appréhender le motif décoratif dans son ensemble. Tout au plus pouvons-nous affirmer qu’il s’agit d’une partie d’un motif géométrique complexe que l’on retrouve communément dans les ensembles RSFO (bronze final IIb/IIIa) dans nos régions.
Structure 57 La structure 57 a livré 70 tessons de céramique et ne possède aucune forme typologiquement identifiable. En effet, aucun bord ni fragment de panse pertinent (décor) n’y a été découvert.
Structure 65 (fig. 104, n°65) Cet ensemble a livré 46 tessons. Parmi eux, seul un élément formel peut être évoqué : un bord d’une urne à col oblique.
Structure 97 (fig. 104, n°97) La structure 97 n’a livré que 6 tessons, dont 2 fragments de panses portant une anse complète provenant de deux récipients différents. La présence de cette paire d’éléments de préhension exclut d’emblée une appartenance aux périodes postérieures au Bronze final. En revanche elles ont leur place au sein d’ensemble du Bronze final IIb/IIIa ou antérieure.
147
Structure 100 (fig. 104, n°100) La structure 100 a livré un ensemble de 42 tessons au sein desquels 4 individus ont pu être formellement identifiés. Il s’agit en premier lieu de 3 écuelles tronconiques présentant chacune une surface interne soignée et lustrée. L’une d’entre elles (100.2) présente une double ligne brisée (zigzag) rehaussant le rebord intérieur. Le dernier individu reconnu est un pot présentant une encolure quasi verticale ainsi qu’une lèvre légèrement éversé. La présence des écuelles tronconiques (forme, dimension et qualité de pâte) rappelle fortement celles issues de la structure 105. Le décor en zigzag est fréquent sur les récipients ouverts (écuelles, assiette) du Bronze Final IIb/IIIa. L’individu 100.3 à encolure haute verticale conforte également la datation au sein du Bronze Final IIb/IIIa (persistance de formes plus anciennes).
III.2.2.1.3. Datation, comparaison et synthèse
Certains ensembles décrits ci-dessus peuvent être attribués de façon certaine à la période RSFO : les structures 72, 73, 100 et 105.L’ensemble du mobilier décrit dans ces structures présente une certaine homogénéité, tant sur le plan technologique que sur le plan morphologique et décoratif. En effet, les pâtes de couleur noire à grise se retrouvent en proportion majoritaire dans ces ensembles, tout comme l’utilisation d’un dégraissant micacé fin souvent associé à de fins nodules de quartz (précisons que les quelques fragments de céramique issue des structures protohistoriques plus tardives (Hallstatt D1) découvertes sur le site ne présentent pas de quartz dans leur dégraissant). Les pâtes de facture grossières sont généralement de couleur orangée à grise. Les formes identifiables ainsi que leurs décors associés, présentent également une homogénéité nous permettant de placer l’ensemble des exemplaires au sein d’un même horizon chronologique : la transition Bronze final IIb-IIIa (fig. 105).
Fig. 105 : Principaux ensembles céramiques du Bronze final IIb / IIIa de Sierentz «Les Villas d’Aurèle»
148
L’un des principaux sites de comparaison pouvant être envisagée est celui de Uffheim Niederer Linsenberg situé à 2 km de notre site et fouillé en 1972160. Ce site, vraisemblablement à connotation funéraire (dépôt de crémation), a livré un ensemble comprenant près de 145 individus céramiques de très bonne qualité, malheureusement non étudiés de manière exhaustive à ce jour. Cependant, les quelques illustrations étant à notre disposition montrent une parenté avec des ensembles de Sierentz entraînant par là même une possible contemporanéité entre les deux sites. On trouve par exemple de beaux exemplaires d’écuelles à panse rectiligne (type 1a) très comparables (dimensions, décor…) aux 4 individus issus de la structure 105. De manière plus pertinente encore, nous pouvons citer les petits gobelets à épaulement d’Uffheim présentant des profils similaires et des décors de même nature (filets horizontaux au peigne métallique, petites cannelures) à ceux présents dans la structure 73. Notons toutefois que les exemplaires d’Uffheim sont beaucoup plus nombreux et présentent par conséquent un panel morphologique et décoratif beaucoup plus large.Le mobilier des structures 73 et 105 du site de Sierentz pourrait donc s’insérer dans la typologie du site d’Uffheim Niedere Linsenberg avec les réserves dues à l’absence d’études exhaustives de ce site.Plus récemment, une nécropole à crémation établie sur le ban même de Sierentz à fait l’objet d’une opération d’archéologie préventive en 2006161. Ce site a livré 38 sépultures dont la datation s’échelonne entre la transition Bronze final Ia/IIb au Bronze Final IIIa. La sériation présentée à cette occasion nous à permis de proposer une phase haute de la transition Bronze final IIb-IIIa pour les objets du site des « Villas d’Aurèle », notamment en raison de la
160 Wolf 1972 p.29-45161 Roth-Zehner et al. 2007
Fig. 106 : Dépôt d’écuelles retournées de la structure
105 (en haut : dépôt in situ, en bas : essai de
reconstitution graphique de l’empilement)
149
forte segmentation du profil de certains gobelets (n°73.1 et 105.5) ainsi que du décor cannelé associé à des filets horizontaux réalisés au peigne métallique bifide (n° 73.2). Cette forte segmentation des gobelets est un critère d’ancienneté au sein des ensembles RSFO comme l’a déjà suggéré J.-F. PININGRE lors de sa proposition de définition du Bronze final IIb en Alsace à l’occasion du Colloque international de Nemours en 1986162. Cette idée a été confortée non seulement par l’étude du site de Sierentz ZAC Hoell en 2006, mais également à l’occasion de l’étude d’une autre nécropole à crémation haut-rhinoise située sur le site de l’usine THK à Ensisheim et dont les structures et le mobilier ont récemment fait l’objet d’une thèse163. Là, des exemplaires très proches des deux gobelets de la structure 71 ont été découverts, apparentés tant sur le plan formel que décoratif164. Ces objets apparaissent dans des structures qu’une classification sériée place dans la dernière phase d’occupation de la nécropole : le Bronze final IIb165. La structure 105 du site de Sierentz «Les Villas d’Aurèle », quant à elle, est liée chronologiquement aux structures 72 et 73 par la présence de fragments d’un de ces gobelets à forte segmentation et à décor cannelé et peigne métallique (105.5). Par ailleurs, il contient un empilement de 4 écuelles à profil rectiligne présentant pour 3 d’entre elles des cannelures internes et pour l’une d’entre elles un décor de zigzag incisé. La structure 100 contient également un fragment d’une écuelle de ce type. Ces récipients sont généralement typiques des ensembles plus tardifs (Bronze final IIIa). On en retrouve de beaux exemplaires sur le site du « Hohlandsberg » à Wintzenheim166. Elles sont également fréquentes à Colmar « Terrasse 162 Piningre 1986, p.179-191 163 Prouin 2007.1 et .2 164 Prouin 2007.2, planche 34, p.62 et planche 12, p.27 165 Prouin 2007.1., fig. 70, p. 122 166 Bonnet 1974, fig. 5 et 6, p.40-41
Fig. 107 : Dépôt céramique de la structure 73
150
du diaconat »167 où elles sont bien calées dans l’horizon Bronze final IIIa. Leur absence dans la nécropole d’Ensisheim THK168 permet également de conforter l’hypothèse d’une apparition postérieure au début du Bronze final IIb. Pour conclure nous pouvons dire que la présence conjointe au sein des 4 structures (St. 72, 73, 100 et 105) d’éléments caractéristiques du Bronze final IIb et IIIa permet une attribution chronologique à cheval entre ces deux horizons chronologiques, autrement dit une phase de transition Bronze final IIb-IIIa.Par ailleurs, le comblement de certaines structures n’a livré que très peu d’éléments caractéristiques (Structure 51, 57, 65 et 97). Leur attribution à cette phase du Bronze final reste très approximative, mais la facture indubitablement protohistorique des tessons ainsi que la présence de quartz au sein du dégraissant semble constituer une parenté potentielle avec les structures citées précédemment.
Les dépôts des structures 73 et 105 (fig. 106 et 107) Comme nous l’avons observé précédemment, les structures 73 et 105 ont livré plusieurs beaux exemplaires de récipients entiers. Le comblement de ces structures n’a rien de détritique et l’absence d’indices de crémation (os brûlés, cendre…) permet d’écarter l’hypothèse de structures funéraires à crémation. En outre, la disposition des vases au sein de leur structure respective permet de confirmer la notion de dépôt céramique volontaire. Ce type de dépôt trouve de nombreux parallèles en Alsace et dans toute l’Europe sur toute la période finale de l’Âge du Bronze. Le site très proche de Sierentz « ZAC Hoell » a livré un tel dépôt rassemblant pas moins de 16 individus déposés les uns sur les autres. Cet ensemble a pu être daté du Bronze final IIIa. Il diffère de la structure 105 de Sierentz « Les Villas d’Aurèle » par la diversité des formes qu’il contient et par l’absence d’écuelle à cannelure interne ou à décor en zigzag169. Par ailleurs nous pouvons citer l’exemple découvert à Entzheim In der Klamm (daté du Bronze Final I-IIa) qui à fait l’objet d’une publication récente170.La disposition suivant laquelle des récipients sont empilés les uns sur les autres se retrouve fréquemment pour le début et le milieu du Bronze final (Gerstheim, Entzheim etc….). L’interprétation de ces structures reste difficile. L’hypothèse la plus vraisemblable concernant le dépôt d’Entzheim est d’ordre rituel : il pourrait d’agir d’un « service à manger » déposé dans une fosse dans le cadre d’un rituel « alimentaire » qui nous échappe. Nos deux dépôts de Sierentz pourraient s’inscrire dans une telle interprétation. En effet, les récipients en question (écuelles et gobelets) représentent bien des éléments de vaisselle alimentaire.
III.2.2.2. Les objets en pierre (fig. 112)
Trois objets semblent être des fragments d’outil de mouture. Deux proviennent de la structure 97. L’un semble avoir appartenu à une probable molette tandis que l’autre serait une partie d’une meule. Tous deux ont été réalisés en grès.Le troisième élément provient de la structure 104. Tout comme le précédent il semble s’agir du fragment d’une probable meule. Cet objet se distingue toutefois des autres par la matière qui a été utilisée pour le fabriquer. Il s’agit en effet d’un bloc de «Brèche permienne» (Rotliegend-Brekzie»), type de roche dont les gisements se trouvent à Schweigmatt, dans le sud de la Forêt-Noire et que l’on retrouve dans toutes la région du coude du Rhin et du Kaizerstuhl (Fig. 108). Cette zone géographique correspond au territoire occupé par le groupe Sud à l’époque de La Tène final. Les plus anciens fragments découverts sont issus du site de Gelterkinden «Bischofsheim», en Suisse, daté de la période du Hallstatt A/B correspondant au Bronze final dans la chronologie française171. L’exemplaire de Sierentz semble cependant être le plus ancien en Alsace.
167 Maise et Lasserre 2005, Pl.7 n°114 ; Pl.10 n°213 ; Pl.17 n°461 168 Zehner et Bakaj 2001169 Roth-Zehner 2007, Vol.I, p.130-133 170 Landolt et Van Es 2009 171 Roth-Zehner 2010
151
Groupe Sud
Groupe NordGroupeAlsaceBossue
Réalisation : M. Roth-Zehner 2010
Mayence
Bâle
Schweigmatt
13
2
34 5
6
7
8
91
17
10
1112
14 15
16
1. – Schweigmatt – atelier de production, LTD-Aug. 2. – Bâle – « Gasfabrik », LTC2-D1 3. – Bâle – « Munsterhügel », LTD2-Aug. 4. – Reinach – « Brüel », Aug.-Tibère5. – Gelterkinden – « Bischofsheim », Hallstatt A/B (Bronze final) 6. – Waldenburg – « Gerstelfluh », LTD7. – Bern – « Engelhalbinsel », LTD 8. – Zurich, La Tène 9. – Sierentz – « Landstrasse/Sandgrube », LTD1b-D2
10. – Sausheim – « Rixheimerfeld », LT D2 11. – Illfurth – "Buergelen", Hallstatt D1-D3 12. - Ehrenstetten – « Kegelriss », LT D213. – Lehen – « Lehener Berg », LTD1 14. – Breisach – « Hochstetten », LTD1 15. – Colmar-Houssen – « Gravière/Base de Loisirs », LTC2-D2 16. – Sasbach – « Limberg », LT D2 17. – Meistratzheim – « Pfett », LT D2b-Aug. 18. – La Wantzenau – « Kirchacker », LTD2.
Fig. 108 : Carte de répartition des meules en «brèche permienne»
152
Les objets en pierre comprennent aussi deux éléments de calcaire issus des structures 51 et 65. Il s’agit d’un fragment de bloc et d’une lamelle, tous les deux chauffés et portant des traces de débitage.
Enfin, un galet provenant de la fosse 100, semble chauffé et présentent des traces de piquetage.
III.2.2.3. Le métal (fig. 112)
Un unique objet en métal a été mis au jour dans la structure 105. Il s’agit d’un petit rivet en alliage cuivreux possédant une tige aplanie à son extrémité et une tête légèrement bombée.
III.2.2.4. La faune (fig. 113)
Sept structures ont livré des restes de faunes : St. 51, 57, 65, 73, 89, 100 et 104. Ces restes ont fait l’objet d’une étude plus précise, disponible dans l’annexe III. Le silo 89 se détache plus particulièrement par le nombre de reste important qui y a été mis au jour. D’une manière générale, les principales espèces représentées (en nombre de restes) sont le lièvre, le chien et le bœuf.
III.2.3. Discussion
L’occupation de Sierentz au Bronze final IIb se matérialise par un ensemble de structures fossoyées composé principalement de silos et de fosses à fond plat, majoritairement localisés
072 073
074
102104
105
0 50 m
Fig. 109 : Répartition du mobilier céramique dans les structures du Bronze final IIb / IIIa
153
dans la moitié ouest de la surface fouillée. Une organisation spatiale particulière se dégage en ce qui concerne les fosses à fond plat. Celles-ci sont en effet alignées sur près de 65 m, selon un axe sud-ouest/nord-est. On remarque aussi que ce sont ces structures qui ont livré les principaux éléments céramiques ayant permis d’établir la datation (fig. 109), la plupart ayant fait l’objet d’un dépôt volontaire sur le fond de ces structures. S’il semble possible de qualifier cette occupation d’habitat, il est néanmoins difficile de préciser sa nature précise.
154
N° d
e St
ruct
ure
Type
Plan
Prof
ilO
rient
atio
nR
elat
ions
Long
ueur
(m
.)La
rgeu
r (m
.)D
iam
ètre
(m.)
Prof
onde
ur
(m.)
Rem
plis
sage
Phas
ePl
anch
e
1VP
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
0,74
-lim
on le
hmiq
ue b
run
IXX
VI51
SIC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1,
90,
7lim
on le
hmiq
ue b
run
à br
un fo
ncé
IIb /
IIIa
XXVI
I57
FSC
ircul
aire
irrég
ulie
r -
- -
-1,
450,
5lim
on le
hmiq
ue b
run
com
pact
et h
étér
ogèn
eIIb
/ III
aXX
VII
65FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
2,75
2,55
-0,
8lim
on le
hmiq
ue a
vec
poch
e de
loes
sIIb
/ III
aXX
VIII
72FS
oval
efo
nd p
lat
- -
- -
1,3
0,15
limon
lehm
ique
bru
n , c
ompa
ct, h
étér
ogèn
eIIb
/ III
aXX
VIII
73FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,5
0,3
limon
lehm
ique
bru
n , c
ompa
ct, h
étér
ogèn
eIIb
/ III
aXX
VIII
74FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,2
0,15
limon
lehm
ique
bru
n cl
air
IIb /
IIIa
XXIX
89SI
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,5
1,5
limon
lehm
ique
bru
n , l
imon
loes
siqu
e br
un c
lair
IIb /
IIIa
XXIX
97FS
Circ
ulai
reen
cuv
ette
- -
- -
1,9
0,25
limon
lehm
ique
bru
n IIb
/ III
aXX
X10
0FS
Circ
ulai
reirr
égul
ier
- -
- -
1,55
1,2
limon
lehm
ique
bru
n, q
uelq
ues
char
bons
IIb /
IIIa
XXX
101
FSC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1,
150,
25lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
IIb /
IIIa
XXXI
I
102
FSC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1,
250,
55lim
on le
hmiq
ue b
run
avec
que
lque
s po
ches
de
loes
sIIb
/ III
aXX
XII
104
FSO
vale
fond
pla
tN
/S -
1,15
0,9
-0,
08lim
on le
hmiq
ue b
run
IIb /
IIIa
XXXI
I10
5FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,2
0,28
limon
lehm
ique
bru
n, m
eubl
eIIb
/ III
aXX
XII
106
FSC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1,
10,
3lim
on le
hmiq
ue b
run
IIb /
IIIa
XXXI
I
Fig. 110 : Inventaire des structures du Bronze final
155
Prof
il co
mpl
etBo
rdPa
nse
Fond
Nb
Tess
ons
Gro
ssiè
reSe
mi-f
ine
Fine
Cou
leur
Cham
otte
Mic
aQ
uart
zin
visib
leTy
pe
Sous
-ty
peØ
ouv
ertu
re
(cm
)H
aute
ur
(cm
)1
1.1
1x
xx
279
xgr
is-no
irex
xgr
and
vase
de
stoc
kage
. Pât
e tr
ès fr
uste
, dég
raiss
ant t
rès g
ross
ier
5151
.11
x1
xbr
unx
x61
2051
51.2
1x
1x
brun
xx
1100
B51
51.3
x1
xno
irx
xun
e in
cisio
n +
petit
s cer
cles
impr
imés
, le
tout
reha
ussé
de
blan
c (p
hoto
)51
51.4
x13
xx
diffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
non
pertin
ente
s
5757
.1x
12x
gris-
oran
gée
xx
diffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
non
pertin
ente
s
5757
.2x
15x
gris-
noire
xx
diffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
non
pertin
ente
s57
57.3
x5
xor
ange
cla
irx
xdiffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
non
pertin
ente
s
5757
.4x
13x
noire
-or
angé
ex
xx
diffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
non
pertin
ente
s
5757
.4x
25x
noire
xx
diffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
non
pertin
ente
s (gr
osse
s inc
lusio
ns d
e dé
grai
ssan
t… u
n pe
u m
ême
type
de
pâte
que
le v
ase
001)
6565
.11
x3
xx
xx
frag
men
t de
bord
pré
sent
ant u
ne e
ncol
ure
mar
quée
. App
arte
nant
à u
n ré
cipi
ent d
e ty
pe 6
210
ou
6220
(disti
nctio
n im
poss
ible
). Lo
calis
ation
: 1
6565
.2x
17diffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
(loc
alisa
tion
: 1)
6565
.3x
26diffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
(loc
alisa
tion
: 2)
7272
.11
xx
47x
roug
e-or
angé
ex
Gobe
let à
épa
ulem
ent.
Dim
ensio
ns in
déte
rmin
ées.
Déc
or fi
n au
pei
gne
et c
anne
lure
s.
7373
.11
xx
noire
x7,
511
,5Go
bele
t à é
paul
emen
t apo
de. D
écor
fin
au p
eign
e73
73.2
1x
38x
gris-
noire
x6
9Go
bele
t à é
paul
emen
t. Dé
cor fi
n au
pei
gne
et c
anne
lure
s
7373
.31
x48
xbr
un-g
risx
x62
20B
14,5
16Po
t ovo
ïde.
Déc
or :
frise
liné
aire
d'im
pres
sions
tria
ngul
aire
s fra
nche
s sur
la p
artie
supé
rieur
e de
la
pans
e73
73.4
0x
oran
gePe
son
mas
sif c
ircul
aire
en
terr
e cu
ite
7373
.50
x72
xx
noire
à
oran
gée
xx
xx
Tess
ons d
e pa
nses
non
iden
tifiab
les.
Dég
raiss
ant g
ross
ier.
Prés
ence
de
cara
mel
s alim
enta
ires.
7474
.10
x10
4x
xgr
ise à
x
xx
Tess
ons d
e pa
nses
non
iden
tifiab
le d
e fa
ctur
e pr
otoh
istor
ique
8989
.11
x1
xor
angé
ex
xx
frag
men
t de
bord
à e
ncol
ure
très
mar
quée
8989
.20
x11
xor
angé
ex
xx
diffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
9797
.11
x2
xor
angé
xx
xfr
agm
ent d
e pa
nse
port
ant u
ne a
nse
appa
rten
ant à
un
gobe
let o
u ta
sse
ansé
e
9797
.22
x1
xor
angé
xx
frag
men
t de
pans
e po
rtan
t une
ans
e ap
part
enan
t à u
n go
bele
t ou
tass
e an
sée
9797
.30
x3
xgr
is cl
air
diffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
100
100.
11
X2
Xgr
is-or
angé
eX
1300
B2
frag
men
ts d
'écu
elle
tron
coni
que
à re
bord
100
100.
21
X1
xgr
is cl
air
x13
00B
1 fr
agm
ent d
'écu
elle
tron
coni
que
à re
bord
. Le
rebo
rd e
st re
haus
sé d
'un
déco
r com
posé
de
deux
lig
nes b
risés
inci
sés p
aral
lèle
s. L
a su
rfac
e in
tern
e es
t lus
trée
.10
010
0.3
1X
3x
gris
clai
rx
x19
3 fr
agm
ent d
e po
t à e
ncol
ure.
Typ
e 62
10 o
u 62
20 (d
istinctio
n im
poss
ible
)10
010
0.4
1X
2x
noire
x13
00B
2 fr
agm
ents
d'é
cuel
le tr
onco
niqu
e à
rebo
rd. S
urfa
ce in
térie
ure
lust
rée.
100
100.
5X
1x
oran
gée
clai
rx
xfr
agm
ent d
e an
se "r
uban
" ass
ez fi
ne. R
écip
ient
de
type
"gob
elet
"
100
100.
6or
angé
e cl
air
frag
men
t de
fusa
ïole
100
100.
7X
33
102
102.
10
x3
xno
ire à
or
angé
ex
xx
Tess
ons d
e pa
nses
non
iden
tifiab
le d
e fa
ctur
e pr
otoh
istor
ique
104
104.
10
x39
xor
angé
ex
xx
Tess
ons d
e pa
nses
non
iden
tifiab
le d
e fa
ctur
e pr
otoh
istor
ique
105
105.
11
x6
xno
irex
1100
B22
6,5
Ecue
lle à
par
oi re
ctilig
ne. S
urfa
ce e
xter
ne b
rute
. Sur
face
inte
rne
soig
née
et li
ssée
. Can
nelu
res
inte
rnes
.
105
105.
21
x63
xro
uge-
noire
x11
00B
207
Ecue
lle à
par
ois r
ectil
igne
. Sur
face
ext
erne
bru
te. S
urfa
ce in
tern
e lé
gère
men
t soi
gnée
. Cro
ix
traç
ée d
ans l
a m
asse
sur l
e fo
nd e
xter
ne.
105
105.
31
x52
xro
uge-
noire
x11
00B
217,
5Ec
uelle
à p
aroi
s rectil
igne
. Sur
face
ext
erne
bru
te. S
urfa
ce in
tern
e lé
gère
men
t soi
gnée
. Can
nelu
res
inte
rnes
105
105.
41
x51
xro
uge-
noire
x11
00B
175
Ecue
lle à
par
ois r
ectil
igne
. Sur
face
ext
erne
bru
te. S
urfa
ce in
tern
e so
igné
e. F
rise
de tr
iang
les
(hac
huré
s ou
vide
s) ré
haus
sée
de p
âte
blan
che
sur l
e m
épla
t du
rebo
rd in
tern
e.
105
105.
51
xx
25x
brun
-gris
xx
Gobe
let à
épa
ulem
ent.
Dim
ensio
ns in
déte
rmin
ées.
Déc
or fi
n au
pei
gne
et c
anne
lure
s.
N°
Inve
ntai
re
Dim
ensi
ons
Des
crip
tion
Stru
ctur
eN
MI
Tess
ons
Fact
ure
Dég
rais
sant
Type
UM
R
Fig. 111 : Inventaire de la céramique de l’Age du Bronze (SGO)
156
L. l. Ep.Grès 97 97.4 12,4 14,4 6,5 Fragment d'outil de mouture (molette ?). Surface supérieur piqueté.
Grès 97 97.5 18,5 18 5Fragment d'outil de mouture (meule ?). Surface supérieur piqueté et usée. Porte de nombreuse petites "cuvettes" pouvant etre d'origine naturelle (inclusions dispariue) ou anthropique (aiguisage). Certaines de ces cuvette semblent en effet avoir été obtenu par abrasion rotative.
Brêche permienne 104 104.2 23,5 18,5 5,5 Fragment d'outil de mouture (meule ?).
Calcaire 51 51.5 2,8 2,3 0,5 Fragment de calcaire chauffé portant des traces de débitage. Couleur bleu sombre.Calcaire 65 51.4 5,4 1,7 0,5 Lamelle en calcaire chauffé. Trace de débitage. Couleur bleu sombre.
Galet 100 51.8 9 7,5 5 Galet chauffé avec traces de piquetage
Mét
al
All. Cu 105 105.6 1,4 - - Petit rivet . Tige aplani a son extrémité, tête légerement bombée. Ø tête = 0,8 cm ; Ø tige : 0,25.
Description
Out
illag
e de
m
outu
reD
iver
s pi
erre
Nature Structure N° d'inventaire
Dimension (cm.)
Fig. 112 : Inventaire du mobilier lithique et métallique de l’Age du Bronze
StructureEspèces 51 57 65 73 89 100 104 Total
Boeuf 11 3 1 15Capriné 3 4 7Chèvre 1 1
Porc 1 2 3Cheval 1 1Chien 1 15 2 18Lièvre 1 70 71
Petit mammifère 1 1 1 3Grand mammifère 1 2 3
Indet. 2 2 2 6Total général 19 7 5 1 85 10 1 128
Fig. 113 : Inventaire des restes animaux présents dans les structures de l’Age du Bronze (LB)
158
984
000
307 000
306 900
985
000
0 25 m
Les n° de structure entre parenthèses et en italiquerenvoient à la numérotation du diagnosticHallstatt D1
66
56 (FS 106)
44
108
71
109
Fig. 114 : Localisation des structures Hallstatt
159
III.3. LE HALLSTATT D1
III.3.1. Les structures
Quatre structures sont attribuées à la période Hallstatt D1 (fig. 114 et 120) : St. 56, 71, 108 et 109 (Pl. XXXIII à XXXVI). Deux autres pourraient également faire partie de l’ensemble (St. 44 et 66) sans toutefois pouvoir l’affirmer de manière nette et pertinente.
Les structures 44, 56, 108 et 109 (fig. 120 ; Pl. XXXIII, XXXV et XXXVI) sont des fosses dont les plans sont pour la plupart ovales ou circulaires. La fosse 109 possède un plan quadrangulaire, aux angles arrondis. En coupe, elles présentent des parois subverticales et des fonds plats. La structure 66, elle, possède un profil convexe. Le remplissage de quasiment toutes ces structures se compose d’une couche de limon lehmique brun avec parfois des poches de loess remanié. La fosse 44 possède toutefois un comblement plus complexe qui peut être décomposé en trois grandes étapes. Dans un premier temps, une couche de limon lehmique brun semble s’être déposée dans un laps de temps assez court. Dans un second temps, deux couches de loess remanié, certainement dues à un effondrement des parois, indiquent que la structure est restée ouverte un certain temps. Enfin, une troisième étape correspond à une couche de limon lehmique clair qui témoigne là aussi d’un comblement terminal assez rapide. Ces différentes étapes évoquent les processus de comblement habituellement décrits pour les silos. Il se pourrait donc que cette fosse soit en réalité les restes d’un silo dont la partie supérieure aurait été détruite par les l’érosion.
La structure 71 (fig. 120 ; Pl. XXXIV et fig. 115) apparait, elle, de façon plus sûre, comme le vestige d’un silo érodé. Son plan est circulaire et son profil, tronconique à fond plat. Son remplissage se compose de trois couches. Les couches inférieures de limon loessique dont la forme évoque un dôme peuvent indiquer un comblement réalisé sur un certain temps. La couche supérieure de limon lehmique brun sombre suggère quant à elle un comblement rapide.
L’organisation spatiale de ces structures n’appelle que peu de commentaires. Elles se répartissent en effet sur l’ensemble de la surface fouillé. On peut cependant noter qu’elles
Fig. 115 : Vue en coupe de la structure 71
160
semblent fonctionner en couple, l’un près de la berme ouest (St. 44 et 71), un second au centre, près de la berme nord (St. 108 et 109) et enfin un dernier couple dans la moitié est (St. 56 et 66).
Chacune de ces structures a livré du mobilier céramique accompagné parfois d’éléments de faune ou lithique.
III.3.2. Le mobilier
III.3.2.1. La céramique (SGO)
Le corpus se compose de 388 tessons pour un nombre minimum d’individus qui s’élève à 19 dont 12 ont pu être typologiquement identifiés (fig. 121).
III.3.2.1.1. Typologie
La typologie utilisée ne sera pas détaillée dans cette étude. Nous nous baserons sur celle élaborée à l’occasion par l’UMR 7044 (Université de Strasbourg) dont la méthodologie est décrite par N. Tikonoff et S. Deffressigne dans une publication parue récemment172 concernant la céramique d’habitat du Premier âge du Fer (fig. 116).
172 Adam et al. 2011, p.13-20
Fig. 116 : Typologie céramique Hallstatt (en rouge : forme présente au sein des ensemble de Sierentz Les Villas d’Aurèle)
161
III.3.2.1.2. Le mobilier par structure
Structure 71 (fig. 117)
- 71.1 (type 2200B) Il s’agit d’une coupe à profil clairement sinueux dont le diamètre à l’ouverture est de 25cm pour une hauteur de 9 à 11cm. La pâte, de couleur gris-noire est fine et de très bonne qualité. Le dégraissant utilisé se compose de chamotte et de minuscules inclusions de mica. La surface interne est très soignée et lissée, contrairement à la surface extérieure brute.
- 71.2 (type 2100A) Cette coupe présente une panse carénée avec une partie supérieure verticale. La lèvre, non éversée, se situe dans le prolongement de la panse. La pâte noire, également de bonne qualité est très proche de celle de 71.1 avec son dégraissant finement micacé additionné de chamotte. Ses dimensions accusent un diamètre d’ouverture de 18cm pour une hauteur de 7.5 cm (seul exemplaire archéologiquement complet de la structure 71).
- 71.3 (type 2200A) Ce récipient est une coupe fermée à panse arrondie. La petite lèvre est nettement éversée. La pâte de très bonne qualité est fine et seules quelques inclusions de mica y sont discernables. L’ensemble de la surface externe a bénéficié d’un traitement d’aplat au graphite recouvrant. Le diamètre à l’ouverture est de 18cm, la hauteur n’ayant pu être déterminée.
- 71.4 et 5 (type 1100A) Ces deux récipients, de même type, sont des jattes grossières dont les dimensions n’ont pas pu être déterminées. La surface extérieure de l’une d’entre elles (71.4) présente des incisions obliques non profondes. Il ne s’agit pas là d’un décor, car ce type de récipient ne présente jamais de décor extérieur ; mais sans doute s’agit-il plutôt d’une éraflure accidentelle ancienne.
- 71.6 (type 2200A) Il s’agit d’une coupe ouverte à panse arrondie dont la lèvre présente est légèrement éversée. La pâte est semi-fine et présente une coloration gris-noire.
- 71.7 (type 5200) C’est un pot à profil simple avec une légère encolure induite par un éversement du bord. La lèvre est ondulée et la partie supérieure de la panse est décorée d’une frise linéaire de légères digitations à peine perceptibles. La pâte noire-orangée est de facture grossière et le dégraissant utilisé est à base de chamotte principalement.
- 71.8 Il s’agit d’un fragment d’amorce d’un fond de récipient perforé de facture grossière. Les perforations sont réalisées de l’extérieur vers l’intérieur. Ce type de récipient se retrouve fréquemment sur des sites de l’époque protohistorique et peut être interprété comme de la vaisselle culinaire de type faisselle.
- 71.9 (type 5100) Ce récipient également de facture grossière est un pot à profil simple sans encolure. Il possède une lèvre éversée et ondulée. La partie supérieure de la panse est rehaussée d’un cordon saillant marqué d’une frise de franches incisions obliques.
Structures 56 La structure 56 a livré 11 tessons au total. Un fragment de panse fine présente une surface externe rehaussée d’un aplat de graphite. La morphologie du tesson pourrait correspondre à un récipient de type 2100 A (coupe à paroi supérieure verticale).
162
ST. 71 Aplat graphite
Echelle : 1 / 2
0 5cm
1
2
3
4
5
6
78
9
Fig. 117 : Matériel céramique de la structure 71
ST. 108
Echelle : 1 / 2
0 5cmST. 109
1
1
2
2
3
3
164
Un autre élément particulier est à mentionner : il s’agit d’un fragment de panse portant un cordon digité. La forme du récipient n’est pas déterminable, mais il pourrait appartenir à une urne de type 6120 (urne à encolure plus ou moins développée). En effet une légère amorce de col est perceptible sur le tesson. Ces différents éléments impliquent une datation analogue à celle de la structure 71. En effet, l’aplat de graphite ainsi que la présence de coupe à paroi supérieure verticale sont des éléments favorisant une datation au Ha C/D1, tout comme le cordon appliqué à la jonction col/panse.
Structure 108 (fig. 118)
- 108.1 (type 2100 A) Cet individu est représenté par un tesson comportant une partie du bord ainsi que la panse. Il se réfère à la forme 2100 A (coupe à profil supérieur vertical). Le diamètre à l’ouverture est de 20 cm. Bien que le fond ne soit pas présent, la hauteur du récipient peut être estimée à 8 ou 9 cm. La pâte semi-fine est dégraissée à l’aide d’un mélange de chamotte et de mica.
- 108.2 (type 2100 A) L’individu 108.2 se présente sous la forme d’une coupe à profil très légèrement sinueux. En effet, la paroi de la panse (très légèrement bombée) se termine dans sa partie supérieure par une faible rupture de pente sous le bord procurant à l’ensemble une sinuosité perceptible. Le diamètre a pu être estimé à près de 18cm. La pâte fine présente un dégraissant de chamotte et de mica tout comme l’individu précédent.
- 108.3 (type indéterminé : 6200 ou 2300 ?) Ce petit fragment de bord correspond à un col d’un petit récipient de type urne à col oblique. Cependant, la finesse de la pâte pourrait davantage orienter son identification vers un récipient de type « urne basse » (type 2300), mais les éléments en présence ne permettent pas de trancher de façon définitive. La pâte est de facture très fine et le dégraissant employé (très fin lui aussi) n’est pas perceptible dans le tesson en question.
Un dernier fragment de panse peut-être évoqué : il s’agit d’un tesson issu d’une pâte grossière portant un cordon digité. La conservation de l’élément ne permet pas d’affirmer la position du cordon sur le récipient (sur la panse ou à la jonction col/panse).
Structure 109 (fig. 118)
- 109.1 (type 2200 B) Ce récipient de petite dimension peut-être attribué au type des coupes à paroi sinueux. La sinuosité n’est ici pas encore marquée de manière forte, mais le bombement de la paroi, la partie supérieure rentrante, la lèvre légèrement éversée ainsi que la finesse et la qualité de la pâte sont autant d’éléments qui procurent au petit récipient un profil particulièrement élégant. La surface externe est soignée et présente une couleur orange-claire assez particulière au sein de l’ensemble. Le dégraissant n’est pas perceptible.
- 109.2 (type 1100 A) Il s’agit d’un récipient de type jatte à profil bombé issu d’une pâte de facture grossière. Les dimensions n’ont pas pu être déterminées en raison de l’état de conservation. Le bord est arrondi et le tesson ne possède aucune autre caractéristique notable. La pâte est dégraissée à l’aide de chamotte et de mica.
Structures 66 et 44 Ces deux ensembles ne possèdent aucun élément pouvant être typologiquement
165
identifié. Toutefois la qualité des différents types de pâte présents offre des comparaisons probables avec les ensembles clairement datés du Hallstatt par ailleurs (qualité du dégraissant, pâte semi-fine et grossière facilement identifiable, teintes générales de même nature). Leur attribution à la phase du Premier Âge du Fer reste donc fortement hypothétique par manque d’indice clair.
III.3.2.1.3. Datation, comparaison et synthèse
Les différents éléments présents dans ces fosses sont suffisamment caractéristiques pour attribuer leur attribuer une fourchette chronologique assez fine. D’une part, dans la structure 71, on constate l’association d’une coupe à profil sinueux et d’une coupe à partie supérieure verticale (n°71.1 et 2) ce qui oriente la datation vers la phase Hallstatt D1/D2. Des récipients tout à fait comparables sont à signaler dans l’ensemble découvert à Brumath dont
Caractéristiques typologique et décoratives.pointe bifide
point de chaînetteméandres
cannelures internestiges creuses
graphite et autres techniques1300 B
petit mamelongraphite (en motif)
1300 Apeinture rouge et graphite
peinture rouge et autres techniquesgraphite en aplat
incisions complexespeinture rouge
7000 Bcordon pliure du col
2100 A2200 A
51002100 B
points estampés ou imprimés en registres2100 C10000
cordon sur pansecroisillons incrustés de pâte blanche
peinture rouge et blanche2200 Bpeigne
8000lignes digités multiples
2200 C1200
cannelures fines tournées9100
engobe grossier rugeux9200
cannelures larges tournées
Illfu
rth
Britz
gybe
rg
Sier
entz
SVA
10
Ha D3 LT ABF IIIb Ha C Ha D1 Ha D2
Bru
mat
h Lo
t. M
anet
Gei
spol
shei
m
Pful
grie
shei
m
Ros
heim
Mitt
elw
eg 2
Ros
heim
Mitt
elw
eg 1
Ste-
Cro
ix-e
n-Pl
aine
Hou
ssen
Col
mar
-Hou
ssen
Ling
olsh
eim
Rie
dish
eim
Har
tman
n
Rei
chst
ett -
Mun
dols
hei m
Leut
enhe
im H
exen
berg
Col
mar
Dia
cona
t
Mer
xhei
m
Bis
chof
fshe
im
Illfu
rth
Burg
elen
2
Hol
tzhe
im
Wol
fgan
tzen
Ros
heim
San
dgru
be
Illfu
rth
Burg
elen
1
Fig. 119 : Classement sérié des différents éléments de formes et de décors des ensembles hallstat-tiens en Alsace et intégration du mobilier de Sierentz (réalisé à l’aide du logiciel Past® à partir des donnés issues
de Adam et alii, à paraître, p.138)
166
la durée d’occupation s’échelonne du HaD1 au HaD2173 ou encore à Rosheim Sandgrube174, site daté quant à lui de la période HaD1. Une autre comparaison, plus proche de Sierentz peut également être évoquée : celle du site de la « Glaisière Hartmann » de Riedisheim où de beaux exemplaires de coupes de même type ont été découverts175. La datation de ce site ne dépasse pas la phase D1 du Hallstatt puisqu’une tombe, clairement datée du HaD2 venait recouper un des fossés dans lequel le mobilier céramique a été découvert. En outre, la présence d’une coupe (ou urne) entièrement graphitée (n°71.3) au sein du corpus de la structure 71 de Sierentz vient conforter la datation au HaD1 puisque le décor en aplat graphité couvrant disparaît quasi complètement dans les périodes postérieures. Cette datation au sein du Ha D1 est également appuyée par le mobilier issu des structures 108 et 109. Là aussi des associations d’éléments comme des coupes de type 2100 A et d’aplat de graphite, ainsi que la présence de coupe à parois plus ou moins sinueuses permettent d’envisager de façon certaine l’attribution chronologique au Ha D1.
En outre, les données typologiques recueillies lors de cette étude ont pu être confrontées à celles étudiées dans le cadre d’une publication très complète à paraître portant sur «La céramique d’habitat du Bronze final III à La Tène ancienne en Alsace et en Lorraine»176 concernant plusieurs ensembles pouvant être considéré comme références régionales pour la période du Premier Age du Fer. Les données de Sierentz «Les villas d’Aurèle» ont pu être intégrées au sein de la sériation réalisée à cette occasion177. Le tableau comparatif qui en résulte expose de manière concrète l’attribution Ha D1 des ensembles de Sierentz (fig. 119). Ce tableau montre de fortes similarités entre les ensembles de Sierentz et les sites de Illfurth Britzgyberg et Rosheim Sandgrube par la présence de graphite en aplat, de cordon situé sur la jonction du col et de la panse, de la présence des formes 2100 A, 2200 A et 5100 qui sont des éléments déjà présents au Ha C, mais qui perdurent en se développant surtout au Ha D1.Par contre, la présence de coupes à profil franchement sinueux (type 2200 B) dans les ensembles de Sierentz (71.1 et 109.1) ne permet pas d’évoquer le Ha C puisque ce type de récipient n’est pas présent avant le Ha D1. La pondération de ces divers éléments entraîne le classement des structures 71, 108 et 109 au sein de la période Ha D1.
III.3.2.2. Le mobilier lithique (fig. 122)
Cette catégorie de mobilier n’est représentée que par deux objets, issus des structures 108 et 109. Dans un cas, il s’agit d’un fragment d’outil de mouture en grès chauffé (108.6). Le second objet est un galet dont la face supérieure porte des traces d’usures, suggérant une éventuelle utilisation en tant qu’ «enclume».
III.3.2.2. La faune (fig. 123)
Quatre structures ont livré un total de 72 restes de faune qui ont fait l’objet d’une étude particulière dans l’annexe III. Le silo 71 a, à lui seul, fourni les trois quarts de ce total. Les espèces les plus représentées sont les caprinés, le bœuf et le cheval.
III.3.3. Discussion
La fouille de Sierentz a permis la mise au jour au moins quatre structures (peut-être six) attribuées à la période du Hallstatt D1. Il s’agit majoritairement de structure fossoyée dont la fonction reste inconnue hormis les structures 71 et éventuellement 44 qui ont pu servir de silo. Il est donc possible que nous soyons là en présence des vestiges d’un habitat (relativement discret) ou, plus probablement en bordure d’une occupation plus importante.173 Mentele et al. 2005, p.143 à 178 174 Röeder et Blanc 1995175 Goepfert 2005176 Adam et al 2011 177 Adam et al 2011, p.138
167
N° d
e St
ruct
ure
Type
Plan
Prof
ilO
rient
atio
nR
elat
ions
Long
ueur
(m
.)La
rgeu
r (m
.)D
iam
ètre
(m.)
Prof
onde
ur
(m.)
Rem
plis
sage
Plan
che
44FS
Ova
lefo
nd p
lat
N/S
-1,
651,
49 -
0,7
3 co
uche
s, li
mon
lehm
ique
bru
n cl
air à
bru
n fo
ncé,
+ lo
ess
rem
anié
XXXI
II
56FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
2,1
0,3
limon
lehm
ique
bru
n cl
air a
vec
poch
e de
loes
s, +
co
ncen
tratio
n ch
arbo
nneu
se d
ans
le fo
ndXX
XIII
66FS
Circ
ulai
reen
cuv
ette
- -
- -
0,7
0,15
limon
lehm
ique
bru
n/ja
une,
com
pact
, hét
érog
ène
XXXI
V
71SI
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
20,
8lim
on le
hmiq
ue b
run
com
pact
ave
c ch
arbo
n de
bo
is, l
oess
rem
anié
XXXI
V
108
FSO
vale
fond
pla
tN
/S -
2,65
2,2
-0,
38lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
, + lo
ess
rem
anié
XXXV
109
FSqu
adra
ngul
aire
(bor
d ar
rond
is)
fond
apl
ani
E/O
-2,
51,
85 -
0,34
limon
lehm
ique
bru
n, c
ompa
ctXX
XVI
Fig. 120 : Inventaire des structures Hallstatt
168
Prof
il co
mpl
etBo
rdPa
nse
Fond
Nb
Tess
ons
Gro
ssiè
reSe
mi-f
ine
Fine
Cou
leur
Cham
otte
Mic
aQ
uart
zin
visib
leTy
pe
Sous
-ty
peØ
ouv
ertu
re
(cm
)H
aute
ur
(cm
)
7171
.11
xx
5x
gris-
noire
xx
2200
B25
Coup
e à
profi
l sin
ueux
. Sur
face
inte
rne
soig
née,
surf
ace
exte
rne
brut
e
7171
.21
x23
xno
irex
x21
00A
187,
5Co
upe
à pa
nse
care
nnée
et p
artie
supé
rieur
e ve
rtica
le. L
a lè
vre
se
situe
dan
s le
prol
onge
men
t de
la p
anse
.
7171
.31
xx
7x
noire
xx
2200
A18
Coup
e fe
rmée
à p
anse
arr
ondi
e et
lèvr
e év
ersé
e. C
éram
ique
de
très
bo
nne
qual
itée
(fine
) don
t la
surf
ace
exte
rne
est r
ecou
vert
e d'
un
apla
t de
grap
hite
.
7171
.41
x1
xno
irex
x11
00A
Jatt
e ou
écu
elle
gro
ssiè
re à
par
ois a
rron
die.
Inci
sions
liné
aire
s ob
lique
s sur
la su
rfac
e ex
tern
e (é
raflu
res a
ncie
nnes
sans
dou
te
acci
dent
elle
s).
7171
.51
x1
xgr
is-no
irex
x11
00A
Jatt
e ou
écu
elle
à p
aroi
s arr
ondi
e.
7171
.61
x2
xgr
is-no
irex
x22
00A
Coup
e ou
vert
e à
pans
e ar
rond
ie e
t lèv
re lé
gère
men
t éve
rsée
.
7171
.71
x1
xno
ire-o
rang
éex
x52
00Po
t à p
rofil
sim
ple
à lé
gère
enc
olur
e et
lèvr
e on
dulé
e. L
a pa
rtie
supé
rieur
e de
la p
anse
est
déc
oré
d'un
e fr
ise li
néai
re d
e lé
gère
s di
gitatio
ns à
pei
ne p
erce
ptibl
es.
7171
.80
xx
1x
gris-
noire
xx
Frag
men
t per
foré
de
la p
artie
infé
rieur
e de
la p
anse
et a
mor
ce d
u fo
nd.
Perf
orati
ons r
éalis
ée d
e l'e
xtér
ieur
ver
s l'in
térie
ur (f
aise
lle).
7171
.91
x1
xno
ire-o
rang
éex
x51
00Po
t à p
rofil
sim
ple
sans
enc
olur
e et
lèvr
e év
ersé
e et
ond
ulée
. La
parti
e su
périe
ure
de la
pan
se e
st ré
haus
sé d
'un
cord
on sa
illan
t m
arqu
é d'
une
frise
de
fran
ches
inci
sions
obl
ique
s.
7171
.10
0x
40x
oran
gée
xTe
sson
s de
pans
es n
on id
entifi
able
s de
coul
eur o
rang
e vi
f. Su
rfac
e br
ute.
7171
.11
0x
7x
xgr
is-or
angé
ex
xTe
sson
s de
pans
es n
on id
entifi
able
s de
coul
eur g
ris-o
rang
é.71
71.1
20
x61
xx
gris-
noire
xx
Tess
ons d
e pa
nses
non
iden
tifiab
les d
e co
uleu
r gris
-noi
r.71
71.1
30
x45
xx
gris-
clai
rx
xTe
sson
s de
pans
es n
on id
entifi
able
s de
coul
eur g
ris c
lair.
7171
.14
4x
4x
xgr
is à
noire
xx
Grou
pe d
e 4
bord
s iso
lés m
ais n
on id
entifi
able
s.44
44.1
x3
xN
oire
xx
5,5
fond
très
légè
rem
ent c
onca
ve
5656
.1x
2x
noire
xfr
agm
ents
de
pans
e pr
ésen
tant
un
apla
t gra
phite
sur l
a su
rfac
e ex
tern
e (p
eut-
être
frag
men
t de
coup
e ty
pe 2
1 00
A)
5656
.2x
1x
roug
e-or
angé
ex
xpe
tit fr
agm
ent d
e pa
nse
port
ant u
n co
rdon
dig
ité p
lus o
u m
oins
sa
illan
t (pe
ut-ê
tre
frag
men
t d'u
rne
type
612
0)56
56.3
x1
xgr
isx
xfr
agm
ent d
e fo
nd56
56.4
x7
xdiffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
non
pertin
ente
s66
66.1
x4
xdiffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
108
108.
11
X2
Xgr
is-or
angé
ex
x21
00A
202
frag
men
ts d
e co
upe
à pr
ofil s
upér
ieur
vertic
al
108
108.
21
X1
Xbr
un-g
risx
x22
00A
181
frag
men
t de
coup
e à
pans
e ar
rond
ie e
t bor
d tr
ès tr
ès lé
gère
men
t ar
rond
ie.
108
108.
31
X1
Xno
irx
frag
men
t de
col d
'un
réci
pien
t de
type
620
0 ou
230
0 (p
eut-
être
urn
e ba
sse)
108
108.
4X
1X
noir
xx
frag
men
t de
pans
e po
rtan
t un
cord
on d
igité
(pos
ition
jonctio
n ou
pa
nse
non
déte
rmin
able
)10
810
8.5
X43
diffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nse
109
109.
11
XX
2X
oran
gex
2200
B10
frag
men
t de
coup
e à
profi
l sin
ueux
. Gal
be é
léga
nt. P
âte
très
fine
109
109.
21
X3
Xgr
is-no
irex
x11
00A
frag
men
t de
jatt
e à
profi
l arr
ondi
109
109.
3gr
is-no
irefu
saïo
le10
910
9.4
oran
gepe
son
109
109.
5x
128
diffé
rent
frag
men
t de
pans
es
Type
UM
RD
imen
sion
sN
° In
vent
aire
Obs
erva
tions
Stru
ctur
eN
MI
Tess
ons
Fact
ure
Dég
rais
sant
Fig. 121 : Inventaire de la céramique Hallstatt (SGO)
169
Prof
il co
mpl
etBo
rdPa
nse
Fond
Nb
Tess
ons
Gro
ssiè
reSe
mi-f
ine
Fine
Cou
leur
Cham
otte
Mic
aQ
uart
zin
visib
leTy
pe
Sous
-ty
peØ
ouv
ertu
re
(cm
)H
aute
ur
(cm
)
7171
.11
xx
5x
gris-
noire
xx
2200
B25
Coup
e à
profi
l sin
ueux
. Sur
face
inte
rne
soig
née,
surf
ace
exte
rne
brut
e
7171
.21
x23
xno
irex
x21
00A
187,
5Co
upe
à pa
nse
care
nnée
et p
artie
supé
rieur
e ve
rtica
le. L
a lè
vre
se
situe
dan
s le
prol
onge
men
t de
la p
anse
.
7171
.31
xx
7x
noire
xx
2200
A18
Coup
e fe
rmée
à p
anse
arr
ondi
e et
lèvr
e év
ersé
e. C
éram
ique
de
très
bo
nne
qual
itée
(fine
) don
t la
surf
ace
exte
rne
est r
ecou
vert
e d'
un
apla
t de
grap
hite
.
7171
.41
x1
xno
irex
x11
00A
Jatt
e ou
écu
elle
gro
ssiè
re à
par
ois a
rron
die.
Inci
sions
liné
aire
s ob
lique
s sur
la su
rfac
e ex
tern
e (é
raflu
res a
ncie
nnes
sans
dou
te
acci
dent
elle
s).
7171
.51
x1
xgr
is-no
irex
x11
00A
Jatt
e ou
écu
elle
à p
aroi
s arr
ondi
e.
7171
.61
x2
xgr
is-no
irex
x22
00A
Coup
e ou
vert
e à
pans
e ar
rond
ie e
t lèv
re lé
gère
men
t éve
rsée
.
7171
.71
x1
xno
ire-o
rang
éex
x52
00Po
t à p
rofil
sim
ple
à lé
gère
enc
olur
e et
lèvr
e on
dulé
e. L
a pa
rtie
supé
rieur
e de
la p
anse
est
déc
oré
d'un
e fr
ise li
néai
re d
e lé
gère
s di
gitatio
ns à
pei
ne p
erce
ptibl
es.
7171
.80
xx
1x
gris-
noire
xx
Frag
men
t per
foré
de
la p
artie
infé
rieur
e de
la p
anse
et a
mor
ce d
u fo
nd.
Perf
orati
ons r
éalis
ée d
e l'e
xtér
ieur
ver
s l'in
térie
ur (f
aise
lle).
7171
.91
x1
xno
ire-o
rang
éex
x51
00Po
t à p
rofil
sim
ple
sans
enc
olur
e et
lèvr
e év
ersé
e et
ond
ulée
. La
parti
e su
périe
ure
de la
pan
se e
st ré
haus
sé d
'un
cord
on sa
illan
t m
arqu
é d'
une
frise
de
fran
ches
inci
sions
obl
ique
s.
7171
.10
0x
40x
oran
gée
xTe
sson
s de
pans
es n
on id
entifi
able
s de
coul
eur o
rang
e vi
f. Su
rfac
e br
ute.
7171
.11
0x
7x
xgr
is-or
angé
ex
xTe
sson
s de
pans
es n
on id
entifi
able
s de
coul
eur g
ris-o
rang
é.71
71.1
20
x61
xx
gris-
noire
xx
Tess
ons d
e pa
nses
non
iden
tifiab
les d
e co
uleu
r gris
-noi
r.71
71.1
30
x45
xx
gris-
clai
rx
xTe
sson
s de
pans
es n
on id
entifi
able
s de
coul
eur g
ris c
lair.
7171
.14
4x
4x
xgr
is à
noire
xx
Grou
pe d
e 4
bord
s iso
lés m
ais n
on id
entifi
able
s.44
44.1
x3
xN
oire
xx
5,5
fond
très
légè
rem
ent c
onca
ve
5656
.1x
2x
noire
xfr
agm
ents
de
pans
e pr
ésen
tant
un
apla
t gra
phite
sur l
a su
rfac
e ex
tern
e (p
eut-
être
frag
men
t de
coup
e ty
pe 2
1 00
A)
5656
.2x
1x
roug
e-or
angé
ex
xpe
tit fr
agm
ent d
e pa
nse
port
ant u
n co
rdon
dig
ité p
lus o
u m
oins
sa
illan
t (pe
ut-ê
tre
frag
men
t d'u
rne
type
612
0)56
56.3
x1
xgr
isx
xfr
agm
ent d
e fo
nd56
56.4
x7
xdiffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
non
pertin
ente
s66
66.1
x4
xdiffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nses
108
108.
11
X2
Xgr
is-or
angé
ex
x21
00A
202
frag
men
ts d
e co
upe
à pr
ofil s
upér
ieur
vertic
al
108
108.
21
X1
Xbr
un-g
risx
x22
00A
181
frag
men
t de
coup
e à
pans
e ar
rond
ie e
t bor
d tr
ès tr
ès lé
gère
men
t ar
rond
ie.
108
108.
31
X1
Xno
irx
frag
men
t de
col d
'un
réci
pien
t de
type
620
0 ou
230
0 (p
eut-
être
urn
e ba
sse)
108
108.
4X
1X
noir
xx
frag
men
t de
pans
e po
rtan
t un
cord
on d
igité
(pos
ition
jonctio
n ou
pa
nse
non
déte
rmin
able
)10
810
8.5
X43
diffé
rent
s fra
gmen
ts d
e pa
nse
109
109.
11
XX
2X
oran
gex
2200
B10
frag
men
t de
coup
e à
profi
l sin
ueux
. Gal
be é
léga
nt. P
âte
très
fine
109
109.
21
X3
Xgr
is-no
irex
x11
00A
frag
men
t de
jatt
e à
profi
l arr
ondi
109
109.
3gr
is-no
irefu
saïo
le10
910
9.4
oran
gepe
son
109
109.
5x
128
diffé
rent
frag
men
t de
pans
es
Type
UM
RD
imen
sion
sN
° In
vent
aire
Obs
erva
tions
Stru
ctur
eN
MI
Tess
ons
Fact
ure
Dég
rais
sant
L. l. Ep.Grès 108 6 17 16 9 Fragment d'outil de mouture chauffé.
Galet 109 6 10,5 9 2,5 Galet portant des traces d'usure sur sa face supérieur plane. Probablement une sorte d' "enclume".
Nature Structure N° d'inventaire
Dimension (cm.)Description
Fig. 122 : Inventaire du mobilier lithique des structures Hallstatt
StructureEspèces 56 71 108 109 Total
Boeuf 1 8 1 10Capriné 14 1 15Mouton 2 2Chèvre 1 1
Porc 2 2Cheval 9 1 10Chien 1 1Cerf 3 1 4
Petit mammifère 2 9 11Grand mammifère 1 4 1 6
Indet. 10 10Total général 13 55 1 3 72
Fig. 123 : Inventaire des restes animaux présents dans les structures Hallstatt (LB)
170
984
000
307 000
306 900
985
000
0 25 m
Les n° de structure entre parenthèses et en italiquerenvoient à la numérotation du diagnosticStructures protohistoriques
indéterminée
136
119
Fig. 124 : Localisation des structures de l’époque protohistorique indéterminée
171
III.4. LA PROTOHISTOIRE INDETERMINEE
Deux structures (St. 119 et 136) sont attribuées à la période protohistorique bien que leur datation n’ait pu être précisée (fig. 124 et 126).
La structure 119 (Pl. XXXVII) est un silo tronconique qui est recoupé par une fosse en cuvette (St. 142) (fig. 126). Son remplissage est principalement constitué d’un litage de couches de limon lehmique et de limon loessique. Sur le fond, une couche de limon lehmique brun forme un petit dôme. Ce type de comblement indique un processus de remplissage naturel. Cette structure a été attribuée à la protohistoire, car, statistiquement, les silos tronconiques de ce type appartiennent à cette période.
La fosse 136 (Pl. XXVIII) possède un plan circulaire et un profil à fond plat (fig. 126). Son remplissage se compose d’une unique couche de limon lehmique brun. Seule cette structure a livré du mobilier (fig. 125). Il s’agit essentiellement de céramique à l’aspect protohistorique. Un fragment d’os appartenant à un cervidé a également été mis au jour.
Profil complet
Bord Panse Fond Nb Tessons Grossière Semi-fine Fine Couleur Chamotte Mica Quartz invisible
Ø ouverture
(cm)
Hauteur (cm)
136 1 1 x 1 x noire x x fragment de bord non déterminable
136 2 x 4 x x xdifférents
fragments de panses
Dimensions
DescriptionStructure N° inventaire NMI
Tessons Facture Dégraissant
Fig. 125 : Inventaire de la céramique d’époque protohistorique indéterminée (SGO)
172
N° d
e St
ruct
ure
Type
Plan
Prof
ilO
rient
atio
nR
elat
ions
Long
ueur
(m
.)La
rgeu
r (m
.)D
iam
ètre
(m.)
Prof
onde
ur
(m.)
Rem
plis
sage
Plan
che
119
SIO
vale
Tron
coni
que
E/O
reco
upée
par
St.
142
2,2
(Ave
c St
. 14
2)2
(Ave
c St
. 14
2) -
1,5
3 co
uche
s, li
mon
lehm
ique
bru
n à
brun
cla
ir,
com
pact
et h
omog
ène,
+ lo
ess
XXXV
II
136
FSC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-2
0,3
limon
lehm
ique
bru
n, m
eubl
eXX
XVIII
Fig. 126 : Inventaire des structures d’époque protohistorique indéterminée
174
984
000
307 000
306 900
985
000
0 25 m
Les n° de structure entre parenthèses et en italiquerenvoient à la numérotation du diagnostic
Structures néolithiques ou protohistoriques
67(FS 124)
50
098
120
43
Fig. 127 : Localisation des structures néolithiques ou protohistoriques
Nature Structure N° d'inventaire
Nombre d'objet Observation
Métal 40 2 1 Fragment de scorie de fer
43 2 3 Fragments d'ossements animaux (Bœuf ; Capriné)
50 2 3 Fragments d'ossements animaux (Bœuf ; Chien)
67 2 1 Fragments d'ossements animaux (Grand mammifère)
67 3 Fragments d'ossements animaux (= 124.001 ; Matériel non fourni)
120 2 1 Fragments d'ossements animaux (Bœuf)
Faun
e
Fig. 129 : Inventaire du mobilier (hors céramique) néolithique ou protohistorique
175
Cette partie concerne les structures qui n’ont pu être attribuées à une période chro-nologique précise que ce soit par leurs formes ou grâce au mobilier mis au jour dans leurs remplissages.
IV.1. Les structures néolithiques ou protohistoriques
Ces cinq structures (St. 43, 50, 67, 98 et 120 ; Pl. XXXIX à XLI ; fig. 129) sont des fosses, essentiellement de forme circulaire en plan et possédant un profil en cuvette, un fond plat ou irrégulier, généralement de dimensions réduites (fig. 130). Leur comblement est princi-palement constitué de limon lehmique brun. Elles ont toutes fourni un mobilier (céramique principalement, mais aussi un peu d’élé-ments de faune) dont l’aspect évoque les périodes néolithique ou protohistorique sans qu’il ait été possible de trancher (fig. 127 et 128).
Hauteur conservée
Ø ouverture
Ø max. conservé Epaisseur
40 1 2 - - - 0,8 Fragments de panse
Epoque romaine ?
43 1 2 - - - 0,8 Fragments de panse
Néolithique ou protohistoire
50 1 3 - - - 0,5 Fragments de panse
Néolithique ou protohistoire
67 1 3 - - - 0,6 Fragments de panse
Néolithique ou protohistoire
67 4 2 - - - 0,5 Fragments de panse
Néolithique ou protohistoire
98 1 1 - - - 0,6 Fragments de panse
Néolithique ou protohistoire
120 1 3 - - - 0,5 Fragments de panse
Néolithique ou protohistoire
DatationStructure N° d'inventaire
Nombre de tessons
Dimensions (cm.)Observations
Fig. 128 : Inventaire de la céramique néolithique ou protohistorique
Nature Structure N° d'inventaire
Nombre d'objet Observation
Métal 40 2 1 Fragment de scorie de fer
43 2 3 Fragments d'ossements animaux (Bœuf ; Capriné)
50 2 3 Fragments d'ossements animaux (Bœuf ; Chien)
67 2 1 Fragments d'ossements animaux (Grand mammifère)
67 3 Fragments d'ossements animaux (= 124.001 ; Matériel non fourni)
120 2 1 Fragments d'ossements animaux (Bœuf)
Faun
e
Fig. 129 : Inventaire du mobilier (hors céramique) néolithique ou protohistorique
176
N° d
e St
ruct
ure
Type
Plan
Prof
ilO
rient
atio
nR
elat
ions
Long
ueur
(m
.)La
rgeu
r (m
.)D
iam
ètre
(m.)
Prof
onde
ur
(m.)
Rem
plis
sage
Obs
erva
tion
Plan
che
43FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
1,95
0,42
Lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
, hét
érog
ène
-XX
XIX
50FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,9
0,3
Lim
on le
hmiq
ue b
run
à br
un fo
ncé
-XX
XIX
67FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,75
0,22
Lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
, hét
érog
ène
-XL
98FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
1,2
0,1
Lim
on le
hmiq
ue b
run
som
bre
et li
mon
loes
siqu
e br
un c
lair
-XL
120
FSP
atat
oïde
irrég
ulie
rN
/S -
6,2
4,5
0,8
2 co
uche
s : l
imon
lehm
ique
bru
n, c
ompa
ct,
hété
rogè
ne ;
limon
lehm
ique
bru
n et
lim
on
loes
squi
e ja
une
Stru
ctur
e co
upée
par
la
berm
eXL
I
Fig. 130 : Inventaire des structures néolithiques ou protohistoriques98
4 00
0
307 000
306 900
985
000
0 25 m
Les n° de structure entre parenthèses et en italiquerenvoient à la numérotation du diagnostic
Structures de périodeindéterminée
24 à 31(FO 125 et 126)
(FS 108)
40(FS 108)
126
129
21
19
18
11
5
42
46(FS 103)
49
52
53
8086
122
115112
110
37
38
33
94
95
107
141(FS 107)
32
8
142
177
984
000
307 000
306 900
985
000
0 25 m
Les n° de structure entre parenthèses et en italiquerenvoient à la numérotation du diagnostic
Structures de périodeindéterminée
24 à 31(FO 125 et 126)
(FS 108)
40(FS 108)
126
129
21
19
18
11
5
42
46(FS 103)
49
52
53
8086
122
115112
110
37
38
33
94
95
107
141(FS 107)
32
8
142
Fig. 131 : Localisation des structures de période indéterminée
178
IV.2. Les structures d’époque indéterminée
Ces trente-sept structures (St. 2, 4, 5, 8, 11, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 46, 49, 52, 53, 80, 94, 95, 107, 110, 112, 115, 122 et 126 ; Pl. XLII à LIV) n’ont fourni aucun indice permettant une datation certaine (fig. 131 et 132). Il s’agit principale-ment de fosses de forme circulaire en plan, peu profondes, au profil en cuvette ou à fond plat. Leur remplissage se compose principalement d’une couche de limon lehmique brun.Quelques-unes de ces structures peuvent cependant appeler quelques commentaires supplé-mentaires.
Au sein du remplissage du fossé 40 (Pl. XLVIII) a été mis au jour un tesson de céra-mique dont l’aspect évoque la période romaine (fig. 127). C’est cependant le seul indice de cette période qui a été mis au jour sur le site. Daté ce fossé de l’époque romaine sur la base de ce seul élément nous paraissant un peu osé, nous avons préféré rester prudent. On peut toutefois remarquer que le fossé 38 (Pl. XLVII), situé à proximité, à l’est, possède un tracé parallèle à la structure 40. On pourrait donc envisager une certaine contemporanéité entre ces deux fossés.
Les structures 24 à 31 (Pl. XLV) sont des fosses de formes allongées, au profil en U disposées parallèlement les unes aux autres (fig. 131 et 132). Nous avons pu les suivre sur un maximum de 12,50 m avant qu’elles ne se perdent dans la berme sud du chantier. Larges d’environ dix centimètres, leur espacement varie entre 1 et 1,50 m. Leur comblement est constitué de limon loessique brun. La nature de ces structures n’est pas assurément connue, toutefois, un article de D. Billoin et J.-Y. Dufour portant sur la reconnaissance des structures liées aux cultures marai-chères a été récemment porté à notre connaissance176. Plus particulièrement, les auteurs examinent deux cas d’aspergerie. Or, les structures attribuées à ce type d’exploitation agricole possèdent de nombreux points communs avec les structures 24 à 31 de Sierentz, tant au point de vue de leurs formes que de leur organisation. Il est donc probable que ces fosses signalent l’existence sur ce site d’une plantation d’as-perges. Cette hypothèse quant à la nature de cette structure ne nous permet pas pour autant de don-ner une datation précise de ces vestiges. Tout au plus peut-on signaler que la plus ancienne trace de la culture de l’asperge en France remonterait au Ier – IIe siècle ap. J.-C177.
176 Billoin et Duffour 2005177 Billoin et Dufour 2005
179
N° d
e St
ruct
ure
Type
Plan
Prof
ilO
rient
atio
nR
elat
ions
Long
ueur
(m
.)La
rgeu
r (m
.)D
iam
ètre
(m.)
Prof
onde
ur
(m.)
Rem
plis
sage
Plan
che
2FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
1,22
0,24
lehm
bru
n co
mpa
ct e
t hom
ogèn
eXL
II
4FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
1;5
0,4
limon
lehm
ique
bru
n, c
ompa
ct e
t hom
ogèn
e. +
sé
dim
ent n
oir c
harb
onne
uxXL
II
5FS
Obl
ongu
ecu
vette
N/S
-3,
421,
56 -
0,24
limon
lehm
ique
bru
n co
mpa
ct e
t hom
ogèn
eXL
II8
FSC
ircul
aire
cuve
tte -
- -
-0,
90,
2lim
on le
hmiq
ue b
run
com
pact
et h
omog
ène
XLIII
11FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,52
0,2
limon
lehm
ique
bru
n co
mpa
ct e
t hom
ogèn
eXL
III
18FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,42
0,36
limon
lehm
ique
bru
n so
mbr
e, p
eu c
ompa
ct,
hom
ogèn
eXL
III
19FS
Obl
ongu
efo
nd p
lat
N/S
-1,
820,
82 -
0,2
limon
lehm
ique
bru
n cl
air,
com
pact
hom
ogèn
eXL
IV21
FSC
ircul
aire
cuve
tte -
- -
-1,
620,
3lim
on le
hmiq
ue b
run
com
pact
hom
ogèn
eXL
IV24
FSO
blon
gue
cuve
tteN
/S -
12 -
- -
Lim
on lo
essi
que
brun
XLV
25FS
Obl
ongu
ecu
vette
N/S
-12
- -
-Li
mon
loes
siqu
e br
unXL
V26
FSO
blon
gue
cuve
tteN
/S -
12,2
5 -
- -
Lim
on lo
essi
que
brun
XLV
27FS
Obl
ongu
ecu
vette
N/S
-12
,25
- -
-Li
mon
loes
siqu
e br
unXL
V28
FSO
blon
gue
cuve
tteN
/S -
12,7
5 -
- -
Lim
on lo
essi
que
brun
XLV
29FS
Obl
ongu
ecu
vette
N/S
-13
- -
-Li
mon
loes
siqu
e br
unXL
V30
FSO
blon
gue
cuve
tteN
/S -
13,2
5 -
- -
Lim
on lo
essi
que
brun
XLV
31FS
Obl
ongu
ecu
vette
N/S
-13
,5 -
- -
Lim
on lo
essi
que
brun
XLV
32FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
10,
16m
elan
ge d
e lo
ess
et d
e te
rre
végé
tale
+ le
hmXL
VI33
FSC
ircul
aire
cuve
tte ir
régu
lière
- -
- -
1,3
0,32
mél
ange
de
terr
e vé
géta
le e
t loe
ss +
lehm
XLVI
37FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
0,75
0,17
limon
lehm
ique
cal
caire
bru
n co
mpa
ctXL
VI38
FOR
ectil
igne
cuve
tteN
O/S
E -
43,7
50,
7 -
0,2
limon
loes
siqu
e br
un c
lair
XLVI
I40
FOR
ectil
igne
en c
uvet
teN
O/S
E -
88,7
5m
ax 1
,2 -
max
0,6
limon
loes
siqu
e br
un c
lair
XLVI
II46
FSC
ircul
aire
en c
uvet
te -
- -
-1,
30,
15lim
on le
hmiq
ue b
run
XLIX
49FS
Circ
ulai
reen
cuv
ette
- -
- -
1,1
0,35
limon
lehm
ique
bru
n, c
ompa
ct, h
omog
ène,
in
clus
ion
de c
harb
ons
et T
CA
XLIX
52FS
Qua
dran
gula
irebo
rd d
roit,
fond
pla
tN
/S -
1,25
0,85
-0,
3lim
on lo
essi
que
brun
cla
ire, m
eubl
eXL
IX80
FSC
ircul
aire
en c
uvet
te -
-1,
81,
7 -
0,45
limon
lehm
ique
bru
n, c
ompa
ct, h
omog
ène
L94
FSPa
tato
ïde
en c
uvet
te -
-3
max
2,4
-0,
2lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
, hom
ogèn
eL
95FS
Circ
ulai
reen
cuv
ette
- -
- -
1,4
0,28
limon
lehm
ique
bru
n, c
ompa
ct, h
omog
ène
LI
107
FSC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1,
400,
25lim
on b
run
com
pact
, + li
mon
loes
siqu
e hé
téro
gène
et p
eu c
ompa
ctLI
110
FSPa
tato
ïde
irrég
ulie
rN
/S -
2,25
1,60
-0,
23lim
on b
run
hom
ogèn
e et
com
pact
LI11
2FS
Pata
toïd
een
cuv
ette
- -
- -
1,75
0,2
limon
bru
n ho
mog
ène
et c
ompa
ctLI
I11
5FS
Circ
ulai
reen
cuv
ette
- -
- -
1,6
0,25
limon
bru
n co
mpa
ctLI
I12
2FS
Pata
toïd
eirr
égul
ier
- -
3,20
4 -
0,23
limon
lehm
ique
LIII
126
FSC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1
0,28
limon
bru
n co
mpa
ctLI
II12
9FS
Circ
ulai
refo
nd ir
régu
lier
- -
- -
1,2
0,2
limon
lehm
ique
bru
nLI
II14
1FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
1,90
0,34
limon
lehm
ique
bru
nLI
V14
2FS
Circ
ulai
recu
vette
-re
coup
e St
. 119
2,2
2 -
95lim
on le
hmiq
ue b
run
XXXV
II
Fig. 132 : Inventaire des structures d’époque indéterminée
180
V. CONCLUSION GENERALE
Au préalable de la construction du lotissement « Les Villas d’Aurèle » par la société Hugues Aurèle sur les hauts de la petite colline du Monenberg, sur la commune de Sierentz, une opération de fouille archéologique a été réalisée par la société Antea Archéologie en 2010. Sur plus de 1,8 hectares, un total de 111 structures ont été mises au jour. Leur état de conservation est globalement satisfaisant, même si on peut noter un plus fort arasement au sud de l’emprise, correspondant au haut de la pente.
Différentes périodes d’occupations humaines ont pu être reconnues, relevant du Néo-lithique et de la Protohistoire.
Les premières traces datent du Néolithique moyen et sont attribuées à la culture de Bruebach-Oberbergen, d’après les rares tessons décorés mis au jour. Il s’agit de trois fosses circulaires, peu profondes et surtout d’un ensemble de fentes. L’organisation spatiale de ces dernières structures est assez remarquable puisqu’aucun autre exemple de ce type n’existe en Alsace. Après quelques siècles, le site est occupé durant le Néolithique récent. Huit fosses circulaires, dont deux contenaient des dépôts de restes humains, appartiennent à la culture de Munzingen. Elles ont livré une petite série céramique, dont l’étude, combinée à la réalisa-tion de datation 14C, nourri l’actualité de la recherche sur cette période et particulièrement la chronologie interne du Munzingen et l’éclaircissement des relations de cette culture avec le Plateau suisse.
Pour la Protohistoire, les premiers indices relèvent du début du Bronze final. Il ne s’agit en fait que d’un seul vase, retrouvé écrasé sur place dans la couche de terre végétale.Les vestiges du Bronze final IIb / IIIa (Période RSFO) sont plus conséquents. Puisque l’on dénombre 14 structures attribuées a cette période. Principalement, ces structures sont des fosses circulaires à fond plat dont certaines contenaient des dépôts de vases entiers. Enfin, six fosses et silos témoignent d’une occupation durant le Premier Age du Fer (Hallstatt D1).
Mais la découverte la plus marquante de cette opération reste celle de quatre sépul-tures campaniformes, dont deux, particulièrement bien conservées, ont livré un riche mobilier et des traces d’architectures en bois. Ces caractéristiques en font un ensemble exceptionnel pour l’Alsace, qui enrichit de manière assez remarquable le corpus régional de cette période.
Du point de vue de l’histoire de Sierentz, cette fouille à permis de mettre en évidence certaines périodes jusqu’à présent absentes, ou très discrètement représentées (Bruebach-Oberbergen), sur la commune et d’enrichir d’autres périodes déjà connues (fig. 133).
181
Néo
litiq
ueA
ge d
u B
ronz
eA
ge d
u Fe
rR
omai
nM
oyen
Âge
Ancien
Ancien
Moyen
Moyen
Récent
Final
Final
Hallstatt
La Tène
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
- Ensemble de fentes et fosses (Bruebach-Oberbergen)
- Fosses circulaires et fosses-silo, Inhumations en fosses circulaires (Munzingen)
- Ensemble funéraire campaniforme
- Fosse détritiques et dépot céramiques, Habitat ? (BFI et IIb)
- Fosses détritiques et silos, Habitat ? (HtD1)
Fig. 133 : Périodes représentées sur la commune de Sierentz, incluant le site «Les Villas d’Aurèle» (en hachuré)
Adam et al. 2005 AdAm A.M. (dir.) - Recherches de Protohistoire Alsacienne : la céramique d'habitat du Bronze final III à La Tène ancienne. Revue Archéologique de l'Est, suppl. 23, 2005
Adam et al. 2011 AdAm A.-M. (dir) - La céramique d’habitat du Bronze final IIIb à La Tène A en Alsace et en Lorraine. Essai de typo-chronologie. Revue Archéologique de l'Est, Dijon, 2011.
Achard-Corompt et al. 2011 AchArd-corompt N., Auxiette G., FromoNt N. - Les fosses à profil " en V – Y – W " / Schlitzgruben : retour sur une énigme. Revue Archéologique de Picardie, spécial 28, 2011, p.549-558
Balek et al. 1999 Bálek M., Dvořák P., kovárník J., MatěJíčková a. -Pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Tvořihrázi (Okr. Znojmo), Das Gräberfeld der Glockenbecherkultur in Tvořihráz (Bez. Znojmo) Pravěk, Suppl. 4, 1999, Brno.
Balfet et al. 1983 BAlFet h., FAuvet-Berthelot m.-F., moNzoN S. - Pour la normalisation de la description des poteries. CNRS ed., Paris, 1983.
Bellard 1960 BellArd A. - Le Chalcolithique au bassin de la Moselle, 5e Contribution à la Préhistoire de Lorraine, 1960, p.21-24.
Behrends 1987 BehreNdS K. - Erdwerk der Jungsteinzeit in Bruchsal. Archäologische Ausgraben in Baden-Wüttemberg, 1987, p.54-57
Biel 1986 Biel J. - Ein Erdwerk der Michelsberg Kultur auf dem Schlossberg von Heilbronn- Klingenberg, Archäologische Ausgraben in Baden-Wüttemberg, 1986, p.45-46
Billard et Penna 1995 BillArd c., peNNA B. - Les sites des Poses "Les quatre Chemins" et la "Plaine des Poses" (Eure) : transition Néolithique moyen-récent et campaniforme. Revue Archéologique de l'Ouest, supplément 7, 1995, p.273-291.
Billard 2011 BillArd c. - Les sépultures individuelles campaniformes de Normandie. In : Salanova et Tchérémissinoff 2011, p.37-46.
Billoin et Duffour 2005 Billoin D., Dufour, J.-Y. – La reconnaissance archéologique des cultures maraîchères ancienne : l’exemple des aspergeries. Archéopages, 15, 2005, p.12-15.
Billoin et al. 2010 Billoin D., Denaire a., Jeunesse C., thiol s. - Une nouvelle sépulture campaniforme à Hégenheim (F-Haut-Rhin). In : Jeunesse et Denaire 2010, p.31 à 42
Bonnet 1974 BoNNet c. – Un nouvel aperçu sur la station d’altitude de Hohlandsberg, Wintzenheim (Haut-Rhin). Cahier Alsacien d’Archéologie, d’Art et d’Histoire, XVIII, 1974, p.33-50.
Bosch 2008 BoSch t.l. - Archäologische Untersuchungen zur Frage von Sozialstrukturen in der Ostgruppe des Glockenbecherphänomens anhand des Fundgutes. Doktorarbeit des Philosophischen, Fakultät III der Universität Regensburg, Deggendorf, 2008.
Case 2004 cASe h. - Beakers and the Beaker culture. In : J. Czebreszuk (ed.) - Similar but Different. Bell Beakers in Europe. Poznan : Adam Mickiewicz University, 2004, p.11- 34.
Christlein 1981 chriStleiN r. - Ein Friedhof der kupferzeitlichen Glockenbecherkultur von Altdorf, Landkreis Landshut, Niederbayern. Arch. Jahr Bayern 1980, 1981.
Denaire 2007 deNAire A. - Les sépultures multiples du Néolithique récent de Didenheim / Morschwiller - Le- Bas (Haut-Rhin), In : Archaeologia Mosellana, VII, p.567- 583
Denaire 2009 deNAire A. - Une nouvelle maison du Néolithique ancien rubané à Sierentz (Zac Hoell, Haut-Rhin). Cahiers Alsaciens d'Arts, d'Archéologie et d'Histoire, 52, 2009.
Denaire et Croutsch 2010 deNAire A., croutSch c. - Du campaniforme à la fin du Bronze ancien en Alsace: essai de synthèse chronologique, In : Jeunesse et Denaire 2010, p.165-202
Drenthe et Lohof 2005 dreNthe e., lohoF e. – Mounds for the dead. Funerary and burial ritual in Beaker period, Early and Middle Bronze Age. In : louwe kooiJMans l. P., van Den Broeke P. w., fokkens h., van GiJn a. l. (eD.) – The prehistory of the Netherland. Vol. 1, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2005, p.433-454
Dvořák 1992 Dvořák P. - Gräberfelder der Glockenbecherkultur in Mähren I (Bez. Blansko, Brno- město, Brno-venkov). Katalog der Funde, Brno, 1992.
Dvořák 1996 Dvořák P. - Gräberfelder der Glockenbecherkultur in Mähren II (Bezirk Břeclav) Katalog der Funde. Brno - Olomouc, 1996.
Dvořák et Hájek 1990 Dvořák P., háJek l. - Die Gräberfelder der Glockenbecherkultur bei Šlapanice (Bez. Brno-venkov). Katalog der Funde. Brno, 1990.
Engelhardt 1998 eNGelhArdt B. - Gräber der Schnurkeramik und der Glockenbecherkultur in Südbayern. In : MiChálek J. , sChMotz k. , záPotoCká M. (hrG.) - Arch. Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- u. Südböhmen, 7. Treffen 11. bis 14. Juni 1997 in Landau an der Isar. Resümees der Vorträge. Rahden/ Westf., 1998, p.71-87.
Ferrier et Leroy 2010 ferrier a., leroY k. - Obernai Schulbach, Nouvel Hôpital. Rapport de diagnostic, PAIR, SRA Alsace, Strasbourg, 2009
Fitzpatrick 2003 FitzpAtricK A. - The Amesbury archer, Current Archaeology, 194, 2003, p.146-152
Fitzpatrick 2009 FitzpAtricK A. - In his hands and in his head: The Amesbury Archer as a metalworker In : Peter Clark (eD.) - Bronze Age Connections Cultural Contact in Prehistoric Europe, Oxbow Books, 2009, p.176-188.
Fokkens et al. 2008 fokkens h., aChterkaMP Y., kuiJPers M. - Bracers or bracelets ? About the functionality and meaning of Bell Beakers wrist-guards. Proceedings of the prehistoric Society, 74, 2008, p.109-140.
Furestier 2005 FureStier r., Les industries lithiques campaniformes du sud-est de la France, Thèse de doctorat, sous la direction de Didier Binder, Université Aix-Marseille - Université de Provence, Aix-en-Provence, 2005
Gallay 1970 GallaY M. - Die Besiedung des südlichen Oberrheinebene in Neolitikum unf Frühbronzezeit. Badische Sonderheft, 12, 1970.
Goepfert 2005 GoepFert S. - Les enclos hallstattiens de la Glaisière Hartmann de Riedisheim, Mémoire de Maîtrise, Université Strasbourg II, Strasbourg, 2005
Goetze 1987 Goetze B.-r. - Glockenbecher-Gräber von Dietfurt an der Altmühl. Arch. Korrbl., 17, 1987, p.169-175.
Guckenbiel et Piller 2007 GucKeNBiehl m., piller c. - Gräber der Kupferzeit aus Germering, Landkreis Fürstenfeldbruck, Oberbayern. Arch. Jahr Bayern 2006, 2007, p.30-32.
Guillotin et al. 2011 Guillotin s. (Dir), GlarDon C., le Martret a., Murer a., Maurer D., Perrin X., roth-zehNer m., verGNAud l. – Wittenheim Lotissement “Le Moulin” (Haut-Rhin). Rapport final d’opération, Antea Archéologie, SRA Alsace, 2011
Hájek 1939-46 háJek l. - Půlměsícovitá spinadla kultury zvoncovitých pohárů, Památky Arch., 42, 1939-46, p.20-29.
Hájek 1966 háJek l. - Die älteste Phase der Glockenbecherkultur in Böhmen und Mähren. Pam. Arch., 57,1, 1966, p.210-241.
Heidinger et Viroulet 1986 heidiNGer A. et viroulet J.-J. - Une nécropole du Bas-Empire à Sierentz, Ann. Soc. Hist. Hochkirch et Hte-Als., 1986.
Hetzer 1949 hetzer K. - Beiträge zur Kenntnis der Glockenbecherkultur in Österreich. Arch. Austriaca. 4, 1949, p.87-115.
Heyd 2000 heYD v., - Die Spätkupferzeit in Süddeutschland. Bonn, 2000.
Heyd 2001 heYD v. - On the earliest Bell Beakers along the Danube. In : Nicolis F. (Hrg.) - Bell Beakers today. Pottery,people, culture, symbols in prehistoric Europe. Proceedings of the International Colloquium Riva del Garda (Trento, Italy) 11-16 May 1998, Volume II, 2001, p.387-409.
Heyd 2007 heYD v. - Families, Prestige Goods, Warriors and Complex Societies: Beaker Groups of the 3rd Millennium cal BC along the Upper and Middle Danube. Proceedings of the Prehistoric Society, 73, 2007, p.321-370.
Husty 1999 hustY l. - Die Funde der Glockenbecherkultur in Landau SüdOst - Gräber und Siedlungen. Doktorarbeit der Philosophischen, Fakultät der Christian-Albrechts- Universität, Kiel, 1999.
Jeunesse 1989 Jeunesse C. - La culture de Munzingen dans le cadre du "Jungneolithikum" du Sud- Ouest de l’Europe centrale d’après les découvertes récentes des sites alsaciens de Didenheim (Haut-Rhin) et Geispolsheim (Bas-Rhin). Cahiers de l’Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace, 5, p.155-184
Jeunesse 2010 Jeunesse C. - La tombe Bronze ancien de Mancenans-Lizerne (Doubs). In : Jeunesse et Denaire 2010, p 119-128
Jeunesse et Denaire 2010 Jeunesse C., Denaire a. (Dir) - Du Néolithique final au Bronze ancien dans le Nord- Est de la France. Actualité de la recherche. Actes de la table ronde internationale de Strasbourg, 9 juin 2009, Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace, 2010.
Kamieńska et Kulczycka-Leciejewiczowa 1970 kaMieńska J., kulCzYCka-leCieJewiCzowa a. - The Neolithic and early Bronze Age settlement at Samborzec in the Sandomierz District. Arch. Polona, 12, 1970, p.223- 246.
Kreiner et al. 1999 kreiner l., PleYer r, haCk s. - Ein reiches Brandschüttungsgrab der Glockenbecherkultur aus Aufhausen. Arch. Jahr Bayern 1998, 1999, p.26- 28.
Kunhle et al. 2001 KuhNle G., WiechmANN A., ArBoGASt r.-m., BoeS e., croutSch c. - Le site Michelsberg et Munzingen de Holtzheim (Bas-Rhin), Revue Archéologique de l'Est, 50, 1999, p.3-51
Kraft 1947 KrAFt G. - Neue Glockenbecherfunde am Oberrhein. Badische Fundberichte, 1941- 1947, p.127-137.
Lack et Voegtlin 1988 laCk J., voeGltin C. - Une tombe à incinération du Bronze Final à Illfurth (Haut-Rhin), Cahiers de l’association pour la promotion de la recherche archéologique en Alsace, 4, 1988, p.67-74.
Lambach 1986 lAmBAch F. - Les sépultures Michelsberg d’Alsace: quelques données nouvelles à propos des rites funéraires. Cahiers de l’Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace, 2, p.16- 36
Landolt et Van Es 2009 lANdolt, vAN eS - lANdolt m., vAN eS m. - Entzheim In der Klamm, un dépôt de céramique du début du Bronze final. In : Schnitzler 2009, p.64-67
Lanting 2008 lantinG J. n. – De NO-Nederlandse / NW-Duitse klokbekergroep : culturele achtergrond, typologie van het aardewerk, datering, verspreiding en graftritueel. Palaeohistoria, 49-50, 2007-2008, p.11-326.
Lanting et Waals 1976 lantinG J.n. et van Der waals J.D. - Beaker Culture relations in the Lower Rhine Basin. In : lantinG J.n. unD van Der waals J.D. (hrG.) - Glockenbecher Symposion Oberried 1974. 1976, p.1-80.
Latron (dir.) 2010 lAtroN F., lAtroN colecchiA A., leFrANc p. - L'occupation du Néolithique récent à Sierentz : habitat et sépultures du Munzingen, Rapport final d'opération, Diagnostic archéologique, INRAP, SRA Alsace, 2010.
Le Brun-Ricalens et al. 2011 le BruN-ricAleNS F., touSSAiNt m., vAlotteAu F. - Les sépultures campaniformes d’Altwies - "Op dem Boesch" (Grand-duché de Luxembourg). In : Salanova et Tchérémissinoff 2011, p.115-122.
Lefebvre 2008 leFeBvre A., GAzeNBeecK m., perNot p. - Les sépultures campaniformes du site de Mondelange "La Sente" (Moselle). Résultats préliminaires. Internéo, 7, 2008, p.187-201
Lefebvre 2010 leFeBvre A. - Les sépultures du Néolithique final / Bronze ancien en Lorraine : vers l’émergence de nouvelles problématiques. In : Jeunesse et Denaire 2010, p.103-118
Lefebvre et al. 2011 lefeBvre a., franCk J., veBer C. (avec la collaboration de h. duvAl) - Les sépultures individuelles campaniformes en Lorraine : l’exemple de Pouilly (Moselle) et d’Hatrize (Meurthe-et-Moselle). In : Salanova et Tchérémissinoff 2011, p.97-111.
Lefranc 2007 leFrANc p. - Néolithique. Bilan Scientifique du Service Régional d’Archéologie d’Alsace, Hors série ½, p.19-104
Lefranc et Denaire 2000 leFrANc p., deNAire A. - Deux nouvelles maisons du Néolithique ancien rubané et une fosse de la culture de Grossgartach à Sierentz "Tiergarten" (Haut-Rhin). Cahier de l'Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace, 16, p.17- 36.
Lefranc et al. 2010 leFrANc ph., deNAire A., ArBoGASt r.-m., cheNAl F. - Les inhumations et les dépôts d’animaux en fosses circulaires au Néolithique récent du sud de la plaine du Rhin supérieur, Gallia Préhistoire, 52, 2010.
Lefranc et al. 2010 leFrANc p., BoëS e., murer A. - Nouvelles données sur les rites funéraires du Bronze ancien évolué en Alsace. In : Jeunesse et Denaire 2010, p.129-149.
Lefranc et al. 2011 leFrANc p., deNAire A., BoëS e., ArBoGASt r.-m., BilloiN d. - L’habitat Néolithique récent de Geispolsheim "Forlen" (Bas-Rhin) : Contribution à la périodisation de la culture de Munzingen et à l’étude de ses relations avec les cultures du Plateau suisse et du lac de Constance. Revue Archéologique de l’Est, 60, 2011, p.45-82.
Lemercier 2011 lemercier o. - Le guerrier dans l'Europe du 3° millénaire avant notre ère. L'arc et le poignard dans les sépultures individuelles campaniformes. In : Baray L., Honegger M. et Dias-Meirinho (Dir.) - L'armement et l'image du guerrier dans les sociétés anciennes. De l'objet à la tombe. Ed. Universitaire de Dijon, Collection Art Archéologie et Patrimoine, Dijon, 2011, p.122-165
Lemercier et Tchérémissinoff 2011 leMerCier o., tChéréMissinoff Y. - Du Néolithique final au Bronze ancien : les sépultures campaniformes dans le sud de la France, In : Salanova et Tchérémissinoff 2001, p.177-194.
Lüning 1968 lüninG J. - Die Michelsberger Kultur: ihre Funde in zeitlicher und räumlicher Gliederung. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 48, 1968, p.1-350
Maier 1958 mAier r.- A. - Neufunde aus der "Michelsberger" Höhensiedlung bei Munzingen, Ldkr. Freiburg i. Bad. Fundber., 21, 1958, p.7- 40
Maise et Lasserre 2005 mAiSe c, lASSerre m. - L'habitat de Colmar-Diaconat (Haut-Rhin) et la définition du Bronze final III en Alsace. In : Adam 2005, p.9-75
Mentele et al. 2005 meNtele S., plouiN S. - L’habitat hallstattien de Brumath "Lotissement Edouard Manet-deuxième tranche", In : Adam 2005, p.143-178
Müller-Karpe 1961 müller-KArpe h. - Die spätneolithische Siedlung von Polling. Materialh. Bayer. Vorgesch. 17,Kallmünz, 1961.
Metzinger-Schmitz 2004 metziNGer-Schmitz B. - Die Glockenbecherkultur in Mähren und Niederösterreich. Typologische und chronologische Studien auf dem Hintergrund der kulturhistorischen Abläufe während der späten Kupferzeit im Untersuchungsgebiet. Mit einem paläometallurgischen Exkurs. Doktorarbeit der Philosophischen, Fakultät der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 2004.
Murer et al. 2010 murer A. - Meistratzheim Station d’épuration intercommunale, Rapport final d’opération d’archéologie préventive, Strasbourg SRA, 2010
Neugebauer et Neugebauer 1993/94 neuGeBauer C., neuGeBauer J.-w. - (Glocken-) Becherzeitliche Gräber in Gemeinlebarn und Oberbierbaum. NÖ. Mitt. Anthr. Ges. Wien 123/124, 1993/1994, p.193-219.
Pape 1978 pApe W. - Neue Glockenbecherfunde aus Sudbaden, Archaeologische Nachrichten aus Baden, 20, 1978, p.18-25.
Perrin 2005 perriN B. - Les enceintes de la culture Michelsberg. Mémoire de Maitrise, sous la direction de C. Jeunesse, Université Marc Bloch - Strasbourg 2, Strasbourg, 2005.
Piningre 1988 PininGre J.-f. - Le groupe Rhin-Suisse-France-Oriental en Alsace : genèse et évolution. In : Brun P., MorDant C. (Dir.) - Le groupe de Rhin-Suisse-France orientale et la notion de civilisation des Champs d'Urnes. Actes du colloque international de Nemours, 1986, APRAIF, Nemours, 1988, p.179-191
Pittioni 1954 pittioNi r. - Urgeschichte des österreichischen Raumes, Wien, 1954.
Röeder et Blanc 1995 röeder B., BlANc e. - Deux nouveaux habitats hallstattiens à Rosheim, Cahiers Alsaciens d'Arts, d'Archéologie et d'Histoire, XXXVII, 1995, p.55-68.
Roth-Zehner (dir.) 2007 roth-zehner M. (Dir.), anCel M.-J., BarranD h., BoYer a., Cartier e. CouBel s., Denaire A., le mArtret A., murer A. et rouGier v. - Sierentz 2006-2007 - ZAC Hoell, Rapport d'archéologie préventive, Antea-Archéologie Sàrl, SRA Alsace, 2007.
Roth-Zehner et al. 2007 roth-zehner M., anCel M.-J., BarranD h., Cartier e., Denaire a. le Martret a. et rouGier v. - Sanctuaires et pratiques funéraires au sud de Mulhouse du Néolithique au Moyen-Age. Présentation des découvertes de Mulhouse-Rocade Ouest (Néolithique récent et la Tène ancienne), Sierentz ZAC Hoell (Néolithique moyen, Bronze final et gallo-romain), Habsheim-Landsererweg (gallo-romain) et Illfurth- Buergelen (Haut Moyen Age). Société d'Histoire d'Eschentzwiller et Zimmersheim, tiré-à-part, 2007.
Roth-Zehner et al. 2008 roth-zehNer m. - Colmar Jardin des Aubépines 2007-2008. Rapport d’archéologie préventive, Antea archéologie, SRA Alsace, Strasbourg, 2008.
Rougier 2001 rouGier v. - Les structures à remplissage de galet chauffé de Sierentz (Bronze final). Mémoire de maitrise, Strasbourg 2, 2001.
Růžičková 2008 růžičková P. - Lukovité závěsky kultury zvoncovitých pohárů ve střední Evropě. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Ústav archeologie a muzeologie Bakalářská diplomová práce, Vedoucí práce: doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.,Brno, 2008
Salanova 2000 SAlANovA l. - La question du Campaniforme en France et dans les Iles anglo- normandes: productions, chronologie et rôles d’un standard céramique. Coédition Société Préhistorique Française et Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2000.
Salanova 2011 SAlANovA l. - Chronologie et facteurs d’évolution des sépultures individuelles campaniformes dans le Nord de la France. In : Salanova et Tchérémissinoff 2011, p.125-142
Salanova et Tchérémissinoff 2011 salanova l. et tChéréMissinoff Y. (Dir.) - Les sépultures individuelles campaniformes en France. XLIe supplément à Gallia Préhistoire, CNRS éditions, Paris, 2011.
Salanova et Tchérémissinoff 2011b salanova l. et tChéréMissinoff Y. - Conclusion générale. Impact des pratiques funéraires campaniformes en France. In : Salanova et Tchérémissinoff 201, p.195 200
Sangmeister 1974 SANGmeiSter e. - Zwei Neufunde der Glockenbecherkultur in Baden-Württemberg. Ein Beitrag zur Klassifizierung der Armschutzplatten in Mitteleuropa. Fundber. Baden- Württemberg, 1, 1974, p.103-156.
Schirmeisen 1934 SchirmeiSeN K. - Steinzeitliche Funde aus der Brünner Umgebung. Sudeta 10, 1934, p.62-68.
Schlencker et Stöckl 1999 SchleNKer В., StöcKl h. - Neue jungsteinzeitliche Grabfunde von Riegel, Kreis Emmendingen. Archäologische Ausgrabungen in Baden-Wurttemberg, p.75-79.
Schmotz 1992 Schmotz K. - Eine Gräbergruppe der Glockenbecherkultur von Künzing, Lkr. Deggendorf. In : sChMotz k. (hrG.) - Vorträge des 10 Niederbayerischen Archäologentages. Deggendorf, 1992, p.41-68.
Schmotz 1994 Schmotz K. - Eine Gräbergruppe der Glockenbecherkultur von Osterhofen- Altenmarkt. Archäologische Denkmäler im Landkreis Deggendorf 9, Deggendorf, 1994.
Schnitzler 2009 sChnitzler B. (Dir.) - 10 000 ans d’Histoire ! Dix ans de fouilles archéologiques en Alsace. catalogue d’exposition, Musées de Strasbourg, 2009
Schröter 2005 Schröter p. - Ein jüngerglockenbecherzeitlicher Begräbnisplatz und einzelne Gräber der Glockenbecherkultur von Regensburg-Burgweinting. Beitr. Arch. Oberpfalz u. Regensburg, 7, 2005, p.39-76.
Schweitzer 1987 sChweitzer J. - Le site Michelsberg de Didenheim, Cahiers de l’Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace, 3,1987, p.50- 87
Schweitzer et Fulleringer 1973 sChweitzer J., fullerinGer r. - Découverte de fosses Michelsberg à Riedisheim. Bulletin du Musée Historique de Mulhouse, LXXXI, 1973, p.23- 38.
Sheridan 2008 SheridAN A. – Upper Largie and Dutch-Scottish connections during the Beaker period. In : fokkens h., Coles B. J., van GiJn a. l., kleiJne J. P., PonJee h., slaPPenDel C. G. (eD.) – Between foraging and farming. Analecta Praehistorica Leidensia, 40, 2008, p.248-260.
Smith 2006 sMith J. -. Early Bronze Age stone wrist-guards in Britain : Archer’s bracer or social symbol ? http://www.geocities.com/archchaos1/article1/1.htm 1, 2006, p.1–37.
Strahm 1995 strahM C. (Dir.) - Das Glockenbecherphänomen. Ein Seminar. Freiburger Archäologische Studien 2, Freiburg, 1995.
Tchérémissinoff et al. 2011 tChéréMissinoff Y., esCallon G., Donath r. - Le coffre lithique campaniforme ou épicampaniforme du site de G. Besse II.5, Nîmes (Gard). In : Salanova et Tchérémissinoff 2011, p.167-176.
Tchérémissinoff et al 2011b tChéréMissinoff Y., Convertini f., fouéré P., salanova l. - La Sépulture Campaniforme De La Folie, Poitiers (Vienne). In : Salanova et Tchérémissinoff 2011, p.11-19.
Treinen 1970 treiNeN F. - Les poteries campaniformes en France, Gallia Préhistoire, 13, 1970, n°1 p.53-107, n°2 p.263-332.
Turek 2000 turek J. - Being a Beaker child. The position of children in Late Eneolithic society. In : In Memoriam Jan Rulf, Památky archeologické, Supplementum, 13, Praha, p.422- 436.
Turek 2004 turek J. - Craft symbolism in the Bell Beaker burial customs. Resources, production and social structure at the end of Eneolithic period. In : Besse M. unD DesiDeri J. (hrG.) - Graves and Funerary Rituals during the Late Neolithic and the Early Bronze Age in Europe (2700-2000 BC). Proceedings of the International Conference held at the Cantonal Archaeological Museum, Sion (Switzerland) October 4th-7th 2001, 2004, p.147-156.
Turek 2006 turek J. - Období zvoncovitých pohárů v evropě. Archeologie ve středních čechách, 10, 2006, p.275–368
Turek 2006b turek J. - Beaker barrows and the houses of dead, In : Šmejda L. (dir) - Archaeology of Burial Mounds. Archaeologica (Ústínad Labem, Czech Republic). University of West Bohemia, Department of Archaeology, 2006, p.170-179
Ulrich 1942 ulrich h. - Ein Zonenbechergrab von Achenheim im Elsass, Germania, 26, 1942, p.175-177.
Vander Linden 2006 vANder liNdeN m. - Le phénomène campaniforme dans l'Europe du 3ème millénaire avant notre ère. Synthèse et nouvelles perspectives. British Archaeological Reports International Series 1470, Archaeopress, Oxford, 2006.
Vokolek 1965 voKoleK v. - Pohřebiště zvoncovitých poháru v Rosnicích. Arch. Rozhledy, 17, 1965, p.613-616 u. 645f.
Wolf 1969 wolf J.-J. - Découverte récente d'une nécropole chalcolithique à Habsheim-Est, Bulletin du Musée Historique de Mulhouse, 77, 1969, p.15-37
Wolf 1972 wolf J.-J. - La station du Bronze final III d’Uffheim Niederer Linsenberg. Bulletin du Musée Historique de Mulhouse, LXXX, 1972, p.29-45
Wolf 1979 wolf J.- J. - Nouveaux éléments du Michelsberg à Eschentzwiller et Magstatt-Le-Bas. Bulletin du Musée Historique de Mulhouse, LXXXVI, 1979, p.29- 38
Wolf 1989 wolf J.-J. - Un dépôt de crémation du Bronze final IIb-III à Uffheim (Haut-Rhin), In : L’Alsace celtique. 20 ans de recherche, catalogue d’exposition. Musée d’Unterlinden, Colmar, 1989, p.43-45.
Wolf et al. 1985. wolf J.-J., heiDinGer a., viroulet J.-J. - Sierentz, 5000 ans d’Histoire, Etat des recherches archéologiques 1977-1985. Ann. Soc. Hist. Hochkirch et Hte-Als., 1985, p.1-103.
Wolf et al. 1993 wolf J.-J., viroulet B., trouChauD n. - Sierentz "Sandgrube" (Haut-Rhin) : un village rubané récent : contexte du mobilier et étude de la céramique, Cahiers de l'Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace, 9, 1993, p.137-180
Zehner 1994 zehNer m. - Sierentz, deux fours de La Tène finale : étude de la céramique. Mémoire de DEA, Université de Strasbourg 2, Strasbourg, 1994
Zehner 1995 zehNer m. - Sierentz-Landstrasse (Haut-Rhin). Les fours de La Tène finale. Etude de la céramique, Cahiers de l’Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace, 11, 1995, p.25-65.
Zehner 2000 zehNer m. - Etude de la céramique de La Tène finale et du début de l'époque romaine en Alsace, Thèse de doctorat, sous la direction de X. Lafon, Université Marc Bloch, Strasbourg, 2000.
Zehner et Bakaj 2001 zehner M. et BakaJ B. - Ensisheim-Reguisheimerfeld-THK 2000 (Haut-Rhin). D.F.S. de fouilles de sauvetage urgent, Antea Sàrl, S.R.A., Alsace, Strasbourg, avril 2001
Zumstein 1965 zumSteiN c. - L’Âge du Bronze dans le département du Haut-Rhin. Revue archéologique de l’Est et du Centre-Est, XVI, 1965, p.7-56.
LISTE DES FIGURES DANS LE TEXTE
INTRODUCTION
Fig. 1 : Localisation de Sierentz dans le sud de la plaine du Rhin supérieur 31Fig. 2 : Localisation de la fouille sur un extrait du fond de carte IGN au 1/25000 31Fig. 3 : Carte archéologique de la commune de Sierentz 32Fig. 4 : Périodes représentées sur la commune de Sierentz 35Fig. 5 : Liste des sites archéologiques de la commune de Sierentz 36Fig. 6 : Vue de la zone de fouille avant décapage 38Fig. 7 : Plan phasé général 39Fig. 8 : Vue d’une bande de terrain décapée, vide de structure 41Fig. 9 : Vue de la bande décapée contigüe à celle de la vue précédente, illustrant le stockage de la terre 41
NEOLITHIQUE
Néolithique moyenFig. 10 : Localisation des structures Bruebach-Oberbergen 43Fig. 11 : Vue en coupe des structures 116 et 123 44Fig. 12 : Organisation spatiale et coupes des fentes 46Fig. 13 : Mobilier Bruebach-Oberbergen 47Fig. 14 : Carte des sites Bruebach-Oberbergen du sud de la plaine du Rhin supérieur 48Fig. 15 : Inventaire des structures du Néolithique moyen (1/2) 50Fig. 16 : Inventaire des structures du Néolithique moyen (2/2) 51Fig. 18 : Inventaire descriptif du matériel lithique néolithique moyen 52Fig. 17 : Inventaire descriptif de la céramique néolithique moyen 52
Néolithique récentFig. 19 : Localisation des structures Munzingen 53Fig. 20 : Vue en coupe de la St 117 55Fig. 22 : Plan et coupe de la St 90 56Fig. 21 : Vue en plan de la St 90 56Fig. 23 : Plan, coupe et vues des squelettes de la St 138 58Fig. 24 : Mobilier céramique de la St 39 59Fig. 25 : Mobilier céramique de la St 90 60Fig. 26 : Mobilier céramique de la St 90 61Fig. 27 : Mobilier céramique de la St 117 62Fig. 28 : Mobilier de la St. 117 64Fig. 29 : Mobilier issu du diagnostic 64Fig. 30 : Tableau synthétique des datations carbone 14 des structures 90 et 117 66Fig. 31 : Carte des sites du Néolithique récent dans le sud de l’Alsace 68Fig. 32 : Inventaire des structures du Néolithique récent 69Fig. 33 : Inventaire descriptif de la céramique du Néolithique récent 70Fig. 35 : Inventaire descriptif du matériel en silex du Néolithique récent 71Fig. 34 : Tableau de comptage de la céramique du Néolithique récent 71Fig. 36 : Inventaire descriptif du matériel lithique du Néolithique récent (hors silex) 72Fig. 37 : Inventaire descriptif du matériel en matière dure animale du Néolithique récent 72Fig. 38 : Tableau de comptage des restes de faune dans les structures du Néolithique récent 72
Néolithique finalFig. 39 : Localisation et plan de l’ensemble funéraire campaniforme 73Fig. 40 : Plan et coupe de la sépulture 10 75Fig. 41 : Mobilier céramique de la sépulture 10 75Fig. 43 : Plan et coupes de la sépulture 68 76Fig. 42 : Vue en plan de la sépulture 68 76Fig. 44 : Traces ligneuses sur le fond de la structure 68 78Fig. 46 : Localisation des traces d’architecture dans la sépulture 68 et proposition d’effets de parois 78Fig. 45 : Fragment calcifié du piquet nord de la sépulture 68 78Fig. 47 : Proposition de restitution de l’architecture de la sépulture 68 79Fig. 48 : Vases de la sépulture 68 80Fig. 49 : Armatures de flèches de la sépulture 68 81Fig. 50 : Mobilier de la sépulture 68 82Fig. 51 : Brassard d’archer de la sépulture 68 et vue de l’objet en cours de fouille 83Fig. 52 : «Pierre à rainures» de la sépulture 68 83Fig. 53 : Position des objets dans la sépulture 68 84Fig. 54 : Plan et coupes de la sépulture 69 85Fig. 55 : Vue en plan de la sépulture 69 85Fig. 56 : Localisation des traces ligneuses dans la sépulture 69 et proposition d’effets de parois 86Fig. 57 : Proposition de restitution de l’architecture de la sépulture 69 87Fig. 58 : Vases de la sépulture 69 87Fig. 59 : Mobilier de la sépulture 69 90Fig. 60 : Armatures de flèches de la sépulture 69 91Fig. 61 : «Pierre à rainure» de la sépulture 69 92Fig. 62 : Pendentif arciforme de la sépulture 69 92Fig. 63 : Fragment de marcassite et éclat de silex (Kit de briquet) de la sépulture 69 93Fig. 64 : Position des objets dans la sépulture 69 94Fig. 65 : Vue de la sépulture 137 94Fig. 66 : Plan et coupe de la sépulture 137 95Fig. 67 : Mobilier de la sépulture 137 96Fig. 68 : Carte des sépultures campaniformes dans le sud de la plaine du Rhin supérieur 98Fig. 69 : Localisation des sites mentionnés dans le texte 99Fig. 70 : Sites campaniformes mentionnés dans le texte et représentés sur la figure 69 100Fig. 71 : Quelques exemples d’organisations spatiales des sépultures campaniformes 102Fig. 72 : Exemples d’architectures funéraires campaniformes 104Fig. 73 : Planche récapitulative des vases décorés 106Fig. 74 : Quelques exemples de gobelets décorés 107Fig. 75 : Planches récapitulative du mobilier en silex 109Fig. 76 : Répartition des armatures de flèches en fonction de leurs proportions Longueur / Largeur 110Fig. 77 : Planche récapitulative du mobilier en pierre dure et en marcassite 112Fig. 78 : Exemples de brassards d’archer biforés et reconstitution d’un brassard d’archer en position 112Fig. 79 : Quelques exemples de «pierre à rainures» 113Fig. 80 : Planche récapitulative du mobilier en matière dure animale 114Fig. 81 : Exemples de pendentifs arciformes à perforation verticale 115Fig. 82 : La sépulture 9 de Künzing-Bruck (Ldkr. Deggendorf, Niederbayern, D.) 116Fig. 83 : Tableau récapitulatif des datations C14 des sépultures campaniformes de Sierentz 118Fig. 84 : Inventaire des structures campaniformes 121
Fig. 85 : Inventaire de la céramique campaniforme 122Fig. 86 : Inventaire du matériel lithique campaniforme (hors silex) 122Fig. 87 : Inventaire du mobilier en matière dure animale 122Fig. 88 : Inventaire du mobilier campaniforme en silex 123
Néolithique indéterminéFig. 89 : Localisation des structures du Néolithique indéterminé 125Fig. 90 : Inventaire des structures du néolithique indéterminé 126Fig. 91 : Inventaire de la céramique du Néolithique indéterminé 127Fig. 92 : Inventaire du matériel lithique du Néolithique indéterminée 127Fig. 93 : Inventaire du matériel osseux et de la TCA du Néolithique indéterminé 127
PROTOHISTOIRE
Bronze final IFig. 94 : Localisation de la structure Bronze final I 129Fig. 95 : Vue en plan et en coupe de la St. 1 130Fig. 96 : Plan et coupe de la structure 1 et restitution du profil du vase 131Fig. 97 : Quelques comparaisons régionales à l’échelle d’urnes de grand gabarit à profil piriforme et à encolure distincte et développée du début du Bronze Final 132
Bronze final IIb / IIIaFig. 98 : Vue de la structure 105 134Fig. 99 : Localisation des structures du Bronze final IIb / IIIa 135Fig. 100 : Vue de la structure 105 136Fig. 101 : Typologie céramique du Bronze final 137Fig. 102 : Matériel céramique des structures 72 et 73 139Fig. 103 : Matériel céramique de la structure 105 140 Fig. 104 : Mobilier céramique des structures 65, 97 et 100 141Fig. 105 : Principaux ensembles céramiques du Bronze final IIb / IIIa de Sierentz «Les Villas d’Aurèle» 143Fig. 106 : Dépôt d’écuelles retournées de la structure 105 145Fig. 107 : Dépôt céramique de la structure 73 146Fig. 108 : Carte de répartition des meules en «brèche permienne» 148Fig. 109 : Répartition du mobilier céramique dans les structures du Bronze final IIb / IIIa 149Fig. 110 : Inventaire des structures du Bronze final 151Fig. 111 : Inventaire de la céramique de l’Age du Bronze 152Fig. 112 : Inventaire du mobilier lithique et métallique de l’Age du Bronze 153Fig. 113 : Inventaire des restes animaux présents dans les structures de l’Age du Bronze 153
Hallstatt D1Fig. 114 : Localisation des structures Hallstatt 155Fig. 115 : Vue en coupe de la structure 71 156Fig. 116 : Typologie céramique Hallstatt 157Fig. 117 : Matériel céramique de la structure 71 159Fig. 118 : Matériel des structures 108 et 109 160Fig. 119 : Classement sérié des différents éléments de formes et de décors des ensembles hallstattiens en Alsace et intégration du mobilier de Sierentz 162Fig. 120 : Inventaire des structures Hallstatt 164
Fig. 121 : Inventaire de la céramique Hallstatt 165Fig. 122 : Inventaire du mobilier lithique des structures Hallstatt 166Fig. 123 : Inventaire des restes animaux présents dans les structures Hallstatt 166Fig. 124 : Localisation des structures de l’époque protohistorique indéterminée 167Fig. 125 : Inventaire de la céramique d’époque protohistorique indéterminée 168Fig. 126 : Inventaire des structures d’époque protohistorique indéterminée 169
STRUCTURES NON-DATEES
Néolithique ou ProtohistoireFig. 127 : Localisation des structures néolithiques ou protohistoriques 171Fig. 128 : Inventaire de la céramique néolithique ou protohistorique 172Fig. 129 : Inventaire du mobilier (hors céramique) néolithique ou protohistorique 172Fig. 130 : Inventaire des structures néolithiques ou protohistoriques 173
Période indéterminéeFig. 131 : Localisation des structures de période indéterminée 174Fig. 132 : Inventaire des structures d’époque indéterminée 176
CONCLUSION GENERALE
Fig. 133 : Périodes représentées sur la commune de Sierentz, incluant le site «Les Villas d’Aurèle» (en hachuré) 178
Sommaire
Planches I à XXV : Structures néolithiques
- Planches I à XV : Structures du Néolithique moyen
- Planches XVI à XXI : Structures du Néolithique récent
- Planches XXII à XXIV : Structures du Néolithique final
- Planche XXV : Structures néolithiques indéterminées
Planches XXVI à XXXVIII : Structures protohistoriques
- Planche XXVI : Structure du Bronze final I
- Planches XXVII à XXXII : Structures du Bronze final IIb
- Planches XXXIII à XXXVI : Structures du Hallstatt D1
- Planches XXXVII à XXXVIII : Structures protohistoriques indéterminées
Planches XXXIX à XLI : Structures protohistoriques ou néolithiques
Planches XLII à LIV : Structures de période indéterminée
n° de la structure
n° de la planche
n° de la structure
n° de la planche
n° de la structure
n° de la planche
1 XXVI 51 XXVII 101 XXXII2 XLII 52 XLIX 102 XXXII3 XVI 54 XXV 104 XXXII4 XLII 55 III 105 XXXII5 XLII 56 XXXIII 106 XXXII6 I 57 XXVII 107 LI8 XLIII 60 XIX 108 XXXV9 I 61 IV 109 XXXVI10 XXII 63 IV 110 LI11 XLIII 64 V 111 X12 II 65 XXVIII 112 LII14 II 66 XXXIV 113 X15 XVII 67 XL 115 LII17 III 68 XXIII 116 XI18 XLIII 69 XXIV 117 XX19 XLIV 71 XXXIV 119 XXXVII21 XLIV 72 XXVIII 120 XLI22 XXV 73 XXVIII 122 LIII24 XLV 74 XXIX 123 XI25 XLV 76 V 124 XII26 XLV 78 VI 125 XII27 XLV 79 VI 126 LIII28 XLV 80 L 127 XII29 XLV 81 VII 128 XIII30 XLV 82 VII 129 LIII31 XLV 84 VIII 130 XIII32 XLVI 85 VIII 131 XIV33 XLVI 87 IX 132 XIV37 XLVI 88 IX 133 XIV38 XLVII 89 XXIX 134 XV39 XVIII 90 XVIII 135 XV40 XLVIII 91 XVIII 136 XXXVIII43 XXXIX 92 IX 137 XXII44 XXXIII 94 L 138 XXI46 XLIX 95 LI 139 XV47 III 97 XXX 140 XV49 XLIX 98 XL 141 LIV50 XXXIX 100 XXX 142 XXXVII
Index des structures
Limon loessique brun clair / jaune hétérogène meuble + inclusions calcaire (Loess remanié)
Limon loessique brun / jaune hétérogène compact
Limon lehmique brun sombre hétérogène compact
Limon lehmique brun hétérogène compact
Limon lehmique brun et limon loessique brun / jaune hétérogène compact
Limon lehmique brun hétérogène compact + inclusions charboneuse
Céramique
Silex
Pierre
Reste de faune / objet en matière dure animale
Ossement humain
Types de sédiments :
Catégories de mobilier récurrentes :
Charte graphique des planches structures
0 20 cm 1 m
N
St. 6
St. 9
N
Planche I :Structures 6 et 9
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
Limon loessique brun clair / jaune hétérogène meuble + inclusions calcaire (Loess remanié)
Limon loessique brun / jaune hétérogène compact
Limon lehmique brun sombre hétérogène compact
Limon lehmique brun hétérogène compact
Limon lehmique brun et limon loessique brun / jaune hétérogène compact
Limon lehmique brun hétérogène compact + inclusions charboneuse
Céramique
Silex
Pierre
Reste de faune / objet en matière dure animale
Ossement humain
Types de sédiments :
Catégories de mobilier récurrentes :
Charte graphique des planches structures
N St. 17
St. 47
N
Moitié coupée par l’INRAP
N
St. 55
0 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
Planche III :Structures 17, 47 et 55(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
St. 12
N
St. 14
N
0 20 cm 1 m
Planche II :Structures 12 et 14
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
N
St. 60 (cf. Pl. XIX)
Limite à 30 cm
Limite sous St 60
0 20 cm 1 mSt. 76
64 B 64 A
N
St. 64
0 2,50 m 1 m
Planche V :Structure 64 et 76
(Relevé : SCO, LV ; DAO : LB)
N
St. 81
ST. 82
N
0 20 cm 1 m
Planche VII :Structures 81 et 82
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
N
St. 78
N
St. 79
0 20 cm 1 m
Planche VI :Structures 78 et 79
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
NSt. 87
N
St. 88
N
St. 920 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
Planche IX :Structures 87, 88 et 92(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
NSt. 84
N
St. 85
0 20 cm 1 m
Planche VIII :Structures 84 et 85
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
N
St. 116
N
St. 123
0 20 cm 1 m
Planche XI :Structures 116 et 123
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
N St. 113
NSt. 111
0 20 cm 1 m
Planche X :Structure 111 et 113
(Relevé : SCO, LV ; DAO : LB)
N
St. 124
N
St. 125
NSt. 127
0 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
Planche XII :Structures 124, 125 et 127
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
N
St. 131
NSt. 132
NSt. 133
0 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
Planche XIV :Structure 131, 132 et 133
(Relevé : SCO, LV ; DAO : LB)
N St. 134
NSt. 135
N
St. 139
St. 140
N
0 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
Planche XV :Structures 134, 135, 139 et 140
(Relevés : SCO, LV, INRAP ; DAO : LB, F.LATRON 5INRAP))
N
St. 131
NSt. 132
NSt. 133
0 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
Planche XIV :Structure 131, 132 et 133
(Relevé : SCO, LV ; DAO : LB)
Moitié coupée par l’INRAP
020
cm
1 m
N
Planche XVII :Structure 15
(Relevé : SCO, INRAP ; DAO : LB, F.LATRON (INRAP))
0 20 cm 1 m
N
Planche XVI :Structure 3
(Relevé : LV ; DAO : LB)
N
N
Individu 1
Individu 2
Amas de matériel
Niveau de dépot de l’individu 1
N
0 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
St. 39
St. 90
St. 91
Planche XVIII :Structures 39, 90 et 91
(Relevés : SCO, ECM, SGO, LV ; DAO : LB, HBE)
St. 7
6 (c
f. P
l. V
)
St76
sou
s la
foss
e-si
lo
St. 7
6 (c
f. P
l. V
)(o
bser
vée
à e
nviro
n 30
cm
de
prof
onde
ur)
St. 6
0
St. 6
0
ST.
060
020
cm
1 m
N
Planche XIX :Structure 60
(Relevé : SCO, LV ; DAO : LB)
N
N
Individu 1
Individu 2
Amas de matériel
Niveau de dépot de l’individu 1
N
0 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
St. 39
St. 90
St. 91
Planche XVIII :Structures 39, 90 et 91
(Relevés : SCO, ECM, SGO, LV ; DAO : LB, HBE)
0 20 cm 1 m
N
Niveau d’apparitiondes squelettes
Planche XXI :Structure 138
(Relevé : INRAP ; DAO : F.LATRON (INRAP), HBE)
(La localisation des objets a été effectué d’après la description textuelle de la tombe)
N
St. 137
Localisation desrestes humains
N
St. 10
0 20 cm 1 m
Planche XXII :Structures 10 et 137
(Relevés : SCO, INRAP ; DAO : HBE, F. LATRON (INRAP), LV)
Traces noires ligneuses
Concrétions calcaires blanches
Schiste
Grès
N
0 1 m20 cm
Planche XXIII :Structure 68
(Relevé : SCO, HBE ; DAO : HBE, LV)
(La localisation des objets a été effectué d’après la description textuelle de la tombe)
N
St. 137
Localisation desrestes humains
N
St. 10
0 20 cm 1 m
Planche XXII :Structures 10 et 137
(Relevés : SCO, INRAP ; DAO : HBE, F. LATRON (INRAP), LV)
Traces noires ligneuses Grès
0 20 cm 1 m
Marcassite
N
Planche XXIV :Structure 69
(Relevé : SCO, HBE ; DAO : HBE, LV)
N
St. 54
Moitié coupée par l’INRAP
N
St. 22
0 20 cm 1 m
Planche XXV :Structures 22 et 54
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
Niveau de décapage
Terre végétale + lehm
N
0 20 cm 1 m
Planche XXVI :Structures 1
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
N
St. 51
NSt. 57
0 20 cm 1 m
Planche XXVII :Structures 51 et 57
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
Niveau de décapage
Terre végétale + lehm
N
0 20 cm 1 m
Planche XXVI :Structures 1
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
0 20 cm 1 m
N
St. 65
N St. 72
NSt. 73
0 20 cm 1 m
Planche XXVIII :Structures 65, 72 et 73
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
NSt. 74
N
St. 89
St. 3
8
St. 38
0 20 cm 1 m
Planche XXIX :Structures 74 et 89
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
0 20 cm 1 m
N
St. 65
N St. 72
NSt. 73
0 20 cm 1 m
Planche XXVIII :Structures 65, 72 et 73
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
N St. 101
NSt. 102
N St. 104
0 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
Planche XXXI :Structures 101, 102 et 104
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
N
St. 100
N
St. 97
0 20 cm 1 m
Planche XXX :Structures 97 et 100(Relevés : SCO ; DAO : LB)
N St. 44
N
St. 56
0 20 cm 1 m
Planche XXXIII :Structures 44 et 56
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
N
St. 105
NSt. 106
0 20 cm 1 m
Planche XXXII :Structures 105 et 106(Relevés : SCO ; DAO : LB)
0 20 cm 1 m
N
St. 119 et 142
St. 119
St. 142
Planche XXXVII :Structures 119 et 142(Relevés : SCO ; DAO : LB)
N
0 20 cm 1 m
Planche XXXVI :Structures 109
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
N
St. 43
N
St. 50
0 20 cm 1 m
Planche XXXIX :Structures 43 et 50
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
0 20 cm 1 m
N
Planche XXXVIII :Structure 136
(Relevé : SCO ; DAO : LB)
Berm
eBerm
e
N
0 1 m 2 m
Planche XLI :Structure 120
(Relevé : SCO ; DAO : LB)
N
St. 67
N
St. 98
Planche XL:Structures 67 et 98
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
0 20 cm 1 m
St. 5
N
St. 4
N
St. 2 N
0 20 cm 1 m
Planche XLII :Structures 2, 4 et 5
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
0 20 cm 1 m
N
St. 18
St. 11
N
St. 8N
0 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
Planche XLIII :Structures 8, 11 et 18
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
St. 5
N
St. 4
N
St. 2 N
0 20 cm 1 m
Planche XLII :Structures 2, 4 et 5
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
0 20 cm 1 m
0 5 m 1 m
St. 24St. 25St. 26St. 27St. 28St. 29St. 30St. 31
N
0 20 cm 1 m
St. 24St. 25St. 26St. 27St. 28St. 29St. 30St. 31
Berme
Planche XLV :Structures 24 à 31(Relevés : LV ; DAO : LB)
N
St. 19
N
St. 21
0 20 cm 1 m
Planche XLIV :Structures 19 et 21(Relevés : LV ; DAO : LB)
N St. 32
NSt. 33
St. 3
8
N St. 37
St. 38
0 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
Planche XLVI :Structures 32, 33 et 37
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
Cpe 1
Cpe 3
Cpe 2
0 20 cm 1 m
St. 37
St. 89
St. 37
Cpe 1
Cpe 2
Cpe 3
Cpe 4
Cpe 4
0 1 m 5 m
St. 89
N
Plan :
Coupes :
Planche XLVII :Structure 38
(Relevé : SCO, LV ; DAO : LB)
N St. 32
NSt. 33
St. 3
8
N St. 37
St. 38
0 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
Planche XLVI :Structures 32, 33 et 37
(Relevés : SCO ; DAO : LB)
Cpe 1
Cpe 1
Cpe 2
Cpe 2
Cpe 3
Cpe 3
Cpe 4
Cpe 4
1 m 5 m
0 20 cm 1 m
Coupes :
0
Plan :
N
Planche XLVIII :Structure 40
(Relevé : SCO, LV ; DAO : LB)
N St. 46
Moitié coupéepar l’INRAP
NSt. 49
N St. 52
0 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
Planche XLIX :Structures 46, 49 et 52
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
Cpe 1
Cpe 1
Cpe 2
Cpe 2
Cpe 3
Cpe 3
Cpe 4
Cpe 4
1 m 5 m
0 20 cm 1 m
Coupes :
0
Plan :
N
Planche XLVIII :Structure 40
(Relevé : SCO, LV ; DAO : LB)
N St. 95
NSt. 107
N
St. 110
0 20 cm 1 m
0 20 cm 1 m
Planche LI :Structures 95, 107 et 110
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
N St. 94
NSt. 94
0 20 cm 1 m
Planche L :Structures 80 et 94
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
0 20 cm 1 m
N
St. 122
Berme
Berm
e
N St. 126
N St. 129
0 20 cm 1 m
Planche LIII :Structures 122, 126 et 129
(Relevés : SCO, LV ; DAO : LB)
N
St. 112
N
St. 115
0 20 cm 1 m
Planche LII :Structures 112 et 115(Relevés : SCO ; DAO : LB)
N° d
e St
ruct
ure
Equi
vale
nce
num
érot
atio
n St
. D
iag.
Parc
elle
Type
Plan
Prof
ilO
rient
atio
nR
elat
ions
Long
ueur
(m
.)La
rgeu
r (m
.)D
iam
ètre
(m.)
Prof
onde
ur
(m.)
Rem
plis
sage
Mob
ilier
Dat
atio
nO
bser
vatio
nPl
anch
e
1 -
12V
PC
ircul
aire
cuve
tte -
- -
-0,
74 -
limon
lehm
ique
bru
nC
éram
ique
Bro
nze
final
I -
XX
VI
2 -
12FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
1,22
0,24
lehm
bru
n co
mpa
ct e
t hom
ogèn
eØ
Indé
term
inée
-X
LII
3 -
13S
IE
lliptiq
uefo
nd p
lat
- -
1,8
1,42
-1,
345
couc
hes;
alte
ranc
e de
loes
s et
lehm
, bru
n à
noir
Cér
amiq
ue ;
Lith
ique
; cha
rbon
Néo
lithiq
ue ré
cent
/ M
unzi
ngen
-X
VI
4 -
14FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
1;5
0,4
limon
lehm
ique
bru
n, c
ompa
ct e
t hom
ogèn
e. +
sé
dim
ent n
oir c
harb
onne
uxØ
Indé
term
inée
-X
LII
5 -
14FS
Obl
ongu
ecu
vette
N/S
-3,
421,
56 -
0,24
limon
lehm
ique
bru
n co
mpa
ct e
t hom
ogèn
eØ
Indé
term
inée
-X
LII
6 -
12FT
Obl
ongu
een
VN
/S -
2,72
0,7
-0,
86lim
on le
hmiq
ueco
mpa
ct e
t lim
on lo
essi
que
com
pact
ave
c gr
ain
de c
alca
ire.
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
I
8 -
12FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
0,9
0,2
limon
lehm
ique
bru
n co
mpa
ct e
t hom
ogèn
eØ
Indé
term
inée
-X
LIII
9 -
12FT
Obl
ongu
een
VN
E/S
O -
2,74
0,66
-1
limon
lehm
ique
bru
n co
mpa
ct a
vec
poch
es d
e lo
ess
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
I
10 -
12S
PQ
uadr
angu
laire
cuve
tteN
/S -
1,5
1 -
0,05
Lim
on lo
essi
que
brun
Cér
amiq
ue ;
Oss
emen
ts
hum
ains
;
Néo
lithiq
ue fi
nal /
C
ampa
nifo
rme
1 in
divid
uX
XII
11 -
12FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,52
0,2
limon
lehm
ique
bru
n co
mpa
ct e
t hom
ogèn
eØ
Indé
term
inée
-X
LIII
12 -
12FT
Obl
ongu
een
VN
NO
/SS
E -
3,16
0,8
-1,
44lim
on le
hmiq
ue b
run
com
pact
et h
omog
ène
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
II
14 -
12FT
Obl
ongu
een
VE
/O -
2,22
1,16
-0,
82
couc
hes
limon
lehm
ique
con
cret
ionn
é, lim
on
lehm
ique
bru
n co
mpa
ct e
t hom
ogèn
eØ
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-II
15FS
104
12FS
Pat
atoï
defo
nd p
lat
- -
- -
2,56
1,95
6 co
uche
s al
tern
ance
de
lehm
bru
n cl
air e
t fo
ncé,
loes
s et
cha
rbon
sC
éram
ique
;
Lith
ique
; Fa
une
Néo
lithiq
ue ré
cent
/ M
unzi
ngen
-X
VII
17 -
13FT
Obl
ongu
een
VE
/O -
2,6
0,52
-0;
68lim
on le
hmiq
ue b
run
com
pact
et h
omog
ène.
Li
mon
lehm
ique
+ lo
ess
conc
rétio
nné
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
III
18 -
11FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,42
0,36
limon
lehm
ique
bru
n so
mbr
e, p
eu c
ompa
ct,
hom
ogèn
eØ
Indé
term
inée
-X
LIII
19 -
11FS
Obl
ongu
efo
nd p
lat
N/S
-1,
820,
82 -
0,2
limon
lehm
ique
bru
n cl
air,
com
pact
hom
ogèn
eØ
Indé
term
inée
-X
LIV
21 -
10FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
1,62
0,3
limon
lehm
ique
bru
n co
mpa
ct h
omog
ène
ØIn
déte
rmin
ée -
XLI
V22
-35
7FS
Ova
leen
cuv
ette
N/S
-2,
11,
46 -
0,4
limon
lehm
ique
bru
n fo
ncé
Lith
ique
Néo
lithiq
ue -
XX
V24
FO 1
25 e
t 126
355
FSO
blon
gue
cuve
tteN
/S -
12 -
- -
Lim
on lo
essi
que
brun
ØIn
déte
rmin
ée -
XLV
25FO
125
et 1
2635
5FS
Obl
ongu
ecu
vette
N/S
-12
- -
-Li
mon
loes
siqu
e br
unØ
Indé
term
inée
-X
LV26
FO 1
25 e
t 126
355
FSO
blon
gue
cuve
tteN
/S -
12,2
5 -
- -
Lim
on lo
essi
que
brun
ØIn
déte
rmin
ée -
XLV
27FO
125
et 1
2635
5FS
Obl
ongu
ecu
vette
N/S
-12
,25
- -
-Li
mon
loes
siqu
e br
unØ
Indé
term
inée
-X
LV28
FO 1
25 e
t 126
355
FSO
blon
gue
cuve
tteN
/S -
12,7
5 -
- -
Lim
on lo
essi
que
brun
ØIn
déte
rmin
ée -
XLV
29FO
125
et 1
2635
5FS
Obl
ongu
ecu
vette
N/S
-13
- -
-Li
mon
loes
siqu
e br
unØ
Indé
term
inée
-X
LV30
FO 1
25 e
t 126
355
FSO
blon
gue
cuve
tteN
/S -
13,2
5 -
- -
Lim
on lo
essi
que
brun
ØIn
déte
rmin
ée -
XLV
31FO
125
et 1
2635
5FS
Obl
ongu
ecu
vette
N/S
-13
,5 -
- -
Lim
on lo
essi
que
brun
ØIn
déte
rmin
ée -
XLV
32 -
353
FSC
ircul
aire
cuve
tte -
- -
-1
0,16
mel
ange
de
loes
s et
de
terre
vég
étal
e +
lehm
ØIn
déte
rmin
ée -
XLV
I33
-35
3FS
Circ
ulai
recu
vette
irré
guliè
re -
- -
-1,
30,
32m
élan
ge d
e te
rre v
égét
ale
et lo
ess
+ le
hmØ
Indé
term
inée
-X
LVI
37 -
4FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
0,75
0,17
limon
lehm
ique
cal
caire
bru
n co
mpa
ctØ
Indé
term
inée
-X
LVI
38 -
4FO
Rec
tilign
ecu
vette
NO
/SE
-43
,75
0,7
-0,
2lim
on lo
essi
que
brun
cla
irØ
Indé
term
inée
-X
LVII
39 -
3FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,54
0,76
4 co
uche
s: le
hm b
run
et c
ompa
ct, l
oess
re
man
ié, l
ehm
cha
rbon
neux
con
crét
ion
calc
aire
s
Cér
amiq
ue ;
Faun
e ; L
ithiq
ue ;
N
éolith
ique
réce
nt /
Mun
zing
en -
XV
IIIre
man
ié, l
ehm
cha
rbon
neux
con
crét
ion
calc
aire
sTo
rchi
sM
unzi
ngen
40FO
108
3FO
Rec
tilign
een
cuv
ette
NO
/SE
-88
,75
max
1,2
-m
ax 0
,6lim
on lo
essi
que
brun
cla
irC
éram
ique
; Fa
une
; Lith
ique
; M
étal
Indé
term
inée
-X
LVIII
43 -
1FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
1,95
0,42
Lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
, hét
érog
ène
Cér
amiq
ue ;
Faun
eN
éolith
ique
/ P
roto
hist
oire
-X
XX
IX
44 -
1FS
Ova
lefo
nd p
lat
N/S
-1,
651,
49 -
0,7
3 co
uche
s, lim
on le
hmiq
ue b
run
clai
r à b
run
fonc
é, +
loes
s re
man
iéC
éram
ique
Hal
lsta
tt D
1 -
XX
XIII
46FS
103
12FS
Circ
ulai
reen
cuv
ette
- -
- -
1,3
0,15
limon
lehm
ique
bru
nØ
Indé
term
inée
-X
LIX
47FT
102
12FT
Obl
ongu
een
VN
NO
/SS
E -
2,96
0,4
-0;
78lim
on le
hmiq
ue b
run
fonc
é, c
ompa
ct, i
nclu
sion
de
loes
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
III
49 -
17FS
Circ
ulai
reen
cuv
ette
- -
- -
1,1
0,35
limon
lehm
ique
bru
n, c
ompa
ct, h
omog
ène,
in
clus
ion
de c
harb
ons
et T
CA
ØIn
déte
rmin
ée -
XLI
X
50 -
17FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,9
0,3
Lim
on le
hmiq
ue b
run
à br
un fo
ncé
Cér
amiq
ue ;
Faun
eN
éolith
ique
/ P
roto
hist
oire
-X
XX
IX
51 -
17S
IC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1,
90,
7lim
on le
hmiq
ue b
run
à br
un fo
ncé
Cér
amiq
ue ;
Faun
eB
ronz
e fin
al II
b / I
IIa -
XX
VII
52 -
17FS
Qua
dran
gula
irebo
rd d
roit,
fond
pla
tN
/S -
1,25
0,85
-0,
3lim
on lo
essi
que
brun
cla
ire, m
eubl
eØ
Indé
term
inée
-X
LIX
54FS
101
14FS
Circ
ulai
reen
cuv
ette
- -
- -
1,7
0,27
limon
lehm
ique
bru
n/no
ir, in
clus
ion
de T
C. +
lo
ess
rem
anié
Cér
amiq
ue ;
Lith
ique
; Fa
une
; To
rchi
sN
éolith
ique
-X
XV
55 -
14FT
Obl
ongu
een
VN
E/S
O -
1,8
0,5
-0,
63lim
on le
hmiq
ue b
run
com
pact
et l
oess
ave
c gr
ain
calc
aire
com
pact
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
III
56FS
106
15FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
2,1
0,3
limon
lehm
ique
bru
n cl
air a
vec
poch
e de
loes
s, +
co
ncen
tratio
n ch
arbo
nneu
se d
ans
le fo
ndC
éram
ique
; Fa
une
Hal
lsta
tt D
1 -
XX
XIII
57 -
12FS
Circ
ulai
reirr
égul
ier
- -
- -
1,45
0,5
limon
lehm
ique
bru
n co
mpa
ct e
t hét
érog
ène
Cér
amiq
ue ;
Faun
e ; L
ithiq
ueB
ronz
e fin
al II
b / I
IIa -
XX
VII
60 -
11FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
-re
coup
e S
t. 76
- -
1,9
0,7
limon
lehm
ique
bru
n à
brun
/noi
rC
éram
ique
; Fa
une
; Lith
ique
;N
éolith
ique
réce
nt /
Mun
zing
en -
XIX
61 -
10FT
Obl
ongu
een
VE
/O -
3,1
0,7
-1,
55lim
on le
hmiq
ue c
ompa
ct e
t loe
ss in
duré
ave
c gr
ain
calc
aire
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
IV
63 -
10FT
Rec
tilign
een
cuv
ette
E/O
-2,
850,
35 -
0,15
limon
lehm
ique
bru
n cl
air,
com
pact
, hét
érog
ène
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
IV
N° d
e St
ruct
ure
Equi
vale
nce
num
érot
atio
n St
. D
iag.
Parc
elle
Type
Plan
Prof
ilO
rient
atio
nR
elat
ions
Long
ueur
(m
.)La
rgeu
r (m
.)D
iam
ètre
(m.)
Prof
onde
ur
(m.)
Rem
plis
sage
Mob
ilier
Dat
atio
nO
bser
vatio
nPl
anch
e
64 A
-35
5FS
Circ
ulai
reen
cuv
ette
- -
- -
1,7
0,45
limon
lehm
ique
bru
n fo
ncé
Cér
amiq
ue ;
Lith
ique
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-V
64 B
-35
5FS
Circ
ulai
reen
cuv
ette
- -
- -
4,5
0,5
limon
lehm
ique
bru
n fo
ncé
Cér
amiq
ue ;
Lith
ique
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-V
65 -
8FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
2,75
2,55
-0,
8lim
on le
hmiq
ue a
vec
poch
e de
loes
sC
éram
ique
; Fa
une
; Lith
ique
Bro
nze
final
IIb
/ IIIa
-X
XV
III
66 -
13FS
Circ
ulai
reen
cuv
ette
- -
- -
0,7
0,15
limon
lehm
ique
bru
n/ja
une,
com
pact
, hét
érog
ène
Cér
amiq
ueH
alls
tatt
D1
-X
XX
IV
67 -
8FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,75
0,22
Lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
, hét
érog
ène
Cér
amiq
ue ;
Faun
eN
éolith
ique
/ P
roto
hist
oire
-X
L
68 -
359
SP
Qua
dran
gula
ireP
lat
NN
O/S
SE
-2,
301,
80 -
0,33
3 co
uche
s : l
imon
loes
siqu
e br
un c
ompa
ct, l
imon
lo
essi
que
brun
cla
ir m
eubl
e et
limon
lehm
ique
br
un s
ombr
e
Cér
amiq
ue ;
Lith
ique
; O
ssem
ents
hu
mai
ns ;
Néo
lithiq
ue fi
nal /
C
ampa
nifo
rme
1 in
divid
uX
XIII
69 -
10S
PQ
uadr
angu
laire
Pla
tN
O/S
E -
2,25
1,70
-50
3 co
uche
s : l
imon
loes
siqu
e br
un c
ompa
ct, l
imon
lo
essi
que
brun
cla
ir m
eubl
e et
limon
lehm
ique
br
un s
ombr
e
Cér
amiq
ue ;
Lith
ique
; O
ssem
ents
hu
mai
ns ;
Néo
lithiq
ue fi
nal /
C
ampa
nifo
rme
1 in
divid
uX
XIV
71 -
1S
IC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-2
0,8
limon
lehm
ique
bru
n co
mpa
ct a
vec
char
bon
de
bois
, loe
ss re
man
iéC
éram
ique
; Fa
une
Hal
lsta
tt D
1 -
XX
XIV
72 -
2FS
oval
efo
nd p
lat
- -
- -
1,3
0,15
limon
lehm
ique
bru
n , c
ompa
ct, h
étér
ogèn
eC
éram
ique
Bro
nze
final
IIb
/ IIIa
-X
XV
III
73 -
2FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,5
0,3
limon
lehm
ique
bru
n , c
ompa
ct, h
étér
ogèn
eC
éram
ique
; Fa
une
Bro
nze
final
IIb
/ IIIa
-X
XV
III
74 -
3FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,2
0,15
limon
lehm
ique
bru
n cl
air
Cér
amiq
ueB
ronz
e fin
al II
b / I
IIa -
XX
IX
76 -
11FT
Obl
ongu
een
VN
O/S
Ere
coup
ée p
ar S
t. 60
2,95
0,3
-1,
4lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
Sile
xN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
V
78 -
11FT
Obl
ongu
een
VN
E/S
O -
2,85
0,85
-0,
452
couc
hes,
limon
lehm
ique
bru
n et
loes
s re
man
iéØ
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-V
I
79 -
12FT
Obl
ongu
een
VN
E/S
O -
3,1
0,6
-0,
97lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
VI
80 -
12FS
Circ
ulai
reen
cuv
ette
- -
1,8
1,7
-0,
45lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
, hom
ogèn
eØ
Indé
term
inée
-L
81 -
11FT
Obl
ongu
een
VN
E/S
O -
3,1
0,7
-1
limon
lehm
ique
bru
n fo
ncé,
+ lim
on lo
essi
que
com
pact
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
VII
82 -
11FT
Obl
ongu
een
VN
E/S
O -
2,65
0,6
-0,
78lim
on le
hmiq
ue b
run,
+ lim
on lo
essi
que
(cal
caire
), co
mpa
ctC
éram
ique
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-V
II
84 -
11FT
Obl
ongu
een
VE
/O -
30,
6 -
0,9
limon
lehm
ique
bru
n, +
limon
loes
siqu
e co
ncré
tionn
éØ
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-V
III
85 -
11FT
Obl
ongu
een
VN
E/S
O -
3,65
0,85
-1,
5lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
, hom
ogèn
e, +
lo
ess
conc
rétio
nné
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
VIII
87 -
12FT
Obl
ongu
een
VE
/O -
3,1
0,75
-1,
45lim
on le
hmiq
ue b
run,
+ lo
ess
conc
rétio
nné
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
IX
88 -
355
FSC
ircul
aire
en c
uvet
te -
-1,
51,
4 -
0,2
limon
lehm
ique
bru
n fo
ncé
Cér
amiq
ueN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
IX
89 -
4S
IC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1,
51,
5lim
on le
hmiq
ue b
run
, lim
on lo
essi
que
brun
cla
irC
éram
ique
; Fa
une
Bro
nze
final
IIb
/ IIIa
-X
XIX
Cér
amiq
ue ;
90 -
4S
PC
ircul
aire
en c
uvet
te -
- -
-1,
350,
25lim
on le
hmiq
ue b
run
Faun
e ; L
ithiq
ue ;
Torc
his
; O
ssem
ents
hu
mai
ns ;
Néo
lithiq
ue ré
cent
/ M
unzi
ngen
Au
moi
ns 2
indi
vidus
(1
adul
te, 1
imm
atur
e)X
VIII
91FS
123
355
FSC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1,
30,
1lim
on le
hmiq
ue b
run
Cér
amiq
ue ;
Lith
ique
; N
éolith
ique
réce
nt /
Mun
zing
en -
XV
III
92 -
3FT
Obl
ongu
een
VN
E/S
O -
2,2
0,5
-0,
6lim
on le
hmiq
ue b
run
fonc
é, +
limon
con
crét
ionn
é bl
anc,
com
pact
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
IX
94 -
355
FSP
atat
oïde
en c
uvet
te -
-3
max
2,4
-0,
2lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
, hom
ogèn
eØ
Indé
term
inée
-L
95 -
357
FSC
ircul
aire
en c
uvet
te -
- -
-1,
40,
28lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
, hom
ogèn
eØ
Indé
term
inée
-LI
97 -
355
FSC
ircul
aire
en c
uvet
te -
- -
-1,
90,
25lim
on le
hmiq
ue b
run
Cér
amiq
ue ;
Lith
ique
; To
rchi
sB
ronz
e fin
al II
b / I
IIa -
XX
X
98 -
357
FSC
ircul
aire
cuve
tte -
- -
-1,
20,
1Li
mon
lehm
ique
bru
n so
mbr
e et
limon
loes
siqu
e br
un c
lair
Cér
amiq
ueN
éolith
ique
/ P
roto
hist
oire
-X
L
100
FS
111
3FS
Circ
ulai
reirr
égul
ier
- -
- -
1,55
1,2
limon
lehm
ique
bru
n, q
uelq
ues
char
bons
Cér
amiq
ue ;
Faun
eB
ronz
e fin
al II
b / I
IIa -
XX
X
101
-4
FSC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1,
150,
25lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
ØB
ronz
e fin
al II
b / I
IIa -
XX
XII
102
-3
FSC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1,
250,
55lim
on le
hmiq
ue b
run
avec
que
lque
s po
ches
de
loes
sC
éram
ique
; Li
thiq
ueB
ronz
e fin
al II
b / I
IIa -
XX
XII
104
-3
FSO
vale
fond
pla
tN
/S -
1,15
0,9
-0,
08lim
on le
hmiq
ue b
run
Cér
amiq
ueB
ronz
e fin
al II
b / I
IIa -
XX
XII
105
-4
FSC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1,
20,
28lim
on le
hmiq
ue b
run,
meu
ble
Cér
amiq
ue ;
Mét
alB
ronz
e fin
al II
b / I
IIa -
XX
XII
106
-4
FSC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1,
10,
3lim
on le
hmiq
ue b
run
ØB
ronz
e fin
al II
b / I
IIa -
XX
XII
107
-35
5FS
Circ
ulai
refo
nd p
lat
- -
- -
1,40
0,25
limon
bru
n co
mpa
ct, +
limon
loes
siqu
e hé
téro
gène
et p
eu c
ompa
ctØ
Indé
term
inée
-LI
108
-35
7FS
Ova
lefo
nd p
lat
N/S
-2,
652,
2 -
0,38
limon
lehm
ique
bru
n, c
ompa
ct, +
loes
s re
man
iéC
éram
ique
; Li
thiq
ue ;
Faun
eH
alls
tatt
D1
-X
XX
V
109
-8
FSqu
adra
ngul
aire
(b
ord
arro
ndis
)fo
nd a
plan
iE
/O -
2,5
1,85
-0,
34lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
Cér
amiq
ue ;
Faun
e ; L
ithiq
ueH
alls
tatt
D1
-X
XX
VI
110
-11
FSP
atat
oïde
irrég
ulie
rN
/S -
2,25
1,60
-0,
23lim
on b
run
hom
ogèn
e et
com
pact
ØIn
déte
rmin
ée -
LI
111
-11
FTO
blon
gue
en V
E/O
-2,
450,
8 -
0,85
4 co
uche
s, lim
on b
run
à br
un c
lair,
+ lo
ess
rem
anié
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
X
112
-11
FSP
atat
oïde
en c
uvet
te -
- -
-1,
750,
2lim
on b
run
hom
ogèn
e et
com
pact
ØIn
déte
rmin
ée -
LII
N° d
e St
ruct
ure
Equi
vale
nce
num
érot
atio
n St
. D
iag.
Parc
elle
Type
Plan
Prof
ilO
rient
atio
nR
elat
ions
Long
ueur
(m
.)La
rgeu
r (m
.)D
iam
ètre
(m.)
Prof
onde
ur
(m.)
Rem
plis
sage
Mob
ilier
Dat
atio
nO
bser
vatio
nPl
anch
e
113
-10
FTO
blon
gue
en V
E/O
-3,
10,
8 -
1,6
4 co
uche
s, lim
on le
hmiq
ue e
t lim
on lo
essi
que
brun
fonc
é à
brun
cla
ir, +
loes
s re
man
iéC
éram
ique
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-X
115
-10
FSC
ircul
aire
en c
uvet
te -
- -
-1,
60,
25lim
on b
run
com
pact
ØIn
déte
rmin
ée -
LII
116
-10
FTO
blon
gue
en V
NE
/SO
-2,
90,
8 -
1,7
3 co
uche
s, lim
on b
run
com
pact
, loe
ss ja
une,
lim
on lo
essi
que
brun
très
con
cret
ionn
éC
éram
ique
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-X
I
117
-35
3S
IE
lliptiq
uefo
nd p
lat
- -
2,1
1,75
-1,
712
cou
ches
, lim
on le
hmiq
ue b
run
à br
un c
lair,
+
loes
s
Cér
amiq
ue ;
Faun
e ; L
ithiq
ue ;
Pré
lève
men
t
Néo
lithiq
ue ré
cent
/ M
unzi
ngen
-X
X
119
-35
5S
IO
vale
Tron
coni
que
E/O
reco
upée
par
St.
142
2,2
(Ave
c S
t. 14
2)2
(Ave
c S
t. 14
2) -
1,5
3 co
uche
s, lim
on le
hmiq
ue b
run
à br
un c
lair,
co
mpa
ct e
t hom
ogèn
e, +
loes
sP
rélè
vem
ent
Pro
tohi
stoi
re -
XX
XV
II
120
-35
7FS
Pat
atoï
deirr
égul
ier
N/S
-6,
24,
50,
82
couc
hes
: lim
on le
hmiq
ue b
run,
com
pact
, hé
téro
gène
; lim
on le
hmiq
ue b
run
et lim
on
loes
squi
e ja
une
Cér
amiq
ue ;
Faun
eN
éolith
ique
/ P
roto
hist
oire
Stru
ctur
e co
upée
par
la
berm
eX
LI
122
-10
FSP
atat
oïde
irrég
ulie
r -
-3,
204
-0,
23lim
on le
hmiq
ueØ
Indé
term
inée
-LI
II
123
-10
FTO
blon
gue
en V
NE
/SO
-2,
61,
1 -
1,1
limon
bru
n fo
ncé
très
com
pact
,loes
s re
man
iéØ
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-X
I
124
-11
FTO
blon
gue
en V
E/O
-1,
200,
76 -
0,46
2 co
uche
s, lim
on le
hmiq
ue b
run
fonc
é, c
ompa
ct
et lim
on lo
essi
que
calc
aire
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
XII
125
-10
FTO
blon
gue
en V
NE
/SO
-2,
460,
60 -
1,42
2 co
uche
s, lim
on le
hmiq
ue b
run
avec
que
lque
s ch
arbo
ns d
e bo
isØ
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-X
II
126
-11
FSC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-1
0,28
limon
bru
n co
mpa
ctØ
Indé
term
inée
-LI
II
127
-11
FTO
blon
gue
en V
E/O
-2,
20,
5 -
0,73
2 co
uche
s, lim
on le
hmiq
ue b
run
clai
r et l
imon
lo
essi
que
calc
aire
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
XII
128
-11
FTO
blon
gue
en V
N/S
-3,
20,
35 -
0,57
2 co
uche
s, lim
on le
hmiq
ue b
run
et lim
on
lehm
ique
+ lo
ess
conc
retio
nné
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
XIII
129
-11
FSC
ircul
aire
fond
irré
gulie
r -
- -
-1,
20,
2lim
on le
hmiq
ue b
run
ØIn
déte
rmin
ée -
LIII
130
-10
FTO
blon
gue
en V
NE
/SO
-3
0,65
-1,
153
couc
hes,
limon
lehm
ique
bru
n fo
ncé,
loes
s re
man
ié, l
imon
bru
n +
loes
s ca
lcifié
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
XIII
131
-10
FTO
blon
gue
en V
EN
E/O
SO
-3,
150,
7 -
1,1
2 co
uche
s, lim
on le
hmiq
ue b
run
com
pact
et
hom
ogèn
e, lim
on le
hmiq
ue b
run
clai
r +
conc
retio
nØ
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-X
IV
132
-FT
Obl
ongu
een
VN
E/S
O -
2,3
0,65
-1,
13
couc
hes,
limon
lehm
ique
bru
n, lim
on lo
essi
que
calc
aire
, lim
on b
run
clai
r, ca
lcifié
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
XIV
132
calc
aire
, lim
on b
run
clai
r, ca
lcifié
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n
133
-10
FTO
blon
gue
en V
EN
E/O
SO
-2,
20,
5 -
0,5
2 co
uche
s, lim
on le
hmiq
ue b
run
et lim
on
lehm
ique
con
cret
ionn
éØ
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-X
IV
134
FT 1
2235
8FT
Obl
ongu
een
VN
E/S
O -
2,6
0,4
-0,
62
couc
hes,
limon
lehm
ique
bru
n et
limon
le
hmiq
ue c
oncr
etio
nné
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
XV
135
-35
8FT
Obl
ongu
een
VN
E/S
O -
30,
6 -
13
couc
hes,
limon
lehm
ique
bru
n, lo
ess
ØN
éolith
ique
moy
en /
Bru
ebac
h-O
berb
erge
n -
XV
136
-27
FSC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-2
0,3
limon
lehm
ique
bru
n, m
eubl
eC
éram
ique
; Fa
une
Pro
tohi
stoi
re -
XX
XV
III
137
SP
105
359
SP
Obl
ongu
eC
uvet
teN
O/S
E -
2,08
1,80
-0,
18Li
mon
lehm
ique
bru
n
Cér
amiq
ue ;
Lith
ique
; O
ssem
ents
hu
mai
ns ;
Néo
lithiq
ue fi
nal /
C
ampa
nifo
rme
1 in
divid
uX
XII
138
SP
110
1S
PC
ircul
aire
fond
pla
t -
- -
-2,
141,
70Li
mon
lehm
ique
bru
nC
éram
ique
; Li
thiq
ueN
éolith
ique
réce
nt /
Mun
zing
en4
indi
vidus
XX
I
139
FT 1
2035
8FT
Obl
ongu
een
VN
E/S
O -
1,30
0,42
-0,
95Li
mon
lehm
ique
bru
nØ
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-X
V
140
FT 1
2135
8FT
Obl
ongu
een
VN
E/S
O -
1,70
0,34
-0,
65Li
mon
lehm
ique
bru
nØ
Néo
lithiq
ue m
oyen
/ B
rueb
ach-
Obe
rber
gen
-X
V
141
FS 1
0735
5FS
Circ
ulai
recu
vette
- -
- -
1,90
0,34
limon
lehm
ique
bru
nØ
Indé
term
inée
-LI
V14
2 -
355
FSC
ircul
aire
cuve
tte -
reco
upe
St.
119
2,2
2 -
95lim
on le
hmiq
ue b
run
ØIn
déte
rmin
ée -
XX
XV
II
N° Structure
Equivalence numérotation
St. Diag
Date de mise au
jourParcelle N°
d'objet NatureNombre
de Reste(s)
Poids (gr) Période Phase / Culture Observation(s)
1 - 04-juin 12 1 Céramique 279 7705 Age du Bronze BF I1 - 04-juin 12 2 Prélévement - 318 Age du Bronze BF I3 - 21-juin 13 1 Céramique 7 145 Néolithique récent Munzingen3 - 21-juin 13 2 Silex 1 13 Néolithique récent Munzingen3 - 21-juin 13 3 Prélévement - 1210 Néolithique récent Munzingen10 - 05-juil 12 1 Céramique 1 49 Néolithique final Campaniforme10 - 05-juil 12 2 Céramique 1 38 Néolithique final Campaniforme
10 - 05-juil 12 3 Ossements Humain - 21 Néolithique final Campaniforme
15 FS 104 05-juil 12 1 Céramique 4 20 Néolithique récent Munzingen15 FS 104 05-juil 12 2 Silex 1 1 Néolithique récent Munzingen15 FS 104 05-juil 12 3 Faune 19 36 Néolithique récent Munzingen15 FS 104 05-juil 12 4 Faune - 58 Néolithique récent Munzingen Matériel non fourni15 FS 104 05-juil 12 5 Prélévement - 2255 Néolithique récent Munzingen22 - 05-juil 357 1 Silex 1 8 Néolithique Néo indet.39 - 28-juin 3 1 Céramique 9 393 Néolithique récent Munzingen39 - 28-juin 3 2 Céramique 6 173 Néolithique récent Munzingen39 - 28-juin 3 3 Faune 1 81 Néolithique récent Munzingen39 - 29-juin 3 4 TCA 8 519 Néolithique récent Munzingen40 FS 108 29-juin 3 1 Céramique 2 7 Romain ? -40 FS 108 29-juin 3 2 Fer 1 20 Romain ? - Fragment de scorie40 FS 108 29-juin 3 2 Faune 2 140 Romain ? -43 - 24-juin 1 1 Céramique 2 38 Indet. Indet. Néo/Proto43 - 24-juin 1 2 Faune 3 255 Indet. Indet. Néo/Proto44 - 24-juin 1 1 Céramique 3 47 Age du Fer Ha indet.50 - 05-juil 17 1 Céramique 3 27 Indet. Indet. Néo/Proto50 - 05-juil 17 2 Faune 3 546 Indet. Indet. Néo/Proto51 - 05-juil 17 1 Céramique 1 10 Age du Bronze BF IIb/IIIa51 - 05-juil 17 2 Céramique 1 7 Age du Bronze BF IIb/IIIa51 - 05-juil 17 3 Céramique 1 8 Age du Bronze BF IIb/IIIa51 - 05-juil 17 4 Céramique 13 105 Age du Bronze BF IIb/IIIa51 - 05-juil 17 5 Calcaire 1 5 Age du Bronze BF IIb/IIIa51 - 05-juil 17 6 Faune 19 1035 Age du Bronze BF IIb/IIIa54 FS 101 05-juin 14 1 Céramique 1 1 Indet. Néo indet.54 FS 101 05-juin 14 2 Faune 10 5 Indet. Néo indet.54 FS 101 ND 14 3 Céramique 3 17 Indet. Néo indet. (=101.001)54 FS 101 ND 14 4 Céramique 2 9 Indet. Néo indet. (=101.002)54 FS 101 ND 14 5 Torchis 1 5 Indet. Néo indet. (=101.003)54 FS 101 ND 14 6 Silex 1 6 Indet. Néo indet. (=101.004)54 FS 101 ND 14 7 Grès 1 26 Indet. Néo indet. (=101.005)54 FS 101 ND 14 8 Faune 7 4 Indet. Néo indet. (=101.006) (Matériel non fourni)56 FS 106 10-juin 15 1 Céramique 2 22 Age du Fer Ha D156 FS 106 10-juin 15 2 Céramique 1 5 Age du Fer Ha D156 FS 106 10-juin 15 3 Céramique 1 9 Age du Fer Ha D156 FS 106 10-juin 15 5 Céramique 7 64 Age du Fer Ha D156 FS 106 10-juin 15 5 Faune 13 853 Age du Fer Ha D157 - 09-juin 12 1 Céramique 12 125 Age du Bronze BF IIb/IIIa57 - 09-juin 12 2 Céramique 15 156 Age du Bronze BF IIb/IIIa57 - 09-juin 12 3 Céramique 5 52 Age du Bronze BF IIb/IIIa57 - 09-juin 12 4 Céramique 13 135 Age du Bronze BF IIb/IIIa57 - 09-juin 12 5 Céramique 25 261 Age du Bronze BF IIb/IIIa57 - 09-juin 12 5 Grès 1 165 Age du Bronze BF IIb/IIIa57 - 09-juin 12 6 Faune 7 61 Age du Bronze BF IIb/IIIa60 - 09-juin 11 1 Céramique 13 87 Néolithique récent Munzingen60 - 09-juin 11 2 Céramique 8 54 Néolithique récent Munzingen60 - 09-juin 11 3 Silex 1 3 Néolithique récent Munzingen60 - 09-juin 11 4 Grès 1 1375 Néolithique récent Munzingen60 - 09-juin 11 6 Faune 12 114 Néolithique récent Munzingen64 - 06-juil 355 1 Céramique 9 14 Néolithique moyen Bruebach-Oberbergen64 - 06-juil 355 2 Grès 1 358 Néolithique moyen Bruebach-Oberbergen65 - 23-juin 8 1 Céramique 3 20 Age du Bronze BF IIb/IIIa65 - 23-juin 8 2 Céramique 17 114 Age du Bronze BF IIb/IIIa65 - 23-juin 8 3 Céramique 26 175 Age du Bronze BF IIb/IIIa65 - 23-juin 8 4 Calcaire 1 8 Age du Bronze BF IIb/IIIa65 - 23-juin 8 5 Faune 5 444 Age du Bronze BF IIb/IIIa66 - 09-juin 13 1 Céramique 4 54 Age du Fer Ha indet.67 FS 124 10-juin 8 1 Céramique 3 13 Indet. Indet. Néo/Proto67 FS 124 10-juin 8 2 Faune 1 6 Indet. Indet. Néo/Proto67 FS 124 ND 8 3 Faune - 145 Indet. Indet. Néo/Proto (= 124.001) Matériel non fourni67 FS 124 ND 8 4 Céramique 2 14 Indet. Indet. Néo/Proto (=124.002)68 - 10-juin 359 1 Céramique 1 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 2 Céramique 1 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 3.1 Silex 1 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 3.2 Silex 1 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 3.3 Silex 1 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 3.4 Silex 1 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 4.1 Grès 1 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 4.2 Silex 1 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 5 Schiste 1 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 6 Silex 1 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 7.1 Silex 1 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 7.2 Silex 1 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 8 Os 1 Néolithique final Campaniforme
68 - 10-juin 359 9 Ossements Humain - Néolithique final Campaniforme
68 - 10-juin 359 10 Prélévement - 715 Néolithique final Campaniforme
Musée
N° Structure
Equivalence numérotation
St. Diag
Date de mise au
jourParcelle N°
d'objet NatureNombre
de Reste(s)
Poids (gr) Période Phase / Culture Observation(s)
68 - 10-juin 359 14 Piquet calcifié 1 1120 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 15 Piquet calcifié 1 496 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 16 Piquet calcifié 1 484 Néolithique final Campaniforme68 - 10-juin 359 17 Piquet calcifié 1 904 Néolithique final Campaniforme69 - 17-juin 10 1.1 Céramique 1 Musée Néolithique final Campaniforme69 - 17-juin 10 1.2 Silex 1 - Néolithique final Campaniforme Poids cf n°369 - 17-juin 10 2 Céramique 1 Musée Néolithique final Campaniforme69 - 17-juin 10 3.1 Silex 1 Néolithique final Campaniforme69 - 17-juin 10 3.2 Silex 1 Néolithique final Campaniforme69 - 17-juin 10 3.3 Silex 1 Néolithique final Campaniforme69 - 17-juin 10 3.3bis Silex 1 Néolithique final Campaniforme69 - 17-juin 10 3.4 Silex 1 Néolithique final Campaniforme69 - 17-juin 10 3.5 Silex 1 Néolithique final Campaniforme69 - 17-juin 10 3.6 Silex 1 Néolithique final Campaniforme69 - 17-juin 10 4 Silex 1 Néolithique final Campaniforme69 - 17-juin 10 5 marcassite 1 24 Néolithique final Campaniforme69 - 17-juin 10 6 Silex 1 - Néolithique final Campaniforme Poids cf n°369 - 17-juin 10 7 Silex 1 - Néolithique final Campaniforme Poids cf n°369 - 17-juin 10 8 Grès 1 134 Néolithique final Campaniforme69 - 17-juin 10 9 Silex 1 - Néolithique final Campaniforme Poids cf n°369 - 17-juin 10 10 Silex 1 - Néolithique final Campaniforme Poids cf n°369 - 17-juin 10 11 Os 1 9 Néolithique final Campaniforme
69 - 17-juin 10 12 Ossements Humain - 4361 Néolithique final Campaniforme
69 - 17-juin 10 13 Prélévement - 561 Néolithique final Campaniforme71 - 25-juin 1 1 Céramique 23 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 2 Céramique 7 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 3 Céramique 1 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 4 Céramique 1 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 5 Céramique 2 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 6 Céramique 1 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 7 Céramique 1 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 8 Céramique 1 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 9 Céramique 5 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 10 Céramique 7 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 11 Céramique 61 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 12 Céramique 45 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 13 Céramique 4 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 14 Céramique 40 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 6 TCA 6 218 Age du Fer Ha D171 - 25-juin 1 15 Faune 55 811 Age du Fer Ha D172 - 25-juin 2 1 Céramique 47 121 Age du Bronze BF IIb/IIIa72 - 25-juin 2 2 Prélévement - 61 Age du Bronze BF IIb/IIIa73 - 25-juin 2 1 Céramique 1 270 Age du Bronze BF IIb/IIIa73 - 25-juin 2 2 Céramique 38 627 Age du Bronze BF IIb/IIIa73 - 25-juin 2 3 Céramique 48 110 Age du Bronze BF IIb/IIIa73 - 25-juin 2 4 Céramique 72 469 Age du Bronze BF IIb/IIIa73 - 25-juin 2 5 Céramique 1 698 Age du Bronze BF IIb/IIIa73 - 25-juin 2 6 Faune 1 14 Age du Bronze BF IIb/IIIa73 - 25-juin 2 6 Prélévement - 90 Age du Bronze BF IIb/IIIa74 - 29-juin 3 1 Céramique 104 668 Age du Bronze BF IIb/IIIa76 10-juin 11 1 Silex 1 12 Néolithique moyen Bruebach-Oberbergen82 - 05-juil 11 1 Céramique 1 19 Néolithique Néo indet.88 - 06-juil 355 1 Céramique 20 45 Néolithique moyen Bruebach-Oberbergen89 - 30-juin 4 1 Céramique 1 Age du Bronze BF IIb/IIIa89 - 30-juin 4 2 Céramique 11 Age du Bronze BF IIb/IIIa89 - 30-juin 4 3 Faune 85 412 Age du Bronze BF IIb/IIIa90 - 30-juin 4 1 Céramique 43 1600 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 2 Céramique 74 7800 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 3 Céramique 51 2100 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 4 Céramique 22 156 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 5 Céramique 18 433 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 6 Céramique 23 392 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 7 Céramique 65 3900 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 8 Céramique 13 3200 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 9 Grès 1 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 10 Grès 1 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 11 Grès 1 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 12 Grès 1 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 13 Grès 1 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 14 Grès 1 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 15 Galet 7 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 16 Galet 3 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 17 Galet 1 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 18 Faune 15 1215 Néolithique récent Munzingen90 - 30-juin 4 19 TCA 5 106 Néolithique récent Munzingen
90 - 30-juin 4 20 Ossements Humain - 1155 Néolithique récent Munzingen individu 1 (adulte)
90 - 30-juin 4 21 Ossements Humain - 160 Néolithique récent Munzingen individu 2 (immature)
90 - 30-juin 4 22 Ossements Humain - 499 Néolithique récent Munzingen individu ?
91 FS 123 ND 355 1 Grès 1 6 Néolithique récent Munzingen (= 123.001)91 FS 123 ND 355 2 Faune 1 23 Néolithique récent Munzingen (= 123. 002)91 FS 123 ND 355 3 Céramique 14 49 Néolithique récent Munzingen (= 123.003)91 FS 123 ND 355 4 Céramique 6 10 Néolithique récent Munzingen (= 123.004)91 FS 123 ND 355 5 Céramique 3 6 Néolithique récent Munzingen (= 123.005)
113
2470
132
7600
1480
N° Structure
Equivalence numérotation
St. Diag
Date de mise au
jourParcelle N°
d'objet NatureNombre
de Reste(s)
Poids (gr) Période Phase / Culture Observation(s)
91 FS 123 ND 355 6 Céramique 10 89 Néolithique récent Munzingen (= 123.006)91 FS 123 ND 355 7 Céramique 2 3 Néolithique récent Munzingen (= 123.007)91 FS 123 ND 355 8 Faune 1 5 Néolithique récent Munzingen (= 123.008) (Materiel non fourni)97 - 06-juil 355 1 Céramique 2 Age du Bronze BF IIb/IIIa97 - 06-juil 355 2 Céramique 1 Age du Bronze BF IIb/IIIa97 - 06-juil 355 3 Céramique 3 Age du Bronze BF IIb/IIIa97 - 06-juil 355 4 Grès 1 Age du Bronze BF IIb/IIIa97 - 06-juil 355 5 Grès 1 Age du Bronze BF IIb/IIIa97 - 06-juil 357 6 TCA 10 517 Age du Bronze BF IIb/IIIa98 - 06-juil 357 1 Céramique 1 39 Indet. Indet. Néo/Proto100 FS 111 29-juin 3 1 Céramique 1 Age du Bronze BF IIb/IIIa100 FS 111 29-juin 3 2 Céramique 3 Age du Bronze BF IIb/IIIa100 FS 111 29-juin 3 3 Céramique 2 Age du Bronze BF IIb/IIIa100 FS 111 29-juin 3 4 Céramique 1 Age du Bronze BF IIb/IIIa100 FS 111 29-juin 3 5 Céramique 1 Age du Bronze BF IIb/IIIa100 FS 111 29-juin 3 6 Céramique 33 Age du Bronze BF IIb/IIIa100 FS 111 29-juin 3 7 Céramique 2 Age du Bronze BF IIb/IIIa100 FS 111 29-juin 3 8 Galet 1 426 Age du Bronze BF IIb/IIIa100 FS 111 29-juin 3 9 Céramique 2 24 Age du Bronze BF IIb/IIIa (=111.001)100 FS 111 ND 3 9 Faune - 90 Age du Bronze BF IIb/IIIa100 FS 111 30-juin 3 10 Prélévement - 253 Age du Bronze BF IIb/IIIa102 - 30-juin 3 1 Céramique 3 30 Age du Bronze BF IIb/IIIa104 - 30-juin 3 1 Céramique 39 247 Age du Bronze BF IIb/IIIa
104 - 30-juin 3 2 Breche permienne 1 3220 Age du Bronze BF IIb/IIIa
104 - 30-juin 3 3 Faune 1 36 Age du Bronze BF IIb/IIIa105 - 30-juin 4 1 Céramique 6 60 Age du Bronze BF IIb/IIIa105 - 30-juin 4 2 Céramique 63 447 Age du Bronze BF IIb/IIIa105 - 30-juin 4 3 Céramique 52 369 Age du Bronze BF IIb/IIIa105 - 30-juin 4 4 Céramique 51 362 Age du Bronze BF IIb/IIIa105 - 30-juin 4 5 Céramique 25 177 Age du Bronze BF IIb/IIIa
105 - 30-juin 4 6 Alliage Cuivreux 1 2 Age du Bronze BF IIb/IIIa
105 - 30-juin 4 7 Prélévement - 113 Age du Bronze BF IIb/IIIa108 - 30-juin 357 1 Céramique 2 359 Age du Fer Ha D1108 - 30-juin 357 2 Céramique 1 2 Age du Fer Ha D1108 - 30-juin 357 3 Céramique 1 1 Age du Fer Ha D1108 - 30-juin 357 4 Céramique 1 6 Age du Fer Ha D1108 - 30-juin 357 5 Céramique 43 102 Age du Fer Ha D1108 - 30-juin 357 6 Grès 1 3465 Age du Fer Ha D1108 - 30-juin 357 7 Faune 1 13 Age du Fer Ha D1109 - 06-juil 8 1 Céramique 2 1970 Age du Fer Ha D1109 - 06-juil 8 2 Céramique 3 7 Age du Fer Ha D1109 - 06-juil 8 3 Céramique 1 8 Age du Fer Ha D1109 - 06-juil 8 4 Céramique 1 6 Age du Fer Ha D1109 - 06-juil 8 5 Céramique 128 321 Age du Fer Ha D1109 - 06-juil 8 6 Galet 1 329 Age du Fer Ha D1109 - 06-juil 8 7 Faune 3 340 Age du Fer Ha D1113 - 01-juil 10 1 Céramique 1 13 Indet. Indet. Néo/Proto116 - 01-juil 10 1 Céramique 9 40 Néolithique moyen Bruebach-Oberbergen117 - 02-juil 353 1 Céramique 16 156 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 2 Céramique 11 107 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 3 Céramique 4 9 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 4 Céramique 2 20 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 5 Céramique 1 9 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 6 Céramique 7 68 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 7 Céramique 10 98 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 8 Céramique 16 156 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 9 Céramique 3 29 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 10 Céramique 21 204 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 11 Céramique 9 87 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 12 Céramique 7 68 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 13 Céramique 1 10 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 14 Céramique 1 8 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 15 Céramique 28 273 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 16 Pierre dure 1 30 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 17 Silex 1 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 18 Silex 1 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 19 Silex 1 Néolithique récent Munzingen
117 - 02-juil 353 20 Ossements Humain 1 9 Néolithique récent Munzingen
117 - 02-juil 353 21 Os 1 Néolithique récent Munzingen Outil en os117 - 02-juil 353 22 Os 1 Néolithique récent Munzingen Outil en os117 - 02-juil 353 23 Os 1 Néolithique récent Munzingen Outil en os117 - 02-juil 353 24 Grès 1 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 25 Grès 1 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 26 Grès 1 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 27 Grès 1 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 28 Grès 1 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 29 Calcaire 1 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 30 Faune 354 12377 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 31 TCA 9 257 Néolithique récent Munzingen117 - 02-juil 353 32 Prélévement - 2000 Néolithique récent Munzingen119 09-juil 355 1 Prélévement - 666 Indet. Indet. Néo/Proto120 - 09-juil 357 1 Céramique 3 13 Indet. Indet. Néo/Proto120 - 09-juil 357 2 Faune 1 626 Indet. Indet. Néo/Proto136 - 15-juil 27 1 Céramique 1 45 Protohistoire Proto. Indet.
168
4500
401
18
16
1935
N° Structure
Equivalence numérotation
St. Diag
Date de mise au
jourParcelle N°
d'objet NatureNombre
de Reste(s)
Poids (gr) Période Phase / Culture Observation(s)
136 - 15-juil 27 2 Céramique 4 32 Protohistoire Proto. Indet.136 - 15-juil 27 3 Faune 1 91 Protohistoire Proto. Indet.
137 - ND 359 1 Céramique 21 33 Néolithique final Campaniforme (= 105.002 + 105.004 + Sd27.001 et 002)
137 - ND 359 2 Céramique 13 26 Néolithique final Campaniforme (= 105.002 + 105.004 + Sd27.001 et 002)
137 - ND 359 3 Silex 1 Néolithique final Campaniforme (= 105.003) 137 - ND 359 4.1 Os 1 Néolithique final Campaniforme (= 105.005) 137 - ND 359 4.2 Os 1 Néolithique final Campaniforme (= 105.006)137 - ND 359 4.3 Os 1 Néolithique final Campaniforme (= 105.005)137 - ND 359 4.4 Os 1 Néolithique final Campaniforme (non inventorié au diag.) 137 - ND 359 5 Grès 1 Néolithique final Campaniforme (= 105.001)
137 - ND 359 6 Ossements Humain - ND Néolithique final Campaniforme (= 105.008 à n105 .020) Materiel
non fourni138 SP 110 ND 1 1 Pelite Quartz 1 137 Néolithique récent Munzingen (= 110.001)138 SP 110 ND 1 2 Silex 1 10 Néolithique récent Munzingen (= 110.002)138 SP 110 ND 1 3 Céramique 72 186 Néolithique récent Munzingen (= 110.003)138 SP 110 ND 1 4 Céramique 40 123 Néolithique récent Munzingen (=110.004)138 SP 110 ND 1 5 Céramique 3 6 Néolithique récent Munzingen (=110.005)138 SP 110 ND 1 6 Faune - 136 Néolithique récent Munzingen (= 110.006) Materiel non fourni138 SP 110 ND 1 7 Faune - 174 Néolithique récent Munzingen (= 110.007) Materiel non fourni138 SP 110 ND 1 8 Céramique 2 3 Néolithique récent Munzingen (= 110.008)138 SP 110 ND 1 9 Faune - 16 Néolithique récent Munzingen (= 110.009) Matériel non fourni
138 SP 110 ND 1 10 Ossements Humain - Néolithique récent Munzingen individu 1 (= 110.010 à 110.020)
Matériel non fourni
138 SP 110 ND 1 11 Ossements Humain - Néolithique récent Munzingen individu 2 (= 110.021 à 110.034)
Matériel non fourni
138 SP 110 ND 1 12 Ossements Humain - Néolithique récent Munzingen individu 3 (= 110.035 à 110.047)
Matériel non fourni
138 SP 110 ND 1 13 Ossements Humain - Néolithique récent Munzingen individu 4 (= 110.048 à 110.063)
Matériel non fourni
ND
ND
Ann.II.1. CATALOGUE DES TOMBES
Ann.II.1.1. LES SEPULTURES CAMPANIFORMES
Ann.II.1.1.1. Sépulture 10
Etat de conservation : Sépulture arasée. Squelette lacunaire. Matière osseuse moyennement conservée.
Orientation de la fosse : Nord /sud
Orientation du squelette : /
Description de la fosse sépulcrale : Fosse quadrangulaire (1,5 x 1m) conservée sur une profondeur maximale de 0,05 m.
Remplissage de la fosse : Remplissage homogène de limon lehmique brun.
Position du squelette et du mobilier : L’état d’arasement de la tombe n’a pas permis de restituer la position initiale du sque-lette. Seuls des éléments de crâne, de mandibule et quelques os longs ont été prélevés dans le quart nord-est de la fosse sépulcrale. Deux vases en céramique, dont seuls les fonds ont été retrouvés,étaient déposés l’un à côté de l’autre, dans la partie centrale de la fosse.
Etat des connexions anatomiques : /
Espace de décomposition et architecture funéraire : /
Inventaire du mobilier : Céramique - vase - vase
Données anthropologiques : Âge au décès : individu immature Infans I âgé d’environ 5 ans +/- 16 mois1
Diagnose sexuelle : indéterminable. Stature : / Lésions et variations anatomiques observées : /
Datation : Campaniforme.
1 Ubelaker 1978
Ann.II.1.1.2. Sépulture 68
Etat de conservation : Sépulture intacte. Squelette complet. Matière osseuse très bien conservée.
Orientation de la fosse : Nord-ouest/sud-est
Orientation du squelette : Nord-nord-ouest/ Sud-sud-est
Description de la fosse sépulcrale : Fosse quadrangulaire (2,30 x 1,80 m) conservée sur une profondeur maximale de 0,40 m. Les quatre angles de la fosse sont aménagés par des piquets en bois (diam : 8 cm, haut. cons. : 0,20 m) . Des traces ligneuses sont conservées près des parois ouest, est et nord et au niveau du squelette, à proximité de son crâne et de son épaule gauche, à proximité du vase 68.1 et sous le pied gauche. Il semble donc que le corps de l’individu a été déposé sur un niveau de planches amé-nagé, certainement surmonté par une superstructure en matière périssable soutenue par les pieux en bois.
Remplissage de la fosse : Remplissage hétérogène de limon lehmique et lœssique brun à brun clair.
Données anthropologiques : Age au décès : individu adulte mature âgé entre 30 et 59 ans2. Diagnose sexuelle : individu masculin3. Stature : 1,77 m +/- 3,53 cm4. Lésions et variations anatomiques observées : - Patella avec une encoche du vaste externe. - déhiscence de la VT10 : désunion de l’arc postérieur. - lésions dégénératives de type arthrose sur le bord inférieur de la surface arti-culaire des patellas, lésions dégénératives de type arthrose au niveau temporo-mandibulaire observable sur le condyle mandibulaire droit, lésions dégénératives de type arthrose sur l’atlas et l’axis. - lésion du périoste sur la partie distale de la fibula et du tibia droits.
Position du squelette et du mobilier : L’individu a été déposé sur le côté gauche en position hyperfléchie. Le bloc crânio-fa-ciale n’apparait pas sa face latérale droite, le thorax est posé à plat contre le sol.Les membres supérieurs sont hyperfléchis, les doigts de la main gauche sont fléchis, la main au contact de la face, de sorte que les phalanges proximales sont au contact de la mandibule et la main droite est posée à plat, face dorsale sur le sol, en avant de l’épaule droite. Les membres inférieurs sont fléchis avec la même intensité, le genou droit plus en amont que le gauche ; les pieds, au contact l’un de l’autre sont remontés sous le bassin. Un brassard d’archer en schiste était placé au niveau de la moitié distale de l’avant-bras gauche et devait vraisemblablement être porté. Une dent de suidé a été trouvée au 2 selon Schmitt 20053 DSP 100% selon Murail et al. 20054 mesure tibia + fémur, selon Trotter et Gleser 1952
niveau du genou gauche, en avant du tibia ; sa position en équilibre instable semble indiquer que cet objet est en position primaire. Le reste du mobilier est déposé à l’arrière de l’individu, le long de la paroi sud de la tombe. Il est composé d’une «pierre à rainure», de trois armatures de flèches associées à un éclat en silex, de deux vases en céramique, d’une lamelle et de deux éclats retouchés en silex.
Etat des connexions anatomiques : fig.1
Espace de décomposition et architecture funéraire : La persistance des connexions les plus labiles (conservation des éléments du carpe, les parties distales des pieds…), ainsi que celle des volumes (bassin) et le maintien en position initiale (de chant) des patellas indique que la décomposition du corps ne s’est pas effectuée dans un espace vide. Les mouvements observés - dislocation de l’articulation humérus-radius-ulna gauche, basculement vers l’extérieur de la scapula gauche, décrochement de la colonne vertébrale au niveau des vertèbres cervicales et des thoraciques ainsi que les perturbations dans la partie inférieure du gril costal droit – ne sortent pas du volume initial du corps. Ces observations permettent d’envisager le port d’une enveloppe (vêtement, linceul, couverture en cuir…) autour de l’individu, empêchant ainsi les mouvements osseux en dehors du volume du corps et préservant donc, dans un laps de temps assez court, un espace vide. Toutefois, ces phénomènes peuvent également être le résultat de la position «hypercontrac-tée» de l’individu. Les seuls déplacements observés (trois ossements : un 5e MTT à l’arrière des pieds, un os du carpe en avant du crâne et un MTC dans l’angle nord-ouest de la tombe) sont certainement dus aux nombreux terriers traversant la fosse sépulcrale. La présence d’un aménagement autour du défunt est attestée par la découverte de planches en bois et de traces ligneuses sur le fond de la structure. Ce contenant ne semble toutefois pas avoir eu d’incidence sur la décomposition du cadavre qui semble s’être réalisée dans un espace beaucoup plus réduit (type « enveloppe » funéraire). L’absence de traces ligneuses sur les pourtours de la fosse et au-dessus du squelette lors de la fouille ne nous permet pas d’affirmer de la présence d’un coffre en bois, même si l’hypothèse d’une chambre funéraire semble la plus vraisemblable. Les éléments dont nous disposons actuellement nous incitent plutôt à parler d’un plancher en bois. Celui-ci était maintenu par des quatre piquets placés à chaque angle. La présence de piquets dans un sédiment compact comme le loess laisse présumer qu’ils supportaient certainement une superstructure en matériau périssable. Les éléments dont nous disposons ne permettent pas de déterminer l’architecture exacte du monument funéraire. Néanmoins, plusieurs hypothèses sont envisageables, parmi lesquelles : - un coffrage en bois réalisé avec un assemblage de planches. - un système de couverture, composé de deux pans de bois formant une toiture, posés par-dessus le plancher en bois. Il semble également que l’architecture funéraire n’a pas empêché un apport assez rapide de sédiment sur le défunt et son mobilier. En effet, les faibles déplacements observés à l’intérieur du volume de la fosse sépulcrale, tant sur le squelette que sur la position de certains éléments du mobilier (pointes de flèches conservées de chant, deux vases en céramique res-tées debout), semblent signifier que la fosse sépulcrale a été comblée dans un laps de temps assez court après le dépôt du corps du défunt.
Inventaire du mobilier : Céramique - vase - vase Lithique - armatures de flèches - Lamelle en silex
- Eclats retouchés en silex - pierre à rainure en grès - Brassard d’arche en schiste Ossements animaux - canine inférieure gauche de suidé.
Datation : Campaniforme.
Ann.II.1.1.3. Sépulture 69
Etat de conservation : Sépulture intacte. Squelette complet. Matière osseuse très bien conservée.
Orientation de la fosse : Nord-ouest/sud-est
Orientation du squelette : Nord-ouest/sud-est
Description de la fosse sépulcrale : Fosse quadrangulaire (2,25 x 1,70 m) conservée sur une profondeur maximale de 0,50 m. Des traces ligneuses sont observables le long de la paroi nord. L’individu est déposé sur le fond de la fosse.
Remplissage de la fosse : Remplissage hétérogène de limon lœssique et lehmique brun à brun clair.
Données anthropologiques : Âge au décès : individu grand adolescent âgé entre 17 et 19 ans5. Diagnose sexuelle : individu masculin6. Stature : 1,78 m +/- 3,53 cm7. Lésions et variations anatomiques observées : - perforation olécrânienne de l’humérus droit. - déhiscence de l’axis : désunion de l’arc postérieur. - agénésie de la 3e molaire inférieure droite.5 d’après le degré de synostose des grands os longs, de l’os coxal et de la clavicule selon Birkner 19806 DSP 99 % selon Murail et al. 20057 mesure tibia + fémur, selon Trotter et Gleser 1952
crâne/ atlas
atlas/ Axis V.C. crâne/
mandibule humérus/ scapula V.T. V.L.
étroite étroite étroite lâche D : étroite G : étroite
- étroite, - léger hiatus entre T11 et T12 -déplacement T12
- lâche - hiatus entre T12 et L1, décalage entre L5 et sacrum
sacrum/ coxaux côtes/V.T. carpe M.T.C. coxo-fémorale patella/
fémur tarse M.T.T
D : / G : lâche
D : lâche, déplacements
des côtes basses
G : lâche
D : lâche G : lâche
D : lâche G : lâche
D : étroite G : étroite
D : étroite G : étroite
D : étroite G : étroite
D : étroite G : étroite
Fig. 134 : Etat des connexions anatomiques de l’individu 68
Position du squelette et du mobilier : L’individu a été déposé sur le côté gauche en position contractée, les membres fléchis. Le bloc crânio-facial n’apparait pas sa face latérale droite, la mandibule en occlusion avec les maxillaires, le thorax s’est affaissé sur le fond de la fosse.Le bras gauche placé en avant du thorax forme un angle de 45° avec l’avant-bras, ce dernier passe entre le bras et l’avant-bras gauches. On observe une flexion du poignet de sorte que la main se retrouve contrainte entre l’épaule droite et la mandibule, les doigts en extension. Le membre supérieur droit est hyperfléchi, la main est posée paume contre le sol, les phalanges ramenées contre la paume. Les membres inférieurs sont fléchis, l’angle entre la cuisse et la jambe est plus fermé sur le membre inférieur gauche, le genou gauche est plus en amont que le droit, tout comme le pied gauche par rapport au droit. Au niveau du bassin, sous l’os coxal gauche (au niveau de l’échancrure ischiatique), un «kit de briquet» comportant un fragment de marcassite (ou pyrite) associé à un éclat en silex permettant la percussion a été trouvé. La position des objets sur le corps de l’individu laisse à penser qu’ils pouvaient être portés. Egalement sous l’os coxal gauche, au niveau de l’aile iliaque, un ensemble de sept armatures de flèches ont été regroupées (dont deux sont de chant). Il s’agit certainement des ultimes vestiges d’un carquois. Un objet en os décoré et percé («pendentif arciforme») ainsi qu’un éclat de silex ont été retrouvés en avant du bassin. Un ensemble de quatre objets, composé d’une armature de flèche, de trois éclats en silex et d’une pierre à rainure en grès, était regroupé au niveau des pieds du défunt ; on peut envi-sager qu’initialement ces objets étaient déposés dans un contenant en matière périssable. La dotation du défunt compte également deux vases en céramique, placés dans le quart nord-ouest de la tombe, le premier au niveau de l’épaule gauche de l’individu et le second à quelques centimètres au nord-est de celui-ci.
Etat des connexions anatomiques : fig.2
Espace de décomposition et architecture funéraire : Nous avons pu observer d’une part, que les connexions les plus labiles sont parfai-tement conservées (maintien des éléments de la main et de la partie distale des pieds) et d’autre part, que des dislocations et des affaissements se sont déroulés à l’intérieur du volume du corps : non-conservation des volumes de la cage thoracique et du bassin, dislocation du coude gauche, basculement vers l’extérieur de la scapula gauche, décrochement de la co-lonne vertébrale au niveau des vertèbres cervicales et thoraciques, perturbations dans la par-tie inférieure du gril costal droit, sortit des têtes fémorales des cavités acétabulaires impliquant un léger décalage de la partie distale des tibias /fibulas par rapport aux pieds. Comme pour l’individu de la sépulture 68, ces observations taphonomiques peuvent être le résultat du port d’une enveloppe en matériau périssable autour ou sur le corps de l’individu, créant ainsi un espace vide interne au corps de l’individu, mais également la consé-quence de sa position hyperfléchie. La position du mobilier accompagnant le défunt, notamment les armatures de flèches situées dans le dos de l’individu (carquois ?), qui ont gardé leur position originelle (elles étaient certainement emmanchées à une hampe), à la verticale sur le tranchant, sous-entend que l’espace interne de la tombe n’est pas resté vide longtemps. Il semblerait donc qu’un apport de sédiment sur le corps du défunt a été réalisé dans un laps de temps assez court après son dépôt dans la fosse sépulcrale et que les mouvements internes au volume du corps observés pourraient être dus au port d’une enveloppe (vêtement, linceul, couverture en cuir…). Contrairement à la sépulture 68, la présence d’un contenant ou d’un plancher en bois n’est pas avérée, mais elle peut toutefois être envisagée par la découverte de quelques traces ligneuses le long de la paroi nord.
Inventaire du mobilier : Céramique - vase - vase Lithique - armatures de flèches - Eclats en silex - Pierre à rainure en grès Tabletterie - pendentif arciforme.
Datation : Campaniforme.
Ann.II.1.1.4. Sépulture 137
Malgré plusieurs sollicitations de notre part, le matériel osseux issu de l’opération de diagnostic ne nous a pas été transmis. Les observations qui suivent sont donc tirées de l’étude réalisée par A. Latron-Colecchia8.
Etat de conservation : Sépulture intacte. Squelette incomplet. Matière osseuse très mal conservée.
Orientation de la fosse : Nord-ouest / sud-est
Orientation du squelette : Sud-ouest / nord-est
Description de la fosse sépulcrale : Fosse ovale (2,08 x 1,80 m) conservée sur une profondeur maximale de 0,15 m à fond plat. Le squelette repose à 10 cm au-dessus du fond de la fosse, au centre de celle-ci.
Remplissage de la fosse : Remplissage homogène de limon lehmique brun très compact. Position du squelette et du mobilier : Le squelette est orienté selon un axe nord-ouest / sud-est, la tête est au sud-ouest. L’individu est déposé sur le côté droit en position fœtale, les membres hyperfléchis. Le bloc 8 Latron et al. 2010
crâne/ atlas
atlas/ Axis V.C. crâne/
mandibule humérus/ scapula V.T. V.L.
étroite étroite étroite lâche D : lâche G : lâche
- étroite, - déplacement et hiatus entre T9 et T10.
- lâche
sacrum/ coxaux côtes/V.T. carpe M.T.C. coxo-fémorale patella/
fémur tarse M.T.T
D : déplacé G : lâche
D : lâche, déplacements
des côtes basses
G : étroite
D : lâche G : lâche
D : étroite G : étroite
D : déplacé G : lâche
D : étroite G : étroite
D : étroite G : étroite
D : étroite G : étroite
Fig. 135 : Etat des connexions anatomiques de l’individu 69
crânio-facial n’apparait pas sa face latérale gauche. Le volume de la cage thoracique n’est pas conservé. Les membres supérieurs sont fléchis, l’avant-bras droit est ramené en avant du crâne, les éléments de la main droite sont disloqués. L’avant-bras gauche passe par-dessus le bras droit et la main gauche (identifiée par deux métacarpiens) devait être en appui contre l’avant-bras droit. Les membres inférieurs sont fléchis, superposés l’un sur l’autre, les genoux ramenés en avant du thorax. Les pieds apparaissent par leur face antérieure. Un objet en os a été retrouvé posé sur le crâne, au niveau de l’os occipital, ainsi que trois boutons à perforation en V dont un au niveau du cou et deux près de l’avant-bras gauche. Un vase en céramique est placé au nord-ouest de l’individu, au niveau de ses pieds. Un outil en silex a été retrouvé à 30 cm. à l’ouest du bassin.
Etat des connexions anatomiques : fig. 3
Espace de décomposition et architecture funéraire : /
Inventaire du mobilier : Céramique - vase - vase Lithique - un éclat en silex - un fragment d’outil de mouture en grès Tabletterie - 3 boutons à perforation en V - un petit objet en os
Données anthropologiques : Âge au décès : Indéterminé. Diagnose sexuelle : Indéterminé. Stature : Indéterminé. Lésions et variations anatomiques observées : /
Datation : Campaniforme.
Ann.II.1.2. LES DEPOTS MUNZINGEN
Ann.II.1.2.1. Sépulture 90
Etat de conservation : Sépulture perturbée. Squelettes incomplets. Matière osseuse bien conservée.
Orientation de la fosse : /
Orientation du squelette : /
Description de la fosse sépulcrale : Fosse de forme circulaire (diam. 1,50 m) conservée sur une profondeur maximale de 0,25 m. La fosse a été comblée par des tessons de céramique et des ossements animaux. Des éléments de squelette appartenant à au moins deux individus se situent stratigraphique-
ment sur l’amas formé par le mobilier.
Remplissage de la fosse : Remplissage homogène de limon brun mêlé à du loess remanié.
Données anthropologiques :- Individu adulte 1: Âge au décès : individu adulte jeune ou mature âgé entre 20 et 49 ans9. Diagnose sexuelle : individu de sexe féminin10. Stature : non déterminable. Lésions et variations anatomiques observées : arthrose sévère des vertèbres lom-baires, arthrose sur les surfaces auriculaires des os coxaux, forte abrasion dentaire.- Individu immature 2: Âge au décès : individu immature Infans I âgé entre 9,1 et 9,8 mois11. Diagnose sexuelle : indéterminable. Lésions et variations anatomiques observées : /- Ossements humains de taille adulte : - un crâne en occlusion avec une mandibule. - une diaphyse de fibula indéterminée.
Position des squelettes et du mobilier : Seule une partie du squelette de l’individu adulte est présent dans la fosse. Les élé-ments en connexion sont la partie inférieure du tronc, le bassin et le fémur gauche. Le corps de l’individu repose sur le côté droit, les fémurs sont perpendiculaires au tronc. Une diaphyse de fibula et un crâne, dont on ne peut certifier l’appartenance au reste du squelette, sont également présents dans la fosse. Le crâne est en connexion et en occlusion avec la mandibule, il est déconnecté de tous les autres éléments de la structure, il est seul au centre de la fosse. La fibula est située à proximité du bloc cranio-facial, au sud de ce dernier. L’individu immature a été déposé contre la paroi sud. Son crâne, placé sur un tesson de céramique, apparait par sa face latérale gauche. Ses côtes sont à plat, le membre supé-rieur gauche est très légèrement fléchi, sa main est déplacée. Les membres inférieurs sont fléchis.Etat des connexions anatomiques : - Individu adulte 1: fig. 4 - Individu immature 2: fig. 5
Espace de décomposition et architecture funéraire : La fosse est comblée en premier lieu par des tessons de céramique, des ossements animaux et des blocs de pierre. Il s’agit vraisemblablement d’une fosse détritique dont la der-nière utilisation correspond au dépôt de deux squelettes. En effet, concernant l’individu adulte, seulement une partie du corps est présent et les segments conservés en connexion correspondent à des connexions persistantes. L’absence d’une partie importante du squelette et particulièrement des plus petits éléments dans le reste de la fosse permet d’envisager qu’il a été déplacé et plaide donc en faveur d’une décomposition 9 selon Schmitt 200510 d’après sillon pré-auriculaire, grande incisure ischiatique symétrique et arc composé double selon Bruzek 199111 d’après Scheuer et al. 1980
crâne/atlas Atlas/ Axis V.C. crâne/
mandibule V.T. V.L. sacrum/ coxaux côtes/V.T. carpe M.T.C. coxo-
fémorale patella/ fémur tarse M.T.T.
étroite / / étroite / / déplacée lâche / déplacée lâche G : déplacée D : étroite
G : étroite étroite
Fig. 136 : Etat des connexions anatomiques de l’individu 137 (d’après A. Latron Colecchia in Latron 2010)
préalable du corps dans un autre endroit. La conservation de certaines connexions persistantes pourrait s’expliquer soit par un déplacement du cadavre lorsqu’il était encore en cours de décomposition (les ligaments sont alors encore présents), soit par le fait que le corps était protégé par une enveloppe en matière périssable (port d’un vêtement, linceul …). En revanche, aucun appariement par contigüité articulaire n’a pu être réalisé avec le crâne et le fragment de diaphyse de fibula adulte. Nous ne pouvons donc pas affirmer que ces trois éléments appartiennent au même individu. Le deuxième dépôt est celui du corps d’un individu immature. Quelques éléments sont manquants, mais les parties présentes sont en position anatomique. La conservation des connexions de la ceinture scapulaire, des membres supérieurs et celle de la position des autres parties du squelette exclut une décomposition en espace vide. De plus, le corps de l’enfant, tout comme les différents éléments appartenant à un (ou plusieurs) individu adulte, sont maintenus contre la paroi de la fosse dans un équilibre instable. Position conservable uniquement si un apport de sédiment a été réalisé dans un laps de temps relativement court ou court après le dépôt du corps. Nous n’avons aucun argument en faveur d’une simultanéité des deux dépôts. Tou-tefois, le fait qu’il n’y ait pas de sédimentation entre les os et les tessons de céramique sur lesquels ils reposent (ainsi qu’entre les tessons eux-mêmes) permet de conclure que les diffé-rents dépôts sont rapprochés chronologiquement et que la fosse est utilisée dans un laps de temps assez court.
Inventaire du mobilier : /
Datation : Munzingen
Ann.II.1.2.2. Sépulture 138
Malgré plusieurs sollicitations de notre part, le matériel osseux issu de l’opération de diagnostic ne nous a pas été transmis. Les observations qui suivent sont donc tirées de l’étude réalisée par A. Latron-Colecchia12.
Etat de conservation : Sépulture intacte. Squelette complet. Matière osseuse très bien conservée.
Orientation de la fosse : /
Orientation des squelettes : 12 Latron et al. 2010
crâne/atlas Atlas/ Axis V.C. crâne/
mandibule V.T. V.L. sacrum/ coxaux côtes/V.T. carpe M.T.C. coxo-
fémorale patella/ fémur tarse M.T.T.
/ / / / / étroite déplacé / / / lâche / / /
Fig. 137 : Etat des connexions anatomiques de l’individu 1 de la structure 90
crâne/atlas Atlas/ Axis V.C. crâne/
mandibule V.T. V.L. sacrum/ coxaux côtes/V.T. carpe M.T.C. coxo-
fémorale patella/ fémur tarse M.T.T.
/ / / déplacée / / / / déplacée déplacée / / / /
Fig. 138 : Etat des connexions anatomiques de l’individu 2 de la structure 90
- individu 1 : nord-est / sud-ouest - individu 2 : nord-ouest / sud-est - individu 3 : nord-ouest - individu 4 : est-ouest
Description de la fosse sépulcrale : Fosse circulaire de 2,14m de diamètre, conservé sur 1,70m. Son profil est en U dans sa partie inférieure, avec des parois s’élargissant brusquement à mi hauteur.
Remplissage de la fosse : La fosse est comblée par une succession de couches de limon lehmique brun et de limon loessique brun clair.
Position des squelettes et du mobilier : Quatre squelettes ont été mis au jour au fond de la structure. L’individu 1 était déposé directement sur le fond de la structure. Il reposait sur le ventre, la tête vers le sud, son membre supérieur gauche fléchi et les membres inférieurs très écartés et fléchis. Le défunt 2 reposait en position fléchie sur le coté gauche, sur le fond de la struc-ture, contre la paroi ouest. Le squelette 3 déposé sur le fond de la fosse était en contact avec l’individu 1. Il est orienté selon un axe sud / nord, la tête au sud. Ses membres inférieurs et supérieurs sont fléchis. Enfin, le corps de l’individu 4 est orienté est / ouest, déposé sur celui des trois enfants. La partie supérieure de son corps reposait sur le ventre, la partie inférieure, sur le côté gauche. Le mobilier, retrouvé juste au-dessus des individus 3 et 4, se compose de fragments de deux vases et d’une lame d’herminette en pélite-quartz.
Etat des connexions anatomiques : (Cf. Latron et al. 2010, p. 36 à 43)
Espace de décomposition et architecture funéraire : (Cf. Latron et al. 2010, p. 36 à 43)
Inventaire du mobilier : Céramique - vase - vase Lithique - lame d’herminette en pélite-quartz
Données anthropologiques :- Individu 1 : Âge au décès : individu immature Infans I âgé entre 2 et 3 ans13. Diagnose sexuelle : / Stature : / Lésions et variations anatomiques observées :- Individu 2 : Âge au décès : individu immature Infans II âgé entre 7 et 9 ans14. Diagnose sexuelle : / Stature : / Lésions et variations anatomiques observées : /
- Individu 3 :
13 selon Birkner 198014 selon Birkner 1980
Âge au décès : individu immature Infans I âgé entre 2 et 3 ans15. Diagnose sexuelle : Stature : Lésions et variations anatomiques observées : /- Individu 4 : Âge au décès : individu adulte jeune ou mature âgé entre 20 et 39 ans16. Diagnose sexuelle : individu de sexe masculin17. Stature : / Lésions et variations anatomiques observées : /
Datation : Munzingen
Ann.II.2. ETUDE ANTHROPOLOGIQUE, MÉTHODE, RÉSULTATS.
Malgré plusieurs sollicitations de notre part, le matériel osseux issu de l’opération de diagnostic ne nous a pas été transmis. Les observations concernant les individus des struc-tures 137 et 138 sont donc tirées de l’étude réalisée par A. Latron-Colecchia18. Seules les estimations de l’âge au décès et du sexe des individus de la structure 138 ont pu être réalisées du fait de la mauvaise conservation des os de la structure 13719.
Ann.II.2.1. LES SEPULTURES CAMPANIFORMES
L’étude a porté sur trois tombes individuelles datées de la période campaniforme. L’état de conservation des sépultures et de la matière osseux est excellent, excepté pour la tombe 10, qui est complètement arasée.
Ann.II.2.1.1. Estimation de l’âge au décès
- pour l’individu de la tombe 68 : Pour déterminer l’âge au décès de l’individu adulte, nous avons utilisé la méthode probabiliste de A. Schmitt20 qui consiste à coter la variabilité de la sénescence sur la surface sacro-pelvienne iliaque afin d’obtenir une estimation de l’âge au décès par tranche d’âge (fig. 6). Les observations ont permis de déterminer qu’il s’agit d’un individu adulte mature âgé entre 30 et 59 ans (fig. 7). Ce résultat est conforté par l’observation de pathologies dégénératives type arthrose sur les vertèbres, les patellas et la mandibule.
- pour l’individu de la tombe 69 : Concernant l’individu sub-adulte, nous avons observé le degré de synostose des os d’après les tableaux de Schinz, Baensch, Friedl et Uehlinger publié par Birkner21 (fig. 8). L’observation du degré de synostose des os longs, de la clavicule, de l’os coxal et des vertèbres a permis d’estimer une fourchette d’âge au décès de l’individu de la SP 069 situé entre 17 et 19 ans.
- pour l’individu de la tombe 10 : Les seuls éléments présents dans la tombe appartiennent au bloc crânio-facial et à des fragments de diaphyses de membres indéterminés. En confrontant nos données dentaires, au
15 selon Birkner 198016 selon Schmitt 200517 selon Murail 200518 Latron et al. 201019 Latron et al. 2010, p.3420 Schmitt 2005, p. 89-101.21 Birkner 1980.
tableau d’Ubelaker22 sur les différents stades d’éruption dentaire (fig. 9), nous obtenons un âge au décès de 5 ans +/- 16 mois.
- pour l’individu de la tombe 137 : «la synostose des épiphyses des os longs aux diaphyses indique qu’il s’agit d’un sujet adulte.»23
Ann.II.2.1.2. Diagnose sexuelle
La très bonne conservation des os coxaux a permis d’utiliser la méthode de diagnose sexuelle probabiliste élaborée par P. Murail24 qui consiste à combiner des données métriques et calcule la probabilité a posteriori pour l’individu d’être masculin ou féminin. Concernant l’individu grand adolescent (69), nous n’avons pas réalisé les mesures DCOX, ISMM et SCOX, car celles-ci prennent en compte des parties encore non soudées (crête non soudée à l’aile iliaque et tubérosité ischiatique en cours de synostose). Les résultats obtenus (fig. 10) nous montrent que les deux individus sont de sexe mas-culin, avec une probabilité de 100 % pour l’individu 68 et de 98 % pour celui de la tombe 69.
Ann.II.2.1.3. Observations des variations anatomiques.
Il est intéressant de noter que nous avons pu observer sur les deux individus adultes un caractère discret (variation anatomique non métrique, dont le caractère discontinu permet de déterminer des apparentements au sein d’ensembles funéraires et d’en comprendre l’orga-nisation25) similaire. Il s’agit d’une déhiscence (ouverture ou une rupture anormale : «désu-nion») de la 10ème vertèbre thoracique chez l’individu adulte mature et de l’axis pour l’individu grand adolescent (fig. 11). Le possible caractère génétique de cette variation nous permet d’émettre l’hypothèse d’un éventuel lien de parenté entre les deux individus. On peut également souligner que les patella de l’individu adulte mature sont marquées par une encoche du vaste externe. Ce caractère discret est dû à l’insertion du muscle vaste externe qui crée à la partie supéro-latérale de la patella une encoche arrondie, avec fréquem-ment un angle pointu en position inférieure : il s’agit toujours d’os cortical, lisse, arrondi et fin sans aspect cicatriciel. L’étiologie la plus évidente est mécanique (marqueur d’activité) avec, peut-être en plus, un défaut de vascularisation de cette zone26.
Ann.II.2.2. LES DEPOTS MUNZINGEN
Pour l’estimation de l’âge au décès et du sexe des individus de la structure 138 : cf. Latron et al. 2010, p.43 à 45.
Ann.II.2.2.1 Estimation de l’âge au décès
- individu 001 : Pour déterminer l’âge au décès de l’individu 001, nous avons utilisé la méthode proba-biliste d’A. Schmitt27 déjà cité. Les observations des deux surfaces auriculaires ont permis de déterminer qu’il s’agit d’un individu adulte jeune ou mature âgé entre 20 et 49 ans (fig. 12).
22 Ubelaker 197823 Latron et al. 2010, p.3424 Murail et al. 2005.25 Crubézy et Sellier, 1990a et 1990b26 Janssens † et Perrot, 2006-2007.27 Schmitt 2005, p. 89-101.
- individu 002 : Les dents ou germes dentaires étant absents, nous avons utilisé la méthode de J.L.Scheuer28 basée sur les longueurs diaphysaires qui permet d’estimer l’âge au décès des fœtus et des périnatals (en semaines) par l’application d’une équation linéaire de régression. Les mesures ont été prises sur le fémur et le tibia droit, nous obtenons les résultats suivants (fig. 13) : L’âge au décès de l’individu 002 est estimé entre 9,1 et 9,8 mois.
- ossements humains : Le crâne, la mandibule et la fibula retrouvés déconnectés dans la fosse sont tous de taille adulte. La maturité dentaire indique qu’il s’agit d’un sujet adulte.28 Scheuer, Musgrave, Evans 1980 / Scheuer, Black 2000, p.394 et 415.
structure os coxal SSPAI SSPIB SSPIC SSPID Clavicule
S/NS estimation
âge 068 Gauche 2 2 1 2 S 30-59
Fig. 139 : Distribution des probabilités à partir d’une population de référence dont la distribution par âge est homogène (Schmitt 2005, p.97).
Fig. 140 : Résultats du codage des différents critères de Schmitt et ossification de la clavicule.
Fig. 142 : The sequence
of formation and eruption of teeth (Ube-
laker 1978)
Fig. 141 : Appari-tion des noyaux
osseux et de leur synostose (d’après
SCHINZ, BAENSCH, FRIEDL, UEHLINGER), Birkner 1980.
Ann.II.2.2.2. Diagnose sexuelle
- individu 001 : La conservation incomplète des deux os coxaux ne nous a pas permis d’utiliser la méthode de diagnose sexuelle probabiliste élaborée par P. Murail29. D’après les observations effectuées selon les critères morphologiques de Bruzek30 - symétrie de la grande échancrure ischiatique, observation du sillon pré-auriculaire et de l’arc composé double – il s’agit d’un individu de sexe féminin.
Ann.II.2.2.3. Lésions et observations des variations anatomiques
L’individu adulte (individu 1) présente des lésions de type arthrose sur les vertèbres lombaires, sur les surfaces auriculaires des os coxaux, il peut s’agir de lésions fonctionnelles ou alors liées à la sénescence. Nous avons également observé que l’émail des dents de sa mandibule est très fortement abrasé.
Ann.II.2.3. STRUCTURES AVEC PRÉSENCE D’OSSEMENTS HUMAINS
St 71Présence d’un fragment de crâne humain appartenant à un individu de taille adulte.
29 Murail et al. 2005.30 Bruzek 1991, 2002
ST os coxal PUM SPU DCOX IIMT ISMM SCOX SS SA SIS VEAC % M % F résultats
068 G 59 28 227 31 117 165,5 76 83,5 35 57 100 0 M
069 G 55 28,5 / 45 / / 70,5 79,5 32,5 56,5 98 2 M
Fig. 143 : Résultats obtenus après la diagnose sexuelle probabiliste, d’après Murail et al. (2005) (va-
leurs exprimées en cm)
Fig. 144 : Déhiscence de l’axis (ind.69) et de la 10ème vertèbre thoracique (Ind.68).
St 73Présence d’une phalange distale de la main humaine appartenant à un individu de taille adulte.
structure os coxal SSPAI SSPIB SSPIC SSPID Clavicule
S/NS estimation
âge 90 Droite 2 2 1 1 ABS 20-49 90 Gauche 2 2 1 1 ABS 20-49
Fig. 145 : Résultats du codage des différents critères de Schmitt et ossification de la clavicule.
Os observés Equation linéaire de régression de l'âge sur la longueur du fémur et du tibia Résultats en semaines Résultats obtenus en année
et en mois Fémur droit (0.3303 x fémur) + 13.5583 ±2.08 37,9023<39,9823>42,0623 0,76 an soit 9,12 mois
Tibia droit (0.4207 x tibia) + 11.4724±2.12 40,9049<43,0249>45,1449 0,82 an soit 9,84 mois
Fig. 146 : Regression equations of age on maximum femoral length (mm) and on tibial length (adapted from
Scheuer et al. 1980)
Leucodermes (Caucasiens) Hommes Femmes
longueur (cm) os
long x +
cms +/- SD
longueur(cm) os long x + cms +/-
SD
Humérus 3.08 70.45 4.05 Humérus 3.36 57.97 4.45 Radius 3.78 79.01 4.32 Radius 4.74 54.93 4.24 Ulna 3.70 74.05 4.32 Ulna 4.27 57.76 4.30 Fémur 2.38 61.41 3.27 Fémur 2.47 54.10 3.72 Tibia 2.52 78.62 3.37 Tibia 2.90 61.53 3.66 Fibula 2.68 71.78 3.29 Fibula 2.93 59.61 3.57 Fémur + tibia 1.30 63.29 2.99 Fémur +
tibia 1.39 53.20 3.55
Mélanodermes (Négroïdes) Hommes Femmes
longueur (cm) os
long x +
cms +/- SD
longueur(cm) os long x + cms +/-
SD
Humérus 3.26 62.10 4.43 Humérus 3.08 64.67 4.25 Radius 3.42 81.56 4.30 Radius 2.75 94.51 5.05 Ulna 3.26 79.29 4.42 Ulna 3.31 75.38 4.83 Fémur 2.11 70.35 3.94 Fémur 2.28 59.76 3.41 Tibia 2.10 86.20 3.78 Tibia 2.45 72.65 3.70 Fibula 2.19 85.65 4.08 Fibula 2.49 70.90 3.80 Fémur + tibia 1.15 71.04 3.53 Fémur +
tibia 1.26 59.72 3.28
Il est recommandé d'ajouter 2.5 cm pour avoir la taille du cadavre
STATURE (cm)
HUMERUS (mm)
RADIUS (mm)
ULNA (mm)
FEMUR (mm)
TIBIA (mm)
FIBULA (mm)
FEMUR+TIBIA (mm)
140 244 179 193 348 271 274 624 141 247 182 195 352 274 278 632 142 250 184 197 356 277 281 639 143 253 186 200 360 280 285 646 144 256 188 202 364 283 288 653 145 259 190 204 368 286 291 660 146 262 192 207 372 289 295 668 147 265 194 209 376 292 398 675 148 268 196 211 380 295 302 682 149 271 198 214 384 298 305 689 150 274 201 216 388 301 309 696 151 277 203 218 392 304 312 704 152 280 205 221 396 307 315 711 153 283 207 223 400 310 319 718 154 286 209 225 404 313 322 725 155 289 211 228 409 316 326 732 156 292 213 230 413 319 329 740 157 295 215 232 417 322 332 747 158 298 217 235 421 325 336 754 159 301 220 237 425 328 340 761 160 304 222 239 429 331 343 768 161 307 224 242 433 334 346 776 162 310 226 244 437 337 349 783 163 313 228 246 441 340 353 790 164 316 230 249 445 343 356 797 165 319 232 251 449 346 360 804 166 322 234 253 453 349 363 812 167 324 236 256 457 352 366 819 168 327 239 258 461 355 370 826 169 330 241 261 465 358 373 833 170 333 243 263 469 361 377 840 171 336 245 265 473 364 380 847 172 339 247 268 477 367 384 855 173 342 249 270 481 370 387 862 174 345 251 272 485 373 390 869 175 348 253 275 489 376 394 876 176 351 255 277 494 379 397 883 177 354 258 279 498 382 401 891 178 357 260 282 502 385 404 898 179 360 262 284 506 388 407 905 180 363 264 286 510 391 411 912 181 366 266 289 514 394 414 919 182 369 268 291 518 397 418 927 183 372 270 293 522 400 421 934 184 375 272 296 526 403 425 941
Fig. 147 : Détermination de la stature par la longueur des os (homme) (d’après Trotter et
Gleser 1952)
Fig. 148 : Equations d’estimation de la stature chez les Leucodermes et les Mélanodermes (sexes séparés) (D’après
Trotter, 1970 in El Najjar & Mc Williams (1978 : 92)
BIBLIOGRAPHIE :
BLACK S., SCHEUER L.,2000 : Developmental juvenile osteology. Academic Press Inc, 2000, 587 p.
BRUZEK J.,1991 : Proposition d’une nouvelle method morphologique dans la détermination sexuelle de l’os coxal. Application à la Chaussée-Tirancourt. In : Rapport de la Table Ronde des 8 et 10 mai 1991 du GRD 742, Saintes, p.13-22.2002 : A method for visual determination of sex using the human hip bone. In : Ameri-can Journal of Physical Anthropology, 117, p. 157-168.
CRUBEZY E., SELLIER P.,1990a : Liens de parenté et populations inhumes. In : Les Nouvelles de l’Archéologie, 40, p.35-38.1990b : Caractères discrets et organisation des ensembles sépulcraux. In : Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, n.s.,2, 3-4, p. 171-178.
MURAIL P. et al,2005 : MURAIL P., BRUZEK J., HOUËT F., CUNHA E., DSP : a tool for probabilistic sex diagnosos using worldwide variability in hip bone measurements. In : Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, t.17, n° 3-4, pp. 167-176.
DEBONO L., PERROT R.,2007 : Annexe 2 - Caractères discrets du post-crâne. In : JANSSENS P.A., PERROT R. - Précis d’anthropobiologie descriptive et métrique du squelette. Site internet : http://anthropologie-et-paleopathologie.univ-lyon1.fr
SCHEUER L., MUSGRAVE JH., EVANS SP.,1980 : The estimation of late fetal and perinatal age from limb bone length by linear and logarithmic regression. In : Annals of Human Biology 7, p. 257-265.
SCHMITT A.,2005 : Une nouvelle méthode pour estimer l’âge au décès des adultes à partir de la surface sacro- pelvienne iliaque. In : Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropolo-gie de Paris, 14(1-2), p. 1-13.
UBELAKER D.H.,1978 : Human skeleton remains, excavation, analysis, interpretation. Washington, Ta-raxacum, 2e édition révisée en 1984, Chicago.
Ann.III.1. Le Munzingen
Cinq structures de cette période ont livré des restes de faunes, dans des proportions non équivalentes. La structure 39 a fourni 1 reste d’humérus de porc. La structure 90 a livré 15 restes (dont 12 de bœuf). Ces éléments osseux ont été retrouvés associés à des fragments de céramique sous les restes de deux individus humains. Les restes de bœuf, principalement des rejets détritiques appartiennent à au moins trois individus puisqu’une mandibule appartient à un jeune de 8/13 mois1 et deux distum droits de tibia à des individus de plus de 24/30 mois2. Enfin, trois structures vont faire l’objet d’une étude plus approfondie.
La structure 15
19 restes ont été retrouvés à la fouille sur le fond de la structure dont 15 appartenant au chat sauvage. L’individu retrouvé avait entre 9 et 11 mois. Aucune trace d’intervention humaine ne sont visibles sur les os du squelette. Il peut donc s’agir d’un dépôt volontaire ou d’un piégeage naturel au fond du silo. Les quatre autres restes osseux sont une mandibule de mustélidé et trois os longs d’anoures.
La structure 60
Dans cette structure, les restes d’un lagomorphe ont également été retrouvés. Il s’agit d’un fémur gauche, de deux coxaux, de deux côtes, un fragment d’occipital, quatre vertèbres lombaires, un sacrum et une série de petits os piégés dans une gangue de calcaire. Tous ces restes peuvent avoir appartenu au même individu, même si aucune observation allant dans ce sens n’a été faite lors de la fouille. Les os étaient accompagnés d’un fragment de coquille d’un bivalve d’eau douce (ordre des Unionoida).
La structure 117
Sur les 354 restes, 267 ont été déterminés, soit un peu plus de 75% du NR et 96 % du PR (fig. 1). Le poids moyen des os est assez élevé. Cela s’explique d’une part par la gangue de calcite qui recouvrait une partie du mobilier et d’autre part par la bonne conservation des restes osseux. En effet, plusieurs os ont été retrouvés entiers, notamment pour le porc. Du fait de cette faible fragmentation, les données métriques sont nombreuses. Malgré cela, les surfaces osseuses sont fortement abimées et les éventuelles traces de découpes ne sont donc plus visibles. L’étude de la découpe bouchère n’est pas envisa-geable, faute d’informations suffisantes.
L’ensemble est dominé par les animaux domestiques, et plus particulièrement par le porc et le bœuf (respectivement 50 et 46 % du NR).
Pour les suidés, les restes dentaires ont montré la présence d’au moins cinq indivi-dus dont un mâle de 19-21 mois, une femelle de 2 à 5 ans, un individu de 1 à 2 ans, un individu de 2 à 5 ans et un individu de plus de 5 ans3. La répartition anatomique des restes nous montre une très forte présence des crânes et des mandibules qui ont été retrouvés quasiment entiers. Le membre postérieur est également bien représenté avec plus de 50% du PO (Parties Obser-vées) (fig. 2). Plusieurs estimations de statures ont été possibles du faite de la bonne conservation des restes. Les porcs ont une hauteur au garrot comprise entre 0,67 et 0,78 m4 (fig. 7). Les restes dentaires de bœuf appartiennent à au moins quatre individus, un veau de 1 à 4 mois, un veau de 8 à 13 mois, un adulte de 6,5 à 9 ans et enfin un adulte de 9 à 11,5 ans. 1 Higham 1967 2 Barone 1986 3 Rowley-Conwy 1993 4 coefficient de Teichert (1969)
NR % Poids % NMI % PR/NR
Caprinés indéterminés 8 3,0% 35,4 0,3% 1 8,3% 4,43
Bœuf (Bos taurus L. ) 123 46,1% 7271,0 62,3% 4 33,3% 59,11
Porc (Sus scrofa domesticus Br.) 134 50,2% 4131,7 35,4% 5 41,7% 30,83
Total domestique 265 99,3% 11438,1 97,9% 10 83,3% 43,16
Cerf (Cervus elaphus L. ) 1 0,4% 236,6 2,0% 1 8,3% 236,6
Oiseau sp. 1 0,4% 3,0 0,03% 1 8,3% 3
Total sauvage 2 0,7% 239,6 2,1% 2 16,7% 119,80
Total déterminés 267 75,4% 11677,7 96,2% 12 100,0% 43,74
Indéterminés Grands mammifères 21 5,9% 333,0 2,7% 15,86
Indéterminés Petits mammifères 22 6,2% 73,0 0,6% 3,32
Esquilles 44 12,4% 57,6 0,5% 1,31
Total indéterminés 87 24,6% 463,6 3,8% 5,33
TOTAL 354 100,0% 12141,3 100,0% 12 100,0% 34,30
Fig. 149 : Spectre de faune de la structure 117
NR = 134NMPS =102NMIf = 3NMIc = 5
Dessin : M. Coutureau (Inrap) d'après Lignereux et Peters, 1996.
Porc
[75;100] %[50;75[ %[25;50[ %]0;25[ %0 %
Fig. 150 : Schéma du % des Parties Observées du Porc (St 117)
0 5 cm
1
32
(117.22)
(117.23)(117.21)
Les individus sont trop peu nombreux pour que l’on envisage une étude des âges d’abattages, deux jeunes sont néanmoins présents. Outre la mortalité infantile, cela montrerait un abattage des veaux pour l’exploitation du lait. La répartition des restes montre quant à elle une nette surreprésentation des fémurs, mais surtout l’absence ou la faible représentation de l’ensemble des os des bas de pattes (fig. 3).
Pour ces deux espèces, les traces de découpes sont très infimes. Comme nous l’avons dit plus haut, les surfaces osseuses étaient très mal conservées. Néanmoins, une vertèbre de bœuf et un coxal de porc ont été tranchés et un humérus de bœuf présente des traces de raclage. Des traces dues à une exposition au feu sont visibles sur certaines dents. Trois objets travaillés en os ont été retrouvés dans ce silo. Le premier artefact est un tibia d’oiseau qui a été scié sur au moins l’un de ses côtés, et dont la surface est parfaitement polie. Nous avons également trouvé une petite ébauche d’objet en os facetté et un poinçon fabriqué dans une côte fendue dans la longueur, poli par son utilisation, mais qui présente la particularité de ne pas avoir été entièrement travaillé. En effet, seule la partie supérieure de l’os a été travaillée, la partie spongieuse étant encore présente dans la partie inférieure (fig. 4).
Ann.III.2. Le Bronze final IIb / IIIa
Pour cette période, un petit ensemble de 45 restes dominé par le bœuf a été retrouvé (fig. 5). L’ensemble est très anecdotique, mais nous voulions le signaler, car les études de faune restes de cette période ne sont pas nombreux en Alsace.
Il faut également associer à cette période la structure 89 : dans le fond du silo, une partie d’un squelette de chien a été retrouvé lors de la fouille. L’ensemble des os longs des membres a été retrouvé, ainsi que le crâne et la mandibule droite. Une mandibule appartenant à un autre animal a également été retrouvée dans le comblement du silo. D’après l’épiphysa-
0
Dessin: M. Coutureau (inrap) d'après R. Barone, Anatomie comparée des mammifères domestiques, T1, éd. Vigot, 1976
]0; 25]
]25; 50]
]50; 75]
]75; 100]
% du PO
le boeuf
NR = 123NMPS = 98NMIf = 4NMIc = 4
Fig. 151 : Schéma du % des Parties Observées du Boeuf (St 117)
NR % Poids % PR/NRChèvre (Capra hircus L .) 1 3,2% 20,4 1,3% 20,40Caprinés indéterminés 7 22,6% 4 0,3% 0,57Total Caprinés 8 25,8% 24,4 1,6% 3,05Bœuf (Bos taurus L. ) 15 48,4% 1398,0 90,3% 93,20
Porc (Sus scrofa domesticus Br.) 3 9,7% 36,4 2,4% 12,13
Cheval (Equus caballus L. ) 1 3,2% 44 2,8% 44,00
Chien (Canis familiaris L.) 3 9,7% 41,5 2,7% 13,83Total domestique 30 96,8% 1544,3 99,8% 51,48Lièvre (Lepus spe. L.) 1 3,2% 3,8 0,25% 3,8Total sauvage 1 3,2% 3,8 0,2% 3,80Total déterminés 31 68,9% 1548,1 95,2% 49,94Indéterminés grands mammifères 3 6,7% 61 3,8% 20,33Indéterminés petits mammifères 3 6,7% 7,4 0,5% 2,47Esquilles 8 17,8% 10 0,6% 1,25Total indéterminés 14 31,1% 78,4 4,8% 5,60TOTAL 45 100,0% 1626,5 100,0% 36,14
0 5 cm
1
32
(117.22)
(117.23)(117.21)
Fig. 152 : Objets en matière dure animale de la St. 117
Fig. 153 : Spectre de faune des structures du Bronze final
tion des os, l’individu est décédé entre 7 et 9 mois. Les informations de fouilles sont très difficilement exploitables du fait de la gangue de calcaire qui recouvrait les os. Néanmoins, lors de l’étude, nous avons remarqué que le canidé était accompagné par les restes de deux jeunes lagomorphes. Les lagomorphes ne semblent pas être des perturbations antérieures. Cependant, aucun indice ne permet de dire que les animaux ont intentionnellement été déposés sur le fond du silo.
Ann.III.3. Le Hallstatt D1
Les structures de cette période renfermaient un ensemble de 72 restes, dominés par les restes d’animaux domestiques, mais avec la présence de 4 restes de cerf, dont un bois très bien conservé et pour lequel il ne manque que l’andouiller central qui a été sectionné (fig. 6).
NR % Poids % NMI % PR/NRChèvre (Capra hircus L .) 1 2,2% 3,4 0,2% 1 12,5% 3,40
Mouton (Ovis aries L. ) 2 4,4% 12,6 0,7% 1 12,5% 6,30Caprinés indéterminés 15 33,3% 81,2 4,6% 0 0,0% 5,41Total Caprinés 18 40,0% 97,2 5,6% 2 25,0% 5,40Bœuf (Bos taurus L. ) 10 22,2% 604,2 34,5% 2 25,0% 60,42
Porc (Sus scrofa domesticus Br.) 2 4,4% 7,8 0,4% 1 12,5% 3,90
Cheval (Equus caballus L. ) 10 22,2% 754 43,1% 1 12,5% 75,40
Chien (Canis familiaris L.) 1 2,2% 7 0,4% 1 12,5% 7,00Total domestique 41 91,1% 1470,2 84,0% 7 87,5% 35,86Cerf (Cervus elaphus L. ) 4 8,9% 280,6 16,0% 1 12,5% 70,15Total sauvage 4 8,9% 280,6 16,0% 1 12,5% 70,15Total déterminés 45 62,5% 1750,8 93,4% 8 100,0% 38,91Indéterminés grands mam. 6 8,3% 72,8 3,9% 12,13Indéterminés petits mam. 11 15,3% 29,6 1,6% 2,69Esquilles 10 13,9% 22 1,2% 2,20Total indéterminés 27 37,5% 124,4 6,6% 4,61TOTAL 72 100,0% 1875,2 100,0% 8 100,0% 26,04
Fig. 154 : Spectre de faune des structures du Hallstatt D1
Hauteur au garrot
Bœuf
ST Os Long.40 Métacarpe 181,550 Radius 23190 Métacarpe 185,5
117.11 Radius 220117.1 Fémur 336
Min 0,95Max 1,12Moy 1,046
Chien
ST Os Long.50 Humérus 150
Porc
ST Os Long.117.11 Radius 137117.14 MC IV 71117.11 Fémur 202117.12 Tibia 184117.11 MT III 83117.15 MT III 84117.11 MT IV 76117.15 MT IV 76,5
Min 0,67Max 0,78Moy 0,729
Caprinés
ST Os Long.71.5 Radius 162
Toutes les longueurs sont exprimées en centimétres
Haut. Garrot0,65
Haut. Garrot0,51
1,120,951,08
0,670,68
0,720,750,730,720,780,78
Haut. Garrot
Haut. Garrot (en m)
1,090,99
Fig. 155 : Tableau récapitulatif des hauteurs au garrot
Bœuf
Mandibule
ST Lmr HM3 BM3 LM350 81,5 74 13 36
117.1 16 37117.1 14,5 36
Scapula
ST LG BG GLP SLC90 54,5 45 67 50
117.15 47 39 54 37
Humérus
ST Bp Bd117.1 91117.11 72
Métacarpe
ST Bp GL SD CD DD Bd90 56 185,5 28 87 21 5740 181,5 57
Radius
ST BP BFp GL SD CD Bd BFd65 76 7250 64,5 58,5 231 33 88 57 56
117.11 72,5 68 220 30 85 65,5 65,5
Coxal
ST LA117.1 67,5
Tibia
ST Bp Bd SD CD71 57 32,5 92
117.11 54 29 99117.11 99,5117.1 5951.1 52
Fémur
ST Bp SD CD GL Bd117.1 113 32 205 336 89117.1 113117.1 93
Métatarse
ST Bd51.1 47,5
Calcaneum
ST GL GB117.14 125 40
Talus
ST Dm Dl GLm GLl117.15 33 34 54,5 62
Phalange 1
ST Glpe Bp SD Bd117.13 57 35,5 31 32
Phalange 2
ST GL Bp SD Bd117.1 38 24 19,5 24
Phalange 3
ST MBS DLS Ld117.1 21 61,5 46
Fig. 156 : Mesures ostéologiques
15
39
40
43
50
51
54
56
57
60
65
67
71
73
89
90
100
104
108
109
117
120
136
Tota
l
Boeuf
22
211
13
812
11
123
1167
Capriné
13
14
41
831
Mouto
n2
2
Chèvre
11
2
Porc
12
12
134
140
Cheval
91
111
Chie
n1
11
15
220
Cerf
31
11
6
Liè
vre
112
70
83
Chat
sauvage
15
15
11
Autr
es e
spèces
44
Petit
mam
mifère
12
11
91
22
37
Gra
nd m
am
mifère
11
21
41
121
32
12
10
210
12
44
72
Tota
l généra
l19
13
33
19
10
13
712
51
55
185
15
10
11
3354
11
623
Str
uctu
reE
spèces
Ois
eau s
p.
Indet.
Fig. 157 : Tableau récapitulatif des restes de faune
Bibliographie
BARONE 1986BARONE R., Anatomie comparée des mammifères domestiques, t. I. Ostéologie 3è éd. Rev. et mis à j., Vigot, Paris.
HIGHAM 1967HIGHAM C.F.W., Stock rearing as a cultural factor in prehistoric Europe, Proceedings of the Prehistoric Society, 33, 1967, p. 84-06.
ROWLEY-CONWY 1993ROWLEY-CONWY P., Season and reason : the case for a regional interpretation of Mesolithic settlement patterns, in PETERKIN G. L., BECKER H.,MELLARS P. (Dir.) : Hunting and animal exploitation in the later Paleolithic and Mesolithic of Eurasia. Washington DC, American An-thropological Association, p. 179-188. (Archaeological papers of the American Anthropological Association, 4), 1993.
TEICHERT 1969TEICHERT M., Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei vo-rundfrühgeschichtlichen Schweinen, Kühn Archiv, 83, 1969, p. 235‐292.
Poznań, 30-06-2011
Report on C-14 dating in the Poznań Radiocarbon Laboratory
Customer: Dr Anthony Denaire ANTEA- Archeologie
11 rue de Zurich 68440- Habsheim France
Job no.: 5323/11
Sample name Lab. no. Age 14C Remark Sierentz St117A Poz-0 >0 BP 0.6%N 5.2%C not suitable
Sierentz St117B Poz-41224 4985 ± 35 BP 3.1%N 9.3%C
Sierentz St117C Poz-41225 4960 ± 40 BP 3.7%N 10.7%C
Sierentz St68 A Poz-41226 3875 ± 35 BP 1.9%N 6.2%C
Sierentz St68 B Poz-41227 3910 ± 35 BP 2.6%N 8.0%C
Sierentz St69A Poz-41228 3925 ± 30 BP 1.8%N 6.4%C
Sierentz St69B Poz-41229 3935 ± 35 BP 3.5%N 10.5%C
Sierentz St90A Poz-41231 4990 ± 40 BP 0.8%N 3.7%C
Sierentz St90B Poz-41232 4910 ± 40 BP 1.6%N 5.7%C
Comments: Results of calibration of 14C dates enclosed
Head of the Laboratory Prof. dr hab. Tomasz Goslar
30-06-2011 Job no.: 5323/11 Page 2 from 2
Results of calibration of 14C dates – order 5323/11.
Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples encompass with the probability of ca. 68% and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal software.
OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010); r:5Atmospheric data from Reimer et al (2009);Sierentz St117B R_Date(4985,35) 68.2% probability 3794BC (68.2%) 3708BC 95.4% probability 3936BC (14.6%) 3873BC 3809BC (77.4%) 3691BC 3686BC ( 3.4%) 3661BCSierentz St117C R_Date(4960,40) 68.2% probability 3783BC (68.2%) 3695BC 95.4% probability 3909BC ( 4.7%) 3879BC 3803BC (90.7%) 3651BCSierentz St68 A R_Date(3875,35) 68.2% probability 2456BC (19.7%) 2419BC 2407BC (17.4%) 2375BC 2367BC ( 1.7%) 2364BC 2352BC (29.3%) 2297BC 95.4% probability 2468BC (89.3%) 2278BC 2251BC ( 4.3%) 2229BC 2221BC ( 1.7%) 2210BCSierentz St68 B R_Date(3910,35) 68.2% probability 2468BC (43.9%) 2397BC 2385BC (24.3%) 2346BC 95.4% probability 2484BC (95.4%) 2289BCSierentz St69A R_Date(3925,30) 68.2% probability 2473BC (29.5%) 2431BC 2425BC (15.7%) 2402BC 2381BC (23.0%) 2348BC 95.4% probability 2547BC ( 0.4%) 2544BC 2489BC (95.0%) 2299BCSierentz St69B R_Date(3935,35) 68.2% probability 2482BC (48.2%) 2400BC 2382BC (20.0%) 2347BC 95.4% probability
Dates calibrées (av. J.-C.)
Mes
ures
radi
ocar
bonn
es (B
P)
ST 90
ST 117
4200 4000 3800 3600 3400
4600
4800
5000
5200
OxCal v4.1.3 Bronk Ramsey (2009); r:5 IntCal04 atmospheric curve (Reimer et al 2004)
2565BC ( 7.7%) 2532BC 2496BC (87.7%) 2299BCSierentz St90A R_Date(4990,40) 68.2% probability 3895BC ( 5.8%) 3882BC 3800BC (62.4%) 3706BC 95.4% probability 3941BC (21.7%) 3858BC 3815BC (73.7%) 3660BCSierentz St90B R_Date(4910,40) 68.2% probability 3711BC (68.2%) 3646BC 95.4% probability 3771BC (95.4%) 3640BC
from to % from to %St 90 -3771 -3701 68.2 -3787 -3661 95.4
St 117 -3773 -3711 68.2 -3895 -3663 95.4St 69 -2474 -2350 68.2 -2488 -2310 95.4St 68 -2460 -2346 68.2 -2466 -2299 95.4
Sierentz : Dates combinées (A. Denaire)
Dates calibrées (av. J.-C.)
Mes
ures
radi
ocar
bonn
es (B
P)
ST 90
ST 117
4200 4000 3800 3600 3400
4600
4800
5000
5200
OxCal v4.1.3 Bronk Ramsey (2009); r:5 IntCal04 atmospheric curve (Reimer et al 2004)
Sierentz : Dates Néolithique récent (A. Denaire)
from to % from to %St 90 -3771 -3701 68.2 -3787 -3661 95.4
St 117 -3773 -3711 68.2 -3895 -3663 95.4St 69 -2474 -2350 68.2 -2488 -2310 95.4St 68 -2460 -2346 68.2 -2466 -2299 95.4
Dates calibrées (av. J.-C.)
Mes
ures
radi
ocar
bonn
es (B
P)
ST 69
ST 68
3000 2800 2600 2400 2200 2000
3600
3800
4000
4200
4400OxCal v4.1.3 Bronk Ramsey (2009); r:5 IntCal04 atmospheric curve (Reimer et al 2004)
Sierentz : Dates Néolithique final( A. Denaire)
0 20 km
1
3
5
8
9
10
11
1314
15
18
19
2022
2
4
6
712
16
17
21
23
24
Sierentz "Les villas d'aurèle"
(D'après Heyd 2000 ; Jeunesse et Denaire 2010)
1. Achenheim (Bas-Rhin, F.)2. Allschwil "Friedhof" (Kt. Baselland, CH.)3. Basel "Hörnligottsacker" ou "Im Hörnlifriedhof" (CH.)4. Colmar "Ecole normale" (Bas-Rhin, F.)5. Efringen "Im Ort" (Gde. Efringen-Kirchen, Kr. Lörrach, D.)6. Erstein "Grasweg-PAE" (Bas-Rhin, F.)7. Feldkirch "Kiesgrube speicher" (Gde. Hartheim, Kr. Breisgau-Hochschartzwald, D.)8. Gündlingen "Härtle" (Stadt Breisach-am-Rhein, Kr. Breisgau-Hochschartzwald, D.)9. Habsheim "Est" (Haut-Rhin, F.)10. Hegenheim (Haut-Rhin, F.)11. Kunheim (Haut-Rhin, F.)12. Meyenheim (Haut-Rhin, F.)
13. Munzingen "Ortsetter" (Stadt Freibourg, Stkr. Freibourg, D.)14. Nierderhergheim (Haut-Rhin, F.)15. Oberentzen "Giessen" (Haut-Rhin, F.)16. Riegel "Breite I" (Kr. Emmendingen, D.)17. Riegel "Grasäcker in der elznierderung" (Kr. Emmendingen, D.)18. Rouffach "Issenbreitfeld" (Haut-Rhin, F.)19. Saint-Louis (Haut-Rhin, F.)20. Sainte-Croix-en-Plaine (Haut-Rhin, F.)21. Sasbach "Wörthstück" (Kr. Emmendingen, D.)22. Schallstadt "Hirschackerwerg" (Gde. Schallstadt- Wolfenheimer, Kr. Breisgau-Hochschartzwald, D.)23. Urschenheim (Haut-Rhin, F.)24. Wyhl (Kr. Emmendingen, D.)
3. BASEL "HÖRNLIGOTTSACKER" ou "IM HÖRNLI-FRIEDHOF" (CH.)
Nature de la découverte : Une sépulture individuelleFosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Aucune informationMobilier : Céramique : Une jatte tronconique non décorée (2), une écuelle à anse non décorée (3) Lithique : Un brassard d'archer à six perfora-tions (1)
Bibliographie : Kraft 1947, Gallay 1970
(Kraft 1947 ; Ech. inconnue)
1 2
3
2. ALLSCHWIL "FRIEDHOF" (Kt. Baselland, CH.)
Nature de la découverte : Une sépulture individuelleFosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Aucune informationMobilier : Céramique : Un gobelet décoré Bibliographie : Kraft 1947, Heyd 2000
(Kraft 1947 ; Ech. inconnue)
(Ech. inconnue)
1
2
3
4 5
6
1. ACHENHEIM (Bas-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Une sépulture plurielle (double)Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumés : Individu 1 : adulte, replié droit, sud-nord, tête au sud Individu 2 : enfant (8/10 ans)Mobilier : Céramique : Un gobelet décoré (5), Une céramique commune décorée (6) Lithique : Un éclat de silex (3) Matière dure animale : Un poinçon en os (1) Divers : Une fusaïole (4) ; Une valve de moule (2)
Bibliographie : Ulrich 1942 et 1946, Treinen 1970, Jeunesse et Denaire 2010
(Ulrich 1946)
(Treinen 1970)
6. ERSTEIN "GRASWEG-PAE" (Bas-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Deux sépultures individuelles
Tombe 101 : Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Un individu replié gauche, sud-est/nord-ouest, tête au nordMobilier : Aucun14C : Poz-25772, 3810 +/-35 BP soit 2298-2151 av. J.-C. à 1 σ.
Tombe 3004 : Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : un homme (Det. anthropo.) replié gauche, sud-est/nord-ouest, tête au sud-estMobilier : Aucun14C : Poz-25799, 3820 +/-35 BP soit 2336-2201 av. J.-C. à 1 σ.
Bibliographie : Croutsch 2008, Jeunesse et Denaire 2010
5. EFRINGEN "IM ORT" (Gde. Efringen-Kir-chen, Kr. Lörrach, D.)
Nature de la découverte : Deux sépultures
Tombe 1 : Sépulture plurielle (Double), étagée (2 niv.).Fosse : rectangulaire ?, 1,85 x 1,40 m.Inhumés : Individu 1 (sup.) replié droit, sud-nord, tête au sud Individu 2 (inf.) : replié droitMobilier : (uniquement niveau sup. ; niveau inf. sans mobilier) Céramique : Deux tasses à anses non décorées (1 et 2), une jatte non décorée (3) Lithique : Une probable armature de flèche (4), deux éclats (5 et 6)
Tombe 2 : Sépulture individuelleFosse : rectangulaire ?, 1,40 x 0,85 m.Inhumé : un individu replié droit, sud-nord, tête au sudMobilier : Céramique : une jatte à profil en S non-décorée (8) Matière dure animale : cinq boutons coniques à perforations en V (7)
Bibliographie : Kraft 1947, Gallay 1970, Heyd 2000
7 8
1 2 3
4
5 6
Tombe 1
Tombe 2
(Kraft 1947 ; Ech. inconnue)
1 2
4. COLMAR "ECOLE NORMALE" (Bas-Rhin, F.) Nature de la découverte : Plusieurs tombes (nombre inconnu)Fosses : formes et dimensions inconnuesInhumés : InconnuMobilier : Céramique : Un gobelet non décoré (1), un gobelet à anse non décoré (2), tessons
Bibliographie : Kraft 1947, Zumstein 1965, Jeunesse et Denaire 2010
(Zumstein 1965)
9. HABSHEIM "Est" (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Trois sépultures individuelles
Tombe 1 : Fosses : rectangulaire, 1,60 x 1 mInhumé : Une femme (Det. anthropo.), repliée droit, sud-nord, tête au sudMobilier : Céramique : Un gobelet (2) et une tasse non-décorés (1).
Tombe 2 : (Détruite)
Tombe 3 :Fosses : rectangulaire, 1,50 x 0,90 mInhumé : Un homme (Det. anthropo.), replié gauche, nord-sud, tête au nordMobilier : Aucun Bibliographie : Wolf 1969, Jeunesse et Denaire 2010
Tombe 3
Tombe 1
Plan d’ensemble des tombes(Wolf 1969)
1 2
8. GÜNDLINGEN "HÄRTLE" (Stadt Breisach am Rhein, Kr. Breis-gau-Hochschwarzwald, D.)
Nature de la découverte : Une sépulture individuelleFosses : formes et dimensions inconnuesInhumé : Une femme (Det. anthropo.), repliée gauche, nord-sud, tête au nordMobilier : Céramique : Un gobelet non décoré (1), fragments d'une probable jatte (2).
Bibliographie : Gallay 1970, Heyd 2000
1
2
(Badische Fund. 1958 ; Ech. inconnue)
7. FELDKIRCH "KIESGRUBE SPEICHER" (Gde, Hartheim, Kr. Breisgau-Hochschwar-swald, D.)
Nature de la découverte : Trois sépultures individuelles
Tombe 1 : (Perturbée)Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : aucune informationMobilier : Céramique : Un gobelet décoré, une tasse à anse, une coupe et une jatte à profil en S non décorées
Tombe 2 : Fosse : forme et dimensions inconnues
Inhumé : Un individu replié droit, sud-nord, tête au sudMobilier : Céramique : Un gobelet, une probable tasse à anse et une cruche non décorés Divers : un fragment de métal
Tombe 3 : (Perturbée)Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : aucune informationMobilier : Céramique : Une tasse à anse non décorée Bibliographie : Gallay 1970, Heyd 2000
6. ERSTEIN "GRASWEG-PAE" (Bas-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Deux sépultures individuelles
Tombe 101 : Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Un individu replié gauche, sud-est/nord-ouest, tête au nordMobilier : Aucun14C : Poz-25772, 3810 +/-35 BP soit 2298-2151 av. J.-C. à 1 σ.
Tombe 3004 : Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : un homme (Det. anthropo.) replié gauche, sud-est/nord-ouest, tête au sud-estMobilier : Aucun14C : Poz-25799, 3820 +/-35 BP soit 2336-2201 av. J.-C. à 1 σ.
Bibliographie : Croutsch 2008, Jeunesse et Denaire 2010
5. EFRINGEN "IM ORT" (Gde. Efringen-Kir-chen, Kr. Lörrach, D.)
Nature de la découverte : Deux sépultures
Tombe 1 : Sépulture plurielle (Double), étagée (2 niv.).Fosse : rectangulaire ?, 1,85 x 1,40 m.Inhumés : Individu 1 (sup.) replié droit, sud-nord, tête au sud Individu 2 (inf.) : replié droitMobilier : (uniquement niveau sup. ; niveau inf. sans mobilier) Céramique : Deux tasses à anses non décorées (1 et 2), une jatte non décorée (3) Lithique : Une probable armature de flèche (4), deux éclats (5 et 6)
Tombe 2 : Sépulture individuelleFosse : rectangulaire ?, 1,40 x 0,85 m.Inhumé : un individu replié droit, sud-nord, tête au sudMobilier : Céramique : une jatte à profil en S non-décorée (8) Matière dure animale : cinq boutons coniques à perforations en V (7)
Bibliographie : Kraft 1947, Gallay 1970, Heyd 2000
7 8
1 2 3
4
5 6
Tombe 1
Tombe 2
(Kraft 1947 ; Ech. inconnue)
1 2
4. COLMAR "ECOLE NORMALE" (Bas-Rhin, F.) Nature de la découverte : Plusieurs tombes (nombre inconnu)Fosses : formes et dimensions inconnuesInhumés : InconnuMobilier : Céramique : Un gobelet non décoré (1), un gobelet à anse non décoré (2), tessons
Bibliographie : Kraft 1947, Zumstein 1965, Jeunesse et Denaire 2010
(Zumstein 1965)
12. MEYENHEIM (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Une sépulture individuelleFosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Aucune informationMobilier : Céramique : Un gobelet à anse (1) et une tasse à anse non décorés (2)
Bibliographie : Zumstein 1965, Jeunesse et Denaire 2010(Zumstein 1965)
1 2
11. KUNHEIM (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Trois sépultures probablement individuelles
Tombe 1 : (Détruite)
Tombe 2 : (Perturbée)Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Au moins un individu, tête au nordMobilier : Céramique : Un gobelet décoré (1), une jatte non décorée
Tombe 3 : (Perturbée)Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Au moins un individu, tête au nordMobilier : Céramique : Un gobelet décoré (2) Lithique : Deux brassards d'archers (3)
Bibliographie : Ulrich 1942, Zumstein 1965, Gallay 1970, Jeunesse et Denaire 2010
1
2
3
Tombe 2
Tombe 3
(Zumstein 1965)
10. HEGENHEIM (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Une sépulture individuelleFosse : Ovale, 1,80 x 1,30 mInhumé : Un adulte, replié droit, sud-nord, tête au sudMobilier : Céramique : Un gobelet décoré.
Bibliographie : Billoin et al. 2010
14. NIEDERHERGHEIM (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Deux sépultures
Tombe 1 : Sépulture individuelleFosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Un adulte, allongé sur le dos, sud-ouest/nord-est, tête au sud-ouestMobilier : Céramique : Une jatte polypode (1), une tasse à anse (2) non décorées Divers : Une probable perle en cuivre Tombe 2 : Sépulture plurielle (triple), étagée (2 niv.)Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Individu 1 (sup.) : replié droit, sud-nord, tête au sud Individu 2 (inf.) : replié gauche, nord-sud, tête au nord Individu 3 (inf.) : replié droit, nord-sud, tête au nordMobilier : Céramique : (Niv. Sup.) : Tessons d'une jatte non décorée (Niv. Inf.) : Un gobelet décoré (3), une cruche (4) et une jatte non décorées (5)
Lithique : (Niv. Inf.) : Un éclat de silex Divers : Un os animal Bibliographie : Jehl et Bonnet 1958, Jeunesse et Denaire 2010
1 Tombe 1
Tombe 2
2
3
4 5
(Jehl et Bonnet 1958)
13. MUNZINGEN "ORTSETTER" (Stadt Freiburg, Stkr. Freiburg, D.)
Nature de la découverte : Quatre sépultures individuelles
Tombe 1 : Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : un individu, sur le ventre, pied croisé, ouest-estMobilier : Aucun Tombe 2 : Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Un individu, ouest-estMobilier : Céramique : Un gobelet non décoré, impressions sur la lèvre (1)
Tombe 3 : Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Un individu, ouest-estMobilier : Céramique : Un gobelet (2) et une coupe (3) non-décorés
Tombe 4 : Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Un individu, ouest-estMobilier : Céramique : Tessons non-décorés
Bibliographie : Kraft 1947, Sangmeister 1964, Heyd 2000
1 2
3
(Kraft 1947 ; Ech. inconnue)
Tombe 2
Tombe 3
12. MEYENHEIM (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Une sépulture individuelleFosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Aucune informationMobilier : Céramique : Un gobelet à anse (1) et une tasse à anse non décorés (2)
Bibliographie : Zumstein 1965, Jeunesse et Denaire 2010(Zumstein 1965)
1 2
11. KUNHEIM (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Trois sépultures probablement individuelles
Tombe 1 : (Détruite)
Tombe 2 : (Perturbée)Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Au moins un individu, tête au nordMobilier : Céramique : Un gobelet décoré (1), une jatte non décorée
Tombe 3 : (Perturbée)Fosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Au moins un individu, tête au nordMobilier : Céramique : Un gobelet décoré (2) Lithique : Deux brassards d'archers (3)
Bibliographie : Ulrich 1942, Zumstein 1965, Gallay 1970, Jeunesse et Denaire 2010
1
2
3
Tombe 2
Tombe 3
(Zumstein 1965)
10. HEGENHEIM (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Une sépulture individuelleFosse : Ovale, 1,80 x 1,30 mInhumé : Un adulte, replié droit, sud-nord, tête au sudMobilier : Céramique : Un gobelet décoré.
Bibliographie : Billoin et al. 2010
17. RIEGEL "GRASÄCKER IN DER ELZNIER-DERUNG" (Kr. Emmendingen, D.)
Nature de la découverte : Une sépulture indivi-duelleFosse : rectangulaire, 1,70 x 1,10 mInhumé : Un individu, replié gauche, nord-sud, tête au nord
Mobilier : Céramique : Un gobelet (1) et une écuelle à anse (4) décorés, un vase tronconique à anse (2) et une cruche (3) non décorés Bibliographie : Kraft 1947, Gallay 1970, Heyd 2000
1 2 3 4
(Kraft 1947 ; Ech. inconnue)
16. RIEGEL "BREITE I" (Kr. Emmendingen, D.)
Nature de la découverte : Une sépulture indivi-duelleFosse : rectangulaire, dimensions inconnuesInhumé : Un individu, replié gauche, nord-sud, tête au nordMobilier : Céramique : Un gobelet (2), une tasse (1) et une jatte polypode (4) non décorés Lithique : Une armature de flèche (5) Divers : Un kit de briquet (silex + fragment d'oxyde ferreux)
Bibliographie : Schlencker et Stöckl 1989, Jeunesse et Denaire 2010
(Schlencker et Stöckl 1989 ; Ech. inconnue)
18. ROUFFACH "ISSENBREITFELD" (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Une sépulture indivi-duelleFosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Aucune information
Mobilier : Céramique : Un gobelet à anse non décoré Lithique : Un fragment de brassard d'archer
Bibliographie : Zumstein 1965, Gallay 1970, Jeunesse et Denaire 2010
15. OBERENTZEN "GIESSEN" (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Une sépulture individuelleFosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Un individu, replié gauche, nord-sud, tête au nordMobilier : Céramique : Un gobelet non décoré
Bibliographie : Zumstein 1965, Gallay 1970, Jeunesse et Denaire 2010 (Zumstein 1965)
12 3
4
22. SCHALLSTADT "HIRSCHACKE-RWERG" (Gde. Schallstadt-Wolfenhei-mer, Kr. Breisgau-Hochschwarzwald, D.)
Nature de la découverte : Une sépulture plurielle (Double), perturbée.Fosse : ovale, dimensions inconnuesInhumés : Individu 1 : replié, nord-ouest/sud-estIndividu 2 : Partie de squelette d'un enfantMobilier : Céramique : Une tasse à anse (1)et une jatte polypode (3) non décorées, tessons d'une faisselle (2). Bibliographie : Sangmeister 1974, Heyd 2000
1
2
3
(Sangmeister 1974 ; Ech. inconnue)
21. SASBACH "WÖRTHSTÜCK" (Kr. Emmendingen, D.)
Nature de la découverte : Cinq sépultures individuellesFosses : Tombes 1, 2, 4 et 5 : forme et dimensions incon-nues Tombe 3 : forme inconnue, 0,9 x 0,46 mInhumés : Tombes 1, 2, 4 et 5 : aucune information Tombe 3 : Un enfant, replié droit, sud-sud-est/nord-nord-ouest, tête au sudMobilier : Tombes 1, 2, 4 et 5 : aucune information Tombe 3 : Céramique : Deux gobelets décorés Bibliographie : Pape 1978, Heyd 2000, Jeunesse et Denaire 2010
(Pape 1978 ; Ech. inconnue)Tombe 3
20. SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Une sépulture individuelleFosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Un individu, replié, nord-sud, tête au sudMobilier : Céramique : Un gobelet décoré Bibliographie : Werner 1958, Jeunesse et Denaire 2010
19. SAINT-LOUIS (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Une sépulture individuelleFosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Un individu (Femme ?), position et orientation inconnueMobilier : Céramique : Un gobelet décoré, une cruche non-décorée Bibliographie : Zumstein 1965, Schweitzer 1972, Jeunesse et Denaire 2010
17. RIEGEL "GRASÄCKER IN DER ELZNIER-DERUNG" (Kr. Emmendingen, D.)
Nature de la découverte : Une sépulture indivi-duelleFosse : rectangulaire, 1,70 x 1,10 mInhumé : Un individu, replié gauche, nord-sud, tête au nord
Mobilier : Céramique : Un gobelet (1) et une écuelle à anse (4) décorés, un vase tronconique à anse (2) et une cruche (3) non décorés Bibliographie : Kraft 1947, Gallay 1970, Heyd 2000
1 2 3 4
(Kraft 1947 ; Ech. inconnue)
16. RIEGEL "BREITE I" (Kr. Emmendingen, D.)
Nature de la découverte : Une sépulture indivi-duelleFosse : rectangulaire, dimensions inconnuesInhumé : Un individu, replié gauche, nord-sud, tête au nordMobilier : Céramique : Un gobelet (2), une tasse (1) et une jatte polypode (4) non décorés Lithique : Une armature de flèche (5) Divers : Un kit de briquet (silex + fragment d'oxyde ferreux)
Bibliographie : Schlencker et Stöckl 1989, Jeunesse et Denaire 2010
(Schlencker et Stöckl 1989 ; Ech. inconnue)
18. ROUFFACH "ISSENBREITFELD" (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Une sépulture indivi-duelleFosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Aucune information
Mobilier : Céramique : Un gobelet à anse non décoré Lithique : Un fragment de brassard d'archer
Bibliographie : Zumstein 1965, Gallay 1970, Jeunesse et Denaire 2010
15. OBERENTZEN "GIESSEN" (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Une sépulture individuelleFosse : forme et dimensions inconnuesInhumé : Un individu, replié gauche, nord-sud, tête au nordMobilier : Céramique : Un gobelet non décoré
Bibliographie : Zumstein 1965, Gallay 1970, Jeunesse et Denaire 2010 (Zumstein 1965)
12 3
4
24. WHYL (Kr. Emmendingen, D.)
Nature de la découverte : Une sépulture individuelleFosse : rectangulaire, 1,70 x 1mInhumés : Un adule, replié droit, sud-sud-ouest/nord-nord-est, tête au sudMobilier : Céramique : Un gobelet (1) et une cruche polypode (2) décorés Bibliographie : Kraft 1947, Gallay 1970, Heyd 2000
1
2(Gallay 1970 ; Ech. inconnue)(Kraft 1947)
23. URSCHENHEIM (Haut-Rhin, F.)
Nature de la découverte : Une sépulture individuelleFosse : forme et dimensions inconnuesInhumés : Aucune informationMobilier : Lithique : Un brassard d'archer à quatre perforations Bibliographie : Zumstein 1965, Gallay 1970, Jeunesse et Denaire 2010
(Zumstein 1965)