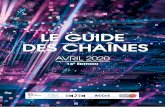“Ingres et Mantegna”, dans Bulletin du musée Ingres, 86, avril 2014, p. 35-52
Transcript of “Ingres et Mantegna”, dans Bulletin du musée Ingres, 86, avril 2014, p. 35-52
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
INGRES ET MANTEGNA
Gennaro Toscano
1
Ingres ne s’est jamais rendu à Padoue, à Vérone ou à Mantoue, villes qui recèlent d’œuvres majeures d’Andrea Mantegna (1431-1506). Jamais mentionné dans ses écrits ni dans sa correspondance, le plus important artiste de cour de l’Italie du Quattrocento n’était pourtant pas inconnu du peintre de Montauban. Ingres voua, en effet, tout au long de sa carrière une admiration discrète pour l’artiste des Gonzague comme en témoignent certaines de ses compositions ainsi que des calques d’après ses œuvres, collés dans sa riche documentation, aujourd’hui conservée au musée de Montauban. Nous donnerons quelques jalons sur la réception de Mantegna en France et la présence de ses œuvres dans les collections françaises, pour conclure sur le regard porté par Ingres sur le grand maître du Quattrocento.
Mantegna en France
Andrea Mantegna n’a jamais franchi les Alpes. Il a d’abord œuvré à Padoue puis, sans interruption, à Mantoue au service des Gonzague, à l’exception de quelques retours en Vénétie, un voyage à Florence et un séjour à Rome de 1488 à 1490. Ce sont les relations entre la cour des Gonzague et la France, ainsi que les ambassadeurs et les humanistes qui facilitèrent sa renommée. Ses œuvres devinrent dès son vivant de véritables objets de propagande politique et les gravures jouèrent un rôle important dans la diffusion de son art 1.
Le premier chef-d’œuvre de Mantegna qui franchit les Alpes fut le célèbre saint sébastien, arrivé à Aigueperse, en Auvergne, à l’occasion du mariage célébré le 26 février 1481 entre Chiara Gonzague, fille du marquis Frédéric, et Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier et dauphin d’Auvergne 2. La toile y demeura jusqu’en 1910, année de son acquisition par le musée du Louvre 3. Le saint sébastien rejoint ainsi les œuvres du maître saisies à Vérone et à Mantoue en 1797 ou au château de Richelieu (Indre-et-Loire) en 1800.
Les Guerres d’Italie donnèrent l’occasion aux rois de France, de Charles VIII à Louis XII, de découvrir ce pays de cocagne. Le peintre des Gonzague était alors à son apogée. En novembre 1494, le duc de Ferrare, Hercule Ier, offrit une tente à Charles VIII dont le mât était orné de scènes peintes et sculptées par Mantegna4. À la même époque, le cardinal Georges d’Amboise (1460-1510) joua un rôle fondamental dans la réception de Mantegna en France 5. En 1502, Francesco Gonzague, offrit à Louis II de La Trémoïlle, prince de Talmont, « una delle più belle cose che mai habbi facto Messer Andrea Mantinea »6, œuvre non identifiée 7. Dès 1504, le jeune duc d’Angoulême, futur François Ier, formulait le souhait de recevoir « des peintures de ces maîtres singuliers d’Italie », ainsi Niccolò Alamanni, florentin résident à Blois, demanda au marquis de Mantoue de procurer au jeune duc « quelque chose d’exceptionnel » de Mantegna, « un artiste des plus excellents »8. En 1507, Florimont Robertet, trésorier du Royaume et secrétaire des
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
2
fig. 1 - Atelier d’Andres Mantegna, Les porteurs de corselets avec un pilastre, avant 1506 burin, H. 21,7 ; l. 32 cm. Paris, Bibliothèque nationale de France, Estampes,
inv. Ea 31a rés (G. L. 419).
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
3
finances de Charles VIII puis de Louis XII et de François Ier, grand amateur d’art italien, désirait posséder une œuvre de Mantegna. Le 11 avril 1508, le marquis de Mantoue, l’informant du décès du peintre, lui indiqua qu’il avait la possibilité d’honorer sa demande en lui envoyant une œuvre d’un peintre à la « manière plus douce et plus suave »9.
Les œuvres de Mantegna et en particulier les gravures de ses triomphes devinrent de véritables modèles pour les artistes européens de l’époque (fig. 1). La frise qui ornait la porte de Gênes au château de Gaillon - résidence d’été du cardinal d’Amboise - fut sculptée d’après l’un des Triomphes de Mantegna, comme le relate la lettre envoyée par Jacopo da Atri à Isabella d’Este en mars 1510 : « In el quadro dal lato della prima porta gli è sculpito tutto il triumpho de Iulio Cesare, ne la forma chel famoso Mantinia lo depinse, de non troppo grande figura ma ben et con bona gratia intagliato et da altri lati de diverse imprese, arme et fenestre ben acconcie et ornate »10.
Suzanne Boorsch et David Landau ont démontré que les sept plaques gravées sur cuivre répertoriées dans l’inventaire après décès (1510) de Ludovico Mantegna, fils du peintre 11, avaient été vraisemblablement emportées en France sans toutefois établir à quelle époque précise ni par qui, comme en témoignent les nombreuses épreuves sur papier avec filigranes français 12. Les estampes de Mantegna furent particulièrement appréciées non seulement par les artistes présents sur le chantier de Fontainebleau mais aussi par le graveur et orfèvre Jean Duvet (1485-1570?) 13. Parallèlement le nom de Mantegna commença à apparaître dans la littérature française. Dans la troisième édition de sa De artificialis Perspectiva (1524), Jean Pèlerin Viator mentionne « André Montaigne » parmi les artistes « decorans France, Almaigne et Italie », aux côtés de Fouquet, Poyer, Pérugin, Léonard, Raphaël et Michel-Ange. Trois ans plus tard, dans son Discours sur l’architecture, publié dans l’édition de la traduction du traité de Vitruve par Jean Martin, Jean Goujon considère « André Mantégne non inférieur » aux artistes italiens les plus illustres du XVIe
siècle, tels Michel-Ange, Bramante et Raphaël 14.
D’autres peintures du maître padouan arrivèrent en France après la dispersion de la collection des Gonzague. Entre 1627 et 1630, le cardinal de Richelieu se procura les tableaux du studiolo d’Isabelle d’Este par l’intermédiaire du duc de Nemours. Ainsi les toiles représentant le Parnasse et Minerve chassant les Vices du jardin des Vertus furent installées près de la chambre du Roi au château de Richelieu, aux côtés des toiles de Costa et du Pérugin provenant du même ensemble 15. Dans le même temps, le cardinal de Richelieu et la reine Marie de Médicis essayèrent d’acquérir les célèbres toiles des Triomphes, passées auprès de Daniel Nys à Venise. Toutefois, la reine ne désirant uniquement les toiles « de facture véritablement exquise » et dignes de sa collection, Nys refusa de morceler l’ensemble et préféra vendre les Triomphes à Charles Ier d’Angleterre. La France passa ainsi à côté d’une occasion exceptionnelle 16.
Le successeur du cardinal de Richelieu, le cardinal Mazarin possédait lui-aussi des œuvres de Mantegna passées de Mantoue en Angleterre. Après la vente des biens de Charles Ier Stuart en 1651, deux tableaux attribués à Mantegna sont en effet mentionnés dans une lettre envoyée par Antoine de Bordeaux au cardinal lui proposant l’achat d’un « homme portant sa croix» et d’un « Jésus-Christ mort ». En 1661, les deux toiles figurent dans l’inventaire de Mazarin : « Deux autres tableaux faictz par Andréa Mantegna, sur thoile, l’un représentant Nostre Seigneur qui porte sa croix au Calvaire, et plusieurs
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
4
fig. 2 - Andrea Mantegna, saint-Jacques devant Hérode agrippa,anciennement à Padoue, église des Eremitani, chapelle Ovetari, fresque détruite en 1944.
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
5
diverses figures ; et l’autre Nostre Seigneur mort à la reverse en racourcy et plusieurs autres figures au naturel »17. Cette dernière toile, admirée par Félibien 18, fut présentée au Bernin en 1665 pendant son voyage en France 19.
L’inventaire après décès d’Everhard Jabach (1618-1695), rédigé en 1695, mentionne des dessins de Mantegna dans sa collection parisienne : « Notre Seigneur debout avec deus saints de coté »20, et deux dessins avec une « partie du triomphe de Jules César, à la plume sur papier bistré »21. Dans la même collection figurait une Vierge à l’Enfant attribuée à Mantegna, vendue auparavant à Louis XIV en 1662 22.
Par sa présence dans de prestigieuses collections françaises, Mantegna entre dans la littérature artistique française du Grand siècle. Dans ses Entretiens publiés à Paris en 1666, Félibien consacre quelques pages à l’artiste des Gonzague et affirme qu’il « a mérité d’être mis au nombre de ceux qui ont bien disposé les figures, qui ont dessiné correctement, et qui ont exprimé leurs sujets avec beaucoup de science » 23. Dans son abrégé de la vie des peintres, rédigé entre 1697 et 1699, Roger de Piles rappelle le rôle du maître dans le domaine de la gravure : « les Italiens le font inventeur de la gravure au burin pour les estampes » 24.
Au siècle des Lumières, d’autres tableaux de Mantegna circulèrent dans les plus prestigieuses collections parisiennes 25. Dans l’inventaire après-décès d’André-Charles Boulle, daté du 11 mars 1732, figurait « Un portefeuille d’André Manteigne avec quelques desseins »26 parmi de nombreux estampes et dessins. De même, dans la collection de Pierre Crozat, des dessins attribués à Mantegna étaient également présents, comme en témoigne la description sommaire de Pierre-Jean Mariette publiée en 1741 : il fait état de 31 dessins attribués à « André Mantegne de Padoue », parmi lesquels il s’en trouve « trois considérables du triomphe de Jules César », et 25 estampes « gravées par André Mantegne, ou d’après lui »27. Pierre-Jean Mariette (1694-1774), marchand, libraire et grand collectionneur s’était chargé d’une traduction en français des Vite de Vasari 28. De cet ambitieux projet, il nous reste des notes manuscrites publiées au XIXe et au XXe siècle. Dans ses notes, la personnalité de Mantegna occupe une large place et sa biographie, bien plus précise que celle de Vasari, s’achève par l’évocation de son activité de graveur 29 à laquelle quatre pages manuscrites sont dédiées dans les volumes consacrés aux Grands peintres de l’école d’Italie 30.
Parallèlement à cet intérêt des grands collectionneurs parisiens pour le peintre de Padoue, quelques voyageurs commencent à apprécier ses œuvres lors de leurs séjours en Italie. Parmi eux, Montesquieu. Arrivé à Padoue, le 14 septembre 1728, après avoir visité le Palazzo della Ragione, Santa Giustina, et la basilique Saint-Antoine, il s’attarde sur les fresques de Mantegna de la chapelle Ovetari dans l’église des Eremitani (fig. 2) : « Dans l’église des Pères-Ermites, dans une chapelle, d’un côté, Le Martyr de saint Christophe, et, de l’autre celui de saint Jacques, ouvrage d’André Mantégna, Padouan ; ouvrage excellent par les merveilles de la perspective »31. Malgré cet éloge, les temps n’étaient pas encore mûrs pour une bonne compréhension de la peinture du Quattrocento. Ainsi, ce même cycle ne réussit pas à séduire le président de Brosses qui visita la ville en 1739 : « une chapelle à fresque de Mantegna, maître du Corrège, excellente en détail et qui cependant ne peut s’appeler un bon ouvrage, à cause du méchant goût du siècle qui règne ; il faut bien distinguer les morceaux qui ne sont pas de la main de Mantegna »32. Malgré le « méchant
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
6
fig .3 - Andrea Mantegna, La Vierge et l’Enfant avec Francesco Gonzagueet les saints Michel archange, andré, Longin, Georges, Jean Baptiste enfant et sainte Elisabeth,
dite La Vierge de la Victoire, 1495-1496,toile, H. 285 ; l. 168 cm (anciennement dans l’église Santa Maria della Vittoria à Mantoue),
Paris, musée du Louvre.
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
7
goût du siècle », le président fut séduit par la Présentation au Temple de Mantegna admirée aux Offices et par la chapelle d’Innocent VIII au Vatican 33. On retrouve ce même esprit dans le journal de voyage de Charles-Nicolas Cochin qui visita l’Italie une dizaine d’années plus tard. Dans son Voyage d’Italie, publié en 1756 puis en 1758, il mentionne brièvement « plusieurs tableaux dont quelques-uns sont fort beaux » dans l’église San Zeno de Vérone sans distinguer la célèbre pala de Mantegna, tandis qu’à Venise, dans la sacristie des Incurabili, il cite une sainte conversation attribuée à Mantegna et la considère comme une « mauvaise antiquaille ». À la fin du siècle, Élisabeth Vigée-Lebrun évoque dans ses souvenirs les célèbres fresques des Eremitani : « on trouve aux Augustins des fresques de Montigni, dont les figures et tous les accessoires sont de la plus grande finesse »35.
Ces tièdes appréciations ou ces incompréhensions de l’œuvre du grand maître du Quattrocento furent définitivement dépassées avec les campagnes napoléoniennes qui firent entrer au palais du Louvre des chefs-d’œuvre de l’artiste. Au cours des campagnes, les commissaires de la République retinrent prioritairement les tableaux qui manquaient dans les collections nationales, c’est-à-dire les grands retables du Moyen Age et de la Renaissance. En mai 1797, quatorze tableaux saisis à Vérone furent présentés au Louvre : six d’entre eux faisaient partie du célèbre Retable de san Zeno de Mantegna. Dans la notice des principaux tableaux recueillis en Italie, qui accompagnait l’exposition de ces tableaux dans le Grand Salon du Muséum en 1798, une brève biographie introduisait le lecteur aux œuvres de l’artiste :
Mantegne (Andrea Mantegna), né à Padoue en 1431, mort à Mantoue en 1517. École Lombarde. Il gardait les moutons dans sa jeunesse, lorsqu’un amateur, s’étant aperçu qu’il s’amusait à dessiner, le mit chez le Peintre Jean Squarcione, qui, charmé de ses progrès, l’adopta pour son fils, et le fit son héritier. Ses principaux ouvrages sont à Padoue, à Rome et à Mantoue. Le musée national n’en possédait qu’un représentant La Vierge et l’Enfant Jésus.Mantegna était architecte ; il a gravé aussi plusieurs planches d’après ses dessins, et les Italiens lui attribuent, on ne sait sur quel fondement, l’invention de la gravure au burin ; mais sa principale gloire est d’avoir eu le Corrège pour disciple.
Cette courte biographie était suivie par la description des tableaux arrachés au retable de San Zeno et accompagnée par le commentaire suivant : « Vasari, et les auteurs qui ont écrit depuis lui, ont toujours mis cet ouvrage au nombre des plus capitaux, que Mantegna ait exécutés »36.
La Vierge de la Victoire de Mantegna (fig. 3), provenant du maître-autel de l’église des Philippins de Mantoue et confisquée en 1797, figurait dans le même lot. Elle arriva à Paris le 27 juillet 1798 et fut exposée au mois de novembre de la même année 37. La notice qui accompagnait l’exposition de 1798 au Muséum décrivait ainsi ce tableau :
Mantegna qui avait été l’architecte de l’église, fut aussi chargé de peindre l’ex-voto du maître-autel ; il se piqua de mettre dans l’exécution de ce morceau tout le soin dont il était capable, et ce fini recherché, cette délicatesse extrême qui caractérisent ses ouvrages : et l’on peut dire qu’il a réussi complètement quant à la perfection de la manœuvre ; car depuis trois siècles qu’il existe, ce tableau, exécuté sur une simple toile ouvrée, n’est altéré dans aucune de ses parties, et se trouve absolument dans le même état où il était sorti de ses mains 38.
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
8
fig. 4 - Jean-Auguste-Dominique Ingres, Romulus, vainqueur d’acron, porte les dépouilles opimes au Tempe de Jupiter, 1812, Détrempe sur toile, H. 276 ; l. 530 cm, Paris, musée du Louvre.
fig. 5 - Détail de la fig. 1.
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
9
D’autres tableaux de Mantegna étaient entre-temps arrivés au Louvre comme les deux toiles provenant du Studiolo d’Isabelle d’Este représentant Minerve chassant les Vices du jardin des Vertus et le Parnasse. Elles avaient été remarquées et sélectionnées par Léon Dufourny et Ennio Quirino Visconti au château de Richelieu (Indre-et-Loire) en 1800 :
Dans le Cabinet du Roi nous eûmes la satisfaction de trouver encastrés dans la boiserie deux très beaux tableaux de Mantegna bien conservés ; ces deux tableaux, peints sur toile, ont cinq pieds un pouce de haut sur cinq pieds sept pouces de large. L’un représente le Parnasse et Apollon qui fait danser les muses au son de sa lyre ; l’autre Minerve chassant les vices, deux compositions exquises 39.
Pour compenser cette saisie, deux panneaux de la prédelle de San Zeno de Mantegna - christ dans le Jardin des oliviers et la Résurrection - furent envoyés en 1806 par le Louvre au musée de Tours 40. Si avec la Restauration, les trois panneaux principaux du retable de San Zeno furent rendus à leur lieu d’origine, la prédelle avec la crucifixion, christ dans le Jardin des oliviers et la Résurrection la Vierge de la Victoire restèrent en France. Grâce aux campagnes d’Italie et aux saisies révolutionnaires, le Musée napoléon pouvait ainsi présenter un très bel ensemble du peintre de Padoue.
Ingres et Mantegna
Après son enfance à Montauban et son premier apprentissage à Toulouse, Ingres arrive Paris en août 1797 avec l’ambition d’y parfaire sa technique de la peinture à l’huile et d’y commencer sa carrière d’artiste. Il entre dans l’atelier le plus influent de la capitale, celui de Jacques-Louis David, et le 14 octobre 1797, il est admis à l’École des beaux-arts. L’atelier de David étant situé au palais du Louvre, les copies dessinées ou peintes d’après les maîtres se retrouvaient au cœur de la pratique des jeunes élèves 41. La masse de tableaux conservée au Louvre s’offrait ainsi aux yeux du jeune montalbanais qui n’échappa pas à l’étude des maîtres anciens. Vers 1800, il copia en pierre noire La Belle Ferronnière de Léonard de Vinci et l’offrit à son maître comme l’indique l’inscription « Dessiné par Ingres élève de / son cher maître David »42.
En 1801, avec Les ambassadeurs d’agamemnon (Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, inv. PRP 40), Ingres obtient enfin le grand prix de Rome de peinture d’histoire 43. Toutefois, les mauvaises finances de l’État, le déménagement de l’Académie de France à Rome, du Palais Mancini à la Villa Médicis, ainsi que l’achèvement de commandes publiques obligèrent le peintre à reporter son départ pour la ville éternelle.
Ingres mit donc à profit ce séjour « forcé » à Paris pour se faire connaître au Salon mais aussi pour parfaire ses connaissances de l’art de l’Antiquité, du Moyen Age et de la Renaissance. Il se lia, entre autres, aux peintres Fleury-Richard, Révoil, Granet et Forbin, le groupe dit des « aristocrates », profondément inspirés par l’histoire du Moyen Age et la littérature chevaleresque 44.
Obligé par l’administration, Ingres se met en route pour Rome vers la mi-septembre 1806. Après avoir traversé les Alpes, Turin, Milan, Lodi, Plaisance, Parme, Reggio, Modène, Bologne, il arrive le 15 septembre à Florence « la Belle, à bien juste titre, où tout rappelle les Médicis et la belle Renaissance des arts en Italie » 45. Dans la cité toscane, il tombe en admiration devant les fresques de Masaccio de la chapelle Brancacci, à l’église
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
10
fig. 6 - Jean-Auguste Dominique Ingres, Second Modello pour l’age d’or, 1843, mine de plomb,plume et rehauts de gouache blanche sur calque, H. 51 : l. 65 cm, Lyon, Musée des beaux-Arts.
fig. 7 - Andrea Mantegna, Le Parnasse, 1496-1497, toile, H. 159 ; l. 192(anciennement dans le Studiolo d’Isabelle d’Este à Mantoue), Paris, musée du Louvre.
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
11
des Carmes. À Rome, tout naturellement, les vestiges antiques et son maître vénéré, Raphaël, se présentèrent enfin à ses yeux, ainsi que les autres maîtres de la Renaissance.
Le 17 septembre 1811, il reçoit la commande de deux œuvres destinées à la décoration du palais du Quirinal devenu résidence impériale : le Romulus, vainqueur d’acron, porte les dépouilles opimes au Temple de Jupiter pour le second salon de l’Impératrice (Paris, musée du Louvre, inv. D. L. 1969-2, fig. 4) et Le songe d’ossian pour la chambre de l’Empereur (Montauban, musée Ingres, inv. MI 867.70) 46. Achevé en 1812, le Romulus vainqueur d’acron se présente comme une grande frise à l’antique qui raconte l’épisode du fondateur mythique de Rome qui s’empare des armes et des cuirasses de l’ennemi pour les apporter au temple de Jupiter. Riche de citations d’après l’antique et la statuaire classique et contemporaine, le cortège de gauche avec trompettistes et porteurs de corselets et de boucliers trouve sa source d’inspiration dans les célèbres Triomphes de Mantegna, connus depuis leur création grâce à la circulation de leurs gravures 47.
L’inventaire des biens de Ludovico Mantegna, fils d’Andrea, établi en 1510, mentionne sept plaques gravées avec des compositions de son père parmi lesquelles trois représentent des Triomphes 48. Comme nous le savons déjà, ces plaques, qui furent emportées en France, servirent à la production d’une grande quantité d’estampes et « la quantité des feuilles imprimées en France [dépassait] largement celle des feuilles imprimées en Italie »49. Pour représenter Romulus portant un corselet, Ingres s’est directement inspiré des gravures d’après les Triomphes représentant Les porteurs de corselets (fig. 5) 50. De même, l’utilisation de la détrempe qui donne un effet mat à la composition, proche des grandes fresques antiques, rappelle l’art de Mantegna, promoteur de cette technique à l’époque où l’utilisation de l’huile pour lier les pigments trouvait nombre d’adeptes parmi ses contemporains.
Le souvenir des Triomphes de Mantegna se retrouve également dans Le martyre de saint symphorien commandé en 1824 par Monseigneur de Vichy pour la cathédrale d’Autun et achevé en 1834 51. Non seulement la foule de personnages et de soldats assemblée derrière le martyr rappelle les Triomphes mais la pancarte qui se détache devant la porte Saint-André reprend également la même forme de celui de la toile 2 (statues capturées et matériel de siège) et de la toile 7 (Prisonniers, bouffons et soldats) des célèbres compositions du maître de Padoue.
Quelques années plus tard, Ingres est occupé par l’ambitieuse commande du duc Albert de Luynes pour le château de Dampierre (fig. 6). La grande peinture murale de la galerie du château représentant l’Âge d’or, peinte entre 1842 et 1847, et en particulier la scène centrale avec la danse rend encore une fois hommage à l’art de Mantegna, notamment le Parnasse (fig. 7) admiré par Ingres lors de ses visites au Louvre 52.
Si les primitifs italiens - Giotto en particulier 53 - et les peintres de la Renaissance - Raphaël notamment54 - sont présents tout au long de la carrière de l’artiste, son intérêt pour les peintres du Quattrocento n’est pas moindre. Dans sa riche documentation, conservée au musée Ingres à Montauban, figurent en effet des dizaines de relevés d’après des œuvres de Fra Angelico, de Piero della Francesca et comme nous le verrons de Mantegna.
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
12
fig. 8 - Calque d’après la partie inférieure de la Vierge de la Victoire d’Andrea Mantegna,graphite sur calque, H. 15,6 ; l. 10, 1 cm, Montauban Musée Ingres, MIC 6.2.
fig. 9 - Détail de la fig. 3.
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
13
Par son testament du 26 août 1866, Ingres lègue à sa ville natale un très riche fond réunissant à la fois ses compositions, ses dessins, ses collections mais aussi un vaste corpus iconographique de gravures et de dessins et calques d’après des œuvres de l’Antiquité, du Moyen Age et de la Renaissance :
Je lègue à la ville de Montauban ma collection de vases grecs, coupes, figurines, terres cuites, fragments antiques de marbre et de bronze […] , ma collection de livres d’art illustrés et gravés comme pensées ( ?), œuvres de grands maîtres, ma collection de choix d’estampes sur l’architecture, la peinture et la sculpture d’après l’antique, le moyen âge, la renaissance, l’art moderne, les œuvres en estampes de Raphaël et celles des écoles d’Italie, d’Allemagne, de Flandres, de France, et sont en portefeuilles classés […] ; aquarelles, gravures, dagueréotypes (sic), photographies, études peintes et dessinées de moi et d’autres 55.
Si les dessins du maître ont fait l’objet d’une étude systématique par Georges Vigne en 1995 56 et l’extraordinaire fonds de relevés graphiques d’après la céramique grecque a été magistralement étudié par Pascale Picard et montré au public pour la première fois en 2006-2007 à Montauban et à Arles, à l’occasion de l’exposition mémorable Ingres & l’antique 57, les centaines de relevés d’après les sculptures et les peintures du Moyen Age et de la Renaissance demeurent encore peu exploités. L’étude de ces derniers permettra non seulement de restituer le musée imaginaire de l’artiste mais aussi une meilleure compréhension de l’ensemble de sa production 58.
Parmi ces relevés d’après les maîtres italiens du Quattrocento, nous nous arrêterons sur deux d’entre eux. Le premier (fig. 8) reproduit la partie inférieure gauche de la célèbre pala de Mantegna représentant La Vierge et l’Enfant avec François Gonzague, et les saints Michel archange, andré, Longin, Georges, Jean Baptiste enfant et sainte Elisabeth, dite la Vierge de la Victoire (fig. 9). Peinte à la commande de Francesco Gonzague, marquis de Mantoue, pour commémorer la victoire de la ligue italienne sur l’armée française de Charles VIII le 6 juillet 1495 et destinée à l’église de Santa Maria della Vittoria à Mantoue, la pala fut transférée à Paris en 1797 et exposée au Muséum central des Arts en juillet 1798, puis à l’époque des restitutions dans les appartements de Louis XVIII aux Tuileries 59. Le relevé du musée de Montauban représente Francesco Gonzague agenouillé devant la Vierge dont on aperçoit la partie inférieure droite ainsi que la main ; on distingue également la figure d’Adam peinte en grisaille sur la base du trône et quelques traits de la robe du saint Michel situé derrière le marquis, ainsi que l’épée du saint reproduite de façon très sommaire.
Le second relevé (fig. 10) reproduit l’une des fresques les plus célèbres du maître de la Renaissance : Le transport du corps de saint christophe de la chapelle Ovetari de l’église des Eremitani de Padoue. Comme nous l’avons vu plus haut, le cycle Ovetari avait été particulièrement apprécié par les érudits, les voyageurs et les peintres à partir du XVIIIe siècle 60. Citons Sir Joshua Reynolds (1723-1792) qui, lors de son voyage en Italie, visita la chapelle Ovetari en 1752 et fut l’un des premiers à copier des détails du cycle dans un carnet aujourd’hui conservé au British Museum 61, ou le plus modeste peintre ligure Giovanni David (1749-1790) qui réalisa à la commande du conte Giacomo Durazzo (1717-1794), ambassadeur impérial à Venise, des copies 62 pour les traduire en gravure 63 d’après ces fresques. À partir de la fin du siècle, les érudits locaux, conscients des dégradations de l’ensemble du cycle, entreprennent une vaste campagne de copies traduites en gravures des scènes les plus célèbres.
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
14
fig. 11 - Gravure d’après la fresque de Mantegna représentant Le Transport du corps de saint christophe à la chapelle ovetari a Padoue, H. 40,3 ; l. 41,8 cm, Venise, musée Correr, codice C 2
fig. 10 - Calque d’après le Transport du corps de saint christophe d’Andrea Mantegnaà la chapelle Ovetari à Padoue, graphite sur calque, H. 42 ; l. 39 cm,
Montauban, Musée Ingres, MIC 1.73.
Étude d’ailes (867.76)
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
15
Quatre gravures tirées des scènes de ce cycle (fig. 11) furent commandées par l’antiquaire et expert de peinture Giovanni Maria Sasso (1742-1803) pour illustrer son ouvrage Venezia pittrice 64. Et c’est d’après l’une de ces quatre gravures, celle représentant le Transport du corps de saint christophe que fut réalisé le calque conservé au musée de Montauban.
Les fresques Ovetari continuèrent à attirer l’attention des Français tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle : citons pour conclure l’expérience de Jules-Elie Delaunay en 1858 et les achats de Nelie Jacquemart-André à la fin du siècle.
Dans une lettre envoyée de Sabbioneta en novembre 1858, Delaunay conseillait à son ami Gustave Moreau d’aller voir les fresques des Eremitani à Padoue :
N’auriez-vous que quelques heures, ne manquez pas d’aller aux Eremitani voir les Mantegna. Je crois bien que ce sont peut-être les seules grandes peintures murales qui restent de ce maître et grand maître ; vous verrez et vous jugerez. Il y a aussi quelques peintures de ses élèves et, au-dessus de son saint christophe, est un autre portant l’enfant Jésus qui, quoique lourd de forme est d’une grande originalité 65.
Admiré et copié par Ernest Hébert, Gustave Moreau, Delaunay et Degas 66, Mantegna trouva sa consécration dans le temple par excellence de la peinture italienne à la fin du siècle : l’hôtel particulier des époux Edouard André et Nélie Jacquemart, boulevard Haussmann. Outre des madones et l’Ecce Homo, ils firent l’acquisition à Venise, avant 1886, de copies anciennes des fresques Ovetari 67.
Ces mêmes fresques furent évoquées et vouées à l’immortalité par Marcel Proust. Dans Du côté de chez swann, le protagoniste rend visite à la marquise de Saint-Euverte et, parmi les valets, il en remarque un « d’aspect particulièrement féroce et assez semblable à l’exécuteur dans certains tableaux de la Renaissance qui figurent des supplices », puis « à quelques pas, un grand gaillard, immobile, sculptural, inutile, comme ce guerrier purement décoratif qu’on voit dans les tableaux les plus tumultueux de Mantegna, songeur, appuyé sur son bouclier, tandis qu’on se précipite et qu’on s’égorge à côté de lui [...], il semblait aussi résolu à se désintéresser de cette scène, qu’il suivait vaguement de ses yeux glauques et cruels, que si c’eût été le massacre des Innocents ou le martyre de saint Jacques. Il semblait précisément appartenir à cette race disparue – ou qui peut-être n’exista jamais que dans le retable de San Zeno et les fresques des Eremitani ».
Proust avait visité la chapelle Ovetari en 1900.
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
16
Notes
(1) Parmi la vaste bibliographie sur le sujet, nous renvoyons aux synthèses de V. Curzi, « Mantegna ritrovato : fortuna storica e critica nel Settecento e nell’Ottocento », dans U. Baldini, V. Curzi, C. Prete, andrea Mantegna, Florence, 1997, p. 91-140 ; G. Toscano, « Per la fortuna di Mantegna in Francia », dans Mantegna e le arti a Verona 1450-1500, catalogue de l’exposition sous la direction de S. Marinelli et P. Marini, Vérone, Gran Guardia, 16 septembre 2006-14 janvier 2007, Venise 2006, p. 94-103 ; M. Gianneselli, « La postérité de Mantegna en France au XVIe et au XVIIe siècle », dans Mantegna 1431-1506, catalogue de l’exposition sous la direction de G. Agosti et D. Thiébaut, Paris, musée du Louvre, 26 septembre 2008-5 janvier 2009, Paris, 2008, p. 448-453 ; A. Del Puppo, « Itinéraires de la fortune moderne de Mantegna en France », dans Mantegna. La prédelle de san Zeno de Vérone, 1457-1459, catalogue de l’exposition, Tours, musée des Beaux-Arts, 4 avril-22 juin 2009, Cinisello Balsamo, 2009, p. 41-49.
(2) Nous renvoyons aux derniers travaux de L. Vissière et J. Noblet, « Autour du Saint Sébastien d’Aigueperse », Revue des musées de France, 2008, 1, p. 34-46; D. Thiébaut, « Autour du Saint Sébastien d’Aigueperse », dans Mantegna 1431-1506, cit., p. 209-217 ; N. Pierrart, À la charnière de deux mondes. claire de Gonzague, comtesse de Bourbon-Montpensier (1464-1503). Rôle diplomatique et culturel d’une princesse italienne à la cour de France, thèse de doctorat inédite sous la direction de B. Schnerb et G. Toscano, Université de Lille 3, 2013, p. 168-172.
(3) G. Agosti, su Mantegna, I. La storia dell’arte libera la testa, Milan, 2005, p. 108-109.
(4) Ibid., p. 109-110
(5) G. Toscano, « Le cardinal Georges d’Amboise (1460-1510), collectionneur et bibliophile », dans Les cardinaux de la Renaissance et la modernité artistique, actes du colloque international sous la direction de F. Lemerle, Y. Pauwels et G. Toscano, Tours, CESR, 2-4 juin 2005, Villeneuve d’Ascq, 2009, p. 51-88, avec bibliographie précédente.
(6) Agosti, su Mantegna, cit., p. 111, 136 , n. 35.
(7) Louis II de La Trémoïlle avait épousé Gabrielle de Bourbon, sœur de Gilbert de Montpensier, et à ce titre belle-sœur de Chiara Gonzague : L. Vissière Louis II de La Trémoïlle 1460–1525, Paris, 2008 ; Gianneselli, op. cit., p. 448.
(8) M. H. Smith, « François Ier, l’Italie et le château de Blois. Nouveaux documents, nouvelles dates », Bulletin monumental, 147, 1989, p. 308.
(9) Le marquis lui proposa une sainte Véronique peinte par Lorenzo Costa (Agosti, su Mantegna, cit., p. 112).
(10) R. Weiss, « The Castle of Gaillon in 1500-1510 », Journal of the Warburg and cortauld Institutes, 1953, p. 7 ; G. Toscano, « Le cardinal Georges d’Amboise », cit., p. 57.
(11) R. Signorini, « New Findings about Andrea Mantegna : his son Ludovico’s post mortem inventory (1510) », Journal of the Warburg and courtauld Institutes, XLIX, 1996, p. 103-118.
(12) D. Landau, «Mantegna graveur» et S. Boorsch, « Mantegna et ses graveurs », dans andrea Mantegna, catalogue d’exposition, Londres-New York 1992, Milan-Londres-Paris 1992, p. 55-77, 480-495 ; S. Boorsch dans Mantegna 1431-1506, cit., p. 107-108.
(13) Gianneselli, op. cit., p. 449.
(14) Ibid., p. 449-450.
(15) A. Schnapper, curieux du grand siècle: collections et collectionneurs dans la France du XVIIe siècle, Paris, 1994, p. 130 sv. ; S. Loire, « La dispersione delle collezioni Gonzaga in Francia », dans Gonzaga. La celeste galeria. L’esercizio del collezionismo, dir. R. Morselli, Genève-Milan, 2002,, p. 262 sv. Pour compléter le décor de son nouveau château, le cardinal commanda à Poussin vers 1635-1636 des œuvres à sujet mythologique, œuvres pour lesquelles l’artiste français résidant à Rome dut se servir de gravures ou de dessins mantegnesques afin de peindre des compositions plus proches d’un esprit Renaissance : Gianneselli, op. cit., p. 450.
(16) Ibid., p. 265-266.
(17) P. Michel, Mazarin, prince des collectionneurs, Paris, 1999, p. 582-583.
(18) A. Félibien, Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes, Paris, 1666, éd. cons. Paris, 1987, p. 239-240.
(19) Paul Fréart de Chantelou raconte que le Bernin avait « vu un Christ mort en raccourci, d’Andrea Mantegna, avec quelques autres figures. Il n’en a rien dit » : Chantelou, Journal de voyage du cavalier Bernin en France, éd. par M. Stanic, Paris, 2001, p. 222, p. 334, n. 2. Une partie de la critique avait identifié « Nostre Seigneur mort à la reverse en racourcy » avec le célèbre Christ mort aujourd’hui à la pinacothèque de Brera de Milan, et « Nostre Seigneur qui porte sa croix au Calvaire » avec la toile du même sujet conservée à la Christ Church d’Oxford. Sur le sujet, voir les notices de Lapenta dans Gonzaga. La celeste Galeria, cit., p. 177-178, n. 12, 195-196, n. 37, avec bibliographie.
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
17
(20) Le dessin est aujourd’hui conservé à la Staatliche Graphische Sammlung de Munich, inv. 3065 : B. Py, Everhard Jabach collectionneur (1618-1695). Les dessins de l’inventaire de 1695, Paris, 2001, p. 62-63, n. 132.
(21) Les deux dessins n’ont pas été retrouvés : Ibid., p. 177, n. 733-734.
(22) Attribué à Mantegna dans l’inventaire de la collection royale rédigée par Le Brun en 1683, le tableau fut envoyé en 1803 à Mayence (Mittelrheinisches Landesmusum, Inv. 220) où il est attribué à Piero di Cosimo : A. Brejon de Lavergnée, L’inventaire Le Brun de 1683. La collection des tableaux de Louis XIV, Paris, 1987, n. 35, p. 116 ; J. Thuillier, andré Félibien et les « anciens peintres », in Hommage à Michel Laclotte. Études sur la peinture du Moyen age et de la Renaissance, Paris-Milan, 1994, p. 498-500, fig. 574.
(23) Félibien, Entretiens, cit., p. 239-240 ; Id., noms des peintres les plus célèbres et les plus connus anciens et modernes, Paris, 1679, p. 11-11.
(24) R. de Piles, abregé de la vie des peintres avec des reflexions sur leurs ouvrages et un Traité du Peintre parfait, de la connoissance des Desseins, et de l’utilité des Estampes, Paris, 1699, p. 156-158.
(25) Quatre œuvres attribuées à Mantegna figuraient entres autres dans la collection d’Amédée de Savoie, prince de Carignan, collection vendue à Paris en 1742 : D. Wildenstein, « Les tableaux italiens dans les catalogues de ventes parisiennes du XVIIIe siècle », Gazette des Beaux-arts, 124, 1982, p. 33.
(26) J.-P. Samoyault, andré-charles Boulle et sa famille. nouvelles recherches, nouveaux documents, Genève, 1979.
(27) P.-J. Mariette, catalogue des Tableaux et sculptures, tant en bronze qu’en marbre, du cabinet de feu M. le Président de Tugny et de celui de M. crozat, Paris, 1751, p. 68, n. 645-646.
(28) Le cabinet d’un Grand amateur P.-J. Mariette 1694-1774. Dessins du XVe au XVIIIe siècle, catalogue de l’exposition sous la direction de R. Bacou, Paris, 1967, p. 17 sv.
(29) Ph. De Chennevières, A. de Montaiglon, « Abecedario de P.-J. Mariette et autres notes inédites de cet amateur sur les arts et les artistes », archives de l’art français, VI, 3, Paris, 1856, p. 248-251.
(30) P.-J. Mariette, Les grands peintres, I, Écoles d’Italie, Paris, 1969, p. 5-8.
(31) Ch.-L. de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu, Voyages, éd. cons. Paris, 2003, p. 75-76.
(32) Ch. de Brosses, Lettres d’Italie, éd. par d’Agay, Paris, 1986, I, p. 200.
(33) Ibid., I, p. 383 ; II, p. 473.
(34) C. Michel, Le voyage d’Italie de charles-nicolas cochin (1758), Rome, 1991, p. 348, 404. Cette sainte conversation a été identifiée avec celle entrée dans les collections du musée de Castelvecchio de Vérone depuis 1871 (S. Marinelli dans Mantegna e le arti a Verona, cit., p. 215-217, cat. 14).
(35) É. Vigée-Lebrun, souvenirs, une édition féministe de claudine Herrmann, tome I, Paris, 1984, p. 252.
(36) notice des principaux tableaux recueillis en Italie, par les commissaires du Gouvernement français. seconde partie, comprenant ceux de l’Etat de Venise et de Rome, dont l’Exposition provisoire aura lieu dans le Grand salon du Muséum…, Paris, 1798, p. 36-41.
(37) R. Signorini, « La Vittoria in Francia. Documenti sulla requisizione della pala del Mantegna e su altre confische d’arte napoleoniche perpetrate in Mantova », dans La battaglia di castiglione del 5 agosto 1796. L’amministrazione napoleonica dell’alto mantovano (1796-1799), atti del convegno a cura di M. Paganella, Solferino, 1997, p. 287-336.
(38) notice, cit., 1798, n. 24, p. 36-38.
(39) M. Tourneux, « Mission de Dufourny et de Visconti au château de Richelieu en 1800 », archives de l’art français, n. s. t. IV, 1910, p. 351-413, p. 384 pour la citation.
(40) Vivant Denon, correspondance (1802-1815), éd. établie par M.-A. Dupuy, I. Le Masne de Chermont, E. Williamson, Paris, 1999, vol. I, n. 805, p. 314 : lettre du 18 février 1806 ; M. Hoog, « Note sur la politique du Premier Consul à l’égard des musées de province ou l’histoire d’un Mantegna », archives de l’art Français, 24, 1969, pp. 353-363.
(41) Sur le sujet, voir l’article de V. Pomarède, « 1780-1806 », dans Ingres 1780-1867, catalogue de l’exposition sous la direction de V. Pomarède, S. Guégan, L.-A. Prat et E. Bertin, Paris, musée du Louvre, 24 février-15 mai 2006, Paris, 2006, p. 91-109, avec bibliographie.
(42) Birmingham, The barber Institute of Fine Arts, inv. 37.3 : Ibid., cat. 14, avec bibliographie.
(43) Ibid., p. 113-114, cat. 3.
(44) Ibid., p. 106-107.
(45) Lettre envoyée de Florence, le 5 octobre 1806, à M. Forestier père et à sa famille (Paris, Fondation Custodia, coll. Frigt Lugt, inv. 8690) : Ibid., p. 148 et 161, n. 7
(46) Ibid., p. 166-167, cat. 36 et p. 170-173, cat. 38.
(47) Tout l’œuvre peint d’Ingres, introduction par D. Ternois, documentation par E. Camesasca, Paris, 1971, n. 68, p. 93.
(48) Voir note 11 de cet article.
BULLETIN DU MUSÉE INGRES - AVRIL 2014
18
(49) Voir note 12 de cet article.
(50) Pour les gravures, voir les notices de C. Elam dans Mantegna 1431 – 1506, cit, cat. 162-164, p. 388-389.
(51) Pour cette composition, voir G. Vigne, Ingres, Paris 1995, p. 189-199 et Ingres 1789-1867, cit., p. 254-259.
(52) Tout l’œuvre peint, cit., p. 145, cat. 144 ; Vigne, Ingres, cit. p. 254-271.
(53) Lors de son séjour à Naples à la cour de Caroline Murat au printemps 1814, Ingres réalisa des croquis extrêmement précis d’après les fresques de l’églises de l’Incoronata attribuées à l’époque à Giotto : G. Toscano, « Le Moyen Age retrouvé. Millin et Ingres à la découverte de Naples angevine », dans Ingres, un homme à part ? Entre carrière et mythe, la fabrique du personnage, colloque international sous la dir. de C. Barbillon, P. Durey et U. Fleckner, Paris, École du Louvre, Académie de France à Rome, 25-28 avril, 2006, Paris, 2009, p. 295-300. Plus tard, en 1820-1824, puis en 1835-1841, à Assise et à Florence, il copia plusieurs compositions de Giotto ou à lui attribuées. Quelques jours avant sa mort, il se rendit à la Bibliothèque nationale pour calquer d’après une estampe la Déploration sur le christ mort de Giotto de la chapelle des Scrovegni : G. Vigne, Dessins d’Ingres. catalogue raisonné des dessins du musée de Montauban, Paris, 1995, p. 516 sv, p. 784, n. 4368.
(54) Voir le dossier qui accompagnait l’exposition Ingres invite Raphaël, commissaire, F. Viguier-Dutheil, Montauban, musée Ingres, 10 février-30 avril 2006.
(55) Paris, Archives nationales, cote XCVII, 1012-1015, copie du testament olographe en date du 28 août 1870, publié par P. Picard-Cajan, « Fragments d’antiques : le fonds archéologique de l’atelier d’Ingres », dans L’illusion grecque. Ingres & l’antique, catalogue de l’exposition sous la dir. de P. Picard-Cajan, Montauban 15 juin-15 septembre 2006, Arles, 2 octobre 2006-2 janvier 2007, Arles 2006, p. 24-25, p. 33, n. 1.
(56) G. Vigne, Dessins d’Ingres, cit.
(57) Voir P. Picard-Cajan dans L’illusion grecque. Ingres & l’antique, cit. p. 24 sv. et F. Viguier-Dutheil, ibid., p. 18-20.
(58) Adrien Goetz, maître de conférences à l’université de Paris-Sorbonne, a lancé un vaste chantier sur le sujet et nous attendons avec impatience les résultats de ses recherches.
(59) Voir notes 37 et 38 de cet article. Sur la fortune de l’œuvre, voir la notice de G. Agosti dans Mantegna 1431-1506, cit., cat. 125, p. 304-306 avec bibliographie.
(60) Voir notes 31-35 de cet article. Pour la fortune du cycle, voir F. Magani, « A colloquio con Mantegna. Immagine e fama degli affreschi Ovetari tra Settecento e ottocento », dans andrea Mantegna e i Maestri della cappella ovetari. La ricomposizione virtuale e il restauro, sous la dir. de A. de Nicolò Salmazo, A. M. Spiazzi et D. Toniolo, Milan, 2006, p. 65-72, et la notice très détaillée de G. Pavanello dans Le carte riscoperte. I disegni delle collezioni Donghi, Fissore, Pozzi alla Fondazione Giorgio cini, éd. Par G. Pavanello, Venise, 2008, p. 127-130.
(61) Londres, British Museum, 201 a 9, f. 8v, 10v, 11v, 12v : G. Previtali, La fortuna dei primitivi da Vasari ai neoclassici, nouvelle édition avec introduction d’E. Castelnuovo, Turin, 1989, p. 196-197 ; G. Pavanello dans Le carte riscoperte, cit., p. 128-129.
(62) Ces copies ont été découvertes et étudiées par Pavanello, ibid.
(63) E. Borea, « Per la fortuna dei primitivi : la Historia pratica di Stefano Mulinari e la Venezia pittrice di Gian Maria Sasso », dans Hommage à Michel Laclotte, cit., p. 506-507, fig. 581.
(64) Ibid., p. 509-521, en particulier la n. 52 à p. 521 ; Magani, op. cit., p. 67-68, fig. 5-8. Pour Giovanni Sasso, voir également R. Callegari, scritti sull’arte padovana del Rinascimento, Udine 1998, p. 287-324.
(65) L. Capodieci, Gustave Moreau. correspondance d’Italie, Paris, 2002, p. 461-462, lettre n. 200. Delaunay réalisa des croquis d’après les fresques de la chapelle Ovetari : un détail d’après le Martyre de saint christophe de Mantegna et le saint christophe d’après la fresque de Bono da Ferrara (Nantes, musée des Beaux-Arts, mine de plomb sur papier blanc, Inv. 4234 et 4236) : G. Toscano, « Per la fortuna di Mantegna in Francia », cit. p. 100-103, fig. 3 et 4.
(66) Sur le sujet, voir G. Toscano, « Paris-Venise 1857-1860 : Delaunay, Henner, Moreau et les primitifs vénitiens », dans Venise en France du romantisme au symbolisme, actes des journées d’études « Paris-Venise », École du Louvre et Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti publiées sous la direction de C. Barbillon et G. Toscano, Paris, École du Louvre, 2006, p. 183-211 ; Id., « Per la fortuna di Mantegna in Francia », cit., p. 100-103.
(67) N. Sainte Fare Garnot, « I Mantegna della collezione Jacquemart-André », dans andrea Mantegna. Impronta del genio, actes du colloque international, Padoue, Mantoue, Vérone, 8-10 novembre 2006, Florence 2010, p. 149-162.