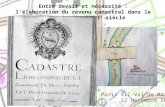"Compoix et aménagement du territoire en Languedoc (XVIe-XVIIIe siècles)"
-
Upload
univ-montpellier -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of "Compoix et aménagement du territoire en Languedoc (XVIe-XVIIIe siècles)"
Compoix et aménagement du territoire en Languedoc
(XVIe-XVIII
e siècles)
Bruno Jaudon – Sylvain Olivier
Depuis le premier quart du XIVe siècle au moins, les compoix sont les documents qui
peuvent donner la description la plus complète et précise de l'organisation spatiale du Languedoc jusqu’à la Révolution. En effet, la plupart des communautés ont conservé un de ces registres au moins. Les compoix sont des matrices fiscales d'Ancien Régime qui recensent une à une les terres des particuliers en vue de l'assiette du principal impôt direct, la taille, ainsi que des frais de fonctionnement ordinaires des communautés d'habitants, rurales comme urbaines. L'espace de chaque communauté était nommé le « terroir et taillable » ; il correspondait à l'ensemble des terres d'un village soumises à la taille, et équivaut au finage des géographes actuels.
Les recherches les plus récentes soulignent tout l’intérêt de questionner à nouveau et différemment les cadastres du Languedoc et de la Provence, à des fins d’histoire des rapports entre les sociétés anciennes et le paysage. Les phases de conquêtes temporaires du saltus et de la silva, celles de contraction de l’ager, les stratégies agricoles mises en œuvre aux marges des finages selon les données démographiques et pédologiques, la représentation que l’on se faisait de l’espace plus ou moins proche, celle de la productivité présumée du sol en fonction des terroirs, de tout ceci les cadastres témoignent. Confrontés à des documents anciens venus d’autres horizons, ils permettent de remettre à jour, au moyen de l’assistance informatique notamment, notre compréhension des connaissances environnementales et agronomiques des ruraux à l’époque moderne, connaissances bien souvent présentées comme archaïsantes et routinières.
Mais les compoix ont-ils gardé la trace des grands travaux d'aménagement du territoire par le passé ? Certainement. Si on applique ce concept quelque peu anachronique à l'époque moderne, quelques grands chantiers mis en œuvre par les pouvoirs publics, en particulier les États de Languedoc, entrent sans doute dans le champ du sujet. C'est le cas des nouveaux canaux, de quelques terroirs ruraux asséchés et surtout des grandes routes royales du XVIII
e siècle. Le
résultat de ces grands aménagements se lit dans les compoix des localités concernées, en particulier dans les confronts des parcelles encadastrées, puisqu'en l'absence de plan les individus chargés de la confection des compoix localisaient les biens fiscalisés par rapport à leur voisinage immédiat. Mais pour faire l'histoire de ces aménagements, point n'est besoin de recourir aux compoix, car les autorités compétentes ont laissé des archives abondantes, avec de surcroît des plans des travaux à entreprendre.
Avec les compoix, c'est une autre histoire qui peut-être menée, laquelle concerne, outre les grands aménagements, la quasi-totalité de l'espace rural, celui aménagé au jour le jour par les simples usagers de cet espace. Les compoix renseignent sur la perception qu'avaient les paysans de leur environnement immédiat. En prenant des exemples dans les diocèses civils du Bas-Languedoc à l'époque moderne, il est possible d’utiliser les compoix afin de mettre en évidence l'appréhension de l'espace communautaire ou « terroir », d'abord du point de vue de l'historien, puis en fonction du point de vue des individus qui composaient les consulats et communautés d'habitants.
Le compoix, révélateur de territoires incessamment aménagés
En filigrane du compoix : la connaissance de l'organisation du territoire pour « l’historien en quête d’espaces »1
Les compoix ont d’abord été utilisés par les historiens afin de repérer des édifices
1 FRAY (J.-L.), PEROL (C.), dir., L’historien en quête d’espaces, actes du colloque de Clermont-Ferrand (2002),
Clermont-Ferrand, Presses de l’université Blaise Pascal, 2004, 470 p.
remarquables, recensés pour eux-mêmes ou subrepticement évoqués dans les confronts d’autres biens. C’est ce que faisait par exemple Gaston Combarnous lorsqu’il retrouvait, dans le compoix de la communauté de Celles, le pont franchissant le Salagou sur la grande route entre Clermont-l’Hérault et Lodève
2. Découvrir une ancienne église, un mégalithe ou le tracé d’une
fortification est chose possible avec les compoix, et de telles perspectives intéressent forcément les historiens de l’Ancien Régime comme ceux des périodes antérieures.
À partir de la thèse d’Emmanuel Le Roy Ladurie, on a pris l’habitude de leur demander davantage. Ce n’était plus l’édifice remarquable qui intéressait l’historien mais la répartition sociale des fortunes foncières et les dominantes culturales de l’espace agraire. Beaucoup plus que le saltus, non ou mal appréhendé par les compoix, c’est l’ager dont la connaissance a été améliorée grâce à la systématisation de l’histoire sérielle et quantitative
3. Mais la dimension
spatiale a souffert de cette tendance historiographique, la connaissance de l’organisation précise des lieux passant au second plan, sinon de manière approximative, par ensemble de tènements ou sections composés chacun de plusieurs centaines d’hectares.
Aujourd’hui, grâce à ces acquis précieux et à une réflexion interdisciplinaire croisant l’histoire, la géographie et l’archéologie, on peut envisager une véritable histoire des paysages agraires. L’histoire de l’évolution des masses de cultures doit aller de pair avec celle de la structuration de l’espace. En effet, en cartographiant les paysages de l’époque moderne, on peut combiner l’étude de l’occupation agricole du sol avec celle des réseaux et des éléments paysagers remarquables, à défaut d’appréhender précisément les parcellaires à l’aide de compoix en général dénués de plans.
Une archéogéographie des paysages languedociens modernes est possible. Les concepts de cette discipline ont été développés surtout pour l’Antiquité et le Moyen Âge
4. Mais pour
l’époque moderne, les compoix constituent une documentation de premier choix afin de dresser les trames paysagères. Certes ils ne fournissent pas la localisation exacte des éléments du paysage, comme le ferait un plan de site archéologique. Mais ils fournissent des trames globales, des tendances. Comparés avec des traces de parcellaires exhumés par la fouille et rapidement classés comme « modernes » ou « post-médiévaux » dans les rapports de synthèse archéologiques, ils peuvent même rapidement donner du sens à des vestiges difficiles à interpréter. Dans la plupart des cas, à défaut de pouvoir être croisés avec des opérations de terrain, les résultats des dépouillements de compoix traduisent toutefois les grandes lignes des aménagements passés.
On y décèle, notamment dans les confronts, les éléments naturels marquant la topographie : les collines importantes, les espaces rocheux et de garrigues, les ruisseaux et fossés entre les parcelles. L’historien peut découvrir comment les sociétés anciennes s’y sont confrontées et adaptées en construisant des infrastructures, plus ou moins dépendantes de ces éléments naturels, afin de les contourner, les atteindre ou les franchir. Un compoix compile toute une série d’informations en terme d’infrastructures, même modestes. C’est en cela que le compoix intéresse la question de l’aménagement. On y découvre des chemins existants entre plusieurs localités, mais aussi des vieux chemins entre les mêmes villages, qui sous-entendent que l’homme a, à un moment donné, décidé d’aménager différemment son territoire. D’ailleurs peut-on toujours employer le terme d’aménagement, puisque celui-ci suppose en effet la mise en place concertée et administrée d’une nouvelle organisation spatiale ? Qu’en est-il de la plupart des chemins ruraux identifiables dans les compoix ? Ne relèvent-ils pas plutôt d’une auto-organisation des formes planimétriques, si l’on emploie les concepts de l’archéogéographie ? C’est-à-dire que, les grands bouleversements de l’histoire économique ou
2 COMBARNOUS (G.), « Un double itinéraire gallo-romain de Saint-Thibéry à Lodève par Pézenas et Clermont-
l’Hérault, d’après la table de Peutinger », Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon. XLIIIe
Congrès (Béziers, 30-31 mai 1970). Béziers et le Biterrois, Montpellier, 1971, p. 83.
3 LE ROY LADURIE (E.), Les Paysans de Languedoc, Paris-La Haye, SEVPEN, 1966, 2 vol., 1034 p. ; SOBOUL, (A.),
Les campagnes montpelliéraines à la fin de l’Ancien Régime. Propriété et cultures d’après les compoix, Paris, PUF,
« Commission de recherche et de publication des documents relatifs à la vie économique de la Révolution, Mémoires
et Documents, XII », 1958, 157 p.
4 CHOUQUER (G.), éd., Objets en crise, objets recomposés, Études Rurales, n° 167-168, juillet-décembre 2003,
EHESS, 2004, 375 p.
sociopolitique n’ayant pas suffi à réorganiser radicalement les trames parcellaires, celles-ci se sont constituées progressivement, sur le long terme
5. Les éléments du paysage que les compoix
désignent à l’époque moderne, et qui pourraient sembler être des aménagements de cette époque, se sont en réalité mis en place progressivement et il est impossible de les estampiller plus spécifiquement comme datant de l’époque moderne ou des périodes antérieures. Les chemins sont souvent des sentes constituées progressivement par les êtres humains et par le bétail à force de passer au même endroit. Mais les modifications de droit de passage ou les déplacements d’itinéraires à cause de l’érosion translatent sensiblement les itinéraires au cours du temps. C’est le résultat de cette réalité lentement construite qu’un compoix traduit en général, et non le résultat d’opérations d’aménagement planifiées. De même, les béals (biefs) d’irrigation et autres petits canaux sont-ils le résultat de véritables aménagements ou plutôt le fruit de « micro-aménagements » peu à peu généralisés dans le cadre de la petite hydraulique ? La même question se pose pour les terrasses de culture, qui sont parfois mentionnées dans les compoix des Cévennes.
Défauts et limites des compoix
L’organisation des espaces ruraux d’autrefois ne peut cependant être appréhendée que partiellement grâce aux compoix. En effet, ces documents n’ont pas été rédigés dans le but de permettre à l’historien des reconstitutions parcellaires. Seule une logique fiscale et non spatiale présidait à leur élaboration. Certes, l’emploi des confronts pour situer les parcelles s’est généralisé et précisé au cours de l’époque moderne. Ceci dit, le compoix reste un document totalement reconstruit en cabinet, parfois durant de longs mois, pour être présenté dans un ordre fiscal. Les rares brouillons conservés montrent pourtant un arpentage strictement topographique. Toute tentative de spatialisation des données induit donc une « déconstruction » préalable avant de basculer sous S.I.G. ou sous gestionnaire de bases de données.
De plus on ne connaît pas la forme exacte des parcelles, qui ne sont pas toujours des polygones simples, surtout dans les zones au relief accidenté. Pour les terrains les plus vastes, les agents cadastraux ont bien souvent eu tendance à négliger de signaler l’intégralité des leurs confrontants, surtout ceux dont le petit polygone jouxtait le grand. Quand on s’essaye à la cartographie dynamique, on bute sur des mutations foncières bien souvent mal tenues. La généalogie du parcellaire s’en trouve d’autant plus compliquée que les enregistrements des mutations dans la matrice peuvent attendre quelques années.
Enfin, il est désormais bien connu que les compoix ne recensent que les terres imposées. Ainsi, les biens nobles et d’Église, mais aussi les vastes garrigues communales n’ont pas souvent fait l’objet de recensement. Même, lors de la mise au compoix des terrains escarpés et de peu de valeur difficiles d’accès, les arpenteurs se sont fréquemment contentés d’une évaluation à vue d’œil sans prendre aucune mesure. Donc l’espace des compoix n’est pas enregistré partout avec la même précision, et certaines zones restent même complètement dans l’ombre lorsque l’historien cherche à réaliser une carte à partir d’un compoix
6.
Il ne faut pas non plus attendre des compoix qu’une fois mis en service, ils prennent régulièrement en compte les changements culturaux intervenus dans la mise en valeur des finages puisque ce n’était pas leur but. La finalité du document demeurait la péréquation et une fois celle-ci mise au point, on ne touchait plus en Languedoc aux revenus imposables villageois calculés grâce au compoix : l’équilibre ainsi trouvé n’autorisait pas les transferts de charges fiscales en temps réel, comme le rappelle Antoine Despeisses : « l’augmentation ou diminution de la valeur des biens roturiers survenuë apres le compoix fait, n’augmente ni ne diminuë pas
5 MARCHAND (C.), « Des centuriations plus belles que jamais ? Proposition d’un modèle dynamique d’organisation
des formes », in CHOUQUER (G.), éd., op. cit., p. 93-114.
6 Sur tout ceci, nous renvoyons à nos contributions dans PELAQUIER (É.), DUMOND (L.), et DURAND (S.) éd.,
Cadastres et paysages. Actes de la journée d’étude du 15 octobre 2005, Liame. Bulletin du Centre d’Histoire et
d’Histoire de l’Art moderne et contemporaine de l’Europe méditerranéenne et de ses périphéries , n° 14, juillet-
décembre 2004 (parution 2007) : JAUDON (B.), « Le compoix languedocien, photographie imparfaite du paysage
(XVIe-XIXe siècle) », p. 11-29 ; et OLIVIER (S.), « Compoix, terriers et cadastres. Des données quantitatives et
spatiales sur l’environnement rural languedocien (XVIIe-XIXe siècle) », p. 63-82.
l’alivrement desdits biens, jusques a une nouvelle recherche, ores que telles augmentations ou diminutions soient perpetuelles, ou pour le moins soient en estat d’estre longuement a tel point ». Seule la rédaction d’un nouveau cadastre entérinait les variations de la valeur imposable des parcelles qui portaient de nouvelles cultures, ce que le Traité des tailles dit plusieurs fois7.
Le compoix, révélateur des dynamiques des finages
Cela dit, en une province où les superficies agricoles fluctuaient sans cesse en fonction de la pression démographique, aux marges des finages notamment, il était nécessaire de prendre en compte les ouvertures inévitables de nouveaux terroirs à soumettre à la taille. Ainsi les compoix précisaient de temps à autres la nécessité juridique de se servir de la table d’allivrement du dernier cadastre réalisé pour arpenter, le cas échéant, de nouveaux terroirs aux limites de l’ager et du saltus. Cela est assez vrai dans les compoix du XVI
e siècle, comme à Agde en 1591, où les
évolutions des masses culturales et partant, des charges fiscales, sont anticipées avec beaucoup de précision : « sy a ladvenir aucunes pieces du segond ordre appelle moyen estoient complantees en vignes, cinq ans apres sera lad[ite] piece ou pieces alivrees a rai[s]on de trois souls pour chescune cesteree complantee et co[m]me les aultres vinhies. Et si elle est complantee en ollivette, dix ans apres estre complantee sera alivree a trois souls pour cesteree, ce a cause que lesd[ites] pieces ainsin complantees sont plus reveneues. Et ne pourront estre alivrees aud[it] pris de trois soulz pour cesteree plus tost q[ue] de cinq ans apres quand a la vigne & dix ans quand a lollivette apres estre complantee, daultant q[ue] lad[ite] vigne ne donne gueres de fruict q[ue] cinq ans apres quelle est plantee, & lollivette dix ans apres. Comme aussy sy aulcunes pieces q[ue] a present sont complantees en vigne ou ollivette sont cy apres lad[ite] recerche ou arpentement arrachees et reduittes en simple champ, elles seront le mesme an remises et alivrees co[m]me champ suivant le dixtraict [tarif] du terroir quelles se treuveront scituees »8.
Il existait donc ici une conscience explicite que les mutations culturales importaient finalement autant, du point de vue contribuable, que les mutations de propriétaires. Le plus souvent, toutefois et plus tard, on trouve des « additions » au compoix qui, prenant en compte les extensions cultivées des territoires, précisent avoir été réalisées selon la loi. C’est le cas, à Bessan où, sous la pression démographique croissante de la seconde moitié du XVIII
e siècle,
près de 500 hectares avaient été gagnés aux marges du finage. Afin de fiscaliser plus justement ces nouvelles terres cultivées, la communauté fit réaliser une addition au compoix, dit des « Mégeries Nouvelles », mis en service en 1787. Il se servait de la table d’allivrement du rôle foncier précédent, celui de 16999. Non loin de là et sensiblement à la même époque, on refit en 1761 le compoix de Castelnau-de-Guers. La procédure, suivant les indications de la Cour des Aides de Montpellier, fut double. On actualisa d’abord le compoix de 1680 sous la forme d’un réparat10
. On encadastra ensuite, pour les « y aditionner, les terres obmises du compoix ou
7 DESPEISSES (A.), Traicté des tailles et autres impositions. Où sont contenuës les decisions des matières des tailles,
aydes, equivalent, decimes ou dons gratuits, gabelles, guet & garde, imposition foraine, haut passage, rève,
fortifications & réparations, levées de chevaux & charriots, solde de cinquante mil hommes; estapes, munitions &
logemens des gens de guerre, impositions pour l'industrie, cabaux, meubles lucratifs, deniers à interest, à rente ou à
pension & bestail gros & menu & de la capitation. Le tout confirmé par loix ou par canon ou par les ordonnances de
nos roys ou par les advis des docteurs ou par des raisonnemens puisez de la source du droit ou par les arrests des
cours souveraines de ce royaume & notamment de la cour des comptes, aydes & finances de Montpelier, Toulouse,
A. Colomiez, 1643, p. 131, 222, 226-227 : la citation est extraite de la p. 131.
8 Arch. mun. Agde, CC 13-16, compoix d’Agde, 1591, 4 vol., 1895 f° : extrait tiré de l’introduction du t. I (CC 13),
nf.
9 Arch. dép. Hérault, 31 EDT CC 5, compoix de Bessan, 1699, 178 f° et 31 EDT CC 7, compoix des Mégeries
Nouvelles (Bessan), 1787 ; SENTENAC (C.), Bessan au diocèse d’Agde (1770-1789). Une communauté rurale à la
veille de la Révolution, mém. maîtrise, BLANCHARD (A.) dir., Montpellier III, Paul Valéry, décembre 1985, 211 p.
10 Réparat : copie actualisée du compoix ; les parcelles, sans prendre en compte leurs mutations culturales, sont
redistribuées aux propriétaires du temps.
nouvellement defrichées », en recourant à l’ancienne table d’allivrement11. Ces opérations, quand elles étaient menées, avaient donc le mérite d’introduire un regain d’équité dans l’assiette foncière de la taille réelle, sinon sclérosée entre deux cadastres.
De la même conscience que l’espace est mouvant relèvent les terres souvent ingrates autour des grands étangs saumâtres qui s’égrènent le long du littoral méditerranéen. L’allivrement de ces terroirs de mise en valeur difficile pose par exemple problème au lendemain de la Recherche générale du diocèse de Maguelone, vers 1520. Une contre-enquête signale que dans le finage de Lattes, ces « messieurs » « omt erré gramdement au jugament de bom [et] moyem car omt jugé bom les camps que sont a la palus, que non se pot fayre blat [parce] que somt terres salemquoses »12. On peut plus simplement retenir l’exemple de Balaruc, où un compoix fut mis en service en 1643. Très vite néanmoins, la nécessité se fit sentir d’encadastrer les terres mises en culture aux abords de l’étang de Thau. À la suite du cadastre se trouve donc le « cayer et compoix des terres et possessions du lieu de Balleruc ouvertes et defrichees depuis le nouveau compoix fait aud[it] lieu en lannée 1643 », homologué en 1663. Une vingtaine de nouvelles parcelles cultivées, parfois taillées dans des parcelles incultes plus vastes, furent ainsi encadastrées13.
En Languedoc, d’autres cas de figure se présentaient, dans le bas-pays en particulier, où les violents orages printaniers et automnaux pouvaient, sur le bord des cours d’eau, même les plus modestes, soustraire ou ajouter des terres aux finages. Cela donnait parfois lieu à la rédaction d’additions au compoix alors en service, en considérant que les « îles » qui venaient de s’accoler à la berge ou de se créer au milieu du cours d’eau se trouvaient dans le prolongement des parcelles riveraines. Le cas se trouve fort bien documenté à Pont-Saint-Esprit où fut constitué un « dossier concernant l’arpentement et allivrement des isles situées dans le terroir du S[ain]t Esprit autorisé par larret du Conseil du 16 avril 1777 ». Les terres furent encadastrées, puis allivrées selon la table du compoix précédent (1635) et en remontant si nécessaire à l’année 171214. La Cour des Aides se montrait très claire dans sa jurisprudence en précisant que « les cremens & augmentations qui se font aux fonds ou terres roturieres, sont contribuables aux tailles, tout de mesmes que lesdits fonds ausquels ils sont adjoustez »15.
On doit enfin imaginer en Languedoc le stock des terres roturières, dites « rurales » (soumises à la taille réelle), en insensible mais permanente augmentation. La rédaction d’un compoix constituait d’ailleurs un moment critique pour la communauté d’habitants qui pouvait alors espérer voir quelques parcelles s’adjoindre au « terroir et taillable ». Les terres menacées de se voir portées au nouveau compoix étaient les terres nobles, souvent oubliées des historiens. Il appartenait en effet au propriétaire d’établir la preuve écrite de la nobilité de chaque fond et l’affaire, du moins pour des bientenants humbles ou illettrés, n’était pas gagnée d’avance car « la noblesse d’un fonds n’est pas prouvée de ce qu’il n’a jamais esté cotisé aux tailles, & si le possesseur ne prouve d’ailleurs la noblesse il peut estre cotisé, comme il se juge tous les jours en ladite Cour »16.
Cela revient à dire que le Cahier des biens réputés nobles accompagnant le compoix précédent n’était pas recopié intégralement et ne servait pas, ici, de juge de paix : sans doute fallait-il produire dans ce cas des titres de propriété. La mésaventure se produisit à Tressan (val d’Hérault) lors de la confection du compoix de 1770 : au final, en 1778, la Cour des Aides
11 Arch. dép. Hérault, 56 EDT 3, compoix de Castelnau-de-Guers, 1680, 279 f° ; 56 EDT 5, compoix actualisé de
Castelnau-de-Guers, 1761.
12 Arch. dép. Hérault, 1 B 10886, Dossier relatif à la recherche générale du diocèse de Maguelone, 1518-1523,
troisième cahier, contre-enquête, s.d., v. 1523, 114 f°, f° 30 v° ; « terres salemquoses » : terres saturées de sel.
13 Sur tout ceci : arch. dép. Hérault, 23 EDT CC 1, compoix de Balaruc, 1643, 178 f° et addition au compoix, 1663,
f° 184-186.
14 Arch. dép. Gard, C 103, Dossier concernant l’arpentement et allivrement des isles situées dans le terroir du
S[ain]t Esprit autorisé par larret du Conseil du 16 avril 1777, 1777, nf ; Arrest du Conseil d’État du Roi, qui
autorise & valide pour cette fois seulement, & sans tirer à conséquence les procédures de compésiement &
d’allivrement faites dans la ville & communauté de Saint-Esprit..., imprimé sans lieu ni éditeur, 1777, 7 p.
15 DESPEISSES (A.), Traicté des tailles…, op. cit., p. 143.
16 Idem, p. 176.
rendit une ordonnance déclassant des terres nobles en terres « rurales ». Le « terroir et taillable » de la communauté venait de gagner huit contribuables et de s’agrandir d’une quinzaine de parcelles. L’espace rural n’avait pas vraiment augmenté mais l’assiette territoriale de la taille si17.
Enfin, un compoix peut enregistrer les modifications de limites entre deux communautés. Dans le sud de la Montagne Noire, en 1601, la communauté d’habitants de la Rivière-de-Cabaret, aussi connue sous le nom de Lastours, demande et obtient de s’agrandir aux dépens de celle de Villanière. Les consuls de Villanière cèdent donc une partie de leur « terroir » qu’ils ont fait borner auparavant, entre les tènements de la Croix d’Escandel, de Montfermier et le cours du ruisseau Grésilhou. Ainsi, les habitants de la Rivière-de-Cabaret pourront désormais, espèrent-ils, mieux s’acquitter de leur participation financière aux affaires communes de la châtellenie royale des tours de Cabardès, auxquelles ils prétendaient avoir du mal à satisfaire du fait de la faible étendue de leur « terroir »
18.
Le compoix, outil de validation d’un territoire produit et de sa frontière
Non content de constituer des documents fiables pour les historiens de l'espace rural, les compoix offraient dans la plupart des cas les mêmes garanties de sécurité dans l’esprit de leurs contemporains. Pour les ruraux, ils représentaient une preuve d'appropriation individuelle de la terre, mais aussi collective de l'espace de la communauté d'habitants, le « terroir et taillable ».
Un document fiable pour ses contemporains
Il est important de souligner que dans le ressort géographique de la Cour des Aides de Montpellier, les données enregistrées dans les cadastres avaient force de preuve au cours d’un procès19. Au-delà de l’aspect purement juridique des choses, les contribuables recouraient fréquemment à leurs compoix pour trancher certains litiges internes à la communauté mais aussi au moment de rédiger de nouvelles matrices.
Ainsi à Générargues (Cévennes) en 1558, au cours de nouvelles opérations de levée, les agents cadastraux, de conserve avec le conseil général des habitants, travaillèrent au nouveau compoix en se référant fréquemment au compoix diocésain qui venait d’être mis en service en 155220. Se servir de l’ancien compoix pour étayer la rédaction du nouveau apparaît régulièrement dans les archives : à Générargues toujours, le compoix de 1559 servit à redessiner les clausades du compoix de 163521. On en a parfois des indices ténus, comme à Puilacher (val d’Hérault) en 1627 : bien que neuf, le cadastre enregistre des parcelles où les confrontants ne correspondent à personne de connu. Il s’agit des anciens propriétaires portés au compoix précédent, qui datait vraisemblablement des années 1580-159022. Sans doute le cadastre de Ribaute-les-Tavernes (environs d’Alès) de 1612 illustre-t-il à lui seul tous les aspects de cette question : « ne sera mis au livre de compoix aucune piece des patus ou vaquans sur aucun particulier, mais en confrontant les pieces y abotisants, sera dit quelles confrontent avec les
17 Arch. dép. Hérault, 30 J 313/1*, double mémoire sur la nobilité des terres de la Plaine de l’Étang (Tressan), 1777 ;
arch. mun. Tressan, CC 1, compoix de Tressan, 1770, 256 f°, surtout le Cahier des biens prétendus nobles, f° 217-
227, passim ; arch. mun. Tressan, CC 3, plan parcellaire associé au compoix de Tressan, 1770, 8 planches, nf.
18 Arch. dép. Aude, 3 E 4321, minute d’Arnaud Brassac, notaire de Salsigne, 3 mai 1601, f° 496 v°-497 v°. Confirmé
par arch. nat., P 18591, Terrier de Villanière, 1490 (copie XVIIIe), passim : le tènement de Montfermier notamment
était encore fréquemment mentionné dans le terroir de Villanière ; alors que arch. mun. Salsigne, 1 G 1, Brouillard du
compoix de la Riviere des Tours en Cabardez…, 1646, passim, le situe dans le terroir de Lastours.
19 DESPEISSES (A.), Traicté des tailles..., op. cit., p. 213.
20 Arch. dép. Gard, E dépôt Généragues CC 1, compoix de Généragues, 1559, introduction, nf.
21 Arch. dép. Gard, E dépôt Généragues CC 3, compoix de Générargues, 1635, introduction, nf ; sur les clausades, cf
infra.
22 Arch. dép. Hérault, 1 B 11048, compoix de Puilacher, 1627, 78 f°, passim.
pactus communs ou avec les terres vacantes, suivant ce que sera reconnu de la verité du fait par le livre vieux compoix ou aucune reconnaisance du seign[eu]r »23.
Plutôt que de laisser les particuliers se lancer dans d’interminables procès sur la possession de terrains de parcours et la juste attribution d’un revenu imposable à ces derniers, le recours au vieux compoix sert ici de juge de paix. À Castelnau-le-Lez (Montpelliérais) en 1658, on décida plus anecdotiquement d’allivrer les aires à dépiquer comme dans le cadastre de 1604. Ce document permet d’ailleurs d’affirmer à nouveau l’idée de la fiabilité alors accordée aux compoix, même obsolètes : « pour facilliter la faction dudit autre nouveau compoix il sera necessaire ausd[its] experts davoir le corps de larpentement fait [en 1603-1604] par le sieur Jean Daniel, arpenteur du lieu de Mauguio, afin de sen servir a ce que besoin sera »24.
Cette confiance au compoix se retrouve dans les très nombreux extraits qui en furent tirés et dont on retrouve fréquemment, en archives, les feuilles volantes égarées ça et là, à des motifs divers. À Montrodat (Margeride) en 1779, lorsque le seigneur du lieu souhaite faire réaliser un terrier de ses emphythéotes, le feudiste recopie des extraits du compoix dit de 1653 et aujourd’hui perdu25. Le feudiste du seigneur de Chadenet (vallée du Lot) agit de même en 1752, le compoix de 1548 sous les yeux26. Tout comme la seigneuresse de Saint-Félix-de-Lodez (Lodévois) réclame en 1612 l'ancien et le nouveau compoix afin de faciliter ses nouvelles reconnaissances
27.
Symptomatiques aussi du point de discussion et d’équilibre parfois atteint dans les relations intracommunautaires grâce à la réalisation du compoix sont certains procès-verbaux introductifs à ces matrices. Le cas est particulièrement net pour trois villages de la Margeride. À l’occasion du règlement des modalités de faction du cadastre, en 1501 à Arzenc-de-Randon, en 1549 à Serverette et en 1556 à Auroux, on adjoignit aux compoix des tarifs pour fiscaliser désormais la possession de bétail, bien que celui-ci n’était ni recensé ni allivré in texto28
.
Les intérêts ainsi partagés peuvent aussi l’être à l’échelle de cellules humaines internes au « terroir et taillable ». En 1774, les habitants du petit hameau de la Fage souhaitaient jouir de la dépaissance de leurs communaux à l’exclusion des troupeaux du reste de la communauté de Saint-Étienne-du-Valdonnez (vallée du Lot). Ils exhibèrent donc une copie du compoix de 1611, dans lequel « toutes les terres communes […] appartenant aux habitans [de la Fage] furent allivrées et dont ils payent et ont toujours payé la taille »
29.
Le compoix servait également à réguler l’accès aux terrains de parcours, et ce de plusieurs manières, en se fondant sur un point juridique fort utile : « les droits perpétuels sur un fonds sont contribuables aux tailles, car un droit annuel (saunage, pêche, pâturage, ramassage de bois, etc…) est considéré comme un immeuble ». Despeisses donne l’exemple de Gatuzières (gorges de la Jonte), qui fait contribuer en 1639 les habitants de Cabrillac pour leur droit de pâturage dans ce finage voisin
30. Les compoix enregistrent ainsi les terrains de parcours ou communaux,
dont ils s’avèrent un excellent révélateur. Ainsi, en Gévaudan, les biens des propriétaires sont souvent classés par hameau, et à la fin de la liste des biens de la section sont ajoutés les « terres communes » de cette dernière, réservées à ses seuls ayant-droits. Aussi le dernier article de chacun d’entre eux consiste-t-il fréquemment en un rappel de sa « part des esplèches et facultés ». Il s’agit d’un quantième du revenu imposable des terres communes
31. Le compoix
23 Arch. dép. Gard, 1 J 229/5, compoix de Ribaute-les-Tavernes, 1612, introduction, nf.
24 Arch. dép. Hérault, 1 B 10980-10981, compoix de Castelnau-le-Lez, Le Crès et Salaison, 1658, 2 vol., t. I,
introduction, nf.
25 Arch. dép. Lozère, 13 J 15, fonds Valgalier, extraits du compoix de Montrodat, 1779, nf.
26 Arch. dép. Lozère, 1 J 140, fonds Peytavin, extrait du cadastre de Chadenet, 1752, nf
27 Arch. dép. Hérault, 254 EDT 1, délibérations consulaires de Saint-Félix-de-Lodez, 26 janvier 1612, f° 57 r°-58 r°.
28 Arch. dép. Lozère : E 820, copie de la « table » du compoix d’Arzenc-de-Randon, nf ; G 586, compoix de
Serverette, introduction, nf ; 3 E 9848, compoix d’Auroux, 1557, f° 160 r°-162 r°.
29 Arch. dép. Lozère, E 927, mémoire des habitants de la Fage, 1775, nf.
30 DESPEISSES (A.), Traicté des tailles…, op. cit., p. 144.
31 Exemples trop nombreux pour être cités, sinon un document cévenol remarquable : arch. dép. Lozère, EDT 036
CC 2, compoix de Cassagnas, 1640, 530 f°.
sert aussi à réguler la possession de bétail des contribuables : le conseil général de la communauté peut demander à ses administrés de ne posséder que tant de têtes de bétail par sou ou par livre de revenu imposable porté au compoix
32. Pour éviter le surpâturage et les conflits,
les consuls de Drigas (Causse Méjan) décident en 1751 de frapper fort. Non seulement ils interdisent l’estivage dans leur finage mais limitent aussi la taille du troupeau pérenne : « les susdites herbes des terres comunes dud[it] village ne seront mangées uniquement que par le propre betail que chacun des particuliers a et poura avoir et tenir de son chef par raport a lalinvrement de son compoix »
33. Dans certains cas-limites, il semble même évident que le
cadastre n’a été réalisé que pour régler cette question, comme au Chastel-Nouvel (Margeride) en 1672. Ici, l’allivrement sert à répartir proportionnellement les nuits de fumature entre les contribuables : les bientenants avaient donc trouvé un moyen de s’accaparer l’accueil rémunérateur des troupeaux venus transhumer là
34.
On ne peut pas non plus oublier de signaler qu’eut lieu en 1687 une grande enquête provinciale qui dénombra les biens et droits des 2687 communautés d’habitants constitutives du Languedoc. In texto, très souvent, et il faudrait mesurer dans quelles proportions, la communauté, pour appuyer la déclaration de ses biens et droits, l’usage de biens fonciers notamment, fournissait à titre de preuve un ou des extraits de compoix, parfois anciens35. À Usclas-d’Hérault (val d’Hérault), il en allait ainsi du four commun du village, dénombré dans un article du compoix de 1655 et recopié in extenso en 1687 : « item un four commun a cuire pain [qui] fait de compoix trois sous, uzages un denier quy fait annuellem[en]t a Monsieur le Commandeur de Pesenas, Seigneur dud[it] lieu »36. Les exemples fourmillent donc et comme le font aujourd’hui les historiens, les Languedociens de l’époque moderne se servaient volontiers de leurs compoix à des fins autres que fiscales, pour établir les limites entre plusieurs communautés d’habitants par exemple ou à tout le moins, assurer les leurs.
Pérenniser le « terroir et taillable »
En effet, les compoix successifs d’une communauté constituent un édifice cumulatif qui vient consolider l’appropriation d’un territoire commun. Ce territoire commun se rapproche assez de nos communes. Les terres roturières sont recensées dans des compoix pour fonder en quelque sorte l’état civil de la terre : « en Languedoc toutes les terres, possessions, ou maisons qui sont dans le territoire dudit lieu où se fait ledit compoix, doivent estre appreciées & comprises en iceluy, […] car en tout ledit pays de Languedoc les tailles & autres imposistions doivent estre imposées dans le compoix & levées par terroirs et juridictions »37.
À partir du XVIIe siècle, quelquefois plus tôt, sont également englobées dans le terroir et
taillable d’une communauté les terres nobles qui, se trouvant sur le territoire de la communauté d’habitants, en sont fiscalement exclues puisqu’exemptes de taille. Il s’agit de ce que les compoix nomment les « biens prétendus nobles », dans le dessein de faciliter, un jour, leur éventuelle imposition.
Le compoix se doit donc d’enregistrer l’entier terroir et taillable de la communauté et, partant, en établir les contours, jusqu’à la « divizion » d’avec le terroir et taillable voisin, espace
32 APPOLIS (É.), « La question de la vaine pâture en Languedoc au XVIIIe siècle », Annales historiques de la
Revolution française, t. X, mars 1938, p. 97-132.
33 Arch. dép. Lozère, EDT 074 DD 1, papiers sur les pâturages de Drigas, 9 juin 1751, nf.
34 Arch. dép. Lozère, E 841, compoix du Chastel-Nouvel, 1672, 267 f°, notamment f° 251 v° sq ; sur tout ceci :
BERNARD (R.-J.), « L’élevage du mouton en Gévaudan aux XVIIe et XVIIIe siècles » in Élevage et vie pastorale dans
les montagnes d’Europe, actes du colloque de Clermont (juin 1982), Clermont-Ferrand, Institut d’études du Massif
Central, 1984, p. 335-354.
35 Arch. dép. Hérault, C 2951-3017, dénombrement pour l’amortissement des biens et droits des communautés pour...
(classés par diocèses civils), 1687-1690, 66 vol.
36 Arch. dép. Hérault, 1 B 11093, compoix d’Usclas-d’Hérault, 1655, 87 f° ; C 2966, dénombrement pour
l’amortissement des biens et droits du diocèse civil de Lodève, 1687, pièce n° 300 (insérée par erreur dans ce volume
au lieu de figurer dans celui du diocèse civil de Béziers).
37 DESPEISSES (A.), Traicté des tailles..., op. cit., p. 210.
fiscal cependant mité par les parcelles nobles. Les compoix devenant de plus en plus précis dans leur description de l’espace au cours du XVII
e siècle, la Cour des Aides leur accordait donc sa
confiance pour fixer les limites « communales », avec l’idée qu’un nouvel encadastrement des terres ne pouvait qu’améliorer l’ancien. Cela dit, il ne faut pas imaginer que la géographie des terroirs et taillables était immuable. Antoine Despeisses donne d’ailleurs des exemples de taillables trop vastes qui avaient demandé à être l’objet de la faction d’un compoix séparé, comme la Val de Montferrand en 158638. De même et au XVII
e siècle, afin de répondre à des
impératifs industriels, Colbert avait accepté de privilégier la manufacture aujourd’hui connue sous le nom de Villeneuvette, tout en lui octroyant un territoire propre. Aussi, lorsque la manufacture est érigée en communauté indépendante sous le nom de Villeneuve-lez-Clermont par lettres patentes datées du 20 juillet 1677, son « terroir » est découpé dans les terres de Clermont et de Nébian, terres alors distraites des compoix de ces deux communautés
39.
On peut aussi ajouter que les compoix faisaient état et dressaient la liste, en pays d’habitat dispersé, des écarts constitutifs du terroir et taillable souvent découpé, ici, en « quartiers », chacun avec ses propres limites. Ces quartiers avaient en outre une véritable utilité fiscale et constituaient les cellules de base au moment de la répartition de la taille40. Ainsi le mandement de Belvezet (Margeride), en Gévaudan, était découpé en trois cartons dans le compoix. Les rôles de taille lui faisaient écho, répartissant ainsi la taille entre ces trois cartons : Belvezet payait le quart de la mande du mandement, Chasseradès les trois huitièmes et Mirandol de même41.
En tant que tels toutefois, les compoix dressent rarement la liste des bornes sur lesquelles vient achopper leur recensement parcellaire. Les « divisions » d’avec les « terroirs et taillables » voisins se retrouvent ainsi, dans les articles du cadastre, parmi les confronts qui bornent les héritages des particuliers : on les rencontre par exemple fréquemment, même dans les châtaigneraies encadastrées « à vue d’œil », à la Salle-Prunet (Cévennes) en 1639
42. Bien sûr,
lorsque les terres vaines et vagues communales se trouvaient en limite de taillable, à l'exclusion de toute parcelle cultivée, l'absence de terrains encadastrés ne laisse pas apparaître la « division » avec le taillable voisin. Cela dit, un compoix peut exceptionnellement établir le cheminement des frontières communales. Dans l’exemple retenu, il s’agit néanmoins de limites internes à la communauté, entre deux villages du même terroir et taillable, celui de Marchastel (Aubrac) en 1685. « Confrons generaux du terroir de Rieutord : conf[ron]t[e] du levant terres de Ferrieirolz et terres de la montaigne de la Pagezie, separe par de croix sur de rochers ; du midi, terres des habitans de March[aste]l et traverssant le chemin royal jusques a la riviere de Béz ; du couchant, avec lad[ite] riviere ; et de bise, avec les terres de Rieutortet jusque au pred de la Gravilhade ; et en montant de lad[ite] bises, terres en conteste entre lesd[its] hab[itan]ts de Rieutord et de Rieutortet jusques a une borne posée en terre le long du chemin royal, et de lad[ite] borne sen va jusques a la terre dud[it] Ferrieiriolz »43.
Outre un conflit territorial à remarquer entre les deux hameaux de Rieutortet et de Rieutort-d’Aubrac, les terres relevant de ce dernier sont donc strictement séparées d’avec celles du village de Marchastel, pourtant « chef-lieu » de la communauté d’habitants. Rares sont cependant les documents d’ensemble, comme le compoix diocésain de Lodève, à établir scrupuleusement, finage par finage, les « divisions » de tous les territoires des localités du diocèse civil. Là, les arpenteurs ont pris la peine de parcourir de manière linéaire les zones limitrophes des taillables, de serre en valat, de rocher en vieille muraille, ou de gros arbre en borne sculptée aux armes du seigneur. C’est du moins c’est ce que laisse supposer la lecture du
38 Sur tout ceci : DESPEISSES (A.), Traicté des tailles..., op. cit., p. 214-215.
39 APPOLIS (É.), Un pays languedocien au milieu du XVIIIe siècle : Le diocèse civil de Lodève, Étude administrative et
économique, Albi, Imprimerie coopérative du Sud-Ouest, 1951, p. 132, 282.
40 JAUDON (B.), « Les contradictions fiscales du Gévaudan au dernier siècle de l’Ancien Régime », in FOLLAIN (A.)
éd., Campagnes en mouvement en France du XVIe au XIXe siècle. Autour de Pierre de Saint Jacob, actes du colloque
international d’histoire rurale (Dijon, 23-24 mars 2007), Dijon, EUD, 2008, p. 275-287.
41 Arch. dép. Lozère, C 23, C 26, C 28, C 1000, C 1094, E 834, E 836, EDT 040 CC 2, enquêtes et documents divers,
dont préambules et rôles de taille, sur le mandement de Belvezet, 1677-1789.
42 Arch. dép. Lozère, E 963, compoix de la Salle-Prunet, 1639, 742 f°.
43 Arch. dép. Lozère, EDT 087 CC 1, compoix de Marchastel-et-Malbouzon, 1685, f° 58 r°.
compoix diocésain. On peut cependant supposer que, même si l’équipe ayant élaboré ce document n’a pas parcouru exactement toute la limite du taillable, elle l’a au moins scrutée du regard afin de repérer les éléments marquants du paysage de confins
44.
La description assez fidèle du bornage communal se retrouve, par essence, plus fréquemment dans les compoix à clausades. Ce genre de cadastres, qu’on retrouve plutôt dans le Languedoc rhodanien, découpait le terroir et taillable en quartiers fiscaux – les clausades ou « cordes » –, quartiers où les revenus imposables variaient en fonction de la localisation dans le finage45. Comme il était nécessaire de rappeler les limites de chaque clausade, on dispose ainsi de solides dossiers pour suivre sur le terrain et par extension le tracé d’une « division », tracé parfois complexe. A Cassagnoles (Gardonnenque), le compoix de 1538 découpe l’espace en trois clausades, dont la première englobe le village, « depuis l’ort [jardin] de Vergile, suivant le chemin de Venobres venant à Cassagnoles, et de Cassagnoles finit au tricat [ruisseau] de la paroisse et de là suit l’Homme Mort et suit le chemin jusqu’à Riu Votre »
46 Même la petite ville
de Lunel disposait ainsi d’un compoix à clausades de 1591, qui classait les biens immeubles, non seulement par quartier urbain mais aussi par corde47.
Revendiquer le limitrophe conflictuel
Les compoix fournissant un état considéré comme fiable des biens immeubles de chacun. Il n’est pas surprenant qu’ils aient constitué une documentation privilégiée afin d’établir des preuves lors de conflits de limites entre deux taillables, en faisant appel aux matrices plus anciennes afin d’étayer des droits. Ceci apparaît bien lorsqu'en Lodévois, plusieurs communautés d’habitants ont été amenées à prendre la mesure de l’étendue de leur terroir au moment de l’élaboration du compoix ou recherche générale du diocèse en 1627. Aussi, c’est au moment de cette grande opération fiscale et « territoriale », et à cause des délimitations alors mises par écrit, que naissent des litiges entre communautés. On ne connaît en effet pas de compoix diocésain en Lodévois antérieur à celui de 1627-1632. Son élaboration est donc l’occasion pour les autorités diocésaines, en accord avec les pouvoirs locaux incarnés par les consulats, d’appréhender de manière globale et précise les territoires du Lodévois, de les délimiter, de les rationaliser en les décrivant de manière linéaire. Le XVII
e siècle n’est-il pas, en
effet, déjà avant le siècle des Lumières, celui de quelques célèbres tentatives d’appropriation du territoire par les travaux des arpenteurs ? Dans les forêts françaises d’alors, la réformation des Eaux-et-Forêts, avec élaboration de plans, est tout à fait révélatrice de ce souci de délimiter. Jusque là, chaque limite de « terroir » était quelque peu floue, et surtout conçue différemment selon le côté duquel on se trouvait puisque chaque communauté tendait à définir son propre territoire de manière unilatérale.
L’opération d’élaboration du compoix diocésain est donc le moment où, dans les zones périphériques de deux terroirs limitrophes, les autorités de ces deux terroirs sont amenées à constater les inadéquations entre leur perception de leur propre territoire et la perception que les consuls du village voisin défendent du leur. Le compoix diocésain révèle des vides, des zones éloignées des villages et hameaux organisés en consulats. Dans ces vides s’insèrent les nombreuses métairies nobles donc non fiscalisées et, partant, non encadastrées, mais aussi des tènements de garrigue communaux, terrains de parcours où vont parfois paître les troupeaux de plusieurs communautés jusqu’alors sans conflits du fait du peu de convoitise pesant sur ces terrains. Mais en 1627, le mouvement de rationalisation qu’impose la mise par écrit, dans le compoix diocésain, d’une limite linéaire conçue sous la forme d’un itinéraire décrit de borne en borne, mène à des conflits d’appropriation. Il est stratégique pour les consuls de défendre les frontières de leur territoire, sachant que la recherche diocésaine représente un document amené
44 Arch. dép. Hérault, 142 EDT 87-88, compoix diocésain de Lodève, 1632, 2 vol.
45 BARRY (J.-P.), « Au sujet des compoix à clausades », Revue d’histoire économique et sociale, vol. 31, n° 3, 1953,
p. 253-271.
46 Arch. dép. Gard, 1 E 896, copie du compoix de Cassagnoles, 1538, introduction, nf.
47 Arch. mun. Lunel, CC 2-6, compoix de Lunel, 1591, 5 vol., 1042 f°.
à être utilisé longtemps. Renoncer aux marges de ce que l’on considère comme son propre territoire créerait un précédent pour les générations à venir.
L’un de ces conflits de frontière concerne la communauté de Mourèze, diocèse civil de Lodève, en contentieux quant aux limites de son terroir et taillable avec celle de Cabrières, au diocèse civil de Béziers
48. En effet, on apprend par les documents mourézois conservés que les
consuls de Cabrières ont formé opposition devant le premier président de la Cour des Aides, Monsieur de Bocaud, commissaire principal en la recherche diocésaine
49. Évidemment, dans un
souci d’objectivité, il serait intéressant d'accéder aux pièces du procès produites par Cabrières, que nous n’avons pas retrouvées. La situation d’ensemble et ses enjeux peuvent cependant être appréhendés à travers les arguments d’une seule des deux parties. Les terres sur lesquelles porte le contentieux se trouvent au niveau du pic de Vissou, dans une zone où la frontière était poreuse pour les troupeaux des deux villages, les 258 hectares concernés consistant surtout en garrigues et pâturages
50.
Afin de s’approprier l’espace litigieux, les Mourézois ne peuvent appuyer leurs revendications sur des bornes. Ils invoquent donc des preuves écrites venues du passé. C’est là qu’interviennent les compoix.. La communauté prend six exemples de parcelles qu’elle s’adjuge par des pièces justificatives extraites des archives, numérotées en chiffres arabes. Ainsi, la troisième justification ou « monstrée » porte « sur la pièce des Ricard al col de Vissou qui se justiffie par le moyen d’un vieux compois couvert de parchemin au feulhet prem[ier] n° 9 et par le compoix de l’année 1611 f[o]l[i]o 3, n° 10 »
51.
Cet appui sur les compoix successifs de Mourèze révèle donc que ce type de document, non content d’être un outil fiscal, représente aussi une preuve d’appropriation du terroir par la collectivité. C’est une des raisons pour lesquelles les consuls avaient intérêt à conserver au moins un compoix dans leurs archives, et éventuellement davantage. La Cour des Aides de Montpellier donnait d’ailleurs aux extraits de compoix, depuis la fin du XVI
e siècle, valeur de
preuves juridiques incontestables pour attester de l’appartenance de terres disputées entre deux communautés : « Les monumens anciens (comme les anciennes inscriptions ou sculptures mises sur des pierres qui sont ez fonds) et les compoix commencez avant le procez, sont pleine foy pour prouver ces bornes & limites »
52.
Sous l’Ancien Régime, le cadastre constituait donc, avec les bornes, un document décisif afin d’établir en justice une preuve de limite de propriété, mais il ne pouvait pas toujours être appelé à la rescousse. Son utilisation est possible à Mourèze, lorsque les tènements contestés entre deux communautés sont au moins partiellement appropriés sous forme de parcelles individuelles. Mais combien de ces tènements marginaux ne sont que des communaux totalement incultes consacrés au pâturage et, partant, échappant aux compoix ? En fait, le compoix, intrinsèquement, renseigne souvent mal sur les marges peu fertiles, au Moyen Âge déjà
53. En effet, les marges sont le lieu où se trouvent les mas et des communautés familiales
relativement autonomes, alors que les alentours du village groupé sont le domaine du consulat et de la communauté d’habitants. Le compoix étant produit par cette dernière, il s’attache surtout à une description précise du cœur du terroir, le plus proche des principaux contribuables. On pourrait multiplier les exemples languedociens de ces « photographies » de paysages précises au centre et plus floues ou déformées sur les bords. A Monoblet (Cévennes) en 1592 par exemple, lors de la faction du nouveau compoix, la communauté se trouva mise en porte-à-faux par quelques propriétaires des marges du finage, qui tentèrent de soustraire un écart, le Mas de
48 APPOLIS (É.), Un pays languedocien…, op. cit, 1951, p. 5.
49 Arch. dép. Hérault, 175 EDT 3, Relations de la communauté des habitants de Mourèze avec celle de Cabrières,
XVIIe-XIXe siècles.
50 Arch. dép. Hérault, 142 EDT 87, doc. cit., f° 544 r°-545 r°.
51 Arch. dép. Hérault, 175 EDT 3, doc. cit., « Invantaire de la monstrée de Mourèze », v. 1627, 4 p.
52 DESPEISSES (A.), Traicté des tailles…, op. cit., p. 213.
53 ABBE (J.-L.), CHALLET (V.), « Du territoire à la viguerie : espaces construits et espaces vécus à Saint-Guilhem-le-
Désert à la fin du Moyen Âge », Annales du Midi, t. 119, n° 260, octobre-décembre 2007, p. 514-516.
Falgueyroles, à l’encadastrement du terroir et taillable en prétendant à tort que le hameau relevait du territoire du village voisin de Colognac
54.
Toutefois, au XIXe siècle encore, les mairies conservaient les anciens compoix, afin de régler
les litiges parcellaires entre particuliers55
ou entre communes. Ainsi, à Mourèze, le conflit qui nous intéresse n’est toujours pas réglé à la Révolution, si bien qu’à cette époque ou après, il est décidé de borner en fonction de la décision d’une sentence arbitrale, « sans préjudice pour fortifier la preuve de la légitimité et de la justice de lad[ite] sentence de faire uzage des autres titres que la municipalité de Moureze peut avoir, & comme terriers compoix et tous autres, etc. »
56. La municipalité agit de même et pour des raisons identiques à Saint-Étienne-du-
Valdonnez (vallée du Lot) en 1791 et 1825. Le cas se retrouve à Tressan (Val d’Hérault), où le conseil municipal en appelle en 1839 au compoix de 1770 pour mesurer des empiètements sur les chemins vicinaux
57.
Cela dit, la loi changea au cours du XIXe siècle et modifia le crédit juridique à apporter au
cadastre dans le cas des litiges de limites de propriété ou de communes. Le Droit dit désormais que la seule détermination juridique de la propriété est l’acte de bornage (à l’amiable ou judiciaire). Nos matrices ne fournissent plus que des présomptions contestables, depuis que la Cour de cassation, en 1844, a rejeté le cadastre parcellaire comme preuve juridique déterminant les limites de propriété58. Tel n’était pas encore le cas sous l’Ancien Régime, et on faisait alors feu de tout bois, sans se contenter des seuls compoix, bien souvent pour pallier les carences d’enregistrement aux marges des finages de ceux-ci ou appuyer plus encore les preuves intangibles que nos registres permettaient de verser au dossier. En effet, les terriers, quittances de lods ou mutations foncières devant notaire étaient tout autant invoquées dans le dossier documentaire mourézois concernant les garrigues de Vissou : en 1627, la communauté se « justiffie par quatre compois et cadastres fort vieux, mesmes par les recognoissan[ces] faites aux seigneurs dud Moreze et par vantes des piesses qui se sont vandues dans ce terroir contancieux », entre autres
59. La fréquente utilisation des compoix afin de gérer de tels litiges
tient autant au statut juridique du document qu’à son omniprésence dans les archives et à son assez grande précision habituelle.
Les compoix, largement répandus dans le Languedoc d’Ancien Régime – peut-être quatre à cinq mille matrices conservées ou utilisées à travers la province à la veille de la Révolution –, revêtaient ainsi des usages et des fonctionnalités dépassant de loin le simple recensement fiscal de terres
60. Clefs-de-voûte de l’édifice de la fiscalité royale et « municipale », ils présentaient
l’incomparable avantage de fonder l’état civil de la propriété et partant son statut juridique : privée ou collective, « rurale » ou noble, etc.
La nature même des opérations cadastrales, leur totale transparence sous l’Ancien Régime, ainsi que la présence de nombreux témoins au moment de la levée topographique, donnaient au compoix issu de ces travaux un caractère difficilement contestable. De là découlent la faible
54 Arch. dép. Gard, 3 E 103, compoix de Monoblet, 1592, f° 513 r° sq.
55 OLIVIER (S.), « Compoix, terriers et cadastres… », art. cit., p. 69.
56 Arch. dép. Hérault, 175 EDT 3, doc. cit ., « Bissou-Boutoury en litige », s.d.
57 Arch. dép. Lozère, E 927, papiers divers de la communauté de Saint-Étienne-du-Valdonnez, copies d’extraits du
compoix de 1611, 1774-1825, nf ; arch. mun. Tressan, documents non classés, délibérations du conseil municipal,
registre des années 1837-1856, délibération du 15 mars 1839, f° 7 r°-9 r°.
58 NOIZET (F.H.V.), Étude sur le cadastre, Paris, Guillaumin et Cie, 1857, p. 2-3 : avec la citation de l’arrêt de la Cour
de cassation.
59 Arch. dép. Hérault, 175 EDT 3, doc. cit., « Mémoire contre Cabrières », XVIIe siècle, nf.
60 LARGUIER, (G.), « Normes, production et évolution des compoix terriens en Languedoc, XVIe-XVIIIe siècles » in
TOUZERY, (M.), dir., De l’estime au cadastre en Europe (XIIIe-XVIIIe siècle), actes du colloque de Paris (4-5
décembre 2003), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2007, t. II : « L’Époque
moderne », p. 339-372.
proportion de procès portés devant la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier mais aussi l’important crédit porté par cette cour souveraine aux informations recelées dans les cadastres.
Assurément fiables, les compoix de l’époque moderne constituent donc d’étonnants révélateurs du rapport des sociétés rurales à leurs territoires. Ceux-ci, plus souvent auto-organisés qu’aménagés pour s’en tenir à des terminologies opératoires, fondaient sur leurs compoix nombre de perspectives liées à la pratique quotidienne de l’espace proche. L’équilibre social et géographique interne à la communauté d’habitants s’appuyait en partie sur son cadastre, de même que ses rapports avec les communautés voisines. Recensement des propriétaires et des propriétés roturières et nobles, inventaire des linéaments du paysage, délimitation précise de la plus grande partie du finage, régulation de l’élevage dans les zones intensément mises en culture de la plaine ou celles aux fragiles équilibres agro-pastoraux de la montagne, où la rupture de charge anthropique n’est jamais éloignée, de tout ceci les compoix languedociens prennent acte et font date.
Documents nécessaires parce que fondateurs de la répartition de la taille royale, les communautés ont su, au cours de l’époque moderne, se saisir des compoix pour en faire des documents utiles à la gestion de leurs espaces. Incarnation de la présence de l’État, le compoix, instrument local de prise en compte de l'espace, était donc comme habité d’une double personnalité qui l’avait rendu indispensable à ses contemporains.



























![Pierre-Ernest de Mansfeld et les ingénieurs militaires: la défense du territoire [2007]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633256718d2c463a5800d382/pierre-ernest-de-mansfeld-et-les-ingenieurs-militaires-la-defense-du-territoire.jpg)