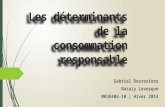Élevage et consommation en territoire arverne. Akten des 34. internationalen Kolloquiums der...
-
Upload
archeodunum -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Élevage et consommation en territoire arverne. Akten des 34. internationalen Kolloquiums der...
RÖMISCH-GERMANISCHE KOMMISSION, FRANKFURT A.M.EURASIEN-ABTEILUNG, BERLIN
des Deutschen Archäologischen Instituts
Kolloquien zur Vor- und FrühgeschichteBand 16
Dr. Rudolf Habelt GmbH ! Bonn 2012
RÖMISCH-GERMANISCHE KOMMISSION DESDEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS
RÖMISCH-GERMANISCHES ZENTRALMUSEUMASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’ÉTUDE DE L’ÂGE DU FER
Die Frage der Protourbanisation in der EisenzeitLa question de la proto-urbanisation à l’âge du Fer
Akten des 34. internationalen Kolloquiums der AFEAFvom 13.–16. Mai 2010 in Aschaffenburg
herausgegeben von
Susanne Sievers und Martin Schönfelder
Dr. Rudolf Habelt GmbH ! Bonn 2012
VIII und 386 Seiten, 229 Abbildungen und 5 Tabellen
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographischeDaten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar
© 2012 by Römisch-Germanische Kommission desDeutschen Archäologischen Instituts Frankfurt a. M.
Redaktion: Susanne Sievers, Martin Schönfelder, Nadine BaumannRedaktoren / comité de lecture:Anne-Marie Adam, Strasbourg
Philippe Barral, BesançonChristopher Pare, Mainz
Rüdiger Krause, Frankfurt a. M.Katharina von Kurzynski, Wiesbaden
Stéphane Marion, NancyMarkus Marquart, Aschaffenburg
Réjane Roure, Montpellier
Einband: Silke BergSatz und Druck: Beltz Bad Langensalza
Gedruckt auf alterungsbeständigem PapierISBN 978-3-7749-3785-7
Sylvain Foucras
Élevage et consommation en territoire arverne.De l’agglomération d’Aulnat aux oppida du bassin clermontois,
changements ou continuité ?
L’étude récente des restes animaux menée en Lima-gne d’Auvergne (FOUCRAS 2010) met en lumière di-vers aspects des pratiques de l’élevage et de laconsommation la fin de l’âge du Fer. L’abondancedes mobiliers fauniques sur quelques-uns desgrands sites du bassin clermontois permet ainsi desuivre l’évolution de ces pratiques durant les troisderniers siècles avant notre ère, dans un espace res-treint d’environ 100 km2; cette évolution concernenotamment la période de passage des habitatsgroupés de plaine aux oppida (Fig. 1).
L’agglomération d’Aulnat(IIIe–IIe siècle av. J.-C.)
Le complexe d’Aulnat, localisé à quelques kilomè-tres à l’est de l’agglomération de Clermont-Ferrand,constitue un tissu d’habitats, d’installations artisa-nales et de zones funéraires, sur une surface d’en-viron 4 km2. Identifié comme un «habitat groupé»,
ce complexe a fait l’objet de plusieurs opérationsarchéologiques distinctes.
Entre 1966 et 1982, au lieu dit La GrandeBorne, quatre opérations se sont succédées. Elleslivrent diverses structures domestiques et de nom-breux vestiges issus de divers artisanats (forge ettabletterie notamment), auxquels se mêle unetrame funéraire d’une dizaine de sépultures. L’en-semble de la Grande Borne propose une séquencechronologique étagée du IIIe au Ier siècle av. J.-C.À quelques centaines de mètres plus au nord, lestravaux de la Rue Elisée Reclus, entrepris en 1991,mettent au jour le même type de structures do-mestiques (trous de poteaux, silos, fosses et puits)datées du IIe siècle av. notre ère. Enfin, les fouillesmenées en 2000 et 2001 au lieu dit «Gandaillat»,s’intercalent entre les deux sites précédents. L’im-portance de la surface fouillée – plus de 8 000m2
– a permis de dégager quelques 500 structures ar-chéologiques dont une bonne part datée du IIe
et Ier siècle av. notre ère (DEBERGE et al. 2007b;Fig. 2).
Altitudes:moins de400 m
400 à 700 m
700 à1000 m
1000 à 1300 m
plus de1300 m Habitat groupé
Oppidum0 20kilomètres
Fig. 1. Localisation des sites arvernes mentionnés.
Compte tenu du nombre considérable de restesanimaux prélevés, le complexe d’Aulnat s’imposecomme un site de référence pour ce qui est de l’ar-chéozoologie. Les 48 788 restes osseux analysés li-vrent, globalement, un faciès classique d’habitatgroupé avec une suprématie des restes porcins(40 % en moyenne) devant ceux de bovidés (capri-nés et bovinés), qui ne dépassent guère 30 % cha-cun. Pour autant, force est de constater que des dif-férences marquées apparaissent au sein de cetensemble.
Alors que les faciès fauniques de La GrandeBorne et de la rue Reclus sont très semblables, celuide Gandaillat se distingue par une prédominancedu bœuf sur les autres espèces. En dépit d’uneaugmentation des restes porcins au cours du Ier siè-cle av. J.-C. (de 32 à 38 %) ces bovins demeurenttoujours bien représentés avec 35 % des vestigesfauniques. Durant toute la période d’occupation, lapart des caprinés reste très secondaire, inférieure à12 %.
Le site de Gandaillat s’oriente donc vers unegestion préférentielle du bœuf, dont la majorité estabattue vers quatre ou cinq ans – c'est-à-dire àl’âge adulte – certains atteignant même parfois desâges très avancés (plus de dix ans). Globalement lamême gestion du cheptel s’applique à La GrandeBorne et rue Reclus. Malgré un abattage non négli-geable d’animaux jeunes (environ 20% enmoyenne) destinés à l’alimentation, il semble
qu’une franche majorité des individus soit conser-vée plus agée. On souligne toutefois que leurconsommation n’en est pas moins effective, unefois abattus.
Cet habitat groupé, qui présente des faciès trèsdifférents, laisse ainsi entrevoir une organisationen secteurs distincts; celui de Gandaillat s’orientantvisiblement vers une utilisation bouchère des bo-vins alors que c’est le porc qui est clairement privi-légié dans la consommation, sur l’ensemble de l’ag-glomération. On rejoindrait à Aulnat, au secondsiècle av. notre ère, l’hypothèse émise pour le sitede Villeneuve-Saint-Germain où G. Auxiette distin-gue des zones dédiées à la boucherie et d’autres àl’habitat1.
Les oppida du bassin clermontois(Ier siècle av. J.-C.)
Regroupés au sud de la Limagne (Fig. 1) et distantsde quelques kilomètres seulement, les trois oppidade Gondole, Gergovie et Corent apparaîssent entrela fin du IIe siècle av. J.-C. et le début du Ier siècleav. J.-C. Le modèle proposé – qui repose sur un ar-gumentaire chronologique – consiste à voir un dé-placement du centre de peuplement, depuis laplaine (Aulnat et ses environs) vers les oppida situ-és quelques kilomètres plus au sud2. L’essor des op-pida marquerait ainsi une nouvelle centralisationdu territoire, constituant un changement politico-social d’importance qui s’accompagnerait d’unephase de désaffection des sites de la plaine.
La zone artisanale de Gondole: entre oppidum ethabitat groupé
Les fouilles entreprises depuis 2005 au pied de l’op-pidum de Gondole ont mis au jour une vaste zoneartisanale (DEBERGE et al. 2009). Occupée durant laseconde moitié du Ier siècle av. notre ère, elle pré-sente un réseau organisé de structures en creux(fosses, puits, caves), renvoyant tantôt au domaineartisanal (fours de potiers, déchets de forge, élé-ments de tabletterie et de corneterie) tantôt à lasphère domestique (fours culinaires, rejets deconsommation), les deux étant souvent mêlés(Fig. 3). Quel que soit le contexte, les vestiges ani-maux y sont toujours représentés en grand nom-bre.
Fig. 2. L’agglomération d’Aulnat, plan général desstructures (Gandaillat, Rue E. Reclus, La Grande Borne).
1 AUXIETTE 1996.2 DEBERGE et al. 2007a; POUX 2005. Voir également le
cas d’Acy-Romance (MÉNIEL 1998).
Sylvain Foucras204
Des 11 500 restes étudiés, c’est le porc qui do-mine nettement le spectre faunique (46 %), devantles caprinés et le bœuf qui sont pareillement repré-sentés avec chacun 25% des vestiges osseux. Al’instar des sites voisins, les autres espèces neconstituent qu’une part restreinte des restes fau-nique (inférieure à 4 %).
La majorité des vestiges est issue de la consom-mation carnée, la part des ossements directementliés aux activités artisanales du site ne représentantque 1% de l’ensemble des restes animaux. Il s’agitpour l’essentiel de chevilles osseuses de cornes bo-vines ou caprines, de bois de cervidés et de quel-ques ébauches de tabletterie, dispersés ça et là dansles différentes fosses.
Un siècle et demi plus tard, le faciès rencontré àGondole est très proche de celui de la GrandeBorne et de la rue Reclus à Aulnat. Outre une re-présentation des espèces, la distribution anato-mique des restes de la triade domestique est égale-ment proche avec une forte représentation desparties les mieux pourvues en viande (Fig. 4). Dansl’ensemble, le tronc et les membres dominent, lesautres régions anatomiques. Si la distribution desrestes de porc est plus équilibrée que chez les bovi-dés, cela est probablement dû au fait que, chez
cette espèce, toutes les parties sont susceptiblesd’être consommées, la tête et les pieds notamment.
L’oppidum voisin de Gergovie offre égalementun faciès semblable à celui d’Aulnat. Malgré la mo-dicité des investigations archéologiques menéesjusque là, les vestiges animaux issus des structuresdomestiques de la fouille conduite au pied du rem-part, livrent des résultats intéressants. Ainsi, les2 396 restes analysés témoignent d’une représenta-tion des espèces semblable à Aulnat et à Gondole,avec une domination des vestiges porcins (46 %)sur les bovins (27 %) et caprins (21 %).
Seule la représentation des restes varie. On ob-serve en effect un équilibre relatif des différentes ré-gions anatomiques pour le bœuf, et une part impor-tante des têtes et des pieds chez les caprinés et lesporcs (Fig. 4).
L’oppidum de Corent: boucherie d’oppidum
Les fouilles conduites depuis 2006 sur l’habitat del’oppidum de Corent ont mis au jour un ensemble
Fig. 3. Zone artisanale de Gondole, plan général desstructures.
Fig. 4. Distribution des parties anatomiques pour lestrois espèces principales.
Élevage et consommation en territoire arverne 205
de structures relatives à des bâtiments organisésautours d’une place centrale. L’étude de l’un de cescorps de bâtiment rend compte de l’importancedes rejets osseux, rassemblés par milliers au seinde larges fosses détritiques (Fig. 5; 6) (POUX et al.2008).
À ce stade de l’étude, ce sont 6 315 restes qui ontété analysés. Le bœuf domine le spectre fauniqueavec 62 % des restes l’essentiel étant constitué debas de pattes (60 à 85 % selon les contextes) ainsique des fragments de crânes (environ 12%). Lesmorceaux les plus favorables à la consommationne constituent qu’une part minoritaire des partiesanatomiques représentées là (moins de 20 %). Leporc (9 %) et les caprinés (20 %) montrent une dis-tribution des restes similaire avec un déficit en par-ties consommables.
Ces ensembles constituent assurément les rejetsde la découpe primaire des activités de boucherie,tels qu’on les observe, pour la période gallo-ro-maine, à Jouars-Pontchartrain ou à Meaux parexemple3. On assiste ainsi, dans la proximité im-médiate du grand sanctuaire de l’oppidum, à uneactivité bouchère d’envergure, principalement ori-entée vers la consommation du bœuf.
En marge de ces accumulations en fosse, d’au-tres éléments viennent compléter ce faciès très par-ticulier. Il s’agit de rachis bovins en connexionsanatomiques, ainsi de crânes et de mandibules dé-couverts sur des niveaux de sol. Ces éléments, lo-calisés en façade des bâtiments donnant sur laplace, pourraient permettre d`identifier des échop-pes de bouchers.
Sur l’oppidum, cette activité de grande ampleursemble aller de paire avec une forme d’urbanisa-tion nouvelle qui s’inspire largement du monde ro-main. Elle fait état d’une distribution, voire d’unmarché de la viande qui nécessite un apport d’ani-maux exogènes, ceux-ci pouvant être issus des fer-mes environnantes4.
Pour autant, cette zone de boucherie qui génèreune production massive de viande bovine – donton ne connaît à ce jour pas d’équivalent en Auver-gne – ne doit cependant pas masquer une autreréalité bien différente. La dernière campagne defouille, menée sur des quartiers d’habitations pluséloignés du sanctuaire, témoigne en effet d’uneprésence du porc nettement supérieure aux autresespèces. L’étude en cours rend déjà compte d’undéficit en restes bovins, à quelques centaines demètres seulement de la zone de boucherie décriteprécédemment.
On découvre, d’ores et déjà, un faciès deconsommation très proche de celui établis à Aulnatdans les secteurs de La Grande Borne et de la rueReclus, et sur les oppida de Gondole et de Gergovie.Cela permet d’entrevoir, sur l’ensemble de ces sites,une sectorisation qui se marque particulièrementdans la composition des rejets osseux animaux;ceux des bovins notamment.
Fig. 5. Oppidum de Corent, plan général des structures de la zone de boucherie et ses abords.
3 LEPETZ / MAGNAN 2008; BLIN / LEPETZ 2008.4 FOUCRAS 2010.
Sylvain Foucras206
De l’agglomération ouverte aux oppida:changement ou continuité ?
À l’habitat groupé d’Aulnat succèdent les oppidade Gondole, Gergovie et Corent. En dépit deschangements sociaux que ce déplacement du pou-voir central a pu engendrer, l’étude des restes ani-maux rejetés dans les structures domestiques deces occupations du Ier siècle av. notre ère, témoigned’un maintien des pratiques alimentaires des siè-cles précédents.
Le porc est l’animal de consommation par excel-lence et domine le spectre faunique à La GrandeBorne et Rue Reclus, conformément au modèle éta-bli sur les habitats groupés de Gaule septentrionaleà Variscourt, Acy-Romance ou Epiais-Rhus parexemple (Fig. 7). Bien que situé au pied de l’oppi-dum de Gondole, le quartier artisanal atteste unedistribution tout à fait similaire à celle des habitatsgroupés et à celui d’Aulnat particulièrement. Il yapparaît clairement une même distribution des es-pèces voire même des parties anatomiques repré-sentées, tout comme sur l’oppidum de Gergovie.
Au final, l’hégémonie du bœuf sur les oppida nese vérifie que sur celui de Corent et seulementdans la proximité immédiate du sanctuaire. Lesdernières investigations menées dans des zonesplus éloignées livrent, à ce stade de l’étude, un fa-
ciès qui rejoint celui des sites voisins, c'est-à-direune consommation préférentielle du porc puis descaprinés. C’est pour cela qu’une sectorisation del’habitat nous semble plus probable avec une zone
Fig. 6. Vestiges de boucherie de l’oppidum de Corent. Crâne de bœuf (à gauche), fosse détritique (à droite) et rachis debœufs (en bas).
Fig. 7. Distribution des sites d’après le nombre de restesde la triade domestique. La zone des habitats groupésest définie selon un panel de sites laténiens (Acy-Roman-ce, Feurs, Epiais-Rhus, Variscourt, Beauvais, Roanne et
Villeneuve Saint Germain).
Élevage et consommation en territoire arverne 207
de boucherie bovine, distincte des quartiers d’habi-tation alentours. Sa localisation à proximité dusanctuaire, et son ampleur, suggèrent une gestionde la viande à l’instar des pratiques gallo-romainesde vente des victimes sacrificielles (le bœuf notam-ment) sur les marchés publics, à la manière du ma-cellum romain.
Cette hypothèse rejoint celle émise pour l’habi-tat groupé d’Aulnat dans le secteur de Gandaillatoù l’on trouve, de la même manière, une forte re-présentation des bovins et une distribution desespèces très différente de celle perçue quelquescentaines de mètres plus loin, dans les secteursd’habitat de la Grande Borne ou de la rue Re-clus.
À ce stade de nos connaissances des faunes ar-vernes, il semble que le passage de l’habitat groupéd’Aulnat aux oppida ne traduise pas de réel change-ment dans la gestion des animaux et de leurconsommation. Il s’agit d’une gestion des viandesadaptée à une population importante. Le petit bé-tail – le porc et dans une moindre mesure les capri-nés – est favorisé dans le cadre d’une alimentationdomestique. Le bœuf, quant à lui, semble préféren-tiellement avoir fait l’objet d’un traitement centra-lisé. Il pourrait s’agir pour les élites d’exercer uncontrôle de l’abattage des animaux et de la distri-bution de la viande dans le cadre d’un commercesans doute régi par des contraintes religieuses,comme cela semble être le cas sur l’oppidum de Co-rent.
Références bibliographiques
AUXIETTE 1996G. AUXIETTE, La faune de l'oppidum de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) : quartiers résidentiels, quar-tiers artisanaux. Rev. Arch. Picardie 1996, 1–2, 1996,27–98.
BLIN / LEPETZ 2008O. BLIN / S. LEPETZ, Sacrifice et boucherie dans lesanctuaire de Jouars-Pontchartrain. In: S. Lepetz /W. van Andringa (dir.), Archéologie du sacrifice ani-mal en Gaule romaine. Rituels et pratiques alimentai-res (Montagnac 2008) 225–236.
DEBERGE et al. 2007aY. DEBERGE / J. COLLIS / J. DUNKLEY (dir.), Le Pâtural,Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme, un établissementagricole gaulois en Limagne d’Auvergne. Doc. Arch.Rhône-Alpes 30 (Lyon 2007).
DEBERGE et al. 2007bY. DEBERGE / C. VERMEULEN / J. COLLIS, Le complexe deGandaillat / La Grande Borne: un état de la question.In: C. Mennessier-Jouannet / Y. Deberge (ed.), L’ar-chéologie de l’âge du Fer en Auvergne. Actes duXXVIIe colloque international de l’Association Fran-çaise pour l’Étude de l’Âge du Fer, Clermont-Ferrand,
29 mai–1er juin 2003. Monogr. Arch. Méditerranéen-ne, Hors-série 2 (Lattes 2007) 267–290.
DEBERGE et al. 2009Y. DEBERGE / U. CABEZUELO / M. CABANIS / S. FOUCRAS /M. GARCIA / K. GRUEL / M. LOUGHTON / F. BLONDEL /P. CAILLAT, L’oppidum arverne de Gondole (Le Cen-dre, Puy-de-Dôme). Topographie de l’occupation pro-tohistorique et fouille du quartier artisanal: un pre-mier bilan. Rev. Arch. Centre France 48, 2009, 33–130.
FOUCRAS 2008S. FOUCRAS, La consommation carnée. In: Les Arver-nes, peuple celtique d’Auvergne. L’Archéologue, ar-chéologie nouvelle 95, avril-mai 2008, 54–55.
FOUCRAS 2010S. FOUCRAS, Animaux domestiques et faunes sauvagesen territoire arverne (Ve s. av. J.-C.–Ier s. ap. J.-C.). Thè-se de doctorat inédite (Dijon 2010).
LEPETZ / MAGNAN 2008S. LEPETZ / D. MAGNAN, Sanctuaire et activité de bou-cherie sur le site de la Bauve à Meaux. In: S. Lepetz /W. van Andringa (dir.), Archéologie du sacrifice ani-mal en Gaule romaine. Rituels et pratiques alimentai-res (Montagnac 2008) 225–236.
LEPETZ/OUESLATI 2003S. LEPETZ / T. QUESLATI, La consommation de viandedans les villes romaines d'Île-de-France au Ier siècle.Les cas de Maux et de Paris (Seine-et-Marne et Seine).Rev. Arch. Centre France 42, 2003, 41–59.
MÉNIEL 1988P. MÉNIEL, Les animaux dans l'alimentation des Gau-lois. L'animal dans l'alimentation humaine: les critèresde choix. Anthropozoologica 9, 1988, 115–122.
MÉNIEL 1998P. MÉNIEL, Le site protohistorique d'Acy-Romance(Ardennes) III. Les animaux et l'histoire d'un villagegaulois. Foullies 1989-1997. Mém. Soc. Arch. Champe-noise 14 (Reims 1998).
MÉNIEL 2007P. MÉNIEL, La boucherie et les sacrifices bovins enGaule aux IIe et Ier siècles avant notre ère. In: W. vanAndringa (ed.), Sacrifices, marché à la viande et prati-ques alimentaires dans les cités du monde romain.Food & History 5,1, 2007, 225–245.
METZLER et al. 2006J. METZLER / P. MENIEL / C. GAENG, Oppida et espacespublics. In: C. Haselgrove (dir.), Les mutations de la finde l'âge du Fer. Actes de la table ronde de Cambridge7-8 juillet 2005. Celtes et Gaulois, l'archéologie face àl'histoire. Bibracte 12,4 (Glux-en-Glenne 2006) 201–224.
POUX 2005M. POUX, Convergence et confrontation. Processusd’urbanisation et conquête romaine en territoire arver-ne. Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches(Aix-en-Provence 2005).
POUX et al. 2008M. POUX / M. DEMIERRE / R. GUICHON / A. PRANYIES,Corent, petite «Pompéi arverne». In: Les Arvernes:
Sylvain Foucras208
peuple celtique d’Auvergne. Numéro spécial. L’Ar-chéologue 95, 2008, 40–47.
RICHARDSON / FOUCRAS 2007J.-E. RICHARDSON / S. FOUCRAS, Les ossements animaux.In: Y. Deberge / J. Collis / J. Dunkley (dir.), Le Pâtural,un établissement agricole gaulois en Limagne d'Auver-gne. Doc. Arch. Rhône-Alpes 30, 2007, 229–244.
Résumé: Élevage et consommation enterritoire arverne. De l’agglomération
d’Aulnat aux oppida du bassin clermontois,changements ou continuité?
L’étude récente des restes animaux menée dans lebassin clermontois met en lumière divers aspectsde l’évolution des pratiques de l’élevage et de laconsommation durant la fin de l’âge du Fer et ledébut de l’époque romaine.
L’oppidum de Corent, durant la seconde moitiédu Ier siècle av. J.-C., témoigne d’un changementradical avec une prépondérance des restes bovinset la mise en place d’une importante zone de dé-coupe bouchère au cœur de l’habitat et aux abordsdu sanctuaire. Cette production de masse, qui neconnaît pas d’équivalents sur les sites environ-nants, implique un apport exogène d’animaux maisne doit cependant pas avoir valeur de modèle. Eneffet, l’oppidum voisin de Gondole rejoint le facièsd'Aulnat, un siècle et demi plus tard, dans le sec-teur de la zone artisanale.
Zusammenfassung: Tierhaltung und -konsumbei den Avernern. Von der offenen Siedlungvon Aulat zum Oppidum im Becken von
Clermont-Ferrand: Wandel oder Kontinuität?
Die jüngsten archäozoologischen Studien aus demBecken von Clermont-Ferrand geben Einblicke indie Entwicklung der Viehzucht sowie den Konsumam Ende der Eisenzeit und zu Beginn der römi-schen Epoche.
In der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.vollzieht sich auf dem Oppidum von Corent ein ra-dikaler Wandel hin zu einer stärkeren Nutzungvon Rindern. Die Fleischzerlegung spielte einewichtige Rolle, sie erfolgte in der Siedlungsmitteund in der Nähe des Heiligtums. Diese Massenpro-duktion, die in den umliegenden Siedlungen keineParallele hat, setzt zwar den Import von Tieren vo-raus, muss aber keinen Modellcharakter besitzen.Schließlich wächst das benachbarte Oppidum vonGondole etwa eineinhalb Jahrhunderte später mitdem Gebiet von Aulnat im Bereich des Handwer-kerviertels zusammen.
Sylvain FoucrasUMR 8546 [email protected]
Élevage et consommation en territoire arverne 209