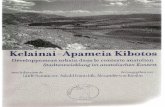"Compoix et aménagement du territoire en Languedoc (XVIe-XVIIIe siècles)"
Le trésor de Brionne (Eure). Une exportation ciblée de numéraire carnute en territoire éburovice
Transcript of Le trésor de Brionne (Eure). Une exportation ciblée de numéraire carnute en territoire éburovice
DE NUMMIS GALLICISMÉLANGES DE NUMISMATIQUE CELTIQUE
OFFERTS À LOUIS-POL DELESTRÉE
Textes réunis par
Pierre-Marie Guihard et Dominique Hollard
Société d'Études Numismatiques et Archéologiques (SÉNA)
Paris
2013
Auteurs
Philippe Abollivier. Chercheur associé au Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Université de Bre-tagne Occidentale, Brest (France). Yves-Marie Adrian. Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (France). Federico Barello. Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie,Torino (Italie).Claire Beurion. Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (France). Jean-Louis Brunaux. Directeur de recherche au CNRS, UMR 8546 – AOROC, École NormaleSupérieure, Paris (France).Jacopo Corsi. Università degli Studi di Torino (Italie).Xavier Delamarre. Chercheur indépendant, Vaucresson (France).Michel Feugè
Jean-Luc Genevrier. Membre correspondant de la Société française de Numismatique (France).Gisèle Gentric. Agrégée d'histoire (France).Daniel Gricourt. Centre d'étude et de publication des trouvailles monétaires, Bibliothèque nationale deFrance, Paris (France).Maria Filomena Guerra. Centre de Recherche et de Restauration des Musées deFrance – UMR 8220 (France).Pierre-Marie Guihard. Ingénieur d'études, responsable du service de numismatique, Centre Michel deBoüard-CRAHAM (UMR 6273), Université de Caen Basse-Normandie (France).Bénédicte Guillot. Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (France).Dominique Hollard. Chargé des fonds monétaires celtiques et romains, Cabinet des Médailles,Bibliothèque nationale de France, Paris (France).Bertrand Houdusse. Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (France).Patrice Lajoye. Secrétaire de rédaction, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie (France).Marie-Clotilde Lequoy. Conservateur en chef du patrimoine, DRAC de Haute-Normandie – servicerégional de l'archéologie (France).Dagmar Lukas. Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (France).Chrystel Maret. Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (France).Maxime Mégret-Merget. Numismate professionnel (France).Jens Christian Moesgaard. Conservateur au musée national, collection royale des monnaies et médailles(Danemark).Fabien Pilon. Chercheur associé UMR7041 – ArScAn (France).Jean-Claude Richard Ralite. Directeur de recherche (er) au CNRS, Centre Camille Jullian, MMSH,Université d'Aix-Marseille (France).Simone Scheers. Professeure (er), Université de Louvain (Belgique).John Sills. Celtic Coin Index, Institute of Archaeology, Oxford (Angleterre). Bernward Ziegaus. Archäologische Staatssammlung, München (Allemagne).
SOMMAIRE
Pierre-Marie Guihard et Dominique HollardL' uvre numismatique de Louis-Pol Delestrée............................................... p. i-iv
Pierre-Marie Guihard et Dominique HollardBibliographie de Louis-Pol Delestrée (1972-2011)........................................... p. v-xv
Philippe Abollivier et Maria Filomena GuerraCatalogue des monnaies gauloises des Osismes du Cabinet des Médaillesde la Bibliothèque nationale de France (Paris).................................................. p.
Jean-Louis BrunauxCe que la monnaie nous apprend de l’art gaulois.............................................. p. 17-30
Jacopo Corsi, Federico BarelloLe prime dracme d’imitazione massaliota : nuove osservazioni sucomposizione e rapporti con la dracma pesante di Marsiglia......................... p.
Xavier DelamarreÀ propos d'une nouvelle légende monétaire gauloise EPPANTIS et lethème verbal pant- "souffrir, endurer" en vieux-celtique................................ p.
Michel FeugèreOralité et autorité en Gaule préromaine d'après les monnaies gauloisesméridionales............................................................................................................ p.
Daniel Gricourt et Dominique HollardUn voyage entre deux mondes avec Épona. À propos d'un bronze gauloisinédit figurant la déesse équine............................................................................ p.
Pierre-Marie GuihardLe trésor de Brionne (Eure). Une exportation ciblée de numéraire carnuteen territoire éburovice........................................................................................... p.
Patrice LajoyeLa triple déesse guerrière celtique sur les monnaies des Lexovii et desVeliocassi. Un cas d'affirmation de souveraineté locale sous Auguste............ p.
Maxime Mégret-MergetUn plomb monétiforme de type élusate : une épreuve monétaire ?.............. p.
Jens-Christian MoesgaardPour un débat dépassionné sur le détecteur à métaux..................................... p.
Fabien PilonYves-Marie Adrian, Claire Beurion, Bénédicte Guillot, BertrandHoudusse, Chrystel Maret, Dagmar Lukas et Marie-ClotildeLequoy Analyses numismatique et contextuelle de monnaies gauloises décou-vertes en fouille en vallées de Basse Seine et d’Iton......................................... p.
Jean-Claude Richard Ralite, Gisèle Gentric et Jean-Luc GenevrierUn ensemble de statères et divisions celtiques découvert en paysGévaudan................................................................................................................ p.
Simone ScheersLa datation des bronzes à la légende SVTICOS/RATVMACOS d’aprèsles prototypes romains.......................................................................................... p.
John SillsReversal of fortune : eye staters of the Treveri and Remi................................... p.
Bernward ZiegausEin Probeabschlag aus dem Oppidum von Manching (Oberbayern)........... p.
Le trésor de Brionne (Eure).Une exportation ciblée de numéraire carnute en territoire éburovice1
(Planches 9-11)
Pierre-Marie Guihard
Dans le domaine de la numismatique gauloise, les dépôts monétaires représentent unesource d’informations souvent cruciale pour le classement de la matière. Depuis les travauxfondateurs de J.-B. Colbert de Beaulieu, plusieurs études ont montré en effet leur intérêt ence qui concerne les questions de chronologie relative ou de durée de circulation. Louis-PolDelestrée a pris précisément part à ce débat en publiant notamment pour les actes ducolloque de Niort le trésor d’Ouzilly2. Son analyse du dépôt a clairement montré que celui-cin’était pas le résultat d’une thésaurisation sur une longue période, mais le reflet d’unecirculation bimétallique chez les Pictons. Nous tenterons ici de faire encore un passupplémentaire dans l’étude des trésors monétaires gaulois en nous intéressant au modestetrésor de Brionne (Eure), et en particulier à ce qu’il apporte au débat sur la circulation dite« secondaire » en Comata.
1. Circonstances de la découverte
Le trésor a été mis au jour aux alentours de l’année 1837 sur le territoire de la communede Brionne (Eure), au lieu-dit « Le Vieux Donjon ». Malheureusement, peu d’informationsont transité jusqu’à nous. On ignore en particulier le nombre exact de monnaies quecontenait le trésor. Les différents auteurs qui ont rapporté cette découverte nous apprennentjuste qu’elle était composée de monnaies de bronze à la légende PIXTILOS ainsi que decentaines de monnaies de bronze à l’aigle des Carnutes et divers potins à l’aigle3. Malgrél’incertitude entourant la composition initiale du trésor, on admettra que le lot sur lequel sebase notre étude constitue un ensemble tout à fait représentatif, qui ne nuit ni à l’analyse, ni àla compréhension générale de cette découverte.
Au total, la suite ici étudiée se compose de soixante-quinze monnaies qui se situent dansune fourchette chronologique centrée sur la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C. Le Cabinetdes médailles de la Bibliothèque nationale de France conserve, sous les numéros 6108 à 6180,
1. Je remercie D. Hollard, chargé du médaillier celtique du Cabinet des médailles de la Bibliothèquenationale de France, de m'avoir permis d'étudier cet ensemble.
2. L.-P. DELESTRÉE, « Le trésor gaulois d’Ouzilly-Vignolles (Vienne) ». Dans : Numismatique et archéologie enPoitou-Charente, Actes du colloque de Niort (7-8 décembre 2007), Paris, 2009 (Recherches et travauxde la Société d’Etudes Numismatiques et Archéologiques, 2).
3. J. LELEWEL, Type gaulois ou celtique, Bruxelles, 1841, p. 355, n. 849 ; E. MURET, A. CHABOUILLET, Cataloguedes monnaies gauloises de la Bibliothèque nationale, Paris, 1889, p. 136 ; A. BLANCHET, Traité des monnaiesgauloises, Paris, 1905, p. 556, n° 72 ; L. COUTIL, Archéologie gauloise, gallo-romaine, franque et carolingienne,Département de l’Eure. II. Arrondissement de Bernay, Évreux, 1917, p. 171-174 ; X. LORIOT et S. SCHEERS,Corpus des trésors monétaires antiques de la France : Haute-Normandie, T. V, Paris, 1985, p. 76, n° 19.
- 67 -
l’échantillon le plus conséquent avec 73 exemplaires. Ces derniers y sont principalemententrés en 1862 (5 monnaies) avec la collection du duc de Luynes et en 1873 (53 monnaies)avec celle de Félicien de Saulcy, tandis que quinze exemplaires proviennent déjà du fondsancien du médaillier. Deux autres monnaies, appartenant à la série PIXTILOS, complètentl’inventaire. L’une a été signalée par La Saussaye en 18374 et l’autre figure dans le médaillierdu musée des Antiquités de Rouen (Seine-Maritime)5. Néanmoins, aucune certitude n’estacquise quant à leur appartenance au trésor. Dans le doute, nous les avons considérées.
2. Composition du trésor (Fig. 1)
Les soixante-quinze monnaies du trésor de Brionne consistent en émissions de bronze etde potin de la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C. Les espèces d’or, toujours susceptibles dese retrouver dans les dépôts contemporains6, ont été exclues de la thésaurisation. Laventilation par origines géographiques des émissions s’effectue de la manière suivante :
Bronze frappéGaule Celtique Centre
- « à l’aigle » des Carnutes- PIXTILOS
Gaule Belgique- « anépigraphe » des Bellovaques
403
1PotinGaule Celtique Centre
- « à l’aigle » des Carnutes- « à l’oiseau » de Loire Moyenne
256
TOTAL 75
Fig. 1 – Composition du trésor de Brionne (données actuelles)
D’un point de vue structurel, les caractéristiques du faciès d’ensemble se révèlent trèsclairement. Représentée à 99 %, la part des monnayages du Centre de la Gaule estparfaitement écrasante. Proportion d’autant plus atypique que les monnaies issues duterritoire des Aulerques Éburovices font totalement défauts7. À cet égard, les mentions de
4. L. LA SAUSSAYE, Revue numismatique, 1837, 88, pl. III. 5. S. SCHEERS, Les monnaies gauloises de Seine-Maritime, Rouen, 1978, p. 84, n° 327. 6. P.-M. GUIHARD, Monnaie et société chez les peuples gaulois de la basse vallée de la Seine. Recherches sur les usages
monétaires d’une région entre le début du IIIe et la fin du Ier siècle av. J.-C., Montagnac, 2012 , p. 307, trésor 24(Protohistoire européenne, 14).
7. Notamment les émissions au nom ethnique des Aulerques Éburovices et autres anthroponymes.Cf. L.-P. DELESTRÉE, M. TACHE, Nouvel Atlas des monnaies gauloises. II. de la Seine à la Loire moyenne, Saint-Germain-en-Laye, 2004, séries 417-451.
LE TRÉSOR DE BRIONNE (EURE)
- 68 -
bronzes à la légende PIXTILOS ne doivent pas faire illusion : bien que fréquentes dansl’actuelle Normandie (dans l’Eure), ces espèces circulent aux confins des territoires desCarnutes et des Aulerques Éburovices8. Les découvertes englobent préférentiellementles départements de l’Eure-et-Loir et du Loiret. Le trésor se présente donc comme unensemble quasi homogène de bronzes et de potins originaires du sud de la basse vallée de laSeine. L’arc chronologique apparaît très court, puisque aucune émission n’est antérieure aumilieu du Ier siècle av. J.-C.
De quels éléments disposons-nous pour déterminer la date d’enfouissement du dépôt ?En première expertise, il est possible d’affirmer qu’elle est nécessairement postérieure auxannées 50. Or, l’une des particularités du trésor est d’avoir contenu plusieurs monnaies à lalégende PIXTILOS. En reprenant, en 1979, l’étude de cette série, S. Scheers avait relevénombre d’affinités avec le monnayage romain, notamment avec des deniers consulaires. Pourl’éminente numismate, une telle dépendance serait la preuve que les monnaies ont étéfrappées « dans une période d’influence romaine croissante, où les deniers romains n’étaientplus une rareté9 ». En se fondant sur le témoignage des trésors, S. Scheers pensait devoirsituer l’afflux des deniers romains vers la Gaule entre les années 40 et 30 av. J.-C. De fait,l’auteur considérait que la frappe des bronzes à la légende PIXTILOS était intervenue aucours de la même période. La datation proposée par S. Scheers paraît cependant un peufragile. Je tendrais aujourd’hui à l’abaisser de quelques années (30-10 av. J.-C.). L’imagerie desdroits et revers semble, en effet, incompréhensible sans un rapprochement avec l’âgeaugustéen10.
Dans ces conditions, la clôture du trésor de Brionne interviendrait au cours du derniertiers du Ier siècle av. J.-C.
2.1. Gaule Celtique CentreDans l’ensemble des monnayages du Centre de la Gaule, les émissions issues du pays des
Carnutes l’emportent largement (87,8 %) et se répartissent à peu près équitablement entrebronzes frappés et potins.
Réunissant à eux seuls 56,6 % des monnaies du trésor, les bronzes frappés ne laissentplace à aucune série sous-dominante. Parmi les potins, les émissions des Carnutes dominenttoujours, dans des proportions toutefois tempérées par la présence de 15,3 % d’espèces dites« à l’oiseau » originaires de la Loire moyenne. Le faciès des émissions du Centre de la Gauletracé, il paraît nécessaire d’apporter quelques précisions sur les principales séries carnutesidentifiées.
Dans la masse des bronzes frappés, la série anépigraphe « à l’aigle » constitue
8. S. SCHEERS, « Un monnayage post-césarien des années 40-30 av. J.-C. : les monnaies à la légendePIXTILOS », Revue numismatique, 1979, p. 73-81 et figure 3, p. 82.
9. S. SCHEERS, op. cit., 1979, p. 67. 10. Voir mon point sur la question : P.-M. GUIHARD, « Pixtilos sous d’augustes augures : honneurs adressés
au princeps sur une émission gauloise ». Dans : Deuogdonion, Mélanges offerts en l’honneur du ProfesseurClaude Sterckx, Rennes, 2010, p. 305-319.
LE TRÉSOR DE BRIONNE (EURE)
- 69 -
la dominante exclusive. Sans entrer dans le détail d’une typologie élaborée, il suffit desouligner que les principales classes déjà répertoriées11 sont représentées, mais dans desproportions différentes. Les bronzes lourds et les petits bronzes « à la tête de Roma »représentent plus de 27 % des émissions des Carnutes. Ils sont suivis par une variété depetits bronzes qui se répartissent entre les émissions « à l’aigle et au pentagramme » (10 %) et« au profil géométrique » (62,5 %). Deux modules cohabitent donc, les petits bronzes étantplus nombreux que les grands bronzes. Nous noterons juste l’absence des bronzes « à l’aigleet au serpent » et « à l’aigle et à l’aiglon ». Parmi les potins, seule la série dite « à l’aigle » seretrouve. Les revers « à l’aigle de face » dominent sur ceux « à l’aigle à la queue d’aronde ». Ilsconstituent les deux classes habituellement signalées pour ce type12.
Sans surprise, la répétitive représentation d’un aigle sur les différents revers examinésreflète bien l’importance que tient l’accipitridé dans le monnayage des Carnutes13. Lecatalogue ci-dessous donne le récapitulatif des revers représentés (cf. n° 1-65).
Il convient enfin de faire une place à part à l’unique témoin de la série PIXTILOS présentdans le médaillier de la Bibliothèque nationale de France (enregistré sous le numéro 6171),qui est intéressant à plusieurs égards. Rappelons que les monnaies inventoriées constituantcette série s’inspirent ou reproduisent souvent des modèles issus d’espèces romaines.Onze classes ont été ainsi distinguées selon qu’elles présentent des affinités plus ou moinsprononcées avec des deniers consulaires14. Les poids moyens s’établissent généralement entre3 et 4 g. À l’intérieur des différentes classes identifiées, aucune monnaie divisionnaire n’estpour l’heure connue. L’exemplaire 73 du trésor retient ici l’attention. Pesant 1,54 g pour unmodule de 14 mm, il offre à l’avers un profil masculin à droite. La chevelure forme destorsades élaborées, qui tombent et s’enroulent sur la nuque. Au revers, on retrouve un aigle,orienté de trois quarts. À droite du rapace, en perspective, le fût d’une colonne surmontéed’un chapiteau est visible. Or, la composition, qui associe un aigle à un élément architectural,est proche de celle décrite pour la classe VIII de la série à la légende PIXTILOS : aigle auxailes déployées devant la façade d’un temple avec deux colonnes visibles aux deux angles.Ainsi, le faible poids de l’exemplaire 73 donne à penser qu’il est l’exacte réduction modulairedu bronze « au temple » considéré comme unité.
2.2. Gaule BelgiqueLe monnayage belge n’est représenté que par un seul bronze qui se range parmi les types
anépigraphes des Bellovaques15. À l’avers, il offre un profil diadémé à gauche, au menton
11. L.-P. DELESTRÉE, M. TACHE, op. cit., 2004, série 505B. Les auteurs ont identifiés six classes, où lesbronzes « lourds » côtoient les « petits » bronzes.
12. Ibid., série 544. 13. Ibid., séries 505 à 556.14. Dans son étude S. Scheers identifie dix classes. À cet inventaire, L.-P. Delestrée ajoute une classe
supplémentaire. Cf. S. SCHEERS, op. cit., 1979 ; L.-P. DELESTRÉE, M. TACHE, op. cit., 2004, série 454. 15. L.-P. DELESTRÉE, M. TACHE, Nouvel Atlas des monnaies gauloises. I. de la Seine au Rhin, Saint-Germain-en-
Laye, 2002, série 62, cl. II, n° 546.
LE TRÉSOR DE BRIONNE (EURE)
- 70 -
lourd. Les cheveux sont tressés et ramenés en chignon (?) sur le sommet du crâne. Au revers,un rapace aux ailes déployées est présenté de face. D’emblée, on remarquera que, par sonstyle, la figure est proche de celle empreinte sur les bronzes carnutes du trésor. La similitudeest étroite et pourrait faire sens pour expliquer la présence de cet unique bronze. Croyantavoir affaire à une monnaie des territoires carnutes, l’attention du thésaurisateur aurait pu eneffet être dupée par le type. Dans ces conditions, la présence d’une émission belge à Brionneserait parfaitement accidentelle.
2.3. Évolution stylistiqueLe caractère compact de l’ensemble des monnaies, entrevu au travers du thème central de
« l’aigle », est renforcé par l’homogénéité stylistique du lot. Parmi les bronzes frappés des Carnutes, quatre classes ont été identifiées, qui
correspondent précisément aux quatre premières phases de cette émission16. Le trésor deBrionne ne s’oppose pas à cette classification. Il vient au contraire la conforter. En effet, ilest possible d’observer une évolution stylistique caractérisée par une démarcation progressivepar rapport au type de la première classe. Ainsi, les profils s’épurent-ils jusqu’à sedécomposer. La structure des visages sur les bronzes 16 à 40 excelle à cet égard : le nez etl’arc sourcilier ne font qu’un et la joue devient un fragment de visage autonome. Pour leurpart, les flans des petits bronzes se rétrécissent et vont en s’amincissant. L’évolution observéesemble donc témoigner d’une continuité parfaite entre les classes I et IV. Une tellehomogénéité indique qu’au moins une partie significative du lot a échappé au brassageconsécutif à la mise en circulation des monnaies. Plus particulièrement, elle témoigne d’unapport groupé et ponctuel depuis la région d’émission. Il est même envisageable quecertaines monnaies aient été prélevées directement à la sortie de l’atelier. Les accidents defrappe relevés sur deux bronzes iraient en ce sens (les droits des n° 18 et 32 sont décentrés).
3. Exportation de numéraire vers le territoire des Aulerques Éburovices
Structurellement le trésor de Brionne se caractérise par la place importante qu’y occupentles séries de bronzes et de potins « à l’aigle ». À l’évidence, un tel rassemblement de monnaiesn’aurait rien d’étonnant s’il avait été mis au jour chez les Carnutes17. Découvert au cœur duterritoire des Aulerques Éburovices, il constitue à vrai dire une exception tout à faitsurprenante, qu’il faut tenter d’expliquer.
En se penchant sur la circulation monétaire de la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C.,J.-B. Colbert de Beaulieu avait conclu à un brassage soutenu de la masse monétaire.
16. L.-P. DELESTRÉE, M. TACHE, op. cit., 2004, série 505B.17. Un ensemble à la composition similaire a été ainsi signalé à Terminiers (Eure-et-Loir) : une centaine
de monnaies des Carnutes « à l’aigle ». Cf. A. FERDIÈRE, « Répertoire des cachettes monétaires d’Eure-et-Loir et des monnaies d’or gauloises, romaines et du haut moyen-âge isolées ». Dans : Monnaies ettrésors en pays Dunois, 1985-1986 (Société Dunoise. Archéologie, Histoire, Sciences et Arts ; 275-276),p. 19, n° 60.
LE TRÉSOR DE BRIONNE (EURE)
- 71 -
Ce phénomène se fonderait dans son expression sur la présence récurrente de monnaiesprovenant de régions situées en dehors du lieu où elles ont été découvertes. Pour lenumismate, elles formeraient le « tout-venant » d’une circulation qualifiées de « secondaire »,circulation qui se caractériserait notamment par la large dissémination de séries en bronze18.
La figure 2 pointe la fréquence des intrusions dans plusieurs collections (trouvaillesisolées) mises au jour dans l’actuelle Normandie19 afin de déterminer les particularités de lacirculation monétaire au lendemain de la conquête. L’analyse démontre de manièreparfaitement lisible la présence de monnaies intruses. Dans les divers lots retenus, celles-ci ysont constantes et donnent toujours lieu à des pourcentages non négligeables. Il existe aussiune semblable distribution dans les faciès monétaires du Nord-Ouest de la Gaule20.
Émissions locales-régionales(%)
Intruses(%)
Acquigny (Eure) 83 17
Berville-sur-Seine(Eure)
70 30
Cracouville-le-Vieil-Évreux (Eure)
77,5 22,5
Dampierre (Eure) 90 10
Évreux, LEP Hébert (Eure)
62,5 37,5
Évreux, rue Saint-Louis(Eure)
66,7 33,3
Saint-Aubin-Celloville(Seine-Maritime)
71,7 28,3
Fig. 2 – Part des émissions locales-régionales et des intruses (tous métaux confondus) dans les trouvaillesisolées de l’actuelle Normandie
La conclusion générale qu’on pourrait avancer de ces observations est que la compositionparticulière du trésor de Brionne relève largement d’un phénomène de circulation secondaire,tel que l’avait défini J.-B. Colbert de Beaulieu. On pourrait d’ailleurs y voir l’une desconséquences de la position géographique de Brionne.
Dans l’itinéraire dit « d’Antonin », Brionne est le site présumé d’une agglomération
18. J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Traité de numismatique celtique. I. Méthodologie des ensembles, Paris, 1973, p. 323.19. Pour la bibliographie correspondante, cf. P.-M. GUIHARD, op. cit., 2012.20. L.-P. DELESTRÉE, « La numismatique gauloise en Gaule Belgique. Problématique et axes de recherche »,
Revue archéologique de Picardie, 1994, p. 23 ; L.-P. DELESTRÉE, Monnayages et peuples gaulois du Nord-Ouest,Paris, 1996.
LE TRÉSOR DE BRIONNE (EURE)
- 72 -
secondaire, Breviodurum. Le document est daté de la fin du IIIe siècle. Dans la « Table dePeutinger », qui est une copie du XIIIe siècle d’une carte routière de l’Empire romain,Brionne est connue sous le nom de Brevoduno. Ces différentes sources, complétées parl’archéologie, nous renseignent également sur le réseau routier de l’époque (Fig. 3). VersBrionne convergeaient grandes routes et autres voies secondaires, faisant de l’agglomérationun nœud routier important. Celle-ci était située au point où la route Rouen-Lisieux traversaitla Risle. On mettra également en valeur sa liaison avec Évreux, qui était un carrefourimportant et notamment un point de départ vers Autricum (Chartres), chez les Carnutes.Ainsi, bien que situer à l’intérieur des terres, l’antique Breviodurum était en prise directe sur lemonde extérieur. Dès lors, la composition du trésor de Brionne, inhabituelle en territoireéburovice, peut-elle trouver un début d’explication à travers le réseau routier qui reliaitl’agglomération de Breviodurum à différentes parties du pays ?
Fig. 3 – Réseau routier de la basse vallée de la Seine à l’époque romaine
On objectera qu’il s’agit d’une situation tardive, le IIIe siècle apr. J.-C., et que rien nepermet de penser que la période qui nous intéresse et qui la précède (Ier siècle av. J.-C.)présentait déjà ces caractères. Qu’ils n’aient pas été semblables n’est pas niable. Une chosecependant est sûre : les enquêtes récentes insistent sur le fait que nombre de routes
LE TRÉSOR DE BRIONNE (EURE)
- 73 -
réutilisaient, en les réaménageant, des parcours d’origine préromaine21. L’archéologie a, deplus, révélé, rue Saint-Denis à Brionne, une occupation des lieux dès le dernier tiers duIer siècle av. J.-C.22 Or, à cette époque, dans les Trois Gaules, le système routier a ététransformé sous la direction d’Agrippa, nommé curator viarum (chargé des routes) parAuguste. Rien n’interdit dès lors de penser qu’au moment où fut enfoui le trésor de Brionne(30-10 av. J.-C.), l’agglomération était déjà un carrefour important et cosmopolite, par lequeltransitaient les hommes, les marchandises et le courrier. On peut alors admettre que c’estd’abord la position géographique de Brionne qui est à l’origine du contenu atypique du trésoret de son transport vers le territoire des Aulerques Éburovices.
Acquigny(Eure)
Berville-sur-Seine
(Eure)
Cracouville-le-Vieil-Évreux(Eure)
Dampierre(Eure)
Évreux,LEP
Hébert(Eure)
Évreux,rue Saint-
Louis(Eure)
Pacy-sur-Eure (Eure)
Saint-Aubin-
Celloville(Seine-
Maritime)
Br.PIXTILOS
2,1 %(3)
15,3 %(2)
3,8 %(6) (0)
12,5 %(3) (0) (0)
2,2 %(4)
Br.« à l’aigle » (0) (0)
1,9 %(3)
5 %(1)
12,5 %(3)
8,3 %(1) (0)
1,1 %(2)
Pot.« à l’aigle » (0) (0)
0,6 %(1) (0) (0) (0)
0,5 %(1) (0)
Fig. 4 – Représentation des bronzes à la légende PIXTILOS, « à l’aigle » et des potins « à l’aigle » dans lestrouvailles isolées de l’actuelle Normandie
Afin d’en apprendre plus sur ce transfert, il n’est pas inutile de procéder à une étudecomparative, permettant de savoir si le trésor de Brionne présente une quelconque unité decomposition avec d’autres trouvailles régionales. Huit ensembles monétaires ont été retenus.D’emblée, la figure 4 montre que les émissions « à l’aigle » et celles à la légende PIXTILOS,même si elles ne sont jamais très nombreuses, reviennent régulièrement dans les collectionsanalysées. La relation est intéressante, car elle ajoute beaucoup à l’hypothèse d’un transfert demonnaies vers le territoire des Aulerques Éburovices, et, d’une certaine façon, permet de
21. R. CHEVALLIER, Les voies romaines, Paris, 1997, p. 201 et suiv. 22. La fouille s’est organisée autour de trois sondages. Bizarrement, le sondage 2 a livré une monnaie à la
légende PIXTILOS (classe « à la louve »). Elle a été découverte dans un niveau de dépotoir (présencede nombreux restes de faune et de coquillage) se caractérisant par un intéressant lot de céramique(gallo- belge, sigillée de la Graufesenque, etc.) datable, selon les fouilleurs, du tout début du Ier siècleapr. J.-C. Cf. D. PITTE et alii, « Archéologie à Brionne. Sondage rue Saint-Denis, août 1988 »,Connaissance de l’Eure, 80, 1991, p. 23-27 ; D. CLIQUET, Carte archéologique de la Gaule (L’Eure, 27),Paris, 1993, notice 155 ; P.-M. GUIHARD, op. cit., 2012, p. 327-328.
LE TRÉSOR DE BRIONNE (EURE)
- 74 -
mieux insérer le trésor de Brionne dans la circulation monétaire régionale. L’homogénéitéstylistique de la série carnute permet d’aller plus loin dans l’analyse. Elle indique, on l’a vu,qu’une partie au moins significative du lot a échappé au fractionnement consécutif à unemise en circulation (Cf. 2.3.). En s’appuyant sur cette observation, il est dès lors possible deconsidérer le trésor comme le résultat d’une exportation ciblée, destinée à alimenterdirectement la circulation monétaire locale. On peut imaginer le scénario suivant : forméchez les Carnutes avant d’être exporté, le dépôt aurait été enfoui en territoire éburovice,après qu’une part des monnaies le composant eut été dispersée.
L’exemple du trésor de Brionne n’est pas un cas isolé. Le dépôt de Belleville-sur-Mer(Seine-Maritime) pourrait lui aussi relever d’un même phénomène de transfert23. Il secompose exclusivement de statères originaires du territoire des Coriosolites, qui ont laparticularité d’offrir une fréquence élevée de liaisons de coins. Là encore, il pourrait s’agird’un ensemble lié à une exportation massive et ciblée de numéraire.
** *
Au terme de son étude, le trésor de Brionne présente l’image d’une découverte atypiqueen territoire éburovice. Mais surtout il a permis d’amorcer une réflexion sur l’exportationmonétaire. Cette approche nous conduit à nuancer quelque peu la notion de « circulationsecondaire ». Dans le cadre d’une économie de plus en plus monétarisée, je ne nie pas eneffet qu’elle ait existé. Seulement, en la qualifiant de « tout-venant », J.-B. Colbert de Beaulieua contribué quelque peu à donner d’elle l’image ambiguë d’un conglomérat informe de petitesespèces, parfaitement mélangées au gré des échanges commerciaux. Le trésor de Brionneinvite, semble-t-il, à reprendre le dossier, en s’intéressant plus spécifiquement à la formationdu phénomène – notamment le rôle structurant de certains trésors dans le transfert d’unnuméraire – qu’à ses ultimes développements. Aussi suis-je d’avis que l’apport monétaire lié àla « circulation secondaire » n’a pas uniquement le caractère d’un brassage aléatoire, mais quecelui-ci a également pu être organisé et ciblé en amont.
23. S. SCHEERS, op. cit., 1978, p. 210, n° 18 et pl. XXIV et XXIVbis (photographie du trésor) ; X. LORIOT etS. SCHEERS, op. cit., 1985, p. 22, n° 10.
LE TRÉSOR DE BRIONNE (EURE)
- 75 -
Catalogue
(Planches 9-11)
Références bibliographiques utiliséesDT I = L.-P. DELESTRÉE et M. TACHE, Nouvel Atlas des monnaies gauloises. I. de la Seine au Rhin,Saint-Germain-en-Laye, 2002.DT II = L.-P. DELESTRÉE et M. TACHE, Nouvel Atlas des monnaies gauloises. II. de la Seine à la Loiremoyenne, Saint-Germain-en-Laye, 2004.LT = H. de LA TOUR, Atlas de monnaies gauloises, Paris 1892Scheers 1977 = S. SCHEERS, La Gaule belgique. Traité de numismatique celtique, Louvain, 1977.Rouen = S. SCHEERS, Les monnaies gauloises de Seine-Maritime, Rouen, 1978.Lyon = S. SCHEERS, Monnaies celtiques du musée des Beaux-Arts de Lyon, Louvain, 1996.
I. Monnayage attribué aux Carnutes
I.1. Bronzes lourds
Émission à la tête de Roma (Cl. I)
D/ Profil à gauche, au casque ailé.R/ Aigle de face, aux ailés éployées, à la tête tournée à gauche. À droite du cou, signe en forme decroissant.Réf. DT II 2574 ; LT 6140 ; Lyon 806.
1. 6,15 g ; 18 mm ; BnF 61372. 6,76 g ; 20 mm ; BnF 61383. 6,62 g ; 19 mm ; BnF 61394. 6,50 g ; 18 mm ; BnF 61405. 6,20 g ; 18 mm ; BnF 61416. 6,18 g ; 18 mm ; BnF 61427. 6,79 g ; 19 mm ; BnF 61438. 5,37 g ; 18 mm ; BnF 6144
I.2. Petits bronzes
Émission dérivée de la tête de Roma (Cl. II)
D/ Profil casqué à gauche aux traits stylisés. R/ Aigle de face, aux ailés éployées, à la tête tournée à gauche. Sous le bec, trois globules disposés entriangle. Sous l’aile droite, croix en X bouletée. Réf. DT II 2575 ; LT 6147 ; Lyon 807-809.
9. 3,32 g ; 15 mm ; BnF 614510. 3,95 g ; 16 mm ; BnF 6146
LE TRÉSOR DE BRIONNE (EURE)
- 76 -
11. 4,67 g ; 16 mm ; BnF 6147Émission à l’aigle et au pentagramme (Cl. III)
D/ Profil à droite, à la chevelure comportant deux rangées distinctes, l’une formée de demi-cerclescentrés d’un globule allongé, l’autre de triangles centrés.R/ Aigle à droite avec une aile éployée, à la queue d’aronde, tenant une proie dans ses serres. Sous le bec,croix bouletée cantonnée de quatre points. Derrière la tête, pentagramme. Réf. DT II 2577-2578 ; LT 6108 ; Lyon 770-771.
12. 3,18 g ; 16 mm ; BnF 610813. 3,17 g ; 16 mm ; BnF 610914. 3,19 g : 16 mm ; BnF 611015. 3,05 g ; 16 mm ; BnF 6111
Émission profil géométrique (Cl. IV)
D/ Profil stylisé à droite, l’œil et le front étant réduits à un triangle pointé. La chevelure est formée d’unerangée de demi-cercles. R/ Aigle debout aux ailes éployées, tenant une proie dans les serres et regardant à droite. Derrière la tête,une rouelle. Réf. DT II 2580 ; LT 6117 ; Lyon 768-769.
16. 2,62 g ; 14 mm ; BnF 611217. 2,34 g ; 14 mm ; BnF 611318. 2,87 g ; 16 mm ; BnF 611419. 2,93 g ; 15 mm ; BnF 611520. 2,66 g ; 15 mm ; BnF 611621. 2,53 g ; 16 mm ; BnF 611722. 2,89 g ; 15 mm ; BnF 611823. 2,93 g ; 16 mm ; BnF 611924. 3,01 g ; 15 mm ; BnF 612025. 1,86 g ; 16 mm ; BnF 612126. 2,52 g ; 16 mm ; BnF 612227. 2,94 g ; 17 mm ; BnF 612328. 2,67 g ; 14 mm ; BnF 612429. 2,61 g ; 15 mm ; BnF 612530. 2,96 g ; 14 mm ; BnF 612631. 2,97 g ; 16 mm ; BnF 612732. 2,42 g ; 16 mm ; BnF 612833. 2,42 g ; 16 mm ; BnF 612934. 2,34 g ; 16 mm ; BnF 613035. 2,78 g ; 15 mm ; BnF 613136. 2,67 g ; 16 mm ; BnF 613237. 3,20 g ; 14 mm ; BnF 613338. 2,86 g ; 16 mm ; BnF 613439. 2,36 g ; 15 mm ; BnF 613540. 3,89 g ; 16 mm ; BnF 6136
LE TRÉSOR DE BRIONNE (EURE)
- 77 -
I.3. Potins
Émission à l’aigle
Cl. I « à la queue d’aronde »D/ Profil à gauche, à la chevelure bouclée dans un cercle au trait plein. R/ Aigle de profil tourné à droite ou à gauche, à la queue d’aronde, une aile éployée, tenant un objet dansles serres. Réf. DT II 2617 ; Lyon 814-815.
41. 8,39 g ; 21 mm ; BnF 614842. 3,90 g ; 17 mm ; BnF 614943. 2,88 g ; 19 mm ; BnF 616044. 4,73 g ; 19 mm ; BnF 616145. 3,74 g ; 17 mm ; BnF 616246. - g ; - mm ; BnF 6163 (détruit)47. 2,97 g ; 19 mm ; BnF 616448. 3,28 g ; 18 mm ; BnF 616549. 3,01 g ; 18 mm ; BnF 616650. 5,07 g ; 18 mm ; BnF 616751. 5,72 g ; 20 mm ; BnF 616852. 3,70 g ; 20 mm ; BnF 616953. 3,17 g ; 19 mm ; BnF 617054. 3,87 g ; 16 mm ; BnF 6180
Cl. II « à l’aigle de face »D/ Profil à gauche, à la chevelure bouclée. R/ Aigle de face, debout sur une branche, aux deux ailes déployées. Réf. DT II 2618-2620 ; Rouen 332-333, 335 ; Lyon 810, 813.
55. 7,65 g ; 20 mm ; BnF 615056. 5,36 g ; 20 mm ; BnF 615157. 7,23 g ; 21 mm ; BnF 615258. 3,49 g ; 19 mm ; BnF 615359. 7,62 g ; 21 mm ; BnF 615460. 2,58 g ; 18 mm ; BnF 615661. 3,55 g ; 19 mm ; BnF 615762. 2,72 g ; 19 mm ; BnF 615863. 4,02 g ; 20 mm ; BnF 615964. - g ; - mm ; BnF 6172 (détruit)65. 3,06 g ; 17 mm ; BnF 6173
II. Monnayage de la Loire moyenne
Potin à l’oiseau
D/ Profil casqué à gauche. R/ Oiseau debout à gauche. Réf. DT II 2675 ; Rouen 424.
LE TRÉSOR DE BRIONNE (EURE)
- 78 -
66. 2,69 g ; 16 mm ; BnF 617467. 3,5 g ; 19 mm ; BnF 617568. 2,70 g ; 18 mm ; BnF 617669. 2,91 g ; 18 mm ; BnF 617770. 2,72 g ; 17 mm ; BnF 617871. 2,23 g ; 17 mm ; BnF 6179
III. Monnayage attribué aux Bellovaques
Bronze anépigraphe « à l’oiseau »
D/ Profil diadémé.R/ Aigle vu de face aux ailes déployées.Réf. DT I 546 ; Scheers 1977, série 178.
72. 3,33 g ; 16 mm ; BnF 6155
IV. Monnayage péri-aulerque
Bronze à la légende PIXTILOS
Cl. VIII « au temple » (petit bronze)D/ Profil masculin à droite, à la chevelure élaborée et enroulée sur la nuque.R/ Rapace orienté de trois quarts ; à sa droite, en perspective, le fût d’une colonne surmontée d’unchapiteau.Réf. -
73. 1,59 g ; 15 mm ; BnF 6171
Cl. VIII « au temple » (bronze lourd)D/ Profil masculin à droite, portant un diadème perlé dans la chevelure d’où pendent trois mèches ourubans sur la joue. Devant, légende PIXTILOS.R/ Aigle aux ailes éployées, debout sur un serpent. Derrière le rapace, façade d’un temple avec deuxcolonnes visibles aux deux angles.Réf. DT II 2472 ; LT 7100 ; Lyon 780/781.
74. - g ; - mm ; La Saussaye, Revue numismatique, 1837
Cl. X « au cheval et sanglier superposés » D/ Tête diadémée à droite. Devant, légende [PI]XTILOS.R/ Cheval libre au galop à droite ; au-dessus, volute ; au-dessous, sanglier. Réf. DT II 2474.
75. 4,07 g ; 17 mm ; Rouen 327
LE TRÉSOR DE BRIONNE (EURE)
- 79 -