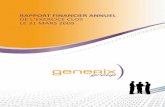Un atelier augustéen de taille de meules en pouding au "Clos des Forges" à Avrilly (Eure)
Transcript of Un atelier augustéen de taille de meules en pouding au "Clos des Forges" à Avrilly (Eure)
Gérard GuillierMiguel BiardAnne Françoise Cherel
Un atelier augustéen de taille de meules en poudingue au "Closdes Forges" à Avrilly (Eure) / An Augustean PuddingstoneQuern workshop at "Le Clos des Forges", Avrilly (Eure)In: Revue archéologique de l'ouest, tome 22, 2005. pp. 199-220.
AbstractIn advance of building development near the village of Avrilly, excavation revealed a farm site, defined by a modest trapezoidalenclosure with traces of two small buildings and some pits. Ceramics discovered can be attributed to the first half of the firstcentury BC. Excavation of a quem workshop, in a corner of the enclosure, enabled technological and typological analysis of theproducts. This activity postdates the filling of the enclosure ditch, in the second half of the first century BC. Finally, there are twophases of High Empire occupation with a field system replaced by the eastem part of a large yard, perhaps the end of a parsrustica.
RésuméL'aménagement d'un lotissement près du bourg d'Avrilly a occasionné la fouille d'un établissement agricole caractérisé par unenclos trapézoïdal de dimensions modestes. Seuls deux petits bâtiments et quelques fosses en constituent les structuresinternes. La céramique collectée est attribuée à la première moitié du Ier siècle av. J.-C. La fouille d'un atelier de taille de meuleslocalisé dans un angle de l'enclos a permis l'analyse technologique de la fabrication de cet outil efla définition de la production.Cette activité se développe après comblement du fossé d'enclos, durant la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C. Enfin, deuxphases se succèdent au Haut-Empire : un parcellaire est remplacé par la partie orientale d'une vaste cour, peut-être l'extrémitéd'une pars rustica.
Citer ce document / Cite this document :
Guillier Gérard, Biard Miguel, Cherel Anne Françoise. Un atelier augustéen de taille de meules en poudingue au "Clos desForges" à Avrilly (Eure) / An Augustean Puddingstone Quern workshop at "Le Clos des Forges", Avrilly (Eure). In: Revuearchéologique de l'ouest, tome 22, 2005. pp. 199-220.
doi : 10.3406/rao.2005.1123
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rao_0767-709X_2005_num_22_1_1123
Revue archéologique de l'Ouest, 22, 2005, p. 199-220.
Un atelier augustéen
de taille de meules en poudingue
au «Clos des Forges»
à Avrilly (Eure)
Gérard GUILLIER Miguel BIARD Anne-Françoise CHEREL
An Augustean Puddingstone Quern workshop at " Le Clos des Forges ", Avrilly (Eure)
Résumé : L'aménagement d'un lotissement près du bourg d'Avrilly a occasionné la fouille d'un établissement agricole caractérisé par un enclos trapézoïdal de dimensions modestes. Seuls deux petits bâtiments et quelques fosses en constituent les structures internes. La céramique collectée est attribuée à la première moitié du Ier siècle av. J.-C. La fouille d'un atelier de taille de meules localisé dans un angle de l'enclos a permis l'analyse technologique de la fabrication de cet outil efla définition de la production. Cette activité se développe après comblement du fossé d'enclos, durant la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C. Enfin, deux phases se succèdent au Haut-Empire : un parcellaire est remplacé par la partie orientale d'une vaste cour, peut-être l'extrémité d'une pars rustica.
Abstract: In advance of building development near the village of Avrilly, excavation revealed a farm site, defined by a modest trapézoïdal enclosure with traces of two small buildings and some pits. Ceramics discovered can be attributed to the first half of the first century BC. Excavation of a quem workshop, in a corner of the enclosure, enabled technological and typological analysis of the products. This activity postdates the filling of the enclosure ditch, in the second half of the first century BC. Finally, there are two phases of High Empire occupation with a field system replacée by the eastem part ofa large yard, perhaps the end ofa pars rustica.
Mots-clefs : Normandie, Eure, enclos trapézoïdal, atelier de fabrique de meules, poudingue, céramique, La Tène finale, Augustéen.
Key-words: Normandy, Eure, trapezoidal enclosure, quern workshop, puddingstone, ceramics, late La Tène, Augustean.
Introduction
Le site1 est localisé dans le département de l'Eure (fig. 1), à une dizaine de kilomètres au sud de Mediolanum Aulercorum (Évreux), chef- lieu de cité de la civitas des Aulerci Eburovices, dont les limites du département actuel de l'Eure reprennent globalement les grandes lignes géographiques (Cliquet, 1993, p. 44 et s.). L'occupation du "Clos des Forges" ne se situe pas dans un environnement naturel et humain favorable pour le premier et le début du second
Age du Fer, du moins sur les plateaux crayeux (Cliquet, 1993, p. 42 et s.), mais qui seront plus densément occupés à La Tène finale et à l'époque antique. Toutefois, quelques points d'occupation d'époque gauloise épars sur le plateau ont été mis en évidence par la prospection aérienne (Le Borgne et al.., 2002). Mais c'est surtout grâce au développement de l'archéologie de sauvetage que ce secteur a pu faire récemment l'objet d'une synthèse (Lepert et Paez-Rezende, 2002).
Le gisement est implanté sur le côté occidental du plateau de Saint-André-de-l'Eure, délimité
1 Le site du "Clos des Forges" à Avrilly (Eure) (n° 27 032 007 ; cadastre Section D, parcelle 115p), a été mis en évidence lors de prospections mécaniques systématiques, effectuées en 2001 par Florence Carré (Service régional de l'Archéologie de Haute-Normandie), motivées par le projet d'aménagement d'un lotissement. L'intervention sur le terrain s'est déroulée du 15 octobre au 10 novembre 2001 et a mobilisé quatre archéologues (Guillier, 2002). L'Institut national de Recherches archéologiques préventives (INRAP) a été chargé des opérations de fouille sous le contrôle et la direction du Service régional de l'Archéologie de Haute-Normandie.
Gérard GUILLIER, Miguel BIARD et Anne-Françoise CHÉREL
40 KM
Fig. 1 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : localisation du site. Fig. 1: Location ofthe site.
par l'Eure, l'Avre et l'Iton, qui se rattache géologiquement au Bassin parisien par la nature crayeuse de son substrat (Cliquet, 1993). Le versant occupé, orienté sud-ouest, présente une pente d'un peu moins de 1 % (fig. 2). Sur le substrat, les formations superficielles sont constituées d'argiles à silex solifluées, les rognons étant inclus dans une matrice argileuse rouge et compacte. Ces formations de surface sont issues de la décarbonatation de la craie et de l'accumulation sur place des silex et des argiles qui y étaient contenus2. Elles sont peu ou pas recouvertes par les dépôts éoliens. Ces limons sont plus marqués sur la pointe nord du plateau et immédiatement au sud d'Évreux.
L'occupation du "Clos des Forges" est caractérisée par un petit enclos trapézoïdal constitué de fossés rectilignes. L'intégralité de sa surface ainsi qu'une bande de terre de 5 à 1 0 m de large sur son pourtour ont été décapées sur une épaisseur d'environ 0,40 m. Les fossés de parcellaire qui se dirigeaient vers l'extérieur de cette zone ont été suivis mécaniquement (fig. 2). La conjonction des rares relations stratigraphiques, des éléments mobiliers et des
observations topographiques fait apparaître un développement de l'occupation selon trois phases principales.
- Dans un premier temps, l'enclos trapézoïdal s'installe sur un site vierge de toute occupation antérieure. Un fossé orienté nord-sud qui tangente la façade est de l'enclos s'installe dans un second état de cette occupation.
- Dans un deuxième temps, la fosse F24, isolée, vient recouper le fossé trapézoïdal dans son angle nord-est, tandis que dans un troisième et dernier temps, à l'époque antique, le site voit se développer - en au moins deux états - un réseau de fossés (fig. 2).
Après une brève présentation de l'enclos, cet article se consacrera à la description de la production de l'atelier de fabrication de meules en poudingue, dont la découverte dans la fosse F24 au nord-est de l'enclos constitue l'originalité de cette intervention. Si la fosse F24 et le mobilier qui y est contenu sont les objets principaux de cette publication, différents éléments que nous n'avons pas jugés en adéquation avec ce sujet, que sont l'enclos trapézoïdal et les différents fossés d'époque antique, font l'objet d'un développement annexe sur le CD-Rom encarté dans la revue.
L'enclos trapézoïdal d'époque gauloise, qui marque la première occupation du site, ne couvre qu'une surface de 2000 m2 environ. Sa façade longue de 54 m, ouverte vers l'est, est marquée par une large interruption dans le fossé, figurant l'entrée de l'enclos. L'étude détaillée de ses fossés marque clairement une adaptation à la topographie locale afin de gérer au mieux l'écoulement des eaux (cf. annexe). Sur son aire interne se dessinent deux bâtiments, dont l'habitation principale, de 29 m2. Les quelques tessons de céramique exhumés des fossés permettent d'envisager leur comblement vers le milieu du Ier s. av. J.-C. Mais il est manifeste que la création de cet habitat est antérieure d'au moins une ou deux générations à son abandon.
I - La fosse-atelier F 24 ; contexte et chronologie
La structure
Durant la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. la fosse F 24 vient recouper l'angle nord-est du fossé de l'enclos trapézoïdal (fig. 2 et 3). Son tracé reprend sensiblement celui de l'angle du fossé. Cette fosse, en forme de "L", mesure au total 7,40 m de long, pour une largeur variant de 1 à 1 ,75 m. Son extrémité ouest, arrondie, est la plus profonde avec 0,60 m (fig. 3), pour 0,20 m dans les
1 Carte géologique de la France à 1/50 000, St-André-de-l'Eure, XX-14, 180. Orléans : BRGM.
Un atelier augustéen de taille de meules en poudingue...
139000 —
AVRILLY (Eure) "Le Clos des Forges"
Fig. 2
Equidistance des courbes :0,25 m
J3UML
Fig. 2 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : implantation topographique (relevé B. Fabry). Fig. 2: Topographical situation.
F 24
A
D
E
1
2
/
— - F
B
C
A point de niveau
0 Coupes et plan 2m
1 : Matrice sableuse constituée de fins éclats de poudingue,
2 : Couche argilo-limoneuse brun clair contenant \ des déchets de taille (éclats de toutes
T , . , . . dimensions), Tracé du fossé de .. l'enclos trapézoMal 3 : c°"che argilo-limoneuse riche en charbon
de bois, de l'argile rubéfiée tapisse le fond.
Fig. 3 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : structure F 24, localisation, plan et coupes. Fig. 3: Location, plan and sections ofF 24 feature.
Gérard GUILLIER, Miguel BIARD et Anne-Françoise CHÉREL
autres secteurs. À l'ouest, la partie la plus profonde, en cuvette, est comblée d'un sédiment sableux, formé de fins éclats de poudingue (de moins de 2 mm), où abondent des déchets de taille et les fragments de meules (fig. 3, coupe A-B). La suite de la fosse, moins profonde, présente un remplissage constitué de limon argileux brun clair (fig. 3, coupe C-D) incluant également de nombreux déchets de taille. Vers le sud, ce sédiment inclut des fragments d'argile rubéfiée, des blocs de silex épars et du charbon de bois (fig. 3, coupe E-F).
Le comblement de cette fosse marque la présence de deux activités. Dans la partie ouest ce sont des éclats de taille du poudingue de toutes dimensions ainsi que du " sable " constitué de petits éclats résultant du bouchardage des meules. Dans la partie sud, des particules de fer oxydées ainsi que la couche d'argile rubéfiée évoquent un travail de forge, indissociable de celui de la pierre : une forge est nécessaire au travail de carrier (Bedon, 1981, p. 160- 161), et notamment pour l'entretien des outils (Cabezuello et al., 2000, p. 194). Leur usure est telle qu'ils "étaient affûtés au minimum deux fois par jour" (Amouric, 1991, p. 462). Lors de la taille d'une meule antique, dans une démarche expérimentale, le temps passé à la forge s'est révélé être de 1 6 % du travail mis en oeuvre (Boyer et Buchsenschutz, 1998). Dans le département de la Seine-Maritime, à Saint- Léonard, la découverte de ce qui pourrait être une cabane de carrier, avec foyer et outils, sur le bord d'une fosse d'extraction de meules, irait dans ce sens (Rogeret, 1997, n° 600).
Bien qu'aucun élément matériel ne permette de reconstituer l'élévation de l'atelier de taillerie, nous envisageons sa construction à l'aide de matériaux légers (branchages...).
Le mobilier céramique (A.-F. Chérel)
La fosse F 24 a livré 87 tessons de facture indigène et cinq fragments d'amphores. Le NMI correspond à six vases ; on possède six lèvres, dont trois appartenant à des vases de type Besançon, et trois fonds. L'essentiel du corpus est constitué de tessons érodés de couleur gris- foncé, qui comportent des éléments de quartz et de micas. Certains individus présentent des stries de tournage très rapprochées.
Les fragments de vases de type Besançon, dorés au micas, montés au colombin et probablement finis au tour lent pour le col, sont de facture grossière (fig. 4, n° 1 à 3). Ils trouvent des parallèles à Évreux (Eure) (Gerber, 1997, p. 42), dans des lots datés entre le dernier quart du Ier s. av. J.-C. et les premières décennies du Ier s. ap. J.-C. Localement, ces céramiques sont toujours associées à des productions augustéennes (information T. Lepert, SRA de Haute-Normandie). Au château d'Angers (Maine- et-Loire) (Bouvet et al., 2003), l'horizon 3, bien cerné chronologiquement, est daté entre 50/40 et 30 av. J.-C. Il voit notamment l'apparition de ce type de vase.
Les fragments d'amphores correspondent à une anse d'amphore vinaire italienne Dressel 1b (fig. 4, n° 4) (80/70 jusqu'à 30/20 av. J.-C), à trois éléments de panse d'Italie (gréco-italique ou Dressel 1 ), et à un fragment de panse de forme Dressel 7/11 de Bétique (type daté de la fin du Ier s. av. J.-C. jusqu'au Ier s. ap. J.-C).
La stratigraphie du site rend compte de la postériorité de la fosse F 24 par rapport à l'enclos. D'après la datation émise pour le comblement des fossés de ce dernier, et compte-tenu de la présence d'éléments d'importation bien datés
Fig. 4 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : mobilier céramique de la structure F 24. Fig. 4: Ceramics from F 24 feature.
Un atelier augustéen de taille de meules en poudingue.
au sein de la fosse comme des comparaisons régionales, on peut attribuer le lot à la période augustéenne.
Il - Les productions de meules de la fosse-atelier F 24
Nombreux sont les articles, notes et colloques qui traitent des meules rotatives, dont la typologie, la datation, le fonctionnement... ont déjà été étudiés en détail, souvent avec l'appui d'exemples ethnographiques. Nous nous sommes principalement référés à ces travaux3.
L'originalité de cette découverte pour la Normandie nous a conduit à faire appel à MM. Boyer et Buchsenschutz, que nous tenons particulièrement à remercier pour leur accueil et leurs conseils. Nous sommes également entrés en contact avec un lithicien, qui s'est chargé de l'étude technologique de la production de meules ; celle-ci sera exposée dans un premier paragraphe. Nous présenterons ensuite la production de cet atelier ; toutes les meules découvertes n'y seront pas figurées, nous ne montrerons qu'une sélection raisonnée. Un corpus détaillé est présenté dans l'annexe sur CD-Rom, en complément de la description de l'enclos trapézoïdal et des fossés antiques. Ce corpus détaille la nature du matériau de chaque meule ainsi que le motif de son abandon ; il est en outre agrémenté des dessins des meules non figurées ci-dessous.
Quarante et une meules ont été inventoriées après collage, elles portent les numéros 1 à 41, numéros qui seront toujours utilisés, dans le texte et les figures, que ce soit dans l'article principal ou dans son annexe.
Étude technologique de la production de meules en poudingue (M. Biard)
Les pièces lithiques recueillies proviennent de presque toutes les séquences opératoires, du bloc initial à la meule quasi finie. Cette étude met en évidence la chaîne opératoire et les procédés de façonnage des meules en poudingue. Cette découverte permet d'approcher, de façon inédite, l'aspect technologique de la fabrication de cet outil. Le matériau, de nature ingrate, ne facilite pas une lecture fine des stigmates de percussion, mais permet d'en aborder les modalités techniques.
Méthode et objectif
Nous utiliserons la terminologie employée en technologie lithique car elle nous semble la mieux appropriée ici, et éviterons l'invention de nouveaux termes. Dans un premier temps, nous avons essayé de caractériser chaque pièce afin d'en déterminer la place au sein des différents stades de fabrication. Cette étape a fourni des indices pour reconstituer cette chaîne. Nous décrirons d'un point de vue typologique les tris effectués (éclats de mise en forme et de préparation, réfection et rejets) et en présentons le déroulement.
L'origine géologique de la matière première
Les poudingues sont des conglomérats de galets généralement d'origine marine liés par un ciment souvent gréseux ou siliceux. Il s'agit ici de formations résiduelles qui se sont développées à partir des terrains tertiaires. Compte tenu du large décapage des sédiments de cette époque, ces poudingues sont généralement mêlés superficiellement aux argiles à silex. Cette matière première est par conséquent facilement accessible là où elle n'est pas occultée par les dépôts éoliens limoneux postérieurs. C'est très fréquemment le cas sur le plateau de Saint- André-de-l'Eure. La notice explicative de la carte géologique correspondante4 présente la "répartition des conglomérats à galets marins". Elle inclut la commune d'Avrilly et ses environs qui présentent la plus forte densité de gîtes au sein de la zone d'étude détaillée.
Les poudingues peuvent prendre la forme de blocs disséminés, affleurants, voire partiellement ou totalement dégagés par l'érosion ou dans des lits d'argile (Passy, 1874, p. 116 et s.). Ils peuvent être imposants, ce sont des dalles d'épaisseur métrique5 et ont souvent servi à ériger dolmens et menhirs. Ils ont aussi été déplacés par l'homme pour ne pas entraver les pratiques agricoles.
Leur fragmentation est souvent plus importante, offrant un module exploitable à l'unité pour la confection d'une meule. Dans ce cas ils sont souvent regroupés et mélangés à des sables, argileux ou non, dans des karsts, exploités depuis l'antiquité. De nombreuses extractions de sable de ce type, certes non datées, sont aujourd'hui fossilisées en zones forestières (forêts de Lyons, d'Eawy, de La Londe...). Les déblais d'exploitations sont souvent riches en poudingue. Des petites carrières à ciel ouvert de cette nature sont mentionnées dans les environs
3 Curwen, 1937 et 1941 ; Rémy-Watté, 1983; Mac Kie, 1986; Py, 1992; Pommepuy, 1995; Boyer et Buchsenschutz, 1998, 1999, 2000; Buchsenschutz et Pommepuy, 2002. 4 Carte géologique de la France à 1/50 000, St-André-de-l'Eure, XX-14, 180. Orléans : BRGM (notice, p. 27, fig. 4). 5Carte géologique de la France à 1/50 000, St-André-de-l'Eure, XX-14, 180. Orléans : BRGM.
Gérard GUILLIER, Miguel BIARD et Anne-Françoise CHÉREL
d'Avrilly par la carte géologique. Le poudingue utilisé pour la fabrication des meules pourrait donc provenir d'une recherche intentionnelle de matière première ou résulter d'une valorisation de sous-produits de l'extraction de sable pour les chantiers de constructions antiques.
La présence récurrente de cette matière première, aisément accessible et largement dispersée sur le territoire régional, explique sans doute en grande partie son utilisation dominante, au cours de la période gallo-romaine, pour la fabrication du matériel de mouture rotatif domestique. Le grès, autre ressource minérale locale, est très nettement délaissé alors qu'il représente l'essentiel des mortiers et des meules, non rotatives, pour l'ensemble de la Protohistoire (on ajoutera l'utilisation anecdotique de meules, hors molettes, en silex bouchardé pour lui conférer un pouvoir abrasif).
Une autre roche locale est exploitée pour la confection de meules rotatives au cours de l'Antiquité. Il s'agit d'un banc de craie silicifiée, proche d'une meulière, comportant de nombreuses et fortes vacuoles centimétriques à décimétriques. Ces meules sont plus imposantes que celles en poudingue. Elles atteignent ou dépassent largement le mètre de diamètre. Leur morphologie est également fort différente : de grands disques plats à bords droits de 1 5 à 30 cm d'épaisseur (Touffreville en forêt de Lyons : 1 exemplaire découvert dans un atelier de potiers du lllème s. ap. J.-C. ; Acquigny dans la vallée de l'Eure : 3 exemplaires découverts en fouille dans des contextes l-lllème s. ap. J.-C). Compte- tenu de la nature de la roche (particulièrement vacuolaire), de leur contexte et de leur gabarit, un emploi à des fins domestiques et de mouture céréalière serait probablement à exclure.
Des roches non sédimentaires sont aussi attestées dans l'Eure pour l'Antiquité. Citons une meule en granité dans un contexte La Tène D2 / Augustéen à Bernay et une deuxième du Haut- Empire à Brionne. Ou encore des exemplaires en roches volcaniques à Pitres, sur la vallée de la Seine, à Acquigny et sur la commune des Ventes sur un atelier de potiers antique, à proximité d'Avrilly.
Le poudingue : caractéristiques et contraintes
Ce matériau se caractérise par une agglomération de galets de silex ou de fragments anguleux de silex liés à une matrice généralement gréseuse. L'assemblage montre une variabilité de granulométrie dans les fragments et les galets de silex comme dans la matrice. Les galets sont parfois de grandes dimensions et varient en moyenne de 0,5 à 10 cm. Mais nous avons rencontré des blocs de silex de plus de 20 cm de long (meule n° 1).
La matrice présente aussi de grandes différences. Elle est parfois homogène à grains fins et d'autres fois grossière et hétérogène. Dans certains échantillons, de nombreux galets sont emprisonnés dans la matrice ou, au contraire, dans d'autres, la roche en possède peu et présente alors un faciès vacuolaire. Ce manque d'homogénéité influe directement sur la fracture conchoïdale. Plus les galets sont petits, associés à une matrice à grain fin et homogène, plus le matériau est apte à la taille. À l'inverse, pour un matériau grossier, le débitage reste difficile à gérer.
Présentation du matériel
La série comporte 314 pièces. Il s'agit de déchets de taille (273 pièces : tab. 1) ou de fragments de meules (41 pièces après collage). Parmi ces éléments, deux meules sont quasiment entières et nous donnent une idée de l'objectif final (cf. infra, fig. 9, n° 23 et fig. 11, n° 41).
1 ° Les éclats de mise en forme
Nous appelons éclats de mise en forme, les pièces présentant une plage de cortex ou de néocortex, les éclats sans préparation au détachement, ni bouchardage des arêtes. Ils constituent 31 % de l'assemblage. Ces éclats sont le résultat des premiers enlèvements effectués sur le bloc initial, permettant d'ébaucher la future meule. Un tiers des pièces, lorsque le matériau permet une lecture, présente des stigmates de percussion. Ces stigmates se caractérisent par la fissuration du talon, lorsqu'il est préservé, et par un léger réfléchissement en partie distale. Néanmoins, la détermination de la technique de percussion semble impossible (fig. 5, n° 1 et 2).
2° Les éclats préparés
Dans un deuxième temps ces pièces sont parfois prédéterminées. Elles se caractérisent par des préparations réalisées par bouchardage. Ce procédé consiste à régulariser une ou plusieurs arêtes, créant ainsi une convexité qui facilitera
Types Eclat de mise en forme Eclat préparé Eclat prédéterminé Eclat de réfection Débris divers Total
Nb 85 60 40 7 81 273
% 31 22
14,5 2?5 30 100
Tab. 1 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : Structure F 24, décompte des déchets de taille (Nb : nombre). Tab. 1: Reckonning of flaking refuse from Feature F 24 (Nb: number of pièces).
Un atelier augustéen de taille de meules en poudingue.
Fig. 5 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : 1 et 2, éclats de mise en forme ; 3 et 4, éclats préparés ; 5 et 6, éclats de préparation de la surface active ou éclats prédéterminés. Fig. 5: 1 &2, shaping flakes ; 3 &4, prepared flakes ; 5&6, préparation flakes ofthe working surface or predeterrnined flakes.
le détachement de l'éclat. La préparation au détachement est réalisée par l'enlèvement de deux éclats latéraux (fig. 5, n° 3 et 4 ; photo 1 ), dont le but est de créer un dôme qui établira l'emplacement d'un outil intermédiaire (burin). Ce dôme est parfois bouchardé afin de le consolider. En outre, la morphologie de l'éclat est gérée par le creusement partiel d'une gorge sur le contour de celui-ci. La gorge ainsi obtenue arrêtera l'onde de choc lors du débitage. Le décompte comprend 22 % de ces éclats dont la dimension varie entre 4 et 20 cm. Plusieurs pièces possèdent de vagues stigmates qui suggèrent une percussion directe (écrasement du talon et réfléchissement).
Photo 1 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : éclat préparé (cl. H. Paitier - INRAP). Photo 1: Prepared flake.
Gérard GUILLIER, Miguel BIARD et Anne-Françoise CHÉREL
3° Les éclats de préparation de la surface active
Ces éclats sont obtenus en dernier. Ils sont de dimensions variables. Il en existe des larges, de 20 cm de diamètre ou au contraire des petits, de 7 cm de diamètre. Ces éclats prédéterminés sont détachés du centre de la future surface active de la meule et parfois de son dos, les convexités sont préparées par écrasement des arêtes par bouchardage. De plus, l'éclat est détouré par le même procédé technique que les éclats préparés : un creusement total d'une gorge autour de l'éclat (photo 2). Le soin apporté à ces préparations détermine le bon déroulement du débitage de l'éclat. Les talons sont fréquents et préparés par deux éclats latéraux afin de dégager une zone proéminente. Le talon est bouchardé partiellement ou totalement (fig. 5, n° 5 et 6). Ces pièces techniques représentent 14,5 % de la série. Elles semblent participer presque exclusivement à la préparation de la surface active et permettent une économie d'un geste répétitif, le bouchardage.
Photo 2 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : stade 3, la meule n° 6 : creusement de la gorge autour de l'éclat prédéterminé (cl. H. Paitier - INRAP). Photo 2: Stage 3, quem n° 6, with gully around prédéterminée! flake.
4° Les éclats de réfection
La série compte 7 pièces provenant de la réfection de la surface active de meules. Ils se distinguent du reste des déchets par le bouchardage total de la face supérieure de l'éclat. La multiplication des chocs sur le bloc lors de son façonnage crée des micro-fissures ou «cheveux», parfois quasi-invisibles à l'œil nu mais qui peuvent céder, détériorant une partie de la meule. Ceci nécessite une remise en forme des surfaces.
5° Les débris
Ces pièces ne possèdent pas de stigmate de percussion, aucune partie bouchardée ou zone travaillée ne permettant de les placer dans la chaîne opératoire. Ces fragments ou cassons mesurent entre 2 cm et 5 cm.
Les techniques mises en oeuvre
1 ° Le "bouchardage"
Ce mot semble le plus approprié6 pour la technique de façonnage appliquée au conglomérat. Après la mise en forme du bloc, elle intervient dans chaque séquence opératoire. Elle permet de régulariser, de créer les convexités recherchées lors du façonnage. Elle offre également la possibilité de soigner les finitions des états de surface du dos de la meule comme de la surface active qui est ainsi rendue abrasive.
L'absence de bouchardé en matière minérale sur le site incite à croire que le bouchardage s'effectue avec un outil composé d'un autre matériau. Il pourrait éventuellement s'agir d'un percuteur en métal. Pour la finition des meules, et notamment de leurs surfaces de mouture, il est fait mention à l'époque médiévale et moderne de "marteau-taillant" (Cabezuello et al., 2000, p. 197). À Châbles-Les-Saux en Suisse, il a été déduit des traces laissées sur les ébauches que le tailleur avait recours à la percussion posée et employait un percuteur et une broche ou ciseau à pointe (Anderson et al., 1999).
2° La perforation
Lorsque le façonnage du dos et de la future surface active de la meule est terminé, une perforation est réalisée de part en part. Celle-ci présente des traces qui rappellent celles d'une percussion. En effet, il n'existe aucune trace de polissage et la technique du carottage est à exclure. La perforation centrale de la meule est initiée sur chacune de ses faces, les deux trous se rejoignant environ au centre. Cette technique possède des contraintes, en particulier la fissuration des pièces qui a été la cause de plusieurs fractures.
3° Abandons et accidents
Les accidents sont fréquents et semblent répétitifs à certains stades de la chaîne opératoire. Exception faite de l'enlèvement de
6 Ainsi que du point de vue du vocabulaire : il s'agit ici de rendre compte par le mot "bouchardage", du résultat d'une action, et non de l'action d'un outil spécifique, la bouchardé, qui n'apparaît qu'à l'époque médiévale.
Un atelier augustéen de taille de meules en poudingue.
l'éclat prédéterminé, le taux de fracture le plus élevé est celui lié à la perforation. En tout, 17 fragments de meules présentent des accidents qui paraissent causés par la perforation. Cette abondance confirmerait l'utilisation de la percussion. La deuxième cause de fracture apparaît lors du bouchardage et se traduit par 11 cas recensés. Enfin, six autres fragments de meules ont cassé sans que nous puissions l'expliquer de façon totalement satisfaisante. Néanmoins, nous sommes à nouveau tentés d'incriminer la percussion, qui fragilise la matière première.
4° Les modalités techniques
Aucun élément ne permet d'identifier le ou les types d'outils utilisés. Toutefois, certains indices ont démontré l'utilisation d'une percussion indirecte. La première information qui confirme ce fait est la technique de débitage du dernier éclat de la surface active. En effet, il n'existe aucun angle adéquat au détachement de ces éclats par percussion directe. Seule l'intervention d'une pièce intermédiaire (type burin métallique) autorise son extraction.
Certains éclats préparés présentent sur leur face supérieure des régularisations des convexités. Elles sont obtenues d'une part grâce au bouchardage et d'autre part grâce au détachement d'éclat à partir d'une nervure guide. Encore une fois, l'angle de la nervure permet de détacher un éclat avec une percussion indirecte pour un résultat garanti.
Conclusions techniques
L'étude technologique permet de mettre en évidence cinq principaux stades théoriques de fabrication (fig. 6) qui, parfois dans la pratique, peuvent se chevaucher. Il s'agit de :
1 - La mise en forme du bloc par l'extraction d'éclats non préparés,
2 - L'ébauchage de la meule par éclats préparés,
3 - La préparation de la surface active par bouchardage et enlèvement de l'éclat préférentiel,
4 - La finition du dos et de la surface active par bouchardage,
5 - La perforation par percussion.
De plus, il faut souligner l'utilisation d'un procédé technique original, adapté au matériau. Il s'agit de dégager un dôme par l'enlèvement de deux éclats latéraux et par bouchardage, facilitant le calage de l'outil intermédiaire ou burin, entre le percuteur et la meule. Ce procédé a été reconnu sur les éclats préparés et sur les éclats de préparation de la surface active. Le creusement
d'une gorge autour de l'éclat a pour conséquence de prédéterminer sa forme. Ce procédé semble réservé aux éclats de préparation de surface active. La technique de débitage utilisé semble être la percussion indirecte à l'aide d'un outil intermédiaire en métal.
Cette étude nous conduit à poser plusieurs questions : lors de son acquisition, sous quelle forme se présente la matière première ? La contrainte pondérale des blocs nécessité-telle une mise en œuvre collective ? Existe-t-il des exemples comparables d'un point de vue ethnographique ? Les modes de fabrication des meules d'Avrilly relèvent d'un savoir-faire élevé qui ne peut pas être le résultat d'un artisanat ponctuel. Il est probable qu'il soit réservé à des spécialistes et constitue un métier à part entière, saisonnier ou non.
Description des éléments de la production
Les 41 restes de meules appartiennent à deux grandes catégories : les ébauches de stade 3 (la préparation de l'éclat prédéterminé, cf. supra) et les restes des stades 4 et 5. Nous avons regroupé ces deux derniers puisque nous y décelons l'objet-meule dans sa finalité : une meta (meule dormante) ou un catillus (meule tournante).
Les observations effectuées avec M. Boyer nous ont conduit à nous interroger sur la distinction meta I catillus. Nous avons donc séparé, par une première approche à l'œil, les metae des catilli, en fonction de leur forme et de leur épaisseur. Puis nous avons tenté un traitement graphique des données afin de les distinguer d'un point de vue morphométrique : la fig. 7 détaille leur rapport diamètre / épaisseur. Elle indique que le diamètre des meules, dans un échantillon chronologiquement homogène, n'est pas un facteur discriminant, fait observé par ailleurs (Buchsenschutz et Pommepuy, 2002), au contraire de l'épaisseur qui permet une sériation réelle des objets.
Le Stade 3 : la préparation et l'enlèvement de l'éclat prédéterminé
Sept restes correspondent à ce stade de la production (les pièces n° 1 à 7).
La meule n° 1 (fig. 8 ; photo 3), un bloc en partie cortical, a reçu sur sa partie supérieure une mise en forme générale. Seule une plage de cette pièce a été épannelée puis bouchardée et la gorge périphérique, devant ceindre le futur éclat prédéterminé, a commencé à être creusée. L'examen de la série montre que la détermination d'une préforme se fait au fur et à mesure de l'avancement et plusieurs opérations, l'épannelage, le bouchardage d'une surface plane
Gérard GUILLIER, Miguel BIARD et Anne-Françoise CHÉREL
1 mise en forme 3 préparation de
2 préforme l'éclat prédéterminé 4 finition S perforation
Stade opératoire 1 mise en forme
2 préforme
3 préparation de l'éclat prédéterminé
4 finition 5 perforation
Produit obtenu éclats avec plage corticale
éclats sans préparation éclat préparé
éclat prédéterminé débris (cm et mm)
indéterminé
Procédé technique aucun
bouchardage des arrêtes et du talon creusement partiel d'une gorge
préparation du talon par l'enlèvement de 2 éclats latéraux bouchardage des arrêtes et du talon
creusement d'une gorge sur toute la périphérie préparation du talon par l'enlèvement de 2 éclats latéraux
bouchardage bouchardage et abrasion grossière
Mode de percussion directe et indirecte
indirecte
indirecte directe
directe pour l'initiation indirecte
Fig. 6 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : Structure F 24, présentation schématique de la chaîne opératoire de fabrication des meules. Fig. 6: F 24 feature, simplifiée! operating process forquerns fabrication.
diamètre
500 t mm
400 -
300 -
200 -
100 -
AVRILLY (Eure) Le Clos des Forges"
Meta Catilli Catilli "ruche- ébauches
épaisseur i
100 l
150 i
200 250
•
LEGENDE Ebauche stade 3 ■ Meta Catilli O Catilli ébauche ▲
D Meta ébauche Catilli "ruche" A Catilli "ruche" ébauche
1 300 mm
Fig. 7 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : diagramme de répartition des meules (hauteur/ diamètre). Fig. 7: Distribution graph (heigh I diameter) ofthe querns.
et le creusement d'une gorge se font par zones, plus ou moins étendues et successivement tout autour du futur éclat prédéterminé. Celui-ci est nettement individualisé et mis en évidence par une surface bouchardée relativement plane ainsi que par une gorge périphérique pratiquement
continue ; il est visible sur les meules n° 2 à 7 (fig. 8 ; photos 4 et 5).
Le tableau 2 détaille la hauteur et le diamètre des ébauches. Nous observons une homogénéité de leurs dimensions, confirmée par l'observation de la figure 7. Sauf pour le n° 5, c'est une tentative
Un atelier augustéen de taille de meules en poudingue...
gorge périphérique EBAUCHES STADE 3
rge périphérique
Eclat prédéterminé \^ /
prédéterminés périphériqu
prédéterminé \ -J. / 9or9e périphérique
N°7
20 cm
B : surface boucha rdée E : surface épannelée C : cortex-néo-cortex
marque la séparation r~ entre deux états de surface
Fig. 8 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : ébauches de stade 3 (n° 1 à 7). Fig. 8: Stage 3 rough-outs (n° 1 - 7).
Gérard GUILLIER, Miguel BIARD et Anne-Françoise CHÉREL
Photo 3 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : stade 3, la meule n° 1 (cl. H. Paitier-INRAP). Photo 3: Stage 3, quem n" 1.
Photo 4 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : stade 3, la meule n° 3 vue de dessus (cl. H. Paitier - INRAP). Photo 4: Stage 3, quem n° 3 seen from above.
Photo 5 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : stade 3, la meule n° 3 vue de profil (cl. H. Paitier - INRAP). Photo 5: Stage 3, quem n° 3 seen in profile.
N° 2 3 4 5 6 7
Hauteur 260 250 230 250 260 200
Diamètre 400 400 405 440 360 410
d'enlèvement de l'éclat prédéterminé qui a présidé à leur bris. Les cassures sont toutes du même type : l'impact devant ôter l'éclat prédéterminé a dû être plus ou moins bien contrôlé et dirigé trop vers le bas ; c'est une partie de la future meule qui a cassé, rendant impossible la suite des opérations de taille.
Les éléments du moulin rotatif
Les metae
Les metae supposées sont au nombre de 16, dont 3 ébauches. Ces dernières (n° 8 à 1 0 : fig. 9) présentent des faces supérieures totalement bouchardées et relèvent de trois étapes. La meule n° 8 (photo 6) est caractérisée par une gorge périphérique sur son dos. La meule n° 9 offre un dos en cours d'epannelage et de bouchardage et, contrairement à la meule précédente, nous y relevons une importante plage corticale supposant un bloc initial de faible épaisseur par rapport au produit fini désiré. La meule n° 10, latéralement épannelée, montre un dos débité à partir d'un bloc plus épais, sans préparation visible. Ces trois blocs ont donné naissance à des ébauches présentant des caractéristiques telles que les opérations effectuées sur l'un d'entre eux ne sont pas transposables sur les autres. Il s'agit d'une gestion opportuniste de la matière première et de la chaîne opératoire. L'élaboration de la future surface active précède celle du dos, qui constitue l'essentiel du stade 4.
Les éléments sans perforation visible (n° 11 : fig. 9 ; n° 12 : annexe, fig. 10) offrent de futures surfaces actives et des dos bouchardés. Cependant, le fait que ces meules soient incomplètes ne permet pas de savoir si elles étaient en cours de perforation.
Lorsque les meules présentent une perforation visible (n° 1 3 et 1 4 : annexe, fig. 1 0 ; n° 1 5 : fig. 9 ; n° 16 et 17 : annexe, fig. 10), celle-ci occupe la
Tab. 2 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : F 24, dimensions des ébauches (en mm). Tab. 2: Dimensions (in mm) ofrough-outs from F 24.
Photo 6 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : l'ébauche de meta, la meule n° 8 (cl. H. Paitier - INRAP). Photo 6: A Meta rough-out : quem n"8.
Un atelier augustéen de taille de meules en poudingue...
METAE Ebauches
N°8
probable négatif de l'enlèvement préférentiel
sr
B : surface bouchardée E : surface épannelée C : cortex-néo-cortex
marque la séparation Y* entre deux états de surface
METAE
N°15
P : perforation
N°23
2â\
Fig. 9 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : les ébauches de mefae (n° 8 à 10) et les metee (n°11 , 15, 18, 22, 23). Fig. 9: Metae rough-outs (n° 8 to 10) and metae (n° 11, 15, 18, 22, 23).
face supérieure de la meta dans quatre cas sur cinq. La seule perforation inférieure (n° 13) ne semble pas devoir être prise en compte puisque la partie supérieure est manquante. Les dos présentent un bouchardage achevé (n° 13, 14 et 17). La présence, sur le dos de deux meules, d'une surface localement épannelée (n° 15) ou présentant une irrégularité due à la matière (ici du grès en plaquettes : n° 16) n'a pas empêché l'amorçage d'une perforation sur la face
supérieure : la finition du dos était suffisante et ne nécessitait pas de bouchardage complémentaire. Pour ces meules, c'est la perforation, et moins probablement le bouchardage, qui a dû causer leur bris.
Les éléments présentant deux perforations distinctes visibles (n° 18 et 22 : fig. 9 ; n° 19, 20 et 21 : annexe, fig. 10), offrent de futures surfaces actives et des dos totalement bouchardés. Sur ces exemples, c'est lorsque le travail de
Gérard GUILLIER, Miguel BIARD et Anne-Françoise CHÉREL
212.
perforation est fait à 60/80 %, que la meule se brise. La seule meta montrant une perforation traversante (n° 23 : fig. 9 ; photo 7) figure le produit le plus abouti de la série. La future surface active et le dos sont complètement bouchardés, la perforation a été initiée à partir de chacune des deux faces.
Photo 7 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : la meule n° 23 (cl. H. Paitier - INRAP). Photo 7: Quern n" 23.
Les catilli
Morphologiquement deux type de catilli ont été déterminés : ce sont les catilli "bas" et ceux qui se rapprochent des catilli "en ruche", caractérisés par leur forte épaisseur.
1° Les catilli "bas"
Ils sont au nombre de neuf, dont une ébauche. Celle-ci (n° 24 : fig. 10 ; photo 8) est intacte. La future surface active est bouchardée et ses flancs sont en cours d'épannelage, le dos est recouvert d'une plage corticale. Cet élément caractérise la première étape du stade opératoire 4, l'ébauche et le dégrossissage du dos.
Les éléments en cours de finition (n° 25 et 26: fig. 10) présentent un profil plus évolué. Les futures surfaces actives sont entièrement bouchardées, les dos présentent des plages
Photo 8 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : une ébauche de catillus, la meule n" 24 vue de profil (cl. H. Paitier - INRAP). Photo 8: A catillus rough-out: n° 24 seen in perfile.
corticales ponctuelles (n° 25) ou rétrécies (n° 26), il en est de même pour les surfaces épannelées. La meule n° 26 marque l'étape de finition la plus aboutie. Le bouchardage s'effectue en remontant de la zone proche de la future surface active vers la partie supérieure du dos.
Les meules sans perforation visible (n° 27 et 28 : annexe, fig. 11 ; n° 29 : fig. 10), ont de futures surfaces actives et des dos entièrement bouchardés. C'est lors du bouchardage de finition qu'elles se sont brisées. Elles appartiennent à la dernière étape, la finition du dos (stade opératoire 4).
Les meules présentant deux perforations distinctes (n° 30 et 31 : annexe, fig. 11 ; et n° 32 : fig. 10), comme pour les metae, montrent une future surface active et des dos totalement bouchardés. C'est lorsque le travail de perforation est pratiquement achevé que la meule se brise (n° 30 : annexe, fig. 11).
2° Les catilli "en ruche"
Ils sont représentés par neuf éléments dont une ébauche et une meule montrant une perforation traversante ainsi qu'une perforation latérale.
L'ébauche (n° 33: fig. 11), qui révèle une future surface active totalement bouchardée, est caractérisée par une gorge périphérique en cours de creusement sur son dos. Cette gorge, qui rappelle celle de la meta n° 8 (fig. 9), relève du même but, ôter une importante masse de matière. Cette dernière, même une fois ôtée, il semble que la meule finie soit un catilli "en ruche". Le bloc à ôter est épannelé. Nous observons que la partie située entre la future surface active et la gorge périphérique est totalement bouchardée, l'avancement du travail de bouchardage se faisant parallèlement de celui du creusement de la gorge périphérique. Il s'agit d'un travail de préparation du dos, la première étape, précédant celle qui consiste en un bouchardage complet de ce dos.
En cours de finition, le n° 34 (annexe, fig. 11) a une future surface active bouchardée, tandis qu'après épanneiage, son dos fait l'objet d'un début de bouchardage couvrant la surface entière, contrairement aux éléments en cours de finition précédemment décrits (meules 9, 25 et 26). Sans perforation visible, le n° 35 (annexe, fig. 11) ne montre pas une surface telle que nous soyons sûrs qu'il n'a jamais présenté de perforation.
Avec une perforation visible, le n° 36 (fig. 1 1 ) est une importante pièce totalement bouchardée. Le sommet du dos montre une cuvette peu profonde matérialisant l'initiation de la perforation, faite par bouchardage. Un gros bloc de silex (250 x 100 mm) observé dans la cassure, matérialisant un point de faiblesse dans la matière, est probablement la cause de son bris.
Un atelier augustéen de taille de meules en poudingue.
CATILLI
L'ébauche
N°24
20 cm
\ en léger creux négatif \ de l'enlèvement préférentiel
B : surface bouchardée C : cortex / néo-cortex E : surface épannelée P : perforation
marque la séparation r~ entre deux états de surface
N°25 N°29
Surface active * bouchardage fin
N°32
Fig. 10 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : catilli n° 24, 25, 26, 29 et 32. Fig. 10: Catilli n° 24 - 26, 29, 32.
Caractérisés par deux perforations distinctes les n° 37 (fig. 11 ; photo 9) et 38 à 40 (annexe, fig. 11) ont une future surface active et des dos bouchardés. Nous remarquons encore que c'est lorsque le travail de perforation est pratiquement achevé que le bris de la meule se produit.
Le catillus n° 41, au profil asymétrique, est traversé par une perforation axiale et montre en outre une perforation latérale (fig. 11); il offre le degré de finition le plus abouti de la série. Le profil de la perforation axiale indique qu'elle a été initiée à partir de chacune des deux faces et que les deux avants-trous se sont rencontrés au milieu de l'épaisseur de la meule. C'est probablement le creusement de la perforation latérale qui a causé le bris de cette pièce.
Photo 9 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : la meule n° 37 (cl. H. Paitier - INRAP). Photo 9: Quern n° 37.
Gérard GUILLIER, Miguel BIARD et Anne- Françoise CHÉREL
Ziê
CATILLI "EN RUCHE"
L'ébauche E gorge périphérique
N°37 perforation latérale
N°41 B : surface bouchardée E : surface épannelée P : perforation
marque la séparation ~ entre deux états de surface
N°36 20 cm
Fig. 11 : Avrilly (Eure), «Le Clos des Forges» : les catilli «en ruche» : n° 33, 36, 37 et 41. Fig. 11: Beehive-shaped catilli n° 33, 36, 37 & 41.
Vers une définition de la production
Cette définition, fondée sur les restes de l'atelier, nous conduit à classer les meules en fonction de leur stade de fabrication, essentiellement le stade 3, et dans un second temps, en fonction de l'objet "fini" (meta I catillus) lorsqu'il est identifiable. Ce classement est validé graphiquement (fig. 7).
Le Stade 3
II concerne la préparation et l'enlèvement de l'éclat prédéterminé. Les sept pièces découvertes (17 % du corpus), constituent un ensemble homogène par leurs formes et leurs dimensions. Le tailleur devait même se faire une idée du futur objet, une meta (n° 1, 2 (?), 4 (?) et 7) ou un catillus (n° 3 (?) ; 5 (?) et 6), et ce dès le premier stade d'élaboration de la meule, sinon lors du choix des blocs.
Nous ne sommes en mesure de présenter régionalement qu'un seul élément de comparaison, mis au jour sur le tracé de l'A 28
à Bourg-Achard, dans le nord de l'Eure, par Eric Mare (fig. 12, n° 1). Réalisée en poudingue, cette ébauche est identique à celles d'Avrilly (cf. fig. 8). Son bris est dû à un mauvais positionnement de la pièce intermédiaire lors de l'enlèvement de l'éclat prédéterminé. Géologiquement il semble que cette pièce provienne de la forêt de La Londe, toute proche et où ont déjà été signalées des fosses d'extraction pour la fabrication de meules (Rémy-Watté, 1983, p. 40). L'identité de forme entre cette ébauche et celles d'Avrilly laisse supposer une même chaîne opératoire sur les sites de taille de meules en poudingue régionaux.
D'autres ateliers présentent des différences notables dans le traitement de la matière première ; ce sont par exemple les sites bavarois (Waldhauser, 1981), de la région Auvergne (Cabezuello ef al., 2000) ou encore de Suisse (Anderson et al., 2001) (nous ne mentionnons pas les sites traitant d'une matière première spécifique : le basalte ou l'andésite).
Un atelier augustéen de taille de meules en poudingue.
gorge périphérique
Honguemare (Eure) 20 cm
Fig. 1 2 : Quelques meules en poudingue du département de l'Eure (n° 1 à 6) (ME : Musées d'Evreux) et quelques meules d'un atelier du Hertfordshire en Grande-Bretagne (n° 7 à 9). Fig. 12: Some pudding stone quems from dept. Eure (n° 1 -6, Evreux muséum), and some querns from an Hertfordshire factory in Great Britain (n° 7-9).
Les metae
Ces pièces dormantes du moulin rotatif sont au nombre de 16 (39 % du corpus). Elles présentent des épaisseurs peu variables, de 120 à 135 mm (une fois 145 mm), la moyenne étant de 128 mm. Leurs diamètres offrent également une faible variabilité : de 330 à 380 mm (une seule atteint 430 mm), la moyenne étant de 360 mm.
Peu de sites permettent des comparaisons ; le seul et probable atelier de taille qui puisse être mis en parallèle avec Avrilly est celui du "Grand-
Mesnil" près de l'oppidum de Moulay dans la Mayenne (Naveau, 1974; 1975). Sur ce site, les metae en granité montrent des épaisseurs qui varient en fonction du type de perforation : 120 mm pour celles qui sont percées de part en part et 160 mm pour celles montrant un oeil aveugle, d'une profondeur constante. Il s'agit de deux types de productions. À Moulay, le diamètre moyen est de 370 mm, mais avec une variabilité plus importante, entre 310 et 440 mm, la plupart variant de 340 à 380 mm.
Gérard GUILLIER, Miguel BIARD et Anne-Françoise CHÉREL
216.
À Avrilly, les amorces de perforations opposées des metae (n° 18 à 22), indiquent que le but recherché était de les percer de part en part, comme cela se remarque sur certains sites de consommation (Pommepuy, 1995, 2003). Les quelques autres metae d'Avrilly ne montrant qu'une seule perforation ne forment pas un groupe suffisamment différencié pour envisager deux types de production comme à Moulay. Nous sommes ici en présence d'un groupe de metae homogène quant au produit fini recherché. La production de metae traversées de part en part a plusieurs implications. D'une part sur la position de l'axe de rotation, pièce non plus fixée sur le catillus mais sur la meta et, surtout, par la possibilité d'un réglage de la hauteur du catillus à partir d'un bâti en bois sur lequel est monté la machine-meule (Mac Kie, 1986, p. 5-7 ; Amouric, 1997, p. 40-41), avec la question corollaire de l'emplacement de ce type d'installation dans l'espace domestique (ibid., p. 41). En effet, nombreuses sont les hypothèses sur cet emplacement, en fonction d'un mouvement rotatif complet ou non.
La forme des metae d'Avrilly est relativement variable : certains exemplaires ont le dos nettement bombé et des bords relativement aplatis (n° 14 et 21) ou sensiblement plat et caréné (n° 15, 16, 17, 18, 20 et 23) ; d'autres présentent des formes intermédiaires (n° 13, 19 et 22). Une telle diversité s'observe aussi à Moulay en Mayenne (Naveau, 1974 ; 1975). Certaines formes sont même comparables : Avrilly n° 18 et Moulay n° 192 ; Avrilly n° 20 et Moulay n° 120, 124 (annexe, fig. 13)...
Les sites de consommation de la vallée de l'Aisne (Pommepuy, 1995) présentent une évolution typo-chronologique : la section des metae y suit le schéma présenté sur le tableau 3. La forme des metae d'Avrilly exclut tout parallèle avec des éléments cylindriques. Elles sont
^^^^ date Section **"'■ — ̂ Tronconique Cylindrique
La Tène C2 75% 25%
La Tène Dl 60% 40%
La Tène D2 35% 65%
Tab. 3 : Evolution typo-chronologique des meules de la vallée de l'Aisne. Tab. 3: Typo-chronological évolution of querns from river Aisne valley.
tronconiques ou tronconique-convexe et ne sont pas sans ressembler à certaines pièces de Grande-Bretagne, de la région de Maindstone ou de Thetford (Norfolk) (Curwen, 1941, p. 21, fig. 23 et 24) ou du nord de la Gaule, à Celles par exemple (Mac Kie, 1986).
Par ailleurs, nous observons que leurs surfaces de mouture sont planes ou légèrement pentues. Ce fait, observé par ailleurs en Angleterre (Curwen, 1941), dans la vallée de l'Aisne (Pommepuy, 1995) ou à Moulay, pourrait trahir une certaine dichotomie nord/sud où les pentes sont plus marquées (Boyer et Buchsenschutz, 1998, p. 202 et fig. 3 ; Buchsenschutz et Pommepuy, 2002).
Les catilli
Ce sont les pièces tournantes du moulin rotatif. Elles sont au nombre de 18 (44 % du corpus). Leurs épaisseurs sont variables, de 150 à 200 mm, avec un maximum de 250 mm et une moyenne de 175 mm. Leurs diamètres offrent une faible variabilité : de 330 à 380 mm et un seul atteint 395 mm, avec une moyenne de 360 mm. Le tableau 4 présente quelques données moyennes recueillies sur quelques sites, permettant un début de comparaison.
Sur les sites de la vallée de l'Aisne, C. Pommepuy (1995 ; 2003) a constaté entre La Tène C2/D1 et La Tène D2 une évolution morphologique : le diamètre augmente tandis que l'épaisseur décroît. Ce phénomène se remarque en comparant les autres données : les sites d'Avrilly, de Levroux et de Moulay présentent des catilli de dimensions comparables, tandis que le site d'Aix (Entremont) se caractérise par leur faible épaisseur. Les meules de Bibracte (datées de 90 à 20 av. J.-C), si elles offrent des diamètres comparables, montrent des épaisseurs intermédiaires (Boyer et Buchsenschutz, 1999). À l'époque antique, les diamètres sont plus importants tandis que les épaisseurs diminuent (Boyer et Buchsenschutz, 2000). Peut-être pouvons-nous voir dans ces données une influence romaine : évidente au Haut-Empire, assez forte à Aix7 et plus lointaine à Bibracte ? Quoi qu'il en soit, les meules d'Avrilly tendent à se placer dans la sphère morpho-chronologique de Moulay, de Levroux et dans une moindre mesure de Bibracte, tout en gardant un particularisme
■ Diamètres Epaisseurs
Avrilly 360 175
Aix 380 105
Bibracte 370 120
Levroux 370 150
Moulay 380 155
Mazières 500 105
AC2/D1 350
- AD2 400
- Légende : A C2/D1 : vallée de l'Aisne, la Tène C2/D1 ; A D2 : vallée de l'Aisne, la Tène D2 (dimensions exprimées en millimètres).
Tab. 4 : Dimensions comparées de meules sur quelques sites. Tab. 4: Compared dimensions of querns from différent sites.
7 Les meules d'Aix-Entremont sont en basalte, matériau qui selon certains auteurs marquerait la " romanisation " (Amouric, 1997, p. 45).
Un atelier augustéen de taille de meules en poudingue...
morphologique, dont il ne faudrait pas rechercher l'origine seulement dans la chronologie mais aussi dans le matériau.
Typologiquement, il semble que nous soyons à Avrilly en présence de deux types de catilli. En premier lieu, ce sont les catilli "bas" qualifiés dans le monde anglo-saxon de flat beehive (Curwen, 1937) ou parfois encore de bun shaped (Mac Kie, 1986). En second lieu, ce sont ceux qui se rapprochent des catilli "en ruche" ou beehive querns (Curwen, 1937 ; Raftery, 1981 ; Mac Kie, 1986), caractérisés par leur épaisseur plus forte et par un profil trapu.
Les catilli "bas" présentent de nombreux parallèles au Royaume-Uni, notamment dans les provinces du nord, à Barlockhart Loch Crannog dans le Kirkcudbrightshire, dans les secteurs de Maindstone (Curwen, 1937), de Shrewsbury ou de St. Albans (Curwen, 1 941 ) et de Dun an Ruigh Ruaidh, Loch Broom dans les Highlands (Mac Kie, 1986), mais aussi parfois sur le continent, à Celles (Mac Kie, 1986). La série présentant le plus de points communs, celle - en poudingue - d'un atelier du Hertfordshire (Curwen, 1941, p. 20 et 21 et fig. 14 à 22), apparaît dans la région de Leicester, Canterbuty, Thetford..., dans des niveaux parfois postérieurs à la conquête.
Les catilli "en ruche" présentent également de nombreux parallèles avec les provinces celtiques d'Irlande et de Grande-Bretagne, parallèles trop nombreux pour être cités ici. Mentionnons toutefois Buxton, Leicester (Curwen, 1941), Ticooly-O'Kelly dans le comté de Galway (Raftery, 1981) ou Drumee dans le comté de Sligo (Mac Kie, 1986), souvent dans des contextes mal datés.
Le manque de données sur le continent, ou tout du moins en Gaule du nord pourrait s'expliquer par ce que les meules "ne retiennent pas nécessairement l'attention des fou illeurs" (Buchsenschutz et Pommepuy, 2002). Le manque de références bibliographiques est flagrant. Mentionnons dans l'Eure, à Évreux et aux Musées d'Évreux, des pièces en poudingue (fig. 12, n° 2 ; annexe : fig. 12, n° 1 à 12), mal datées, probablement d'époque antique ou gauloise, pour certaines comparables avec Avrilly, surtout avec les catilli bas. Nous relevons quelques éléments mieux datés : à Honguemare à La Tène D1/D2 (information David Honoré - INRAP : fig. 12, n° 3 à 5) ; à Bosrobert de la fin de La Tène finale à l'époque augustéenne (ibid. : fig. 12, n° 6), à Lyons-la-Forêt8 (annexe : fig. 12, n° 12), tous éléments qui offrent de nombreux
parallèles avec la production de l'atelier de meules en poudingue du Hertfordshire (Curwen, 1941, fig. 14-24) (fig. 12, n° 7 à 9). Dans le Calvados, signalons aussi une meule gauloise en
poudingue à Quetteville (annexe : fig. 12, n° 13 ; information H. Lepaumier - INRAP). L'atelier de Moulay en Mayenne a livré des pièces en granité permettant peu de comparaisons strictes avec Avrilly ; notons toutefois des formes proches avec les catilli n° 34 et 70 (Naveau, 1974 ; 1975 - cf. annexe: fig. 13), la majorité des pièces récoltées étant comparable à celles de la vallée de l'Aisne de type 2 (Pommepuy, 1995). La différence peut être à notre sens liée à la nature du matériau, le poudingue étant plus difficile à façonner, notamment pour la dépression centrale supérieure.
La taillerie de meules d'Avril ly : bilan
Les meules d'Avrilly offrent une diversité de formes que nous retrouvons sur le site de Moulay dans la Mayenne (Naveau, 1974 ; 1975). Nous avons essayé de présenter les restes qui nous sont parvenus en fonction de critères traditionnels (meta, catillus, diamètre, épaisseur, morphologie), mais nous ne nous sommes pas engagés sur la voie de la distinction des critères ayant une "incidence fonctionnelle de ceux qui relèvent de l'habitude ou du décor" (Buchsenschutz et Pommepuy, 2002). Nous sommes toutefois en mesure, d'émettre l'hypothèse de critères morphologiques liés au matériau. En effet, le poudingue, pour aussi "dur" qu'il soit n'en est pas moins un matériau fragile. Un façonnage trop complexe, par exemple de l'œil ou d'une cuvette sur la partie supérieure du catillus, à l'exemple des meules de la vallée de l'Aisne, de Bibracte ou de Moulay, aurait été la cause d'un trop grand nombre d'accidents de façonnage pour pouvoir être justifié. Les différents catilli régionaux en poudingue (Remy-Watté, 1983), ne présentent pas ces dépressions ou cuvettes. Le poudingue serait donc un matériau présentant certains inconvénients qui pourraient induire une simplification des formes au niveau de la partie supérieure des catilli.
Peu d'ateliers de meules ont été fouillés. Quelques exemples sont connus en Belgique (Jottrand, 1894-1895). Plus récemment, quelques sites ont fait l'objet de recherches ponctuelles (Laville, 1963) ou approfondies, que ce soit pour l'époque antique (Anderson et al., 1999, 2001) ou moderne (Cabezuello et al., 2000). Certains sites ne sont connus qu'au travers de leur production (Naveau, 1974 et 1975 ; Curwen, 1941), ou à partir de fouilles ponctuelles comme aux "Grouas" à Alençon (Bernouis, 1999, p. 72 et 75). Grâce à des prospections, quelques carrières sont connues au nord de l'embouchure de la Loire (information J.-P. Bouvet - SRA des
Zil
8 Information Yves-Marie Adrian (INRAP) : meule issue des fouilles 2002 des ateliers de potiers gallo-romains de Lyons-la-Forêt (Eure), en remploi dans un solin de bâtiment du lléme s.
Gérard GUILLIER, Miguel BIARD et Anne-Françoise CHÉREL
Pays-de-la-Loire), en llle-et-Vilaine9ou en Haute- Bretagne (Triboulet et al., 1996). Notons encore des découvertes ponctuelles à Chènehutte- les-Tuffaux dans le Maine-et-Loire (Cadoux, 1991) ou dans le Finistère (Mornand, 1987). Un recensement des meules de Seine-Maritime (Rémy-Watté, 1983), complété récemment (Rogeret, 1997) cite, d'après des mentions anciennes, quelques sites d'extraction ou de fabrication de meules en poudingue10.
Nombreux sont les auteurs faisant référence à des ateliers de fabrication spécialisés. Les raisons évoquées sont des correspondances entre formes et matériaux qui ne s'expliquent guère autrement (Pommepuy, 1995, p. 24-25), une forte technicité alliée à une bonne connaissance du matériau, une production standardisée et une économie du geste (Anderson et al., 1999 ; 2001, p. 4 à 6). L'absence de déchets de taille et d'ébauches sur les habitats, une bonne connaissance des contraintes de la "machine-meule" et une diffusion importante des produits - jusqu'à 200 km - sont des arguments complémentaires (Buchsenschutz et Pommepuy, 2002). Tous ces auteurs s'accordent pour voir dans
l'extraction et la taille des meules un artisanat spécialisé (Anderson et al., 1999, p. 188; 2001, p. 5), et ce probablement dès l'apparition des meules rotatives (Buchsenschutz, 1985 ; Pommepuy, 1995 ; 2003). Mais qu'en est-il du site d'Avrilly ? Les mentions pour le seul département de la Seine-Maritime de six sites d'extraction / fabrication de meules en poudingue (Rémy-Watté, 1983), suggérerait une production différente de celle des sites à long rayon de diffusion (Curwen, 1941 ; Waldhauser, 1981 ; Buchsenschutz, 1985). Pourrions-nous envisager la présence de sites de production moins importants, au moins quantitativement, mais dont la technicité n'en est pas moins certaine, et dont l'activité allierait par exemple agriculture et taille de pierre ? Ces petites unités de taillerie seraient générées par la présence locale de matériaux appropriés et leur diffusion serait régionale.
D'autres questions sont également soulevées, notamment pour ce qui a trait à l'acquisition de la matière première. S'agit-il de vastes carrières exploitant un matériau homogène, et pouvant couvrir plusieurs hectares comme à Saint- Christophe-le-Chaudry dans le Cher (Laville, 1963), ou quelques centaines de mètres carrés comme en Suisse (Anderson et al., 1999 ; 2001) ? Il peut aussi s'agir de simples fosses d'extraction de poudingue, parfois de grandes dimensions,
comme en forêt de La Londe, à Neufchatel-en Bray, à Saint-Saëns "Le Bois de l'Abbaye", ou à Vattetot-sur-mer en Seine-Maritime (Rémy- Watté, 1983 ; Rogeret, 1997). L'acquisition du matériau a pu se faire par ramassage de surface de blocs erratiques ou bien encore par la récupération de blocs issus de carrières de sable. À Saint-Léonard "Le Bois des Hogues", en Seine-Maritime, il aurait été découvert des fosses de 20 m de profondeur, la roche étant débitée au feu (Rogeret, 1997, p. 496-497).
Conclusion
Le site du "Clos des Forges" constitue l'une des rares occurrences fouillée d'époque gauloise et antique sur les plateaux de l'Eure. Mais son intérêt réside essentiellement dans la découverte de la fosse-atelier F 24, une taillerie de meules rotatives en poudingue de type celtique, datable de la fin du 1er siècle av. J.-C. Cette découverte a permis, au travers des déchets liés à cette activité, d'approcher l'aspect technique de la fabrication de cet outil, de mettre en évidence la chaîne opératoire et ses différentes modalités.
Peu nombreux sont les autres sites de production de meules permettant quelques comparaisons ; citons toutefois celui de Moulay dans la Mayenne, qui n'est pas sans parallèles tant chronologiques que culturels. Mais nous ne devons pas oublier les sites de production de Suisse ou d'Auvergne, même si les matériaux travaillés sont peu comparables.
La découverte d'un tel site pose aussi quelques interrogations, notamment sur l'acquisition de la matière première et sur le statut du ou des artisans, sans doute spécialisés, qui y ont exercé. Dépendaient-ils par exemple d'un grand domaine, comme en Suisse (Anderson et al., 2001), ou s'agissait-il d'artisans indépendants ? Les quelques données acquises sur la gîtologie du poudingue et la gestion de l'atelier nous suggèrent, à l'image de l'artisanat céramique, une hiérarchisation des modes de production : des sites à forte production et à diffusion lointaine et des unités plus restreintes s'adressant à une clientèle plus locale, ou dont la production, spécialisée, s'adresse à une clientèle particulière. Des sites laténiens, notamment ceux de la vallée de l'Aisne, présentent souvent un faible pourcentage de meules d'origine exogène - dont le poudingue - , qui pourraient ne pas relever seulement de la classique mouture des céréales.
9 " Le Pertre " près de Vitré (llle-et-Vilaine), meules et ébauches de meules en granité. Information aimablement communiquée par J.-C. Meuret (Université de Nantes). 10 Nous ne faisons pas ici référence aux ateliers du sud de la Gaule, principalement languedociens, qui présentent des matériaux ainsi que des contextes chronologiques, culturels et historiques bien différents.
Un atelier augustéen de taille de meules en poudingue...
Enfin, la présence de catilli à la typologie marquée - les éléments de comparaisons les plus proches sont relevés dans les îles Britanniques avec les beehive querns et les flat beehive querns - marque-t-elle encore une des nombreuses relations trans-Manche ou bien seulement une conjonction de forme due à la nature particulière du matériau utilisé, qui n'est pas sans contraintes ?
Remerciements
Nous tenons à remercier les personnes qui ont contribué à la réussite de la fouille : Mme Florence Carré du Service régional de l'archéologie de Haute-Normandie et MM. Yoann Escats, Enzo Mutarelli (fouille) ainsi que Benjamin Thomas (fouille/infographie), dont la diligence et les compétences ont été les garants de la qualité de l'intervention. Remercions aussi Mlles Sylvie Baia, V. Renault et MM. H. Lepaumier et T. Lepert pour leur relecture ainsi que Mlle L. Simon pour l'identification des amphores. Je tiens aussi à remercier M. J. Naveau pour avoir mis à ma disposition les données du site du "Grand Mesnil" à Moulay (Mayenne).
Bibliographie
AMOURIC, H., 1991 - Carrières de meules et approvisionnement de la Provence au Moyen-Age et à l'époque moderne. Carrières et constructions en France et dans les Pays limitrophes. Actes du 115e congrès national des sociétés savantes (Avignon, 9-12 avril 1990). Paris : éd. CTHS, p. 443-464. AMOURIC, H., 1997 - L'anille et les meules. In : GARCIA, D. et MEEKS, D (dir.) - Techniques et économie antiques et médiévales : le temps de l'Innovation (colloque international d'Aix- en-provence, 21-23 mai 1996). Paris : éd. Errance, p. 39-47. ANDERSON, T., VILLET, D. et SERNEELS, V., 1999 - La fabrication des meules en grès coquillier sur le site gallo- romain de Châbles-Les-Saux (FR). Archéologie Suisse, 22 (4), p. 182-189. ANDERSON, T., DUVAUCHELLE, A. et AGUSTONI, C, 2001 - Carrier et forgeron gallo-romains à Châbles. Cahiers d'Archéologie Fribourgeoise, 3, p. 2-13. BEDON, R., 1981 - Les carrières et les carriers de la Gaule romaine (doctorat de 3e cycle, Université de Tours), 361 p. BERNOUIS, P., 1999 - Carte Archéologique de La Gaule : l'Orne, 61 . Paris : Académie des Inscriptions et Belles- Lettres / Fondation Maison des Sciences de l'Homme.
BOUVET, J.-P., BRODEUR J., CHEVET P., MORTREAU, M. et SIRAUDEAU, J., 2003 - Un oppidum au château d'Angers (Maine-et-Loire). Revue Archéologique de l'Ouest, Supplément 10 (Les marges de l'Armorique à l'Âge du Fer - Actes du XXIIIe colloque de l'AFEAF), p. 173-187. BOYER, F. et BUCHSENSCHUTZ, O., 1998 - Les conditions d'une interprétation fonctionnelle des moulins "celtiques" rotatifs à mains sont-elles réunies ? Revue Archéologique du Centre, 37, p. 197-206.
BOYER, F. et BUCHSENSCHUTZ, O., 1999 - Les meules de Bibracte. In : BUCHSENSCHUTZ, O., GUILLAUMET, J.-P. et RALSTON, I. (dir.) - Les remparts de Bibracte. Recherches récentes sur la porte du Rebout et le tracé des fortifications. Glux-en-Glenne : éd. du Centre archéologique européen du Mont Beuvray (collection Bibracte, 3), p. 212-216. BOYER, F. et BUCHSENSCHUTZ, O., 2000 - Les meules rotatives manuelles. In : BERTHAUD, G. (dir.) - Mazières- en-Mauges gallo-romain (Maine-et-Loire). Un quartier à vocation artisanale et domestique. Angers : ARDA - AFAN, p. 171-185.
BUCHSENSCHUTZ, O., 1985 - Apports de l'archéologie à l'étude des céréales : l'exemple de l'Europe tempérée à la fin de l'Âge du Fer. Les techniques de conservation des grains à long terme (3, fasc. 2), Paris : éd. du CNRS, p. 347-355. BUCHSENSCHUTZ, O. et POMMEPUY, C, 2002 - Les enjeux d'une recherche sur les meules rotatives dans le monde celtique. In : PROCOPIOU, H. et TREUIL, R. (dir.) - Moudre et broyer : l'interprétation fonctionnelle de l'outillage de mouture et de broyage dans la préhistoire et l'Antiquité, II. Archéologie et histoire : du Paléolithique au Moyen Âge. Paris : éd. du CTHS, p. 177-182.
CABEZUELLO, U., CONNIER, Y. et GAUTHIER, F., 2000 - Les carrières de meules de moulins dans la région de Vic-le-Comte : premier état de la recherche. Nouvelles archéologiques, du terrain au laboratoire. Revue d'Auvergne, n° 554-555, p. 184-200.
CADOUX, Y, 1991 - Une meule brisée en cours de fabrication à Chènehutte-les-Tuffaux (Maine-et-Loire). Bulletin trimestriel de la Société d'Etudes scientifiques de l'Anjou, 82, p. 16-18. CLIQUET, D., 1993 - Carte Archéologique de la Gaule : l'Eure, 27. Paris : Maison des Sciences de l'Homme, 285 p. CURWEN, E. C, 1937 - Querns. Antiquity, 11, p. 133-151. CURWEN, E. C, 1941 - More about querns. Antiquity, 15, p. 15-32. GERBER, F., 1997 - Évreux 1, place de la République / rue Lépouzé (rapport de diagnostic et d'évaluation). Rouen : AFAN - SRA de Haute-Normandie. GUILLIER, G., 2002 - La ferme gauloise et gallo-romaine précoce du "Clos des Forges" à Avrilly (Eure) (rapport de fouille). Rouen : INRAP - SRA de Haute-Normandie, 51 p., 85 pi. JOTTRAND, M. G., 1894-1895 - L'industrie de la fabrication de meules en Belgique avant et après la conquête romaine. Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, XIII, p. 390-408. LAVILLE, L., 1963 - Découverte d'une carrière gallo-romaine spécialisée dans la fabrication de meules à grain domestiques à Saint-Christophe-le-Chaudry (Cher). Revue archéologique du Centre, 2, n° 6, p. 146-151 .
LE BORGNE, V., LE BORGNE, J.-N., ETIENNE-EUDIER, A., EUDIER, P. et DUMONDELLE, G., 2002 - Archéologie aérienne dans l'Eure. Les Éditions Page de Garde, 101 p. LEPERT, T. et PAEZ-REZENDE, L., 2002 - Reflets de l'occupation sur le plateau de Saint-André-de l'Eure (Eure) du Ier siècle avant J.-C. au IIIe siècle après J.-C. (R.N. 154 -Section nord). Revue archéologique de l'Ouest, 19, p. 87-116. MAC KIE, E. W., 1986 - Impact on the Scottish Iran Age of the disconvenances at Leckie Broch. Glasgow Archaeological Journal, 13, p. 1-18.
lit
Gérard GUILLIER, Miguel BIARD et Anne-Françoise CHÉREL
MORNAND, J., 1987 - Meules antiques du Finistère. Revue archéologique Sites, 33, p. 11-19. NAVEAU, J., 1974- Moulay (Mayenne). Meules du Grand-Mesnil (rapport de fouille dactylographié). Nantes : Circonscription des Antiquités historiques des Pays-de-la-Loire. NAVEAU, J., 1975 - Moulay (Mayenne). Meules du Grand-Mesnil (rapport de fouille dactylographié). Nantes : Circonscription des Antiquités historiques des Pays-de-la-Loire. PASSY, A., 1874 - Description géologique du département de l'Eure. Évreux : Conseil général - Société libre d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres de l'Eure. POMMEPUY, C, 1995 - Le matériel de mouture de la vallée de l'Aisne de l'Age du Bronze à La Tène finale : Formes et matériaux. Actes de la table ronde "Moudre et Broyer", Clermont-Ferrand, 34 p.
POMMEPUY, C, 2003 - Le matériel de mouture, un marqueur territorial : les meules rèmes et suessiones. Revue archéologique de l'Est, 20*™ supplément (Habitats, mobiliers et groupes régionaux à l'Âge du Fer -Actes du XXe colloque de l'AFEAF), p. 375-385. PY, M. 1992 - Meules d'époque protohistorique et romaine provenant de Lattes. In : PY, M. (dir.) - Recherches sur l'économie vivrière des Lattarenses. Lattes : éd. de l'ARALO (coll. Lattara, 5), p. 183-232.
RAFTERY, B., 1981 - La Tène in Ireland. Problems oforigin and chronology. Marbourg, 335 p., 27 cartes, 113 pi. REMY-WATTE, M., 1983 - Meules à grains tournantes antiques en Seine-Maritime. Bulletin de la Société normande d'Études préhistoriques et historiques, XLVI, p. 18-47. ROGERET, I., 1997 - Carte archéologique de la Gaule : La Seine-maritime, 76. Paris : Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 663 p.
TRIBOULET, C, LANGOUET, L. et BIZIEN-JAGLIN, C, 1996 - Recherches sur les origines de meules gallo-romaines dans le nord de la Haute-Bretagne. Les Dossiers du Centre régional dArchéologie d'Alet, 24, p. 39-47. WALDHAUSER, J., 1981 - Keltische Drehmuhlel in Bôhmen. Pamàtky Archeologické, (Prague), 72, p. 153-221.