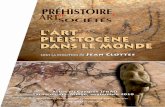Espaces bretons entre territorialisation et déterritorialisation
Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges, St-Amand-sur-Ornain, Boviolles,...
-
Upload
univ-lorraine -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges, St-Amand-sur-Ornain, Boviolles,...
Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), 147Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
LES ESPACES CULTUELS DE FORUM LEUCORUM/NASIUM (NAIX-AUX-FORGES ET SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN, MEUSE)Pascal VIPARDA et Perrine TOUSSAINTB
Résumé Abstract
Forum Leucorum/Nasium, première capitale des Leuques durant le Haut-Empire, présente la particularité de possé-der un important quartier cultuel occupant le quart sud-est de l’agglomération. L’analyse des résultats de prospections aériennes et géophysiques a permis d’en appréhender la topographie et d’analyser une vingtaine d’ensembles qui le composent et où se côtoient des temples de tradition indigènes de type fana, majoritaires, et des formes plus ro-maines, ainsi qu’un gigantesque édifice absidé à portique de près de 200 m de long. Ce type de bâtiment, dont on connaît quelques autres exemples dans des sanctuaires, sert ici à marquer la limite entre les parties civile et religieuse de la ville. L’histoire de ce quartier paraît étroitement liée à celle que l’on commence à entrevoir pour le reste de la ville : il semble en effet naître durant la période qui correspond à la fin de l’utilisation de l’oppidum et aux probables débuts de la ville romaine installée dans la plaine (dernier tiers du ier siècle av. J.-C.). Un certain nombre d’indices montrent une importante phase de monumentalisation dans le der-nier tiers du ier siècle ap. J.-C. et une romanisation accrue des formes. Par ailleurs, des destructions relativement précoces, à la fin du iie ou au début du iiie siècle, pourraient refléter le déclin de la ville à la suite du transfert des fonc-tions de chef-lieu à Toul.
The distinctive feature of Forum Leucorum/Nasium, the first capital of the Leuci in the Early Roman Empire, is a major worship district, which occupies the south-eastern quadrant of the settlement. Analysis of results obtained using aerial and geophysical prospecting reveals its topo-graphy and makes it possible to analyse the twenty or so complexes which it comprises, in which the preponderant indigenous fanum temples, more typically Roman styles and a huge building with an apse and a portico nearly 200m in length can all be found in close proximity. This type of building, a few examples of which exist in sanctua-ries, marks the boundary between the civic and religious areas of the town in this instance. The history of this dis-trict would seem to be intimately associated with new historical details which are beginning to emerge about the rest of the town. It seems to date from a period which cor-responds to the end of the occupation of the oppidum and the putative early days of the Roman town established on the plain (in the last third of the 1st century BC). A number of clues point to a significant phase of monument buil-ding in the last third of the 1st century AD, and increased Romanisation of styles. Furthermore, relatively early inci-dences of destruction in the late 2nd century or early 3rd century could reflect the decline of the town following the transfer of administrative operations to Toul.
Mots-clefs Key-words
Sanctuaire, quartier cultuel, temple, Temple de Mazeroie, bâtiment absidé à portique, Nasium, chef-lieu de cité.
Sanctuary, worship district, temple, Temple of Mazeroie, building with a porticoed apse, Nasium, administrative centre of a tribal capital.
A- MCF d’Antiquités Nationales, université de Lorraine, Nancy, EA 1132, HISCANT-MA.
B- Responsable d’opérations, INRAP Grand-Ouest.
in : Th. Dechezleprêtre, K. Gruel et M. Joly, éd., Agglomérations et sanctuaires. Réflexions à partir de l’exemple de Grand, actes du colloque tenu à Domrémy-la-Pucelle, 20-23 octobre 2011, coll. Grand. Archéologie & Territoire, 2, 2015, p. 147-165.
148 Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
Introduction
L’agglomération de Nasium, dont on sait désormais qu’elle a vraisemblablement été le premier chef-lieu des Leuques1 et que son nom officiel était Forum Leucorum (Burnand et Vipard 2011), était une ville de plus d’une cinquantaine d’hectares (fig. 1), très éten-due donc, mais avec de notables variations de densité d’occupation. Elle s’est développée dans la vallée de l’Ornain, au pied de l’oppidum de Boviolles contempo-rainement de la fin de l’occupation de ce dernier aux
alentours du changement d’ère (Dechezleprêtre et al. 2011). Son organisation urbaine n’a véritablement commencé à être connue qu’à partir de 1998 grâce aux résultats spectaculaires de la prospection aérienne et, surtout, de campagnes systématiques de prospections géophysiques. Le quart sud-est du territoire urbain, installé sur un coteau orienté au nord-ouest et descen-dant vers la vallée, présente la particularité d’être un quartier cultuel.
1- Au moins jusque dans le courant du iie siècle ap. J.-C., avant le transfert de celui-ci à Toul à une date incertaine dans le iiie siècle.
Barb
oure
Orn
ain
Théâtre ?
Temple de Mazeroie
Forum ?
a
b
c
Edifices du quartier cultuel
Bâtiments a, b et c Edifices cultuels urbains ? 0 100 200 400 mètres
824 000 824 200 824 600 824 800 825 000824 400
824 000 824 200 824 600 824 800 825 000824 400
108
600
108
800
108
400
108
200
108
000
107
800
108
600
108
800
108
400
108
200
108
000
107
800
Lambert 1
fig. 1 - Localisation des temples dans la ville. P. Toussaint.
Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), 149Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
1. Les édifices cultuels de Forum Leucorum
Quelques structures cultuelles isolées, érigées à l'inté-rieur et à la périphérie de la ville, ont été repérées. L’une d’elles, située au nord-est de la ville, au pied de l'oppi-dum, peut être qualifiée de temple péri-urbain puisqu’il se situe à plusieurs centaines de mètres de l'agglomé-ration. Repéré par photographie aérienne, il s'apparente à un édifice à simple cella encadré par un mur péribole. D'autres édifices, parfaitement intégrés au réseau viaire de l'agglomération, pourraient eux aussi être identifiés comme des temples. C’est le cas de deux construc-tions quadrangulaires reconnues au sein d'un ensemble construit interprété comme le forum de l'agglomération (Mourot et Frigério 1999-2000, p. 366-367, fig. 2 ; CAG 55, p. 407-408 et fig. 287-289) (fig. 1, a). La forme concen-trique de l'une d’entre elles ne fait aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un temple à plan centré (fanum). Enfin, quelques centaines de mètres plus au nord, deux autres édifices, occupant chacun un îlot urbain, pourraient, par leur forme et leur caractère monumental, être également assimilés à des lieux de culte (fig. 1, b-c). Cependant, ces constructions n'ont fait l'objet d'aucune étude approfon-die et leur identification, fondée principalement sur des plans issus de prospections géophysiques et sur des mentions des explorations anciennes, est à considérer avec prudence.
Nettement plus intéressant est le quartier cultuel occu-pant tout le quart sud-est de l'agglomération (fig. 1) que des fouilles anciennes et contemporaines, ainsi que des campagnes de prospections aériennes et géophysiques, ont permis d’identifier sur le plateau de Mazeroie.
Au xixe siècle, un édifice situé sur le sommet de ce der-nier a été exploré par les premiers archéologues du site, mais sa nature et sa fonction n’ont alors pas été identi-fiées. Claudine Gilquin et Laurent Legin qui en ont repris la fouille de 1967 à 1988 (Gilquin 2004, p. 64-69 ; Legin 1997) ont établi qu’il s’agissait d’un temple dont ils ont reconnu deux phases de construction distinctes (fig. 2). Le matériel amphorique (dont des exemplaires « sa-brés ») et numismatique laisse supposer une occupation (et donc peut-être une création) dès le troisième quart du ier siècle av. J.-C. au moins (Poux 2004, p. 437 ; Baudoux 1996, p. 30-33, Gilquin 2004, p. 67 ; Dechezleprêtre et al. 20112), contemporain donc de la fin de l'occupation de l'oppidum. Il était alors formé d'une cella quadrangulaire entourée d'une galerie péribole construites en matériaux périssables. La cella comportait deux ouvertures à l'est et à l'ouest ainsi qu'un foyer en son centre. Après une destruction, un second édifice a été reconstruit au même emplacement sous la forme, cette fois, d’un temple sur
2- En particulier l’annexe de Pierre-Damien Manisse (voir Manisse 2011).
0 1 0 2 0 m
Premier état du temple de Mazeroie(dernier tiers du Ier s. av. J.-C. )
Second état du temple de Mazeroie(troisième tiers du Ier - fin du IIe s. ap. J.-C.)
fig. 2 - Les deux états reconnus du temple de Mazeroie. P. Toussaint d'après Legin 1997, p. 252.
150 Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
podium (voir plus bas). Ce second état est datable du der-nier tiers du ier siècle ap. J.-C. (Maligorne à paraître)3 ; la destruction serait intervenue vers la fin du iie siècle ap. J.-C.
À partir de 1998, l’analyse des photographies aériennes a mis en évidence que le temple de Mazeroie n’était pas isolé4 et les campagnes de prospections géophy-siques menées depuis sur le plateau ont clairement fait apparaître que la quasi-totalité de celui-ci était en fait occupée par des constructions à caractère cultuel. La cartographie des données anciennes et récentes a permis d'établir un plan de ce quartier cultuel et de ca-ractériser les constructions qui s'y trouvaient (Toussaint 2009). Dix-sept ensembles5 ont été individualisés qui peuvent être répartis en trois catégories : des édifices à plan centré, des enclos à édifices multiples, tous deux de tradition indigène, et des constructions présentant des caractéristiques plus romaines.
1.1 LES ÉDIFICES À PLAN CENTRÉ (P. TOUSSAINT)
D'une manière générale, le plan centré est l’une des caractéristiques qui définit le temple romano-celtique, communément dénommé fanum par les archéologues depuis le début du xxe siècle (Vesly 1909 ; Fauduet 2010, p. 8-9). Présent dans les anciens territoires celtes (Gaule, Germanie, Bretagne), il est constitué d’une cella, le plus souvent quadrangulaire, entourée par un déambulatoire généralement de même forme. Ce plan caractéristique le distingue donc des temples de tradition italique qui peuvent revêtir des aspects très variés (Fauduet 2010, p. 11-13).
Tout aussi important que l’ensemble formé par la cella et galerie périphérique, l’aire sacrée enclose d’un péribole a été prise en compte dans la définition architecturale de l'édifice, le tout participant de la définition des édifices à plan centré. La caractérisation précise de ces derniers demeure cependant complexe parce que la quasi-totalité des plans, à l'exception de ceux du temple de Mazeroie et de l’édifice des Petites Corvées, n’est établie qu’à par-tir des résultats pas toujours parfaitement lisibles des prospections aériennes ou géophysiques. Il faut égale-ment tenir compte du fait que les assemblages de murs peuvent n’être pas synchrones, mais résulter de possibles ajouts ou remaniements architecturaux dont seule une fouille permettrait de vérifier la contemporanéité ou la succession. Malgré ces difficultés inhérentes aux sources exploitées, plusieurs modèles d'édifices à plan centré ont pu être déduits des onze constructions recensées dans cette catégorie. La figure 3 (infra) en expose de façon schématique les différentes réalités planimétriques.
Au moins un exemple d’édifice à cella sans galerie péri-phérique (A) est attesté dans le quartier cultuel. Il s'agit du premier état du temple de Mazeroie (15), déjà évo-qué, où la cella est encadrée par une galerie péribole (fig. 2). Dans ce cas, la forme concentrique de l'ensemble architectural repose sur le mode de clôture et non sur l'architecture du temple.
Dans la catégorie des temples à galerie périphérique (B), deux autres ensembles à plan centré d'assez grandes dimensions ont été mis en évidence. Il s'agit des ensembles 6 et 18, dotés d’un péribole prenant la forme d’une galerie (fig. 3). Le premier a visiblement connu plusieurs états.
3- Il semble, en effet, qu’il faille élargir un peu la datation des années 70 proposée par Cl. Gilquin et L. Legin (Gilquin 2004, p. 69).
4- PCR « Nasium, de l’oppidum à l’agglomération antique », 2005-2007 et 2008-2011, dirigé par Thierry Dechezleprêtre.
5- Ce nombre ne recense que les édifices du quartier cultuel, il exclut les trois ensembles repérés ailleurs dans la ville. De la même manière, il ne tient pas compte de huit ensembles construits n'ayant pas de caractéristiques cultuelles bien définies.
Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), 151Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
Premier état du templede Mazeroie
(20) (21) (22)
(23)
(24)(7)
(6)
Second état du temple de Mazeroie
(17)
(18)
A. Les temples sans galerie périphérique
B. Les temples avec galerie périphérique
avec mur de péribole
avec galerie péribole
sans péribole reconnu
sur podium et pronaos
avec galerie péribole
(15 bis)
(15)
Exemple pour Forum Leucorum
avec galerie péribole
Exemples pour Forum Leucorum
0 10 50 m.
0 10 50 m.
0 10 50 m.
0 10 50 m.
0 10 50 m.
fig. 3 - Représentation schématique des variantes architecturales autour du plan centré et mise en parallèle avec les temples du quartier cultuel de Forum Leucorum. P. Toussaint.
152 Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
Enfin, six autres édifices simples, de plus petites dimen-sions, ont été mis en évidence par les prospections. Ils semblent correspondre à des édifices présentant une cella entourée d'une galerie périphérique. Cinq d’entre eux sont dotés d’une cella quadrangulaire (17, 20, 21, 22, et 24), tandis que celle du sixième est octogonale (7)6. Aucun péribole ne semble attesté pour ces six construc-tions mais l’ensemble 23, lui, pourrait en avoir eu un puisqu'on observe au moins trois constructions concen-triques. D'une manière générale, ces fana, type de temple le plus fréquent sur le site, correspondent à la grande majorité des temples connus en Gaule et en Germanie7.
1.2 LES ENCLOS À ÉDIFICES MULTIPLES (P. TOUSSAINT) (FIG. 4)
Le quartier cultuel comporte également trois ensembles correspondant à des enclos à édifices multiples (en-sembles 1, 12 et 13). Ce type de sanctuaire regroupe aussi bien des temples à cella simple que des temples à cella et à galerie périphérique. En ce qui concerne le mode de clôture, deux des ensembles sont délimités par un mur péribole (1 et 13), tandis que le troisième (12), plus monumental que les précédents, est encadré par une galerie péribole. Ce type d'ensemble cultuel consistant en un enclos regroupant plusieurs temples ou édicules probablement consacrés à plusieurs divinités n'est pas inhabituel en Gaule, mais il semble, quand cela a pu être vérifié, que toutes ces constructions ne soient pas contemporaines (Fauduet 2010, p. 82-87, 120).
1.3 LES ÉDIFICES D’INSPIRATION ROMAINE (P. TOUSSAINT ET P. VIPARD)
1.3.1 TEMPLESÀ côté de ces édifices de tradition indigène, on trouve de nombreux temples qui présentent un caractère roma-nisé, voire nettement romain.
Le mieux connu est l’état 2 du temple de Mazeroie (fig. 2, supra) qui, malgré un léger changement d’axe (décalé
d’environ 2 degrés vers le sud), peut-être destiné à l’aligner sur la même trame que les édifices situés immé-diatement au nord et à l’est, conserve les grandes lignes de sa disposition centrée originelle. Des modifications lui confèrent toutefois désormais un aspect nettement plus romain. L’étude du plan et du riche matériel lapidaire par Y. Maligorne (à paraître) permet de donner une vision renouvelée8 de l’aspect de cet édifice dont l'élévation se rapprocherait de l'édifice de la Grange des Dîmes à Avenches (Bridel 2011) : à savoir un bâtiment installé sur un podium de plus de deux mètres de hauteur avec une entrée vraisemblablement à l'est par l’escalier installé dans ce dernier. La cella en tour, avec toiture à quatre pans qui émergeait d'une galerie périphérique soutenue par un ordre complet, était vraisemblablement précédée - dans une zone non fouillée - par un pronaos dont l’exis-tence est déduite, notamment, de l’existence de blocs d'architecture qui ne peuvent être attribués à l'enveloppe externe du temple. L’un des deux types de chapiteaux (composites et corinthinisants) et quelques fragments de corniches appartiennent indubitablement à un fron-ton et se rattachent au même système ornemental que des corniches horizontales qui, elles, proviennent assu-rément de la péristasis. Ce temple était entouré par une cour dallée bordée par une galerie péribole. Cet état, en maçonnerie concrète, correspond à une phase de monu-mentalisation. L’ensemble du décor, surtout abondant dans la cella (pilastres, chapiteaux et, peut-être, grands panneaux sculptés de rinceaux peuplés) et datable du troisième tiers du ier siècle, montre une influence très sensible des pratiques de la Narbonnaise augustéenne9.D’autres temples situés au nord du précédent, présentent également un caractère plus romanisé ou nettement romain.
Le premier (n° 10, fig. 10 infra), qui se présente sous l’aspect d’un temple circulaire à pronaos empiétant sur un portique, pourrait bien n’être également, comme pour d’autres cas connus en Gaule, qu’un temple de type indi-gène habillé à la romaine plutôt qu’une création originale (fig. 5). C’est une imposante construction circulaire d’en-
6- Il est apparemment en relation avec un aqueduc souterrain (Boulanger 2011, p. 142) qui semble avoir été spécialement créé pour lui. Cette liaison avec l’eau rappelle celle du « temple de source » octogonal du sanctuaire d’Apollon Moritasgus d’Alésia (Cazanove 2011, p. 163-166, avec une douzaine d’exemples comparables regroupés dans la fig. 5).
7- Cette catégorie représente en effet plus de la moitié des 840 temples inventoriés par I. Fauduet en 1993.
8- Sa reconstitution, appuyée sur un examen poussé des éléments architectoniques et décoratifs, diffère sensiblement de celle proposée en 2003 par le Centre de Recherche en Architecture et Ingénierie - UMR 694 MAP CNRS qui considère que l’on est en présence d’un édifice de type fanum (Bur et al. 2003).
9- Merci à Y. Maligorme de nous avoir fourni les précisions inédites concernant l'aspect architectural et la décoration du second état de cet édifice utilisées dans cette notice.
Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), 153Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
viron 30 m de diamètre dont on peut estimer l’épaisseur des fondations à environ 2 m de large. Les résisto-grammes laissent deviner la trace mal visible d’une cella circulaire au centre (peut-être récupérée). La construc-tion présente une double particularité : d’une part, elle est accolée, à l’ouest, à un portique d’environ 10 m de large (avec au moins quatre murs de soutènement hémi-circulaires à l’est) ; d’autre part, elle est visiblement dotée d’un pronaos occupant l’espace du portique10. Son axe ne semble pas exactement perpendiculaire à ce dernier, mais légèrement en biais, ce qui pourrait indiquer une différence chronologique dans la construction. La struc-ture du pronaos est mal visible et il est donc difficile d’être
assuré qu’il s’apparentait aux cas des temples indigènes aquitains romanisés de Périgueux (Lauffray et al. 1990) ou de Barzan (Aupert 2010), visiblement conçus comme des mixtes de temples indigènes et du Panthéon d’Ha-drien - achevé vers 125 ap. J.-C. Par sa cella circulaire et sa liaison avec un portique, il s’apparente également à celui des Tours Mirandes à Vendeuvre-du-Poitou, par exemple, dont les dimensions sont très voisines (Fincker et Tassaux 1992, p. 49).
Ce temple paraît avoir été situé sur le tracé d’un aqueduc (cf. infra, fig. 10) et l’eau pourrait donc y avoir joué un rôle dans le culte qui y était rendu.
10- Comme pour le sanctuaire dit des Lares Publics à Pompéi, par exemple (Dobbins 1994, p. 685-688 ; Van Andringa 2009, p. 49-53).
avec templesà simple cella
ou à galerie périphérique
et mur de péribole
avec temples à galerie
périphériqueet galerie péribole
C. Les enclos à édifices multiples
Exemples pour Forum Leucorum
(1) (13)
(12)
0 10 50 m.
0 10 50 m.
fig. 4 - Les enclos à édifices multiples. P. Toussaint.
154 Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
Le cas suivant, lui, n’est visiblement pas un type indigène romanisé, mais il est néanmoins assez peu classique (n° 11, fig. 10). Il s’agit d’un temple à cella absidée (de 12 m x 11 m environ) précédée d’un court pronaos, greffé sur un quadriportique s’étendant sur environ 56 m dans le sens est-ouest11. Alors qu’un tel type de temple greffé à l’extérieur d’un portique à un, trois ou quatre côtés n’est pas rare, celui-ci présente la particularité de tourner le dos à l’espace intérieur, comme dans le cas du temple cruciforme de Sanxay (Formigé 1944, p. 48-57, fig. 4-6). Une telle disposition, qui ne s’explique apparemment pas par un manque de place à l’est, devait entraîner une utili-sation différente de l’aire centrale.
1.3.2 LE BÂTIMENT ABSIDÉ À PORTIQUE DES PETITES CORVÉES (P. VIPARD)À un peu plus de 200 m à l’ouest de ces temples, en bor-dure occidentale du secteur cultuel, le long de ce qui est interprété comme le forum, la prospection géophysique de 2005 a permis d’identifier un ensemble monumental constitué d’un édifice absidé (fouillé en 2007 par P. Vipard) greffé au centre d’un long portique (sondé en 2009 par P. Toussaint : 2011) (fig. 6, 7). La construction est très ara-sée : il n’en subsiste généralement que les fondations ou des tranchées de récupération ; aucun sol n’est conservé et le matériel recueilli est peu abondant. On dispose tou-tefois d’informations assez précises sur les deux états architecturaux qu’a connu cette construction qui, avec le temple de Mazeroie, est donc l’un des deux seuls édifices du quartier cultuel pour lequel on possède des informa-tions sur les élévations et sur la chronologie.
Son installation a été précédée par d’énormes travaux d’aménagement du terrain destinés à adoucir sa pente naturelle par l’apport de milliers de mètres cubes de terre argileuse. Le matériel contenu dans le remblai préparatoire fournit un terminus post quem dans le der-nier tiers du ier siècle, voire au tout début du iie siècle12.
L’édifice originel se présentait alors sous l’aspect d’une vaste salle dotée d’une abside de plan semi-circulaire (état 1)13 (fig. 7, 8). Les murs, construits en opus uitta-tum (états 1 et 2), étaient installés sur des fondations de plusieurs mètres de profondeur et dotés de contreforts (au moins à l’état 1). L’entrée, à l’est, semble avoir été tripartite, en liaison avec une interruption du mur orien-tal du portique vers l’est. À l’intérieur, les murs étaient rythmés par des colonnes ou des piliers engagés dont l’empreinte des socles a été retrouvée. L’épais mur du fond (le mieux conservé) était interrompu par une abside semi-circulaire flanquée de deux petites exèdres aménagées dans l’épaisseur du mur. L’ensemble évoque un scaenae frons qui renvoie à la grande architecture officielle. Aucune trace d’ordre libre intérieur n’a pu être repérée ; la portée d’environ 15 m entre les murs longitu-dinaux autorisait un plafond simple14.
Après une destruction intervenue à une date incertaine dans le iie siècle et dont la nature (volontaire ou acciden-telle ?) est inconnue, l’édifice a fait l’objet d’une vaste entreprise de reconstruction, toujours en opus uittatum (état 2)15 : les fondations des longs murs latéraux ont été reprises en sous-œuvre et le mur occidental a été rasé et remplacé par un chevet plat interrompu au milieu par une abside quadrangulaire. L’édifice, toujours sans colonnes libres intérieures, présentait désormais un aspect nettement plus trapu, proche du carré. Sa toiture était constituée de plaques de calcaire, traditionnelles à Nasium. Rien ne permet de supposer que cette construc-tion de l’état 2 ait été moins luxueuse que celle de la période précédente.
Une nouvelle destruction est intervenue probablement dans le deuxième quart ou vers le milieu du iiie siècle. Dans la première moitié ou au milieu du iiie siècle (phase 3), l’édifice a été systématiquement démonté et ses ma-tériaux récupérés ; les déblais ont été soigneusement
11- Le portique sud n’est pas visible. La largeur des galeries est d’environ 4 m ; celle de l’espace intérieur d’environ 45 m.
12- Noter que, typologiquement, les murs M3 à M5 (fig. 7), sont semblables à ceux du second état du grand temple de Mazeroie, daté du dernier tiers du ier siècle.
13- Dimensions extérieures : Longueur hors-tout : 24,45 m ; 20,40 m (sans l’abside) ; largeur : 18,22 env. à l’est et 17,84 m à l’ouest. Diam. de l’abside : 10,60 m de diamètre ; l’outrepassement est de 0,50 m env. au niveau du rayon médian. Dimensions intérieures : env. 15,20 m de largeur sur env. 18,40 m de longueur (22,30 m avec l’abside). Surface intérieure : 280 m2. Diam. int. de l’abside : env. 7,80 m.
14- Grâce à la technique de la charpente à ferme triangulée, les Romains étaient en effet déjà capables de couvrir des portées d’une vingtaine de mètres dès le Ier siècle av. J.-C. et de dépasser les 30 m dès la fin du Ier s. ap. J.-C. (Adam 1989, p. 228).
15- Dimensions extérieures : Longueur hors-tout : 20,80 m ; 18,30 m (sans l’exèdre) ; largeur : 18,20 env. à l’est et env. 18 m à l’ouest (les tran-chées de récupération des murs ne permettent que des approximations). Dimensions intérieures : L. : env. 16,20 m [env. 19 m avec l’abside] ; l. : 15,20 m. Largeur int. de l’exèdre : env. 3,70 m ; profondeur : 2,50 m. au moins.
Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), 155Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
fig. 5 - Temple circulaire à pronaos empiétant sur un portique. Dessin d'après résistogramme de la prospection géophysique de Géocarta 2006 ; P. Vipard.
fig. 6 - Bâtiment absidé à portique des Petites Corvées : planimétrie. P. Vipard et P. Toussaint
156 Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
fig. 7 - Bâtiment absidé des Petites Corvées : relevé des murs et des tranchées de récupération. P. Vipard.
Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), 157Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
fig. 8 - Suggestion de reconstitution de l’aspect du bâtiment absidé des Petites Corvées à l’état 1 vu à partir du nord-est. Croquis axonométrique P. Vipard.
nivelés. Ultérieurement (phase 4), on a observé une oc-cupation de nature indéterminée (fossé) du milieu ou de la seconde moitié du iiie siècle.
La vaste salle précédemment décrite n’était pas iso-lée, mais formait un ensemble architectural avec une construction de 187 m de long au milieu du côté occi-dental duquel elle était greffée. D’après la maçonnerie, cette construction est contemporaine de l’état 1 et a été conservée à l’état 2. Elle se composait d’un long portique de 158 m, large d’environ 7,70 m, dont chacune des extré-mités se prolongeait par un pavillon de 12 m sur 7,50 m environ. Le pavillon sud semble avoir été doté d’un accès vers l’est (il est impossible de le déterminer pour celui du nord). Deux larges exèdres (11 m sur 6 m) occupaient le milieu des côtés occidentaux. Une interruption semble avoir existé devant la porte de l’édifice absidé, sans doute pour laisser la place à un emmarchement permettant d’accéder à l’esplanade adjacente.
Le plan et l’aménagement intérieur de cet édifice impo-sant ne constituent pas des éléments suffisamment caractéristiques pour permettre une identification spontanée de sa nature. L’importance accordée à la co-lonnade et son insertion topographique dominante dans le quartier cultuel de la capitale des Leuques fournissent peut-être un indice. Il n’est en effet pas sans rappeler les portiques à exèdres monumentaux d’origine hellénis-tique dont on connaît la lointaine descendance à l’époque romaine, tout particulièrement dans les sanctuaires16 et dont on soupçonne fortement qu’ils ont pu être choi-sis parce qu’ils étaient particulièrement bien adaptés à l’exposition des effigies impériales ou de personnages remarquables (Tranoy et al. 2008, p. 97).
Si la présence de cette colonnade a également pu faire jouer à l’édifice des Petites Corvées un rôle scénogra-phique (nous aurons l’occasion de revenir sur ce point), l’importance accordée à la vaste salle centrale – qui est
16- Sur ces portiques à exèdres en Occident : Brouquier-Reddé et Gruel 2006, p. 135-153, fig. 1-15 ; également : Cazanove 2011, p. 166-167 et fig. 7. Sur les cas rectilignes en particulier et sur la fonction possible de ces aménagements : Tranoy et al. 2008, p. 95-97 et fig. 20-22.
158 Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
bien plus qu’une exèdre améliorée – montre qu’il ne se réduisait pas à être un simple portique. La présence d’un tel espace ne résout toutefois pas le problème de l’iden-tification de la construction puisque les grandes salles absidées, associées ou non à un portique, ne sont en effet pas attachées à une fonction unique17. Le contexte apporte toutefois des éléments qui permettent peut-être de privilégier certaines pistes plutôt que d’autres.
L’ampleur, le luxe et, surtout, l’ouverture sur l’extérieur ne sont pas sans évoquer certaines caractéristiques de temples liés au culte impérial, du type de l’augusteum de Pompéi (plus connu sous l’appellation de Sanctuaire des Lares Publics18), s’ouvrant largement sur le portique du forum. Bien qu’on ne trouve pas ici de portique en pi, l’association d’une salle absidée à une galerie évoque également une série bien connue de temples inspirés de l’Aedes ou Templum Pacis19 du Forum de Vespasien, construit vers 71-75 ap. J.-C., édifice complexe à fonc-tions multiples, non exclusivement religieuse20. Le rapprochement est d’autant plus pertinent que, si sur le plan formel, il est évident qu’il y a une différence impor-tante entre une porticus triplex et un portique rectiligne simple, sur un plan fonctionnel, il n’est absolument pas sûr qu’elle ait existé21. Le choix d’un portique rectiligne pourrait s’expliquer moins par manque de place que par un choix esthétique et fonctionnel (nécessité scénogra-
phique), par exemple. L’édifice de Nasium pourrait donc être une forme originale d’édifice public qui se serait prêtée à des utilisations variées et mêlant peut-être harmonieusement fonctions religieuses et civiles22. Les informations que l’on peut tirer des rares édifices se rap-prochant morphologiquement de Nasium, tous localisés dans des grands sanctuaires, iraient dans le même sens. De dimensions plus modestes, ils présentent une dispo-sition générale se rapprochant du cas leuque (fig. 9).
Ainsi, même si l’on n’y retrouve pas les pavillons, l’édifice mis au jour en 2009 par Lydie Joan dans le sanctuaire civique séquane de Mandeure, à côté du théâtre et face au sanctuaire du Champ des Fougères23, présente une parenté formelle indéniable (Marc et Blin 2010). La fonc-tion de ce bâtiment n’est pas assurée, mais son contexte et la découverte d'un dépôt enfoui à l’arrière de la grande salle axiale confortent une interprétation cultuelle24. Un des autres éléments de comparaison le plus intéres-sant est sans doute celui de l’« édifice à paraskenia » du sanctuaire d’Apollon Moritasgus à Alésia (Cazanove 2011, p. 166-169), édifice créé à l’époque flavienne et profon-dément remanié au milieu du iie siècle ou un peu avant (phase 2) : à ce moment, l’arasement des exèdres plates, la rectification du mur du fond, l’enlèvement des paras-kenia (avancées) et leur remplacement par des pavillons d’angles lui confèrent désormais une morphologie assez
17- On le voit notamment bien avec le cas des trois bâtiments administratifs du côté sud du forum de Pompéi, par exemple, dont l’identification précise, malgré une bonne connaissance du contexte, fait toujours débat. Voir également les exemples religieux évoqués infra.
18- L’état actuellement connu date des environs de 62-68, mais il pourrait avoir repris un plan plus ancien, d’époque augustéenne. Voir la n. 10.
19- L’expression désigne à la fois le seul temple et l’ensemble du complexe dans les textes antiques.
20- Anderson 1982, p. 106, Gros 1996, p. 165, 216-217 et 365. Très polyvalent, il abritait de multiples fonctions, civiles (parc public avec œuvres d’art, bibliothèque), administratives (siège de la préfecture de la ville et des archives) et religieuses (cette dernière composante est finalement assez faible).
21- Les processions liturgiques (du culte impérial en particulier) n’impliquant pas de circumambulation, tout portique, qu’il soit à trois côtés ou à un seul était donc sans doute susceptible de convenir.
22- De ce fait, on pourrait se demander, mais cela reste hautement spéculatif, si l’on ne pourrait pas être, pour de tels édifices un peu atypiques et très luxueux, en présence de ces basiliques de sanctuaire mentionnées par l’épigraphie aux IIe et IIIe siècles, mais si rarement identifiées matériellement parce que, comme l’a notamment montré P. Gros (2003, p. 196-197), elles ne correspondent à aucune forme architecturale par-ticulière : « vaste hall … adaptable aux contextes les plus variés », souvent caractérisé par le « caractère peu contraignant de son ordonnance interne » (pas nécessairement une salle hypostyle) ; c’est-à-dire toute salle de quelque ampleur appartenant à un complexe public, un lieu de rassemblement public couvert, sans doute richement décoré, orné de statues de divinités (de pagi notamment), de notables (flamines en parti-culier), et sans doute également d’empereurs. Leur caractéristique principale serait « à chercher dans la position secondaire ou subordonnée par rapport au temple de ces espaces qui sont reliés à l’ensemble de façon à servir d’annexe liturgique, d’encadrement architectural, ou d’entrée plus ou moins monumentale. La typologie dans ces divers cas n’est évidemment plus le critère discriminant ». Le problème de ces monuments a été récemment évoqué pour la « basilique » de Grand (Vipard 2013).
23- Édifice composé d’une grande salle de 16 m x 12,5 m greffée sur une galerie de 57,5 m x 5 m, construit à la fin du Ier siècle sur un quartier artisanal rasé.
24- Merci à Lydie Joan pour les informations qu’elle nous a aimablement fournies.
Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), 159Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
proche de celle de l’édifice de Nasium. Encore une fois, la fonction exacte de cette construction n’est pas connue, mais, ce qui est sûr, c’est qu’elle jouait un rôle important dans la mise en scène de l’espace, différent toutefois de l’exemple leuque : visible de loin en arrivant, elle servait en effet de façade monumentale au sanctuaire qui se situait en arrière, voire à la ville (Cazanove 2011, p. 166).
L’édifice de Nasium trouve également des comparaisons avec des édifices du sanctuaire des Arènes de Tintignac à Naves (Corrèze) (Lintz 1992, p. 160-164) : d’abord avec le prétendu « tribunal » situé au nord-ouest du théâtre, formé d’un portique long de 47 m orienté à l’est et doté d’une exèdre centrale large de 15 m sur son côté ouest (en face d’un grand escalier), de deux pavillons débor-dants à chaque extrémité, et de deux exèdres, mais également – bien que cela ne saute peut-être pas im-médiatement aux yeux – avec le « temple » tangent à la cavea du théâtre où l’on retrouve la même idée géné-rale d’une vaste salle (cella ici) greffée au centre d’un portique de 90 m – courbe, sans doute pour épouser
la forme de l’édifice de spectacles – avec une série d’exèdres (semi-circulaires ou quadrangulaires) et deux pavillons aux extrémités.
Bien que la nature de l’édifice à portique des Petites Corvées soit encore loin d’être établie, divers indices convergents suggèrent néanmoins un bâtiment public cultuel, mais pas forcément un temple ou, du moins, pas seulement un temple. Quoi qu’il en soit de sa nature exacte, ce qui est sûr c’est qu’à Nasium, l’édifice for-mait un écran entre les parties civile et religieuse de la ville. Par sa taille (exceptionnelle aussi bien sur le site que par rapport aux autres cas gaulois connus) et par sa situation, mais aussi du fait qu’il est tourné vers cette partie religieuse, il jouait visiblement un rôle important dans l’organisation spatiale de cette dernière. La coïnci-dence entre le portique et la très vaste esplanade qu’il surplombait légèrement n’est probablement pas fortuite, mais pourrait au contraire avoir été conçue en lien avec les grands rassemblements civiques et religieux que de-vaient connaître les capitales de cités.
fig. 9 - Bâtiments à portique : plans comparatifs. P. Vipard.Mandeure. D'après un dessin aimablement communiqué par L. Joan ; Naves. D'après Lintz 1992 ; Alésia. D'après Cazanove 2011 ; Naix-aux-Forges.
160 Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
2. Topographie sacrée de la ville antique (P. Toussaint et P. Vipard)
Du point de vue topographique, l’ensemble des édifices cultuels évoqués précédemment est situé sur un plateau, entre 260 et 270 m d’altitude, où il formait un pôle spécia-lisé dominant les autres quartiers urbains situés plus bas dans la plaine. On y distingue, sans solution de continuité, deux ensembles (fig. 10).
Le premier ensemble occupait le côté oriental, le plus élevé. Il apparaît d’abord comme un nuage de petits fana (17 à 24 et 1er état de 15) disposés de façon anarchique dans l’angle sud-est, mais ne se superposant néanmoins jamais. Situé en contrebas de l'oppidum et ne présentant pas d'organisation ou d’orientation liées aux autres com-posantes de l'agglomération, cet ensemble de petits fana dont les plans très simples ne semblent pas comporter d'éléments architecturaux mixtes, ou le premier état du temple de Mazeroie (fin ier siècle av. J.-C.), pourrait bien, avoir constitué le noyau le plus ancien du quartier cultuel.
Un second groupe de constructions rassemble tous les autres temples. Les constructions y sont majoritairement orientées nord-sud et semblent implantées de manière cohérente par rapport à la trame viaire. Tout ce secteur semble s’articuler autour d’un vaste espace de 3 à 4 ha non bâti25 (ou très faiblement), qui pourrait avoir été une véritable esplanade ou, du moins, un vaste espace peu densément occupé susceptible d’accueillir plusieurs di-zaines de milliers de personnes. Les deux bâtiments à portique de façade (2 et 10) sont tous les deux orientés se-lon un axe nord-sud. Avec leurs entrées respectivement situées à l’est pour le bâtiment à portique des Petites Corvées, tournant le dos au supposé forum, et à l’ouest pour le grand temple rond, tournant le dos au groupe de
temples situé sur le haut du plateau, ils en constituaient les limites orientale et occidentale. Sa limite sud corres-pondait visiblement à l’alignement des ensembles 6 et 12 ; sa limite nord paraît avoir été la grande rue (resti-tuée) est-ouest située 200 m plus au nord, si l’on ne tient pas compte du petit temple octogonal 7. Tous les temples ne donnaient toutefois pas directement sur cette espla-nade. Un second espace privilégié non bâti doit en effet être envisagé au sud, en rapport avec les complexes 1226, situé à l’arrivée de la voie de Langres (dont la partie extra muros a été révélée par les prospections géophysiques, fig. 10, voie 4), au sommet du plateau, et 6 qui, lui, pourrait éventuellement avoir également entretenu une relation topographique privilégiée avec l’hypothétique théâtre27.
Les rues qui structuraient le quartier n’apparaissent pas clairement sur les photos aériennes ou les relevés géophysiques, mais les principales peuvent être assez facilement déduites de l'orientation des bâtiments et de la position de leurs entrées (fig. 10). Partant de la grande esplanade centrale, la plus visible est sans conteste le cardo (voie 1) qui passait entre les enceintes des temples 13 et 15 (Mazeroie) et celle du complexe 12 pour marquer l’entrée dans la ville de la voie de Langres (voie 4) ; vers le nord, son axe correspond à celui d’une rue reconnue dans la plaine alluviale, à 150 m du portique du temple circulaire 10. Deux autres cardines, toujours en liaison avec la grande esplanade, passaient probablement entre le bâtiment à abside des Petites Corvées et le complexe 6 (voie 2, en direction du théâtre ?) et entre les complexes 6 et 12. Enfin, entre les bâtiments 10 et 11 et/ou 11 et 15, on pourrait soupçonner l’existence d’un ou deux decu-mani reliant le secteur des temples orientaux à la grande esplanade.
25- Cet espace mesure 220 m dans le sens est-ouest et environ 130 à 180 m dans le sens nord-sud, soit environ 3 à 4 ha. La prospection géophysique y fait apparaître quelques rares traces de substructions éparses, mais celles-ci, contrairement à ce qui se passe partout ailleurs sur le site, sont très floues et ne permettent pas d’identifier de plans (serait-on en présence de bâtiments démontés ?).
26- Dans ce cas, le bâtiment installé au milieu de la façade sud du péribole pourrait avoir constitué une entrée monumentale.
27- Sur cet édifice : Dechezleprêtre et Mourot 2004, p. 152-153 ; Mourot 2001, p. 408-409. Sur la fréquente relation d'axialité et de frontalité entre un édifice cultuel et un édifice de spectacles : Brunet-Gaston 2008, p. 283-286.
Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), 161Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
Système d’adduction d’eau
Voie Voie présumée
Accès probables au quartier cultuel
0 100 200 m
Forum ?
824 600 824 800824 400
824 600 824 800824 400
108
200
108
000
107
800
108
200
108
000
107
800
Théâtre ?
N° des édifices cultuelsAccès probables aux édifices cultuelsSystème d’adduction d’eau
Voie Voie présumée
Accès probables au quartier cultuel
0 100 200 m
Forum ?
824 600 824 800824 400
824 600 824 800824 400
108
200
108
000
107
800
108
200
108
000
107
800
Théâtre ?
Esplanade
Accès 1
Accès 3 ?
Accès 2
voie
1
voie
2
voie
312
13
15
18
17
16
11
181818101818197
1
62
22
20
23
21
24
1
voie
4
fig. 10 - Topographie du quartier cultuel de Nasium. P. Toussaint.
162 Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
Conclusion (P. Vipard)
Malgré une connaissance très imparfaite et majoritaire-ment planimétrique des bâtiments, il semble néanmoins bien établi désormais que Nasium possédait un vaste quartier à vocation religieuse situé sur la marge orien-tale de l’agglomération. Étant donné cette position, il est évident que l’on n’est donc pas en présence d’un sanc-tuaire péri-urbain (c'est-à-dire situé au-delà de la limite de la ville), mais suburbain, selon la terminologie ac-tuelle (Van Andringa 2002, p. 77 ; Péchoux 2010, passim). Quoique commode, il est toutefois évident que l’emploi de ce qualificatif n’est sans doute pas pertinent pour désigner la réalité antique. La nature juridique du secteur n’étant pas connue, rien n’autorise en effet à penser qu’il pourrait s’être agi, à Nasium, d’un faubourg (suburbium), c’est-à-dire d’une zone contiguë à la ville, mais extérieure à elle, plus que d’un quartier urbain à part entière. L’existence de probables limites matérielles (non contraignantes) entre les parties civile et religieuse ne permet pas de trancher ; elle montre simplement l’existence d’une zone spéciali-sée, peut-être contrôlée par l’autorité publique28.
On ne sait à quel moment l’habitat de l’oppidum a com-mencé à descendre dans la vallée, mais le secteur cultuel pourrait avoir commencé à voir le jour dès le troisième quart du ier siècle av. J.-C. si l’on en croit les indices chro-nologiques livrés par le seul site de Mazeroie. Il est pour l’instant impossible de savoir s’il était installé légèrement à l’écart ou juste en limite de la future agglomération romaine, mais l’analyse de la topographie, aussi impar-faite soit-elle, laisse toutefois supposer l’existence d’un véritable quartier cultuel spécialisé au moment où la ville va apparaître à l’époque augustéenne. Leurs développe-ments respectifs semblent avoir été très liés. En effet, même si le quartier religieux semble à l’écart et si ses fana les plus anciens paraissent disposés de façon anar-chique, on doit quand même remarquer que le seul cardo (maximus ?) qui paraît traverser intégralement la ville y
aboutit. Tel que les prospections géophysiques le font ap-paraître, on a l’impression, peut-être trompeuse, que le quartier n’a été rattrapé par l’urbanisation (en maçonne-rie concrète) que plus tardivement, d’abord à l’occasion de phases de monumentalisation dont on observe des traces nettes à partir de la seconde moitié du ier siècle ap. J.-C. à travers les édifices de Mazeroie et des Petites Corvées et postérieurement29. Nettement plus inhabituel en revanche est le déclin précoce, voire la cessation d’une partie de l’activité cultuelle, qui se manifestent par des destructions dès le dernier quart du iie siècle (Mazeroie) et au début du iiie siècle (Petites Corvées), quelquefois même par un démontage systématique dans la pre-mière moitié du iiie siècle. L’ampleur d’une telle tâche est vraisemblablement l’indice d’un travail effectué sous contrôle des autorités de la cité, ce qui conforte l’hypo-thèse d’un sanctuaire public30.
On est bien évidemment tenté de mettre ces observa-tions en rapport avec ce que l’on commence à savoir de l’histoire très particulière de Nasium : d’abord chef-lieu de cité des Leuques, déchu au profit de Toul à une date inconnue, mais que la fin d’utilisation de deux des principaux bâtiments du sanctuaire inciterait éventuelle-ment à placer vers la fin du iie ou au début du iiie siècle31. Ces observations sont révélatrices des liens très étroits unissant le destin des sanctuaires urbains et celui des villes qui les abritaient. À Nasium, peut-être n’a-t-on pas jugé bon, pour des questions pratiques ou rituelles, de continuer à entretenir les édifices liés au culte public (empereur et divinité tutélaire des Leuques), désaffec-tés lors du transfert dans le nouveau chef-lieu. Pour les autres (cultes moins liés au statut juridique et adminis-tratif de l’agglomération), ils ont pu continuer leur activité durant un temps indéterminé, la ville ayant assurément continué d’exister durant tout le iiie siècle et sans doute encore au ive siècle32.
28- Sur les sanctuaires « suburbains » publics (souvent installés – comme ici ? – en périphérie du premier urbanisme augustéen) : Van Andringa 2002, p. 64-81.
29- Transformation de l’édifice à portique des Petites Corvées à la phase 2 ; temple rond (n° 10) d’époque hadrianique ou postérieure (?).
30- L’absence d’information sur les divinités honorées ne favorise pas l’étude. La seule trace probablement rattachable au complexe cultuel (puisque découverte à proximité immédiate du supposé théâtre en 1863) est une dédicace « À Tibère César Auguste, fils d'Auguste, et pour le salut de per-pétuel de la maison divine » qui, en même temps qu’elle constitue l’un des témoignages épigraphiques le plus ancien du culte rendu à la domus diuina dans l’Empire (par exemple, Clauss 1999, p. 270 ou Van Andringa 2002, p. 171 et 202-204), s’avère être une manifestation très précoce du culte impérial sur le site.
31- Ce problème des capitales successives des Leuques fait actuellement l’objet d’une recherche de la part de l’un de nous (P. Vipard).
32- Mourot 2001, p. 439 et 453-456, par exemple.
Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), 163Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
ADAM (Jean-Pierre) La construction romaine. Matériaux et techniques, Paris, Picard, 1989 (2e éd.), 368 p.
ANDERSON (J. C.) « Domitian, the Argiletum and the Temple of Peace », AJA, 86, 1, 1982, p. 101-110.
AUPERT (Pierre) dir. Barzan II. Le sanctuaire au temple circulaire (« Moulin du Fâ ») : tradition celtique et influences gréco-romaines, supplément à Aquitania, 22, Bordeaux, 2010, 470 p.
BAUDOUX (Juliette)Les amphores du nord-est de la Gaule (territoire français). Contribution à l'histoire de l'économie provinciale sous l'Empire romain, DAF, 52, Paris, 1996, 220 p.
BOULANGER (Karine) « Les “qanâts” gallo-romains de Lorraine », dans ABADIE-REYNAL (C.), PROVOST (S.), VIPARD (P.) dir., Les réseaux d'eau courante, dans l'antiquité : réparation, modifications, réutilisations, abandon, récupération, Actes du colloque international de Nancy (20-21 novembre 2009), Rennes, PUR, 2011, p. 133-143.
BRIDEL (Philippe) « Le sanctuaire de la Grange des Dîmes. Témoin de l'évolution de l'architecture religieuse d'Aventicum du ier au début du iie siècle », dans REDDÉ et al. dir. 2011, p. 287-298.
BROUQUIER-REDDÉ (Véronique) et GRUEL (Katherine) « Variations autour d’un plan-type de sanctuaire », dans BROUQUIER- REDDÉ 2006, p. 135-153, fig. 1-15.
BROUQUIER-REDDÉ (Véronique) et al. Mars en occident, Actes du colloque international « Autour d'Allonnes (Sarthe), les sanctuaires de Mars en Occident », Le Mans, université du Maine, 4-5-6 juin 2003, Rennes, Presses universitaire de Rennes, 2006, 337 p.
BRUNET-GASTON (Véronique) « Temple et théâtre en Gaule : une relation architecturale complexe », dans CASTELLA (D.) et MEYLAN-KRAUSE (M.-F.) dir., Topographie sacrée et rituels : le cas d’Aventicum, capitale des Helvètes, Actes du colloque international d’Avenches, 2-4 novembre 2006, Bâle, Archéologie Suisse, 2008, p. 283-286.
BUR (Didier) et al. « Laser Scanning as a Tool for archeological Reconstitution : a Gallo-Roman Temple in Naix-aux-Forges, France », Proceedings of the XIXth International Symposium CIPA 2003, New Perspectives to Save the Cultural Heritage, Antalya, Turkey, 30 September - 4 October, 2003. Url : http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/ doc/antalya/36.pdf
BURNAND (Yves) et VIPARD (Pascal) « Hadrien et la cité des Leuques », Latomus, 70, 4, 2011, p. 1068-1080 et pl. XI-XII.
CAZANOVE (Olivier de) « Le lieu de culte d'Apollon Moritasgus à Alésia. Données anciennes et récentes », RA, 53, 1, 2011, p. 158-169.
CLAUSS (Manfred) Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen Reich, Stuttgart-Leipzig, 1999, 597 p.
DECHEZLEPRÊTRE (Thierry) et MOUROT (Franck), dir. Nasium. Ville des Leuques, Bar-le-Duc, Conseil Général de la Meuse, 2004, 315 p.
DECHEZLEPRÊTRE (Thierry), TOUSSAINT (Perrine), et BONAVENTURE (Bertrand) « Nasium : de l’oppidum à l’agglomération gallo-romaine », dans REDDÉ et al. dir. 2011, p. 129-144.
DOBBINS (John J.) « Problems of Chronology, Decoration, and Urban Design in the Forum at Pompeii », American Journal of Archaeology, 98, 1994, p. 629-694.
Bibliographie
164 Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
FAUDUET (Isabelle) Les temples de tradition celtique en Gaule romaine, Paris, Errance, 2010, 351 p.
FINCKER (Myriam) et TASSAUX (Francis) « Les grands sanctuaires “ruraux” d'Aquitaine et le culte impérial », MEFRA, 104, 1, 1992, p. 41-76.
FORMIGÉ (Jules) « Le sanctuaire de Sanxay », Gallia, 2, 1944, p. 43-120.
GILQUIN (Claudine) « Les fouilles du temple de Mazeroie. 1967-1988 », dans DECHEZLEPRÊTRE et MOUROT 2004, p. 64-69.
GROS (Pierre) L'architecture romaine du début du iiie siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire. 1 - Les monuments publics, Paris, Picard, 1996, 503 p.
GROS (Pierre) « Basilica sous le Haut-Empire. Ambiguïtés du mot, du type et de la fonction », BABESH, 78, 2003, p. 191-204.
LAUFFRAY (Jean) et al. La Tour de Vésone à Périgueux. Temple de Vesunna Petrucoriorum, 49e supplément à Gallia, 1990.
LEGIN (Laurent) « Naix-aux-Forges. Nasium, de l'oppidum gaulois à la ville romaine », dans MASSY (J.-L.) dir., Les agglomérations secondaires en Lorraine romaine, Besançon, Annales littéraires de l'université de Franche-Comté, 1997, p. 231-252.
LINTZ (Guy) Carte archéologique de la Gaule. La Corrèze. 19, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1992, 223 p.
MALIGORNE (Yvan) « Les modèles sud-galliques et la première parure monumentale des villes de Gaule Belgique : l’exemple de Nasium », dans TARDY (D.) dir., Actes des journées d’étude de Lyon sur le décor architectonique des Gaules, université Lyon II-Lumière, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, à paraître.
MANISSE (Pierre-Damien) « Les monnaies des fouilles du temple de Mazeroie, site de Nasium », annexe dans DECHEZLEPRÊTRE et al. 2011, p. 143-144.
MARC (Jean-Yves) et BLIN (Séverine) « Le grand sanctuaire de Mandeure à l'époque impériale et ses destinataires », Bulletin et Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard, 133, 2010, p. 23-54.
MOUROT (Franck) et FRIGERIO (Philippe) « Découvertes récentes sur la topographie de l’agglomération antique de Nasium (Meuse) », RAE, 50, 1999-2000, p. 363-371.
MOUROT (Franck) Carte archéologique de la Gaule. La Meuse. 55, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2001, 656 p.
PECHOUX (Ludivine) Les sanctuaires de périphérie urbaine en Gaule romaine, Montagnac, Mergoil, 2010, 500 p.
POUX (Matthieu) L’âge du vin : rites de boisson, festins et libations en Gaule indépendante, Montagnac, 2004. 637 p.
REDDÉ (M.) et al. dir. Aspect de la romanisation dans l’Est de la Gaule, Bibracte, 21, 1, Glux-en-Glenne, 2011.
TOUSSAINT (Perrine) Les temples et le quartier cultuel de Nasium (bilan des connaissances et essai d'interprétation), mémoire de Master 2 d’Histoire de l’Art et Archéologie, sous la direction de P. Vipard, université de Lorraine - Nancy, 2009, 2 vol., 184 p.
TOUSSAINT (Perrine) « Le bâtiment à abside et son portique : sondages archéologiques de 2007 et 2009 », dans DECHEZLEPRÊTRE (Thierry), dir., Nasium : de l’oppidum à l’agglomération gallo-romaine, Bilan du projet collectif de recherches (2007-2010), Metz, SRA Lorraine, 2011, p. 366-429.
TRANOY (Laurence) et al. « La “Grande Avenue” à Barzan (17) : les acquis des premières campagnes de fouille (2006-2008) », Aquitania, XXIV, 2008, p. 77-104.
Les espaces cultuels de Forum Leucorum/Nasium (Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain, Meuse), 165Pascal Vipard et Perrine Toussaint / p. 147-165
VAN ANDRINGA (William) La religion en Gaule romaine. Piété et politique (ier-iiie siècle ap. J.-C.), Paris, Errance, 2002, 336 p.
VAN ANDRINGA (William) Quotidien des dieux et des hommes : la vie religieuse dans les cités du Vésuve à l’époque romaine, BEFAR, 337, Rome, 2009, 404 p.
VESLY (Léon) Les fana ou petits gallo-romains de la région normande, Rouen, Lecerf, 1909, 170 p.
VIPARD (Pascal) « La “basilique” de Grand : l’histoire d’un nom », Grand, archéologie et territoire, 1, 2013, p. 37-60.