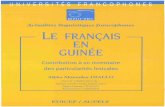Savoirs anthropologiques, administration des populations et construction de l'État
Learning Centres et circulation des savoirs : espaces, frontières, identités / Y. Maury
Transcript of Learning Centres et circulation des savoirs : espaces, frontières, identités / Y. Maury
Learning Centres et circulation des savoirs :
espaces, frontières, identités
Yolande Maury Laboratoire GERiiCO, Lille 3
Les Learning Centres, un modèle de bibliothèque à interroger : du terrain à la recherche
Lille 3, 26 novembre 2014
Learning Centres et circulation des savoirs
En guise d’introduction
« Au lieu de considérer la bibliothèque comme une forteresse isolée, ou
comme un tigre de papier, je voudrais la peindre comme le nœud d’un vaste réseau où circulent non des signes, non des matières, mais des matières devenant des signes. La bibliothèque ne se dresse pas comme un palais des vents, isolé dans un paysage réel, trop réel, qui lui servirait de cadre. Elle courbe l’espace et le temps autour d’elle et sert de réceptacle provisoire, de dispatcher, de transformateur et d’aiguillage à des flux bien concrets qu’elle brasse en continu ».
B. Latour. Ces réseaux que la raison ignore : laboratoires, bibliothèques,
collections. In : Le pouvoir des bibliothèques. Albin Michel, 1996, p. 23
Learning Centres et circulation des savoirs
La bibliothèque, le Learning Centre, nœud d’un vaste réseau où circulent des savoirs
- au cœur de la relation entre savoirs et individus ;
- au cœur de phénomènes d’échanges, de reconfigurations de sens, entrant en jeu dans les savoirs ;
- à la fois transformateur, dispatcher, aiguilleur de flux de savoirs, brassés en continu ;
- au centre de relations de pouvoir, d’influences, liées à la circulation des savoirs…
Une présentation en 3 temps
La circulation des savoirs, une entrée par l’espace ;
Terrains et choix méthodologiques ;
LC et circulation des savoirs : mouvements, frontières, questionnements
- Organisation de l’espace et ordre des savoirs ;
- Un ordre transitoire, questionné-poussé par les usages ;
- Un marquage initial bousculé, des rôles reconfigurés, des identités questionnées
Learning Centres et circulation des savoirs
Le savoir, compris comme un vaste ensemble de représentations, de discours et de pratiques au cœur de toute société humaine
(C. Jacob, 2011)
- le(s) savoir(s), du côté de l’action (act of knowing, F. Barth),
indissociable des situations, des moments, des gestes, des actes dans
lequel il se déclare ;
- une forme privilégiée de rapport de l’homme au monde
se révèle dans les expériences, en relation avec les autres et le monde
Learning Centres et circulation des savoirs
La circulation des savoirs, bien plus que la diffusion ou la transmission de savoirs
- un processus de transformations, bricolage, traduction, avec des productions spécifiques (mises en relation, inscriptions diverses) ;
- un processus dynamique, et collectif (fabrique collective des savoirs), à l’articulation du visible et de l’invisible ;
- un processus, avec des systèmes de normes qui se confrontent, révélant les parts respectives de liberté et de contrainte des acteurs ;
Circulation des savoirs, entrée par l’espace
Interroger le LC à partir d’une étude de l’espace, « dimension cachée de la culture »
- langage de l’espace : sa sémantique implicite, ses codes, ses règles, décomposables et analysables (E. T. Hall) ;
- espace participant au « pouvoir communiquer », comme le langage au «savoir communiquer » (M.C. Ferrao Tavares) ;
- ne fait pas seulement communiquer, organise presque toute la vie
« il est même plus facile de voir comment l’espace peut organiser les activités et les institutions, que de reconnaître la façon subtile dont le langage structure la pensée »
(E.T. Hall, Le langage silencieux, p. 13)
Circulation des savoirs, entrée par l’espace
Interroger la dynamique de l’espace, un espace vécu, un espace sensible, rempli de forces et de mouvements
« Les formes et relations géométriques ne se présentent dans l’espace sensible […] qu’en tant qu’images transitoires et approximatives » (Platon)
« L'espace ne se limite pas à celui d'un géomètre, assemblant des volumes, ni à celui du plasticien qui joue des matières et des couleurs, ni à celui de l'ingénieur qui maîtrise sa construction et ses équipements techniques, ni enfin à celui de sociologues et de psychologues qui ne se préoccuperaient que de sa pratique
sociale et individuelle » (François et Jacques Riva, BBF, 2000, n° 3)
Choix méthodologiques et terrain(s)
Terrain : LC du supérieur
9
Learning center (LC) Caractéristiques du projet
Echéances / phasage Projet pendant l’enquête
n° 1
Grande Ecole
Ile de France
Expansion de services à distance ; nouveaux espaces et offre en culture générale
2008 : inauguration, rénovation des espaces et services
Réevaluations, mises à jour
n° 2
Université
Ile de France
Nouveau bâtiment, espaces modulaires (formation, travail en groupe)
2012 : Notion de LC intégré au projet architectural ;
Janvier 2013 : inauguration
Limites du LC interrogées : bibliothèque universitaire? campus?
n° 3
Université
Midi-Pyrénées
« Troisième lieu » pour ingénieurs : lieu de vie, pédagogie active
4 phases à partir de 2009 : Innovation pédagogique, sociabilité, contacts entreprises
En cours : renforcement des services, restructuration des espaces modulaires multi-fonctions
n° 4
Université
Nord-Pas de Calais
LC « Innovation » : renouveau du campus
Février 2014 - Ouverture Experimentarium ; Projet architectural en cours : espaces évolutifs, salles de travail, convivialité
Développement Experimentarium, lancement travaux
n° 5
Université
Nord-Pas de Calais
LC SHS à vitrine archéologie/égyptologie
Pré-projet rénovation bibliothèque ; Programme de conférences, offre culturelle
Choix méthodologiques et terrain(s)
Terrain : LC du secondaire
Learning center (LC) Caractéristiques du projet Echéances / phasage Projet pendant l’enquête
n° 6
Lycée polyvalent et CFA,
Alsace
Réussite des élèves ; nouvelles formes d’interaction entre enseignants/adultes et élèves
Phase 1, 2013- : reconfiguration des espaces, amélioration des ressources numériques ;
Phase 2, 2014- : modification des pratiques
Modifications spatiales en cours ; discussions sur les rôles
n° 7
Internat de la réussite,
Ile de France
(deux sites : 7A et 7B)
Modernisation de l’infrastructure, environnement d’apprentissage
Phase 1, 2008- : mise en réseau des ressources documentaires ;
Phase 2, 2013- : reconfiguration des espaces, extensions
Modifications spatiales en cours ; installation des ressources numériques ; discussions sur les rôles
n° 8
Collège,
Nord- Pas de Calais
Réussite des élèves, partenariats ;
collège connecté
Phase 1, 2012 -2013 : reconfiguration des espaces
Phase 2, 2013-2014 : intégration NTIC
Evaluation impact NTIC ; consolidation des partenariats ; modification rôles professionnels
n° 9
Collège,
Midi-Pyrénées
Développement “naturel” à partir de proximités créées entre CDI et vie scolaire
Phase 1, 2005 - reconfiguration espaces ;
Phase 2, 2010 - formalisation de la transition du CDI vers le LC
Réflexion en cours sur les ressources numériques
Choix méthodologiques et terrain(s)
Approche qualitative, posture a posterioriste
- LC dans sa globalité : une culture, des pratiques, espace
comme « lieu pratiqué » (de Certeau) ;
- repérer et interroger les dynamiques, les émergences, s’ouvrir à l’inattendu vs catégorisation a priori, hypothèses ;
Observations ethnographiques, avec focalisation progressive
- immersion, sur la durée, description riche (H. Becker)
- notes de terrain, plans, photographies, recueil documents ;
Entretiens formels + conversations informelles
Learning Centres et circulation des savoirs
Deux citations, reprise d’échanges avec des acteurs de LC
« C’est l’espace qui indique …»
« Ce sont les étudiants qui décident et font les usages » Deux exemples qui, bout à bout, posent la question du rapport entre
espace géométrique, organisé selon un tracé régulateur, et espace vécu, espace sensible
Espace et ordre des savoirs
Plusieurs types d’organisation donnant à voir un certain ordre, rendant intelligible le LC
- à l’horizontale, éléments juxtaposés : LC 7 A (distribution autour d’un couloir), LC 8 et LC 9 (salles communicantes) ;
- à la verticale : LC 6 (Alsace), LC 7B (Ile de France) ; - combinaison des deux : niveaux ou plateaux, avec hiérarchie :
espace lieu de vie en rez-de- jardin (LC 2) ; à chaque niveau, juxtaposition d’espaces différenciés (LC 1, LC 2, LC 3);
Espace et ordre des savoirs
Ordre de la bibliothèque revisité, modularité, flexibilité mais permanence d’une hiérarchie des savoirs
- la bibliothèque, cœur du LC, comme lieu de travail individuel et collectif
(vs espace d’information) : travail silencieux, concentration, en appui
sur les ressources de cours (vs fonds documentaire)
« Learning, not information, is increasingly the focus » (Brown et Long, 2006) ;
- dans certains cas, déplacement vers les marges : presse actualité,
culture-loisirs, documentation orientation (zones chaudes : zones de
passage, espaces convivialité, vie scolaire) ;
Espace et ordre des savoirs
Les ressources / presse actualités-culture-fonds manga
LC1, à l’accueil, Actualité et culture LC 2, la Buvette, rez-de-jardin
Espace et ordre des savoirs
- à la périphérie, espaces dédiés à la formation, en université
(espaces clos vs open space, relation sacré/profane ?)
LC 2, salle de formation LC 1, espace CTI, à l’extérieur
Espace et ordre des savoirs
- des espaces de formation intégrés dans le secondaire
LC 8, collège connecté LC 6, salle interne au LC
Un ordre transitoire, questionné par les usages
Des espaces délaissés, marqueur d’évolution dans l’approche des savoirs
l’espace périodiques LC 1 les points info, LC 2 (photo), LC 1
Un ordre transitoire, questionné par les usages
Des résistances au tout numérique, une permanence de la culture papier-crayon // prescriptions enseignantes
LC 7A, cahiers, fiches bristol, polys LC 2, culture livre, prise de notes
Un ordre transitoire, questionné par les usages
LC 1, écran noir, omniprésence polycopiés et bibliographies sélectives
Un ordre transitoire, questionné par les usages
LC 2, écrans noirs,
travail sur documents papier
« C’est une manière plus apaisée d’être en relation avec […] le savoir » A un moment donné, c’est important de pouvoir figer » (entretien enseignant, LC 6)
Un ordre transitoire, questionné par les usages
Une superposition des usages, une continuité des savoirs, un dépassement des frontières
- travail dans les lieux de vie et les espaces intermédiaires ;
- travail en solitaire dans les salles de travail de groupe (LC 1, LC 2)…
travail dans le
hall, LC 6
espace tutorat
étudiant seul, LC 2
Un ordre transitoire, poussé par les usages
Un mouvement centre périphérie, des connexions
LC 1 , vers des espaces proches (boxes), même principe que
les salles de travail en groupe
Un ordre transitoire, poussé par les usages
LC 7 B (tisaneries) et 7A (couloirs), extension sur le modèle rhizome
Un ordre transitoire, poussé par les usages
LC 7A, travail dans les couloirs près du LC, dans le hall d’entrée
Marquage bousculé, identités questionnées
“L’espace est un des lieux où le pouvoir s’affirme et s’exerce, et sans doute sous la forme la plus subtile, celle de la violence symbolique, comme violence inaperçue”
(Bourdieu, P. La Misère du monde. Seuil, 1993, p. 249-262)
« Notre identité sociale apparaît toujours en premier lieu dans et par l’espace »
(Fabienne Cavaillé, 1999, p. 15, à propos de l’expropriation).
Marquage bousculé, rôles reconfigurés
Des rapprochements // glissements dans la circulation des savoirs
- peu de rapprochement enseignement-documentation dans
le supérieur (relation sacré/profane ?) : enseignants peu présents
(usagers « rares ») ; séances de formation (teaching) peu nombreuses, concentrées sur des temps forts, dans des espaces clos en périphérie ;
- des rapprochements dans le secondaire : séances plus nombreuses,
réparties dans l’année ; enseignants inégalement présents ; dans certains cas, temps de présence augmenté ;
- rapprochement vie scolaire-bibliothèque dans le secondaire, résistance
des enseignants à « intervenir » en vie scolaire (frontière invisible).
Rôles reconfigurés, identités questionnées
LC 1, décembre 2013 LC 6, relevé des séances,
Google Scholar pratique nov 2013-janv 2014
Rôles reconfigurés, identités questionnées
LC 6, accompagnement LC 8, « aide aux devoirs »
élèves sur Europresse équipe pédagogique
Rôles reconfigurés, identités questionnées
Un élargissement des interventions, un rapprochement « top-down » et « bottom-up » (savoirs nobles savoirs moins nobles)
- des transferts, de compétences techniques vers la documentation,
nouvelle fonction créée en « communication » pour la promotion du LC (LC 1) ; de la bibliothéconomie vers la formation (LC 1, LC 2) ;
- notion d’accueil revisitée (LC1, LC 2, LC3, LC 6, LC 7, LC 8, LC 9)
« Les étudiants commencent à ne plus nous voir comme des caissières […] à biper des bouquins », [ils] « viennent vers nous pour poser des questions … de recherche documentaire… qu’on ne faisait pas trop avant », [ils] « prennent conscience de notre rôle » (bib. assistant spécialisé, LC 2)
Rôles reconfigurés, identités questionnées
Des rapprochements, des décloisonnements, à l’origine de flottements, de malaises/ou et de résistances
- « bon, c’est compliqué de savoir qui s’occupe de qui… » (CPE, LC 8) ;
- « un binôme bibliothécaire/enseignant-chercheur, moi je pense que ça ne peut être que positif » « il faut que la réflexion se poursuive » […] « les enseignants, on a été formés » (enseignant-chercheur, LC 5) ;
- « le fait d’être en open space est pertubateur » « les temps de tout le
monde sont mélangés » (enseignant, LC 6)…
En conclusion…
- Le LC , un espace « hasardeux, accidenté », co-construit dans les interactions ;
- Des messages ambigus, parfois contradictoires sur la circulation des savoirs ;
- Un élargissement à des formes « moins nobles », une « courbure » de l’espace-temps, à l’origine de résistances et questionnements ;
- un « réceptacle provisoire », pas de modèle, un processus évolutif , débordant de la bibliothèque au sens classique
« Quand on ne parlera plus de Learning Centre car tout le campus sera un Learning Centre, on aura réussi le projet »
(conversation informelle, conservateur LC 2)
Références bibliographiques
Barth, Fredrik. An anthropology of knowledge. Current Anthropology, vol. 43, n° 1, p. 1-11.
Becker, Howard S. Les ficelles du métier : Comment conduire sa recherche en sciences sociales. La Découverte, 2002. 352 p. (Guides Repères)
Bennett, Scott. Righting the balance. In : Library as Place: Rethinking Roles, Rethinking Space. Washington, D.C. : Council on Library and Information Resources, 2005, p. 10-25.
Bourdieu, Pierre. La Misère du monde. Seuil, 1993.
Brown, Malcom, Long, Philip. Trends in Learning Space Design. In : Oblinger, Diana G. (Ed.).
Learning Spaces. Educause, 2006.
Cavaillé Fabienne. L’expérience de l’expropriation. Paris : ADEF, 1999. 222 p.
Certeau, Michel de. L’invention du quotidien. 1. Arts de faire. Gallimard, 1990.
Depaule, Jean-Charles et Arnaud, Jean-Luc. A travers le mur. Paris : Centre Georges Pompidou, 1985.
Fabbri, Paolo. Considérations sur la proxémique. Langages, 1968, vol 3, n° 10, p. 65-75.
Références bibliographiques
Fabre Isabelle, Gardiés Cécile. Expected usage and perceived usage, photography as a methodological tool: the case of a learning centre in France ». Libraries in the Digital Age (LIDA), 2014, vol. 13.
Hall, Edward T. Le langage silencieux. Paris : Seuil, 1984.
Jacob, Christian. Pour une anthropologie des savoirs. Conférence présentée le 4 février 2011 devant la Société Française pour l’Histoire des Sciences de l’Homme. Paris : EHESS, 2011.
Kovacs, Susan, Maury, Yolande. Studying User Appropriation of University and Secondary school «Learning Centers»: Methodological Questions and Issues. In: Aparac Jelusic, Tatjana, Saracevic, Tefko. Libraries in the Digital Age (LIDA) 2014, Zadar, Croatia, 16 - 20 June 2014.
Latour, Bruno. Ces réseaux que la raison ignore : laboratoires, bibliothèques, collections. In Baratin M., Jacob C. Le pouvoir des bibliothèques : la mémoire des livres en occident. Albin Michel, 1996.
Le Corbusier. Oeuvres complètes,1910-29. 9e éd. Zurich : Les Editions d’Architecture, 1967.
Low, Setha M., Lawrence-Zuniga, Denise. The Anthropolgy of Space and Place : Locating Culture. Blackwell Publishing, 2012.
Références bibliographiques
Maury, Yolande. Espaces documentaires, espaces de savoir, espaces d’expérience : vers une (re)définition du modèle des CDI ? In : McKenzie, Pam, Johnson, Catherine, Stevenson, Sarah (coord.). Les intersections : gens, lieux, information. 39e congrès annuel CAIS-ACSI. Fredericton, Nouveau-Brunswick, Canada. Université du Nouveau-Brunswick et Université Saint-Thomas, 2-4 juin 2011, 5 p. http://www.cais-acsi.ca/proceedings/2011/13_Maury.pdf
Maury, Yolande (dir.) « (R)évolutions dans les bibliothèques ? Les learnings centres, un modèle de bibliothèque à interroger » Bonus Qualité Recherche (BQR) 2013-2014, Lille 3. Recherche impliquant trois laboratoires : GERiiCO (Lille 3), Susan Kovacs, Yolande Maury, Florence Thiault, Jacques Sauteron ; CIREL (Lille 3), Sylvie Condette ; EFTS (Toulouse), Isabelle Fabre, Cécile Gardiès.
Platon. Timée, Critias. 5ème éd. màj. Garnier Flammarion, 2001.
Riva, François et Riva, Jacques. La mise en vie des espaces de bibliothèques. Bulletin des bibliothèques de France, 2000 , n°3. http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-03-0070-007.
Segaud, Marion, Anthropologie de l’espace : habiter, fonder, distribuer, transformer, 2ème éd. Armand Colin, 2012.