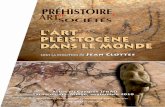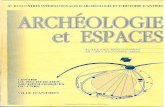Entre association légale et société politique informelle : les espaces de sociabilité en France...
-
Upload
landaverde -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Entre association légale et société politique informelle : les espaces de sociabilité en France...
1
Congrès de la Société Canadienne d’Etude du Dix-Huitième Siècle et de la Eighteenth-
Century Scottish Studies Society, « Sociabilité en révolutions au XVIIIe siècle », Montréal,
16-18 octobre 2014.
Session « Pouvoir, politique et réseaux de sociabilité ».
- Vivien Faraut -
Entre association légale et société politique informelle : les espaces de
sociabilité sous en France sous la Restauration.
Depuis le retour de Louis XVIII, la France est en perpétuelle opposition entre les
tenants de l’Ancien Régime et ceux ouverts aux idées de la Révolution. Ce conflit se
cristallise à la Chambre des députés où s’affrontent, de 1817 à 1830, une droite royaliste
voire ultraroyaliste et une gauche libérale. Au fur et à mesure que s’égrènent les années, la
vie politique est marquée par de fréquentes oscillations vers la droite. Cela se traduit, entre
autre, par la mise en place d’un arsenal législatif liberticide, contraignant les opposants
libéraux à inventer ou réinventer, sans cesse, des formes de contestation, plus ou moins
directes et violentes, allant de la pétition à la conspiration.
Dans ce contexte, les espaces de sociabilité politique qui ont fleuri pendant la période
révolutionnaire n’ont plus cours sous la Restauration. L’édifice législatif encadrant le droit de
réunion est, sous le régime de la Charte, identique à celui mis en œuvre avec le Code pénal
napoléonien. Les articles 291, 292, 293 et 294 en sont les piliers. De ces quatre articles,
retenons que pour toute association à l’effectif supérieur à vingt personnes dont le but est de
se réunir à jours fixes pour discuter « d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres [cela]
ne pourra [s]e faire qu’avec l’agrément du Gouvernement et sous les conditions qu’il plaira à
l’autorité publique d’imposer à la société ». C’est avec un cadre strict que, partout en France,
des associations, que l'on trouve sous différentes dénominations telles que cercles ou
sociétés vont demander l’autorisation de se réunir. Ces trois termes seront indistinctement
employés par la suite.
Ces associations ont de nombreux points communs. Leur but est d’offrir un espace de
détente pour leurs membres avec, notamment, la possibilité de jouer aux jeux de société,
mais également de lire la presse. Elles sont fermées sur le monde profane, pour y adhérer il
faut être coopté par un ou plusieurs sociétaires. Enfin, l'association loue un local. Les frais
d'entretiens – chauffage, éclairage entre autres - ainsi que l'abonnement à la presse sont
payés par les cotisations annuelles. Ces espaces, a priori apolitiques, vont pourtant être des
lieux de sociabilité politique informelle. Il s’agira d’analyser quels sont les processus qui
permettent cela. Notre propos est construit en deux temps. Un premier durant lequel la
question des logiques d'implantation, de développement des associations et de leur
récupération par les libéraux sera posée. Puis un second où nous analyserons, au travers de
2
l’exemple de la ville d’Angoulême, l'action politique menée à destination du monde profane.
I. Création, développement et récupération de l’association au profit des
libéraux.
Avant de s'intéresser aux stratégies d'implantation et de développement des associations, il
est important de préciser qu'il faut distinguer l'attitude des différents membres d'une même
société vis-à-vis de la vie politique. En effet, tous les membres ne sont pas des libéraux
exaltés. Il en est bien évidemment de même pour les royalistes. On trouve dans tous les
cercles deux catégories de membres : ceux qui sont engagés totalement dans l'action
politique et ceux qui sont, a contrario, très peu engagés. Il s'agit là d'une nuance
fondamentale.
Répartition spatiale du phénomène associatif dans le Gard.
Un panorama général des associations en France sous la Restauration reste difficile à
dresser. C’est dû à un niveau de précision de l’information inégal selon les départements.
Cependant, une vaste enquête lancée au cours de l’année 1820 permet d’avoir quelques
estimations de la répartition de ces sociétés et de leur coloration politique d’après les préfets.
Les rares documents parvenus permettent d'observer, à l'échelle départementale,
l'implantation de ces sociétés. Le département du Gard pour lequel le préfet établit un
rapport très détaillé de la situation illustre cela. Il identifie 37 associations, représentées sur
cette carte. Ces associations sont réparties entre 13 cités différentes. Nîmes, chef-lieu de
préfecture abrite à elle seule 9 sociétés, là où des communes de plus modeste envergure
comme Roquemaure ou Lasalle n’en ont qu’une. Le premier constat reste celui d'une inégale
répartition. Cependant tant les villes que les villages d'une moindre importance abritent ces
concentrations d'hommes.
3
Figure 1 Les sociétés du département du Gard
Mais si l’on prend en compte la tendance politique dominante au sein des associations,
tendance telle que le préfet la définit, les clivages à l’intérieur des cités apparaissent, et
permettent de noter des oppositions entre libéraux et royalistes. La carte projetée ici rend
compte de cela. Dans les principales villes du département (Alès, Uzès et bien évidemment
Nîmes), un clivage a lieu. La présence dans ces espaces peut s'expliquer principalement par
4
le fait qu'outre la concentration d'hommes et donc des capitaux nécessaires pour la bonne
tenue de ces sociétés, la vie électorale y a lieu. Les collèges électoraux s'y réunissent et la
presse s'y diffuse plus facilement et rapidement que dans les villages reculés. Cependant, le
rapport préfectoral qui a fourni les données n'est exhaustif que pour les associations de plus
de 20 personnes. De ce fait, on ne peut écarter l'existence d'associations plus faibles
numériquement.
6
La carte produite ici permet une capture à l'instant t, soit en juin 1820, de l'état du
département. Cette carte trace les contours à l’intérieur desquels les sociétés vont se créer
et se développer.
Les tactiques libérales pour obtenir ces espaces de sociabilité.
Suivant les réalités locales, les partisans du libéralisme auront tout un éventail de
stratégie à disposition. Ce dernier devant permettre de détourner les associations de leur
rôle initial. Trois stratégies sont identifiables. 1. Lorsque l’ensemble des membres fondateurs
sont ouverts aux idées libérales, il suffit simplement pour eux de mettre en place un
règlement (dans lequel ils prennent soin de ne pas mentionner l'interdiction des discussions
politiques), ils le proposent aux autorités (maire, puis préfet puis ministère) et espèrent
recevoir l'autorisation du droit de se réunir. Ce droit est soumis à un sévère examen, le
ministre de l’Intérieur somme le préfet et ses agents de trouver tous les moyens possibles
pour refuser la requête (et fait insérer systématiquement dans le règlement, l'interdiction de
discuter politique). Une fois l'autorisation accordée, le cercle est scruté scrupuleusement à la
recherche d'un motif valable d'interdiction. C'est le cas notamment du Cercle du Commerce
de Bordeaux. Ce dernier, composé de 300 personnes, obtient l'autorisation en 1820. Parmi
ses membres, se trouve toute l'élite négociante, protestante et libérale de la ville. Citons par
exemple la famille Balguerie ou encore la famille Fonfrède, revenue d'exil et propriétaire de
la principale feuille libérale de la ville.
2. Lorsque les membres fondateurs ne sont pas unis par une appartenance politique
strictement définie, l'obtention de l'autorisation est facilitée. Le plus souvent les autorités
estiment que la présence de royalistes permettra de savoir ce qu’il en est des plans des
libéraux. La contrepartie de cette coexistence entre des individus partageant des opinions
divergentes est la restriction des espaces de discussion politique. La salle principale étant un
espace de sociabilité apolitique. Le cas du salon Pullignieu à Montauban (Tarn et Garonne)
est révélateur de cette situation. Société qualifiée de composite, les libéraux se réunissent
en petit comité dans les salles annexes de la maison où est implantée l’association. Les
discussions à caractère politique débordant très rarement de ces espaces, leur contenu nous
reste inaccessible.
3. Enfin, il arrive en de rares cas que les libéraux poussent, progressivement, les membres
fondateurs (qui ont obtenu l'autorisation) et qui sont soit pas ou peu intéressés par la
politique, soit royalistes, vers la sortie. Cela procède d'une stratégie de prise de contrôle de
l’espace. Le cas du cercle du commerce de Nancy, dit également Casino, l’illustre. En
octobre 1820, 37 habitants de Nancy font une demande d’association auprès du préfet de la
Meurthe. Sur ces 37, un tiers environ sont d’anciens officiers de l’armée française, huit sont
7
des membres de la Garde nationale nancéienne.
Figure 3 Les fondateurs du cercle de Nancy (1820) - professions
De plus, les membres fondateurs collectionnent les distinctions. 23 décorations ont
été obtenues : 13 médailles de l’ordre de Saint Louis ont été octroyées par Louis XVIII ; 9
membres ont le grade de chevalier de la légion d’honneur. Enfin, un individu peut également
revendiquer le titre de chevalier de l’ordre de Saint Michel.
8
Figure 4 Les fondateurs du cercle de Nancy (1820) – distinctions À partir de ces brefs éléments, on peut déjà entrevoir les contours du portrait du
partisan du royalisme tel que l'a brossé Oliver Tort. Les autorités municipales et préfectorales
n'hésitent pas à soutenir la demande auprès du ministère de l'Intérieur. L’autorisation est
délivrée en fin d’année 1820. Deux années plus tard, ce Casino inquiète les autorités. En
cause, le fait que se réunissent « plus de 200 personnes dont la majorité est connue pour
professer des opinions libérales ». Ce sont 242 membres exactement. Les 37 fondateurs ont
quitté la société. Mais surtout, la composition sociale et professionnelle des nouveaux
membres révèlent des mutations profondes : les professions du monde du négoce sont les
plus représentées avec 28% de ces membres, suivis des rentiers (13%) et enfin, les
professions du droit et les militaires (dont la majorité sont des sous-officiers) sont les plus
représentés.
9
Effectif réel Fréquence (en %)
Professions du négoce 70 28
Rentiers 33 13
Militaires 31 12
Professions du droit 30 12
Professions notariales 15 6
Artisanat 12 5
Médecins et professions de la santé 11 4
Fonctionnariat 9 4
Autres 8 3
Sans emploi ou en retraite 7 3
Propriétaires 7 3
Professorat 6 2
Professions de la banque 6 2
Monde de l'édition 6 2
Agricultures 2 1
Figure 5 Les membres du cercle de Nancy (1822) – professions Outre une composition sociale en rupture avec celle des membres de 1820, il faut
également souligner qu’aucun membre ne revendique une quelconque distinction. On
retrouve ici également les principaux traits des partisans du libéralisme de la Restauration,
des personnes issues du monde du négoce ainsi que des sous-officiers français. La rupture
totale intervenue en deux ans peut s’expliquer notamment par la méthode de cooptation qui
semble avoir permis aux libéraux d’y entrer. Cependant la question des premières entrées
d'individus tenant des idées nouvelles reste entière. Et on en est réduit à deux hypothèses :
soit la société était initialement apolitique et le virage libéral a alors poussé les anciens
membres vers la sortie, soit les fondateurs étaient un tant soit peu politisé et donc il y a eu
des adhésions qui ont changé la donne et poussé vers la sortie les autres.
Toujours est-il que les stratégies employées par les libéraux pour obtenir des espaces
de sociabilité politique informelle sont plurielles. Une fois l'autorisation obtenue, il est
important de trouver des moyens pour les conserver. L'attitude ministérielle à l'égard des
associations dont on sait pertinemment que des libéraux en sont membres est marquée par
la volonté de trouver tous les moyens de les interdire. Le cercle de Nancy, dont il a été
question, offre un exemple de la difficulté rencontrée par les libéraux. En effet, la conspiration
de Belfort des carbonari français en janvier 1822 fournit l'occasion aux autorités d'ordonner
la fermeture du Casino de Nancy. Un arrêté ministériel le ferme sans fournir d'explications.
Les 4 articles du Code Pénal sont présentés comme unique motif. Cette fermeture amène
les membres du cercle à se mobiliser. Face à cette décision arbitraire, ils n'hésitent pas à
demander au journal libéral Le Constitutionnel de se faire l'écho de la situation. Mais surtout,
les membres vont trouver des relais politiques importants par le biais de trois députés de la
Meurthe Louis, Laruelle et Grandjean. Le premier étant l'ancien ministre de Louis XVIII qui,
10
au moment des faits, a pris une petite place sur le canapé doctrinaire, les deux autres
oscillant d'avantage vers l'extrême gauche libérale. L'appui sur des personnalités politiques
nationales pour « protéger » l'association est un procédé constant. À différents degrés, les
cercles à tendances libérales y ont recours. Dans le département de la Vienne, le cercle de
Châtellerault nomme même, en 1827, le marquis Voyer d'Argenson, ténor libéral à la
Chambre, comme président. L'objectif étant toujours de disposer d'un relais auprès des
autorités parisiennes.
Les processus de récupération et de développement ainsi que les stratégies
d'implantation des sociétés par les libéraux sont nombreux mais procèdent toujours de la
volonté de protéger ces membres et d'obtenir des espaces de réunion. Mais les membres de
ces cercles ont néanmoins des objectifs à destination du monde profane.
II. Angoulême : entre reconfiguration du tissu associatif et activités.
Le cas de la Charente en général, et de la ville d’Angoulême en particulier, illustre les
différents aspects dont il a été question jusqu’à maintenant et permet de mesurer l’action des
membres à l’extérieur de la société.
Angoulême, chef-lieu de préfecture de la Charente, ville de 15 000 d’habitants en
1820, abrite depuis 1810 « une réunion d’hommes formée de tous les magistrats, et citoyens
les plus recommandables de la ville ». Cette dernière prend le titre de « Cercle de l’Union ».
Elle semble être, jusqu’au tournant de l’année 1819 la seule association de plus de 20
personnes dans la ville.
C'est le contexte national qui va amener un changement. À cette époque, les prémices
d’une modification de la loi électorale apparaissent. Le projet dont il est question a pour but
d'endiguer l’épidémie libérale qui sévit à la Chambre des députés. Il va entrainer des
répercussions sur la vie associative de la ville. Le cercle de l'Union va se scinder en deux.
Cette scission s’opère sur fond de clivage entre partisans de la proposition de modification
de loi électorale, assimilables à des ultraroyalistes ; et opposants, ceux qui restent dans la
lignée du ministère Dessolles-Decazes, qui tente l'ouverture libérale. Ce sont ces derniers
qui vont fonder une seconde société. Progressivement, les libéraux vont massivement
l'investir. Tant et si bien, qu’à partir de la fin de l’année 1819, il existe deux associations
distinctes politiquement : le Cercle de l’Union et le Cercle littéraire. Ce dernier va permettre
aux libéraux charentais de se doter d’une structure.
Dès l'année suivante, les membres du Cercle littéraire sont à l’œuvre. En 1820, un
projet de loi modifiant la loi électorale est proposé aux Chambres. En réaction, une
campagne de pétitions contre ce projet débute. Dans toute la France, des pétitions
demandant le maintien de la loi en vigueur (celle favorable aux libéraux) sont réunies. Le
département de la Charente est le théâtre d'une mobilisation orchestrée par deux membres.
11
Le maréchal de camp Pinoteau ainsi que le colonel en non activité Gannivet de Graviers
sont chargés de faire circuler les pétitions et d'en recueillir les signatures. Cet épisode scelle
le basculement des membres du Cercle littéraire. Le préfet de la Charente note qu’après
l’épisode des pétitions « quelques hommes prudents s’en sont retirés ». Et le préfet de
souligner que le Cercle sera appelé à devenir « le foyer où s’organiseront les moyens
d’influencer les prochaines élections ». Les membres du cercle qui se lance dans la bataille
électorale connaissent des fortunes diverses, le candidat Gannivet du Graviers, celui-là
même qui récoltait pour les pétitions, est défait. Alors qu'un autre, François Albert, député
appartenant au centre d’après ces contemporains, triomphe. Mais le cas du député Albert est
unique car, une fois élu il quitte le cercle. De plus, ce dernier n'est pas reconnu comme étant
un farouche partisan du libéralisme. L'hypothèse d'un détournement du capital social offert
par le cercle à des fins personnelles est à explorer ; une comparaison entre les membres du
cercle et les électeurs de l'arrondissement d'Angoulême (qui ne doit dépasser guère les 200
unités) livrerait quelques réponses.
Mais l’activité politique s'exerce dans d'autres canaux et en d'autres lieux. Certains
membres du cercle entretiennent des correspondances avec les ténors du libéralisme
parlementaire : Caminade de Chatenay, préfet de l’arrondissement de Cognac sous l’Empire
est en contact, entre autre, avec le marquis Lafayette, ténor de l’opposition libérale à la
Chambre. Ou encore le négociant Martell, futur député, qui, alliant commerce et politique est
le relais charentais du banquier Jacques Laffitte. Mais les liens entre local et national
s'expriment principalement lors des préparatifs pour la venue de figures de l’opposition
libérale. Ce sont les membres du cercle qui en sont en charge. Lorsqu’un banquet est donné
en l’honneur du député d’extrême gauche Beauséjour le 24 août 1820, on ne saura s'étonner
de trouver dans la liste des souscripteurs la plupart des membres du Cercle. Ces derniers
mangeant, buvant et trinquant à la liberté. Les Cercles, si l'on doit se livrer à une
hiérarchisation des activités, font de l'organisation des banquets leur activité centrale. Le
cercle de Pulligneu dont il a été question précédemment est à l'œuvre chaque fois qu'il s'agit
d'honorer les députés.
Dans le cas angoumoisin, l’activité politique du Cercle littéraire pose d’évidents
problèmes pour l’autorité. Dès sa création, il est dans le collimateur des autorités. À partir de
1820, le préfet de la Charente n’hésite pas à réclamer la dissolution de cette association.
Trois ans plus tard, alors que se profilent les élections de février 1824, le ministère Villèle,
soucieux de remporter une victoire électorale décisive dans sa lutte contre les libéraux,
prépare activement les candidatures dans les départements. En Charente, le préfet remet
son rapport mensuel sur l’esprit public. Il note qu’un changement a eu lieu à la tête du cercle
avec la nomination à la présidence d’un certain Gélibert. Ce dernier, médecin à Angoulême,
est, de l’avis du préfet, « un ultra libéral qui a beaucoup d’esprit [il] pourrait être dangereux,
12
d’autant qu’il serait candidat aux prochaines élections ». Le préfet de la Charente prescrit en
conclusion de son rapport la fermeture du cercle, chose faite par décision ministérielle.
Le cas du cercle littéraire d'Angoulême montre les procédés d’intégration dans le tissu
politique local. D'autres cas auraient tout aussi bien permis d'illustrer la quête de structures
locales qui occupent des fonctions de réunion, de préparation et de diffusion du message
politique à la fois en son sein mais également vers l'extérieur.
En conclusion, les associations, sous la Restauration, figurent parmi les outils à
disposition des libéraux pour la propagation de leurs idées. Présentes dans toute la France,
elles sont tout à la fois des lieux de détente, de rencontre, de structuration des réseaux
locaux et surtout de diffusion des idées dans une double logique : interne et externe. Les
processus de récupération de ces espaces mis en œuvre par les libéraux permettent de
contourner la législation en vigueur et ceux qui l’appliquent. Détournées de leur but premier,
les associations prennent la place de vecteur de sociabilité politique. Elles ont une double
fonction : à la fois en leur sein, par la rencontre et les réunions ; mais à la fois vers l'extérieur
où certains de leurs membres sont des animateurs de la vie libérale locale. Le cas du cercle
d’Angoulême a mis en lumière leur rôle ainsi que les procédés employés pour insérer la
Charente dans le tissu national de l’opposition libérale.
Plus généralement, dans « le processus de descente de la politique vers les masses »
mis en lumière par Maurice Agulhon, nous n'en sommes ici qu'à ses balbutiements. En effet,
la situation législative et la capacité de mobilisation des membres de ces sociétés ne
permettent pas (pour différentes raisons qui amènent à s'interroger sur la nature et les
nuances du libéralisme de la Restauration) une ample diffusion des idées libérales.
Sans parler uniquement de cercles dont tous les membres seraient libéraux, les
différentes formes d'engagement et les trajectoires personnelles des acteurs se rejoignent
dans ces espaces dont le rôle sera accru dans les années qui suivent les Trois Glorieuses.