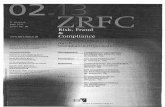« Les philanthropies : un objet d’histoire transnationale », introduction au numéro spécial «...
Transcript of « Les philanthropies : un objet d’histoire transnationale », introduction au numéro spécial «...
IntroductionLes philanthropies : un objet d’histoiretransnationale
Thomas DavidUniversité de LausanneÉcole polytechnique fédérale de Lausanne
Ludovic TournèsUniversité de Genève
La philanthropie fait partie de ces notionssi vastes qu’elles constituent un défi pour
l’analyse historique. Action en faveur d’autrui,elle est fondamentalement un don (de temps,d’argent, de biens, de services) et tisse une rela-tion forteentre ledonateuretsonrécipiendaire1.Cette relation a priori asymétrique et unidirec-tionnelle entre le premier qui agit et le secondqui reçoit est plus complexe qu’il n’y paraît,notamment parce qu’elle se caractérise par uneinterdépendance forte : d’abord parce que lerécipiendaire contribue à l’élaboration du pro-cessus de don, mais aussi parce que le donateurattend de celui-ci un retour sur investissement(en termes financiers ou symboliques), et enfin
1 Voir par exemple à ce sujet Amy Singer, “Special Issueintroduction”, “Politics of Benevolence”, InternationalJournal of Middle East Studies, vol. 46 (2014/2), p. 227-238; Lawrence J. Friedman, “Philanthropy in America:Historicism and its Discontents”, in Lawrence J. Friedman,Mark D. McGarvie, eds., Charity, Philanthropy, and Civilityin American History (Cambridge: Cambridge UniversityPress, 2003), p. 1-21; Nicolas Guilhot, Financiers, philan-thropes : Sociologie de Wall Street, Paris, Raisons d’agir,2006 [1re éd. 2004], introduction.
parce que le résultat du don a un impact surle donateur comme sur le récipiendaire. Et sil’on imagine principalement la philanthropiecomme une activité de proximité, il arrive sou-vent que le donateur et le récipiendaire soientséparés par des milliers de kilomètres, commeon le verra dans les articles de ce numéro. À cetitre, l’analyse des relations d’interdépendanceentre ces deux acteurs constitue un magnifiqueobjet d’histoire transnationale – ou globale, oumondiale, comme on voudra.
Philanthropie ou philanthropies ?
Bien qu’elle ne possède dans son acception ori-ginelle grecque aucune dimension religieuse,la notion de philanthropie est devenue au filde l’histoire synonyme de charité et de bien-faisance, deux activités qui ont été longtempsl’apanage des organisations religieuses. Maisle concept se sécularise à la fin de l’époquemoderne :auXVIIIe siècle, lorsque le terme« phi-lanthropie » fait son apparition en français chezFénélon, il désigne une vertu civique, humaniste
rticle on linerticle on line monde(s), n° 6, novembre 2014, p. 7-22
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 7 — #7
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Thomas David – Ludovic Tournès
et laïque avant la lettre, qui s’inscrit en ruptureavec la charité chrétienne2. De fait, au XIXe siècle,la philanthropie se sécularise progressivement,même si, en pratique, la frontière qui la séparede la sphère religieuse reste poreuse et difficileà tracer : les deux formes coexistent étroite-ment au moins jusqu’au début du XXe siècle, etl’on constate encore une telle coexistence denos jours. Il n’en reste pas moins que depuis ledébut du XIXe siècle, les individus ou les groupesqui se réclament de la philanthropie se sontmul-tipliés, donnant à cette notion une diversité trèsgrande (accentuée par les sens différents don-nés au terme selon les pays3), dont on verraquelques exemples dans ce numéro. Cette diver-sité justifie le fait de parler du terme au pluriel.
Les mouvements abolitionnistes du début duXIXe siècle, dont les motivations sont complexes,entrent incontestablement dans la catégoriedes sociétés philanthropiques transnationales.Leurs avatars au XXe siècle sont les multiplesassociations de défense des droits de l’hommequi agissent dans des domaines très divers,depuis la défense des indigènes – thème del’article d’Emmanuelle Sibeud – ou minoritésethniques, jusqu’à ceux des prisonniers ou exi-
2 Céline Leglaive-Perani, « De la charité à la philanthropie.Introduction », Archives Juives, 2011/1, p. 4-16.
3 Klaus Weber, « ‘Wohlfahrt’, ‘Philanthropie’ und ‘Caritas’ :Deutschland, Frankreich und Großbritannien im begriff-sgeschichtlichen Vergleich », in Rainer Liedtke, KlausWeber (dir.), Religion und Philanthropie in den europäi-schen Zivilgesellschaften. Entwicklungen im 19. und 20.Jahrhundert, Paderborn, F. Schöningh/W. Fink, 2009,p. 19-37.
lés politiques – traités dans l’article de PaolaBayle et Juan José Navarro –, en passant par lesdroits des femmes, etc. Mais la philanthropieregroupe aussi les formes modernes d’actioncaritative instaurées par la CharityOrganisationSociety anglaise créée en 1869, laquelle élaboreune méthode qui sera perfectionnée quelquesdécennies plus tard par les grandes fondationsaméricaines. Celles-ci inaugurent en effet l’èrede la « philanthropie scientifique », dont l’ob-jectif n’est pas de traiter les problèmes sociauxen aval par l’action caritative, mais en amont,par l’analyse scientifique cherchant à détermi-ner leurs causes afin d’élaborer des solutionsapplicables à grande échelle. La philanthropiescientifique est indissociable d’une forme deprofessionnalisation, non seulement parce queles multiples fondations deviennent des appa-reillages administratifs complexes, mais aussiparce qu’elles font un appel massif à l’expertisedes spécialistes4. Les contributions d’IngeborgStensrud sur les activitésde la fondationFordenEurope de l’Est durant les années 1950 et 1960et de Teresa Pospísilová sur la Fondation Sorosdans la même région du monde depuis la der-nière décennie du XXe siècle mettent en lumièreles activités internationales de ces grandes fon-dations américaines.
4 Robert A. Gross, “Giving in America: From Charity toPhilanthropy”, in Lawrence J. Friedman, Mark D. McGarvie,eds., Charity, Philanthropy, and Civility, op. cit., p. 29-48 (cf. note 1); Alexandre Lambelet, La philanthropie, Paris,Presses de Science Po, 2014.
8
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 8 — #8
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Introduction. Les philanthropies : un objet d’histoire transnationale
Mais ces exemples n’épuisent pas le spectre dela philanthropie moderne. D’abord parce que,comme on l’a vu plus haut, la philanthropied’inspiration religieuse est longtemps un acteurincontournable du champ, comme le montre laprojection internationale des missions protes-tantesetdesorganisationsapparentéesdécritespar Ian Tyrrell dans son ouvrage Reforming theWorld: the Creation of America’s Moral Empire,
qui fait l’objet du débat de ce numéro. Ensuiteparce que l’action humanitaire qui naît à la findu XIXe siècle constitue unedéclinaisonmajeurede l’activité philanthropique5, en particulier àl’échelle internationale. Les articles de GlenPeterson sur la philanthropie diasporique chi-noise et de Davide Rodogno sur le Near EastRelief (NER) en donnent ici deux exemples trèsdifférents.
Toutes les organisations citées plus haut fontl’objet d’historiographies foisonnantes qui sontle plus souvent imperméables les unes auxautres. L’un des objectifs de ce numéro est decréer des ponts entre elles, en particulier surdeux points. Le premier concerne la catégorie« philanthropie », qui englobe de nombreusesactivités d’organisations traditionnellementdésignées sous le nomd’ONG (organisations nongouvernementales), une catégorie largement
5 Graig Calhoun, “The Imperative to Reduce Suffering:Charity, Progress, and Emergencies in the Field ofHumanitarian Action”, in Michael Barnett, Thomas G.Weiss, eds., Humanitarianism in Question: Politics, Power,Ethics (Ithaca: Cornell University Press, 2008), p. 73-97.
artificielle6 intégrant des acteurs extrêmementdifférents et qui répond avant tout
« aux intérêts changeant des organisations inter-nationales et des États qui les investissent. [Defait,] il existe autant de définitions des ONG qued’organisations internationales ayant ou non lacapacité de les accréditer en fonction de leursintérêts propres »7.
De ce point de vue, il est clair qu’une réflexionsur la philanthropie transnationale peut aussicontribuer à affiner l’analyse de la catégorie« ONG » et permet de mieux comprendre lanébuleuse des organisations désignées sous cenomet travaillant à l’international. Le deuxièmepoint est lié à la présence écrasante des organi-sations américaines dans l’historiographie dela philanthropie contemporaine, notammentdu fait de leur nombre, mais aussi de leursarchives très riches et largement ouvertes auxchercheurs. Mais la philanthropie contempo-raine ne se résume pas à ces organisations,et c’est l’un des objectifs de ce numéro qued’ouvrir la perspective sur ce point en allantconvoquer d’autres historiographies dont lesarticles de Glen Peterson, d’Emmanuelle Sibeudet de Paola Bayle et Juan José Navarro nousdonnent un aperçu, traçant des directions de
6 Dorothée Meyer, « Une catégorie juridique introuvable, unedéfinition utilitaire. Réflexions sur une définition en droitdes ONG », in Johanna Siméant, Pascal Dauvin (dir.), ONG
et Humanitaire, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 139-160.7 Johnanna Siméant, « ONG et humanitaire », in Johanna
Siméant, Pascal Dauvin (dir.), ONG et Humanitaire, op. cit.,p. 16-17 (cf. note 6).
9
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 9 — #9
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Thomas David – Ludovic Tournès
travail dans lesquelles il serait souhaitable quel’historiographie de la philanthropie s’engage.
Une histoire longue des mouvementsphilanthropiques
L’histoire des philanthropies transnationalesdoit à l’évidence se déployer sur le long termeet être connectée aux analyses des phénomènestransnationauxquiont fait l’objetd’âpresdébatsparmi les historiens depuis les années 1990.Dans un article sur l’histoire de l’aide humani-taire internationale, Johannes Paulmann pro-pose ainsi une réflexion stimulante sur la pério-disationet l’importancedemoments charnières,qui s’applique à bien des égards à l’ensemble del’activité philanthropique8. Il identifie notam-ment comme premier moment majeur la fin duXIXe siècle, au cours de laquelle ont été poséesles fondations de l’action humanitaire interna-tionale. Deux ensembles de faits sont particu-lièrement importants : d’une part la régulationde la conduite de la guerre, avec l’adoption dela première Convention de Genève en 1864 etl’émergence du mouvement de la Croix-Rouge ;d’autrepart, l’essor d’un complexemissionnaireà l’échellemondiale. Johannes Paulmann rejointainsi Emily Rosenberg qui a également soulignél’essor de courants socio-culturels transnatio-naux – idées, images – qui ont commencé àcirculer à l’échelle du globe à partir de 1870.
8 Johannes Paulmann, “Conjunctures in the History ofInternational Humanitarian Aid During the TwentiethCentury”, Humanity, vol. 4 (2013/2), p. 223.
Plus largement, il semble que la fin du XIXe siècleconstitue unmomentmajeur dans le développe-ment de mouvements philanthropiques9 dontbeaucoup vont développer leurs activités endehors du cadre national10. Dans Reformingthe World, Ian Tyrrell étudie ainsi les mou-vements évangéliques américains entre 1880et 1930, soulignant qu’ils ont essaimé dans lemonde dans un contexte marqué par la révolu-tion des transports qui facilita les communica-tions, et par l’émergence des États-Unis commepuissance mondiale. La charnière des deuxsiècles est également marquée par la premièrevaguede créationdes grandes fondations améri-caines :MilbankMemorial Fund (1905), RussellSage Foundation (1907), Carnegie Endowmentfor International Peace (1910), RockefellerFoundation (1913). De son côté, Glen Petersonnous montre l’essor important de la philan-thropie diasporique chinoise au cours de lamême période. Il est à noter que ce « moment »de la fin du XIXe siècle est discutable : dans le
9 Stefan-Ludwig Hoffmann, “Civil Society and Democracyin Nineteenth Century Europe: Entanglements,Variations, Conflicts”, Wissenschaftszentrum Berlin fürSozialforschung, Discussion Paper n° SP IV 2005-405,Berlin, Berlin Social Science Center, 2005 ; Hans UlrichJost, « Sociabilité, faits associatifs et vie politique enSuisse au XIXe siècle », in Hans Ulrich Jost, Albert Tanner(dir.), Sociabilité et faits associatifs, Zurich, Chronos, 1991,p. 7-29.
10 Harald Fischer-Tiné, “Reclaiming savages in ‘DarkestEngland’ and ‘Darkest India’: The Salvation Army as trans-national agent of the civilizing mission”, in Carey A. Watt,Michael Mann, eds., Civilizing Missions in Colonial andPostcolonial South Asia (London: Anthem, 2011), p. 125-165.
10
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 10 — #10
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Introduction. Les philanthropies : un objet d’histoire transnationale
débat portant sur l’ouvrage de Tyrrell, RebekkaHabermassedemandesi lapériodisationesquis-sée par l’auteur – la création d’un réseau trans-national de « réformateurs moraux » à la fin duXIXe siècle – ne résulte pas de l’accent mis surl’étude d’associations philanthropiques états-uniennes. Elle souligne qu’en Europe, durantla première moitié du XIXe siècle, il existait denombreuxréseaux internationauxengagésdansdes activités de bienfaisance, au premier rangdesquels le mouvement abolitionniste11.
En ce qui concerne le XXe siècle, JohannesPaulmann distingue trois moments-clés dansl’histoire de l’aide humanitaire internationale,et là encore, cette périodisation peut s’appli-quer partiellement aux mouvements philan-thropiques transnationaux. Il met d’abord enexergue la période immédiatement postérieureà la Première Guerre mondiale, caractériséepar l’effondrement des empires centraux et lacréation de la Société des nations (SDN). De fait,ces années sont marquées par une accéléra-tion des activités transnationales de certainesorganisations philanthropiques, notamment lesfondations américaines. Davide Rodogno décrit
11 Sur ces réseaux internationaux, voir Chris Leonards, NicoRanderaad, “Transnational Experts in Social Reform, 1840-1880”, International Review of Social History, vol. 55(2010/2), p. 215-239. Sur les mouvements abolitionnistes,se référer à Seymour Drescher, Abolition–A History ofSlavery and Antislavery (New York: Cambridge UniversityPress, 2009); Peter Stamatov, “Activist Religion, Empire,and the Emergence of Modern Long-Distance AdvocacyNetworks”, American Sociological Review, vol. 75 (2010),p. 607-628; Karim Ghorbal, Réformisme et esclavagismeà Cuba (1835-1845), Paris, Publibook, 2007.
ainsi les actions du Near East Relief (NER)durant la décennie qui suit le conflit et montrecomment cette organisation connaît une muta-tion, passant de l’aide d’urgence temporaire àun “constructive community service” ambition-nant de s’inscrire dans la durée. EmmanuelleSibeudsouligneégalementdequellemanière lesannées 1920 marquent un moment importantdans l’histoire des mouvements abolitionnistes,une forme de philanthropie bien étudiée pourle XIXe siècle, mais qui a peu suscité l’intérêt deschercheurs pour la période suivante. L’histoiredu Bureau international de défense des indi-gènes illustre bien le processus par lequel cer-taines organisations internationales nouvelle-ment créées s’aventurent sur un terrain autre-fois exclusivement occupé par les associationscaritatives traditionnelles. Enfin, Paola Bayle etJuan José Navarro montrent que la création duWorld University Service (WUS) en 1950 est lerésultat de la fusion de deux organisations, dontl’une – le European Student Relief (ESR) – futmise sur pied en 1920 afin de venir en aide auxétudiants européens touchés par la PremièreGuerre mondiale.
Le deuxième moment-clé pointé par Paulmannest la fin des années 1960 et le début des années1970, période durant laquelle les conflits post-coloniaux, la fin des programmes de dévelop-pement et la mobilisation sociale en Occidentont transformé le champ humanitaire. Cettecharnière est également visible dans l’articlede Paola Bayle et Juan José Navarro, qui meten évidence l’importance de la décennie 1970
11
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 11 — #11
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Thomas David – Ludovic Tournès
dans l’activité du WUS en Amérique latine. Lecoup d’État au Chili en 1973 suscite en effeten Europe un mouvement de solidarité qui setraduit, entre autres, par une politique d’aideaux universitaires chiliens réfugiés. Cette actionest coordonnée par le WUS qui développe ainsiun vaste réseau auprès d’universitaires, de mili-tants de droits de l’homme ou d’organisationsreligieuses en Amérique latine. De même, leprogramme d’échanges créé en 1956 par la fon-dation Ford avec la Pologne, la Hongrie et laYougoslavie est interrompu en 1969 en raisond’un changement de la politique internationalede la fondation, qui se détourne de l’Europe del’Est.
Paulmann identifie enfin avec les années 1990une troisième “historical conjoncture” dansl’histoire de l’aide humanitaire internationale,liée à la fin de la Guerre froide et au « dés-intérêt » politique pour l’aide au développe-ment des pays du tiers-monde, à l’éclatementde conflits ethniques ou intercommunautairesen Europe et à la capacité croissante desmédiasà intervenir pour couvrir les situations d’ur-gence humanitaire, conférant de ce fait unenouvelle dynamique à l’humanitarisme inter-national. Dans un numéro spécial consacréà l’histoire des politiques de bienfaisance auMoyen-Orient, Amy Singer met également enévidence ces années comme une phase impor-tante dans l’histoire de la philanthropie12, ensoulignant pour quelles raisons ces organisa-
12 Amy Singer, “Special Issue Introduction”, op. cit.(cf. note 1).
tions ont vu, un peu partout dans le monde,leur influence croître. Parmi ces facteurs, ellecite entre autres l’émergence de grandes for-tunes personnelles13 ou encore le déclin desprestations de l’État-providence, inauguré parles gouvernements Thatcher et Reagan, maisaussi, pour le monde islamique, la diversifica-tion des pratiques de charité depuis les années1990 ainsi que les répercussions des attentatsdu 11 septembre 2001. C’est également pen-dant cette période que se construisent les for-tunes colossales des philanthropes contempo-rains tels queBill Gates et George Soros, dont lesfondations ont des dotations qui relèguent loinderrière leurs devancières Rockefeller ou Ford.L’article deTerezaPospísilová, consacré auxpre-mièresannéesde laCentralEuropeanUniversity(CEU), illustre ce nouveau trend qui semble biens’appliquer à la philanthropie transnationale.La création de cette université résulte en effetde l’effondrement des régimes communistes enEurope centrale qui avaient mis fin aux asso-ciations philanthropiques privées d’une partet de la mise sur pied, au cours des années1980, de réseaux anticommunistes par GeorgeSoros, un émigré hongrois ayant fait fortune
13 Sur l’accroissement des inégalités (et donc l’augmenta-tion de la concentration des patrimoines) dans les paysdéveloppés depuis les années 1980, dû aux retourne-ments des politiques fiscales et financières, voir ThomasPiketty, Le capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2013. Pourune analyse de l’impact des politiques fiscales sur les pra-tiques philanthropiques dans une perspective historiqueet comparative, nous renvoyons à Gabrielle Fack, CamilleLandais, eds., Charitable Giving and Tax Policy (Oxford:Oxford University Press, 2014).
12
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 12 — #12
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Introduction. Les philanthropies : un objet d’histoire transnationale
dans la finance d’autre part. La trajectoire deSoros illustre l’émergence d’une « nouvelle phi-lanthropie » transnationale au coursdes années1990 qui apparaît comme « une sorte de retourde bâton régulatoire qui succède à la fièvre dela dérégulation »14 de la décennie précédente,philanthropie dont l’une des fonctions seraitde légitimer le processus de financiarisation del’économie.
Les stratégies philanthropiques : unediplomatie des réseaux
Les philanthropies transnationales ont adoptétrès tôt une méthode de travail reposanten grande partie sur la mise en réseauxdes hommes et des femmes, comme lemontre très bien Rui Kohiyama dans sacontribution au débat sur le livre de IanTyrrell. Elle souligne que, au XIXe siècle, lesfemmes constituèrent la force dominantedes mouvements missionnaires états-uniensà l’étranger et que l’activisme des femmesde la classe moyenne blanche ainsi que leurrôle de « gardiennes morales » influencèrent,à partir de la fin du XIXe siècle, la politiqueétrangère des États-Unis, permettant en partiede justifier l’interventionnisme américain.Cette mise en réseaux des acteurs estliée d’abord à la faiblesse structurelle desorganisations philanthropiques, souvent detaille modeste (même s’il s’agit de grosses
14 Nicolas Guilhot, Financiers, philanthropes : Sociologie deWall Street, op. cit., p. 112 (cf. note 1).
fondations), qui interviennent dans deslieux parfois très lointains, et souvent avecun soutien ténu des structures étatiques(qu’il s’agisse de celles du pays d’origine oudu pays d’intervention), et parfois mêmecontre elles. Cette position n’est d’ailleurs passpécifique aux associations philanthropiques :c’est celle de la quasi-totalité des acteursnon gouvernementaux qui se projettent àl’international sans disposer d’une autoritélégale, d’une force militaire ou d’un appareillogistique élaboré. Et si leurs disponibilitésfinancières sont parfois importantes, elles ledoivent précisément à la mobilisation conjointede multiples organisations mettant en communleurs ressources. L’action en réseau est donc leplus souvent dictée par la nécessité. Elle n’estpas une réalité exclusivement contemporaine,puisqu’on la rencontre dès le XIXe siècle, commele montrent les organisations de réformateursmoraux étudiés par Ian Tyrrell, qui agissentparfois de leur côté, parfois ensemble mêmesi elles poursuivent des objectifs différents.Mais cette propension à agir en réseau sedéveloppera tout au long du XXe siècle à mesureque le nombre d’organisations non gouver-nementales, et notamment d’organisations àbut philanthropique, augmentera. Aujourd’hui,cette diplomatie du réseau est plus que jamaisla marque de fabrique des organisations nongouvernementales, dont les organisationsphilanthropiques font partie.
L’exemple des fondations américaines montreque leur fonctionnement en réseau se déploie
13
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 13 — #13
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Thomas David – Ludovic Tournès
au moins sur quatre niveaux15 : le niveau del’organisation elle-même ; le niveau national,entenducommeceluidupaysd’originede l’orga-nisation ; le niveau international, à savoir celuides pays où les organisations interviennent ;et enfin le niveau transnational, qui concernela connexion des actions menées par une orga-nisation ou un ensemble d’organisations dansplusieurs pays. Ce schéma peut s’observer dansle cas d’autres organisations philanthropiques.On ajoutera que ces niveaux ne sont pas imper-méables les uns aux autres, et qu’ils se déploientdans une « tension créative mutuelle »16, parexemple lorsque les logiques transnationalesviennent se heurter aux réalités nationales17.
Le premier niveau concerne la structure mêmedes organisations philanthropiques. D’abordparce qu’elles sont fréquemment, au moins àleurs débuts, des entités informelles reposantsur les contacts personnels qui, en l’absence
15 Ludovic Tournès, « Carnegie, Rockefeller, Ford, Soros :généalogie de la toile philanthropique », in Ludovic Tournès(dir.), L’argent de l’influence. Les fondations américaines etleurs réseaux européens, Paris, Éditions Autrement, 2010,p. 12-18.
16 Emily S. Rosenberg, “Transnational currents in a ShrinkingWorld”, in Emily S. Rosenberg, ed., A World Connecting,1870-1945 (Cambridge: Harvard University Press, 2012),p. 821.
17 Daniel Laqua, “The Tensions of Internationalism:Transnational Anti-Slavery in the 1880s and 1890s”, TheInternational History Review, vol. 33 (2011/4), p. 705-726. Sur les jeux d’échelle au niveau transnational, voirPierre-Yves Saunier, “Learning by Doing: Notes aboutthe Making of the Palgrave Dictionary of TransnationalHistory”, Journal of Modern European History, vol. 6(2008/2), p. 159-180.
d’institutionnalisation, constituent le ciment duprojet philanthropique. Tereza Pospísilová nousrappelle ainsi que, pendant les dix premièresannées, les actions philanthropiques de Sorosne sont pas regroupées dans une organisationen tant que telle, son inspirateur s’appuyantessentiellement sur des amitiés de jeunessepour déployer ses activités derrière le Rideaude fer. Ce modus operandi est à la fois le refletd’un projet encore à ses débuts, mais il est aussiadapté à un contexte politique, où les régimescommunistes interdisent l’émergenced’unephi-lanthropie privée. De même, les philanthropesde la diaspora chinoise n’ont aucune unité entant que telle avant que l’administration Qingne fasse appel à eux et contribue à leur donnerl’apparence d’un groupe, en les ancrant dans leprojet national chinois. Ce n’est que plus tardqu’ils se donneront des structures communesà travers des organisations telles que le fondsd’aide du Shandong créé par Tan Kah Kee en1928, et surtout l’association d’entraide géné-rale chinoise de Nanyang mise sur pied dix ansplus tard pour venir en aide aux victimes del’invasion japonaise. La création d’une organisa-tion n’intervient souvent que lorsque le réseauest déjà suffisamment structuré pour s’installerdans la durée.
Le deuxième niveau du fonctionnement enréseau se situe à l’intérieur des pays d’originedes organisations philanthropiques et se carac-térise par la connexion d’institutions et/ou d’in-dividusprovenantdedifférentsmilieuxouactifs
14
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 14 — #14
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Introduction. Les philanthropies : un objet d’histoire transnationale
dans des domaines très divers18. Mark Elliott,dans le débat, souligne ainsi l’importance de lapériodedereconstructionduSuddesÉtats-Unisau cours des années 1870. En effet, ce projetvisant à réintégrer le Sud au sein de l’Union vitl’étroite collaboration entre des sociétés mis-sionnaires religieuses, souvent nordistes, et lesagences gouvernementales. Surtout, Elliott sou-ligne que ce projet fut le précurseur direct del’« exportation » du christianisme protestantaméricain à la fin du XIXe siècle décrite par IanTyrrell. DavideRodognonous endonneunautreexemple parlant à propos du NER, dont la compo-sition sociale mêle les mondes de l’entreprise,desmissions protestantes et de la politique, unecoalition très WASP (white anglo-saxon protes-tant) et élitiste, mais qui sait éviter le piège dela consanguinité en établissant des liens avecle monde de la réforme sociale et de l’éduca-tion, donnant ainsi à la grande philanthropieaméricaine un code génétique inédit où le chro-mosome des capitaines d’industries s’allie àcelui des mouvements progressistes et réforma-teurs. Cette logique se retrouve dans les autresgrandes fondations telles que la Ford, traitéepar Ingeborg Stensrud (à travers les cas deJohn McCloy et Shepard Stone), mais aussi dansd’autres telles que la Carnegie ou la Rockefeller,dont les boards of trustees sont peuplés à lafois d’universitaires, d’industriels et d’ex- ou
18 Thomas David, Janick Marina Schaufelbuehl, “SwissConservatives and the Struggle for the Abolition ofSlavery at the End of the Nineteenth Century”, Itinerario.International Journal on the History of European Expansionand Global Interaction, vol. 34 (2010/2), p. 87-103.
de futurs membres de l’administration fédéraleaméricaine. La philanthropie de George Soross’inscrit dans cette logique puisque son fon-dateur est introduit à partir des années 1980dans les réseaux américains des défenseurs desdroits de l’homme gravitant autour de l’orga-nisation Helsinki Watch (qui devient HumanRights Watch en 1988). Ces réseaux vont jouerun rôle majeur dans la formulation du projetinternational de Soros. Là encore, la connexionentre les différents niveaux de réseaux est évi-dente. Ces exemples témoignent de la grandeplasticité du monde philanthropique et de sacapacité à faire travailler ensemble des hommesvenus d’horizons sociaux et politiques très dif-férents. Ils montrent aussi tout l’intérêt qu’il yaurait à pratiquerplus avant unehistoire socialedes milieux philanthropiques transnationauxencore balbutiante.
Le troisième niveau du fonctionnement enréseau est le niveau international, celui-ci dési-gnant les actions mises en œuvre dans despays autres que celui d’origine de l’organisa-tion. C’est là que se révèle le modus operandiparticulier de ces organisations, qui s’exprimepar un contact très poussé avec les réalités desterrains locaux et par la focalisation sur desobjectifs concrets et identifiables. Le cas de laphilanthropie diasporique chinoise est ici par-ticulièrement significatif, à la fois pour ce quiconcerne les aides aux populations locales vic-times de catastrophes naturelles, mais aussiet peut-être surtout pour la création d’écoles
15
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 15 — #15
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Thomas David – Ludovic Tournès
impulsées par Tan Kah Kee en Chine19. Le casdes fondations américaines est également par-lant : comme le NER, la fondation Rockefellerappuie son action internationale à partir desannées 1920 sur une politique de contacts sys-tématiques avec les acteurs locaux, depuis lesinfirmièresdedispensaires jusqu’auministredela Santé publique en passant par les directeursd’écoles d’hygiène, les professeurs des universi-tés ou les autorités municipales ou régionales20.C’est également la politique que suit Soros lors-qu’il met en place son réseau de fondations enEurope ex-communiste, et Tereza Pospísilovánous montre bien comment ces créations s’ap-puient sur les réseaux locaux, notamment ceuxde la dissidence qui parviennent au pouvoiraprès 1989. Elle montre également comment leprojet de Soros doit s’adapter à des contextesnationaux spécifiques qui, en retour, ont unimpact sur la dimension transnationale de l’acti-vité philanthropique : l’évolution de la situationpolitique en Tchécoslovaquie à partir de 1993,en raisonde l’arrivée aupouvoir deVaclavKlaus,conduit à la fermeture de la branche praguoise
19 Voir aussi sur ce point Éric Guérassimoff, Chen Jiageng[Tan Kah Kee] et l’éducation : stratégies d’un émigré pourla modernisation de l’enseignement en Chine, 1913-1938,Paris, L’Harmattan, 2003. Pour un autre exemple d’activitéphilanthropique d’une diaspora, voir Stacy Fahrenthold,“Sound Minds in Sound Bodies: Transnational Philanthropyand Patriotic Masculinity in al-Nadi al-Homsi and SyrianBrazil, 1920-1932”, International Journal of Middle EastStudies, vol. 46 (2014/2), p. 259-283.
20 Ludovic Tournès, Sciences de l’homme et politique. Lesfondations philanthropiques américaines en France auXXe siècle, Paris, Éditions des classiques Garnier, 2013[1re éd. 2011].
de la CEU et, in fine, met un terme au projetoriginel d’université transnationale caressé parSoros. Le cas du NER est plus complexe et illustrela difficulté pour les organisations philanthro-piques de mener des actions de terrain dansdes aires géographiques où l’État n’est pas oumal installé : de ce point de vue, les improvisa-tions du NER sont intimement liées au caractèremouvant du terrain local et aux brusques chan-gements politiques intervenus dans la région,notamment lors de l’évacuation française dela Turquie et de l’installation au pouvoir deMustapha Kemal. Ici, l’action de l’organisationest en permanence dictée par l’imprévisibilitéde la situation politique ; dans ce contexte, lerecours aux acteurs locaux est sans doute renduencore plus crucial.
L’échelle transnationale représente lequatrième niveau du fonctionnement enréseau. Elle consiste à connecter entreelles des initiatives mises en œuvre surdifférents terrains nationaux par une ouplusieurs organisations. Les stratégies sont icimultiples. Ingeborg Stensrud nous en donne unexemple particulièrement parlant à travers lesprogrammes d’échange de la Fondation Forden Europe de l’Est. Comme les autres grandesfondations américaines, la Ford raisonne àl’échelle mondiale ou à celle de grandes régions,et non simplement en termes de pays. Elle nese contente pas de juxtaposer des actions sansliens les unes avec les autres dans plusieurspays, mais tente de les connecter entre elles ;si elle est obligée de prendre en compte les
16
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 16 — #16
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Introduction. Les philanthropies : un objet d’histoire transnationale
réalités nationales, une partie de son activitéconsiste à les subvertir en vue d’avancer dansla création d’une société internationale. Lesprogrammes d’échanges sont un élémentessentiel de cette stratégie. Ceux de la Fords’inscrivent dans le cadre d’une stratégie deGuerre froide visant à miner de l’intérieurchacun des régimes communistes en favorisantla circulation transnationale des élites desdémocraties populaires, non seulement endirection des États-Unis, mais aussi vers lespays d’Europe occidentale, et enfin avec lesautres pays du bloc de l’Est. Les hommes de laFord font le pari que ce processus de circulationpermettra de convaincre l’intelligentsiaest-européenne de la supériorité du modèlede la démocratie libérale par rapport aucommunisme. Mais au-delà du contextespécifique de la Guerre froide, ces programmesd’échanges visent à organiser la circulation desélites nationales afin de favoriser l’émergenced’un habitus transnational destiné à subvertirle nationalisme fauteur de guerre et à créerune élite mondialisée partageant les mêmescodes et les mêmes expériences. Pour ce faire,la fondation Ford met en place une logistiquecomplexe mobilisant les réseaux universitairesaméricains afin d’accueillir les 700 boursiersvenus de Pologne, de Hongrie et de Yougoslavieentre 1958 et 1969.
Une autre stratégie typique de la logique trans-nationale des organisations philanthropiquesest de se connecter à d’autres organisationstravaillant elles-mêmes à l’échelle de plusieurs
pays. C’est le cas des réseaux abolitionnisteseuropéens dont Emmanuelle Sibeud nousdonne un échantillon d’autant plus intéressantqu’il illustre la nécessité de les considérersur le long terme : l’action du Bureauinternational de défense des indigènes est eneffet incompréhensible si on ne la replace pasdans la continuité de l’histoire desmouvementsabolitionnistes depuis le début du XIXe siècle.Le Bureau n’est qu’une organisation parmid’autres dans une nébuleuse21 dont on aperçoitd’autres rameaux, notamment l’Anti-Slaveryand Aborigines’ Protection Society anglaise,mais aussi des organisations allemandes,françaises et suisses. L’histoire que nousprésente Emmanuelle Sibeud est pour partiecelle d’une tentative de fédération avortéeentre diverses organisations antiesclavagistestravaillant (ou souhaitant le faire) à l’échelle del’ensemble des empires coloniaux, et qui sontmarginalisées par les pesanteurs conjointesdes États et de la SDN, leur échec étant d’autantplus patent que le Bureau n’arrive pas àfédérer des organisations dont chacune évoluedans des logiques nationales et impérialesincompatibles. Cet exemple illustre bien lefait que ces organisations philanthropiques,quoique défendant les mêmes causes, sontsouvent aussi rivales. Il met en avant unautre élément important : dans un contexted’impérialisation de la défense des indigènes,
21 On emprunte l’expression à Christian Topalov (dir.),Laboratoires du nouveau siècle : la nébuleuse réforma-trice et ses réseaux en France, 1880-1914, Paris, Éditionsde l’EHESS, 1999.
17
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 17 — #17
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Thomas David – Ludovic Tournès
la voix des acteurs non gouvernementauxest à peine audible, la logique impérialeredoublant et accentuant la logique nationale22,restreignant la marge de manœuvre desorganisations philanthropiques, et ce d’autantplus que celles-ci sont très divisées.
Philanthropies, États, organisationsinternationales : des interactionscomplexes
Un autre aspect majeur de l’histoire des phi-lanthropies transnationales est celui de leursinteractions avec les acteurs institutionnels desrelations internationales, qu’il s’agissedesÉtats,des empires ou des organisations intergouver-nementales.
À partir de la fin du XIXe siècle, les organisa-tions philanthropiques poussent les États à élar-gir le périmètre de leurs prérogatives. C’est lecas notamment dans les domaines sanitaire ouéducatif qui font peu partie des prérogativesdes États au milieu du XIXe siècle, mais qui yseront progressivement intégrés lorsque ceux-ci prendront en charge l’éducation de masseou la protection sociale des populations. À l’in-verse, depuis plus de vingt ans, certains milieuxpolitiques et philanthropiques dénoncent lescarences de l’État-providence et soulignent lesbienfaits de l’assistance privée. Ainsi, MarvinOlasky, qui fut un des porte-parole du président
22 Christopher Bayly, The Birth of the Modern World, 1780-1914: Global Connections and Comparisons (Maiden:Blackwell Publishing, 2004), notamment le chapitre 6.
Georges W. Bush en matière de philanthropie,se référait à la « tragédie de la compassion amé-ricaine » enracinée dans une dépendance exces-sive envers les dépenses et les services sociauxgouvernementaux et prônait une réduction desprogrammes fédéraux23. Les frontières entrephilanthropie privée et action gouvernementalesont donc poreuses, certains historiens ayantmis en avant le concept de “mixed economyof welfare” pour caractériser les formes d’in-teraction entre ces deux groupes d’acteurs –
oscillant entre concurrence et coopération – quiont façonné le visage des États sociaux natio-naux24. Ce concept peut également s’appliquerà l’échelle internationale : c’est ce qu’illustrele cas du travail humanitaire, historiquementpris en charge d’abord par des organisationsprivées avant d’être investi par les États. LaCroix-Rouge américaine est un exemple caracté-ristique. Créée en 1881, elle intervient au coursdes années 1890 dans un certain nombre decatastrophes naturelles ayant eu lieu dans dif-
23 Lawrence J. Friedman, “Philanthropy in America”, op. cit.,p. 18-20 (cf. note 1).
24 Martin Lengwiler, “Competing Appeals: The Rise of mixedWelfare Economies in Europe”, 1850-1945, in GeoffreyClark, Gregory Anderson, Christian Thomann, J.-MatthiasGraf von der Schulenburg, eds., Appeal of Insurance(Toronto: University of Toronto Press, 2010), p. 173-200;Bernard Harris, Paul Bridgen, “Introduction: The ‘MixedEconomy of Welfare’ and the Historiography of WelfareProvision”, in Bernard Harris, Paul Bridgen, eds., Charityand Mutual Aid in Europe and North America Since 1800(New York: Routledge, 2007), p. 1-18; Martin A. Powell,ed., Understanding the mixed Economy of Welfare (Bristol:Policy Press, 2007); Olivier Zunz, Philanthropy in America:A History (Princeton: Princeton University Press, 2012).
18
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 18 — #18
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Introduction. Les philanthropies : un objet d’histoire transnationale
férents pays. Mais c’est à partir de la guerrehispano-américaine de 1898 qu’elle commenceà établir un partenariat avec l’État fédéral dansle cadre des opérations humanitaires à Cuba. Cepartenariat s’approfondit en 1905 lorsqu’elledevient une agence semi-publique sous l’au-torité directe du Congrès et du départementde la Guerre. Lors de la Première Guerre mon-diale, elle devient une agence auxiliaire de lapolitique étrangère américaine et est chargéede coordonner l’action humanitaire américaineen Europe25 ; ce qui ne l’empêche pas d’êtrealimentée par des dons privés, qui explosentlittéralement au cours de ces années26.
Le cas des organisations philanthropiques amé-ricaines montre également que les philanthro-pies transnationales peuvent constituer unvecteur d’expansion des États-nations préci-sément en mobilisant un répertoire d’actionsque l’État ne peut pas utiliser. Ian Tyrrell etDavide Rodogno nous décrivent des organisa-tions qui font de l’action en faveur d’autrui lecentre de leur activité internationale, dilatantainsi la sphère de l’intérêt général à l’échellede l’humanité et de la planète. Les réforma-teurs moraux étudiés par Tyrrell, mais aussila Croix-Rouge américaine ou encore le NER
apparaissent ainsi comme des laboratoires du
25 Marian Moser Jones, The American Red Cross from ClaraBarton to the New Deal (Baltimore: The Johns HopkinsUniversity Press, 2013).
26 Merle E. Curti, American Philanthropy Abroad. A History(New Brunswick: Transaction Books, 1988 [1963]), p. 220,240.
globalisme américain27 dont le messianismeet l’humanitarisme sont des ingrédients fonda-mentaux que l’on retrouve presque inchangésdans l’action internationale de la fondation Billet Melinda Gates depuis le début de la décennie2000. L’affirmation nationale des États-Unis surla scène internationale se fonde ainsi en par-tie sur la stratégie transnationale des multiplesacteurs philanthropiques américains dont ledynamisme est complémentaire de celui de l’ad-ministration fédérale face à un Congrès, sinonisolationniste, du moins plus frileux en matièrede stratégie internationale.
Mais lesphilanthropies transnationalespeuventégalement agir depuis l’extérieur des frontièresnationales. C’est ce que montre le cas de ladiaspora des négociants chinois auxquels ladynastie Qing fait appel pour intervenir lorsdes catastrophes naturelles afin de pallier lesmanques de l’État chinois. Celui-ci en pro-fite pour tenter de renforcer sa légitimité enoctroyant à ces marchands philanthropes deshonneurs impériaux destinés à renforcer, ou àcréer de toutes pièces, un sentiment de fidé-lité vis-à-vis d’une dynastie déclinante dont leterritoire est l’objet des convoitises des puis-sances européennes. Si le soutien des philan-thropiesdiasporiquesn’apassuffi àempêcher lachute de la dynastiemandchoue, l’appel à la phi-lanthropie de l’émigration va continuer aprèsla révolution de 1911. Ainsi, depuis la fin du
27 Frank A. Ninkovich, Global Dawn: The Cultural Foundationof American Internationalism (1865-1900) (Cambridge:Harvard University Press, 2009).
19
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 19 — #19
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Thomas David – Ludovic Tournès
XIXe siècle, la philanthropie a étémobilisée pourparticiper à la construction du roman nationalchinois. Son action a contribué à la construc-tion d’une « communauté imaginée »28 élabo-rée pour partie à l’extérieur du territoire natio-nal, selon un mécanisme bien mis en lumièrepar Arjun Appadurai29. Mais la situation estrendue encore plus complexe du fait de la situa-tion coloniale. Les émigrés chinois sont, de parleurs activités philanthropiques, sujets de deuxentités territoriales : l’empire du Milieu, maisaussi l’Empirebritannique. Ladiaspora chinoiseoccidentalisée est en effet courtisée par le colo-nisateur anglais qui tente de créer un loyalismeimpérial chez les Chinois de Malaisie afin decontrecarrer l’action du gouvernement chinois.Alors qu’entre Anglais et Chinois se dressentdes barrières infranchissables construites parles théories raciales, la philanthropie constitueun moyen d’accès ménagé par le colonisateur àl’espace impérial, une ouverture relative desti-née à lui permettre de durer. L’idée développéepar Peterson rejoint la démonstrationdeTyrrellsur la manière dont les réseaux transnationauxdes missionnaires évangéliques et des réforma-teurs moraux essaiment au cours des années1880 et vont offrir des justificatifs idéologiqueset une présence outremer à l’Empire – formel etinformel – américain qui va émerger une décen-
28 Benedict Anderson, Imagined communities. Reflectionson the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso,1991 [1st ed. 1983]).
29 Arjun Appadurai, Modernity At Large: Cultural Dimensionsof Globalization (Minneapolis: University of MinnesotaPress, 1996).
nie plus tard. On voit ici que la réflexion sur lesmouvements philanthropiques nepeut pas fairel’économie du rôle joué par les empires dansl’émergence de dynamiques transnationales30.
Les organisations internationales intergouver-nementales constituent le troisième type d’ac-teurs avec lesquels les organisations philanthro-piques sont très tôt en relation. C’est le cas dèsles années 1920 avec la SDN, dont les activi-tés techniques vont rapidement devenir l’acti-vité principale, et dans le cadre desquelles leSecrétariat établit un contact avec de nombreuxacteurs privés travaillant dans les domaines quirelèvent de la philanthropie. Cet aspect de l’his-toire de la SDN est fréquemment sous-estimé,car il n’existe pas de cadre institutionnel for-malisant la relation entre les acteurs privés etl’organisation internationale, mais la réalité duterrainmontre que les relations sont constantes.Les organisations philanthropiques sont parti-culièrement sollicitées dans le domaine sani-taire ou dans celui de l’aide aux réfugiés31. Maislà encore, les relations sont complexes, commenous le montre le cas du Bureau internatio-nal de défense des indigènes. La coopérationentre la SDN et les organisations philanthro-piques s’avère particulièrement difficile, voire
30 Kevin Grant, Philippa Levine, Frank Trentman, eds.,Beyond Sovereignty: Britain, Empire and Transnationalism,1860-1950 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007).
31 Voir par exemple Dzovinar Kévonian, « L’organisation nongouvernementale comme acteur émergent du champhumanitaire : le Zemgor et la Société des nations dans lesannées vingt », Cahiers du Monde russe, 2005/4, p. 739-756.
20
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 20 — #20
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Introduction. Les philanthropies : un objet d’histoire transnationale
impossible, sur la question des mandats. Nonseulement la définition du périmètre d’actionde la Commission des mandats est un sujet deconflit entre les États, mais la place à accor-der aux acteurs philanthropiques est, selon lestermes d’Emmanuelle Sibeud, « une véritablepomme de discorde » puisque leur conférerune importance trop grande aboutirait à pla-cer les puissances coloniales sous le feu desprojecteurs de l’opinion publique internatio-nale, non seulement dans ces territoires qu’ellesconsidèrent comme des « prises de guerre »,mais aussi, à terme, dans toutes les coloniesqu’elles ont conquises au cours du XIXe siècle.Dans ces conditions, il est extrêmement difficileà l’organisation internationale de s’appuyer surles acteurs privés alors que les États-empires,notamment la France et la Grande-Bretagne,font tout pour restreindre au maximum sonpérimètre d’intervention.
Après 1945, la relation entre les organisationsphilanthropiques et les organisations interna-tionales acquiert une visibilité plus grande àtravers la construction du statut d’organisationnon gouvernementale qui permet d’institution-naliser leur coopération avec les agences spé-cialisées de l’ONU. Les acteurs philanthropiquessont appelés à jouer un rôle croissant dansle cadre de certaines d’entre elles, notammentdans les secteurs de la santé (l’OMS-Organisationmondiale de la santé), des réfugiés (le HCR-Haut commissariat pour les réfugiés) ou encoredu développement (le PNUD-Programme desNations unies pour le développement). C’est
le cas du World University Service, qui obtientle statut d’ONG auprès d’ECOSOC (Economic andSocial Council) et entretient des liens avecles organisations de la galaxie onusienne quirelèvent de son domaine d’intervention et qui àce titre financent ses activités, qu’il s’agisse del’humanitaire (le HCR), de l’éducation (l’UNESCO),du développement (le PNUD, l’UNICEF), ou encoredes migrations étudiantes (l’Organisation inter-nationale pour lesmigrations). Les années 1990semblent, à certains égards, marquer une nou-velle étape dans ces relations. L’arrivée de laBill and Melinda Gates Foundation dans ledomaine de la santé a ainsi eu pour consé-quence de restreindre et même de dicter lechamp d’activités de l’OMS, ainsi que le préciseAnne-Emmanuelle Birn qui parle à ce sujet de“shift of players, power and paradigms in theinternational health field in the wake of theCold War”32. Là encore, des recherches empi-riques sur ces sujets encore peu balisés seraientsouhaitables, que ce soit sur les grandes fonda-tions, mais aussi, et peut-être surtout, sur lesmultiples organisations plus modestes qui gra-vitent autour des organisations internationales.
32 Anne-Emanuelle Birn, “The Stages of International (Global)Health: Histories of Success or Successes of History?”,Global Public Health, vol. 4 (2009/1), p. 61; voir aussiTheodore M. Brown, Marco Cueto, Elizabeth Fee, “TheWorld Health Organization and the Transition from‘International’ to ‘Global’ Public Health”, American Journalof Public Health, vol. 96 (2006/1), p. 62-72; David McCoy,G. Kembhavi, J. Patel et al., “The Bill & Melinda GatesFoundation’s Grant-Making Programme for Global Health”,Lancet, vol. 373 (2009), p. 1645-1653.
21
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 21 — #21
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Thomas David – Ludovic Tournès
Le champ de recherche, on le voit, est vaste,et les quatre pistes de travail esquissées ici(périmètre de l’action philanthropique, pério-disation, logique de réseaux, relations avec lesacteurs des relations internationales) ne sontpas limitatives, tout comme les articles de cenuméro ne constituent qu’un échantillon. Desétudes futures devraient permettre de mieuxcerner cette nébuleuse philanthropique trans-nationale, à la fois en ce qui concerne le fonc-tionnementdesorganisationsqui la constituent,mais aussi en ce qui concerne leur participationà la construction d’un espace du transnatio-nal qui a émergé depuis le XIXe siècle, et enfinà l’émergence d’une société civile33 dont ellesconstituent sans doute des composantes essen-tielles, alors que les États et les organisationsinternationales ont montré les limites de leurcapacité à élaborer une gouvernance mondialedigne de ce nom.
33 Béatrice Pouligny, « Une société civile internationale ? »,Critique internationale, 2001/4, p. 120-122. Pour unevision historique du concept de société civile, voir JürgenKocka, Civil Society and Dictatorship in Modern GermanHistory (Waltham, MA: Brandeis University Press, 2010);Margrit Pernau, « Gab es eine indische Zivilgesellschaftim 19. Jahrhundert ? Überlegungen zum Verhältnis vonGlobalgeschichte und historischer Semantik », Traverse,vol. 14, 2007, p. 51-67.
22
“mondes6” (Col. : Monde(s)) — 2014/10/14 — 8:47 — page 22 — #22
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐