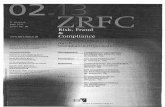Paris capitale culturelle nationale, internationale, transnationale?
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Paris capitale culturelle nationale, internationale, transnationale?
CHRISTOPHE CHARLE
PARIS CAPITALE CULTURELLE NATIONALE, INTERNATIONALE,
TRANSNATIONALE ?
XIXE-XXE SIÈCLE
Avant de commencer cette conférence d’ouverture pour le
congrès d’histoire de l’ENIUGH, je tiens à remercier Michel
Espagne de m’y avoir convié et de me donner l’occasion
d’exposer divers travaux que j’ai menés avec des chercheurs de
l’Institut d’histoire moderne et contemporaine depuis plus
d’une dizaine d’années sur les thèmes qui seront au centre de
mon propos. C’est aussi pour moi une manière de relier des
ouvrages, articles ou contributions dispersés dans diverses
publications sous ma propre plume ou en coopération avec
certains de mes élèves ou anciens élèves qui participent
d’ailleurs activement à ce congrès (voir diapo). Je remercie
également l’Institut historique allemand où j’ai fréquemment
travaillé ou suivi des conférences ou colloques de bien vouloir
nous accueillir pour cet événement.
Ce qui justifie la thématique choisie en accord avec Michel
Espagne, c’est non seulement la capitale où nous sommes réunis
et plus généralement la problématique des capitales
culturelles. Elle nous paraissait permettre de réfléchir sur
les difficultés et les potentialités de l’histoire globale ou
transnationale, les comparaisons dans le temps et l’espace et
les processus de transferts culturels. Par capitale culturelle
j’entendrai ici : « un espace urbain dont suffisamment
1
d’indices convergents permettent d’établir qu’il est, à
l’époque considérée, un lieu d’attraction et de pouvoir
structurant de tel ou tel champ de production symbolique
(voire, pour les plus importantes, comme Paris, Londres,
parfois Rome, de la majorité de ces champs). » (voir diapo) La
notion n’implique donc pas forcément l’alliance avec un rôle
politique, même si la plupart des capitales politiques aspirent
à jouer aussi un rôle culturel depuis la tradition des mécénats
royaux ou princiers ou aujourd’hui avec la diffusion du mot
d’ordre de l’attractivité des métropoles mondiales grâce aux
activités culturelles ou symboliques.
Paris, depuis le Moyen Age et surtout depuis ce qu’on appelle
aujourd’hui la Belle époque, a suscité une énorme littérature
qui exalte sa fonction de capitale notamment culturelle. Il
s’agira ici non de rappeler ces poncifs non vérifiés ni
historicisés sur la centralité du rôle de cette capitale dans
de nombreux aspects de la vie culturelle en fonction de la
définition précédente, mais d’essayer d’en mesurer les effets
et les origines à trois échelles différentes imbriquées mais
dont la distinction est nécessaire pour en montrer les
éventuelles contradictions : l’échelle nationale, l’échelle
internationale et l’échelle transnationale. La littérature
habituelle sur ces thèmes se contente de témoignages
qualitatifs, positifs ou négatifs issus de témoins hétérogènes
qui n’y font que transmettre leurs expériences personnelles
dont on ne peut tester la représentativité globale, ce qui
produit donc un effet de miroir. Pour sortir de ce cercle
vicieux, je tâcherai de mettre en œuvre de nouvelles approches
2
par la comparaison à partir de critères objectivables, même si
c’est particulièrement difficile dans les divers domaines de la
culture, par l’étude des transferts culturels et la mesure de
leurs impacts, à moyen et long terme, par l’inventaire des
connexions avec les autres espaces nationaux et internationaux
et leurs effets sur les dynamiques culturelles françaises et
étrangères.
Il faut aussi essayer de rompre avec les évidences du sens
commun. La domination culturelle de Paris, tout au long des
deux derniers siècles, n’est pas seulement le fruit d’un
héritage de la monarchie et de la Révolution, elle s’est
accentuée et ce en dépit des récriminations constantes sur ses
effets pervers et des tentatives pour l’atténuer depuis le
milieu du XXe siècle (politique dite de la « décentralisation
culturelle »). Il faut essayer de comprendre pourquoi. Elle est
aussi l’enjeu d’un combat intellectuel et idéologique au sein
de l’espace national et international, combat qui est toujours
d’actualité, à l’heure, d’un côté, de la montée en puissance
des « villes globales », de plus en plus situées hors d’Europe,
et qui ne sont plus forcément des capitales au sens politique,
mais aussi des nouveaux réseaux de transmission culturelle. Ils
n’impliquent plus, comme jusqu’aux années 1980, la
concentration des ressources culturelles en un seul lieu
central pour produire des effets de domination culturelle,
comme le montre l’exemple états-unien dont les centres de
création et diffusion culturelle sont beaucoup plus dispersés
et s’appuient sur des entreprises multinationales. Pour des
raisons de compétence historique, mon propos s’appuiera surtout
3
sur le XIXe siècle et le premier XXe siècle, avant précisément
que les industries culturelles de masse de type états-unien
n’assoient leur hégémonie durable sur le monde occidental et
partiellement non occidental.
I. LA DOMINATION CULTURELLE PARISIENNE AU PLAN NATIONAL
L’accentuation du rôle de Paris comme capitale culturelle
nationale est liée à l’époque révolutionnaire et impériale où
l’idéal centralisateur l’a emporté sur la tentative
décentralisatrice de la période initiale de la Constituante. Ce
qui aurait pu n’être qu’une réponse administrative et militaire
aux menaces de subversion contre-révolutionnaire et de guerre
extérieure s’est étendu à toute la culture dans la mesure où la
révolution politique s’est accompagnée d’une révolution
culturelle générale. Les nouveaux régimes issus de la décennie
révolutionnaire ont voulu marquer dans l’espace parisien
l’ampleur de la rupture politique avec notamment la fondation
du Muséum central au Louvre, palais devenu propriété nationale,
les fêtes révolutionnaires en des lieux symboliques, le culte
des grands hommes au Panthéon, précédents qui seront repris
parfois avec des interruptions par d’autres époques ou régimes.
Ils ont dû aussi réorganiser les institutions d’enseignement et
de consécration héritées de la monarchie (Ecoles, académies) ou
du Moyen Age (universités, collèges). Même si le Consulat,
l’Empire, la Restauration ou la monarchie de Juillet ont effacé
partiellement certains souvenirs douloureux de cette décennie
conflictuelle et sanglante, l’effacement des traces ou
4
l’intérêt nouveau pour le patrimoine en réaction contre le
vandalisme de certains épisodes radicaux ont permis d’ériger de
nouveaux symboles culturels ou patrimoniaux, toujours situés
dans la capitale, pour en modifier l’image symbolique mais
toujours selon la même logique de centralité culturelle de la
capitale. Cette permanence d’une politique symbolique et
culturelle centrée sur Paris est d’autant plus paradoxale que
ces régimes recrutaient leurs élites dans des groupes de
notables à fort enracinement provincial, voire rural. Certains
(par exemple la noblesse contre-révolutionnaire de la
Restauration) entretenaient même une animosité non dissimulée
contre la capitale et ses classes populaires régulièrement en
ébullition tout au long du XIXe siècle. Force est de constater
qu’avant les années 1860, aucune force politique n’a cependant
contesté sérieusement cette hypercentralisation de toutes les
activités culturelles les plus importantes et elle est même
devenue, dès cette époque, aux yeux des intellectuels étrangers
un phénomène quasi consubstantiel pour l’identité française.
Goethe, dans ses Conversations avec Eckermann, en 1827-28, s’en fait
l’écho à la fois admiratif et dubitatif :
Pour l’aspect positif en fonction d’une comparaison avec la
situation allemande inverse, il déclare à son confident :
« Imaginez une ville comme Paris où les meilleurs cerveauxd’un grand royaume sont réunis sur un seul point ets’instruisent et s’exaltent réciproquement par un contact,une lutte, une émulation de tous les jours, où l’on aconstamment sous les yeux ce qu’il y a de plus remarquabledans tous les domaines de la nature et de l’art du mondeentier ; songez à cette cité universelle, où chaque foisqu’on traverse un pont ou une place, le souvenir d’un grand
5
passé se réveille, où chaque coin de rue a été témoin d’unévénement historique. Et surtout n’allez pas vous imaginerle Paris d’un âge sans lumières et sans esprit, mais leParis du XIXe siècle, dans lequel depuis trois générationsdes hommes comme Molière, Voltaire, Diderot et leurssemblables ont mis en circulation une abondance d’idéescomme on ne la reverra plus jamais, réunie sur un pointunique de la terre1. » Diapo 6
En 1832 Henri Heine surenchérit encore dans cette imaged’une ville absorbant toutes les forces intellectuelles de lanation :
« Paris est à proprement dire toute la France. Celle-cin’est que la grande banlieue de la France. Sauf ses bellescampagnes et les aimables qualités de ses habitants, engénéral toute la France est déserte, déserte au moins sousle rapport intellectuel2. » Diapo 7
Mais, dans un autre passage de ces mêmes conversations, un peu
plus d’un an après, Goethe reconnaît aussi certains avantages
du polycentrisme culturel allemand, là encore par comparaison
implicite avec la domination parisienne qui étoufferait, selon
lui, le développement culturel de certaines parties du
territoire national :
« Un Français, homme d’esprit, je crois que c’est Dupin, aébauché une carte de l’état de civilisation de la France,et mis sous les yeux, l’aide de couleurs plus claires ouplus sombres, le degré plus ou moins grand d’instructiondes différents départements. Or il se trouve que dans lesprovinces du Midi surtout situées loin de la capitale, desdépartements entiers marqués tout en noir, signe del’ignorance dans laquelle ils sont plongés. Cela serait-ilarrivé si la belle France, au lieu d’un grand centre
1 3 mai 1827, Paris, Gallimard, 1988, p. 517.2 H. Heine, De la France, 1832-33, éd. « Tel », Gallimard, 1994, p. 69.
6
unique, en avait dix d’où émanent la lumière et la vie ?3 »Diapo 8
En attendant que des forces de contestation reprennent en 1864
avec le programme de Nancy puis avec la renaissance de
mouvements culturels régionalistes comme le Félibrige les
arguments en faveur de la décentralisation résumés ici par
l’auteur de Faust, tous les indicateurs disponibles indiquent
une concentration unique de tous les pouvoirs de commandement
culturel national, qu’il s’agisse de l’édition, du théâtre, des
arts plastiques, avec le rôle central du Salon au Louvre puis
dans d’autres lieux spécifiques d’exposition (diapo 9), des
créations théâtrales, musicales ou d’opéra, de la presse
générale ou culturelle et enfin de la vie universitaire.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, Paris concentre le plus grand
nombre de salles de théâtre, d’opéra et de spectacles divers
d’Europe. Ces salles assurent l’essentiel des créations de
nouveauté et de maintien du répertoire consacré. Madrid mis à
part, Paris dispose du plus grand nombre de places de spectacle
par habitant bien qu’elle ne soit pas la capitale la plus
peuplée du continent qui à l’époque est Londres (voir diapo
10) ; si au XXe siècle d’autres grandes villes la dépassent
pour l’équipement en salles de spectacles, la force nationale
et internationale de Paris comme ville spectacle réside dans sa
capacité exportatrice de ses plus grands succès sur laquelle
nous reviendrons dans la deuxième partie.
Cela ne signifie pas, comme semblait l’indiquer Goethe, que la
province ou les grandes villes ne jouent aucun rôle culturel,
3 23 octobre 1828, ibid., p. 574.
7
mais soit elles se contentent de diffuser les nouveautés venues
de Paris (ainsi pour la production théâtrale ou l’édition), de
suivre les modes parisiennes (à travers la lecture des romans
ou des journaux spécialisés) ou d’inventer des institutions
analogues qui servent de marchepied vers le centre (salons de
peinture locaux, sociétés savantes, sociétés musicales locales
qui recherchent toujours le patronage ou des liens avec leurs
homologues du centre via l’emprise du système académique qui
embrasse les arts, la littérature, les sciences).
Romanciers, enquêteurs sociaux, statisticiens, chroniqueurs
ont beau souligner les effets négatifs de cette attractivité
parisienne excessive sur les jeunes aspirants à la gloire
culturelle et le pouvoir corrupteur de la concentration de tous
les pouvoirs de consécration culturelle aux mains d’un petit
groupe d’hommes, rien n’y fait. Qu’il s’agisse des académies
qui distribuent prix et avantages4 des collèges, lycées ou
écoles d’élite pour l’accès au sommet de l’Etat ou de
l’Université, des critiques des journaux qui font les succès
des œuvres du jour. La domination centralisée facilite la
corruption des réseaux d’interconnaissance, comme le soulignent
Balzac dans Illusion perdues (partie intitulée « un grand homme de
province à Paris ») et sa « Monographie de la presse
parisienne »5, ou, pour le Second Empire, Jules Vallès dans le
4 Voir les Mémoires de Berlioz sur les tractations pour l’attribution du « prix de Rome ».5 « Chose étrange ! Les livres les plus sérieux, les œuvres d’art ciselées avec patience et qui ont coûté des nuits, des mois entiers, n’obtiennent pas dans 1es journaux la moindre attention et y trouvent un silence complet » Balzac, Monographie de la presse parisienne, (21/1-28/2/1843) éd. J.-J. Pauvert, 1965, p.140.
8
bachelier et pour la troisième République bien des romans
parisiens dont Maupassant dans Bel-Ami. On sait que ce discours
critique sur les « coteries parisiennes », ce que Jean Dubuffet
appellera « le grand clan des arts et des lettres » se retrouve
presque inchangé jusqu’à nos jours où il fleurit
particulièrement à l’occasion de la remise des prix
littéraires, à chaque automne, même si, du fait des
transformations de la scène culturelle, il prend évidemment des
formes moins grossières qu’à l’époque romantique où Balzac lui-
même pouvait rédiger sous pseudonyme un compte rendu d’un de
ses propres livres !
Bien que les régimes successifs interviennent beaucoup dans la
vie culturelle (contrôle et censure des théâtres, commandes
publiques d’œuvres d’art, achats pour musées, contrôle étroit
de la presse jusqu’aux années 1880), on ne peut pas dire qu’ils
utilisent ces armes pour affaiblir la domination nationale de
Paris. Près de la moitié des étudiants français vivent au
Quartier latin, facteur d’agitation et de troubles dans les
périodes de contestation qui se produisent régulièrement au
XIXe siècle et avec lesquels renouent certaines manifestations
de l’entre-deux-guerres suscitées par l’extrême droite, ou dans
les années 1960 à l’extrême gauche avec la lutte contre la
guerre d’Algérie, puis du Vietnam et enfin les événements de
mai 1968. Les réformes universitaires de la troisième
République ont bien essayé de renforcer les universités des
autres villes, mais l’écart avec les facultés ou établissements
de la capitale ne diminue guère comme le montrent diverses
statistiques présentées dans les diapos suivantes.
9
Voir Diapos 11-12: En comparaison des autres capitales, les
établissements universitaires de Paris, en chiffres absolus
comme en pourcentage relatif, concentrent beaucoup plus
d’étudiants que toute autre ville en Europe et sans doute dans
le monde : 42,4% des étudiants français contre 13,2% des
étudiants allemands à Berlin par exemple en 1909, et
respectivement 41,4 et 15,3% en 1928. Ce rôle de formation
s’accompagne de la concentration également des moyens de
recherche à chaque époque ou des spécialités les plus rares.
Bien que Londres et Berlin à la fin du XIXe siècle tendent
aussi à rassembler une grande part des ressources
universitaires nationales, il existe d’importants contrepoids
qui freinent ce mouvement ; en Angleterre, il s’agit d’Oxford
et Cambridge toujours très bien dotés grâce à leur fortune
propre ou des universités écossaises autonomes par rapport au
centre, dans l’Allemagne impériale, les états fédérés
soutiennent leurs universités contre la domination prussienne,
ainsi Leipzig en Saxe face à Berlin, Munich en Bavière.
Une capitale nationale contestée (diapo 13-16)
Comment expliquer, au delà des effets de l’héritage historique,
la persistance de ces phénomènes de longue durée, alors même
que des mouvements régionalistes se développent sous la
troisième République, que la classe politique est dominée par
des élus provinciaux qui revendiquent leurs origines et ont
souvent une vision très locale et hostile à la capitale ?
Pourquoi le courant décentralisateur, notamment en matière
culturelle, échoue-t-il régulièrement en France ? Ne s’agit-il
10
que d’un effet des structures de longue durée renforcé par les
mécanismes de concentration des ressources économiques pour les
activités culturelles relevant du secteur commercial (édition,
presse, théâtre, marché de l’art), par la présence des grandes
fortunes aristocratiques et bourgeoises qui commencent à
pratiquer le mécénat culturel (fondation de musées privées,
donations aux musées et aux universités), ce qui avantage
encore la capitale où elles résident selon un « effet Mathieu »
bien classique ?
L’hystérésis du mouvement vers la centralisation culturelle ne
relève pas seulement de ces facteurs globaux, qu’on retrouve
par exemple aussi à Londres ou à Madrid, mais où ils
n’empêchent pas l’émergence d’autres centres culturels avec les
grandes villes du nord industriel anglais ou écossais dans le
premier cas, de Barcelone dans le second. Pour comprendre le
renforcement de la domination culturelle parisienne même à une
époque de libéralisation, de démocratisation ou d’essor des
thèses régionalistes, il faut tenir compte de la double
catastrophe antérieure qu’aucune autre capitale européenne
n’avait alors encore subie : le terrible siège de 1870-71 et la
guerre civile meurtrière qui a opposé la Commune au
gouvernement de Versailles de mars à mai 1871. Ce double
traumatisme n’a aucun équivalent dans une autre capitale de
l’époque où les derniers événements comparables remontent à
1812 pour la Russie (incendie de Moscou face à l’invasion de
Napoléon), ou à 1848 pour l’Europe centrale (révolutions à
Berlin, Vienne, Budapest). Il explique en partie l’atmosphère
encore très particulière de Paris trente ans après. Ville
11
ressuscitée de ses cendres (voir le symbole de l’Hôtel de ville
en ruines), elle s’est efforcée, tout au long de ces quarante
quatre années, de retrouver son rang européen et mondial. Cette
obsession transparaît dans la série des expositions
universelles qui culmine avec celle de 1900. Sans ces souvenirs
tragiques également, on ne comprendrait pas la soif de liberté
et de novation, la frénésie de divertissement et de dérision,
la passion politique inquiète et l’obsession du dépassement qui
habitent non seulement les élites, les écrivains, les artistes,
les intellectuels, mais aussi la plupart des habitants de
souche ou migrants ou des hôtes de passage de cette ville de
tous les contrastes et de tous les défis. Les incendies de la
Commune, les bombardements du siège, la migration partielle
hors de la ville de la fonction politique jusqu’en 1878, le
maintien de l’état de siège bien au delà de la guerre ont
montré que même la capitale des révolutions, même la ville qui
se pensait comme le centre du monde civilisé lors de
l’exposition universelle de 1867 où presque tous les souverains
se sont rendus en personne, pouvait en quelques mois perdre son
rang, se vider d’une partie de sa population, être honnie par
ses élites et une grande partie de la population nationale et
soumise aux plus grandes violences internes ou externes.
Il faut donc penser la plus grande partie de la troisième
République, malgré son provincialisme affiché, comme une
nouvelle séquence de restauration et de renforcement de Paris
comme capitale nationale et surtout symbolique et
internationale. Dans ce pays humilié et diminué après 1871,
pays incertain de son avenir avec la montée en puissance de
12
l’Allemagne unifiée et de l’Angleterre impériale, bientôt des
Etats-Unis, une grande partie des élites politiques, des
intellectuels, des écrivains ou des artistes, du moins ceux qui
n’adhérent pas au régionalisme assez minoritaire, veulent non
seulement effacer ce passé dramatique mais redonner au capital
symbolique séculaire de Paris comme capitale culturelle toute
sa fonction dans la lutte de concurrence renforcée où la France
globalement a perdu constamment du terrain par rapport au début
du XIXe siècle, en particulier en matière économique et
sociale.
II. CAPITALE CULTURELLE INTERNATIONALE
Ainsi au terme de ce premier ensemble d’analyses, Paris se
caractérise depuis la dernière partie du XIXe siècle par sa
domination culturelle écrasante dans son espace national mais
aussi de sa fonction internationale de référence par rapport
aux autres capitales européennes dont le pouvoir attractif
reste globalement inférieur, même quand il s’agit de villes en
passe de la dépasser sur le plan démographique. On peut le
démontrer plus en détail à partir de l’observatoire des
expositions et notamment celle de en 1900 qui se veut, selon le
titre donné au rapport par le commissaire général Alfred
Picard, « le bilan du siècle ».
La preuve par les expositions et les congrès
Ce schéma d’interprétation de l’obsession du rôle national et
international de Paris à préserver peut paraître abstrait et
en partie indémontrable puisqu’il relève de l’histoire des
13
représentations et d’initiatives disjointes et, pour partie,
non concertées. Il trouve cependant son illustration très
concrète dans l’une des manifestations symboliques et
culturelles majeure qui domine la période jusqu’en 1937, la
politique des grandes expositions où se mobilisent, selon une
tradition bien française, acteurs privés et acteurs publics,
élites locales et élites nationales. Elles sont l’occasion de
manifestations culturelles nationales et internationales de
grande ampleur. Quelques rappels tout d’abord : Paris est la
ville qui, au XIXe siècle et avant 1940, a accueilli le plus
d'expositions universelles : 7 contre 2 ou 3 seulement à
Londres et aucune à Berlin : 1855, 1867, 1878, 1889, 1900,
1925 (Arts décoratifs), 1931 (Exposition coloniale) et 1937
(Exposition des arts et techniques).
Diapo 18 : De plus, les expositions de Paris ont été les plus
visitées et ont rapporté globalement énormément d'argent : on
passe d'un peu plus de 5 millions de visiteurs en 1855 à 11
millions en 1867, 16 millions en 1878, 25 millions (payants)
en 1889 et 50 millions en 1900, 15 millions en 1925, 31
millions en 1937. Le record absolu de 1900 a été dépassé
seulement à la fin du XXe siècle quand les facilités de
déplacement sont beaucoup plus grandes qu’à l’époque du train
et du bateau à vapeur.
L’Exposition de 1900
Le succès de cette exposition repose d’abord sur le prestige
international et ancien de Paris comme le montre le fait qu'en
1900, alors que Berlin, capitale de l’Allemagne impériale,
14
souhaitait enfin accueillir une exposition, le choix parisien a
de nouveau prévalu au nom à la fois de la réussite des
expositions antérieures et de la volonté gouvernementale de
maintenir la périodicité régulière établie tous les onze ans,
manière d’entretenir l’entreprise de redressement national
inaugurée en 1878 pour effacer le traumatisme de 1871.
Quels sont les atouts plus substantiels dont bénéficie Paris
par rapport à ces rivales dans la course au titre de
« capitale des capitales » ? Le bilan statistique de
l’exposition en fournit quelques pistes d’analyse.
Les statistiques disponibles permettent de préciser le
rayonnement géographique international de Paris comme capitale
culturelle en cette dernière année du XIXe siècle : En 211
jours on a recensé 50 860 801 entrées dont 41 027 177 payantes.
La moyenne des entrées par jour s’établit à 241 046 avec des
pointes le dimanche à 409 376 et à 438 577 lors de la journée
gratuite de novembre6. Si ce dernier indicateur souligne la
forte présente d’un public parisien, le trafic des gares et des
ports indiquent un afflux également notable de provinciaux et
d’étrangers. Le trafic des gares parisiennes connaît ainsi un
pic particulier avec 102 millions de passagers, soit 25 de plus
qu’en 1899, et 56 millions de plus qu’en 1889, une autre année
d’exposition. L’Album statistique de 1900 permet d’aller plus loin
dans l’analyse des provenances géographiques : 439 976
voyageurs sont venus par chemin de fer de l’étranger et 150 763
par mer. Sans surprise, les pays qui envoient le plus de
visiteurs sont à la fois les plus proches et aux classes
6 Annuaire statistique de la ville de Paris 1900, Paris, Masson, 1902, p. 516.
15
supérieures les plus riches. Par ordre d’importance, ce sont la
Grande-Bretagne, la Belgique, la Hollande, la Suisse,
l’Allemagne et l’Autriche, l’Italie. Il est difficile de
déterminer l'importance du contingent américain puisque
beaucoup passent par les transatlantiques anglais et ensuite
retraversent la Manche après avoir fait escale à Liverpool ou
Londres. La statistique consultée nous montre aussi l’étendue
du rayonnement de l’Exposition puisqu'on note des provenances
très lointaines : plus de 10 000 voyageurs sont venus
d'Amérique du sud, plus de 3 600 de Chine et du Japon, plus de
8 000 des Indes orientales et d’Australie, plus de 14 000
Russes sont venus par bateau (auxquels il faut ajouter ceux qui
ont emprunté la ligne de train Paris/Berlin/Moscou, confondus
dans le contingent « allemand »), plus de 28 000 proviennent du
Bassin oriental de la Méditerranée. 59 753 d'Algérie, 14 556 de
Tunisie, 2 974 de Cochinchine. Paris, lors de cette exposition,
apparaît ainsi comme une des capitales de ce qu’on a appelé la
première mondialisation.
La superficie dédiée à l’Exposition est immense avec 216
hectares sur deux sites (Champ de Mars Champs-Elysées, colline
de Chaillot, et Bois de Vincennes) et pourtant l’entassement
des pavillons, tel qu’il ressort des photos aériennes, donne
l’impression d’un espace saturé où l’on a voulu faire figurer
toutes les parties du monde. Tous les styles architecturaux,
artistiques ou musicaux se mêlent et se côtoient. L’espace de
l’exposition opère des rapprochements incongrus entre l’ancien
et le moderne, le proche et l’exotique.
16
A côté de la fonction distractive de la culture parisienne,
l’exposition de 1900 met aussi en valeur un autre trait de la
centralité internationale parisienne avec la multiplication
des Congrès scientifiques et professionnels qui s’y tiennent à
cette occasion. Situer un congrès à Paris c’est en assurer le
rayonnement et attirer des participants qui souhaitent en même
temps profiter des ressources culturelles, sociales,
politiques, distractives de la seule capitale qui les
concentre sur un espace étroit.
Diapo 20 Congrès : Cette exposition, comme les précédentes,
accueille de très nombreux congrès qui structurent peu à peu
le champ du savoir international dans tous les domaines au
cours du XIXe siècle et au delà : on en dénombrait 3 en 1855,
14 en 1867, 48 en 1878 ; 101 en 1889, il y en a le double en
1900 203, avec un total de 68 000 participants7. Grâce à tous
ces experts et ces savants rassemblés, Paris joue le rôle
capitale intellectuelle du monde pendant quelques mois. Paris
conquiert dès cette époque son titre de ville où se tient le
plus grand nombre de congrès et où à l’échelle du pays ils se
concentrent de préférence sur les bords de la Seine comme le
montre le contraste avec Londres où même une année
d’exposition la moitié ou moins des congrès du pays s’y
retrouve (diapo 21).
Cette centralité est évidemment à double tranchant. Elle
traduit aussi le déséquilibre du réseau urbain français par7 Chiffres donnés par Claude Tapia, « Paris, ville des congrès de 1850 ànos jours », in A. Kaspi et A. Marès (dir.), Le Paris des étrangers depuis un siècle,Paris, Imprimerie nationale, 1989, p.35-43, ici tableau p. 39. Certainesautres sources, comme le rapport cité de l’exposition de 1900, donnent deschiffres légèrement différents mais du même ordre de grandeur et decentralité par rapport à l’ensemble national.
17
rapport aux autres pays ; les autres grandes villes françaises
n’ont pas les atouts pour figurer dans un palmarès
international de ce type alors qu’une ville comme Bruxelles,
guère plus grande que Lyon ou Marseille à l’échelle
internationale, occupe, on le voit, un rang tout à fait
éminent dans le palmarès, ce qui n’empêche pas d’ailleurs des
villes belges comme Gand et Anvers de se lancer également dans
l’organisation de grandes expositions. Cette fonction
rassembleuse de Paris tire sa puissance de considérations
scientifiques (proximité de la plus grande concentration
d’étudiants et de chercheurs de haut niveau) mais aussi
extrascientifiques : en dehors du congrès, les congressistes
sont assurés de trouver des activités intellectuelles,
artistiques ou distractives sans équivalent ailleurs. Enfin
pour un pays comme la France républicaine qui se sent diminué
depuis 1871, les congrès sont un enjeu symbolique et les
autorités les soutiennent par des marques d’hospitalité ou de
prestige dans une politique d’image que ne pratiquent pas
autant les monarchies traditionnelles, engoncées dans les
rigidités des rituels de cour ou d’ethos aristocratique alors
que la culture des congrès est plus en phase avec l’idéal
démocratique et égalitaire. Ce point se relie aussi à la
seconde centralité internationale de Paris liée à sa fonction
savante ancienne.
Cette fonction savante internationale de Paris peut être
précisée par l’examen du rayonnement universitaire des
établissements parisiens. Un facteur nouveau, d’origine
internationale, contrecarre la volonté décentralisatrice
18
partielle de la République née après la défaite de 1871. Il
s’agit du développement des flux d’étudiants étrangers, élément
de prestige dans la concurrence entre nations. Dans tous les
pays d’Europe avancée, comme l’a montré Victor Karady, ces
étudiants et, de plus en plus, ces étudiantes venus d’ailleurs,
si l’on met à part la Suisse dont les universités accueillent
de nombreux étudiants russes, tendent à se concentrer dans les
capitales alors que la vie y est beaucoup plus chère
qu’ailleurs. Ils peuvent en effet y construire des réseaux
d’entraide ou y trouver des activités annexes pour survivre.
C’est particulièrement vrai à Paris comme le montre la
comparaison avec Berlin ou les universités provinciales. Dans
l’entre-deux-guerres, ce mouvement centripète persiste et il
faudra attendre la politique volontariste de création
d’universités hors Paris dans les années 1960 pour que la part
des effectifs des universités parisiennes dans le total
français descende au tiers du total national, ce qui reste
beaucoup plus que partout ailleurs si l’on met à part le cas de
Mexico ou Buenos Aires.
A Paris, le pouvoir d’attraction universitaire, loin de
diminuer, s'accentue sous la troisième République alors que
l’attractivité sur les étudiants étrangers de l’autres grande
université européenne, celle de Berlin, tend au contraire à
régresser dans les années 1920, malgré la croissance générale
des effectifs l'Université Friedrich-Wilhelm (aujourd’hui
Humboldt) à l’époque de Weimar. On passe à Paris d'un peu moins
de 10% d'étudiants étrangers (1890) à 17,7% en 1910 et 24,5% en
1928 (contre 13% à Berlin) (diapo 19).
19
Droit Médecine Lettres SciencesParis 9,4 13,7 6,4 8,3Berlin 4,26 15,6 21,3 17,02Tableau n°1 : Pourcentage d’étudiants étrangers par faculté en1897/98 à Berlin et à Paris. Voir diapo 19L’inégale présence des étudiants étrangers selon les facultés
(tableau n°1) souligne bien les fonctions très variables des
études à Paris, selon la discipline et le pays d'origine.
Paradoxalement, ce sont les facultés professionnelles (droit et
médecine), dominantes par les effectifs et la centralité
parisienne, qui apparaissent les plus cosmopolites. Ceci
traduit le souci utilitariste d'étudiants, venus surtout de
l’Europe pauvre de l’est et du sud pour obtenir un titre
professionnel rendu prestigieux, par son origine parisienne,
dans leur pays natal. Inversement, les facultés intellectuelles
recrutent plutôt leurs auditeurs étrangers dans les vieilles
nations intellectuelles, tout particulièrement quand il s'agit
de la faculté de culture générale par excellence, la faculté
des lettres. Alors qu'ailleurs ils sont peu nombreux, les
étudiants allemands, américains du nord ou des pays nordiques
souhaitent s'imprégner de la civilisation française en suivant
les cours de la Sorbonne. L'idée ne leur vient pas en revanche
d'apprendre les rudiments de la science et de la médecine à
Paris, puisqu'ils disposent, chez eux, d'établissements
équivalents voire supérieurs par les locaux et les équipements.
20
Pays Faclettres
Facsciences
Facmédecine
Facdroit
Total %
Grande-Bretagne
3 2 8 9 22 1,8
EU/Canada 18 6 7 3 34 2,9Russie 8 30 182 17 237 20,2Bénélux 6 6 13 9 34 2,9Autriche-Hongrie
7 3 6 3 19 1,6
Allemagne 31 2 19 5 57 4,8Suisse 7 5 21 10 43 3,6Espagne/Portugal
- 1 10 1 12 1,0
Italie - - 5 2 7 0,6Paysnordiques
5 2 2 - 9 0,7
Bulgarie 4 1 - - 5 0,4Serbie 6 1 5 23 35 2,99Roumanie 8 26 74 117 225 19,2Turquie 4 13 88 47 152 12,9Grèce 2 3 24 31 60 5,1Japon 1 - - 2 3 0,2Amériquelatine
- 4 58 26 88 7,5
sous total 110 106 546 344 1106 94,5Égypte - 1 6 32 39 3,3Perse - - 3 1 4 0,3Afrique - - 15 6 21 1,8Totalgénéral
110 107 570 383 1170 100
Tableau n°2: Pays d'origine des étudiants étrangers à Paris en18988.D’où proviennent ces étudiants étrangers à Paris ? (tableau
n°2) Les étudiants russes sont particulièrement nombreux en
8 Source Annuaire statistique de la Ville de Paris et C. Charle, Paris fin de siècle, culture et politique, Paris, Le Seuil, 1998, p.35-36.
21
sciences et en médecine, à la fois parce qu’ils viennent d'un
pays en retard et qu'ils trouvent en France un climat de
liberté et de tolérance supérieur, encore élargi dans une
métropole comme Paris : bon nombre de ces Russes appartiennent
en fait aux ethnies ou religions dominées ou persécutées dans
la Russie tsariste (Polonais, Juifs). Leur insertion est
facilitée en outre par le précoce apprentissage du français
dans cette partie de l'Europe.
L’espace culturel international sur lequel particulièrement
Paris exerce son emprise au tournant du XXe siècle est
essentiellement tourné vers les pays du sud-est européen
(Roumanie, Balkans, Grèce) les enclaves francophones
(Belgique, Suisse, élites russes et slaves en général), le
Proche Orient où existe une implantation ancienne
d’institutions d’enseignement d’origine française (Egypte,
Liban, Turquie) mais surtout liées au catholicisme et à une
culture assez classique et conservatrice9. Cette géographie
différentielle sera confirmée par l’entre-deux-guerres, mais
complètement transformée dans les années 1950-60 avec
l’arrivée massive des étudiants coloniaux puis plus tard de
l’ancien empire français.
Cette montée en puissance de la fonction universitaire
internationale de Paris a longtemps été laissée sans direction
et a été produite par les choix individuels des intéressés,
qu’il s’agisse des chercheurs ou universitaires ou des
étudiants eux mêmes. Progressivement toutefois, toujours dans
9 V. Karady, « La migration internationale d’étudiants en Europe », Actes de larecherche en sciences sociales, n°145, décembre 2002, pp.47-60. Pierre Moulinier,Les étudiants étrangers à Paris au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2011.
22
la perspective de la concurrence internationale avec les
autres grands pays, des initiatives officielles ou des mécènes
se préoccupent du problème : invitations de professeurs
étrangers dans les facultés parisiennes (en particulier mise
en place d’échanges réguliers avec Columbia et Harvard10),
création d’un service de coopération universitaire avec
l’Amérique latine et surtout fondation et développement de la
Cité universitaire internationale après la Grande Guerre, à
l’occasion de la libération de terrains au sud du quartier
latin par la disparition des fortifications ; une grande
partie du financement des pavillons est d’origine
internationale, voire privée comme le montrent la chronologie
et les noms des pavillons : fondation Deutsch de la Meurthe
(un grand industriel du pétrole), fondation Rosa de Abreu-
Grancher pour Cuba, fondation Nuber Pacha pour l’Arménie,
fondation Biermans-Lapôtre pour la Belgique (diapo 23).
La construction au milieu d’un parc s’inspire du modèle du
campus américain ou des collèges anglais (on parle d’un Oxford
français), mais si ces mécènes ou Etats consentent à ces
créations c’est bien parce que cette résidence cosmopolite est
à quelques kilomètres seulement du Paris mythifié par la fin
du XIXe siècle. L’idéal de mélange des nationalités qui
préside à l’installation des étudiants (malgré la nationalité
affichée de chaque maison) s’inscrit aussi dans le message
pacifiste postérieur au grand massacre de la jeunesse après
1918. L’ordre de naissance des maisons est un fidèle reflet du
système d’alliances de la diplomatie française et des
10 Voir C. Charle, La République des universitaires (1870-1940), Paris, Le Seuil, 1994,p. ?
23
proximités culturelles entre la France et les autres nations ;
c’est ce qui explique que la maison des étudiants canadiens et
la Belgique arrivent en tête, suivi des nations latines ou de
l’allié anglais. Les anciens ennemis sont durablement exclus
et la maison Henri Heine fondée par l’Allemagne fédérale et
des mécène allemands attendra 1956 pour trouver une place dans
le cercle extérieur de la cité tout proche du périphérique en
construction, situation assez peu enviable pour
l’environnement et la quiétude.
Paris capitale dans les livres
Pour expliquer le rayonnement et l’attractivité de Paris, il
faut aussi faire intervenir la dimension littéraire de l’image
de cette ville à l’échelle internationale. Avant même de venir
à Paris, provinciaux ou étrangers, intellectuels ou non, qu’ils
viennent en touristes, pour s’y établir durablement ou pour
affaire s’en font une certaine image. Elle est véhiculée certes
par les nouveaux supports médiatiques propres à la fin du
siècle que sont la presse illustrée, les cartes postales, les
affiches de chemin de fer, les tableaux de peintres exportés à
l’étranger. Nous pensons évidemment aux scènes parisiennes de
certains impressionnistes mais à l’époque d’autres peintres
moins modernes se font une spécialité des scènes de la vie
parisienne. Mais ce qui touche peut-être le plus les
contemporains pour se former une représentation de Paris à
distance, ce sont sans doute les images et les personnages plus
ou moins exacts, plus ou moins stéréotypés qui sont présents
dans l’abondante production romanesque ou dans les pièces de
24
théâtre de boulevard traduites et exportés dans les autres pays
d’Europe tout au long du XIXe siècle avant que le relais soit
pris par la production cinématographique dans l’entre-deux-
guerres où le paysage social et culturel parisien est très
présent sous forme réaliste ou fantasmé (voir en particulier le
Paris romantique des Enfants du Paradis). Cette production est
massive ; des tentatives ont été faites pour la connaître mais
sa masse même est décourageante tout comme le caractère très
répétitif de cet ensemble de « romans parisiens », de
« comédies de boulevard » ou de films divers. Le plus important
est moins le contenu, souvent conventionnel pour le gros de ces
œuvres destinées au public moyen, que leur exportation dans
d’autres pays soit directement en français pour les classes
supérieures qui peuvent lire cette langue, soit en traduction
pour les romans qui ont le plus de succès. Le XIXe siècle et le
début du XXe siècle est celle d’une double domination à
l’exportation des romans anglais et français en Europe, mais la
différence entre les premiers et les seconds est que les romans
anglais sont surtout exportés vers les zones anglophones et
sont retenus par une censure morale bien plus rigide qu’en
France. Ils sont beaucoup moins centrés sur Londres ou en
présentent une image plutôt négative comme l’a partiellement
montré Franco Moretti dans son Atlas du roman européen. Les romans
français peuvent être traduits dans de nombreuses langues
européennes et attirent pour leur réputation d’être plus libres
que leurs concurrents anglais : en italien, allemand, espagnol,
russe et touchent donc des pays très divers. Il en va de même
pour les pièces de théâtre.
25
Ces productions de littérature moyenne sont surtout le fait
d’auteurs habitant Paris, étant donné la concentration de la
vie littéraire dans la capitale. Ils y situent très souvent
leurs intrigues ou personnages souvent pour en tenir une
chronique plus ou moins réaliste et informée et avec une
déformation très nette vers le haut de la pyramide sociale même
si certains romans naturalistes à succès comme ceux de Zola
s’attachent à des groupes longtemps tenus aux marges de la
littérature : ouvriers, employés, prostituées, artistes,
journalistes, etc. Cela ne veut pas dire que la littérature
parisienne dérangeante traverse sans encombre les frontières
car certaines licences ne sont pas acceptées dans les autres
pays aux censures plus sévères. Du moins ces œuvres même quand
elles font scandale ou sont assez librement caviardés (je pense
aux traductions des Mystères de Paris, des Misérables, de l’Assommoir,
ou Nana de Zola) entretiennent une image complexe et fascinante
de la ville dans les autres pays. Depuis Dickens et si l’on met
à part Conan Doyle mais dans un genre un peu déconsidéré à
l’époque le roman policier, Londres ni a fortiori aucune autre
capitale européenne n’a bénéficié de cet accompagnement
littéraire continu depuis le XVIIIe siècle d’œuvres et
d’auteurs internationalement connus. Cette relation intime
entre Paris comme capitale littéraire (centre du champ
littéraire français), capitale des livres (centre de l’édition
nationale et de la presse), et capitale dans les livres, thème
central pour de nombreuses œuvres de fiction ou de théâtre,
explique trois phénomènes :
- certains best-sellers internationaux français sont centrés
26
sur la capitale depuis les mystères de Paris, les Misérables jusqu’à
Paris de Zola pour ne parler que d’œuvres encore connues
aujourd’hui ;
- le roman parisien comme genre spécifique est imité dans
d’autres capitales émergentes comme Saint Pétersbourg avec
Dostoïevski, Vienne avec Schnitzler, Rome avec
D’Annunzio, Berlin avec Döblin pour ne parler que
d’auteurs encore connus.
- Les images véhiculées tiennent à la fois compte des
changements urbains et, en même temps, retardent souvent
sur eux. D’une part, les auteurs décalent volontiers leurs
intrigues dans un temps plus ancien ou quand ils ne le
font pas, intervient le décalage du temps de la traduction
et de l’adaptation dans d’autres pays. Eugène Sue par
exemple est encore lu en Russie à la fin du siècle tout
comme Balzac. Zola ne pénètre qu’avec un certain retard
dans les pays les plus conservateurs.
Extrait de Paris :
“Si le monde antique avait eu Rome, maintenant agonisante,Paris régnait souverainement sur les Temps Modernes, lecentre aujourd’hui des peuples, en ce continuel mouvementqui les emporte de civilisation en civilisation, avec lesoleil, de l’est à l’ouest. Il était le cerveau, tout unpassé de grandeur l’avait préparé à être, parmi les villes,l’initiatrice, la civilisatrice la libératrice. Hier, iljetait aux nations le cri de liberté, il leur apporteraitdemain la religion de la science, la justice, la foinouvelle attendue par les démocraties. Il était la bontéaussi, la gaieté et la douceur, la passion de tout savoir,la générosité de tout donner. En lui, dans les ouvriers deses faubourgs, parmi les paysans de ses campagnes, il yavait des ressources infinies, des réserves d’hommes où
27
l’avenir pourrait puiser sans compter. Et le sièclefinissait par lui, et l’autre siècle commencerait, sedéroulerait par lui, et tout son bruit de prodigieusebesogne, tout son éclat de phare dominant la terre, tout cequi sortait de ses entrailles en tonnerres, en tempêtes, enclartés victorieuses, ne rayonnait que de la splendeurfinale dont le bonheur humain sera fait. […]Et ce n’était pas non plus la ville avec ses quartiersdistincts, à l’est les quartiers du travail embrumés defumées grises, au sud ceux des études d’une sérénitélointaine, à l’ouest les quartiers riches, larges et clairs,au centre les quartiers marchands, aux rues sombres. Ilsemblait qu’une même poussée de vie, qu’une même floraisonavait recouvert la ville entière, l’harmonisant, n’enfaisant qu’un même champ sans bornes, couvert de la mêmefécondité.11”
Paris capitale artistique internationale (diapo 29)
L’attractivité artistique internationale de Paris s’est
développée au cours du XIXe siècle et a peu à peu éclipsé (sauf
dans la sculpture) la fonction acquise par Rome comme lieu de
formation après la Renaissance, ce qu’attestent la fondation de
l’Académie de France à Rome et l’institution du prix de Rome
qui joue toujours un rôle central au XIXe voire au XXe siècle
dans certains domaines pour désigner la future élite artistique
du moins définie en termes académiques12. A l’inverse, on voit
progresser la part des étudiants étrangers à l’Ecole des Beaux-
Arts ou dans les ateliers privés qui se multiplient et celle
des artistes qui exposent dans les principaux salons parisiens
voir tableau n°3.
11 E. Zola, Paris (1898), édition établie et présentée par Henri Mitterand, Paris, Stock, 1998, p. 457-58.12 Maria Pia Donato, Giovanna Capitelli et Matteo Lafranconi, « Rome capitale des arts au XIXe siècle », in C. Charle (dir.), Le temps des capitales culturelles XVIIIe-XXe siècles, op. cit., p. 65-99, en particulier p. 72 et s.
28
S.Nale Beaux Arts1899
Artistesfrançais1899
S. Nale Beaux Arts1909
Artistes français1909
Salond’automne1909
Paris 34,7 21,3 34,1 30,3 35,2
Berlin1897
9,1
Tableau n°3 : Part des artistes étrangers dans divers Salons àParis et à Berlin.
En 1899, on dénombrait 34,7% d’exposants étrangers à la Société
nationale des Beaux-Arts et 21,3% à la Société des artistes
français ou encore 35,1% au Salon d’Automne de 1909, le plus
international. C’est un nouvel indice de l’attractivité et du
rayonnement du monde de l’art parisien même si par ailleurs les
institutions officielles restent assez conservatrices. Il
existe du moins des espaces de liberté que saisissent ces
avant-gardes.
Comme pour l’essor congrès internationaux ou la fréquentation
des facultés parisiennes par des étudiants étrangers, le
mouvement débute sous le Second Empire mais s’accentue sous la
troisième République lorsque trois phénomènes convergent : la
floraison des avant-gardes et des polémiques artistiques contre
la peinture académique, la montée en puissance du marché de
l’art contemporain à Paris (qu’il soit novateur ou
traditionnel) avec le développement du système
marchand=critique, encouragé par la puissance de la presse
parisienne générale ou spécialisée, l’arrivée sur le marché
parisien de nouveaux collectionneurs étrangers, notamment
29
américains qui succombent à leur tour au mythe parisien,
d’abord comme capitale du goût, de la civilisation et du luxe
depuis le XVIIIe siècle puis, pour les moins conformistes,
l’intérêt pour les tendances novatrices en fonction de la
victoire symbolique du thème de la modernité en art.
L’idée ressassée, et propre à Paris du fait de son histoire
révolutionnaire spécifique, qu’en art, comme en littérature et
dans tous les domaines culturels, l’avenir appartient à ceux
qui rompent avec la tradition s’appuie sur la preuve par la
réussite des mouvements antérieurs qu’on annexe pour la
démonstration13, même si c’est au prix d’une certaine
distorsion de la réalité historique : le romantisme dans sa
dimension littéraire, picturale, musicale (voir « l’hommage à
Delacroix » de Fantin-Latour où figurent tous les représentants
la jeune peinture des années 1860), le réalisme avec plus de
difficulté, avec le succès de Courbet en Allemagne et la propre
mise en scène de sa gloire et de ses amis dans l’Atelier du peintre,
présenté et refusé à l’exposition de 1855, et surtout
l’impressionnisme dont le succès international coïncide avec
l’exposition centennale dans le cadre de l’exposition
universelle de 1889. Cette histoire glorieuse de la novation
artistique masque la masse des échecs dans un univers de plus
en plus concurrentiel du fait de sa centralisation. Cette
légende dorée du « modernisme » implique, aux yeux de
l’étranger que ceux qui produisent la « nouvelle » peinture et
qu’on appellera bientôt l’avant-garde, comme si l’histoire
était déjà écrite, ont toute chance d’être bientôt les
13 Voir Théodore Duret, Critique d’avant-garde, (1885) n. éd., Paris, ENSB, 1998, p. 42.
30
vainqueurs en fonction de cette représentation historicisée et
tendue vers le futur amorcée dès les années 1860 et peu à peu
théorisée par Baudelaire, Zola ou d’autres.
Cette image de Paris comme lieu de la réussite artistique la
plus brillante ne concerne pas seulement les peintres novateurs
mais aussi des peintres plus traditionnels qui obtiennent des
succès mondains comme l’américain John Singer Sargent formé à
l’Ecole des Beaux-Arts, Whitsler, compagnon des
impressionnistes tout comme Mary Cassatt, l’italien Giovanni
Boldini, etc.
Ce rayonnement et cette attractivité se retrouvent avec les
avant-gardes en « ismes » caractéristiques de la fin du XIXe
siècle et de la première décennie du XXe siècle, en peinture
avec le divisionnisme de Seurat et Signac (1886), le mouvement
nabi (1899), la fondation du Salon d’Automne (1903), explose le
fauvisme en 1905 et le cubisme en 1908 ou des peintres de
l’Ecole de Paris après 1910 (diapo 31). Ces novateurs dans
différents genres sont souvent liés entre eux, par l’amitié, le
souci d’entraide ou un lieu de résidence proche. Les nombreux
peintres étrangers, résidents permanents ou épisodiques
caractérisent cette période des années 1890 aux années 1930,
certains se lient à ces mouvements, d’autres suivent les voies
traditionnelles : A. Mucha et F. Kupka, originaires de Bohême
débutent dans les journaux satiriques parisiens en 1896 avant
de se lier à l’avant-garde, K. Van Dongen, venu de Hollande,
installé à Paris en 1899, Edvard Munch, norvégien présent en
1896 et qui envoie régulièrement des tableaux aux salons de la
capitale, tout comme W. Kandinsky qui passe un an à Paris en
31
1906. Picasso, formé à Barcelone, après une première visite à
l’exposition de 1900, y habite de manière permanente à partir
de 1904, Sonia Terk, plus tard épouse de Robert Delaunay, venue
de Russie via l’Allemagne, s’installe, elle, en 1905 comme
Modigliani venu de Livourne14. Chagall arrive en 1910 ; l’un et
l’autre seront hébergés à La Ruche, résidence d’artistes
passage de Dantzig (15è arrondissement) dans un pavillon
métallique récupéré de l’exposition de 1900 ouvert en 190215.
Ces artistes venus de partout sont parfois contraints de se
faire connaître par des expositions hors des lieux officiels
dans les cafés ou à l’étranger, ils dépendent des articles de
jeunes écrivains ou journalistes publiés dans les petites
revues comme le Mercure de France, la Revue blanche. Ils recourent
plus rarement à des ouvrages de doctrine comme celui de Paul
Signac, D’Eugène Delacroix au néo-impressionnisme (1899) ou à des
manifestes, difficilement placés dans la grande presse, comme
celui des futuristes italiens qui ont droit à la première page
du Figaro pour se faire connaître en février 190916.
Paris joue ce rôle de capitale artistique internationale non
seulement en raison de cette concentration multinationale
d’artistes de toute origine et de tout type, mais aussi à cause14 Le fauvisme ou « l’épreuve du feu ». Eruption de la modernité en Europe, Musée d’artmoderne de la ville de Paris, Paris, Paris Musées, 1999, p. 451, 462, 464,477, 481.15 Cf . La Ruche cité des artistes. 1902-2008, exposition au Palais Lumière à Evian,catalogue éditions alternatives 2009. (cf. Harry Bellet, « La Ruche un belabri pur les artistes comme Chagall, Modigliani ou Léger », Le Monde, 26 mars2009, p. 22).16 Réédition, Paris, Hermann, 1978, introduction et notes de FrançoiseCachin; « Manifeste du futurisme », version publiée dans Le Figaro du 20février 1909, reproduit et commenté dans Fanette Roche-Pezard, L’aventurefuturiste 1909-1916, Rome, Ecole française de Rome, 1983, p. 68.
32
du grand nombre des marchands d’art, des ventes, des multiples
lieux d’exposition, de la présence de colonies étrangères de
riches amateurs ou collectionneurs et de la masse des touristes
étrangers qui y viennent régulièrement pour leurs achats de
luxe dont font partie les objets d’art produits ou exposés dans
la capitale. Sans doute, d’autres capitales comme Londres,
Bruxelles, Vienne, Munich ou Berlin, voire Saint Pétersbourg ou
Moscou montent dans la hiérarchie des prestiges artistiques et
se dotent peu à peu des mêmes atouts (nouveaux musées, nouveaux
lieux d’exposition) comme l’a montré Béatrice Joyeux-Prunel
dans son livre Nul n’est prophète en son pays. Toutefois l’indicateur
qu’elle a construit sur les expositions d’art moderne montre
que jusqu’en 1914, malgré le rattrapage des autres villes la
position dominante est toujours occupée par la capitale
française (voir diapo 32).
L’entre-deux-guerres, avec la multiplication les difficultés
économiques de la France dans les années 1930 et l’émergence
internationale du phénomène des avant-gardes comme le montrent
des phénomènes comme le futurisme, les avant-gardes russes et
allemandes indépendantes des influences parisiennes, marque un
début de déclin de Paris comme capitale mondiale de l’art.
Cependant les tensions politiques des années 1930 redonnent à
Paris une fonction comme lieu d’accueil des avant-gardes
persécutées par les dictatures, mais c’est aussi le moment où
le marché de l’art s’effondre du fait de la crise de 1929 et du
tarissement des achats américains. Le déclin est accentué par
la guerre et l’Occupation où de nouveaux centres artistiques
prennent leur essor, en particulier dans le sud de la France et
33
surtout aux Etats-Unis avec New York puisque l’avant-gardisme
devient impossible dans la capitale devenue l’un des bastions
du nazisme et de ses collaborateurs. La même alternance de haut
et de bas se retrouve dans les années 1950 et 1960 comme l’ont
montré Julie Verlaine et Raymonde Moulin avant que le
polycentrisme du marché artistique triomphe au profit de New
York et aujourd’hui de multiples villes et leurs biennales ou
foires internationales comme Bâle17.
Paris capitale internationale de l’opéra et de la musique
(diapos 33-38)
En matière d’opéra et de musique, le cosmopolitisme parisien
est plus ancien encore que pour les arts plastiques : depuis
Louis XIV, les relations musicales avec l’Italie par exemple
dans le domaine de l’opéra ont été intenses et Paris a
accueilli de nombreux compositeurs ou interprètes étrangers
dans des postes en vue de ses institutions culturelles à
commencer par Spontini, Rossini ou Donizetti, Reicha au
Conservatoire ou à l’Opéra et à l’Opéra italien, Chopin et
Liszt comme interprètes ou créateurs en partie exilés pour ne
citer que les plus célèbres. Dans la seconde moitié du XIXe
siècle cette ouverture aux autres musiques ou musiciens
continue et s’étend à de nouvelles contrées plus diverses et
lointaines (comme la Russie, l’Espagne et l’Allemagne). Surtout
les créations opératiques et musicales parisiennes s’exportent
à une échelle nouvelle à l’étranger avec la facilité des
17 J. Verlaine, Les galeries d’art contemporain à Paris 1944-1970, Paris, Publication de la Sorbonne, 2012, chapitres 8 et 9 ; Raymonde Moulin, Le marché de la peinture en France, Paris, Ed. de Minuit, 1967, rééd., 1989.
34
communications et la médiatisation croissantes. Nous sommes à
un moment où l’école musicale française et singulièrement la
production d’opéras ou d’opéras comiques connaissent de vrais
et durables succès à l’exportation avec les opéras d’Auber et
Meyerbeer (sur des livrets de Scribe l’auteur français le plus
joué en Europe), Faust de Gounod, Carmen de Bizet, sans parler
des opérettes d’Offenbach, d’Hervé, de Lecoq jouées dans toute
l’Europe. La focalisation excessive sur la lutte entre les
partisans et les adversaires de Wagner, qui réduit cette époque
à une nouvelle forme de l’affrontement franco-allemand en donne
une image déformée que les travaux de William Weber, Jan
Pasler, Myriam Chimènes ont sensiblement corrigée. Sans aucun
doute, l’accès de Wagner aux institutions officielles a été
retardé après le scandale de Tannhäuser en 1861 et le rejet du
compositeur en fonction de ses prises de position haineuses
pour la France lors du conflit de 1870. Exclu de l’Opéra
jusqu’en 1891 (première de Lohengrin), Wagner est cependant très
présent en extraits dans les concerts des principales sociétés
parisiennes depuis les années 1880.
Mais cet aspect de la vie de l’opéra perturbé par les tensions
nationales ne doit pas masquer le phénomène le plus important
qui caractérise cette époque à savoir la forte
internationalisation des œuvres créées à Paris et, en sens
inverse, l’arrivée sur les scènes parisiennes de nombreux
auteurs étrangers ou de musiques nouvelles inconnues dans la
première partie du XIXe siècle. Ce double mouvement est lié à
des traits spécifiques déjà évoqués mais qu’il faut rappeler
aussi dans une perspective comparative : Paris est la capitale
35
théâtrale de l’Europe, qu’on raisonne en termes de théâtre
parlé ou de théâtre chanté ; Paris dispose de nombreux théâtres
spécialisés ainsi que d’un ensemble de périodiques généraux ou
spécifiques qui sont lus hors des frontières et contribuent à
faire connaître les échecs ou les succès des scènes
parisiennes. Les directeurs des salles des autres pays les
importent quand ils flairent un succès qui a su plaire au
public parisien réputé pour son exigence du fait de la pléthore
des nouveautés et son bon niveau culturel, ce qui fait espérer
que ledit succès pourra réussir hors des frontières18.
Ces exportations sont soutenues également par les tournées à
l’étranger de certaines vedettes (chanteurs, chanteuses et
acteurs ou actrices), de certains chefs ou certains
compositeurs. Enfin le théâtre lyrique français bénéficie de
l’arrivée d’une nouvelle génération novatrice de musiciens qui
prend enfin le relai de la génération qui avait dominé l’époque
depuis les années 1830. Le tableau de la diapo 36 enregistre
les noms de ces musiciens dont les œuvres sont les plus
exportées à l’étranger : outre Offenbach et Bizet décédés, il
s’agit d’une nouvelle génération productive avec Gounod,
Massenet, Saint-Saëns, Debussy, Charpentier. Certains succès
anciens comme Carmen de Bizet, créé à l’Opéra comique en 1875,
continue d’être repris dans toute l’Europe mais aussi aux
18 C. Charle, Théâtres en capitales. Naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londreset Vienne, 1860-1914, Paris, Albin Michel, 2008, chapitre 8 ; «Circulationsthéâtrales entre Paris, Vienne, Berlin, Munich et Stuttgart (1815-1860),Essai de mesure et d’interprétation d’un échange inégal», in N. Bachleitner& Murray G. Hall (Hrsg.), "Die Bienen fremder Literaturen". Der literarische Transferzwischen Großbritannien, Frankreich und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur(1770–1850), Wiesbaden, Harrassowitz 2012, p. 229-260.
36
Etats-Unis ou dans des villes très lointaines comme Oslo,
Johannesburg, Sofia ou Shanghai (diapo 37).
Cette ouverture internationale de la musique à Paris se
retrouve également dans l’abondance des concerts donnés dans la
capitale française et dont les programmes mêlent volontiers des
musiques originaires de France, d’Allemagne, d’Italie ou
d’Espagne. Les travaux récents de différents chercheurs
américains déjà cités ont montré qu’en dépit du climat
nationaliste, les expositions universelles, comme celle de 1900
et, avant elle, celle de 1889 ou de 1878, avaient été
l’occasion de l’importation de musiques nouvelles de nations
qui n’occupent pas le centre de la création musicale en
Europe : musiques folkloriques d’Europe du nord ou d’Europe
centrale, musique exotiques d’Asie et d’Extrême Orient. En
1889, un critique musical Julien Tiersot pouvait déjà écrire à
propos de cette mondialisation de la musique réalisée grâce à
l’exposition (diapo 38) :
« Rome n’est plus dans Rome ; le Caire n’est plus en Egypte, ni
l’île de Java dans les Indes orientales. Tout cela est venu au
Champ de Mars, sur l’esplanade des Invalides et au Trocadéro.
De sorte que, sans sortir de Paris, il nous sera loisible
pendant six mois d’étudier, au moins dans leurs manifestations
extérieures, les us et coutumes des peuples les plus lointains.
Et la musique étant, entre toutes ces manifestations, l’une des
plus frappantes, aucun des visiteurs exotiques de l’Exposition
n’a eu garde de l’oublier. Sans parler des grands concerts de
l’orchestre, de musique vocale, d’orgue, etc. dont la série
vient de s’ouvrir au Trocadéro, nous trouvons dans les diverses
37
sections de l’Exposition universelle mainte occasion d’étudier
les formes musicales propres à des races chez lesquelles l’art
est compris d’une façon très différente de la nôtre 19 . »
Le champ musical et de l’opéra moins prisonnier de la langue
nationale est évidemment celui qui assure la meilleure
transition vers la dernière interrogation sur le rôle de
capitale culturelle au XIXe et XXe siècle de Paris. Capitale
nationale et internationale, Paris est-elle aussi une capitale
transnationale ? C’est ce qui nous reste à examiner de manière
plus interrogative.
III. PARIS CAPITALE TRANSNATIONALE ?
Quelques définitions préalables
La distinction entre la fonction internationale d’une capitale
culturelle comme Paris et sa fonction transnationale peut
paraître un peu spécieuse puisque ces deux phénomènes sont
étroitement imbriqués, comme l’ont montré les derniers
exemples. On fera la distinction ici selon le critère suivant :
l’international, c’est la présence de plusieurs cultures
nationales en un même lieu de façon temporaire (cas des
expositions, des congrès, des étudiants, des écrivains ou
artistes en séjour temporaire) ou durable (présence
d’intellectuels, d’écrivains, d’artistes immigrés qui y
19 J. Tiersot, « Promenades musicales à l’Exposition », Le Ménestrel, 26 mai 1889, p. 165-166.
38
trouvent un milieu d’accueil parisien ou d’autre origine le
temps de leur séjour). Pour tous ces acteurs de la vie
culturelle, il s’agit de profiter des rencontres ou du
rayonnement d’une ville centrale dans la dynamique culturelle
européenne ou mondiale, mais sans renoncer à leur identité
propre et parfois pour la découvrir par différence face aux
différents chocs des rencontres ou échanges avec la culture
locale ou celle d’autres nationalités présentes simultanément.
La dimension transnationale, selon moi, n’est atteinte que
lorsque cette confrontation produit des effets supplémentaires
qui dynamisent les cultures nationales initiales en coprésence
(celle du pays d’accueil et celle du pays exportateur) pour une
œuvre, une identité, une affirmation idéologique spécifique, en
une nouvelle synthèse originale ou aspirant à l’originalité où
des éléments des cultures initiales sont transformés. Paris, du
fait de sa longue domination nationale et internationale, peut
sembler un endroit privilégié pour l’éclosion de cette nouvelle
dimension. Mais c’est loin d’être toujours le cas car la
dimension transnationale entre souvent en contradiction avec
les deux autres dimensions très marquées du rôle de cette
ville : la dimension nationale s’affirme souvent par le rejet
des éléments étrangers par ceux qui se prétendent les gardiens
et les porte parole naturels de l’identité nationale (ainsi les
académiciens ou académiques de tout poil), notamment quand ils
évoquent « l’esprit français », « la tradition française » ou
pire encore « l’esprit parisien ».
La dimension internationale, elle, est toujours déséquilibrée
au profit de la ou des cultures dominantes selon les champs
39
considérés qui marginalisent ou « exotisent » les représentants
des cultures dominées, s’opposant ainsi à des transferts
culturels équilibrés ou constants. Ceci explique que certaines
capitales culturelles plus modestes soient parfois de meilleurs
lieux pour les transferts ou l’émergence de productions
culturelles véritablement transnationales. On peut penser ici à
Bruxelles, à Genève, à Weimar ou, dans l’ordre d’une culture de
masse, à Hollywood de la grande période où les cinéastes et
artistes européens chassés par les dictatures ont contribué à
l’européanisation du premier cinéma américain et à sa montée en
ambition intellectuelle.
Les artistes ou intellectuels étrangers, attirés par Paris en
fonction du mythe peu à peu construit d’une ville accueillante
à tout ce qui sort des règles héritées, depuis la Révolution
française et les autres révolutions symboliques à dimension
internationale qui y ont eu lieu, découvrent très vite
l’ampleur des facteurs d’exclusion et d’opposition à leur
intégration. Les intellectuels ou créateurs locaux affichent
fréquemment une certaine arrogance ou un impérialisme culturel
dominateur et assimilateur, que ce soit au plan politique, au
plan social, au plan linguistique. Ils n’acceptent les
créateurs étrangers qu’autant qu’ils se francisent ou acceptent
leur position périphérique et dominée comme l’avait déjà noté
Heine de manière ironique. Ces facteurs négatifs s’aggravent à
mesure que la France, globalement, décline dans les autres
domaines (ce qui s’exprime à travers les idéologies antisémite,
xénophobe, raciste ou certaines formes de rappel à l’ordre
comme le mythe classique ou le mythe latin lancés au tournant
40
du XIXe-XXe siècle par l’extrême droite)20 et traverse des
crises nationales (crise boulangiste, Affaire Dreyfus, guerre
de 1914, crise des années 30, période de Vichy, période de la
décolonisation). Ces crises tendent à renforcer à Paris, comme
capitale « nationale », notamment les forces anti-cosmopolites
et anti-internationalistes qui ont leurs intellectuels et leurs
artistes attitrés et présentent les œuvres étrangères ou les
colonies d’artistes ou d’écrivains venus d’ailleurs comme des
menaces pour l’identité culturelle du pays.
Les avant-gardes elles-mêmes, espaces plus accueillants aux
étrangers comme l’attestent des mouvements comme
l’impressionnisme (avec Whistler et Mary Cassatt ou Sisley), le
symbolisme où l’on retrouve des écrivains belges, grec
(Moréas), américains d’origine (Stuart Merrill, Viellé-
Griffin), le cubisme (avec Picasso, Juan Gris, Apollinaire), le
surréalisme (Dali, Man Ray, Miro, Picabia), du fait de
l’extrême concurrence et de la centralisation, ne sont pas
épargnés par cette intolérance et cette peur du mélange qui est
pourtant la force et l’essence même d’une capitale
transnationale.
Il faut souligner aussi que cette notion récente de
« transnational » n’existe évidemment pas pendant la plus
grande partie de l’époque analysée dans cette conférence. Cette
orientation culturelle produite par les multiples transferts20 Voir Amotz Giladi, Ecrivains étrangers à Paris et constructions d’identité supranationale. Lecas de la panlatinité, 1900-1939, Thèse de doctorat en sociologie, dirigée parGisèle Sapiro, Ecole des hautes études en sciences sociales, 2010; pour lapériode antérieure voir la thèse de Blaise Wilfert, B. Wilfert, Paris, la Franceet le reste…Importations littéraires et nationalisme culturel en France, 1885-1930, thèseUniversité de Paris-I, sous la direction de Christophe Charle, 2003 etpour la suite Gisèle Sapiro, La guerre des écrivains 1940-1953, Paris, Fayard,1999.
41
culturels qui se développent est désignée, de manière floue,
soit par des épithètes vagues comme « cosmopolite » ou par des
adjectifs franchement négatifs « déracinés », « transplantés »
voire hostiles « métèques », « barbares » chez les gardiens de
l’identité nationale que sont les critiques et les idéologues
dominants de droite et d’extrême droite mais parfois aussi de
gauche.
La fonction transnationale de Paris est donc plus compliquée à
inventorier que les deux fonctions précédentes, plus massives
et plus faciles à identifier par des critères objectivables.
Elle n’apparaît le plus souvent qu’à travers des analyses
monographiques en profondeur de minorités culturelles ou de
conjonctures spécifiques très liées à des contextes politiques
précis. Le recours à l’approche objectiviste, comme celle
tentée dans les deux parties précédentes, s’avère ici très
difficile, faute de mise en série possible ou d’inventaires
exhaustifs et du caractère discontinu du processus comme l’ont
montré les travaux sur les transferts culturels animés par
Michel Espagne. On ne prendra donc que quelques exemples, au
risque d’être victimes du piège des sources dénoncé
précédemment dans l’introduction de cette conférence. Trois
thématiques seront privilégiées ici : la thématique
internationaliste et pacifiste, la thématique de l’exil
volontaire ou involontaire, celle de la modernité enfin, avec
toutes ses ambiguïtés.
L’utopie pacifiste et internationaliste
42
Pendant ces deux siècles où le nationalisme et le patriotisme
sont des valeurs centrales dans la plupart des pays d’Europe et
singulièrement en France, très marquée par toute une série de
conflits majeurs depuis la Révolution et l’Empire jusqu’aux
guerres de la décolonisation, l’affirmation culturelle et
politique d’un idéal pacifiste comme idée régulatrice de
l’histoire, ne va évidemment pas de soi. Pourtant Paris a été,
conjointement avec Genève, l’une des rares capitales
culturelles où des communautés d’intellectuels militants,
parfois d’écrivains et d’artistes ont tenté d’en faire une
réalité mobilisatrice. La première occasion en a été
l’organisation du congrès pour la paix en août 1849 dont c’est
l’écrivain français le plus célèbre alors, Victor Hugo, qui en
prononce le discours inaugural et final (voir diapo)21. Le
choix de Paris pour l’événement et de Victor Hugo pour son
orchestration rhétorique n’est évidemment pas des hasards. Nous
sommes un an ou un peu plus après le printemps des peuples dont
Paris a donné le signal dès février 1848. S’y est affirmée
l’idée d’une solidarité transnationale des révolutions
libérales et démocratiques contre la Sainte Alliance des
monarchies et des aristocraties. Solidarité très relative, on
le sait, puisque très vite l’idéal national allemand notamment
est entré en conflit avec l’idéal national slave et que le camp
contre-révolutionnaire a su exploiter les divisions sociales,
politiques et nationales entre les quarante-huitards des divers
pays pour ramener la situation à la normale voire à une
régression politique. Paris, à l’époque, malgré juin 1848,
21 Voir Évelyne Lejeune-Resnick, « L'idée d'États-Unis d'Europe au Congrès de la paix de 1849 », Revue d'histoire du XIXe siècle [En ligne], 7 | 1991,
43
malgré la victoire des conservateurs aux élections législatives
en 1849 et leur soutien à la papauté avec l’expédition contre
la république romaine, est l’une des dernières villes où
l’esprit pacifiste de 1848 existe encore un peu et où des
intellectuels nationaux ou exilés tentent de maintenir l’esprit
internationaliste de l’année précédente. Voir texte diapo 37 :
« Vous avez voulu dater de Paris les déclarations de cette
réunion d’esprits convaincus et graves, qui ne veulent pas
seulement le bien d’un peuple, mais qui veulent le bien de
tous les peuples. (Applaudissements.) Vous venez ajouter aux
principes qui dirigent aujourd’hui les hommes d’état, les
gouvernants, les législateurs, un principe supérieur. Vous
venez tourner en quelque sorte le dernier et le plus
auguste feuillet de l’évangile, celui qui impose la paix
aux enfants du même Dieu, et, dans cette ville qui n’a
encore décrété que la fraternité des citoyens, vous venez
proclamer la fraternité des hommes22. »
Le mélange, dans l’extrait cité, d’un vocabulaire politique
(« le bien d’un peuple »), référence aux révolutions
démocratiques, de l’humanisme transnational, hérité des
Lumières (« le bien de tous les peuples »), tout en ménageant
une ouverture religieuse universaliste de type chrétien (« le
dernier et le plus auguste feuillet de l’évangile »), du fait
de la forte présence de pacifistes d’obédience anglophone et
protestante, marque bien le souci du Victor Hugo d’avant
22 V. Hugo, « discours d’ouverture Congrès de la paix 21 août 1849 », réédité dans Œuvres complètes. Politique, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », p. ?
44
l’exil, qui n’a pas encore affirmé toute sa radicalité
républicaine, de réconcilier les divers courants intellectuels
européens. Leur compatibilité à ce niveau de généralité est
plus postulée que démontrée, d’autant que l’année précédente
avait été énoncé un autre internationalisme, prolétarien, cette
fois dans le manifeste du parti communiste de Marx et Engels,
bien éloigné de celui-là, ce qu’ignorait évidemment V. Hugo. Or
il va s’affirmer quarante ans plus tard au même endroit avec la
fondation de la Deuxième internationale à l’occasion du
centenaire de 1789 et de l’exposition universelle par le
Congrès international ouvrier socialiste de Paris du 14 au 21
juillet 1889.
Ce second moment d’affirmation transnationale de la capitale
parisienne peut nous paraître, lui aussi, évident du fait de
ces deux rappels du passé ou du présent. Quoi de plus logique
que de refonder, après l’échec de la Première internationale
sous l’effet des divergences entre marxistes et anarchistes, de
la guerre franco-allemande et surtout de l’écrasement de la
Commune ou des mouvements révolutionnaires apparentés en
Espagne, le nouvel organe internationaliste dans la seule
capitale républicaine du continent et la première victime des
effets négatifs des haines nationales avec le siège, la défaite
et la guerre civile ? Cette lecture un peu simple oublie que
Paris vient à peine de sortir, elle aussi, d’une grave crise
nationale avec le mouvement boulangiste où le nationalisme et
le bellicisme de la population parisienne (y compris dans les
quartiers populaires) se sont clairement exprimés lors de
manifestations de rue et d’une élection partielle en faveur de
45
celui qu’on appelait « le général Revanche ». Elle oublie aussi
que, de tous les partis socialistes ou apparentés en voie de
formation en Europe et qui tentent de s’unir, les partis
français sont les plus divisés, les plus faibles et loin
d’adhérer totalement à l’internationalisme dont s’inspire la
nouvelle organisation, au point qu’un congrès rival tenu par
les possibilistes et des délégués surtout venus d’Angleterre se
tient en parallèle et refus de fusionner avec le congrès
organisé par les marxistes23. Le même problème se repose lors
du nouveau congrès parisien de l’Internationale en septembre
1900.
Les lieux symboliques, même chargés d’histoire
révolutionnaire, ne suffisent donc pas à effacer les cicatrices
de mémoire liées à l’histoire nationale plus ou moins récente.
Là où Paris réussit le mieux à affirmer son rôle transnational,
c’est dans les moments critiques où elle est le théâtre de
grandes manifestations intellectuelles ou politiques, ainsi en
octobre 1909 (voir diapo) lors des protestations contre
l’exécution de Ferrer, pédagogue espagnol de sympathie
anarchiste, victime de la répression militariste et cléricale
qui suscite deux manifestations socialistes sur les boulevards
parisiens et un certain nombre en Europe24, plus tard au moment
de l’émergence d’un mouvement antifasciste à dimension
internationale, avec le congrès international pour la défense
23Georges Haupt, La Deuxième Internationale 1889-1914. Etude critique des sources.Essai bibliographique. Préface d'Ernest Labrousse, Paris, La Haye, Mouton,1964, p.106-113.24 Voir Gilles Candar et Vincent Duclert, Jean Jaurès, Paris, Fayard, 2014, p.377-78 ; et V. Robert, “La « protestation universelle » lors de l’exécutionde Ferrer. Les manifestations d’octobre 1909”, Revue d’histoire moderne etcontemporaine, tome 36, avril-juin 1989, p. 245- 265.
46
de la culture de l’Association des écrivains et artistes
révolutionnaires où écrivains, intellectuels français et exilés
des pays tombés sous domination fasciste tentent de mobiliser
l’opinion internationale en juin 1935. Ces moments critiques
permettent d’oublier partiellement tensions politiques
secondaires, inégalités entre cultures et expressions
nationales trop marquées.
Traduction et exil
Les travaux sur les transferts culturels ou la dimension
transnationale des évolutions culturelles insistent beaucoup
sur le rôle de certaines personnalités marquées par
l’expérience de l’exil et de nombreux travaux récents ont
permis de sortir d’une approche purement empathique ou
biographique largement dominante. Je pense au livre de Michel
Espagne Les Juifs allemands à Paris à l’époque de Heine, à la thèse récente
de Delphine Diaz sur les exilés en France dans la première
moitié du XIXe siècle, aux deux livres collectifs dirigés par
André Kaspi et Antoine Marès sur le Paris des étrangers avant et
depuis 1945, aux thèses, en partie divergentes de Pascale
Casanova sur la République mondiale des lettres, d’Anna Boschetti sur
L’espace culturel transnational et tout récemment sur les Ismes25, aux
travaux sur la traduction de Blaise Wilfert et Gisèle Sapiro où
Paris occupe une grande place, sinon une place centrale. Il est
évidemment impossible de résumer cet ensemble de recherches
dont les conclusions ne sont pas toujours convergentes en
25 Anna Boschetti (dir.), L’espace culturel transnational, Paris, Nouveau Monde éditions, 2010; « Ismes », du réalisme au post-modernisme. Genèse et usages, pratiques et savants, Paris, CNRS éditions, 2014
47
raison de fortes variations historiques selon les époques. Les
unes insistent sur la fonction transnationale de Paris en
littérature comme Pascale Casanova26 et Gisèle Sapiro, les
autres, comme Blaise Wilfert ou Delphine Diaz, soulignent
plutôt les résistances aux importations étrangères ou à
l’intégration des intellectuels exilés dans la vie culturelle
parisienne. Anna Boschetti donne aussi un tableau plus nuancé
que la légende dorée courante sur le caractère réellement
transnational de certaines avant-gardes littéraires ou
artistiques entre le réalisme, le futurisme et le surréalisme.
Pascale Casanova parle d’un « méridien de Greenwich » de la
littérature novatrice située à Paris, , pour construire un pôle
alternatif de circulation des oeuvres revendiquant leur
autonomie face à la littérature moyenne ou au pôle industriel
et commercial de l’édition de plus en plus dominé par les
conglomérats anglophones. De même Gisèle Sapiro voit dans Paris
en termes de traduction littéraire (surtout depuis les années
1970-80) un lieu central des échanges entre petites et grandes
littératures. Auparavant, du fait de l’impérialisme
francophone, les éditeurs parisiens exportaient beaucoup mais
traduisaient assez peu (comme l’a montré en détail Blaise
Wilfert pour le XIXe siècle et les début du XXe siècle) en
comparaison des éditeurs allemands, italiens, espagnols ou
russes27. A partir du moment, dans les années 1980, où le
français comme langue de traduction internationale est de plus
en plus nettement surclassé par l’anglais, l’édition française
26 Pascale Casanova, La République mondiale des lettres, Paris, Le Seuil, 1999.27 Gisèle Sapiro (dir.), Translatio, le marché de la traduction en France à l'heure de lamondialisation, Paris, CNRS éditions, 2008.
48
s’ouvre plus, non seulement à l’anglais (phénomène ancien),
mais à de nouvelles langues et contribue à la reconnaissance
transnationale de littératures dont la langue est moins bien
située dans la hiérarchie de l’internationalité et dont les
productions ne répondent pas forcément au modèle dominant de la
littérature globalisée du roman anglophone. Le succès
international du roman latino-américain, de certains auteurs
allemands (Heinrich Böll, Günter Grass, Ellfriede Jellinek),
italiens (Pasolini, Buzzati, Umberto Eco, Sciascia, etc.),
espagnols, tchèques (Kundera) ou de littératures encore plus
exotiques (Japon, Chine, Caraïbes, Afrique) s’est construit,
selon elle et selon P. Casanova, en grande partie à Paris grâce
à sa fonction transnationale de bourse d’échange et à la
construction d’une image critique transnationale pour les
auteurs des langues ou pays périphériques.
L’ouverture aux autres littératures et le ressourcement de
certains auteurs français à ces traditions nationales plus
diverses que la tradition gréco-latine, si prégnante en France
du fait de la construction ancienne d’un classicisme, formation
de base de la plupart des écrivains et intellectuels dominants
depuis le XIXe siècle, dépend à l’évidence de l’accessibilité
de ces nouveaux univers de littérature étrangère qui
caractérisent les références des nouveaux auteurs à partir de
l’orée du XXe siècle. Ces littératures alternatives sont lues
en priorité par le public lettré et, au premier rang, par les
auteurs eux-mêmes à la recherche d’une certaine novation ; très
peu d’auteurs français avant une date récente disposaient d’une
culture linguistique en dehors du français et du latin
49
(rarement de l’anglais ou de l’allemand) leur permettant de
s’imprégner de littératures d’ailleurs sans dépendre des
traductions.
Or celles-ci comme l’ont montré les travaux cités, sont assez
éloignées pendant très longtemps, surtout plus la langue est
rare, des canons actuels de l’authenticité originale : les
romans russes, les pièces scandinaves, les romans italiens que
des lecteurs surtout parisiens peuvent lire en français à
partir de la fin du XIXe siècle sont plus des adaptations que
des traductions en raison de l’impérialisme du goût français,
notion aussi vaste qu’imprécise qu’imposent les instances
critiques et éditoriales comme l’ont montré en détail Blaise
Wilfert à propos, par exemple, de D’Annunzio ou d’autres
travaux à propos du roman russe28.
Cette fabrique parisienne de nouvelles œuvres étrangères est
donc une sorte de processus de construction transnationale dans
la mesure où souvent ces « infidèles » servent de base pour la
traduction vers l’italien, l’espagnol, voire l’anglais. Tout
ceci se produit en raison des règles spécifiques de
fonctionnement du champ littéraire parisien, de son histoire
centralisée et conflictuel (les auteurs étrangers sont annexés
dans les luttes internes aux auteurs parisiens) et de la
collaboration d’auteurs ou critiques français avec des
traducteurs souvent fantômes ou réduits à l’anonymat, issus des
communautés d’exilés dans la capitale, étant donné pendant très
28 B. Wilfert, Paris, la France et le reste…Importations littéraires et nationalisme culturel enFrance, 1885-1930, thèse Université de Paris-I, sous la direction deChristophe Charle, 2003 et «« Littérature, capitale culturelle et nation àla fin du XIXe siècle, Paul Bourget et Gabriele d’Annunzio entre Paris etRome 1880-1905 », in C. Charle, Le temps des capitales culturelles XVIIIe-XXe siècle, op. cit.
50
longtemps la rareté des experts en langue étrangère d’origine
française surtout dans les langues rares29. Il faut souligner
que des phénomènes similaires se produisent dans les sciences
humaines quand des auteurs étrangers de référence sont peu à
peu introduits ou adaptés aux débats intellectuels internes via
des intellectuels originaires de ces pays, on peut penser ici
au structuralisme et au formalisme russe en linguistique30.
Conclusion/ Paris capitale de la « modernité » ?
Au terme de ce parcours forcément lacunaire tant la diversité
des thèmes et l’ampleur de la période exigeraient de multiples
compléments et nuances mais aussi, paradoxalement, des
recherches nouvelles, ne serait-ce que pour disposer de données
comparatives continues au delà de toujours les mêmes exemples
ou villes de référence, deux conclusion s’imposent qui sont
aussi des hypothèses de travail pour d’autres recherches.
La première était attendue, à savoir la multidimensionnalité
des rôles de Paris comme capitale culturelle et, ce qui est
trop oublié, les fortes variations en réalité de ses diverses
fonctions selon des phases historiques contrastées.
Contrairement à l’image habituelle d’une constante du rôle
dominant de Paris, je soutiendrais volontiers l’idée que le
29 Blaise Wilfert, « Cosmopolis et l’Homme invisible. Les importateurs delittérature étrangère en France, 1885-1914 », Actes de la recherche en sciencessociales, no 144, septembre 2002, p. 33-46 ; Blaise Wilfert, « Traductionlittéraire : approche bibliométrique », in Yves Chevrel, Lieven d’Hulst etChristine Lombez (dir.), Histoire des traductions en langue française en France. XIXe siècle1815-1914, Lagrasse, Verdier, 2012, p. 255-344.30 Anna Boschetti, « Ismes », du réalisme au post-modernisme. Genèse et usages, pratiques etsavants, op. cit., chapitre 4; Frédérique Matonti, « L'anneau de Moebius. Laréception en France des formalistes russes », Actes de la recherche en sciencessociales, n° 176-177, 2009, p. 52-67.
51
maximum d’intensité et la capacité à assumer les trois
dimensions possibles du rôle de capitale culturelle sont à
Paris en raison inverse de la capacité de la France à prétendre
au rôle de société impériale. C’est après l’échec du Premier
Empire dans son rêve de domination européenne, que Paris
redevient une capitale culturelle attractive et rayonnante et
s’ouvre, grâce au romantisme, aux nouveautés venues d’ailleurs
et commence à rompre avec le néoclassicisme imposé par Napoléon
dans tous les domaines. Après l’échec du rêve de Charles X de
revenir partiellement à l’ancien régime en 1830, Paris est la
destination privilégiée des exilés et persécutés de l’Europe de
la Sainte Alliance ; c’est après la défaite de 1871 et
l’obsession de la décadence qui taraude les élites politiques
et intellectuelles que les universités sont rénovées et jouent
à Paris un rôle international bien plus ample qu’autrefois.
Parallèlement à partir des années 1880, la France devenue
républicaine et Paris redeviennent une terre d’accueil et
d’exil de tous les intellectuels et artistes qui se trouvent à
l’étroit dans l’Europe des monarchies et des empires non
libéraux. Cela n’exclut pas, on l’a vu, des réactions aussi de
rejet internes. Mais, tous les onze ans, elle redevient
provisoirement la capitale de la modernité et du monde
occidental lors des expositions universelles et des congrès qui
s’y déroulent. Les avant-gardes artistiques, poétiques ou
romanesques parisiennes exercent une forte influence sur les
créateurs étrangers homologues. C’est de nouveau après les
années sombres, où Paris perd pendant quatre ans sa fonction de
capitale, que le champ intellectuel parisien retrouve
52
provisoirement sa place centrale dans la modernité
internationale et transnationale : avec Sartre et Camus,
influents en Italie, en Allemagne, au Japon, aux Etats-Unis
même, avec les nouvelles avant-gardes de l’abstraction en
peinture qui se vendent surtout à l’étranger, avec le théâtre
de l’absurde dont la plupart des auteurs sont des étrangers
transnationaux (Beckett, Ionesco, Adamov, Gatti), avec les
musiques expérimentales, avec la nouvelle vague au cinéma, avec
l’internationalisation universitaire renouvelée. Or ces années
riches culturellement, correspondent politiquement à
l’effondrement de l’empire colonial et à une crise de la
République parlementaire qui n’en finit pas de mourir.
F. Braudel, dans un passage peu commenté de Civilisation matérielle,
économie et capitalisme, avait noté, du moins pour les siècles qui
le concernaient dans son triptyque (XVIe-XVIIIe siècles), le
décalage entre la ville dominante de l’économie-monde de chaque
époque et le centre culturel le plus rayonnant au même moment,
comme si la modernité économique ne répondait pas aux mêmes
conditions que la modernité culturelle. Cette conclusion était
relativement paradoxale pour l’époque de l’ancien régime
culturel où le mécénat princier ou ecclésiastique était l’une
des conditions premières de l’émergence de formes culturelles
nouvelles dont le premier public était formé par les cercles de
la société de cour dont les liens avec le grand commerce et la
finance sont connus. Pour le nouveau régime culturel qui
s’établit progressivement au cours du XIXe siècle, placé sous
le signe de la différenciation croissante et la diversité des
publics, de la compétition entre des formes dominées par les
53
mécanismes marchands et des formes qui essaient d’échapper à
toutes les contraintes héritées ou liées au souci de la
rentabilité, la divergence est beaucoup plus logique.
Précocement libéré de la société de cour (et même à l’origine
de sa destruction au sens le plus concret à travers la
radicalisation des Lumières puis les journées révolutionnaires
qui effacent Versailles et la monarchie du centre du pouvoir),
une fraction des artistes et créateurs parisiens de tout type
lutte en permanence sur plusieurs fronts : contre la tutelle
encore pesante de l’Etat qui n’a pas renoncé à son rôle hérité
de régulateur et de mécène avec la restauration napoléonienne,
contre la marchandisation culturelle montante, inspirée
partiellement du modèle londonien, contre les autres fractions
de chaque champ culturel prêtes à se plier à ces tutelles
avivées par la centralisation constante et sans équivalent dans
les autres capitales culturelles. Ces dynamiques
contradictoires se retrouveront mutatis mutandis à mesure que des
facteurs similaires apparaîtront un peu plus tard à Bruxelles,
à Berlin, à Vienne, à Rome, à Saint Pétersbourg, Madrid ou
Moscou. Elles sont beaucoup plus difficiles à retrouver en
revanche à Londres ou New York avant une date encore plus
récente (les années 1900) alors que Londres puis New York
passent pour les centres à l’époque du capitalisme financier et
impérialiste, ce qui rejoint le propos de Braudel déjà cité.
Le modèle parisien a donc partiellement essaimé et a été en
retour influencé par ces nouvelles capitales culturelles, via
l’intensification des échanges inter- et transnationaux. S’il a
perduré au-delà de ce qu’on aurait pu attendre, malgré la
54
montée en puissance des Etats-Unis ou de nouvelles puissances
culturelles depuis l’orée du XXe siècle, c’est que sa modernité
paradoxale (au sens de sa prétention à incarner le futur avant
les autres) provient de l’archaïsme persistant tout aussi
paradoxal d’une large partie de la France de ces deux siècles.
En concentrant une part disproportionnée des ressources
culturelles et des capacités d’innovation dans sa capitale, la
France maintient plus longtemps qu’ailleurs les sociétés
provinciales en état de domination culturelle externe et
entretient le cercle vicieux de la centralisation culturelle,
productive d’un côté, grâce à l’intensité de la concurrence et
des échanges en un espace restreint, mais stérilisante, de
l’autre, pour le reste du pays, ce qu’avait déjà lumineusement
analysé Goethe dans le texte cité au début de cette conférence.
Grâce à l’hystérésis des représentations transmises par les
œuvres qui y sont produites et la réverbération de son mythe
par les groupes d’étrangers qu’elle attire de manière
relativement constante, Paris réussit à maintenir son emprise
symbolique jusqu’aux années 1960, alors même que ses conditions
de possibilité s’effritent progressivement bien plus tôt.
Au delà, à partir des années 1960 au moment où la France
gaulliste se lance dans une autre modernité, inspirée par
l’exemple américain sur le plan économique et technique, nous
entrons dans un autre monde dominé par le modèle états-unien
malgré les slogans de la « francophonie » et de l’exception
culturelle française qui tâchent de prolonger le mythe de la
capitale culturelle à la française étendue au monde. C’est dans
le monde de l’art contemporain que ce décrochage se produit le
55
plus tôt, comme l’ont montré Julie Verlaine et Raymonde
Moulin31, puis il s’est diffusé de proche en proche vers les
domaines où la langue nationale reste longtemps un frein majeur
au transnational et à l’international. Aujourd’hui, même si
notre congrès provisoirement semble dire le contraire, l’idée
d’une capitale culturelle centrale n’a sans doute plus de sens
à l’âge des foires, festivals, congrès temporaires, collèges
invisibles et réseaux électroniques. Cette organisation
n’empêche pas d’ailleurs la persistance, comme le montrent
divers épisodes récents de formes d’impérialisme culturel
principalement d’origine américaine tout aussi contraignantes
au profit de centres invisibles ou inatteignables car organisés
en réseaux ou multipolaire et passant par des formes
culturelles assez différentes qui s’adressent beaucoup plus aux
masses qu’aux élites lettrées et cultivées que j’ai surtout
évoquées et typiques de la culture d’origine parisienne32.
Bibliographie
Honoré de Balzac, Monographie de la presse parisienne, (21/1-28/2/1843), Paris, éd. J.-J.Pauvert, 1965.Anna Boschetti (dir.), L’espace culturel transnational, Paris, NouveauMonde éditions, 2010.Anna Boschetti, « Ismes », du réalisme au post-modernisme. Genèse et usages,pratiques et savants, Paris, CNRS éditions, 2014.
31 Julie Verlaine, Les galeries d’art contemporain à Paris 1944-1970, op. cit. ; RaymondeMoulin, Le marché de la peinture en France, op. cit.32 Cf. Patrice Higonnet, Paris capitale mondiale, Paris, Tallandier, 2004.
56
Gilles Candar et Vincent Duclert, Jean Jaurès, Paris, Fayard,2014.Pascale Casanova, La République mondiale des lettres, Paris, Le Seuil,1999.Pierre Casselle, Nouvelle histoire de Paris. Paris républicain, 1871-1914,Paris, Association pour la publication d'une histoire de Paris,Bibliothèque historique de la Ville de Paris, diff. Hachette,2003.Christophe Charle, Paris fin de siècle, culture et politique, Paris, Editionsdu Seuil, 1998.C. Charle et D. Roche (dir.), Capitales culturelles, capitales symboliques,Paris et les expériences européennes XVIIIè-XXè siècles, Paris, Publications dela Sorbonne, 2002.Christophe Charle (éd.), Capitales européennes et rayonnement culturelXVIIIè-XXè siècles, Paris, Editions rue d’Ulm, 2004.Christophe Charle, Théâtres en capitales. Naissance de la société du spectacleà Paris, Berlin, Londres et Vienne, Paris, Albin Michel, 2008.Christophe Charle (dir.), Le temps des capitales culturelles XVIIIe-XXesiècle, Seyssel, Champ Vallon, 2009.Christophe Charle, Discordance des temps, une brève histoire de lamodernité, Paris, A. Colin, 2011.Christophe Charle, « Opera in France 1870-1914, betweennationalism and foreign imports » in Victoria Johnson, CraigCalhoun, Jane F. Fulcher (eds), Opera and Society in Italy and Francefrom Monteverdi to Bourdieu, Cambridge, Cambridge U.P., 2007, pp.243-266.Christophe Charle, « Exportations théâtrales et dominationculturelle : Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle », inAnna Boschetti (dir.), L’espace culturel transnational, Paris, Nouveaumonde éditions, 2010, pp.135-162.Christophe Charle, « La circulation des opéras en Europe auXIXe siècle », Relations internationales, n°155, décembre 2013, p.11-31. Delphine Diaz, Un asile pour tous les peuples? proscrits, exilés, réfugiésétrangers en France 1813-1852, thèse sous la direction de ChristopheCharle et de Gilles Pécout, Paris 1, 2012 et Paris, A. Colin,2014.Alain Dubosclard, L’action artistique de la France aux Etats-Unis 1915-1969,Paris, CNRS éditions, 2003.Théodore Duret, Critique d’avant-garde, (1885) n. éd., Paris, ENSB,1998.Michel Espagne Les Juifs allemands à Paris à l’époque de Heine, la translation
57
ashkénaze, Paris, PUF, 1996.Malcolm Gee, Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting. Aspects of theParisian Art Market between 1910 and 1930, New York, Garland, 1981.Amotz Giladi, Ecrivains étrangers à Paris et constructions d’identitésupranationale. Le cas de la panlatinité, 1900-1939, Thèse de doctorat ensociologie, dirigée par Gisèle Sapiro, Ecole des hautes étudesen sciences sociales, 2010.Johann Wolfgang von Goethe, Conversations de Goethe avec Eckermann,traduction de Jean Chuzeville, Paris, Gallimard, n. éd., 1988.Claire Hancok, Paris et Londres au XIXe siècle, Représentations dans les guideset récits de voyage, Paris, CNRS éditions, 2003.Henri Heine, De la France, n. éd. par G. Höhn et B. Morawe,Paris, Gallimard, « Tel », 1994.Patrice Higonnet, Paris capitale mondiale, Paris, Tallandier, 2004.Roland Huesca, Triomphes et scandales : la belle époque des Ballets russes,Paris, Hermann, 2001. Victor Hugo, Œuvres complètes, Politique, Paris, Laffont,« Bouquins », 1985.Béatrice Joyeux-Prunel, « Nul n’est prophète en sonpays ? »L’internationalisation de la peinture avant-gardiste parisienne 1855-1914,Paris, Musée d’Orsay/Nicolas Chaudun, 2009.Béatrice Joyeux-Prunel, « L’internationalisation de la peintureavant-gardiste, de Courbet à Picasso : un transfert culturel etses quiproquos », Revue historique, n °644, octobre 207, p.857-885.André Kaspi, Antoine Marès, (dir.), Le Paris des étrangers depuis unsiècle, Paris, Imprimerie nationale, 1989.Antoine Marès, Pierre Milza (dir.), Le Paris des étrangers depuis 1945,Paris, Publications de la Sorbonne, 1994.Pierre-Michel Menger, « L'hégémonie parisienne. Economie etpolitique de la gravitation artistique », Annales (ESC), n°6,1993, pp. 1565-1600.Raymonde Moulin, Le marché de la peinture en France, Paris, Ed. deMinuit, 1967, rééd., 1989.Gisèle Sapiro, La guerre des écrivains 1940-1953, Paris, Fayard, 1999.Gisèle Sapiro (dir.), Translatio, le marché de la traduction en France àl'heure de la mondialisation, Paris, CNRS éditions, 2008.Alexander Varias, Paris and the anarchists aesthetes and subversives duringthe "fin de siècle", Basingstoke, Londres, Macmillan, 1997, VIII-208p.Paris-Barcelone : de Gaudí à Miró : [exposition], Galeries nationalesdu Grand Palais, Paris, du 9 octobre 2001 au 14 janvier 2002,Museu Picasso, Barcelone, du 28 février au 26 mai 2002.
58
Americans in Paris, Kathleen Adler, Eric E. Hirshler, H. BarbaraWeinberg, eds Londres National Gallery 2006.Paris 1900 et les artistes américains à l'Exposition universelle Musée Carnavalet,21 février-29 avril 2001, Paris, Paris-Musées, 2001, 192 p.Julie Verlaine, Les galeries d’art contemporain à Paris 1944-1970, Paris,Publication de la Sorbonne, 2012.Blaise Wilfert, « Cosmopolis et l’Homme invisible. Lesimportateurs de littérature étrangère en France, 1885-1914 »,Actes de la recherche en sciences sociales, no 144, septembre 2002, p. 33-46. Blaise Wilfert, Paris, la France et le reste…Importations littéraires etnationalisme culturel en France, 1885-1930, thèse Université de Paris-I,sous la direction de Christophe Charle, 2003.Blaise Wilfert, « Littérature, capitale culturelle et nation àla fin du XIXe siècle, Paul Bourget et Gabriele d’Annunzioentre Paris et Rome 1880-1905 », in C. Charle (dir.), Le tempsdes capitales culturelles XVIIIe-XXe siècle, op. cit.Blaise Wilfert, « Traduction littéraire : approchebibliométrique », in Yves Chevrel, Lieven d’Hulst et ChristineLombez (dir.), Histoire des traductions en langue française en France. XIXe
siècle 1815-1914, Lagrasse, Verdier, 2012, p. 255-344.
59