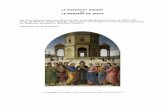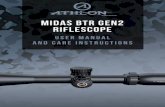Réflexions et jalons pour une histoire de l' "identité jésuite" pendant la suppression de la...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Réflexions et jalons pour une histoire de l' "identité jésuite" pendant la suppression de la...
REFLEXIONS ET JALONS
POUR UNE HISTOIRE DE L’« IDENTITE JESUITE » PENDANT LA SUPPRESSION DE LA COMPAGNIE DE JESUS (1762-1814)
« Quel spectacle ? trois mille hommes tombés tout à coup d’un état honoré, dans l’abyme du mépris, évités de tout le monde, réduits à se fuir eux-mêmes, n’osant avouer ce qu’ils étaient, moins encore ce qu’ils avaient été… »1 « Il fut un temps, qui meurt peut-être sous nos yeux, où le sens que les compagnons avaient de leur cohésion et de leur originalité était très fort et n’avait pas besoin d’être tellement explicité ; ce qui était urgent, c’était d’éviter par tous les moyens que l’on rabaisse au-dessous de lui-même ce sens de la cohésion et de l’originalité. »2
Il s’agit, par ces deux extraits, l’un d’un ex-jésuite ayant décidé de prêter le serment contre son Institut en 1764, l’autre, d’un jésuite actuel écrivant en 1974 sur les Constitutions, de souligner d’emblée une difficulté à laquelle la recherche sur la Compagnie de Jésus est confrontée aujourd’hui. Penser l’histoire des jésuites depuis une vingtaine d’années c’est se heurter à un concept de plus en plus mobilisé – sans pour autant être clairement défini –, celui de l’« identité jésuite ». L’emploi de ces deux termes par les historiens contemporains et par la Compagnie elle-même n’est pas anodin ; il nous conduit au cœur d’un questionnement sur le sens, l’authenticité et l’originalité de la mission de la Compagnie – qu’elle se donne mais aussi que l’on perçoit. Ce questionnement est accru ces derniers temps par l’intérêt grandissant dont bénéficie l’histoire de la suppression de l’Ordre (1773-1814), épisode qui se révèle particulièrement probant pour appréhender cette problématique qui porte autant sur l’institution que sur les individus qui la composent.
Sujet complexe et délicat, l’« identité jésuite » nécessite que l’on avance prudemment. C’est
pourquoi nous nous proposons ici non de régler définitivement les questions qu’elle soulève mais plutôt de soumettre quelques observations, de suggérer certaines pistes de travail et de tenter d’établir des repères qui permettront de poursuivre la réflexion amorcée il y a quelques années autour de cette notion. Il s’agira donc dans un premier temps de partir d’un constat simple, l’usage fait aujourd’hui par la Compagnie de Jésus et par les historiens de l’expression « identité jésuite », en tentant brièvement de démêler les raisons de cette apparition et de ce succès, pour ensuite essayer de faire la lumière sur les sens et les réalités que ce concept peut revêtir et la pertinence de son usage dans l’étude de l’histoire des jésuites, en résonance avec un travail entrepris sur la suppression de la Compagnie. L’« identité jésuite » en question De l’usage du concept d’« identité jésuite » par la Compagnie de Jésus aujourd’hui et par les historiens contemporains
L’utilisation de l’expression et du concept d’« identité jésuite » fait bien sûr écho à celle du concept d’identité qui s’est généralisé notamment en sciences sociales et humaines à partir des années
1 Dieudonné Thiébault, Apologie des jeunes ex-jésuites qui ont signé le serment prescrit par Arrêt du 6 février 1764, s.l., 1764 ; nous soulignons les derniers mots. 2 Dominique Bertrand, Un corps pour l’esprit. Essai sur l’expérience communautaire selon les Constitutions de la Compagnie de Jésus, Paris, Desclée de Brouwer, 1974, p. 140 ; l’auteur se livre ici plus particulièrement à une réflexion sur l’obéissance ignatienne comme principe de cohésion et de singularité.
Europa Moderna n°3 / 2012
102
1960. L’apparition du terme « identité », comme le suggère Catherine Halpern, semble procéder d’un besoin, d’une urgence à nommer – puis à définir – ce qui n’est désormais plus perçu avec précision : « Si nous sommes entrés dans l’ère des identités, c’est précisément parce qu’elles ne vont plus de soi, qu’elles sont protéiformes et à construire. »3 Elle dépend donc d’un contexte d’énonciation qui doit être précisé, aussi bien en ce qui concerne la Compagnie que les historiens qui s’intéressent à son histoire4.
Ce dont témoigne Dominique Bertrand en 1974 dans l’extrait que nous avons choisi de mettre
en exergue, c’est de la conscience de traverser un moment où la Compagnie de Jésus fait face à une certaine perte de sens : perte du sens d’une unité et d’une cohésion – parmi lesquelles l’obéissance est un point d’ancrage essentiel –, perte du sens de l’originalité et de l’actualité d’une mission. La « crise culturelle majeure »5 que vit le Catholicisme au lendemain du concile Vatican II, cette « longue hémorragie qui vide en silence des structures laissées intactes mais exsangues »6, touche également la Compagnie qui s’efforce, sous le généralat de Pedro Arrupe en premier lieu, puis lors des décennies suivantes, de répondre au mieux au monde contemporain, à ses défis et à ses pluralismes en interrogeant les fondements et les orientations de la vie jésuite. C’est dans ce contexte de questionnement de soi et de redéfinition qu’intervient, semble-t-il, le concept d’identité, suivi le plus souvent de l’adjectif « jésuite » ; il est, selon nous, à la fois révélateur de ce qui « ne va plus de soi » et un moyen de le réinvestir, de le redéfinir en le nommant, en l’explicitant et en le délimitant. Le bref examen que nous avons effectué des textes des deux dernières Congrégations Générales, c’est-à-dire la 34e Congrégation Générale (1995), suivie des Normes Complémentaires qui lui sont indissociables et qui prolongent et précisent dans un sens actuel les Constitutions, et la 35e Congrégation Générale (2008)7, est particulièrement révélateur de cette étape d’interrogation et de reformulation dans laquelle l’« identité », mot et concept, joue un rôle indéniable. Étant définie comme « la plus haute instance par laquelle le corps universel de la Compagnie exprime à un moment donné la compréhension qu’il a de lui-même »8, la Congrégation Générale est le témoin d’un mouvement perpétuel entre une tradition et la manière contemporaine de la vivre. Elle met en évidence une réciprocité indispensable que Michel de Certeau a longuement décrite dans une réflexion concernant le mythe des origines :
« Nous sommes avec le passé pour discerner ce que doit être aujourd’hui notre esprit, et avec nos contemporains pour juger ces origines et pour décider de nos engagements d’hommes, de chrétiens et de jésuites. Cette question initiale ne nous vient pas seulement des autres ; elle nous est intérieure. Elle est radicale, car elle nous atteint là même où nous prétendons exister. Elle signifie : « Peut-on être jésuite ? » Ce mot désignerait soit une survivance, le reste d’une institution normalement logée dans les musées ou dans les livres d’histoire, soit plutôt, chez des hommes solidement
3 Catherine Halpern, « L’identité. Histoire d’un succès », dans Catherine Halpern (dir.), Identité(s). L’individu, le groupe, la société, Auxerre, Sciences Humaines Editions, 2009, p. 12. 4 Nous adoptons ici une démarche analogue à celle qui a été proposée par les auteurs du Dictionnaire des concepts nomades. Certains termes, explique Olivier Christin en introduction, « correspondent à un moment particulier de l’état du champ qu’ils concernent et où certains acteurs se trouvent en position de nommer ce qu’ils font, de faire exister ce qu’ils sont ». Le défi, poursuit-il, réside donc dans la description des « conditions d’émergence de nouveaux lexiques et de nouveaux usages qui se forgent dans des pratiques politiques, savantes, littéraires », dans Olivier Christin (dir.), Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, Paris, Editions Métailié, 2010, p. 20. 5 J. Komonchak, « La réalisation de l’Église en un lieu », dans Giuseppe Alberigo et Jean-Pierre Jossua (éd.), La Réception de Vatican II, Paris, Editions du Cerf, 1985, p. 118-119, cité par Jean-Marie Mayeur (dir.), Histoire du Christianisme des origines à nos jours, vol. 13, Paris, Desclée, 2000, p. 125. 6 Michel de Certeau, La faiblesse de croire, Paris, Seuil, 1987, p. 300. 7 Les textes ont été consultés sur le site des jésuites de la Province de France en novembre 2011: pour la 34e Congrégation Générale (34e CG), http://www.jesuites.com/documents/34cg/index.html ; pour les Normes complémentaires des Constitutions de la Compagnie de Jésus (NC), http://www.jesuites.com/documents/constitutions_nc/normes-index.html ; pour la 35e Congrégation Générale (35e CG), http://www.jesuites.com/compagnons/35cg/decrets/index.html. 8 35e CG, d. 5, n. 4.
Europa Moderna n°3 / 2012
103
enracinés dans le présent, une fiction, l’illusion d’une référence vidée de son contenu et couvrant aujourd’hui une réalité toute différente. Nous devons aborder le problème. »9
L’« identité jésuite » est avant tout une tension, celle qui postule une identité des origines,
dont la perception est toutefois biaisée et dont la réalité est comme inatteignable aux hommes du XXIe siècle ; une identité qu’il faut néanmoins transmettre et faire vivre dans les identités présentes non à l’état de « survivance » ni de « fiction », mais bien à l’état d’incarnation avec les contradictions qu’elle suppose. Malgré cette « résistance » du passé10, il subsiste, semble-t-il, un substrat à partir duquel la réflexion et le questionnement sont possibles. L’attention portée, dans les textes cités plus haut, aux occurrences des mots « identité » et « identité jésuite » et au lexique qui leur répond nous a conduit à distinguer une série de notions clefs et de pistes de réflexion, certes marquée par la perception actuelle que la Compagnie a d’elle-même, mais qui peut se révéler utile pour l’étude de l’« identité jésuite », quelque soit la période envisagée, et de l’histoire de l’Ordre et de ses membres11 :
- Tradition, héritage et fidélité. Affirmer une « identité » dans une communauté religieuse, c’est
d’abord se « reconnaître dans une expérience passée »12, mais cela implique parfois que ce même passé demeure lointain et imprécis. Paradoxalement, pour les jésuites d’aujourd’hui, « leur tradition leur devient tout à la fois étrangère et plus nécessaire avec l’évolution des échanges culturels »13. Ainsi, « la Compagnie de Jésus s'efforce de toujours approfondir la connaissance qu'elle a de son caractère et de sa mission pour que, demeurant fidèle à sa vocation, elle se renouvelle et adapte sa vie et son activité aux exigences de l'Église et aux besoins des hommes de notre temps »14. Cette recherche d’authenticité se traduit donc par une « organisation » du passé en fonction des « urgences » du temps15 : « nous voulons unir la fidélité à nos origines et une rénovation adaptée au moment présent »16. C’est pourquoi les Normes Complémentaires rédigées en 1995 deviennent « comme l'expression actuelle de l'image authentique de la Compagnie »17.
- « Notre manière de procéder ». Cette expression propre à la Compagnie de Jésus semble à elle seule contenir les diverses dimensions entreprenantes de l’identité jésuite : « certaines attitudes, valeurs et modèles de comportement s'unissent pour former ce qu'on a appelé la manière jésuite de procéder »18. Elle se caractérise, nous l’avons vu, par une « tension », une « série de polarités typiquement ignatiennes » qui résultent des principes fondateurs d’être en même temps avec les autres, avec le monde et avec l’Église : « être et faire ; contemplation et action ; prière et vie prophétique ; être complètement unis au Christ et complètement insérés dans le monde avec lui
9 Michel de Certeau, op.cit., p. 67 ; ce chapitre sur « Le mythe des origines », il est important de le noter, est tiré d’un article que Michel de Certeau écrivit au moment de la 31e CG, en 1966, sous le généralat d’Arrupe. 10 Ibid., p. 73 et suiv. 11 Voir à ce propos François-Xavier Dumortier, « Les grandes orientations actuelles de la Compagnie de Jésus. Le regard d’un universitaire », dans Etienne Ganty, Michel Hermans et Pierre Sauvage (dir.), Tradition jésuite. Enseignement, spiritualité, mission, Namur, Presses Universitaires de Namur, 2002, p. 157-174. Cette ébauche, nous en avons conscience, doit conduire à un travail plus approfondi reposant en premier lieu sur les textes fondateurs, à commencer par les Exercices spirituels et les Constitutions qui forment le cadre dans lequel l’identité jésuite prend tout son sens. De même, l’usage restreint des textes des Congrégations générales et des Normes Complémentaires doit être replacé dans l’histoire particulière des sources normatives de la Compagnie. Il est donc nécessaire de garder ici à l’esprit cet horizon. 12 Jacques Dalarun, « Écrire son histoire. Les communautés face à leur avenir », dans Écrire son histoire. Les communautés régulières face à leur passé, Actes du 5e colloque international du C.E.R.C.O.R., Saint-Etienne, 6-8 novembre 2002, Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2005, p. 676. 13 Michel de Certeau, op. cit., p. 67-68 ; nous soulignons. 14 NC 1. 15 Michel de Certeau, op.cit., p. 69. 16 34e CG, d. 7, n. 1. 17 NC 5, § 1 (nous soulignons). 18 34e CG, d. 26, n. 1. L’ensemble du décret 26 est d’ailleurs consacré à cette notion.
Europa Moderna n°3 / 2012
104
comme corps apostolique : toutes ces polarités marquent profondément la vie d’un jésuite et expriment à la fois son essence et ses possibilités. »19
- Charisme. Le charisme suppose une créativité dans la réponse que donne la Compagnie au monde
dans lequel elle vit : il s’incarne dans une « culture du dialogue » mais surtout dans cette volonté de répondre à tous les défis : « notre charisme, la raison même de notre existence, est de pouvoir aller là où les besoins ne reçoivent pas de réponse »20. Le charisme jésuite est une persévérance qui cherche à aller plus loin dans l’accomplissement d’une mission.
- Mission et service. L’identité du jésuite réside dans sa mission21. Cette mission est individuelle,
propre à chaque jésuite, mais elle est également collective et forme une seule et même mission, celle de la Compagnie de Jésus et de l’Église. Cette mission est encore « détachement de la stabilitas, de la définition de soi-même comme appartenant à une seule famille ou à un cercle de parents ou même à une Église particulière, à une culture et à un lieu déterminés »22. Elle est ainsi une expérience qui doit s’accomplir dans la liberté grâce aux quatre vœux. Elle est enfin marquée par les priorités du temps et prend alors, dans les textes des deux dernières Congrégations Générales, une coloration contemporaine et conforme au concile de Vatican II, celle du service de la foi et de la promotion de la justice.
- Activités caractéristiques, œuvres jésuites et œuvres ignatiennes. Ces notions nous invitent
d’abord à réfléchir aux œuvres concrètes – traditionnelles et actuelles – dans lesquelles s’incarne cette identité jésuite, « celles par lesquelles [la Compagnie] remplit sa mission propre et manifeste les valeurs ignatiennes »23. Elles nous poussent surtout à réfléchir à l’identité jésuite et à l’esprit ignatien en dehors de la Compagnie : « Qu’est-ce qui constitue une œuvre jésuite ? Comment peut-elle se maintenir telle si elle est dirigée par d’autres que des jésuites ? »24 Ce questionnement découle bien sûr de l’implication grandissante des laïcs dans les tâches assumées aujourd’hui par la Compagnie de Jésus ; il nous conduit à distinguer les œuvres jésuites des œuvres ignatiennes : « L’identité ignatienne d’une telle œuvre ne dépend pas nécessairement de la Compagnie de Jésus, même si l’œuvre peut être en lien avec elle par le biais de réseaux ou d’autres structures ». Enfin, « une œuvre ignatienne peut être dite jésuite lorsqu’elle a une relation claire et définie avec la Compagnie de Jésus »25.
- Communauté et compagnonnage. L’identité jésuite est clairement définie par une identité
« relationnelle », une identité qui se fait, avance et s’accomplit dans la relation ; être avec les autres, laïcs et compagnons : « L’identité jésuite et la mission jésuite sont liées par la communauté. En fait, identité, communauté et mission sont une sorte de triptyque répandant une lumière qui aide à mieux comprendre notre compagnonnage. […] L’identité jésuite est relationnelle ; elle se développe dans et à travers la diversité de nos cultures, langues et nationalités, nous enrichissant et nous stimulant. C’est un processus qui commence lorsque nous entrons dans la Compagnie et dans lequel nous avançons chaque jour »26.
- « L’union dans la diversité »27. La dialectique de l’individu et de la communauté, de la différence
et de l’unité, du particulier et de l’universel28 – dialectique qui concerne aussi bien la vocation
19 35e CG, d. 2, n. 8-9. 20 34e CG, d. 5, n. 17 et d. 26, n. 22. 21 34e CG, d. 2, n. 4 : « Comme compagnons de Jésus, notre identité est inséparable de notre mission.» 22 34e CG, d. 8, n. 11. 23 NC 307, § 7. 24 35e CG, d. 6, n. 8.1 25 35e CG, d. 6, n. 9-10. 26 35e CG, d. 2, n. 19 ; « Ainsi nous trouvons notre identité de jésuites non pas seuls mais en compagnonnage», 35e CG, d. 2, n. 3. 27 34e CG, d. 7, n. 4 ; il est fait référence ici au discours de septembre 1990 du R. P. Kolvenbach sur « La vocation et la mission du frère jésuite ».
Europa Moderna n°3 / 2012
105
que l’existence dans la Compagnie et la mission, chacune étant à la fois « une et diverse » – est ici la dernière notion clef, et sans doute la plus complexe, pour appréhender l’identité jésuite : « Dans la Compagnie, le sujet ne peut plus se contenter de se trouver lui-même, serait-ce au prix d’une crucifiante élection ; dans le corps dont il est désormais membre, son « pour avec lui-même » – indispensable – est ordonné à son « pour avec les autres » »29. La métaphore du corps et de ses membres, empruntée à saint Paul et maintes fois reprise dans les Constitutions, suppose en effet l’existence d’une identité individuelle qui participe à une identité collective, celle de la Compagnie de Jésus dispersée : « l’identité jésuite de chacun » doit se renforcer et s’approfondir en vue de « son union avec le corps tout entier de la Compagnie par le moyen de la communauté locale par laquelle [elle] s'insère dans ce corps. » 30 Le principe d’« union dans la diversité » nous conduit surtout à être attentifs, notamment dans la relation qu’entretient la Compagnie avec son passé, aux écarts, voire aux possibles contradictions entre individus et communauté, et à cette « évanescence de l’unité toujours postulée »31.
L’usage des termes et de la notion d’« identité jésuite » par les historiens travaillant sur
l’époque moderne procède semble-t-il d’une même logique, celle d’une certaine perte de sens, bien que les causes en soient sensiblement différentes. L’entrée dans « le patrimoine collectif » de l’histoire de la Compagnie de Jésus et de ses membres, qui s’est traduite dans les années 1990 par un véritable « désenclavement », ne s’est pas faite sans conséquences :
« cette institution et ces acteurs, placés sous d’autres projecteurs que ceux de l’historiographie jésuite elle-même, prennent progressivement des contours plus flous, et deviennent moins les représentants d’un ordre déterminé dans le monde que des professeurs, des savants, des écrivains, mais aussi des clercs en général, auxquels, parfois très rétrospectivement, le prédicat commun de « jésuites » est prêté comme une qualité substantielle » 32.
À la lecture des travaux parus ces dix dernières années, on constate que la recherche sur la
Compagnie de Jésus est marquée par une contradiction caractéristique des travaux sur l’identité, tiraillés entre la position dite « essentialiste » et celle dite « constructiviste ». Tout se passe comme si les historiens affirmaient, parfois malgré eux, l’existence d’une « identité jésuite », soulignant par là même une certaine cohérence et similitude à travers l’espace et le temps, tout en s’appliquant dans le même instant à la remettre en cause et à la défaire, pour mieux en révéler les phénomènes de construction. Parmi les travaux les plus récents, il faut souligner deux séries d’articles aux titres révélateurs : la première, née d’une table ronde organisée à Bologne en 2002, intitulée Anatomia di un corpo religioso. L’identità dei gesuiti in età moderna ; la seconde, Identità religiose e identità nazionali in età moderna, issue également d’une table ronde en 2003 à Rome33. La réflexion sur le concept d’identité, menée jusqu’à présent par une majorité de chercheurs italiens, s’est faite en premier lieu dans des travaux portant sur les origines de la Compagnie de Jésus et son premier siècle d’existence ; elle a soulevé des problématiques plus que fécondes qui rejoignent celles de la recherche
28 Voir notamment le Prologue des Constitutions et plus particulièrement la Const. 1351 et ses notes correspondantes de l’édition des Constitutions de la Compagnie de Jésus dans Ignace de Loyola, Écrits, Paris, Desclée de Brouwer, 1991 [rééd. 2011]. 29 Dominique Bertrand, op. cit., p. 20-21. Ce principe est au cœur même de la fondation de la Compagnie de Jésus décrite dans l’historiographie comme l’œuvre non pas d’un seul fondateur mais bien de plusieurs « amis dans le Seigneur » de nationalités différentes et à qui sera confiée une mission particulière. 30 34e CG, d. 6, n. 23 ; NC 317. 31 Michel de Certeau, op. cit., p. 72. 32 Antonella Romano et Pierre-Antoine Fabre, « Présentation », Revue de Synthèse, t. 120, n. 2-3, 1999, p. 247 et p. 255. Nous renvoyons ici plus généralement à l’ensemble du numéro de la revue intitulée « Les jésuites et le monde moderne. Nouvelles approches », dirigé par Antonella Romano et Pierre-Antoine Fabre. 33 Franco Motta (éd.), « Anatomia di un corpo religioso. L’identità dei gesuiti in età moderna », Annali di storia dell’esegesi, 19/2, 2002, p. 333-464 ; Marina Caffiero, Franco Motta et Sabina Pavone (dir.), « Identità religiose e identità nazionali in età moderna », Dimensioni e problemi delle ricerca storica, n°1/2005, p. 7-93.
Europa Moderna n°3 / 2012
106
actuelle sur les ordres religieux34. Il s’agit surtout de démontrer l’existence d’« identités plurielles », construites au gré de stratégies déterminées et de dynamiques non seulement internes mais aussi externes, au contraire d’une identité jésuite qui serait linéaire comme ont eu tendance à le soutenir la Compagnie elle-même, mais également certains historiens. Plusieurs recherches ont montré par exemple l’importance des divergences entre un centre romain et les périphéries constituées par les différentes provinces jésuites ou encore la mise en œuvre à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle d’une stratégie d’autolégitimation, laissant ainsi apparaître l’importance d’une perception extérieure de l’Ordre35.
Cependant, le postulat adopté par nombre de chercheurs d’une identité jésuite in progress,
selon les termes de Maurizio Sangalli36, présente une limite évidente dont le dépassement est malgré tout plus qu’incertain. Sans remettre en cause les apports de l’approche constructiviste que nous adoptons en grande partie, nous prétendons, à la suite de Luce Giard, qu’une définition préalable de cette « identité jésuite » est indispensable – ce qui est encore trop peu pratiqué et ce que nous avons commencé par esquisser ici – et doit résulter d’une pratique familière des textes fondateurs. Il semble donc que la recherche et les tentatives de définition d’une sorte de dénominateur commun aux jésuites et dans un même temps son questionnement et le constat de ses limites puissent et gagnent à s’effectuer conjointement. S’il est par exemple illusoire voire dangereux de penser l’appartenance ethnique par le biais d’une identité primordiale, il n’en va pas de même concernant l’appartenance à une communauté religieuse. Ce n’est pas faire injure à un certain esprit d’invention que de souligner que le temps de l’engagement au sein de la Compagnie, de même que dans un autre ordre religieux, repose sur un ensemble de valeurs spirituelles, de normes et de principes unificateurs, mais également sur une conformité d’action progressivement adoptés par le postulant durant son intégration et dont le but est avant tout de maintenir une cohésion entre des membres dispersés et différents. En outre, la Compagnie se laisse la décision d’« incorporer » ou non un postulant suivant des critères d’utilité et d’adéquation. Que cette « identité jésuite » soit conçue comme un idéal et qu’elle soit par la suite sans cesse ajustée aux priorités de l’endroit ou même de l’instant, cela n’enlève semble-t-il rien à son sens fondateur. L’identité jésuite, « une et diverse », est comme un thème commun dessiné par Ignace et ses premiers compagnons, sujet à de nombreuses variations et interprétations suivant les générations ; elle est une première impulsion donnée par le fondateur dont le mouvement doit être poursuivi par ceux qui viendront à sa suite37. Il faut avoir conscience, comme l’a souligné Luce Giard dans un ouvrage incontournable, que « chaque génération, face à ses inquiétudes, prise dans ses déchirements, infléchit l’un ou l’autre énoncé, choisit de reléguer ou de suspendre telle règle, accentue sa fidélité à Ignace sur tel point pour mieux s’en écarter sur tel autre, parfois pour y revenir à dix ou vingt ans d’écart ». Alors, poursuit-elle plus loin, « il revient à l’historien de noter les écarts entre ce que dit le droit et ce qui eut lieu dans la pratique et d’en chercher les raisons : c’est alors, et alors seulement,
34 Voir les résultats du colloque du C.E.R.C.O.R. cité plus haut (Écrire son histoire…), mais également l’article de Bernard Dompnier, « L’historiographie française, la sociologie et les gens d’Église », dans Philippe Büttgen et Christophe Duhamelle (dir.), Religion ou confession. Un bilan franco-allemand sur l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, Editions des Sciences de l’Homme, 2010, p. 227-252. 35 Silvia Mostaccio, « A Conscious Ambiguity: The Jesuits Viewed in Comparative Perspective in the Light of Some Recent Italian Literature », Journal of Early Modern History, 12, 2008, p. 414; Franco Motta, « Il serpente e il fiore del frassino. L’identità della Compagnia di Gesù come processo di autolegittimazione », dans Massimo Firpo (dir.), Nunc alia tempora, alii mores. Storici e storia in età postridentina, Atti del Convegno internazionale, Torino, 24-27 settembre 2003, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2005, p. 189-210; mais encore, Marina Caffiero, « La rhétorique symétrique, discours et stratégies d’autolégitimation des jésuites », dans Pierre-Antoine Fabre et Catherine Maire (dir.), Les Antijésuites : discours, figures et lieux de l’antijésuitisme à l’époque moderne, Rennes, PUR, 2010, p. 197-220. 36 Maurizio Sangalli, « Le congregazioni religiose insegnanti in Italia in età moderna : nuove acquisizioni e piste di ricerca », Dimensioni e problemi delle ricerca storica, n°1/2005, p. 30 ; l’auteur affirme néanmoins la nécessité de reconstruire ce qui compose ce substrat appelé « identité jésuite », p. 35. 37 Voir la préface de Maurice Giuliani aux Ecrits d’Ignace, citant les paroles du fondateur : « Ceux qui doivent venir après les premiers compagnons seront meilleurs et feront davantage. Quant à nous, nous avons fait ce que nous avons pu » (Écrits… op. cit., p. 18), ou la formule employée par Dominique Bertrand : « La Compagnie restera toujours à faire par tous » (Dominique Bertrand, op. cit., p. 60).
Europa Moderna n°3 / 2012
107
qu’il pourra prétendre rendre compte, en connaissance de cause, de l’identité et de la spécificité jésuites »38. La lecture des Exercices Spirituels et des Constitutions mais surtout, comme cela a été souligné dans le numéro de la Revue de synthèse, une meilleure connaissance de la spiritualité ignatienne et de son histoire, sont d’autant plus nécessaires du fait de l’intérêt croissant des historiens non-jésuites pour la Compagnie.
Conscients d’évoluer parfois au bord d’un vide en usant du langage « d’un esprit jamais
localisable quelque part », ne peut-on cependant faire nôtre l’invitation de Michel de Certeau à persévérer toujours plus dans la voie ainsi ouverte qui « nous oblige à deviner tout un système de relations humaines »39, à dépasser l’abstraction et l’impuissance d’un concept pour se concentrer sur la description des liens complexes qui unissent les membres d’un même corps ? En fin de compte, ce sont moins les termes d’« identité jésuite » qui se révèlent utiles ici, mais plutôt ce qu’ils charrient de questionnements et de réflexions sur de possibles continuités et ruptures, nous permettant alors d’envisager et de mieux saisir ces relations humaines dans leurs nuances, leurs difficultés mais aussi leurs échecs. L’« identité jésuite » à l’épreuve de la suppression
La suppression de la Compagnie de Jésus – ou plutôt les suppressions, tant elles dépendent à
la fois des contextes nationaux et du bref papal de 177340 – n’est désormais plus regardée comme une « traversée du désert » durant laquelle les jésuites seraient restés dans le silence hors des quelques enclaves où la Compagnie s’est maintenue41. Elle représente aujourd’hui un champ de recherche sans doute délicat, du fait surtout de la dispersion des archives, mais fertile et qui a été délimité depuis quelques années par plusieurs chercheurs extérieurs à l’institution jésuite42. À l’instar d’autres périodes critiques traversées par la Compagnie, l’intervalle de la suppression – envisagé dans le temps long des suppressions et restaurations nationales (des années 1750 à la fin du XIXe siècle) et dans le temps court des brefs pontificaux (1773-1814) – est une étape significative et décisive dans l’histoire des jésuites, alors confrontés pour une majorité d’entre eux à une vie en dehors de l’Ordre. Le témoignage singulier et emphatique laissé par Dieudonné Thiébault (1733-1807), entré dans la Compagnie de Jésus en 1752, montre bien que c’est principalement en termes d’« identité » que la question de la suppression peut être posée : l’attitude adoptée par les jésuites français non exilés est-elle, comme l’auteur le laisse entendre, celle de la résignation et de la retraite ? Pour l’historien qui s’engage dans cette voie difficile, le défi consiste à savoir, à l’aide des outils analytiques apportés par la réflexion générale sur l’« identité jésuite », ce qui survit à l’institution, ce que les anciens membres jugent utile de conserver et de faire vivre de cette société éteinte, mais aussi quelles règles sont retenues et quelles priorités soulignées par les futurs membres qui ignorent encore la vie au sein de la Compagnie. Car c’est en envisageant aussi la suppression comme le lieu de l’élaboration d’une « nouvelle » Compagnie de Jésus, à la fois semblable et différente de la précédente, qu’il sera possible de comprendre davantage ce qui est « restauré » par la bulle Sollicitudo, de mesurer les distances prises
38 Luce Giard, « Relire les Constitutions », dans Luce Giard et Louis de Vaucelles (dir.), Les Jésuites à l’âge baroque (1540-1640), Grenoble, Jérôme Million, 1996, p. 52 et 54. 39 Michel de Certeau, op. cit., pp. 72-73. 40 Pierre-Antoine Fabre, « L’histoire des jésuites hors les murs. L’état de la recherche en France », Annali di storia dell’esegesi, 19/2, 2002, p. 461. 41 Sur cette question voir notamment les travaux d’Antonio Trampus, I gesuiti e l’Illuminismo : politica e religione in Austria e nell’Europa centrale, 1773-1798, Firenze, Olschki, 2000 et de Sabina Pavone, Una strana alleanza. La Compagnia di Gesù in Russia dal 1772 al 1820, Napoli, Bibliopolis, 2010. 42 Voir le travail de Paolo Bianchini sur les effets de la suppression en France, Educazione, cultura e politica nell’età dei lumi. I Gesuiti e l’insegnamento dopo la soppressione della Compagnia di Gesù, Torino, Libreria Stampatori, 2001. Puis, l’ouvrage collectif sur la suppression en Europe : Paolo Bianchini (dir.), Morte e resurrezione di un Ordine religioso : le strategie culturali ed educative della Compagnia di Gesù durante la soppressione (1759-1814), Milano, Vita e Pensiero, 2006. Enfin, signalons le programme international de recherches sur l’histoire de la Compagnie de Jésus entre 1773 et 1814 conduit par Pierre-Antoine Fabre, Patrick Goujon s.j. et Martin Morales s.j., dont les conclusions seront présentées à Rome en 2014 à l’occasion des 200 ans de la restauration de l’Ordre.
Europa Moderna n°3 / 2012
108
vis-à-vis de l’« ancienne » Compagnie de Jésus et enfin de mieux saisir les traits et l’apparence endossés par les jésuites au XIXe siècle. C’est pourquoi nous adoptons ici une perspective, certes complémentaire mais plus large que celle proposée dans l’étude pionnière de Paolo Bianchini43 en prenant également en compte les congrégations masculines dont l’objectif, à partir des années 1790, est de faire revivre l’esprit de la Compagnie de Jésus.
Nous proposons dans cet essai d’aborder la question de l’« identité jésuite » et de sa survie pendant la suppression sous plusieurs angles qui nous ont été suggérés par l’approche quelque peu iconoclaste du sociologue Rogers Brubaker. Sans renoncer entièrement au terme d’« identité » jugé selon lui trop ambigu et donc dangereux, nous pensons néanmoins qu’il est salutaire d’user comme il le fait de notions conjointes qui permettent d’appréhender, au-delà du terme et du concept générique d’« identité jésuite » – et c’est bien dans cet « au-delà » que le travail de Rogers Brubaker est intéressant mais pour le moins déroutant –, les différentes réalités, les divers acteurs enfermés sous ce vocable44. Ainsi, nous prendrons garde à distinguer dans les discours retenus ce qui relève davantage d’une stratégie, d’un processus de construction volontaire de la part d’« agents » identifiables et ce qui relève d’autre part d’un processus de formation plutôt inconscient et contextuel, à la fois chez les individus et dans un groupe45. Perception et écriture de l’histoire de la Compagnie de Jésus et de ses membres : deux exemples d’entreprises d’identification
Les notions d’« identification » et de « catégorisation », initialement proposées par le sociologue américain, peuvent former les premiers outils d’analyse pour saisir une des possibles significations de l’« identité jésuite » pendant la suppression. Elles impliquent, comme nous l’avons dit plus haut, des acteurs – externes ou internes au sujet formalisé – qui se livrent, notamment par le moyen du discours, à ce que certains nomment des « opérations d’identification »46. Qu’il s’agisse de la Compagnie de Jésus, confrontée à la lecture et à l’écriture de l’événement de la suppression et de la restauration, ou par exemple de l’administration des Cultes sous le Consulat et l’Empire face au développement des congrégations masculines, l’enjeu semble être le même : qui peut-on identifier comme étant resté « jésuite » ? Qui peut être nommé ainsi ? C’est parce que ces deux institutions, proposées en exemple ici, ont la capacité et le pouvoir d’« énoncer quoi est quoi et qui est qui »47, que les problématiques soulevées par l’usage du terme « jésuite » dans les rapports adressés à Napoléon par Portalis et dans les récits immédiats et ultérieurs émanant de la Compagnie, nous paraissent en définitive centrales.
La question des Pères de la Foi est à ce titre exemplaire. Il est essentiel de revenir ici sur la
formation de cette congrégation pour comprendre les conditions de son existence en France et les rapports entretenus avec la Compagnie de Jésus survivante en Russie. Ce que l’on nomme « Pères de la Foi » est le résultat de la réunion de deux initiatives qui prenaient pour modèle l’Ordre de saint Ignace supprimé. Une première société religieuse, celle des Pères du Sacré-Cœur, est fondée en Belgique en 1794 par les PP. Léonor de Tournely (1767-1797) et Charles de Broglie (1765-1849) et se compose, pour ce qui est du petit groupe fondateur, de prêtres français émigrés issus de la noblesse et formés au séminaire de Saint-Sulpice. Les Pères de la Foi quant à eux, ou paccanaristes, du nom de leur fondateur Nicolas Paccanari (1771-1811), voient le jour en 1797 à Rome et sont à l’origine le fruit
43 Paolo Bianchini, « Tra fedeltà e innovazione : la costruzione dell’identità gesuitica », dans Annali di storia dell’esegesi, 19/2, 2002, p. 369-383. 44 Pour la trame analytique adoptée ici, voir Rogers Brubaker, « Au-delà de l’identité », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 139, septembre 2001, p. 75 et suiv. 45 Jean-François Bayart, L’illusion identitaire, Paris, Fayard, 1996, p. 12. 46 Ibid., p. 93 47 Rogers Brubaker, art. cit., p. 76.
Europa Moderna n°3 / 2012
109
d’un apostolat laïc dirigé vers les couches populaires de la société48. Si ces deux congrégations décident de se réunir à partir de 1799, désignant comme supérieur général Paccanari et prenant alors le nom générique de Pères de la Foi, il ne faut pas négliger les divergences profondes qui les séparent, comme l’a souligné avec justesse Eva Fontana Castelli49. Divergences qui ont pour origine le contexte de fondation des deux sociétés et le milieu social des membres, mais qui se cristallisent avant tout sur un point essentiel, celui de la finalité recherchée par les Pères de la Foi. L’ambition affichée au commencement est certes l’admission dans la Compagnie de Jésus, dans l’éventualité prochaine et désirée d’une restauration de l’Ordre, mais lorsque Pie VII donne des preuves officielles d’encouragement pour le rétablissement des jésuites par les brefs Catholicae fidei (1801) et Per alias (1804)50, Paccanari semble de moins en moins disposé à la réunion, considérant sa société comme un nouvel institut, distinct de celui des jésuites. La phase d’expansion des Pères de la Foi dans plusieurs pays d’Europe coïncide alors avec un épisode de crise puis de rupture au terme duquel une partie des membres décide en 1804 de se détacher de Paccanari et du petit groupe romain qui lui restera fidèle, soit pour rejoindre la Compagnie de Jésus en Russie – ce qui est le cas par exemple des membres installés en Angleterre – soit pour continuer indépendamment l’apostolat, dans l’attente du rétablissement complet de la Compagnie – attitude adoptée par les Pères de la Foi français qui, pour la plupart, incorporeront l’Ordre après 1814. Ainsi, le petit groupe de prêtres établi clandestinement en France à partir de 1800 et qui fait bientôt l’objet de la surveillance étroite de Portalis et de Fouché, doit davantage aux Pères du Sacré-Cœur, dont il est en grande partie issu, qu’aux Pères de la Foi, bien qu’il en conserve le nom après la séparation de 1804. Représentations associées des jésuites et des Pères de la Foi dans les rapports de Portalis
À la veille de dissoudre définitivement la congrégation des Pères de la Foi sur le sol français, Napoléon demande au petit conseil chargé de la question des associations religieuses de résoudre une question lancinante : « Qu’est-ce que les Pères de la Foi ? […] Qu’est-ce qui distingue un Père de la Foi d’un Père de la Compagnie de Jésus ? À quoi les reconnaît-on ? »51. Clairement énoncées ici en 1807, ces interrogations sont au cœur des démarches entreprises à partir de 1802 par l’administration des Cultes pour connaître « en réalité et sans fard »52 le but de cette congrégation clandestine, localiser la quarantaine d’individus qui bientôt la compose, mais avant tout pour déterminer si celle-ci ne dissimulerait pas « sous un autre nom » la Compagnie de Jésus. Le portrait des Pères de la Foi que dresse Portalis, directeur des Cultes à partir de 1801, au fil de ses rapports est dès l’origine déterminé par la crainte du retour des jésuites en France, dont on sait qu’ils survivent alors en Russie. Il s’élabore notamment dans cette perspective, prenant pour appui la représentation que l’on se fait de la Compagnie ; c’est donc un deuxième portrait qui se dessine parallèlement au premier.
Dans un premier temps, les rapports tendent à dissocier les deux sociétés religieuses, même
s’ils en soulignent les similitudes. Ils se réfèrent pour cela au discours volontairement complaisant et rassurant tenu par les Pères de la Foi eux-mêmes, lors des premières mesures prises à leur encontre. Déjà à Lyon, en août 1802, alors que l’on s’apprête à fermer le premier établissement d’éducation ouvert par les Pères de la Foi un an plus tôt, le P. Roger (1773-1839), interrogé par la police, refuse la dénomination de « Société jésuitique » que le « bruit public » attribue alors aux Pères de la Foi, et il ajoute que, même s’« ils se proposaient de suivre les errements des jésuites » en ce qui concerne
48 Voir Eva Fontana Castelli, La Compagnia di Gesù sotto altro nome : Niccolò Paccanari et la Compagnia della fede di Gesù (1797-1814), Rome, IHSI, 2007, p. 20 et suiv. 49 Ibid., p. 86-87. 50 Le premier reconnaît l’existence de la Compagnie de Jésus en Russie, permettant également au nouveau P. général de recevoir quiconque désire entrer dans la Compagnie ou la réintégrer ; le second rétablit la Compagnie dans le Royaume des Deux-Siciles. 51 « Ordre concernant des associations religieuses. Fontainebleau, 19 octobre 1807 », Correspondance de Napoléon Ier, t. 16e, Paris, Plon et Dumaine, 1864, p. 103 ; voir également, Jacques-Olivier Boudon, Napoléon et les cultes. Les religions en Europe à l’aube du XIXe siècle (1800-1815), Paris, Fayard, 2002, p. 168. 52 « Ordre concernant… », Correspondance… op. cit., p. 102.
Europa Moderna n°3 / 2012
110
l’instruction, c’était « avec les modifications qu’exigent les circonstances »53. Le député des Pères de la Foi reçu en septembre 1802 par Portalis déclare, quant à lui, que ce « qui les a fait confondre avec l’ancienne société des jésuites […] c’est qu’en effet, en se réunissant, ils ont eu la pensée […] de servir la cause de la religion et de l’humanité dans l’univers entier »54. D’ailleurs, en plus de n’avoir « point de règlement rédigé », « les vrais jésuites ont refusé de les reconnaître et de se réunir à eux », remarque à juste titre Portalis, quelques jours plus tard dans un nouveau rapport55.
Mais, Portalis y explique également qu’à Rome « les jésuites ne purent conséquemment
s’introduire que sous un nom simulé et avec un costume un peu différent du leur », c’est-à-dire celui des paccanaristes56. Si rapidement l’on désigne les Pères de la Foi comme étant des « jésuites déguisés »57, si l’on craint qu’ils soient une « reproduction des jésuites sous une nouvelle forme »58, c’est que l’on perçoit chez eux un certain nombre de caractéristiques, structurelles et essentielles, attribuées, à tort ou à raison, aux membres de la Compagnie de Jésus, à commencer par la dimension étrangère de la congrégation. Très vite, Portalis souligne l’importance de « connaître une institution qui a déjà des racines hors de France »59 et qui dépend ouvertement d’un supérieur étranger. C’est donc également comme « paccanaristes » qu’ils sont nommés dans les divers rapports envoyés à Napoléon. Or, on sait que la société de Paccanari s’est fondée sur le « projet de faire revivre […] l’institut des jésuites »60. Quelques jours avant la promulgation du premier décret de dissolution des Pères de la Foi du 22 juin 1804, Portalis assure que ces « jésuites déguisés » suivent bien « l’institut des anciens jésuites ; ils professent les mêmes maximes » et, de même qu’en 1762, « leur existence est donc incompatible avec les principes de l’Église gallicane et le droit public de l’empire »61. Progressivement, l’image de la société des Pères de la Foi se dissout dans celle de l’Ordre de saint Ignace et leur parfaite similitude – ou du moins l’unité de leur plan – étant démontrée, leur interdiction est immédiate. En janvier 1805, Portalis trouve, dans la « nouvelle » association religieuse proposée par le Cardinal Fesch pour suppléer aux Pères de la Foi, une dernière preuve que ces derniers dissimulaient bien des jésuites62. Il voit dans cette société l’exact antidote à la Compagnie de Jésus et trace ainsi le portrait en négatif des jésuites. Cette « association d’ecclésiastiques citoyens » ne proposerait que des « engagements annuels » et non des vœux perpétuels. De plus, « aucun supérieur étranger n’interviendra. L’association sera purement française et nationale » et pour s’assurer qu’aucun lien avec l’étranger ne sera entretenu, Portalis propose, comme lors de la suppression des jésuites en 1762, la soumission à un serment empêchant toute « correspondance avec des supérieurs étrangers et […] tout retour à des institutions jugées incompatibles avec nos mœurs et nos lois ». Alors, cette société réformée n’offrirait « rien de semblable au régime de l’ancienne Compagnie de Jésus »63. Il soutient qu’une « séparation des métaux », entre « vrais » et « faux » jésuites, ne manquera pas de s’opérer si d’anciens Pères de la Foi décident d’y entrer car : 53 Voir la transcription du rapport dans Emile Flourens, « Napoléon Ier et les jésuites », La Nouvelle Revue, janvier-février 1894, p. 692. 54 « Rapport à l’Empereur sur une association de prêtres se destinant à l’éducation de la jeunesse. Du 18 fructidor an X [5 septembre 1802] », Jean-Etienne-Marie Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, les articles organiques publiés en même temps que ce concordat et sur les diverses questions de droit public, Paris, Joubert, 1845, p. 445-446. 55 « Rapport à sa Majesté l’Empereur sur les association dites du cœur de Jésus, et société des victimes de l’amour de Dieu. 25 fructidor an X [12 septembre 1802] », Portalis, op. cit., p. 450 ; nous soulignons. 56 Ibid., p. 448. 57 « Rapport et projet d’arrêt du conseil d’état sur les ecclésiastiques qui s’établissent en France sous le titre de Pères de la foi et sur les associations connues sous le nom de Sacré cœur et autres semblables. 19 prairial an XII [8 juin 1804] », Portalis, op. cit., p. 458. 58 « Rapport à l’Empereur sur l’analogie que cette association paraîtrait avoir aux yeux de quelques personnes, avec l’ordre des jésuites, et sur l’utilité d’une association ecclésiastique. 8 pluviôse an XIII [28 janvier 1805] », Portalis, op. cit., p. 471. 59 « Rapport à l’Empereur … 18 fructidor an X », Portalis, op. cit., p. 447. 60 « Rapport à sa Majesté… 25 fructidor an X », Portalis, op. cit., p. 448. 61 « Rapport et projet d’arrêt… 19 prairial an XII », Portalis, op. cit., p. 458-459. 62 Le Cardinal Fesch s’efforce en réalité de protéger les Pères de la Foi et de continuer à les employer dans son diocèse. 63 « Rapport à l’Empereur sur l’analogie… 8 pluviôse an XIII », Portalis, op. cit., p. 472 et p. 474.
Europa Moderna n°3 / 2012
111
« les vrais jésuites, soumis par leurs vœux à un général étranger et au pape seul, ne pourraient jamais consentir à se détacher de la cour de Rome, et même encore à reconnaître un prélat français pour supérieur général. S’il y a des Pères de la foi qui entrent dans la nouvelle association, ce sera une conquête que l’on aura faite sur une corporation qui tendait à renaître et que l’on a proscrite […]. Ceux qui sont jésuites par le cœur s’expatrieront plutôt que d’abjurer leur ordre ; et on aura l’avantage de recouvrer les jeunes ecclésiastiques qui, par goût ou par piété, s’étaient réunis à des confrères dont ils étaient désireux de partager les fonctions sans en partager la politique. »64
L’analogie étant manifeste à ses yeux, le discours de Portalis sur les Pères de la Foi emprunte
naturellement les formes traditionnelles de l’antijésuitisme. Dès 1802, il soupçonne les Pères de la Foi de suivre un plan secret : « j’avais personnellement quelques motifs de croire qu’ils se proposaient quelque chose de plus que l’instruction »65. Et malgré les efforts d’identification menés par l’administration des Cultes, l’ambiguïté, le mystère et l’obsession prédominent : « on ne sait qui est Père de la foi ou qui ne l’est pas ; en apparence il n’y en a plus, en réalité il en existe encore. Des laïques même sont des Pères de la foi sans qu’on s’en doute ; ils sont ce qu’on appelait des jésuites de robes courtes »66. Enfin, face à l’inefficacité du décret de 1804, alors que l’on réorganise l’enseignement, Napoléon insiste sur ce qui caractérise à ses yeux la société des Pères de la Foi et qui a été imputé à la Compagnie de Jésus au moment de sa suppression par les parlements français : « il y en a à Clermont qui rivalisent avec l’instruction publique, discréditent des lycées et s’emparent de l’esprit de la jeunesse »67. Ainsi, après la promulgation de la bulle Sollicitudo en 1814, lorsque le retour des jésuites devient une réalité, la lecture antijésuite de la présence des Pères de la Foi en France est reprise et exagérée dans plusieurs opuscules. Les représentations des deux sociétés religieuses s’y superposent dans une visée polémique pour n’en former qu’une seule, celle de la Compagnie, là où les rapports de Portalis consignaient les nombreux points de jonction entre les deux sociétés, sans pour autant aller jusqu’à un complet amalgame. Pour l’auteur du petit ouvrage intitulé Du rétablissement des Jésuites en France sous le nom de Pères de la Foi, le masque emprunté par les jésuites ne trompe personne et c’est bien « sous le nom modeste de Pères de la foi » qu’ils sont rentrés en France : « ils ne se présentent plus aujourd’hui sous le nom de Jésuites, flétri par l’arrêt de 1762 et par les lois de 1789, mais sous celui de Pères de la Foi, comme s’ils pouvaient à la faveur de ce déguisement se glisser incognito »68. L’histoire des Pères de la Foi se confond avec celle des jésuites et les deux dénominations sont utilisées tout au long de l’ouvrage sans distinction pour désigner une seule et même chose : « Je ne m’arrêterai pas ici à démontrer l’identité des Jésuites et des Pères de la Foi ; à faire voir qu’ils se représentent aujourd’hui avec le même institut, les mêmes prétentions d’autrefois ; que tout ce qu’on a dit, tout ce qu’on peut dire des ex-Jésuites et de leur institut, s’applique exactement aux Pères de la foi : personne n’élève de doute là-dessus »69.
Au-delà de cette représentation au trait forcé, il reste néanmoins l’idée qu’à travers les Pères
de la Foi, Napoléon et Portalis s’imaginent atteindre les jésuites survivants en Russie et que la présence des uns permettra le retour des autres. Si l’on perçoit les Pères de la Foi comme des « jésuites déguisés », on les envisage aussi comme une « avant-garde » sur laquelle le rétablissement de l’Ordre est susceptible de s’appuyer70. Portalis répète ainsi plusieurs fois que la société des Pères de la Foi « tient à des plans plus vastes », c’est-à-dire au rétablissement de la Compagnie de Jésus, car poursuit-il, « les jésuites n’ont jamais été entièrement morts, quoique frappés par les bulles de Ganganelli et par 64 Ibid., pp. 472-473 ; nous soulignons. 65 « Rapport à l’Empereur sur une association… 18 fructidor an X », Portalis, op. cit., p. 445. 66 « Rapport à l’Empereur sur l’analogie… 8 pluviôse an XIII », Portalis, op. cit., p. 473. 67 « Ordre concernant… 19 octobre 1807 », Portalis, op.cit., p. 103. 68 Du rétablissement des Jésuites en France sous le nom de Pères de la Foi, Paris, chez Plancher, 1819, p. 5 et p. 41. 69 Ibid., pp. 7-8. 70 Joseph Burnichon, La Compagnie de Jésus en France : Histoire d’un siècle, 1814-1914, t. 1, Paris, Beauchesne, 1914, p. 18.
Europa Moderna n°3 / 2012
112
les édits de tous les princes catholiques »71. C’est bien un lien de parenté qui est décrit dans les divers rapports de l’administration des Cultes, une filiation que l’on ne perçoit pourtant pas dans toute son étendue et sa complexité et que l’on réduit, de façon délibérée, à une simple analogie. « Identità a confronto » : la Compagnie de Jésus de Russie face aux Pères de la Foi
En considérant les Pères de la Foi du point de vue des jésuites eux-mêmes et du petit noyau formé par la Compagnie de Jésus en Russie, il est possible de dénouer davantage ce lien qui paraît unir les deux sociétés et d’en préciser la nature. L’apparition d’initiatives telles que la société de Paccanari, perçue le plus souvent par l’opinion comme étant une société de jésuites, constitue une véritable concurrence qui se heurte ouvertement à partir de 1801 à la Compagnie de Jésus de Russie, alors confirmée dans son statut par Pie VII. Comme nous le révèle le travail d’Eva Fontana Castelli, dont nous soulignerons ici les traits les plus marquants, c’est sous le signe de la confrontation que se développent les relations entre la Compagnie et les paccanaristes et que se caractérise l’identité jésuite durant cette période d’incertitude concernant le rétablissement de l’Ordre72. La notion d’« identità a confronto », mise en évidence par l’historienne, nous semble être le résultat d’un double processus, tout à la fois volontaire et non déterminé, qui conduit la Compagnie, d’une part, à délimiter son espace en discriminant les paccanaristes et leur fondateur et, d’autre part, à se penser et se présenter comme la véritable héritière et garante de l’esprit de saint Ignace. Cet effort de « catégorisation » mais aussi de « localisation sociale »73 vise autant à construire une image des Pères de la Foi dévaluée et étrangère aux jésuites, dans un mouvement opposé à toute une littérature antijésuite recherchant la confusion entre les deux congrégations, qu’à définir et affirmer sa propre image s’inscrivant notamment dans un passé ininterrompu ; c’est aussi par cette opposition que la Compagnie se situe dans l’espace religieux encore incertain.
Un travail minutieux reste à faire sur les Pères de la Foi en France, qui permettrait de détailler
leurs relations avec les anciens jésuites et la Compagnie de Jésus survivante en Russie. Séparés officiellement de Paccanari en 1804, une partie d’entre eux forme, à partir de 1814, le petit groupe de novices et de futurs membres sur lequel la Société s’appuie pour reprendre pied en France. Mais, s’ils ont pris une voie sensiblement différente de celle de Paccanari, témoignant de leur désir constant de rejoindre les jésuites, la position et le discours tenus par la Compagnie, à l’heure de son rétablissement sur le sol français, semblent néanmoins adopter plusieurs des caractéristiques soulignées par Eva Fontana Castelli concernant l’attitude prise auparavant face aux paccanaristes. La « discontinuité » introduite par les Pères de la Foi74 conduit la Compagnie de Jésus à affirmer l’importance du rôle des anciens jésuites survivants dans la transmission de son « identité »75. Le rétablissement de la Compagnie en France, comme en témoignent certaines lettres envoyées par le P. Général Brzozowski (1749-1820) aux deux principaux artisans de cette restauration, doit avant tout reposer sur la continuité, assurée essentiellement par les membres encore vivants76. En 1814, Brzozowski confie donc au P. de Clorivière (1735-1820) le soin de rechercher ses anciens confrères et de s’assurer de
71 « Rapport et projet d’arrêt… 19 prairial an XII » et « Rapport à sa Majesté… 25 fructidor an X », Portalis, op. cit., p. 455 et p. 448. 72 Eva Fontana Castelli, op. cit., p. 117 et suiv. 73 Rogers Brubaker attire notre attention sur ce qui relève aussi, au niveau individuel et collectif, d’une « subjectivité située » et des « compréhensions particularistes du moi et de sa localisation sociale » qui ne relèvent plus de stratégies déterminées, en proposant également les termes d’« autocompréhension » et d’« autoreprésentation » comme possibles substituts à l’« identité », Rogers, Brubaker, art. cit., p. 77. 74 Cette « discontinuité » résulte notamment de l’absence d’anciens jésuites intervenant dans la fondation de la congrégation, comme cela a pu être le cas au même moment pour d’autres sociétés religieuses masculines ou féminines, mais surtout leur quasi-absence au sein même des Pères de la Foi. Voir à ce propos la transcription d’un des catalogues de la société, établi probablement en 1802-1803, dans Eva Fontana Castelli, op. cit., Annexe 2, p. 279 et suiv. 75 Ibid., p. 126 et 128. 76 En tant que profès des quatre vœux, Clorivière est vu selon les Constitutions comme faisant partie du noyau même de la Compagnie de Jésus, de cette quatrième « manière » d’être uni à la Compagnie, considérée comme « la plus appropriée » [Const. 511].
Europa Moderna n°3 / 2012
113
« leurs dispositions envers Celle qui fut leur mère ». Il désigne également deux anciens jésuites français susceptibles de l’épauler dans l’entreprise de rétablissement : « vous pourrez vous concerter avec Barruel, Grosier et tels autres que vous trouveriez animés de bons sentiments, et vous aviserez avec eux aux moyens de secourir et de consoler cette mère affligée. »77 La tâche qui les attend consiste d’abord à un retour à l’ordre, c’est-à-dire principalement à l’application rigoureuse des règles et des Constitutions. Si, jusqu’à présent « une façon de voir et d’envisager les choses qui n’est pas tout à fait juste » a eu cours, explique le P. Général en 1818 au P. Simpson (1742-1820), vice-provincial de France, « il est temps que les choses soient établies comme elles le doivent être » ; « de l’observation exacte de ce point dépend l’existence de la Compagnie ». Les efforts porteront sur la formation longtemps négligée: « vous avez bien raison », ajoute Brzozowski dans la même lettre, « de penser que tout ce qu’il peut y avoir de défectueux vient de ce que jusqu’à présent le noviciat n’a pas été tel qu’il devait être »78. La question de l’incorporation des anciens Pères de la Foi est bien sûr au cœur des recommandations du P. Général qui demande à son vice-provincial de conseiller le P. Gury (1773-1854) dans son emploi de maître des novices : « je désire que vous vous assuriez par vous-mêmes de la manière dont il s’acquittera de cet emploi, et que vous le dirigiez autant que cela sera nécessaire, pour que tout se fasse selon l’Institut, sans addition ni altération »79. Déjà en octobre 1804, à propos du rétablissement des jésuites à Naples, le Journal des Débats témoignait de cet effort entrepris par la Compagnie pour aplanir l’obstacle constitué par plus de quarante ans de suppression et réduire la distance d’avec son passé :
« Les nouveaux Jésuites […] sont ce qu’étaient les anciens. Outre le même nom, le même habit, la même règle, les nouveaux vont être formés par les anciens, ces restes d’Israël que la Providence ne semble avoir conservés que pour être les dépositaires du feu sacré et des vraies traditions et principes de l’Institut. De sorte que la chaîne depuis saint Ignace ne se trouvant nullement interrompue, on peut dire que les nouveaux Jésuites sont véritablement les successeurs des anciens, et que l’Ordre, sans avoir la même étendue, n’en a pas moins la même perfection. »80
Alors que le pape prouve à plusieurs reprises sa volonté de rétablir l’Ordre, la Compagnie de
Jésus s’efforce, depuis les années 1800, de présenter l’image de la permanence et de l’uniformité. Les précautions prises à partir de 1814, notamment en France, cherchent effectivement à faire valoir un retour à ce que l’on estime être l’« ancienne » Compagnie. Le P. Brzozowski recommande à Clorivière, en mai 1814, trois mois avant la promulgation de la bulle Sollicitudo, la plus grande prudence concernant le rétablissement, ou plutôt le « rappel » des jésuites en France : « il s’agit en effet d’avoir tellement égard à l’Institut de la Société que ce soit l’ancienne Société qui revive et non pas une nouvelle Société qui s’élève à sa place »81. La distinction faite ici, qui se concrétise en premier lieu par le vocabulaire, renvoie à la dissociation que la Compagnie a tenté d’imposer jusqu’à présent entre deux représentations d’elle-même, entre la « vraie » et la « légitime » Compagnie de Jésus, qu’elle considère incarner, et la « fausse » et donc « illégitime » Compagnie, image qu’elle assigne aux paccanaristes82. Le P. Général met en garde ici contre l’erreur qui fut celle de Paccanari, perçu au début par ses zélateurs comme un « nouvel Ignace », d’avoir voulu « renouveler le corps des jésuites »83 et de « former une société séparée de celle des jésuites », ce qui, affirme le cardinal Spina en 1801, « les avait excité contre [lui] et les avaient porté à [le] contrecarrer en tout »84. Deux ans
77 Lettre du P. Général Brzozowski à Clorivière, 7/9 mai 1814, retranscrite du latin dans Joseph Burnichon, op. cit., p. 54. 78 Vanves, Archives Françaises de la Compagnie de Jésus (AFSI), série A-Pa 31 2, Lettres des Pères généraux, « Lettre du P. Général Brzozowski au P. Simpson, Potosk, 24 mars 1818 ». 79 Ibid. ; nous soulignons. 80 Article du 10 vendémiaire an XIII [2 octobre 1804], dans Joseph Burnichon, op. cit., p. 37. 81 Lettre du P. Général Brzozowski à Clorivière, 7/9 mai 1814, retranscrite du latin dans Joseph Burnichon, op. cit., p. 55 ; nous soulignons. 82 Ce vocabulaire prend bien sûr un sens particulier dans le contexte de Restauration de la monarchie. 83 AFSI, série C-Pa 500/7, Pères de la Foi, « François-Marie Halnat, Extrait (copie) d’une lettre de Munster du 30 juillet 1799 » ; nous soulignons. 84 Lettre du P. Varin au P. Paccanari de 1801, dans Eva Fontana Castelli, op. cit., p. 199.
Europa Moderna n°3 / 2012
114
avant son départ pour la Russie, le P. Halnat, revenu de son premier enthousiasme, a bien conscience que, malgré ses déclarations en faveur de la réunion avec la Compagnie de Jésus, le P. Paccanari « avait décidé l’année dernière, sans en rien dire [aux Pères de la Foi], que la réunion n’était pas possible, et qu’[ils] ferai[ent] un corps à part, qui serait une réforme »85. La « campagne antipaccanariste » qui se met en place dès 1799, parmi les jésuites survivants de Russie et dans les milieux proches de la Compagnie de Jésus, s’explique donc par la conscience d’être face à une forme de dissidence qui met en danger l’unité de la Compagnie et ainsi son éventuel rétablissement86. De plus, alors que la congrégation de Paccanari n’a jamais pu bénéficier que d’une autorisation temporaire de la part du Souverain Pontife, la petite Compagnie de Jésus de Russie, reconnue officiellement par le bref Catholicae Fidei, est amenée à se penser et se représenter comme la légitime garante de l’authenticité de l’Institut de saint Ignace, notamment auprès des Pères de la Foi, comme en témoigne le même P. Halnat, à qui l’on enjoint en 1803, lui et ses confrères d’Angleterre, de « ne faire qu’une seule bergerie et un seul pasteur sous le successeur légitime de St Ignace ». Il explique, par ailleurs, à son destinataire que le P. Général « désire qu’ [ils aillent] en Russie afin de puiser à la même source et de [se] disposer ensuite comme du temps de St Ignace » 87. C’est en des termes similaires que les Pères de la Foi du collège de Spolète expriment à Pie VII en 1804 leur désir de se joindre à la Compagnie de Jésus en Russie : ils assurent qu’ils emploieront leurs forces « à vivre et mourir dans l’Institut de la vraie Compagnie de Jésus et sous l’obéissance de son général légitime »88. À l’heure du rétablissement en France, le P. Général est ainsi persuadé que les efforts fournis par le P. Simpson et par « la petite, mais précieuse portion de la Compagnie » qui lui a été confiée permettront de faire régner « le vrai et pur esprit de notre saint fondateur » et il se réjouit en 1819 de voir que dans la maison de Saint-Acheul « l’esprit de la Compagnie commence à y régner tout de bon »89.
Par leur séparation d’avec Paccanari et du petit groupe romain qui l’entoure, les Pères de la Foi français, bien qu’ils conservent une forme d’indépendance, témoignent d’une certaine manière leur allégeance et leur soumission à l’autorité instituée de la Compagnie de Jésus en Russie. Bien qu’une distinction semble être faite entre eux et les paccanaristes – distinction qui sera volontairement soulignée de plus en plus dans les récits de fondation au cours du XIXe siècle –, ils ne sont jamais définis par les jésuites survivants, avant leur incorporation à la société, comme des fils de saint Ignace à proprement parler mais l’image qui est renvoyée par la Compagnie, et qu’elle a auparavant tenté d’imposer à l’ensemble des Pères de la Foi, est celle d’un « vivier » permettant au rétablissement de l’Ordre de prendre corps concrètement. Ainsi, Brzozowski reconnaît la valeur du P. Varin (1769-1850), qui fut à la fois supérieur des Pères du Sacré-Cœur et supérieur des Pères de la Foi en France, parce qu’il s’est aussi distingué « par le service qu’il a rendu à la compagnie en lui procurant tant de bons sujets qui ne peuvent manquer de lui faire honneur »90.
Bien que nous n’ayons fait ici qu’en esquisser les contours, nous pouvons néanmoins voir se
dessiner un premier lieu de l’« identité jésuite » pendant la suppression, un espace défini principalement par la Compagnie de Jésus elle-même, dans les premières années du XIXe siècle, et dont il est possible de percevoir la délimitation et les frontières. La Compagnie, organisant son rétablissement, rappelle une donnée importante de son « identité » : la nécessaire intervention de l’institution dans la transmission et la conservation même d’un mode de vie religieux réglé par l’Institut de saint Ignace. Elle est amenée de ce fait à préciser le sens que renferme selon elle le terme de « jésuite », définition qu’un membre de la Compagnie au XXe siècle, à propos des Pères de la Foi, résumait ainsi : « Nous ne pouvons pas, on le comprend bien, employer ici ce nom dans un sens aussi arbitrairement étendu. Il a pour nous une signification nettement définie. Or, pour être religieux de la 85 AFSI, série C-Pa 500/7, Pères de la Foi, « Lettre du P. Halnat au P. Kohlman, Londres, 7 octobre 1803 » ; nous soulignons. 86 Eva Fontana Castelli, op. cit., p. 124. 87 AFSI, série C-Pa 500/7, Pères de la Foi, « Lettre du P. Halnat au P. Kohlman, Londres, 7 octobre 1803 ». 88 Eva Fontana Castelli, op. cit., p. 208 ; nous soulignons. 89 AFSI, série A-Pa 31 2), Lettres des Pères généraux, « Lettre du P. Général Brzozowski au P. Simpson, Potosk, 24 mars 1818 » et « Lettre du P. Général Brzozowski au P. Simpson, Potosk, 6 août 1819 ». 90 AFSI, Série A-Pa 31 2), Lettres des Pères généraux, « Lettre du P. Général Brzozowski au P. Simpson, Potosk, 24 mars 1818 ».
Europa Moderna n°3 / 2012
115
Compagnie de Jésus, deux conditions sont requises, l’admission par les supérieurs légitimes et l’émission des vœux, l’une et l’autre soumises à des règles précises. En dehors de là, on ne peut être jésuites qu’en métaphore »91. Aussi, en 2008, la 35e Congrégation générale précise à son tour, dans un passage auquel nous avons déjà fait référence ici, que c’est par « une relation claire et définie avec la Compagnie de Jésus » qu’une « œuvre ignatienne peut être dite jésuite ».
La Compagnie de Jésus a joué un rôle indéniable dans la survie et la continuité de l’« identité
jésuite » durant les années 1800 et semble y avoir réussi autant par le contrôle exercé sur son identité que par une certaine centralisation, deux conditions sans lesquelles la scission aurait sans doute été inévitable et le rétablissement en un seul corps religieux impossible. L’usage du vocabulaire dans ce contexte se révèle de nouveau symptomatique d’une image de soi qui est vécue et pensée par la Compagnie dans des bornes précises mais aussi comme un ensemble indivisible92. C’est pourquoi, si l’on use volontiers du pluriel lorsque l’on parle d’« identités franciscaines »93, ce qui s’explique évidemment par la présence de différentes branches dans l’Ordre franciscain, il n’en va pas de même pour l’« identité jésuite », lorsque l’on entend parler de l’existence dans la Compagnie de Jésus et selon l’Institut fondé par saint Ignace, même lors de la suppression. De la même façon, s’il y a une « famille » et un « mouvement » franciscains, il ne peut y avoir de famille « jésuite » qui supposerait la présence de congrégations issues de la Compagnie de Jésus. L’adjectif « ignatien » apporte donc une nuance indispensable qui permet d’envisager les initiatives des Pères du Sacré-Cœur et des Pères de la Foi sans que de quelconques rapports soient nécessairement entretenus avec la Compagnie de Jésus, une existence qui se serait finalement formée à la lisière ou même en dehors de l’« identité jésuite », comme a pu nous le montrer le travail d’Eva Fontana Castelli mais comme le rappelle également la 35e Congrégation Générale. Un « Corps détruit », des « membres épars »94 : l’expérience individuelle de la suppression
User du concept d’« identité jésuite » lorsque l’on se propose d’étudier la suppression de la Compagnie de Jésus, suppose, comme l’explique Paolo Bianchini, mais comme le suggère également Rogers Brubaker qui recourt, dans un deuxième temps, aux notions d’« autocompréhension » ou d’« autoreprésentation »95, d’aller au-delà d’une perception extérieure de l’image commune transmise par la Compagnie. Il s’agit en effet d’adopter une perspective non plus globale et institutionnelle mais de porter notre attention sur les comportements et les parcours individuels des jésuites après 1762, date des premiers arrêts de suppression des parlements français. Réfléchir à l’« identité jésuite » et à sa survie pendant la suppression consiste donc, de ce point de vue, à mettre à jour, autant qu’il est possible, la manière dont les anciens jésuites conçoivent et expriment leur appartenance à l’Ordre de saint Ignace, mais aussi les habitudes et les pratiques dévotionnelles et culturelles qui à leurs yeux traduisent une certaine fidélité envers leur première vocation.
Nous sentons en premier lieu toute l’insuffisance et l’ambiguïté d’user de termes génériques
tels que ceux d’« anciens jésuites » ou d’« ex-jésuites », qui ont été notamment utilisés par les
91 Joseph Burnichon, op. cit., p. 8. 92 Soulignons que c’est principalement en ces termes que la Compagnie est décrite et pensée dans les Constitutions, notamment dans le Prologue, en tant que « corps universel » dont on « recherche principalement l’union, le bon gouvernement et la conservation en son bon état », [Const. 1351]. Néanmoins, les Constitutions, comme nous le rappelle Dominique Bertrand, ne visent pas la continuité et la reproduction servile des origines ; cela révèle, semble-t-il, l’une des difficultés que pose l’image de la Compagnie de Jésus au début du XIXe siècle, image qui s’élabore dans une fidélité presque excessive aux origines. 93 Voir Frédéric Meyer et Ludovic Viallet (dir.), Identités franciscaines à l’âge des réformes, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2005. 94 Dieudonné Thiébault, op. cit., p. 19. 95 Ces notions sont intimement liées au troisième ensemble terminologique proposé par le sociologue qui concerne le sentiment d’appartenance à un groupe limité et fermé et le ressenti affectif vis-à-vis d’une communauté ; il s’agit d’une « forme spécifique d’autocompréhension chargée affectivement » et qui se rapproche du terme générique d’« identités collectives », Rogers Brubaker, art. cit., p. 78.
Europa Moderna n°3 / 2012
116
parlements français et les jésuites eux-mêmes pendant la suppression et qui font état d’une qualité considérée comme désormais révolue96. De même que continuer d’employer le mot « jésuite » pour désigner des hommes qui sont entrés dans la Compagnie de Jésus et ont pour certains prononcé des vœux, mais qui ont vécu la rupture de la suppression, ne traduit pas la réalité des trajectoires empruntées dont certaines se sont éloignées de ce premier état. Enfin, les qualificatifs employés par l’historiographie tels que « jésuites survivants », pour définir essentiellement les jésuites de Russie, ou « jésuites de cœur », qui exprime aux yeux de Joseph Burnichon l’attachement indéfectible à la Compagnie, ne peuvent être donnés qu’a posteriori et essentiellement au petit nombre d’individus qui se réunira de nouveau à l’Ordre après 1814. C’est une difficulté à laquelle nous nous heurtons chaque fois que nous nous penchons sur le destin d’un de ces hommes et nous devons nous résoudre, pour la plupart d’entre eux, à rester dans l’incertitude quant aux sentiments qui les animent après 1773 vis-à-vis de leur ancien ordre97.
Néanmoins, quelques jalons peuvent être posés grâce aux cas de deux anciens jésuites,
Augustin Barruel (1741-1820) et Jean-Joseph Rossignol (1726-1815), pour lesquels nous disposons des correspondances et d’un récit autobiographique98. Malgré la diversité des chemins parcourus par les anciens jésuites français après 1762 et 1773, leurs parcours attestent de certains choix pris par leurs anciens confrères lors de la suppression99 et sont similaires en plusieurs points. Ils sont marqués par deux périodes d’exil qui surviennent à deux moments critiques, lors des premières mesures d’interdiction et d’expulsion de la part des parlements qui aboutiront à l’édit royal de novembre 1764, confirmant définitivement la suppression de la Compagnie de Jésus, et suite à la promulgation de la Constitution Civile du Clergé. Si le P. Rossignol est appelé dès 1761 par ses confrères polonais du collège de Vilnius pour s’occuper notamment de l’enseignement de la philosophie et de la construction de l’observatoire, Barruel, lui, fait le choix plutôt rare d’un exil lointain en Bohème pour effectuer sa théologie dans un collège de la Compagnie. Prêtre réfractaire, c’est en Angleterre qu’il choisira de s’exiler en 1792 pour ne revenir définitivement en France qu’en 1802. Pour fuir le serment et les persécutions, Rossignol, quant à lui, traverse les cols des Hautes-Alpes en 1792 pour s’installer à Turin où il y restera jusqu’à sa mort. Entre ces deux périodes d’exil, les deux anciens jésuites, forcés en 1773 par le bref de suppression de quitter les maisons jésuites où ils résidaient, retournent en France. Après un séjour en Avignon, le P. Barruel réside à Paris et le P. Rossignol, quittant le collège des Nobles de Milan où, depuis 1764, il aidait notamment le P. Boscovich dans ses travaux, revient dans son diocèse d’origine, à Embrun. Les lettres laissées par ces deux anciens jésuites, dans lesquels ils parlent de leur ancienne vie religieuse et de la Compagnie de Jésus, sont adressées pour la plupart à des anciens confrères et ont surtout été écrites entre 1800 et 1806, période des brefs Catholicae Fidei et Per alias. Dans ce contexte particulier où les signes d’un rétablissement se multiplient et où la Compagnie a désormais une existence officielle en Russie, ces lettres ont certes pour intention d’attester de sa soumission, de sa fidélité et de son espérance d’être bientôt réuni à la Compagnie de Jésus, une fois celle-ci entièrement rétablie, mais montrent avant tout un attachement et un sentiment identitaire certain pour l’Ordre de saint Ignace et ses disciples.
96 Ces deux termes étaient aussi employés avant la suppression pour désigner une personne ayant quitté ou ayant été renvoyée par la Compagnie, acte qui ne peut se faire sans l’autorité d’un supérieur. 97 Outre le peu de documents publiés ou manuscrits laissés par la majorité d’entre eux sur ce sujet, rappelons que le bref de 1773 interdisait notamment aux anciens membres de la Compagnie de remettre en cause ou même de parler de la suppression et de ses motifs, y compris de l’Institut et des Constitutions, voir la traduction du bref Dominus ac Redemptor faite par Léon Mention, Document relatifs aux rapports du Clergé avec la Royauté de 1682 à 1789, tome II de 1705 à 1789, Paris, Alphonse Picard et fils, 1903, p. 259. 98 Une partie de la correspondance du P. Barruel est conservée aux archives de Vanves, série H Ba (les lettres auxquelles nous nous référons sont pour la plupart des copies). Abel Dechêne a notamment publié les Lettres inédites de Barruel à se retour d’exil (1802-1806), Aubenas, Habauzit, 1923. Le P. Rossignol, quant à lui, a imprimé de son vivant une partie de sa correspondance, notamment dans ses Lettres de M. Rossignol de Vallouise, Turin, Imprimerie de la Cour d’appel, 1806, et a fait un récit de sa vie dans son Histoire des œuvres de M. Rossignol composée à la demande du ministre de Rome à Turin M. le C. Modestino Pellicani, par l’auteur même, Turin, Chez Ignace Soffietti, 1804. 99 Voir le travail déjà cité de Paolo Bianchini et en particulier ses analyses statistiques, Educazione… op. cit., p. 187 et suiv.
Europa Moderna n°3 / 2012
117
La manière dont les PP. Barruel et Rossignol expriment leur appartenance se traduit
premièrement par le rappel fréquent et volontaire de leur qualité d’« ancien jésuite » et d’« ancien confrère ». Barruel se définit, dans sa troisième lettre au P. Angiolini comme « cet ancien confrère qui n’attend que [sa] voix pour y reconnaître celle de Dieu et pour la suivre »100. De même, Rossignol rappelle volontiers au secrétaire du pape son premier état : « ma qualité de votre ancien confrère me persuade que vous accueillerez avec quelque intérêt les détails où je vais entrer », commence-t-il avant d’expliquer son parcours et solliciter ainsi la « bénédiction apostolique sur [sa] personne et sur [ses] travaux ». Mais, déjà en 1797, Rossignol rédigeait une supplique au général Bonaparte au nom des « jésuites milanais » pour l’obtention d’une pension : « nous sommes les restes infortunés » de la Compagnie de Jésus, précisait-il101. Et c’est bien « auprès d’un jésuite » que Joseph de Maistre, en 1803, se félicite de voir son fils, lequel bénéficiera ainsi des « mêmes principes d’éducation dont [il] est redevable […] à cette Société »102. Les deux anciens jésuites écrivent à leurs confrères pour exposer leurs « dispositions à l’égard de la Compagnie », comme l’explique le P. Barruel ; « je me suis cru en devoir de vous faire connaître mes dispositions », termine le P. Rossignol dans une lettre au P. Andrès103. Elles sont essentiellement adressées à un interlocuteur privilégié, le P. Gaétan Angiolini (1748-1816), procureur de la Compagnie de Jésus à Naples, chargé au nom du P. Général d’accueillir, suite au bref de 1804, tous ceux qui souhaitent rejoindre la Compagnie dans le Royaume des Deux-Siciles104. Les PP. Barruel et Rossignol manifestent alors leur désir de retourner dans le sein de la Compagnie. Bien que nous ne sachions pas exactement si Rossignol a eu le temps de demander avant sa mort sa réadmission, il assure, le 17 septembre 1800, désirer « ardemment de passer le reste de sa vie dans l’exercice des vertus propres de son premier état » et les réponses du P. Angiolini, auquel Rossignol a pris soin d’envoyer des exemplaires de ses travaux, rendent compte des bonnes dispositions de l’ancien jésuite : « je suis rempli de consolation, du désir ardent que vous montrez de mourir avec l’habit de notre Compagnie » ; « continuez à prier le Seigneur avec ferveur », poursuit-il, « et tenez pour assuré que Dieu vous donnant encore un ou deux ans de vie, vos désirs seront accomplis »105. Quelques mois avant la promulgation du bref Per alias, le P. Angiolini encourage son confrère : « Je suis toujours plus consolé d’apprendre que vos sentiments pour votre ancienne mère, sont invariablement les mêmes. Conservez-les, et augmentez-les, si la chose est possible. Peut-être le temps n’est pas éloigné, où vous pourrez en suivre l’impulsion, et en donner des preuves »106. Le P. Barruel s’adresse également à Angiolini pour lui « redire le sentiment qu’[il a] toujours conservé pour la Société dans laquelle [il a] eu le bonheur d’être élevé » et sa volonté de retrouver ses anciens confrères à Naples107. Empêché de les rejoindre par l’arrivée de Joseph Bonaparte en 1806 qui expulse alors les jésuites, il montre sa déception à son confrère anglais le P. Strickland et déplore « cette situation toujours pénible pour une vocation à laquelle [il] ne veu[t] ni ne p[eut se] résoudre à renoncer » ; « me voilà de nouveau réduit à vivre au milieu du siècle et loin de nos retraites religieuses » car, précise-t-il, « pour la Russie, franchement, je n’ai pas le courage d’en supporter les glaces »108.
100 AFSI, série H Ba 52 d) Barruel – correspondance, « Lettre au P. Angelini [sic], Paris, 1er avril 1805 ». 101 « Lettre à Monseigneur Marotti secrétaire du pape, Turin, 12 avril 1800 » et « Modèle de supplique au citoyen Bonaparte général en chef de l’armée française d’Italie », dans Rossignol, Lettres… op.cit., p. 123-125 et p. 153. 102 « Lettre de M. le Comte de Maistre, à Saint-Pétersbourg, 3 novembre 1803 », dans le recueil de lettre des Pièces fugitives par M. Rossignol de Vallouise, Turin, De l’imprimerie de la Cour d’appel, 1806, p. 29. 103 AFSI, série H Ba 52 d) Barruel – correspondance, « Lettre au P. Angelini [sic], Paris, 1er avril 1805 » ; « Lettre à M. l’abbé Andrès de Parme, Turin, 17 septembre 1800 », dans Rossignol, Lettres… op. cit., p. 36. 104 Les copies des lettres du P. Barruel envoyées au P. Angiolini indiquent « Angelini » et Rossignol écrit parfois « Angliolini » dans ses Pièces fugitives mais il s’agit bien du même P. Angiolini, désigné par sa qualité de procureur général de la Compagnie. 105 « Lettre à M. l’abbé Andrès de Parme, Turin, 17 septembre 1800 », dans Rossignol, Lettres… op. cit., p. 36 et « Lettre du père Angliolini [sic] jésuite, Rome, le 11 décembre 1803 », dans le recueil de lettre des Pièces fugitives…op. cit., p. 38. 106 « Lettre du même, à Naples, le 31 mars 1804 », dans le recueil de lettre des Pièces fugitives… op. cit., p. 40. 107 AFSI, série H Ba 52 d) Barruel – correspondance, « Lettre au P. Angelini[sic], Paris, 4 janvier 1805 ». 108 « À William Strickland, Amsterdam, 19 juin 1806 », dans Abel Dechêne, Lettres inédites… op. cit., p. 36.
Europa Moderna n°3 / 2012
118
Dans cette définition que les PP. Barruel et Rossignol donnent d’eux-mêmes, les portraits de la Compagnie de Jésus et du groupe auquel ils ont appartenu prennent naturellement place. Malgré la suppression, leurs propos témoignent d’une image de soi perçue à la fois comme dépendante de la Compagnie mais aussi solidaire de la communauté dans laquelle elle entend toujours s’inscrire. Pour Augustin Barruel, l’appartenance est surtout affective et filiale ; la Compagnie est une mère dont il est un des enfants. Il aspire à se voir « de nouveau rendu à cette sainte Mère qui [l]’a élevé dans son sein », cette « sainte Compagnie » dont il a appris à apprécier « les leçons », « les exemples de vertu » et à laquelle il doit son « éducation ». Sa réadmission, en 1816, est pour lui une « nouvelle adoption »109. Jean-Joseph Rossignol, dont le parcours de plus de trente ans au sein de l’Ordre a été marqué par les travaux littéraires et scientifiques, montre davantage un lien d’ordre intellectuel avec la Compagnie, un lien qui perdure par l’adhésion persistante à un idéal religieux, pédagogique et culturel qui fut celui de la Compagnie de Jésus jusqu’à sa suppression. Dans l’histoire de ses œuvres, il en transmet la mémoire et, sous couvert de vouloir « établir un corps de savants répandus sur toute la surface du globe », il dresse le portrait de la Compagnie à laquelle il reste attaché, un portrait qui mérite néanmoins quelques retouches :
« Cette société cosmopolite aurait un objet principal le perfectionnement de la géographie, de l’histoire naturelle, de la physique expérimentale et de l’astronomie […]. Un corps qui portait le nom même de société, a été longtemps, et l’a été seul à portée d’exécuter d’une manière assurée, un si vaste et si magnifique dessein. S’il existait encore, il le pourrait aujourd’hui avec un degré de facilité bien plus marqué que dans les temps passés. La rouille de la vieille éducation dont il était encore un peu infecté, ne saurait y mettre aucun obstacle ; et s’il en restait encore quelque léger vestige, rien en serait plus aisé que de le faire disparaître »110.
Alors qu’il voit dans le rétablissement des jésuites le plus sûr moyen conduisant au rétablissement de la religion, Rossignol insiste sur l’importance d’« un état quelconque, pour la sûreté des peuples et des souverains, un corps d’instituteurs et de ministres éclairés, religieux, qui n’altèrent pas la parole de Dieu par leur sens particulier », un corps qui œuvrerait principalement contre le philosophisme ; « voici à cet égard ma profession de foi, et c’est celle du corps dont j’ai été membre trente ans et plus », ajoute-t-il111. En se positionnant également vis-à-vis du groupe, les deux anciens jésuites sont amenés à décrire ce lien réel ou passé qui continue de les unir à leurs confrères. Les adjectifs possessifs, régulièrement employés, traduisent ainsi une volonté d’insertion dans la communauté formée par les jésuites de Russie et du royaume des Deux-Siciles. Les deux anciens jésuites se félicitent de la réussite de la Compagnie : « je suis rempli de la plus grande consolation en apprenant les succès de nos Jésuites de Naples et de Sicile », dit le P. Rossignol en juin 1805112. Le P. Barruel encourage la publication des lettres édifiantes des nouvelles missions de Russie qui fera connaître « l’état où nos frères ont [développé] l’éducation dans les différentes provinces où ils sont établis ». Par ailleurs, il témoigne de son intérêt pour « ceux qu’[il a] toujours regardés comme [ses] frères » et demande au P. Angiolini de s’excuser auprès de ceux qu’ils nomment « nos Révérends Pères » du retard qu’il prend à rejoindre les jésuites de Naples113. De manière plus générale, c’est une famille et une fraternité religieuses que l’on décrit : « j’étais toujours chez moi, étant chez les jésuites », explique Rossignol, « partout où j’arrivais j’étais regardé comme étant de la maison », et il poursuit, « ce sont de ces fraternités qui ne sauraient donner des ombrages aux souverains, et qui ne peuvent qu’exciter leur
109 AFSI, série H Ba 52 d) Barruel – correspondance, « Lettre au P. Angelini [sic], Paris, 12 août 1805 » et « Lettre au P. Général, Paris, 23 octobre 1816 ». 110 Histoire des œuvres de M. Rossignol… op. cit., p. 44-45. 111 « Prophéties sur la France proposées à l’examen des personnes sensées », dans Rossignol, Pièces fugitives… op. cit., p. 40. 112 « Lettre à Monseigneur le Cardinal de Pietro, Turin, 3 juin 1805 », dans Rossignol, Lettres… op. cit., p. 167. 113 AFSI, série H Ba 52 d) Barruel – correspondance, « Lettre au P. Angelini [sic], Paris, 12 août 1805 ».
Europa Moderna n°3 / 2012
119
admiration »114. Faisant ses adieux au P. Strickland, avant de partir d’Angleterre, Barruel remercie tendrement son ami : « chez vous j’ai retrouvé tout ce que la fraternité religieuse a tout à la fois de plus constant et de plus édifiant »115. Les lettres et les récits de Rossignol et de Barruel dessinent enfin des liens et des réseaux d’amitiés. Le P. Rossignol invoque régulièrement les noms et rappelle le souvenir de ses anciens compagnons et amis ; nous savons ainsi que le P. Barruel, son « ami intime », fut également son « ancien compagnon d’exil en Allemagne »116. Après avoir trouvé refuge auprès du P. Strickland en Angleterre, le P. Barruel, lui, retrouve trois de ses « anciens frères », à Amsterdam, dans la maison du P. Beckers117. Bien que nous ne fassions que les évoquer ici, la problématique des réseaux construits et entretenus pendant la suppression par les anciens jésuites, comme celle de la survivance d’une éventuelle « identité relationnelle », sont parmi les plus passionnantes soulevées par la recherche sur la suppression. La question de la survie d’une « identité jésuite » nous amène enfin à nous interroger sur les signes tangibles de l’appartenance à la Compagnie de Jésus et les raisons qui conduisent certains anciens jésuites à affirmer leur fidélité envers leur première vocation : sur quoi la font-ils reposer ? Quels principes et quelles pratiques relèvent d’une « manière jésuite de procéder » chez ces « membres épars », éloignés de la Compagnie de Russie ? Aux yeux d’Augustin Barruel, le lien effectif avec la Compagnie n’a pas été entièrement rompu par le bref de suppression et il tient à rappeler au P. Angiolini en 1805 l’importance et la validité de ses vœux, n’étant en 1773 ni novice ni scolastique non ordonné :
« Permettez-moi de vous dire, mon Révérend père, que je ne me suis jamais regardé comme étranger à mon ancien état. Quoique mon âge, lors de la fameuse bulle, ne m’eût pas permis encore les vœux de profès, il y avait plus de quinze ans que j’étais dans la compagnie. Ainsi à la teneur de la bulle, mes vœux ne sont pas dissous ; puisque Clément XIV ne prononçait cette dissolution que pour les écoliers qui n’avaient passé que deux ans dans la compagnie. Oui je crois toujours tenir à mes anciens frères ; et ce titre me devient chaque jour plus précieux »118.
Lorsque Barruel demande sa réadmission dans la Compagnie de Jésus en 1815, ce problème essentiel du statut canonique des anciens jésuites reparaît dans un échange de lettres avec le P. Général. Le P. Brzozowski lui demande de faire une année de noviciat avant d’être admis à la profession des quatre vœux, conformément, dit-il, à la coutume adoptée en Russie-Blanche et d’après le Concile de Trente, mais le P. Barruel lui explique qu’étant resté jésuite il espérait être admis dans son degré et non « replacé », bien qu’avec une « parfaite soumission » de sa part, au rang des novices : « je m’étais toujours regardé comme lié par mes vœux, sans cesser d’être vraiment jésuite », explique-t-il. De plus, il ne croit pas que ce soit dans l’esprit du Concile de Trente « d’éprouver l’amour d’un enfant qui accourt se jeter dans les bras d’une mère qu’il a le bonheur de voir ressuscitée » et ainsi – cela mérite d’être souligné – d’user de même envers lui qu’envers « celui qui n’a jamais connu la Société religieuse dans laquelle il demande d’entrer »119. Reconnaissant la justesse de l’objection, le P. Général l’admet à la profession, le 15 août 1816. De même qu’en 1805 dans sa lettre à Angiolini, le P. Barruel souligne alors l’importance des vœux qu’il avait prononcés en tant que scolastique et qui l’engageaient, par la promesse d’entrer dans la Compagnie, sur la voie de l’incorporation. Il remercie
114 « Lettre de Cracovie, 1761 », dans Lettres sur la Pologne par M. l’abbé Rossignol de Vallouise, Turin, Chez Ignace Soffietti, 1804 ; ce recueil de lettres a été reconstitué de mémoire dans les années 1800 par le P. Rossignol, d’après son journal écrit lors de son séjour en Pologne et brûlé à la Révolution. 115 Lettre au P. Strickland du 5 septembre 1802 dans Abel Dechêne, Lettres inédites… op. cit., p. 7. 116 Histoire des œuvres de M. Rossignol… op. cit., p. 13 et « Lettre à Monseigneur Marotti secrétaire du pape, Turin, 28 mai 1800 », dans Rossignol, Lettres… op. cit., p. 125. 117 « À William Strickland, Amsterdam, 19 juin 1806 », dans Abel Dechêne, Lettres inédites… op. cit., p. 36-37. 118 AFSI, série H Ba 52 d) Barruel – correspondance, « Lettre au P. Angelini [sic], Paris, 12 août 1805 ». Le bref Dominus ac Redemptor renvoyait « tout de suite, sur-le-champ, immédiatement et effectivement » les novices et déliait de leurs vœux « les membres de cette Société qui n'ont fait que des vœux simples et qui ne sont point encore entrés dans les Ordres sacrés », Léon Mention, op. cit., pp. 250-251. 119 « Lettre du P. Barruel au P. Brzozowski, 8 janvier 1816 », citée par Joseph Burnichon, op. cit., p. 74.
Europa Moderna n°3 / 2012
120
le P. Général de ce « jour heureux » où il lui a été permis de faire sa profession ; « la promesse que j’en avais faite avec nos premiers vœux » précise-t-il, « me tenait trop à cœur, et grâce éternelles en soient rendues à Dieu, me voilà enfin irrévocablement lié à cette sainte Compagnie »120. Le P. Général peut alors en 1817 se féliciter de voir dans le P. Barruel un de ces « précieux restes », un de ces « anciens modèles » de la « Compagnie renaissante », « propres à exciter l’émulation, à enflammer le zèle de la nouvelle génération ». Mais il reconnaît surtout que le jésuite a su conserver une part de ce qui le liait à la Compagnie de Jésus même éteinte, une part de ce qu’il était au sein de celle-ci : « vous n’avez jamais cessé de lui appartenir par les sentiments de votre cœur», affirme-t-il, « après l’avoir constamment honorée par vos talents et vos utiles travaux »121.
Faisant ainsi référence aux talents de polémiste du P. Barruel, cette dernière remarque nous rappelle que, parallèlement aux témoignages de fidélité exprimés par les anciens jésuites, le sentiment d’appartenance envers la Compagnie de Jésus se concrétise aussi par ces « utiles travaux », qui furent envisagés par certains non pas dans une totale indifférence avec leur ancien état mais dans la continuité avec certaines des missions de la Compagnie. Recherchant, comme la majorité de leurs confrères, une situation et un moyen de subsistance, les PP. Barruel et Rossignol sont toutefois amenés à poursuivre les activités traditionnelles de l’Ordre de saint Ignace, à commencer par l’éducation. Après avoir été jusqu’en 1777 précepteur des enfants de François-Xavier de Saxe dans le cas de Barruel et avoir participé, pendant les mêmes années, à la réforme des études du collège d’Embrun pour Rossignol, les deux anciens jésuites se consacrent à leurs activités littéraires et apologétiques. Le témoignage détaillé du P. Rossignol, sur lequel nous nous appuyons principalement, et dans lequel sont expliqués sa démarche et les orientations prises par ses travaux littéraires, se révèle très précieux et nous renseigne tout autant sur la signification qu’il donne à certaines de ses activités intellectuelles que sur la compréhension de son engagement au sein de la Compagnie de Jésus.
La poursuite des travaux littéraires est tout d’abord perçue par les deux anciens jésuites
comme un besoin, un devoir. Le P. Barruel explique à son père, alors qu’il demeure à Paris pendant les événements révolutionnaires, les raisons qui le conduisent à persévérer dans ses activités : « la Providence m’attache ici par un travail qu’il me serait impossible de suivre ailleurs et duquel dépend tout le bien que je fais peut-être aux autres, […] en travaillant au moins conformément à mon état. Tant que la Providence me ménagera cette ressource, je m’y attacherai comme à mon devoir », ajoute-t-il122. « Mes occupations littéraires étaient devenues un besoin pour moi », affirme quant à lui le P. Rossignol. Ses travaux demeurent pour lui cohérents et inchangés depuis bientôt soixante ans, c’est-à-dire depuis son entrée dans la Compagnie de Jésus en 1742, soixante années consacrées, dit-il, « à se rendre utile, à procurer les progrès des sciences et des arts, et à former la jeunesse aux lettres et à la vertu »123. Si la rupture de la suppression semble parfois contredite par l’affirmation répétée d’une certaine permanence, que ce soit de sa qualité de jésuite ou de la finalité de ses travaux, elle est du moins vécue, par le P. Rossignol, comme un temps d’attente, un moment transitoire dont l’horizon est le rétablissement de la Compagnie de Jésus. Ainsi répète-t-il dans plusieurs de ses lettres son espérance et sa certitude de voir la Compagnie restaurée ; c’est cette perspective qui a guidé son travail : « Je n’ai jamais douté du rétablissement de la religion et de notre Compagnie en France. J’ai réglé invariablement mes travaux sur cette intime persuasion. J’ai mis à profit le loisir que la Providence m’a ménagé ; j’ai publié un grand nombre d’ouvrages, qui seront suivis de plusieurs autres ». Puis il poursuit, décrivant à son ancien confrère les deux grands domaines auxquels il s’est attaché : « un de mes grands objets est le perfectionnement des études de Collèges. Mais ce à quoi je m’applique plus particulièrement, c’est de faire ressortir l’accord admirable de la vraie Philosophie et 120 AFSI, série H Ba 52 d) Barruel – correspondance, « Lettre au P. Brzozowski, Paris, 23 octobre 1816 [copie] ». Ceux qui sont reçus en tant que scolastiques, outre les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, promettent également d’entrer dans la Compagnie en tant que profès ou coadjuteur formé pour le reste de leurs jours [Const. 5403]. 121 « Lettre du P. Brzozowski au P. Barruel, 13 avril 1817 », citée par Joseph Burnichon, op. cit., p. 76. 122 AFSI, série H Ba 52 a) 7, n°59, Barruel – correspondance, « Lettre de Barruel à son père, Paris, 29 novembre 1789 ». 123 Histoire des œuvres de M. Rossignol… op. cit., p. 36 ; « Lettre à M. L. C. Salmatoris, Turin, 1er janvier 1804 », dans Rossignol, Lettres… op. cit., p. 29.
Europa Moderna n°3 / 2012
121
de la Révélation »124. Alors que l’on s’occupe en 1804 et 1805 de l’ouverture et de l’organisation de nouvelles maisons à Naples, le P. Angiolini assure au P. Rossignol la diffusion de ses manuels d’arithmétique ou de trigonométrie, composés dans les années 1770 et 1780 et dont l’usage final était avant tout destiné aux futurs collèges de la Compagnie : « je remettrai vos traités élémentaires pour nos collèges, au Père Cavina excellent mathématicien », affirme donc Angiolini, après avoir expliqué qu’il enverrait également au P. Général à Saint-Pétersbourg la collection des œuvres de Rossignol125. Outre l’amélioration de l’enseignement, Jean-Joseph Rossignol témoigne de son obstination dans la lutte contre la philosophie et la défense du christianisme et explicite régulièrement sa démarche. Ses principes et sa conduite « ont naturellement droit de trouver place dans l’Histoire de [ses] Œuvres », car « il est bon […] que les Sophistes me connaissent pour ce que je suis », poursuit-il ; « si quelque nouveau Philistin entreprend de se mesurer à moi, il me trouvera avec ma fronde. Il verra et sentira ce que je puis, et l’avantage que me donne sur lui l’auguste cause que je défends »126. Ses travaux ont « principalement pour objet la défense de la Religion contre les attaques des soi-disant philosophes » et c’est pourquoi il aime à se rapprocher de son ancien confrère le P. Barruel, avec lequel il est uni non seulement par les liens de l’amitié mais aussi par la cause qu’ils défendent tous deux. Même s’il a entrepris « depuis longtemps de fournir une carrière très différente » de l’auteur des Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, il « tend au même but », selon lui ; il se propose ainsi « d’écraser les sophistes modernes par une autre voie », c’est-à-dire par les sciences naturelles essentiellement127. C’est d’ailleurs ce qui l’amène à confier au cardinal de Pietro ses inquiétudes concernant la formation de ses confrères à Naples ; le P. Rossignol montre à cette occasion sa capacité à adapter les principes éducatifs de la Compagnie en vue de poursuivre au mieux l’une de ses principales missions :
« Nous n’avons plus rien à démêler avec les disciples de Luther, Calvin et Jansénius. Tout ce qu’on pouvait dire à cet égard, a été dit. Notre grande querelle est actuellement avec les philosophes du jour. Ces hommes ont des connaissances étendues sur les sciences naturelles ; et c’est par où ils attaquent principalement la religion. C’est ce qui m’a engagé à insister fortement dans mes œuvres, sur l’accord de la vraie philosophie et de la révélation. Mais ce genre d’escrime exige qu’on soit parfaitement au fait de tous les points de sciences naturelles qui ont quelque rapport avec la religion. Je crains bien que nos jésuites ne montent pas leurs études sur le ton qu’exigent les besoins de l’Église, dans les temps où nous sommes ».
Fort de son expérience dans les collèges jésuites de Vilnius, de Milan et enfin au collège d’Embrun, dans lesquels il fut, dit-il, « chargé de la réforme des études », le P. Rossignol espère ainsi combattre « l’empire des vieilles habitudes » en proposant l’usage de ses nombreux manuels qui « pourraient être fort utiles dans nos collèges », assure-t-il128. Le témoignage laissé par Jean-Joseph Rossignol, remarquable à plus d’un titre, nous est précieux enfin par un dernier aspect. Il atteste, quoique brièvement, d’une dimension plus ordinaire mais aussi plus intime de l’identité jésuite pendant la suppression, et donc peu évoquée par les anciens membres de la Compagnie, celle d’une éventuelle conservation des règles de vie de la Compagnie de Jésus et la poursuite des pratiques dévotionnelles liées à la tradition spirituelle jésuite. Le P. Rossignol écrit en 1800 à son confrère le P. Andrès, alors bibliothécaire à Parme, et auprès duquel il espère être accueilli dans l’éventualité du retour de la Compagnie dans le duché : « Je n’ai jamais douté du futur 124 « Lettre à Monseigneur Marotti secrétaire du pape, Turin, 12 avril 1800 », dans Rossignol, Lettres… op.cit., pp. 123-124. 125 « Lettre du père Angliolini [sic] jésuite, Naples, le 26 janvier 1805 », dans le recueil de lettre des Pièces fugitives…op. cit., p. 43. 126 Histoire des œuvres de M. Rossignol… op. cit., p. 27. 127 « Lettre au cardinal Borgia, Turin, 13 décembre 1804 » et « Lettre à Monseigneur Marotti secrétaire du pape, Turin, 28 mai 1800 », dans Rossignol, Lettres… op.cit., pp. 44-45 et p. 126. 128 « Lettre à Monseigneur le cardinal de Pietro, Turin, 3 juin 1805 », dans Rossignol, Lettres… op.cit., pp. 167-169.
Europa Moderna n°3 / 2012
122
rétablissement de notre Compagnie, dont je me suis étudié à conserver l’esprit ». Il précise ensuite l’endroit où il était et la fonction qu’il occupait lors du bref de suppression : « j’enseignais la philosophie et les mathématiques au collège des Nobles de Milan en 1773 », pour atténuer aussitôt la portée de cette rupture en affirmant : « Depuis ce temps-là j’ai fait constamment mes exercices spirituels à l’ordinaire, l’oraison, les examens, la retraite chaque année, etc. »129. Parallèlement à ses travaux littéraires dont il fait auparavant le résumé, la poursuite et la conservation des exercices de piété quotidiens pratiqués au sein de la Compagnie sont pour Rossignol autant de preuves de fidélité, voire de symboles, portés à la connaissance de son confrère qui en connaît la signification. Les deux cas sur lesquels nous avons choisi de nous attarder ici ne peuvent bien sûr avoir valeur d’exemple pour l’ensemble des jésuites ayant vécu la suppression. S’ils appartiennent à cette poignée de jésuites français encore en vie dans les années 1800, les PP. Barruel et Rossignol se singularisent aussi par leur attachement explicite envers leur ancien ordre mais également envers la Compagnie de Jésus de Russie et par leur disposition à y être réadmis. Néanmoins, ce n’est pas tant le fait que l’on puisse les qualifier rétrospectivement de jésuites « survivants » ou « persévérants » qui nous intéresse ici, mais bien la conception consciente et affective qu’ils ont d’eux-mêmes et qui se construit au fil du discours. Nous n’ignorons pas la part importante prise par le contexte et les destinataires dans l’élaboration de cet « énoncé identitaire »130. Ces circonstances permettent surtout aux PP. Barruel et Rossignol de formuler et de définir, selon une perspective individuelle, le sens de l’« identité jésuite » et les moyens de sa conservation en dépit d’une institution lointaine. L’« identité jésuite » doit, semble-t-il, se comprendre tout d’abord au sens premier du terme. Pour les deux anciens jésuites, il s’agit d’affirmer qu’ils se sentent et continuent d’être, par certains côtés, identiques à ce qu’ils avaient été au sein de la Compagnie de Jésus, semblables par leurs sentiments et leurs pratiques – ce qui, dans le cas de Rossignol notamment, peut aussi supposer une adaptation et un certain renouvellement –, semblables enfin par leur existence même. Le P. Barruel, conformément aux vœux qu’il a prononcés, n’a pas cessé, selon ses termes, « d’être vraiment jésuite », de même que son confrère le P. Clorivière estime, après 1773, pouvoir se considérer comme « existant »131. Barruel demande alors sa réadmission comme si le temps, de même que sa progression au sein de la Compagnie, étaient demeurés en suspens et devaient ainsi reprendre normalement. Mais au-delà de l’individu, les propos des PP. Barruel et Rossignol nous ramènent inévitablement vers la Compagnie de Jésus et vers la communauté formée par leurs compagnons, sans lesquels l’« identité jésuite » n’est finalement que fragmentaire et incomplète, voire illusoire. Ils nous montrent l’importance de l’expérience communautaire, le dialogue entre le groupe et l’individu amenés tous deux à former un corps, principes qui résultent avant tout, pour les deux anciens jésuites, d’un sentiment d’appartenance exclusive allant bien au-delà d’un simple sentiment d’affinité. C’est, semble-t-il, ce qui distingue les PP. Barruel et Rossignol d’autres jésuites français qui ont conservé, pour certains, un attachement, une sympathie envers leur ancien ordre et qui continuent les activités caractéristiques de la Compagnie sans pour autant demander leur réadmission après 1814132. Epilogue Nous voudrions, en conclusion, aborder brièvement un troisième niveau d’analyse possible qui concerne cette dimension communautaire de l’« identité jésuite » et qui relèverait de la question de la 129 « Lettre à M. l’abbé Andrès de Parme, Turin, 17 septembre 1800 », dans Rossignol, Lettres… op. cit., p. 35-36. 130 « Non seulement le choix de l’identité qu’on affiche dépend de la circonstance dans laquelle on se trouve, de l’interlocuteur auquel on s’adresse, mais aussi l’énoncé identitaire varie selon qu’il est accueilli avec sympathie ou avec hostilité », Jean-François Bayart, L’illusion identitaire… op. cit., p. 116. 131 Le bref de suppression n’étant pas promulgué en France car les jésuites étaient déjà supprimés par les parlements, Clorivière en vient à cette affirmation dans une lettre adressée en 1814 à un de ses confrères, alors qu’il était en 1773, comme Barruel, en exil et donc soumis au bref ; voir Burnichon, op. cit., p. 56. 132 C’est par exemple le cas de Jean-Baptiste Grosier (1743-1823) qui publie notamment en 1790 les Mémoires d’une société célèbre, compilation d’articles remarquables des Mémoires de Trévoux dans laquelle il exprime tout son attachement pour la Compagnie supprimée. Bibliothécaire de l’arsenal après 1814, il n’est pas réuni à la Compagnie lors de sa restauration.
Europa Moderna n°3 / 2012
123
« mémoire collective » et de sa transmission. Un travail spécifique sur le destin du théâtre chez les jésuites français pendant la suppression nous a conduits notamment à réfléchir de façon plus approfondie à l’articulation entre un héritage commun, conservé et transmis par les anciens jésuites – cela ne supposant pas, selon nous, qu’il y ait chez chacun d’entre eux un fort attachement à l’ancienne Compagnie –, et un héritage reçu et choisi par ceux qui formeront la Compagnie de Jésus au XIXe siècle. En tant que tradition culturelle qui a contribué à former l’image de la Compagnie de Jésus depuis ses origines, le théâtre est, selon les termes de Paolo Bianchini, un « indicateur valable » pour saisir les modalités d’un passage de l’« ancienne » à la « nouvelle » Compagnie133.
La survie de la pratique et de la culture dramatiques chez les anciens jésuites est une survie fragile et modeste qui reste principalement attachée, comme ce fut le cas avant 1762, à l’apostolat éducatif et, dans une moindre mesure, au domaine des périodiques, deux des principales activités privilégiées pendant la suppression. Quelques rares exemples de pièces de théâtre écrites et représentées en France avant 1789, notamment dans des couvents féminins134, attestent d’un savoir-faire et d’une pratique qui certes ne se manifestent qu’occasionnellement mais qui, malgré la fermeture des collèges de la Compagnie, n’ont pas été entièrement abandonnés par certains anciens jésuites. C’est également dans les divers ouvrages destinés à la jeunesse, tels que les traités de morale, les manuels d’éducation ou les compilations et collection littéraires, que les anciens jésuites gardent en mémoire une connaissance théorique et un ensemble de modèles communs issus d’une culture classique enseignée auparavant dans les collèges. Que ce soit dans ces ouvrages de pédagogie ou dans ceux consacrés plus généralement aux belles-lettres ou encore par quelques rééditions, certains témoignent enfin d’une volonté claire de rappeler le souvenir du glorieux passé théâtral de la Compagnie de Jésus, auquel ils ont parfois contribué. S’y dessine alors un panthéon littéraire parmi lequel on célèbre par exemple l’illustre P. Porée (1676-1741) dont la mémoire reste associée au prestigieux collège Louis-le-Grand et au discours qu’il y prononça en 1733, type même de l’argumentaire jésuite pour la défense du théâtre et de son rôle pédagogique135. Un glissement, dont les raisons ne doivent pas être uniquement rapportées aux circonstances particulières de la suppression et des événements révolutionnaires, semble néanmoins se concrétiser dans les petits séminaires des Pères de la Foi en France. La tradition des exercices publics et de la distribution des prix en fin d’année scolaire y est certes maintenue mais les représentations théâtrales qui suivent d’ordinaire ces manifestations sont interdites. Une place sensiblement différente est ainsi assignée au théâtre que l’on continue néanmoins d’aborder pour l’enseignement de la rhétorique par exemple. Si le rétablissement progressif de la Compagnie de Jésus en France voit notamment une 133 L’historiographie sur le théâtre jésuite, renouvelée depuis une vingtaine d’années, s’attache néanmoins presque exclusivement à la pratique théâtrale. Dans un ouvrage privilégiant principalement cette dimension spectaculaire, Anne Piéjus souligne pourtant la nécessité de replacer le théâtre de collège dans les institutions pédagogiques où il a vu le jour (Anne Piéjus (dir.) Plaire et instruire : le spectacle dans les collèges de l’Ancien Régime, Rennes, PUR, 2007, p. 12). Les travaux de Marc Fumaroli (L’Âge de l’éloquence : rhétorique et « res literaria », de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Genève, Droz, 1980), de François de Dainville (L’éducation des jésuites, Paris, Editions de Minuit, 1978), de Jean-Marie Valentin (Les jésuites et le théâtre (1554-1680) : contribution à l’histoire culturelle du monde catholique dans le Saint-Empire romain germanique, Paris, Desjonquères, 2001) et d’Edith Flamarion (édition présentée et annotée de Charles Porée, De Theatro, discours sur les spectacles, Paris, H. Champion, 2000), nous invitent à envisager la réalité théâtrale jésuite dans sa globalité, là où l’enseignement de la rhétorique, la conception de l’art dramatique, la culture de la scène française et étrangère et le discours militant sur les spectacles marchent de concert avec la pratique théâtrale. Enfin, soulignons le manque d’études spécifiques sur le répertoire français du XVIIIe siècle, envisagé trop souvent dans la prolongation de celui XVIIe siècle. 134 Le P. Clorivière, en 1779, célèbre par exemple le carmel de Saint-Denis et son illustre prieure, Madame Louise de France, dans un drame pastoral intitulé Zénobie. Quant à son confrère Jean-Baptiste Fouet de la Fontaine (1739-1821), qui se réunira lui aussi à la Compagnie après 1814, il compose pour les pensionnaires du monastère des bénédictines de Montargis la pièce sainte Les vertus à la crèche. 135 Voir notamment l’ouvrage du P. Duparc (1702-1789) intitulé Nouveau recueil de plaidoyers françois, auxquels on a joint plusieurs recherches très-utiles aux jeunes élèves de l’éloquence, Par M. l’Abbé Lenoir du Parc, J. ancien professeur de rhétorique au Collège Louis-le-Grand, Paris, Veuve Thiboust, 1786, destiné plus particulièrement à un jeune ecclésiastique chargé de professer la rhétorique en province.
Europa Moderna n°3 / 2012
124
reprise précaire et contestée des représentations théâtrales, à partir des années 1820, dans certains des petits séminaires jésuites, l’ampleur, la régularité et l’éclat qui faisaient de ces spectacles de vraies manifestations mondaines sont désormais relégués au passé de la Compagnie de Jésus. Nous souhaitions, par ce bref aperçu, souligner une des problématiques majeures que soulève le vaste chantier de la recherche sur la suppression de la Compagnie de Jésus, dont nous avons tenté ici de tracer quelques lignes principales. Si l’usage commun a retenu les termes d’« ancienne » et de « nouvelle » Compagnie, séparant en deux entités distinctes deux périodes ainsi marquées par les stigmates de la suppression, ce n’est pas sans susciter de nombreux questionnements et des remises en causes, qui ont toutefois le mérite de nous conduire au cœur même du problème de la suppression et de la restauration des jésuites. C’est en effet sur la base de l’« identité », de l’unité et de la continuité que la Compagnie entendait être restaurée et que les PP. Barruel et Rossignol, nous l’avons vu, semblaient envisager leur retour dans la Compagnie de Jésus. La problématique du théâtre nous laisse néanmoins entrevoir la réalité d’un « nouveau langage », celle où la suppression demeure un lieu de discontinuité, celle où le retour à l’ordre et la « restauration » sur le même pied n’est finalement qu’une illusion136. Car il est question, dans les années 1820, non plus seulement d’une survie d’un passé illustre mais d’un choix et ainsi d’une recomposition d’un présent théâtral, sans doute déjà en œuvre dans les années 1800 et dont il nous reste à définir les modalités. Nous touchons ici, semble-t-il, aux « variantes » d’une même « structure d’identification »137, qui suppose que la Compagnie et son « identité » soient à la fois « une et diverse » dans l’espace et dans le temps et qui nous conduit ainsi à envisager une « nouvelle » Compagnie qui soit, comme l’expliquait l’historien jésuite Joseph Brunichon en 1914, « une personne morale distincte de l’ancienne qui a cessé d’être, une seconde Société de Jésus, réplique fidèle de la première, mais ne se confondant pas avec elle »138.
Anne-Sophie GALLO Doctorante en Histoire moderne de l’Université Grenoble II - CRHIPA
136 Michel de Certeau nous explique, à propos du christianisme : « Les chrétiens qui voulaient ainsi « restaurer » l’esprit n’en créaient pas moins de nouvelles formes d’expression ; fût-ce sur le mode d’un « retour aux sources », ils se distanciaient de leurs prédécesseurs immédiats et ils produisaient un autre langage », Michel de Certeau, La faiblesse de croire… op. cit., p. 217. 137 Michel de Certeau, La faiblesse de croire, op. cit., p. 217. 138 Voir la transcription faite par Robert Danieluk d’un manuscrit non publié de Burnichon dans « La reprise d’une mémoire brisée : l’historiographie de la « nouvelle » Compagnie de Jésus », Archivum Historicum Societatis Iesu, n°150, 2007, p. 271.