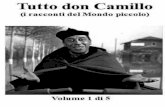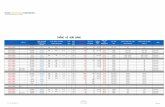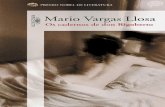shri vile parle kelvani mandal's mithibai college of arts ...
JÉSUS PARLE À DON CAMILLO Analyse praxéologique des manifestations divines dans Le Petit Monde de...
Transcript of JÉSUS PARLE À DON CAMILLO Analyse praxéologique des manifestations divines dans Le Petit Monde de...
JÉSUS PARLE À DON CAMILLOAnalyse praxéologique des manifestations divines dans Le Petit Monde de Don CamilloJean-Noël Ferrié La Découverte | Réseaux 2013/4 - n° 180pages 13 à 38
ISSN 0751-7971
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-reseaux-2013-4-page-13.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ferrié Jean-Noël, « Jésus parle à Don Camillo » Analyse praxéologique des manifestations divines dans Le Petit
Monde de Don Camillo,
Réseaux, 2013/4 n° 180, p. 13-38. DOI : 10.3917/res.180.0011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour La Découverte.
© La Découverte. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
DOSSIER
Varia
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
JÉSUS PARLE À DON CAMILLO
Analyse praxéologique des manifestations divines dans Le Petit Monde de Don Camillo
Jean-Noël FERRIÉ
DOI: 10.3917/res.180.0013
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
A vec une étonnante constance, les différentes théorisations portant sur le fait religieux se sont obstinées à considérer celui-ci comme un phénomène homogène, structurant en profondeur la société. Elles
se sont attachées à ne parler que de « grandes choses ». Ainsi se sont-elles peu intéressées à la relation familière que les humains pouvaient entretenir avec les êtres divins. Ce faisant, on les a, en quelque sorte, perdues de vue, puisqu’on en est arrivé à les redéfinir comme autre chose. On les considère, en effet, comme des représentations, ce qui implique qu’on les prive de la per-sonnification qui les caractérise, par ailleurs, aussi bien pour les croyants que pour la plupart des non-croyants. Dieu n’est plus alors une personne (même d’un genre particulier) mais, dans la suite de la vulgate durkheimienne (dont Durkheim n’est pas forcément responsable), une métaphore de la société. Pourtant, il paraît difficile de comprendre la place qu’il occupe dans les affaires humaines, si l’on ne tient pas compte du fait qu’il est aussi – et, à vrai dire, surtout – conçu comme un être à part entière par la plupart des gens qui s’y réfèrent. Cette perception est au cœur de son insertion dans les sociétés humaines. On ne peut faire sans, mais on doit pouvoir la considérer sans être tenu de prendre position sur le fond des choses, en d’autres termes sans devoir se préoccuper de l’existence même de l’entité divine ou, ce qui est une autre manière d’en parler, du bien-fondé du « croire » dont elle est l’objet. En effet, la question de l’existence de Dieu est une question métaphysique qui ne peut être tranchée dans tous les mondes possibles. Une fois que l’on a dit qu’il n’existait pas, il n’en reste pas moins présent dans la vie de tout un chacun, dans des images, des conversations, des œuvres, des non-fictions… Cette pré-sence, au moins comme entité fictive, demeure. Bref, Dieu est ou un être (et, bien sûr, pas n’importe lequel des êtres) ou, a minima, une entité incomplète (suivant la terminologie de Meinong). Il n’est pas tout simplement rien. Dès lors, le problème se pose de la façon de rendre compte de cette présence, en respectant son épaisseur phénoménologique. Je crois qu’une solution pos-sible consiste à adopter un point de vue d’« indifférence ontologique », qui implique de seulement tenir compte de son étancité, c’est-à-dire ce par quoi elle se manifeste, son mode d’être (Chauvier, 2006) et son insertion dans des dispositifs tangibles.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
16 Réseaux n° 180/2013
L’étancité du divin constitue donc un fondement robuste pour l’investigation, parce qu’elle ne peut être mise en doute, de quelque manière que l’on s’y prenne. En d’autres termes, les entités divines, dans l’étendue de leur étancité, font partie des connaissances routinières partagées de membres normalement compétents de la société, où elles se manifestent. On sait des choses sur Dieu comme on sait des choses sur les divinités romaines, sur le système solaire, sur les relations entre amis, sur l’amour ou sur l’effet des saisons sur le feuil-lage des arbres. Ces savoirs sont positifs. Il s’ensuit que les caractéristiques de Dieu et les relations qu’elles permettent ou ne permettent pas de nouer avec lui sont posées de manière indépendante du point de vue que l’on adopte sur son existence. C’est ainsi que, même quand j’affirme : « Dieu n’existe pas », je ne fais finalement rien d’autre que dire : « Dieu n’existe pas au-delà des jeux de langage dans lesquels il est inséré » ; et je ne fais pas que Dieu ne soit pas présent en tant qu’usage du mot « Dieu ». Ainsi, dès lors que Dieu est considéré depuis l’évidence communément accessible de son étancité, il devient possible de séparer le fait de travailler sur la relation que les hommes entretiennent avec lui du fait de travailler sur les croyances, leur justification, leurs modalités et leur intensité ; et, pareillement, croire en Dieu ou ne pas y croire n’entraîne pas sa disparition de la liste des « étants » présents dans le monde de la vie quotidienne. C’est ainsi qu’un membre ordinaire de la société pourrait nous parler de Dieu, quand bien même penserait-il qu’il ne s’agit que d’une fable. Il est, en somme, possible de concevoir Dieu d’une certaine manière, même si je ne crois pas, comme je peux concevoir à quoi ressemble un personnage de roman, même si je sais que je ne le croiserai pas au coin de la rue ; et, dès lors que je conçois Dieu d’une certaine manière – c’est-à-dire en m’appuyant sur des schèmes d’intelligibilité publiquement partagés –, j’établis avec lui des relations plus ou moins stables et plus ou moins profondes. Dit autrement : Dieu est un fait de culture avant même que d’être un fait de croyance, c’est-à-dire que, comme tous les faits de culture, il jouit d’une existence publique (son étancité) qui le place dans des jeux de perspective réciproque. J’entends par là que l’on peut parler de Dieu en s’ap-puyant sur le fait que ce que l’on en dit alors est connu par la plupart des gens, de sorte que nos propos ou ce que l’on fait à partir d’eux n’a pas besoin d’être justifié ni même entièrement accompli pour être reconnu et compris. En d’autres termes, Dieu relève de dispositifs de communication ordinaires. Il en découle que l’investigation des dispositifs le manifestant ne doit pas nécessai-rement être entendue comme l’investigation de dispositifs spécialisés tels que les récits de miracles ou d’apparitions mariales (par ex. Claverie, 2003). Dieu est, au contraire, en tant du moins qu’il est un élément de la culture de tout un chacun, présent, dans l’ordinaire de la vie.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
Jésus parle à Don Camillo 17
Si l’on se situe dans cette perspective, s’intéresser à la caractérisation de Jésus dans Le Petit Monde de Don Camillo (1951) ne devrait pas apparaître comme un choix inapproprié. Il s’agit de la description d’un dispositif parmi d’autres ; un dispositif qui capte l’attention des gens, indépendamment du fait qu’ils soient croyants ou pas. Un film, notamment s’il est « commercial », cherche, en effet, à s’inscrire dans un jeu de perspectives réciproques et parta-gées. Au cinéma, nous ne nous demandons pas si nos voisins voient la même chose que nous ; nous pensons spontanément que c’est le cas. Cette évidence des cours d’action et des significations est produite de manière continue par nos activités comme par le script des activités des êtres de fiction dans les films ; en effet, dans la mesure où leurs actions doivent aller de soi, elles sont effectuées aussi bien en fonction de la ligne narrative du film qu’en regard des « attentes naturelles » des spectateurs (ce qui, du reste, caractérise aussi la ligne narrative). Pendant des décennies, une porte se refermant sur un couple, la nuit, indiquait une relation sexuelle. De même, on ne nous explique jamais, dans un film de cape et d’épée, que le héros est courageux, cela va de soi dès la première séquence, comme il va de soi qu’il est fin escrimeur. Ce qui n’est pas montré à l’écran est donc parfaitement connu des spectateurs ; pour eux, c’est tout simplement une évidence. Le savoir préalable, d’arrière-plan, sur lequel se fonde la possibilité même de suivre et d’apprécier un film est ainsi un phénomène culturel au sens de Sacks (2005, p. 226), c’est-à-dire la production d’actions ou de significations reconnaissables par les membres (Jayyusi, 1988).
Il en découle que les manifestations de Dieu dans une fiction cinématogra-phique s’inscrivent naturellement à l’intérieur d’un ordre des choses commu-nément admissibles à son propos et nous les donnent explicitement à connaître. Il va de soi que nous n’accédons pas pour autant à un savoir global sur Dieu et encore moins sur le religieux. Cela ne provient pas d’un biais particulier de l’investigation choisie mais de la nature même de l’étancité de Dieu et de ce qu’est le religieux. Si Dieu est phénoménologiquement un ensemble d’usages du mot « Dieu », il est évident que l’on ne peut faire mieux que décrire la grammaire de ses usages ainsi que les configurations en « air de famille » qui en résultent. Il en va de même en ce qui concerne le religieux : les usages de la référence religieuse sont si nombreux et à ce point insérés dans des activi-tés diversifiées qu’il paraît impossible de les réunir en une formule univer-selle. Avec l’analyse praxéologique des manifestations de Dieu dans Le Petit Monde de Don Camillo, nous n’accédons pas à tout ce qu’il peut en être de Dieu et donc encore moins à un résumé de ce que Dieu peut être pour les
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
18 Réseaux n° 180/2013
hommes en général. Pour tout dire, nous n’y accéderions pas davantage si nous interrogions ce qu’il peut en être de lui à partir des romans de Bernanos ou des sermons de Bossuet, de la théologie de Tillich ou du point de vue d’un prêtre ordinaire. Nous accéderions à des usages s’inscrivant parmi d’autres usages dans une série de variations possibles. Mais décrire un paysage partie par partie, ce n’est pas seulement se concentrer sur des particularités, c’est aussi donner une idée des contraintes qui s’imposent à l’ensemble et, partant, dire ce que l’ensemble ne pourra pas être, compte tenu de ces contraintes.
Je vais, tout d’abord, présenter rapidement l’œuvre et les manifestations directes du divin décrites dans celle-ci. Pour l’essentiel, elles résident dans la voix de Jésus. Don Camillo parle à Jésus et Jésus lui répond (I). Je vais, ensuite, décrire à quoi ressemble le Dieu de ces dialogues et ce qui paraît finalement communément admissible de concevoir et d’attendre à son propos (II). Je montre, ce faisant, les « extensions » sur lesquelles se fonde le dispo-sitif de manifestation du divin mis en place dans le film. Je me centrerai sur deux conversations. Certes, les dialogues sont fictifs, en ce sens qu’ils sont écrits avant d’être dits, mais il n’en demeure pas moins qu’une partie des contraintes formelles inhérentes aux conversations naturelles s’y retrouve. Je poursuivrai en m’intéressant au « Petit monde » lui-même en tant qu’ordre moral (III). Indexée par la relation particulière entre Don Camillo et Jésus, le petit monde de celui-ci a toutes les allures d’un monde sous le regard de Dieu. De ce point de vue, le film peut être conçu comme un documentaire – au sens où précisément il documente – sur ce qu’est un monde (possible) avec Dieu. Il en découle qu’il rend ce monde, à la fois, accessible et crédible, et qu’il montre de quoi – de quels mécanismes – est faite cette crédibilité. J’évoquerai, dans la foulée, un problème plus général : celui des conditions de l’existence des êtres divins dans notre monde. Mon propos soulignera le fait que l’indépendance ontologique de ces êtres est entièrement dépendante de notre activité orientée vers sa production, de sorte qu’il conviendrait de se garder de l’idée que nous avons affaire a des êtres à part entière (Houdart et Thiery, 2010). En outre, cette activité est-elle clairement communication-nelle et, donc, de part en part, conduite publiquement (Grice, 1989). Ce qui s’y passe est ainsi toujours parfaitement visible : nous savons, à la fois, que leurs manifestations sont artéfactuelles et nous les prenons, néanmoins, au sérieux. Autrement dit, la fabrication efficace des êtres n’implique pas l’adop-tion d’une attitude réaliste vis-à-vis d’eux. Ils sont « vrais » parce que nous nous orientons pratiquement vers leur existence.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
Jésus parle à Don Camillo 19
LES MANIFESTATIONS DE JÉSUS
Le Petit Monde de Don Camillo est un film tiré d’un ouvrage, homonyme en français, de Giovannino Guareschi. Il a été tourné en Italie, par Julien Duvivier durant l’automne 1951. Il est sorti en salle à la fin du printemps 1952. Le film se présente comme une série d’historiettes, plus ou moins emboîtées l’une dans l’autre, émaillant les relations amicales et conflictuelles d’un curé et d’un maire communiste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L’un des traits remarquables du film comme, bien entendu, de l’ouvrage d’où il est tiré tient au fait que Don Camillo parle à Jésus et que celui-ci lui répond. Ces conversations ont généralement lieu avec le Christ sur la croix du maître-autel. Il arrive, parfois, que le Christ parle à Don Camillo indépendamment de ce dispositif, mais c’est relativement rare. Un autre crucifix peut éventuellement faire l’affaire. Toutefois, le Christ du maître-autel apparaît comme l’interlo-cuteur privilégié de Don Camillo, puisque dans le deuxième film de la série (Le Retour de Don Camillo), celui-ci, exilé dans une petite paroisse de mon-tagne où le Christ ne lui répond pas, retourne dans son ancienne église afin d’y prendre le crucifix du maître-autel pour le ramener avec lui. Également, dans le quatrième film de la série (Don Camillo monseigneur), Don Camillo, évêque à Rome, parle au Christ sans que celui-ci ne lui réponde. C’est à l’oc-casion d’un retour dans son ancienne paroisse qu’il peut reprendre ses conver-sations avec le Christ, en parlant à nouveau avec celui du maître-autel.
Dieu est partout, le Fils aussi, mais on ne peut parler sans s’adresser à quelqu’un, à moins, bien sûr, que l’on ne parle à un public (fût-il virtuel). Une conversation implique donc un tour de parole régulé entre protagonistes : A parle, B prend la parole et parle, A reprend la parole puis B, puis A, etc. S’adresser à quelqu’un, dans un cadre conversationnel, c’est s’adresser à un être localisé. En d’autres termes, la condition normale d’une conversation est la présence d’un interlocuteur. Sans la présence d’un interlocuteur aisément repérable par le spectateur, Don Camillo pourrait ne se parler qu’à lui-même, soliloquer en somme ; la voix de Jésus pourrait n’être que la manifestation d’un dialogue intérieur et le Jésus de la voix un simple être in intellectu, une fiction. Un premier élément concourant à établir sa qualité d’être extra intel-lectum réside dans la différenciation de la voix de Jésus, dotée d’un timbre très différent de celui de la voix de Don Camillo. Mais, après tout, Don Camillo pourrait imaginer une voix différente de la sienne. Il faut donc rendre évident qu’il se tourne vers un interlocuteur extérieur. C’est pour cela que la pre-mière séquence du film dans laquelle Don Camillo s’adresse à Jésus montre
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
20 Réseaux n° 180/2013
Don Camillo parlant depuis ce que serait le point de vue de son interlocuteur, le Christ du maître-autel (la caméra est un peu en retrait afin que le specta-teur puisse reconnaître la croix et comprendre immédiatement à qui parle le curé). On voit Don Camillo s’avancer vers lui en parlant avec effusion. Le plan d’après montre le Christ de la croix et Don Camillo au premier plan, avec un effet de contrebas. Le plan suivant montre le visage du Christ pendant qu’il parle. Le réalisateur traite explicitement Jésus comme s’il filmait effec-tivement une autre personne. À part la voix, aucun autre artifice n’est utilisé. On ne voit pas bouger les lèvres du Christ. Sa personnification est laissée à un objet normal du décor d’une Église. Les plans de la séquence reproduisent les plans dont on userait si, à la place de Jésus, il y avait un homme discutant avec Don Camillo. C’est cette scénographie qui supporte à elle seule l’exté-riorité de Jésus par rapport à l’esprit du prêtre. La voix est un élément intrin-sèque de la scénographie. Elle permet à la fois l’alternance des timbres (ce qui manifeste la présence de deux identités) et celle des plans (Don Camillo vu depuis Jésus, Jésus vu depuis Don Camillo, Jésus seul, Don Camillo seul) qui sont caractéristiques habituelles des échanges conversationnels filmés (à l’intérieur d’une fiction comme d’un documentaire). Cette façon de procéder a pour conséquence d’assimiler les conversations entre Jésus et Don Camillo à des conversations normales entre tout un chacun ; elle produit ainsi simulta-nément la réalité de la conversation et sa normalité, de sorte qu’elle n’est pas spontanément homologuée en tant que « miracle » mais en tant que fait de la vie quotidienne. Dans beaucoup de films, le moment de la manifestation de Dieu (de Jésus ou, plus largement, du divin) est, au contraire, mis en exergue par un élément scénographique l’extirpant de l’ordre normal des choses. Dans Le Petit Monde de Don Camillo, le dispositif qui montre la réalité du divin est aussi celui qui le rapatrie au sein du monde de la vie quotidienne.
Ce rapatriement a comme conséquence remarquable et, cependant, non prise en considération que Jésus, réputé omniscient et omnipotent à l’instar du Père, se trouve, lors des situations d’interaction avec Don Camillo, partiel-lement limité à sa manifestation objectivée, c’est-à-dire au point de vue du Christ à la croix du maître-autel. Dans une scène où Don Camillo se prépare à le porter pour aller en procession bénir le fleuve, afin qu’il ne cause pas de dégâts, le Christ lui dit : « Alors on y va ? Le fleuve doit être magnifique avec tout ce soleil. Je le verrai avec plaisir. » Si l’on considère que c’est le Christ de la croix qui parle, cette envie n’a rien de surprenant, puisqu’il passe le reste de son temps à l’intérieur de l’Église. La proposition n’a donc, prima facie, rien d’étonnant ou de contradictoire. Cependant, si l’on s’avise de penser que
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
Jésus parle à Don Camillo 21
le crucifix n’est pas un fétiche habité par l’esprit du Christ mais une simple représentation de celui-ci, il paraît étrange qu’il faille déplacer cette représen-tation inhabitée afin que le fils de Dieu puisse profiter de la beauté du fleuve sous le soleil. Il pourrait, sans doute, en profiter du ciel, où il réside, et certai-nement depuis ce « point de vue de Dieu », qui est le sien et d’où découle son omniscience. La contradiction est donc évidente mais il est non moins évident qu’elle ne se pose pas sérieusement. Au moment même où je l’évoque, je continue à me représenter le Christ comme un être pouvant dire qu’il a envie de sortir de l’église afin de voir le fleuve. Comment est-ce possible ?
C’est tout d’abord possible parce que nous nous situons à l’intérieur d’un ordre séquentiel dans lequel s’élabore l’identité du Christ pour le film. Il ne s’agit de soutenir que le « Christ-pour-le-film » n’a rien à voir avec les caractéristiques et les usages du Christ à l’extérieur du film. Il en est, au contraire, nourri, mais le Christ est, en même temps, un personnage du film soumis à l’histoire que le film raconte ; il en découle que ses caractéristiques dépendent, à chaque scène, des caractéristiques exposées dans la scène pré-cédente et des caractéristiques qui lui seront prêtées dans la scène suivante. Le « Christ-pour-le-film » est ainsi un personnage dans un monde fictionnel cohérent, soumis au fil de la narration qui parcourt et assemble ce monde. Cette cohérence est d’autant plus forte que la narration vise à éviter les rup-tures avec les attentes naturelles des spectateurs. Personne ne comprendrait, par exemple, que l’acteur qui incarne Don Camillo change (sans explication) au cours du film ou qu’il devienne borgne sans que l’on sache pourquoi. C’est une attente d’arrière-plan des plus partagées que le personnage conserve ses traits du début à la fin du film ou que celui-ci rende compte des raisons qui font qu’il change de traits. Pareillement, si le Christ est posé en protagoniste d’une conversation, doté d’un point de vue de protagoniste, il n’est pas éton-nant que, dans une scène suivante, cette capacité à avoir un point de vue s’ex-prime comme capacité à avoir un point de vue sur le fleuve ensoleillé. On ne peut doter un personnage de certaines caractéristiques dans une scène et ne pas en tenir compte dans les scènes suivantes. En d’autres termes, si Jésus est doté de traits anthropomorphiques à un moment donné du film, il conserve ces traits et son anthropomorphisation lui donne, ultérieurement, accès à des traits relevant, par contiguïté, de la même famille que ceux qui lui ont déjà été prêtés. Il s’ensuit que, si le Christ « voit » Don Camillo dans une situa-tion d’adresses réciproques (l’un s’adresse à l’autre en le regardant, comme le montre la succession des plans lors des conversations), il peut aussi voir le fleuve, parce que son regard sur le monde est tout simplement de la même
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
22 Réseaux n° 180/2013
nature que le nôtre – et presque de la même « hauteur ». Ces traits et ces com-pétences de Jésus sont garantis par le récit et non par la logique abstraite ou par la théologie ; ils ne peuvent donc pas être ramenés négativement à ce que serait Jésus en dehors du film, parce que « Jésus-en-dehors-du-film » n’est pas le « Christ-pour-le-film ». C’est au récit que je me réfère spontanément afin de juger de la pertinence des caractéristiques qui sont attribuées au fils de Dieu. Néanmoins, le « Christ-pour-le-film » peut être relié, cette fois positivement, à un état de connaissance à propos de « Jésus-en-dehors-du-film ». Il va alors de soi que l’anthropomorphisation à laquelle se livre la fiction cinématogra-phique s’appuie sur un fait christologique, l’incarnation, caractérisant fonda-mentalement Jésus. Du reste, le dialogue du film y fait référence à ce moment précis. En prenant la croix du Christ du maître-autel pour la procession, Don Camillo dit : « Ils auraient pu la faire un tantinet plus légère cette croix » et Jésus lui répond : « À qui le dis-tu ! Moi qui ai dû la traîner jusque là-haut. Et je n’avais pas ta carrure ! » Le Christ rappelle ainsi qu’il a (transitoirement) possédé un corps et qu’il s’est trouvé de plain-pied (si l’on peut ainsi dire) dans un point de vue humain. Cette connivence originelle rend aisé d’imagi-ner aussi bien la conversation de Don Camillo et du Christ que le désir de ce dernier de voir le fleuve sous le soleil.
On notera, pour finir, que s’appuyer positivement sur une caractéristique comme l’incarnation ne consiste pas à soumettre le « Christ-pour-le-film » aux caractéristiques organisées de « Jésus-en-dehors-du-film ». Cela consiste dans le fait que le « Christ-pour-le-film » est soutenu par un arrière-plan de connaissance à propos du Christ en général. Il n’est pas question d’entrer, ici, dans le débat sur les noms propres et les désignateurs. Disons simple-ment que cette question est d’abord d’ordre pratique et que l’on peut décrire l’attitude pratique comme suit : de manière non forcément logique et peut-être comparable aux listes chinoises de Borges, nous avons à notre disposition un ensemble de caractéristiques, d’histoires et d’anecdotes liées (de manière plus ou moins souple ou plus ou moins rigide) à une entité ou à un nom (propre, en l’occurrence). Elles sont comme déposées sur les rayonnages d’une biblio-thèque. Ce n’est pas la bibliothèque qui organise le choix que nous opérons parmi les caractéristiques mais la logique de notre investigation (ou de notre errance) dans ses rayonnages ; bref, c’est la trame de notre activité. En ce sens, la référence à l’incarnation est une conséquence de l’orientation du récit même si la possibilité de cette orientation réside partiellement dans la faculté ouverte par l’incarnation. La référence à un trait externe conventionnellement admis et en fonction duquel on accorde telle ou telle caractéristique à un être
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
Jésus parle à Don Camillo 23
ou à un événement propres à une situation spécifique ne suit qu’en apparence (et après coup) la forme d’un syllogisme. En fait, le choix du trait et son application se font en même temps. C’est l’incarnation qui fait du Christ un interlocuteur familier pour Don Camillo et c’est le choix narratif d’en faire un interlocuteur familier qui valide l’incarnation comme une caractéristique per-tinente du Christ. En dehors de la situation, il n’y pas de filtre de pertinence ; il ne peut donc y avoir de choix d’une caractéristique comme « s’appliquant à la situation », et partant pas de présence d’une caractéristique tout court. En d’autres termes : aucune caractéristique n’est dans l’esprit de personne. Dans le monde vécu, c’est tout bonnement l’application qui fait penser à la caracté-ristique de référence et non le contraire.
À part sa capacité à faire la conversation en posture de réciprocité des pers-pectives – et donc à intervenir dans le monde humain selon des dispositifs eux-mêmes proprement humains –, Jésus fait preuve de réserve et de discré-tion. Il ne se livre à aucun miracle au sens indiqué par Wittgenstein pour qui un miracle est une action majeure et manifeste de Dieu. Un exemple en serait, écrit-il, qu’après qu’un prophète ait parlé, les arbres s’inclinent devant lui « comme par révérence ». En fait – j’y viendrai en détail – il n’y a aucun miracle dans Le Petit Monde de Don Camillo, tout ce que fait le Christ consis-tant à inspirer des actions humaines. C’est, du reste, cette présence de Dieu sans miracle qui fait toute une part de l’intérêt du film et son (peut-être invo-lontaire) pari narratif.
CONVERSATIONS AVEC JÉSUS
La première conversation entre le Christ et Don Camillo est politique et présente immédiatement un aspect de « supra-séquentialité » sur lequel je reviendrai. Disons, pour l’instant, que j’utilise ce terme afin de désigner le fait qu’une conversation peut porter sur des faits (ou s’appliquer à eux) relevant de séquences différentes.
Don Camillo : Jésus, vous voyez où nous en sommes. Ils défilent (les com-munistes défilent à l’extérieur se rendant sur la place de l’église ; ils viennent de remporter les élections municipales). Ils triomphent. Je vous dis qu’ils viendront jusqu’ici, dans votre maison, pour vous marcher sur la figure (Don Camillo se rapproche de l’autel en parlant). L’autre dimanche, je leur ai dit ce que je pensais d’eux en chaire. Eh bien, il y a en un, dans la nuit, qui m’a sauté dessus de derrière une haie et qui m’a administré une volée de coups de bâton.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
24 Réseaux n° 180/2013
Jésus : Et tu t’es laissé faire ? Tu as raison, Camillo, bienheureux les paci-fiques !Don Camillo : Oui, c’est-à-dire, j’avais en main une douzaine d’œufs et je cherchais à les préserver. Il faisait une de ces nuits. J’ai pas pu savoir qui c’était, mais si jamais je viens à le savoir… (il fait un geste menaçant en agi-tant la main).Jésus : Il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et puis, entre nous, une petite raclée, ça ne peut pas te faire du mal. Peut-être comprendras-tu enfin qu’il vaut mieux ne pas faire de politique chez moi (l’image se fixe sur le visage du Christ).Don Camillo : Tout de même, sans critiquer vos méthodes, je dois dire que moi, si j’étais à votre place, j’aurais jamais permis à un Peppone de devenir maire. Pensez donc que pas un de ces nouveaux conseillers ne sait lire et écrire couramment. Des illettrés pour diriger les affaires de la commune !Jésus : Ils n’ont pas eu le temps d’aller à l’école. Tu le sais bien, Camillo. À peine savent-ils marcher qu’ils travaillent dans les champs. Le pays est dur.Don Camillo : À qui la faute ?!Jésus : Va, Camillo, ce n’est pas l’orthographe qui compte, c’est ce qu’il y a dans le cœur et dans la tête. Laisse-les se mettre à l’ouvrage avant de les juger, ces braves.Don Camillo : Avec vous, on peut pas discuter (on entend l’Internationale, jouée par les communistes en train de défiler). Écoutez-les, mais écoutez-les. Et c’est moi qui leur ai appris la musique ![Séquence où l’on voit l’installation des haut-parleurs et leur essai par les communistes.]Don Camillo : Vous entendez ça, Seigneur. Ils ont tourné ces trompes de notre côté, exprès, c’est une violation de domicile !Jésus : Que veux-tu que j’y fasse, Don Camillo, c’est le progrès.[Séquence où l’on voit une jeune fille parler à sa vieille institutrice qui rentre chez elle en passant par la place où Peppone va faire un discours. Peppone fait son discours à ses électeurs et leur promet l’édification d’une maison du Peuple.]Don Camillo : (devant le portail de l’église, un peu à l’intérieur) Une maison du Peuple ! Ou prendra-t-il l’argent, je vous le demande (il ferme le portail avec empressement).[Don Camillo fait les cent pas derrière le portail, énervé par le discours du délégué de la fédération venu féliciter Peppone. À un moment donné, il se pré-cipite vers le portail comme pour aller prendre à partie l’orateur.]Jésus : Reste ici ! Tout ceci n’est pas ton affaire. Ici seulement tu peux faire tout ce que tu veux.Don Camillo : Ici, je peux ?Jésus : Naturellement, tu es chez toi (Don Camillo se dirige d’abord en mar-chand puis en courant vers la porte du clocher).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
Jésus parle à Don Camillo 25
Les communistes ont remporté les élections municipales. Don Camillo appar-tient au parti opposé, non parce qu’il soutiendrait les « capitalistes », mais parce que les communistes sont matérialistes et révolutionnaires. On verra par la suite qu’être « révolutionnaire », c’est être emporté par un mot d’ordre plutôt que prêter attention aux faits eux-mêmes. Quant à être matérialistes, les communistes de Don Camillo le sont nominalement mais certainement pas de manière intrinsèque. Le premier reproche que leur fait le curé est de ne pas respecter l’ordre établi considéré dans son architecture divine : « Je vous dis qu’ils viendront jusqu’ici, dans votre maison, pour vous marcher sur la figure. » C’est l’impiété supposée qui est d’emblée mise en avant par Don Camillo. La réponse du Christ ne vient pas immédiatement. Lorsqu’il répond, c’est en reprochant à Don Camillo de faire de la politique. Il en découle que l’accusation d’impiété contenue dans le propos du curé à propos des commu-nistes perd ipso facto sa crédibilité : le jugement de Don Camillo est obscurci par l’esprit de parti. Du point de vue de Dieu, « c’est ce qu’il y a dans le cœur et dans la tête [qui compte] ». Cependant, ce point de vue bienveillant n’est pas pour autant favorable aux communistes, du moins en tant qu’ils se reconnaissent dans une idéologie. Il invalide en effet de façon non polémique la croyance selon laquelle l’amélioration du sort de tout un chacun et la pour-suite du bien dépendrait de l’action politique. En incluant sans rechigner les communistes parmi les « braves », Jésus indique le caractère fondamenta-lement subsidiaire des projets politiques par rapport aux vertus possédées par les personnes. La force de cette invalidation réside dans le fait qu’elle est conduite à partir de l’attitude de Don Camillo et non à partir de celle de Peppone : c’est en contredisant ce dernier qu’il affirme en même temps la dignité des communistes et (au mieux) la subsidiarité du communisme. Celui-ci semble n’être atteint que par ricochet.
Si la conception du bien comme procédant d’un projet politique est invali-dée, il ne reste donc qu’à juger des choses et des gens en fonction de critères moraux s’appliquant au comportement humain. La morale a comme particu-larité de ne pas porter sur l’ordre du monde mais sur la conduite des personnes à l’intérieur d’un monde ordonné de l’extérieur. La cause du mal et du bien réside donc dans la conduite des hommes. De fait, si Jésus désapprouve que Don Camillo fasse de la politique, il ne désapprouve pas qu’il se précipite dans le clocher, afin de faire sonner les cloches à chaque fois que l’orateur, sur la place, se laisse emporter par des excès de langage. Pareillement, c’est sur leur activité que le Christ demande à Don Camillo de juger les communistes et non sur leur instruction. On retrouve ici, en mode mineur, l’opposition entre
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
26 Réseaux n° 180/2013
l’intelligence intuitive de l’homme (et, tout particulièrement, du « peuple ») et l’intelligence donnée par l’instruction ; que cette dernière n’apparaisse pas nécessaire à bien faire, lui ôte une bonne part de son lustre. Il s’agit, généra-lement, d’un point de vue conservateur, de droite et, pour tout dire, « antimo-derne », au sens de Péguy. Présenté positivement, il consiste dans l’idée que l’action volontariste, planifiée, scientifique et objectivante fait bon marché de la complexité de la réalité et que certains états de choses, apparemment dys-fonctionnels, contiennent des « vérités » et des bienfaits que le modernisme planificateur met aveuglément à mal. C’est exactement ce que dit le Christ : « Ce n’est pas l’orthographe qui compte, c’est ce qu’il y a dans le cœur et dans la tête. » Dans la mesure où il le dit en reprenant Don Camillo – « Va, Camillo, ce n’est pas l’orthographe qui compte… » –, que l’on pourrait pour-tant rapidement décrire comme « de son parti », sa position ne semble à nou-veau exprimer rien d’autre que la vérité même, celle précisément du point de vue de Dieu.
Ce point de vue se manifeste contrastivement par la rectification des propos de Don Camillo. Jésus a donné des enseignements aux hommes ; le Christ du maître-autel enseigne familièrement à Don Camillo en lui rappelant les enseignements de Jésus. L’antécédent « instituant » du Christ du maître-autel est le Christ de l’histoire sainte. Ce que l’on sait de l’un, on le sait aussi de l’autre, et cela s’ajoute aux caractéristiques propres que lui attribue le film. Plus exactement, les caractéristiques se confondent. Le point important, ici, est que la narration cinématographique fasse référence à un arrière-plan de compréhension afin d’élaborer et de spécifier, en interaction avec lui des per-sonnages fictifs dont, bien sûr, le « Christ-pour-le-film ». Ce dernier apparaît ainsi comme un composite dont la texture sémantique s’étend en dehors du film. Revenons à la posture rectificatrice : elle montre, à elle seule, que la conversation, quoique dénuée de décorum, n’a pas lieu entre égaux, ce que souligne le fait que Jésus tutoie Don Camillo qui le vouvoie. La possibilité de rectifier découle d’une position statutaire liée à l’interaction et clairement manifestée par elle. Le médecin peut reformuler les propos de son patient en fonction de son savoir, il en est de même du garagiste vis-à-vis du conducteur à propos d’une panne. On pourrait multiplier les paires inégalitaires de ce genre. L’inégalité qui les caractérise tient à ce que l’un des membres de la paire détient une compétence pour lequel l’autre le consulte. En dehors de cette situation l’inégalité disparaît ou se reforme à partir d’une autre com-pétence (par exemple, lorsque le médecin va chez le garagiste). Dans le cas d’une divinité omnisciente, l’inégalité demeure. À moins de se situer dans
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
Jésus parle à Don Camillo 27
une parodie, la parole de Jésus, même familièrement insérée dans un dis-positif humain, est ainsi toujours la parole d’un maître. Il en découle que, lorsque le scénario fait parler le Christ, on attend spontanément de lui un pro-pos juste, conforme à ce qu’il est censé être de manière communément parta-gée (même les non-croyants ont une idée de ce que le Christ peut être et elle n’est pas nécessairement éloignée de celle des croyants). En d’autres termes, l’effet d’indexation du propos en fonction du statut, couramment observable dans la vie quotidienne, se retrouve dans le dispositif fictionnel et y produit le même effet, un effet d’autorité. C’est pareillement le cas des médecins, lorsqu’ils parlent dans les films à propos de médecine. Le statut donné aux personnages d’une fiction se présentant comme essentiellement duplicative de la vie indique, par translation, qu’ils possèdent dans le film les mêmes carac-téristiques statutaires que dans la réalité et, partant, que leurs propos jouissent de valeurs de vérité semblables. Les propos attribués au Christ du maître-autel se doivent donc d’être reconnus comme tels, c’est-à-dire comme des propos que le Christ aurait pu tenir. Ils s’orientent ainsi vers un socle réputé commun de caractéristiques appropriées à la personne de Jésus. De ce point de vue, peu importe que l’on pense qu’il est bien un être divin ou un personnage his-torique ; ces caractéristiques sont les attributs d’un nom, au sens où l’on peut dire qu’Hercule est le fils de Zeus, même si l’on ne croit plus ni à l’existence de Zeus ni à celle d’Hercule. Il en découle que le Christ ne peut tenir qu’un discours de fraternité humaine transcendant les divisions partisanes. Toute-fois, si l’on y réfléchit bien, ce discours est autant le discours des gens que le discours du Christ et, plus exactement, celui que les auteurs du film pensèrent être le discours que les gens trouveraient normal d’entendre tenir par Jésus. En ce sens, le propos du Christ, dans sa conversation avec Don Camillo, n’est, du point de vue de son contenu propositionnel, rien d’autre qu’une opinion commune plus ou moins partagée. Mais il s’agissait aussi d’établir que les propos du Christ n’étaient pas seulement justes parce qu’ils correspondaient à ce que l’on pouvait penser que le Christ aurait pu dire en de telles circons-tances. Il fallait encore qu’il apparût dans une position incontestablement (ou tendant à l’être) supérieure aux autres parties en présence, et donc en s’oppo-sant à l’un des siens. C’est ce qui en fait un enseignement, puisqu’il rectifie une vision erronée de ses disciples.
De ce point de vue, le dialogue et la manière dont il procède à l’affirmation de l’évidence de la position magistrale du Christ ne sont pas sans évoquer une conception particulière de la vérité, celle de la théorie « propositionnelle » (prosentential theory of truth) (Brandon, 2009 ; Grover, 1992). La vérité serait
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
28 Réseaux n° 180/2013
une assertion affirmant la vérité d’une assertion précédente lorsque celle-ci porte sur un fait. Le contenu de vérité de la seconde proposition n’est alors pas différent de celui de la première. Si je dis : « il est vrai que Don Camillo est un prêtre », je ne dis rien d’autre que la phrase précédente affirmant : « Don Camillo est un prêtre ». En même temps, si je considère les choses de manière praxéologique, il est évident qu’il ne s’agit pas d’une simple redondance. La redondance est, ici, une explétion, au sens de la rhétorique classique, c’est-à-dire un ajout sémantique qui n’apporte rien à la signification mais qui renforce l’expression, en un mot qui l’appuie. Pareillement, attribuer une assertion à Jésus ne change pas non plus la signification de cette assertion ni, a priori, sa vérité. S’il est vrai que ce qui est important, c’est d’être de bonne volonté et non de se conformer à une doctrine partisane, la proposition est vraie par elle-même ; il en est de même si elle est fausse. Mais, en revanche, faire de cette assertion une parole de Jésus, c’est la renforcer en produisant l’autorité de sa vérité en lieu et place de la preuve de celle-ci. Jésus parlant et l’équivalent de « il est vrai que ». C’est une indexation de vérité d’autant plus commode et efficace qu’elle porte sur une assertion de sens commun. On notera, cepen-dant, que l’efficacité de cette indexation est étroitement liée au fait qu’elle reprend une idée commune et qu’elle s’appuie sur un subterfuge attestant de la neutralité du point de vue divin (la rectification du propos de Don Camillo). Elle dépend, en somme, de son niveau le plus humble.
La deuxième conversation ente Jésus et Don Camillo porte sur le baptême du fils de Peppone. Elle est de nature théologique et se présente également comme une rectification par le Christ de la position de Don Camillo. Cette rectification, toutefois, n’est pas pleinement satisfaisante ainsi qu’en témoigne un propos de Don Camillo dans une autre séquence du film. L’échange entre le Christ et Don Camillo est introduit par le refus de Don Camillo de baptiser le fils de Peppone parce que l’un de ses prénoms est Lénine.
« Don Camillo : Vous avez vu, Jésus ! Cette fois, je les ai pas manqués ces sans Dieu.Jésus : Ce que tu viens de faire est affreux ! Rappelle cette femme et baptise son enfant !Don Camillo : Mais enfin, Jésus, il faut bien vous mettre dans la tête que le baptême, c’est pas une plaisanterie, le baptême c’est…Jésus : Je sais, c’est moi qui l’ai inventé le baptême. Admets que, si cet enfant meurt à l’instant, c’est ta faute s’il ne va pas au paradis !Don Camillo : Mais pourquoi voulez-vous qu’il meure ?! Il est rose et frais comme une fleur.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
Jésus parle à Don Camillo 29
[La caméra filme le Christ du maître-autel qui reste silencieux ; son visage est tourné vers Don Camillo.]Don Camillo : Bon ça va, j’ai toujours tort. Je vais essayer d’arranger ça. »
Le problème évoqué par Jésus est celui des Limbes. Les enfants qui meurent avant d’être baptisés sont censés ne pas pouvoir aller au Paradis, du fait qu’ils ne sont pas lavés du péché originel, et ne vont pas en Enfer, puisqu’ils n’ont encore rien fait de mal. Ils se retrouvent dans un lieu intermédiaire, plus ou moins hospitalier selon les théologiens. Jésus se montre pressant et manifeste sa colère, parce que Don Camillo prend un risque. D’un point de vue externe, l’attitude du Christ du maître-autel ne peut qu’étonner. Être agité par un risque est, a priori, une attitude contradictoire avec le fait d’être omniscient. Jésus sait que l’enfant va mourir ou sait qu’il ne va pas mourir. Sa colère vis-à-vis de Don Camillo devrait donc être justifiée par la légèreté avec laquelle celui-ci, pour des raisons politiques, se comporte avec les sacrements et notamment par le fait qu’il prend, lui, un risque, puisqu’il n’est pas omniscient. Ce risque n’est un risque que pour Don Camillo ; le Christ, en effet, sait que le fils de Peppone ne va pas mourir. Dans ces conditions, la colère de Jésus se com-prend mais pas l’empressement qui se retrouve dans le texte – « Rappelle cette femme et baptise son enfant ! » – et dans le ton. L’empressement n’a aucun sens. Il ne s’agit pas non plus d’un empressement destiné à mettre un terme à la crainte qu’éprouverait la mère que son fils puisse mourir sans être baptisé. Quand elle quitte l’église, après le refus de Don Camillo («… allez le faire baptiser chez les cosaques »), elle paraît outrée, certes, mais non apeu-rée. Logiquement, l’empressement du Christ n’a donc aucun sens. Il est inco-hérent avec les attributs divins. Il est également incohérent avec la conception de la religion qui court tout au long du film. Selon cette conception, Dieu est compassionnel ; il comprend les hommes et ne les punit pas. Un propos de Don Camillo exprime clairement cette philosophie à partir de laquelle on imagine mal que le Christ puisse laisser un nouveau-né dans les Limbes, alors qu’il épargne l’enfer à des hommes qui le mériteraient :
« Taisez-vous, vieille folles ! Les responsables, ce sont les propriétaires, ces égoïstes entêtés, ce Filloti de malheur et ses pareils, qui flamberont en enfer comme du bois sec ! – Pardonnez-moi, Jésus, en définitive, je sais bien que vous n’envoyez personne en enfer. »
Cette double incohérence n’apparaît pas prima facie, c’est-à-dire lorsqu’on regarde le film dans la posture naturelle, celle du spectateur qui se laisse guider par la narration. Pour que l’incohérence apparaisse, il faudrait qu’un
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
30 Réseaux n° 180/2013
élément scénique introduise un marqueur d’incongruité qui attirerait l’atten-tion sur l’étrange attitude de Jésus ; or le scénario comme la mise en scène et le montage sont le plus souvent faits en sorte de lisser les aspérités de la narration, bref d’éviter ou de gommer de tels marqueurs. Dans la scène des reproches de Jésus, aucun élément ne vient indiquer que quelque chose ne va pas ; au contraire, les réparties sont vives comme dans un échange familier, le Christ hausse le ton, Don Camillo amorce une critique ; la scène est juste en tant que scène entre deux hommes ayant une divergence à propos d’une activité commune où l’un est le « patron » de l’autre. En d’autres termes, elle n’étonne pas ; on la reconnaît par référence à d’autres scènes du même genre, fictionnelles ou réelles. L’incohérence est tout à fait visible – puisqu’elle figure dans les éléments qui sont exposés et ne résulte donc pas d’un tra-vail interprétatif – mais n’est pas aperçue. La continuité narrative l’ignore et notre attention se porte sur cette continuité plutôt que sur le détail des conte-nus. Nous avons affaire à un problème de granularité que l’on pourrait aussi nommer « syndrome de Funes », par référence au personnage de Borges qui possède une mémoire eidétique, c’est-à-dire une connaissance détaillée et définitive de tout ce qu’il perçoit (Borges, 2010). On désigne par granularité (dans une perspective ontologique) le fait que la perception des constituants d’un événement ou d’un être varie en fonction du niveau de réalité auquel on se réfère. Si (pour reprendre une formule de Wittgenstein) la chaise que je vois n’est pas composée d’électrons, les constituants de la chaise sont, eux, composés d’électrons ; mais cela n’a aucune importance dans mon usage de la chaise. La granularité rend ainsi compte du fait que tout est présent en même temps mais que les « états de réalité » varient avec la sélection du grain et que nous vivons plutôt dans certains états de réalité que dans d’autres, dont nous n’avons besoin que lorsque nous entamons une investigation ou une révision, à la suite d’un incident survenu dans le cours de nos activités quoti-diennes. Le niveau affiné de granularité auquel atteint Funes rend finalement le monde vécu parfaitement chaotique. La cohérence et la continuité de la vie impliquent, en effet, que nous nous limitions à certains niveaux de granularité. Par exemple, nous n’avons pas besoin de connaître le code génétique d’une personne pour sympathiser avec elle ; en revanche, la connaissance de son code génétique peut être nécessaire à l’innocenter d’un crime qu’elle n’aurait pas commis. Cet exemple nous prouve que nous n’avons pas affaire à une hiérarchie causale des granularités, indépendante des cours d’actions. Ce sont les cours d’action (et plus spécifiquement les interactants) qui sélectionnent les niveaux de granularité pertinents. Dans un film, ce sont d’abord les auteurs (scénaristes et metteurs en scène) qui sélectionnent le niveau de granularité
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
Jésus parle à Don Camillo 31
pertinent ; c’est, ensuite, le public. Si le film est bien fait, le niveau de gra-nularité auquel se situe le public est celui sélectionné par les auteurs. Pour le dire en une formule, on ne remarque que les acteurs jouent que lorsqu’ils jouent faux. En d’autres termes, si le jeu des acteurs ou la ligne narrative du récit sonnent juste à un certain niveau – celui à partir duquel on en prend com-munément connaissance –, les incohérences ne sont tout simplement pas des incongruités. Rien n’indique dans le dialogue entre le Christ du maître-autel et Don Camillo qu’il faille à un moment ou à un autre changer de granula-rité (Nef, 2006). Le marqueur d’un tel changement réside dans la manifesta-tion d’une incongruité. La production continue de la normalité des situations – le lissage, pourrait-on dire – est une activité courante, aussi bien dans les interactions de la vie quotidienne que dans les narrations fictionnelles qui se donnent la vie quotidienne comme modèle. Dans l’un et l’autre cas, c’est la normalité et l’expressivité de la situation saisie qui en créent la « logique » et non la cohérence, considérée depuis d’autres niveaux de granularité.
L’ORDRE MORAL DU « PETIT MONDE »
Ce qui est tout d’abord frappant, dans le petit monde de Don Camillo, c’est la simultanéité de la familiarité avec Jésus et l’absence complète de miracle. Il semblerait même que le registre de la familiarité exclut la nécessité du miracle. Ce qui est ensuite remarquable, c’est que les interventions spirituelles de Jésus – il conseille Don Camillo et éclaire aussi Peppone – ne portent que sur la préservation de l’ordre moral du petit monde et jamais sur des pré-occupations d’ordre mystique. On notera, à ce propos, que, contrairement à d’autres prêtres de fiction (de facture, certes, plus dramatique), Don Camillo ne fait pas devant nous l’expérience de ce que Bernanos appelait « l’âpreté de la grâce ». Cela ne provient pas de ce que ses aventures nous décrivent un monde idyllique, mais de ce que ce monde est d’emblée assuré de la présence bienveillante de Dieu, en l’espèce de Jésus.
Les modalités de cette présence demandent à être précisées. Si l’on considère Le Petit Monde de Don Camillo (et éventuellement les films suivants), nous avons affaire à la chronique d’un gros bourg rural administré par les commu-nistes. Cette chronique est d’abord politique ; il est question des propriétaires terriens, des ouvriers agricoles et des petits fermiers, de la résistance, de la construction d’une maison du peuple, de football, d’une cité-jardin pour les enfants de la commune et de ce que chacun doit faire pour mener sa vie. Tout ceci pourrait facilement donner lieu à un récit dont la religion serait exclue ;
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
32 Réseaux n° 180/2013
et il est probable qu’on ne le remarquerait même pas, puisque ces sujets ne sont pas intrinsèquement religieux. Ils sont faits de la matière même de la vie quotidienne de tout un chacun. Cependant, ils deviennent religieux sans que leur contenu change le moins du monde, parce qu’ils sont évoqués par Don Camillo et que Don Camillo converse avec Jésus ou simplement s’adresse à lui sans que Jésus ne lui réponde (mais le silence de Jésus n’est alors que momentané, puisqu’il succède à une conversation ou la précède). Prenons comme exemple l’épisode de la grève générale décidée par Peppone pour contraindre les propriétaires à céder une (petite) partie de leurs terres afin d’y faire construire une digue, ce qui donnerait à la fois du travail aux chômeurs et protégerait le pays contre les crues du fleuve. La grève consiste à ne plus s’occuper des cultures ni des animaux. Les vaches cessent d’être traites. Elles souffrent et risquent de mourir. L’une d’elle, la Rousse, doit donner naissance à un veau et ne peut être aidée par le vieux vacher. Don Camillo décide d’in-tervenir, de traire et de nourrir les vaches. Il pénètre de nuit dans la ferme, ren-contre Peppone qui y patrouillait et parvient assez facilement à se faire aider de lui. Il aide la Rousse « à faire son veau ». L’ensemble de ces actions répond à une préoccupation morale qui est de ne pas laisser souffrir les animaux et de ne pas les laisser mourir. « On ne peut pas laisser crever les vaches, c’est trop bête », dit Don Camillo. La fille du propriétaire disait : « Écoute-les, ça te fend le cœur, ces pauvres bêtes… ». Il ne s’agit pas de condamner la grève et encore moins de donner raison aux propriétaires terriens. Don Camillo ne disait-il pas : « Les responsables ce sont les propriétaires, ces égoïstes entê-tés, ce Filloti de malheur et ses pareils, qui flamberont en enfer comme du bois sec » ? Il n’est tout simplement pas admissible que les animaux meurent, même si la grève est juste. Il peut y avoir un accord moral raisonnable sur ces deux positions ; c’est ce qu’illustre le ralliement de Peppone à Don Camillo. L’accord moral sur le traitement des animaux est aussi un accord sur la proxi-mité de certaines classes d’entre eux (les animaux domestiques, les vaches), puisque le malheur de la Rousse, qui est prête à vêler, se propage en tant que « malheur de la Rousse » – et non d’une vache anonyme – dans le bourg. Cet épisode reprend le thème de la subsidiarité de l’engagement politique par rap-port au devoir incombant à tout homme de se comporter honnêtement, c’est-à-dire de respecter des limites : « … Les plus graves conflits gardent un air de gentillesse… On s’en veut, on se bat mais on reste des hommes », peut-on entendre, en voix off, dans le propos d’ouverture du film. Cette conception de ce que doivent être les relations entre les hommes n’a rien, on le voit, de spécifiquement catholique ou chrétien (ou païen, ou athée). C’est une concep-tion de sens commun, qui pourrait être reprise par beaucoup de personnes très
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
Jésus parle à Don Camillo 33
différentes les unes des autres. La présence de Don Camillo indexe, toutefois, cette conception à l’ordre divin. L’opération doit être comprise dans toute sa simplicité. Nous avons un ensemble de valeurs articulées à une série d’ac-tions. Ces valeurs deviennent illustratives de l’ordre moral divin à cause du personnage de Don Camillo. C’est le pendant du mécanisme conversationnel que j’évoquais plus haut, lequel rapatriait l’ordre divin dans l’ordre humain en prenant comme modèle des échanges entre le Christ et Don Camillo les conversations familières entre proches de statut inégal (patron et employé, par exemple). Nous avons affaire, ici, à un mécanisme qui exporte dans le domaine divin les conceptions humaines de la normalité, c’est-à-dire un cer-tain style de relations sociales.
En fait, nous avons, bien sûr, affaire à une même chose que l’on pourrait sans doute décrire comme la coïncidence des ordres humain et divin. Peut-être, du reste, est-ce la cause de l’absence de miracle comme de l’absence de combat pour la grâce dans le film. Le miracle, en effet, est avant tout une perturbation de l’ordre naturel des choses, un événement extraordinaire, au sens où l’indiquait Wittgenstein, c’est-à-dire un événement toujours plus ou moins incroyable (Wittgenstein, 2002, p. 107) et donc finalement gênant. Il est très difficile, même dans une fiction – et c’est, d’une certaine manière, la fiction qui révèle le mieux la difficulté générale de la chose –, d’admettre que la trame narrative soit bouleversée de manière continue par des interven-tions divines. À vrai dire, le récit s’y perdrait. Les ouvriers agricoles feraient grève, mais les vaches n’auraient pas besoin d’être traites ou seulement nour-ries, puisque Dieu les maintiendrait en vie. La première conséquence en serait que les propriétaires terriens n’auraient plus aucune raison d’accéder à leurs demandes, de sorte que la survie des vaches laisserait les grévistes sans tra-vail et certainement aussi sans espoir. Dieu devrait alors opérer un nouveau miracle, afin que les propriétaires deviennent compatissants. À ce stade, on pourrait se demander s’il n’aurait pas mieux valu que Dieu ne fasse qu’un seul miracle consistant à les rendre compatissants avant même que la grève ne débute. Du coup, l’épisode de la grève disparaîtrait et avec lui toute une part du récit qui nous fait éprouver les tensions entre les hommes, leur sollicitude pour les animaux et l’amitié de Peppone et Don Camillo. Si l’on appliquait la même idée à l’ensemble du récit, il ne s’y passerait plus rien, du moins rien de ce qui fait que la vie a une consistance et un déroulement et qu’elle n’est pas le morne ennui de l’éternité. Il n’y aurait plus, à vrai dire, qu’un seul personnage : Dieu ; quant à Jésus et à Don Camillo, ils cesseraient de parler ensemble, puisque, comme il ne se passerait désormais rien, ils n’auraient
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
34 Réseaux n° 180/2013
plus de sujet de conversation. La trame narrative du Petit Monde ne résisterait donc pas à l’invasion du miracle. On y perdrait ce qui fait qu’une narration est une narration, c’est-à-dire l’existence humaine ; en d’autres termes, elle aurait tout simplement disparu, puisque, Dieu intervenant à tout bout de champ, les hommes auraient cessé d’être libres.
Le monde possible avec Dieu documenté par Le Petit Monde de Don Camillo est donc le monde même des hommes, le monde tel qu’il est. C’est le monde – pour reprendre l’expression de Joseph Doré – de « l’ordinaire de la vie », dans lequel Dieu se manifeste avec « discrétion » (Doré, 2010). Cette dis-crétion a des raisons théologiques que je ne discuterai pas. Elle a aussi (et peut-être surtout) une raison narrative et une raison existentielle. Je viens de donner la raison narrative : l’impossibilité de confectionner un récit fondé sur l’omniprésence d’un être omnipotent et omniscient, puisque le récit implique les aléas, les tours et les détours qui sont le propre de la vie humaine et de son libre arbitre (au sens théologique du terme). La raison existentielle n’est, quant à elle, rien d’autre que la reprise de la raison narrative : elle tient dans le fait qu’il est impossible de vivre une vie humaine ailleurs que dans un monde humain, c’est-à-dire ailleurs que dans la vie ordinaire. L’ordre moral du Petit Monde est ainsi l’ordre moral du monde ordinaire. Son indexation à l’ordre divin opérée par les conversations de Don Camillo avec Jésus a donc ceci de remarquable qu’elle ne modifie nullement la conception de la normalité qui y a cours. Ce n’est pas pour autant qu’elle est sans effets ; bien au contraire : elle produit une explétion et attribue une intentionnalité. L’explétion est une figure de style consistant à rajouter, dans une proposition, un mot qui n’en modifie pas le sens, mais le nuance ou le souligne. Ici, l’indexation au divin est bien explétive puisqu’elle ne s’accompagne d’aucune modification de l’ordre routinier de la normalité (ce que l’on fait, ce que l’on doit faire et comment) tout en renforçant la teneur de celle-ci. En ce sens, elle augmente la propension à se conduire moralement. Dans un autre monde, il eût été pos-sible que Peppone laissât mourir les vaches ou que deux amoureux séparés par leurs familles de bords politiques opposés – elle est la petite-fille de Filloti ; il est d’une famille de « rouges » – allassent au bout de leur projet de suicide. Ces choses-là n’arrivent pas dans le Petit Monde. On notera que le divin agit alors à l’intérieur du monde ordinaire, dans le cœur des hommes. Les miracles et l’extraordinaire paraissent ainsi inutiles. L’autre effet de l’indexation est l’attribution d’une intentionnalité au monde tel qu’il est (ou à des états du monde). Sans doute sont-ce les conversations entre Jésus et Don Camillo qui en rendent le mieux compte. L’intentionnalité, ici, c’est l’attribution d’une
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
Jésus parle à Don Camillo 35
conscience au monde avec laquelle les hommes peuvent entrer dans un jeu de perspectives réciproques. Ils s’adressent à « quelque chose » qui peut com-prendre et répondre. De ce point de vue, Dieu et davantage encore Jésus, qui a été homme, sont probablement les êtres les plus appropriés à un tel jeu de réciprocité. Ils sont aisés à placer dans une posture « humaine » ; on l’a vu s’agissant du Christ du maître-autel. Ce que le Petit Monde de Don Camillo rend particulièrement explicite – notamment, parce que le cinéma permet de déployer la situation –, c’est que les êtres divins répondent adéquatement au besoin d’interlocuteurs des humains, c’est-à-dire au besoin d’interlocution avec le monde.
Dans un livre consacré au Fait religieux, Albert Piette, distingue son approche de l’approche durkheimienne en notant que, de son point de vue, Dieu n’est pas une métaphore de la société (Piette, 2003), ce qui était le cas chez Durkheim. Selon lui, Dieu serait un être autonome quoique résultant d’une construction humaine, ce qui nous sortirait de l’alternative, décrite comme une « impasse », entre réalisme (Dieu existe extra intellectum, il est du domaine des realia) et constructivisme (Dieu est du domaine des ficta). Il en parle, par la suite, comme d’un être à part entière (extra intellectum, donc), partant de l’analo-gie avec le ferment lactique décrit par Bruno Latour à propos de Pasteur : le travail d’élaboration du ferment lui permet d’exister indépendamment de son créateur. Albert Piette remarque ainsi que « l’acteur n’est donc pas un homme manipulé qui ignore qu’il construit situationnellement l’être divin. Il le sait, sans pour autant nier la réalité de Dieu. Il n’y a donc pas d’alternatives entre la conception du Dieu construit et celle du Dieu réel. » Je partage le refus de cette alternative, mais je voudrais en préciser les contours, à la lumière de ce que nous apprennent les conversations entre Jésus et Don Camillo.
Du point de vue du sens commun, quand on dit : « Dieu existe », on veut bien dire que Dieu existe extra intellectum. On peut, certes, avoir du mal à s’en convaincre, parce que, pour reprendre l’expression de Wittgenstein, on ne l’a pas rencontré dans un hall comme on aurait rencontré Monsieur Smith (ou quelqu’un qui l’aurait rencontré), mais c’est indéniablement d’une existence extra intellectum dont on parle. Quand on croit en Dieu, c’est à cette sorte d’existence que l’on croit et, quand on doute, c’est de cette sorte d’existence – et pas d’une autre – dont on doute. Il en va de même, lorsqu’on ne croit pas. S’agissant du Christ du maître-autel, on peut dire qu’il existe, même si l’on ne croit pas que Dieu existe extra intellectum. Le film met, en effet, en place un dispositif continu qui produit l’étancité du Christ et en fait un protagoniste
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
36 Réseaux n° 180/2013
crédible. On dira de lui qu’il existe selon son mode d’être, c’est-à-dire en fonction du dispositif qui en fait un certain type d’être. Il s’agit des plans du film et de leur organisation séquentielle, du dialogue et de l’arrière-plan de compréhension qu’ils impliquent. Le fait que le spectateur sache que la bio-graphie du Christ comporte qu’il est homme apparaît, par exemple, comme un élément important la crédibilité du dispositif ; cela fait partie de ses exten-sions dans le reste du monde, c’est-à-dire de ses connexions avec d’autres éléments culturels apparentés qui vont de soi. La familiarité du Christ avec Don Camillo est ainsi crédible, parce qu’on sait plus ou moins précisément d’où elle vient ainsi que de quelles caractéristiques communément admises à propos du Christ elle procède. Bref, il y a des choses dans le monde qui font que ce que relate le film est considéré comme « vrai ». Nul ne doute donc (même pas les athées) de l’étancité du Christ du maître-autel, mais il est clair qu’elle ne circonscrit pas une existence pleine et entière, au sens courant que nous donnons à ce terme. Elle est, pour tout un chacun (ou presque), une « étancité-dans-le-cadre-du-film », c’est-à-dire une étancité limitée au jeu de conventions qui la manifeste. Tout le monde sait, par exemple, que la voix de Jésus n’existe pas en dehors du film. En d’autres termes, le Christ du maître-autel est un exemple d’être à étancité limité. Il a besoin de notre bonne volonté pour exister ainsi que d’une partie de nos compétences et d’un certain état du monde.
Considérons, maintenant, une église dans le monde de la vie. Une église est un dispositif complexe célébrant l’existence de Dieu et entretenant sa présence comme étancité. On conviendra, cependant, que ce dispositif n’y parvient que dans la mesure où les humains, qui s’y trouvent, participent à sa production. C’est leur intentionnalité qui lui donne vie ; ce sont leurs pensées qui sont, au moment précis où ils s’y trouvent, les pensées de Dieu (ou tout au moins les choses que Dieu est censé penser), comme ce sont les paroles du dialoguiste qui sont les paroles du Christ du maître-autel. Sans les paroles des hommes, Dieu est muet. Une part de ce qui fait l’étancité de Dieu est donc in intellectu plutôt qu’extra intellectum. Cette question est différente de celle de son exis-tence ou de sa non-existence dans l’ordre des realia, laquelle est hors des limites du langage ; celui-ci ne nous donne que les moyens de parler de son étancité. Malgré la citation bien connue d’Isaïe – « Mes pensées ne sont pas vos pensées » (55,8) –, le siège des pensées connues de Dieu est bel et bien dans l’esprit des hommes. Il fait partie de ces êtres avec lesquels nous n’entre-tenons de perspectives réciproques que parce que nous conformons une partie de nos pensées – selon des conventions plus ou moins strictes – pour être les
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
Jésus parle à Don Camillo 37
leurs. Cette liste d’êtres est fort longue. En fait, elle comprend l’ensemble de ce que l’on a pris l’habitude, à la suite de Bruno Latour et de son « principe de symétrie généralisée », de désigner comme « non humains ». C’est la pure et simple application de ce principe qui conduit à conférer descriptivement à ces êtres les attributs d’une intentionnalité que, phénoménologiquement, ils ne possèdent pas. S’ils existent, c’est donc en tant qu’êtres incomplets, au sens de Meinong (1999). Car ce qui fournit la parole de Jésus, dans Le Petit Monde, n’est rien d’autre qu’un dispositif et ce dispositif est crédible parce qu’il calque les relations avec Jésus sur les relations avec les humains. Si les « frontières de mon langage sont les frontières de mon monde » (Wittgenstein, 1993, § 5.6.), alors tout ce qui est dans mon monde n’y paraît que dans la formulation de mon langage. De ce point de vue, l’idée fondamentale de Durkheim selon laquelle l’organisation des autres mondes (adjacents, transcendants, paral-lèles, fictionnels, etc.), que nous évoquons, reproduit l’organisation du nôtre s’avère parfaitement bienvenue. En d’autres termes, nous pratiquons sponta-nément le sociocentrisme quoi qu’il en soit, par ailleurs, aussi bien des raisons et des caractéristiques secondaires de nos relations avec les non-humains.
Ce que nous mettons en place, aussi bien avec Don Camillo qu’avec les lieux de culte, les œuvres qui s’y trouvent, les apparitions mariales, les manifes-tations des saints et l’ensemble des fictions comme des non-fictions qui s’y rapportent, c’est essentiellement une interlocution avec notre propre monde, puisque – ainsi qu’en témoignent les conversations entre Jésus et Don Camillo – nous parlons toujours à l’univers, aux grandeurs, aux choses morales et à Dieu comme si nous parlions entre nous. De manière surprenante, car ils ne se détachent plus alors l’humanité, ce sont pourtant les êtres divins qui, par l’autorité manifestée de leur présence – ici le Christ du maître-autel – rendent cette interlocution crédible et, surtout, confiante. Peut-être, est-ce là, du reste, l’essence même du religieux : la confiance dans ce qui est.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte
38 Réseaux n° 180/2013
RÉFÉRENCES
BORGES J. L. (2010), « Funes ou la mémoire », Fictions, Œuvres complètes, vol. 1, Paris, Gallimard (La Pléiade).BRANDON R. (2009), L’Articulation des raisons, Paris, Cerf.CHAUVIER S. (2006), « L’étant sans l’être », Revue de métaphysique et de morale, n° 52, 2006, p. 495-513.CLAVERIE E. (2003), Les Guerres de la Vierge. Une anthropologie des apparitions, Paris, Gallimard.DORÉ J. (2010), « La portée révélatrice des miracles de Jésus », Recherches de sciences religieuses, tome 98, n° 4, p. 559-579.GRICE, P. (1989), Studies in the Way of Words, Harvard, Harvard University Press.GROVER D. (1992), A Prosentential Theory of Truth, Princeton, Princeton University Press, 1992.JAYYUSI L. (1988), « Toward a Socio-logic of the Film Text », Semiotica, vol. 68, n° 3-4, p. 56-77.HOUDART S. et THIERY O. (2010), Humains, non humains. Comment repeupler les sciences sociales, Paris, La Découverte.MEINONG A. (1999), Théorie de l’objet et présentation personnelle, Paris, Vrin (1re édition, 1904).NEF F. (2006), « Ontologie de l’objet, théorie des propriétés et théorie des ensembles : quelques propriétés et perspectives », Revue internationale de philosophie, n° 236, p. 181-207.PIETTE A. (2003), Le Fait religieux. Une théorie de la religion ordinaire, Paris, Economica.SACKS H. (2005) Lectures on Conversation, vol. 1., Oxford, Blackwell.WITTGENSTEIN (1993), Tractatus logico-philosophicus, Paris, Gallimard.WITTGENSTEIN L. (2002), Remarques mêlées, Paris, Flammarion.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Bib
lio S
HS
-
- 19
3.54
.110
.35
- 09
/10/
2013
20h
14. ©
La
Déc
ouve
rte
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - B
iblio SH
S - - 193.54.110.35 - 09/10/2013 20h14. ©
La Découverte