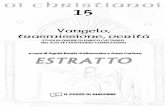« L’interprétation des actes et paroles de Jésus dans les Lettres d’Ignace d’Antioche »,...
-
Upload
univ-lorraine -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of « L’interprétation des actes et paroles de Jésus dans les Lettres d’Ignace d’Antioche »,...
Oi christianoi - Nuovi Studi sul cristianesimo nella storia
Collana diretta da Sergio Tanzarella - Pontificia Facoltà Teologica dell’Ita-lia Meridionale (Napoli).
Comitato scientifico: Maria Grazia Bianco - Università LUMSA (Roma);Bruna Bocchini Camaiani - Università degli Studi di Firenze; Filippo Bur-garella - Università degli Studi della Calabria; Anna Canfora - PontificiaFacoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli); Enrico Cattaneo - Pon-tificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli); Paolo Corsini -Università degli Studi di Parma; Antonio Ianniello - Istituto Superiore diScienze Religiose “Roberto Bellarmino” (Capua); Marek Inglot - Univer-sità Gregoriana (Roma); Giorgio Jossa - Università “Federico II” (Napo-li); Alberto Melloni - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;Daniele Menozzi - Scuola Normale Superiore (Pisa); Grado Giovanni Mer-lo - Università degli Studi di Milano; Enrico Norelli - Université de Genève;Emanuela Prinzivalli - Università “La Sapienza” (Roma); Luigino Rossi -Università di Salerno; Giovanni Sale - Università Gregoriana (Roma); Pier-roberto Scaramella - Università “Aldo Moro” (Bari); Francesco Sportelli -Università degli Studi della Basilicata; Miriam Turrini - Università di Pa-via (sede di Cremona); Adriana Valerio - Università “Federico II” di Na-poli; Giovanni Vitolo - Università “Federico II” (Napoli); Annibale Zam-barbieri - Università degli studi di Pavia.
In copertina:Codex Purpureus RossanensisMuseo diocesano di Rossano Calabro
© 2013, Il Pozzo di GiacobbeCortile San Teodoro, 3 - 91100 TrapaniTel. +39 923 [email protected]
ISBN 978-88-6124-418-4
Copertina: Cristina MartinicoImpaginazione: Giovanni DragoStampa: Stampa Editoriale s.r.l. - Manocalzati
CARATTERISTICHEQuesto libro è composto in New Aster, corpo 10; è stampato su carta Arcoprint Edi-zioni da 85 gr/m2 delle Cartiere Fedrigoni; le segnature sono piegate a sedicesimo - for-mato rifilato 14,5x21,5 cm - con legatura in brossura e cucitura a filo refe; la coperti-na è stampata su cartoncino Gardamat Art delle cartiere Garda da 300 gr/m2 plastifi-cata opaca e soggetti con UV lucida.
Volume pubblicatograzie all’IUF - InstitutUniversitaire de France
Pubblicazione promossa dall’Istituto di Storia del Cristianesimo“Cataldo Naro - vescovo e storico della Chiesa”della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionalesez. san Luigi - Via F. Petrarca 115 - 80122 Napoliwww.storiadelcristianesimo.it
5
IntroduzioneAnna Carfora
Questo volume è nato come un riconoscimento ed un omaggio che col-leghi e studiosi hanno voluto dedicare ad Enrico Cattaneo in occasione delsuo settantesimo compleanno. La sua intensa attività di studio, di ricercae di insegnamento ha contribuito in maniera significativa allo sviluppodelle conoscenze negli ambiti ai quali si è applicato. Con i suoi lavori lacomunità scientifica si è confrontata e continua a confrontarsi, secondouna dialettica fertile e costruttiva: è in questo spirito che il volume è statoconcepito e composto. Le sezioni in cui esso è diviso rispecchiano i setto-ri nei quali si è esercitata l’attività del professor Cattaneo: la Scrittura e lasua ricezione, lo sviluppo della Chiesa nella sua dimensione storica e teo-logica, la patristica, la teologia e la spiritualità. Gli articoli che costituisco-no le diverse sezioni sono concepiti in dialogo virtuale con i lavori di En-rico Cattaneo, si riallacciano a suoi studi, ne raccolgono spunti, sviluppa-no aspetti in consonanza o in confronto con i temi da lui trattati; a testi-monare la vita che circola all’interno della comunità scientifica.
Esplorando più da vicino i diversi contributi, per quanto riguarda laprima sezione, «Scrittura e ricezione», il contributo di Pino Di Luccio sisofferma sulle denominazioni attribuite a Gesù nel Nuovo Testamentoevidenziando come ognuna di esse costituisca un aspetto parziale del-l’identità di Gesù e come, allo stesso tempo – in quanto i “nomi” vengonoattribuiti a Gesù da parte di coloro che lo hanno seguito – tali denomina-zioni rappresentino il riflesso della diversità dei percorsi di salvezza intra-presi da coloro che hanno creduto in Lui.
Silvio Barbaglia propone un’esegesi di Matteo 6,11 a proposito di qua-le sia il pane da chiedere: quello per l’oggi o quello escatologico. Conside-ra che Girolamo traduce ™pioÚsioj come supersubstantialis. Si può dischiu-dere un senso ulteriore del pane da chiedere, come quello di “domani”,ossia un pane che, a differenza di quello materiale, non conduce alla mortema dà la vita? In linea con Es 16, i racconti sinottici e giovannei dellamoltiplicazione dei pani e dei pesci e dell’istituzione eucaristica, secondoBarbaglia si può pensare ad una richiesta del pane di “domani” come delpane del “sabato”, quello che dà la vita per sempre.
Cosimo Pagliara sviluppa un’analisi del secondo capitolo di Osea peresplorare il tema del simbolismo nuziale in esso contenuto, in partico-lare intorno alla dinamica lite-riconciliazione. Il profeta, a partire dalla
6
sua esperienza matrimoniale, interpreta e legge teologicamente il rap-porto tra JHWH e il popolo d’Israele. In tutto il testo s’individua, dietrol’io del profeta e la sua vicenda autobiografica, l’“io” di Dio che sostienel’intera narrazione.
Domenico Marafioti affronta il tema della scomparsa della parola “te-stamento” dalle traduzioni più recenti della Bibbia e dell’uso, invece, deltermine “alleanza”. Esamina i commenti ai Salmi di Agostino, sul tema del-l’eredità e del testamento: il termine testamentum si addice al rapporto traDio e l’uomo, non agli accordi che intervengono tra gli uomini. Se Girola-mo in una prima fase utilizza “patto”, successivamente ricorre anch’egli atestamentum. Attualmente il termine berîth viene tradotto come “alleanza”,tuttavia questa traduzione, per Marafioti, sbilancia il significato del termi-ne verso una parità tra Dio e l’uomo. La traduzione di diatheke non puòessere “alleanza”; non riscontrandosi ciò nel greco letterario né in quellobiblico. Attraverso l’analisi di alcuni passi paolini e di Ebrei, l’autore di-mostra come diatheke sia da intendersi come “testamento”, che rende se-manticamente ragione della categoria fondamentale di elezione e di ado-zione, come testimoniato inoltre dalle formulazioni liturgiche.
Cesare Giraudo esamina i diversi modi di designare il quarto sacramen-to: conversione, penitenza, confessione, perdono, riconciliazione, ripercor-rendone gli usi biblici – che risultano assenti per una delle designazioni –e le etimologie, con le relative curvature semantiche, mettendo in eviden-za ciò che esse fanno risaltare oppure mortificano del quarto sacramen-to, la cui ricchezza va adeguatamente sottolineata perché esso possa tro-vare rilevanza nel contesto odierno.
Agnès Bastit-Kalinowska investiga il corpus ignaziano, alla ricerca deiluoghi in cui Ignazio di Antiochia cita o si richiama a parole o fatti di Gesù.Emergono dall’analisi i modelli esegetici e interpretativi a cui Ignazio ri-corre e che avranno grande fortuna storica. La lettura ignaziana si pre-senta attualizzante e contemplativa.
La seconda sezione del volume è dedicata allo sviluppo della Chiesanelle sue dimensioni storiche. Enrico Norelli considera le testimonianzesu Ignazio di Antiochia offerte da Origene. In primo luogo il commento aLc 1,26-27 in cui compare un cenno al martire di Antiochia, per la cuiautenticità Norelli propende. Altra testimonianza origeniana su Ignazio sitrova nel Commento al Cantico dei cantici in cui Origene cita la sua Lette-ra ai Romani (7,2). Ancora, il trattato di Origene Sulla preghiera (20,2) ri-chiama in un punto la Lettera ai Romani (3,3).
Andrea Villani tratta la questione dei ministeri negli scritti di Tertul-liano chiedendosi se la maniera in cui egli ne parla può essere considera-ta una descrizione obiettiva dell’esistente o se non evidenzi, invece, que-
7
gli aspetti della realtà in cui Tertulliano vive che meglio rispondono ai suoiscopi letterari. In Apologeticum 39, Tertulliano non intende fare afferma-zioni sulla gerarchia cristiana ma comparare il comportamento dei re-sponsabili della comunità cristiana con quello dei responsabili della co-munità civile. In De baptismo 17, la questione affrontata è relativa al nonridimensionare il ruolo del vescovo, pur riconoscendo che anche i laicipossono battezzare. In De fuga in persecutione 11, l’accento è sulla mora-lità richiesta al clero, più che alle sue prerogative. Esempi, questi, chemostrano come le esigenze retoriche siano fondamentali nella costruzio-ne del discorso di Tertulliano.
Il tema dell’articolo di Antonio V. Nazzaro è costituito dal modo in cuiAmbrogio legge le figure dell’imperatore Costantino e della madre Elena.Nel De obitu Theodosii 39-51si trova la prima attribuzione ad Elena del-l’inuentio crucis. La trasformazione dei chiodi in un morso e in una coro-na, sta ad indicare la continuità, hereditas fidei e non dinastica, dell’impe-ro dei nuovi principi cristiani: va letta, dunque, in chiave politico religiosa.
La terza sezione del volume ospita contributi focalizzati su tematicheteologiche, dall’età dei Padri alla contemporaneità. Il tema del contributodi Enrico dal Covolo è l’articolazione della trasmissione della fede con latestimonianza nei Padri. Ireneo di Lione definisce l’apostolicità della tra-smissione dei contenuti della fede nella successione episcopale. Si trattadi una tradizione pubblica, unica, pneumatica. Ambrogio ed Agostino ven-gono considerati in quanto permettono di passare dal livello dei contenu-ti della fede all’atto del credere, che non può essere trasmesso ma testi-moniato. Gli inizi della relazione personale tra i due, come riportati dalleConfessioni di Agostino, testimoniano una modalità di testimoniare la fedeche passa attraverso gli atti più che attraverso le parole. Trasmettere e te-stimoniare riconducono alla via catechetica da seguire. Per Ambrogio sitratta di una catechesi concreta, dottrinalmente solida, centrata sulla per-sona di Gesù. La catechesi agostiniana è centrata sulla Bibbia, è cristo-centrica e orientante alla speranza.
Dominique Bertrand conduce una disamina particolare del quarto ana-tematismo che compare nella Lettera di Cirillo di Alessandria. Analizzan-do il duro confronto tra Cirillo e Nestorio, Bertrand mostra come il dis-senso tra i due riguardi la cristologia ma anche la soteriologia. Inoltre essidivergono anche sulla nozione filosofica di natura.
Nicola Salato esamina il concetto di persona in un passo della Sum-ma di Tommaso d’Aquino in cui tratta della Trinità. Tommaso supera ilconcetto di persona proposto da Boezio conferendogli spessore ontologi-co: nella persona l’essere si realizza nella sua pienezza. “Persona” va rife-rito innanzitutto a Dio, agli esseri umani in maniera imperfetta, ma essa
8
conferisce agli uomini altissima dignità e li costituisce nella loro unicitàe irripetibilità.
Giuseppe Guglielmi affronta il tema, in generale poco esplorato, dellastoricità in Lonergan. Una categoria interpretativa proposta è quella del-la differenziazione della coscienza come fenomeno eminentemente stori-co. Fondamentale è il passaggio dalla fondazione aristotelica della teolo-gia a quella storico-critica: Lonergan considera importante questo passag-gio ai fini della comprensione dello sviluppo dottrinale del cristianesimo,ossia del rapporto tra storia e Tradizione, tra ciò che non è permanente eciò che lo è.
La quarta sezione è dedicata a temi di spiritualità. In essa DominiqueBertrand propone la traduzione francese della Lettre sur la cellule attribuitaa Paolo di Tamma, asceta egiziano del IV secolo. La traduzione è corre-data da un’ampia introduzione che affronta le questioni sottese allo scrit-to. Si tratta di un piccolo ma prezioso documento dell’antica spiritualitàmonastica del Medio Egitto.
Francesco Asti affronta il tema della mistica in relazione alla santitàin quanto in essa Dio si comunica alle creature. Ciò a partire dal confrontocon il mondo greco, alla luce della Rivelazione e considerando importan-ti passaggi del Magistero, come la posizione di Benedetto XIV, il ConcilioVaticano II, il Catechismo della Chiesa Cattolica, il Documento della Con-gregazione per la Dottrina della Fede, Orationis Formas. Inoltre delinea itratti della vita mistica e le articolazioni con altre dimensioni come la teo-logia, la psicologia e il dialogo interreligioso.
La quinta ed ultima sezione del volume è incentrata su Enrico Catta-neo. Agnès Bastit-Kalinowska ne ripercorre l’attività scientifica, soffer-mandosi sugli aspetti di metodo e contenuto della sua opera e evidenzian-do il contributo da egli apportato alla ricerca nei diversi campi oggetto deisuoi studi.
La nota di Antonio Barruffo è una testimonianza su Enrico Cattaneodedicatagli da un confratello gesuita, che è stato Decano e Preside dellaPontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e Rettore del Pontifi-cio Seminario Campano Interregionale e ha condiviso con lui anni di im-pegno scientifico e didattico.
Infine Giancarlo Isnardi ha stilato un breve curriculum e la bibliogra-fia di Enrico Cattaneo.
Il volume è stato pubblicato grazie al finanziamento dell’Institut Uni-versitaire de France e con la collaborazione dell’Istituto di Storia del Cri-stianesimo “Mons. Cataldo Naro - vescovo e storico della Chiesa” dellaPontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. san Luigi.
9
Collaboratori
Francesco Asti è ordinario di Teologia presso la Pontificia Facoltà Teolo-gica dell’Italia Meridionale (sez. San Tommaso - Napoli).
Silvio Barbaglia, è docente di Introduzione all’Antico e al Nuovo Testa-mento, Esegesi di Antico e di Nuovo Testamento presso lo Studio teo-logico del Seminario Vescovile “San Gaudenzio” di Novara.
Antonio Barruffo, già Preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’ItaliaMeridionale, è emerito di Ecclesiologia presso la Pontificia Facoltà Teo-logica dell’Italia Meridionale (sez. San Luigi - Napoli).
Agnès Bastit-Kalinowska è Maître de conférences presso l’Université deLorraine e membro dell’Institut universitaire de France. Si occupa diEsegesi patristica del Nuovo Testamento.
Dominque Bertrand è Direttore dell’Institut des Sources Chrétiennes.
Anna Carfora è incaricata di Storia della Chiesa medioevale e modernapresso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (sez. SanLuigi - Napoli).
Enrico dal Covolo è docente di Letteratura cristiana antica greca e Retto-re della Pontificia Università Lateranense.
Pino Di Luccio è straordinario di Esegesi del Nuovo Testamento presso ilPontificio Istituto Biblico.
Cesare Giraudo è docente emerito di Liturgia e Teologia sacramentariapresso il Pontificio Istituto Orientale.
Giuseppe Guglielmi è associato di Antropologia teologica presso la Ponti-ficia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (sez. San Luigi - Napoli).
Giancarlo Isnardi esercita attività di docenza nei Licei classici e scienti-fici di Torino e della provincia.
Philippe Luisier è professore di Copto e Discipline dell’Oriente cristianopresso il Pontificio Istituto orientale e il Pontificio Istituto Biblico. Di-rige la collana Patrologia Orientalis.
Domenico Marafioti è ordinario di Teologia dogmatica presso la Pontifi-cia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (sez. San Luigi -Napoli).
Antonio V. Nazzaro è professore emerito dell’Università degli Studi diNapoli “Federico II” e socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei.
Enrico Norelli è ordinario di Storia del cristianesimo delle origini pressola Faculté de Théologie della Université de Gèneve.
Cosimo Pagliara è incaricato di Teologia biblica, Greco biblico, Ebraicobiblico presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
Nicola Salato è incaricato di Ecclesiologia presso la Pontificia FacoltàTeologica dell’Italia Meridionale (sez. San Luigi - Napoli).
Andrea Villani è ricercatore presso il progetto “SAPERE” (Scripta Antiqui-tatis Posterioris ad Ethicam Religionemque Pertinentia) dell’Accade-mia delle Scienze di Gottinga.
121
L’interprétation des actes et paroles de Jésusdans les Lettres d’Ignace d’AntiocheAgnès Bastit-Kalinowska
Les sept lettres d’Ignace, adressées principalement aux Églises d’Asiedans les premières années du second siècle1, ont chacune leur tonalité pro-pre, qui correspond à leur centre d’intérêt particulier: l’harmonie pour lesÉphésiens, le réalisme de l’incarnation pour les Smyrniotes etc.2 Comptetenu de ces caractéristiques liées aux destinataires, la série des lettres tour-ne autour de problèmes similaires et revient fréquemment sur quelquespoints décisifs aux yeux de l’expéditeur: l’évêque d’Antioche, si on le con-sidère séparé de son Église propre au cours de ses étapes vers le témoigna-ge à Rome, dicte dans l’urgence ce qui lui paraît essentiel de communiqueraux Églises avec lesquelles il s’était trouvé en contact et auxquelles il de-vait remerciements et encouragements. Ceci explique que le lecteur se trou-ve – à l’exception de la Lettre aux Romains dont l’objet est particulier etcompte tenu aussi de la spécificité de la Lettre à Polycarpe – face à une sé-
1 Considérées comme authentiques dans leur recension «moyenne». Je suis pour mapart convaincue par les arguments d’A. Wenger dans sa critique de la thèse de R. Weijen-borg, A. WENGER, «A propos des Lettres d’Ignace d’Ignace d’Antioche», in Revue des Étudesbyzantines 29 (1971) 313-316, qui montre comment on peut expliquer le passage du textemoyen aux développements de la version longue, beaucoup plus difficilement l’inverse. Àcet argument, E. CATTANEO, «La figura del vescovo in Ignazio di Antiochia», in Rassegna diTeologia 47 (2006) 497-539, ajoute à la page 538, n. 170, que l’existence même d’une versiondéveloppée du corpus épistolaire d’Ignace, datable de la seconde moitié du IV° siècle, té-moigne en faveur de l’authenticité de la recension reçue. Un point sur la question, avec unepréférence pour la thèse du faux, se trouve en B. DEHANDSCHUTTER, «L’authenticité des Epî-tres d’Ignace d’Antioche», in Studia Patristica 18/3 (1989) 103-110, repris par l’auteur en ID.,Polycarpiana. Studies in Martyrdom and Persecution in Early Christianity, Peeters, Leuven2007, 145-151. On se reportera aussi avec profit à IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Le Lettere, a cura diE. Norelli, Edizioni Paoline, Milano, 2013.
2 Voici les centres unificateurs que l’on peut proposer, de manière schématique, pourchaque lettre:
Éphésiens Harmonie Magnésiens ancien et nouveau
Tralliens contamination de l’erreur Romains désir du martyre
Philadelphiens Esprit et divisions Smyrniotes réalité de la chair du Christ Polycarpe devoirs du pasteur
�
122
rie de cinq ou six variations sur quelques motifs récurrents, qui peuventfacilement être identifiés: la foi en Jésus-Christ, dans sa divinité et dansson humanité, le caractère réel et fondateur de sa passion et de sa résur-rection, la relation à l’ancienne alliance, celle avec la tradition juive, la di-mension centrale et unificatrice de la participation à l’eucharistie, l’harmo-nie à garder dans la vie interne de l’Église, l’attitude à l’égard des déviantset des païens, l’espérance du salut. Le langage des Lettres est avant tout uneparole directement adressée à des récepteurs, elle est rapide, condensée,ne s’attarde pas en développements théologiques, moraux ou autobiogra-phiques comme les Lettres de Paul, composées plus à loisir pour servir d’en-seignement de référence. L’auteur vise immédiatement son objet. S’il citetrès peu, au sens strict, les textes scripturaires – quelques passages vétéro-testamentaires, des expressions pauliniennes ou des paroles de Jésus –,toujours de manière rapide, se contentant souvent de quelques mots, ilmobilise beaucoup plus largement un très riche arrière-plan textuel. On ale sentiment que, plus ce qu’Ignace tente de dire est dense et ramassé, plusson langage paraît saturé de micro-expressions à tonalité scripturaire.
Le matériau évangélique, entre autres3, affleure presque à chaque ins-tant, mais de manière particulièrement allusive, comme si les récits de lavie de Jésus ou les discours de celui-ci constituaient un bien commun par-tagé par les correspondants auquel il suffisait à l’évêque de renvoyer pourl’évoquer à la mémoire des destinataires4. Dans ce contexte, on observe
3 On pourrait dire la même chose en ce qui concerne les Lettres pauliniennes (surtout1 Corinthiens et Ephésiens) et, dans une moindre mesure, les Actes des Apôtres (cf, pour cequi est de Paul, A. LINDEMANN, «Paul’s Influence on ‘Clement’ and Ignatius», in A. GREGORY -C. TUCKETT [edd.], Trajectories through the New Testament and the Apostolic Fathers, OxfordUniversity Press, Oxford 2005, 9-24, sp. 9-16). Pour l’étude du matériau néotestamentairechez Ignace, voir récemment P. FOSTER, «The Epistles of Ignatius of Antioch and the Wri-ting that Later Formed the New Testament», in ib., 159-186, qui reprend dans une perspec-tive plus rapide et sélective l’étude analogue menée de manière très approfondie par W.R.INGE, «Ignatius», in OXFORD SOCIETY OF HISTORICAL THEOLOGY (ed.), The New Testament in theApostolic Fathers, Clarendon Press, Oxford 1905, 61-83. Voir aussi l’index de C.T. BROWN, TheGospel and Ignatius of Antioch, Peter Lang Publishing, New York 2000, 227-234. Celui-cin’est cependant qu’indicatif car, par exemple, on n’y trouve aucune entrée pour Ep 5, dontla présente étude montrera la présence exceptionnellement dense dans les Lettres, particu-lièrement celle aux Éphésiens, voir ci-dessous n. 68. Je donne en annexe un tableau regrou-pe, sous forme sommaire, les principaux lieux des évangiles canoniques dont je prends icien considération un contact possible avec les Lettres.
4 En témoigne, par exemple, l’allusion contenue dans le «telle», non préparé dans ce quiprécède et qui renvoie donc manifestement à une référence extérieure partagée avec lesinterlocuteurs d’Éphèse: «si la prière (commune) “d’un ou de deux” possède une telle force(cf Mt 18,20), combien plus celle de l’évêque et de toute l’Église» (Éphésiens 5,2, IGNACE D’AN-TIOCHE - POLYCARPE DE SMYRNE, Lettres, Martyre de Polycarpe. 2è édition revue et augmentée,par les soins de P.T. Camelot, Cerf, Paris 1951, 72 [désormais abrégé en SC 10]).
123
trois formes principales que peuvent prendre la référence ou l’allusion àce que nous connaissons à travers les évangiles canoniques: - les confessions christologiques et les moments du développement qui
tendent à prendre forme de confession; - la contemplation de moments de la vie de Jésus ainsi que, sous un autre
aspect, la présentation d’actes de Jésus comme modèles à imiter; - la parénèse qui emprunte aux paroles et images tirées du langage de
Jésus.Nous explorerons successivement ces trois registres, en tentant de pré-
ciser la relation entretenue par Ignace avec ces éléments évangéliques etle type d’approche qui est le sien, qu’il s’agisse d’évoquer des passages nar-ratifs ou de reprendre des mots du Seigneur5. Notre enquête ne se posepas directement la question de savoir sous quelle forme, orale ou écrite,conforme à la tradition postérieure ou originale, Ignace avait eu accès àce matériau évangélique dont il était manifestement pénétré – la possibi-lité même d’une telle étude le montre –, mais s’intéresse, dans le cadre del’histoire de l’exégèse, aux modes d’utilisation, d’appropriation et d’inter-prétation repérables à travers l’écriture de l’auteur: dans cette perspecti-ve, Ignace est pour nous un témoin exceptionnel car nous découvrons chezlui, comme in nuce, des procédés et même des données exégétiques pro-mis à une large postérité. La brièveté répétitive des Lettres, évoquée ci-dessus, et la nature souvent allusive des références d’Ignace rend certesla recherche délicate, mais d’autant plus significative: nous surprenonsl’auteur dans son geste exégétique spontané, et ce geste a d’autant plus deprix qu’il s’agit pour nous, avec les Lettres d’Ignace, de l’émergence d’unarrière-plan évangélique auparavant presque inconnu des témoignages
5 Logia kuriaka, selon l’expression de Papias de Hierapolis, lui aussi contemporain dePolycarpe en Asie, d’après le témoignage d’Irénée rapporté par Eusèbe, (Histoire Ecclésias-tique 3,39,1). Un peu plus haut, Eusèbe présentait ensemble Ignace, Polycarpe et Papias:«en ces temps se faisait remarquer en Asie Polycarpe, qui s’était entretenu avec les Apôtres[...], dans le même temps se faisait connaître Papias, lui aussi évêque de la communautése trouvant à Hiérapolis, et Ignace, à présent encore très largement célèbre» (ib. 36,1-2).D’après l’historien de Césarée, dans la préface de son ouvrage intitulé Explication des paro-les du Seigneur, Papias se disait disciple des presbytres, et attestait qu’il s’était intéressé aux«préceptes» (entolai) venant du Seigneur (ib. 39,3). On notera que le terme «entolai» est celuiutilisé par Ignace en Éphésiens 9,2, où il parle des «préceptes de Jésus-Christ». Eusèbe citepar ailleurs deux témoignages de Papias concernant l’un la mise par écrit non ordonnée des«logia kuriaka» provenant de la prédication de Pierre par Marc (ib. 39,15), l’autre le regrou-pement ordonné de «logia» en langue sémitique par Matthieu (ib. 39,16). Voir PAPIA DI HIE-RAPOLIS, Esposizione degli oracoli del Signore. I frammenti, a cura di E. Norelli, Edizioni Pa-oline, Milano 2005, en particulier la discussion autour de sa situation historique, 30-54,aboutissant à la page 54 à une proposition de datation entre 110 et 120.
124
écrits. Enfin, s’il est très probable qu’Ignace ait connu un substrat textuel(oral ou écrit), surtout en ce qui concerne les paroles de Jésus, sa pensées’oriente immédiatement vers la personne du Sauveur, vers ses actes et sesattitudes, vers le mystère de son action. C’est pourquoi nous abordonscette présentation quelque peu de biais, par les moments de confession oùl’allusion à la vie de Jésus se trouve particulièrement simplifiée.
1. Vers la confession christologique6: «éclairer l’économie»
Ignace fait en Éphésiens XX, 1 une confidence significative: s’il plaît àDieu qu’il puisse adresser à ses destinataires un second livret, l’évêque – quia en effet conscience de ne se livrer dans sa Lettre qu’à un survol rapide –se propose d’“éclairer” pour eux “l’économie”: «si Jésus-Christ m’en esti-me digne, à votre prière, et si telle est sa volonté, dans le second livret quej’ai l’intention de vous écrire, je mettrai en lumière pour vous ce que je viensd’aborder, l’économie qui se rapporte à l’homme nouveau, Jésus-Christ»7.
On voit en effet, dans les Lettres, Ignace dessiner les lignes d’une éco-nomie dont la venue et l’action de Jésus-Christ est le centre: préparée par«les prophètes et la loi de Moïse», qui aurait dû en procurer la persuasion(cf Lc 16,29-31)8, attendue par patriarches et “prophètes” à la rencontredesquels Jésus est allé au moment de sa mort, cette venue a été attestée etannoncée par les “apôtres”. Ce témoignage, pour Ignace comme pour Paul,s’appelle “évangile”: «l’évangile comporte un facteur de persuasion parti-culièrement remarquable (exaireton): la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, sa passion et sa résurrection»9. Ignace explicite cette déclaration eninsistant sur la supériorité de «l’évangile» sur «les prophètes que nousaimons»: certes ils ont regardé vers lui et l’ont «annoncé», mais «l’évangi-le est réalisation d’incorruptibilité»10. De même, «il convient de s’attacherde manière particulière (exairetos)11 à l’évangile, où la passion nous a été
6 On remarquera que ces confessions interviennent plutôt au début des lettres.7 Éphésiens 20,1, SC 10, 90. Toutes les traductions données ici sont miennes.8 «Eux que n’ont pu persuader ni les prophètes ni la loi de Moïse, ni même jusqu’à pré-
sent l’évangile», Smyrniotes 5,1-2, SC 10, 158. Ignace semble ici faire écho à la déclarationd’Abraham en Lc 16,29 et 31: «ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent»: on note-ra l’inversion, les prophètes procurant des ressources plus directes quant à la préparationdu kérygme.
9 Philadelphiens 9,2, SC 10, 150.10 Ib.11 Il est significatif qu’Ignace utilise à deux reprises et dans deux contextes différents les
termes «exaireton/exairetos», pour évoquer cette spécificité de “l’évangile”, le «ni même l’évan-gile» de Smyrniotes 5,1-2 jouant un rôle analogue (voir n. 8 ci-dessus). On en déduira faci-lement que ce caractère remarquable situe l’annonce de l’évangile sur un fond plus large –
125
montrée et la résurrection accomplie (teleleiotai)»12. Cette dernière expres-sion révèle les deux versants de “l’évangile” selon Ignace tels qu’il nousapparaîtront dans cette étude: d’une part l’œuvre de Dieu est “montrée”,c’est-à-dire attestée dans son effectivité, mais aussi offerte au regard, à laconsidération, et même à la contemplation des fidèles, de l’autre l’événe-ment du salut auquel il rend témoignage possède en lui-même une dyna-mique historique d’une réelle efficience: la résurrection est “accomplie”,l’incorruptibilité “réalisée”; ainsi, l’action du Christ n’est pas limitée aupassé mais rayonne toujours dans le présent de l’auteur et des destinatai-res, ce qui permet l’actualisation de ses paroles ou logia, car «celui qui pos-sède véritablement la parole de Jésus peut entendre même son calme»13.
Confessions antithétiquesAvec Ignace commence, dans la tradition chrétienne, le type de confes-
sions binaires, qui s’efforcent de mettre sous forme antithétique le para-doxe du Dieu fait homme14. Une première tendance l’incite à opposer ter-me à terme des qualificatifs abstraits, empruntés sans doute à la théolo-gie philosophique contemporaine, peut-être par l’intermédiaire d’élabora-tions judéo-helléniques15. Parmi ces séries, l’une – renvoyant à la divinité –est composée d’adjectifs verbaux privatifs, correspondant à une désigna-tion négative, l’autre en miroir est une série de désignations positives,pouvant s’appliquer à l’humanité. Ceci est particulièrement visible dansla Lettre à Polycarpe, où l’évêque s’adresse, en la personne de son destina-taire, à un égal quant à la culture hellénique, l’incitant à attendre leur com-mun Seigneur:
celui des “prophètes” et de la «loi de Moïse». La notation d’Ignace est à comprendre essen-tiellement comme désignant, avec l’œuvre du Christ, le moment éminent de “l’économie”globale du salut. Il n’est pas à exclure, peut-être, qu’Ignace pense également aux documentsnéotestamentaires, en indiquant leur supériorité à l’égard du corpus vétérotestamentaire(«la loi et les prophètes», selon l’expression de Mt 5,17, cf Lc 16,31 etc.).
12 Smyrniotes 7,2, SC 10, 162.13 Éphésiens 15,2, SC 10, 84.14 Voir A. BASTIT, «S’asseoir sur le puits et marcher sur la mer. La lecture antithétique
des récits évangéliques dans la première littérature chrétienne», in M.A. VANNIER (ed.), LesPères de l’Église et la christologie, Cerf, Paris 2013 (à paraître).
15 Si les usages philosophiques d’“apathès” et “aoratos” remontent au moins à Platon (cedernier terme se retrouve dans le Nouveau Testament, en particulier dans la doxologied’1Timothée 1,17: «au roi des siècles, Dieu incorruptible, invisible (“aoratos”) et unique» etCol 1,15), celui d’“achronos” ne paraît pas attesté avant Alexandre d’Aphrodise et Plotin (Lid-dell-Scott Greek Lexicon ad verbum), ce qui ne signifie pas qu’un tel usage philosophiquen’ait pu exister antérieurement. Quant à “apsèlaphètos”, il semble forgé par Ignace sur unmodèle similaire, pour insister implicitement par contraste sur le caractère “palpable” (“psè-laphètos”) du Verbe incarné.
126
extérieur au temps (achronos) Invisible (aoratos) [devenu] pour nous visible (horatos)
Impalpable (apsèlaphètos) Impassible (apathès) [devenu] pour nous passible (pathètos),
ayant pour nous supporté l’épreuve en tout genre16
� On remarque que, dans ce tableau binaire, la symétrie n’est pas par-tout parfaite. Il nous faut bien entendu comprendre et suppléer, en con-trepartie aux indications d’intemporalité et d’impalpabilité, que le Verbeest entré dans le temps et s’est fait «palpable», cette dernière qualité étantl’une des caractéristiques de l’humanité de Jésus qu’Ignace met volontiersen avant, en particulier à travers la citation aux Smyrniotes d’un logionde Jésus ressuscité disant aux disciples «palpez moi»17. On notera aussila récurrence du «pour nous» et le réalisme croissant des caractéristiquesde l’humanité: entré dans le temps, il devient visible, non seulement visi-ble, mais palpable18, et plus que tout passible, puisque la passion «pournous» est l’aboutissement de l’incarnation. Cette gradation d’intensité, dumoins au plus concret, me paraît devoir être relevée: elle correspond chezl’écrivain à une tendance à l’expressivité, au pathétique même qui se fon-de sur l’éloquence du tangible.
De perspective analogue, mais dans une tonalité moins philosophiqueet davantage théologique, ou plus précisément christologique19, était déjàla confession antithétique transmise aux Éphésiens:
«Un unique médecin
charnel (aussi bien que) spirituel Engendré (gennètos) et inengendré (agennètos)
en un homme/venu en la chair20 Dieu
�16 À Polycarpe 3,2, SC 10, 172-174.17 Smyrniotes 3,2, cf Lc 24,39 «palpez-moi et voyez », SC 10, 156. Le Theologisches Wör-
terbuch zum Neuen Testament ne consacre pas d’article à “psèlaphao”, ce verbe remarqua-ble mis dans la bouche de Jésus par Luc.
18 Pour les Actes de Jean, qui se situent dans un milieu asiate, Jésus est “akratètos”, in-saisissable, et la tentative de le “palper” (“psèlaphao”) réserve des surprises: «tantôt, vou-lant le saisir je rencontrais un corps matériel et solide, mais d’autres fois m’efforçant de lapalper (“psèlaphontos”), sa substance était immatérielle et incorporelle, comme n’existantpas du tout» (E. JUNOD - J.D. KAESTLI (edd.), Actes de Jean 93, Acta Ioannis, Brepols, Turn-hout 1983, 197), cf aussi le par. 89, 193, sur la sensation troublante de Jean dans son tou-cher (“psèlaphao”) de la poitrine de Jésus (selon Jn 13,23-25), dont la qualité tactile est va-riable. La note 1 du commentaire de Junod et Kaestli, ib., 487, citant d’autres témoignagesapocryphes, montre l’importance, pour ce courant, de la non palpabilité du Sauveur.
19 Avec les précautions d’usage, naturellement, quant à l’emploi anachronique – au moinsquant à la désignation – de ces termes à propos d’Ignace.
127
en la mort Vie véritable et de Marie et de Dieu
Passible (pathètos) auparavant impassible (apathès)
� Jésus-Christ notre Seigneur»21
Nous retrouvons, dans cette sextuple opposition, le recours aux déno-minations philosophiques (“inengendré”, “impassible”), nous y rencon-trons aussi l’opposition des natures (“homme”/“Dieu”), qui s’exprime entermes pauliniens, ou plus largement bibliques par l’opposition du “char-nel” et du “spirituel”, mais nous voyons également intervenir dans la con-fession des références plus concrètes, avec la mention de Marie et celle dela “mort” où est ultimement descendu le Fils de Dieu. On notera, là enco-re, que la pensée va de l’incarnation vers la passion, et que toute la confes-sion converge vers l’affirmation du caractère “passible” du Seigneur, trans-cendé ultimement par l’accession à une seigneurie désormais impassible.
Plus avant dans sa Lettre aux Éphésiens, Ignace reviendra rapidementsur l’antithèse de la double origine de Jésus: «Notre Dieu en effet, Jésus-Christ, a été porté dans le ventre de Marie, selon l’économie de Dieu, “dela semence (spermatos) de David” (Rm 1,3) et “de l’Esprit saint” (Mt 1,20b),lui qui est né et a été baptisé» 22.
Le contraste paradoxal est maximal entre la mention initiale de “Dieu”et le caractère concret, médical, du verbe qui suit au passif (ekuophorè-thè)23, entre la fonction de sujet grammatical qui est celle de «notre Dieu
20 On peut considérer, comme le fait A. WENGER, «A propos des Lettres...», cit., 315, que:«Théodoret de Cyr, de tendance dyphysite, et réagissant contre la formule à relent apollina-riste “en sarki genomenos theo” lui substitue la formule “en anthropo theos”; si le texte dumanuscrit médiéval, le Mediceus Laurentianus 57, 7 (XIe s.) porte effectivement: “venu en lachair, Dieu”», je serais pour ma part tentée de privilégier, pour l’ancienneté de sa transmis-sion et pour la rime interne (anthropo/thanato), la version rapportée par Théodoret (G.H.ETTLINGER [ed.], Eranistès, Florilegium I, 84, Clarendon Press, Oxford 1975, 96), mais aussi parATHANASE (De Synodis, 47, PG 26, 776c) qui écrivent «en un homme, Dieu». Dira-t-on qu’Atha-nase était adversaire de la théologie du «Verbe fait chair»? A. GRILLMEIER, Le Christ dans la tra-dition chrétienne, Cerf, Paris 1973, 128-129, ne pose pas le problème textuel, mais théorise,à propos de ce passage, la présence chez Ignace d’une conception de l’union logos/sarx.
21 Éphésiens 7,2, SC 10, 74-76.22 Ib. 18, 2, SC 86, une confession ramassée similaire revient à la fin de la Lettre, en ib.
22,2: «en Jésus-Christ, selon la chair de la race (ek genous) de David (Rm 1,3), fils de l’hom-me et fils de Dieu» (90); on notera l’expression «Fils de l’homme», qui évoque le langagede Jésus. Les deux désignations «fils de Dieu» et «fils de l’homme» apparaissent rappro-chées dans l’étonnant passage johannique évoquant «les morts entendant la voix du Filsde Dieu» (Jn 5,25) et recevant la vie, en fonction du jugement «car il est [aussi] fils de l’hom-me» (Jn 5,27).
23 Terme utilisé par les traducteurs de l’Ecclésiaste (Qo 11,5 LXX), et qui se rencontrecomme variante dans le corpus hippocratique, De natura muliebri 12.
128
Jésus-Christ» et sa passivité biologique, mais cette fois-ci le langage se faitplus “biblique”, avec l’allusion à la confession binaire qui ouvre l’Épître auxRomains24 ainsi qu’à l’annonce de l’ange à Joseph que nous trouvons audébut de l’Évangile de Matthieu. L’affirmation de la double origine de Jé-sus-Christ ouvre ensuite sur la narration, non plus symétrique, mais dia-chronique, de ses actions. Celles-ci sont explicitement rapportées à un plansupérieur: «selon l’économie divine»25.
Confessions narrativesUn autre type de confession, qui nous intéresse plus directement ici,
se centre sur l’action de Jésus-Christ, condensée en une série nourrie d’af-firmations généralement soutenues par l’adverbe “véritablement” (“alè-thôs”), ou parfois encore “fermement” (“bebaiôs”). Un exemple particuliè-rement ramassé est donné par la Lettre aux Magnésiens, que l’évêque d’An-tioche encourage à être «remplis de foi» «en la naissance, en la passion etla résurrection survenue à l’époque du gouvernement de Ponce Pilate,quant à ce que a été accompli (“prachthenta”) véritablement et fermementpar Jésus-Christ» (Magnésiens 9,1-2). La précision historique «au momentdu gouvernement de Pilate» inscrit avec conviction l’événement de la ré-surrection dans l’histoire de la Rome du siècle passé.
La confession contenue par la Lettre aux Tralliens est plus développée:
«...de Jésus-Christ,de la race (genos) de David, né de Marie,qui a été véritablement engendré,a mangé et a bu,a véritablement été poursuivi [en justice] sous Ponce Pilate,a véritablement été crucifié et est mort,à la vue des êtres célestes, terrestres et de dessous terre,
24 «Son fils (de Dieu), né de la semence de David (ek spermatos) selon la chair» (Rm 1,3),cf Jn 7,42, Actes 13,23 et 1Tim 2,8, où on lit aussi: «ek spermatos», qui semble faire partiedes confessions primitives sur Jésus. D’où vient «ek genous» au lieu de «ek spermatos», quise trouve en Éphésiens 20,2 et Smyrniotes 1,1? Faut-il supposer une transmission fluide dunoyau de la confession sur l’origine de Jésus, dont nous trouverions un écho en Apocalypse22,16 «Moi, Jésus [...], moi, je suis la racine et la race (genos) de David, l’étoile brillante dumatin», ou seulement un souci de variation chez Ignace?
25 L’usage théologique de ce terme, ainsi que de celui de “mystère” – qui sont les deuxnotions dominantes de la christologie d’Ignace –, s’enracine dans l’emploi qu’en fait, en sondébut, l’Épître paulinienne aux Éphésiens, parlant de la venue de Jésus-Christ et de sa fi-nalité: «nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté (de Dieu), selon son bon plaisirqu’il avait disposé à l’avance en lui-même, en vue de l’économie (oikonomian) de la pléni-tude des temps, dans l’intention de récapituler toute chose dans le Christ, les êtres célesteset les terrestres» (Ep 1,9-10).
129
qui s’est aussi véritablement réveillé de chez les morts,son Père l’ayant réveillé»26.
La confession est scandée par la récurrence de quatre “véritablement”,qui mettent en valeur la naissance, la passion (dont la véridicité se trouvedoublement soulignée) et la résurrection, et qui témoignent que le proposd’Ignace n’est pas seulement probatoire, mais avant tout confessant.
La dimension argumentative est cependant importante: l’humanitéauthentique de Jésus est attestée d’abord par ce qui fait tout être humain:la relation à des ancêtres et à des parents, la naissance biologique, l’ab-sorption de nourriture et de boisson, enfin la mort. Ces faits sont ici ga-rantis par des précisions historiques destinées à situer concrètement l’in-dividu: l’inscription dans une lignée donnée – nous retrouvons la mentionde la «race de David» –, la naissance d’une femme dont on précise le nom,les circonstances de son procès et de sa mort en relation avec la fonctionde Ponce Pilate comme gouverneur de Judée sous Tibère, connue par Lc3,1. Vers la fin de la confession, la perspective s’élargit, visuellement etthéologiquement: la mort de Jésus sur la croix apparaît comme une ouver-ture, où il se trouve exposé à la vue des êtres célestes (par son élévation)ainsi que des spectateurs terrestres, mais aussi – et l’allusion est plus mys-térieuse – des êtres qui sont sous la terre, dans le domaine des morts. Àtravers cette triple formule («célestes, terrestres et dessous terre») qui rap-pelle la triple vénération du nom de Jésus exalté après sa descente dansla mort en Paul, Philippiens 2,1027, la gloire de Jésus est manifestée, et sadescente aux Enfers discrètement évoquée28. La tonalité finale de la con-fession est de fait paulinienne, car Ignace n’a pas recours, comme le plussouvent, au verbe “ressusciter” (anistanai), il emploie ici «être réveillé»(egerthènai), qui est le verbe utilisé par Paul dans sa grande profession defoi christologique de 1Co 15,429.
26 Tralliens 9,1-2, SC 118. On notera la proximité de cette confession avec l’article chris-tologique du symbole de foi, et en particulier que les deux précisions «né de Marie» et «asouffert sous Ponce Pilate» se retrouvent dans le «Symbole des Apôtres», cf A.C. BAUDOIN,«Ponce Pilate: la construction d’une figure dans la littérature patristique et apocryphe»,thèse dactylographiée soutenue en juin 2012 en Sciences de l’Antiquité, EPHE, V° section(École doctorale 472: mention Religions et systèmes de pensée), chapitres 23-1, 815-826,et déjà 86 sq., «l’émergence de la formule “crucifié sous Ponce Pilate”».
27 «C’est pourquoi Dieu l’a exalté au-dessus de tout et lui a fait don du nom au-dessus detout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse des êtres célestes, terrestres et souter-rains et que tout langue confesse Jésus-Christ Seigneur à la gloire de Dieu le Père» (Phil 2,10).
28 Pour la descente aux enfers, cf Magnésiens 8,2 et Philadelphiens 5,2 évoquant le salutapporté par le Sauveur aux “prophètes” et patriarches qui l’attendaient.
29 «Je vous rappelle, frères, l’évangile que je vous ai annoncé [...] je vous ai transmis eneffet en premier que “le Christ est mort pour nos péché selon les Écritures”, qu’il a été en-
130
Les données précises mentionnées par Ignace ont toutes de multiplesinscriptions évangéliques, qu’il s’agisse de la lignée de David, du nom deMarie, de la “poursuite” judiciaire dont Jésus a fait l’objet, de sa cruci-fixion sous Pilate ou de la résurrection30. Un élément est particulièrementà relever, de notre point de vue: la mention: «il a mangé et il a bu»; à par-tir d’une reprise probable de la remarque de Mt 11,19 («mangeant et bu-vant»)31, ce rappel des nécessités biologiques de la nourriture et de la bois-son fera partie, tout au long de la tradition théologique, des passages obli-gés attestant la véritable humanité de Jésus.
La confession adressée aux Smyrniotes est la plus expansive, et nousintroduit directement à l’étude de la relation d’Ignace aux textes évangé-liques:
«remplis de foi en notre Seigneur,véritablement de la race (ek genous) de David selon la chair,/fils de Dieu selon la volonté (Jn 1,13 variante) et la puissance de Dieu (Lc 1,35)32,/issu véritablement d’une vierge,baptisé par Jean «afin que par lui soit accomplie toute justice» (Mt 3,15),véritablement, sous Ponce Pilate et Hérode le tétrarque, cloué pour nous dansla chair [...],«afin de lever son étendard pour les siècles» (Is 5,6) par sa résurrection, surles saints et sur ses fidèles, soit des Juifs soit des nations, dans le corps uni-que de son Église.Tout cela en effet, il l’a souffert à cause de nous, afin que nous soyons sauvés,et il a véritablement souffert, comme il s’est aussi véritablement ressuscité lui-même»33.
seveli, et “qu’il s’est réveillé (egerthè) le troisième jour selon les Écritures”» (1Co 15,1-4). Cfaussi 1Thes 1,10 «son Fils Jésus, qu’il a réveillé (ègeiren) des morts».
30 Pour la lignée de David: cf Mt 1,16-17 et Lc 1,27 et 32 etc.; pour le nom de Marie, Mt1,18 et Lc 1,27 etc.; pour la poursuite de Jésus devant Pilate, Mt 27,1 sq. et parallèles, Jn18,28 sq. etc., pour sa résurrection, outre les chapitres des évangiles canoniques, voir Ac-tes des Apôtres 2,23-24 etc. Il est remarquable qu’en Magnésiens 11,1, Ignace mentionne «larésurrection au moment du gouvernement de Ponce Pilate» (voir A.C. BAUDOIN, «Ponce Pi-late: la construction d’une figure dans la littérature patristique et apocryphe», cit., 85): nonseulement la passion, mais aussi la résurrection de Jésus est pour Ignace un événementhistorique concret, datable.
31 «Le Fils de l’homme est venu, mangeant et buvant» (Mt 11,19). Comme cela sera lecas dans les utilisations christologiques postérieures, la formule est détachée de tout con-texte narratif pour exprimer la pure humanité de Jésus.
32 Voir A. ORBE, Introduction à la théologie des second et troisième siècles, II, Cerf, Paris2012, 797, et déjà F.M. BRAUN, «Qui ex Deo natus est», in Aux sources de la tradition chré-tienne, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel 1950, 11-31, spécialement 22.
33 Smyrniotes 1,1-2 et 2,1.
131
Le développement est plus riche et plus complexe, et l’évêque sent lebesoin, au terme, de le clore sur une conclusion qui reprend l’essentiel dukérygme: la passion véritable et la résurrection véritable du Sauveur. Avantcette conclusion, le texte est scandé par trois “véritablement”, les deux pre-miers portant sur l’authentique naissance humaine de Jésus tout comme sursa conception virginale, et le dernier attestant la réalité de la passion. Nousretrouvons l’indication «de la race de David» (genos), la mention histori-que de Pilate, cette fois accompagnée de celle d’Hérode (Lc 3,1 et Lc 23,7-13 sur les rôles respectifs de Pilate et d’Hérode dans la passion de Jésus34),et rencontrons en outre le nom de Jean (Baptiste). Là encore, la fin de laconfession correspond à un élargissement de la phrase et de la pensée –spatiale et théologique –, obtenu cette fois par la reprise d’une métaphoretriomphale d’Isaïe – l’évocation de «l’étendard levé»35, et par l’évocation dela réunion des croyants des deux peuples dans l’unique corps de l’Église.
Cependant, la tonalité de ce texte est assez différente de la confessionaux Tralliens, qui était sobre et ramassée. Il s’agit, non pas seulement com-me pour les Tralliens de transmettre un donné de foi assuré, mais de l’in-terpréter et d’en dégager le sens théologique et économique: les élémentsde la vie du Christ qui se trouvent rappelés, la naissance virginale, le bap-tême, la passion et la victoire ultime, ne sont pas seulement des événements,mais, pour anticiper sur la terminologie même d’Ignace, des “mystères”dont il convient de percevoir toute la portée. J’en vois un indice dans la ré-currence de la conjonction finale “hina”, dont les deux premières introdui-sent des citations, l’une de l’Évangile selon Matthieu, la seconde d’Isaïe, etla troisième, dans la conclusion-résumé, explicite le «à cause de nous»(di’hèmas) en «pour que nous soyons sauvés». Il est caractéristique d’ob-server le parallélisme entre les deux premiers développements finaux:
«baptisé [...] pour que “soit accomplie toute justice” (Mt 3,15)»«cloué [...] “pour faire lever son étendard” (Is 5,26)»
Outre la similitude de traitement entre la référence à ce logion quelquepeu mystérieux de Jésus – spécifique de Matthieu qui est seul à introdui-re un dialogue entre Jésus et Jean au moment du baptême – et la reprisede l’image d’Isaïe, nous saisissons ici sur le vif la question du “pourquoi”qui se pose au théologien à propos des actions de Jésus36. Ignace n’apporte
34 Avec peut-être un écho d’Actes 4,26-27, selon le commentaire d’A.C. BAUDOIN, «PoncePilate: la construction d’une figure dans la littérature patristique et apocryphe», cit., 82-84.
35 Isaïe 5,26, cf ib. 49,22 et 62,10.36 Aux Éphésiens, Ignace disait, prenant à son compte cette explication: «il a été baptisé
pour (hina) purifier l’eau par sa passion» (Éphésiens 18,2). Voir ci-dessous partie 2.1.
132
pas de réponse directe, mais il répond par l’intermédiaire de ces référen-ces scripturaires qu’il introduit – et on constate ici que la référence évan-gélique est mise sur le même plan que celle au prophète. Le geste exégé-tique d’Ignace consiste à éclairer les faits dont il pose l’historicité par unelumière qui leur vient d’ailleurs, de la révélation des deux Testaments. Lacitation de la réponse de Jésus à Jean-Baptiste est intéressante car ellesuppose, au seuil de l’action publique de Jésus, une «justice à accomplir»,c’est-à-dire un plan divin à l’œuvre dans l’histoire37. Si cette déclarationde Jésus à Jean reste un peu sibylline, l’emprunt à Isaïe est beaucoup plusexplicite: l’économie à l’œuvre est celle de la victoire du Dieu Sauveur d’Is-raël, victoire qui regroupe sous un même étendard les élus d’Israël et ceuxdes nations.
Confession et visionOn peut rattacher encore à cette intention confessante l’évocation – qui
suit, dans la Lettre aux Smyrniotes, le texte que nous venons de prendreen compte – des apparitions de Jésus ressuscité. Ce passage vient en effet«sceller» la rétrospective de l’économie du Sauveur. Ignace y attache uneimportance particulière, comme l’indique la formule en “je” par laquelleil l’introduit avec force: «Quant à moi en effet je sais et je crois (kai...oidakai pisteuo) que même après sa résurrection il était dans la chair»38.
Le développement qui suit s’attache à mettre sous les yeux des desti-nataires de la Lettre une apparition de Jésus au groupe des disciples dési-gnés comme «ceux qui étaient avec Pierre» (hoi peri Petron). Ignace faitse succéder deux moments: tout d’abord (3,2) la représentation concrètede l’apparition, que l’on peut rapprocher de celle rapportée par Luc auchapitre 24 (Lc 24,36-43), et qui rappelle aussi la scène de l’apparition àThomas en Jn 21,26-2939. L’évêque y convoque Jésus ressuscité et le faitparler au style direct, avec une grande puissance d’expressivité, «ek pro-
37 Même H. KÖSTER, Synoptische Überlieferung bei den apostolischen Vätern, Akademie-Verlag, Berlin 1957, 58-59, si sceptique par ailleurs, reconnaît dans le contenu de la finale«pour que soit accomplie toute justice» une dépendance directe de Matthieu, dans la me-sure où l’expression relève de la spécificité rédactionnelle de Matthieu.
38 Smyrniotes 3,1, SC 10, 156.39 Les critiques sont partagés à ce propos, comme l’indique C.T. BROWN, The Gospel and
Ignatius of Antioch, Peter Lang Publishing, New York 2000, 50-51, n. 86, mais en généralle parallèle avec Luc est privilégié. A. GREGORY, The Reception of Luke and Acts in the periodbefore Irenaeus, Mohr Siebeck, Tübingen 2003, 70-75, se livre à un examen attentif du pro-blème posé par la superposition imparfaite entre Luc et Ignace: après avoir envisagé la pos-sibilité de la connaissance par Ignace d’un texte lucanien antérieur au texte alexandrin fixépostérieurement, il préfère à cette explication celle d’une source (écrite?) spécifique laquelleIgnace se serait référé, distincte de celle de Luc.
133
sopou Ièsou Christou», comme le traduit l’ancienne version grecque du DeViris illustribus de Jérôme. Il est à noter en effet qu’il s’agit ici du seul pas-sage des Lettres d’Ignace où Jésus, souvent désigné à la troisième person-ne, se trouve directement mis en scène comme locuteur, qui plus est pourune déclaration assez longue (du moins eu égard à la concision d’Ignace).En un second temps (3,3), après avoir inséré un commentaire en incise,Ignace rapporte de manière plus résumée et moins directe les repas deJésus ressuscité avec ses disciples, dont il donne une lecture théologique.Voici ce texte:
«Et quand il vint retrouver ceux qui étaient avec Pierre il leur dit: “Tenez, pal-pez-moi et voyez que je ne suis pas un démon incorporel”. Et aussitôt ils letouchèrent et crurent, saisis par sa chair et par son esprit (c’est pourquoi aussiils méprisèrent la mort et furent trouvés supérieurs à la mort). Et après sa ré-surrection, il mangea et but avec eux (sunephagen kai sunepien) en tant qu’êtrede chair, tout en étant spirituellement uni au Père»40.
Ce qu’il convient d’abord de remarquer, à mon sens, c’est qu’Ignace rendcompte ici assez fidèlement du contexte des récits que nous trouvons chezLuc 24 et chez Jean 21: le groupe de ceux qui entourent Pierre, réuni à l’in-térieur, voit venir à lui le ressuscité. Selon sa manière ramassée et allusi-ve, Ignace ne donne aucun détail permettant de situer plus précisément lascène évoquée, seules comptent les deux informations qu’il entend trans-mettre: l’auto-désignation de Jésus comme non fantomatique, et le fait de«manger et de boire». Nous avons vu que, dans la confession aux Tralliens,ce «il mangea et il but» était le seul élément de la vie de Jésus qui se trou-vait mentionné, en témoignage éloquent de son humanité authentique.Nous le retrouvons ici, avec l’ajout de la dimension communautaire (sun-), très probablement en écho à la déclaration de Pierre dans le résumé-ké-rygmatique de l’action de Jésus qu’il donne à Corneille: «à nous qui avonsmangé et bu avec lui (sunegagomen kai sunepiomen auto) après sa résur-rection» (Actes 10 41, qui clôt le résumé d’Actes 10,36-43).
Après l’invitation «tenez» (labete), le cœur de la phrase mise dans labouche de Jésus, «palpez-moi et voyez» correspond littéralement à ce quenous lisons en Lc 24,39, mais le contenu de la complétive qui suit «[voyez]que je ne suis pas un démon incorporel» se différencie de celui de Lc 24,39:«[voyez] qu’un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous me voyez enavoir», même si pour le sens il en est équivalent. Outre la présence possi-ble d’un tel énoncé, selon le témoignage d’Origène, dans la Doctrine dePierre, qui atteste peut-être une certaine fluidité dans la transmission du
40 Smyrniotes 3,2-3, SC 10,156.
134
dialogue41, on se rappellera qu’au début de son récit, deux versets plushaut selon l’Évangile de Luc, les disciples terrifiés «croient voir un esprit»(Lc 24,37).
Il est remarquable qu’Ignace suppose une réponse immédiate et con-crète des disciples qui touchent (hèpsanto) le ressuscité – action qui ne setrouve pas explicitement rapportée dans les récits évangéliques canoni-ques, mais qui reprend le schéma de succession entre une appréhensionpar les sens et l’acquisition de la conviction qui conduit à la foi des disci-ples. On est sans doute fondé à percevoir en effet, dans le «kai [...] oida kaipisteuo» inaugural, un écho de la notation de l’évangile de Jean à proposdu «disciple» arrivé au tombeau vide: «kai eiden kai episteusen» (Jn 20,8),lieu majeur de la proclamation de la résurrection de Jésus. Jérôme y a étésensible – au mépris de la grammaire latine (et grecque!) –, lui qui traduit:«ego vero et post resurrectionem in carne eum uidi et credo quia sit, etquando uenit ad Petrum et ad eos qui cum Petro erant, dixit eis: “eccepalpate me et uidete, quia non sum daemonium incorporale”, et statimtetigerunt eum et crediderunt42. On remarque le parallélisme dans la jux-taposition d’un acte de sensation et de la foi qui en découle, selon le pas-
41 F. BOVON, L’évangile selon saint Luc (19,28-24,53), III d, Labor et Fides, Genève 2009,461, parle à propos de la déclaration «je ne suis pas un démon incorporel» d’agraphon et de«sentence flottante». ORIGÈNE, Traité des principes I, par les soins de H. Crouzel - M. Simo-netti, Cerf, Paris 1978, préface, par. 8, écrit en effet: «si quelqu’un veut nous opposer le pas-sage du petit livre intitulé Doctrine de Pierre, où notre Sauveur aurait dit aux disciples: “jene suis pas un démon incorporel” (“non sum daemonium incorporeum”), il faut d’abord ré-pondre que cet écrit n’est pas de ceux qui sont reçus par l’Église», avec la claire intentionde discréditer une présentation “réaliste” de la résurrection de Jésus en un corps physique«solide et palpable» (ib. 86); ce faisant, il expose de manière claire et fidèle, me semble-t-il– quoique pour la rejeter –, la thèse qui est celle d’Ignace ici. Les éditeurs des Écrits apocry-phes Chrétiens de la collection de la Pléïade (vol. 1, F. BOVON - P. GEOLTRAIN (edd.), Gallimard,Paris 1997), en l’occurrence D.A. Bertrand, ne voient pas de «raison» de ne pas distinguer laDoctrine de Pierre (Didaskalia) de la Prédication de Pierre (Kèrugma) et, de ce fait, présententles deux séparément – notre énoncé se trouvant à la page 465 avec le peu qui se rapporte àla Doctrine de Pierre. Outre ce qu’en dit ici Origène, on ne sait rien de plus de la “Petri Doc-trina”, à l’exception d’une sentence sapientielle sans rapport avec les récits de la résurrec-tion citée par Grégoire de Nazianze (EAC, ib.). On ne supposera pas qu’Ignace se réfère àla Doctrine de Pierre, mais plutôt que l’évêque comme l’auteur du “libellus” connu d’Origè-ne dépendaient d’une même source. La déclaration de Lc 24,39 faisait l’objet de discussionsau second siècle, comme on le voit avec Marcion, cf A. ORBE, Introduction, cit., 1277-1278.
42 Jérôme avait suffisamment de sens historique pour ne pas faire d’Ignace un témoindirect de la résurrection de Jésus, son texte est donc plutôt un indice d’un rapprochementqu’il opère avec Jn 20,8, cf JÉRÔME, De viris illustribus 16, PL 23, 633. L’ancienne traductiongrecque de l’œuvre de Jérôme respecte ce choix et écrit «eidon kai pisteuo», contrairementau texte transmis d’Ignace et à la citation faite par EUSÈBE (Histoire Ecclésiastique 1,3,36,11Cerf, Paris 1952, 150). Dans son Commentaire sur Isaïe, Jérôme glose l’énoncé de Lc 24,7,«ils avaient l’impression de voir un esprit» par une variante qu’il dit tirer de «l’évangile du
135
sage de la vue à la foi chez «le disciple» et Pierre selon Jn 20,8, du tou-cher à la foi chez les disciples qui entourent le ressuscité.
Ignace lit ce récit dans une perspective théologique: Jésus revenu de lamort est certes pleinement humain et charnel, comme l’atteste l’insistan-ce sur l’action de manger, mais il se trouve uni, dit l’évêque, de manièretoute spirituelle à Dieu, plus étroitement qu’au cours de sa vie terrestre an-térieure – c’est au moins ce que suggère la précision finale du théologien:«tout en étant uni spirituellement au Père». D’ailleurs, la chair ressusci-tée de Jésus est elle-même étroitement unie à l’Esprit et vivifiée par lui, carles disciples qui touchent Jésus se trouvent eux-mêmes en retour «saisis»,«possédés», «dominés» (krathentes) par la chair et l’Esprit du Seigneur, quileur communique une force leur permettant de se montrer supérieurs àla mort. On le voit, l’introduction de Jésus au discours direct, la visualisa-tion insistante de la scène conduisent insensiblement, au-delà de l’expres-sivité et de l’hypotypose, à une compréhension théologique de l’épisode,qui constitue l’aboutissement de la confession qui précédait: les Smyrnio-tes sont, d’après l’ouverture de la Lettre, attachés, et même «cloués selonla chair et selon l’esprit à la croix du Seigneur Jésus-Christ», c’est-à-direqu’ils sont «remplis de foi» en son action aussi concrète que glorieuse etefficace: comme les apôtres qui se trouvent «dominés par la chair et l’es-prit» de Jésus, ils sont aussi les «fruits» (karpoi)43 de cette action.
2. Les actes de Jésus
Les mystères vécus (Éphésiens 17-20)Nous avons vu que les actions de Jésus avaient besoin d’une explication
qui les situe dans le cadre du plan de Dieu, explication qu’Ignace exprimeà l’aide de la conjonction finale «hina». Les principaux “mystères” qui re-
Nazaréen des Hébreux», qui au lien de «pneuma», («spiritus»), aurait porté «incorporaledaemonium» (on notera que le Codex de Bèze atteste pour sa part la leçon «phantasma»);l’usage que Jérôme fait de cette indication ne dit pas clairement s’il s’agit d’une variante duv. 37 ou du v. 39 qu’il cite ensuite (JÉRÔME, In Isaiam 18, PL 24, 628). Les critiques moder-nes n’ont pas relevé l’écho de Jn 20,8: on ne trouve rien à ce propos chez C. MAURER, Igna-tius von Antiochien und das Johannesevangelium, Zwingli Verlag, Zürich 1949, 104.
43 Le texte de Smyrniotes 1,2 à cet endroit est rude: après «véritablement attaché (cloué)pour nous dans la chair», l’unique manuscrit médiéval introduit une relative: «de ce fruit –aph’hou karpou – nous [sommes], de sa passion (apo tou pathous) divinement bienheureu-se», avec une insistance sur la fonction inaugurale et féconde de la passion exprimée parla répétition de la préposition «apo». Étant donné la proximité graphique du “upsilon” etdu “iota”, le passage de “oi” à “ou” est envisageable, ce qui donnerait un sens plus naturel:«aph’hou karpoi hèmeis», «dont nous sommes les fruits». Cependant, il n’existe pas de va-riante attestée.
136
tiennent son attention, selon l’expression d’Ignace qui les rapporte à une«économie divine» surpassant la sagesse humaine44, l’«économie de Dieu»45,«économie en vue de l’homme nouveau, Jésus-Christ»46, qu’il souhaite pou-voir mettre davantage en lumière dans un autre écrit47, sont la naissancevirginale, le baptême (et l’onction), et finalement la passion de Jésus48:
«La virginité de Marie et son enfantement, de même que la mort du Seigneuront échappé au prince de ce monde: trois mystères (musteria) à clamer, ac-complis dans le calme de Dieu»49.
De manière frappante, l’évêque présente ainsi le contraste entre la for-ce de la proclamation des mystères – le «clamer» – qui suivra la manifesta-tion de la divinité du Sauveur – et le caractère caché, humain, ordinaire,de leur réalisation effective avant la manifestation. Sa méditation admireautant, semble-t-il, le «calme» de Dieu qui agit dans le silence que le «cri»des créatures qui feront connaître cette action. Ici prend place, dans le coursdu discours aux Éphésiens, un excursus particulièrement développé50, detonalité para-apocalyptique, consacré à l’expression de la manifestation du
44 «La croix, qui est scandale pour les incroyants, mais pour nous salut et vie éternelle.“Où est le sage?” “où est le disputeur?” où est la vantardise de ceux qui se disent intelligents?Notre Dieu en effet, Jésus-Christ, a été porté dans le ventre de Marie selon l’économie deDieu [...]» (Éphésiens 18,1, SC 86). En invoquant avec insistance «l’économie divine», Ignacerappelle, à sa manière allusive, le début de la Première Épître de Paul aux Corinthiens: «Oùest le sage, où le disputeur?» (1Co 1,20), comme auparavant il évoquait le «scandale» de lacroix selon 1Co 1,23-24 (cf Ga 5,11). C’est tout ce passage paulinien du début de la Premiè-re aux Corinthiens qui se trouve donc ici à l’arrière-plan de la réflexion d’Ignace (cf P. FOSTER,«The Epistles of Ignatius of Antioch and the Writing that Later Formed the New Testa-ment», cit., 165).
45 Éphésiens 18,1, SC 86.46 Ivi, cf Ep 2,15: «faisant la paix en vue d’un seul homme nouveau». Il est intéressant
de voir Ignace se référer ici à la perspective économique d’unification des deux peuples envue d’une humanité nouvelle, exposée par Paul aux Éphésiens.
47 Éphésiens 20,1, SC 10, 90.48 Les trois mystères exprimés par des verbes en Ep 18,2, sont repris par des substan-
tifs (où se résume l’action) en Ep 19,1, selon le tableau suivant:Éphésiens 18,2
(verbes) Éphésiens 19,1 (substantifs)
«Il a été porté dans le ventre» Conception virginale (parthenia)
«il a été enfanté»
Enfantement (toketos)
«il a été baptisé […] par sa passion» Mort (thanatos)
� 49 Éphésiens 19, 1, SC 10, 88.50 La séquence est surprenante par sa longueur; toutes les autres allusions en effet sont
traitées, on l’a vu, de manière beaucoup plus concise et ramassée.
137
Dieu fait homme, qui prend, semble-t-il, pour arrière-plan le lever de l’étoi-le en Mt 2,2, combiné peut-être avec la venue de «l’étoile du matin» an-noncée par Zacharie en Lc 1,8-79, et de la «lumière des nations» saluéepar Siméon en Lc 2,30-32:
«Comment s’est-il alors manifesté aux siècles (aiones) ? Un astre dans le cielbrilla (elampse) au-dessus de tous les astres, et sa lumière était inexprimable,et sa nouveauté apportait de l’étrangeté; tous les autres astres avec le soleil etla lune formaient un chœur pour cet astre, et lui-même, par sa lumière exces-sive, était au-dessus de toute chose; d’où un trouble, pour savoir d’où venaitsa nouveauté sans similitude avec eux. À partir de là fut ruinée toute magieet disparut tout lien maléfique: l’ignorance fut ôtée, l’antique royaume détruit,Dieu se manifestant humainement en vue de la nouveauté de la vie éternelle.Et ce qui avait été ajusté par Dieu reçut un commencement. De là, tout étaitmis en branle à cause de la ruine de la mort qui se préparait »51.
Ce qui frappe avant tout dans ce texte surprenant, sommet de la Lettreaux Éphésiens – avant les réflexions conclusives et les salutations finales –,qui évoque sous un mode hellénique un «chœur (choros) des astres» ana-logue à la vision de Joseph en Gn 37,952, c’est la conjonction de l’annoncede la mise en branle de «l’économie divine», marquée par le lever inaugu-ral de l’astre nouveau, et de l’expression parallèle de la transcendance deson rayonnement, qui lui confère un caractère supratemporel53. La spéci-ficité d’Ignace ressort par comparaison avec deux textes similaires, sansdoute un peu plus tardifs:
Ignace, Éphésiens 19,2 Extraits de Théodote 74,2 Protévangile de Jacques 21,2 Un astre dans le ciel brilla au-dessus de tous les astres
Un astre se levait, Nous avons vu une étoile énorme qui brillait parmi ces étoiles-ci,
et sa lumière était inexpri-mable, et sa nouveauté ap-portait de l’étrangeté
étrange et nouveau
tous les autres astres avec le soleil et la lune formaient un chœur pour cet astre;
lui-même, par sa lumière excessive, était au-dessus de toute chose.
brillant d’une lumière nouvelle, qui n’était pas de ce monde
et qui les éclipsait au point que les autres étoiles n’étaient plus visibles.
�51 Ib., 19,2-3, SC 10, 88-90.52 Ce qui suppose la typologie Joseph-Jésus.53 La comparaison entre le texte d’Ignace et celui du Protévangile de Jacques fait ressor-
tir cette dimension supratemporelle, par contraste avec l’allure toujours narrative de l’apo-cryphe (Écrits apocryphes chrétiens, cit., 101), mais celle avec les Extraits de Théodote faitau contraire apparaître l’enracinement historique de la vision d’Ignace.
138
De fait, ce moment où l’évêque semble céder à l’inspiration prophétiqueprésente nettement deux versants: l’un qui exalte la prééminence incom-parable de la lumière de l’astre qui surgit et inscrit sa nouveauté (kainotès)dans une harmonie cosmique intemporelle, soulignée par la récurrence desimparfaits duratifs, l’autre qui développe le motif de la surprise, de l’étran-geté («xenismos») et insiste sur la rupture inaugurale54, passe ensuite del’imparfait à l’aoriste ponctuel en évoquant la réaction, le «trouble» provo-qué par cette apparition surprenante et ses résultats effectifs. Il énumèrealors quatre exemples d’effondrement de toute réalité maléfique rapportésultimement à la cause de cette disparition, qui intervient sous la formed’une clausule au génitif absolu «Dieu se manifestant humainement en vuede la nouveauté de la vie éternelle» (Ep 19,3). Au terme, un retour à l’im-parfait duratif accompagne l’évocation de l’inauguration de l’économie di-vine, désignée ici en termes plus concrets comme «ce qui avait été ajustépar Dieu» et dont la finalité est clairement indiquée: la «ruine de la mort».
On comprend, au-delà de la description d’une telle “vision”, que cetteexaltation de l’apparition de la lumière divine salue l’événement inaugu-ral de l’incarnation et de sa manifestation au monde, et qu’elle la présen-te comme orientée vers son accomplissement dans la victoire pascale. Iln’est pas interdit de lire aussi, à travers l’annonce de la défaite future detout mal, une tension eschatologique vers la réalisation plénière de ce qui,par le lever de «l’étoile brillante (astèr lampros) du matin» selon l’auto-désignation de Jésus en Apocalypse 22,16, s’est «mis en branle». Histori-quement, la lumière de l’étoile révèle la manifestation humaine de la di-vinité55, venant inaugurer la libération de tout lien et la destruction de lamort – avec tout ce qui s’y rattache – en vue de la vie nouvelle incorrupti-ble. S’il y a ici allusion à l’apparition de l’étoile en Matthieu 256, nous nous
54 Ignace accumule avec insistance en Éphésiens 19,3 les indications temporelles in-cluant le suffixe “-then” qui marque la provenance, l’origine, le point de départ.
55 Le schéma suivant met en forme le parallélisme entre la manifestation de l’astre etcelle du Dieu humainement manifesté. Au parallélisme des thèmes correspond leur super-position, voire leur identité.
Éphésiens 19,2 Éphésiens 19,3 Manifestation (phanerosis) de l’astre «Dieu s’étant manifesté humainement»
Nouveauté (kainotès) «en vue de la nouveauté de la vie» Trouble (tarachè) «à partir de quoi tout fut mis en mouvement
en même temps» Destruction (lusis, diaphtheiria) Destruction de la mort (thanatou katalusis)
� 56 Les thèmes traités et la tonalité générale sont assez différents, néanmoins le vocabu-laire rappelle celui de Mt 2,1-12: l’«astre» d’Éphésiens 19,2 renvoie peut-être à celui de Mt2,2, la «tarachè» d’Ep 19,3 rappelle le «etarachthè» de Mt 2,3, la «mageia» d’Ep 19,3 évoque
139
trouverions en présence de la plus ancienne version de la tradition syrien-ne qui voit dans l’étoile des Mages la manifestation du Christ lui-même,«astre du matin» et «astre de Jacob», conformément au sens messianiquede la prophétie de Balaam (Nb 27,17), qui marque aussi la fin de toute in-fluence astrologique57.
Ce texte, au premier abord figuratif et visionnaire, constitue donc enréalité, par-delà l’image à la fois biblique et hellénique du «chœur» oùapparaît une dernière fois dans la Lettre son “Leitmotiv” qui est l’harmo-nie, une méditation théologique sur la portée de l’incarnation, sur la nou-veauté radicale qu’elle induit en lien avec l’inauguration de l’économie dusalut, sur la manifestation humaine de Dieu et sur l’excès de lumière ca-chée sous ces actes obscurs qu’ont été la naissance, la plongée dans le Jour-dain, l’onction et la mort de Jésus, vus dans la continuité de l’économiedivine. On notera que la référence à l’arrière-plan biblique, qu’il s’agissedu songe de Joseph, de la péricope des mages ou même peut-être de l’Apo-calypse, est particulièrement souple et allusive: Ignace, dans ce momentd’éloquence inspirée, s’adonne à un libre exercice de méditation, d’appro-fondissement, de variation, comme nous le verrons dans le traitement qu’ilréserve aux “mystères” retenus.
A propos du baptême, le pourquoi de l’action prend en effet, dans laLettre aux Ephésiens, une valeur théologique profonde, mystérieuse: «No-tre Dieu en effet, Jésus-Christ, a été porté dans le ventre de Marie [...], luiqui est né et a été baptisé pour (hina) purifier l’eau par sa passion»58.
Le baptême, que la Lettre aux Smyrniotes resituera dans le contexte nar-ratif de Matthieu comme nous venons de le voir, est appréhendé ici de ma-nière transversale: à partir du sens métaphorique de “baptême” dans lelangage de Jésus59 et, conjointement, de la théologie paulinienne de l’en-
les «magoi» de Mt 2,1. Enfin, si le «royaume ancien» (palaia basileia d’Ep 19,3) se rapported’abord à l’ancienne époque de la domination des puissances angéliques liées aux astres, ilpourrait évoquer aussi le règne finissant d’Hérode (Mt 2,1 et 19). La liberté de l’allusionéventuelle peut s’expliquer par la popularité d’un récit qui pouvait être bien connu des des-tinataires d’Ignace. Le Protévangile de Jacques, antérieur à Clément d’Alexandrie (voir l’in-troduction d’A. FREY, Écrits apocryphes chrétiens, cit., 73, n. 1, dans laquelle il fait aussidu «trouble» de la Judée et de l’excès de lumière de l’étoile les deux caractéristiques du ré-cit de la venue des Mages (Protévangile de Jacques, par. 21, EAC, 101).
57 J. DANIÉLOU, Théologie du judéo-christianisme, Cerf, Paris 1958, 240-241, nouvelle édi-tion, Cerf, Paris 1991, 273-284; A. BASTIT, «Chrysostome et l’exégèse des Homélies sur Mat-thieu: l’exemple de la péricope des mages (Mt 2,1-12) », in Giovanni Crisostomo, Oriente eOccidente tra IV e V secolo, , Augustinianum, Roma 2005, 315-333, et surtout A. ORBE, In-troduction, cit., 871-880, en particulier ici 873.
58 Éphésiens 18,2, SC 10,86.59 Cf Mc 10,38-39; Lc 12,50.
140
sevelissement dans la mort60, la plongée de Jésus dans le Jourdain est vuecomme une action dont l’effet est de purifier l’eau baptismale par l’événe-ment de sa mort. La pénétration dans le Jourdain et la descente dans lamort sont vues en continuité, d’autant que l’imaginaire biblique associaitl’eau profonde à l’habitation d’êtres mauvais comme «le dragon que Dieufit pour en rire» (Ps 103,26b LXX)61. Ce qui est frappant ici est la synthè-se économique de l’évocation d’Ignace, partant de l’événement du baptê-me de Jésus pour aboutir à sa passion qui en offre le sens et en constituel’accomplissement; encore au-delà, par le mouvement d’élargissement quenous avons déjà noté, la pensée de l’évêque prolonge, semble-t-il, sa mé-ditation – en précisant «afin de purifier» – jusqu’à la prise en compte del’efficacité actuelle, dans l’Église, de l’eau par laquelle le baptême est con-féré aux fidèles.
Un peu plus haut dans le même développement de la Lettre aux Éphé-siens, Ignace faisait passer devant les yeux de ses destinataires un autre“flash” transversal, particulièrement mystérieux et suggestif, qui attesteplus encore la profondeur de sa méditation des actes vécus par le Christ:«c’est à cause de cela que le Seigneur a reçu l’onction sur la tête, afin (hina)d’exhaler pour son Église [une odeur d’]incorruptibilité»62.
Nous retrouvons la proposition finale explicative, ici renforcée encorepar l’annonce: «c’est à cause de cela» (dia touto), car ce qui importe à Igna-ce est de souligner la continuité entre l’onction reçue par le Christ et le par-fum d’incorruptibilité qu’il communique à «son Église». Mais l’expressionest tellement ramassée qu’elle frôle l’énigme. De quelle onction s’agit-il? Onpense d’abord à «l’onction» d’Esprit, reçue au baptême et revendiquée parJésus dans la synagogue de Nazareth, à partir de la lecture d’Isaïe 61,1:«L’Esprit du Seigneur est sur moi, c’est en vue de cela qu’il m’a oint» (Lc4,18)63. Cette onction évoque celle d’Aaron (Lev 8,12) ou des rois élus par leSeigneur, comme Saul ou David, qui était reçue «sur la tête» (1Samuel 10,1et 16,13). Néanmoins, l’onction du baptême pour Jésus est toute spirituel-le, et le contexte – orienté vers les «mystères» vécus par «l’homme nouveau»– indique qu’Ignace pense à un moment concret de la vie de Jésus, où ce-lui-ci a effectivement reçu une onction «sur la tête». Ceci nous renvoie auxdeux récits de Matthieu et de Marc, qui rapportent une telle onction reçuepar Jésus dans une maison de Béthanie (Mt 26,7, cf Mc 14,3). Le récit pa-rallèle de l’onction chez Jean évoque les gestes successifs de Marie qui a oint
60 Cf Rm 6,3-4a.61 J. DANIÉLOU, Bible et liturgie, Cerf, Paris 1951, 59, 104-121 et 131.62 Éphésiens 17,1, SC 10, 86.63 A. ORBE, La Uncion del Verbo, Università Gregoriana, Roma 1961, 9-13.
141
les pieds de Jésus, avant de s’arrêter sur l’effet de cette action: «et la mai-son fut remplie du parfum de l’onguent» (Jn 12,3). Il semble qu’Ignace as-socie ces données, et qu’il pense à la diffusion de l’odeur dans la «maison»qu’est figurativement l’Église64. Mais plus intimement encore, Ignace, quiécrira aux Tralliens: «Ainsi donc, la tête ne peut pas être sans les mem-bres»65, suppose sans doute présente à la mémoire de ses destinataires éphé-siens la continuité entre le Christ, qui est la «tête», et son corps, qui est l’Égli-se (Ep 1,22 etc.), que Paul avait formulée dans l’Épître qu’il leur avait adres-sée un bon demi-siècle plus tôt66. Dans cette même lettre paulinienne, l’Apô-tre avait présenté le sacrifice du Christ comme «offrande de bonne odeur»:«le Christ nous a aimés et s’est donné lui-même pour nous, offrande et sa-
64 On relèvera d’ailleurs que les récits de Matthieu et Marc, très voisins entre eux, rem-placent l’évocation de la diffusion du parfum par une allusion à la diffusion de l’évangile«dans le monde entier», où le geste de la femme se trouvera raconté (Mt 26,13 et Mc 14,9).La lecture figurative de l’Église ancienne verra volontiers ainsi dans la maison le «monde»où se diffuse la bonne odeur du Christ. Dans ses Homélies sur le Cantique, comme aussi dansson Commentaire, Origène rapproche l’onction reçue par le Christ sur la tête des versets duCantique: «ton nom est un parfum répandu («muron ekkenothen»)» (Ct 1,3b, ORIGÈNE, Ho-mélies sur le Cantique 1,4 et ID., Commentaire sur le Cantique des Cantiques 1,4) et «mon narda donné son odeur» (Ct 1,12, ORIGÈNE, Homélies sur le Cantique 2,2 et ID., Homélies sur leCantique 2,2 sq). Il semble rappeler un exégème connu lorsqu’il écrit: «ceci (la mention dela diffusion de l’odeur dans la maison en Jn 12,3) indique de toute façon que l’odeur de l’en-seignement (doctrinae = didaskalias) qui provient du Christ et le parfum de l’Esprit-Saintont rempli toute la maison de ce monde, ou la maison de l’Église entière» (ORIGÈNE, Homé-lies sur le Cantique 2,9,5, SC 375, 438); voir aussi THÉODORET, Sur le Cantique (sur Ct 1,3), oùil évoque les Apôtres qui, dans leur course par laquelle ils transmettaient le kérygme, «ontrempli de bonne odeur la terre habitée entière» et fait explicitement le rapprochement avecla communication de l’Esprit par la chrismation (PG 81, c. 60b); cf le fragment caténiquede Théodore d’Héraclée évoqué par W. Bauer à propos de Jn 12,3, où on lit: «aussitôt eneffet après la passion du Christ la création entière, comme une vaste maison, fut rempliede l’onguent de la bonne odeur du Christ», je cite d’après H. KÖSTER, Synoptische Überliefe-rung bei den apostolischen Vätern, cit., 56).
65 Tralliens 11,2, SC 10, 120.66 Il est très vraisemblable de supposer que la communauté d’Éphèse conservait, à l’épo-
que d’Ignace, la lettre qui lui avait été adressée par Paul. Ignace lui-même y fait explicite-ment allusion, en Éphésiens 12,2, lorsqu’il dit que Paul «dans toute ses Lettres – ou peut-être simplement dans toute sa Lettre (en pasa epistolè) – se souvient de vous dans le ChristJésus», après avoir appelé les Éphésiens: «co-initiés avec Paul, le consacré, le témoin, di-gne [d’être appelé] bienheureux, dans les traces duquel j’aspire à être trouvé quand j’attein-drai Dieu». La remarque suppose aussi, naturellement, qu’Ignace lui-même disposait dutexte – peut-être en possédait-il le rouleau? – de l’Épître paulinienne, ainsi que des autresLettres où Paul mentionne les Éphésiens, voir en ce sens P. FOSTER, «The Epistles of Igna-tius of Antioch and the Writing that Later Formed the New Testament», cit., 163-164, 172et 185. Nous avons un aperçu de l’activité de l’Église d’Éphèse à la fin du premier siècle parApocalypse 2,1-8, cf J.P. LEMONON, «Les christianismes à Ephèse au I° siècle», in M. BERDER
(ed.), Les Actes des Apôtres. Histoire, Récit, théologie, Cerf, Paris 2005, 85-119.
142
crifice en parfum de bonne odeur» (Ep 5,2). Selon les trois versions de Mat-thieu, Marc et Jean, l’onction reçue par Jésus précède de peu sa passion, etJésus déclare qu’il s’agit d’une anticipation de sa «sépulture» (Mt 26,12; Mc14,8; Jn 12,7): l’onction a donc, par avance, comme fonction de conserverle corps de Jésus et de le préserver de la corruption. Dans la lecture qu’Igna-ce fait de l’épisode, dont nous avons vu qu’elle cherche à pénétrer la finali-té de ce moment évangélique, l’onction parfumée vise, au-delà de la mort,la diffusion de l’Esprit reçu par le Christ à l’Église, comme en témoigne Jeandans son prologue «de sa plénitude tous nous avons reçu, grâce aprèsgrâce» (Jn 1,16)67: à terme, selon Paul, celle-ci peut dire: «nous sommesdevant Dieu la bonne odeur du Christ» (2Co 2,15).
À travers cette association, harmonieuse et cohérente, d’arrière-plansdifférents, la pensée d’Ignace, habitée par la méditation de la mort, s’atta-che ainsi d’abord à «l’économie divine», qui s’enracine dans le passé – lesévénements vécus par Jésus, sur lesquels il pose un regard contemplatif –mais se projette dans le présent et l’avenir des Églises: le Christ, sans dou-te par sa résurrection qui accomplit son baptême, a reçu l’incorruptibili-té, il l’a reçue pour lui mais davantage encore pour son corps qui est l’Égli-se et auquel il la communique comme un parfum qui se diffuse, peut-êtredéjà matérialisé par des onctions sacramentelles. La suite immédiate, quirenoue avec le contexte antérieur de mise en garde, toujours à partir duchapitre 5 de l’Épître paulinienne aux Éphésiens68, à l’encontre du «mau-vais enseignement» (kakè didaskalia) susceptible de «corrompre (phthei-rein) la foi»69, montre Ignace renversant l’image en son contraire négatif:«ne vous enduisez pas de la mauvaise odeur de l’enseignement du prince
67 C’est ORIGÈNE qui rapproche ce verset johannique de la diffusion de la bonne odeurdu Christ (Commentaire sur le Cantique des Cantiques 1,4,27 sur Ct 1,3b)
68 Le début du chapitre 5 de l’Épître de Paul aux Éphésiens est très sollicité dans cesparagraphes de la Lettre d’Ignace: en 16,1, il cite une mise en garde de la première aux Co-rinthiens (1Co 6,10, voir ci-dessous point 3, introduction) dont un équivalent très prochese lit en Ep 5,3-5. L’avertissement de se garder du «mauvais enseignement» rappelle le ver-set suivant d’Ep 5,6: «que personne ne vous trompe par de vains discours», la méditationsur l’onction et la diffusion (pnein) de l’odeur fait sans doute écho à Ep 5,2 sur l’offrandedu Christ pour l’Église en «parfum de bonne odeur». Quant à l’attaque de ce chapitre pau-linien: «devenez imitateurs de Dieu» (Ep 5,1), elle était citée à l’ouverture de la Lettre d’Igna-ce aux mêmes Éphésiens (voir point suivant, 2.2). En outre, l’injonction paulinienne d’Ep5,21 se trouve reprise en Magnésiens 13,2, et le conseil de la Lettre à Polycarpe 5,1b rappel-le beaucoup Ep 5,25. En Philadelphiens 2,1, on peut entendre de même un écho d’Ep 5,8«en enfants de lumière», souligné par une identité d’emploi stylistique «enfants de la lumiè-re de vérité», en attaque de la phrase également (Philadelphiens 2,1). Ces correspondancesn’ont pas été relevées par les critiques (cf W.R. INGE, «Ignatius», cit., 68).
69 Éphésiens 16,2, SC 10, 84. On notera que l’«aphtharsia» d’Éphésiens 17,1 répond à ce«phtheirein» de 16,2.
143
de ce monde»70. À travers la continuité de la métaphore, on passe sansrupture de la théologie à la parénèse, de la considération du Christ oint,qui communique «véritablement [à l’Église] son charisme» – mais aussi la«connaissance de Dieu»71 –, à la mise en garde communautaire.
Un modèle vécuA l’intention des Éphésiens et des Tralliens, Ignace insère à deux repri-
ses, dans l’adresse aux Églises qui ouvre ses lettres, la formule paulinien-ne de l’Épître de l’Apôtre aux Éphésiens: «devenez donc imitateurs de Dieu»(Ep 5,1)72. Par ailleurs, dans la Lettre aux Philadelphiens, il présente com-me parole inspirée par l’Esprit sa déclaration proclamée parmi eux, se ter-minant par: «devenez imitateurs de Jésus-Christ, comme lui-même l’estde son Père». Dans sa propre Lettre aux Éphésiens, il reprend encore cethème, dans un contexte d’affrontement: «efforçons-nous d’être imitateursdu Seigneur», et poursuit en donnant le «Seigneur» comme modèle de pa-tience et de support des torts: «Qui a subi un plus grand tort ? qui s’esttrouvé davantage dépouillé ? qui a été [comme lui] supprimé ?» (Lettre auxÉphésiens 10,3).
Nous surprenons ici le regard d’Ignace – qui écrira que dans l’évangilese trouve «montrée» la passion (Smyrniotes 7,2) – posé sur le Christ souf-frant, dont les épreuves sont évoquées selon une gradation dans l’anéan-tissement, non sans référence sans doute à l’arrière-plan de la prophétiedu Serviteur en Isaïe 53. Sur cette base, l’évêque passe finalement de la con-templation à la parénèse, pour exhorter les Éphésiens à la patience et ausupport des offenses. C’est l’attitude même de Jésus, maître qui enseigneet sauveur silencieux, qui peut s’incarner dans le disciple assimilant inté-rieurement la personne du Christ, en tension vers la perfection, «afin d’agirpar ses paroles et de se faire connaître par son silence» (Éphésiens 15,2).
L’action accomplie par le Sauveur est donnée en modèle au chrétien,non seulement pour des gestes particuliers, mais en son inspiration et ensa visée profondes. Après avoir énuméré les œuvres de miséricorde, quiévoquent aussi bien les préceptes de l’Exode (32,21-22) que les œuvres de-mandées par «le roi» de Mt 25,35-36 – se préoccuper de la veuve, de l’or-phelin, de l’opprimé, du prisonnier et de celui qui sort de prison, de celui
70 Éphésiens 17,1-2, SC 10, 86. L’Épître de Jacques évoquait, pour sa part, une sagesse(sophia) “diabolique” (cf Jc 3,15).
71 «Et pourquoi ne devenons-nous pas tous sages en recevant la connaissance de Dieu,qui est Jésus-Christ? Pourquoi périr follement dans la méconnaissance du charisme, quele Seigneur nous a véritablement envoyé» (Éphésiens 17,2, SC, 86).
72 Ib., 1,1 et Tralliens 1,2.
144
qui a faim et soif73 – (Smyrniotes 6,2), Ignace montre Jésus en modèle decharité pour autrui puisque «sa chair a souffert pour (huper) nos péchés»(ib. 7,1). S’adressant à Polycarpe, Ignace écrit: «aime ceux qui partage tavie, comme le Seigneur aime l’Église»74, et auparavant: «porte tous [lesfidèles], comme le Seigneur te porte»75, «porte les infirmités de tous!»76.Cette dernière expression renvoie à un double arrière-plan: à la prophétied’Isaïe 53,4, mais plus encore à l’application que l’évangéliste en fait en Mt8,1777: Matthieu, en invoquant ce verset prophétique après la mention desguérisons opérées par Jésus, montre dans la solidarité de Jésus avec lesinfirmes l’accomplissement de cette prophétie. Le conseil donné par Igna-ce à Polycarpe suppose donc une perspective de l’imitation par l’évêquede l’attitude de Jésus, en répétant avec insistance «comme le Seigneur»78.Enfin Ignace, qui se présente, selon l’exemple de Jésus, venu servir et don-ner sa vie, comme «le serviteur – et le dernier – de tous» (Mt 20,28, cf Mc9,35), par son martyre en puissance est «imitateur de la passion de sonDieu» (Romains 6,3).
En conclusion de cette première partie, nous pouvons déjà récapitu-ler quelques résultats de ces analyses: certes, Ignace est attaché à l’histo-ricité, à l’enracinement concret des actions de Jésus: celui-ci a vécu en untemps donné, et si «Dieu s’est manifesté humainement» (Éphésiens 19,3),c’est avec une authentique corporéité, caractérisée par la naissance, lemanger et le boire, la souffrance, la mort physique. Pourtant, cette dimen-sion réaliste, insérée dans le cadre plus vaste d’une théologie opposant lepassible à l’impassible, le divin à l’humain en Jésus, ne doit pas faire oublier
73 On constate là encore une gradation de l’abstrait – relatif – au concret.74 À Polycarpe 5, 1b, SC, 174, très proche du conseil paulinien d’Ep 5,25: «aimez vos fem-
mes comme le Christ a aimé l’Église».75 À Polycarpe 1, 2, SC 10, 170.76 Ib. 1,3, SC 10, 170.77 C’est ce qui ressort de l’examen parallèle du texte massorétique d’Isaïe, de celui des
LXX et de la version de Matthieu auquel se livre H. KÖSTER, Synoptische Überlieferung beiden apostolischen Vätern, cit., 32-33. Dans la Lettre de l’Église de Rome à celle de Corin-the, dite Prima Clementis, au par. 16, Clément cite in extenso le long passage d’Isaïe sur leServiteur souffrant, mais reproduit en général, et en particulier pour le verset d’Is 53,4 enquestion ici, le texte des Septante (1Clem 16, 4).
78 E. CATTANEO, «La figura del vescovo...», cit., montre à la page 524 que, chez Ignace, lemodèle évangélique du disciple (mathètès) et le paradigme paulinien de l’“imitatio Christi”(mimètès) se confondent. Voir auparavant T. PREISS, «La mystique de l’imitation du Christet de l’unité chez Ignace d’Antioche», in Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses 18 (1938)197-242, repris in ID., La Vie en Christ, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel/Paris 1951, et W.M.SWARTLEY, «The imitatio Christi in the Ignacian Letters», in Vigiliae Christianae 27 (1973) 81-103.
145
la préoccupation première d’Ignace, en ce qui concerne l’enseignement dela foi, qui est de «mettre en lumière» («prosdèloun») «l’économie divine»,celle qui est «en vue de l’homme nouveau» (Éphésiens 20,1). En ce sens,les événements de la vie de Jésus qu’il prend en compte ne sont pas pré-sentés uniquement comme des “faits”, des données historiques (qu’ils sontaussi pour l’évêque), mais comme des moments d’une construction divi-ne, «ce qui a été ajusté par Dieu» (Éphésiens 19,3). Dans cette perspectiveoù la mission de Jésus est «d’accomplir toute justice», les actions de Jésussont portées par une finalité, qu’exprime de manière répétée le recours,dans la langue d’Ignace, aux proposition finales explicatives, dont l’exem-ple le plus insistant et le plus ramassé se trouve dans le condensé final dela confession aux Smyrniotes: «Tout cela en effet, il l’a souffert à cause denous, afin que nous soyons sauvés» (Smyrniotes 2,1). Ainsi, les actes deJésus, sa manifestation, son baptême, l’onction reçue, sont-ils pris dans uneperspective plus large, qui relie étroitement l’histoire vécue par Jésus et seseffets actuels dans la communauté. La «manifestation humaine» du Ver-be a bouleversé l’histoire du monde, elle a préparé libération et «dissolu-tion de la mort» pour «la nouveauté de la vie éternelle» (Éphésiens 19,3).De manière plus immédiate, le baptême et l’onction reçus par le Christ vi-sent en profondeur la vie de l’Église: le baptême de Jésus en a purifié leseaux, l’onction lui a communiqué l’incorruptibilité. Il ne s’agit pas d’unelecture “allégorique”, qui ajouterait à l’événement visé un sens symbolique,il s’agit aux yeux de l’évêque de la visée propre de ces événements, de leurseule et unique finalité, qui est la transmission de la grâce à l’Église. Dansle cadre de l’écriture de concision qui est la sienne dans les Lettres, l’inter-prète n’envisage pas de “raconter” l’événement passé, il en dégage le traitcaractéristique où se trouve condensé le sens.
Enfin, Ignace est aidé dans ce mouvement à la fois théologique et ac-tualisant par sa fréquentation des Épîtres pauliniennes, qui affleurent fré-quemment dans son écriture. Tout se passe comme si, par exemple, pourécrire aux Éphésiens, il s’était à nouveau pénétré de l’Épître paulinienneà la même Église d’Éphèse – il le suggère lui-même en évoquant devantses destinataires le contenu de la Lettre, et en exprimant le souhait d’êtretrouvé «dans ses traces». L’écriture de Paul constitue comme une matricequi porte et informe celle de l’évêque, mais ce dernier, comme Paul, nequitte jamais tout à fait la considération de l’action du Christ, même dansles conseils les plus concrets donnés à la communauté. C’est pour cetteraison aussi qu’on peut passer si facilement de la prise en compte des évé-nements passés à la vie présente de la communauté, selon une lecture ac-tualisante, non seulement des moments vécus par Jésus, mais aussi de sesparoles, comme nous le verrons dans la partie suivante sur les logia.
146
3. L’usage des paroles
Le rapport d’Ignace à la citation est complexe. Il cite peu d’énoncésentiers, modifie volontiers les sentences qu’il reprend mais offre au lecteurune mosaïque de micro-unités textuelles insérées dans son discours. Il estd’autant plus remarquable de le voir se référer explicitement à des cita-tions directes, comme dans le cas du fameux “gegraptai”, «il est écrit», quiintervient à deux reprises chez Ignace pour annoncer à chaque fois, dansla Lettre aux Éphésiens puis dans celle aux Magnésiens, une citation desProverbes: «Dieu s’oppose aux orgueilleux» (Pr 3,34)79 et «le juste est sonpropre accusateur» (Pr 18,17)80. On rapprochera cet emploi sapientiel desProverbes de la citation de l’adage de Mt 19,12: «que celui qui en est ca-pable comprenne» (Smyrniotes VI,1). Cette expression proverbiale, récur-rente dans les évangiles81, se trouve ici parfaitement détachée de tout con-texte et utilisée comme une maxime générale. En Magnésiens 5,1, l’évê-que paraphrase le Deutéronome: «devant [toi] les deux ensemble, la mortet la vie» (cf Dt 30,19)82. Dans la Lettre aux Tralliens, un “gar” introduitune citation d’Isaïe 52,5, plutôt développée quant aux habitudes d’Igna-ce: «malheur à celui par la légèreté duquel mon nom sera blasphémé»83.Enfin, une mise en garde similaire de Paul dans la Première aux Corin-thiens se trouve rapportée deux fois par Ignace, qui la commente aux Éphé-siens et aux Philadelphiens (avec réécriture accommodatrice dans le se-cond cas): «ne vous y trompez pas, mes frères84, les ... [suit une énuméra-tion de dix vices] n’hériteront pas le royaume des cieux» (1Co 6,10)85. Endehors de ces quelques reprises d’énoncés plus ou moins complets, donton notera la tonalité prophétique d’avertissement parfois sévère (telle l’in-vocation de la «colère qui vient», cf Mt 3,7= Lc 3,7)86, et compte non tenu
79 Éphésiens 5, 3, SC 10, 74.80 Magnésiens 12, SC 10, 106.81 Avec en outre le jeu de reprise interne: «ho choron choreito», voir Mt 19,12.82 Cette allusion, qui me paraît très nette, n’est pas signalée par l’édition des Sources
Chrétiennes, et n’apparaît pas non plus chez W.R. INGE, «Ignatius», cit., 63).83 Tralliens 7,2. Cette même citation sera reprise par Polycarpe dans sa Lettre aux Phi-
lippiens (10,3).84 L’expression «mes frères», «adelphoi mou», deux fois à cette place chez Ignace, n’est
pas dans le texte reçu de la Première aux Corinthiens.85 Éphésiens 16,1 et Philadelphiens 3,3. Nous avons vu ci-dessus (n. 68), que cette cita-
tion de la Première aux Corinthiens était très proche d’une déclaration parallèle de l’Épîtrede Paul aux Éphésiens (Ep 5,3-5).
86 Éphésiens 11,1: si l’expression «colère à venir» est évangélique, venant de la bouchede Jean-Baptiste (Mt 3,7= Lc 3,7), on lit dans les premiers versets du chapitre 5 de l’Épîtrede Paul aux Éphésiens, si présents à la pensée d’Ignace: «la colère de Dieu vient...» (Ep 5,6,
147
de la mise en scène au discours direct de la déclaration de Jésus ressusci-té (voir ci-dessus I, 3), tout le reste est beaucoup plus diffus, morcelé, re-pensé, reformulé. Mais le caractère minimal et comme cellulaire de la ré-férence ne doit pas masquer sa diffusion dans le texte, d’autant plus grandeen un sens que les passages invoqués se retrouvent morcelés.
En ce qui concerne les Évangiles canoniques – particulièrement les pa-roles de Jésus –, il convient de distinguer trois cas principaux, si on prenden compte les allusions: - les allusions plus ou moins explicites; - les citations identifiables comme telles, même reformulées ou remaniées; - la simple reprise de termes ou d’images isolés.
On compte approximativement une vingtaine d’allusions, ou reprises,ou quasi citations correspondant à ce qu’on trouve dans les Synoptiques(en grande majorité chez Matthieu), et une dizaine de renvois johanniques(voir tableau en annexe). Tous ces moments ont tantôt une fonction théo-rique, proches là encore de la confession, tantôt une fonction parénétique,tantôt enfin, sans que ce soit exclusif des deux autres lignes dégagées, unefonction d’expressivité, à travers le jeu des métaphores et des antithèses.Ces utilisations, surtout les deux dernières, répondent à une préoccupationactualisante, il ne faut donc pas s’étonner si le contexte des versets se trouvequelque peu, ou même davantage, déplacé, sortant de leur «Sitz in Leben»évangélique87 pour correspondre aux réalités des communautés asiates.
Fonction théorique:«La connaissance de Dieu - qui est Jésus-Christ» (cf Mt 11,27)88
La pensée d’Ignace, nous l’avons vu, revient fréquemment sur le mys-tère du Christ. On le constate, non seulement par le rappel de ce que Jé-sus a vécu, mais aussi dans le recours à ses paroles: Jésus est «la bouchesans mensonge, en laquelle le Père a parlé en vérité»89. En témoignent cespassages d’inspiration johannique, en particulier dans les deux premièresLettres, celles aux Éphésiens et aux Magnésiens – écrites peut-être avec
cf 1Thes 1,10). Cf aussi, en Éphésiens 16,2, la mention du «feu inextinguible» (Mt 3,12 etLc 3,17), qui appartient au même discours de Jean, dont on note la récurrence dans cetteLettre d’Ignace.
87 C’est ce qu’à mon sens ne voit pas H. Köster, quand il refuse, par exemple, d’authen-tifier l’affinité de «il mangeait et buvait» de Tralliens 9,1 avec le «mangeant et buvant» deMt 11,19 au motif d’une trop grande disparité dans le «Sitz in Leben» de ces deux énoncés,voir H. KÖSTER, Synoptische Überlieferung bei den apostolischen Vätern, cit., 28.
88 Éphésiens 17,2, cf aussi Romains 8,2.89 Ib., 8,2, SC 10, 136.
148
davantage de recul –, où l’évêque médite sur le lien du Verbe au Père. Cesmoments théologiques sont insérés dans des développements parénéti-ques: ils attestent qu’en même temps que le docteur enseigne et avertit,sa pensée reste fixée sur les mystères qu’il confesse et aime à rappeler,comme en passant et sans s’y attarder.
Dans la Lettre aux Éphésiens, il affirme que Jésus est «uni au Père»90.Dans la Lettre aux Magnésiens, il évoque, conformément au prologue deJean, la présence de Jésus-Christ «avant les siècles auprès du Père» 91, puissa «venue du Père» pour y retourner selon un schéma très johannique92,sa «manifestation à la fin», c’est-à-dire dans les derniers temps de l’éco-nomie. Il est «le grand-prêtre», selon la terminologie de la Lettre aux Hé-breux, «auquel a été confié le saint des saints, à qui seul ont été confiéesles choses cachées (ta krupta) de Dieu (cf Dt 29,28)»93. Ainsi, dit-il auxÉphésiens, il est possible de devenir “sages” en recevant «la connaissancede Dieu, qui est Jésus-Christ»94.
Un peu plus loin dans le développement aux Magnésiens, Ignace insistesur le fait que la foi au Dieu unique manifesté par son Verbe à travers sonhumanité est la réponse à ceux qui refusent de croire, et que celle-ci avaitété annoncée par les prophètes:
«en vue de remplir de foi ceux qui ne croient pas, [leur enseignant]qu’il n’y a qu’un seul Dieu,qui s’est manifesté lui-même à travers Jésus-Christ son Fils,qui est son Verbe venu du silence,lui qui en tout “a plu” à “celui qui l’avait envoyé” (cf Jn 8,29)»95.
90 Éphésiens 5,1, SC 10, 72.91 Magnésiens 6,1, SC 10, 98.92 «Un unique Jésus-Christ – lui qui est venu d’un Père unique, demeurant tourné vers
l’Unique et qui est allé vers Lui», Magnésiens 7,2, SC, 100, cf «Jésus [...,] sachant qu’il ve-nait de Dieu et qu’il s’en allait vers Dieu» (Jn 13, 3). Voir aussi ci-dessous à propos de Phi-ladelphiens 7,1.
93 Ib., 9,1, SC 10, 150. L’expression renvoie sans doute à Dt 29,28 LXX, où on lit «les cho-ses cachées (ta krupta) sont pour le Seigneur notre Dieu, les manifestes pour nous et pournos enfants».
94 Éphésiens 17,2, SC 10, 86.95 Magnésiens 8,2, SC 10, 102. L’expression «Verbe venu du silence» a suscité une abon-
dante discussion, voir en dernier lieu B. DEHANDSCHUTTER, «Silence and Speech in Ignatius,To the Magnesians 8,2», in Parola e silenzio nella patristica, Augustinianum, Roma 2012, 251-256, qui privilégie la variante développée «son Verbe éternel non venu du Silence» et voitdans cette formule une polémique contre les émissions valentiniennes. Cependant, il n’estpas indispensable de faire appel à cet arrière-plan anachronique: Ignace, qui était familierdes textes sapientiels, pouvait faire allusion à la déclaration solennelle de Sagesse 18,14-15:«un silence paisible enveloppait tout [...] du haut des cieux, ta parole toute-puissante s’élan-ça», comme le propose F.M. BRAUN, Jean le théologien et son évangile dans l’Église ancienne,
149
Nous sommes très proches ici de ce qui sera défendu par Irénée à l’en-contre des gnostiques, Valentiniens ou autres: l’insistance sur l’unicité di-vine, attestée par les prophètes hébreux, et sur la médiation révélatrice deJésus, l’envoyé du Père. Comme le montrera encore Irénée, ce Verbe n’estpas seulement révélateur, il est aussi créateur:
«Il n’y a qu’“un seul maître” (Mt 23,8),qui “dit et cela fut fait”(Ps 33,9),et ce qu’il a accompli en silence était digne du Père»96.
L’association de la référence au «seul maître» de Matthieu et de l’évo-cation du Verbe créateur souligne ici le lien découvert par l’évêque, à lasuite de Jean, entre le Jésus des récits synoptiques et la puissance qui as-sistait le Père dès le commencement. L’expression «ce qu’il a accompli ensilence», où le silence s’oppose à l’éclat de la parole créatrice, est à com-prendre d’abord comme renvoyant la grande œuvre de la formation dumonde mais aussi, dans le prolongement de la méditation d’Ignace auxÉphésiens sur les «mystères accomplis dans le calme de Dieu», à la vieterrestre du Verbe incarné qui, en un certain sens, est toute entière «viecachée» puisque la divinité est voilée par l’humanité, comme le diront desPères syriens postérieurs97, et renvoie peut-être aussi concrètement au si-lence de Jésus durant sa passion, qui sera explicitement noté par les évan-gélistes (Mt 26,63 et 27,14 et parallèles, Jn 19,9). Ignace insiste ainsi surl’union, non seulement «avant les siècles», mais aussi économique du Filsau Père. Jésus, dit-il comme en écho de déclarations johanniques, «ne fait(poiein) rien sans le Père» (Magnésiens 7,1 reprenant Jn 5,19, ou plus pro-bablement Jn 8,2898). En prolongement de cette synergie et par actualisa-tion à la vie de la communauté, il convient de «ne rien faire (prattein) sansl’évêque» (cf aussi Tralliens 2,2).
Dans la Lettre aux Philadelphiens et à partir d’une conjonction entre deuxversets de Jean – quasi identiques –, Ignace élargit également à l’Esprit cetteconscience de son origine divine, caractéristique du Jésus johannique:
Gabalda, Paris 1959, 267. On peut à l’inverse faire l’hypothèse que l’élaboration valentinien-ne s’appuyait sur ce verset de la Sagesse, ou sur des conceptions analogues potentiellementliées au «logos prophorikos» des Stoïciens. Voir, outre Jn 8,29 qui semble visé ici à la fin decette déclaration confessante, les autres parallèles johanniques mentionnés par C. MAURER,Ignatius von Antiochien und das Johannesevangelium, cit., 41.
96 Éphésiens 15,1, SC 10, 84.97 «Voilé par la chair», THÉODORET, Eranistès, PG 83, col. 320.98 Au paragraphe suivant, en effet, Jn 8,29 sera évoqué; ainsi, Jn 8,28 le serait en Ma-
gnésiens 7,1 et le verset suivant de Jean en Magnésiens 8,2.
150
«l’Esprit n’est pas trompé, étant de Dieu. “Il sait” en effet (cf Jn 8,14) “d’où ilvient et où il va”, et dénonce ce qui est “caché”»99.
Ignace pense très probablement ici, en l’adaptant au contexte de sonexpérience d’inspiration prophétique dans l’Église de Philadelphie100, à laréponse quelque peu mystérieuse de Jésus à Nicodème: «l’Esprit [souffleoù il veut], tu ne sais ni d’où il vient ni où il va» (Jn 3,8) – comme le suggè-re l’emploi du présent «il vient». Mais il la transforme d’un énoncé négatifen énoncé positif, en l’associant, consciemment ou par un raccourci de lamémoire, à la déclaration de Jésus dans sa controverse avec les docteursjuifs: «mon témoignage est véritable, car je sais d’où je suis venu et où jevais, alors que vous ne savez ni d’où je viens ni où je vais» (Jn 8,14)101. Cet-te science de l’Esprit, qu’il partage donc avec le Fils, semble découler, auxyeux de l’évêque, de son origine divine, l’Esprit «étant de Dieu», peut-êtrepar allusion à une autre thèse johannique «[l’Esprit] provient du Père » (Jn15,26). L’apparente liberté de l’évêque dans sa référence aux contextes évan-géliques – discussion avec Nicodème ou altercation avec les Juifs – témoi-gne une nouvelle fois de son souci de globaliser, de recueillir l’élément prin-cipal de plusieurs contextes. Ici, il montre qu’il a été sensible au Leitmotivque constitue, dans l’évangile de Jean, le couple «provenir et se diriger vers»,qui marque le mouvement d’origine et de retour du Verbe à Dieu – motifqui trouve une expression solennelle dans l’ouverture du récit du lavementdes pieds: «Jésus sachant [...] qu’il venait de Dieu et retournait à Dieu» (Jn13,3)102 –, et on ne peut exclure a priori qu’il ait voulu, par le caractère syn-thétique de son expression, englober aussi l’Esprit dans le monde divin.
Nous constatons en même temps comment une proposition généraleremontant aux paroles de Jésus – en l’occurrence un logion johanniqueintroduit par “gar”103 – trouve une application concrète dans la vie ecclé-siale, à ses moments les moins prévisibles104.
99 Philadelphiens 7,1, SC 10, 146.100 Sur cet épisode, voir E. CATTANEO, «Figure di vescovi-profeti nel secondo secolo», Pro-
feti e profezia. Figure profetiche nel cristianesimo del II secolo, Il pozzo di Giacobbe, Tra-pani 2007, 173-203, et particulièrement 177-178.
101 Ce blocage intertextuel est étudié par C. MAURER, Ignatius von Antiochien und dasJohannesevangelium, cit., 25 sq.. Selon ce critique, la double attribution possible de la ré-férence serait l’indice d’une relation parallèle d’Ignace et des rédacteurs de Jean à une sourcecommune. Une telle conclusion complique davantage l’analyse qu’elle ne la simplifie et faitabstraction de l’intention théologique de l’auteur.
102 Verset dont nous avons vu qu’on pouvait le retrouver en Magnésiens 7,2.103 Indication discrète de citation, qui intervient plusieurs fois, cf Éphésiens 6,1, Tralliens 7,2.104 Il faut peut-être aussi percevoir un écho du logion de Mt 10,26b, «il n’y a rien de ca-
ché qui sera connu» dans l’expression finale «L’Esprit n’est pas trompé [...] et il dénonce cequi est caché», même si son contenu semble exprimé par Ignace en termes pauliniens: «l’Es-
151
La parénèse ou les «préceptes de Jésus-Christ» (Éphésiens 9,2)Si Ignace encourage les Magnésiens à demeurer «fermes dans les pres-
criptions (dogmata) du Seigneur et des Apôtres»105, l’éloge que l’évêqueadresse aux Éphésiens au milieu de sa Lettre s’achève sur la déclarationqu’ils sont «en toute chose parfaitement ornés quant à ce qui regarde lespréceptes (“entolai”) de Jésus-Christ»106. Le terme “entolai”, par son usagemême, met sur le même plan les prescriptions qui découlent des parolesde Jésus et les préceptes vétérotestamentaires. Un exemple simple, mini-mal, d’une reprise actualisante, juste soulignée par la généralisation dequelques incises («en toute chose», «toujours»), est le conseil donné parIgnace à Polycarpe: «sois prudent comme le serpent en toute chose, et sim-ple toujours comme la colombe», qui reprend ce que nous lisons en Mt10,16 (b)107 et se contente d’énoncer au singulier ce que le logion évangé-lique exprime au pluriel.
Dans la perspective d’une application ecclésiale concrète des parolesde Jésus, on portera attention à l’emploi par Ignace du raisonnement afortiori. Les Lettres nous en fournissent au moins deux exemples, dont lepremier est nettement matthéen, emprunté au discours communautairequi se trouve chez Matthieu au chapitre 18:
«si la prière (commune) “d’un ou de deux” possède une telle force (cf Mt 18,20),combien plus celle de l’évêque et de toute l’Église»108.
L’énoncé de Mt 18,19-20 se trouve ici simplement évoqué109: il s’agit, sion peut dire, d’une base textuelle rapidement rappelée à la mémoire envue d’un prolongement communautaire. On notera le caractère allusif du“tosautè”, une “telle” force, supposant de la part des destinataires la con-naissance du logion matthéen. Ce qui restait général dans la formulationmatthéenne se trouve ici transposé et inséré de manière concrète dans lecadre de la vie ecclésiale. Les facteurs sur lesquels joue l’a fortiori sontdoubles: qualitatif – car l’évêque semble être par qualité supérieur aux ano-
prit», selon 1Co 2,10, «pénètre tout» et, selon 1Co 14,24, «ce qui est caché [du cœur] appa-raît». Aux Éphésiens, Ignace rappelait de même, dans une ligne biblique, que «rien n’échap-pe à l’attention du Seigneur, mais même ce qui de nous est caché est à sa porté», Éphésiens15,2. Il s’agit d’un thème biblique commun, cf Sagesse 1,8 etc, Ps 138,15 (LXX), etc.
105 Magnésiens 13,1, SC 10, 106. 106 Éphésiens 9,2, SC 10, 78.107 À Polycarpe 2,2, SC 10, 172.108 Éphésiens 5,2, SC 10, 72.109 «Si deux d’entre vous s’accordent sur terre, quelle que soit l’affaire pour laquelle ils
implorent, cela leur adviendra de la part de mon Père qui est aux cieux. Là en effet où deuxou trois sont réunis en mon nom, là je suis au milieu d’eux» (Mt 18,19-20).
152
nymes «un ou deux», et quantitatif – car «toute l’Église» est plus impor-tante que ce petit nombre. En ce sens, le logion de Jésus déterminerait unesorte de «degré zéro» du rassemblement qui a vocation, aux yeux d’Igna-ce, à s’épanouir dans le rassemblement liturgique, en présence de l’évêque.On notera pour finir que la notion métaphorique présente dans le logionévangélique par le biais du verbe “sumphonein”, “s’accorder” – non re-transcrit ici – était reprise un peu plus haut par Ignace, («symphonoi on-tes»), et orchestrée dans le cadre d’une large comparaison sur l’harmoniede l’Église, chœur accordé à l’évêque110.
En Éphésiens 6,1, un raisonnement a fortiori intervient encore à pro-pos d’un autre logion, dont l’origine est plus difficile à déterminer, maisqui rappelle à la fois Mt 10,40 et Jn 13,20111:
«tout homme en effet (gar) que le maître de maison (oikodespotès) envoie àsa propre économie (domaine ?), il convient de le “recevoir comme celui mêmequi l’envoie”. Il est donc (oun) évident qu’il convient de considérer l’évêquecomme le Seigneur lui-même»112
On se rappellera qu’indépendamment des paraboles où Dieu est mis enscène sous la figure d’un «maître de maison» ou «de domaine», Jésus s’estdésigné lui-même, selon Mt 10,25, comme étant «le maître de maison»dans le cadre d’une extrapolation a fortiori113. Le raisonnement, ici enco-re (on notera le “donc”), conduit à déterminer plus concrètement, à adap-ter à un cadre plus précis et “institutionnel” ce qui se trouvait exprimé demanière plus large et générale dans la parole de Jésus sur la réception del’envoyé «comme celui-là même qui l’envoie»114. On notera l’expression
110 Éphésiens 4,2 – et déjà 4,1 avec «symphonos agapè», ib., 72.111 E. VON DER GOLZ, Ignatius von Antiochien als Christ und Theologe, TU 12, 3, J.C. Hin-
richs, Leipzig 1894, 137, conclut à propos de l’emploi de “pempein” (johannique) au lieu d’“apostellein” (matthéen): «Der Gedanke von Mt 10,40 ist mit Worten aus Joh. 13,20 wieder-gegeben». Il convient de nuancer ce jugement en notant qu’Ignace utilise “dechesthai” com-me Matthieu, au lieu de “lambanein” qui se lit en Jean. Voir les textes en colonne chez H.KÖSTER, Synoptische Überlieferung bei den apostolischen Vätern, cit., 40.
112 Éphésiens 4,1, SC 10, 74.113 «S’ils ont [osé] appeler “Beelzeboul” le maître de maison, à combien plus forte rai-
son ceux de sa maison!» (Mt 10,25).114 Faut-il voir ici un écho de la parabole des vignerons (Mt 21,33-34 et parallèles), com-
me le fait A. ORBE, Parabolas evangelicas en San Ireneo, I, La Editoria catolica, Madrid 1972,228, qui y lit une perspective économique, les évêques venant prendre la suite des prophè-tes de la première alliance? Ou plutôt, plus immédiatement, un renvoi à Mt 10,40? Cf Mc1,37; Lc 7,48; Jn 13,20. Un conseil analogue est donné en Didachè 11 à propos cette fois desprédicateurs “prophètes”: «À l’égard des apôtres et des prophètes, agissez selon la prescrip-tion de l’Évangile (dogma), de la manière suivante: Que tout apôtre arrivant chez vous soitreçu comme le Seigneur».
153
«son économie» (oikonomia), qui suggère que le Christ est le premier res-ponsable des communautés, auxquelles il délègue ses envoyés115. Le «dè-lon oun», insistant, souligne le fait que l’évêque est certes un cas particu-lier dans une catégorie plus large, mais semble aussi suggérer qu’il enconstitue le type même – l’évêque étant par excellence celui qui est envoyéau nom du Seigneur, comme si le logion de Jésus ne prenait toute sa va-leur que dans la relation entre l’évêque et l’Église.
En Romains 9,3 réapparaît une autre réminiscence de l’expression «re-cevoir au nom de Jésus-Christ» appliquée cette fois, non plus à l’évêqueen général, mais à Ignace lui-même: «la charité des Eglises qui m’ont reçuau nom de Jésus-Christ». Selon un processus de détermination toujoursplus concret, nous nous trouvons alors devant un cas particulier de l’ap-plication précédente – qui déjà spécifiait en le rapportant par excellenceà l’évêque ce que le logion déclarait plus généralement116. La parole de Jé-sus est encore une fois présupposée et réutilisée dans le contexte de situa-tions immédiates.
Métaphores et antithèses: la reprise expressive d’images évangéliquesPar définition, la métaphore concentre le discours et permet une évo-
cation maximale pour un espace minimal. On ne s’étonnera pas alors, auvu de la recherche de la concision qui est celle d’Ignace, de constater queles reprises de métaphores évangéliques sont proportionnellement plusfréquentes par rapport aux autres allusions et citations. La mention d’unsimple terme, le plus souvent métaphorique, suffit à rendre présent toutun contexte de l’enseignement de Jésus et confère ainsi à la prose de l’évê-que une coloration évangélique. Ces métaphores sont parfois simples, eten ce cas elles ont souvent une valeur théologique, mais le plus souventelles sont doubles, antithétiques, et s’intègrent alors dans la parénèse ec-clésiale où les destinataires sont mis en face d’un choix binaire.
Métaphores simplesÀ propos des rapports des “prophètes” et plus largement des grandes
figures vétérotestamentaires au Christ, Jésus est appelé «porte du Père»,en référence très probable à la déclaration de Jésus en Jean «je suis la por-te» (Jn 10,9, cf Jn 10,7 «je suis la porte des brebis») et, plus loin toujours
115 Le terme, dont nous avons vu qu’il était volontiers utilisé par Ignace au sens diachro-nique hérité de Paul, prend ici une valeur synchronique plus synoptique.
116 On notera que le même procédé d’ “épiscopalisation” est appliqué, en Magnésiens13,2, au verset paulinien d’Ep 5,21: «soyez soumis les uns aux autres», qui devient dans laréécriture d’Ignace: «soyez soumis à l’évêque et les uns aux autres» (SC 10, 106).
154
chez Jean, «nul ne va au Père sans passer par moi» (Jn 14,6). Outre l’ima-ge de la “porte”, Ignace reprend ici l’élément essentiel et le plus concis detout ce développement johannique: le “dia” suivi du génitif définissant la“porte” comme la médiation d’un passage: «étant lui-même la porte duPère, par laquelle entrent Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, les apô-tres et l’Église, tout cela en vue de l’unité de Dieu» 117.
Il est intéressant d’observer le léger déplacement de sens: là où le Jé-sus de Jean proclame, par opposition au judaïsme, que ses disciples doi-vent passer par lui pour accéder au Père, Ignace, qui utilise lui aussi cenom du Christ dans le cadre d’une polémique anti-judaïsante, élargit laperspective à l’ensemble de l’économie du salut, depuis les patriarchesjusqu’à l’Église, en passant par les prophètes et les apôtres. Le Christ de-vient ainsi une “porte” de toute l’histoire humaine.
Une autre métaphore de Jean est celle du «pain de Dieu» (Jn 6,33). EnÉphésiens 5,2, Ignace rappelle simplement, avec une allusion eucharisti-que, que celui qui n’est pas «à l’intérieur» de lieu de l’offrande (thusiastè-rion) se prive du «pain de Dieu» (cf Jn 6,33). Dans la Lettre aux Romains,il reprend l’expression, en explicitant sa portée eucharistique, et la com-plète par le parallèle du “sang”: «je désire le “pain de Dieu”, qui est la chairdu Christ né de la semence de David, et je désire son sang comme bois-son, qui est charité incorruptible»118. Le parallèle du pain et de la boisson,de la chair et du sang renvoie au long développement de Jésus au chapi-tre six de Jean, particulièrement: «le pain que je donne est ma chair» (Jn6,51c), «ma chair est nourriture véritable et mon sang boisson véritable»(Jn 6,55). Nous saisissons ici à sa naissance le geste exégétique: Jésus re-liait sa “chair” au pain et à la nourriture par le biais de la copule “est”: cemoment théorique devient chez Ignace le tour «le pain – qui est la chair duChrist». Ici sont noués les trois fils principaux de l’exégèse chrétienne: ladésignation d’un référent dans le passé («le Christ, de la semence de Da-vid»), l’inscription dans un texte (le chapitre six de Jean), l’actualisationdans la vie de l’Église, à la fois sacramentelle et mystique pour Ignacedans le cas présent.
Le dernier emprunt johannique s’insère dans un contexte similaire,puisqu’il s’agit du célèbre passage lyrique de la Lettre aux Romains où l’évê-que s’écrie: «une “eau vive” et qui parle en moi, disant intérieurement: “vavers le Père”»119. L’«eau vive» représente l’Esprit saint, selon l’interpréta-tion même de l’évangéliste, apportée sous forme de commentaire explica-
117 Philadelphiens 9,1, SC 10, 150.118 Romains 7,3, SC 10, 136.119 Ib., 7,2, SC 10, 134.
155
tif en Jn 7,39. En continuité avec l’application de Jean, Ignace en fait uneexpression de l’Esprit qui l’anime et l’inspire, non plus en pleine assem-blée, comme en Philadelphiens 7, mais en lui-même. Ignace réutilise lamétaphore du surgissement interne, mais la complète par la mention d’uneincitation répétitive qui lui est adressée. Ainsi, l’eau vive intériorisée – onnotera la redondance d’Ignace qui insiste «en moi, à l’intérieur de moi»(«en emoi, esothen moi») – est porteuse d’un appel divin.
Deux autres métaphores ont des enracinements synoptiques à conno-tation christologique, tout en étant aussi chargés d’une portée ecclésiale.En Magnésiens 10,2, le “sel” dont il est dit qu’il «conserve en vue de l’in-corruptibilité» n’est autre que Jésus-Christ lui-même, car c’est «en lui» («enauto») que l’évêque invite les croyants à «être salés». Le «sel de la terre»que sont les disciples selon Mt 5,13 (ou Mc 9,50) le sont donc, semble-t-il,par paronymie, du fait de l’action au milieu d’eux du “sel” authentique. Unetelle lecture s’inscrit dans la continuité immédiate de celle qu’Ignace pro-pose du «levain nouveau» en qui il convient de se transformer, levain «quiest Jésus-Christ» lui-même selon Ignace, par allusion sans doute au logionde la parabole du levain dans les trois mesures de pâte, en Mt 13,33120. Onnotera, du point de vue du procédé exégétique, que le sens proposé pourl’expression évangélique l’est par le moyen le plus simple et le plus effica-ce, celui d’une assimilation introduite par «qui est»: «le levain nouveau,qui est J-C». Ces deux assimilations supposent déjà une exégèse rapportantces noms métaphoriques en premier lieu au Christ121.
Enfin, dès l’exorde de la Lettre à Polycarpe, Ignace félicite son corres-pondant d’avoir une “gnomè”, c’est-à-dire à la fois l’adhésion intérieure etla volonté, «établie (hèdrasménè) en Dieu, comme sur une pierre inébran-lable». On peut y percevoir un écho de Mt 7,24-25 et de sa célèbre visionde la maison construite sur la pierre, qu’Ignace, lecteur des livres sapien-
120 En réalité, l’exemple pourrait aussi s’intégrer dans l’étude des métaphores antithéti-ques (point 3,3,2), car nous avons affaire ici à une variation sur l’antithèse paulinienne duvieux levain et les azymes de vérité (1Co 5,7), où ceux-ci sont remplacés pour le «levainnouveau», sans doute sous l’influence de Mt 13,33.
121 Magnésiens 10,2, SC 10, 104. Cette lecture apparaît, selon Irénée, chez Ptolémée etson courant valentinien «Fermentum uero ipsum Salvatorem dicunt» (IRÉNÉE, Adversus Hae-reses 1,8,3). Elle sera répandue dans la tradition, cf A. ORBE, Parabolas, II, cit., 468-469. Demanière transparente, chez Jean, le «grain de blé tombé en terre» (Jn 12,24) se rapporte aucorps de Jésus lui-même et, selon la même ligne, le “trésor” enfoui de Mt 13,44, pour Iré-née, est non seulement figure de l’Écriture, mais aussi du Christ lui-même (IRÉNÉE, Adver-sus Haereses 4,26,1). Ambroise y voit des sortes d’“epinoiai” figurées, expliquant que le Christest à la fois le «grain de blé» et le «grain de moutarde» (cf Mt 13,31), ou le royaume lui-même (selon une lecture exprimée aussi par Origène); cf AMBROISE, Exposition sur Luc VII,182, SC 52, 76.
156
tiels comme nous l’avons vu, associe à un souvenir du Siracide: le «cœurétabli (hèdrasménè) dans la connaissance» (Sir 22,17).
Le point commun à ces emprunts, en laissant de côté «l’eau vive» del’Esprit, est la mise en valeur des diverses potentialité du Christ, à la foisporte, pain, sel, levain, pierre: la concentration métaphorique soulignedavantage encore la force, l’appui et l’impulsion que celui-ci, sous diffé-rents aspects, communique aux fidèles. Il est intéressant de noter que, ceque Paul dit de l’Esprit dans la Première aux Corinthiens: «vous êtes letemple de Dieu, et l’Esprit de Dieu habite en vous» (1Co 3,16) est reprissous forme parénétique par Ignace, qui parle de l’habitation du Seigneur:«faisons tout, dans la mesure où il habite en nous, afin que nous soyonsson temple et qu’il soit Dieu en nous»122.
Images doubles en contrasteOn constate la reprise par Ignace – non sans une certaine systémati-
sation –, de ces couples antithétiques, soit johanniques, soit synoptiques,qui parcourent les évangiles canoniques: bon grain et ivraie, bon ou mau-vais fruit, sarment vivace ou sec, levain du royaume ou levain ancien, lesliens et le déliement, Dieu et César, le bon berger et les loups, etc. Le rem-ploi d’images qui étaient déjà antithétiques dans les logia évangéliques, oudont Ignace accentue l’aspect binaire, se situe d’abord dans le cadre de lapolémique qu’il mène contre les déviants, plus largement dans le prolon-gement de l’opposition johannique entre les disciples et le “monde”, etplus profondément encore au cœur de l’option décisive qui révèle la na-ture de l’homme.
Un premier lieu me semble emblématique en ce sens. Il s’agit de Ma-gnésiens 5,2, où Ignace écrit:
«De fait, les réalités [du monde] ont une finalité (“telos”), et ces deux [fins]se présentent ensemble [devant nous], la mort et la vie, et chacun doit abou-tir “à son lieu propre”123. De même en effet qu’il y a deux monnaies, l’une deDieu, l’autre du monde, et que chacune d’entre elles porte inscrit son proprecaractère, ceux qui ne croient pas portent celui de ce monde, mais les fidèlesportent, dans la charité, le caractère de Dieu le Père par Jésus-Christ»124.
Il n’y a pas ici à proprement parler référence, mais il est très probableque la distinction binaire des «deux monnaies», chacune portant son ca-ractère propre, soit une allusion au dialogue avec les Pharisiens en Mt
122 Éphésiens 15,3, SC 10, 84.123 L’expression «il s’en est allé à son lieu propre» est une périphrase euphémique de la
communauté à propos de Judas, en Actes 1,25.124 Magnésiens 5,1-2, SC 10, 96-98.
157
22,15-22 (et parallèles) et tout particulièrement aux versets 20-21, où Jé-sus distingue entre ce qui revient à Dieu et ce qui revient au prince, au vude «l’image et de l’inscription» figurant sur la monnaie impériale. Dès lesecond siècle en effet, les textes gnosticisants ou patristiques qui théma-tisent l’opposition de deux empreintes se réfèrent tous explicitement aulieu fondateur des Synoptiques qui évoque «l’image et l’inscription» de“César” et implicitement, en contrepartie, celle de Dieu (Mt 22,20 ou Mc12,13 ou Lc 20,24). Certes, selon Matthieu, Jésus ne dit pas qu’il faut don-ner à Dieu une autre monnaie, seulement qu’il convient de donner à Cé-sar ce qui porte son inscription. Il y a donc extrapolation dans la lectureque l’Église ancienne fait de ce dialogue, peut-être inspirée par l’opposi-tion paulinienne entre «l’image du terrestre» et «l’image du céleste» (1Co15,49), et la forte expression du même apôtre disant qu’il porte les «mar-ques (stigmata) du Christ» (Gal 6,17)125. En outre et comme ce sera le caspour les Extraits de Théodote, quand il oppose “fidèles” et “infidèles”, dontles premiers portent le “caractère”, c’est-à-dire la “marque” du Père enJésus-Christ, sans doute Ignace rapproche-t-il déjà cette bonne emprein-te – “charakter” – du sceau ou “sphragis” baptismal126. Ce qu’il y a de sûr,
125 «Il en va ainsi du fidèle: par le Christ, il porte comme inscription (epigraphèn) le nomde Dieu, et l’Esprit comme image (cf Mt 22,20); même les bêtes sans raison font voir parun sceau (sphragis) à qui elles appartiennent [...] il en va de même de l’âme fidèle, qui areçu le sceau de la vérité, et porte en elle les poinçons (stigmata) du Christ (cf Gal 6,17)»,(Extraits de Théodote, par. 86, 2 – après le rappel au par. 86,1 du fait que l’«image de Cé-sar» doit lui revenir, SC 23, 210). Les Eclogai prophetikai explicitent l’opposition entre l’ima-ge terrestre de César, “archonte” temporaire, et ce qu’il convient de rendre à Dieu. Il y adeux empreintes (charagmata): «le Seigneur nous marque d’une autre empreinte (charag-ma) [...] de la foi, au lieu de l’incroyance», de manière à porter «l’image du céleste» (Ecl24, GCS143, 12-19, cité par F. Sagnard, SC 23, 211). Selon une ligne identique, Origèneécrit, à propos du didrachme réclamé par les percepteurs en Mt 17: «Jésus, étant “l’imagedu Dieu invisible”, ne portait pas l’“image de César”» (ORIGÈNE, Commentaire sur Matthieu13,10, cf aussi 17,28, où Origène précise que «l’image de César» n’est autre que «l’imagedu prince de ce monde» – on notera que, selon Lightfoot, la version syriaque d’Ignace dé-veloppe ici [le caractère] du prince de ce monde», et non seulement «du monde»). Les tex-tes du second ou troisième siècle qui opposent «l’image du terrestre» et «l’image du céles-te» se fondent tous sur une lecture anthropologique de Mt 22,20 ou parallèles et, pour laplupart, voient dans “César” le «prince de ce monde» qui règne sur les incroyants, alors queles croyants reçoivent l’image de Dieu.
126 Cf la note de F. Sagnard, SC 23, 229 sq., particulièrement 235. Avec un arrière-planbaptismal probable et sans contrepartie négative, en ce qui le concerne, Irénée parle del’homme qui a reçu «par l’Esprit “l’image et l’inscription” du Père et du Fils» (IRÉNÉE, Ad-versus Haereses 3,17, 4, SC 34, 308) et, ailleurs, de l’Esprit qui distribue “l’image et l’inscrip-tion” du roi, la connaissance du Fils de Dieu – qui est incorruptibilité » (IRÉNÉE, AdversusHaereses 4,36, 7, SC 100, 912), voir A. ORBE, Parabolas, I, cit., 128-133 et 452-455, qui men-tionne d’autres témoignages de ce même exégème dans l’Église ancienne.
158
c’est que cette marque s’imprime pour lui «dans la charité» (en agapè),c’est-à-dire à la fois par la grâce transmise et par la pratique du don reçu.
Un thème particulièrement récurrent dans les Lettres, qui se retrouve-ra abondamment aussi dans les Similitudes du Pasteur d’Hermas, est ce-lui des bonnes et mauvaises plantes, en écho très probable à la paraboledu bon grain et de l’ivraie (cf Mt 13,24-30; Mt 15,13), complétée par le mo-dèle matthéen des bons et mauvais fruits (Mt 12,33). En Éphésiens 9,1,Ignace évoque la “semence” des hérétiques («ce qu’ils ont semé»), qui estleur «mauvaise doctrine» semée par les oreilles. Un peu plus loin, en 10,3,il parlera de «l’herbe du diable»127, qui ne doit pas se trouver chez les fidè-les. Il n’est pas impossible de voir dans ces images une allusion à deux sta-des de “l’ivraie” semée par l’ennemi dans la parabole en Mt 13,25, dontl’une des applications est l’erreur semée dans l’Église par les mauvais doc-teurs128. De même, en Tralliens 6,1, Ignace oppose la nourriture chrétien-ne («christianè trophè») à «l’herbe étrangère», qui n’est autre, déclare-t-ilexplicitement, que “l’hérésie”. En Tralliens 11,1, Ignace reprend les termesdu logion de Mt 15,13, deux fois cité dans les Lettres, pour caractériser cespousses: «ceux-ci ne sont pas plantation du Père». Il se réfère alors à unmodèle distinct de celui de l’ivraie, quoique apparenté, en parlant de «mau-vaises pousses parasites», «para-phuas», «dont le fruit est mortel» (“tha-natophoros”). Le contexte suggère que l’évêque transpose aux sectaires ceque Jésus, selon l’évangéliste Matthieu, disait des Pharisiens. En Philadel-phiens 3,1, Ignace reprend une dernière fois, à propos des hérétiques, l’ex-pression de «mauvaises plantes» et la citation du même logion de Mt 15,13.Cette fois, la “culture” est attribuée à Jésus-Christ, qui cultive ce que le Pèrea planté129: «abstenez-vous des mauvaises plantes, celles que ne cultive pasJésus-Christ, car elles ne sont pas plantation du Père (Mt 15,13)».
Dans le même sens, en Éphésiens 14,2, Ignace citait le logion de Mt12,33: «on reconnaît l’arbre à son fruit», qui, chez Matthieu, se poursuitde manière encore plus insistante: «le bon à ce qu’il donne un bon fruit, lemauvais à ce qu’il en donne un mauvais». Le croyant, pour sa part, se re-connaît à ses actes. Il est intéressant de voir le commentaire d’Ignace ex-
127 “Botanè” n’est pas évangélique, mais se trouve entre autres, avec connotation péjo-rative, dans HERMAS, Le Pasteur, Similitudes 5,55, 3-4 (parabole de la vigne envahie de mau-vaises herbes) et 58,3, SC 53 bis, 226 et 236 (explication de la parabole, par le moyen d’unesérie d’identifications en «a est b»: «les herbes sont les iniquités» etc.).
128 Ce rapprochement entre l’ivraie et la mauvaise doctrine deviendra assez courant à par-tir du troisième siècle, cf A. ORBE, Parabolas, I, cit., 323-324, renvoie à TERTULLIEN, De praes-criptione 31,1-4, mais il est probable qu’une telle application ait été proposée antérieurement.
129 Voir J. DANIÉLOU, Théologie du judéo-christianisme, Cerf, Paris 1958-1991, 71, quimentionne des parallèles dans l’Ascension d’Isaïe et les Odes de Salomon.
159
pliciter ici le parallèle métaphorique implicite dans les paroles de Jésus ets’appliquer à retranscrire le logion en termes clairs et non plus imagés: «dela même façon (houtôs), ceux qui font profession d’appartenir au Christ,c’est par les actes qu’ils produisent qu’ils se font reconnaître»130.
Selon une analogie de proportionnalité, les actes sont aux “fruits” ceque les chrétiens authentiques sont aux arbres. On a vu dans la mise engarde aux Tralliens que, si les chrétiens entés sur le cep peuvent porter unfruit incorruptible, tel n’est pas le cas des sectaires qui, n’étant pas gref-fés sur la croix, produisent un fruit mortifère131. La forte présence de cemotif végétal, qui revient à sept reprises dans le corpus restreint des Let-tres, atteste de l’importance aux yeux d’Ignace du thème de l’enracinement,de l’insertion vivifiante et de la fécondité.
Un dernier couple métaphorique est celui des brebis et des loups, dansun contexte à nouveau johannique. En Philadelphiens 2, la comparaisonde Jn 10,7-16 sur les bons et mauvais pasteurs se trouve relayée par l’usa-ge qu’en fait Paul dans son discours aux Anciens d’Éphèse (Actes 20,29).Le pasteur du troupeau ecclésial est l’évêque, comme l’indique le contex-te immédiat de la Lettre, mais l’expression ignacienne est suffisammentgénérale pour conserver l’équivoque entre le pasteur visible et le pasteurinvisible qui est le Christ (selon l’expression de Magnésiens 3,2)132. Quantaux “loups” opposés aux “brebis” (selon Jn 10,12 ou peut-être aussi Mt7,15, ou encore Mt 10,16), ce sont les fauteurs de «division et de mauvai-se doctrine»133. Nous rencontrons ici un nouvel exemple d’application ec-clésiale d’une opposition évangélique, sous forme d’une mise en gardecontre la dissidence et l’hérésie.
En général, on peut observer que le domaine pris en considération parIgnace se répartit entre «le monde», livré à la souveraineté de son “prin-ce”134 et «la plantation du Père», selon une tension qui semble dessiner, àl’arrière-plan des Lettres, un tableau conflictuel particulièrement insistant.On constate en outre que la plupart de ces emprunts au langage de Jésussont des variations sur le thème de la relation nécessaire, mieux de l’union,qui rattache les disciples au maître, qu’il s’agisse de la comparaison du
130 Éphésiens 14,2, SC 10, 82.131 Tralliens 11,1 (voir ci-dessus), SC 10, 120.132 Philadelphiens 2,1 et 2, SC 10, 142. Voir E. CATTANEO, «La figura del vescovo...», cit.,
502-503.133 Cette image intervient comme mise en garde à la fin de la Didachè (16, 3). Elle sera
explicitement appliquée par Irénée, qui la rapporte à un avertissement du Seigneur, auxchrétiens déviants, qui «utilisent un langage similaire, mais pensent différemment», dansson prologue de l’Adversus Haereses, (IRÉNÉE, Adversus Haereses, praef. 2, SC 264, 22-23).
134 Jn 12,31 et 14,30.
160
troupeau, des métaphores botaniques (dominantes) ou du paradigme del’empreinte. Ce lien d’intégration et d’association est d’autant mieux misen lumière que le contraste avec la contrepartie négative de ces motifs fi-gurés le fait ressortir. Un pas de plus, et on pourrait se demander si lesmétaphores évangéliques invoquées ne l’ont pas été, parmi d’autres pos-sibles, en raison de leur lien intime avec la personne du Christ, et leur ex-pansion possible au fidèle135. Ignace lui-même théorise cette dimension,quand il approfondit, pour les Tralliens, la représentation de la continui-té entre la vigne et les sarments (Jn 15,1-8) par la métaphore suggestivedes «ramifications de la croix» («kladoi tou staurou»)136, qui annoncent un«fruit incorruptible» («karpos aphthartos»)137. Ignace rapproche ce para-digme johannique du thème paulinien de la tête et des membres138: «parla croix, dans sa passion, il vous appelle ses membres. Ainsi donc (“oun”),la tête ne peut pas être sans les membres, Dieu promettant l’union, qu’ilest lui-même»139. Par cette variation métaphorique très dense, Ignace in-siste, une fois encore, sur la continuité entre Jésus et l’Église, par le canald’une sève vivace qui circule du Seigneur – et particulièrement de sa croix –aux fruits présents promis à l’incorruptibilité.
Conclusion générale
Au terme de cette recherche, nous nous trouvons devant deux consta-tations au premier abord contradictoires: d’une part nous constatons ladisparité des influences attestées par les Lettres, où nous avons vu quePaul (1Co, Ep), Matthieu (les discours communautaires) et Jean140 (le dis-cours théologique de Jésus) dessinaient un triangle à l’intérieur duquel se
135 Le refus d’une telle conclusion conduirait à penser qu’Ignace n’avait connaissance,parmi les logia de Jésus transmis, que de ce qui se rapporte à un tel thème, ce qui serait àl’évidence réducteur, voire absurde. Certes, le motif de la fécondité du Christ et de la vie qu’iltransmet aux fidèles est déterminant dans la perspective évangélique, mais il n’était pas leseul à circuler au début du second siècle, comme l’atteste par exemple la Lettre de Polycar-pe aux Philippiens, voir à ce propos M.W. HOLMES, «Polycarp’s Letter to the Philippians andthe Writing that Later Formed the New Testament», in A. GREGORY - C. TUCKETT (edd.), TheReception of the New Testament in the Apostolic Fathers, cit., 187-227.
136 Voir aussi en Smyrniotes 1,2 le thème des croyants “karpos” de la croix. Voir J. DA-NIÉLOU, Théologie du judéo-christianisme, cit., 125-127.
137 Cf Jn 15,16 et son thème d’un “fruit” qui “demeure”.138 Ep 1,22-23 et 4,15-16; Col 2,19.139 Tralliens 11,2, SC 10, 120. Je lis “genethènai” au lieu de “gennèthènai”.140 Sur les lieux johanniques chez Ignace, et plus largement les contacts entre la langue
d’Ignace et celle de l’évangile de Jean, voir F.M. BRAUN, Jean le théologien et son évangile dansl’Église ancienne, Gabalda, Paris 1959, 270-287.
161
mouvait la réflexion d’Ignace. De Paul il retient surtout son exigence éthi-que et son ecclésiologie, à Jean il demande d’abord une lumière lui per-mettant de formuler, théologiquement mais aussi par la reprise de méta-phores fécondes, le mystère du Verbe incarné et, dans une moindre me-sure, celui de l’Esprit. Aux paroles des Jésus il emprunte des règles com-munautaires et des images du lien entre le maître et ses disciples. A destitres divers, la réflexion paulinienne et la théologie de Jean viennent l’uneet l’autre éclairer ce que la narration synoptique ou les logia de Jésus peu-vent avoir de sommaire ou d’implicite. En évaluant ces influences, je neme prononce pas sur le mode de contact entre le texte d’Ignace et ce quinous est parvenu comme textes canoniques néotestamentaires même si,en ce qui concerne Paul et particulièrement sa Lettre aux Éphésiens, je suisportée à penser que l’évêque d’Antioche en avait vu le rouleau, pour ne pasdire un recueil en codex141. D’autre part, nous observons chez Ignace unegrande cohérence dans le choix et le traitement des thèmes à résonnanceévangélique: à peu d’exceptions près, tous les motifs retenus ici se laissentramener, soit au mouvement de remontée, à partir des données évangéli-ques – sur la factualité desquelles Ignace insiste –, vers le mystère de Jé-sus qui s’inscrit dans l’économie du Père, soit au mouvement inverse par-tant de la révélation du Christ, de sa puissance vivifiante, pour redescen-dre à travers les médiations ecclésiales, vers la diffusion de cette vie dansles fidèles, jusqu’en ses manifestations les plus immédiates. En un mot,le caractère central du mystère de Jésus, en qui «Dieu se manifeste humai-nement» dans l’histoire, supporte aussi bien la dimension contemplativeet confessante du discours d’Ignace que son effort d’extension et d’actua-lisation des actes et des paroles de Jésus à la vie des communautés, selonque «dans l’évangile, la passion nous a été montrée et la résurrection ac-complie». À l’articulation entre les deux versants, théologique et prati-que142, on trouve l’incitation à l’imitation, qui s’exprime chez Ignace parla récurrence des conseils, repris à Paul: «soyez imitateurs de Dieu»,«soyez imitateurs du Christ», imitation, association et proximité qui setraduiront à travers le remploi des métaphores évangéliques exemplifiantle lien du fidèle au Christ. Cette perspective explique qu’Ignace voie prin-cipalement dans les moments ou paroles évangéliques des “cadres” exten-
141 H.Y. GAMBLE, Livres et lecteurs aux premiers temps du christianisme. Usage et produc-tion des textes chrétiens antiques, Labor et Fides, Genève 2012, 88-89.
142 La perspective mystique d’origine johannique (mais aussi partiellement paulinien-ne) n’est jamais, chez Ignace, exclusive d’une grande attention portée aux circonstancesconcrètes, qu’il s’agisse de celles de la vie de Jésus, de celles où Ignace se trouve engagé oude celles qui se laissent deviner à travers ce qu’il écrit aux Églises destinatrices des Lettres.
162
sibles grâce à l’Esprit, d’où leur côté condensé, simplifié et synthétique –débarrassé de tout superflu narratif143.
Du point de vue de l’historien de l’exégèse qui est le nôtre, nous avonsvu s’amorcer, outre le recours à Paul et Jean pour éclairer le Jésus des sy-noptiques – selon une méthode promise à un grand avenir pour la lecturedes Synoptiques dans l’Église ancienne –, un certain nombre de procédéssommaires, mais qui n’en ont pas moins un grand prix en tant que pre-miers témoins de pratiques postérieures: l’usage testimonial (en particu-lier dans le cas des confessions christologiques), la recherche d’une fina-lité économique passant par le recours à des propositions finales explica-tives, l’extension a fortiori, l’application à une situation particulière desentences plus générales, la liaison entre un terme figuré et son référentréel – par le biais de la relation copulative «qui est» –, la reformulationd’énoncés imagés en termes non figurés, l’extrapolation figurative antithé-tique, l’assomption de métaphores évangéliques en «noms du Christ»144.Qui plus est, la constance postérieure dans l’association d’une lecture an-cienne et d’un lieu évangélique, comme l’interprétation christologique dulevain ou le contraste entre les deux empreintes, celle du fidèle et celle del’infidèle, lié dans l’exégèse primitive à l’examen par Jésus du denier deCésar, renforce à nos yeux la probabilité qu’une telle liaison ait été déjàprésente à l’arrière-plan des développements ignaciens. Dans l’ensemble,ces pratiques dessinent un faisceau convergent d’approches du matériauévangélique, qui cherche à en recueillir la richesse, à l’adapter aux situa-tions présentes par le biais d’une réception simplificatrice, mais jamaisréductrice – grâce au regard du théologien qui demeure toujours fixé surle mystère du Christ. Il est frappant de constater en effet à quel point lesactions de Jésus et, plus largement son économie, sont chez Ignace l’ob-jet d’une réflexion explicite sur le jeu complémentaire du silence et de laparole. L’accent est mis à plusieurs reprises par l’auteur des Lettres sur laportée du silence de Jésus, sur le poids de ses actes en eux-mêmes, en-deçàdes paroles. Cette attention est le signe chez Ignace de la conviction que
143 Mutatis mutandis, je dirais volontiers de l’écriture d’Ignace ce qu’A. Puech écrivaitdans son introduction à PINDARE (Les Olympiques, CUF, Paris 1922, 10): «Il opère des sim-plifications résolues, et la vie qui anime ses poèmes leur vient moins de la réalité, à laquelleil n’emprunte qu’un petit nombre de traits essentiels, que de la sûreté avec laquelle il choisitces traits et de la puissance avec laquelle il les exprime».
144 Aussi sommaires que soient ces procédés, ils n’en constituent pas moins les prémi-ces de ce qui deviendra bientôt, chez les Valentiniens et d’autres familles gnostiques, chezMarcion ou Justin, et surtout dans la grande Église chez Irénée, l’explosion de l’exégèsenéotestamentaire, spécialement celle des évangiles canoniques, au second siècle.
163
tout en Jésus est porteur de sens, et que celui-ci doit être recherché à pro-pos de ses actions comme de ses déclarations.
Enfin, c’est par le biais de la méditation personnelle, de l’appropriationvitale, mais également par l’action liturgique de la communauté que se faitcette communication de la grâce, qui est au centre de la vision de l’évê-que, et que nous avons vu emblématiquement représentée, soit, parmi lesacta Christi, dans la diffusion de l’onction parfumée du Christ à l’Église,soit, parmi les logia, dans la métaphore johannique équivalente de la vi-gne et des sarments. Ainsi, lorsqu’Ignace proclame aux Philadelphiensqu’il aspire à «se réfugier dans l’évangile comme dans la chair du Christet dans les Apôtres comme dans le presbyterium de l’Église»145, Jésus etses apôtres sont bien sûr à ses yeux des personnes vivantes, avec lesquel-les il recherche une communion spirituelle, mais on est également fondéà lire, dans cette déclaration, une symétrie entre la table eucharistique –si présente dans les Lettres – et la table de la parole146, dont la présenteétude aura cherché à mettre en lumière la fécondité pour la pensée et laparole d’Ignace.
145 Philadelphiens 5,2, SC 10, 144. Inversement, Ignace incitera les Tralliens à être «sou-mis à l’évêque comme au précepte [de l’évangile]» (Tralliens 13,1). On notera l’analogie deproportionnalité dans le cadre d’un modèle liturgique: les «apôtres» sont à «l’évangile» ceque le «presbyterium» est au Christ.
146 Je pense à la lecture des “prophètes” complétée peut-être, éventuellement dans lecadre de lectionnaires, par celle de péricopes évangéliques (au sens textuel, et non plus seu-lement au sens de proclamation) et d’autres textes d’origine apostolique, à commencer parles principales Lettres de Paul, selon le schéma attesté environ un demi-siècle plus tard parJustin: «On lit les mémoires des apôtres ou les écrits des prophètes», qui servent de base àune homélie actualisante «pour nous exhorter à imiter ces enseignements» (JUSTIN, Apolo-gie pour les Chrétiens 67,3-4, SC 507, 308). E. CATTANEO, «La figura del vescovo...», cit., 521,n. 91, écrit à ce propos, en s’appuyant sur C.E. HILL («Ignatius and the Apostolate: The Wi-tness of Ignatius to the Emergence of Christian Scripture», in Studia Patristica 36 (2001)226-248): «non è escluso che Ignazio si riferisca anche a testi scritti».
164
ANNEXELieux scripturaires mentionnés147
147 En gras les versets cités in extenso dans la présente étude, en italique les versets pourlesquels on suppose un contact possible, en gras et en italiques les versets pour lesquels uncontact me semble très probable ou certain. Les abréviations utilisées dans la présente étudesont celles de la Bible de Jérusalem.
Matthieu1,16-17; 1,18; 1,20b; 2,2; 2,1-12;2,1.3.19; 3,7; 3,12; 3,15; 5,13; 5,17;7,15; 7,24-25; 8,17; 10,16b; 10,23b;10,25; 10, 26b; 10,40; 11,9; 11,19;11,27; 12,33; 13,24-30; 13,25; 13,33;15,13; 16,12; 18,19-20; 18,20;18,40.41; 19,12fin; 20,28; 21,33-34?;22,20-21; 23,8; 24,25; 25,35-36; 26,7;26,12.13; 26, 63; 27,1sq; 27, 14
Marc1,37; 9,35; 9,50; 10, 38-39; 14.3; 14.8.9
Luc1, 27. 32; 1,35; 1,78-79; 2,30-32; 3,1;3,7; 3,17; 4,18; 7,48; 10,41; 12,42;14,9; 16,29.31; 23, 7-13; 24, 37;24,39; 24,36-43;
Jean1,13; 1, 16; 3,8; 4,10; 5,19; 5,19.30;5,25 et 27; 6,33; 6,51c; 6,55; 7,39;7,42; 8,14; 8,28; 8,29; 10,7.9; 10,7-16;10,9; 10,12; 12,1-9; 12,3; 12,7; 12,31;13,3; 13,20; 14, 6; 14,12; 14,30; 15,1;15,1-8; 15,16; 15,26; 18,28sq; 20,8;21,26-29
Actes1.2; 1, 25; 2,23-24; 3,13; 4,12; 4, 26-27;10, 41; 10, 36-43; 20,28; 20.29
Romains1, 3; 6,3-4; 8,5
1Corinthiens1,20; 1,23-24; 2,10; 2,14; 3,1.2; 3,9;3,16; 4,4; 4,14; 5,6-7; 6,9; 6,9.10; 6,10;6,19; 7,22; 9,1; 9,15; 9,27; 11,1; 14,8.9;
14,24; 15,1-4; 15, 4; 15,15; 15,32; 15,49;
2Corinthiens2.15; 4.4; 11,9; 12,13-16
Galates1,1
Ephésiens1.9-10; 1.22; 1,22-23; 2, 15; 4,4-6;4,15-16; 5,1; 5.2; 5.3-5; 5.6; 5,8; 5.21;5, 25; 5,25-29
Philippiens1, 23; 2.10; 2,17; 2.18
Colossiens1, 23; 2, 19;
1Thessaloniciens1,6; 1,10; 2,7; 2,8; 5,17
2Thessaloniciens1,1
1Timothée1, 1; 1,3; 1,5; 6,3
2Timothée2,4; 2,8; 4,6
Jacques3,15; 4,6
1Pierre5, 5
1Jean2,18
Apocalypse2,1-822,16
165
A. Bastit-Kalinowska considers, in a quite exhaustive manner, thesteps of the Ignatius’s corpus, considered authentic by scholars, inwhich the author of the Letters refers to the facts of the life of Jesusor echoes his words. On this basis, she offers an analysis of the mainways of interpretation of the subject. The analysis highlights two dom-inant trends in Ignatius: a theological and contemplative one, whichreveals the bishop’s gaze leaning on Christ, seeking to penetrate thenature and extent of his action, thus an actualizing tendency, whichfavors metaphors that express the unity and continuity between Christand the faithful and, in which integrates in its parenhesis, the languageand wisdom of Jesus: a simple example of which is the adaptation tothe Church and to the Bishop of Jesus’ parenethics logia concerningcommunity’s life.
A. Bastit-Kalinowska analizza, in maniera potenzialmente esausti-va, i passaggi del corpus ignaziano, considerato autentico dalla mag-gioranza degli studiosi, in cui l’autore delle Lettere si riferisce a fattidella vita di Gesù o echeggia le sue parole. Su tale base, si impegna acoglierne le principali modalità interpretative. La disamina mette inluce due tendenze dominanti in Ignazio: una teologica e di accessocontemplativo, in cui si rivela lo sguardo del vescovo posato su Cri-sto, che cerca di penetrare la natura e la portata della sua azione,una tendenza quindi attualizzante, che privilegia le metafore cheesprimono l’unità e la continuità tra Cristo e i fedeli ed integra nellasua parenesi il linguaggio e la saggezza di Gesù: di cui un esempiosemplice è l’adattamento alla Chiesa e al vescovo dei logia pareneti-ci di Gesù sulla vita della comunità.
321
De la méthode a la vérité:l’œuvre d’Enrico Cattaneo1
Agnès Bastit-Kalinowska
«Ora la verità è cio che corrisponde alla realtà delle cose, e cogliere questo èl’operazione propria della mente. Per Ireneo la rivelazione è verità, non solonel senso di verità religiosa, ma di verità in senso assoluto, per cui l’oppostodi questa verità è l’errore»2.
L’œuvre d’Enrico Cattaneo, dont les premières études ont été de philo-sophie, est marquée par une recherche méthodique de la vérité, selon «l’opé-ration propre de l’esprit». A la philosophie s’est ajouté un second cursusen Lettres classiques. Enrico Cattaneo a ainsi étendu son souci de rigueurau domaine historique, celui de la première antiquité chrétienne, dont laconnaissance repose principalement sur des textes. Dans le cadre de sesétudes de théologie, Enrico Cattaneo a eu la possibilité de se familiariseraussi avec la langue hébraïque et, plus largement, avec le monde sémiti-que, ce qui lui a ouvert la compréhension directe du substrat judaïque despremiers textes chrétiens. En ce sens d’ailleurs, l’un des terrains d’enquê-te historique privilégié du théologien est celui des toutes premières élabo-rations chrétiennes non canoniques, antérieures à la fixation du canonnéotestamentaire, que sont les Lettres entre Eglises, celle de l’Eglise deRome à l’Eglise de Corinthe, celles de l’évêque d’Antioche Ignace aux com-munautés d’Asie (et de Rome), dont il montre la proximité et la compé-nétration avec le monde apostolique, particulièrement paulinien. Ces troisunivers culturels, la philosophie, la philologie classique et les études sé-mitiques, sont pour Enrico Cattaneo au service de la théologie, entenduecomme recherche d’une vérité rationnellement fondée qui vise à épouser
1 En présentant cet ouvrage en modeste hommage au Professeur E. Cattaneo, nousémettons en même temps le vœu que ses diverses contributions à la Rassegna di Teologia,de 1980 à 2012 (pour le moment) soient réunies en un recueil. Dans un autre genre, onpourrait aussi souhaiter que les textes courts parus dans La Civiltà Cattolica se trouventégalement rassemblés.
2 «La vérité est ce qui correspond à la réalité des choses, et percevoir cela est l’opéra-tion propre de l’esprit. Pour Irénée la révélation est vérité, non seulement dans le sens d’unevérité religieuse, mais de vérité au sens absolu, et de ce fait l’opposé de cette vérité est l’er-reur» (E. CATTANEO, «La metafisica implicita nella rivelazione e i limiti del sapere teologicosecondo Ireneo», in E. CATTANEO - L. LONGOBARDO [ed.], Consonantia Salutis. Studi su Ireneodi Leone, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2005, 199).
322
le plus étroitement possible la révélation divine: à partir des «données fon-damentales de la foi, présentes dans les Ecritures et dans la regula fidei»,qui «demeurent inchangées», «la raison fonctionne comme des ciseaux àdouble lame, la lame supérieure correspondant à la raison déductive, quiapplique les premiers principes, sans lesquels aucun raisonnement n’estpossible (comme le principe de non contradiction par exemple), et la lameinférieure correspondant à la raison inductive, qui s’applique dans lessciences»3. L’œuvre d’Enrico Cattaneo présente diverses facettes, selon lanature des domaines abordés (discussions théoriques, reconstitutions his-toriques, études de textes – grecs surtout –, recherches thématiques, en-quêtes d’attribution etc.), mais sa marque caractéristique en est l’intentiondémonstrative dans le respect de la matière abordée: la démonstrationapparaît d’autant plus décisive que l’intention apologétique ne prend ja-mais le pas sur l’examen pénétrant des données sollicitées. Un tel résultatne peut être atteint que par la mise en œuvre préalable d’une investiga-tion méthodiquement exigeante, qui réalise l’équilibre entre une analy-se – philologique, historique ou rationnelle – tendant à ne laisser aucunélément dans l’ombre et la force d’une synthèse intégratrice offrant à cesdifférents éléments leur place dans le cadre d’un tout unifié. Comme ledit le théologien: «occorre lavorare con metodo, andando per quantopossibile in fondo alle questioni», mais dans le même temps et selon unetendance complémentaire la recherche tend à restaurer l’unité intellec-tuelle des divers domaines menacés par des poussées centrifuges et à éta-blir des «ponts»: «il compito del teologo-storico è di stabilire dei ponti, traesegesi e storia, tra storia e teologia ecc., perché si sono operate troppefratture». En conséquence, ses enquêtes les plus abouties – et elles le sontpresque toutes – communiquent au lecteur l’impression de se trouver con-fronté à l’éloquence du vrai, et comme face à la réalité elle-même, danssa simplicité, son unité et sa cohérence. C’est particulièrement le cas dece chef d’œuvre qu’est le recueil sur Les ministères dans l’Eglise ancienne(1997). A d’autres moments, moins théoriques et plus narratifs, la prosed’Enrico Cattaneo atteint une grande puissance évocatrice, comme si l’ef-fort fait pour se transporter en esprit dans le contexte étudié lui permet-tait de visualiser son objet et de communiquer par hypotypose cette vision
3 «Ora mentre i dati fondamentali della fede – presenti nelle sacre Scritture e nella re-gula fidei – rimangono immutati, la ragione invece funziona come una forbice a due lame:la lama superiore è la ragione deduttiva, che applica i primi principi, senza i quali non èpossibile nessun ragionamento (ad esempio, il principio di non contraddizione); la lamainferiore è la ragione induttiva, che si applica nelle scienze» (E. CATTANEO, «Agostino, La cittàdi Dio, a cura di D. Marafioti, Oscar Mondadori, Milano 2011», in La Civiltà Cattolica 162[2011] IV 93-95, ici 93; ma traduction, italiques dans le texte).
323
au lecteur. Je n’en veux pour exemple que sa reconstitution du contextede la Prima Clementis, l’un de ses textes favoris, dans le cadre des Votaadressés dans l’empire romain pour l’accession au pouvoir de Vespasien.On n’oubliera pas, en ce sens, qu’Enrico Cattaneo est non seulement letraducteur des thèses et discussions scolastiques, d’une grande acuité ra-tionnelle, du De Verbo incarnato de B. Lonergan, mais aussi celui d’un ro-man qui se situe dans l’Europe sud-orientale des années cinquante, Lavingt-cinquième heure, de V. Gheorghiu (1956)4. Le souci de la pureté for-melle dans la démarche d’exposition n’est pas incompatible avec l’attraitpour des productions plus littéraires, comme en témoigne la part de sesétudes textuelles qui porte sur la poésie et l’éloquence (Ambroise, Paulinde Nole, Romanos le Mélode, les Encomia de la croix). Libre de ses inté-rêts, le théologien ne se meut pas toujours dans l’univers patristique, mêmes’il y revient le plus souvent: il le déborde en aval, par des discussions con-temporaines relevant de la théologie fondamentale, mais aussi en amontpar sa fascination pour la spiritualité lévitique vétérotestamentaire.
Du point de vue des sphères théologiques abordées, trois sont domi-nantes, qui attestent de l’attention portée à l’Esprit en lui-même, mais sur-tout à l’Esprit dans la vie des communautés et dans l’Ecriture inspirée: lapneumatologie, l’ecclésiologie et l’herméneutique biblique – auxquelless’ajoute la christologie. Pour une évocation plus détaillée de son œuvre, ilfaut partir de la thèse publiée en français à Paris, intitulée Trois Homéliespseudo-chrysostomiennes sur la Pâque comme oeuvre d’Apollinaire de Lao-dicée. Attribution et étude théologique (1981), où se rencontre déjà l’ac-cent pneumatologique et qui frappe par sa sobriété rigoureuse, l’enraci-nement dans le substrat biblique, la variété des questions théologiquesabordées, qui vont de sens du mot «Pâque» à l’anthropologie et la chris-tologie d’Apollinaire en passant par la portée eucharistique du rituel pas-cal, enfin par la compétence philologique mise au service d’une forte in-tention démonstrative.
Une quinzaine d’années après se situe ce lumineux recueil d’études in-titulé Evangelo, Chiesa e Carità (1995), qui anticipe sur l’opus magnum desMinisteri. Les deux premières études en particulier, les plus développéeset les plus abouties, sont des modèles de la méthode décrite plus haut: àpartir de données apparemment restreintes, une intention de la prièreeucharistique pour le premier, les indications de la Didachè pour le second,la recherche s’élargit par cercles concentriques jusqu’à parvenir à la plei-ne compréhension de chacun des points en question, la nature de l’unité
4 Cf C.V. GHEORGHIU, Dalla venticinquesima ora all’eternità, tr. it. E. Cattaneo, San Pao-lo, Cinisello Balsamo 2007.
324
demandée pour l’Eglise dans le premier cas, la place dans le christianis-me du partage des biens et de l’argent destiné à l’Eglise et à ses ministrespour la seconde étude. Dans l’un et l’autre cas, la progression prend encompte longuement des éléments très concrets – quoi de plus concret quela subsistance matérielle, ou l’unité et la division? – pour aboutir à la dé-couverte biblico-théologique de notions ecclésiologiques fondamentales.
Les Ministeri (1997) sont donc peut-être, jusqu’à ce jour, le chef d’œu-vre de notre auteur. On y retrouve trois atouts majeurs: l’acribie de l’exa-men, l’art de la synthèse harmonieuse et l’équilibre dans la pondération dujugement, particulièrement délicat à porter dans une matière souvent âpre-ment disputée. L’introduction d’environ deux cents pages, assez longuepour constituer à elle seule un monographie, assez courte pour ne pasdéséquilibrer l’ensemble, s’appuie sur les documents (potentiellement ex-haustifs) qui font l’objet dans le recueil d’une traduction originale, profon-dément mûrie et pensée par l’auteur en cohérence avec sa vision d’ensem-ble, et d’une annotation précise, où le critique n’hésite pas à prendre posi-tion, avec pondération mais clarté. Le tout, servi par des indices abondants,est remarquable de complétude, de clarté magistrale et de cohérence.
Le manuel de théologie fondamentale paru deux ans plus tard (1999),et que l’auteur vient de rééditer en une version remaniée, mais avec un ti-tre inchangé Trasmettere la fede. Tradizione, Scrittura e Magistero nella Chie-sa, nous transporte dans une toute autre atmosphère, même si l’attentionau texte biblique, surtout néotestamentaire, et à ses implications concrè-tes s’y retrouve de manière similaire. L’idée dominante est celle du passa-ge, qui fascine notre auteur: passage historique de Jésus aux témoignagesécrits en passant par la transmission apostolique, passage économique del’inspiration divine aux auteurs sacrés, passage plus conflictuel, mais toutaussi fécond, du donné scripturaire au dogme proclamé, théologie du té-moignage enfin, dans la perspective d’un vingtième siècle finissant mar-qué, comme le rappelait Jean-Paul II, par un renouveau du martyre.
Dès 1985, Enrico Cattaneo avait cosigné, avec H. de Lubac, une ré-flexion portant sur la portée de la constitution conciliaire Dei Verbum, ily est revenu avec sa contribution approfondie à l’Introduzione generale allaBibbia de R. Fabris (2006) portant sur l’inspiration scripturaire, dans uneétude parue récemment (2012) à partir de l’Exhortation apostolique post-synodale de 2010 Verbum Domini, et, au moment même où j’écris cetteesquisse, Enrico Cattaneo prend part à un Colloque international organi-sé pour les Cinquante ans de Dei Verbum, à l’occasion duquel il pourradéployer plus largement sa réflexion sur les difficiles questions du rapportentre Ecriture et Tradition, entre histoire et théologie, entre critique etadhésion, et chercher à éclairer ce que doit être la position équilibrée d’une
325
herméneutique biblique savante, mais néanmoins ecclésiale, ou peut-êtrefaut-il dire à l’inverse ecclésiale, et néanmoins savante.
Dans tout ce qui précède, Enrico Cattaneo affronte des problèmes, queceux-ci soient d’ordre historique ou théorique, et cherche à les résoudregrâce, je l’ai dit, à une méthode adaptée. Il existe également des problè-mes textuels, philologiques, tels ceux posés par le texte fameux d’Irénéeen AH III,3,2 ou celui, non moins important peut-être, des décrets d’Atha-nase, pour lesquels il avance des propositions de lecture (Augustinianum2000 et Adamantius 2002). Il ne recule pas non plus devant les grandesmachines probatoires destinées à soutenir l’attribution d’un texte ou d’uncorpus textuel à un auteur: ce type de recherche a été celui de sa premiè-re publication, avec la proposition d’attribution à Apollinaire de Laodicéede trois Homélies pascales, c’est aussi celui de son plus récent ouvrageencore inédit, prévu pour 2013, qui s’efforce de justifier l’attribution à Ba-sile de Césarée du Commentaire sur Isaïe transmis sous son nom, attribu-tion contestée par la critique; chemin faisant, Enrico Cattaneo met au jourde grands pans d’exégèse origénienne du prophète Isaïe, à peine retouchéssans doute, comme une nouvelle Philocalie à laquelle Basile se serait li-vré à partir de l’œuvre du maître de Césarée.
Cette présentation ne serait pas complète si on ne prenait pas en comp-te les nombreux écrits de «haute vulgarisation» auxquels Enrico Cattaneoaime se livrer, en complément de ses études plus fouillées: ils satisfont àla fois son sens de la synthèse et son goût de la réflexion sur des thèmesgénéraux ou d’actualité. Certains, comme la plaisanterie patristique sur le«“Credo” d’Ignace d’Antioche (Civiltà Cattolica 2010), brillant centon d’énon-cés confessants d’Ignace disposés selon le plan du Credo de Nicée, l’arti-cle de la Rassegna di Teologia 2007 sur la continence des clercs, construitselon une marche régressive, de Jean-Paul II à saint Paul, ou celui de LaCiviltà Cattolica 2012 sur la spiritualité sacerdotale des Lévites sont, dansleur brièveté, de vraies réussites, du fait de la portée de la réflexion et del’élégance condensée de la forme.
Qui sait ce que produira encore la créativité de notre auteur? Il n’estpas à craindre que sa verve ne tarisse – seulement qu’elle cède la place ausilence de la stupeur devant la démesure du mystère.
The article traces the scientific work of Enrico Cattaneo, focusing onthe aspects of method and content of his work and highlighting hiscontribution to research in the various fields object of his studies.
326
L’articolo ripercorre l’attività scientifica di Enrico Cattaneo, soffer-mandosi sugli aspetti di metodo e contenuto della sua opera e eviden-ziando il contributo offerto da Enrico Cattaneo alla ricerca nei diver-si campi oggetto dei suoi studi.
327
P. Enrico Cattaneo S.I.:un itinerarioAntonio Barruffo
Da molti anni conosco padre Enrico Cattaneo. Nella ricorrenza del suo70mo compleanno desidero offrire anche ad altri una mia breve testimo-nianza su di lui perché quando ero Rettore del Seminario Campano diPosillipo l’ho avuto come collaboratore e come animatore nella formazio-ne dei seminaristi, e quando sono stato Decano e Preside della PontificiaFacoltà Teologica dell’Italia Meridionale ho potuto apprezzare le sue qua-lità di docente in campo accademico.
Il compito principale che egli ha avuto nella Facoltà Teologica di Na-poli è l’insegnamento dei Padri della Chiesa. Rivela una forte passione perquesti autori di vita santa e di conoscenza teologica profonda. Egli si ap-passiona nel cercare e descrivere il modo con cui questi autori hanno con-tinuato e approfondito con cura quanto narrato dagli autori dei Vangeli edelle lettere apostoliche.
Sugli eventi di Gesù e degli Apostoli non si ferma al singolo autore, masviluppa anche il rapporto tra di loro e l’importanza della loro dottrinadogmatica e spirituale. Tutto questo padre Cattaneo lo rende in un modovivace che fa sentire il gusto di appartenere a un organismo vivo, quale èla Chiesa, da cui il cristiano attinge per crescere nella sua vita di fede e dioperosità umana e cristiana.
La buona conoscenza delle lingue antiche, in particolare del greco e dellatino, danno al padre Cattaneo, una comprensione più vera del discorsodi coloro che da Dio sono stati designati ad annunziare il suo regno e adinvitare ad entrarvi. In tal modo il testo dei Vangeli, degli Atti degli Apo-stoli e degli altri autori cristiani, che ruotano intorno a questi, acquista-no un sapore di attualità che parla agli uomini di oggi e ad essi rivolge ildiscorso impegnativo della sequela.
I suoi contributi scientifici in articoli e libri sono molti. In alcuni diquesti scritti, egli ritrae i fatti evangelici con maestria di rappresentazio-ne tale da coinvolgere il lettore nella storia narrata o nel messaggio tra-smesso. Così, segue la scelta di Gesù nella proclamazione della beatitudi-ne dei poveri a cui appartiene il regno dei cieli. E di questi egli ha una curatutta particolare.
I suoi studi lo hanno reso anche padrone delle lingue moderne: fran-cese, inglese, tedesco... Il che gli permette di entrare direttamente nei pro-
328
blemi umani attuali, di discernerli alla luce del Vangelo e di trovare la for-za spirituale di farli propri. E di proporli agli altri come cammino di vita.
Si ascolta con gioia spirituale padre Cattaneo che parla, perché il suodiscorso è pieno di luce, quella luce che viene dall’alto e che porta pace alcuore. Le sue parole sono cariche di fede. Con cui fa sentire più vicino ilmistero di Dio che coinvolge gli uomini.
Barruffo’s note is a sign of affect to dedicated to Enrico Cattaneoby abrother, who was Dean and Headmaster of the Pontifical TheologicalFaculty of Southern Italy and Rector of the Pontifical Interregional Se-minary of Campania and who shared with him many years of scien-tific and teaching collaboration.
La note d’Antonio Baruffo apporte un témoignage personnel, de la partd’un confrère qui a été Doyen et Président de la Faculté ThéologiquePontificale d’Italie du Sud ainsi que Recteur du Séminaire Interrégio-nal de Campanie, et qui a eu ainsi l’occasion de connaître pendant denombreuses années Enrico Cattaneo en tant qu’enseignant, chercheuret coresponsable de la formation des futurs prêtres.
329
Curriculum studi di Enrico CattaneoGiancarlo Isnardi
- Maturità Classica, conseguita presso l’Istituto Leone XIII, Milano (1962)
- Licenza triennale in Filosofia (Facoltà Filosofica Aloisianum di Gal-larate, 1964-67), conseguita con la dissertazione (dattiloscritta):
IL LIBRO LAMBDA (XII) DELLA METAFISICA DI ARISTOTELE (pagine 65).
- Laurea in Lettere Classiche, Università di Padova (1967-71), conse-guita con la tesi (dattiloscritta):
CONOSCENZA DI DIO E RIVELAZIONE IN TERTULLIANO. PER UNA ESEGESI PRENICE-NA DI LC 10, 21-22 (pagine 217).
- Baccalaureato in teologia (triennale), presso la Pontificia Facoltà Teo-logica dell’Italia Meridionale (Napoli) 1971-74.
- Maîtrise en Théologie biblique et systématique, Institut Catholiquede Paris (1974-76), avec la dissertation (dactylographiée) :
L’APOCATASTASE CHEZ GRÉGOIRE DE NYSSE DANS L’INTERPRÉTATION DE
H.U. VON BALTHASAR. ESSAI D’HERMÉNEUTIQUE THÉOLOGIQUE (pagine 142).
- Doctorat de 3ème Cycle, Institut Catholique de Paris - Université dela Sorbonne, 1976-79), avec la thèse (publiée):
TROIS HOMÉLIES PASCHALES PSEUDO-CHRYSOSTOMIENNES COMME OEUVRE
D’APOLLINAIRE DE LAODICÉE. ATTRIBUTION ET ÉTUDE THÉOLOGIQUE.
349
Indice
INTRODUZIONE
Anna Carfora ............................................................................................................. 5
COLLABORATORI .............................................................................................. 9
SCRITTURA E RECEZIONE
NOMI DI GESÙ
Pino Di Luccio ........................................................................................................ 131. Rabbi e Signore ............................................................................................. 132. Agnello di Dio ................................................................................................ 143. Figlio di Dio e Figlio dell’Uomo ................................................................... 164. Figlio di Giuseppe e Figlio di Davide .......................................................... 175. Salvezza e Luce .............................................................................................. 186. Parola di Dio .................................................................................................. 207. Figlio di Maria ............................................................................................... 228. Riepilogo e conclusioni ................................................................................. 23
«IL NOSTRO PANE, QUELLO DI DOMANI (SABATO), DONACELO OGGI (VENERDÌ)»(MT 6,11). I RISVOLTI ERMENEUTICI DEL VANGELO EBRAICO SECONDO MATTEO
ALLA LUCE DELLA TESTIMONIANZA DI SAN GIROLAMO
Silvio Barbaglia ....................................................................................................... 251. Introduzione .................................................................................................. 252. La discussione sulla traduzione ................................................................... 303. La duplice natura della “manna”: la “manna quotidiana”, dei sei giorni
e la “manna di domani (sabato)”, del settimo giorno ............................... 334. Il cammino del “pane del sabato”, al cospetto di YHWH,
nell’arca dell’alleanza ................................................................................... 355. La tavola dei pani dell’offerta e la continuità
del «pane del sabato» ................................................................................... 416. Il Padrenostro e il reticolo semantico
del Vangelo secondo Matteo .......................................................................... 447. Es 16 e Gv 6: Gesù come «manna del sabato», un «cibo che
dura per la vita eterna» (Gv 6,27) ............................................................... 478. Conclusione ................................................................................................... 49
350
IL SIMBOLO NUZIALE IN OSEA 2,4-251Cosimo Pagliara ...................................................................................................... 51
1. Un simbolo personalizzato ........................................................................... 522. Il testo nel suo contesto ................................................................................ 533. Articolazione del testo .................................................................................. 534. Il litigio matrimoniale ................................................................................... 55
La sposa accusata e minacciata (2,4-6) ..................................................... 55La corsa dietro gli amanti (2,7-9) ............................................................... 56Il piano divino della correzione (2,10-15) .................................................. 57
5. La Riconciliazione Matrimoniale ................................................................ 61La divina seduzione (2,16-17) .................................................................... 61Il Nome nuovo (2,18-19) ............................................................................ 64I doni divini (2,20-22) ................................................................................ 66Prosperità del paese e moltiplicazione del popolo (2,23-25) ...................... 70
Conclusione ....................................................................................................... 72
TESTAMENTUM-DIATHEKE
Domenico Marafioti ................................................................................................ 731. La scomparsa di Testamento ........................................................................ 732. Agostino e testamentum ................................................................................ 743. Girolamo e foedus ......................................................................................... 774. Le oscillazioni tra foedus e testamentum .................................................... 795. “Alleanza”, una traduzione insoddisfacente ............................................... 806. La deformazione di diatheke nella lingua greca ......................................... 847. La deformazione di diatheke nella lingua biblica ....................................... 868. L’irriducibile significato di testamento ....................................................... 909. Breve analisi di Gal 3,15-18 .......................................................................... 9210. Breve analisi di Eb 9,15-20 ......................................................................... 9411. Primi risultati e conseguenze ..................................................................... 9612. Alleanza e testamento, breve analisi semantica ....................................... 9813. Adozione filiale .......................................................................................... 10014. La dignità filiale nella liturgia .................................................................. 10315. La famiglia di Dio nella liturgia e nel Vaticano II .................................. 10416. Il testamento .............................................................................................. 10617. Conclusione ............................................................................................... 109
IL QUARTO SACRAMENTO IN CERCA DI NOME. LA LITURGIA ALLA LUCE DELLA SCRITTURA
Cesare Giraudo ..................................................................................................... 1131. Sacramento della Conversione .................................................................. 1142. Sacramento della Penitenza ....................................................................... 1143. Sacramento della Confessione ................................................................... 1154. Sacramento del Perdono ............................................................................ 1175. Sacramento della Riconciliazione ............................................................. 119
351
L’INTERPRÉTATION DES ACTES ET PAROLES DE JÉSUS
DANS LES LETTRES D’IGNACE D’ANTIOCHE
Agnès Bastit-Kalinowska ...................................................................................... 1211. Vers la confession christologique: «éclairer l’économie» ........................ 124
Confessions antithétiques ......................................................................... 125Confessions narratives .............................................................................. 128Confession et vision .................................................................................. 132
2. Les actes de Jésus ........................................................................................ 135Les mystères vécus (Éphésiens 17-20) ..................................................... 135Un modèle vécu ......................................................................................... 143
3. L’usage des paroles ...................................................................................... 146Fonction théorique:«La connaissance de Dieu - qui est Jésus-Christ» (cf Mt 11,27) ............ 147La parénèse ou les «préceptes de Jésus-Christ» (Éphésiens 9,2) ............ 151Métaphores et antithèses: la reprise expressived’images évangéliques ............................................................................... 153
Métaphores simples ............................................................................. 153Images doubles en contraste .............................................................. 156
Conclusion générale ........................................................................................ 160Annexe .............................................................................................................. 164
CHIESA E CONTESTO STORICO
LA TESTIMONIANZA DI ORIGENE SU IGNAZIO DI ANTIOCHIA
Enrico Norelli ........................................................................................................ 169L’Omelia 6 su Luca .......................................................................................... 169Le altre testimonianze .................................................................................... 180
LA RAPPRESENTAZIONE DEI MINISTERI NEGLI SCRITTI DI TERTULLIANO
Andrea Villani ........................................................................................................ 1831. Apologeticum 39 ........................................................................................... 1842. De baptismo 17 ............................................................................................ 1863. De fuga in persecutione 11 .......................................................................... 1894. Conclusioni .................................................................................................. 192
COSTANTINO E LA MADRE ELENA
NELL’INTERPRETAZIONE POLITICO-RELIGIOSA DI AMBROGIO DI MILANO
Antonio V. Nazzaro ............................................................................................... 1951. Dedica ........................................................................................................... 1952. Il De obitu Theodosii di Ambrogio ............................................................. 1953. Teodosio incontra Graziano nel paradiso ................................................. 1974. Teodosio incontra gli altri parenti e Costantino ....................................... 198
352
5. Con il pellegrinaggio a Gerusalemme e l’inuentio crucisElena propizia al figlio la protezione divina ............................................ 202
6. Elena: de stercore ad regnum ...................................................................... 2037. L’apostrofe al diavolo sul Golgota e il rapporto figurale Maria-Elena ... 2048. Rinvenimento della croce ........................................................................... 2069. I chiodi della croce trasformati da Elena
in un morso e corona-diadema ................................................................. 20810. Tormento dei Giudei ................................................................................. 21211. Riflessioni finali sul sanctum super frenum e sull’Helenae operatio ..... 21312. Conclusione ............................................................................................... 215
TEOLOGIA PATRISTICA E MODERNA
LA TESTIMONIANZA DEI PADRI DELLA CHIESA
E LA TRASMISSIONE DELLA FEDE NEL MONDO D’OGGI
Enrico dal Covolo ................................................................................................. 2211. Ireneo di Lione: quale fede trasmettere? .................................................. 2222. Ambrogio e Agostino: come trasmettere
(o meglio testimoniare) la fede? ................................................................ 2253. Ancora Ambrogio e Agostino: come educare alla fede? ........................... 229
3.1. La teoria catechetica di Ambrogio ..................................................... 2293.2. La teoria catechetica di Agostino ....................................................... 231
LE SUJET D’ATTRIBUTION DES ÉNONCÉS BIBLIQUES:L’ANATHÉMATISME 4 DE CYRILLE D’ALEXANDRIE
Dominique Bertrand ............................................................................................. 2351. Entendre un anathématisme ...................................................................... 2352. Le moment des anathématismes ............................................................... 2363. La pointe de l’anathématisme 4 ................................................................. 2375. L’abîme d’un simple écart ........................................................................... 2396. Profiter de l’unité première du Christ ....................................................... 2417. Brève actualisation ...................................................................................... 244
LA PERSONA IN TOMMASO D’AQUINO.SONDAGGIO CRITICO A PARTIRE DA SUMMA THEOLOGIAE I, Q.29, A.1Nicola Salato ......................................................................................................... 247
STORIA E TEOLOGIA. L’APPORTO DI B. LONERGAN
Giuseppe Guglielmi ............................................................................................... 2551. Differenziazione della coscienza e sviluppo dottrinale ........................... 2552. Gli studi storico-critici ................................................................................ 2563. Storicità e significato permanente del dogma .......................................... 257
353
SPIRITUALITÀ
PAUL DE TAMMA, LETTRE SUR LA CELLULE. UNE TRADUCTION FRANÇAISE
Philippe Luisier ..................................................................................................... 265Introduction ..................................................................................................... 265Traduction ........................................................................................................ 270Index ................................................................................................................. 281
Citations bibliques .................................................................................... 281Noms propres ............................................................................................ 281Mots grécoptes ........................................................................................... 282
SULL’ESPERIENZA MISTICA CRISTIANA FRA STORIA E TEOLOGIA
Francesco Asti ....................................................................................................... 285Introduzione .................................................................................................... 2851. Un trinomio linguistico: mistero-mistica-iniziazione .............................. 2852. L’esperienza di Dio nella rivelazione ebraico-cristiana ........................... 2883. Un dinamismo storico: la condiscendenza di Dio
e lo slancio del cuore umano ..................................................................... 2924. La posizione di Benedetto XIV sulle grazie mistiche .............................. 296
Alcune suggestioni del Concilio Vaticano II sulla mistica ...................... 298Il Catechismo della Chiesa Cattolica ........................................................ 300Documento della Congregazione per la Dottrina della Fede:Orationis Formas ..................................................................................... 302
5. Vita mistica ed esperienza mistica ............................................................ 303Tratti fondamentali dell’esperienza mistica .............................................. 304
6. Mistica e santità .......................................................................................... 3067. Mistica e teologia ........................................................................................ 3088. Mistica e psicologia ..................................................................................... 3109. Mistica e dialogo interreligioso .................................................................. 314Per continuare a riflettere: l’attualità dei mistici ......................................... 316
ENRICO CATTANEO SJ
DE LA MÉTHODE A LA VÉRITÉ: L’ŒUVRE D’ENRICO CATTANEO
Agnès Bastit-Kalinowska ...................................................................................... 321
P. ENRICO CATTANEO S.I.: UN ITINERARIO
Antonio Barruffo ................................................................................................... 327
CURRICULUM STUDI DI ENRICO CATTANEO
Giancarlo Isnardi .................................................................................................. 329
354
PUBBLICAZIONI DEL PROF. ENRICO CATTANEO SJ
Giancarlo Isnardi .................................................................................................. 331
INDICE DEI NOMI ......................................................................................... 343
INDICE ....................................................................................................... 349
I volumi di questa collana intendono favorire il dibattito e l’approfondimento della ricerca storica dedicata alla cristianistica, con particolare attenzione all’area medi-terranea. Essi hanno come obiettivo il tentativo di colmare la diffusa ignoranza e il !"#$%&'$()*+,-+!)$%$*)-#-.+&(&/%*(-!'-+$+!$'#0-1/&2-*(-+/3$+&(/*%&+/&%&))$%-22&(*+le conoscenze comuni sul cristianesimo. La collana vuole così stimolare nei lettori e negli studiosi la promozione in Italia di sempre nuovi e aggiornati studi - o tra-duzioni inedite - dedicati a questioni aperte e dibattute della storia del cristianesi-mo, con particolare attenzione a quei temi che possono aiutare nella ricostruzione della mentalità religiosa, esigenza questa tanto riaffermata quanto sovente disatte-sa. Del sorgere e dello svilupparsi di quella mentalità i volumi della Collana si pro-pongono di fornire analisi aggiornate, attente al contesto e innovative nella moda-lità della ricerca. Una Collana ideata e realizzata in quel sud d’Italia di cui molti vorrebbero oggi ne-4&%$+$!-!)$(2&.+,-4(-)5+!/-$()-1/&+$+&")*(*'-&+,-+#$(!-$%*6+7+#%*#%-*+,&+8"$!)&+/*(-,-2-*($+,-+'&%4-(&0-)5.+,9-(,-::$%$(2&+$+#%*4%$!!-;&+%-,"2-*($+,-+1(&(2-&'$()-+$+,-+risorse da parte degli Enti Locali e di scarso riconoscimento ministeriale, che la Collana si propone di offrire un pur piccolo contributo: sia alla cultura italiana - so-vente presuntuosamente competente di storia del cristianesimo, sia per alimentare la molto tenue speranza per un sud d’Italia consapevole della ricchezza del pensie-ro meridiano. Un Meridione responsabilmente impegnato ad affrancarsi da quei poteri accademici e politici concepiti come dominio e monopolio dei saperi e delle coscienze.
SEZIONE ANTICA
1. CONSONANTIA SALUTIS Studi su Ireneo di Lione a cura di Enrico Cattaneo e Luigi Longobardo
2. GIUDEI O CRISTIANI? Quando nasce il Cristianesimo? a cura di Dario Garribba e Sergio Tanzarella
3. GIUDEI E CRISTIANI NEL I SECOLO Continuità, separazione, polemica a cura di Maria Beatrice Durante Mangoni e Giorgio Jossa
4. GESÙ E I MESSIA D’ISRAELE Il messianismo giudaico e gli inizi della cristologia a cura di Annalisa Guida e Marco Vitelli
5. PATRES ECCLESIAE Una introduzione alla teologia dei padri della Chiesa Enrico Cattaneo, Carlo Dell’Osso, Giuseppe De Simone e Luigi Longobardo
6. PROFETI E PROFEZIA Figure profetiche nel cristianesimo del II secolo a cura di Anna Carfora e Enrico Cattaneo
7. IL GEMELLO DI GESÙ Commento al Vangelo di Tommaso James W. Heisig
8. REDEMPTOR MEUS VIVIT Iscrizione cristiane antiche dell’area napoletana Giovanni Liccardo
9. UN ALTRO GESU? I vangeli apocri!ci, il Gesù storico e il cristianesimo delle origini a cura di Annalisa Guida ed Enrico Norelli
10. I CRISTIANI AL LEONE I martiri cristiani nel contesto mediatico dei giochi gladiatorii Anna Carfora
11. GIOVANNI E IL GIUDAISMO Luoghi, tempi, protagonisti a cura di Annalisa Guida e Dario Garribba
12. GIOVANNI BATTISTA: UN PROFETA E TRE RELIGIONI a cura di Paolo Gamberini
13. APOCALITTICA E VIOLENZA POLITICA nelle tre grandi religioni abramitiche Pasquale Arciprete
14. SYNKATABASIS La condiscendenza divina in Giovanni Crisostomo Carlo Scaglioni
15. VANGELO, TRASMISSIONE, VERITÀ a cura di Agnès Bastit-Kalinowska e Anna Carfora
SEZIONE MODERNA E CONTEMPORANEA
1. GLI ANNI DIFFICILI Lorenzo Milani, Tommaso Fiore e le Esperienze Pastorali Sergio Tanzarella
2. MESSAGGERE DI LUCE Storia delle quacchere Katherine Evans e Sarah Cheevers prigioniere dell’Inquisizione Stefania Arcara
3. LORENZO MILANI Memoria e risorsa per una nuova cittadinanza a cura di Luigi Di Santo e Sergio Tanzarella
4. TU NON UCCIDERAI Diario di un obiettore di coscienza alla guerra di Algeria Jean Pezet
5. TEOLOGHE IN ITALIA Indagine su una tenace minoranza a cura di Anna Carfora e Sergio Tanzarella
6. IL PENSIERO DI LANZA DEL VASTO Una risposta al XX secolo a cura di Antonino Drago
7. RICORDI AUTOBIOGRAFICI ! IL MIO TESTAMENTO Raccolta di pensieri pratici Baldassarre Labanca edizione critica a cura di Sylwia Proniewicz e Sergio Tanzarella
8. PROFEZIA E POLITICA IN EMMANUEL MOUNIER Nucleo strategico del pensiero utopico del Novecento Luciano Nicastro
9. IL SIGNORE CI CONDUCE COME MADRE La missione etiopica di Fra Francesco da Mistretta Stefano Brancatelli
10. ANTONIO PALLADINO "1881!1926# Un prete “fuori sacrestia” in una diocesi del Mezzogiorno Angelo Giuseppe Dibisceglia