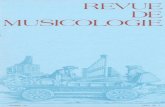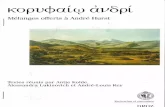Prolégomènes à l’Interprétation du Rêve de Freud : 3. – Analyse de contenu des chap. V, VI,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Prolégomènes à l’Interprétation du Rêve de Freud : 3. – Analyse de contenu des chap. V, VI,...
1
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
● https://ashtarout.org –– –– e-mail : [email protected] ●
’Ashtaroût Bulletin volant n° 2014∙0425 (avril 2014), 22 p. ~ Traumdeutung / Clinique & Épistémologie ISSN 1727-2009
Amine Azar
Prolégomènes à l’Interprétation du Rêve de Freud 3. Ŕ Analyse de contenu des chap. V, VI, et VII
Résumé. ― Les trois derniers chapitres de la Traumdeutung ne forment pas un ensemble autonome comme les trois précédents. Ils dépendent des précédents parce qu’ils re-prennent pour les approfondir les questions laissées précé-demment en suspens. Leur liste est aux mots-clés.
Mots-Clés. Ŕ Compulsion d’aveu – Illusions rétrospectives Ŕ Sexualité infantile – Perversions sexuelles Ŕ Complexe d’Œdipe Ŕ Complexe de castration – Symbolique – Analité – Rêves de punition – Débats épistémologiques – Objet de la psychanalyse – Appareil psychique – Discours intérieur.
Ce texte est le 3e volet de l’ensemble suivant :
Prolégomènes à l’Interprétation du Rêve de Freud
1. Ŕ Les trois ou quatre catastrophes ’Ashtaroût, bulletin volant n° 2014∙0411, avril 2014, 7 p.
2. Ŕ Analyse de contenu des chap. II, III et IV ’Ashtaroût, bulletin volant n° 2014∙0418, avril 2014, 8 p.
3. Ŕ Analyse de contenu des chap. V, VI et VII ’Ashtaroût, bulletin volant n° 2014∙0425, avril 2014, 22 p.
4. Ŕ Récapitulation & Bibliographie ’Ashtaroût, bulletin volant n° 2014∙0503, mai 2014, 11 p.
19/ L’unité des 3 chap. suivants. – 20/ Les 4 sources du rêve. – 21/ La compulsion d’aveu. – 22/ Aperçus sur la
psychologie de l’enfant. – 23/ La sexualité infantile. – 24/ Les perversions sexuelles. – 25/ La question du
complexe d’Œdipe. – 26/ Lalangue onirique est un procédé d’écriture. – 27/ Destin des particules argumentatives. –28/ L’élaboration secondaire. – 29/ La Symbolique
universelle. – 30/ Le sordide, le morbide & le stercoraire. – 31/ L’autoanalyse mise à nu par ses desservants mêmes. – 32/ Les rêves de punition du parvenu. – 33/ L’appareil
psychique. – 34/ Où est donc passée la Censure. – 35/ L’objet de la psychanalyse. – 36/ Clivage entre théorie
& pratique. – 37/ Processus primaire & secondaire. – 38/ Le discours intérieur.
L’unité des trois chapitres suivants Les chap. V, VI et VII de la Traumdeu-tung peuvent être groupés ensemble.
Mais ils ne constituent pas un ensemble auto-nome. Freud y reprend pour les approfondir des questions spéciales et des problèmes particuliers laissés en suspens. Le lien de ces trois chapitres aux trois précédents est organique. Ceux-ci pou-vaient s’adresser à tous publics. Ceux-là ne s’adressent qu’à ceux qui veulent approfondir les choses. Ils s’adressent aux chercheurs et aux sa-vants. À la différence des trois précédents, ils sont divisés en sections et sous-sections, munies géné-ralement de titres. Nous passons, mais en douceur et progressivement, à un autre régime d’écriture, culminant, au chap. VII, sur des pages particuliè-rement ardues. Quant aux additions, elles n’étaient pas nombreuses jusqu’à présent. Elles vont se multi-plier, tant dans le corps du texte que dans les notes infrapaginales, surtout pour les chap. V et VI. Le VIIe est un chapitre de doctrine. Ce der-nier a subi peu de changements. Freud a seule-ment ajouté du matériel. Il n’a pas modifié la doc-trine, ni n’a remanié ou mis à jour son texte, si ce n’est pour signaler (avec retenue et parcimonie) des prolongements à certaines thèses. Autrement, il aurait fallu tout refondre. Nous allons passer en revue ces trois cha-pitres un à un. Le chap. V est consacré au maté-riel et aux sources du rêve. C’est l’occasion pour Freud de confronter ses découvertes aux intui-tions de ses prédécesseurs. En somme, le pano-rama bibliographique qu’il nous avait infligé au chap. Ier n’aura pas été tout à fait inutile. En se confrontant maintenant à ses prédécesseurs sur des points particuliers de doctrine, Freud est en possession d’une batterie minimale de principes qui lui permet de prendre immédiatement un avantage considérable sur eux. Toutes les obser-vations recueillies par ses prédécesseurs ne con-cernent que le contenu onirique manifeste. Quant à lui il est non seulement en possession de la dis-
19
2
tinction entre contenu manifeste et contenu latent, mais il est également en possession d’une esquisse orientée de l’appareil psychique, comprenant deux systèmes (grosso modo l’Inconscient et le Conscient) séparés par une instance de censure.
1er Système
(Inconscient)
→ La
CENSURE
→ 2e
Système
(Conscient)
Si l’on voulait être précis, il faudrait plutôt parler de trois systèmes. Mais il semble que Freud englobait le 1er système et la censure dans un même ensemble. Une notation à propos de Mey-nert, son maître en neurologie, le laisse entendre. Celui-ci distinguait d’un Moi Primaire un Moi Secon-daire qui viendrait au cours du temps le recouvrir et l’inhiber 1. À la même époque (1892) d’autres auteurs avaient également avancé cette thèse, tel que l’aliéniste américain Kiernan de Chicago 2. Au-trement dit : c’est le moi secondaire qui censure le moi primaire. Tout cela étant une affaire interne au moi. Quinze ans plus tard Freud dira encore quelque chose de semblable 3 :
Pour l’instant, tenons ceci pour acquis : la défor-mation onirique est une conséquence de la censure qui est exercée par des tendances reconnues du Moi (aner-kannten Tendenzen des Ichs) contre des motions de sou-hait choquantes, d’une façon ou d’une autre, qui s’agitent en nous la nuit pendant le sommeil.
Les 4 sources du rêve Le chap. V est un chapitre intermé-diaire. Les additions qui y sont faites
troublent peu le fil du discours, jusqu’à ce que nous soyons parvenus à la dernière section con-sacrée aux rêves typiques. Ce chapitre est divisé en quatre sections, consacrées chacune à l’une des sources du rêve. La 1re source, ce sont ce que Freud dénomme les excitateurs oniriques (Traumerreger) 4, Ŕ encore une notion appartenant à la métapsychologie oc-culte de Freud qu’il faudrait (re)découvrir. Ce sont les restes diurnes de la veille. Freud les divise en deux groupes. En effet, les restes diurnes insigni-fiants font généralement écran à des restes diurnes
1 Traumdeutung, chap. V, § D-β. Ŕ GW, 2/3 : 256. SE, 4 : 250. 2 Cf. AZAR (1975), pp. 182-183, texte nº 92. 3 FREUD (1916-1917) : IXe leçon d’Introd. à la Psycha. Ŕ GW, 9 : 148. SE, 15 : 147. OCF, 14 : 150. 4 On pourrait dire aussi : les instigateurs oniriques.
hautement significatifs. Et Freud prend nettement position en faveur de la continuité psychique entre l’état de veille et la vie onirique 5. C’est ce qu’André Breton dénomma en 1932 des vases com-municants. Freud insiste sur la radicalité de sa thèse : il n’y a pas d’instigateurs oniriques indifférents, donc pas de rêves innocents non plus 6. Et le voilà qui nous ouvre sa collection pour en tirer quelques beaux spéci-mens. Comme ils touchent à la sexualité, il referme vite son classeur sur nos doigts, et passe aussitôt à la seconde source. La 2e source est constituée par le matériel in-fantile. De même que dans toute interprétation de rêve on retrouve des restes diurnes appartenant à la veille du rêve, on retrouve également du maté-riel infantile. Ainsi est-on parfois surpris de re-trouver des souvenirs oubliés. Ici aussi prévaudra la même argumentation que pour les restes diurnes insignifiants. Freud se fait fort de démon-trer que ces souvenirs, apparemment insignifiants, sont en fait des souvenirs-de-couverture qui font écran à des épisodes significatifs de l’enfance. Pour étayer son propos, il se complait à nous rapporter de larges échantillons de ses propres rêves et sou-venirs-de-couverture. Arrivé au terme de cet examen, Freud se heurte au problème de l’induction. On a beau ac-cumuler des exemples où le matériel du rêve ap-partient aussi bien aux restes diurnes qu’aux sou-venirs de l’enfance, cela ne permet nullement d’en tirer une règle générale. Il aurait aimé pou-voir soutenir, en effet, la thèse suivante : chaque rêve comporte dans son contenu manifeste un point de rat-tachement au vécu récent, mais, dans son contenu latent, un point de rattachement plus ancien, qui le relie à des expériences significatives de la prime enfance. Que faire, si l’on ne peut pas recourir à l’induction ? La question est superfétatoire. L’investigation du rêve est une lucarne (Fensterlücke) à travers la-quelle nous pouvons jeter un coup d’œil à l’inté-rieur de l’appareil psychique 7. On sait que, d’une part, le rêve doit être replacé parmi les autres formations psychiques (normales et patholo-giques), et que, d’autre part, il doit être rattaché au fonctionnement général du psychisme. La so-lution de ces deux problèmes est reportée au chap. VII. Quant-à nous, allons y sans attendre. Nous y voyons Freud se servir d’une comparai-son devenue célèbre. Il dira que la pensée du jour
5 Traumdeutung, chap. V, § A. Ŕ GW, 2/3 : 180. SE, 4 : 174. 6 Traumdeutung, chap. V, § A. Ŕ GW, 2/3 : 189. SE, 4 : 183. 7 Traumdeutung, chap. V, § B. Ŕ GW, 2/3 : 224. SE, 4 : 219.
20
3
joue le rôle de l’entrepreneur, qui a besoin d’un capi-taliste pour financer son entreprise. Suivant Freud, l’investissement provient d’un souhait de l’en-fance ayant conservé dans l’inconscient toute son énergie 8. C’est ainsi qu’il résout élégamment ce problème épistémologique épineux. La 3e source du rêve est une vieille connais-sance qui remonte à la nuit des temps. On a tou-jours estimé que le rêve trouve son incitation dans des sensations corporelles : une mauvaise digestion, un bras ankylosé, un besoin naturel, etc. L’ancienne médecine utilisait même le rêve pour diagnostiquer des maladies se trouvant en-core en incubation. La source somatique du rêve a toujours été reconnue, mais, suivant Freud, elle a été surévaluée. D’une part, on s’est borné jus-qu’à présent à rattacher les excitations somatiques au contenu onirique manifeste. D’autre part, l’analyse montre qu’il ne faut pas accorder plus d’importance aux excitations somatiques qu’aux restes diurnes comme inducteurs du rêve. Le travail du rêve sait tirer parti de ceux-ci comme de ceux-là pour parvenir à ses fins, à sa-voir exprimer par leur intermédiaire le souhait in-conscient. Un rêve personnel est présenté à l’appui. Freud y chevauche un cheval gris, alors qu’il souffre d’un furoncle à l’entre-jambe, gros comme une pomme. Ce rêve permet à Freud de défendre l’idée que le travail onirique n’est pas embarrassé pour tirer parti même et y compris d’un matériel pénible. Il engage ici une dialectique ser-rée avec ses prédécesseurs. Il en conclut que tous les rêves sont, au bout du compte, et d’une cer-taine façon, des rêves de commodité. Cela revient à dire qu’avant toute chose le rêve accomplit le souhait de dormir. La première fonction du rêve est d’être le gardien du sommeil. La 4e source, ce sont les rêves typiques. Cette section est de la plus haute importance. Elle a subi au cours des rééditions d’amples remanie-ments qui ont altéré la présentation qui nous est faite de l’évolution des idées de Freud. Il est bon de se reporter d’abord à l’édition originale (11900). Freud y traitait à la file des rêves de nudité, puis des rêves de mort de personnes chères. Il ter-minait son chapitre par une série de rêves où
8 Traumdeutung, chap. VII, § C. Ŕ GW, 2/3 : 566. SE, 5 : 560. La même comparaison est reprise à la fin de la 14e Leçon d’Introduction à la Psychanalyse (1916-1917). Ŕ GW, 11 : 232-233. SE, 15 : 226-227. Naturellement cette discussion épistémologique n’est pas prise en compte par WELSH (1994). On le comprend : elle va à l’encontre de sa thèse. Mieux vaut donc l’escamoter par honnêteté intellec-tuelle, et par charité envers le lecteur.
l’égoïsme absolu du rêve, déjà établi au cours de l’étude des rêves de mort, est illustré par une nouvelle suite de matériel. Quelques remarques sur d’autres rêves typiques suivaient encore. Les divisions et les sous-titres ont été ajoutés ultérieu-rement, et cette section s’est enrichie des rêves d’examen qui la couronnent. Des additions ont été insérées en 21909 et 31911, puis elles furent déplacées au chapitre suivant, quand Freud y créa une section spéciale pour le symbolisme (chap. VI, § E, 41914). La 1re et la 3e source du rêve ne nous arrête-ront pas. En revanche, la 2e et la 4e source ré-clament une attention particulière. On verra aus-sitôt pourquoi.
La compulsion d’aveu La 2e section du chap. V est consacrée à l’infantile comme source du rêve.
Freud s’y débonde. Il y use même d’un subterfuge pour attribuer à un prétendu « estimé collègue » deux de ses propres souvenirs d’enfance. La dé-monstration qu’il cherche à parfaire n’en deman-dait pas tant. Il y a de sa part une complaisance certaine à se raconter de cette manière. Ou encore il y a peut-être chez lui une compulsion à l’aveu qui s’assouvit par le biais de la science 9. Ŕ C’est du moins ce que je pense. L’ambivalence de Freud, ici comme ailleurs, est démontrable. Il lutte parfois contre le coefficient de subjectivité autoanalytique de ses écrits, et il les enrichit d’autres parfois avec du matériel autoanalytique. Ce balancement est, chez lui, constant. Rappelons qu’au cours de la préparation de la 3e éd. de la Traumdeutung, début 31911, Freud son-gea sérieusement à ne plus réimprimer ce livre. Il a caressé le projet de le remplacer par un nouveau Traumbuch, d’où serait expurgée toute marque de subjectivité. Il y renonça devant la protestation de son éditeur. Mais ce dernier projet a, pour ainsi dire, abouti tout de même. Un lustre plus tard, la 2e partie des Leçons d’Introduction à la Psychanalyse en constituera la réalisation différée 10. Revenons à cette 2e section du chap. V de la Traumdeutung, consacrée à l’infantile comme source
9 Thèse que j’ai défendue in La Confession dédaigneuse de Sigmund Freud. Cf. AZAR (2003). Dans une addition de 21907 à la Psychopa-thologie de la Vie Quotidienne (1901b), chap. X, § 4, Freud s’émerveille devant la force impulsive qui nous pousse à dire la vérité (Wahr-heitsdrang). Ŕ GW, 4 : 247. SE, 6 : 221 (the urge to tell the truth). Cf. également KYLE ARNOLD (2006). 10 FREUD (1916-1917) : Leçons d’Introd. à la Psycha., chap. 5 à 15.
21
4
du rêve, où Freud, comme je l’ai dit, se débonde. Cette section constitue une oasis inattendue au sein d’un traité à la typographie compacte. Au cours des remaniements du livre, Freud en a res-pecté le contour. Il n’a jamais entrecoupé ce frag-ment d’une grande confession (Goethe) avec du maté-riel emprunté à d’autres sources, étrangères à sa vie intérieure. Mais ce qui doit nous arrêter plus particulièrement ce sont des détails apparemment secondaires. Des détails qui ont acquis, rétrospec-tivement, une importance insigne. Il s’agit de la sexualité infantile et de la légende d’Œdipe. Nous exa-minerons le biais par lequel ces thématiques furent introduites. Faisons une remarque générale. Ce qu’apporte de nouveau et d’original ce chap. V est un mor-ceau disparu de la vie de l’âme de l’enfant (ein Stück vom untergegangenen Kinderseelenleben), mais qu’un psy-chanalyste parvient à retrouver à partir de témoi-gnages (Zeugnissen) décelés dans le présent d’une psychanalyse 11.
Quelques aperçus de plus sur la psychologie de l’enfant Une précision pour commencer. Les
folkloristes ont divisé leur travail en deux grands domaines de recherches menés de front. D’une part, l’inventaire des motifs ; d’autre part, certains assemblages de motifs en des contes-types 12. Quand Freud parle de rêves typiques, on est embarrassé de situer sa réflexion par rapport à la dichotomie des folkloristes. On a le sentiment que ce qu’il dénomme des rêves typiques s’apparente plus à des motifs de rêves qu’à des rêves-types. Cette ambi-guïté vient de ce que Freud vise parfois le conte-nu manifeste du rêve, et parfois son contenu la-tent. Comme c’est le contenu latent qui prime dans l’orientation psychanalytique, il serait plus approprié de parler de motifs de rêves plutôt que de rêves-types. D’un point de vue psychanaly-tique strict, il n’y a pas de rêves typiques mais des motifs typiques de rêves. L’investigation de ces soi-disant rêves ty-piques ramène Freud à leur source dans l’enfance. Toute cette division doit être comprise comme une contribution à la psychologie de l’enfant, dont Freud nous avait donné un premier aperçu au
11 Traumdeutung, chap. V, § D-β. Ŕ GW, 2/3 : 255. SE, 4 : 250. 12 Ce travail est représenté par le célèbre Index de Antti AARNE (1867-1925), publié en 1911. Il fut remanié en 1928, puis de nou-veau en 1961, par Stith THOMPSON (1885-1976). Cet index consti-tue la référence de tous les folkloristes.
cours du chap. III 13, et un autre ici même, quand il traitait de la 2e source du rêve. Les deux piliers de la psychologie de l’enfant suivant la Traumdeu-tung sont représentés par les deux catégories de rêves typiques qu’il a sélectionnés : d’une part les rêves de nudité, d’autre part les rêves de mort de personnes chères. Chacune de ces catégories prend en charge un aspect particulier de l’âme en-fantine, tout en effectuant des trouées dans un continent nouveau, que Freud s’emploiera à ex-plorer méthodiquement au cours de la décennie suivante. C’est pourquoi il faut rester attentifs à ne pas faire dire à Freud, en 1899, ce qu’il ne par-viendra à formuler que plusieurs années plus tard, au prix d’un formidable labeur. Pour de nombreux commentateurs le risque d’anachronisme et les illusions rétrospectives ne furent pas évités.
La sexualité infantile La sexualité infantile, telle qu’elle se présente dans la 1re éd. de la Traumdeu-
tung comporte quatre traits spécifiques :
a/ Les rêves de nudité sont des rêves d’exhi-bition [Quadrige, p. 284]. Ces rêves de nudité nous reportent au vert paradis de l’enfance où la nu-dité ne suscitait ni gêne ni honte. Il y a pour ain-si dire une sorte de période fugitive où l’enfant s’ébat en toute innocence. Il est difficile d’affirmer si cette « innocence » est réelle, ou si elle projetée rétrospectivement sur cette période. Cette ambiguïté est essentielle, et ne peut être dissipée. Freud le dit expressément : Der Traum ist eben fast niemals eine einfache Erinnerung / Le rêve n’est presque jamais un simple souvenir 14.
b/ Une autre notion appartenant à la méta-psychologie occulte intervient encore. C’est la notion de période préhistorique, qualifiant l’en-fance jusqu’à la 3e année environ 15. Par la suite Freud forgera la notion d’amnésie infantile en rela-tion avec ce temps préhistorique. Au passage nous cueillons une remarque qui aura un reten-tissement considérable 16 :
Les relations entre nos rêves typiques et les contes et autres matériaux poétiques ne sont assurément ni isolées ni fortuites.
13 Cf. le § 10, de la 2e partie de ces Prolégomènes. 14 Traumdeutung, chap. V, § D. Ŕ GW, 2/3 : 251. SE, 4 : 246. 15 Traumdeutung, chap. V, § D. Ŕ OCF, 4 : 284, 286, 294-295, etc. 16 Traumdeutung, chap. V, § D. Ŕ GW, 2/3 : 252. SE, 4 : 245.
22 23
5
Freud s’était déjà référé, à propos des rêves de nudité, au conte d’Andersen : Les habits neufs de l’Empereur. La notation que je viens de citer est aussitôt illustrée par un passage du roman de Gottfried Keller (1855), Henri le Vert, qui donne la clé d’un épisode de l’Odyssée d’Ulysse (Rhapsodie VI), celui de son apparition devant Nausicaa et ses compagnes de jeu. C’est aussi dans la suite de ce même chapitre que Freud développera plus ambitieusement une autre tentative de psychana-lyse appliquée à la littérature, ainsi qu’on le verra plus loin (→ Cf. § 25).
c/ Les rêves de vol et de chute, en tant que rêves typiques, se ramènent aux jeux de mouve-ment de l’enfance. Ils éveillent des sensations sexuelles concomitantes. Les jeux de bagarre et de « bousculade » (Hetz) 17 surtout, sont souvent rapportés par les analysants comme ayant provo-qué leurs premières érections. Il faut sans doute y ajouter la notion d’effet, de produit, ou de gain marginal (Nebenprodukt) pour toute dépense en ef-fort violent. Il se peut que cette idée provienne directement de la lecture de Binet, mais plus vrai-semblablement de Binet via Krafft-Ebing 18. La notion freudienne de coexcitation (Miterregung) est en relation avec ce que Freud dénomme un gain marginal (Nebengewinn). Ces deux notions (Miterre-gung et Nebengewinn) sont associées joliment dans l’incipit de son étude sur « Personnages psychopa-thiques à la scène » ([1942a] circa 1906).
Les perversions sexuelles d/ Les rêves de nudité sont des rêves d’exhibition / Die Nacktheitsträume sind
also Exhibitionsträume [Quadrige, p. 284]. Freud ne dit pas des rêves d’exhibitionnisme. Il y pense, mais il ne le dit pas encore. La 1re théorie des perver-sions sexuelles en tant que fixation (ou régres-sion) à cette période infantile est présupposée ici. En témoigne dans tout son éclat de bouton frai-chement éclos le texte suivant 19 :
Dans l’histoire de jeunesse des névrosés, se dé-nuder devant les enfants de l’autre sexe joue un grand rôle ; dans la paranoïa, le délire d’être observé quand
17 Cf. Traumdeutung, OCF, 4, chap. V, p. 237, et chap. VI, pp. 312-314. Cf. également les (1905d) Trois Essais sur la Théorie Sexuelle, GW, 5 : 102-104 ; SE, 7 : 201-203 ; OCF, 6 : 138-140. 18 Cf. AZAR (2013) : Notules sur la Psychopathia Sexualis de Krafft-Ebing, I § 6. 19 Traumdeutung, chap. V-β. Ŕ GW, 2/3 : 250. SE, 4 : 244.
on se vêt ou se dévêt doit être ramené à ces expé-riences vécues ; parmi ceux qui sont restés pervers, il existe une catégorie où l’impulsion infantile a été éle-vée au rang de symptôme, celle des exhibitionnistes.
C’est un pas fait en direction de la sexualité de l’enfant en tant que perverse polymorphe. Mais en 1899, Freud n’y est pas encore tout à fait. Il ne fait que tâtonner et soupçonner ces choses, comme on peut s’en rendre compte en lisant sans idées pré-conçues, et sans illusions rétrospectives, les lettres de Freud à Fließ nº42 (88) en date du 1er mars 1896, et nº75 (146) en date du 14 novembre 1897. Ce qui vaut la peine d’être noté c’est cette évolution par petits pas et sans solution de conti-nuité. Pendant dix ans, soit environ de 1895 à 1905, Freud tire sur le même fil et déroule la même pelote. Les ruptures interviendront plus tard, dans des débats véhéments avec lui-même, par personnes interposées : Adler, Jung, et quelques autres. Ce qui brouille les cartes, c’est que les témoignages relatifs à cette période ont été tru-qués. La Traumdeutung, dont la 1re éd. est de 1899, a été remaniée 6 fois, et les Trois Essais sur la Théorie sexuelle, dont la 1re éd. est de 1905, ont été remaniés 5 fois. Il faut une patience de chartiste pour s’y retrouver. Et puis, il faut surtout se méfier des di-verses présentations que les psychanalystes ont répandues. Aucune n’est fiable, celles de Freud moins que les autres.
La question du complexe d’Œdipe La question du complexe d’Œdipe a
fait couler beaucoup d’encre, ce qui a compliqué les choses outre mesure. Nous en sommes au point où le dossier est devenu inextricable vu le nombre de disciplines qu’il concerne : la psychana-lyse, mais aussi l’ethnologie, les études hellénistes, la littérature et l’épistémologie. Il faudra se conten-ter de relever quelques points fondamentaux, sans aucune prétention à l’exhaustivité.
a/ Les rêves de mort de personnes chères mettent en évidence à la fois l’égoïsme absolu de l’enfant, et l’universalité et la toute-puissance de ses sentiments de jalousie 20. La jalousie est l’insé-parable compagnon de l’égoïsme. Vœux de mort,
20 Si, au lieu de qualifier la Traumdeutung de roman de l’ambition, il l’avait qualifiée de roman de la jalousie, WELSH (1994) aurait mon-tré plus de perspicacité psychologique. Mais de la psychologie il n’a pas cure. → Cf. plus bas le § 37.
24 25
6
parce qu’il n’y a pas de dosage en ces questions de lèse majesté. C’est la loi draconienne qui s’applique : la mort 21.
Pour l’amour-propre illimité (le narcissisme) de l’enfant, toute atteinte est un crimen laesae majestatis, et, à l’instar de la législation draconienne, le sentiment de l’enfant ne sanctionne tous les manquements de cette sorte que de la seule peine impossible à doser.
La jalousie a généralement pour cible le pui-né. Elle a ensuite pour cible le parent de même genre que l’enfant : le père pour le garçon, la mère pour la fille. b/ Ce qui permet à Freud d’être aussi affir-matif, c’est la découverte d’une sorte de pierre de Rosette. C’est d’abord un cas d’hystérie féminine qui est passé successivement par plusieurs états. Un cas de névrose de contrainte lui fait suite 22. c/ La légende du roi Œdipe est appelée à la rescousse des vœux de mort contre les parents. Cette légende lie ensemble l’inceste et le parricide. Freud conjoint l’analyse de la pièce de Sophocle avec celle du Hamlet de Shakespeare, comme il l’avait déjà fait dans une lettre envoyée à Fließ le 15 octobre 1897. d/ Et Freud ajoutera après coup des notes pour signaler le rôle important que le complexe d’Œdipe aura à la fois dans la psychologie indivi-duelle, tout comme dans la psychologie collective, ainsi que le fait qu’il polarisera la résistance à la psychanalyse. Il ne s’agit pas d’épuiser les problèmes que cette section soulève. Traitons d’abord des pro-blèmes épistémologiques. Le cadre dressé par Freud est impeccable, et ne saurait soulever des contestations de la part des épistémologues. Le voici restitué dans ses arrêtes : 1/ L’observation directe des enfants est insuffisante. Elle n’est pas décisive. 2/ La cure psychanalytique des adultes névrosés apporte une plus grande conviction. 3/ Car la méthode pathologique grossit les con-tours. 4/ On peut enfin utiliser comme contrôle
21 Traumdeutung, chap. V-β. Ŕ GW, 2/3 : 261. SE, 4 : 255. OCF, 4 : 294-295, note de bas de page ajoutée en 51919. 22 Traumdeutung, chap. V-β. Ŕ GW, 2/3 : 265-267. SE, 4 : 259-260. OCF, 4 : 299-301. Ai-je besoin de dire qu’un WELSH (1994) saute prestement ce genre de passages ? Sa lecture attentive de certains passages de la Traumdeutung a pour contrepartie une scotomisation pour tant d’autres, Ŕ ceux qui ne s’ajustent pas à son parti pris.
les produits culturels : mythes, contes, légendes, ainsi que les œuvres poétiques. À quoi on peut ajouter, à partir d’autres publications : les méta-phores mortes ou les étymologies. Malheureusement Freud ne s’est pas borné à ce cadre admissible. Il a gâté sa cause en lui appor-tant ici et ailleurs deux entorses. Il dépasse son cadre en prétendant fournir des aperçus sur le pro-cessus de civilisation. Ce sera chez lui une ambition constamment revendiquée, malgré les gros risques qu’il est conscient de courir. Les deux ouvrages qu’il chérissait le plus en sont le témoignage : (1912-1913) Totem & Tabou, et (1939) L’Homme Moïse. Ils comptent au premier rang de ses produc-tions les plus aventureuses et les plus sujettes à caution. Ils ont soulevé des débats oiseux et susci-té à l’encontre de la psychanalyse une hostilité gra-tuite dont nous nous serions bien passés. Freud dépasse, d’autre part, ce cadre admis-sible en se laissant entraîner sur la pente hyper-dangereuse de la psychographie. Il prétend psy-chanalyser in absentia Shakespeare ici, ailleurs : Jensen, Leonard de Vinci ou Michel-Ange. En ce qui concerne Shakespeare, cette lubie l’a possédé toute sa vie. Il a fallu toute la diplomatie d’Ernest Jones pour le retenir de publier toutes les sottises qu’il a conçues à ce propos.
Commentaire. Ŕ Il y eut plusieurs forçages. La légende d’Œdipe (et non le complexe), la pièce de Sophocle, et le Hamlet de Shakespeare figurent dé-jà dans une lettre de Freud à Fließ (15 oct. 1897). Freud s’est contenté de reprendre dans la 1re éd. de la Traumdeutung les idées exposées au fil de la plume dans cette lettre qu’il avait sans doute sous les yeux. Lors de la publication (1950a) de la cor-respondance de Freud avec Fließ, Ernst Kris, l’annotateur, ne put s’empêcher de s’écrier 23 :
Nous constatons ici que le complexe d’Œdipe s’y trouve pour la première fois explicitement mentionné.
Il n’en est rien. Le complexe d’Œdipe n’était pas même pressenti, ni dans cette lettre, ni dans la 1re éd. de la Traumdeutung. Preuve en est qu’il a bien fallu attendre plus de dix ans pour qu’il soit nom-mé. Freud n’y est pas arrivé en ligne directe, ni du premier coup. Une étape transitoire, bientôt ou-bliée et effacée des mémoires, l’a préparé. En 1908, sous la pression de l’école de Zurich, Freud se mit à la recherche du complexe nucléaire des névroses.
23 FREUD (1950a) : La Naissance de la Psychanalyse, PUF, 21969, p. 199, note.
7
Il s’était persuadé que quelque chose de semblable devait exister : un espoir ou un pari. Ce n’est qu’alors qu’un phénomène de convergence mentale s’est produit (1910). Freud s’est souvenu du Roi Œdipe, et il a superposé la légende d’Œdipe au complexe nucléaire des névroses. Une fois ce pas franchi, ce ne fut plus qu’une fuite en avant. C’est comme lorsque, dans un moment fécond, une idée délirante s’insinue dans notre esprit, l’envahit, et finit par en prendre possession. Depuis ce mo-ment, la surenchère n’a plus cessé. Au point que Freud, dans un moment de frénésie combattive, en fit son mot de ralliement : le complexe d’Œdipe en tant que Schibboleth de la psychanalyse 24. D’ailleurs, une incise de la Traumdeutung est à cet égard parfaitement démonstrative. Freud vient de dire que le souhait de mort envers les parents découle de la première enfance. Il ajoute ceci 25 :
Cette supposition se confirme pour les psycho-névrosés, avec une certitude excluant totalement le doute, dans les analyses entreprises avec eux. On y apprend que les souhaits sexuels de l’enfant s’éveillent très précocement Ŕ pour autant qu’à l’état de germe ils méritent ce nom / soweit sie im keimenden Zustande diesen Namen verdieden Ŕ et que le premier penchant de la fille concerne le père, les premiers désirs infantiles du gar-çon la mère.
J’ai souligné l’incise qui montre que nous sommes loin du forcing ultérieur. Si l’on compte à partir de la lettre de Freud à Fließ d’octobre 1897, il aura fallu attendre 13 ans ce forcing. Naturelle-ment, ce n’est rien au regard de l’éternité. Je l’accorde volontiers. Mais supposons que Freud, à Dieu ne plaise, soit décédé à la sortie de presse de la Traumdeutung, la « découverte » du complexe d’Œdipe ne se ferait-elle pas attendre encore au-jourd’hui, à l’ère du déclin de l’imago paternelle et du règne de l’anti-Œdipe ? Ŕ S’il nous est permis de plaisanter un peu ! James Strachey, l’artisan de la très belle Stan-dard Edition des œuvres de Freud, partage l’illu-sion rétrospective d’Ernst Kris. Nous avons mentionné qu’au le chap. III de la Traumdeutung Freud expose un morceau de psychologie enfan-tine. On y relève le passage suivant 26 :
Si nous proclamons l’enfance heureuse parce qu’elle ne connaît pas encore le désir sexuel, nous n’allons
24 Note ajoutée en 1920 aux Trois Essais sur la Théorie Sexuelle. Ŕ GW, 5 : 127. SE, 7 : 226. OCF, 6 : 165. 25 Traumdeutung, chap. V-β. Ŕ GW, 2/3 : 263-264. SE, 4 : 257. 26 Traumdeutung, chap. III. Ŕ GW, 2/3 : 136. SE, 4 : 130.
pas méconnaître quelle riche source de déception, de renonciation et par là d’incitation au rêve l’autre grande pulsion de vie peut devenir pour elle.
L’autre pulsion dont il s’agit est la gourman-dise. J’ai également souligné ici l’incise litigieuse. Strachey s’y est arrêté, et a exprimé en note sa ré-probation. Il était plus royaliste que le roi. Il est prêt à admonester Freud d’avoir laissé passer cette inconsistency. Il est tellement sûr de son fait qu’il considère que ce passage est en contradiction avec le passage que j’ai cité plus haut. Il y renvoie de lui-même en restant parfaitement sourd à l’incise qui y figure et qu’il traduit d’ailleurs plutôt mal : if in their embryonic stage they deserve to be so described. Passons sur embryonic ; il faudrait tout de même mettre à la fin : so named. Cette question l’a tracassé. Il y re-vient dans la notice consacrée aux Trois Essais sur la Théorie Sexuelle 27. Son hypothèse est que le passage cité du chap. III de la Traumdeutung serait un reli-quat de la première rédaction du livre 28. L’incise que j’ai relevée dans le passage du chap. V-β ne l’émeut point. Il est absolument convaincu que Freud a découvert le complexe d’Œdipe en oc-tobre 1897. Point final. C’est cette vulgate accrédi-tée par les meilleures autorités (en sus de Kris et Strachey, Jones ou Anzieu), contre laquelle il fau-drait à la fin réagir. 29
Conclusion. Ŕ Que ce soit pour la sexualité in-fantile, pour la théorie des perversions sexuelles, ou pour le complexe d’Œdipe, le seul moyen de se préserver de l’illusion rétrospective serait de prendre les choses à rebours. Au lieu de saluer ou d’applaudir la prescience de Freud, il faudrait se demander plutôt ce qui a pu l’empêcher durant plusieurs années de formuler des thèses qui nous paraissent (à tort) préformées dans ses premières publications. Quels obstacles épistémologiques avait-il eu à surmonter ? Telle serait la bonne question, que Bachelard nous a appris à poser.
D’autres questions mériteraient qu’on s’y ar-rête pour redresser des inexactitudes ou dénoncer des erreurs. Le processus de civilisation est assu-rément un point important. On sait que le socio-logue Norbert Élias 30 a reconnu de bonne grâce
27 Cf. SE, 7 : 126-129. 28 Strachey croyait que cette 1re rédaction remonte à début 1896. 29 Cf. FORRESTER (1980), pp. 84-96, et MARINELLI & MAYER (2003), chap. 6. Même si ces sources sont disponibles en langue française, elles restent lettre morte auprès des ténors. 30 ÉLIAS (1939) : Le Processus de Civilisation, trad. franç., 1977, pp. 318-319, et note 75, pp. 386-387.
8
sa dette envers Freud . Ce qui ne veut pas dire qu’ils n’ont pas erré de concert. Freud assure qu’entre l’Œdipe-Tyran de So-phocle et le Hamlet de Shakespeare il y a eu « au cours des siècles une progression du refoulement dans la vie affective de l’humanité » 31. Lacan écarte cette asser-tion du revers de la main 32. Le diagnostique d’hystérie que Freud épingle sur Hamlet me pa-raît discutable. La boucherie qui termine la pièce est plutôt le fait d’un malade dissocié. Enfin, il me paraît curieux que Freud n’envisage pas un seul instant que l’apparition nocturne du spectre de son père, puisse être un rêve de Hamlet. Et cela, alors même qu’il rédige un livre sur l’inter-prétation des rêves 33. Ŕ Étrange cécité. Ne terminons pas cette série d’observations relatives au chap. V de la Traumdeutung sur des chi-canes. Relevons plutôt le point par où le texte de la Traudeutung diffère avantageusement de la lettre envoyée à Fließ le 15 octobre 1897. Freud cons-tate que depuis les temps les plus reculés les hommes ont souvent rêvé de la mort du père et de l’inceste avec la mère. La légende d’Œdipe, nous dit-il, est la réaction de notre faculté d’imagination à ces deux rêves typiques 34. Ŕ Cette fois nous ne pouvons qu’acquiescer et souscrire. Beaucoup de contes populaires sont effectivement la transposi-tions directe ou indirecte de motifs de rêves 35.
Lalangue onirique est un procédé d’écriture Avec les deux chapitres suivants de la
Traumdeutung (chap. VI et VII) nous passons aux choses sérieuses. Ces deux chapitres représentent à eux seuls la moitié du volume dans l’édition originale 36. C’est dire leur importance. Ils sont effectivement consacrés à des choses vraiment sérieuses, au regard desquelles ce qui a précédé constitue presque des hors-d’œuvre. Ce sont deux chapitres ambitieux. Ce sont là les plats de résistance. C’est là que le lecteur sérieux devra
31 Traumdeutung, chap. V-β. Ŕ GW, 2/3 : 271. SE, 4 : 264. 32 LACAN : Le Séminaire VI : Le Désir & son Interprétation, éd. de la Martinière, 2013, pp. 287-288 (séance du 4 mars 1959). 33 Cf. AZAR (2014g) : Que se passe-t-il exactement dans Hamlet ? Ŕ J’y propose une analyse radicalement différente de celle de Freud. 34 Traumdeutung, chap. V-β. Ŕ GW, 2/3 : 270. SE, 4 : 264. 35 Antoine Sarkis et moi-même avons tenté naguère (1990) de démontrer que le conte du Petit Chaperon Rouge peut être considéré comme le rêve de guérison d’une jeune anorexique. 36 Le déséquilibre s’accuse de dix pour cent dans l’éd. définitive (81930) où les chap. I à V n’occupent plus que 45 % du volume, et les chap. VI et VII, les 55 %.
s’attarder. C’est vraiment là ce pourquoi ce livre a été publié, et ce pourquoi Freud en espérait tant. Pour le chap. VI (Le Travail Onirique), les choses se présentent au mieux. Une fois qu’il eût reçu son incitation de W. Robert (1886), Freud a été sûr de son fait 37. Il est parvenu à décrire, de manière poussée, le travail du rêve, et ce qui re-garde les règles de son interprétation. Par la suite, et à une exception près, il n’y a pas ajouté grand-chose, non plus que ses élèves. Que pendant plus d’un siècle il n’y eut pas de nouvelles découvertes en ce domaine est un phénomène rare et curieux dans les sciences. Il est probablement le fruit de la paresse intellectuelle qui gangrène de notoriété courante la corporation des psychanalystes institu-tionnels. Voici les divisions de ce chapitre :
Chap. VI : Le Travail Onirique
[Prologue] 1 2
a ● Le travail de condensation 18 28
b ● Le travail de déplacement 3 5
c Les moyens de présentation du rêve 17 30
d ● La prise en considération de la présentabilité 7 11
e [La présentation au moyen de symboles dans le rêve. Autres rêves typiques]
– 59
f Exemples. Calculs et paroles dans le rêve 8 20
g Rêves absurdes. Les opérations intellectuelles dans le rêve
24 35
h Les affects dans le rêve 18 30
i ● L’élaboration secondaire 11 21 107 241
Clés du Tableau. Ŕ À titre indicatif, l’avant der-nière colonne fournit le nombre de pages de chaque section de l’éd. originale, et la dernière co-lonne celui des sections de la traduction française des OCF. La section « E » 38 a été créée en 41914, à la 4e édition (→ Cf. § 29, infra). J’ai signalé par des boulettes noires les quatre procédés du travail du rêve. Le lecteur pressé ira directement à la fin du chapitre : ses deux dernières pages comportent un résumé acceptable. Il est cependant grevé d’une curieuse incongruité. Ce résumé termine la section consacrée à l’élaboration secondaire, or Freud passe en revue les trois autres procédés de la for-mation du rêve en oubliant justement celle-ci.
Le titre de ce chapitre Ŕ le travail onirique Ŕ est suffisamment opaque pour que le lecteur profane, et surtout les psychanalystes, se méprennent sur son contenu. Pourtant, Freud ne se fait pas faute de décliner, dès son prologue, l’objectif qu’il s’est
37 Cf. supra Chap. I, § 5, et note 18. 38 Dans l’édition originale de la Traumdeutung, les sections sont désignées par des lettres alphabétiques minuscules.
26
9
assigné. Il s’agit d’examiner le mode de transfert qui transforme le contenu latent en contenu manifeste. L’expression « travail onirique » désigne ce mode transfert. Hélas, pour se faire comprendre, Freud enchaîne dans son Prologue plusieurs approxima-tions inappropriées qui ont donné le change. À la distance où nous sommes, la démarche tâtonnante de Freud tout le long de ce chapitre offre quelque chose de pathétique. Sur le moment, Freud se croyait sans doute assez malin pour se jouer de son lecteur et le promener à sa guise. En réalité, Freud ne maîtrisait nullement son procédé d’exposition et se laissait plutôt aller à son inspira-tion. Il lui manquait quelques termes techniques qui nous sont aujourd’hui devenus familier. C’est d’ailleurs dans ces moments où il lâche la bride à son élan créateur, que ce que le Pr Laplanche dé-nommait l’exigence freudienne le guide avec sûreté. C’est à nous qu’incombe alors la tache de ne pas lâcher prise en lui emboitant le pas. Arrêtons-nous d’abord aux approximations que comporte le Prologue du chap. VI 39 :
Pensées oniriques et contenu onirique s’offrent à nous comme deux présentations du même contenu en deux langues distinctes, ou pour mieux dire, le contenu onirique nous apparaît comme un transfert (Übertra-gung) des pensées oniriques en un autre mode d’expres-sion dont nous devons apprendre à connaître les signes et les lois d’agencement par la comparaison de l’original et de sa traduction. Les pensées oniriques nous sont compréhensibles sans ambages dès que nous en avons pris connaissance. Le contenu onirique est donné en quelque sorte dans une écriture en images (Bilderschrift), dont les signes sont à transférer un à un dans la langue des pensées de rêve. On serait évidem-ment induit en erreur si on voulait lire ces signes d’après leur valeur en tant qu’images et non d’après leur relation entre eux en tant que signes. J’ai par exemple devant moi une énigme en images (rébus) : etc.
Ce passage est emblématique. Il recèle des intuitions fécondes habillées d’un costume mal ajusté. Le contenu latent est formé de pensées ; ce n’est pas un langage. Le contenu manifeste est formé d’images ; ce n’est pas non plus un langage. Un texte original et sa traduction appartiennent tous les deux à des langues vivantes. Si l’on prend cette manière de présenter les choses au pied de la lettre, le rêve et son interprétation, l’incons-cient et le conscient, seraient des instances de bi-linguisme. Il n’en est rien.
39 Traumdeutung, chap. VI, prologue. Ŕ GW, 2/3 : 283-284. SE, 4 : 277-278. OCF, 4 : 319.
Une autre confusion provient d’une appré-hension incorrecte de ce qu’est un système d’écri-ture. À moins d’avoir affaire à une peinture cu-biste, l’écriture n’est pas un mode d’expression, mais un procédé de transcription. À témoin, ce que devient la parole articulée dans le rêve. Elle est dévitalisée et devient chose (Q., pp. 339 et 347). C’est le terme d’Übertragung qui est ici en cause. Indéniablement Übertragung veut dire transfert. Mais le transfert au sens psychanalytique du terme était encore à dé-couvrir, de sorte que ce terme ne peut que nous fourvoyer à cause du sens qu’il allait incessamment acquérir et nous imposer. Mais Übertragung veut dire ici transcription, comme le donne l’ancienne traduction française, et comme le certifie le titre courant de la p. 389 des OCF. Un autre terme a fourni du fil à retordre aux lecteurs, à commencer par les traducteurs : Bilder-schrift. En 1926, Ignace Meyerson le traduit en français par : hiéroglyphes. En 1967, Denise Berger entérine cette traduction. En 1953, Strachey le traduit en anglais par : pictographic script. En 1999, Joyce Crick le retraduit en anglais par : hieroglyphs. C’est tout un, sans doute, à cause des doublets à partir des racines latines et germaniques dont la langue allemande abonde. Mais il est rare que ces doublets soient, chez Freud, interchangeables, à témoin Trieb et Instinkt. Grand amateur d’égypto-logie, si Freud avait voulu dire hiéroglyphe, il n’aurait pas hésité à le faire. Il faut donc prendre Bilder-schrift au pied de la lettre : une écriture en images. Hiéroglyphe est trop spécifique. Il fallait une dési-gnation générique qui embrassât la diversité des écritures en images, c’est-à-dire aussi bien celle des anciens égyptiens, que des Mayas, des Péruviens, des Chinois, des Japonais. À la rigueur le terme de pictogramme aurait fait l’affaire. À peine avons-nous vidé ce problème de ses embrouilles, que Freud nous relance avec une nouvelle intuition. Le rêve serait apparenté à une énigme en images, à un rébus. Il est bien évident qu’un rébus n’est nullement réductible à une écri-ture pictographique. Tous les systèmes d’écriture tendent vers une certaine homogénéité. Les rébus sont hétérogènes. Ils sont constitués de bric et de broc. En cela ils diffèrent de tous les systèmes d’écriture en images. Et c’est peut-être du rébus que le rêve se rapproche le plus. En Bref. Ŕ Cette controverse n’a pas éclairci la question, elle a plutôt failli la rendre inextri-cable. Concluons sur une thèse réduite au strict
10
minimum : lalangue 40 du rêve n’est pas une parole articulée, mais un procédé d’écriture tout à fait spécifique.
Renouons à présent le fil de la controverse entamée au § 17 supra. J’avais cité des extraits du livre sur le Trait d’Esprit (1905d) et des Leçons d’Introduction à la Psychanalyse (1916-1917), où Freud affirme péremptoirement que le rêve ne veut rien dire du tout à qui que ce soit, qu’il n’est pas un vé-hicule de la communication ; bien au contraire, il est fait pour rester incompris. Ce en quoi il diffère du Witz et des systèmes d’écriture en images. Tout à coup, Freud oublie que beaucoup de systèmes d’écritures (anciens ou modernes) sont délibérément cryptés. Il oublie que les scribes égyptiens avaient une écriture sacrée (hiératique) qui n’était pas destinée aux profanes, et une écri-ture profane (démotique) pour le peuple. Il oublie que les livres d’alchimie sont hermétiques aux non-initiés. Il oublie également que certains traits d’esprits sont d’une finesse telle que des com-plices les saisissent au vol, alors que la victime n’y voit que du feu. Freud oublie tout à coup qu’il nous arrive quelquefois de parler et d’écrire de telle manière que ceux qui sont préposés à la cen-sure soient bernés. Il oublie également que cer-tains de nos rêves nous interpellent après le ré-veil, et nous poursuivent parfois sans relâche dans la journée, jusqu’à ce que nous cherchions à comprendre le message qu’ils nous adressent. Pourquoi écarte-t-il tous ces cas de figure ? C’est qu’il raisonne toujours en darwinien et en scientiste. Heureusement que, dans sa pratique de la psychanalyse, il agit tout autrement, comme je l’ai souvent relevé. Il y a, d’ailleurs, beaucoup d’humour involontaire à rédiger un gros livre sur les règles de l’interprétation des rêves, tout en clamant haut et fort que le rêve ne veut rien dire du tout à qui que ce soit. Autrement dit, l’antithèse que Freud dresse entre le trait d’esprit et les systèmes anciens d’écriture, d’une part, et le rêve, d’autre part, est tout simplement spécieuse.
Destin des particules argumentatives dans lalangue onirique Jetons à présent un coup d’œil d’en-
semble sur ce chap. VI. Il y a donc, suivant Freud, quatre procédés essentiels du travail du
40 J’emprunte sans hésitation à Lacan cette écriture afin de bien marquer que c’est par abus qu’on parle de la langue du rêve.
rêve. La 1re section est consacrée « au prodigieux travail de condensation » (Verdichtung) qui se produit dans le rêve. Il arrive aussi qu’il le dénommer com-pression (Pressung, Kompression), ce qui est encore mieux (Q., pp. 356, 384). Ce procédé semble l’avoir beaucoup frappé puisqu’il lui consacre, depuis la 1re éd., de nombreux exemples. Il ne lui ajoutera par la suite que deux pages. Il y montre que les signifiants apparaissant dans le rêve forment des points nodaux où se rejoignent un très grand nombre de pensées. En découle la notion de surdé-termination (Q., p. 326). Mais le travail de condensa-tion se sert de plus d’un moyen (Q., p. 335). La fa-brication de personnes collectives et composites en est l’un des principaux (Q., p. 337). La 2e section est consacrée au déplacement des intensités psychiques. Freud n’y présente aucun ma-tériel spécifique. Il se contente de se référer à des rêves déjà interprétés, c’est pourquoi cette section est très courte. Il y souligne le décentrement qui se constate entre le thème principal du récit du rêve, et le thème majeur de l’interprétation du rêve. Le terme de déplacement a pris par la suite une accep-tion plus large, ce qui a créé parfois des confu-sions. Il faut garder cela à l’esprit, comme Freud nous en a ultérieurement prévenus 41 :
Omission, modification, redistribution du matériel sont donc les effets de la censure onirique et les moyens de la déformation onirique. La censure onirique elle-même est l’auteur ou l’un des auteurs de la déformation onirique dont l’investigation nous occupe en ce moment. Nous avons aussi l’habitude de regrouper modification et réordonnancement sous le terme de « déplacement ».
La compression et le déplacement sont, suivant Freud, « les deux maîtres ouvriers à l’activité desquels nous pouvons attribuer principalement la mise en forme du rêve » 42. Deux autres procédés devront encore être envisagés : la prise en considération de la représentabilité, et l’élaboration secondaire Mais Freud en diffère l’exposé. Pourquoi ? Il ne le sait pas lui-même. Possédé par l’exigence freudienne, il se sent con-traint de faire halte pour consacrer la 3e section de son chapitre à ce qu’il appelle les moyens de présenta-tion du rêve. De quoi s’agit-il ? Les logiciens diront qu’il s’agit des connecteurs propositionnels. Les grammairiens diront qu’il s’agit des conjonctions de coordination et de subordination. Mais Freud nous prévient aussitôt que ces connecteurs ou ces
41 FREUD (1916-1917) : IXe leçon d’Introd. à la Psycha. Ŕ GW, 9 : 140-141. SE, 15 : 140. OCF, 14 : 143. 42 Traumdeutung, chap. VI, § B. Ŕ GW, 2/3 : 313. SE, 4 : 308.
27
11
conjonctions sont tout simplement absents du rêve. On croit rêver en lisant cet avertissement 43 :
(…) qu’advient-il des liens logiques qui avaient jusqu’ici donné forme à l’agencement ? Quelle pré-sentation trouvent dans le rêve le « quand, parce que, de même que, quoique, ou bien… ou bien », et toutes les autres prépositions * sans lesquelles nous ne pou-vons pas comprendre la phrase et le discours ? À cela il faut d’abord répondre que pour ces rela-tions logiques entre les pensées oniriques, le rêve n’a à sa disposition aucun moyen de présentation. La plu-part du temps, il laisse là toutes les prépositions sans en tenir compte et ne reprend, pour l’élaborer, que le contenu concret des pensées oniriques. C’est à l’interprétation du rêve qu’est laissé le soin de rétablir
la cohésion que le travail onirique a anéantie.
1re Conclusion. Ŕ L’interprétation du rêve est tout simplement la lecture d’un texte transcrit dans une écriture ésotérique excessivement abrégée, à par-tir d’une dictée de la bouche d’ombre 44. 2e Conclusion. Ŕ L’intentionnalité. Tout ce cha-pitre est écartelé entre deux forces antagonistes. D’une part, l’idéal de Freud est de décrire un pro-cédé mécanique qui transforme de manière aveugle ou automatique une matière première (les pensées latentes du rêve) en un produit fini (le récit du rêve). D’autre part, Freud est bien obligé de recon-naître presque à chaque pas, la place du fantôme dans la machine. Ce fantôme est l’intentionnalité du désir, et de la contre-volonté avec laquelle le désir est en conflit ouvert. Un compromis est atteint en raturant le terme d’intentionnalité. C’est ainsi que Freud opère la réduction des particules argumen-tatives à de la logique ou de la grammaire, ce re-vient à les dévitaliser. Il se peut que Freud se soit heurté à un problème d’expression. Il ne disposait pas du vocabulaire adéquat que la linguistique de l’énonciation, élaborée depuis par Benveniste, nous a fourni. Conformément à cet apport, il fau-dra dire que le rêve ne dispose d’aucun moyen pour représenter l’espace d’interlocution. Il est dévolu à l’interprétation du rêve de le restituer.
43 Traumdeutung, chap. VI, § C. Ŕ GW, 2/3 : 317. SE, 4 : 312. * [Ici, comme plus bas, le terme de préposition a été remplacé par celui de conjonction à partir de la 6e édition (1921). Les GW (1942) reviennent toutefois à « préposition ».] (Note des OCF) 44 La bouche d’ombre est une expression forgée par Victor Hugo.
L’élaboration secondaire On observe en outre que Freud rature l’intentionnalité en laissant pendre, au
lieu de le nouer, le lien reliant l’élaboration secon-daire à la rêverie diurne. Comme c’est souvent le cas, c’est le plus su-perficiel qui mène au plus profond et au plus conséquent. Il me paraît en effet que c’est la der-nière section de ce chapitre, consacrée à l’élabora-tion secondaire, qui est à la fois la plus négligée (par les psychanalystes) et la plus prometteuse (à mes yeux) 45. Freud y indique la limite de ses propres investigations. Il y aurait lieu d’explorer mieux qu’il ne l’a fait, la relation entre le rêve nocturne et la rêverie diurne. Freud a reconnu d’emblée le statut des rêveries diurnes en psychopathologie. Il en a tiré, dès la 1re éd. de la Traumdeutung, une le-çon à propos des symptômes hystériques 46 :
L’étude des psychonévroses mène à la connais-sance surprenante que les fantaisies ou rêves diurnes sont les stades préliminaires les plus proches des symp-tômes hystériques, du moins de toute une série d’entre eux ; ce n’est pas aux souvenirs eux-mêmes mais aux fantaisies édifiées sur la base des souvenirs que se rat-tachent en premier lieu les symptômes hystériques.
Mieux. Quelques lignes plus loin, il a reconnu aux rêveries diurnes leur parenté avec les rêves noc-turnes, et en a tiré cette surprenante conclusion :
Elles ont en commun avec les rêves nocturnes une partie essentielle de leurs propriétés ; les sou-mettre à investigation aurait pu, à vrai dire, nous ou-vrir l’accès le meilleur et le plus immédiat à la com-préhension des rêves nocturnes.
Pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? Il avait ses rai-sons, ou ses entraves. Dans une note ajoutée en 21909 à la Traumdeutung, il nous dit que ses propres rêves étaient impropres à une pareille exploration, c’est pourquoi il avait sous-estimé cette relation 47. Il indiquait par là un programme de recherches pour l’avenir, demeuré lettre morte aussi bien pour lui-même que pour ses affidés. Ŕ J’aurais sans doute à y revenir. Le choix des termes Ŕ élaboration secondaire Ŕ est des plus malheureux. Il insinue l’idée fausse que ce procédé du travail onirique intervient en dernier
45 À cet égard, l’entrée du Vocabulaire de la Psychanalyse consacrée à l’élaboration secondaire, souligne l’essentiel. Le Pr Laplanche n’a cessé d’y insister dans son enseignement par la suite. 46 Traumdeutung, chap. VI, § I. Ŕ GW, 2/3 : 495-496. SE, 5 : 491. 47 Traumdeutung, chap. VI, § I. Ŕ GW, 2/3 : 498, note. SE, 5 : 494, note. OCF, 4 : 545, note.
28
12
lieu, au moment où le rêve est mis en mots pour être raconté. On confond d’habitude l’élaboration secondaire avec la façade du rêve. Ce n’est pas inexact, mais insuffisant. L’élaboration secondaire intervient à toutes les étapes du processus onirique : avant, pendant et après le rêve proprement dit.
La symbolique universelle La section consacrée à l’élaboration secondaire ne succède pas à la 3e [§ C],
dévolue aux particules argumentatives. Elle est la 9e et dernière du chapitre [§ I]. Il nous faut donc retourner en arrière pour passer en revue les sec-tions intermédiaires [§§ D, E, F, G, H]. On peut dire de manière générale que toutes ces sections-là sont consacrées au 3e procédé du travail du rêve : la prise en considération de la présentabilité, auquel Freud n’a pas forgé une désignation plus brève. De fait, il achoppe constamment contre une désignation et une définition claires de ce procédé. Le 3e procédé du travail du rêve concerne les règles suivant lesquelles le contenu de pensée du rêve est transvasé dans une autre forme d’expres-sion afin de rendre possible sa transcription en images. Freud utilise effectivement le terme d’Um-leerung (transvasement) 48, que l’on pourrait d’ailleurs adopter pour la commodité. Freud lui-même, dans son opuscule de vulgarisation sur le rêve (1901a), semble plutôt enclin à utiliser le terme de « Drama-tisation », qu’il emprunte à Spitta (1882). Les règles de transvasement procèdent de la symbolique universelle. On peut dire que toutes ces sections intermédiaires visent à circonscrire, au sein d’une symbolique universelle élargie, la part qui revient plus spécifiquement à la vie onirique. Freud le dit expressément dès 1899 49 :
Une bonne part de cette symbolique, le rêve l’a d’ailleurs en commun avec les psychonévroses, les lé-gendes et les coutumes populaires.
La section « D » du chap. VI, intitulée : La prise en considération de la représentabilité, remonte presque entièrement à la 1re éd. On pourrait l’intituler : Pour introduire le symbolisme. Freud a eu la bonne idée de résumer son propos dans une addition de la 4e éd. (1914) 50 :
48 Traumdeutung, chap. VI, § D. Ŕ GW, 2/3 : 349. SE, 5 : 344. 49 Traumdeutung, chap. VI, § D. Ŕ GW, 2/3 : 351. SE, 5 : 345. 50 Traumdeutung, chap. VI, § D. Ŕ GW, 2/3 : 346-347. SE, 5 : 341. OCF, 4 : 386. Interlettré dans l’original.
En général, dans l’interprétation de chacun des éléments du rêve, on ne sait pas : a) s’il doit être pris au sens positif ou au sens néga-tif (relation d’opposition) ; b) s’il est à interpréter historiquement (en tant que réminiscence) ; c) symboliquement, ou s’il d) doit être évalué à partir de l’énoncé littéral. Malgré cette multiplicité d’aspects, on peut bien dire que la présentation du travail onirique, qui certes ne vise pas à être comprise, n’impose pas au traducteur de plus grandes difficultés que, par exemple, les anciens scribes de hiéro-glyphes n’en imposaient à leurs lecteurs.
Le transvasement des pensées oniriques dans la symbolique universelle met à contribution les mots d’esprit, les citations, les chansons popu-laires, les dictons et proverbes, et les locutions toutes faites, dont notre mémoire regorge. Dans ce cas, la présentabilité est exempte de censure (zensurfreien). C’est que ce matériel de transforma-tion, disponible avec ses voies déjà frayées et bien rôdées, subvertit la censure 51. Cette section est illustrée par deux rêves de femmes. Le premier se rapporte à une nuit passée à l’opéra. Freud parvient à en interpréter des fragments sans l’aide du sujet. L’autre est un rêve de fleurs où il se contente de souligner typogra-phiquement les termes du récit du rêve à en-tendre symboliquement par des allusions sexu-elles. La conclusion de cette section est ramassée en quelques lignes :
On n’a pas à faire l’hypothèse d’une activité sym-bolisante particulière de l’âme dans le travail onirique. Le rêve se sert des symbolisations qui sont connues, déjà toute prêtes, dans le penser inconscient parce qu’elles satisfont mieux aux exigences de la formation du rêve, du fait de leur présentabilité, la plupart du temps aussi du fait qu’elles sont exemptes de censure.
Le public a toujours été passionné de symbo-lique. Les premiers psychanalystes aussi. Ils s’en-gouffrèrent dans ce domaine de recherches en se bousculant. Un bureau central du rêve fut créé. L’école de Zurich (Bleuler, Jung, Riklin, Abraham, Maeder, etc.) en fit son affaire en tout ce touche à la symbolique. Bientôt Freud dut lui aménager dans son livre une section spéciale, laquelle prit promp-tement une large extension en raison des nom-breux travaux publiés. 52
51 Traumdeutung, chap. VI, § D. Ŕ GW, 2/3 : 350-351. SE, 5 : 345-346. OCF, 4 : 390-391. 52 Cf. MARINELLI & MAYER (2003), chap. 4 à 9. L’école de Zurich enrôla Silberer parmi les siens dans une véritable fronde.
29
13
Un épais brouillard d’idées vagues entoure la symbolique ou le symbolisme, qu’il y a lieu de dis-siper. Comme on vient de le constater, le rôle de la symbolique dans le rêve est fort bien balisé dès la 1re édition de la Traumdeutung. Mais Freud lui-même a avoué, dix ans plus tard 53, que ce n’est que dans l’intervalle qu’il a appris à apprécier plus justement l’ampleur et la significativité de la symbo-lique dans le rêve. Il reconnaît également que l’un de ses élèves (Wilhelm Stekel) a eu un rôle prépon-dérant dans cette prise de conscience 54. Ŕ Sans doute le fait-il d’ailleurs pour estomper le mérite des Zurichois 55. C’est dans la 3e éd. (31911) qu’il livre ces aveux, mais c’est dans la 2e éd. (21909) qu’il avait commencé à introduire dans son ouvrage les re-maniements correspondants, insérés au chap. V. Il créa finalement à la 4e éd. (21914) une section spé-cialement dévolue au symbolisme, insérée au chap. VI. À elle seule, cette section « E » comporte dans l’actuelle traduction française une soixantaine de pages 56, soit le double de la section la plus longue du chapitre. En outre, la quasi-totalité du matériel présenté est reprise à ses élèves, lesquels ont rivalisé d’émulation et d’ingéniosité en ce do-maine. On observe aussi que cette section est con-sacrée pour moitié à un répertoire des symboles les plus remarquables 57, et pour moitié à une ral-longe aux rêves typiques du chapitre précédent. Voici la note des OCF qui présente cette section (j’ajoute l’indice de l’édition) [Q., p. 395] :
De toute cette section, ne figurent dans la 1re édi-tion de L’interprétation du rêve que deux paragraphes (p. 440-441). Les ajouts de 21909 et 31911 furent tout d’abord insérés dans le chapitre V (section D), sous le titre : Rêves typiques. La section E [du chapitre VI] sous sa forme actuelle n’apparaît qu’en 41914 ; elle est constituée pour une part des ajouts du chapitre V et pour une autre d’un matériel nouveau. Elle s’enrichira d’autres paragraphes en 51919 et 61925.
53 Préface à la 3e éd., printemps 1911. 54 Cette reconnaissance est assortie d’une volée de verges. 55 Notons à cette occasion que la référence canonique des psycha-nalystes à propos de la symbolique universelle sera l’ouvrage de RUDOLF KLEINPAUL (1898), que Freud ignore en 1899. Ce sont les Zurichois qui ont attiré son attention sur cet auteur vers 1908. Il le reconnaît implicitement dans une note ajoutée à la 3e éd. (31911). Ŕ Cf. Traumdeutung, chap. VI, § E, GW, 2/3 : 356, note. SE, 5 : 351, note. OCF, 4 : 396, note. 56 Traumdeutung, chap. VI, § E. Ŕ GW, 2/3 : 355-409. SE, 5 : 350-404. OCF, 4 : 395-453. 57 Dans une addition de 51919 (Q., p. 405), Freud signale qu’un répertoire de symboles plus détaillé se trouve dans ses Leçons d’Introduction à la Psychanalyse (1916-1917), Ŕ Cf. 10e leçon.
Trois Remarques. Ŕ 1/ La symbolique est un complément à l’analyse classique, un moyen auxi-liaire. Il n’est pas question d’interpréter les rêves sans recourir aux idées traversières. C’est seule-ment quand le sujet est en panne (läßt im Stich) d’idées incidentes que l’on peut recourir à cette technique combinée (Q., 398, 406). 2/ Cette symbolique est pour une large part universelle, avec une partie dérivée des bains linguistiques régionaux. Elle se retrouve dans les contes, les légendes, les mythes, les locutions courantes des quatre coins du monde (Q., 396). 3/ Dans un accès de sa frénésie spécula-tive, partagée avec nombre de ses contemporains, Freud se laisse aller à énoncer l’un des articles les plus aventureux de sa sémiotique darwinienne. La symbolique serait de nature génétique 58 :
… celle-ci est de nature génétique. Ce qui est aujourd’hui relié symboliquement était vraisembla-blement, dans des temps originaires, réuni par une identité conceptuelle et langagière. La relation sym-bolique semble un reste et un signe marquant de l’identité de jadis.
4/ Enfin, il semble possible d’introduire un peu d’ordre dans le fouillis que présente la symbolique. Quelques psychanalystes s’y sont essayés (Jones, Ferenczi, Rank & Sachs, Melanie Klein, etc.). Je m’y suis essayé aussi à mon tour (AZAR, 2014a).
Le sordide, le morbide & le stercoraire Allons-nous maintenant aborder le 4e
des facteurs à l’œuvre dans la formation du rêve ? Nullement. Freud est décidé à nous renvoyer de promesse en promesse, d’ajournement en ajour-nement. Dans la traduction française de l’édition définitive (81930) 85 pages, réparties en 3 sections (F, G, H), nous séparent du 4e facteur. Freud sait qu’au chapitre suivant il n’aura plus l’occasion de présenter d’autres rêves 59. Sa collection de rêves risque de lui rester sur les bras. Il se résout à pio-cher largement dans sa collection des exemples pour illustrer les trois facteurs déjà traités. Voici les premières lignes de la section « F » 60 :
58 Traumdeutung, chap. VI, § E. Ŕ GW, 2/3 : 357. SE, 5 : 353. OCF, 4 : 297. Texte ajouté en 41914. J’ai exposé et critiqué la sémiotique de Freud in AZAR (2009) : Freud & Cie sous les auspices de Darwin. 59 De fait, Freud ne présentera au chap. VII qu’un seul rêve per-sonnel : Mère bien-aimée avec personnages à bec d’oiseau. 60 Traumdeutung, chap. VI, § F. Ŕ GW, 2/3 : 410. SE, 5 : 405.
30
14
Mais avant de mettre à la place qui lui revient le quatrième facteur régissant la formation du rêve, je vais aller chercher dans ma collection de rêves quelques exemples qui, pour une part, illustrent l’action con-jointe des trois facteurs connus de nous, qui, pour une autre part, peuvent ajouter des preuves à l’appui d’affirmations avancées librement, ou faire ressortir les conclusions irrécusables qui en découlent.
Telle est l’intention déclarée. Et de fait, Freud s’emploiera apparemment à remplir ce program-me. Cependant, sous cette couverture vertueuse, il va se livrer aussi à un déballage de confidences intimes et d’indiscrétions de toute sorte, touchant un grand nombre de personnes, maîtres et amis, sans s’en excepter lui-même, ni les siens. Il est sans exemple de tomber sur une « chronique scandaleuse » de cet ordre dans aucun autre ouvrage de type scientifique. Certes, la science y trouve un peu son compte, mais elle aurait pu le trouver à de moindres frais. Faisons le décompte du matériel onirique personnel dont fait étalage le chap. VI, section par section, et dans l’ordre de présentation (R indique une reprise) :
Chap. VI : Le Travail Onirique
§ Rêves personnels de Freud
A Monographie botanique (R) Hearsing Norekdal Autodidasker Oncle à la barbe blonde (R)
B
C Goethe attaque Monsieur M. Ne pas trouver son chapeau On est prié de fermer les yeux / un œil Dissection de son propre bassin
D
E
F Non vixit
G Père sur son lit de mort (ressemble à Garibaldi) Comte Thun (R) Missive du conseil municipal (1851, 1856) Goethe attaque Monsieur M. (R) Auf Geseres Madame Doni et ses trois enfants Dissection de son propre bassin (R) Hollthurn
H Navire du petit déjeuner (château au bord de la mer) Cabinets en plein air Dissection de son propre bassin (R) Non vixit (R)
I
Ce raz-de-marée de matériel onirique person-nel a peut-être une raison. Il s’agissait peut-être de compenser le « Grand Rêve » que Freud a dû sup-primer sur les instances de Fließ. Mais il est à se
demander si cette substitution n’a pas été pire que le mal. En tout cas, les biographes de Freud s’en sont donnés à cœur joie. Laissons-les à leur félicité pour aborder quelques thèmes particuliers. Le thème dominant est la mort dans son as-pect le plus repoussant : la vieillesse, la dégrada-tion des fonctions vitales, le cadavre, sa mise en bière et sa mise en terre. L’analité dans ses as-pects les plus répugnants est étroitement entrela-cée à ce thème dominant. C’est la mort du père qui ouvre la procession des morts. Des thèmes subordonnés s’y ajoutent : les impulsions hostiles envers tous ces morts, mêlées à la satisfaction mégalomaniaque de leur avoir survécu. Satisfac-tion amère : Freud est convaincu de ne plus en avoir pour longtemps. Il s’approche tristement de l’âge de 51 ans, qui est, nous dit-il, l’âge où l’homme semble être particulièrement en danger 61. Encore n’est-il pas sûr de l’atteindre. Les pensées du rêve du na-vire du petit déjeuner, portent sur l’avenir des siens après sa mort prématurée 62. Notons incidemment que les grandes œuvres sont rédigées un pied dans la tombe. Les bons au-teurs suivent spontanément l’injonction de Diderot 63 :
On ne pense, on ne parle avec force que du fond de son tombeau : c’est là qu’il faut se placer, c’est de là qu’il faut s’adresser aux hommes.
Plume en main, chacun rédige en quelque sorte son testament, tout en se mirant dans un miroir d’encre. Il est inévitable de prendre la pause, et il est tout aussi inévitable de feindre de regarder ce monde, par un trou de serrure, à partir de l’Au-delà. L’écritoire est un dispositif ayant ses contraintes. En rédigeant la Traumdeu-tung Freud a joué ce jeu à fond, moitié sérieux, moitié jobard. Notons encore que l’hécatombe ne s’arrête pas au chap. VI. Dans le sordide ou le morbide, le chapitre suivant ne le cède en rien au précé-dent. Freud débute son chap. VII brutalement, en rapportant le rêve d’un père endeuillé de son fils, alors que le cadavre de ce dernier est en train de brûler dans la pièce voisine, à la suite de la chute d’un cierge 64. Freud y rapporte également un sien rêve d’angoisse remontant à sa septième ou huitième année : Mère chérie avec des personnages à
61 Traumdeutung, chap. VI, § G. Ŕ GW, 2/3 : 440. SE, 5 : 438-439. 62 Traumdeutung, chap. VI, § H. Ŕ GW, 2/3 : 514. SE, 5 : 465. 63 DIDEROT : Essai sur Sénèque, (11779) § 69, [OC, 12 : 643] ; (21782), II § 6, [OC, 13 : 464]. 64 Traumdeutung, chap. VII, début, et § B. Ŕ GW, 2/3 : 513-515, et 538-539. SE, 5 : 509-510, et 533-534. OCF, 4 : 561-562 et 586-587.
15
tête d’oiseau 65. Celle-ci est étendue sur un lit, et l’expression de son visage est copiée sur le visage de son grand-père, qu’il avait vu ronflant dans le coma, quelques jours avant sa mort. C’est peut-être le lieu de citer Georges Bataille (1957) : De l’érotisme, il est possible de dire qu’il est l’approbation de la vie jusque dans la mort. Freud n’a que 43 ans, mais il croit que la crise cardiaque le guette. Il pense aussi qu’à cet âge il est un peu tard pour que l’immense ambition qu’il a nourrie, trouve jamais à se réaliser. Convaincu de son génie et de l’importance de ses trouvailles, il est tout aussi convaincu de son guignon et de l’injustice universelle. Il en a contre tout le monde. Contre ses maîtres et contre ses collègues de l’Université, où l’avancement est un parcours du combattant. Contre ses aïeux aussi : ah, s’il n’était pas né juif, ah si son père avait été un notable, ah s’il était lui-même le fils de ses œuvres… Le fils de ses œuvres ? Lesquelles ? Voici les circonstances anecdotiques qu’il rapporte parmi les idées traversières de son rêve de la dissection de son propre bassin. C’est dans ces lignes, on ne peut plus célèbres, que gît la clé de la Traumdeutung 66 :
Je m’occuperai d’abord de ce qui occasionne le rêve. C’est une visite de cette dame, Louise N., elle qui dans le rêve assiste au travail. « Prête-moi quelque chose à lire. » Je lui propose « She » de Rider Haggard. « Un livre étrange, mais plein de sens caché », comme je veux le lui expliquer ; « l’éternel féminin, l’immortalité de nos affects… ». Alors elle m’interrompt : « Ce livre, je le connais déjà. N’as-tu rien de toi ? » Ŕ « Non, mes propres œuvres immortelles ne sont pas encore écrites. » Ŕ « Alors, quand paraîtront donc tes soi-disant dernières révélations, celles qui, à ce que tu promets, seront lisibles aussi pour nous ? », demande-t-elle, non sans piquant. Je remarque maintenant que par sa bouche c’est quel-qu’un d’autre qui m’adresse un avertissement, et je me tais. Je pense à ce qu’il m’en coûte, à ce qu’il faut sur-monter, ne serait-ce que pour soumettre au public ce travail sur le rêve, dans lequel il me faut livrer tant de mon être intime. « Le meilleur de ce que tu peux sa-voir, tu ne saurais pourtant le dire à ces garnements. » [Goethe, Faust I, vers 1840-1841]. La préparation ana-tomique sur mon propre corps, qu’on m’enjoint de faire dans le rêve, est donc l’auto-analyse liée à la communica-tion des rêves.
L’aspect mystérieux de ce passage restera en suspens tant que nous ne nous reporterons pas aux deux derniers vers du Faust II :
65 Traumdeutung, chap. VII, § D. Ŕ GW, 2/3 : 589-590. SE, 5 : 583-584. OCF, 4 : 638-639. 66 Traumdeutung, chap. VI, § G. Ŕ GW, 2/3 : 456. SE, 5 : 453-454.
Das Ewig-Weibliche Zieht uns hinan
L’Eternel féminin Nous tire vers le haut
Les nombreux exemples fournis par la Traum-deutung vont à l’encontre de ces deux vers. La femme est fatale pour l’homme. Ce n’est pas vers le haut que l’éternel féminin le tire, mais vers sa perte. Qu’il se nomme Lasker, Lassalle, ou Freud 67 :
Lasker mourut d’une paralysie progressive, donc des suites d’une infection contractée auprès de la femme (syphilis) ; Lassalle, on le sait, mourut en duel à cause d’une dame.
Quant-à Freud, il ne nous a pas laissé ignorer qu’il a raté la découverte de la propriété anesthé-siante de la cocaïne à cause de sa fiancée. Au lieu de persévérer dans ses recherches de laboratoire, il était allé la rejoindre à Wandsbeck (sept. 1884), laissant Koller lui souffler cette découverte. Il est heureux que, suivant la légende imaginée par Freud 68, ce fut Breuer la victime de la femme hys-térique, et non pas lui-même. La Traumdeutung n’aura nullement à pâtir de l’éternel féminin. Bien au contraire : ce furent les hystériques qui en pâti-rent en la personne d’Emma Eckstein, la malheu-reuse héroïne du rêve dit de l’injection faite à Irma. Ils se mirent à deux pour la tourmenter. Freud s’ad-joignit Fließ pour la meurtrir dans son corps et dans son esprit 69. Puis en la personne de Dora [Ida Bauer]. Là ils se mirent à trois. Freud, en effet, prêta main forte au père de la victime et à l’ami de ce père, pour la broyer. Et plutôt à quatre, si l’on tient compte de l’ombre portée de Fließ 70.
L’autoanalyse mise à nu par ses desservants mêmes Autre grand thème : la discrétion et
l’indiscrétion. Freud assure se faire violence. Il évoque ce qu’il lui en coûte, les résistances qu’il doit surmonter, pour livrer tant de son être intime au public. Mais il ne s’agit pas seulement de lui. Avait-il de grands scrupules envers les autres ? Le cas est jugé depuis la biographie officielle de Jones. Freud n’était pas discret. Mais il ne fallait pas l’in-sinuer devant lui, Ŕ ça le fâchait. Sa clairvoyance là-dessus était grande 71. Il ne se méprenait pas sur
67 Traumdeutung, chap. VI, § A. Ŕ GW, 2/3 : 305, note. SE, 4 : 300, note. OCF, 4 : 343, note. 68 AZAR & SARKIS (1993) : Freud, les Femmes, l’Amour, Ire Partie. 69 AZAR & SARKIS (1994) : Freud, Parties Carrées, IIe Partie. 70 AZAR & SARKIS (1993) : Freud, les Femmes, l’Amour, IVe Partie. 71 Traumdeutung, chap. VI, § H. Ŕ GW, 2/3 : 485-486. SE, 5 : 481-482. OCF, 4 : 532.
31
16
ses vertus. Néanmoins cette clairvoyance avait des limites. Il y avait chez lui des clivages résistants. C’est ainsi qu’il faisait, par exemple, remarquer 72 :
On ne saurait se cacher qu’interpréter et commu-niquer ses rêves implique un difficile surmontement de soi. On ne peut que se révéler le seul scélérat parmi tous ces gens nobles dont on a partagé l’existence.
Le seul scélérat ? Fi donc ! Où est-il allé cher-cher tant de candeur, lui qui vient de ravaler tant de proches, d’amis et de maîtres ! Cela me remet en mémoire le procédé du prédécesseur de Freud en la carrière. La menace imminente de la publi-cation des Confessions de Rousseau, et l’insistance de ses propres amis, firent que Diderot s’empres-sât de faire imprimer ces dures paroles 73 :
Si, par une bizarrerie qui n’est pas sans exemple, il paraissait jamais un ouvrage où d’honnêtes gens fus-sent impitoyablement déchirés par un artificieux scélé-rat qui, pour donner quelque vraisemblance à ses in-justes et cruelles imputations, se peindrait lui-même de couleurs odieuses ; anticipez sur le moment, et deman-dez-vous à vous-même si un impudent, un Cardan 74, qui s’avouerait coupable de mille méchancetés, serait un garant bien digne de foi ; ce que la calomnie aurait dû lui coûter, et ce qu’un forfait de plus ou de moins ajouterait à la turpitude secrète d’une vie cachée pen-dant plus de cinquante ans sous le masque le plus épais de l’hypocrisie ? Jetez loin de vous son infâme libelle, et craignez que, séduit par une éloquence perfide, et entraîné par les exclamations aussi puériles qu’insen-sées de ses enthousiasmes, vous ne finissiez par deve-nir ses complices. Détestez l’ingrat qui dit du mal de ses bienfaiteurs ; détestez l’homme atroce qui ne ba-lance pas à noircir ses anciens amis ; détestez le lâche qui laisse sur sa tombe la révélation des secrets qui lui ont été confiés, ou qu’il a surpris de son vivant. Pour moi, je jure que mes yeux ne seraient jamais souillés de la lecture de son écrit ; je proteste que je préférerais ses invectives à ses éloges. Mais ce monstre a-t-il jamais existé ? Je ne le pense pas.
Diderot publiait ces lignes au moment où Rousseau venait de mourir, et où la menace de la publication imminente de ses Confessions flanquait des transes à Diderot et à ses amis, Ŕ ceux que
72 Traumdeutung, chap. VI, § H. Ŕ GW, 2/3 : 489. SE, 5 : 485. 73 DIDEROT : Essai sur Sénèque, (11779) § 39, note, [OC, 12 : 567-568] ; (21782), I § 61, [OC, 13 : 352-353]. Je cite le texte remanié. 74 GIROLAMO CARDANO (1501-1576). De Vita Propria/Ma Vie, fut publiée à titre posthume en 1643. Mathématicien de la Renais-sance, haut en couleurs, et jouissant de talents multiples, il relate dans son autobiographie toutes sortes de données intimes, de rêves et de délires. Il est curieux qu’aucun psychanalyste ne se soit penché sur son cas, à la notable exception de JUNG.
Rousseau dénommait la coterie holbachique. Les membres de cette coterie avaient raison de trem-bler, et ils tremblaient d’autant plus fort que leur conscience n’était pas si exempte de tache qu’ils se plaisaient à l’affecter 75. Cela étant dit, et la part des choses, des circonstances, et surtout la part de la déclamation étant faites, l’argument qui fait le fond de cette diatribe tient bon. Médire de soi n’est-ce point un habile stratagème pour médire impuné-ment d’autrui ? Et Rousseau et Freud n’en ont-ils pas tiré bon parti ? Pour ma part, j’aimerais qu’on me persuade du contraire.
Les rêves de punition du parvenu Nous allons nous intéresser à présent
aux additions apportées par Freud à la section « H » du chap. VI, consacrée aux affects dans le rêve. La majeure partie en a été ajoutée en 31911, à la suite d’une communication faite par Margarethe Hilferding à la Société psychanalytique de Vienne en déc. 1910. Elle concernait un rêve désagréable et récurrent du romancier régionaliste Peter Ro-segger (1843-1918), qui contredisait la doctrine de l’accomplissement de souhait. Rosegger avait été dans sa jeunesse un apprenti tailleur chez un maître sé-vère, puis il avait fait plusieurs métiers, avant de trouver sa voie et le succès en tant qu’écrivain. Il se mit étrangement, à rêver la nuit qu’il était de nouveau apprenti tailleur chez ce maître sévère. Ces rêves désagréables ne cessèrent que lorsqu’il arriva dans un rêve que ce maître, mécontent de lui, le congédiât. Rank signala également à Freud que ce « mo-tif » se retrouve dans le conte bien connu des frères Grimm : Le vaillant petit tailleur. Après que le petit tailleur soit devenu, à la suite de plusieurs pé-ripéties et d’artifices, le mari de la princesse, il se mit à rêver la nuit à haute voix qu’il était retourné à son établi. La princesse devina son passé, et il ne fut sauvé du désastre que par son écuyer. Comment rendre compte de ces rêves récur-rents et désagréables ? Freud fit appel à sa propre expérience. Il était lui-même passé par là 76 :
Mes propres rêves de ce type m’ont permis d’ap-porter des éclaircissements sur de tels rêves. Jeune doc-teur, j’ai longtemps travaillé à l’Institut de Chimie [1881-1882] sans parvenir à quoi que ce soit dans les
75 Sur la question de fond, Cf. la précieuse étude du regretté BE-
NOIT MELY (1985) : Jean-Jacques Rousseau, un intellectuel en rupture. 76 Traumdeutung, chap. VI, § H. Ŕ GW, 2/3 : 479. SE, 5 : 475.
32
17
techniques qui y étaient requises, et c’est pourquoi, à l’état de veille, je n’aime jamais penser à cet épisode infructueux et à vrai dire honteux de mon apprentis-sage. Par contre c’est devenu chez moi un rêve récur-rent que de travailler en laboratoire, faire des analyses, vivre toutes sortes de choses, etc. ; ces rêves me don-nent le même malaise que les rêves d’examen et ne sont jamais très nets.
Suivant Freud, ce sont là des « rêves de punition du parvenu ». Ils procèdent des tendances maso-chistes de notre vie psychique. Nous nous punis-sons rétrospectivement de nos arrogantes fantai-sies d’ambition passées. De quand faut-il dater ces rêves introduits à la 3e éd. de la Traumdeutung (31911) ? Sans doute faut-il les placer dans l’intervalle qui sépare la 2e de la 3e éd., soit entre 21908-31911. L’un de ces rêves est d’ailleurs cité et daté de la nuit du 10/11 octobre 1910 en un autre endroit du livre 77. À quel événement ces rêves sont-ils réactionnels. Là encore nous pouvons présenter une conjecture. Ils datent vraisemblablement de son retour d’Amérique. Il ne fait pas de doute que c’est lors de ce voyage (sept. 1909) que Freud a eu le sen-timent d’être parvenu à l’acmé de sa vie. On s’en convainc en prenant connaissance du témoignage oculaire de Jung, rapporté par Lacan 78 :
J’ai entendu un jour parler de Freud en ces termes Ŕ sans ambition et sans besoins. La chose est co-mique si l’on songe au nombre de fois, tout au long de son œuvre, où Freud nous a fait l’aveu de son am-bition, sans doute avivée par tant d’obstacles, mais qui va beaucoup plus loin dans l’inconscient, comme il a su nous le montrer. Faudrait-il, pour vous la faire sentir, vous peindre, Ŕ comme Jung un jour, parlant à ma personne, l’a fait Ŕ la réception de Freud à l’Université [de Worcester] qu’il portait à l’éclairage mondial ? Je veux dire, peindre le flot, dont il a été le premier à avoir montré la signification symbolique, fleurir en une tache grandissante son pantalon clair.
En 1900, Freud était de ces auteurs qui en appellent à la postérité de l’injustice de leurs con-temporains. Après être allé en Amérique, c’était un parvenu : un chef d’école controversé, mais re-connu comme tel. Dans une note ultérieure (81930), Freud a encore précisé ceci 79 :
77 Traumdeutung, chap. V, § A. Ŕ GW, 2/3 : 173, n. SE, 4 : 167, n. OCF, 4 : 204, n. Ŕ Note ajoutée à la 3e éd. (31911). 78 LACAN (1956) : Freud dans le siècle, p. 266. 79 Traumdeutung, chap. VI, § H. Ŕ GW, 2/3 : 480, n. SE, 5 : 476, n.
Depuis que la psychanalyse a décomposé la per-sonne en un moi et un sur-moi (Psychologie des masses et analyse du moi, 1921), il est facile de recon-naître dans ces rêves de punition des accomplisse-ments de souhait du sur-moi.
Mais Freud va plus loin, toujours grâce à son autoanalyse. À un autre niveau, ces sortes de rêves véhiculent « l’un des souhaits qui ronge sans re-lâche l’homme vieillissant ». C’est-à-dire l’aspiration à une Fontaine de Jouvence. Une illustration ex-quise me vient à l’esprit. Elle se trouve dans les Cahiers Inédits d’Henri de Régnier 80 :
Lundi 23 décembre [1929] (…)
Un rêve bizarre. On vient m’annoncer que mon élection à l’Académie n’a pas été régulière, qu’elle n’est pas régulière et qu’il va falloir me représenter, mais que, cette fois, je n’aurai guère plus de cinq à six voix.
Samedi 28 décembre [1929] J’ai eu aujourd’hui 65 ans.
Henri de Régnier fut élu à l’Académie Fran-çaise au premier tour, le 9 février 1911, avec 18 voix sur 32 votants. Il avait 47 ans. Dix jours après son élection, il écrivait dans ses Cahiers 81 :
J’éprouve un grand repos de l’heureuse conclusion de cette affaire académique ; ce n’est qu’un jeu, mais on finit par s’y piquer. Il me semble maintenant que je vais pouvoir travailler, lire, vivre en paix, quand j’aurai répondu aux cinq cents lettres et cartes que j’ai reçues…
C’était la 3e fois qu’il se présentait. Cette af-faire aura duré 5 ou 6 ans, puisqu’il avait com-mencé ses visites académiques en mars 1906. Il n’y a pas de doute qu’avec cette élection à l’Aca-démie Régnier se soit considéré comme un par-venu. Mais il n’a vécu le rêve de punition du par-venu que longtemps après, à la veille de ses 65 ans. Quelques mois auparavant il s’était fait une entorse au poignet, et il avait visité, dans une sorte de « pèlerinage », les lieux de son enfance au 6 quai du Louvre. Ces trois exemples (Rosegger, Freud et Régnier), établissent que le rêve de punition du parvenu a pour instigateur l’appréhension de la mort. Un autre point me paraît riche d’enseignement. Si Freud fait référence in extremis au Surmoi (81930), en revanche il passe sous silence le complexe de castration. Ce complexe a été officiellement intro-duit en 1923, même s’il est pressenti depuis le
80 REGNIER (2004) : Cahiers Inédits 1887-1836, Pygmalion, p. 834. 81 Idem, p. 632. (Entrée du 18 février 1911).
18
compte rendu du cas du Petit Hans (1909b). Faut-il supposer qu’en 1930 Freud n’en possédait tou-jours pas un maniement aisé ? Cette omission est d’autant plus étrange que les tailleurs se caractéri-sent par leurs grands ciseaux, et que la mort est souvent représentée comme la Dame à la Faux 82.
L’appareil psychique Le chap. VII et dernier de la Traum-deutung est consacré à la psychologie
des processus oniriques. C’est le couronnement du livre. L’ambition de Freud est ici à son Zénith. Il s’agit de rattacher le rêve, en tant que formation psychique, à notre vie d’âme. Freud pensait qu’il s’aventurait là dans un domaine obscur, et que son apport était conjectural. Il ne se trompait pas. Il a pu lui-même, par la suite, pousser les choses plus loin. Néanmoins, il a sagement renoncé à remanier son chapitre et à le mettre à jour. On n’y trouve donc que l’état de la question aux alentours de 1900, hormis une note laconique de 81930, pour signaler derechef, dans les rêves de punition, la place du Surmoi, « reconnu plus tard par la psychanalyse » 83.
Fig. 1. – L’appareil-à-langage de Freud en 1891
1. Schéma anatomique
Fig. 2. – L’appareil-à-langage de Freud en 1891 2. Schéma de la représentation-de-mot (Vorstellung)
82 Les rêves de Rosegger ont été une pomme de discorde entre Freud et l’école de Zurich. Cf. MARINELLI & MAYER (2003), chap. 8. 83 Traumdeutung. Ŕ GW, 2/3 : 563, note. SE, 5 : 557, note.
Son exposé procède du fameux Entwurf, ce projet d’une psychologie pour neurologues qu’il a rédigé fiévreusement en automne 1895, au retour d’une rencontre avec son ami Fließ. Ce projet était resté inachevé, et n’a été révélé qu’en 1950a. Le souci de Freud de construire un appareil psychique (dénommé aussi un appareil d’âme) remonte très loin. On peut considérer qu’il procède de la même inspiration qui avait présidé à la construction du double schéma de l’appareil-à-langage dans son étude critique sur l’aphasie (1891b) [Fig. 1 et 2]. Dans la Traumdeutung, Freud pose les pre-mières pierres pour une approche psychanalytique de l’appareil psychique. Il sait qu’il s’agit d’une en-treprise quasi inédite, et il ne se fait pas faute de le dire et de le revendiquer 84. Il laisse entendre que Fechner l’avait précédé dans cette voie 85, ou Pla-ton avec son attelage ailé (Phèdre, 246a) 86. Pour-quoi pas. Mais Platon ou Fechner ne sont pas dif-férents des Charcot, des Lipps, des Breuer ou des Fließ. Ils font partie des inspirateurs de Freud, ou de ses excitateurs, au sens donné par Freud lui-même aux restes diurnes dans la formation du rêve. Freud n’en reste pas moins un navigateur solitaire. Dans ce genre de modélisation, le prototype est l’appareil réflexe. Il s’agit d’abord de distinguer l’une de l’autre les composantes de cet appareil, de spécifier la fonction de chacune de ces pièces, et d’en décrire la dynamique en suivant le chemine-ment d’une stimulation depuis son entrée dans cet appareil jusqu’à sa sortie. À la sortie de l’appareil nous avons la motilité (l’action), qui est bloquée dans le rêve. Freud a recours à une esquisse en trois étapes. Il part d’un baquet divisé en compar-timents, entre deux bornes : une extrémité-perception (Wahrnehmungsende, W) qui traite le sti-mulus afférent, et une extrémité-motilité (Motilität-sende, M) pour le vecteur efférent (Fig. 1 de Freud). La borne perception (W) ne conserve pas de traces mnésiques (Erinnerungsspur). Il faut envisager qu’il lui succède dans cet appareil un certain nombre de systèmes qui encodent ces traces mné-
84 Traumdeutung, chap. VII, § B. Ŕ GW, 2/3 : 541. SE, 5 : 536. 85 Traumdeutung. Ŕ GW, 2/3 : 51. SE, 4 : 49. 86 Cf. DUMORTIER (1969). Comp. à la tripartition de l’âme exposée in République (439d sqq.). Cf. DELCOMMINETTE (2008) pour plus ample informé. REISS (1983), p. 35, estime que les prédécesseurs de Freud se nomment en réalité Galilée, Descartes et Frege. Sans qu’il utilise le terme propre, Reiss fait de Freud un praticien de la méthode de simulation. Mais c’est encore Platon qui en est le premier promoteur. Cf. l’argumentation du Livre IV de La République fon-dée sur la transposition de la structure de la Cité à celle de l’âme, par un changement d’échelle. L’organisation de la Cité permet de voir en lettres capitales la structure de l’âme.
33
19
siques suivant des associations particulières : par simultanéité, par successivité, par ressemblance, etc. (Er, Er’, etc.) (Fig. 2 de Freud). Le cheminement du vecteur traverse alors le système de l’incons-cient (Unbewußte, Ubw), et, s’il passe avec succès l’épreuve critique de la censure, il devient passible de conscience et d’éconduction motrice. Le der-nier système est donc une sorte d’antichambre que Freud dénomme le préconscient (Vorbewußte, Vbw). D’où le schéma définitif suivant [Fig. 3] :
À partir de ce schéma général de l’appareil psychique, Freud se proposera donc de décrire comment, dans cette condition particulière, le rêve se forme, sachant que l’issue de la motilité lui est fermée. Le rebroussement du vecteur dans l’appareil psychique, jusqu’à la borne-perception (W), dénommé régression, est censé expliquer les images hallucinatoires du rêve.
Où est donc passée la Censure ? Au § E de ce chap. VII, Freud s’est appuyé sur trois esquisses pour aider
son lecteur à visualiser l’appareil psychique. Celui-ci se présente sous la forme d’un baquet. Mais pour comprendre le propos de Freud, il faut con-cevoir ce baquet dans l’espace, et l’enrouler sur lui-même de façon à faire coïncider W (le pôle Percep-tion) avec Vbw (le pôle Préconscient) 87.
Deux Remarques. Ŕ Cette esquisse se rapporte à l’appareil psychique en général. J’y relève une omission de taille : la Censure. De plus, cette es-quisse n’est pas spécifique à la psychologie du rêve. On trouve sur Google un schéma qui tente de surmonter ces deux handicaps. Il est dû au wi-kigraphiste Frédéric Michel, qui s’est inspiré d’Ellenberger. Son schéma me paraît utile. La po-sition de la censure principale du rêve y est, à mon
87 Cf. LAPLANCHE (2003) pour plus ample informé.
avis, pertinemment placée. Il faudrait seulement lui ajouter une censure secondaire au niveau du Préconscient, dont l’élaboration secondaire est une émanation.
Fig. 4. – L’appareil psychique selon Wikipedia
En outre, l’élaboration secondaire n’intervient pas seulement en après-coup par rapport au travail onirique, comme le laisse entendre ce schéma. Sa relation au travail onirique est plus complexe. J’en ai touché un mot plus haut (§ 28). Une partie de la section dévolue à l’élaboration secondaire est con-sacrée par Freud à montrer qu’elle intervient aussi bien avant la première censure, qu’au cœur du tra-vail onirique, tout comme dans la mise en mot du récit du rêve. Ce qui brouille nos idées est le fait que Freud ait choisi d’intituler cette fonction : éla-boration secondaire. De plus, l’ellipse contenant la résolution du complexe d’Œdipe, placée à la base de ce schéma, est, en 1900, un parfait anachronisme. En 1900 il n’y a pas encore de complexe d’Œdipe. Et même au prix d’un anachronisme elle me paraît discu-table. Il serait, à mon avis, plus judicieux de la remplacer par une notion plus pertinente, et moins « populaire », celle de Névrose Infantile, à laquelle le Vocabulaire de la Psychanalyse n’a malheu-reusement pas accordé droit de cité 88. C’est la névrose infantile, reconstituée invariablement du-rant la cure-type, qui est la catégorie fondamen-tale à considérer. Une fois faites ces observations didactiques, il est nécessaire de revenir au schéma du baquet déroulé. La première qualité de ce schéma, aux yeux de Feud comme aux nôtres, est son homo-généité. Il se réduit à un mécanisme. Si la censure
88 Cf. le beau rapport de LEBOVICI (1980) sur ce sujet.
45
20
y est absente, c’est que Freud ne la conçoit pas comme un mécanisme. Elle est toujours person-nifiée chez lui, c’est-à-dire pétrie de subjectivité. En ce sens, elle ne peut pas occuper de place dans un schéma mécanique ou en constituer un rouage. Ce n’est que bien plus tard, quand Freud imaginera des baudruches, formées de pièces rapportée à la manière d’un collage, qu’il sera en mesure de lui ménager une place. À ce moment-là tout l’appareil psychique aura d’ailleurs été en-vahi par l’anthropomorphisme. On observe néanmoins que même sur ces schémas tardifs la censure n’est pas mentionnée en nom propre.
Fig. 5. – La Baudruche de 1933
Sur la baudruche de 1933 [Fig. 5], la censure est représentée par une double ligne brisée, figu-rée en pointillés sur l’un de ses tronçons, et en traits pleins sur l’autre. On lit en surimpression sur ce dernier tronçon : refoulé. Pourtant, Freud a accordé des lettres capitales au MOI et au SUR-
MOI. Tout cela me semble manifester un certain embarras, Ŕ et à juste titre. À mon sens, la cen-sure exerce sans doute ses effets dans l’appareil psychique, mais elle est localisée ailleurs. Son siège se trouve dans notre discours intérieur. Elle mêle sa voix à celles qui y règnent, et elle parvient souvent à les dominer moyennant l’attraction de l’inconscient.
L’objet de la psychanalyse De ce chap. VII, il me semble qu’il faudrait retenir trois thèses princi-
pales, non sans les radicaliser : 1º/ Il faut consi-dérer que l’appareil psychique est l’objet spéci-fique de la psychanalyse en tant qu’objet de science. Ce point m’a paru mériter que je lui con-sacre un essai particulier, auquel je renvoie 89.
89 AZAR (2014b) : L’objet de la psychanalyse en tant qu’objet de science, in ’Ashtaroût, bulletin volant n° 2014∙0329, mars 2014, 7 p.
Notons que Freud ne se fait pas faute de van-ter son approche. Il dit textuellement que cet ins-trument d’âme [Seeleninstrumentes] est de tous les instruments le plus merveilleux et le plus mysté-rieux [dieses allerwunderbarster und allergeheimnisvollsten Instrumentes] 90 ! Quarante ans plus tard, Freud as-sumera plus complètement son invention dans l’Abriß 91. C’est que l’appareil psychique ou appa-reil d’âme [psychischer ou seelischer Apparat] est l’objet spécifique de la psychanalyse en tant qu’objet de science, comme je viens de le dire. Il m’est par conséquence incompréhensible que Pierre-Henri Castel ait pu affirmer à cet égard 92 :
La suite de l’œuvre indique ce qui importait le plus à ses yeux : radicaliser l’analyse des conflits du Moi et du refoulé, la théorie de l’appareil ψ dût-elle être abandonnée (475).
« … la théorie de l’appareil ψ dût-elle être abandon-née » ? Il n’en est rien. Je ne constate rien de tel. Je ne vois nullement Freud abandonner à aucun moment le recours à l’appareil ψ. Surtout pas à la page de la Traumdeutung que Castel signale en gras. Bien au contraire. C’est à cette page que Freud, dans une note de l’édition définitive (81930), in-dique le lieu d’insertion du Surmoi, thématisé ulté-rieurement. Freud n’a cessé de remanier sa modé-lisation de l’appareil psychique, ce qui n’est pas y renoncer. Il se peut que la référence de Castel soit er-ronée, et qu’il eût indiqué par inadvertance la p. 475 au lieu de la p. 517. Nous lisons en effet en cet endroit 93 :
(…) nous devons être toujours prêts à laisser tomber nos représentations auxiliaires (Hilfsvorstellungen) si nous nous croyons en position de les remplacer par quelque chose d’autre qui serait plus proche de la réali-té effective inconnue.
Néanmoins ce passage n’indique pas non plus qu’il faille formellement renoncer à l’appareil psy-chique comme objet de la psychanalyse en tant que science. Freud se contente d’y envisager de troquer une modélisation de secours (Hilfsvorstel-lung) pour une autre, plus adéquate.
90 Traumdeutung, chap. VII, § E, à la fin. Ŕ GW, 2/3 : 613-614. SE, 5 : 608. OCF, 4 : 663-664. 91 Abriß, Ire Partie, chap. I. Ŕ GW, 17 : 68. SE, 23 : 145. 92 CASTEL (1998) : Introd. à L’Interprétation du Rêve de Freud, p. 318. Les italiques sont de Castel. Le chiffre en gras renvoie à la pagina-tion de l’ancienne trad. franç. de la Traumdeutung révisée en 1967, aux PUF. Le passage dont il s’agit est une addition de 1919, et correspond à GW, 2/3 : 563-564. SE, 5 : 558. OCF, 4 : 612. 93 Traumdeutung, chap. VII, § F, début. Ŕ GW, 2/3 : 614-615. SE, 5 : 610. OCF, 4 : 665.
35
21
Clivage entre théorie & pratique Le même auteur relève deux pages plus loin l’étrange paradoxe de l’appa-
reil ψ de Freud. Sa remarque est tout à fait perti-nente, et ne pouvait provenir que d’un lacanien pour qui : « Freud, Lacan, même combat ! » Voici cette remarque 94 :
Il y a d’ailleurs un paradoxe étrange dans cette théorie de l’appareil ψ, puisqu’en réalité sa structure est définie en relation à un Autre opaque (la mère du nourrisson en est le prototype) dont Freud ne dit presque rien, mais qui vectorise ab initio ce qui se pré-sentait d’abord comme une décharge réflexe. Du cri à l’appel, un pont est ici jeté, (etc.)
Je me suis expliqué là-dessus à de nom-breuses reprises. Freud réfléchit dans le cadre du Darwinisme (et du Scientisme fin-de-siècle), au re-gard desquels il est requis de réduire le psychisme à une théorie de l’expression. On assiste ainsi chez Freud à un clivage d’ordre épistémologique entre sa théorie et sa pratique. Sa théorie est une théorie de l’expression. Sa pratique prend en charge la relation interhumaine, laquelle demeure chez Freud non thématisée. Chez Lacan, c’est le contraire : la théorie de l’expression y brille par son absence, alors que la relation à l’Autre et aux autres accapare toute son attention. Freud écorne le sommet « Appel » du triangle sémiotique de Bühler [Fig. 6], tandis que Lacan écorne son som-met « Expression » 95.
Fig. 6. – Le Triangle Sémiotique de Bühler, 1934
94 CASTEL (1998) : Introd. à l’Interprétation du Rêve de Freud, p. 325. 95 Cf. entre autres AZAR (2009), (2011d) et (2011e).
Processus primaire & secondaire 2º/ Freud consacre aux processus
primaire et secondaire une section spéciale de son chap. VII, le § E, conjointement avec le refoule-ment. Jusque là tout va bien. Mais en 1911b, il pro-longera sa réflexion dans un texte intitulé : Les deux principes de fonctionnement de l’advenir psychique. Qui connaît l’œuvre antérieure de Freud Ŕ que ce soit l’Entwurf ou la Traumdeutung Ŕ se serait attendu à ce que ces deux principes soient le processus pri-maire et le processus secondaire. On est surpris qu’il n’en soit pas ainsi. On apprend (avec per-plexité et chagrin 96) que ce sont le principe de plaisir et le principe de réalité. Jusque là nous avions le principe de plaisir-déplaisir, et l’épreuve de réalité. D’où vient l’intrus ? Ŕ De la jalousie 97. Rappelons d’abord l’épisode suivant, d’après la lettre de Freud à Fließ du 10 mars 1898 :
J’ai pris entre mes mains, le cœur battant, un livre de Janet qui vient tout juste de paraître, « Hystérie et idées fixes », et c’est le pouls tranquille que je l’ai mis de côté. Il ne pressent pas la clé.
Eh bien, Janet a malheureusement récidivé. Il avait publié en 1909 ses cours du Collège de France sur les Névroses. Il y avait fait la promotion de la fonction du réel. En reposant de côté ce nou-veau livre, le pouls de Freud était cette fois très agité. Il fallait faire quelque chose. Il commit un larcin. Il recycla la fonction du réel de Janet 98 en principe de réalité, Ŕ et il engagea la psychanalyse dans une impasse. Il n’y a pas de principe de réa-lité dans l’appareil psychique, Ŕ ou plutôt le seul principe de réalité qui a cours en psychanalyse est celui de la différence des sexes 99.
Le discours intérieur 3º/ Dans le rattachement du rêve à notre vie d’âme, il faut aller, là aussi,
plus loin que Freud. Il faut insérer le rêve dans le discours intérieur. C’est à ce domaine qu’il appartient.
96 Je parle évidemment pour moi ! 97 Cf. la note 20, supra, § 24. 98 C’est en 1903 que Janet avait introduit la fonction du réel. Cf. Les Obsessions et la Psychasthénie, tome I, Ire Partie, chap. III, 4e sec-tion, § 2 : « La perte de la fonction du réel », pp. 431-439. 99 Cf. AZAR (2011g) (2011h) (2011i).
36 37
38
22
Freud n’a pas poussé l’investigation dans cette di-rection. Il avait ses raisons exposées plus haut, ou plutôt son idiosyncrasie. Il nous a confié que ses propres rêves nocturnes étaient impropres à l’étude du lien les rattachant à ses rêveries diurnes 100. Comprenons plutôt que lui Ŕ ce grand rêveur éveillé que nous connaissons 101 Ŕ avait d’énormes résistances intérieures à pousser ses in-vestigations de ce côté-là. Il s’en doutait d’ailleurs. Dans son chapitre sur le travail du rêve, il avoue avoir été tenté d’envisager une catégorie de rêves sous le titre de « fantaisies pendant le sommeil », mais qu’il y avait renoncé. Trente ans plus tard, dans l’édition définitive de son livre (81930), il ajoutait à ce passage cette note de bas de page : « Je ne sais pas aujourd’hui si j’ai eu raison » 102. Ŕ Il eut tort ! Relevons un autre indice de sa cécité, ou de son évitement délibéré. En 1906 l’éminent psy-chiatre Emil Kraepelin publiait un opuscule sur les distorsions verbales dans les rêves, largement fondé sur des auto-observations. L’auteur avait en vue de rapprocher ces distorsions de celles qu’on relève dans la démence précoce (schizophré-nie). Cet ouvrage est dûment répertorié par Freud dans sa bibliographie, sans avoir jamais été discu-té ni exploité 103, alors qu’il est assez propre à passionner le psychanalyste. Freud considérait en outre que le rêve n’avait pas de destinataire du fait qu’il ne vise pas à être compris 104. Il avait adopté une acception restric-tive (angélique) du discours. N’est discours à ses yeux que celui qui s’adresse à un destinataire dans l’intention de s’en faire comprendre. Aussi, les rêves ou les symptômes ne sont pas des discours
100 Traumdeutung, chap. VI, § I. Ŕ GW, 2/3 : 498, note. SE, 5 : 494, note. Cette note fut ajoutée en 21909. 101 On trouve dans la Traumdeutung, chap. V, § A, un rêve éveillé remarquable : Si j’avais (comme papa) un glaucome, j’irai à Berlin… Ŕ GW, 2/3 : 176. SE, 4 : 170. On trouve dans la Psychopathologie de la vie quotidienne (1901b), chap. VII, § A-11, un rêve éveillé non moins remarquable : Ah ! si je pouvais sauver la vie au Pr Charcot, il me donnera en mariage sa fille qui lui ressemble tant… Ŕ GW, 4 : 165-166. SE, 6 : 149-150. On trouve aussi dans son esquisse Sur l’Histoire du mouve-ment psychanalytique (1914d), chap. Ier (in fine), un rêve éveillé tout aussi remarquable, où il s’imagine comme un malchanceux précur-seur, recevant une sorte de réparation à titre posthume. 102 Traumdeutung, chap. VI, § C. Ŕ GW, 2/3 : 336, et note. SE, 5 : 331, et note. La note fut ajoutée en 81930. 103 Apparemment… On peut soupçonner Freud d’y avoir puisé ce qu’il avance à propos du langage des schizophrènes dans son court traité sur l’Inconscient (1915e). Même Lacan a négligé cet opuscule, ce que j’ai plus de mal à m’expliquer. Lacan prisait la rigueur noso-logique de Kraepelin, et ne se faisait pas faute de le dire. 104 Traumdeutung, chap. VI, § D. Ŕ GW, 2/3 : 346-347. SE, 5 : 341-342. OCF, 4 : 386. → Cf. aussi les §§ 17 et 26, supra.
au sens strict du terme, où il veut toujours se pla-cer. Dans sa doctrine il n’aborde le rêve qu’au point de vue d’une théorie de l’expression, déta-chée d’une théorie de la communication. Et pourtant, à chaque pas nous le surprenons en train de traduire, ou plutôt de réduire les rêves à des formules dialogiques 105. Le Discours Intérieur. Ŕ C’est le chantier qui nous attend si nous voulons être freudiens et pro-longer le sillon qu’il a commencé à creuser. Faut-il aller plus loin ? Faut-il admettre que le rêve consti-tue, pour ainsi dire, le degré zéro du discours inté-rieur ? Théodore Flournoy estimait, en 1903 déjà, que le rêve est le degré inférieur de ces produits psy-chiques anormaux tels que les symptômes de l’hystérie. Avait-il raison ? Le cas échéant, ce ne serait ni par l’aphasie, ni par la rêverie (diurne) qu’il serait fructueux d’entamer l’investigation du dis-cours intérieur, mais bien par le rêve nocturne.
(à suivre)
Creative Commons
Attribution ― Non commercial ― No derivative works
Justificatif de diffusion sur le site ashtarout.org www.ashtarout.org/handle/123456789/000
Mis en ligne le 00 novembre 2014
105 J’en ai touché un mot ici-même. → Cf. § 17, supra.