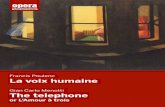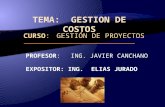Analyse de la locomotion humaine: exploitation des propriétés ...
La gestion hédonique : Prolégomènes à une hédonologie humaine
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of La gestion hédonique : Prolégomènes à une hédonologie humaine
Autres ouvrages publiés aux Éditions Nègrefont
editionsnegrefont.fr
Bissard : Alors là c’est un film, guide du cinéma, par Edwige Bissard.
Structures et fonctions des fantaisies sexuelles, psychologie, par Éric Loonis.
Criminalité et délinquance sexuelles, psychologie, par Éric Loonis.
Théorie générale de l’addiction, psychologie, par Éric Loonis.
La gestion hédonique, psychologie, par Éric Loonis.
L’imaginaire familial, psychologie, par Éric Loonis.
Stats pour les nuls, statistiques en psychologie, par Éric Loonis.
Promenades métaphysiques, philosophie, par Éric Loonis.
Murmures engloutis, nouvelles, par Anna Coreisan.
Manuel de Tantra pour le Couple, spiritualité, par le lama Darjeeling Rinpoché.
Changer d’univers : Méditation, physique quantique et hypermatrice informationnelle, spiritualité, par le lama Darjeeling Rinpoché.
Copyright © 2015 Éditions Nègrefont
Tous droits réservés.
ISBN : 1505930634 ISBN-13 : 978- 1505930634
TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos............................................................................... 7
I. Arrière plan théorique : les addictions .................................... 9
A. Les addictions .......................................................................10 B. La gestion hédonique........................................................... 30 C. Les sources de gestion hédonique ....................................... 38
1. Les stimulations psychoactives .............................................................. 40 2. Les stimulations psychiques endogènes................................................... 41 3. Les stimulations psychiques exogènes .................................................... 43 4. Les stimulations somatiques ................................................................. 45 5. Les stimulations comportementales........................................................ 46 6. Les stimulations sociales....................................................................... 48 7. Les stimulations contextuelles............................................................... 50
D. Les addictions de la vie quotidienne ................................... 53 Pierre, le fameux cadre dynamique et… impuissant .................................. 54 Daniel, une tête en ébullition .................................................................... 55 Paul, cocooning, bière et télévision ............................................................. 57 Sylvia, l’euphorie de l’effort ....................................................................... 58 Marc, la passion du jeu ............................................................................ 59 Simon et Liliane, une dépendance amoureuse ............................................ 59 Albert, shooté à l’orgasme......................................................................... 64 Béatrice, être entourée pour ne pas mourir.................................................. 65 Addiction à la recherche ........................................................................... 67 Addiction à la pornographie ..................................................................... 67 Les méfaits de l’addiction numérique......................................................... 69 Un « hardcore » repenti............................................................................ 74 Adolescent addicté à la musique Techno.................................................... 75 La carrière d’un joueur pathologique......................................................... 76 Les méfaits de l’addiction à la sexualité .................................................... 79 L’anorexie-boulimie ou l’addiction alimentaire.......................................... 83 Addiction au café ..................................................................................... 85 Addiction automutulatrice ........................................................................ 86 Addiction à l’activité : même les animaux (et les enfants) ! ........................ 89 Les achats compulsifs ............................................................................... 90 Mettre le feu............................................................................................. 92 Vie hédonique d’un indien Yanomami ..................................................... 93
ÉRIC LOONIS
4
II. Hédonologie humaine ......................................................... 97
A. Le système de gestion hédonique ........................................ 98 B. Les désafférentations........................................................... 119 C. Les microdésafférentations ................................................. 121 D. La prévention et le soin.......................................................133
III. Programme de recherche ..................................................143
A. Introduction.........................................................................144 B. Le protocole du programme................................................148
La situation de base de microdésafférentation...........................................148 1. Démonstration de la dysphorie ............................................................149 2. Hiérarchie d’activation des sources hédoniques .....................................150 3. Variété du système d’actions ...............................................................150 4. Saillance dans le système d’actions ......................................................151 5. Vicariance dans le système d’actions ...................................................152 6. Systèmes de gestion hédonique .............................................................152 7. Stratégies de gestion hédonique ............................................................153 8. Écologie de la gestion hédonique..........................................................153 9. Économie comportementale de la gestion hédonique ..............................153 10. Genèse et développement de la gestion hédonique ................................154 11. Gestion hédonique, cognitions et structures mentales...........................154
C. Applications et conclusion ..................................................155 Bibliographie ...........................................................................159 Index des matières................................................................... 171 Index des auteurs.....................................................................175 Glossaire hédonologique .........................................................177 Table des tableaux ................................................................... 211
« L’addiction conduit chaque homme vers ce pour quoi il s’amuse et batifole. »
William Shakespeare, Othello, 1604.
Avant-propos Cet ouvrage s’inscrit dans la lignée des deux précédents, qui élaboraient et validaient une théorie générale de l’addiction. Dans notre premier travail (Loonis, 1997), nous faisions appel à la « pensée décousue » (Bateson, 1980), cette faculté du scientifique à laisser aller sa pensée, à « spéculer » et aborder des idées nouvelles, aux frontières de la connaissance, afin d’esquisser un premier modèle général des addictions. Le pluriel est important. Car plus tard nous serons amenés à parler de l’addiction, au singulier, comme d’un principe. Cela signifie, qu’au départ, ce principe n’avait pas encore émergé dans notre pensée. Nous avions simplement l’ambition de regrouper, dans une théorie synthétique, l’ensemble des phénomènes d’addiction, sans encore percevoir, ni même envisager clairement, un schéma directeur unique à cette multiplicité. A l’époque, les concepts d’action hédonique (pragmalogique) et de système d’actions étaient pour nous très embryonnaires. Et, comme le sous-titre de l’ouvrage l’indiquait, nous ne faisions qu’aller vers une théorie générale. La suite de notre travail fit appel à la « pensée rigoureuse » (Bateson, 1980), celle de la recherche scientifique universitaire, qui consiste à tester le modèle préalablement construit. Ce modèle est source d’hypothèses qu’il convient de valider ou d’invalider. Ce test du modèle fut l’objet de notre thèse d’université en psychopathologie (Loonis, 1999c), présentée dans un second ouvrage (Loonis, 2001b),1 où nous décrivions un système de pensée plus complet, une véritable théorie générale de l’addiction, cette dernière étant considérée selon son principe et son caractère universel. Les concepts de système d’actions de gestion hédonique et d’écologie de l’action y étaient approfondis et déjà, nous annoncions une introduction à l’hédonologie, à la fin et dans le sous-titre de l’ouvrage. Au cours de cette première validation du modèle (Loonis, Apter, Sztulman, 2000 ; Loonis, Apter, 2000), nous avons montré comment les actions de gestion hédonique s’organisent dans un système d’actions, dont les paramètres de saillance, de variété et de vicariance, peuvent être directement reliés aux niveaux d’implication addictive et de souffrance psychique des individus. Dans ce troisième et présent ouvrage, nous voici de retour à la « pensée décousue », afin de reprendre et renforcer les bases d’un modèle de la gestion hédonique. Finalement, les addictions, même regroupées de façon synthétique dans une théorie générale, gardent encore un côté un peu « spécial », de comportements spécifiques, le plus souvent pathologiques. 1 Réédité en 2014 (http://www.amazon.fr/dp/150577280X).
ÉRIC LOONIS
8
C’est en approfondissant notre concept primaire d’addiction de la vie quotidienne (Loonis, 1997), en prenant conscience de l’importance des addictions « positives » (Glasser, 1976) et des facteurs non biologiques des activités addictives (Peele, 1985) et, surtout, en prenant en compte les stratégies cognitivo-comportementales de sélection des états métamotiva-tionnels (Apter, 1989, 1992) et en découvrant l’approche psychologique des addictions comportementales (Brown, 1997) que nous nous sommes rallié au concept particulièrement fécond de ce dernier chercheur, celui de gestion hédonique. Le concept de gestion hédonique, renvoie directement à une hédonologie humaine définie comme la science de la gestion hédonique (Loonis, 2001b), qui se propose d’étudier l’ensemble des stratégies que les êtres humains mettent en place, dans le cadre d’une psychologie des états, pour gérer leur hédonie, c’est-à-dire atteindre et maintenir des états d’esprit apaisés ou excités et bienheureux. Nous avons désormais dépassé le concept d’addiction lui-même et la formulation de son principe général comme gestion hédonique, nous amène à poser une fonction générale, universelle et fondamentale, sous-jacente à toutes nos activités : tout ce que l’homme fait, réalise, apparemment s’illusionne-t-il, pour servir son adaptation biologique au monde, remplir des devoirs et des tâches sociales, renvoie en permanence à une nécessité d’adaptation à soi impérieuse, mais si évidente, triviale et quotidienne, qu’elle en devient invisible : nécessité de conforter tout au long de sa vie ses états psychologiques. L’hédonologie étudie donc la gestion hédonique comme un ensemble de systèmes, de stratégies individuelles et collectives, qui organisent au mieux les actions de gestion hédonique et leurs ressources. L’ouvrage est divisé en trois grands chapitres. Le premier fait un rapide tour d’horizon de l’arrière plan des addictions, qui représente les fondations pratiquement épistémologiques de toute hédonologie. Le second chapitre jette les bases d’une hédonologie humaine en décrivant et illustrant un modèle de gestion hédonique. Enfin, la troisième partie de l’ouvrage, propose un programme de recherche complet en hédonologie humaine, offrant ainsi du blé à moudre pour la postérité des chercheurs. Un glossaire, à la fin, regroupe et présente tous les termes et concepts utiles pour fonder une hédonologie. Ce livre est la réédition de l’ouvrage de 2002 sur la gestion hédonique . Il a été révisé et enrichi d’un grand nombre de vignettes cliniques concernant les addictions de la vie quotidienne, des témoignages qui font la démonstration vivante de cette activité générale et universelle : la gestion hédonique.
Dr Éric Loonis
A. Les addictions « Addiction » est un terme et un concept encore peu connus du grand public français.2 Bénéficiant de l’influence anglophone américaine, les francophones du Québec le connaissent mieux et en font usage au quotidien. Dans la langue anglaise, le terme « addiction » est utilisé dans le langage populaire depuis le 16e siècle (Peele, 1990). Si l’on se réfère à cet usage commun et ordinaire, depuis le 19e siècle, la palette des activités concernant les addictions est très large dans la mesure où pratiquement toutes les activités humaines sont concernées (Berridge, Edwards, 1981). On peut être addicté à une substance psychoactive (alcool, drogue, tabac, médicament psychotrope…), mais aussi à une activité sans consommation de substance, mais qui se révèle être une source de stimulations pour notre encéphale (télévision, jeu vidéo, jeu d’argent, sexualité, achats, travail, sport…), en générant la sécrétion de « drogues », substances endogènes (neuropeptides, hormones…), substances naturellement fabriquées et utilisées par notre cerveau pour son propre fonctionnement. Qu’est-ce qu’un « addicté » ? Que signifie le fait d’être « addicté » ou de s’adonner, voire de souffrir, d’une addiction ? Si l’on reprend les exemples ci-dessus, dans l’usage commun du mot addiction, on se rend compte qu’être addicté ce n’est pas tant faire quelque chose de particulier, que faire quelque chose d’une façon particulière. Consommer de l’alcool, fumer du tabac ou avaler quelques calmants ou somnifères, n’est pas en soi une addiction. Et il en est de même de la télévision, des jeux ou de la vie sexuelle. Ainsi la réponse à la question de l’addicté et de l’addiction ne concerne pas tant le type, la qualité de l’activité mise en jeu, que la quantité et le niveau d’investissement dans l’activité addictive. C’est parce qu’une activité addictive a pris une place importante ou très importante, cruciale, dans la vie quotidienne de l’individu, qu’il pourra être dit « addicté ». Cette investissement excessif dans l’activité addictive, que nous avons appelé, avec Brown (1997) « saillance », cet abus, vont naturellement entraîner de nombreuses conséquences dommageables pour l’individu, voire pour ceux qui l’entourent ou la société en général (problèmes de santé, familiaux, sociaux, financiers, légaux…). Ce sont ces conséquences, inscrites dans le court et le long termes, qui font de certaines addictions de véritables fléaux contre lesquels les sociétés mènent un combat acharné.
2 Affirmation qui était valable au début des années 2000, peut-être moins de nos jours, en 2015.
ÉRIC LOONIS
28
vulnérable à la rechute à partir d’indices environnementaux associés à la drogue, dans un contexte d’affaiblissement des défenses.
Les quatre critères de base de toute addiction étant ainsi posés, une synthèse devient possible, autorisant une définition unifiée de l’addiction, tout en respectant les particularités de chaque addiction et de son devenir :
L’addiction est une activité corporelle ou psychique, produisant une activation ou sédation cérébrale, destinée à occulter une dysphorie antécédente, consistant en une souffrance psychique intrinsèque et une menace existentielle ; la saillance dans l’activité addictive est une fonction du degré de cette dysphorie et entraîne une dysphorie conséquente et des conséquences négatives ; mais pour une dysphorie antécédente donnée, la dysphorie conséquente et les conséquences négatives seront elles-mêmes une fonction des facteurs non-biologiques de l’environnement et de la personne, selon un moindre coût adaptatif (Loonis, 2001b).
Cette définition complexe du concept d’addiction commence à nous introduire au modèle de gestion hédonique et à l’hédonologie humaine. Le concept d’addiction renvoie nécessairement à un large éventail d’activités, qu’il s’agisse des consommations psychotropes, des ingestions de substances non psychotropes, ou de l’apport des diverses sources de stimulations sensorielles, perceptives et mentales (intellectuelles, imaginaires, émotionnelles). Car, finalement, le piège a été longtemps de rester aveuglé par l’arbre de l’objet d’addiction, qui nous cachait la forêt des fonctions de l’addiction et de ses véritables moyens. Ce à quoi un individu est « addicté », en dernier ressort, c’est à l’activation cérébrale que produit l’objet (substance, comportement…), car cette activation cérébrale (il peut aussi s’agir, dans certain cas, de sédation) est avant toute chose destinée au contrôle hédonique, c’est-à-dire au contrôle de l’état psychologique de la personne. Les états psychologiques humains sont largement marqués par la dysphorie, et cela à de multiples niveaux. Tout d’abord, il apparaît une dysphorie de fond, comme absolue, pratiquement intrinsèque au fonctionnement cérébral. Cette dysphorie (que nous avons comparée à un « bruit de fond cérébral » ou « existentiel » – Loonis, 1997), largement évoquée et décrite par les mystiques, les philosophes, comme par les poètes, n’a été qu’effleurée expérimentalement par les études scientifiques sur les désafférentations (Bexton, Heron, Scott, 1954 ; Scott, Bexton, Heron, Doan, 1959 ; Azima, Lemieux, Fern, 1962) et, plus récemment, elle fut indirectement mise en lumière, même chez l’animal, dans un renouveau du concept d’anhédonie (Koob, Le Moal, 1997). La souffrance de base a ceci de particulier, qu’elle peut transparaître même au fond du plaisir et du bonheur, elle est toujours là « comme les charognes boursouflées des chiens qui reviennent à fleur d’eau malgré les pierres qu’on leur a attaché au cou pour les noyer », a pu dire Flaubert.
ÉRIC LOONIS
32
addictions aux consommations de substances psychoactives et les addictions plus proprement comportementales ; ou encore, les addictions non pathologiques de la vie quotidienne et les addictions pathologiques, qui ne sont pas moins « quotidiennes » que les premières, mais qui représentent des « solutions » extrêmes à des niveaux tout aussi extrêmes de souffrance psychique). Nous avons proposé (Loonis, 2001b) de définir la gestion hédonique ainsi :
La gestion hédonique est tout ce que fait l’être humain, chaque jour et à chaque instant, pour réguler son humeur et plus généralement pour contrôler ses états psychologiques.
Englobant toutes les activités humaines, la gestion hédonique considère l’ensemble de ces activités comme des sources possibles de stimulation, de plaisir, de soulagement, d’excitation ou de relaxation. La gestion hédonique est donc ubiquitaire, on la retrouve au sein toutes nos activités, comme une fonction spéciale et supplémentaire aux activités, quelle que soit la fonction de base de cette activité. Chaque jour et à chaque instant, la gestion hédonique est un comportement permanent, auquel nous nous livrons tout au long de notre vie. A chaque instant nous avons besoin de nous sentir bien, de fuir l’ennui, la tristesse, l’énervement, l’anxiété, la déprime. Souvent nous avons aussi besoin de nous détendre ou de nous exciter, d’avoir du plaisir, des sensations, des émotions fortes et positives. Tous ces besoins sont les besoins de la gestion hédonique. La gestion hédonique est un comportement général et fondamental pour l’être humain. Elle lui sert à réguler ses états psychologiques, c’est-à-dire : son humeur (fuir l’humeur négative – malaise, ennui, déprime, dépression, angoisse, anxiété, peur… – et atteindre une humeur positive – soulagement, détente, réassurance, confiance, plaisir, euphorie, jouissance) ; réguler ses états motivationnels (désir, intérêt, frustration, ou au contraire dégoût, rejet, désintérêt, indifférence) ; réguler ses états métamotivationnels (Apter, 1989 ; Loonis, 2001b), c’est-à-dire des états psychologiques, sous forme de paires d’états opposés, qui surdéterminent les motivations de base (les paires d’états métamotivationnels télique-paratélique, conformiste-opposant, maîtrise-sympathie, autique-alloïque). La gestion hédonique détermine ainsi une véritable psychologie des états, que nous avons définie (Loonis, 2001b), en regard de la psychologie des motivations, comme :
un ensemble de motivations parallèles et spécifiques à la recherche d’états psychologiques, motivations qui se superposent aux motivations « classiques » et déterminent leur interprétation à un niveau métamotivationnel.
LA GESTION HÉDONIQUE
33
Pour Brown (1997) :
tous les individus apprennent à manipuler leur niveau d’activation, leur humeur et leur vécu de bien-être subjectif afin de soutenir une tonalité hédonique positive (des états de plaisir ou d’euphorie), aussi longtemps qu’ils le peuvent, dans le cadre d’une poursuite normale du bonheur. Certains de ces états émotionnels, lorsqu’ils sont régulièrement reproduits, deviennent des besoins acquis.
Cette assertion princeps, au fondement du modèle de gestion hédonique de Brown, pose le caractère fondamental et universel de la gestion hédonique. Nous ne naissons pas et nous ne vivons pas jusqu’à notre mort avec la gestion hédonique en option. Nous n’avons pas vraiment le choix : la gestion hédonique s’impose à nous comme une nécessité, souvent vitale. On a peine à croire que la vie puisse dépendre de nos états psychologiques, mais pour bien comprendre l’importance vitale de la gestion hédonique, nous devons nous référer à toutes ces situations extrêmes où la souffrance psychologique (c’est-à-dire une défaillance dans la capacité à gérer son hédonie) conduit à la mort : le nourrisson ou le vieillard délaissés qui se laissent mourir, le dépressif qui se suicide après être passé longtemps par la fameuse « perte de l’élan vital », l’alcoolique, le drogué, le preneur de risques excessifs, qui s’autodétruisent dans leur fuite effrénée de la souffrance. La seule chose que l’être humain semble pouvoir faire est de contrôler, plus ou moins, cette nécessité de la gestion hédonique : être conscient de son existence et de ses conséquences pour lui-même, comme pour autrui, faire attention aux excès comportementaux que la gestion hédonique peut entraîner, maintenir une variété suffisante des sources hédoniques, acquérir une philosophie de la modération saupoudrée d’excès bien ritualisés. Il s’agit donc bien d’un art de la « gestion » du bonheur et du plaisir. Ainsi, la gestion hédonique nous est nécessaire, mais en même temps, son but même (le bonheur) rend aussi nécessaire une « bonne » et « saine » gestion, car sans cela, les mesures de gestion hédonique deviennent, elles-mêmes, anti-hédoniques (le toxicomane au long cours sait ce qu’il en est, désormais, de son accès au bonheur…). La gestion hédonique nécessaire, s’apprend, se conditionne et développe ses propres besoins, des besoins acquis, qui se nourrissent de tout notre environnement social et culturel. Tenter de renoncer, ne serait-ce que quinze jours, à la télévision, aux amis, au partenaire de couple, à l’animal domestique, au travail, à l’ambiance musicale, au café, au petit verre, à la cigarette… démontre rapidement toute l’importance de ce que sont les « besoins acquis », car toutes ces choses n’existent pas naturellement dans notre environnement, elles sont une construction à la fois matérielle, sociale et culturelle, dont le seul but est de produire en permanence des sources hédoniques capables de répondre à la nécessité de la gestion éponyme.
ÉRIC LOONIS
52
Tableau III : Exemples de relations inter-catégorielles de quatre moyens de gestion hédonique.
Moyens de gestion hédonique
Catégories Sexualité Toxicomanie Jeu d’argent Travail
Stimulations psychotropes
Cannabis, hallucinogènes,
Viagra®
Toutes substances
psychotropes
Médicaments anxiolytiques
Médicaments stimulants
Stimulations psychiques endogènes
Fantaisies sexuelles
Fantaisies de grandeur
Fantaisies de richesse
Fantaisies de réussite
Stimulations psychiques exogènes
Pornographie Télévision
Informations sur les jeux, les
courses, les paris
Informations profession-
nelles
Stimulations somatiques
Toute activité sexuelle
Sexualité Activation
physiologique Sensation de
stress Stimulations comporte-mentales
Compulsions sexuelles
Rituel toxicomane
Rituel du joueur
Routine du travail
Stimulations sociales
Couple anaclitique
Socialité toxicomane
Socialité du joueur
Collègues, clients
Stimulations contextuelles
Contextes transgressifs
Recherche de sensations
fortes
Contextes de fraudes
Contextes de pouvoir
En fait, chaque action de gestion hédonique est elle-même multiple et complexe, reliée à d’autres actions, qui peuvent entrer dans d’autres catégories. Nous n’avons donc pas affaire à des compartiments bien cloisonnés, mais à une nébuleuse hédonique, pour laquelle tout est relié à tout. Dans le tableau III ci-dessus, nous donnons quatre exemples d’actions de gestion hédonique (Sexualité, Toxicomanie, Jeu d’argent, Travail), considérées de façon globale, avec leur répartition sur chaque catégorie de gestion hédonique (les sept catégories de stimulations). De fait, nos sept catégories de stimulations, à la base de toutes les addictions imaginables, de tous les moyens de gestion hédonique, forment un réseau dense les associant, plus ou moins, les unes aux autres (par exemple, dans le cadre des poly-addictions). Si l’on considère ainsi l’addiction sexuelle, à sa base somatique évidente, doivent être associés les fantaisies sexuelles (stimulations psychiques endogènes), la vidéo pornographique (stimulations psychiques exogènes), un système de compulsions (stimulations comportementales), une relation de couple anaclitique (stimulation sociale), voire un contexte de prise de risque ou de transgression (stimulation contextuelle).
LA GESTION HÉDONIQUE
53
Associations, comorbidité, substitutions, alternances… nous sommes donc en présence d’un système d’addictions, des addictions qui sont en continuité et en association les unes avec les autres, soit un système de gestion hédonique. De multiples liens fonctionnels tissent un réseau d’interrelations et d’interactions entre les moyens hédoniques, cette nébuleuse expliquant aussi bien la dynamique des trajectoires addictives entre addictions de la vie quotidienne et addictions pathologiques, que l’apparente « liberté » de manœuvre d’un système qui peut avoir recours, pour son efficace, tantôt à des stimulations psychotropes, tantôt à des stimulations psychiques, tantôt à des stimulations somatiques, comportementales, sociales ou contextuelles. C’est ce système hédonique et ses implications cérébrales qui suggèrent fortement la présence d’un « processus addictif de base sous-jacent à toutes les addictions » (Goodman, 1990).
D. Les addictions de la vie quotidienne Parler d’addictions de la vie quotidienne, c’est parler d’addictions que tout un chacun est amené à entretenir, à l’état dit « normal », sans être un « addicté », un « drogué » au sens pathologique du terme. Ces addictions n’utilisent pas, généralement, d’agents chimiques comme les drogues de synthèse, les médicaments, mais des stimulants de la libération des drogues endogènes, celles qui sont naturellement fabriquées par le cerveau. Ces addictions ne sont pas non plus rattachées à des comportements particuliers. Ce n’est pas la nature du comportement qui fait l’addiction, mais l’exclusivité de ce comportement, parce qu’il est tellement massif, présent, dans la vie du sujet, parce qu’il n’est pas souplement équilibré avec d’autres comportements, il devient une addiction. En ce sens, ce qui va permettre de distinguer un comportement addictif du même comportement sur un mode non addictif est la présence des phénomènes de dépendance/tolérance, avec leurs corrélats respectifs : symptôme de manque et nécessité d’augmenter les doses. La frontière entre addiction et passion est souvent bien mince et il ne faut pas considérer les addictions de la vie quotidienne comme essentiellement négatives, pathologiques. Les passions, les grands intérêts de notre vie sont, au contraire, tout ce qui fait la richesse d’une personne, elle y place son énergie, son talent, ses connaissances, sa créativité et de nombreuses passions sont souvent utiles à la société. De telles passions peuvent, par leur densité, correspondre souvent à une addiction, mais c’est sa maîtrise, l’équilibre trouvé par rapport aux autres obligations sociales, familiales, vitales, qui déterminera si cette addiction est nuisible ou pas. Par exemple, un sport peut être une passion, devenir une addiction, tant que la santé physique de la personne n’est pas touchée, tant que ses relations
ÉRIC LOONIS
54
familiales et professionnelles ne sont pas perturbées, tout va bien. Dans la mesure où nos addictions de la vie quotidienne entrent dans le cadre de comportements très naturels (activités physiques, mentales, sociales, affectives), qu’elles sont en plus le reflet du fonctionnement addictif naturel de notre cerveau, elles restent tout à fait valables. Seuls les excès sont préjudiciables à la personne et son entourage. Afin de permettre au lecteur de se faire une idée plus précise de ce qu’est cette fameuse « gestion hédonique » de tous les instants, ces « addictions de la vie quotidienne », nous allons vous présenter une série de vignettes cliniques, issues diversement de la clinique psychologique, d’interviews radiophoniques ou de témoignages sur des blogs ou forums en ligne. A l’analyse, vous allez facilement retrouver dans toutes ces données les éléments de base de toute addiction : la souffrance psychique de fond, celle qui résulte de l’addiction elle-même, l’emprise de l’addiction, les phénomènes d’habituation, le manque, la nécessité d’augmenter les « doses », les rechutes à long terme et la grande difficulté pour s’en sortir. Mais surtout, vous verrez, au travers de la diversité des « objets » d’addiction, comment elles se glissent dans la vie quotidienne des individus et finissent par devenir de véritables modes de vie, signant ici leur caractère universel de gestion hédonique.
Pierre, le fameux cadre dynamique et… impuissant Le travail est, de nos jours, une addictions de la vie quotidienne privilégiée par de nombreux hommes. Il entre dans le cadre de l’idéologie moderne du dynamisme, de la réussite, de l’argent. Pierre est un cadre commercial d’une grande société multinationale. À quarante deux ans il est parvenu à un haut niveau de responsabilités, gagne un salaire particulièrement confortable, est divorcé, a trois enfants qu’il voit rarement, possède deux maisons de standing, son ex-épouse vivant dans l’une avec les enfants, lui, passant quelques nuits dans l’autre, entre deux avions. Il travaille à peu près soixante heures par semaines, si l’on compte la totalité de ses prestations professionnelles (rendez-vous, gestion des dossiers, voyages, conférences et… coups de téléphone). Ses responsabilités le mettent sans cesse sous pression, il est stressé et par contre coup son corps réagit par quelques perturbations psychosomatiques dans le genre ulcère à l’estomac, psoriasis et migraines. Son divorce l’a beaucoup affecté, mais il a fini par oublier en intensifiant encore davantage son travail. Sa femme était lasse de cet homme dont la présence se réduisait à son compte en banque bien approvisionné. Leurs relations avaient fini par prendre une telle distance que leur union était devenue tout à fait
A. Le système de gestion hédonique L’élaboration d’un modèle de gestion hédonique a commencé pour nous par celle d’une théorie générale de l’addiction, au cœur de laquelle était placé le concept de système d’actions de gestion hédonique. Ce concept est parti de l’idée qu’une nouvelle pierre pouvait être ajoutée au mur des contraintes vexatoires monté par nos prédécesseurs. S’il est vexant pour l’humain de ne plus être au centre de l’univers, de n’être qu’un animal plus évolué parmi les autres animaux, de ne pas être « le maître en sa propre demeure » psychique à cause de son inconscient, d’être à la merci des processus cérébraux de traitements perceptif, cognitif et soumis aux conditionnements et autres influences cognitivo-comportementales, d’être dominé par les ambiances et cognitions propres aux systèmes humains (groupes, famille, couple, opinion, mentalité, croyances, etc.), d’être sous la domination d’états métamotivationnels, il apparaît, avec le système d’actions, une nouvelle contrainte, qui entrave la liberté de l’homme et porte atteinte à son sentiment de libre arbitre. L’organisation de nos activités, leur succession, les choix que nous portons sur certaines et non sur d’autres, tout cela n’est plus désormais une condition entièrement libre, mais va dépendre des contraintes rattachées à la gestion hédonique, c’est-à-dire aux fluctuations de nos niveaux de souffrance psychique. C’est après la lecture d’un article de vulgarisation ornithologique que, pour nous, l’idée d’un système d’activités chez l’être humain se fit jour.31 Dans cet article il était montré que l’assertion « libre comme l’oiseau » est une illusion. En fait, la plupart des oiseaux sédentaires vivent dans un espace restreint, un territoire, à la fois au sol et aérien. De plus, ils ne se déplacent pas (en volant) dans ce territoire, selon des trajectoires libres, mais suivent le plus possible des trajets prédéterminés et immuables, seules des perturbations extérieures pouvant les dévier de ces trajets programmés. Il était expliqué que la sélection naturelle avait choisi un tel « système de trajets » afin d’augmenter la survie de l’individu et partant de son espèce. Effectivement, en suivant des trajets identiques et bien connus et repérés, un oiseau abaisse considérablement la probabilité de rencontrer un prédateur (sauf si ce dernier est suffisamment intelligent pour avoir repéré le circuit et posé une embuscade, mais c’est une autre histoire). Nous avons imaginé que la résultante actuelle, expérientielle, pour l’oiseau, d’un tel choix stratégique de trajets immuables, pouvait correspondre au contrôle d’un niveau d’alerte, un équivalent du niveau d’angoisse chez l’homme. En suivant des trajets prédéterminés, l’oiseau évite les prédateurs,
31 Un article dont nous avons, malheureusement, perdu la référence.
LA GESTION HÉDONIQUE
103
perversions, pédophilie, tourisme sexuel, viols, harcèlements… La sexualité humaine possède, elle aussi, cette double fonction : pragmatique et hédonique (ce n’est d’ailleurs pas une invention humaine, puisque c’est la nature et l’évolution qui ont sélectionné la « récompense » cérébrale – avec des circuits cérébraux spécialisés – pour nous motiver à manger, à nous reproduire, etc. – Koob, Le Moal, 1997).
Tableau IV : Double fonction de quelques activités courantes.
Fonctions
Activités Pragmatique (activité)
Hédonique (action)
Sexualité Reproduction de l’espèce humaine
Plaisir sexuel, excitation, détente, sensations fortes, fuite de l’ennui, émotions amoureuses, effets psychologiques des fantaisies, du renversement des interdits, etc.
Manger Sustentation physiologique
Plaisir de manger, des bons plats, des bonnes recettes, de la cuisine exotique, du restaurant, de se sentir bien, repus, d’avoir des sensations gustatives, de partager un repas, etc.
Travail
Adaptation socio-économique, gagner un salaire, servir la
société
Plaisir de travailler, de se sentir intégré, utile, de passer le temps, de ne pas s’ennuyer, d’avoir un sentiment de valeur personnelle, etc.
Boire de l’alcool
Être adapté à une certaine vie sociale
Plaisir de boire, de partager le boire, de faire la fête, de goûter de bons vins, des alcools forts, de s’éclater ensemble, d’être autour d’un verre, le petit verre du soir, devant sa télé, oublier le quotidien, la vie morne et triste, noyer le malheur, etc.
Téléphoner Être adapté à une vie sociale amicale
Plaisir de bavarder, de passer le temps, de fuir l’ennui, d’être écouté, d’être stimulé par les paroles que l’autre nous adresse, de partager des sentiments, des émotions, des expériences, par le discours, d’apprendre des choses passionnantes, de papoter, de dire du mal de tiers, etc.
ÉRIC LOONIS
104
Dans le tableau ci-dessus, pour chaque exemple d’activité, nous proposons ses fonctions pragmatiques et hédoniques. Nous conviendrons désormais, et afin de les distinguer, d’appeler « activité » la face pragmatique des activités et « action » leur face hédonique. Pratiquement, il n’existe jamais une activité qui soit purement pragmatique ou purement hédonique : les deux fonctions, en proportions diverses et variées, sont toujours présentes. Simplement, une activité peut être à prépondérance pragmatique (le travail) une autre à prépondérance hédonique (la consommation de drogue) ; mais, il restera toujours un fond d’hédonie dans le travail (satisfaction personnelle, fuite de l’ennui) et un fond de pragmatique dans la consommation de drogue (adaptation au petit monde du « drogué »). Nous avons donc affaire à un continuum différentiel entre pragmatisme et hédonisme, qui co-varient comme des vases communicants, ces co-variations fluctuant selon les situations, les individus et le moment.
Le dégagement de ce principe fondateur de la double fonction, nous amène à reformuler nos lois générales du modèle de gestion hédonique, qui comporte désormais une loi cadre, qui définit ce que sont les actions, sous-entendu « actions de gestion hédonique », sur lesquelles s’appliquent les trois autres lois :
1) La loi (cadre) de la double fonction des activités : toute activité possède à la fois une fonction pragmatique d’adaptation au monde (que l’on continuera d’appeler « activité ») et une fonction hédonique d’adaptation à soi, dans le cadre d’une lutte contre la dysphorie (que l’on appellera « action ») ;
2) La loi de contrainte de l’action (on ne peut pas ne rien faire au plan hédonique) ;
3) La loi d’implication du manque d’action (tout manque d’action induit une dysphorie ou défaillance hédonique) ;
4) La loi de persévération de l’action ou de vicariance (toute action manquante augmente la probabilité d’émergence d’une action de substitution).
A partir du principe de la double fonction des activités (fonction pragmatique et fonction hédonique), il n’est plus possible de désigner telle ou telle activité comme activité de gestion hédonique en propre. Ou encore, de dire que telle activité est une addiction pathologique et une autre une addiction non pathologique. En fait, ce sont les mêmes activités qui peuvent tantôt servir davantage la fonction pragmatique ou la fonction hédonique, tantôt représenter une passion dévorante et maladive et d’autres fois, ou chez une autre personne, n’être qu’une pratique occasionnelle.
LA GESTION HÉDONIQUE
111
saillance, la variété et la vicariance. Pour une définition opératoire de ces trois concepts : a) la saillance peut être définie comme la force du surinvestissement
d’une action particulière (celle qui correspond à l’activité addictive) par rapport aux autres actions ;
b) la variété correspond à la largeur de l’éventail des actions disponibles dans le système ;
c) la vicariance correspond à la possibilité pour l’individu de substituer telles actions importantes par d’autres actions, si les premières sont rendues impossibles.
Le niveau d’addictivité d’un système d’actions de gestion hédonique, c’est-à-dire la visibilité d’une action de gestion hédonique comme addiction plus ou moins pathologique dans la vie de l’individu, dépendra de la valeur relative de ces trois variables (voir le tableau ci-dessous). Examinons plus en détail ces trois variables.
Tableau V : Niveaux d’addictivité selon les trois variables de base du systèmes d’actions.
Niveaux d’addictivité du système Variables Faible Forte
Saillance
Faible saillance, aucune action de gestion hédonique n’est privilégiée par rapport aux autres.
Forte saillance, une action de gestion hédonique est surinvestie et envahit la vie quotidienne.
Variété
Grande variété, un large éventail d’actions de gestion hédonique est disponible dans la vie de l’individu.
Peu de variété, il y a réduction de l’éventail des actions de gestion hédonique facilement accessibles.
Vicariance
Haute vicariance, l’individu peut facilement substituer une action de gestion hédonique par une autre.
Basse vicariance, il est très difficile, voire impossible, pour l’individu de remplacer une action de gestion hédonique surinvestie défaillante par une autre.
La saillance dans le système d’actions de gestion hédonique se définit comme l’importance et la force de l’investissement de l’individu dans une action de gestion hédonique particulière par rapport aux autres actions de son système. Concrètement, un individu peut acheter du vin à l’occasion des courses d’alimentation hebdomadaires au supermarché. Boire un à deux verres aux repas et peut-être un apéritif en famille les dimanches à midi. L’alcool possède ainsi une place modérée, restreinte dans sa vie et on peut
LA GESTION HÉDONIQUE
113
Tableau VI : Niveaux différentiels de saillance de quelques solutions hédoniques courantes.
Saillance Actions Faible Forte
Sexualité
Faire l’amour ou se masturber de temps en temps, agiter quelques fantaisies sexuelles en voyant une personne attirante, mais accorder encore une grande place à tout le reste : vie affective, familiale, le travail, les loisirs (non sexuels).
Ressentir un besoin sexuel fort et se donner des satisfactions très fréquemment (plusieurs fois par jour), agiter constamment des fantaisies pornographiques dans sa tête, passer beaucoup d’heures tous les jours pour épier des gens, pour trouver des victimes, imaginer des scénarios, des plans et négliger le travail, les relations amicales, d’autres modes de satisfaction.
Cannabis
Consommer du cannabis occasionnellement, au cours d’une fête, sans que cette consommation ne puisse empiéter sur les autres activités (travail, vie familiale, autres loisirs), nonobstant l’interdit législatif en France, portant sur cette consommation.
Consommer du cannabis tous les jours, plusieurs fois par jour, en passant beaucoup de temps pour se procurer la drogue, la consommer et se remettre de ses effets, en négligeant par ailleurs le travail, la vie familiale et amicale, les loisirs, les études.
Travail
Travailler selon les horaires normaux de son entreprise et passer à autre chose en rentrant chez soi.
Travailler en dépassant les horaires normaux, faire de nombreuses heures supplémentaires, ramener du travail chez soi, le soir et les week-ends, ne pas prendre de vacances, négliger sa famille, sa santé.
Sport
Avoir une activité sportive modérée et limitée chaque jour et un entraînement plus poussé chaque semaine.
Consacrer plusieurs heures par jour à l’activité sportive, tous les jours, en négligeant d’autres aspects de la vie et sa santé.
Cependant, les choses sont encore plus complexes, car le caractère intégré ou non intégré d’une action de gestion hédonique ne dépend pas seulement de la nature de l’action elle-même, mais d’autres paramètres et,
A. Introduction En science, un modèle n’est qu’une vue de l’esprit, bien commode pour comprendre les choses, les formaliser, imaginer des processus et finalement poser des hypothèses. A la différence de la religion ou de l’idéologie, le modèle scientifique n’est rien en lui-même. Toute sa validité provient du terrain empirique ou expérimental qui le sous-tend. Le modèle de gestion hédonique est placé entre deux horizons de validation : en arrière, l’horizon des faits empiriques d’observation et des faits expérimentaux touchant aux désafférentations et aux addictions, tant aux plans neurobiologique, cognitif, psychologique, comportemental que psychosocial ; en avant, le terrain d’explorations et d’expérimentations qu’il reste à défricher. Le programme de recherche que nous présentons ci-après concerne donc ce second horizon de découvertes à faire et reste confiné sur un secteur très étroit d’une proposition de recherche expérimentale en hédonologie humaine. Cela signifie à l’évidence, qu’à l’avenir, bien d’autres programmes de recherche pourront être imaginés, pour ce qui concerne l’hédonologie générale et ses multiples déclinaisons (humaine, animale, sociale… voir le glossaire en fin d’ouvrage). Ce sont des activités universelles, qui concernent tous les êtres humains, tout au long de leur vie. Ce sont elles qui nous permettent, en permanence, de nous sentir « bien » ou de lutter contre les tourments qui nous assaillent. Ces activités sont abordées par tous les bouts, comme des addictions, des compulsions, des symptômes psychopathologiques, des phénomènes neurobiologiques ; mais ce serait sans doute une démarche trop ambitieuse (et sans doute aussi trop intelligente) que de considérer toutes ces activités de gestion hédonique sous un principe unique (comme l’a suggéré Goodman – 1990) et dans un modèle hédonologique unifié. Le modèle de gestion hédonique représente cette « démarche ambitieuse » d’unification et de synthèse. Les êtres humains (mais aussi les animaux) n’obéissent pas seulement à des besoins adaptatifs. Déjà, à la base, l’adaptatif est contrôlé chez l’organisme par son « état » qui, au fur et à mesure du développement évolutif du système nerveux central, devient un « état psychique ». Chez les animaux supérieurs (pour l’essentiel les mammifères), et plus particulièrement les primates, le poids de cet état psychique a pris une valeur considérable. Chez l’humain (mais aussi chez les singes supérieurs, chimpanzés et bonobos, nos plus proches cousins), l’état psychique a acquis une sorte d’autonomie. Pour prendre une image triviale, c’est comme si le thermostat qui règle la température de votre appartement, avait soudain pris conscience de son état « thermostatique » et représentait désormais à lui tout seul un élément « à
LA GESTION HÉDONIQUE
145
prendre en compte » et que cet « élément » pouvait désormais avoir ses humeurs, avoir ses besoins autonomes de réglage sur telle ou telle température, indépendamment des nécessités thermiques de l’appartement lui-même. Chez l’humain, il semble qu’il en soit de même. Le vieil « état psychique », destiné au départ à une sorte de synthèse centralisée traduisant l’état global de l’organisme, est devenu un noyau indépendant avec ses exigences propres. Pire, ce noyau d’état psychique peut parfois avoir des exigences qui vont s’opposer au « bien être » même de l’organisme au plan physiologique, comme l’alcoolique, le fumeur de tabac ou le toxicomane, qui consomment des substances psychoactives « bonnes » pour l’état psychique (du moins durant un certain temps), mais toxiques pour le reste de l’organisme. L’autonomisation fonctionnelle de l’état psychique se traduit par un ensemble de besoins et nécessités psychiques que l’on regroupe sous les termes de « gestion hédonique », qui se définit comme « tout ce que font les êtres humains, chaque jour et à chaque instant, pour gérer leurs états psychologiques » ; l’hédonologie étant la science de la gestion hédonique. Le protocole du présent programme de recherche en hédonologie humaine est basé sur une Situation de Base de Micro-Désafférentation (SBMD) contrôlée par ordinateur. Le plan expérimental comporte onze étapes : 1) Démonstration de la dysphorie ; 2) Hiérarchie d’activation des sources hédoniques ; 3) Variété du système d’actions ; 4) Saillance dans le système d’actions ; 5) Vicariance dans le système d’actions ; 6) Systèmes de gestion hédonique ; 7) Stratégies de gestion hédonique ; 8) Écologie de la gestion hédonique ; 9) Économie comportementale de la gestion hédonique ; 10) Genèse et développement de la gestion hédonique ; 11) Gestion hédonique, cognitions et structures mentales. La gestion hédonique est la pièce maîtresse d’une longue lignée. Si l’on suit le modèle de recherche de sensation de Zuckerman (1994), la première pièce correspond aux pulsions exploratoires que l’évolution a donné aux animaux pour améliorer leur capacité à survivre dans un vaste et complexe environnement. Le développement du cerveau (en particulier du néocortex chez les mammifères et surtout les primates, dont l’être humain) a transformé les pulsions exploratoires en un besoin de recherche de sensation.
ÉRIC LOONIS
148
addictions) nous a conduit à mesurer plusieurs variables du système d’actions comme la saillance, la variété et la vicariance ; mais encore, le degré de conflit, le niveau de souffrance psychique, l’avancement sur la trajectoire hédonique, les traits ou dimension de la personnalité et les niveaux d’addictivité comportementale. Une étude qui a comparé des sujets addictés et non addictés (Loonis, Apter, Sztulman, 2000 ; Loonis, Apter, 2000), montre qu’il existe des liens fonctionnels entre les variables de saillance, variété et vicariance. Ainsi, un système d’actions peut être décrit dans le cadre d’un continuum entre un « système d’actions équilibré » (basse saillance, haute variété et forte vicariance) et un « système d’actions déséquilibré » (centré sur une action de gestion hédonique hautement saillante, avec basse variété et faible vicariance). Ces variables ont aussi été corrélées avec la consommation addictive de substances et des variables cliniques comme la dépression et l’anxiété. Ci-après nous allons détailler le protocole du programme de recherche en hédonologie humaine, selon ses onze étapes, en définissant et expliquant à nouveau ses principaux concepts et variables.
B. Le protocole du programme La situation de base de microdésafférentation Ce présent programme de recherche s’inspire des expérimentations d’économie comportementale qui utilisent un ordinateur pour créer une situation expérimentale et pour contrôler l’étude (Herrnstein, Loewenstein, Prelec, Vaughan, 1993). Toutes les expériences proposées sont basées sur la Situation de Base de Micro-Désafférentation (SBMD) qui peut être décrite ainsi : le sujet volontaire est seul dans une pièce nue, aveugle et insonorisée, avec un éclairage doux et contrôlé, une température ambiante optimale. La pièce est suffisamment spacieuse pour éviter tout sentiment de claustrophobie. Le seul ameublement de cette pièce est une petite table et une chaise confortable. A côté de la table, l’unité centrale et le clavier de l’ordinateur sont dans une boite opaque et fermée (ou bien hors de la pièce), le moniteur et la souris étant sur la table à l’usage du sujet. Une vidéo ou un autre dispositif sont installés pour enregistrer toutes les « activités hors protocole » (voir plus loin). Enfin, le sujet peut lire blanc sur noir un message sur l’écran du moniteur : « Patientez un moment, s’il vous plaît… ». Et rien d’autre ne se passe dans la situation de base de microdésafférentation. Le but de la SBMD est de placer l’individu dans une situation où il ne trouvera aucune stimulation spécifique. La SBMD n’est pas comparable à la situation classique et extrême de privation sensorielle (silence absolu,
LA GESTION HÉDONIQUE
149
obscurité, tubes cartonnés pour isoler bras et mains du toucher, immobilité, etc.). La SBMD est plutôt une situation de type salle d’attente, où les gens sont désœuvrés, où il n’y a rien d’intéressant ou d’excitant à percevoir ou à faire et où l’ennui est le premier sentiment qui apparaît. Dans la SBMD des instructions minimales sont nécessaires : en premier, l’individu peut librement quitter la SBMD à tout moment selon son besoin (c’est la clause d’éthique, mais ce départ interrompt, bien entendu, l’expérience) et il peut faire tout ce qui peut être fait normalement dans une salle d’attente (par exemple, attendre tranquillement assis, ou se lever, se déplacer, marcher en rond, parler seul et ainsi de suite ; ce que nous appelons des activités hors protocole) sauf de porter atteinte aux meubles et aux composants de l’ordinateur et d’utiliser d’autres sources de stimulation (comme un livre, un magazine, un baladeur musical, un téléphone mobile, etc.). Sauf si le protocole expérimental en décide autrement, le sujet est aussi invité à s’abstenir de ses addictions habituelles, comme fumer une cigarette, boire de l’alcool, ou se masturber… Le sujet est autorisé à utiliser la souris de l’ordinateur si un message ou des événements sont vus sur l’écran du moniteur (tous les sujets ont appris à utiliser une souris d’ordinateur). Enfin, le sujet est informé que l’expérimentation durera tant de minutes (par exemple, 30 minutes).47 A partir de cette situation, l’opérateur peut manipuler la présence ou non, le nombre et la variété des sources de gestion hédonique, qui apparaissent comme des icônes à activer avec la souris sur l’écran du moniteur. Chaque icône ouvre sur une source de stimulation (par exemple, une énigme à résoudre, la pensée du jour, un jeu vidéo, un film vidéo, des images érotiques, des articles de magazine à lire, des animations, des sons, de la musique et ainsi de suite). Les sources de stimulation peuvent être contrôlées, à la fois dans leur contenu, et dans leur durée. Dans le cadre de la SBMD et de ses instructions de base, l’ensemble des expérimentations du programme de recherche en hédonologie humaine prennent place.
1. Démonstration de la dysphorie La dysphorie qui apparaît chez les individus dans une salle d’attente, durant un voyage (en train, en avion ou en voiture comme passager), ou dans d’autres situations de désœuvrement, est évidente. Cette dysphorie a bien était confirmée par les expériences de privation sensorielle (désafférentation), cependant, la recherche sur la gestion hédonique a besoin de produire une « ligne de base » pour ce qui concerne la dysphorie. 47 Cependant, certains protocoles pourraient prévoir, avec l’accord du sujet, une durée indéterminée pour le sujet.
Glossaire hédonologique Ce présent glossaire est destiné à définir d’une façon précise et pratique un certain nombre de concepts que nous sommes et serons amenés à utiliser dans le cadre d’une hédonologie. Le lecteur ne trouvera ici, la plupart du temps, que de simples définitions, étant renvoyé pour les détails et références au corps du texte ou à nos autres publications. Une traduction anglaise (en italiques entre parenthèses) des termes de ce glossaire est destinée à inaugurer la dimension internationale de l’hédonologie.
– A –
ACTION (action) – Action désigne la fonction hédonique des activités*.49 Le principe (ou loi) de la double fonction des activités, pose que toutes les activités humaines possèdent deux fonctions, pragmatique* et hédonique*. La fonction hédonique sert l’adaptation à soi-même, par l’accès et le maintien d’états psychologiques positifs (activation* ou sédation*, plaisir*, joie, euphorie, quiétude, etc.). Le terme d’action peut être précisé en disant action hédonique ou de gestion hédonique*, bien qu’il s’agisse d’un pléonasme. ACTIVATION
(arousal) – L’activation est, avec la sédation*, l’un des deux moyens par lesquels une action* remplit sa fonction hédonique*. L’activation est considérée à la fois sur les plans physiologique, neurologique et psychique. Le terme d’excitation est un équivalent de celui d’activation. ACTIVITÉ
(activity) – Activité désigne la fonction pragmatique des activités. Le principe (ou loi) de la double fonction des activités, pose que toutes les activités humaines possèdent deux fonctions, pragmatique* et hédonique*. La fonction pragmatique sert l’adaptation au monde physique, social, culturel, informationnel, économique (se vêtir, manger pour vivre, travailler, s’informer à la télévision, lire journaux et livres, faire ses courses, rencontrer des gens, etc.). Le terme d’activité peut être précisé en disant activité pragmatique, bien qu’il s’agisse d’un pléonasme.
49 Les termes suivis d’un astérisque renvoient à d’autres entrées du présent glossaire.
ÉRIC LOONIS
178
ACTIVITÉ ADDICTIVE
(addictive activity) – Le passage conceptuel des consommations addictives de substances psychoactives aux activités addictives, marque l’ouverture du concept d’addiction* vers les addictions comportementales*. Activité addictive renvoie donc à une généralité, celle d’activités qui sont marquées par l’addictivité*, par exemple, avec des phénomènes de manque*, de tolérance*, de perte de contrôle*, de saillance* dans la vie quotidienne, de rechute*, etc. Une activité addictive peut donc consister à consommer des drogues, de l’alcool, ou bien se masturber, jouer de l’argent, travailler, regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo, grignoter, etc. ADDICTION
(addiction) – Le concept d’addiction renvoie à plusieurs définitions qui varient dans leur extension selon les modèles de référence. En hédonologie*, c’est une conception large qui est retenue, addiction étant donc équivalent à action* (de gestion hédonique*). On range les addictions sur un double continuum, déterminé par deux axes orthogonaux : l’axe du type d’addiction qui part des addictions directement psychotropes (les consommations de substances psychoactives) jusqu’aux addictions indirectement psychotropes (les addictions comportementales* et les consommations de substances non psychoactives, qui agissent indirectement par la stimulation de la libération des drogues endogènes*) ; le second axe, dit de la sévérité de l’addiction, part des addictions de la vie quotidienne* (en fait toutes les activités humaines selon leur fonction d’actions hédoniques) jusqu’aux addictions pathologiques*, facilement reconnaissables de par leur caractère extrême (alcoolisme, toxicomanie, jeu pathologique, délinquance sexuelle, achats compulsifs, vols à l’étalage, meurtres en série, etc.). Les addictions sont au faîte de la lignée évolutive des comportements animaux, puis humains, qui s’enracinent dans les pulsions exploratoires* et la recherche de sensation*. ADDICTION COMPORTEMENTALE
(behavioral addiction) – L’addiction comportementale (ou procédurale*) regroupe l’ensemble des activités et comportements addictifs hédoniques ne consistant pas à consommer des substances psychoactives. Le principe de l’addiction comportementale consiste en ce que le comportement fournit à l’individu qui le réalise, un ensemble de stimulations (par exemple, psychomotrices, sensorielles, proprioceptives, intellectuelles, émotionnelles, etc.), stimulations qui, en dernier ressort, ont une action cérébrale et psychique par l’intermédiaire de la libération de drogues endogènes*. L’addiction comportementale s’inscrit bien dans la ligne du concept d’activité addictive*.
LA GESTION HÉDONIQUE
179
ADDICTION DE LA VIE QUOTIDIENNE
(everyday life addiction) – Le concept d’addiction de la vie quotidienne s’inspire de celui de psychopathologie de la vie quotidienne forgé par Freud pour désigner ces éléments de psychopathologie qui apparaissent à bas bruit, dans la vie de tout un chacun (actes manqués, lapsus, petites obsessions, peurs, inhibitions, etc.). Dans le cadre d’un concept élargi d’addiction*, tel que considéré en hédonologie*, les addictions de la vie quotidienne consistent en l’ensemble des actions* hédoniques répétitives, communes, qui permettent à l’être humain de s’occuper, de passer le temps, de se nourrir de stimulations, finalement de gérer son hédonie*. On peut dire que toutes les activités* humaines sont des addictions de la vie quotidienne, mais on conviendra de réserver le terme à des actions hédoniques répétitives peu saillantes*, relativement équilibrées les unes par rapport aux autres, ce qui les distingue des addictions pathologiques*. ADDICTION PATHOLOGIQUE
(pathological addiction) – Les addictions pathologiques s’opposent aux addictions de la vie quotidienne* par leur caractère massif, envahissant et entraînant de multiples conséquences* négatives. Un système d’actions* de gestion hédonique* fortement saillant*, avec une faible variété* et peu de possibilités de vicariance*, correspond à une addiction pathologique. En plus des consommations abusives de substances psychoactives (drogues, alcool, tabac, médicaments psychotropes), la plupart des activités* humaines peuvent donner lieu à addiction pathologique (jeu pathologique, délinquance sexuelle, achats compulsifs, vols à l’étalage, meurtres en série, prises de risque, recherches de sensations fortes, transgressions, etc.). ADDICTION POSITIVE
(positive addiction) – On désigne par addiction positive le caractère bénéfique et constructif de certaines activités* faisant l’objet d’un investissement plus ou moins soutenu, sur des périodes plus ou moins importantes. Il s’agit d’addictions* du fait de l’investissement au quotidien et de la valeur hédonique de telles activités, mais de plus, ces addictions permettent l’accroissement des compétences individuelles, des apprentissages, des savoirs, ce qui peut, en retour, entraîner un bénéfice collectif. Par exemple, les passions pour l’art, la science, le sport, les études, certains métiers de la création, du social, etc., par un entraînement et investissement quotidiens, font le grand artiste, le grand scientifique, le grand sportif, permettent d’atteindre de hauts niveaux de formation, d’apporter à la société les bénéfices de son art, de ses travaux, de son activité. Le concept d’addiction positive est destiné à contrebalancer une vision trop étroite des addictions, uniquement cantonnée au registre de la pathologie ; il renvoie à celui de « sublimation ».
LA GESTION HÉDONIQUE
209
– V –
VARIÉTÉ
(variety) – La variété est l’un des paramètres du système d’actions* de gestion hédonique. Elle se définit comme la largeur de l’éventail des actions de gestion hédonique* disponibles dans le système. Le niveau de variété du système d’actions est inversement lié au niveau de sévérité de l’addiction*. VICARIANCE
(vicariousness) – La vicariance est l’un des paramètres du système d’actions* de gestion hédonique. Elle se définit comme la possibilité pour l’individu de substituer telles actions* de gestion hédonique* importantes par d’autres actions, si les premières sont rendues impossibles. Le niveau de vicariance du système d’actions est inversement lié au niveau de sévérité de l’addiction*. VULNÉRABILITÉ HÉDONIQUE
(hedonic vulnerability) – La vulnérabilité hédonique comprend l’ensemble des facteurs susceptibles d’entraîner une défaillance hédonique* chez l’individu. La vulnérabilité hédonique se compose de : 1) l’acquisition (familiale et micro ou sub-culturelle) de certaines dominances métamotivationnelles ; 2) les différences individuelles dans l’expérience de la tonalité hédonique et de l’activation* ; 3) la pauvreté des compétences dans la gestion hédonique* ; 4) les bas niveaux de tolérance* à la frustration ; 5) les carences émotionnelles de l’enfance générant une sensibilisation hédonique ; 6) les différences individuelles en termes de personnalité* et de tempérament ; 7) les facteurs actuels, sociaux, économiques et culturels.