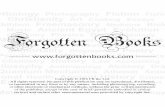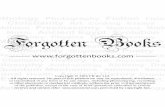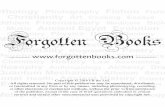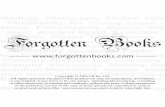R E V U E - Forgotten Books
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of R E V U E - Forgotten Books
REV U E
d e
P H O QN É T I U EÏ
PU BLIÉE PAR
l’
Abbé ROUSSELOT et Huber t PERNOT
T O M E DEU X I È ME
PAR I S
2 3 , RUE DES FOSSÉS—SA INT-jACQ UES , 2 3
Kouriles du sud et l’
extrémité
méridionale de Sakhal in (fig .
Ils font l’
ob jet de grandes
discussions parmi les ethnolo
gistes2
.
Le premier , La Pérouse a
recuei l l i quelques mo ts de leu r
langue, Voyages de La Pérouse
autour du monde, Paris , 1 797
Vocabu laire des hab itans
dans son Dictionnaire amo— russe
(Kazan,1 87 5 ) tou s les g los
saires particu l iers qu i ava ien t
été faits avant lu i . Le fasÂ
cicule des Mémo ires de l’
UniFIG . 1 . Kane/catoka (A) .
versrte de Tok io est un i que
1 . Élisée Rec lus , Géog r . , VI , p . 844 , 86 3-864 ; VII , 749
—
7 5 7 . Revue de
Géog r . ,t .XXV ( 1889 , ju i l p . 22-24 , 9 5
—
96 .
2 . Revue d’
Etlmog raphie, VI I (sept—od . p . 449—4 5 4 . Revue d
’
Anthro
polog ie, XVI I , p . S I - 89 ; XVI I I , 1 29— 14 1 .
Me'
m . du Cong r . int. des Or ient.
(Paris, p . 19 5 et suiv .
6 L’
ABBÉ ROU SSELOT
ment consacré à la langue, à la grammai re et à la bib l iograph ie
des Aïnos
Le Rev . john Batchelo r, après un sé jou r pro longé chez les
Amos, a publ ié dans les Transac tions of Asia tic Society of ]apan
(t . V,an . au Ainu Vocabulary , pu i s dans le même recuei l
FIG . 2 .
N upetkano (D) , Anretuku (C) , S i rambeno (B) , (E) .
(t . XIV, an . an a inu eng lish—japanese Dictionary, dont i l a
donné une 2° édition à part (Tok io ,
Enfin, unPo lonai s , M . Pi l sudsk i , qu i a passé d ix-hu i t ans2
1 887
1 90 5 ) dans les î les Sakha l in et de Yeso et s ’est famil iarisé avec les
langues des G i l iaks,des O roks, ces proches paren ts des Aïnos, et
cel le des Aïnos eux—mêmes , a rassemblé de nombreux documentssur les mœu rs , la l i t tératu re o ra lede cepeup lemy stérieux . I l a déj à
1 . Memoi r s of the li terature College, Im per ia l U n ivers ity of Japan I (Tôkyô ,
2 . Sur ces 1 8 années M. Pi lsudsk i en a passé 1 5 en ex i l . 11 n’
est restéque 3 m o is à Yéso .
PHONÉT IQUE DES AÏN OS 7
publ ié quelques art ic les de s tatis tique,de géograph ie et d
’
ethno
logie Mais , avant de l ivrer ses textes , i l a vou lu s’
entendre
avec m o i pou r l ’établ issemen t d’
un a lphabet phonétique.
PIG .
Territo ire des Aïnos .
I l comprend les par ties om brées de la carte.
1 . La stat ist ique des Aïnos de S aghalin et leur s i tuation économ ique (Bull .de la Soc . de Ge
'
og r . de Vlad ivostok,
le Sham anism e chez les Aïnos (Globus
, les aborigènes de l’ î le de Saghalin 1909 ) la fête de l’Ours
chez les Aïnos de Saghalin la grossesse et l ’accouchement chez lesG i l iaks et les Aïnos (Anthropos, les s ignes de propriété chez les Aïnos
8 L’
ABBÉ ’
ROU SSELOT
Q uand i l v int m e vo i r,51 la rentrée de 1 909 , i l m
’
apporta ,
avec les textes recuei l l is et no tés par lu i , des cy l indres de phono
graphe qu ’ i l avai t fai t graver par les indigènes de Sakhal in .
J ’
avoue que je n’
en pus r ien ti rer et que j’
en fus rédu i t àtranscri re la prononciat ion même de M . Pi lsudsk i . Natu rel lement , el le ne m
’
inspira it que peu de confiance et je ne d issimu lai
po in t le regret de n ’
avo i r pas sou s la main quelque Ain0, que je
pusse écou ter et au beso in soumet tre à mes expériences . Cette
bonne fortune, sur laquel le je ne compta is guère,deva i t se pré
senter .
On o rganisai t a lo rs à Londres une expos i t ion anglo- japonai se,et un vi llage d’
Aïnos figurai t au programme. I l fut convenu que
nous irions à Londres .
M . Pi l sudsk i s’
y rendi t dès l’
ouvertu re de l’
exposi t ion et y
resta jusqu ’à la fin . I l y trouva d ix Aïnos qu i vivaient dans le
cadre art ific iel,ma is auss i fidèle que poss ible, de leu rs propres
vi l lages,occupés à leu rs petits travaux habituels . I l fu t bien vite
leur am i assidu et i l pu t compléter ou revo i r les 300 textes dont
i l dispose et son d ict ionna i re riche de mo ts , don t plu s de
n’
avaient pas enco re été recuei l l i s .
Pou r m o i, je dus attendre jusqu ’à la deux1em e qu inzai ne
d ’
aoû t . ]’
eus l ’avantage de n’être pas seu l . M . Chlum sky vou lu t
b ien m’
accompagner , ce qu i doubla la réco l te, car je pus m e
décharger su r lu i du so in des apparei ls . En ou tre je trouvai
en lu i un contrô le de m on o rei l le pou r les cas d iffici les .
j’
avais fait transformer m on enregist reu r à resso rt en vue de
le rendre plu s portat if. Pou r cela,j ’avais supprimé tou t bâti en
fonte,et ent ièremen t modifié le chario t à l ’ im itation de celu i du
Laborato i re. L’
apparei l , d ivisé en deux , é ta i t d’
un transport et
d’
un man iement très faci les (fig . ]’
y ava is a jou té un phono
(Rw . d’
Etlm . etde Soc .
,M. Pi l sudsk i est en train d
’ imprim er son tra
va i l sur le fo lk lore des Aïnos avec textes et rem arques , qu i sera publié dansl ’année par l
’
Académ ie des Sc iences de Cracovie.
PHONÉTIQUE DES AIN OS9
graphe Ed i son,nouveau modè le. Quan t aux accesso i res , vern is,
god i va, etc .,nous comptions les trouver sans peine à Londres .
F IG . 4 .
Apparei l enreg istreur .
Le cyl indre et le char io t , porteu r des tam bou rs , sont ac tionnés par le m ême m ouvement d
’
hor loger ie . U ne pou l ie à plus ieu rs gorges règ le les déplacem ents du chariot . Le
cyl indre,recouvert d ’
un pap ier noirc i à la fum ée d ’
un rat-de—cave, reç o i t la trace de
leviers qu i rep rodu isent les m ouvem ents transm is aux tam bou rs par les apparei ls récepteu rs . C ’
est à savo ir,dans l ’expér ience figu rée, une em bouchu re pou r recuei l l i r le
souffle avec les vibrations , une o l ive qu i prend l ’a i r dans une nar ine,
et u ne capsu lequ i va chercher su r le thy roïde les vibrations du larynx .
Nou s les avons trouvés en effet , mais mo ins faci lement que
nous ne pens ions .
Grâce à une. let tre de recommandat ion deno tre chargé d’
af
fai res,en l ’absen ce de l
’
ambassadeu r de France, tou tes faci l i tés
1 o L’
ABBÉ ROU SSELOT
nous fu rent acco rdées pour notre travai l . M . H ideatsu Yosh ida,
propriétai re de l’
Ainu H ome,nous amenai t lu i—même les Aïnos
à no t re hôtel , que nou s avions cho is i dans le vo is inage. La m ai
tresse d ’
hôtel ne se mont ra pas mo ins complaisante el le mit à
no tre d ispos i tion la grande sal le de son établ issemen t et nous
avions a ins i un splend ide labo rato i re.
Tou s les momen ts l ibres des Aïnos nous é taien t consacrés .
Pendant les séances qu i é ta ient dues au publ i c de l’
Expos ition ,
nous nou s rend ions au vi l lage ; et là , so i t en c i rcu lant,so i t
debou t à la po rte des cases , so i t à l’ intérieu r assis sur un bi l lo t
de bo i s, je recuei l la is les noms des ob jets famil iers aux Aïnos
,
que j’
avais sous les yeux . M . Pi l sudsk i é tai t le plu s souven t pré
sent, mais pas tou jou rs , pou r me serv i r d ’
interpréte . I l en est
résu l té qne j’
ai recuei l l i un certa in nombre de mo ts qu ’ i l nereconnaî t pas , et que j
’
a i eu d ’
abord l ’ in ten t ion de supprimer . A
la réflexion, je les conserve ; mais comme i ls m e sont suspects
so i t dans leur form e,so i t dans leu r traduction, je les marque d
’
un
astéri sque. En plus des mots iso lés , j’
ai recuei l l i quelques phrases
et des textes su iv is qu i m’
étaient réci tés lentement . C ’
est ainsi
q ue je m e renda is compte des expériences à fai re.
J’
ai t rouvé auprès des Aimos l’
accuei l le plus sympath ique. I ls
sont doux , confiants, empressés à fai re pla is i r . Une seu le fo is ,
j’
ai rencontré de la résistance. M . Pi lsudsk i demandai t à une
jeune fi l le son chant d ’
amou r (toute jeune Ai no compose el le
même son chant d ’
amou r pou r son fiancé) . A nos ins istances
el le opposa d ’
abo rd des larmes ; pu is el le fin i t par déclarer
qu ’
el le ne pouva i t pas le chanter devant des hommes de son
pay s . Ceux-ci so rt i rent,et el le s
’
exécuta avec la mei l leu re grâ ce.
J ’
aurais pu profi ter de neuf su jets . En réa l ité , je n’
en ai u t i l isé
que sept,
une femme étan t malade,
et un des hommes,
jaloux des préférences de M . P i l sudsk i pou r les au tres,ayant été
presq ue la issé de côté a ins i qu ’
un enfant . I ls sont tous de l ’ i le de
Yéso
PH ON ÊTIQ UE DES A 1NOS
A. Un homme de 6 5 ans , bel le barbe blanche (fig . 1) S i ramoura (en j apona is) , K aneka z
‘
oku (dans sa langue) , né à Piratorou ,
sur la riv i ère Sarou (c’
es t le vi l lage le p lus connu) .
B . 46 ans,c ’étai t le chef Ka iÊaoa (nom japonais) , S irambeno
(dans sa langue), né à N iptani su r la même rivière (fig .
C . 4 3 ans , la femme du chef,Anretuku , du même vi l lage que
son mari (fig .
D . S ie'
(nom N upetkano, jeune fi l le,n ièce de la femme
du chef, leu r fi l le adoptive,de 1 8 à 20 ans (fig .
E. 10 ans,neveu de la femme du chef et leu r fils adoptif
,
Ka iÊaua (nom Êe'
nski (nom chrét ien) ; i l est pet it—fils d’
un
japonais (fig .
F . 26 ans,bel le barbe no i re
,cou sin du chef et du m ême vi l
lage K ênj i (nom Motasnu (dans sa langue) .
G . Un au tre homme.
H . Une femme, 5 3 ans
, N uka teki,du vi l lage de Mom bet sur
la rivière du mêm e nom .
Ils par lent tou s le même dialecte .
Les Aïnos son t très b ien de leu r personne : on les prendra i t
pou r des pay sans ru sses . Ils sont tous dotés de bel les barbes ,objets de la ra i l lerie des Jaunes et de l ’envie des femmes , qu i se
donnent,au moyen d
’
un tatouage bleu ,l ’ i l lu s ion de bel les
pai res de moustaches .
Je n’
a i fai t de pa lai s artifi ciels que pou r A,B,D
, qu i s’
en son t
bien vi te servis avec une grande habi leté .
Les inscriptions à l ’enregistreu r ne comportaient que deux tambours (fig . l
’
un pou r la bou che, l’
au tre pou r le nez . Je faisais
1 . J’
ai souvent ind iqué la m aniere de fa ire so i -m êm e ces petits apparei lsprise de l ’em preinte du pa la is avec le god iva (substance emp loyée par les dent istes) , appl ication su r le m ou le d ’
une feu i l le de pap ier fi ltre m ou i l lée, d ’
une
couche de seccotine et d ’
une seconde feui l le de papier fi ltre, que l’
on estam pe
bien avec les do igts . Ma is, je do is a jouter un perfect ionnement que je ne cro is
pas avo ir encore ind iqué quand le pala is est sec , quand les part ies inut i les ontété supprim ées , on étend dessus , avant de le vern ir, une so lution de caoutchouc .
1 2 L’
ABBÉ ROU SSELOT
répéter le même m ot ou la même phrase un grand nombre de
fo is à chaque su jet,ce qu i m e procu rai t des variantes intéres
santes et m e servai t pou r le contrô le.
Quand l’
eXpérience ne rou lai t que su r quelques mo ts, je
n’
avais au cune d ifficu l té à les fai re d ire co rrectement . Mais,quand
i l s ’
est ag i de textes su iv is , même des chant s q u i sont répétés de
mémo i re, je ne pouvais obten i r deux fo is de su i te la même
F IG . 5 .
Tam bour 1nsc ripæur .
Je donne i c i pour la prem i ere fo is u n c roq u is des pet i ts tam bou rs que em ploie d ’
o r
d inai re, m a is non tou jou rs , au jou rd ’
hu i pou r l 'enreg i strem ent des vibrations de la vo ixet du larynx . D imens ions de la cuvette A : 1 5 mm . de d iamètre,
1 mm . de p rofondeur .
Caou tchouc non tendu , de'
mm . d’
épa isseu r . Pet i t support en la iton D . Levierfo rm é d ’
une seu lepa i l le E ; g rand bras 1 2 3 mm . peti t b ras U ne seule v i s C perm et d
’
approcher ou d’
m c liner à vo lonté la cuvette. L ’
a i r est por té au centre de la m em
brane par un tube servant de t ige B . Le levier es t fixé à u n suppo rt F q u i entre en frottem ent du r dans un b loc mob i le su r la tige où i l est m aintenu par u ne v is G . \
’ i ro leavec sa v is H .
chose. La lectu re des tracés devena i t a lo rs fo rt d iffici le, s inon
dans beau coup de cas impossib le. Alors j ’eus recou rs à la doubleo o 0 r
1nsc r1pt10n avec l enregœtreur qu i fou rn i t les élements de l ana
lyse et le phonographe qu i m e donna i t le son .
Je ne pu is pas m e fiatter,dans les hu i t jou rs que nou s avons
passés auprès des Aïnos , d’
avo i r,malgré un t ravai l sans rel âche
épu isé la matière mais je cro is que no us avons recuei l l i le prin
c ipal .
PH ONÉT IQUE DES AÏN O S 1 3
VOYELLES
Les voyel les son t a,e,i,o,u .
J’
ai no té enco re accidentel lement u et ce.
L’
u est une variante de i dans suk (F) œ i l pour sik . J’
ai
entendu suk et sik d ’
une même bou che (D) .
Cette voyel le que j’
ai d ’
abo rd prise pou r un u,n
’
en est pas un ,
car je n’
ai pas vu les l èvres se fermer el le se rapproche durusse. C ’
est la langue qu i do i t se porter en arrière et a l térer le
son sans que le su jet parlan t , qu i veu t prononcer un i,en ait
conscience. Ces réflexions n’
on t été fai tes qu’
à m on retou r .
M . Pi lsudsk i , consu l té sur ce su jet,m e répondi t de Londres
l’
i est t rès souvent du r et se rapproche du Dans si/e,m o i
j ’en tends i
L’
æ se présen te dans nocepôro (F) fron t comme une a l téra
tion de ’
é noyejbo'
rô (G) .
L’
o et l’
a,dans les fina les atones, ne sont pas tou jou rs b ien dis
t incts et s’échangen t en t re eux. Le nom d’
Aïno par exemple, que
nous écrivons ai nsi, est a inu (a inu) pou r Bat chelor et d
’
au t res .
Mo i—même à quelques secondes de d istance j’
ai transcri t a ino et
a inu (B), nànofu et nano/‘
à (D) laver le visage inaoet inau
(B) , inao (B) baguet tede sacrifice Batchelo r écri t inao, M . Pi l
sudsk i inau . J’
ai c ru entendre d ’
abo rd makir i notako (F) lame de
cou teau pu i s j’
ai effacé l’o final pour mett re et . J’
ai écri t de
même sineotoj>to un cheveu et sinere‘
ktu po i l de barbe à
côté l’un de l ’au tre (F) . M . Pi lsudsk i,consu l té à cet égard m e
répond que les Aïnos réclament sineotoptu et m e d it que’
étymo
logie leu r donne ra ison . Mais j’
ai observé que les 0 de M . Pi l
sudski sont trop aigus . Et je cro i s p lu tôt à un et a igu très vo isin
de’
à grave. La l imite qu i sépare les deux est faci le à franchi rdans la prononciat ion et
,d ’
au tre part, l’
auditeu r , qu i ne possède
pas cette nuance, est porté natu rel lement à classer c et a tantôtparmi les 0 tantôt parmi les u .
14 L’
ABBÉ ROU SSELOT
L’
i de la d iphtongue a i se rapproche de même des e. Peu t -êtresera i t— i l un i grave. Tou jou rs est— i l que j
’
ai no té à deux jou rs ded istance a ijup et ae
,c“
up (A) roseau Batchelo r écri t a isbup. I l
do i t no ter de même, je pense, ce que j
’
ai écri t ae’kênsi (A) rai
nu re Cette t ransfo rmat ion de la d iphtongue a i est normaleel le s
’
est produ i te, par exemple, en latin et en frança is .
En dehors de ces quelques cas,les voyel les ai
‘
nos restent
stables dans leu rs famil les respectives , mais avec des nuances
t rès variées . El les possèden t des t imbres analogues à ceux des
voyel les françaises t ro is po ur a e 0,deux pou r i u . J
’
ai
donc no té à grave (fr . pa r) , a moyen (pa tte) , a a igu (paris ien
pa r t) ; é grave, 1: moyen,aigu ; o a igu (fr . bord) , 0 moyen
(botte) , grave (beau) ; i moyen . i aigu ; et moyen (boutei lle),ri grave (boue) .
Dans certains 111015 le t imbre de la voyel le parait fixe. Ains i lem or âep po isson que j
’
a i rencontré une d iza ine de fo i s,iso l é
et dans les textes,a constamment son e moyen fos j ambière
a de même conservé tou jours son a moyen pour tous les su jets .
Parm i les différences de t imbre relevées , quelques-unes seraien t
peu t— être d ialectales, je veux d ire propres à certaines fami l les ou
à certains i nd iv idus, par exemple klé barbe (F) et tlëk (D) ,
inuyè tatouage (F) et inuye (C ,D) ; ipe
‘ manger (A) et ibe
ou ipe(B ,F) ka rapto sakhaline (A) et ka râpto(F) ; makta (A)
et niakra (F) . Ma is la p lupart para issent l iées à la vi tesse de laprononciat ion,
à l ’accent du m ot ou de la phrase. El les se pré
sen tent dans la même bou che comme simples varian tes kémàsapet bémâ sak (F) chevron ipe
‘
et ipe manger (A) ; ota'
pi
cheveux et otopibi (G) , o'
topibi (D) kaka corde de l ’arc et
kuosoro bas de l ’arc (A) ; tcîma co l l ier et keine tama col
l ier de fer (D) , etc .
Je n’
ai pas rencon tré de d ist inct ions de t imbre l i ées à des diffé
rences de sens , comme dans le français pâ te et pa tte.
Vo ic i des exemples des d ifférents t imbres que j’
ai notés
PHONÉT IQUE DES AÏN O S 1 5
a . k usapaa tête de l ’arc (A), kam i le D ieu
(A,B) ; pi raleka sanda le am ongle (C) parate
‘
ke
main (D) ; fu la odeu r (E) ; sabina t raverses (F) ,
parateke main (F) ; sikkubobo paupière (G) ; pendrameîpoi trine (H) . C ’
est le t imbre o rd inai re de l’a
a. s’
âniku a rc e'
inusa pm â partie descendante de lacourro ie de l
’
arc laeirbsayçî part ie du manche du cou teau deMasse pa ta d
’
un co in à l ’au tre (A) ; burcî odeu r (B) ;
pâ rdtêk dos de la mai n *se
‘
ur isdpa cou ku sapâba m a
tête sdPamuye‘
co iffu re si to—opera spatu le tara ban
deau pour porter sur la tê te ydra bassin en écorce i tatc'
zni
hacho i r (C) ; tdrna co l l ier cim ip robe am iptusa
manche kisâ ra o rei l le notaka rni joues (D) ; sapatète kuâ bâton tr ikânz mon tant d ’
une charpente »,
*kitayomoni faite (F) ; fura odeu r (H) .
pone rnakani bo is de la flèche (A) ; a ioinc‘
z kàmuy
(B) ;*1nakonaamunirn bras sackoÇ jamb1eres d
’ été sikara
karabê j ambières fa i tes par m o i (C) ; êàpàmuye bandeau
nànofu laver le v isage (D) ; as ê tre debou t »,kukonnispa
mon maî tre na t te sikràbobo ci ls
retàrasiknumibi b lanc de l ’œ i l ràrôbo sourci l (G) .
e. pet r iv ière tambe celu i— c i ke et nep ki r ien
faire (A) ; endramû po i tr ine ane ine étai t et renueva
les tro is êep po isson (B) ; askepet do igt paæyebe
lèvre notkevebe mâcho i re (C) ; sine tâma co l l ier de
perles *opususke lobes de l ’ orei l le (D) ; penlarnubu po i
trine (E), parateke ma in askebet do igt tek bras
tekukoti po ignet tekurägane bracelet sineotopto un che
veu pendam po i t rine urebe pied urePet do igt de
pied (F) ; e'
renni rat (H) , elù nez (P)e‘
. kieër iotop p ipe curé rouge e‘
rernü rat (A) ;ibe
‘ manger (B) ; rèkibi b arbe te‘
kukol po ignet sêu r i
sapa cou êtupu ike narine sinuye‘ tatouage pe
’
ra un
1 6 L’
ABBÉ ROU SSÉLOT
plat (C) ; ke‘
et tékuñkane bracelet para télæ ma in
tlék barbe êbi ta tou t furè rouge (D) ; bu rê rouge
(E) ; ipë manger nipèsa ratika corde de t i l leu l inaye
o rnements (F) ; rêki ln’
barbe kzmnësiknum ibi pupi l le
de l ’œ i l (G), ce‘
ppa garde (H) .
e'
. tu étaye' viser
,ti rer e
'
mucni bo i s du manche to ne'
kane'
sorte d’
anneau Çe'
pa garde oyuspe‘
ouverture
leieér i pipe umpe' baleine ipe
' manger 6bm beré
courber irécpa ine m’
élevaient et -ké et (à côté de-be) , nuy_
é dessina i t (A) ; ven. mauvais koeramc‘unin
méchan ts iere'
ka m e nou rrissai t (B) ; okkéve nuque
(C) ; tre'
k barbe yoéraégere merc i e'
tu po inte anéÂane
fi l de fer (F) re’
tàrasiknumibi blanc de l ’œ i l éteibu nez
(G) .
i . ka r imba l ien en écorce de prunier silc œ i l
sir ika fourreau ukoraî i le même etc . (A) ; nupur i m on
tagne f a l/z i tuer etc . (B) ; sittok coude notkir i m en
ton etc . (C) ; niñ/za ri boucles d ’
o reil les kisâ ra o rei l le
amip robe etc . (D) ; fumi bru i t (E) ; s°
içî œ i l
cubki pai l le silei bambou c i laki coude patôi
l èvres nimak den t etc . (F) ; o'
tôpibi cheveux (G) .
Tous : a udi feu (pou r l’
i final) , ananike vivai t et
excepté A,
‘osibz
'
au retou r (le 1er i) pir ika bien
,bon
(m ot prononcé bien souven t et par tous les su jets) .
z .
‘osibi , yapi frère aîné yoyleir i arranger lei fai
sai t (A) ; koerorneunin méchants koyki battre (B) ;leisaraba o rei l le e
‘
tupu ike nar ine am ip robe (C) ;oto
'
bi cheveux (F) . Tous,sauf D et E
,Eosibi au retou r
furni bru i t (ne cons idé rer que l’
i final)0. osoro le bas ikayop carquo is prækaoni at taches
du carquo is puetotta boî te pou r les al lumettes tâmbako
tabac akoro m a etc . (A) ; koro ayant kotan la
terre parauna beaucoup etc . (B) ; pokna patoye l èvre infé
PHONÉT IQUE DES A1NOS 17
rieure etc . (C) ; poiêeppa médai l lon port é au cou sorno
non etc . (D) ; kitâyornoni fai re kokkasap genou
nouakt lame etc . (F), otopibi cheveux (G) .
Tous -pou r l’o cosibz
'
,
Cos jam b1ere
l
o. tasirô cou teau de chasse kâ ntb ciel sa]>ô sœu r
aînée (A) ; oyamÔkte admirer oto'p cheveux noæbôro
front pa to'
i l èvres (F) ; o'
to'
pi cheveux noyépo'
rô
front (G)o. ikayopnzom le couverc le tac irbni manche du cou
teau (A) ; aukô l’
un con tre l ’au tre (B) , bm j ambe,cu i sse
(F) ; abékôkor ip co iffu re rà rôbo paupière (G) .
u . kunum cou rbu re de l ’arc curulru po ison paku i
baguet te pou r les l ibat ions tug inum bol pou r les l iba
tions puni donnai t,etc . (A) ; nka ras
’
i de la même façon
umbe baleine lausu pou r etc . (B) ; mourn chemise tu
sikibi les deux yeux etc . (C) ; kisa rap uy t rou fai t au lobe de
l ’orei l le etc . (D) ; tueasbebet pou ce tekurigane bracelet
sinere‘
l tu po i l de barbe taruvu sou rci l . tupkeæ ven tre
parambe langue etc . (F) ; kunnésikuumibi pupi l le de l ’œ i l
no i r (G) .
Tous pour l’u fure‘ rouge fi tm i bru i t jura odeu r
unâi feu
a. kei lea corde de l ’arc —atuturu le mil ieu de la
sangle tumbu peti te chambre ayoreê2‘
c ils m’
élevaient
(A) ; etu nez eritei rasip hu tte (F) e'
tùbu nez (G) .
La mesu re des mots inscr i ts su r le tambou r, en même temps
qu’
i l s éta ien t no tés d ’
après l ’orei l le,mon tre b ien la dépendance
du t imbre et de la quant i té . En vo i c i quelques exemples où la
du rée des voyel les est m arqu ée en cen tièmes de seconde.
te ku 7301 po ignetA 8 1 6
B 3-1 3
C t 5 10 1 8
Revue dephonétique.
1 8 L’
ABBÈ ROU SSELOT
Pou r A et B ,l’
e est moyen ; pou r C , i l est grave.
ye r éka
A 1 5
Le second e ( 1 5 c . de sec .) est aigu à côté du premier ( 3)
qu i est moyen .
ko ta n kb ro ka m uy la terre ayant Dieu c ’est-à
B 4 9 6 1 9 d i re D ieu ayant la terre
Le premier 0 de bbro est grave et long par rappo rt au second
q u i est moyen et bref.
J’
a i noté comme moyens les tro i s et de u turu fron tière
mais la différence, s i grande, de quan t i té qu i existe ent re le second u
et les deux au tres m e fai t cro i re que le plus long a été aussi
le plus grave.
u t u r u
8 3 4 4
8 2 5 6
7 20 8
Tou te voyel le en contact avec une consonne nasale est plus
ou mo ins nasal isée,a lo rs même que l
’
orei l le ne le remarque
pas . C’
est un fai t de phonétique généra leLa nasa l i té cro î t progress ivemen t jusqu a la consonne nasale
ou décro î t de même à part i r de cel le—ci .
I l se peu t que la s imp le qua l i té de fina le suffise pour amener
de la nasal i té,même une consonne nasale. Dans ce cas
,la
bou che se ferme avant que la langue ne cesse de vibrer,la vo ie
nasale servant seu le au passage de l ’ai r . Ai ns i e‘remu rat a été
entendu e'
remû et e‘
remur‘
i (B) .
Exemples de nasa l i té (fig . 6 et 7)
p a n g e répugnance e n d r a m po i trineN N N
a a 6 a a
5 2 5 6 27 14 1 6 8
20 L’
ABBÉ ROU SSELOT
Dans les diphtongues, les voyel les gardent d’
ordinai re leur
t imbre respecti f aa,ao
,au
,a i
,ae
,ea
,eo, eu, io, no, 00, 0e, oi , etc .
Le changement de i en y et de u en‘
LU ne s’ impose pas .
Le y al terne avec i et ce avec et . Le ce est rare le y , assez fré
quent .
J’
ai c ru entendre une fo is iklæuebe et ik/zrebe nœud de do igt
(F) . M . Pi l sudsk i , à qu i j’
ai exposé m on dou te,m
’
éc rit que
iklewebe est une fau te au d ire des Aïnos . F . ne reconnai t donc
pas cette forme, qu i do i t être ray ée du langage vou lu . Mai s el le
peu t b ien fai re part ie du langage inconscien t , pré lude d’
une evo
lution nouvel le.
I l résu l te de tou t ceci que je ne pou rrais admettre les équ iva
lences anglaises données par Batchelo r pou r les voyel les ai‘
nos
fa ther o m ate
benefi t u (u) ru lerav ine
n i pou r les diphtongues
a i,a is le, i ce ; ey , they
tandis qu ’ i l reconnai t avec ra ison que chaque voyelle reste distinc tedans ao
,au (au) , eo, eu (eu) , ou (ou) .
Mais, j
’
ai été frappé , comme lu i,de la fai b lesse et de la dou
ceur de l’
accent . I l n ’
y a de grands écarts ni pou r la hauteu r n i
pour l ’ intens ité . En vo ici des exemples pris dans les mots iso lés .
Les vibrations son t comptées en vibrat ions doubles°
pou r un cen
tièm e de seconde, que j
’
adopte pou r un i té du temps même pou rla hau teu rmus ica le. La durée est notée entre parenthèse et les
ch iffres successifs indiquent la hau teu r moyenne pou r destranches de 5 cent1emes de seconde.
pâ nge(B) a — n —
g (6)22 .
’
osipi (B) o s i ( 1 9)i 2 .
PHONÉT IQUE DES AÏN OS 2 1
Dans la gamme norma le ( la ; 870 v . m i 2 co rrespond à
1 , 63 ; ja z , à sol ., à la à la 2 ,à a t, a
C ’
est ent re ces no tes qu’
a évo lué la vo ix,tout en se tenant
à peu près dans d’ in terva l le d ’
une quarte.
Quant à l’ intensi té , la s imple vue des t racés suffi t à montrer
que les var iat ions de force ne sont pas plus impo rtantes . Je cho i
sis comme exemple u tu ru (fig . 9 et L’égal ité de voyel le danschaque syl labe é l im ine les d ifféren ces qu i proviennent du t imbre.
Et,de p lu s
,le t racé
,pris avec un tambou r é last ique
,nous donne
vra isemblablement la somme des ampl itudes pou r chaque vibra
tion ; eu tou t cas, la mesu re en est p lu s aisée. Je prends la longueu r
et l ’ampl i tude (double) de 4 vibrat ions du 1eret du 2
eu,et de 3
du et j ’obtiens en cent ièmes de mil l imètre pou r la longueu r
1 ) 1 1 6 . 100 ; 2) 84 . 88 . 84 . 88 ; 3 ) 1 20 . 1 3 6 . 1 72 ;
pou r l ’ampli tude 1 ) 3 6 . 44 . 48 ; 2) 24 .
3 ) 40 . 3 6 . En divisan t l ’ampl itude par la longueu r, nou s
él iminons , en partie du mo ins,l ’ influence de la hau teu r mus i
cale et nous obtenons
1) 2)
3 ) so i t une moyenne de 1) 2)
3 ) Et,en tenant compte des durées 1 ) 2)
3 ) on vo i t que'
la ton iquegarde bien son rang,mais ne pré
sente pour l ’ intens i té rien d ’
excessif.
D ’
une enquête au ss i restreinte que cel le don t je d ispose et
d’
un caractère au ss i spécia l,pu isqu ’
el le éta i t fai te un iquement en
vue de l ’al phabet , i l est poss ib le pourtant de tirer quelques indi
cat ions sur la v ie des voyel les . Vo ic i les varian tes qu’ i l m
’
a paru
u t i le de relever à cet égard
A eur/eu et Ç‘
uruku po i sson leusapaa tête de l’
arc
(cf. sapa tête F) émuÇipe'
be'
,leiee
‘
r iotop, kiee’
r iolopu et kee‘
r iotop
pipe sapo'
et saboko sœu r aînée
C . re‘
kibi barbe pendra zn et pendra ruu po i trine
(c f. E) .
C . re‘
kibi, pdrdtek dos de la ma in (cf. paratëke, D) ;
22 L’
ABBÈ ROU SSELOT
pa toyebe l èvre et pokna pa toye lèvre inférieu re kanna pa toye
l èvre supérieu re (c f. patoi , F) ; piraka ap ou piraka a t et
piraka a tuku cou rro ie de la sandale am ip et amibibi robe
ôtopibi cheveux (cf . o'
tôpi , et oto'
p G) ; s ikibi et sik l ’œ i l
ku sapdba m a tête ktsa raba orei l le
D . nitibi
E. furnibi bru i t (les au tres — i) ; penlamubu po i trine
(les au t res —eî,
- ‘
tl,
—u) et penda rn (P) .
F .
— sapâ et sapaba tète sukr rap c i ls (c f. s ikkdbobo
(G) ; sukkap u paupière (c f. sikkababo G) ; makir i c'
tu et
—e'
tubu po intedu cou teau nipibi manche urche pied
et urepet do igt de pied
G . ôtôpi et otopibi cheveux uoye[>ôrô et noyépôrobo
front e'
telka nez (c f. etri P) ; rà rbbo sourc i l
I l résu l te de là
10 Q ue des voyel les peuvent d isparaî tre so i t à l ’ intérieu r des
mo ts (eu rku), so i t à la finale pendrarn, piraka at,
2°
Que la voyel le finale peu t être redoublée avec intercalat ion
d’
un 17 .
Cette dern i è re constatat ion a été faire par Batchelor qu i établ itla règle su ivante : Quand on dési re donner une clarté spéc iale
à la prononciat ion d ’
un nom ou d’
un ad jectif fin issan t par une
voyel le,cette voyel le finale peu t ê tre redoublée
,précédée de la
consonne b .
Dans le vocabula ire des habitans de l i te c oka recuei l l i par La
Pérouse,on trou ve les deux fo rmes Coubou arc (je n
’
ai
no té que kei A) , étou nez tsoubou so lei l I l est intéressant
de rapprocher tébe' la barbe de trek (P), rekibi (C,G) et trêkibi
(C) , chy œ i l de sik et sikibi .
La voyel le redou blée est le plus souvent moyenne. Ma is i l y a
des except ions (érnuêipébé (A) , rdrbbo (G), él î lk‘tt (F) .
U ne fo is je n’
ai pas entendu le b (kusapaa A) .
La voyel le s imple paraî t longue et d’
un au tre timbre que lavoyel le redoublée saj>d et sapaka (P) sapo
'
et sapobo (A,etc
PHONÉT IQUE 0133 AÏN OS 2 3
Le rad ical au ss i est al longé et les voyel les ont u ne au t renuance, quand la finale est p lus légère ou supprimée a
'
topi et
otopibi (G) , amip et am ipibi (C) .
La voyel le su scept ib le de redou blemen t peu t tomber comme
une voyel le s imple pa toi (F) , patoye et pa toyebe (C) , etc .
Seu l , l’
enfan t a employ é les fo rmes penlarärubu et fu rnihe
dans l ’enqu ête co l lective que j’
ai fai te.
Le vieux à la barbe blanche n’
a prononcé qu ’
une fo is sapobo
devant mo i . J’
ai i ns isté su r ce m ot et cherché à ramener la forme
double. A tou tes nos quest ions ins id ieu ses , sapô seu l se présentai t .J ’
aimera is b ien à savo i r ce qu i au juste amène la forme redon
blée,s’ i l n ’
y a pas une tendance à l’abandonner chez les vieux,à
la reprendre chez les jeunes , si l’
usage est général,s
’étendant à tousles mots
,ou restrein t à quelques—uns , s
’
i l n’
y a pas à cet égard desvariantes locales . Batchelo r nou s avert i t en effet q ue, ma lgré l ’un i
form ité de langage,p lus ieu rs mo ts se prononcent différemment
dans d ifféren ts vi l lages ou d istricts ; et i l c i te des variantes de erum
(je garde son o rthographe, u u) rat erernû (Sam ) , e‘
rum
(Porpet—Ko tan), e“
rern (Ishkari) , irurn (Shirav i) , eruru (U su) .
U ne enquête sur place ne sera i t p robab lement pas bien d iffici le
et pou rrai t être bien fru ctueu se.
CONSONNES
Le sy stème consonnantique des Amos est s imp le et var i e en
même temps,à peu près comme celu i de leurs voyel les . O n peu t
d ire qu ’ i ls n ’
on t qu ’
une sp iran te,une fricat ive labiale, une s ifilante,
une semi-occ lus ive sifflante, une vibrante,une semi—occlusive
vibrante,t ro is occlus ives et deux nasales . Mais des var ié tés assez
cons idérables se produ isen t de su jet à su jet sans qu’ i ls paraissents
’
en dou ter , sans que la sign ification en so i t mod ifiée et même
dans le même su jet sans que celu i— c i en ait conscience.
Spi rante Cette consonne évo lue entreun ê faible(cb
24 L’
ABBÉ ROU SSELOT
un b saintongeais), sonore du jusqu a la s imple aspirat ion
et va même jusqu ’à disparai tre entièremen t . Le rapprochemen t
des lèvres peu t la transfo rmer en
A l ’ in i t iale, je l
’
ai étudiée spécia lemen t avec tous les su jetsréun is au tou r de m o i dans êosibi au retour 505 j ambièreêure
‘ rouge êurni bru i t’
ura odeu r
J ’
avais noté précédemmen t c“
osibi,
’
os, fa re,
cam i , et ura
,
’
abo la mère’
urnpé (A) , b—umbe (B) baleine
PIG . 8 .
Spira’
nte.
fdp0 com paré à apa ,
(Tam bou r m oyen
Pou r êosibi , j’
ai tou jours sen ti le c dur et sourd,p lus tort seu
lement chez A ; de même pou r 505 , mais plus fort chez C D E(la femme du chef et ses enfan ts) . êurâ (A) est devenu
’
u rê
(C , H) , fure‘
(B et D) ,’
urè et fu lê (E) . êumi (C) furni (A,
B , D , E), umi (H) .
’
urc‘
1 (A,B , H) fura et fu la (D) , fu la
(E) , urà (B et C) .
Nous avons don c ic i les stades bien marqués c chu te ou
transformation en f .
L’
i nscription avec un peti t tambou r ne donne pas un résul tat
PHONÉT IQUE DES AÏN OS 2 5
assez net . J’
ai dû recouri r à un tambou r moyen,p lus élasti que,
et j’
ai comparé'
apoet apa porte’
umi et u turu (B) . La pré
sence de l’
aspiration n’
est pas dou teuse et se reconnaî t au bru sque
jet de souffle qu i précède la voyel le dans’
apô,’
urni et qu i manque
dans apa et uturu . Dans l ’expérience,B a bien prononcé l’asp irée
et non l’
f , qu i do i t représenter pou r lu i une art icu lation négl igée.
PIG , 9 .
Spirante.
êumi,com paré à u tur iu
Mais l ’ élément fricatif qu i renferme la consonne c n’
apparai t
pas dans le t racé . Je conclus à une aspi re'
e sourde, de fo rce
variable (fig . 8 et
Entre voyel les,la spirante paraî t à l
’
o rei l le tantôt sono re, tan
tôt sou rde, dans la même bouche el le peu t enfin s’
efiacer com
plètement ou°
se changer en f.
Ou tre les exemples déj à donnés, je ci tera i encore
km apaa (A) pou r kusapaba ; e'te2bu nez éteiôu ,
éteifu (H),ôtopibi cheveux (C) et dans le même momen t btopiôi (D) .
Les expériences ont po rté su r les mots'
rêkibi , et akup (A et
26 L’
ABBÉ ROU SSELOT
B) entrez Les résu l tats sont les su ivan ts la spi rante est tou
jours sonore pou r A ; 1 7 fo is con tre 8 , où el le est sourde,sur
2 5 expériences pou r B ; 1 fo is contre 5 sur 6 expériences pour C .
Chez les enfants,el le a tou jou rs été sourde. Malheureusement
je n’
ai fai t que 3 expériences pour D et 2 pou r E. C ’
est le mot if
qu i m’
empêche de rectifier m a graph ie l à où je n’
avais pou r gu ide
PIG . 1 0 .
Spirante.
Com paraison de la sonore et de la sou rde b ou 5 dans rékihi (B) ou rêkiêz (C , D ,
Nasa l isat ion de la sp i rante (B .
que l’
o rei l le. Je do is avouer , du reste, que je n’
ai j amais sen t i un5 dans la prononciat ion de C ni de E. Je ne l
’
ai no té qu ’
une fo ispou r D . Mes graph ies sont—el les j ustes sont— el les fausses Je ne
pu is le d i re. Dans l ’expérience, quand el le n ’
est pas souven t
répétéef on a plu tôt la prononciat ion so ignée. C ’
est peu t—être lecas ic i . Mais nous le verrons
,la tendance a l’assourdissem ent de
la consonne chez les jeunes est un fai t qu i n’
est pas douteux
Chez B,le b présen te cette particu lari té dans ak up que le cou
28 L’
ABBÉ ROU SSELOT
Batchelo r a tou jou rs représenté la sp iran te par la(cel lede bouse) ,ou f devan t et .
Un m ot dans lequel j’
ai c ru entendre une très l égère aspirat ion
et que j’
ai écri t ta’
dube cel le— l à (A B) par oppos it ion à tâ …be
cel le—c i n’
offre que la success ion de deux t imbres d ifférents
très sens i bles su r le t racé (fig . 1 2) fou rn i par A et B .
F r icative labia le. La fricat ive labiale est le U ne seu le fo is
j’
ai c ru en tendre un au dans un même m o t di t deux fo is de su ite
okkéwe et okkéve nuque (C) L’
f est un c inconsciemment
labial isé . Aux exemples déj à c 1tes , a jouter ndnofu laver le
visage (D) .
Pour l ’orei l le, le am o sonne comme le 11 frança is . Cependant
i l en diffère par une mo indre émission de sou ffl e,car dans les
t racés de ve'
n mauvais (B), par exemple,et ceux de renneva
les tro is (B) , orooa après a inom iva fa i re lesacrifice (B),la l igne de la bouche n
’
es t pas déviée, comme en frança is,et la
consonne ne se d istingue de la voyel le que par la fo rme des
vibrat ions .
A l ’ in i t iale,les vibrations du débu t son t très fa ib les
,et gran
d issent peu à peu jusqu’
au vo is inage de la voyel le. A la médiale,
el le est ent ièrement et fo rtement sonore.
Batchelor ignore le o . I l ne connai t que le tu, semblab le au au
anglais .
S ifilante La siffl ante est normalement s ; mais el le se teint
de nuances s i d istinctes qu ’ i l ne leu r manque pou r fo rmer des
espèces à part,comme dans les au tres langues , que la fix ité et
une valeu r séman t ique part i cu l ière. On peu t en tendre,sans que
le su jet ait l ’ai r de s’
en dou ter s pu re, g mou i l lée avec un l éger
recu l de la po inte de la langue, (un cb doux a l lemand) avec une
détente de l ’organe, un e pur et un 5 mou i l lé . Les l èvres ne
sont pou r rien dans ces nuances d ifférentes la langue seu le en
est la cause .
La sifflante est tou jours sou rde à l ’ i n it iale et presque tou jou rs
PH ON ÊTIQUE DES AÏN OS 29
à la médiale. Quand el le est sono re,el le est entendue comme
i .M. Batchelor ne note que deux var iétés s et sb qu ’ i l ass igne
ind ifféremment aux mêmes mo ts, reconnaissan t que dans bien
des cas i l est d iffi ci le de savo i r si les Aïnos d i sent s ou sb
M . Pi l sudsk i m ’
éc r it qu ’
i l y a quelques mots dans lesquels le
son est p lus d ist inct parce que le l éger changement de pronon
c iation entraîne un changement de sens ; et i l m e c i te comme
exemple so la dette et s'o réc if T ou tefo i s i l m e fai t
remarquer que Batchelor donne à chacu n de ces mots la même
PIG . 1 3 .
S iffl ante.
1 . seppa (B ) . 2 .1. asarna , ois i ; 2 . sapa (D) 3 S€PPa ; 2 ’ ”P”
(D) . 4 1 , aÇip ; 2 , 5 27€ (D) .
transcription sa et sbo. Quan t à lui,i l no te s
' s i la voyel le précédente est mou i l lée sam mai s i—s '
am . Ce qu i ne l ’empêche
pas cependant d’
en tendre s'urruku ou su ruku l à ouB atchelor écri tseu lement surugu .
Le palai s art ificiel donne dans ce cas de t rès u t i les renseigne
ments . J’
ai expér imen té en même temps que j’
a i écou té les pri nc ipales variantes s i n it ial et médial
,seppa (B et D) , sapa la
tète sik ou suk,asanta le fonds oisi robu ste êeppa
la garde du sabre ac ip fleu ri r (D) .
N ou s avons d ’
abo rd le t racé norma l de l’
s (fig . 1 3 , n° SI et
pu is la palatal isat ion acum inale à d ifférents degrés d ’
abord faib le
ensu i te p lus prononcée A nous en ten i r aux seu les
impress ions de l ’orei l le et aux local isat ion s quenous pouvons fa ire
3 0 L’
ABBÉ ROU SSELOT
sur nous-mêmes,nou s aurions jugé au t rement . Nou s au rions c ru
à un recu l success if du dos de la langue, depu is 5 ju squ’à g , et à
PIG . 14 .
S ifli ante sourde.
OS
PIG Jy H 5S iffl ante sonore.
[akor] o s a b [a].
PI G . I 6 .
S iffl ante m i — sonore[ayor] esu .
une détente pou r le c”
. Et c’
est dans la d irection des dents que lemouvement s ’
accom pli t .
La siffl ante intervoca l ique; enregistrée dans C
osipi par tous lessu jets, a été constamment sou rde (fig . Seu le, l
’
s de akorosapb (A) dans les t racés d
’
un réci t a été sono re,à la fin du m or
PHONÉT IQUE DES AÏN OS 3 1
cean et non au débu t (fig . 1 5 ) de A,et à demi sonore dans
ayoresu i ls m’
élevaient
Vo i ci les varian tes que j’
ai recuei l l ies
A. K u osoro et j c i—dessou s ; P c urku et Ç‘
uruku (s .
Batchelo r) ; a ijup et aeÇup (ai -shap , Batchelo r) ; sik bou c le
e'
mueni bo is du manche du sabre émue étaye' t i rer le
sabre lame du sabre e'
muz at (s, 5) courro iee'
rnusa p usdet°
emuzatpusçî part ie qu i descend sir ika fou r
reau pus le corps du cou verc le puekaoni attacher’
des
courro ies puetota bo î te pou r les a l lumettes tasirô cou teau
de chasse taeirôni manche taka iäara sou coupe
kice‘r i ojora as (â) 505 (e) j ambière Ç’e'
pa garde du sabre
ire‘epa (5 ) m’
élevaient upsororoke(â) dans l ’ intérieu r de la
maison ayoresu(Ç) i ls m’
élevaient
B . taka isara ; c”
og ;
C . sinuye‘ tatouage sik ; sdpamuye
‘ co iffure sàk°oê
jam b1eres d’é té êôg(s) seppa
D . sik ; poiÇeppa medai l lon ÇàPàmuye bandeau co'
_s ;
€ePPü (S) 5
F . eitoki(s) coude suk(e) ; osoro ; siki bambou etc .
G . sikrdbobo ci ls keinne'
siknumibi pupi l lede l’œ i l
H . êoÇ‘
, (5 , g) Çeppa(s) .
Tou s les su jets nou s fou rnissent d es exemples de l ’a l té rat ion
de l’
s ; mais nu l au t re en au ss i grand nombre que A. C’
est à Aet à P seu l s qu
’
appar tiennent les formes sono res .
L’
s exis te comme réduct ion de lasemi-occlu sive sifflante.
Semi —occlusive sifllante. L’
articu lation de la sifflante peu t être
précédée d’
un pet i t con tact de la langue su r le palais . De là naî tla semi—o cclus ive siffl ante
, qu i natu rel lement se montre avec les
nuances que nou s venons d ’
observer s’
, 5 , É“
. Mai s,de plu s, la
semi—occlus ive peu t perdreso i t son é lémen t o cclu sif et se rédu i re
à 5 , so i t son é lémen t fricat if et se restreind re à un (mou i l l é) et
même à un t (dur) .
L’
ABBÉ ROU SSELOT
Les différences possib les dans le degré de palatal i sat ion se
montrent b ien sur le palais artificiel (fig . 1 7) où nous pouvons en
reconnaî tre t ro is, deux extrêmes dans le tracé de Êep po isson
PIG . 1 7
Sem i— occ lus i ve s ifflante.
1 ,1,z et 3 Var iantes de âep 2 . à a .
Flo . 18 .
Sem i-occ lusive siffl ante.
êoêa .
B . I . Sem i—occ lus ive in itiale i inplos ion tenue B; explos ionY.
_
B . 2 . Exp losionde la consonne in it iale et tou te la consonne m éd iale. A . Le m ot ent ier à partir del ’explosion de l ’ in itiale .
PHONÉTIQU E DES Aixos 3 3
et un au tre in terméd iai re dans celu i de,ÊoÊa atteindre avec une
flèche (D) .
On t ét é enregistrés ÊoÊa par A et B,et un
_âi le feu par A,
B,C
,D
,E,G .
La l igne du sou ffle bu ccal (fig . 1 8) nou s permet de mesu rer latension et la tenue
, qu i est l’
occ lus ion de la consonne,quo ique
ces actes se so ient accompl is en si lence. La tension (A) a du ré
3 cent ièmes de seconde ; la tenue Pu is commence la part ie
sifflante qu i a é té sou rde et sono re Dans le secondexemple (B), nous avons pou r cet te dern ière part ie et
pu is viennen t pOur le c’
média l su ivant imp los ion sonore,1 ;
occlus ion don t sonores,
sou rds explosion,ou par
tie siffl ante 4 , dont sourds et sono re.
Le tracé de A nous donne pour la consonne i n i t ia le part ie
sifflante dont son t sou rds et sono re ; pour la con
sonne médiale implosion sonore o cclusion don t
sono re, . 9 sourds ; partie siffl ante 3 , dont 2 sou rds et 1
sono re.
Dans cette consonne,la part ie occlus ive est de beau coup la
plus grande. Et,quand el le est placée en tre vo yel les , tou t en
restan t sourde pou r l ’orei l le,el le est au début un peu de temps
sonore.
Les deux que nous venons d’ étudier
,d iffèrent en core par l
’
in
tensité d ’
aprè s l ’ampli tude du tracé le 1era 3
mm 8,le 2
°
mai s j’
en ai mesu ré d ’
au tres où la d ifférence est bien plu s sen
s ible et (B) ; 1 ,6'
et (A) .Après une consonne nasale (unâi) , l
’
occ lusion et l ’explosion
tou t ent ières peuven t êt re sonores . El les l ’ont été (fig . 1 9) 1 fo is
sur 3 (A) et 2 fo i s su r 3 (B) dans une expérience (fig . Pou r
tous les au t res su jets,el les sont sou rdes
,avec une portion sonore
plus ou mo ins grande(fig . Mais ce qu i parait i c i d’
une grande
importance,c ’es t la d iminu t ion de la tenue et l ’al longemen t de
la part ie sifflante,en sorte que l
’
on peut prévo i r la d ispar i tionRevue de phonétique.
PHONÉT IQUE DES A1NOS 3 7
Tous ont di t rèkibi , qu i a été l’
objet d ’
une expérience à laquel le,
seu l,P n
’
a pas pris part .Chez tou s aussi , l
’ é lément occ lu s if manque pou r e'
remu rat
(êlemu ,E) , dont Batchelor c ite une forme d ialectale endrum .
C ’
est sur cette espèce d ’
r que s’
es t po rtée tou te m on attention .
J’
ai d ’
abord recou ru au palais art ificiel ; et j’
ai cho is i pou r les expé
riences le m ot rap, qu i ne demandai t de contact avec le pa lais
que pou r l’
r . B donne la fo rme d ’
une denta le, contou rnant les
a lvéo les,avec un élargissement sensible derrière les dents de
PIG . 22 .
Sem i—oc c lus ive vi brante.
i ap .
2 . A . 3 . D . Deux var iantes . 4 . A . Deux v ariantes de la consonne non
devant , s igned’
unmouvement v ibrato i re (fig . 2 2 ,I )A et C font en
plus pressent ir l ’appu i de la langue dans la part ie postérieu re de
la bouche (fig . 2 2 ,2, Enfin Am ’
a fourni par deux fo is la trace
d ’
une r normale sans add ition d’
un élément occlusif so i t denta l so i t
gu ttura l (fig . 22 ,Les variantes tr et kr s
’
expl iquent donc très
bien . La perte de l ’é lément occ lus if avec rédu ction à r,et même
de l ’ élément v ibrant avec rédu ct ion à d offrent enco re mo ins de
difficu l té . La t ransformation de cette r en l qu ’
el le so it seu le
ou précédée de t, k montre la tendance de la langue à s ’appuyer
sur sa po inte et à la isser fiéchir les bo rds . Rare chez P,el le est
fréquente chez D , constante chez E,inconnue des au tres su jets .
Pour l ’ étude du cou rant d ’
a i r, j
’
ai enregis tré le même m ot rap
(fig . 2 3 ) et de plus re‘
kibi (fig . 24) et pendrain (fig .
On y vo i t c lai remen t que l’élément occlusifet vibrato i re, assez
L’
ABBÉ ROU SSELOT
Bat chelor écri t uncbi ou un; z . Un agronome russe, m’
a d it
M . Pi l sudsk i , entenda i t tisye la maison pou r s’
isye, et tef po is
son pou r iep. J’
ai en tendu de même deux fo is t pou r s‘ (A B) .Vibrante. La v ibrante ne m
’
a pas paru d ifférer d ’
une r du
bou t de la langue faib le’
et dou ce. A l ’o rei l le, je n’
ai sent i rien de
part icu l ier et le t racé de cette consonne en tre voyel les est tou t à
fait no rmal (fig .
Comme variante certaine, je n’
ai rencontré qu’
un d taeiro et
taeido cou teau de chasse (A) , et une seu le fo is . Ce peu t ê tre
une erreu r . Dans fura odeu r l’
r al terne avec 1 chez D et la
PIG . 2 1
Vibrante.
[u tu]ru .
Emprunté au m ême tracé que la figure 9 . F in de Pau et la dern i ere syllabe .
remplace’
chez E. Mai s i l faudrai t savo i r s i cet te r ne provien t pas
de la semi—occlu sive, ce que j’ igno re.
Vibrante semi—occlusive. Vo ic i les variantes que j’
ai notées
A. rurn et trum po inte de flèche trap et krapp lume
B . pendramû po i trine
C . rékibi et tr_
èkibi barbe pendrame‘
î .
D . tle‘k et lèk barbe pendlamù et pendramei .
E. peniamubn .
P. tre'k et kle'k ; sukkrap ci l pendam po i t rine rêkihi
Sikï üb0h0 ci ls
G . pendramû .
PH 0NÉTIQUE nes A1NOS 3 5
de la part ie occlus ive. Ains i,en face des mesu res précédentes ,
nous avons entre la fin de la nasa le et la sortie de l ’ai r A 3c s 6
,
D 9 , E et pou r la part ie s iffl ante A DE 10
, 5 .
Des arti cu lations instables,comme cel les des semi—occ lusives
,
demandent à être étudiées dans le discou rs su iv i,le mot iso lé ne
l ivrant que la forme consciente quand i l n’
est pas su ffi samment
répété . J’
ai s’
ep après une n dans un réc i t (B) le s’
a perdu son
occlusion dans cel le de la nasale et s ’
est confondu avec cel le—ci .
PIG .,
20 .
Sem i - oc c lus ive sifflante.
unâi et unsi .
1 . Sourde. 2 . Sonore (fa ib lem ent) .
Vo ic i les variantes que m on o rei l le m’
a indiquées
.ÿinki fat igué $dniku (i t) arc ukora i i le
même s’is le plein ,
pleu rer s’
os’
a (ë) simoîa (c’
)chanson unsz .
B . nka ras”
i ; fop (s, t , unyz (z) .
C. i ikàrakarog j ambières fai tes par m o i untz i (ou dz
E. nutzt .
F . u i ika rn j ambe
G . nutzt .
J’
ai rappel é fidè lement les variantes graph iques
que, d’
après m es expériences, t; so i t no to i rement
entendre un avec un s très faib le.
PHONÉT IQUE DES AÏN O S 3 9
C ’
est sur la l igne du nez que se l isent les variations dependram .
La consonne est tou jours entièrement sonore et l’
occ lus ion n’
estcomplète nu l le part .
Cette consonne est représentée d iversemen t par les au teurs .
Dobm tvorsky en distingue t ro is variétés tr , Tr , tR d’
après l’élément qu i a la prédominance ; i l a aussi reconnu le d . Batchelorécri t rap . La Pérouse avai t no té te'be' la barbe
J’
ai déj à adopté pou r un son analogue r, qu i convient très bien
pou r dr . Mais i l manque une sou rde pou r tr à plus forte ra isonpour kr ; et pu is i l faudrai t sans dou te un au tre caractère pou r l’rcorrespondante
PIG . 2 5 .
Sem i-occ lusi ve vibrante.
Occlusives . Batchelor admet les paires d ’
art icu lat ion b d t,
g k, qu’ i l ne dist ingue pas des occlusives anglai ses . J
’
ai cru les
mêmes art icu lat ions conformes au type françai s ; mais je fus bien
vite détrompé . Je demanda is au chef (B) de m e_
répéter le mot
qu i s ign ifie mère et je disais habô à la française. I l ne m e
comprenai t pas . Pu is,après un momen t de réflexion, i l m e pro
posa bapo'
? Ou i . Mon b bien sono re l ’ava i t dérou té . De son
côté,M . Pi l sudsk i entendai t les occlus ives mou i l l ées dans les
‘
cas où el les le sont en russe.
Avant de relever les expériences , je cro is u t i le de recuei l l i r les
variantes que j’
ai notées d’
après m on orei l le.
A l ’ in i t iale,i l n’
y a pas de dou te la sou rde est constante ; et
40 L’
ABBÉ ROU SSELOT
je n’
ai à s ignaler comme cas particu l iers qu ’
une aphérèse, endrarmî
et pendramu po i trine (B) , la mou i l lu re d’
un t , tupkese et
ventre (P) , et l’
asp irée k’
,kcarze tama co l l ier de fer (D),
k ’
ar imba et kar imba l ien d’
écorce de prun ier
Entre voyel les, ou après une nasale et devan t une voyel le.
A. rnakani (g) bo is de la flèche emuÇ ipäbe'
(b) lame
du sabre si r ikakdbe (p) o rnements du fou rneau ipe'
(b)manger (La Pérou se ajbe
'
)’
umpe' baleine (b,
B ibe'
; pdnge et pari ke;’
umbe (A p) .
PIG . 26 .
O cc lus ive gutturale1 . B . anenike . 2 . D . Iek .
D . èbitta p) tou t
P . ipe‘
,tekukoti et tegukoti art i cu lation du po ignet ukua
gane, tegurtgane et tekurtkane bracelet noæbôro p) front
inaye (d) mou lu res nipibi (b) mancheG . nikdbuntarahä et -
pç' natte
Les su jets réun is , j’
ai obtenu pou r êosibi b (A, B, E), b et p(D) , (C,
H) ; kdnti rame (B, D) , t (C ,E,G) .
Je rencontre un au tre t dans mes notes nitibi spatu le
(D) .
A la finale ke'
mdsap et -ak (P) chevron de la hu tte » , nimaket nimak dents piraka ap cou rro ie de la sandale et —at
(C) , tou jours t (D), et pi raka a ta lru (C) . Les occ lus ives fina les
sont souvent très faib les et d iffi ci les à reconnaî tre. L’
agronome
russe a entendup commef (ref po isson DemêmeM . Pi l sudsk isukup sukuf jeune
PHONÉT IQUE DES AÏN O S 4 1
Les expériences appo rtent les précisions que la s imp le aud it ion
ne peu t donner, en même temps qu’
el les expl iquent les erreu rs .
Le pala is art ificiel témo igne que le k ne se mou i l le n i devant e
PIG . 27 .
O cc lus ive denta le initiale .
O c c lusive guttura le m éd iale.
tekukot.
PIG . 28 .
O cc lus ive dentale initia le.
ta [ambeJ.
(anenike B ,fig . 2 6
,n i après e (lek D , fig . 26 n i même
après i (sikD, fig . 2 6,
Uneo rei l le slave sent donc comme mou i l
lure ce qu i n’
est vraisemblablement que mo l lesse d’
arti cu lat ion .
Mais la mou i l lure peut être admise comme exception .
Dans les mo ts i so l és ou commençant un membre de ph raseaprès un repos
,l’
occ lusion est tou jou rs sourde. Dans certains
42 L’
ABBÉ‘
ROU SSELOT
tracés (fig . 27 , el le est t rès b ien marquée des le débu t sur
la l igne du souffle. Et la constatat ion est tou jou rs faci le à fai re.
L’
explos ion peu t être assez forte (fig . d ’
o rd inai re el le est
modérée, ce qu i se reconnaî t à la fo rme arrond ie du t racé par
oppos i t ion au ressau t brusque caracté rist ique des explosions
fo rtes . Même,D et E ont produ i t
,avant l
’
explos ion propre, un
PIG . 29 .
O c c lus ive labiale m éd iale.
[‘osJipi
B sonore. C sourde .
B continue la figu re . C continue,m o ins 1 5 v rb la fig 1 4 .
souffle qu i a du ré ICS
. 8 (D), (E) . La part ie sou rde de l’explo
sion est d ’
une durée variable. El le a été de 1 centième de seconde
dans tekukot (fig . de et mêmede 3 pou r ta âmbe (fig .
C ’
est là un fa i t rare qu i ne s’
est produ i t que deux fo is pour t ,une pou r k, et qu i au torise ma graph ie k ’
à ti tre exceptionnel .
Mai s on ne sau rai t admet tre l ’équ ivalence des occlusives ainos
avec cel les de l ’anglais . Cela est dit pou r A B . De même, D a des
exp losions sou rdes de 1c s
et C I, 5 et su r 3 exemples
de tekukot,el le a eu 2 explos ions sonores . E a donné 4 fo i s de
su i te une explos ion sonore au t de tekukot. C’
est à peu près l’état
des sou rdes françai ses .
Entre voyel les , les occlus ives sont dans m es tracés,tou jou rs
sono res pou r A et le plus souvent pou r B . Au con tra ire,pou r
C D E,el les sont d ’
o rd inaire sou rdes . Entrons en quelques
détai ls . Les ch iffres entre paren thèses qu i accompagnent ceux des
44L
’
ABBÉ ROUSSELOT
Pou r tous , l’
exp los ion est sonore et extrêmement douce.
L’ émission d ’
ai r est si faib le que la l igne n’
est pas déviée
même pou r les hommes (fig . J’
ai cité le seu l exemple (C)
qu i fai t exception (fig . E est al l é encore plus lo in , l’
occlusive
PIG . 3 1 .
O cc lus ive labiale finale.
lt ]üPlm plos ion et débu t de la tenue du p .
PIG . 3 2 .
O cc lusi ve denta le finale.
[tekuk]ot .
lm plos ion et débu t de la tenue du t .
parai t être devenue chez lu i une vraie spirante sonore (2 fois) .
rèkibi . B . S ix sonores et deux sou rdes (3 , explos ion
forte), (explos ion forte) . C . U ne sonore et deux sou rdes
D . Tro is sou rdes 9 1 2
E. Deux sou rdes (souffle sans explosion
(souffle plus fort
PHONÉT IQUE —: s AÏN OS 4 5
En résumé A sonores B sono res 1 8,sou rdes 7 . C
sono res 2 ,sonores après occlu s ion sou rde 4 , sourdes 6 . D
sou rdes 1 3 . E sonores 3 , sonores avec occlu sion sourde 9 ,
sou rdes 2 .
Après une nasale (tàâmbe, pâ ñge) le b a tou jou rs été sonore
(A,B) , le g a été sonore 1 5 fo i s et sou rd 5 fo i s (B) .
A la finale, l’
occlus ive ne possède que l’
im plos ion et l’
occlusion .
PIG . 3 3b
'
final devenu spirant .
[f lût
L’
explosion manque. Au cun tracé de A, B ,C , E,
n’
en porte le
mo indre vestige. U ne expérience de A (akup) , fa i te avec un tam
bou r élast ique, est t rès expl ic ite à cet égard . Les mo i ndres varia
t ions de la co lonne d ’
a i r son t en registrées . O r depu is l’ implosionjusqu ’ à la reprise .du souffle, marqu ée par un abai ssemen t de la
l igne (fig . 3 0 a) , i l n’
y a pas la mo indre expu ls ion d ’
a i r . Seu l s
les tracés de D pourraien t fai re cro i re à une explosion la l igne
se rel ève en effet après chaque m ot enregistré . Mais cette
i n terpré tation est imposs ible car l’
occ lusion au rai t a lors
de 3 1 à 3 6 cent ièmes de seconde (ce qu i est beaucoup trop) ,et de plus
,comme nou s a l lons vo i r
,le p est devenu sp i
ran t .
L’
implosion est sonore,ains i que le débu t de l
’
occlusion . Le
fai t est faci le à reconnaî tre, car la l igne du nez se couvre de
vibrations plus amples , qui son t dues à la fermeture de la v o ie
buccale(rap B fig . 3 1 , tékukot B fig . Tracés analogues de A
46 L’
ABBÉ ROU SSELOT
et de E,avec cette différence que la sono ri té est bien mo indre
pou r ces deux dern iers su jets (te‘
kuktot C E, fig .
Le de rap (C et D) donne un trace (fig . 3 3 ) qu i prend lesa l lures d ’
une spirante sourde terminée par 5 ou 6 vibrat ions , restes
de la sonore (C), ou ent ièrement sonore et parfai tement dist inctede la voyel le précédente (D) . Quant au t de têkukot
,i l conserve
bien le signe de l’
im plosive chez C (fig . 3 2) mais i l pré
sente chez D l ’ image d ’
une spirante a peu près‘
sourde
(fig 3 4)Pour achever de mettre en rel ief la d ifférence qu i existe entre
l ’ impression audi t ive et la réal i té inscrite dans les tracés,j ’a jou te
PIG . 34 .
t fina l devenu sp irant .[tekuk]ot
quelques l ignes de deux récits su ivis, qui ont été enregistrés dan s
le même ins tan t au phonographe et avec les tambours et tran
scri ts phonét iquement , quand j’
avais enco re l ’o rei l le pleine des sons
que je venais d’écou ter . Les consonnes écri tes dans le texte son t
cel les que j’
ai c ru entendre ; cel les qu i son t imprimées au—dessou s
son t des symbo les de consonnes réel les divisées en 3 part ies
implos ion,o cclu sion,
explos ion . La qual it é sono re ou sourde
de chaque tranche est indiquée par une sonore ou une sourde ;l ’ importance relative de cet te qua l i té est marquée
,su ivant une
progression descendante, par un caractère romain
,i tal ique.
L’
absence de cet te no tat ion prouve qu ’ i l y a acco rd entre l ’o rei l le
et le tracé . Enfin,quand le caractère dominant est net temen t
sonore ou sou rd , une seu le lettre en avert i t . Les virgu les séparent
des coupes réel les .
PHONÉT IQUE DES A‘
1‘
N 0 5 47
sœ ur aînéesa p o
bpb ien
ramma —kam,
8
tous les vases b ien arrangés d’
un co in à l ’autre blanc arbre
yoy k i r i pa ta , r eta nn i
g b d (1
petite cham bretum bu ,
d
i ls m é leva ientay or eêu ,
h
dess ina it le petit sabrenuy é, tôm i ka
gfa ire cec i faisa1t
ki nea ki …
8
L’
un contre l ’autre m échants D ieu étanta u kô k oeranænnin, kamuy anoine
g g
viva it et m ontagne ayant D ieu (nom de héros)anani k e, nupu r i k oro kam uy a i oi nd
gge b a“e g
D ieu la terre ay ant D ieu les tro isle amuy ,
ko ta n k ôr o kam a y ,r enueva ,
gke ddd g e
A. Ma sœ ur a înée, m on frère aîné et m elevaient b ien,et viva ient . Tous
les vases bien arrangés d’
un co in à l ’autre dans la pet ite ch am bre de bo is blancà l ’ intérieur de la m a ison
,ils m
’
éleva ient . Le petit sabre dessina it, la terre dess inait . I l faisa it seu lem ent cec i . R ien de plus . I l fa isa it cec i .B . L
’
un contre l ’autre m échants,D ieux viva ient D ieu de la m ontagne,
le D ieu Aiona,le Dieu de la terre
,tous
frère a iné
WP’ »
bv iva ient et
0 k a a n i ke‘
gk g
à l ’ intérieur de la m a isonupsororoke,
bp
et la terreananike
,s i r i ka
8 8
cec i seu lementtâ m be pa te k ,
b (1 g“
48 L’
ABBÉ ROU SSELOT
Que conclu re de tou t cela ? Q ue,sous ces formes var i é es , i l
n’
y a que t ro is occlus ives une labia le,une denta le,
une gut tu
ra le. Chacune n’
a qu ’
une qual i té essent iel le. S i , avec cela ,la
même occlus ive est explosive ou simplement implosive, forte ou
douce, sou rde ou sonore du re ou mou i l lée, instan tanée ou
spiran te, peu importe c est affai re de posi tion ou de force.
Personne ne s’
en i nqu i ète et personne ne le rem arque.
° Mais
PIG . 3 6 .
N asale guttura le com parée à la dentale.
I . pd rtge et 2 . kâ nti .
tou tes ces nuances n’
ont rien de t ranché et de parfai tement d is
t inct . L ’
ar ticu larion est faib le ; les vibrat ions du larynx souven tà peine esqu issées . Et i l est lo isi b le à l ’o rei l le d ’
entendre commesou rdes des sonores que le larynx enve10ppe inu ti lement de ces
sonori tés trop éteintes .
N asa le_s . Sauf à la finale, el les reprodu i sent le type français
et ne s’
en distinguent ni à l ’o rei l le,n i sur les tracés . A la finale
,
el les sont pu rement implosives, mais avec une longue occ lus ion
PHON ÈTIQUE 013 5 AiN 0 $ 49
sonore (fig . A l ’ in i t iale, j’
ai mesuré avant l ’explosion 7
(A) et 3 (B) cent ièmes de secondé.
Comme partou t,a i n s i qu ’
on peu t le constater par les figu resprécéden tes , el les influen t su r le t imbre des voyel les et mêmeagissen t su r les consonnes .
Les Aïnos possèden t t ro i s consonnes nasales la labiale,m ; la
dentale,n et la gu ttu ra le rt. Mai s je cro is qu
’ i ls n ’
ont. conscience
que de deux rn et n . Le n, b ien qu’ i l so i t certai n , bä nkeou
pâ r'
zge B (fig . 3 6, do i t ê t re une variété gu ttu rale,don t la
forme dentale nou s est donnée par kä nti (fig . 3 6, de l’
n,la
seu le qu i s’
emplo ie à l’ i n i tia le ou à la finale.
L’
n mou i l lée est inconnue.
En somme,la phonét ique des Amos, très pauvre en é léments
significat ifs, est d’
une rare richesse comme moyen d’
harmon ie et
d ’
expression .
L’
Abbé ROU SSELOT .
Revue de phonétique.
ETUDES DEPRONONCIATIONS CATALANES
A L ’
AIDE DU PALAIS ARTIFICIEL
1 . Lo rsque je publ iai m on premier essai sur les voyel les
du ca talan ? en prenan t pour base m a propre prononciat ion ,
j ’étais lo in d’
apercevo ir auss i nettement qu ’
au j ou rd ’
hu i le rôle
décisif q ue joue la Phonétique expérimentale dans l’
analy se des
phonèmes . La deuxième part ie de m on travai l devai t porter sur
les consonnes catalanes . Mais entretem ps une heureuse décis ion
de la section phi lo logique de l’
Insti tut d’
Estudis Ca ta lans de Barcelone
,d irigée par l
’ i l lustre propagateu r des études ph i lo logiques
catalanes, M . le Dr Anton i Ma Al cover, m e désigna pour ven ir
à Paris afin d’
y étudier les procédés expérimentaux de la Phoné
t ique. Je renonçai don c à publ ier les no tes que j’
ava i s préparées,
dans l’espo i r de fai re mieux . Les lecteu rs du Balleti voudront
b ien ne pas m’
en ten i r rigueu r .
Qu’ i l m e so i t permis de remercier ic i M . l ’abbé Rousselo t
,
directeu r du Labo rato i re de Phonét ique expérimenta le du Col
lège de France,a ins i que M . le professeu r J . Chlum skÿ pour
leu r amabi l i té envers m o i et l ’orientat ion qu ’ i ls m ’
on t donn éeau cou rs de ce trava i l .
2 . Comme l ’ indique le t i t re même de cet art ic le,celu i-ci
n’
aura d ’
au tre base d’
eXpérim entation que le palais art ificiel . Laméthode en quest ion a été s i souven t décri te qu ’ i l semble inu
t i le d ’y reveni r et qu ’ i l suffira de renvoyer par exemple à l’
art ic lede M . Rou sselot Les a r ticu la tions à l ’a idedu pa la is ar t ificiel paru
1 . U ne analy se des sons du catalan d’
après le systèm e analphabétique de
O . Jespersen faite en comm un avec m es am is A . Griera et M . de Montoliu a
paru sous le seu l nom de B . Schä del dans le Bulletin de D z‘
a lectolog ie Romane,t . I I
,1 9 10 , p . 1 sqq . Com p . Bolleti del D z
‘
cc z‘
onar i de la Lleng ua Cata lana ,t . IV.
I 909 . 1) . 398 sqq2 . Balleti del D iccionar i de la L lengua Catalana , t . VI
, 9 10- 19 1 1 , p . 26 1 sqq .
5 4 P . BARN ILS
I . VOYELLES
A. VOYELLES TON IQUES
a . La voyel le i .
S 5 . Considérons d ’
abord la voyelle i prononcée isolement
comme longue (fig . 1 et comme brève (fig . 1 L’
i s’
articu le
b ien plus en avan t que i et s’ étend en outre davan tage su r le fond
du palais . N ous n’
essaierons pas de rechercher ic i commen t se
répart issen t en cata lan les voyel les longues et brèves . Nous constatons s implement la différence d ’
art icu lat ion qu i accompagne la
du rée. Peu t-être s’
eXplique—t-el le ains i : pou r la voyel le brève, la
langue n’
a pas le temps de se déployer,pui sque el le do i t prendre
et qu i tter au plus vite sa place ; i l en va tou t au tremen t
dans l’
émiss ion d ’
une voyel le longue . C ’
est ce dern ier cas
que nou s avons cho i s i pou r tou tes les figu res qu i renfermen t
des tracés de i tonique ou atone ; la différence est ains i plus
visible.
6 . Vo i ci la l iste de nos exemples avec i ton ique. Les caractères entre parenthèse indiquen t l
’
or thographe courante en catalan
Fig . 2 i (i) . pi , bi , m i , fi (pi , vi , mi , fi) .
pif (pim , pif
Fig . 3 i (i) . fit (fi l) . file (fila) .
Fig . 4 t (i) . biba, pipa, mima, piga, fig .? (v iva , pipa,mima
,piga
,figa) . fikä , pik9 , mika (fica, p ica, mica) .
7 . On vo i t que dans le cho ix des exemples nou s avons évi té
la combinai son de la voyel le avec des consonnes qui auraien t pudétru i re la pu reté des tracés . Nous n’
avons pris i que dans le voi
1 . La voyel le que nous notons a correspond à Pa: franç a is sans arrond issement des l èvres . Bien qu
’
el le ait d iverses nuances dans le m ot,nous ne la ren
dons pour l’ instant que par un signe unique.
ETUDES DE PRONONC IAT IONS CATA LANES 5 5
s inage de f, p, b, m ,1,k, g ,
et seu lem en t après k et g parce que,si ces consonnes précéden t i , el les se palatalisent assez faci lement
(v . S 40) et la voyel le est ainsi al térée.
Les t racés ne mont rent pas une infl uence très frappante desconsonnes su r la voyel le, sauf une l égère exception que nous
signalerons tou t à l ’heu re. En revan che la qual i té de la voyel ledépend de sa posi tion dans le m ot . Comp . 2 et 3 à 3 et 2
La divergence entre i iso l é et i précédé d ’
une consonne y apparaî t
cons idérab le, et ceci provient , à m on avis,de ce que dans 2 et
3 la voyel le, placéeen sy l labe fermée, est pour ains i d ire étou ffée
par les deux consonnes qu i empêchen t son dép lo iement . Maisdès qu ’
el le est débarrassée de la fermetu re, el le se rapproche du
tracé de 1“ type. Comp . les aut res l ignes des figu res 2 et 3 . On
peu t en rapprocher au ss i 4 où la voyel le se trouve propremen t
en sy l labe l i bre sans ê tre finale.
Onnotera également la faib le ampleu r de 4 L’
i dans ce cas
n’
es t po in t comparable à celu i d ’
une sy l labe fermée ni à celu id ’
une sy l labe l ibre, bien que cette sy l labe so i t en effet tel le. Cec i
tien t sans dou te à l’ influence de la gu ttu ra le su ivante : im pu is
sante à su ivre l’
i vers le palai s,comme dans les cas où la gut
turale précède, el le atti re cette voyel le en arrière et en diminue
la zone art icu lato i re. La seu le i nfl uence sens i b le, ou tre cel le-l‘
a,
est cel le de 1 (fig . 3 qu i ré tréci t un peu la voyel le. Ce fai t
s ’expl ique probablement par le carac tère latéra l deno tre con
sonne.
G et B n ’
accusent ic i aucune d ivergence no tab le. Nou s verronsbientô t qu ’ i l n’
en est pas tou jou rs a ins i .
b . La voyel le e'
.
8 . Exemples Fig . 5 ê (e) . fe’
(fer) .
Fig 6 ê (e) mêb9, pére (meva, Pere) .
(fem) .
5 6 P . BARN ILS
Comme pou r la voyel le i nou s répétons i ci la l igne de e(v .
fig . 1 sur les deux figures .
S 9 . O n aperço i t de su i te quel legrande d ifférence sépare e'
de
i,au ss i b ien chez G que chez B (fig . 1 et 1 respec tivemen t) .
Le l ieu d’
articu lation de la langue se rédu i t considérab lement
pou r edans tous les sens . Pou r ce qui concerne ê, vo i r S 5 .
Examinons maintenant les tracés propres a é.
U ne anomal ie se présente,don t je ne sau ra is trouver une
expl icat ion satifaisante. L’
e'
,cont rai rement à ce qu ’
on attendrai t,
est plus fort aprèsf qu’
après b (fig . 5 et 5 respec t . ) cette dif
férence est
’
sens ible même sans palai s art ificiel ; nous avons le
sent iment que l’
é de fé se prononce plu s en avant dans la bouche
que celu i de be'
. Le rapprochement des mâcho i res exigé par b et
par f paraî t i c i être en cause et exige un au tre mode d’
expéri
mentation .
Pou r le reste,confirme ce qu i a été d i t de i , c
’
est—à—di re que
la surface art icu l ée de e'
est mo indre en sy l labe fermée qu’
en
sy l labe ouver te. On peu t comparer ent re eux les tracés et des
fig . 6 . En échange la voyel le l ib re fina le (fig . 5 est identiqueaux voyel les l ibres non finales .
S 10 . L’
ê ouvert de même que a et tou te la série postérieure,ne laissant au cune trace sur le palais
,se trouven t en dehors de
cet art ic le et devron t être étudiés par d’
au tres moyens d’
expéri
mentat ion . Q u’
on compare cependant pou r u le S 20 .
B . VOYELLES A'
I‘
ON ES .
a . La voyel le i .
S 1 1 . Exemples Fig . 7 i (i) . fumi (fumi) . mima,
bibb (mimar , vibo) . pugi (pugu i) .
Fig . 8‘
t ( i) 9 iabak9 îra (ah i r ho va acabar) . empê
biba (En Pep hi va) . pikaba (picava) .
ÉTUDES DE PRONONC IAT IONS CATALANES
Fig . 9 i (i) . az , mai (ay ,m ay) . ya (ya) .
aya (ah ja l) .
Fig . 10 i ( i) . bo_z (Boy) . bog, bu i (Boy ,
vull) .
Fig . 1 1 i (i) . . . be'
i (bey) . , be'
i (vel l) .
Fig . 1 2 i ( i) . . aiga (aygua) . ai ôa(t) (ayguat) .
Nous séparerons l’i atome des figu res 7 et 8 de ceux des au t res
figu res qu i nous fou rn issen t des cas tou t spéciaux
S 1 2 . L’
i atome à la fina le,sauf quand i l est précédé de la fri
cat ive gu t tu rale, nou s donne à peu prè s la même l igne que l’
i
ton ique (fig . 7 7 mais la différence entre la ton ique et
l ’atoue est plu s visi b le quand cel le—ci se trouve dans la sy l labe
précédan t l ’accent (fig . 7 Cet te d ifférence entre les deux
voyel les semble plus marquée enco re pou r G que pou r B . Noustrouvons auss i chez G un recu l considérable de la voyel le atone
,
tant à la finale que dans le mot,quand cet te voyel le est ac
'
com
pagnée d’
une consonne vélai re (fig . 7
Nous avons d ’
au tres tracés de i part icu l iè remen t atone dans le
cou rs d ’
une petite phrase (8 8 Ic i G et B s’
0pposent l’
un a
l ’au t re. Ainsi , l’
i de G dans la phrase abir bo va acabar,offre une
part ie ombrée plus grande que dans En Pep bi va . Chez B el le est
au cont rai re plus petite et ceci s ’
expl ique par une d ifférence de
force articu lato i re co rrespondan t à une nuance de sens .
8 1 3 . Examinons main tenant la natu re des semi— voyel les .
Leu r caractère apparai t net tement dans les d iphtongues décro is
santes . L ’
accen t reposant sur la première des deux voyel les affai
bl it cons idérablement l ’1 . La fig . 9 . permet de com parer a i et i .
Et encore ic i a l ’avan tage de se t rouver à la fin du m ot et par
conséquen t de pourvo i r s’étendre en l iberté . Mais prenons le m ot
a_iÿ 9 (fig . 1 2 i l nous donnera un i dont l ’arti cu lation est rédu i te
au min imum . Débarrassons la d iph tongue de la force de l’
a ccen t
(fig . 1 2 l ’articu lat ion de l’i progressera ,ma i s n ’
arrivera pas
même à la mo it ié du développement s igna l é fig . 1 2 La voyel le
en d iph tongue est l iée au sort de sa vo is ine. Quand l’i est pré
5 8 P . BARN I L S
cédé non'
pas de d mais dee(fig . 1 1 i l s ’
a l longe en avan t et
cet a l longement augmente s i,au l ieu de e
,nou s avons un e
’
(fig . 1 1 En ce qu i concerne les voyel les postérieu res , les fai ts
sont plus complexes . Pou r i précédé de à, G s’
oppo se de nouveau
à B (fig . 10 Quand i est précédé de o, G et B son t d’
accord
(fig . De plus , chez eux le tracé de_o'
+ i est iden tique àcelu i de u —J— i Les voyel les o et et ne la issen t d ’
o rd inai re aucune
trace au pala is art ificiel , m a i s l ’ identi té i ci observée peu t être con
s idérée comme une preuve ind i recte de leu r grande proximité
articu lato i re chez les deux su jets .
14 . Nous jo indrons le y aux voyel les (fig . 9 9 car on
en pourra mieux apprécier ic i l ’art icu lat ion . Son articu lat ion plu s
forte à l ’ ini t iale (9 qu ’
entre voyel les (9 4) n’
a rien de surpre
nant ; nous retrouverons des exemples du même phénomène. Ce
qu ’ i l fau t reten ir pour y c’
est que cette articula t ion est repo rtée
en arriè re et que le faible rétréc issement du couran t d’
ai r n ’
est
q u’
apparent . Le palais ne nou s d it pas tou t . A en j uger par nos
tracés on q ualifierait ley de voyel le, ma is l’ impression acoust ique
fa i t supposer que le passage de l’
ai r est plus rét réc i que pou r une
voyel le. Sous la voûte palat ine l ’organe contrac té peu t t rès bienfortemen t gêner la sort ie
,sans pou rtan t nous fourn i r un palato
gramme tou t à fai t no i r .
b . La voyel le e'
.
S 1 5 . Pu isque en catalan les voyel les a , e en passan t de laton ique à l ’atoue
,sauf les cas de composi tion ou d
’
étymolog ie
popu lai re, perdent leu r qual i té et viennen t s’
obscurc ir en 9,nous
n’
au rons que peu de chose à dire sur l’
e'
en syl labe atone. Ic iencore nous étud ierons cette voyel le dans la phrase.
Pig . 1 3 e(e) . btufa, ufabe'
o‘
kç‘
e (be ho fa l, ho fa be 0
queP) . bafefo
‘
k (va fer foch) .
S 1 6 . N os t racés nous mon tren t a quel po int l ’orei l le peu t
60 P . BARN ILS
Fig . 1 5 abb9, palme, (s)aiba (alba , palma, salvar) .
2 . butge, (r)9mu lku, j aiko'
(vu lga , remo lcar , fal co) . faike,
(d)ètrnz (falca, delme) .
Fig . 1 6 palpabe, bolba (pal pava , bo lva) . blabæ blé
(b lava ,ble) . blal
‘
u,blé
, plaka, klaù (blava, ble, placa , clau) .
F ig . 17 plôu (plou) . atÿ 9 , klau (a lga, clan) .
(s)èuba, aube (seuva, auba) .
1 9 . La plupart des t racés,aussi b ien chez G que chez B ,
dél imiten t la zone art icu lato i re de no tre consonne par une l igneextrême imaginai re t racée ho rizontalemen t de l’échanc rure postérieure d ’
une can ine à l ’au tre. Nou s constatons dans cet espace
tou tes sortes d’
articu lations,tantôt excess ivement avancées
,tan
tôt étrangemen t dess inées en arrière,au po int de dépasser même
no tre l igne. Observons d ’
un peu plus près cette pitto resquemul t ip l ici té .
Le déplacement en arn ere que nous venons d ’ ind iquer appa
rai t seu lement dans des cas où l est précédée ou su iv ie d ’
une
au tre consonne,
sans que ce so it une cond it ion nécessai re,pu isque nous voyons dans les mêmes circonstances des tracésno rmaux ; cf. B . fig . 1 5 avec deux var iantes pou r les mêmes
exemples ; on peu t comparer aussi entre eux G et B (fig . 1 6
avec des résu l tats 0pposés . Mais,l
‘
a où 1 n’
est pas accompagnée
de consonne, le phénomène ne se produ i t pas . Nous n’
en don
nons que quelques exemples,bien que, comme partou t ai l leu rs ,
nous ayons mu l t ipl ié les expériences .
En ou tre,l s
’étend parfo is en arrière, davantage et plus cons
tamment pour G que pou r B . Il n’
y a pas l ieu de s’
en étonner,si l
’
on considère que no tre 1 a un caractère essentiel lement
vé lai re,su rtou t devant consonne ( 14 1 5 Une con
séquence de cette vélar isation est l ’absence d ’
un t racé préc is su r
le pa lais B (fig . 1 5 1 6 et le s imple effl eu rem ent de la voûte
pa latine.
20 . Dans un certain nombre de m o ts, surtou t devant
ÉTUDES DE PRONON C IAT IONS CATALAN ES 6 1
labia le, a lba,ta lp, delme, etc .
, nous prononçons ind ifféremmen t
l ou i i,tandis qu ’
en généra l 1 reste vélai re devant consonne.
Vou lan t explo rer cette évo lu t ion , b ien connue par ai l leu rs, j
’
ai
étudié les mo ts en quest ion sous leu r double forme. L’
n laissa i t
des t races p lus . constantes chez G que chez B . Les l ignes des
figures 1 7 nous font vo i r la part ie tou chée accidentel lemen t parla langue au cou rs de ces tentat ives . En généra l nous pouvons
d ire qu ’
en parei l cas le pa lais n ’
est pas at teint par l’
o rgane, pas
plus que pou r et s imp le. Que dédu i re de ces tracés acc identels ?Il est fo rt poss ib le que nou s ay ons eu le sen t imen t qu ’ i l s ’
ag is
sai t de prononcer un u équ iva lent de l consonne et que ceci
ait influencé à no tre in su le mouvement de la lang ue.
En somme,l’
im préc ision articu lato i re de 1 mont re que nous
avons affai re à un phonème mobi le,pou van t évo luer dans des
directions d iverses ; la langue indécise cherche i c i une stabi l i té
qu ’
el le a perdue,nous ne savons pas à quel le époque.
2 . La consonne r .
2 1 . Exemples Fig . 1 8 pèra, ara, mar (pera, ara,m ar) .
Fig . 1 9 . forum (farùm ) . pork, arp9 (po rch ,arpa) .
Fig . 20 g rap9 , ang r9pa (grapa, engrapar) . krak (crach
Fig . 2 1 braÿ 9 (b raga) . pre‘
u (pren) .
Fig . 22 ram (ram ) . fouke (ronca) .
Fig . 2 3 paruke, arenkaba (perruca, arrancava) . kom rdnk9
(com ronca
Nous a l lons cons idérer séparémen t les deux so rtes de r qu i
figu rent dans la l i ste.
22 . L’
r que nou s appelons s imp le, par 0pposition à l
’
f rou l ée,est produ i te par des vibrations de la po inte de la langue, mo ins
considérables pou r r que pou r r . G (fig . 1 8) nous fou rn i t un
tracé assez d ifférent de B qu i d’
ai l leu rs offre deux variantes pou rles mêmes exemples . On pou rra i t en di re au tan t pour les fig . 1 9 .
6 2 P . BARN ILS
Cependant dans cel les-ci nou s retrouvons plus d ’
accord pou r lesexemples où l
’
r est su ivie d ’
une au tre consonne. Dans ce cas
l’
r est p lus forte que quand el le se t rouve entre voyel les ou à lafina le. La variante la plu s grande de B (fig . 1 8) ne do i t pas nous
égarer . I l faut se rappeler que la plu s l égère vibrat ion de la languepeu t enlever une part ie considérable du tal c du palais et nou s
offri r un dess in étrange ; c’
est dans ce sens que nous dev ons
interpréter no tre var iante et ne pas lu i attribuer plus de vibra
tions qu’
el le n’
en a en réal i té . Une influence in dubi table exercée
sur r par les gu ttu ra les nous est attestée fig . 20 B arrive
même à ne donner au cun signe de v ibration pou r l ’exemple et
un signe seu lement très fa i b le pou r G offre une d ivergence
et semble ne pas vélariser s i faci lemen t l’ i' précédée de gu t turale.
Lorsque c ’est une au tre consonne qui pré cède r (fig . nous
avons des l ignes d ifférentes pou r les deux su jets,mais en tou t
cas des l ignes très rédu i tes q u i nous montren t la fa ib lesse de la
vibrante.
2 3 . L’
? rou lée malgré son énergie vibrato i re ne no i rc i t pas
beaucoup le palai s de G . I l n’
en est pas de même pou r B
(fig . 22 D ’
après les t racés, G do i t éprouver de la peine à
vaincre l ’état de repos de l ’organe et le secouer vivemen t tou t
d’
un coup . Mai s quand i l s ’
agi t de r entre voyel les , la langue se
trouvant secondée par l’
action des au t res sons,touche le palais G
d ’
une façon net te quo ique faib le. Cette faib lesse resso r t mieux
pou r B,car chez lu i nou s avons un terme de comparai son avec
l’
r init iale (fig . 2 3 L’
r rou l ée devient p lu s forte,quand el le
es t précédée d ’
une consonne et tel est également le cas chez G
(fig 2 3 2)
b . NASALES
La consonne n .
24 . Exemples Fig . 24 . . j an (fan) . nap (nap) .
Fig . 2 5 . bbn?, bônbmâ (bona, bon home) .
ÉTUDES DE PRONONCI ATI ON S CATALANES 63
2 5 . La seu le remarque à fai re au su jet de n est sa posi tion à
l ’ in itiale pou r B (fig . 24 el le s ’avance tou t dro i t jusqu’
aux
dents . Ho rs ceci , G au ss i b ien que B nou s offrent des tracés régul iers qu i chez G apparai ssen t plus fa i b les par compara ison avec lafigure 2 5 . Nou s avons constaté, et nous constaterons encore
,
l’
affaiblissem ent des consonnes en tre voyel les , mais i c i c’
est lecontra i re qu i se produ i t . Le carac tère de n n
’étan t pas tou t à fai tcomme celu i des au t res consonnes ne sau rai t non plus servi r de
base fixe.
C . S IFFLANTES
Les consonnes s et
26 . Exemples Fig . 26 se‘
k (sech) . pes (pes) .
Fig . 27 paskw» (pasqüa) . paska (pescar) .
Fig . 28 masa (massa) . kaz 9 (casa) .Fig . 29 (es)bätp , (esbotz a, setze) .
27 . L’
s placée à l ’ in i t ia le ou à la fin du m ot est assez uni
forme,bien qu ’ i l semble que dans la première posi t ion la langue
touche plus le pa lai s en arri ère que dan s la seconde au contra i re
en avant vers le pa la is c’est à la finale que la partie ombrée est la
plus grande (fig : 26 En tou t cas no tre consonne est relative
ment recu lée su r le palai s,ce qu i expl ique son caractère acous
t ique grasseyé . Q uant à s su iv ie de consonne (fig . nous
n’
avons pas de tracés exacts pou r les deux exemples on pou r
rai t cro ire à une influence de l ’accent qu i , se portant sur la
tonique (27 et l’
allongeant par conséquent , a l longe au ss i la
tenue de s ; au contrai re quand 5 est en sy l labe atone (27 le
tracé est plus rédu i t . Au su jet de s ent re voyel les (fig . 28 on
observera seu lemen t que cet te consonne est p lus forte que sa
correspondante sonore (28 L’
affaiblissem ent de ent re
voyel les est bien plus vis ib le chez G que chez B .
64. P . BARN ILS
28 . A se rattachent dans une certainemesu res les figu res 29 .
I l s ’
agi t ic i non pas d’
un double ma is d ’
une consonne mi
occlu sive que pou r le moment nous transcrivons par la.
G montre une fermeture du couran t phonateur un peu plus
avancée vers les dents que B et son t racé est d ’
a i l leurs auss i
plu s grand , ce qu i le rapproche assez des tracés des dentales .
Malgré tou t je ne m e décide pas à donner à nos consonnes un
qua l ificat if déterminé pou r leur l ieu d’
art iculat ion
d . DENTALES
Les consonnes t et d .
29 . Exemples Fig . 3 0 tape, tbke ( tapa , toc a) got,
f e
'
t (gar, fet) . dau , dé (dau ,do) .
Fig . 3 1 beta, bata (beta, bata) . muda, (s)egodo(muda ,
segado r) .
Les seu les den tales que nous ayons son t t et d,cette dern ière
sous forme d’
explosive et de fricat ive. La fricat ive n’
existe
qu ’
entre voyel les, comme le montrent nos exemples .
3 0 . Le 1 prend différents aspects su ivan t sa pos i t ion dans lem ot : excessivement fort à la fina le (fig . 30 un peu plu s affaibl i à l ’ in i t iale ( 3 0 i l est assez rédu i t
,surtou t pou r B
,en tre
voyel les (fig . 3 1 Nou s en constatons donc tro is variantes b iendessinées . S i nous comparons la correspondante sono re
,et c ’es t
seu lement à l ’ in it iale que nous le pouvons fai re, nou s retrou
vons la même distinc tion que pou r et s l ’art icu lat ion de dno i rci t une partie moindre du pala is que cel le de t (fig . 3 0
et Pou r le d intervocal ique, i l ne peu t , pu i squ’ i l n ’
est plus
occ lu sif, donner l ieu à aucune comparai son ; cependant la pet i te
section du palais touchée par la langue (fig . 3 1 nous ren
seigne un peu su r son caractère de dentale faib le et rédu i te.
ETUDES DE PRONON CIAT IONS CATALANES 6 5
PALATALES
1 . Les consonnes e et j
3 1 . Exemples Fig . 3 2 eap9 , ebp9 (xapa, xopa) .
fée (encaix ,feix) . kaea, mêe9 (caixa , m eixa) .
Fig . 3 3 gap», eo'
p9 (xapa, xopa) . jak9 , jobe ( j aca , jove) .brija (pu ja, bo ja) .
3 2 . Les figu res 3 2 nou s donnen t le c prononcé à l ’ in i t ialeà la finale et entre voyel les U ne art icu lat ion un
peu plus étendue pou r e i n i t ia l que pou r e finale est communeà B et à G ; la d ifférence est encore p lus vi sible chez le dern ier
des deux su jets . Entre voyel les nou s ne sau rions établ i r une
zone spéciale in termédia i re entre les deux précédentes,car les
l ignes ici avancen t et là recu len t ; néanmo i ns cette zone est plus
rétréc ie que cel le du c i n i t ia l , et cela suffi t .
3 3 . La sonore j (fig . 3 3 nou s donne une mei l leure
orientat ion . Pou r en faci l i ter la comparaison nou s avons repro
du i t la l igne de e à l ’ in i t iale (3 3 Quo ique habi tuel lementnous ne prononcions pas tou t a fai t au commencement du m ot ,
G et B s’
y sont efforcés à d iverses reprises ( 3 3 Ce j est mo ins
fortement art icul é que le c correspondant et , ce q ui est ici l’ im
portant,la région palat ine touchée est plus étendue que pou r le
intervocal ique ( 3 3
2 . Les consonnances et
3 4 . Exemples Fig . 3 4 faêa, ko'
ê3 (fatxa, corxe) .
maê,bbê (m aig , bo ig) .
Fig . 3 5 fake, ( jaca , jove) . méj 9 fç'
j 9 (metge,ferge) .
3 5 . Nous rencontrons ensu i te les mi—occ lus ives c , La pre
m i ere ne se présente qu ’
entre voyel les et à la finale (fig . 3 4
et la seconde à l ’ in i t iale et entre voyel les (fig . 3 5 et U n
Revue de pbonétique. 3
66 P . BARN ILS
coup d’œ i l su r nos figu res nous mon tre une grande d ivers i té de
tracés et auss i d’
oppos i t ion entre eux . Pour ê la région d ’
arti cu
lat ion varie chez G et B i l en est de même pou r sauf l ’exemple
de B) .
La fermeture de la cavi té buccale se fait en général chez Bd ’
une façon très restreinte au contra i re G m et plus d’ i n tens i té et
a l longe la zone ju squ’à la région dentai re. Les deux tracés de
(fig . 3 4) ent re voyel les et à la finale n’
indiquent aucune
d ifférence d ’
articu lat ion . O n serai t tenté de cro i re qu ’ i l n’
en est
pas de même pou r j‘
,mais bien que le t racé de à l ’ in i t iale
(fig . 3 5 so i t plus étendu,sur tout chez B
, que celu i dej inter
voca l i que ( 3 5 une réserve s’ impose peu t- êt re. Le tracé de B
peu t fo rt b ien être dû au sou l èvement de l ’o rgane pendant {sa
tension,p lus grande l ’ in i t ia le qu
’
à la su i te d’
un au tre phonème.
f. MOU I LLÉES
Les consonnes l et
3 6 . Exemples : Fig . 3 6 Jam , lép (llam p, 1lop) . bal,mo
‘
l (bal l , mo l l) .
Fig . 3 7 bab,mol? (bal la , mo l la) . bal—la, ammel-la
(bat l le, ammetlla) .
Fig . 3 8 bôrt, 9mpèn (bony , empeny ) . kuya, pena (cunya,penya) .
3 7 . La consonne (fig . 3 6 et 3 7) permet de constater une
fo is de p lu s des var iations de zone articu lato ire su ivant la placeoccupée par la consonne dans le mot . Ces d ifférences son t para llèles pou r G et pou r B . La zone va en décro i ssant de l ’ i n i t ia le
(3 6 à la fina le (3 6 et à l’ intervocalique (3 7 L’
exemple
de la figu re 3 7 offre un caractère spécia l ; i l s’
agi t en effet d ’
unepro longée ou doub le, en ce sens que l
’
art icu lat ion étreignantle passage de l
’
a i r, la tenue de la consonne a plus de du rée, ce
qu i donne l’ impression d ’
une t + _l .
‘
Pou rtant les tracés sont
68 P . BARN IL S
$ 4 1 . La figu re 3 9 po rte le t racé de bènk je vends
et de benpa je vends du pain Ces deux exemples donnent
un t racé un ique,preuve que le n garde intacte son articu lat ion ,
malgré la d ispari t ion du k . De même tink je possède et
tin sabates je possède des sou l iers blank blanc et bla ir
nèÿ ra blanc-no i r et ainsi dans tous les cas où le d isparaî t en
syntaxe dans les groupes de t ro is consonnes .
N ou s espérons pouvo i r b ientôt compléter cet te étude des sons
du catalan avec d’
au tres moyens d ’
expérimentat ion et abo rder
ainsi de plus près quelques-uns des intéressants problèmes que
soul ève la phonétique de cette langue.
P. BARN ILS .
LA MESURE DES DURÉES RYTHMIQUESDANS LES VERS
Il n ’
est pas beso in de se demander commen t se mesu rent enmusique les durées ry thmiques . No tre no tat ion l ’ indique depu islongtemps pou r les mesu res , par les barres ; pou r les sons , par
la va leu r des no tes ; pour les temps , par la répart i t ion des sons
dans des fract ions égales de .la mesu re. Tou t le monde le sai t .Mais quel est le principe de cette no tat ion
, qu i est devenue hab i
tuelle et presque insti nctive, on ne s’
en rend pas tou jou rs compte.
Qu ’
es t— ce que la mesu re, par exemple ? El le ne co rrespond que
de temps à autre,et par hasard, au grou pemen t des notes
,son s
d’
un instrumen t ou sy l labes d’
une langue les notes fo rment
entre el les des grou pes rythmiques , que coupe souvent en deux
tronçons la barre de la mesure. Ces groupes ry thmiques , don t la
compos i tion varie san s cesse par le nombre et l ’o rdre des (no tes)fortes et des (no tes) faib les , ne sau ra ien t const i tuer l
’
un i té du
ry thme. Cette un ité,c’es t la mesure, dont le commencement et
la fin sont s igna l és par le temps marqu é,ou i ctus , c
’
est-à- dire
par cet endro i t de la phrase mu s i cale où l'
on bat la mesu re et
qu ’
on met en rel ief par un accro issement d ’ intensi té . Si la
mesu re ne com c ide pas fo rcément , ni même d’
o rd ina i re, avec le
groupemen t des no tes,c ’est qu ’
el le n’
es t autre chose, tou t comme
les au tres du rées rythmiques,qu ’
une s imple d ivis ion du temps
signalée par un phénomène sono re, le temps marqu é . Le temps
marqué ne const i tue pas p lu s une so lu t ion de cont inu i té dansla phrase mus ica le, par exemple
, que la crête d’
une vague ne
détermine une so lu t ion de continu i té dans la m er et dans le
mouvement de l ’eau.
Vo i là pou r la musique. Là,s i l
’
on ne se rend pas tou jours
70 PAUL VERR IER
compte du principe su ivi , tou t le monde est au mo ins d ’
acco rd ,
en théorie et en prat ique, su r la no tat ion des du rées ryth
m iques . I l n ’
en es t po in t de même en poés ie. Ic i,comme en
témo ignent les scans ions d iverses et même opposées des m étri
c iens,c ’est encore le chaos . Pou r y mettre ordre et clarté , i l fau t
chercher à établ i r un principe.
L’
o rei lle, ou plu tôt le sens du ry thme, ne peut .év idemment
mesurer les du rées qu’
à l ’aide d’
un po int de repère constant .
Nous en avons un , net et préc is , dans le temps marqué
Le so lei l le revêt d ’
éc latantes cou leurs .
LECONTE DE L I SLE .
The way was long, the wind was cold .
W. SCOTT .
L’
un i té du ry thme ne peu t donc être que l’ interval le compris
entre deux temps marqués success ifs . Q u’
on l ’appel le mesu re ou
pied,i l ne s
’
agit pas là d’
une d ivis ion phonét ique ou logiquede la matière l ingu ist ique en groupes indépendants
,ma is d ’
une
s imple d ivision du temps, qu i est s igna lée par un phénomène
sono re,un accro issement d ’ in tens i té . Pas plus q u
’
en mus ique,
i l n ’
y a de co ïncidence fo rcée avec les g roupes rythmiques,dont
la fo rme varie, d’
a i l leu rs , t rop souvent,
’
m êm e en fran ç ais,pou r
qu ’ i ls pu issent serv i r d ’
un i té au rythme. Pas p lus qu’
en mus ique,
le temps marqué ne const i tue une so lu t ion de continu i té dansla su i te des sons
,c’est-à —d ire
,ici dans la paro le.
Où i l tombe,ce temps marque, c ’est—à—di re quel les sont les
(syl labes) fortes , vo i là qu i s’
entend du premier coup . Ma is aquel endro i t de la sy l labe ? I l suffit , semble— t—i l
,
’écou ter avecun peu d
’
at ten tion pou r s ’
apercevo i r qu ’ i l co ïncide avec le com
m encem ent de la (voyel le ou consonne) sy llabante
A lance that sp l inter’
d l ike an icicleTENNYSON .
DU REES RYTHM IQUES DANS LES VERS 7 1
Auss i le fai t a- t— i l été reconnu,à la s imple audit ion
, par les
métri ciens q u i se sont occupés de cette quest ion , en tre au t res
par MM . Havet et M inor . I l est faci le à vérifier . Q uand on bat la
mesure en frappan t du do igt sur une table,le coup coïncide avec
la voyel le ( l’
observat ion , je cro is , est de M . Landry) . En ou t re,
les consonnes in i t iales de la fo rte ne part ic ipent pas , en anglai s
du mo i ns , à l’
abrègem ent qu ’
el le sub i t quand le nombre desfaibles augmente D ’
yon like .
the sance ? H e’
s a sancy
fel low H e sau ci ly cal led m e‘
foo l ’ (v . Verrier,
Métrique ang la ise, III , 87 e, 90 , 9 3 , 2e
, 9 6 b) . Ces consonnes
n’
appartiennen t donc pas au même interva l le ry thmique que lereste de la forte, mais au précédent . Enfin
,la tendance à l ’ iso
chronism e apparaî t p lus nettement quand on fai t commencer les
interval les,mesu res ou pieds
,avec la sy llabante des fortes
ce ne peu t être là un s imple hasard ,le ca lcu l des probabi l i tés
s’
y oppose,
ma is le résu l tat d’
un cho ix subconscient de cet
endro i t comme temps marqué . J’
onbliais une au tre preuve dans
tou tes les versifications,i l fau t et i l suffi t que la rime finale com
mence avec la sy llabante de la dern i è re forte. Si la ressem
blance des consonnes ou semi— voyel les précédentes est recherchée
en français,el le n
’
y est n i obl igato i re ni même hab i tuel le,excepté
chez certai ns poètes,et on l ’ évite so igneu sem ent dans les langues
german iques,où ces phonèmes ini t iaux sont pou rtan t b ien plus
intenses et bien plus longs . I l s n ’
appart iennent donc nu l le part
au dern ier pied (s imple ou composé), q ue do i t embrasser la
rime ; i l s précèden t le dern ier temps marqué , que la rime a
surtou t pou r ob jet de s ignaler . Mai s l’allitération Nous y viendrons tou t de su i te. D ’
ai l leu rs,si le temps marq ué tombai t su r
les consonnes in i t ia les , i l ne tomberai t souvent sur rien d’
au tre
qu ’
une occlu sive glo ttale à peine aud ib le (Eine) , ou même sur
rien du tou t (a ll , a i r )
Die K leine, d ie Peine, die Reine, die Eine
Der Eine spra ch Wieweh wird m i r !H enri H EIN E.
72 PAUL VERR IER
Am idst the all—surround ing a i r .
All we hope and all we love.
S H ELLEY .
Pu isque les consonnes in it ia les de la fo rte en sont séparées
par le temps marqué et se rattachen t ain s i à la faib le précédente,i l en décou le nécessai remen t que les syllabes
,fa i b les comme
fo rtes , se mesu ren t de sy llabante à sy llabante. Vo i là, en effet,et c’est là une preuve i rréfu table de ce qu i précède, vo i là
comment on procède dans les vers ifications où l’
on mesu re c on
sciemment les sy l labes en tenan t exactement compte de la quan
tité . Remarquons bien qu ’ i l ne s’
agi t pas d’
une théorie de m étr i
c iens,qu ’
on pou rrai t ten i r pou r su jette à cau t ion,mai s d ’
une
prat ique antér ieure aux métriciens et c ommune à des peup les
aussi é lo ignés dans l’
espace et dans le temps que d ifférents de
langue et de civ i l isation Grecs du temps d’
H om ère et de Péri
clés,avec leu r accentuat ion mélod ique et leu r versificat ion pure
ment quant itat ive ; Germains du Ives iècle au x1n
°
(Is lande) ,avec leu r accentuat ion dynamique et leu r vers ification essent iel le
ment accentuel le. Dans ces deux membres anapestiqnes
o< A7t'
o
’
r s cp i / t r s po v 52X7. 0
ox o'
r o ç a nn i o y_ o> v x pür: r s r v eus /a u .
EUR IP IDE, H ippol . 1 9 1-2 .
ce n’
est pas la syl labe in it ia le du second membre qu i est al lon
gée par les consonnes c v. m ais . la fina le du premier . Dans ces
deux pet i ts vers ou hémist iches de l’Edda,
stjornor ne visso x
hvar stu,pe ot to . x
Volospÿ , 5 11 . 5 .
1 . Je représente le tem ps m arqué par un po int, le tem ps m arqué princ ipaldes d ipod ies par deux po ints .
DURÉES RYTHM IQUES DANS LES VERS 7 3
la deux 1eme sy l labe du second est t ra i tée connu e brève,malgré
la fo rce et la longueu r du groupe allitérant st Les consonnes
allitérantes appartiennent par conséquen t à la fa ib le précédente,dont la quant i té est ind ifférente (x) comme cel le de tou tes les
faib les de la poés ie german ique ancienne, et non à la forte su i
vante,dont la quan t ité es t soumise à des règles str ictes . El les
ne contiennent pas le temps marqué,d ’
au tant qu ’
el les peuvent
être absentes
Orm a r unner, en are
VQlos]>o st r . 5 0 .
El les serven t même bien mo ins à l’annoncer qu ’
el les ne sont
renforcées et mises en rel ief par son vo is inage.
Les du rées ry thmiques se mesu rent donc,qu ’ i l s
’
agisse de
pieds ou de sy l labes , de sy llabante a sy llabante. Comm e la syl la
bante est d ’
ord inai re une voyel le, tou j ours en français, M . Lan
dry a proposé pou r cette éva luation des durées le nom de scan
sion prévocalique. M ieux vaudra i t l ’appeler scansion présy lla
bante. Enco re ne sera i t-ce pas abso lument exact la du rée com
mence avec la sy llabante, non avant. Pas plus que pou r le piedon la mesu re, i l ne s
’
agi t ic i d ’
une d ivis ion l ingu ist ique, ma is
bien d ’
une s imple d iv is ion du temps , d’
une du rée rythmique,
dont le commencemen t et la fin sont indiqu és par l’
arrivée d ’
une
sy llabante. Comme ces du rées reposent su r un phénomène sy l
labique et qu ’
el les co rresponden t par leu r nombre au nombre
des sy l labes, on peu t les appeler syllabes ry thm iques , par opposi
t ion aux sy l labes l ingu ist iques, aux syllabes vulga ires .
Où fau t—il chercher l ’expl ication de cette mesure des du rées ,qu i s
’
es t imposée d ’
el le-même à tou tes les versifications Ce n’
est
pas dans la d ifficu l té de d istinguer les sy l labes au sens ord inai re
du mot, les sy l labes vu lgai res . Cet te difficu l té existe. El le ne se
présente pas sous la même fo rme dans tou tes les langues . On le
vo i t à la mani ère don t se coupen t les mo ts à la fin des l ignes
74 PAUL VERR IER
En français , quand i l n’
y a qu ’
une seu le consonne entre deux
voyel les , nous la rattachons à la su ivante ; quand i l y en a plusd ’
une,à mo ins que la seconde ne so i t 1 ou r
,nous les répart is
sons entre les deux syl labes , en rat tachant la première a la voyel leprécédente et le res te a la su ivante. En is landais , les consonnes qu isu ivent une voyel le s
’
y rattachent tou tes (excepté quand la dern ière est v ou r) ask—a
,sett-u , bôfd— in—u
, ma rg- ir
,best—a r (legg
jam ,bag
-w,ved— r it) . Q u
’
y a—t- i i de vraiment phonét ique dansces d iverses o rthographes O n ne l
’
a pas enco re bien étud ié et on
ne l’
établira pas sans peine. En angla is,la question est assez com
pliquée. Q uand une consonne se t rouve placée entre deux
voyel les , el le se rattache à la première par l’
attaque (l’
im plosion
dans les occ lusives) et à la seconde par la détentes i bien qu ’
el le se partage en réal i té entre deux sy l labes rat— ta i l,
meta l,metre
,a t a ll times, a ta l! man . On ne s
’
en aperço i t,i l est
vra i,sau f dans le premier exemple
, que par un effo rt d ’
at tent ion .
Pou r no tre o rei l le,la consonne intermédiai re se rat tache à la sy l
labe précédente ou à la su ivante,selon que l
’
accent en fai t ressor
t i r avec p lus ou mo ins de fo rce,so i t l ’attaque, so it la détente
met-a l, rue—tre ; a ta l! man,a t a ll times
,ra t ta i l (où la fo rce de
l ’attaque et de la détente donne l ’ impress ion d ’
une consonne
double) . Pou rrions-nons mesu rer les du rées ry thmiques d’
après
cette sy l labat ion N on seulement el le n’
a pas de po int de repère
constant,ma is el le nous laissera dans l ’embarras pou r tou te con
sonne comprise entre deux voyel les inaccentu ées , comme l’
ss de
necessa ry dans une prononciation rapide,i l est impossi ble à
l ’o rei l le de l’attribner à la syl labe précéden te plu tôt qu’
à la su i
vante,ou inversement . B ien plus , quand i l s
’
agira de mesu rer les
du rées sur nos tracés nous serons obl igés dans les cas ind i
qués plu s hau t, et dans tous les semblables, de couper les sy l
labes ent re l’
attaque et la détente de la consonne intermédiai re
la transcription met-a l,rue— tre
,a t a ll
,a ta ll
,etc .
,ne sera donc en
réal i té qu ’
un t rompe— l’
œ il . Que ferons—nous, enfin,quand i l y
OBSERVATIONSSUR LES INSERTIONS DE CONSONNES
EN SUÉDOIS MODERNE
J’
ai lu avec intérêt l ’art icle de M . Millardet,paru dans la
Revue de Phonétique, I ( pp . 3 09-
446 . I l confi rme l’obser
vat ion audi t ive et la complète. J’
y a i cependant relevé quelques
omiss ions ou erreu rs . Comme i l sera i t t rop long d’
entrer dans
le détai l, je m e bornerai à des considérat ions générales
Les insert ions de consonnes don t i l s’
agi t con s isten t dans le
renforcemen t et la fixat ion au mo ins part iel le d’
un son t rans i
to i re régul ier ou i rrégu l ier, je veux d i re inévitable ou occasion
nel .
Dans la l iste des phénomènes s imi lai res (p . i l y ava i t
l ieu de ci ter les fractu res du vieux no rro is et du viei l anglais .
En vieux no rro is,avantDne consonne influencée par un u [u ,
u] ou un a su ivants,i l se développe après e un [i l] ou un [a] ;
pu is *
[eu eo eo] > .ia jo > jo,*
[eu ça] ia ja
par exemple,v ieil islandais nom . mje hydromel ”
medaR ,
gén . mjadar*medaR ,
au prés de dat . m idi*med iu . En viei l
angla is,avant une b avant une 1 ou une r su ivies d ’
une con
sonne et avant une consonne influencée par un u [i t] on un a
[ri] su ivants , i l se développe un [u] ou un [h] après a , eet i , pu is*
[au,ago] ea bref [eu] de la même mani ère et sans
dou te à peu près en même temps que*au germanique devien t e”a
[eu] : par exemple, ea rm bras go tique arms et viei l islan
1 . Je m ets entre crochets la transcription phonét ique, qu i est cel le de
M. Rousselot, excepté [<p] constri ct ive bi labiale invoisée,et pour ind iquer
le dévo isem ent . Pour le vocabulaire je renvo ie à m a Me'
tr ique ang la ise, Paris ,1909
— 10 (MA) . t 1. 2 1-3 0 .
CONSONNES EN SUÉDOI S MODERNE 77
dais armr , meada hydromel medu (conservé en saxon occ idental) , siolufr argen t go t ique si lubr . Mais passons .
M . Mi llardet se demande s i les épenthèses qu ’ i l étud ie en sué
do is ont déj à été remarquées (p .
I l y a une v ingtaine d’
années , M . O tto Jespersen s ignalai t
l ’ émission d’
ba leine (v . MA,t . I
,24 ; Rem . par laquel le se
term inent les vo vel les vraimen t finales dans les langues scand i
naves , particu lièrem ent è n dano is (V . Dahlernp og Jespersen ,Kortfattet danskLydlære, Copenhague,
1 889 , 20 ; cf. Jespersen ,
Tbc Articula tion of Speech Sounds , Marbu rg,1 889 , 1 10
,p .
'
70 ;
Dania , I , Copenhague, 6 1,p . 5 6 et Fonetik
,Copen
hagne, 1 897— 1 899 , 2 5 8 , p . 3 2 5 ; i l m e semble que M . Sweet
en avai t dé j à parl é dans son art ic le On Danish Pronuncia tion,
Londres , 1 87 3 - 1 874 , et dans son H andbook of Phonetics, Oxfo rd ,
1877 , comme i l l’
a fai t p lu s tard dans son Pr imer of Phonetics,Oxford
,1 890, 122 , p . C ’
est un [b] instable. c’
est— â— di re
s 1)—2 on 5 1 )- 3 , qu i conserve le t imbre de la voyel le. Après une
voyel le fermée [i , u , u , y], i l est assez fort , su rtou t peu t—ê tre en
dano is,pour frapper immédiatement l ’orei l le de l ’observateu r le
plu s superficiel dano i s vi nous [v iibr] et un maintenant
[nuue ressem blent à [vif, uw], sans pou rtan t leu r êt re identiques .
I l y a une trenta ine d ’
années,M . Sweet no tai t dans son H and
book of Phonetics (p . 147) la bi-aspi rat ion des occlus ives invo i
sées doubles en is landai s moderne. M . S torm le rappel le dansson Eng lische Philolog ie (deuxième éd it ion ,
t . I,Leipzig , 1 892 ,
p . et M . Jespersen ment ionne le fai t dans sa Fonetik
(p . I l y a en part i cu l ier avan t la consonne géminée une
assez forte émiss ion d ’
ba leine et même de sou ffle, c’
est —à—d ire 5 1)3 , qu i empiète su r l
’
occlusive,et comme la bou che n ’
abandonne
que peu à peu l’
art icu lat ion de la voyel le précédente, on entendaprès [u], par exemple, un [h] net tement labial isé et quel que peu
vélaire dôttir fi l le et dtta hu i t peuvent se transcri re
ou [doub aub souvent même
78 PAUL VERR IER
I l en est à peu près de même dans les Féroé
(S to rm ,e.
,p . 240) et dans certa ins d ia lectes norvégiens
, par
exemple dans leno rd du Gndbrandsdal où je l’
ai remarqué tou t
récemment . J’
ai s ignal é le phénomè ne,pou r l’islaùdais
,et
j’
en ai donné une brève expl ication,dans MA (1 . III . p . 206
ZO7 . S 3 0 5 .Comm eles occ lus ives invo isées vra iment finales sont aussi assez
fortes en scandinave (j’
appl ique fo rte à l ’expirat ion), a ins i qu’
en
témo igne leu r aspi rat ion ,très sensib le en dano is
,le son t rans i
to i re qu i les précède se termine également par une l égère émis
s ion d’
ba leine. O n a a in s i un [b] qu i conserve le timbre de la
voyel le précédente et antic i pe en même temps sur l ’art i cu lat ionde la consonne su ivan te ent re i et p, comme dans suédo i s
klipp coupe ! ce [b], q u i part icipe de [i] et de [p], ressemble
à un [c] l égèrement arrond i , lab ial isé ; le m ot peu t se t ranscri re
Ce [b] a ins i mod ifié par la consonne su ivante, permet
de d istinguer ent re les tro i s mots suédo is lâpp lèvre lâ tt
léger et lâ ck qu i fai t eau même quand les explos ives
proprement d i tes s’
am uïssent (v . No reen,Vdr t sprdk, I , Lund ,
1 9 1 5 , p . 400
Dès 1878 , M . Lundell s ignala it ce [b], sous le nom de voyel le
dévo isée,dans les mo ts tel s que gott bon loppe puce
bri ck ru isseau (Det svenska landsmdlsa lfabeæt, S tockho lm ,
p .
Fau t- i l y vo i r le commencement d ’
une nouvel le fractu re
El le ne ressemblera i t guère aux anciennes,pu isque la seconde
parti e de la voyel le dissociée parai t tendre à se t ransfo rmer'
en
cons trict ive, généra lemen t invo isée, cette consthctwe qu’
a c ru
entendre M . Millardet et qu’ i l a cru l i re su r ses t racés . Mais
nous ne sau rions préjuger l ’aven i r . Revenons aux phénomènesactuels .
Pendant son sej ou r à Greifswa ld , en 1 892 , M . Rousselo t aobservé ce renforcem ent du son transi to i re dans la prononciation
CONSONNES EN SUÉDO IS MODERNE 79
d’
un Suédo is . I l a pub l ie un de ses t racés,avec de brèves expli
cat ions , dans son Précis de prononciation frança ise (Par is ,
P 77
Les fa i ts qu’
expose M . Mi llardet étaien t donc connu s , analysés même, au po in t de v ueaud it if et art icu lato i re
,avec une exac
ti tude qu’ i l n ’
a tteint pas tou jou rs malgré l’
a ide de la phonét ique
expérimentale. Son mérite n’
en reste pas mo ins t rès grand i l
ne les a pas seu lemen t redécouverts de lu i—même,i l en donne
dans de nombreux t racés une preuve vis i ble, i l en montre l’ im
po rtance par des mesu res précises . Son étudeminu t ieuse,en con
firm ant et en complétan t la’
s imple observation,rendra service à
la phonétique suédo i se.
Pau l VERR IER,
Charg é de cour s d la Sorbonne.
LA QUESTION DU PASSAGE DES SONS
En parcou ran t les t ravaux de phoné tique expérimentale,on
cons tate qu ’ i l n’
y a pas d’
uni té dans la façon de dél imiter et de
mesu rer les sons . On est d ’
acco rd sur les sons eux—mêmes, onl ’est mo ins quand i l s ’
agi t du passage de deux sons vo isins (gl ide) .
Si nous prenons par exemple le m o t papa (fig . n ous y t rou
vons deux sortes de ces sons interméd iai res : I° l
’
un,de la con
sonnep :‘
t la voyel le a°
2° l ’autre
,de la voyel le a à la consonne p.
Or,les uns disen t qu I l fau t attri buer les deux passages à leu rs
voyelles ; d’
au tres at tribuen t les deux ou bien l’un d ’
eux au mo ins
à la consonne vo is ine ; d’
autres enfin fon t une so rtede compro
m is en coupant le passage en deux et en le distribuant entre la
voyel le et la consonne. Ce désacco rd est un peu troublant,et peu t
jeter des dou tes sur la va leu r des mesu res a ins i étab lies . I l peu t
donc ê tre u t i le d ’
examiner la quest ion .
Prenons d ’
abord le premier passage ment ionné,celu i de
consonne à voyel le (fig . I l est assez nettement marqué par
l ’élévat ion du 3° tracé et par la forme des vibra t ions du tand is
que le co rps de la voyel le,ind iqué par la 2
°et 3
° perpend icu lai re,a des vibrat ions relat ivement grandes et assez semblab les les unes
aux au tres,cel les q u i co rrespondent à l ’é lévat ion sont pet i tes
et d’
un au tre aspect que le reste.
Ce q ui se v_oi t aussi du premier coup su r la figu re,c’est q ue
le commencemen t de l’eXplosion coïncide avec le commencement
des vibrat ions laryngiennes i l suffi t de comparer les tracés
bucca l et nasa l . Donc le brui t consonant ique et le son vocal ique
se produ isent s imu l tanément le passage est a lo rs const itué par
une po rt ion commune à la consonne et à la voyel le, et rigou
reusement parlant, on devrai t le compter deux fo i s pou r la
82 J . CELUMSR Ÿ
consonne et pou r la voyel le,ce qu i en effet peu t se fa i re
,quand
i l s ’
agit de donner la durée entière de chaque son séparémen t .
Mais cec i est peu prat ique pou r la mesu re des syl labes parexemple.
I l fau t donc se déc ider et j ust ifier sa décis ion . M . Rondet cro i t
que, seu le,la du rée des voyel les fa i t une impress ion nette sur
notre sens audi t i f ; i l a jou te alo rs le passage a la voyel le (Pr incipes
de phonétique généra le, p . C ’
est auss i de cette façon que
m esu rentMM . Co l inet (De qua ntiteit der vocaa l a) et Bogoroditz k i
(Prononc ia tion com . russe, p . M . Meyer adopte auss i le
même principe. I l d it expressémen t (Eng lische Lautdauer , p . 8)
q ue, dans ses mesu res de la du réedes consonnes , cel le des passages
n’
es t pas comprise. Et a la page 3 1 du même trava i l i l p récise
encore La du rée des voyel les a é té cal cu l ée depu is la fin de
l’
oc c lu sion on de la constriction jusqu ’
au parfa i t accompl issement
de l’
occ lns ion on de la constriction de la consonne su ivan te.
Cet te dél imitat ion,d i t— il
,est d ’
acco rd avec le pro cédé pra t iqu é
par M . Rousse10 t et ses élèves et en part ie auss i avec celu i de
MM . Wagner etViè to r . S i nous laissons decôté la dern ièreasser
t ion,
on verra plus lo in cequ ’ i l en fau t penser l ’examen des
tracés no us montre q ueM . Meyer est tou t de même un peu trop
l ibéra l pou r les voyel les en y faisant ent rer tou t ce qu i su i t l’
ou
verture des o rganes : l ’explos ion tou t ent ière et m êm el’
asp iration
qu i la dépasse. Cela pourra i t se sou ten i r pou r un p frança is
ou s lave,dans lesquels le son voca l ique s
’
annonce avec l’explo
s ion ; et enco re,cela ne serai t pas tou jou rs poss ib le dans u ne
prononciat ion p lus fo rte une part ie de l ’explos ion du dev ien t
sou rde et possède des vibrations pu remen t consonant iques vo i r
Rou sselo t,Pr incipes , p . 4 5 4 , et Chlum skjr , Essa i de mesure des
sons et syllabes tchèques dans le discours suivi , fig . 8 . C ’
est mo ins
poss ib le encore pou r t et k où le commencemen t de l ’explosionest d ’
ord ina i re pu remen t consonantique,et i l y a imposs i b i l i té
abso lue pour l ’anglais et l ’a l lemand non seu lement les o cclu
84 CH LUMSK Ÿ
reusement ce gl i ssement est trop nettement entendu,su rtou t
quand les Anglais ou les Al lemands ont à prononcer des mo ts
frança is tel s q ue père,qua i etc . Donc l ’effet acou st ique de l’as
pirat ion et sa durée montrent que M . Meyer au ra i t m ieux fa i t degarder la dél imitat ion par laquel le i l ava i t commencé dans leMaî trephonétique, 1 90 1 , p . 60 (vo i r sa remarque
,p . 3 5 6, Zu r
vocaldauer) . A cette époque i l ava i t cal cu l é la du rée des voyel les
sans cette aspi rat ion . M . Rondet, i l est vra i , ne va pas si lo i n queM . Meyer ; cependant la ju st ifica t ion qu
’ i l donne de son procédéne me parait pas sat isfaisan te. S
’ i l n ’
y a que la durée des
PIG . 3 .
uPOlfl ]
prononcé par un Am érica in .
En haut,nez au m i l ieu , bouche en bas , d iapason (200 v .
voyel les qui fasse l’ impress ion nette sur no tre sens auditif ce
n’
es t sûrement pas cel le du passage qu i peu t cont ri buer a cet tenetteté , é tant donné la fo rme des vibrations de l ’ élément
vocal ique et leurs pet i tes ampl i tudes . Le son vocal ique do i t y
être fai b le par rappo rt à la force de l’
exp los ion consonant ique,c’est donc cette dern ière qu i a le plus de chance de prévalo i r
pou r ce moment— là . Vo i là pou rquo i i l vau t mieux a t tri buer cette
port ion à la consonne. C ’
est le procédé de MM. Rosapelly
(M . S . L .,X , p . Rou sselo t et de la plupart de ses él èves .
Quan t à M . Scriptu re,i l parai t hés i ter pou r les deux passages,
ce qu i s’
expl i que principa lemen t par le fai t qu’ i l n ’
a qu ’
un seu l
tracé ; auss i t rouverai t- il plus commode de compter les passages
séparément .
LA QUEST I ON DU PASSAGE DES SONS 85
Ce qu i a été d i t pour les occlusives sou rdes, se rencontre dans
les sonores avec les d ifférences amenées, bien entendu , par la sonorité l’explosion y est au ss i mo ins fo rte et le passage peu t— êtreplus court . I l est encore p lus cou rt pou r les constrictives sourdes
(quelquefo i s une seu le vibration) , tandis qu’ i l s’al longe un peu
pou r les constrictives sono res .
En somme, ce premier passage parai t offri r mo ins de difficultés que le second , celu i de voyel le à consonne. Ce dern ier
s ’annonce sur le tracé par une l égère descen te pou r les occlus ives ,
par une peti temontée pour les constric tives . En même temps les
ampl itudes , grandes au commencemen t, décro i ssent vers la fin et
s’
altèrent . C ’
est précisémen t le mouvemen t o rgan ique exprimé
sur le tracé qu i a décidé M . Rosapelly à attri buer auss i le second
passage à la consonne. De même,en dehors des sy l labes ry th
m iques don t nous n’
avons pas à nou s occuper,c’est le pro
cédé de M . Verrier (Métrique ang laise, III, Au con trai re,
su ivan t le principe c i té p lu s hau t,M . Rondet attribue au ss i le
second passage à la voyel le. De même M . Josselyn (Phonétiqueita lienne
,La Parole
,1 90 1 , non pas cependant sans une
certaine hésitat ion qu i se man ifeste quand i l s’
agi t de la d ivis ion
des sons sur les t racés (vo i r au ss i Phon . espagnole) . M . Grégo i rea deux principes bien d ifféren ts selon qu ’ i l se propose de d iv i
ser un mo t en sons ou bien en sy l labes . Vo ic i comment i l déli
mitela voyel le dans le m ot tra i tèrent (Syllabefrança ise, La Pa role,1899 , Le commencement de l’oc clusion du second tmarque la fin de la voyel le les co rdes vocales s
’
imm obi lisent .
C’
est donc la fin des v ibrat ions de son tracé qu i lu i i nd ique
la fin de la voyel le, et_ ainsi le passage ent ier appartiendrai t à la
voyel le comme chez M . Rondet . Le t racé de M . Grégo i re est
s implemen t celu i de la bouche, et comme le montre la figure
de la p . 1 67 de son art i c le,la plume dont i l s
’
est servi n’
étai t
pas assez sens i b le pou r rendre tou tes les vibrat ions du cou rant
d’
ai r,surtout cel les qu i sont p lu s fa ib les vers la fin du passage.
86 CH LUMSK Ÿ
N ’
ayant qu’
un seu l t racé , insuffisant pour le renseigner su r le
momen t exact où les vibrat ions du larynx cessent , M . Grégo i rea été tout natu rel lemen t amené à placer le tra i t , s éparan t lavoyel le de la consonne, non pas à la fin réel le des vibrat ions bu cca les
,mais un peu avan t
,de sor te que con t ra i rement à sa pensée,
par sui te de l’ insuffisance du tracé un ique, i l coupe le passage en
PIG . 4 .
Calque des tracés deM. Meyer .ddkt
’
d .
En hau t , cou rbe du courant d’
a ir bucca l ; en bas , tracé des cordes {voca les Les
po int i l lés perpend icu la i res ont été tracés ensu ite et i ls indiquen t les l im i tes de chaque
son . En a,fin de l
’
o cc lu s ion du d de dd . a - b du rée de la voyel le à . En b,l
’
occlu sion
du k est accom pl ie. Dans la pa rt ie ini tiale de l ’occ lu s ion ,on vo it encore les vibrations
des cordes voc ales . En c,fin de l
’
oc clus ion du k . En d, l
’
oc clus ion du d de kid est
ac compl ie.
da“
süs .
En hau t, cou rbe du cou rant phonateur bu c ca l au m i l ieu ,tracé du larynx
,en bas ,
cou rbe du tem ps [suppr im ée i c i]. Les courbes comm encent aprè s le prem ier t iers de âet sont coupées à peu près au m i l ieu du second s . La c onstr ict ion de l ’s in i tia le est
‘
accom p l ie au m om ent m arqué par le po int i l lé m ené en a et du re ju squî
au po int i llém ené en b . Entre b et c on rem arque le souffle sourd (st imm loser Abhauch) du passagede i
’
s à La constr ic t ion de l’
s finale est accom pl ie en d .
LA QUEST ION DU PASSAGE DES SONS 87
deux en attr ibuant une po rt ion à la voyel leet l’
aut reala consonne.
—'
Si dans lesmesu res des sons simples la voyel lea été un peu écour
tée,el le est considérablemen t al longée quand i l s
’
agit de la syl labat ion . Car les sy l labes examinées par M . Grégo i re comprennen t nonseu lemen t la voyel le et son passage, mai s encore l’occ lus ion entière
de la consonne su ivante. M . Grégo i re cherche à ju st ifier son pro
cédé,p . 269 Phonétiquement (M. Grégo i re veu t d i re probab le
men t phy s io logiquement) , i l va sans d i re que l’
occ lus ion se rat
tache à la consonne c’es t l ’ i n terva l le pendant lequel les o rganesla pos ition Ma is
,a jou te- t- i i
,en parlan t des
mo ts commençan t par une o cc lu s ive sou rde comme tra i tèrent,
nous . sentons que, pou r l’
o rei l le, le m o t ne débu te véri tablemen t
qu ’
avec l ’explos ion . I l do i t en être de même pou r la seconde
sy l labe pou r l ’o rei l le têrent ne commence qu ’
avec l ’exp losion .
Force nou s est donc de j o indre le s i lence interméd iai re à la
part ie anté rieure tou j ou rs au po i n t de vue de l ’ impression pro
du i te. D ’
après no tre t héo rie, pâ teux ,
tra itèrent,se composera ien t
de deux parties auxquel les on peu t donner le nom de sy l labes
(acoustiques) ; la première i ra i t de l’
explos ion du p ou cel le du t
à l ’explosion du second t exclu sivemen t . M . Grégo i reappl ique le même principe aux mo ts dont les syllabes com
m encent par une occlus ive sono re . La sono ri t é de la dern iè rene
l’
inquiète pas car pou r les occlus ives ini t ia les, à l ’aud i t ion , à
mo ins de s ’ être exercé,on d ist ingue à peine l’antériorité des
vibration s su r l ’exp los ion . l ’o rei l le fai t abstract ion de l’occ lu
sion préparato i re à la consonne Q uant aux o cclus ives intervo
caliques l ’o rei l le,croyons-nous , assnm le a la voyel le précé
dente les v ibrat ion s lary ngiennes accompagnant l’
o cc lusion
Il est dommage que les apparei ls deM . Grégo i re ne lu i a ien t
pas permis d’
examiner aussi les mo ts dont les sy l labes com
mencent par des constr ic tives , tels que val lée,oser, savo i r . Là ,
i l au rai t d iffici lement pu sou ten i r que l’
o rei l le fai t abstraction de
la constrict ion de la consonne et i l au rai t p robab lement h ési té
88 CH LUMSKY
o 0 0 o
a appl i quer son prm c 1pe aussi r igou reusemen t qu i l l ava1t fai t
(cf. M . Rousselo t , Pr inc ipes 9 92-
3 et 1000 En théo
rie,M . Meyer procède comme M . Rondet mai s, dans sa pra
t ique, on trouve des exemples qu i sont en faveu r des deux
procédés je le conclus d’
après les figu res de son trava i l Zur
Phonü ik der ungar ischen Sprache publ ié en co l laborat ion avec
M . Gomboc z dans Le Or ienta l, 1 907— 1 908 . Là
,le passage
m mPIG . 5 .
Spéc imen des tracés de M. Wagner (reproduct ion photograph ique) .
de la voyel le à l’
occlusive est att ribué tou t ent ier à la con sonne etimmédiatemen t après
,le même passage de la voyel le à
'
la con
sonne s est a jou t é à la voyel le, contrai remen t donc au principe
précéden t . Les figu res a jou tées par lu i et q ue nou s reprodu i sons
ici fig . 4) ne laissent au cun dou te à ce su jet . On pou rrai t peu t
être vo i r au ss i une certa ine inconséquence chez M . Gauthiot dans
son arti cle Du tra itementphonétique du ni mquiescent en persan (LaParole, 1 900, p . 440) et chez M . Millardet dans son Peti t AtlasL inguistique, 1 910, où la séparat ion n
’
a pas été faite de la même
LA QUESTION DU PASSAGE DES SONS 89
façon partou t . M . Rousselo t , dans sa thèse Les modifica tionsdu langage, fai t en trer le passage ent ier dans la voyel le ; plu s
tard des tracés enregis trés avec des apparei l s perfectionnés
évei l lent ses dou tes a lo rs i l modifie un peu son procédé tou t enconservant le prin cipe et coupe le passage en deux en mettan t
la grande po rt ion à la voyel le, la pet i te à la consonne. Enfin i l
faut que je fasse auss i m a confess ion . Dans m on Essa i demesure,
en 1 9 1 1 , j’
attribue à la voyel le le passage entier , en y a jou tan t
une pet i te po rt ion sono re comportan t de 1 à 3 vibra t ions . Ces
vibrat ions apparaissent quelquefo i s après le passage mais non
pas tou jou rs su r le tracé nasal devan t les con sonnes sou rdes .
Dans l’Analyse du courant d ’
a ir phona teur en tchèque (La Parole,1 902 ,
p . 1 3 9) je ne t iens pas compte de ces quelques vibrat ions
et je ne fa is en trer dans la voyel le que le passage tout seu l . Jesu is revenu à ce dern ier po i n t de vue
1 . Pour être complet jem ent ionne encore un procédé d’
un intérêt p lutôt h istor ique c
’
est celu i dont s ’
est serv i (M. Ph . Wagner dans son trava i l sur led ialecte de Reutl ingen (Der gegenwä rtigeLautbestand des S chwabischen in derMundart von Reutl ingen) paru dans le Programm e de l
’Ecole réa le de Reutl ingen, 1889 (16 partie) et 189 1 (116 partie) . M. Wagner exprime la durée desvoy el les placées entre deux occ lusi ves non nasales par la d istance d ’
une expios ion à l ’autre
,donc i l comprend dans la voyel le non seu lement les deux pas
sages, m a is auss i la durée de la seconde o cc lusion consonnatique. Vo ic i textuellem ent cequ
’ i l dit, p . 19 : S i l
’
on mesure sur les six prem ières courbes (surla tab le deM.Wagner i l s
’
ag i t des m ots b ib; beb, kab , kob , knb , bob) la distance des branches m ontantes des sons exp los i fs , entre lesquel les se trouventles voyel les pures , on trouve presquepartout 1 2 mm . pour les voyel les longues ,8 pour les brèves . En effet les ch iffres correspondent à cette d istance, m aisjamai s à la durée des voyel les , et encore m o ins a cel le des voyel les pures,comme le ditM.Wagner . Pour que nos lecteurs pu issent se fa ire une idée dela faç on de m esurer de M . Wagner, je donne ic i quelques m ots enreg istréspar lu i (fig . En com parant ces courbes avec les tracés que l
’
on obtientaujourd ’hu i
,on pourra fac i lem ent se rendre com pte com bien son procédé est
rud imenta ire,com b ien sont justifiés les doutes qu i ont été ém is à propos de
ses m esures . I l est vra i qu’ i l sera it injuste de juger avec sévérité des travaux
de début,b ien qu
’ i l so ient venus douze ans aprés ceux de R osapelly , toutefo ispuisqu
’
on a souvent parlé des résu ltats de M. Wagner et que l’
on a parfo isvanté l ’exac t itude de ses mesures , i l y a lien de d ire la vérité Les ch iffres sontlo in d ’être exacts et ne pouva ient pas l
’être car un tracé unique, dépourvu
90 j . CH LUMSK Ÿ
Q uel le est la décis ion qu’
i l fau t prendre
Pou r cela ,i l es t de nouveau u t i le de consu l ter les deux choses
les tracés et l ’o rei l le . Comme tracé , je reprodu is (fig . 6) celu i
qu i a é té imprimé dans La Pa role, 1 902 , p . 1 3 9 , fig . 10,où la
même quest ion a été touchée par m o i . La figu re représen te le
m ot apa . S imu l tanément avec la vo ix,a été pris le mouvemen t
des lèvres , pou r a ider a i nterpréter ce q u i se passe pendant le
passage de la voyel le la consonne. Or,le tracé labial nou s di t
que I° pour le moment en ques tion les l èvres s
’
achem inent vers
l’
occlusion vo i r la montée de ce t racé qu i se produ i t sim u lta
ném ent avec la descente du t racé bucca l marquant le passage ;2° l
’
occ lus ion n’
est accomplie qu ’
avec la fin de la descen te du
t racé buccal la preuve en est l’
acco rd complet du sommet de la
cou rbe labia le avec le commencement de la part ie basse de la
l igne bucca le. C ’
es t donc à ce moment— là que se termine le pas
par—dessus le m arché de toute vibration de la vo ix , ne peut pas fourn ir une
grande préc ision ,
S i les voyel les placées entre deux occ lus ives ont été m al m esurées,la
chose devient plus grave encore’
quand les consonnes encadrant la voyel le sont
des nasa les . Je n’
en veux comme preuve que le tracé du m ot mon reproduitp lus haut . I l est dû cette fo is à l ’ inscript ion un ique du souffl e nasa l et non
plus bucca l inscript ion obtenue par l’ introduct ion d ’
un tuyau de caoutchoucdans l ’une des deux mar ines , tand i s que l
’
autre éta it bouchéepar l’expérimenta
teur . La d istance,d it M. Wagner, du plus haut po int de la courbe de la con
sonne in itiale jusqu’
à la branchem ontante de la consonne finale atteint pourles voyel les nasales longues 9 a 10
, pour les brèves seu lem ent 5 mm . Le
tracé reprodu it m ontre bien ce qu’ i l y a d
’
arbitraire dans cette faç on de m esu
rer . Mém e s i l’
on pardonne à M. Wagner ce fa it qu’ i l bouchait une narine et
changeait a ins i les cond it ions de la prononc iat ion norm ale sans avo ir aucunm oyen de contrôle
,i l ne reste pas m o ins que les po ints ind iqués comm e l im ites
sont lo in d ’être sûrs , non seu lem ent à cause de la grande élastic ité de la m em
brane qu i fa isa i t sauter la plum e et cachai t a ins i la form e réel le du courant,m a is surtout parce que le courant nasa l est lem o ins apte à nous renseigner surla durée de la voyel le encadrée entre deux nasa les i l em pi ète ord ina irem entsur le commencem ent et la fin de la voyel le, par conséquent les ch iffres uni
quem ent basés sur la form e du cou rant nasa l tendraient à fa ire cro ire que lesvoyel les placées dans la pos i t ion qu
’
on vient de défin ir ont une durée m o indreque dans la réal ité . C ’
est ce qu i estarrivé justem ent à M . Wagner . Les m esuresdes constrictives n
’
offrent pas plus de préc ision .
U n procédé analogue para ît avo ir été em ploy é par M. Viétor (Elemente dePhonetik
, 5 e éd it . , p . 277
9 2 CH LUMSK Ÿ
seconde pou r avo i r l ’ impress ion de la durée d’
un son . Ain si
l ’expl icat ion de M . Rou sselo t m e semble,
el le au ss i,être en
faveu r du procédé qu i att r ibue le passage entier à la voyel le.
Q uan t au son consonantique, je ne l’
entends pas vers la fin dupassage, mai s immédiatement après . O n peu t fac i lemen t se rendrecompte de ce son
, s i l’
on prononce le m ot hop de sorte que le pn
’
ai t pas d’
explos ion et so i t donc,comme on dit
,pu rement
implos if c ’es t la prononciat ion couran te de ce mot dans m a
lang ue et el le est auss i poss ib le en français . Le m ot a le mêmesens dans les deux langues . En le chucho tant ains i
,on entend
un bru i t parti cu l ier , produ i t par le c laquemen t des l èvres l’
une
contre l ’au t re. Et pu isque,d ’
après le tracé,les lèvres n ’
arriven t
à se toucher qu ’
après le passage, le bru i t produ i t par leur claque
ment la vraie implosion serai t donc à placer après la fin du
passage. J’
y vo is un nouvel argumen t en faveur du procédé quiattribue le passage en t ier à la voyel le.
L’
examen des passages terminé,i l reste encore un po in t à
éclai rc i r . Su r le tracé nasal , comm e il a été di t plus hau t,les vibra
t ions ne s’
arrêtent pas tou jou rs avec la fin du passage,mais el les
la dépassen t quelquefo is d’
envi ron un ou deux centièmes de
seconde. La première question qu i se pose, est de savo i r s i ces
vibration s représentent réel lement un son,ou b ien si ce n
’
est pastou t s imp lement l ’ inert ie de la membrane qu i pro longe la durée
du mouvemen t reçu . La dern i ère hypo thèse parai t probable ;tou tefo is i l est assez d iffic i le d
’
admett re que la membrane travai l leà vide pou r la port ion en t ière
,étan t donné la faib lesse de la
résonance nasale qu i peu t d iffic i lemen t mainten i r la membranedans le mouvement , après la fin de l
’ impuls ion réel le. M . Ronsselot es t auss i porté à cro i re à la réal i té de ces vibrat ions dépas
sant le passage.
Ce fai t une fo is é tab l i , une au tre quest ion se pose Est— ce à la
voyel le ou à la consonne qu ’ i l fau t attr iber cette port ion sono re
C ’
est à la consonne, je pense, pu isque cette part ie correspond au
LA QUESTION DU PASSAGE DES SONS 9 3
momen t où se produ i t ou peu t se produ i re le bru i t consonant ique dû à l’accom plissem ent de l
’
occlusion bu ccale .
Pou r con clu re cette analy se, je m e résume a ins i °
1° Le passage de la consonne à la voyel le do i t ê tre at tribu é a
la consonne
2° Celu i de la voyel le à la consonne do i t êt re attribué à la
voyefle ;
3° La pet i te po rt ion sonore dépassant parfo i s le passage de la
voyel le à la consonne sou rde et vis ib le sur le tracé nasal ou su r
celu i du larynx do i t ê tre rat tachée à la consonne su ivante.
N . B . Cet art ic le est le résumé et en part ie auss i ledéve10ppement d’
un chapi tre de m on t rava i l sur la Mesure des sons et des
sy llabes tchèques dans le discours suivi , publ ié en vo lume aux fra i s
de l’
Académ ie tchèque de Prague en 19 1 1 . Les tracés soumis à
l’analy se ont été enregistrés au moyen des peti ts tambou rs et de
l ’orei l le inscriptrice de M . Rou sselo t et comparés ensu ite aux
tracés du phonographe t ranscri ts avec l ’apparei l Lioret .
Jos . CH LUMSKŸ .
L’
APPAREIL DE M . GARTENPOUR L
’
ENREGISTREMENT PHOTOGRAPH IQUEDE LA PAROLE
D ’
après la description qu ’
en donneM . Garten dans la RevueZeitschr iftfür Biolog ie, 1 9 1 1 , tome 5 6 , p . 4 1 et su iv .
,son apparei l
PIG . 1
Coupe du corps de l’
apparei l .R . Bo i te tr iangu la i re. L . O uvertu re c i rcula i re couverte
e m em brane de savon l iq u ide. M . Elec tro - a im ant gouver
la pet ite pouss ière de fer qu i se trouve au m i l ieu de la m em
e. R . Vis qu i rég le'
l’
élec tro-a im ant . OP . M ic roscopeontal . QV. Condensateur de lum iè re.
est une autre torme du phonoscope de M . Weisz,ment ionné par
la Revue de Phonétique, 1 9 1 1 , p . 3 82 . C’
es t de nouveau un co rpsde microscope placé horizon talement , et un condensateu r delumière et entre les deux une bo i te a membrane de savonl iqu ide. Ce qu i le dist ingue du phonoscope, c
’
est que le levier de
PIG . 2
Mem braneet élec tro—a im ant vu s
d’
en hau t . Au -dessou s Elec troa im an t M v u de face. H 1 H 2 .
Extrém ités de l ’élec tro-a im ant .
P. Pet i te pouss ière de fer . T4T2 . Vi s de rég lage de l ’élec troa im ant .
L’
APPAREIL DE M . GARTEN 9 5
M . Weisz est supprimé et remplacé ingén ieu sement par une
pet ite poussière de fer qu i est maintenue au mi l ieu de la m em
brane par un électro—aimant (fig . 1 et La pet i te pou ssière su i t
PIG . 3
3 Var iations du tracé su ivant que la m em brane est plus ou m o ins assourd ie.
tou t natu rel lemen t les vibrat ions commun iquées par la vo ix à la
membrane, le condensateu r éclai re les mouvements de la pou s
sière,le microscope les agrandit et les pro jette su r une bande de
papier sensi b le où el les sont fixées phonog raphiquement .
PIG . 4
I‘ chanté Son fondam ental 286 vib rat ions .
Se rendant b ien comptedes difficu l tés qu’
offrent les membranes
flexibles à l ’enregistremen t de la paro le (fig . M . Garten a cher
ché à y parer en rédu isant les dimens ions de la membraneet en lu i
donnant l’assou rdissem ent approprié,en vue d ’
obten i r une bonne
reproduct ion des vibrat ions sonores . I l cro i t arriver à ce résu l tat
1 . M . Garten nous écr it qu’
actuellem ent i l emp lo ie des m em branes beaucoupplus pet ites , jusqu
’à mm .
9 6 CH LUMSKŸ
en remplissant d ’
onate la bo î te triangu lai re à membrane de savon
et ne laissant l ibre qu ’
une tou te pet i te cavi té comparable dans sa
forme i rrégu l ière à la cavité du tympan . Les paro is extérieu res,
el les auss i , sauf cel le q u i est mun ie de membrane, sont couvertes
PIG . 5 .
S ch.
Ag rand i 1 , 6 fo is . D ’
après le cal c u l , on pou rra it admettre envi ron 3 200 vib rationspar seconde. I l y a suc cess ion i rrég ul ière des vibrat ions plus lentes et p lus rapides .
de feu tre. Par su ite de cet assou rd issement,son apparei l est mo ins
sens i ble que le phonoscope, M . Garten l ’avoue lu i-même, mais i l
le juge suffisant pou r la reproduct ion de la paro le. I l a enregistré
ains i les voyel les chantées et chuchotées auss i b ien que les con
sonnes s et sch don t nous donnons la reproduction (fig . 4 et
Les cl ichés nous ont été obl igeamment prêtés par la direction
de la Biolog ica .
CH LUMSK Ÿ .
CH RON IQUE
NOU VELLES
Enseignement de la Phonétique et de la Linguistique en Autr iche.
D’
après une ordonnance du Min istère de l’ Instru c tion publique d’
Au
triche,datée du 1 5 j u in 1 9 1 1 (Bulletin m in . 1 9 1 1 , n° 2 1
, p . 1 74 et
et concernant la Bohêm e,la Moravie, la S i lésie, la Po logne
autrich ienne, la Bukov ine, la Basse Autriche, la H au te Au triche,
le Tiro l et le Vorarlberg,le S a lzbourg ,
la S tyr ie, la Car inthie, la
Carn io le,le L ittora l et la Dalm atie
,le cours de Phonétique ou les
exercices de ce genre a ins i qu’
un cours d’ introdu ction à l ’étude dela L ingu istique sont v ivem ent recommandés à tous les étudiants detoutes les branches de la ph i lo logie. U ne connaissance sûre
,théorique
et pratique des é lém ents de la phonétique et une bonne prononc ia
tion sont ob l igato ires pour tou s ceux qu i aspirent à l’
enseignementd
’
une langue vivanteM. Verrier est nomm é secréta ire des Arch ives de la Parole à la
Sorbonne .
L’
un des d irecteurs de la Revue,M. Pernot, va faire au Congrès
des O rienta l istes, qu i se tient à Athènes , deux commun ications dont
l ’une a pour su jet les app l ications de la Phonétique expérimenta le àl ’étude des langues vivantes .
N ous pouvons s igna ler comm e bons les enregistrements su ivantsfaits par la Société Ed ison (phonographe) , laMor t del’H iver d ’
Edmond
Rostand (M. Le Marchand) , m orceau dé jà ancien,Phèdre de Racine
(MU‘° Sarah Bernhardt) , nouveau d iaph ragme de 4 m inutes ; par laSociété du Gram ophone, les nouveaux m orceaux de M.. Brémond ;
par la m a ison Pathé , le Corbeau —
et le Renard du Pathég raphe.
D’
après le Bulletin de l’
Alliance frança ise, les U n iversités deGrenoble
,L i l le
,Montpel l ier, N ancy et les cours de vacances de
Di jon ,H onfleu r
,L is ieux , Paris , Rouen ,
Tours , V i l lerville-sur-Mer,
annoncent des cours de phonétique à l’
u sage des étrangers .
On sait que la Facu l té des Lettres de l’
Institu t catho l ique de Parisoffre aux étud iants deux cou rs de phonétique expérimenta le, p arsem aine l
’
un théorique, d’
un caractère général , et l’
autre pratiqueetappliqué spécia lement à la prononciation franç aise.
CHRON IQUE
LABO RATO IRES
H ambourg . Le labo rato ire, créé en 1 9 1 0 par la vi l le de H ambourg , a été confié à la d irection de M . Panconcel l i—Calz ia
,docteur
de l’
Univers ité de Paris , ancien é lève du Co l lège de France. Il est
rattaché au Sém inaire des langues co lonia les et proviso irement i l a étélogé dans le bâtiment réservé à la physique. I l faut fé l iciter le gouvernement de H ambou rg du l ibéra l ism e dont i l a fa it preuve en favorisant une science nouvel le. Après une longue v is ite
,le Ministre de
l ’ instru ction pub l ique s’
est déc laré satisfa it de ce qu ’ i l ava it vu et a pro
m is que les fonds nécessaires ne feraient pas défaut .L ’ insta l lation présente ne comprend encore que deu x p ièces , p lu s
une sa l le de cours commune à d ’
autres enseignements . Tous les
apparei ls d’
acoustiqne sont a la d i spo s ition de la phonétique. Dans le
m ême Institu t se trouve une riche bib l iothèque de phys ique ; quantaux ouvrages purement l ingu istiques , i l est lo isible de les emprunterau Sém inaire des langues africaines . U ne imprimerie o fficiel le et des
atel iers de rel iure travai l lent gratuitement pour toutes les fondat ionsscientifiques de l
’
état de H ambou rg .
M. Panconcel l i—Calz ia a sous la m a in l ’eau,le gaz , l
’é lectric ité et
l ’air comprim é . Son laborato ire, qu i n’
a pas encore deux annéesd
’
ex istence, possède les apparei l s su ivants u n cyl indre enregistreur
de Zimmerm ann avec tou s les tam bours nécessaires,un ch ronomètre
,
les laryngoscopes de F latau et de Mayer Brünn ing s , le phonau to laryngo scope de Calz ia , le labiog raphe de Mayer
,l ’apparei l de Mayer
qu i perm et de m esu rer les hauteurs mu sic ales'
et d’
obteni r en m êmetemps la c ourbe m é lod ique décrite par la vo ix ; l
’
apparei l de Leppinet Masche pour la pro jection et la pho tograph ie de la paro le ; l
’
appa
rei l de Boéke pou r l’
exam en m icro scop ique des cy l indres du phonographe ; l
’
apparei l de Marbe (Ru ssfl amm en) , des gram ophones et des
p honog raphes , sans com pter tous les m enus ac cesso ires dont on a
beso in pour les enquêtes scientifiques . Cette org anisation dé j a trèsriche recevra tous les com plém ents nécessa ires grâ ce aux créditsannuel s dont nou s par lons p lus lo in .
Pou r un avenir très prochain des plans très amp les ont été approu
vê s . La phonétique i ra s’
étab l ir dans une vi l la vo is ine qu i sert actuellement de logement au d irecteur de l’ Institut de physique ; cette vi l lasera entièrement transform ée. Les pro jets prévo ient dans le sous-sol ,
100 CHRON IQUE
férences de M . Panconcel l i-Calz ia étaient des pro fesseurs de chant etde langue,
des chanteurs,des 1n 15 5 10nna1res , des
—ni édeCins, des é tu
diants en l ingu istique. Dès la prem ière année un‘
certa in nombre detravau x ont été pub l iés , dont cinq par M . Panconcel l i-Calz ia (Mediri
nisch-Pädagog ische Monatschr ifl für die gesumm te Spracbbeilkùnde,novem breKAZAN Université. Le directeur du laborato ire, M. Bogoroditz k i ,
nous a envoyé une étude su r les intonations lettes qu i sera publ iéedans le prochain numéro . C
’
est auss i su r la m ême m atière q ue tra
va i l le chez lui un étud iant lette, M. Plak is . M. Bogorod itz k i prépareun travai l sur les voyel les russes atones .
PAR I S Collège de F rance. Chaque sem aine, M. Loth, professeur
de langues et l ittératures celtiques , consacre une séance à l ’étudedela prononciation ga l lo ise de M. Watcyn ,
de Glain o’
rgan et de
M“° Gwlady s Will iam s,de L lanrwst (N o rd du Pays de Ga l les) .
M. l ’abbé Rousselot poursuit des études su r l ’ass im i lation et le
rythm e dans les d ivers sy stèmes de versification .
M. le Dr Thoo r is continue ses recherches su r le timbre des voyel les :M. Chlum sk5
*
,en même temps qu
’ i l se l ivre à ses études p ersonnel les sur le tchèque et la com para ison des d ivers apparei l s, prêtégénéreusem ent son c oncours aux nouveau x venus et aux passants etles fait profiter de son expérience.
M . Ivcov itch , é lève deM. Belitch de l’
U n ivers ité de Belgrade, étud ieles intonations serbes .
M . Barni ls,de Barcelone
,s
’
occupe actuel lem ent du rythm e du
cata lan .
M . H entrich, professeu r au lycée de G ladbach près Dusseldorf, a
passé quelque temps au Laborato ire afin de contrô ler ses matériaux
pour son Wô rterbu ch der N o f dwestthür ing i schén Mundart paruces jours-ci . Les expériences nécessa ires et la lecture des tracés ont étéfaites par M. Chum skyU n étudiant m alais
,M. Zapata L i l lo , professeur à Santiago (Ch i l i) ,
et M . Mladedenov,docent de l ’U n iVers ité de Sofia, ont profité du
’
peu
de temps dont ils d isposaient pour des recherches l im itées su r leurslangues respectives .
’
L’
e‘
Gérant J .
‘
ROU SSELOT .
MACO N ; PR0TAT« -P i_
tER—ES,I IMPR IMEU RS .
NOTES DE PHONÉTIQUE H ISTORIQUE
INDO -EUROPÉEN ET SÉM ITIQUE
Les vues de M . Hermann Mo l ler paraissen t avo i r récemmen t
reçu en Al lemagne un accuei l beaucou p plu s favo rable qu ’ i l ya t rente et quelques années ( 1 879 I l n ’
est peu t— être donc
pas inopportun de reprendre plus en déta i l qu ’
on ne l ’avai t fai t
pour ses précédentes pu bl ications la quest ion qu ’ i l a le premier
posée d ’
une façon vra iment scientifique (v . Rev . Et. Anc .
p . 27 5 su iv .,et p . 90 ,
cf. au ss i Bu lletin de la Société de
L inguistique de Par is pp . CCCXC I I et su ivan tes) . D ’
une
part , en effet,M . Mo l ler v ient d ’
exposer à nouveau les résu l tatsde ses recherches sous la forme d
’
un Verg leicbendes indogermanischsemi tisches Wôrterbuch paru en 1 9 1 1 , et d
’
autre part , M . G . M i llardet a tout récemment ( 1 9 1 2) publ i é dans la Revue Phonétique
un substan tiel art icle su r les Inser tions de consonnes en suédois
moderne don t certaines conclus ions qu i ont tra i t à la phonétiquegénéra le
,ont paru de première importance pou r la question sou
levée par M . Mül ler . O n a pensé pouvo i r avec ce secou rs fai re
plus et mieux qu ’
un s imple compte rendu du Wo”
rterbuch.
CONSONNES—VOYELLES ET VOYELLES— CONSONNES
‘
1 . Dans le premier des comptes rendus rappel és plus hau t
(Rev . Et. Anc .,1 909 , p . 278 , n . on avai t brièvemen t indiqué
qu ’
un des fai ts que l’
on peu t invoquer en faveu r du système de
M . Mol ler est le tra itement constan t en indo—européen du groupe
sonante - j— 9 devan t consonne. M . F . de Sau ssure a prouvé dansRevue de phonétique. 7
102 A . CUNY
leMémoiresur lesystèmepr imitif des voyelles inde—européennes 1 878)
que ces groupes : y+ 9,au a
,l+ a
, r+ 9,m a
,n abou
t issa ient (dans cette pos it ion) , non pas à*
yÿ ,*wa, c
’
est-ù— d ire*
yâ ,*wâ on
*wi , mais bien à i,a, l, m, n, qu
’
en un m o t
c ’éta i t le premier é lément et non le second qu i se vocal isai t . So i t
l ’exemple cho is i (loc . ci t . ) racine dissy l labique stere étendreà terre degré zéro stra devant consonne, p . ex . dans l ’ad jectif
verbal fo rmé au moyen du mo rphème -to ou de son équ iva
lent - no indo-européen *stp
-tôs ou*strä
-nôs abou tissant dès
l ’époque indo —européenne à *stÏ tôs ou
*st?nôs (lat . strâ tus
skr . sti r 1_zâ b et non pas
*stre
-to'
s ou*stre
-no'
s (lat .
*strà tus
skr .
*str indb
,Cec i montre de tou te évidence que le
*a étai t à l ’o rigine un phonème mo ins fac i lement vocalisable queles sonantes proprement d ites y ,
w, r , l , m , n . Pou rtant (M . F .
de Saussu re l ’ava i t dé j à écri t dans le Mémoi re) , quelque étrange
que para isse la chose, le phonème*9 est d ’
une natu re analogue £1
cel le des sonantes . Comme ces dern ières en effet,i l peu t au ss i
fai re partie des élémen ts rad icaux à ti tre de coqficient, p . ex . dans
une rac ine *sag ( lat . sag
—ïre, got . sôkjan etc . c ’est—à-d ire *
se?g
degré zéro sag (lat . sag-â x c ’est-à-di re *
sgg tout comme r ,
par exemple dans une rac ine *bherdh (gr . a épôo ), degré zéro
*bhrdb (gr . : paô
—stv) , ou y dans une racine
*bbeydb (gr . 7 : ei00 ,
lat . fido) , degré zéro*bhidb (gr . 7'CLO- ‘Ît t
,lat . j id
-ès) . O r, quel leidée faut- i l se fai re de l ’antiqu i té respective des fonctions vocaliqnes i , u
, r , l, net des fonct ions consonan tiques y, eu, r , 1,l i t
,n Tou t le monde
,depu is la publ icat ion du Mémoi re, admet
comme certain que la fonction voca l ique dans les sonan tes est
relat ivement récente et qu ’
el le résu l te de la chu te de la voyel le
(e: o) . La fonct ion consonantique est incon testab lemen t la plusancienne. S
’
i l en est a ins i,à p lus forte raison faudra-t-i i admettre
pou r a indo-eu ropéen une fonction consonantique plus ancienne
i r r
I . Grec dor . aysoua 1, att . nysona 1.
104 A. C ‘
UNY
le sai t depu is la publ icat ion du Me'
moi re,d etre iso l é dans la
morpho logie indo -européenne i l y en a beaucoup d ’
au tres où
tou t ne s’
expl ique au fond que dans l’
hy po thèse d’
une ancienneconsonne A .
On n’
a peut- être pas à ce po int de vue fa i t assez ressort i r depu is
leMémoire, que dans la fo rmat ion des présents athémat iques avec
syl labe d’
infixation —nè (ty pe skr . yu-nd—j -rni) , quand cette for
mation s’
appl ique à une des racines d i tes dissy l labiques (*
pela
rempl i r p . tou t se passe comme s i a étai t,au mo ins à
l ’o rigine,une consonne. En effet *yu—né -g .
-mi et*
pi—nè— e-m i (skr .
yundj rni et skr . parudrni) son t fo rmés exactement de la même
façon . O r g . est la consonne finale de la rac ine yeng . , degré zéro
yug . . I l s ’
en su i t évidemment que l’
on est en dro i t de d ire que
(= A) est la consonne finale de la racine *
pele C ’
est ce que laissai t entendre du resteM . P de Saussu re quand i l écriva i t (Mémoi re,p . 24 1) l
’
i‘
de grbh—
u— ï—ntds a un rappo rt tou t auss i intime
avec 17 de g rdbh— i — ta r que le i de pim-s
'
—rnas avec le i de pei tar .
3 . L’
au teu r du Mémoire ava i t lu i—même fai t remarquer auss i
(p . 242) que le rô le du phonèmeA dans pa r i (c’
est—à -direpela
en transcription est abso lument paral l è le à celu i querempl issent d on s
” dans bhe-d,bhi— nd —d pe
-i, pi
-na — i O n peu t
a jou ter que, dans un grand nombre d ’
au tres racines à élargissement man ifeste, le sert à cet te fin auss i bien qu ’
une consonne
quel conque. La racine me? p . ex . mesu rer contracté en me“
skr . nui lat . me“
est const itu ée d ’
une façon tou t à fai tanalogue à med (même sens got . m itan I l en résu l te que
deva it êt re éga lement une consonne, au mo ins à l ’o rigine. C ’
est
a ins i qu ’
on pourra i t interpréter ce qu’
écr ivait M . F . de Sau ssu re
à la page 260 du Mémoire le 9 de la racine d issy l lab ique peu t
n’ êt re qu ’
un élargissemen t entre beau coup d’
au tres de la racine
monosyl lab ique I l en c itai t des exemples intéressants , a ins i
racine primit ive eco t isser degré p lein skr . o'
tam,degré
1 .Au po int de vue de M. H . Mo l ler
,cette rac ine commune à l ’ indo—euro
IND0— EUROPÉEN ET SÉM IT IQUE 10 5
z éro ( gv= u) sk . u-ma élargissement par -eA (l’élémen t *
ew
passe alo rs au degré zéro)—weA *wâ skr . vdtum etc
de même,é largissemen t par —ey
*w—ey (skr . vdy—a ti) . Mais là
,
non plus qu ’
ai l leu rs , M . F . de Saussu re n’
insistai t pas part i
cnlièrement su r la nature consonant ique de A,chose s i palpable
dans le cas de meA med mesu rer et dans celu i de la racine
s ign ifiant t isser si l’
on y a jou te p . ex .
’élargissement *webb
(v . n . veja ,vha . wé
”
ban,skr . (Wua— )vä bbi gr . i
'
>s—vj, zend ub
dac‘
na etc .
4 . C ’
est pourtan t encore M . F . de Sau ssu re qu i (p . 244 du
Mémoire) a mont ré q u’
à côté des racines dissy l labiques terminées
par a, i l y a des racines de même catégo rie terminées par i t . I l est
vrai q ue ce sur quo i i l entenda i t uniquement i nsi ster , c’étai t le
paral l é l isme exact de format ions tel les que vruôm i et p(rr
_1ârni , la
première étan t indo-européen *wl—né—z v—m i et la seconde, indo
européen *
pi—ne-9 —nu . Mais,ce qu i a son in térê t par ai l leurs , c
’
es t
que dans ces deux cas— types,i l s ’
agi t d ’
une racine term inée par
un phonème qu i pouva i t à l’
or igine fonct ionner ind ifféremment
comme voyel le ou comme consonne *wel—w et*
pel-e (a côté
desquels on pou rrai t très b ien avo i r *wl-cu 1 et*
pl-e9 tou tes ces
fo rmes résu l tant d’
élarg issements différents,ma is s t ri ctement
paral lè les de racines monosy l lab iques pel rempl i r et wel
couvri r
5 . Ceci condu i t a faite une réflexion qu i es t tou t à fai t dans
l ’esprit du Mémoi re b ien qu ’
el le n’
y so i t exprimée formel lemen tnu l le part . Le t rava i l d ’ élargissement des racines s
’
est fai t,non
par s imple add it ion d ’
une consonne,mais par adjonct ion d ’
unesyllabe composée de la voyel le su iv ie d ’
une consonne. En un
m ot l ’ élargissement étai t à l ’o rigine un vra i morphème,bien
péen et au sém it ique devra i t être notée H ew (premd0eur .
’
aw m a is la chosen
’
a pas d’ importance ic i où l’on ne t ient com pted
’
abord que de l’ indo-européen .
I . Grec .
’
é)tur pov skr vdr utra rn de indo -européen*wélu- trorn . Cf . lat . uoluo
Les bases de M. H ist sera ient respect ivem ent ic i**
pel—eA et
*“wel—ew.
106 A . CUNY
que, :i l epoqueque nou s atteignons par la comparaison , i l ne forme
plus qu ’
une cel lu le morpho logique avec la racine m onosy lla
bique primit ive, d’
où i l su i t nécessa i remen t qu ’ i l ne subs iste
plus qu ’
un des deux e. So i t p . ex . la racine monosyl labique *
g . hen
verser (en particu l ier des l ibat ions) skr . ho'
—tu1n,gr . y_sü- p. z ,
degré zéro hutdh, gr . 7_ur éç La racine *
g . head*
g . boud du germ .
go t . g z’
utan, etc . et du lat . füdï do i t se comprendre
comme étant issue d’
une base **
g . hero—ab . Par chu te du second
e, on a en g .head g . bond O n eût pu tou t auss i b ien avo i r*
g . hwed par chu te du premier, et , comme*
g . bud est le degré
zéro commun à *
g , h—wed et à *
gheud i l est possib le que le lat in
fund— ant c’
est— ‘
a—dire *
g . bund-onti t ransformé de *
g . hand-enti
comme souti (sunt) de*senti (osque set, got . sind), repose sur
le degré zéro de *
g . heu—ed Or,s i dans ce cas et les cas semblab les
l’
on ne peu t parler sérieu sement qued’
un élargissement -cd
dans le cas des racines d issy l lab iques , on ne peu t égalemen t par
ler que d’
un élargissement -eA c ’est—à-d ire e su iv i d ’
une con
sonne.
6 . U ne règle bien connue de la morpho logie i ndo—enm péenne
exige que les thèmes— racines employ és comme mo ts indépen
dan ts ou comme seconds élémen ts dans les composés adjoignent
un — t à la racine lo rsque la consonne finale de cel le—ci est
s implemen t une des sonantes y ,eu
,l , m ,
n , r,type skr . vieva
i i-t qu i vainc tou t de la racine vajra —bhor-t qu i por te
le foudre de la racinebher zend â —bä rä -t celu i qu i apporte
de la même racine,sk . deva — stz i -t q u i loue les d ieux de la
racine *stew zend â hum—stu— t die Wel t preisend de la
m ême racine, cf. le m ot indépendan t z d . stzt—t louange O n
pou rrai t ci ter de t rès nombreux au t res exemples indo - i ran iens
1 Étant donné queM. H Mo l ler considère l’ethém atique comme appartenantà la rac ineprim i t i vep . ex . g 1 herve et non
*
g ,heu i l est d ’
avis que l’
élarg issement
a été -de etc . et non -cd etc . Cette vue semb le d iffic i lement conc i l iableavec la doctrine deM. F . de Saussure.
1 08 A . CUNY
schéma bh—f— (t) (de racinebher —v— i — (t) (de racinewel
mais gâ‘
— j —a sk . g ir mais p— l— 9 sk . pzÎr . )
Donc a éta i t à l ’or igine d ’
une natu re analogue en une certainemesure à cel le des occ lu s ives . Il est vrai que pou r se rendre nette
ment compte de sa natu re consonant ique i l fau t rétabl ir les deux ede la base don t l’un es t régul ièrement expu lsé en vertu de la lo i
de M . F . de Saussu re ; mais alo rs le paral l é l isme est éclatant
schéma
L’
addi tion de -t don t i l a été parlé n’
a laissé q ue des traces
dans les langues d ’
Enr0pe dans les cas de racines terminées par
une sonan te : lat . (corn)— ï— t nom . cornes compagnonra
’
c . ey a l ler (in)— î— t— (iurn) commencement de la même
racine ; cf. sk .
— z— t dans les composés,
Dans le cas où,à la d ifférence des précédentes , la racine éta i t
term inée non pas par une sonan te seu le ou par une sonante su i
v ie de a,mais par 9 seu l (ce qu i apparaît c lai rement au degré
zéro sk . bi tdh gr . ôsr êç , i .—e.
*dhÿ — tô—s, le sanskr it a aban
donné la fo rmat ion par — 1 que l’
on at tend,pou r la remplacer par
la format ion thématique (add it ion de la voyel le e o) , que pra
t ique au con t ra i re le grec dans le cas précéden t,
ex . 3 i— 9p-0
—ç
char à deux places de la racine bher porter C ’
est a ins iqu ’ i l fo rme —d—a qu i donne et qu ’ i l possède — sth-a dans go
stbd ag re—
sth— d au l ieu de — di— t*st(b)i— t qu i sera ient les
abou t issants de i . — e.
*de— t
*stg
— t Tou tefo is ces formes ont
existé ains i que le prouvent les au tres langues dont une des plus
proches parentes du sanskri t,le zend . Malheureusement ces
langues ont presque partou t propagé le degré plein de la racine,
ce qu i est un contresens au po int de vue primitif, étan t donné
qu’
à ce degré le a éta it non pas voyel le, mais consonne et qu’
ains i
l ’addi t ion de — t devenai t inu t i le pou r l imi ter la racine. C’
est
INDO— EUROPÉEN ET SÉM IT IQUE 109
ains i que le zend a fratæna —da— r p lacé le premier,prince
0raotô—sM— t qu i se t rouve dans les fleuves le grec 0r,1 5 ;
(sans dou te primit if et régu l ier de*dhe— l—ô— s) , le latin sacer
dos (sacerd â— t de rac ine do plu tôt que de racine dhe Pou r
tan t les langues i tal i ques et le lat in en part icu l ier ont conservé
pour la rac ine sta un nombre impo rtant d ’
exemples présentan t
la régu lari té ancienne. On peu t c i ter antistes, (anti—)sti t(- is), Inp
piter (prae—stes) , Lares (prae-sti tes) , l
’
ad jectif super -stes, -sti t- is et
même *
(inter)—stes , —stit- is conservé dans inter —sti’
tium,so i t un
thème—racine indo— eu ropéen "‘
stg- t De même spà tium est dér ivé
d’
un thème- rac ine *spe
- t— tou t à fa i t comparable à skr . bkr— t lat .
(in—)it etc
Mais l ’o rgan isme de ces fo rmat ions étai t sans dou te t rop del i
cat , eu ce sens que l’
add it ion de - t ne se produ isa i t que lorsque
la dés inence commençai t par une voyel le, so i t un jeu tel que
nom .
*
d -s,géni t if "
dhg—t-o'
s,ce qu i fai t qu
’
el les ont été partou t
transfo rmées de l’une ou de l ’au tre des deux man iè res indiquées
plus hau t .
7 . C’
est encore la natu re consonant ique de A qu i écla i re la
const i tu tion de racines (monosy l labiques en apparence) tel les que*dhe p lacer
,fai re do donner sthâ se ten i r debou t
Au fond i l ne s’
agit pas d’
autre chose q ue de racines d issyl labiques
dont la fo rme monosy l lab ique n’
est attestée par aucune des
langues fimo —européennes quel que ancienne q ue so i t la date où
nous la connaissons et qu i ne présentepas non plus de formea l ter
mante d ifféran t (par la place de l’
e on de l’
o) de la forme que nous
po ssédons . Autrement d i t,
*sthâ par exemple (c
’
es t-à—di re *stbeA
pou rrai t être accompagné d’
une fo rme al ternante *set(h)A(c
’
est—à
d ire set(h)e l ’une et l ’au tre s’
exPliqnant immédiatement par
une base :—eA so i t par une racine monosy l labique
*set(h)
1 . Cette analyse a été éga lem ent fa ite par M. H . Mo l ler en vue d’
une com
para ison avec des m ots sém it iques , m ais ici on se tient au po int de vue uni
quement indo-européen .
1 10 A . CUNY
augmentée d ’
un déterminat i f —eA. De même *dbe sort i ra d ’
une
base **Aedh-eA et dod ’
une base **Aed -eA avec chu te du premier
c ce qu i amenai t cel le de l’
A in i t ial qu i gardai t i c i sa fo rme con
sonantique devant consonne. (Cf. plus bas les rac ines* ’
cs* ’
ey
c ’est—à—d ire *Aes
*Aey
8 . U ne remarque de M . A. Mei l let (Introduc tion ‘
,p . 1 3 8)
t rouve son expl icat ion dans la natu re consonant ique o riginai re
dea. La vo i c i les racines d issyl lab iques se terminent par leur
voyel le longue : i l y a des racines du type *
peto*
pld i l n ’y en a
pas2 du ty pe
*
pet3k— z
*
ptà k ou*
petas*
ptà s Les exemples qu ’
on
pou rra i t al léguer cont re ce principe sont en généra l l imités àune seu le langue et t rè .° pen clai rs pour la Une rac inetel le que
*
pmk en effet , ne pou rra it s ign ifier au po int de vue de
l ’ indo-européen ancien au tre chose que**
pet eA — J- ek ce qu i
es t i rrégu l ier,non parce qu ’ i l y au rai t ains i cumu l de deux
élargissements (le skr . ubhnâ‘
ti i l t isse en comprend bien deux
lu i auss i -ebb et —eA plus un infixe rac ine primit ive cro
premier élargissement —w-ebb deuxième élargissement *ubh-eA
avec infixe *abb—neA c’est-à-d ire ubhnâ
’
mais bien par la place
de l ’élargissement , ce qu i t ien t sans dou te au dés ir d’évi ter une
séquence de phonèmes tel le que —9k là où a étai t consonne dans*
pteAk par exemple.
9 . Un phonème très impo rtant de l ’ ini t iale des mors indoeu ropéens serait expl iqué par la même hypothèse A consonne
d iversemen t vocalisable le cas échéant . M . F . de Sau ssure a lu i
même exposé et étudié ce phénomène dans les pages 276—28 3 de
son Mémoire. Vo ic i comment i l le fo rmu lai t Dans une série
de cas où el les se t rouvent placées au commencement des mots,on observe que les sonantes ariennes i . u
, r , n, m sont rendues
dans l’européen d’
une man ière particu l iè re et inattendue une
1 . En un m ot dhê dheA est à *Aedh dô d—eA est à *Aed
ce qu’
effectivem ent yä y—eA est à Acy (gr . si —p 1, sk . e
’
m i , etc .)2 . Entendez è en règ le générale.
I 1 2 A . CUNY
Quan t aux exemples tels que gr . Foi s : u (c f. $<F sa dans o’
<âov.ovr o
et got . wahsja qu i ava ient arrê té M . de Saussu re,ils ne font plus
d iffi cu l té ma intenant q ue l’
on admet (v . Mei l let,lnt
‘
roduction °
,
p . 73 ) qu’
au degré zéro,certains groupes de consonnes difli c i les
à articu ler pouvaien t ê t re a l légés par l’ insert ion d ’
une voyel lemin imale que l
’
on no te 0 et qu ’ i l fau t segarder de confond re avec
le g indo-européen . C ’
est le c as par exemple pou r le lat in quà ttuor ,c i . s l . comm .
*c’
i tyr tchèque c' tyri . De la so rte, F 5101 0 est simple
ment *w°stu (*Aw°stu avec A consonne) , tand is que éFéo(c)xcvr c
est la fo rme forte co rrespondante *
A-wes (avec A vocal isé) . I l est
bien vra i que l’
on admet auss i que ce 0 est rendu par u en ger
m anism e : p . ex .
*
d°k. (s i . comm .
*d isel germ . comm .
*lux
*tug vba . (moein) -
z i rg ,ma is on est en dro it pou rtant d ’
expli
quer par 0 l’
a de wahs; a à cause de l ’ influence dissim ilatrice du
eu, tou t comme on expl ique en indo- i ranien la voyel le à provenantde au contact de y précédent ou su ivan t sk r . optatif moyen
bodheya contre aoriste moyen akr‘
1r i tous deux avec la désinenceseconda i re de première personne a, so i t —
y.? abou t issant à -
ya ;
de même *
gy abou ti t à *ay , p . ex . skr . dhdy
-a l i , V . s l . dojo, got .
daddjan, i . —e.
*dhey% Du res te wabsja peu t s
’
expl iquer aussi par*u roks car M . Mei l let a mon tré que l
’
on con state quelquefo i s le
degré 0 dans des présen ts qu i pou rtant appart iennent à des racines
en e(type nzolo, go t . ma lan) . M . F . de Saussu re (p . 29 3 ) avai t év i
dem m ent raison de soupçonner que le parfa i t go t . wobs est secon
clai re. I l t ient à ce que le présent ava i t une voyel le a sans qu’
à,l ’ori
gine le verbe ait réel lement appartenu au type des présents aor istes
tels que scàbo, got . skaba,gr . p. :iy ouarr etc … . C
’
est un s imp le cas
d’
ablautsentg leisung . I l n ’ y a donc pas lieu d’
hés iter à reconnaî tre
dans ces cas et les cas analogues la présence du phonèmeA (rédu i t
A c ’est—à-dire vo ca l isé) . Ici encore l ’hypo thèse d’
un A consonne
est ce qui l ève tou tes les d i ffi cu l tés
Mei l let a bien dém ontré l ’ex istence en indo—européen (v . D ialectes indo—euro
peens) .
. Dans lecas dewasbja comme celui de umbi,le germ an ique est d
’
accord
INDO-EUROPÉEN ET SÉM IT IQUE 1 1 3
L’
expl icat ion proposée de A in i t ia l a l ternant avec aéro es t au
reste confirmée par le dialecte A du tokharien . O n sai t en effet
q ue dans ce dia lecte lo in de d isparaî tre,est représenté par a
(mêmeen seconde sy l labe intérieure) , exemple tokharien dial . A
paca r skr . pitdr lat . pé ter , gr . a ut ép so i t indo -eu ro
péen*
pgtér et de même tokharien A ckâ ca r skr . dubitdr gr
.
0U °
{ i t sp so i t indo-eu ropéen *dhug(h)gter ( le d ialecte B dutokharien su i t la même lo i et présen te éga lement O r
,le
même dialecte tokharien A a ampi , ampes ign ifiant les deux
(v . A. Mei l let,Les noms de nombre en tokhar ien B Mémoires de
la Soc iété de L inguistiquedePar is , t . XVII , fasc . 5 , p . 286 [ 1 9 1 2J) .
M . Mei l let a jou te de lu i —même : on y reconnai t immédiatement g r . lat . ambô (en effet bb est rendu par p comme le
mont repraca r skr . bbrà ta r lat . frater , gst . bropa r I ci
encore î ne peu t représenter que a, car l ’hypothèse d’
un à indo
eu ropéen est tou t à fai t imposs ib le, tou tes les au tres langues ne
présentan t que*
mbb ou*â —mbh La réa l i té de l ’hypothèse
*
Anzbh est par là d irectement é tabl ie. Q uan t au rapport évident
des mo ts o
’
ip.ç o ambô d ’
une part et o
’
< p.ç i des deux côtés
amb(i) de l’
autre,vo i r par exemple Walde Lot. etyrn . War terb 2
.
S . v . ambo.
S i l’
on admet que le phonèmeA est con sonant ique à l ’o ri
avec l mdo- iran ien i l n ’
a pas voca l isé leA et procède de *Aw°ks (ou
*Awoks)
et de*Arp bhi avec A consonne et par conséquent rzz voyel le De m êm e
dans le nom de l’
argent, le zend araza tu indo- iran ien '
Orânta représente
une forme indo-européenne avec A consonne et voyel le, so it *Agfg ,tand is
que le lat . argentum , ganl . a rg anto procèdent de *
Arg avec A voca l isé et r
second élément de d iphtongue. Le g rec ä pyu (dans ä _oyu-pog et éipvu-cpo ç ) et
l’
arm én ien ar c a th admettent l ’une et l ’autre expl icat ion :*
Arg , et*AJ
'
g
Quant au skr . raja tdm i l ne devient c la ir que s i l’
on adm et que sa prem ièresy l labe, à la d ifférence des autres langues , est au degré e
,so it indo-européen
—
ntônz avec A consonne. Le t ra i tem ent est conform e à celu i devi de uk; de vaks
1 . Quelques-unes des idées qu i su i vent ava ient déj à été b ri è vem ent ind iquées par M. Mô ller en 1 879
— 1880 ,m a is personne n
’
ava it vou lu s’
y arrêter .
1 14 A . CUNY
gine,toutes les racines indo—eu ropéennes (et auss i les mo rphèmes
et les dés inences) rent ren t dans une seu le série vo cal ique (1?on e“
0 o u 0 zéro) ; tou tes les racines en ou tre seront constituées de lamême façon au po int de v ue consonant ique. Dé j à la presqueto tal i té des racines indo—eu ropéennes (qu
’
el les cont iennent ou
non un coefficient sonantique) , sont reconnues comme l imitées
par deux consonnes (une de ces deux consonnes ou tou tes deux
pouvan t au reste être des sonantes) . O n a par exemple, pet
bherdb bheidh bheudh tuer a res mais quelques racinestrès usi tées semblent n et re l imi tées qu
’
à la finale par une con
sonne z ey al ler ès être od sent i r ak. ê tre aigu,
po intu ( l’ inverse ne se rencont re j ama is M . F . de Sans
sure l’a déj à expressément remarqué à propo s de skr . tistba ti , lat .
sistit (qu’ i l fau t entendre comme étant *
sl i —st(9)—eti) une racine
tel le que se terminant par la voyelle pu re et s imple es t
quelque chose d ’
inex istant en indo—européen) . Or,les racines
tel les que ès ey od rent rent dans le plan généra l de lalangue et sont également l im itées par deux consonnes , s i l
’
on
admet à l ’o rigine que l’ in i t iale en éta i t l’A consonne dont i l a
été ques tion précédemment . Ce phonème est du reste encore
so igneusemen t noté en grec au moyen de l’
esprit doux ’
s’
er r,
s im , ëôo>Bz , De la sorte (et , pou r la dern ière rai son,la chose
ne relève même pas d’
une hypo thèse), les racines Aes"
Acy
sont de tou t po int comparables à des racines tel les querâc ler dépéri r sed être ass is (cette dernière
contient en ou tre un coef’
cient, car el le vau t *se9d (la racine ed
manger comportai t à la fo i s un A consonne en qual i té d ’ ini
t ia le et en qual i té de coefficient et vaut théoriquement *AcAd) .
Dans tou tes les langues au tres que le grec , ou bien la fai b le art i
cu lat ion consonan t ique A est tombée dès avan t le débu t de
la t radition (c’
est,on le sa i t
,le so rt o rd ina ire des in i t iaux et
antévo caliques dans la plupart des langues) , ou bien el le a été
négl igée dans la graphie à cause de sa faiblesse même. Ic i encore,
1 1 6 A . CUNY
*
Ay— énti eût abou t i si ot et se fût ains i confondue avec la
3° personne du s ingu l ier.
1 1 . Après avo i r prouvé la nécess i té d ’
admettre pou r l ’ indoeu ropéen un n et un m voyel les longs (Mémoi re, p .
so i t net’
tZ
—
l,M . F . de Sau ssu re montrai t pou rtant quelque scru
pu le à le fa i re et a jou tai t La no tat ion de en n n’
estpeu t- être pas sans o ffri r quelque d ifficu l té . Je comprends cel lede r at en c ’est à l’o r ig ine
'
nne pro longat ion de l’r du rant l ’em i s
s ion du A . Parei l phénomène semble imposs ible quand c’
est unenasale qu i précède A,
l’
occ lus ion de la cavi té bu ccale,et par con
sequent la nasale cessan t nécessa i rement au moment où le A
commence. Malgré cela,le u et le m ont été adoptés par la très
grande m ajo ri té des l ingu istes indo-eum péan isants, en particu
l ier par M .M .
-Brugm ann,H i rt et Mei l let .
I l ne subs iste du reste au cune d ifficu l té s i l’on admet que le iiest une pro longa tion den pendant la durée d
’
un A purement con
sonantique. I l est bien vrai qu’
un A,so rte d’
h fa i ble,lo in d ’
ex i
ger nne o cc lus ion bucca le,est fo rmé par un s imple rétré
c issem en t,lequel est même beaucoup mo ins considérable que
cel le d ’
une spi rante quel conque (Millardet) , et qu’
avec un tel b,
l’
o cc lns ion buccale de n ou de r n cessera i t nécessa iremen t aumoment où i l commence. Ma is i l su ffi t d ’
admettre qu ’ i l s ’
agit
d’
un h (A) pu remen t la rynga l tels que sont par exemple certa ins
phonèmes des langues sémitiques . Dans ce cas l’
h (A) se fo rme
u n iquement par rétrécissement de la glo tte et ceci n’
em pêchenu l lement que par la su i te le courant d
’
a i r so i t émis par le nez
pendant tou te la du rée de m on de 11. C’
est donc en défin i t ive
avec raison qu ’
on a admis les phonèmes n et tu,mais par l à le
phonème A est caractérisé comme étant vra iment larynga l°
.
1 . C ’
est—à — d ire 101 A .
2 . Cec i n ’
est naturel lem ent pas un obstac le pour que, dans les cond it ionsord inaires , entre deux consonnes par exem ple, 4 (ou bien A à l ’ in itiale devantvoyel le) a it eu une ar ticu lat ion buccale b ien déterm inée. Ma is dans le cas d
’
oc
c lusion com pl ète et pro longée, cette articu lation se perda i t nécessairem ent .
INDO—EU ROPEEN’
ET SÉM IT IQUE I 17
1 2 . En seconde sy l labe non finale de m ot ,*9 tombe en ira
nien,s lave
,bal t ique
,arm én ien et german i que ; a ins i
,à sk r .
dubitd fi l le gâ th . dugadd (d issy l labe) ,
persan dux t, v . sl . dri tti , l i t . dukté, arm . dustr, got . dadbtar
(Mei l let,Introduction“
, p . Ceci enco re se comprend très faci
lement si l’on admet à l ’o rigine la natu re consonantique de a (A) .
I l n ’
au ra été vocal isedans cette posit ion qu ’
en sanskri t,en grec
et en i tal ique (skr . jdni -tum , o sq . Genetai . lat . genetr ix , genitor) .
La dispari tion de cette so rte d’
h a amené,on le sai t
,la metato
nie de la première syl labe (Brugm ann,Abrégé de gramma ire
comparée, p . 86 note) . C’
est a ins i q ue l’
on a l i tuan ien
béräas, sl . comm .
*bérra
*bréra (ru sse berèga) à côté de skr .
bbûrjah qu i est indo—eu ropéen *bh
‘
g .o c’es t-à- d i re *bbp g .o En
somme, pou r ce qu i est de I’
intonation de l i t . bérä et de sl .*bérz
tou t se passe comme s i la voyel le de la sy l labe éta i t longue
d ’
origine el le a l’
intonation rude. C ’
est d ire qu ’
el le a subi un
al longemen t par su i te de la chu te du phonème 9,so i t d ia lecte
indo- européen préslave et prébalt iqne*bhérg . de *
bher9g . mai s
i l n ’
est nu l lement nécessai re que ce phonème ait pris ici la forme
voca l ique. L’
allongem en t de e et la d ispari t ion de a se com
prennen t en effet p lus faci lemen t encore si ce dernier éta i t dialec
talem ent res té consonne C’
est donc exactemen t le même phéno
mène que celu i qu i a é té rappel é plus haut *strAto
'
s +*stî tÔ s,
*bhçoato
'
s*bbutôs
,etc . et que celu i qu i s
’
est produ i t dans la plu
par t des parlers arabes modernes où voyelle est devenu s imple
voyelle longue, so i t le type ar . c lass . ra’
s tête vu lg . rds etc .
1 2 . Tou t s ’
exp l ique donc mieux dans l ’hy po th èse d’
un A con
sonne. Ma is ce qu i vient a jou ter à ces vues théoriques (qu i ressorten t pou r la p lupart immédiatement du Mémoire de M . F . de
1 . So it do nc quelque chose connu e*bberhg ,o Le cas du type <po
’
pnoç , o ppo
sez 9 a péTpa , péper pov, skr . bhar i est peut-êtreencore le m êm e
,so it *
bhorh—nzos
(après 0 rad ical on ne trouve pas en grec trace du Ma i s à vra i d ire, on
ne s’
expl ique pas ic i l’
interdépendance des fa its .
Revue de phonétique.
1 18 A . CUNY
Saussu re) l’
au tori té dont jou i ssent à juste t itre les recherches dephonétique expérimentale
,c ’es t le t rava i l de M . G . Mi llardet
auquel on a fa i t a l lus ion au débu t de cet art ic le. L’
au teu r y a
mon tré,comment
,dans certaines conditions
,une voyel le quel
conque tend en suédo i s à se consonant ifier dans sa part ie fina le
et i l en a lu i—même conclu (no te 2,p . 3 6 du t irage
‘
a part) quenon seu lement les voyel les extrêmes i
,u,etc .
,mais encore les
voyel les qu i ne son t pas aux extrémités de ’échel le voca l ique,
tel les que a,
sont suscept ib les de produ i re directement des
consonnes épenthét iques sans passer pa r les deg rés de fermeture
ex trême i,u,
C ’
est d i re clai rement que tou te voyel le peu t
revêti r un aspect consonantique,peut se consonantifier en part ie
(et par conséquent en tou t) et qu’
inversement,dans des cond i
t ions favo rables,ces consonnes co rrespondant à a
,peuven t
directement se vocal iser . Il n ’
y a donc plu s aucune d ifficu l té au
po in t de vue de la phonétique phy s io logique, à adm ettre,comme
le proposai t déj à M . H . Mô ller en 1 879 (Eng lische S tudien,III
,
p . 1 5 1 en no te) que la voyel le indo—eu ropéenne 9 n’
es t que la
fo rme vocal ique prise par un A consonne‘
. C’
est le paral lé l isme
des fonct ions de cet A et de cel les des sonantes qu i prouve
seu l , mais qu i suffi t à prouver que la fonction consonantique en
indo— eu ropéen est plu s ancienne que la fonct ion voca l ique.
1 3 . Du reste,s i l
’
on en jugepar une commun icat ion fa ite à la
Soc iété de Lingu is t ique le 6 j u in 189 1 (V . Bulletin Soc . Ling ,
n°
3 4 p . CXVI IJ) , mais qu i , malheu reusemen t , n’
a pas, àno tre connaissance, été pub l iée, M . F . de Saussu re lu i-même
étai t arrivé pou r indo—eu ropéen à une conception sens iblemen tanalogue à cel le qu i vien t d
’être proposée à savo i r qu ’ i l avai t à
l’
origine une valeu r consonant ique éga le a cel le d ’
une sorte d’
b.
Ceci resso rt en effet clai rement des deux exemples ci tés qu i
1 . M. H . Mo l ler excepte encore au jourd ’
hu i les cas tels que *
As degré zérode Aes ê tre I l a sans doute tort , car alors le paral lel ism e n
’
est plusparfait entre les d ifférents tra item ents deA.
120“
A. CUNY
*eg .e
-%m . d’
où présanskrit*ajbam ,
sk . ahdm . I l en est de mêmedemabdnt grand en face de -
ç , so i t i . —e.
*meg 9 I l vaut *meg .a
°
/ont présk .
*majhdnt d
’
où la fo rme attestée. O n pou rra i t encoreexp l iquer de même le b de duhi tdr en face du grec I lfaudra i t admett re que
*dhug91er avec 9 consonne et
*dhugeter avec9 voyel le ont vécu côte à côte un certai n temps . Le résu l tat deleur contaminat ion au ra i t é té dhug 9gter (so i t dbaghÿ ter avec9 consonne et voyel le tou t à la fo i s . I l ne res te plus a lors quel’
exemple de bdnu m âcho i re en face du lat . genu(ini) (dentes) ,gr . —
(âvoç , go t . kinnas so i t i ndo-européen *
génu—s . I l
ne peu t s’
expl iquer de la même façon ,ma is i l y a longtemps
déj à que M . Mei l let y a reconnu l ’effet d ’
une é tymo logie populai re qu i a rapproché
*
janu de *jhan frapper,tuer et l
’
a
a i n si transfo rmé en*
jhdnu d’
où le hdnu védique (v . Mei l letMSL
,t . VIII [ 1 89 3 J p .
II . LES TRO IS INDO—EUROPÉENS .
Pou r p lus de s impl ici té on a jusqu ’ i c i ra isonné sur a indo
eu ropéen comme s’
i l étai t abso lument un,ce que paraissent
admet tre sans réserve MM . Brugm ann et Mei l let . Mais en réal i té,
i l do i t ê tre considéré comme recouvrant tro i s phonèmes d ist incts ,dont M . F . de Saussu re ava i t lu i—même d ist ingué deux qu ’ i l
dés ignai t par A et 9 (Mémoire) et qu’ i l ava i t nettemen t qual ifiés
I l est étonnant qu ’ i l n ’
ai t pas lu i—même reconnu le tro is ième,
car i l écrivai t encore (Mémoire, p . 14 1 ) une combinaison
a .a . (no tat ion actuel le ee) para l l è le aux combina isons d .A,
a .i , a .u (notation actuel le : e9,ei
,eu), fa i t l
’
effet d’
un contresens .
S’
il y a des raisons d’
admettre q ue a . (c’
est— à-d i re e) , avec son
substitu t a. (c’
est-à—di ré o) , possède des att ribu t ions qu ’
au cune
au tre sonante ne possède, pou r que tou tes n’
apparaissen t que
tokharien makàh . V . A. Mei l let, j ournalAsiatique (janvier-février 19 1 2,
INDO— EUROPÉEN ET SÉM IT IQUE 1 2 1
comme les satel l i tes de ce phonème, commen t admettre que ce
même a . (e) pu isse à son tou r se transformer en coefficien t ?C ’éta i t imposs ib le en effet , mais on n
’ étai t pas pou r cela néces
sairement accu l é à la suppos i t ion formu lée p . 144 du Mémoi re
Les éléments de l’
é sera ien t les mêmes que ceux de l’
a,leu r
formu le commune étant a . A (notat ion actuel le e
En effet , la ra ison invoqu ée en no te de la même page 144 et
t i rée de la pronon ciat ion des d iphtongues l i tuan iennes n’étai t
pas va lable, pu i sque M . F . de Saussu re a prouvé lu i—même p lu s
tard (MSL . t . VIII , p . 42 5 su iv . que di , du ne sont
pas , comme i l l’
écr ivait en 1878 , ident iques par l’ étymo logie
à a i , au (même oppos i t ion que béräas et va?nas , que 1 . berè‘
za
et r . vôron) .
D ’
au tre part,s i l’on n
’
admet pas pou r l’ indo—eu ropéen tro i s
d istincts,i l fau t
,dans les cas tel s que gr . 05 1 5 ç , ëor ôç , c r a r ôç ;
yevé—rnp , hp.5
—oa 1 (iipo—
1 pov) , a er oi-vvopa ,supposer que le
grec a donné à l’
un ique voyel le eu ropéenne *d (issue de l
’
un ique*
e) un t imbre chaque fo i s d ifféren t en vertu de l’
analog ie de la
fo rme fo rte des rac ines Orj c r oi Cette ana logie du
reste éta i t imposs ib le dans b ien des cas où la forme forte n ’
est
pas attestée en grec,dans celu i de ép.. et de o
’
<po par exemple
(àp.d>pom do i t évidemmen t ê tre coupé ôp. —xa et non au tre
ment) . De plus c’est admet tre un scindement et M . P. de Saussure
a d i t lu i—même que l’
hypothèse d’
un sc indem ent est tou jou rs
entou rée de grosses d ifficu l tés I l est fâcheux qu ’ i l en ai t admis
un ici , car,depu i s
,malgré l ’art ic le de M . H . Mül ler qu i , en
1 879 , reconna issai t t ro i s espèces dea(cedern ier renonçai t m omen
taném ent à g en 1 880 (P . u . Br . Bei trä ge, p . 49 3 , note) , et m al
gré l’Ablaut de M . H i rt (paru en on con t inue à enseigner
1 Surtout étantdonné que le sc indem ent supposé sera it ana log ique, c’
est—à-d ired
’
or ig ine psy cholog ique. I l y a des sc indem ents reconnus par tout le m onde,
m ais ceux— là sont d’
orig ine purement phonét ique, p . ex . celu i de le en k et ien indo- iran ien et en slave su ivant que le t im bre de la voyel le su ivante éta itvélaire ou palatal (koh : ca i .-e.
*k2w—os
*k2we ; pekç peéetù i .
-e. pekw-o
*
pek%-e
1 22 A . CUN Y
qu a l epoqne indo -européenne i l n ’
y avai t qu ’
une espèce d ’
a et
que c’
est le grec qu i a créé ains i la d is tinction 0 a , innovat ionpou r l ’expl icat ion de laquel le on n
’
a t rouvé rien d ’
au t re que ce
q u i avai t déj à été supposé dans le Mémoire. Sans dou te c’est parun excès de scrupu le scient ifique et parce que le grec est seu l à
d ist inguer par le t imbre vocal ique les degrés zéro des racines*dhe
‘
,
*do et
*stbâ (par exemple), que M . F . de Saussu re n
’
ava i t
reconnu que les deux phonèmes A et g et n’
avai t pas vou lu y a jouter un E ou (coeffi cien t ou iso l é su ivan t le degré de la racine) ,ma is i l fau t b ien reconnaî tre que cette hés i tat ion obscu rc i t
cette part ie de son génia l ouvrage. I l semble pourtan t qu ’
on
pu isse l’adm ettre en tou te conscience, car le grec n’
est pas abso lument seu l à attester l
’
é de Osr éç , âr éç , 7 3 vérnp , En effet ,l ’osque ignore les effets de l
’ intens i té ini tia le qu i a rédu i t tou tes
les brèves atones du lat in à d’
indifférents i(e) , n(o) . S i donc i l
parai t certai n que l’
i de genitor ou l’
é de genétr ix représente un
plus ancien,étant donné celu i de sri -tus
,de fâ - c— tus
,
on n’
a abso lument aucun dro i t de vo i r un affaib l issement de
même nature, par exemple dans le second e de l ’osque Genetai .
Cet e qu i correspond au second e de —{avé
— : rjp, à i du skr . jdni
tur n, ne peu t ê tre qu’
un é ancien et at teste qu ’ i l s’
agit d ’
une
voyel le indo-eu ropéenne d ’
une natu re spéciale i l est vra i , devenuepartou t a i l leurs (et même en osque dans le cas d ’
une sy l labe
rad icale un ique : fac t-nd) à indo— i ran ien I l n’
y a pas au
reste à s’
en étonner . M . Mei l let,dans ses Innovations déc l . la t .
a justemen t i ns isté sur l’
archai‘
sm e du vocal isme osque qu i , avec
le vocal isme grec , est le mieux conservé et le plus l impide sur
le domaine indo—eum péen . C ’
est a ins i que, s’
au torisant de la
désinence — ei de l ’osque pater—ci , M . Mei l let en a t iré la
1 . U n exem p le analogue est fourn i dans les m êmes cond itions, par l
’
om
brien i te-k (en face de latin i ta sk . i ti , i . e .
*i lg. I l est tout auss i naturel de
couper comm e on le fa it ic i , avec le m êm e suffixe —k que dans lat . s ic,hic
,
que de couper i t—eh. Cette faç on de couper est au reste c el le de M. Bréal , v .
Tables Eug ubines, p . 306 .
1 24 A . CUNY
vélai re I l ne s’
exprim ait pas de cette façon ,mai s ce n ’
est sans
dou tepas t rah i r sa pensée quede la tradu ire a ins i . I l a depu is abandonné cette fo rme d ’
expression qu i étai t certainement la p luss imple et la plus c lai re et i l vo i t main tenant
Wôrterbuch,dans E une forte non emphat ique
,dans A une
forte emphat ique et dans O une spi rante emphat ique dou ce.
O n comprenai t très bien au contrai re dans la première expressionde son système que, s i E avai t une art icu lation prépalatale, son
rés idu vocal ique fût également de t imbre palata l (osque ê , gr . et) ,qu ’
au contact du même E con sonne, la voyel le e mai n tînt sontimbre (indo— européen) intact :
*dheE *
dhê . Dem ême,s i la con
sonne A avai t la même art icu lation qu ’
un a pur, ne t i rant n i
su r e ni su r 0,on comprendrai t que son résidu vocal ique fût
un à dès l ’origine et que e indo—européen,lequel étai t encore
très ouvert,s
’
ouvrît à son contact et donnâ t comme résu l tat a,
so i t le processus eA nA à (à mo ins qu’
on n’
adm ît que
le t imbre anc ien de e lu i—même fût également a,ce qu i faci l i te
rai t encore l ’ intel l igence des fai ts) . Enfin,s i le phonèmeO avai t
,
ou tre son art icu lat ion laryngienne, une art i cu lation buccale lab io
véla i re,son résidu voca l ique étai t tou t naturel lemen t 6 (gr . 0)
et , au contac t de cet 0 ,la voyel le e se labial isa i t en 0 ouvert ,
so i t le p rocessu s 60 00 ô (plus fac i le à concevo i r enco resi le t imbre de e é tai t primitivemen t a) .
Ceci n ’
empêcherait nu l lemen t, on l’
a v u,les t ro is phonèmes E
,
A,O d ’être
,comme le d i t M . Mô ller
,des laryngales dans le
genre de cel les que possède le sémit ique. Un phonème peu t êtreen effet laryngal et bu ccal : c’est le cas des consonnes em pha _
t iques de l ’arabe,c ’est même celu i de tou tes nos sonores et de
tou tes nos voyel les (sauf le cas exceptionnel de voyel les sou rdes) .
1 . La nore de la page 1 9 du t irage a par t de l’
art ic le c i té de M. G . Millardet
(Inser tions de consonnes en suédois moder ne) a égalem ent i c i une grande im portance : 11y a des b lary ng iennes ou bronch iales , des h véla ires , des h pa latales , prépalatales ou a lvéola ires ou m êm e I l peut y avo ir pour cha
cune de ces la une var iété sonore à côté de la var iété sourde généralem ent plusrépandue. L
’
expér inæntation le montre. C ’
est la doc trine deM. M. Grammont .
IND0-EUROPÉEN ET SÉM IT IQUE 1 2 5
La natu re de A,E
, O, ne changeai t évidemmen t pas du fai t
qu ’ i l s étaien t amenés à fonctionner comme voyel les ; seu lement dans ce cas l ’articu lat ion palatale
,m oyenne ou vélai re
,
tendai t à se perdre dès l’
i ndo -eu ropéen comme el le s ’est en effet
perdue dès avant la séparation des d ialectes dans les combinaiE E E E E
>1< >1<sons yâ , 103 , rg, lg, ng, mg qu i son t devenues m d1ffe
remment*i , a, n, m, et ceci nécessai remen t , on l
’
a vu,pu isque
dans les deux dernières,tou te ouvertu re bucca le étan t su pprimée
,
i l ne resta i t qu ’
une sorte d’
b laryngienne dont la du réevenai t s ’a jou ter à cel le de la sonan te précédente.
Tou t ce qu i précède peu t parfai temen t être admis pour l’ indo
eu ropéen sans que l’
on so i t entraîné pou r cela à admet tre du
même coup l’ hy po thèse de la parenté du groupe indo-eu ropéen
avec le groupe sémit ique. C’
est en effet un s imp le coro l lai re
t i ré du l ivre de M . F . de Saussu re. Au res te,M . H i r t a lu i
même dédu i t quelques-unes de ces dern ières conséquences, saur
cel les de la conception consonan t ique de A, E , O . Mais s i l’on
va jusque- là,l ’hy po thèse à laquel le faisai t al lus ion Wil
manns en 1 897 (Deutsche Gramm . I Abthei lung , [2° éd i t ion],
pp . 2 1 8—2 1 9) est partout vérifiée,si bien , que a l’origine, le
sens des mots n’é ta i t su pporté que par les consonores . N on
pas que les mots fussen t un iquemen t , a j ou ta i t l ’au teur , compo
sés de consonnes cec i sera i t i n imaginable mai s en ce sens
que le sou ffle sonore que l’
on pouvai t percevo i r dans l’ interval le
des consonnes,étai t enco re à cette époque amo rphe et non
sign ificat if ; ce ne sera i t q u’
insensiblem ent que de cette voyel le
première indéterminée seraien t sort ies par évo lut ion quelques
voyel les caractéristiques et s ignificat ives au même t i tre que les
consonnes On ne sau rai t m ieux résumer les avantages de l’
hy
1 26 A . CUNY
pothèse de A,E
, O consonnes . Pour reprendre une expression
de M . L . Havet , l ’élégance mathémat ique et la s impl ic i té de
la théo r ie parlent hau temen t en sa faveu r . On a vu d ’
au tre part
que, pou r arr iver à ce résu l tat, i l n’
es t nu l lement n écessai re de
fai re vio lence à la phonét ique so i t h isto rique so i t expérimentale.
Mais i l fau t bien avouer auss i que si l’
on admet que l’ indo
européen ancien posséda i t a insi t ro is articu lat ions laryngales , i l ylà un fa i t que M . H . Mol ler peu t lég it imemen t invoquer à l ’appu ide sa thèse
Certains trai ts du consonant isme i ndo—eu ropéen concernant
le mode d’
articu lat ion des occ lus ives , pou rraient éga lement être
rappelés dans le même but et c’est ce qu i a été fai t dans lecompte rendu c i té plus hau t (Bullel in Soc . Ling ,
n°
3 8 , pp . cccxciv
et cccxcv) pour le phénomène appel é lo i de Bartholomae
Un concou rs d ’
occ lus ives , l’
une sono re aspi rée,l ’au tre sourde
forte -bb t par exemple,devenant par assimi lat ion progrè s
s ive —bb dh d’
où —bdh a ins i indo— i ran ien ubdhd z d .
ubda rac ine u rebh t i sser sk . 1î r rza -vabbi so i t
indo -eu ropéen *ubh to
' peu t ê tre conçu comme ayan t sub i
l ’assim i lat ion progress ive de sourde for te (ou sourde douce) à
sonore forte, so i t dans la graph ie de M . Mül ler : —P t ou
-P d -P T (c’
est— à— di re —bh dh Dans le premierc as
,i l y a pro longat ion des vibrat ions glo tta les pendan t la du rée
de la sourde fo rte, cel le-c i ressemblan t à la première par tou tesles au tres qual i tés (sauf natu rel lemen t le po int d ’
art icu lation) .
Si au con trai re i l s ’
agi t (en préindo-eu ropéen) de sonorefor te
1 . Aux yeux de M. H . Mol ler ce n ’
est qu’
une des m o indres ra isons de lalég it im ité de son hypoth èse. Ma is ic i encore on a vou lu s
’
en ten ir à un po intde vue plus bas, heureux si l
’
on est su iv i jusque— là,ce qui serait dé j à pour lui
un sérieux avantage.
2 . Dans le déri vé ubdaêna fait d ’
étoffe t issée
128 A . CUNY
impossi b le s i l’
on t ien t compte de c as tels que arabe Eabak— a,
so i t sémit ique commun*DaH ak hébreu ,sâ haq dans lesquels la
sou rde fo rte à été transfo rmée en emphat ique sou s l ’ influence dela consonne ini t iale de la première svllabe. Ic i en effet les deux
consonnes impl iquées dans le processus d ’
ass imi lat ion ne pou
va ient veni r en contac t dans au cune fo rmeCe phénomène qu i s
’
est réal isé non dan s le sémit ique com
m un, ma is dans l ’évo lu t ion parti cu l iè re de certaines langues
du groupe, parai t au contrai re avo i r é té la règle en indoeu ropéen . O n connai t en effet la lo i reconnuepour les rac ines indoeuropéennes par M . F . de Saussu re et enseignée par M . Mei l let
(Introduction p . quand une rac ine commence on fin i t
par une aspirée sonore, el le ne peu t fin i r ou commencer que
par une au tre aspi rée sono re. Ainsi , on peu t avo i r une racine
ghebh ou une rac ine bheudh mai s on ne peu t avo i r n i *kebb n i
*
ghep n i*
peudb ni*bhent Evidemmen t , cette lo i , bien q ue
régissan t l ’ indo-eu ropéen commun,ne do i t pas ê tre primit ive,
car r ien,so i t en phonét ique géné rale
,so i t en phonétique expé
r imentale,
ne démont re l ’ impossib i l i té phys io logique des
séquences interd i tes d’
occ lusives . Tou t ce qu ’
on peu t d ire,c ’
est qu’
à cette époque le sen t iment phonétique de la langue yrépugnai t . L’état indo- eu ropéen que nous atteignons par la c o i n
paraison do i t donc reposer sur l ’assimilat ion constante de l’oc
c lusive sou rde à l’occ lu sive sonore aspi rée,
et,s i l’on tient
compte de la d irection de l ’assimilat ion dans la lo i dite de Bar
tholam ae (cel le— c i est progress ive’
et présente évidemment un
phénomène t rès ana logue) , on sera porté à cro i re qu ’ ic i encore
l ’assimi lat ion s’
est opérée dans le même sens , en un m o t que
l’
on do i t dans chaque cas parti r de formes tel les que**
ghep ou
“bheut 3
. Transcr ites dans le sy stème de M . Mül ler où p, t, k
1 . M. H . Mô ller n’
admet du reste pas ces expl ications .
2 . Comm e ayant précédé*
ghebh
3 . Comme ayant précédé*bheudh Le double astérisque ind ique qu
’ i l s’
ag itde formes préindoeuropéennes .
INDO—EUROPÉEN ET SÉM IT IQUE 1 29
dés ignent des sou rdes fortes , ces formes seront *K ep
*
Peuet
so i t une séquence sonore for te voyel le seu le ou accompagnée
de coefficient sonantique) sourde for te. I l y au rai t donc en
propagat ion à distance des vibrations glo tta les jusque pendant ladu rée de la seconde occlus ive, la voyel le (éven tuel lemen t lesvoyel les et la sonantey , eu, etc . ) const i tuant le champ naturel decette propagat ion ,
pu i sque les unes et les au tres étaien t essentiel
lement sonores
Depu i s les t ravaux de M . Grammon t sur la dissimilat ion ,
l ’ass im i lat ion et la m étathèse, on do i t admett re que ces phenomènes
,dans unemêm e langue (à une même époque et en deho rs
de circonstances part icu l i ères) , ne peuvent se produ i re que dans
le même sens . O r la sou rde forte peu t occuper par rappor t à lasonore forte une autre pos i tion
,el le peu t ê tre la première ; en un
m ot,pu isque l ’on
’
a fai t la su ppos i t ion **
ghep pou r*
ghebb on a
le dro i t et le devo i r de fai re la suppos i t ion inverse,c
’
es t—à— d ired ’
admet tre des racines q ui , primi t ivemen t , débu ta ient par une
sou rde forte pou r fin i r sur une sonore forte (sonore asp irée) .
Que se passai t-i l dans ce cas ? La di rection de l’
ass imi lat ion
nou s est donnée par la catégo rie précédente el le do i t ê tre pro
gressive et el le l ’es t en effet . U ne rac ine tel le que*
pegh n’
existe
pas en princ ipe en indo—eu ropéen,on n
’
a norma lement que
pck Comme dans le cas précédent, la seconde occlus ive a pris
le mode d ’
art icu lation de la première : el le est devenue sou rde.
On vo i t donc c lai remen t ce qu i s’
est passé le préindo—eu ropéen
conna issa i t auss i b ien des séquences de sourde sonore aspirée
que des séquences de sonore aspi rée sourde. L’ i ndo-européen
I . A cette époque les rac ines à coeffic ient sonantique comporta ient sansdoute encore deux voyelles (so it deux e) .
2 . En d’
autres termes, pour réa l iser la séquence prim itive **
g hep bhent
(“R ep i l fal la it suspendre les vibrat ions g lotta les dès le début du p et
du t aprés les avo ir pro longées jusque— là . I l éta i t plus fac i le de continuer à lefa ire
,et ce qu i y déterm ina it , c
’
est le fa it que la seconde consonne ne d ifiérait
de la prem i ère que par un léger détai l .
1 3 0 A . CUNY
proprement d i t n’
en possède plus par assimi lation les prem i eressont rentrées dans le ty pe
*bbendh. les secondes dans le type
Enfin , grâce à certa ines remarques particuheres de M . Grammont à p 10pos de la m étathèse
,i lest faci le de comprendre pou rquo i
les racines tel les que*steigh skâbb
*sperdh on speig .b échappent
à l ’ interd iction expl iquée plus hau t c ’est que st, sk, sp com
po rtent un souffle auss i bien que db, gb, bb ; la d ifférence, c’
es t
que dans st, sk, sp le souffle est sou rd et qu ’ i l précède l’occ lusive.
Au po in t de vue de la const i tu t ion des racines indo—eu ro
péennes, st, sk, sp ini tiaux équ iva lent complètement à des occlus ives s imples (remarque fai te par M . H . Mül ler entre au tres P .
11 . Br . Beiträge, III , p . 492 ,n . La preuve qu ’ i l s compo r
ra ient un souffle du fa i t de la sifflante, c’
est qu ’
en pâl i les groupessan skri ts st
,sk
,sp ont about i à (t)th, (b)bb, (p)ph, v . M . Gram
mon t La Métatèse en pâ li (Mélanges S . Lév i , p . 6 5 En une
certaine mesure donc st,sp, sk son t de simples équ iva lents dedb,
bb,dh et par conséquen t
*steigh est auss i l égi t ime que
*dheigh
Les tro i s interd ictions relat ives aux occlus ives en indo— eu ro
peen peuvent donc se résumer en une seu le formu le dans lecas
de deux occ lus ives l im itant le même é lémen t morpho logique et ne
différant que par le point d’
art icu lation,l ’ indo -eu ropéen n
’
adm et
ta i t (pou r les sono res s imples v . la no te 1) que deux sourdes ou
deux sonores aspirées,c ’est— à— d i re qu’ i l n ’
admettai t que des fortes,lesquel les deva ien t en ou tre ê t re identiques l ’une à l ’au t re par lemode d ’
art icu lat ion , tou tes deux sourdes ou tou tes deux sono res
C ’
es t là un état relat ivemen t récen t et i l reste des traces del etat ancien deig . par exemple dans le lat in dig — i tas , got . ta ik
s i7. lat . dic(37
us,etc .
,à côté du régu l ier deik. (skr . dec gr .
(ère) etc .,ou dans v . sl . pariti fai re at tent ion à côté
de*
pek*spek r . d ia l . pasa ti (au sens depro
“
uidê re), skr . pdçyati ,
lat . specia, etc . (V . Wa lde, La t. etym . Wôr terb. pp . 7 29
1 . Des neuf possi b i l ités abso lues de séquences d’
occlusives dans les rac ines
1 3 2 A . CUNY
to ta le ou partiel le des sy stèmes morpho logiques . Mais l’élar
g issem ent des racines q u i a en l ieu aussi bien en sémitiquequ ’
en indo— eu ropéen n’
a- t- i l pas en précisément dans la période
présém it ique et dans la période pré indo —européenne une valeur
morpho logique définie et ces é largissements ne sont-i ls même
pas quel quefo is identiques dans les deux groupes de langues
(V . Wôrterbuch,pp . XX I I -XXX I I I) ? Et ceci ne viendra i t— il pas
co rrobo rer,en faveu r de M . H . Mül ler
,le témo ignage du parfa i t
indo-européen que l’
au teu r ident ifie,peu t— être avec raison
,a
la part ie radicale de l’ im parfait sémitique Ma is ce sont l à desquest ions de morpho logie qu ’
on ne saurai t qu’
indiquer dans
une revue spécialement consacrée à la phonét ique ‘.
A. CUNY .
1 . Com parez par ex . le parfait indo—européen (“de-)droma , g r . 8é— ôpo;1— a
avec l ’ im parfa it arabe (y a)-dr um-u (m ême sens) . La seu le d ifférence ic i estqu
’
à sém it ique d correspondra it indo—européen t. En un mot,i l s ’
ag it desdeux côtés d ’
une rac ine’ à é larg issement -m qu i se présentait avec l’
alternanceprim iti ve D : d ( indo—européen d t) , c
’
est-à — d ire sonore douce a lternant avecsourde dance. Pour la va leur prim it i ve de ce qu
’
on appel le l’
im parfai t en sém i
m itique, v . le récent trava i l de M. H . Bauer, D ie Tempora in Sem i tischen (Beitr äg e z ur Assy r iolog ie und sem isticben Spraclnvissenschaft, VI I I , I [ 19 10] et lecom pte rendu qu
’
en a fa it M. M. Cohen dans le Bulletin de la Soc iété de L ing uisti que, n
°3 9 [ 19 1 1 ] pp . cxxxvj et su ivantes .
2 . C ’
est ce qu i a été esqu issé par M . H . Pedersen dans un artic le de laK ubn
’
s Zei tschr ift, t . XL , pp . 1 5 5- 1 5 6 (avant la publ ication du prem ier l ivre de
M. H . Mô ller [Sem i tisch und Indogermanz‘
sch] qu i est de Quelquesunes des idées développées p lus haut ont été expr im ées par M . H . Pedersendans un artic le dé jà c i té (IP,
1 . XX I I [ 1 907-1908J, p . 347 On a c i tél’
I ntroductio nde M. Mei l let d ’
après la seconde éd ition ,non d
’
après la tro isièm e qu i vient de paraitre. Sur aucun des po ints en question la doctrine deM. Mei l let n’
a varié .
UNE VARIATION MÉTRIQUË
INVERS ION DE L’
ACCEN T
Dans les so i-disan t vers iambiques des langues germaniques,
les sy l labes pa i res son t for tes, les sy l labes impai res sont fa ibles
1 . Th is pretty , puny ,weakly , l i ttle one.
TEN N YSON,Enocb Arden
I l arrive quelquefo is, su rtou t au commencemen t du vers, que
Cet o rdre est renversé
2 . Merri l y rang the bel ls and they werewed .
I b.
Au l ieu de la deuxœme sy l labe, c’
es t la’
prem i ere qu i reço i tl ’accent . Cette invers ion de l ’accent comme on l ’appel le
,
M . O tto Jespersen a cherché à l ’expl iquer, par des considérat ions
très ingén ieuses , mai s , à m on sens du mo ins, peu probantes (v .
Comptes rendus de la Société danoise des S ciences . 1 900 , pp . 487
A m es yeux , comme je scande tou s les vers en pieds comm en
çant par la fo rte. c’
est là une var ia tion combinée: le poète sup
prime une fa ib le,
la fai b le ini t iale ou anacruse, et en ajoute
une au premier p ied , afin de conserver le nombre de sy l labesrequ is par le mèt re. Comparez les vers su ivants :
a°
(absen ce d’
anacruse)
Worse and worse shewi l l not com e ! O
S KAKESPEAR Ê,Tam . of theShrew,
1 3 (premier p ied tr issy llabique)
4 . The suni and ra inv seasons came and went .
Enoch Arden .
Revue dephonétique
1 34 PAUL VERR IER
a°
1 3
Suddenly flash’
d on her a wi ld des ire.
TEN NYSON,Lancelot and Ela ine.
6 . Innocent lam bs ! they thought not any i ll,
SH ELLEY , The Cenci ,
La variat ion combinée des deux derniers vers ne détru i t pas
l’
isosy llabie, mai s el le n’
en varie pas mo i ns le mètre, et par un
effet t rès sensib le, qu i a souven t une évidente valeu r express ive.
M . Jespersen tend,au contra i re, à l
’
effacer , ou tou t au mo insà la d iminuer , afin de ramener le vers au schéma du mètre.
Tand i s que dans ce schéma,si nous représen tons les fo rtes par
a et les fa i b les par a , l’ in tens i t é cro î t et décro î t al ternativement
en sui vant la d irection ind iquée par les soufflets
a< o (a),
nous aurions tou t simplemen t dans les deux dern iers vers, et dans
les semblables,
(a)
su r d ix accro issements ou décro i ssemen ts,i l y en aurai t un de
renversé,le premier
,vo i là tou t .
D’
abo rd,M . Jespersen oub l ie deux choses .
I l raisonné comme s’
il y avai t tou jou rs a l ternance d ’
une forteavec une faib le dans les vers avec ou sans invers ion d’
accent
Ce n’
es t pas exact . Il peu t y avo i r partou t deux fai bles entre deuxfortes comme dans le vers 4 et dans celu i- ci (3
7 . So these were wed and merri ly rang the bel ls .
Enoch Arden .
M . Jespersen considère chaque vers à part . I l cache ains i une
part ie de l’ i rrégu larité . D’
un vers à l ’au t re, le phénomène est lemême qu
’
à l ’ in térieur d’
un vers,du su ivan t, par exemple
13 6 PAUL VERR IER
c ’
est la règle dans les pieds trissy llabiques o rd ina i res , la secondefai b le l ’empo rte un peu en intens i té sur la première. Nous en
trouvons la preuve, et M . Jespersen la connai t m ieux que personne, dan s les nombreuses syncopes de la prononciationfamil ière ou même sou tenue history bistr 1], every Caven
dish ["kænds , ha lfpenny difierent etc . On n
’
a
donc pas mais bien plu tôt qu i
tou tefo is , à cause de l’
imperceptibi lité de l’
avant— dern ier
donne l ’ impression de
L’
erreu r deM. Jespersen vient de ce qu ’ i l a pris pou r po in t dedépar t le cas exceptionnel
,except ionnel au mo ins en anglais
(v . Jespersen,l . e.
,p . 5 0 3 , no te) , où le vers comm ence par
une accentuation de la forme 4 3 I , 4 2 1 ou 3 2 1
I I . All-seeing heaven,what a world is th is ?
SH AK ESPEARE, R icb., 3 , I I , I , 82 .
1 2 . Grim —visagedwar hath smoothed h is wrink led face.
I b.,I,I, 9 .
Fau t-i l compter a ll— seeing ou g r im-visaged pou r un pied , ou pour
un p ied précédé d ’
une anacruse,ou pou r deux pieds ? Cela dépend
surtou t dela du rée des sy l labes , de la première en parti cu l ier (v .
m a Métr ique ang la ise, I , 3 3 4 S i l’
on a un pied précédé
d ’
uneanacruse,et d ’
uneanacrusep lu s i n tense que la fo rtesu ivante,l ’analy se de M . Jespersen est exacte
,mais seu lement dans ce cas
,
qu i reste en général assez dou teux (V . Partou t a i l leurs,
c ’est— à-d ire presque partou t , el le est inexacte.
Revenons à la variation combinée a° 1 3,etc . O n remarquera
que par la suppression d ’
une fai b le entre deux fo rtes,i l y a un
pied monosyllabique dans le corps du vers da rk ou à la findu précédent caves
o r where the secret caves,
Rugged and dark , wind ing among the Spring s
SH ELLEY , Alastor.
U N E VAR I AT ION MÉTR IQUE 1 37
Vo i là pou rquo i l’
i nvers ion de l ’accen t ne se rencontreguère qu
’
au commencement d ’
une section ry thmique, vers ou
hémist iche : la pau se fina le permet de p ro longer sans peine lafo rte précédente, de man ière à rempl ir , avec ou sans s i lence
,la
durée no rmale du pied le heur t des deux accents est au ssi
mo ins sens ible en ou tre, le premier p ied de la sect ion ry thmique,surtou t du vers, est en généra l un peu p lus long q ue les au t res ,et i l admet par su i te p lu s faci lement l ’addit ion d ’
une faib le v .
m a Métr ique ang la ise 1, 3 1 5 , 3 1 6, 2°et 3 20 Rem .
, 3 22 , 3 2 3 ,
et 3 z 4 ; Il , pp . 1 3 8 , no te 6 , et 1 3 9 , no te 1 III , 146 ,
186,
1 9 2 , 1 98 ,
Vo i là pou rquo i , en ou tre, l ’ i nvers ion de l ’accent ne se
produ i t presque j amais dans les vers trocha1ques c’
es t qu ’
en
parei l cas,dan s le p ied monosy l labique, dans celu i du vers su i
vant, par exemple pa le
14 . The pa le purpleSH ELLEY
,TO a Sky lark,
i l n ’
y a n i s i lence n i pau se d ’
aucune sorte i l est plu s d iffi ci le de
pro longer la sy l labe un ique de man ière à rempl i r un pied , sur
tou t le premier ; il y a rencon tre immédiate de deux accentu ées;le prem ier p i ed , q u i tend à être le plu s long , a une sy l labe de
mo ins que les au tres . Dans ce cas, t rès rare, nou s avons pourtan tune variat ion comb inée de même espèce que la précéden te, ma is
renversée add it ion d ’
uneanac ruses imple(a‘
) et suppression d’
une
faible au pied su ivan t L’
expl i cat ion de M . Jespersen devrai t
donc s’y appl iquer auss i . C’
es t imposs ib le. Nouvel lepreuve qu’
el le
est i nexacte.
Résumons . El le ne peu t s ’appl iquer aux i nversions d’
accent
du vers trochaïque n i même à cel les des vers iambiques
où la seconde forte n ’
est précédée que de deux sy l labes (9 et
El le dé tru i t l’ isochronism e, comme je l’
ai démontré (v . m a Mé
trique ang laise, III , $ 3 et comme on s’
en rendra compte en
1 3 8 PAUL VERR IER
comparan t entre eux les pieds que M . Jespersen attr ibueaux vers 2 , 6 et 8 , par exemple -ocent soul et fli t ted Enfin
,
et c ’est là un vice abso lument rédh i b ito i re, el le repose sur une
d ist inct ion erronée entre deux fai b les—au po in t de vue de l ’ in ten
s ité .
Pau l VERR IERChargé de cours à la Sorbonne.
140 H . PERN OT
t oa >rr rj7«z = rcavv1 7c ouve t’
o t upi l i nge dans lequel on cai l lele fromage -9 kandila .
t oa p: üy_1a tsarouks , sou l iers à la pou laine ka ruça .
t eam —Jp: (lat . secur is) hache kekurt os
'
7m poche kep .
.oiwa gou rde -9 kika .
Ces fo rmes,don t la plupart sont relat ivement récentes en grec
,
ind iquen t que le phénomène ne remonte pas à une date b ien
ancienne.
L’évo lu tion en est faci le à déterminer dans ses grandes l ignes,
si l’
on t ient compte de ce que, à l’
heu re actuel le encore,on
observe à Del phes des s qu i deviennent e,auss i b ien devant
voyel le postérieu re que devan t voyel le antérieure sa ea ,
so eo,su e u
,se ce
,si ei . Ce e se prononce t rès en avan t
dans la bouche. I l est dès lors probable que l’évo lu t ion a été
ts te tç le. Ce le lu i-même,tel qu ’
on m e l’
a émis,étai t
un lemou i l lé t rès avancé .
Hubert PERN 0T .
APPAREIL DU Dr STRUYCKENPO UR LA PH OTOGRAPH IE DES VIBRATION S SON ORES
Ce qu i fai t le caractè re propre de cet apparei l,c’est l ’emplo i
de deux membranes pour act ionner lemiro i r , qu i transmet leurs
osci l lat ions au rayon lumineux afi n de les agrandir et de les
photograph ier . Ce procédé n ’
est po i n t un caprice de constructeu r,
c ’est le résu l tat de longues recherches et de sérieu ses réflexions .
Si l’
on n’
a qu ’
une seu le membrane, le miro i r a beau ê tre trèspetit et très léger
,i l n ’
arr ive pas , pour les vi brat ions d’
une
ampl i tude p lu s pet i te que u, a tou rner au tou r de son axe,
mai s i l est pou ssé en avant et en arrière dans son pivo t qu i fo r
cément do i t donner un peu de jeu . Les deux membranes sup
priment cet i n convén ient , en forçant le miro i r à exécu ter son
mouvemen t au tou r de son axe. On pou rra s’
en rendre compted ’
après les fig . 1 et 2 .
La figu re 3 représente deux coupes du même apparei l .
A. Coupe hor izontale. Les v ib rat ions sonores son t recuei l l ies
par l’
entonno ir A (long . 10— 1 5 centim . larg . 4-
9 Les
deux membranes q et q’sont paral l èles et tendues d
’
une man ière
appropriée, au moyen de la vis 1) (coupe vert icale Deuxpeti tes t iges von t de cel les—ci à deux leviers du peti t m iroi r 0.
Celu i-ci reço i t le fa isceau lumineux fourn i par la lent i l le r et le
renvo ie presque dans la même d irection . Les vib rat ions des
membranes q 9’ cm . ) font osci l ler le pet i t miro i r 0
mm . ) et le rayon lumineux su i t cet te o sci l lat ion avec une
ampl itude agrandie 5 00 fo is s’
observe faci lemen t) . Ce
rayon tombe sur leprisme (fig . 2) et est pro jeté sur la bandede
papier sens ible 17 qu i est mise au po in t à l’
aide de la rouew. Sur la
coupe vert icale A'
, on peu t vo i r les extrémités du levier du
142 D' STRUYCKEN
peti t miro i r 0 où son t fixées à l’
a ide d’
un peu de so lu t ion de
caou tchou c les tiges r igides , qu i viennen t des membranes . La len
t i l le z D . ) pro jet te l’ image du po i n t lumineux L (pet i te
ouverture dans un d iaphragme écla i ré à l ’a ide d’
un hé l iostat)juste sur la bande sens ib leen réfractant deux fo i s les rayons lumi
neux . La roue W cont ient la bande sens ib le de 30 a 100 m . ;
Fig . ]
Fig . 1 . U ne seu le m em brane.
Déplacement du m i ro i r dans le p ivo t .
S i l ’am pl i tude A B devient de plus en plus peti te elle arr ivera à égaler ce déplacement
et le m i ro ir ne tournera plus .
F ig . 2 . M'
, M'
. Deux mem b ranes fa isant des excursions synch roniques , m a is con
tra i res .
A '
. M i ro i r tou rnant sur l ’axe v irtuel o'
Dans l ’apparei l , lem iro i r est fi xé à un pet it levier su ivant un ang le de afin qu i lpu isse refléter plus fac i lement le rayon lum ineux .
cel le- c i est enroulée sur la roueW et la pet i te rouew’entretient
par sa frict ion la tension nécessai re. Les roues ont le d iamètre de
3 3 cm . en so rte que chaque tou r fa i t un mètre de bande.
Pou r l ’enregist remen t du temps,on se sert du diapason d , de
1 000 v . d ., qu i est frappé légèrement par un peti t marteau ,
chaquetro is ième tour de roue. Les vibrat ions de ce d iapason sont réflé
ch ies avec un agrand issemen t de 3 00 fo is, à l’
a ide du pet i t m i ro i r
m’ maintenu à une des tiges du d iapason (avec du caou tchouc)tand is qu ’ i l reç o it l’ im pu ls ion de l
’
au tre t ige par un pet i t fi l d’
acier .
Le fai sceau lumineux venant du même po in t L ,est dévié par le
prismePde quelques cen timètres à côté et l’ imageest formée par la
144 D’STRU YCK BN
len ti l le (d’
une réfract ion p lus forte que e) à côté de la premièreimage sur la bande b.
De cetteman i è re on obt ien t sur une même bande les vibrations sono res d ’
une sou rce vou lueet , indépendante de cel les— ci,la
0,000 I :s.
0,000 I
1000
g g'
g2
g'
g'
v . d . 96 192 3 84 768 1 5 36 3072 6 144
FIG . 4 .
Abaque logarithm ique de correc tion1 ) pou r l’ intens i té physique .
2 ) pou r l ’ intens ité physiolog ique.
3) logar i thm ique des m inima perceptibles .
La l igne (1 ) donne les am p l itudes en m icr a d ’
une m em b rane dans le c as où les d iapasons g , g
l, etc .
, ont l ’am pl i tude de 1 00 }1 Cette l igne do it être constru ite pou r chaqueapparei l et pour une tens ion donnée. Ce n
’
est qu’
après la correct ion des valeurs desordonnées d
’
une courbe à l ’a ide de l ’abaque qu ’
on peu t arr iver à une com para ison avecl ’ana lyse fai te à l ’a ide de d iapasons ou de résonnateur s .
La l igne (2) m arque l ’am pl itudedes sons de d iapasons donnant l ’ impress ion de forteà notre orei l le.
marque du temps,de so rte que l
’
on n’
a pas a s’
inqu1eter des
variat ions de vi tesse de rotation .
Avant de pouvo i r u ti l iser les cou rbes ob tenues , on do it fa ire le
contrô le de l’apparei l . En variant la tension on peu t fai re appa
rai tre plu s ou mo in s les cou rbes de sons p lus ou mo in s é levés .
APPARE I L DU ' D ’ STRUYCKEN 14 5
On fai t la recherche d’
après la méthodesu ivan te
L’
entonno i r A est enlevé et remplacé par une p laque avec uneouvertu re de 1 cm2
. Devan t cet te ouvertu re on fa i t v ibrer des dia
pasons de hau teu rs diverses et l’
on marque l ’ampli tude du rayonlumineux au momen t où les diapasons ont une ampli tude ind i
quée (d isons de 1 0 La membrane peut a lors réagi r avec desampl i tudes d iverses par exemple pou r G (sol,) avec o mm . 1
,
pou r g 0 . 3 , pou r g 2 g 3 etc . On se fai t un abaquelogari thmique et à l ’aide de celu i- ci on peu t fai re la co rrec
t ion des résu l tats de l ’analy se mathémat ique et t rouver les
ampli tudes co rrespondan t aux vibrat ions de l ’ai r .
Avec les méthodes qu’
on a su ivies ju squ ’ i ci on n’
obt ient que
les ampl i tudes de la membrane, par exemple du phonographe, et
celu i—ci ayant un paraléllisme tant so i t peu physio logique et .non
phy s ique, ou do i t être très pruden t pou r en t i rer des conclus ions .
Les ampli tudes qu’
on trouve ne corresponden t que très peu aux
ampl i tudes des cou rbes aériennes .
Prenons , par exemple, un d iapason donnant comme son fon
dam ental G et comme harm on ique g, .
A l ’extrém ité de la branche nou s pouvons mesu rer l’
ampli
tude ; et nous t rouvon s pou r G 2 mm . ; pou r g 3 seu lemen t
0 mm . 020 . Cependan t le son g , est pou r no tre ouïe perçu
beaucoup plus for t que le sonfondamenta l . Faisons inscri re ce son
par le phonographe, nous au rons une cou rbe, qu i présenterapour
G une ampl i tude de 4pt et presque la m ême ampl itude pou r g 3 .
Alors on t i re la conclus ion que l’ in tensi té des deux sons a é té
la même et r ien n’
est plus f aux que cela .
Un son G,avec la même ampl itude que g,, est un pian issimo
des plus faib les, tandis que le son g , est un for l issimo. Si nous
faisons la correct ion avec notre abaque,nous pouvons retrouver
l ’ampl itude aérienne réel le et nous pouvons vo i r à l ’aide del’
abaque pour l’ intens i té phys io logique que, bien que l
’
ampl itude
de g, so i t de cent fo is plus pet i te que cel le de G, g 3 dominera
cependant sur not re ou ïe.
146 D' STRUYCKEN
Généralement on peu t d i re que, même après co rrect ion pou r
l ’ampl i tude aérienne réel le, les sons plus bas do ivent avo i r
une amplitude de 10 n/N p lus grande pour arr iver à la mêmein tens i té phys io logique (n et N étant le nombre des v ibrat ions) .
Au -dessus de c+cependan t la d ifférence est déj à mo ins considé
rable de sorte qu ’
on do i t fai re la correction à l ’a ide d ’
une l ignecourbe et qu ’ i l est à préférer de s ’
en ten i r à l ’ampl itude aérienne
( l’ intens i té physique) et d
’
être t rès pruden t quan t à la conc lus ion,
qu ’
un tel son est le fo rmant d ’
une voyel le, parce qu’
on
trouve dans l ’analyse d’
une cou rbe quelconque son ampli tude
préva lant su r les autres .
148 CH LUMSKŸ
A l ’a idedeces deux perfectionnemen ts, on peut tou jours donnerau saphi r la pos i t ion vou lue. I l va de so i que l
’ insta l lation do i t
se fa i re sur un s i l lon dro i t , sans vibrat ions .
Vue en dessou s . Vue en dessus .
F IG . 1 .
Enreg istreur phonograph ique, sy stèm e L ioret .
A . Saph i r t ranchant fixé sur la p laque v ib rante D . B . Saph i r mousse. fi xé sur
un ressort R .— K Bou ton à v is m ic rom étr ique (vue en dessous) , en comm un ication
avec le resso rt R , perm ettant de relever ou d’
aba isser le saph i r m ou sse et de rég lerains i la profondeur du s i l lon c reusé par le saph i r tranchant et enfin , d
’
em pêcher les tré
p i dat ions q u i se p rodu isent pour l ’enreg istreu r phonog raph ique ord ina i re. C . Cadran0 . Ouverturedu condu it en comm un icat ion avec la plaque v ibrante. L . Pièce servant
à sou lever la art ie antér ieu re qu i porte la plaque vibrante.— VV
'
éc rous de serrage.
T. Tenon e fixage.
REMARQUES SU R L’
APPAREIL LIORET 149
3° U n parleur a été i nstal l é su r une t ige placée à côté du cyl indre
pour fac i l i ter le cont rô le de l’
enregistrement . Comme on sa i t,
l ’apparei l Lioret cons t i tue en réal i té deux mach ines : un pho
nog raphe, système Lioret , avec un enregistreu r spécial fixe,dont
nous donnons i c i la figu re (PIG . 1 ) et un apparei l t ranscri pteu r .Cette méthode permet donc d
’
éco u ter ce que l’
on a enregistré .
On le fa isai t primit ivemen t en tenant à la main le reproducteu r
phonograph ique ou bien l’ on étai t obl igé d ’
at tendre que la t ranscr iption fût terminée et d ’
examiner après . Avec le nouveau par
leur on peu t immédiatemen t se rendre compte de la qua l i té de l’enreg istrem ent .
4° Les deux pou l ies qu i porten t la bande de papier no i rc i
étaient originai remen t en bo is et par cela exposées à l ’ influencede l ’humidité . S i cet te act ion su r la pou l ie é lo ignée du levier
peu t être indifféren te,el le ne l ’est pas pou r cel le qu i se trouve
le plus proche de la p lume. Le mo indre changement produ i t par
l ’humidité su r la su rface de la pou l iemodifie les degrés de contact
de la p lume et du papier no i rci, augmente la fri ction de la
po inte et peu t a l térer a i ns i la fidél i té de la transcript ion de la
cou rbe phonograph ique. Pou r ces ra isons‘
la pou l ie en question
a été remplacée par un cy lindre b ien ca l ibré , en a lumin ium . Le
con tact est dès lors plus faci le à régler , on peu t le rendre t rès
léger et donner au tracé la finesse nécéssaire.
Un au t re réglage, non mo ins impo rtant que celu i de la plume,est celu i de la bande de papier
,portée su r deux pou l ies . Il ne
fau t pas la isser le papier toucher à l’
un des bo rds du cy l indre, car
i l se p rodu i rai t un l éger fro t tement qu i rendra i t i rrégu l iè re la
marche du papier et nu i ra i t à la précis ion dans les mesu res delongueu r et de hau teu r mus ica le.
La bonne posi t ion,au mil ieu du cy l i ndre métal l ique, s
’
obt ient
par une tro is ième pou l ie, p lacée à la base du bât i et reposant su rla part ie inférieu re de la bande de papier : el le donne a cette
dernière une tension un iforme et lamaintient comme i l convientRevue dephonétique.
10
Vue de côté . Vue de face.
F lo . 2 .
Levier double de l ’apparei l L io ret .
VX . Vi s à pointes perm ettant d’
inc l iner le g rand b ras du second levier s im plecette art icu lation n
’
ex i ste pas su r le m odéle‘
exam iné .
1 5 2 CH LUMSKŸ
à ret rouver le fond du s i l lon . Po ur arriver au même résu l ta t,à
l ’action du po id s est subs tituée cel le d’
u n ressort fixé par derri ère
su r la p lat ine. Ce ressort, vis ib le auss i su r la figu re, exerce u ne
press ion su r le pet i t bras et ma intient a ins i le saph i r en contact avecle fond du s i l lon .
Plus s imple est le grand bras L du même levier . I l es t fo rmé
d ’
une tige dro ite terminée par une fou rcheG,dans laquel le entre
commodémen t la po inte O du pet it bras du second levier s impleOBL’
. Pou r rédu i re le fro ttemen t au minim um,M . Lio ret fa i t
agir seu lement un côté de la fou rche, le côté dro i t , et assu re le
contac t cont inu de ce côté avec le peti t b ras par un spira l S,
attaché sur l’
axe B du po int d’
appu i du second levier .
Ce dernier est une s imple tige t rès l égère, en méta l- l i ege,
commedu reste le levier tou t ent ier el le se term ineen une po inte
tou rnée vers le papier no i rc i afin d ’y transcri re les cou rbes pho
nographiques . Su r la fig ure, ce lev ier est plus compl iqué ; i l cons
titue un nouveau modèle que le constructeu r trouve mei l leu r ;ce modè le a également é té acqu is p ar le Labo rato i re du Co l lège
de France,mais le temps m ’
a manqué pour l’exam iner . Pou r
donner la plus grande sens ib i l ité au second levier,son po int
d ’
appu i a un axe empierré à pivots t rès fins,osci l lant dans des
t rous de rub is .
Vo i c i maintenant comment fonct ionne cet apparei l . Suppo sons
que pendan t la marche du cy l indre un rel ief, c’
est— à -d ire un po int
supérieu r du s i l lon , passe sous le saph i r . Alo rs,ce rel ief
,grâce à
son épaisseu r pousse en arrière le saph i r et par l à au ss i le pet i t
b ras du premier levier et avance le grand . Ce dern ier, par le côté
dro i t de la fou rche, exerceune press ion su r le pet i t bras du second
levier et lu i commun ique son mouvement . Par contre,s i le
mouvement est inverse, correspondant à l’
arrivée,non pas d
’
un
rel ief,mais d’
un creux et à la pénétration du saph i r dans un
po in t plus profond du s i l lon,la fou rche va en arrière
,cesse
d ’
exercer sa press ion ,et el le abandonnera i t le pet i t bras du second
REMARQUES SU R L’
APPAREIL L IORET 1 5 3
levier , s i le sp i ral nevenai t en a ide en poussant vers le côté dro i t
de la fou rche et en fo rçant a ins i le second levier à reprodu i re auss i
la seconde part ie du mouvemen t du saph i r et à donner par con
sequen t la cou rbe complète. C’
est donc une idée ingén ieuse
que cel le d’
employer un spira l pou r assu rer le fonct ionnement
du levier et pour d im inuer u n frot tement perni c ieux à certainsdéta i ls dél icats de la cou rbe. Tou tefo i s une ob jection est possi b le.
Le spiral agissant dans un seu l sens do i t opposer une rés i stance
au mouvemen t inverse qu i co rrespond à la marche en arrière
du saph i r , cau sée par une é lévat ion du s i l lon . je ne vo is à celaau cun danger . La résistance est min im e eu égard à la force exer
cée su r le saph i r par chaque rel ief de la courbe, force qu i do i t
faci lement contrebalancer et la résistance du spira l et cel le dupo ids du second levier . Du res te on peu t en j uger au ss i un peu
d ’
après les détai ls du t racé . Malgré le pet i t agrandissement du levier
examiné,on obt ient des vibrations des consonnes p
,t , k , et S
qu i pou rraient d iffi ci lemen t se reprodu i re,s i la rés istance du
spira l se fa isa i t sent i r . Ces vibrat ions, b ien entendu,sont l is ib les
à la lou pe. Pou r les rendre plu s d istinctes,i l fau t recou rir à un
agrandissement p lu s cons idérable, comme celu i dont se sert M .
Bogoroditz k i de l’
Univers ité de Kazan son levier agrandi t 3 00
fo is .
Sur les apparei ls de MM . Hermann et Scripture,le saph i r
retrouve le fond du si l lon par son propre po ids . Pou r l ’apparei l
Lio ret,c ’est la pression exercée par le resso rt et mai ntenue par la
v is du support q u i condu i t à ce résu l tat . I l fau t seu lement recher
cher quel le press ion convient le mieux,ou en d ’
au tres termes ,quel le est la mei l leu re posi tion du levier et de la plume. M . L io
ret di t que c’
est la pos i t ion vert icale. Pou r contrôler ces ind ica
t ions . j’
a i enregistré unephrase avec son enregistreu r spécia l (fig . 1 )après avo i r natu rel lement rabo t é le cy l indre de cire afin de le
rendre parfai tement rond et d ’
obten i r,comme transcription
,un
tracé le plu s dro i t poss ib le. J’
ai ensu i te transcri t 1 9 fo is un m ot
1 5 4 CH LUMSK Ÿ
(nain) de la phrase enregistrée, en augmentant sy stématiquemen t
la press ion au moyen de la v is et en donnant a ins i su ccessivemen t
au levier d ifférentes pos it ions,depu is la plus incl inée
,exprimée
par 1 8 mm . de la réglette,jusqu ’à la dro i te vert i cale qu i est à 7
mm . Pu is j’
ai dépassé la verti cale et j’
ai examiné les au tres pos i
t ions,en donnant à la p lume une l égère incl inat ion dans le sens
opposé . O n au ra une idée de la du rée du travai l,s i j ’a j ou te que
chaque transcript ion de ce même m ot a exigé en moyenne une
heu re,non compris le réglage de l ’apparei l et les au tres travaux
nécessai res .
La transcription terminée, j
’
ai cho is i t ro is vibrat ions correspon
dantes su r chaque t racé,deux pet ites
,pou r savo i r comment la
plume rendai t les vibrations min imes, et une grande,pou r
savo i r ce qu i se passa i t dans les mouvements plus cons idérables .
Enfin j’
ai m esuré le chemin parcou ru par la plume,en prenant
,
pou r chaque dent etc .) de la vibrat ion composée,deux
o rdonnées qu i donnent la hau teu r de la den t , l’
une par rappor t à
son commencement,l ’au tre par rappo rt à sa fin (v . la fig . des
Pr incipes , p . et j’
ai obtenu les chiffres réunis (page
qu i représentent des d ixièmes de mm .,les fract ions indiquant un
nombre mo ins précis .
Ces chiffres permet tent les conclus ions su ivantes
1° Pou r les tracés pris entre 18 et 10 mm .
,les o rdonnées sont
les plus petites, pu isque la press ion a été au ss i la plus pet ite : le
saphi r ne tou chai t pas suffi sament le fond du si l lon . L’
insuffisance
de la press ion se vo i t du reste à la forme des tracés qu i sontt remblés
,su rtou t les premiers, preuve que le saphi r ava i t trop de
jeu . Ce tremblement d iminue à mesu reque la pression augmente.
2° Pour les pos it ions entre 9 et 4 , les ordonnées atteignent
leu r maximum et , ce qu i est non mo ins importan t , el les gardent la
même grandeu r ; pou r les pet ites vibrat ions l’
accord va plus lo in
encore, ju squ’à zéro . Les quelques d ifférences qu ’
on y rencontre
sont min imes el les ne dépassent pas un demi—dix ième de mm .
1 5 6 CH LUMSK Ÿ
et s ’expl iquen t par la résistance de l a fumée. Dans tous ces cas,
l e dessin est net,sans aucun tremblement, l e saph i r s
’
appliquait
bien à la base du si l lon .
3° Pour les posi t ions su ivan tes , après quatre pour les grandes ,
aprés zéro pour les peti tes , l es ordonnées d iminuen t . Mais cen ’est qu ’après le zéro que la courbe s ’
altère.
Donc la mei l leure pos ition du levier est aux environs de laverticale , entre 9 et 4 mm .
,espace largement suffi sant pour le j eu
du levier .
Ces ch iffres montrent en même temps que la marche len te du
cyl indre n’
abîme pas le s i l lon,fa i t don t j ’ai pu me rendre compte
en faisan t u l térieurement une nouvel le transcription,l a et en
obtenan t la même forme du tracé e t les mêmes quanti tés pour lesordonnées .
A côté des expériences,où j ’a i v ari é la position du saph ir et
du levier et où j ’a i mesuré seulement quelques vibrations corres
pondantes , d’autres ont été fa i tes où la bonne posi tion a été con
servée pour deux transcriptions successives du même mot e t oùtoutes les vibration s ont été mesurées . Les ch iffres montren t que
l ’accord est parfai t,s i l ’on a pris so in d’
enfumer régul ièremen t l e
pap ier et de fa i re appuyer la plume d ’une façon égale,chose
faci le avec un cyl indre métal l ique b i en cal i bré,et s i de plus le
pap ie r lu i-même est b ien g lacé .
Cette dern ière comparaison parle donc auss i en faveur de l ’apparei l
,aussi b ien que la finesse des tracés et la richesse des détai ls
attribuable,à mon avis
,au con tact du saph i r e t du fond du si l lon
,
touj ours assuré par la pression qu i remplace fort avantageusemen t
le poids et , en second l ieu , grâceà ce fa it que l’on n ’a pas besoin
de touc her au cyl indre phonograph ique depuis le commencemen t
de l ’enregistrement j usqu ’à l a fin de la transcri ption et que l’on
ne déforme n i le cyli ndre n i le tracé ; voir l a Revue, tome I , p . 68 .
La press ion offre encore une autre ut i l i té la marche du lev1er
est moins sens ib le au bruit de la rue que par exemple pour l ’appa
REMARQUES SU R L’
APPARE1L L IORET 1 5 7
rei l de M . Scripture employé au Laboratoire . En outre , avec unman iemen t faci le , onfa i t des expériences peu coûteuses e t par
lantes aux yeux . Ce son t là ce rtes des avantages qu i ne son t
pas à méprise r .
Toutefois,s i la tran scription dans le no i r de fumée a ses beaux
côtés,el le a auss i ses i n convén ien ts : l a rés istance de la fumée
,
qui doi t occasionn er une certa in e perte, du reste inévitabl e pou rtous l es appare i ls s imi la i res . Pou r évi ter cette perte i l faut recouri r à l a photograph ie . Des expérien ces de ce gen re
,avec l e
même appare i l L ioret,on t é té commencées au Laborato ire du
Col lège de France . E l l es permettron t de j uger de la perte en question et de compléte r l e con trôle . On pourra pousser plus lo in e tcomparer l es résu l tats avec les mesu res d i rectes qu ’on ob tien t avec
l ’apparei l Boeke. Cependan t, même san s la photograph ie, te lquel
,l ’apparei l L io ret es t un bon out i l d e plus pour l
’ étude de
la durée,de l a h auteu r musica le , pour la compara ison en gros
des in ten s i tés e t des t imbres . Un exempl e de l a faç on don t i lpeu t êt re u t i l isé sera donné dans le prochain fascicu le de la Revue
de phonétique.
N . B . M . Lioret se propose de constru ire un lev ier renversé,pour d iminuer l ’ac tion du poids du levier e t pour en augmente r
la sen sib i l i té,en outre d ’a j outer au centre de rotation B’ un
peti t cadran faci l itan t l ’examen de l ’ in cl inaison du saph i r par
rapport au si l lon .
CH LUMSK Ÿ .
Téléphoneécr ivant.
Sur les ind icat ion s de M . Rousse lot , M . Lioret a construi t un
téléphone écrivan t . La Revue en donnera l a description quand
les expériences qu i se poursu ivent avec cet appare i l dans l e labo
rato ire de Phonét ique du Col lège de France seron t term inées .
1 5 8 CH LUMSK Ÿ
Apparei l deM . Li]chit< .
Nous signa lons simp lemen t l’art ic le publ i e su r cet appare i l
dans le j ourna l dePhysique, I 9 I I , qu i com p lè te l es ind icat ionsdonnées dans le premier fascicul e de la Revue de Phonétique,
r9 r r , p . 77 .
Le recue i l de M . Tigerstedt, H andbuch der physiolog ischenMethodik , où a paru la Phonétique de M . Poirot
,a publ ié auss i
un trava i l i n téressan t de M . O . Frank Kymog raphien, Sehrez‘
bhe
bel, Reg istr ierspiegel , Pr inz ip ien der Reg istr ierung ,
travai l qu i m ériterait un art ic le spéc ia l .
Jos . CH LUMSKŸ .
1 60 L ’ABB I—î ROU SSELOT
Nature l lement le s Fran ç ais on t conservé dans les mots em pruntés l ’orthographe latine
,et se son t app l iqués à y conformer leur
prononc iation . I ls n ’on t pas tou j ours réu ss i,so i t qu ’une sonore
lat ine a it été sentie comme une sourde,ou inversement une
sourde comme une sonore . Nous rencontrons,en effet
,dans les
documents d ’arch ives qu i échappen t l e p lus à la tradi t ion
orthograph ique des mots comme ceux—c i
obtenir ( 128 3 , Dép . de l’Aube) , apsance ( 1 3 08 , Loiret) , dans
Godefroy . Au XVIe s iècle
,Baïf écri t opw
‘
roant ; Be lon souber‘on
names ; Le Pless is : soubçonner (God ) ; Rob . Est ienne soubson
(Thuro t) . Au XVI Ic s ièc le
,R ichelet mentionne so ubçon ,
et le con
damne .
Le premier qu i a i t formulé une 0pin ion générale sur la prononc iation de ces groupes est Frem ond d
’
Ablancou rt
Comparan t d ’un côté subti l,
observer,et de l
’autre soupçon,
capr ioler , i l d it qu’ on p rononce presque les uns comme s’ i l y
avait un p,et les autres connu e l e b (Thuro t, II , p .
L ’abbé de Dangeau ( 1 694) étab l i t l a rég le Q uand on aura ,d it— i l
,à prononcer deus de ces confor mes (b p, 7) f, d t, g h, s
,
i eh) l’
une auprès de l’au tre, fans diftance, qu ’ i l y en aura une
foib le l ’autre forte,cèl e qu i fera la dern ière anportera l a pré
miere . Et i l donne comme exemple scr ibo, Puis i l
a j oute Un G qu i devien t K,un B qu i devien t P
,ne change
poin t de nature,i l a l a prononc iac ion qu
’ i l do i t avoi r,
qu ’ i l
n e peut pas s ’
anpécher d’avoir quand i l eft devan t une letre forte
come le T On a beau y (dans observare, obtenir) écrire un Bdevan t l’S devan t le T
,l a bouche ne fauro it l es p ronon cer,
on l i ra tou j ours optenir , opserva re avec un P (2° disc . qu i tra ite
des cons . , p . 1 2,1 3 , H ardu in ( 17 5 7) et Bou lliette ( 1 760)
reprodu isen t la règle de Dangeau et Cherrier ( 1760) fait remar
quer que p lusieurs fon t prononcer apstra it, optenir , cab verd
(Thurot , II ,Pour Boulliette
,i l n ’
y a pas non plus de mi l ieu en tre l a douce
LA PRONONC IAT ION FRANÇA ISE 1 6 1
et la forte fi des deux Syl labes de ce mot,cheva l
,j e n ’ en
veux fa i re qu’
une,
que j e veu i l le p rononcer la Conform e fortech
,i l faudra néceffai rem ent que j e change l e v qu i fu ir, en f, qu i
eft l a conform e forte qu i répond au v , que j e prononce ch'fa l .S i au contra ire c
’
eft la Confo rm e foibl e v que j e veux faireen tendre , i l faudra a lors que j e change l e ch qu i précède, en qu i
eft l a Confor me foib le qu i lu i répond ; que j e prononce i’
va l .
La raifon de ce changemen t eft fenfible. Pu isque de deux Sy ll abes on n ’ en fai t qu ’une i l n ’y a p lus qu ’une feule im pu lfron ou
ém iffi on de voix . Or i l eft im poffible de pouffer la voix fortement et fo iblem ent dans l e même inftant (Sons de la LangF r .
,p .
Avan t Li ttré,l es auteurs de d ict ionna ires se son t désintéressés
de la question Féraud, Roland , Napoléon Landais font pronou
cer ab- ce‘. Littré ne se sépare pas de ses devancie rs pour ab—së,
ab-si -s’
(abc isse) . Ma is quand i l rencon tre abscisse,i l se ravi se e t
songe à la prononciation rée l l e Ce mot est figuré par a— bsi
s’
, ou su ivan t la prononciat ion réel le a -
psi-s
’ de même pourabsent
,abside, absinthe. Avec le temps
,cet te coupe de syl labes a
fi n i sans doute par le choquer e t à bon droit alors i l représen te
absolu par ab-so- lu,ou
,su ivan t la prononcia ti on rée l le
, ap—so
lu I l marque sa préférence pour l a prononciation réel le à
propos d’
absolutisme a -bsa-lu- ti —sme,ou p lutôt ap-
so—1u-ti—sm’
et i l cont inue ainsi,mais non sans quelques d istraction s . I l con serve
le b devan t deux ou trois consonnes (ab—stê—m’
,ab-ste—nir
,ab
stm —hsian,
arrivé à obscène, i l reprend la forme t rad it ionnel l equ ’ i l conserve jusqu ’à l a fin ob-sê—n
,ob- skur
’
, ob- se
'—de
'
,ob- te-nir ,
sub-sé—kan,sub-ti l
,etc .
Le Dictionna ire Généra l a trouvé sa règle en cours de route .
Après avoir donné la pronon ciat ion ab’—sé (abcès), i l éc ri t rŸp
’— si
( yon (abcis ion) , puis [’
ib’-ste
‘
nz’ Désormais pour lu i , l a
loi est ains i fixée b sourde p, b s sourde b.
M . Passy (D ict. pbon . de la 1. fr .) ne connaî t pas cette
1 62 L ’ABBE ROU SSELOT
d ist inction : sa règ le est b ien sim p l e b sourde se prononce
touj ours p .
M. Koschvvitz dans ses Pa r lers Pa r isiens entend de même
touj ours une sourde dans les mots où le contact des consonnes
est ancien,et figure avec des p l a prononciat ion de absolument
,
ab.ridia l, abside, absinthe, abstra ction ,observa teur , obstiné , obtint
,
subti l,obscur . Aucun de ses lecteu rs n
’ a impressionné au trement
son orei l le .Mais dans les groupes e t les mots où les consonnes sontmises en contact par simp le rapp rochement ou par l a chute d ’
un
emuet , i l hés i te j e t rouve tsu et dsu (dessous) , dpz‘
bi,dtpiùi , tpi ùi
(depu is), t soet dso(de son) , dt sa (de sa) , dunee t tkote'
(decôté) ,mais
le p lus souven t t,rôrvô (Roncevaux) , omnibur da (omn ibus de) ,
afar de(en face des) , tels mare e t tùsr ma re (tous marchen t) , etc .
Plus ieurs des notations mul t iples dt, 5 { se rapporten t à unelecture que j ’ai fa ite à loisi r pendan t l es vacances à Greifswa ld .
M . Gaston Paris , de son côté , avai t lu devan t M . Koschwi tz
un morceau de ses Par lers de France La transcr i pt i on qui
fut faite de certa in s g roupes lu i dép lu t . I l p rotesta con tre les graph ies du par le t par i du parle r de Pa ri s lepar le t s
‘
aha”
a l e
parler de chacun â faç en face des national ités Ma i sM . Koschwi tz l es main t in t dans sa première édit ion p . 43 , l .
2 1 ; p . 47 , l . 1 2 ; p . 4 1 l . 3 . I l n e voyait dans ce désaccord
e ntre le sen timent du su j e t observé e t l ’ impression audi t ive del ’observateur qu ’un de ces cas d ’ assimi lat ion s inconscien tes
qu i se fon t fréquemmen t dans la bouche de chaque lecteur sans
qu ’ i l s’
en aperç oive, mais qui d isparaissen t, dès qu’ i l y fai t atten
tion , dès que d’
inconsc ien t i l devien t consc ient Et i l a j outait
pour sa j usti fi cation j’aura is péché con tre mes principes de
t ran scrip t ion si j ’avais noté autre chose que ce que j’
entendais etM . G . Paris aura it tort de n e pas protester contre une notat ionqu i n e s
’
accorde pas avec ce qu ’ i l sai t p rop re à lu i (p .
Néanmoins dans sa seconde édit ion,M . Koschwi tz corr igeafas, d
hote e t dueeahaê par déférence pour M . G . Paris,mais
,me di t—i l
,
san s ê tre convaincu e t i l supprima sa note .
L ’ABBE ROU SSELOT
-1 Z
PIG . 1 6 .
Consonne entre deux voyelles
(exp los ive)N ez . B . Bouche (peti ts tam bou rs) .
— L . Lèv res (tambour de de d iam ètre) .
Les l ignes po in ti l lées v ert ica les étab l i ssent le synch ron ism e les hor izon ta les , l’am p l itude du m ouvem ent ar t icu lato i re. tem ps de l ’ im plos ion e tem ps de l ’exp lo s ion .
LA PRONON CIAT ION FRAN Ç AISE 1 65
de la consonne, mars auss i des voyelles cont iguë s ou d’autres
causes, sans que l’
orei l l e en so i t sensiblement affectée .Cette
remarque étai t nécessa ire pour nous épargner plus tard des erreursd ’ interprétat ion
En y regardan t de près , on voit que la montée de la courbe
Ag rt
Pro . 1 7 .
Consonne entre deux voyelles(exp losive)
1 . aba . 2 . apn.
Même d isposition que fi g . 1 6 ._
Pour le tambou r de 2 5 de d iamètre, l 'arc et m arque lad irection que prend le dép lacement du lev ier : on en aurait beso in pour étab l ir le syn
ch ronisme exact entre les l ignes N , B et L .
1 . Toutes les mesures sont prises sur les tracés or ig inaux . Les figures sont
agrandies suivant la propo rtion sauf ind ication contraire.
Revue dephonétique.
166 L’
ABBÊ'
ROU SSELO‘
I‘
PIG . 18 .
Consonne im plosive
(entre voyel les)ab o[w]
N ez . B . Bouche. L . Langue (m êmes tam bou rs que fi g .
Le comm encement de la I"
voyel le et la fin de la seconde ont été retranchés . I l enest de m ême dans la p lupart des figures q u i su ivent .
Ag r‘
PIG . 19 .
Consonne im plosiv‘
e
(entre voyel les)ah o[vo] deux foi s, à Beau[veau]
Tracé du souffle (N ) nasa l , (B) bucca l . A cette v i tesse, les v ibrat ions nasa les ne sontpas tou jou rs sens ib les .
1 68 L ABBÉ ROU SSELOT
I l est un au tre caractère , d’une portée généra l e aussi , qu i dis
t ingue les implosives des explosives c ’est la force d ’art iculation.
Toute implosive est faibl e par rapport à l’explosive. Ainsi
PIG . 2 1 .
Consonne im plosive(devant une consonne)I o absa . 2 0 ap5 a .
Mêm es tam bours que fig. 1 7 .
(fig . 1 7 et 2 1 ) les tracés de aba,apa comparés a ceux de
absa , apsa , pris à la su ite les uns des autres et avec le même disposi tif, montrent bien l
’
affaiblissement articu latoi re des deux der
n iers . On fera une constatation identique en rapprochant ab ovo
(fig . abdornen (fig . ablégat ( l i re ah—leÇç a t) de ablette
(fig . abr i (fig .
LA PRONONC IAT ION FRANÇAISE 1 69
Cet affa ibl issement de l’
effort art icu latoi re,comme on l ’a vu
par la compara ison de apa et de apsa , rapproche la forte implo
P10 . 22 .
Consonne implosive ( 1) et explosive (2)(devant une consonne)
a bleÏg a able[tle]Même d ispos ition que fi g . 1 6 .
Ic i able'
g at a m êm e été p rononcé à m on insu avec un b sp i rant : faib le rapprochem ent
des lèv res et sortie de l ’a ir par la bouche.
PIG . 2 3 .
Consonne explosive
(devant une consonne)abr i .
Même d ispos i tion que fi g . 1 6 .
sive de la douce explosive.Ai ns i s’ expl ique que des fortes pu issent
paraî tre douces à l ’ore i l le,et soupçon sonner comme soubçon.
L’
intercalation d ’une tro is ième consonne dans le groupe ne
peut qu’
affaiblir encore l’articu lat ion de l a première, ains i que
nous le verrons plus loin . D ’autre part,le caractère de l a douce
1 70 L’ABBE ROU SSELOT
ne peut qu ’en être renforcé ; et l’on comprend que le b se fasse
mieux senti r dans abstm ir que dans abcès .
Dans une prononciat ion so ignée , l a douce et la forte resten t oupeuven t tou j ours rester d ist inctes . C ’est ainsi que dans ma pronou
FIG . 24 .
Douce et forte devant une forte.
1 . abcès. 2 apcès.
Même d ispos ition q ue fi g . 1 6 . Remarquer l ’exp los ion du p et l’
s dans apcès p lusv i sib les que dans abcès .
c iation abcès et *apcês son t touj ours reconnaissables (fig .
Mais, comme un mot artifi cie l n e permet peut-être pas de mesurer assez b ien l’effort , j
’a i chois i des composés qui ont un sens
pour moi et qu i présen tent l ’al ternance de la douce et de la forte .
J ’ai donc enregistré : (fig . 2 5 ) abdä (Abdon , nom propre) et ap -dô
(happe donc) (fig . abs_
é (abcès) et apce'
(happe et (fig .
absta apstâ (happe ce taon), obskuet opsku (hop ! ce Or toutes les fois
,la forte s’est effec
tivement trouvée due à une pression articu latoire plus grande .
1 72 L’
ABBÉ ROU SSELOT
entre 20 et 2 3 , moyenne 22 . E l le peut descendre pour b à
pour p à et monter pour b à 18 , pour p a J ’ai
une' confirmation de ce p artage dan s une première expérience où
la p lume,bien réglée pour un b de pression moyenne , qui tta it
l e cyl indre pour une pression plus grande aucun p n ’a fourn i
une courbe semblable à cel le du b l e plus énergique. I l est à remar
FIG . 26
Douce et forte devant une forte.
I .
quer que la fréquence de la répéti t ion accroissai t l’effort , car les
ch iffres les plus é levés ,se? trouvent en fin de série . Les expériences
avec le palai s art ificiel sont concordantes .
Nous sommes donc en droi t de conclure que la douce vou luene se confond pas avec la forte voulue et que , dans l
’
arti
culat ion,e l le se distingue tou j ours de cel le- ci par une pression
organique moins grande . Quan t à la forte s uivie d’une au tre
1 74 L’
ABBÈ ROU SSELOT
consonne,les figures 1 7 et 2 1 nous ont dé j à permis de d ire qu
’e l le
égale la douce devan t voyel le . La courbe de apsa a,en effet, exac
temen t la même ampl i tude que cel le de aba . De son côté,l a douce
dans la même posi t ion tend vers la spi ran te .
Voyons maintenant ce qu i se passe du côté du la rynx . Nousavons pour nous ren seigner l e t racé du larynx lu i-même ou ,ce qu i revien t au même
,ce lu i du nez ; ce lu i de l a bouche , qui
nous indique le momen t préc is de l’occ lus ion complète ; enfin
ce lu i du mouvement a rt icu lato i re .
1
PIG . 28 .
Arti culat ion du t et du d .
1 . jœ t pa r t (je te pa r ie) . 2 . jæ d pa r i (jeu de Pari s) .
Revenons à l a figure 1 6 . Les deux tracés apa e t opo nous per
mettent de suivre in stan t par instan t,vibration par vibration
,l e
passage de l a voyel le (a ou a) à l a consonne Considérons
les voyel les au moment où el les doiven t être le plus parfa i tes,au
mi l ieu de la tenue (en) , avan t que les lèvres aien t commencé leu r
mouvement de fermeture pour le p . L’accord des trois l ignes
(nez , bouche et l èvres) est complet . Nous n’ avons en N et en L
qu ’une période qui parai t simple ; mais B i nd ique la complex itédes harmon iques . Toutefois
,le point de p lus grande ampli tude
est l e même . Nous pouvons su ivre période par période j usqu’en
sans que notre œ il, armé d’une forte loupe , saisisse de diffé
rence appréciab le sur la l igne B, qu i est ce l le de la voix . E t cepen
dant eu (3) les lèvres — se sont ; rapprochées d’
une quantité qu i
1 76 L’
ABBÉ ROU SSELOT
exemples, nous avons ain si 3 vib ration s, ou plutô t, s i nous y j o ignons ce l les de l a consonne transitoire , ce qu i est légi t ime dans
notre syl labat ion,6 vibrations pour le p de apa et 4 pour
celu i de apa : ce qu i donne , après l e 11 b i lab ia l transi toire,en
réal ité un implosif avec une occlus ion assourd ie . On voi t parlà que la sourde in tervoca l ique a des tendances à deven ir sonore .
Remarquons encore que les vibrat ion s nasales deviennen t p lus
amples à mesu re que les vibrat ion s buccales d iminuen t , que
même les vi brations qui corresponden t à l a consonne sont d ’une
grande ampl i tude . On pourrai t cro ire que l ’augmentation de lapression de l ’ a i r par su ite de la fermeture de la bouche est ic ip lus en cause que le larynx lu i-m ême mais la l igne laryngienne
(par exemp l e fig . montre bien qu ’ i l en est autremen t et
qu ’une augmentation de l ’activi té glottale se produ it pendant l a
ten sion de la consonne,qu i est en même temps la détente de la
voyeHe.
Q uel le mod ification apporte à cet état de choses l’add it ion d ’une
seconde consonne C ’est ce qu ’ i l nous reste à voi r pour déterm i
ne r le degré d ’assimi lation . Envisageons les cas principaux .
Deux sonores contiguë s resten t en généra l sonores . Cependan t
nous sommes averti s par la phonétique h istorique qu ’ i l y a des
cas d’
assou rdissement ( n, jn, par exemple , on t pu deven i r sn,en (Pr inc . deph. exp.
,p . 964 dy , dz , dj , dans certa i nes
régions du M id i,se sont changés en ts, te ou 3 , ê ; à Paris même ,
un mot étranger (Pygma lion) présente dan s sa forme po pu la i re
(pikmâyô) un le pour un g à côté d’une m (fig . M . Laclotte
m ’a signalé atmettront qu ’ i l a en tendu de la bouche d ’un Bre ton .
Ce phénomène que j ’ ai expl iqué par l a nature spéciale des consonnesgroupées
,pourrait avoi r une cause plus générale et dépendre du
1 . La preuve que ce n’
est pas là une erreur acc identelle, c’
est la lectu reprak:matik
,staknasyô (pragm atique
,stagnation) chez ceux qu i obéissent à leur sy stème
vocal plus qu’
à la lettre.
LA PRONONCIAT ION FRANÇAI SE 177
Agrt 2 . 4
PIG . 29 .
Sonore devenue sourde devant m .
pik mà[yô lPygm a l ion
B.Bouche. La . Larynx .
Agrt
Pro . 30 .
Sourde suiv ie d’
une autre sourde.
jœ i par i je te parieMême d i sposi t ion que fig. 29 .
Com parer les deux l ignes (La) aux po ints m arqués par
1 78 L’
ABBÉ Roussm.or
besoin d ’une act ivi té glottale p lus grande pendant l’ implosion
l e supplémen t de trava i l n écessaire se ra i t économisé et remplacé
par un effort plus grand de la l angue ou des lèvres .
Quand le groupe est composé de deux sourdes, l e lary nx se
comporte dans la prononciation moll e ou lente comme s’ i l n ’y
avai t qu ’une seu le consonne (fig . 24 ,Mais dans une pro
nonc iation énergique ou rapide , i l peut perdre quelques vibrat ions .
La phrasejæ t par i ( j e te parie) répétée plusieurs fois présenteu n t qui réal ise ces deux types (fig . Les deux tracés ont été
d i sposés de man ière à fai re concorder l es deux occ lusions . O r onvoi t que le premie r exemple reprodu i t l e type de apa (fig . 1 7) et
de après (fig . tand is que le second nom présen te un t assourdi
avan t la complète fermeture du tube vocal . La forme de la
détente de la voyel le p lus brusque dans l e second cas que dans lepremier annonce une consonne plus forte avec un moindre travai l
laryngien (La) .
Dans les groupes formés de sourdes et de sonores ou desonores et de sourdes
,l a tendance à l ’as simi lation l aryngienne varie
suivan t la nature des consonnes . Faib l e avec les l iquides,el le est
puissan te avec les occ lus ives et les constric tives correspondan tes .
Des expériences systématiques fa ites avec les petites ph rases jæt li t) ( j e te lève) , jæ t ros ( j e te rosse), jæ t mani ( j e te man ie) ,
iæ t nwa ( j e te no ie) , montren t que le t n’ est pas modifi é i l n ’ a
reçu quelques v ibrat ions de plus que 3 fois devan t m ,à la fin d ’une
série . L’
r s’est assourd ie plusieurs fois . Un fai t p lus intéressantest ce lu i—ci dans ce membre de phrase di t par un e Parisienne ,daz un mas lèg
—zÙi5 tik (dans une masse l inguist ique) , l
’
: est deve
nue en partie sonore . Ma is nous a l lons y reven ir bientôt .Une sourde su ivie d ’une sonore non- l iqu ide a bien des chances
Le passage de la sonore à la sourde a été observé par M. Loth dans les
finales qu i ont perdu l’
accent tonique (Rema rques et addi tions à l’
introduction to
ear ly welsb de S trachan, p, Ce fa it se rapporte de m êm e à une dim inution
de l’
activ ité la y ng i‘
enne,conséquence du recul de l
’
accent .
r80 L’
ABBÉ ROU SSELOT
phonéticien s figurent un commencement d ’assimi lation,leur
graph ie fait supposer que la part ie assimi lée est con tiguë à la corisonne assimilan te . Je l is dans lesPar lers par isiens de M . Koschvv
‘
itzÎ
masa lêg iùistik (masse l ingu ist ique) , sarkaszm (sarcasme) , servirada: la véri té
, modt te‘
t (maux de tête) , etc . Quand on n’ a que les
Ag r‘2 . 4
Pro . 3 2 .
Sonor isat ion prog ressive d’
une
mas lêgB . Bouche. La . Larynx .
i nd ication s de l ’orei l l e pour se ren seigner , on peut cro ire qu’ i l
en est a insi . L ’
assim i lation nasale, si fréquente dans les tracés ,semble même parle r en ce sens . Ma is en est—il bien ains i ? Lesvarian tes de l a figure 3 1 , qui posent le prob lème , permetten t dele résoudre . L
’
ass im i lation peut être complète pour le k san s que
celu i—ci soit en contact avec le d (nous avons g , un ,silence, (1,
n ° 1 ) l e k sonore (g) peut être contigu au d ,mais s ’ en d istinguer
LA PRONONC IAT ION FRANÇAI SE 1 8 1
par l ’ampl i tude plus grande des v ibrat ion s du larynx (n ° l ed peut s ’
assourdir (n°
3 ) e t même deven i r ent iè remen t sourd aum oment de l
’
explosion (n° Ce n ’est donc pas par l e con tact
que la sonore agi t sur la sourde précédente,c ’ est par une
influence qu i s’
exerce sur le larynx au moment de l’ implosion decel l e—c i (et, nous savons dé j à (fig . 1 7) qu
’ el l e est sonore) . Cetteaction à d istance n ’
a rien de surprenant . En effet,étan t donné
l’espri t de prévoyance qu i se montre dans tous nos actes physiologiques,on conçoi t que la
'
glotte,alors qu ’e l le est encore ouverte
,
doive être p lutôt so l l i c i tée a garder‘
sa posi tion . qu’
à la quit ter
pour l a reprendre en su ite . Le ra isonnemen t tout seu l pouvai t
Pro . 3 3 .
Assourd issem ent d’
une consonne qu i a sonor isé une sourde .
f] as dé.
B . Bouc he. La . Larynx
donc conduire à cette conclusion . Mais j e crois bien qu ’en fai t
c’
est une conquête de l’expérim entation . Pourtant,j e . ne serais
pas surpris qu ’e l le lu i fût contestée . Cela est arrivé à d’autres qu i
s ’ imposent avec une éviden ce te l l e que le l inguiste,à leu r seu l
énoncé , est exposé à s’ imagin er de bonne fo i l es retrouver dans
son arsen al et n e rien devoir à l a phonét ique expérimen ta le .
Voici une confi rmation qu i a bien son p rix , car e l l e est éc latan te . Dans le groupe un mas lêg i£ti5 1ik (une masse l ingu istique)répété p lus ieurs fois par une Parisienn e
,l ’ : de mas (fig . 3 2) tend
à deven ir sonore . C ’ es t le bon moment pour observ er le phéno
mène . O r,il est cl ai r que ce n
’
est pas 5 { qu’ i l fau t écri re , mais
( 5 ; car la sonori té s’étend à part i r de l’ im plos ion ,
c’
est—à-d ire deRevue de phonétique. 1 2
1 82 L ’A BRÉ ROU SSELOT
la part ie voisine de l’a . Comparez au n ° 1 qui présen te une
no rmale les n° 5
2 e t 3 où l a prem ière part ie de l’
: est devenue
sonore .
Mais n ’oubl ion s pas l a poss ibi l i té d ’
un échange,en quelque
sorte,de sonorité . Nous en avon s un nouvelexeinple dans fi fa :
de‘
(en face des . où l ’ : est en ti èrement sonore et le d en pa rti esourd (fig .
Nous al lons en rencontrer encore d ’autres .
Pour me faire une idée sommaire de la puissance assimi latrice
des sonores su r une sourde précédente,j ’ a i in sc ri t un ce rtain
FIG . 34 .
Assourd issement d ’
une sono re.
a bcès .
N . N ez . B . Bou che. l . . Lèv res .
nombre de foi s les petites ph rases jæ t ba lâ 5 ( j e te balance) , jæ
t don ( j e te donne) , jæ t gardæ (j e te garde) , jœ t vwa ( j e te vois),
jœ t z èbræ ( j e t e zèbre) , jœ t jui ( j e te j uge) . O r l e t est devenusonore devant e t o 1 3 fo is sur 14 , devan t d et j 5 fois sur 7 ,devant 6 fois sur 9 , devant g 4 fois sur 7 . Cet ordre n ’est sans
doute pas abso lu mais i l y a quelque chose de sédu isan t
lab ia les,den ta les
,guttu rales . Attendons d ’au tres expériences .
Les exemp l es précédents nous présenten t l’assourdissem ent
du b une fois, du v et du j deux fois à des degrés d ifférents .
Une sonore suivie d ’une sourde peut conserver sa sonorité
184 L ’ABB I‘3 ROU SSELOT
plosion . Comparez (fig . 3 5 ) jæ d par i (j eu de Paris) et fa: t par i( j e te parie) dits par une Pari sienne d et t resten t parfai tementd istin cts su r la l igne du larynx (La) .
Ag r‘2 4 .
Fra . 36 .
Mêm e sujetdu pa r lé de pa[ r i ].
Com parez u+p et d+p. Dans le second cas la sono ri té est p lus grande el le est due
au (1.
Pro . 37 .
Sonore suiv ie de deux sourdes .
absteni r .
N . N ez . L . Lèv res .
Comme pour le groupe t+ sonore,j ’ai enregistré p lusieurs fois
de suite de peti tes ph rases contenant d+- sawdo jæ d par i ( j eu
LA PRONONCI AT ION FRANÇA I SE I 8 5
de Paris), jæ d tenis ( j eu de tenn is) , joed kartæ ( j eu de carteS) ,iæ d [ 22 ( j eu de fous) , jæ d sei ( j eu de sous) , joe d eyê ( j eu de
ch iens) . Del’
ensemble des constatations , 11resu l te que, dans la prononc iation rapide, l a sonore peu t arriver à se confondre avec lasou rde à début sonore . Mais i l n e faut pas oubl ier que cel le-cidans la même position serait plus sourde encore . Comparez du pet e+ d p (fig . dans le 2 ° cas , les vibra tion s du larynxson t plus amples et p lus n ombreuses .
PIG . 3 8 .
Force du souffle.
Dans les groupes sonore sourde et sourde sourde.
I absolumcî . 2 apsolumd .
Quand la sonore est su ivi e de deux sourdes , par exemple , ost,osk (abstenir , fig . 3 7 ubsid abs ten [t ion] ohslz u obscu[r]fig . l e larynx est encore moins gêné dans son travai l : i l profi tede la déten te art icu lato ire amenée par l’s . Comparez avec ap s tâ
(happe ce taon) e t op 5 ku (hop i ce cu[rieux] Même ubstâ l aissesoupç onner un sp i rant,
‘ car la l ign e du souffl e bucca l montre
clai remen t un écoulement de l ’a ir après la voyel le . I l n ’est donc
pas étonnan t que certaines ore i l les d ist inguen t,par exemple , un
dans abstenir et sen ten t un p dans abcès .
Enfin,on pourra i t ten i r compte auss i de l a forme du couran t
d’
air tel le qu ’e l le est i nd iquée par un tambour é last ique . Je
I 86 L’
ABBÉ ROU SSELOT
n’
insisterai pas sur ce point ; mais j e ne pu is me dispenser de
reproduire,en terminan t
,l es tracés de absolument prononcé par
une Parisienne : une première fois à l’
ord ina ire (fig . 3 8 , n°
une deuxième fois avec un p (n ° La volonté expresse de
reproduire la pronon ciat ion figurée apsolumâ en traî nerai t donc
a un effort expi ratoi re excessif, ce lu i—là même qui se tradu it
chez les Etrangers trop doc i les par tr0p de dureté .
Après avo ir étud ié le son dans les v ibrationsde l’a i r e t l es m on
vem ents des organes qu i les produisen t , i l nous reste à l e cons idérer dans l ’organe récepteur , l
’ore i l l e .
je me suis dé jà occupé de l’ass imi lat ion des consonnes pour
l ’ore i l le dans mes Modifications phm e‘
tiques du langage. J ’ avais ,dan s ce but , chois i comme matières
’ épreuves des composés
artificiel s,qu i on t l ’avantage d ’échapper aux influences psy cholo
g iques . Or,étan t données un e voix et une ore i l le te l les que tous
l es groupes de consonnes étaien t sûrement décomposab les de 10
à 1 5 cm .,j ’a i constaté que l ’ass imilation se faisai t pour j et
pour tou tes les autres sonores devant les sou rdes du même organe
à 1 mètre ; pour p b et t b d ( à 2 mètres ; pour 17 1) devan t
une sourde quelconque à 6 mètres ; et que les l iqu ides l m n r
é taien t tou j ours en tendues correctement (p . 3 9
Depu is,j ’a i recherché la d istance d ’
audibili té des consonnes
pour mon chap i t re su r l ’intensité (Pr inc . de Pbon . Exp) ,auque l
i l sera bon de se référer . Br j e su is revenu sur l a question des grou
pem ents pou r mon Cours de 1909- 1 9 10 . Dans ces études nou
ve l les,j e me su is l im ité à un seu l cas : l a rencontre de t d avec
une autre consonne . M ais,au l ieu de prendre
,comme précédem
ment,des composés art i fi ciel s
,don t la prononc iat ion est moins
assurée , j’a i eu recours à des combinaisons formant un sens et,
l e t imbre des voye l les au besoin égal isé , ne d ifféran t entre e l les
que par la consonne,obj et de nos recherches
,par exemple : ]æ t
pa r i ( j e te parie) , e t jee d pa r i ( j eu de Paris) , jæ t balâ s ( j e .te
I 88 L ’ABBE ROU SSELOT
Ces tab leaux suggèrent les réflexions su ivantes
1° Les j ugements portés su r les données de l ’orei l l e dans une
prononciation ordi nai re (I et III) ne son t pas sûrs ; et dans unconfl i t en tre ce lui qu i parle e t ceux qui écouten t
,nul n ’est fondé
à mainten i r son poin t de vue : l ’erreur est trop fréquen te .
Les chances d ’ erreur dim inuen t beaucoup,sans d isparaî tre
entièremen t,s i la prononciat ion est len te (II) ; el les augmen ten t
dans une notable proportion , s i e l le est rapide (IV) .
2° Les varian tes aud i tives se rangent sous trois chefs
,su iv an t
la composi t ion des groupes . Nous avons : I°sonore sourde
(d p,I e t II
,2) ou sourde sonore(t 19
,III e t IV,
2°
deux sourdes (t p,I e t II
,1 ) 3
° deux sonores (d 17,III et
_
IV,
Nous ne rencon treron s poin t les déformat ions variées dont j ’ai
LA PRONONC IAT ION FRAN ÇAISE 1 89
donné des exemples dans mes Pr inc . dePbon. Exp., puisque l
’
au
diteur ne s’attend qu
’
à deux al ternatives t ou d .
Les deux premiers cas ne présen ten t r ien que de très naturel .
Ag r‘r . ;
PIG . 39 0
Var iantes laryngiennes de deux sonores consécut ives et d’
une sourde devenue sonore.
B. ,
Bouche. L . Larynx .I . dœ. 2-5 bd . tb.
I 90 L ’ABBE ROU SSELOT
L’
assim ilation est un p hénomène banal ; et l’
affaiblissement d ’une
forte la rapproche de la douce , qu i se confond avec une sonore .
La dissim i lation , qu i se produ it à l’ore i l l e dan s le troisième
cas,n
’
étonne que par sa fréquence : nous re levons th 9 fois (III) et2 1 fois (IV) . Sans doute
,nous nous attendons à un affaibl isse
ment des vibrations du la rynx . Mais comment at tribuer à unphénomène si peu importan t et qu i a eu des effets s i rares enphonétique h istorique
,une te l le influence sur l ’orei l le ? Dans
l’
espoi r d ’obten i r quelque lumière nouvel le,j ’ai refait
,en prenant
les vibrations du larynx et la voix,les t racés de d i n i tial , d b
et t b,dans dee
, jæ d ba lâ s et jæ t ba là s que j e prévoyais
devoir donner un d pour un t . Cet espoi r n ’a pas été déçu . Uns implecoup d ’
œ i l sur la figure 3 9 , su ffit pour mon trer que le d
possède des vibrat i ons la ryngiennes plus amples à son explosion
(dæ,I ) qu
’à son implosion (db, 2- 5 ) e t pendan t sa tenue ; deplus qu ’ i l se d ifférencie net temen t par l ’ ampl i tude des mêmes
vibrat ions du t devenu sonore dans tb (6 e t Que s i l’on veut
des ch iffres , j’ai compté à l a loupe 4 d ix ièmes de mil l imètre
( I ) , 3 (s) , 2 (7) La diffé
rence de longueur des vibrat ions ( 1 7 pou r 1 et 1 3 pour les autres)ne détrui t pas les proport ions . L
’
oreille se t rouve donc en pré
sence d ’un son in stab le (d) et voisin d’un autre son (t devenu
sonore) . Quoi d’é tonnan t qu ’e l l e se broui l le e t
,à moins d ’une
grande acu ité un ie à une grande atten t ion,qu ’el l e se t rompe
J ’ai voulu,de plus , me rendre compte de l
’ importance de l ’attention . Dans une épreuve
,j ’a i un iquement prononcé jæ d balâ s,
et mes auditeurs s ’
attendaient auss i b ien à joe t ba lâ s . Eh b ien les
erreurs,qui é ta ien t au nombre de 7 l a prem iè re fois son t tombées
success ivement à 6, 4 , 2 , 3 , 3 . Comme el l es se sont parta
gées entre lec 1 3 auditeurs d’une man ière i rrégu l ière (F 2
, I 1 ,An 2
,A 0
,A ’
I,A°
4 , A“'
3 , A°"
2,B 3 , Z 3 , S 4, L N
el les ind iquen t aussi l a pa rt qui revien t à la qual ité de l ’organe ou
à ses hab i tudes .
COURS
DE GRAMOPH ON IE
LES AN IMAUX MALADES DE LA PESTE
Un mal qui répand la te rreur,
Ma l que le c ie l en sa fureurInven ta pour punir les crimes de l a terre ,La peste (puisqu
’ i l faut l ’appe ler par son nom),Capable d ’en rich i r en un j ou r l’Achéron ,
Fa isa i t aux an imaux la guerre .
I l s ne mouraien t pas tous , mais tous étaien t frappésOn n ’en voyai t poin t d ’
occupés
A chercher le soutien d ’une mouran te vie ;Nul mets n ’
exc itait l eur envie
N i loups n i renards n’
épiaient
La douce et l’innocente p roieLes tourte re l l es se fuyaien t ;Plus d ’amour , partan t plus de j oie .
Le l ion t i n t consei l et d i t Mes chers amis,
Je crois que le cie l a permis
Pour nos péchés cette i n fortune .
TRANSCRIPTION PHONÉTIQUE
Lé( animé, ma ladæ, dæ
a? ma l,ki re
'
pä la térrâz r
ma l ; kæ lœ syél à sa furder
êvdta , pai r puni r lé kr imœ dæ la térœ .
la pèstæ ; piÙisk i l fo'
l apælé pàr sô nô
kapalflæ d â r iei r [in a? fair l aeerô ;fœze
‘
t ô( animé la gèr .
i l n[â] muré pd tels mé tus eté frapé.
ô n d uwayè pwê d okupe'
z
a eereé le sutyê d unæ murâ tæ m'
yæ .
nul mé n eksite‘
la‘
er â viyœ,
ni lu ni rænà r , n épyè
la dus e l inosdt prwd .
plu d amdr , partâ plu dæ jwd .
læ lio, tê'
kô”
séyœ e di . mé eérz ami .
jæ krwa lue læ syèlæ,a pérmi
pair no'
peeé set êfortun .
1 94 MARGUER ITE DE SA INT-GEN ÈS
Q ue l e plus coupable de nous
Se sacrifie aux t raits du céleste courm ux ;
Peut—être i l obt iendra l a guérison commune .
L ’ h istoire nous apprend qu ’en de te ls acc iden ts
On fa i t de pare i ls dévouements .
Ne nous flat tons donc poin t ; voyons sans i ndulgenceL’éta t de notre conscience .
Pou r moi , sat isfa isan t mes appéti ts gloutons ,J ’a i dévoré force moutons .
Que m’
avaient- i l s fai t ? nu l le offense
Même i l m ’est arrivé quelquefois de manger
Le berger .
Je me dévouera i donc , s’ i l l e fau t mai s j e pense
Q u’ i l est bon que chacun s
’
accuse a insi que moi ;Car on doit souh aite r
,selon toute j ust i ce
,
Q ue l e p lus coupab le périsse .
S i re,d it l e renard
,vous êtes trop bon roi
Vos scrupules font voir t rop de dél icatesse .
Eh bien ! manger moutons,ca nai l le
,sotte espèce
,
Est-ce un péché ? Non , non . Vous leur fi tes , seigneur,En les croquan t
,beaucoup d ’honneur
Et,quan t au berger
,l ’on peut d i re
Q u’ i l éta i t d igne de tous maux
,
Étant de ces gens- là qu i sur les an imauxSe fon t un ch imérique empire .
Ainsi d i t le renard ; e t flatteurs d’
applaudir .
On n ’osa trop approfondirDu tigre
,n i de l ’ours , n i des au tres pu issances,
Les moins pardonnables offenses
Tous les gens querel l eurs , j usqu’ aux s imples matins ,
Au dire de chacun , étaien t de pet i ts sain ts .
L’
âne vin t à son tour, et d it J ’ ai souvenance
Qu’ en un pré de moines passan t
,
1 9 6 MARGUER ITE DE SAINT—GENES
La faim ,l ’occas ion , l
’herbe tendre, et, j e pense,
Q uelque -d iab le auss i me poussan t,
Je tond is de ce pré l a largeu r de ma langue ;
Je n’en avais nul d roi t
,puisqu ’ i l faut parle r net .
5 3 A ces mots,on cria haro sur le baudet .
Un loup,quelque peu cle rc, prouva par sa harangue
Q u’ i l fall ai t dévouer ce maudi t an imal ,
Ce pe lé,ce galeux
,d ’où vena i t tout leu r mal .
Sa peccad il le fut j ugée un cas pendable,60 Manger l ’herbe d ’autru i ! quel crime abominable !
R i en que la mort n ’était capable
D’
expier son forfa i t . On le lu i fi t b ien voir .
Selon que vous se rez pu issan t ou misérable ,Les j ugements de cour vous rendront blanc ou noir .
(Di t pa r M . Delaunay, de la Comédie-França ise, d
’
aprés un disquede la Compagniedu Gramophone. )
DICTION
Quatre personnages : l e fabul iste , l e l ion , l e renard et l ane .
Pour b ien les marquer , l e lecteur choisi ra dans sa voix quatre
regist res d ifférents .
I l prendra son registre ord inaire pour l e fabu l iste, dont i l fai t
n aturel lemen t l e personnage . Cette voix est du reste l a plus
nuancée,e t le l ecteur aura besoin de toutes ses ressources
,car
i l devra produ ire des effets très variés .
Après un début solenn e l et sombre,i l an nonce très simple
men t l’assemblée, met en scène l e l ion et l e renard, soul igne i ro
niquement l ’ accue i l fait à l a confession des grands,in troduit
l’ âne ; puis , pren an t sur lu i de t raduire les sen t iments de tous,
COURS DE GRAMOPH ON IE 19 7
la fè ;_
l okdsyô ; l erbæ tâdræ ê jæ pâ sæ,
kelkæ dya'
bl o'
si maeprisé,
jæ todi dæ sæ pré la larjâ9r dæ ma ldg ;
jæ n du avé nul drwa piùisk i l fô pa r lé nét.a sè mô
,ô kr ia dro sur læ bôdè.
de lu,kelkæ pœ kiér . pruva par sa arâg ,
k i l ja lé déb i té sæ mo'
dit anima l,
sæ pælé, sæ ga iné du væné tu lder ma l ;
sa pekadiy fu jugea? lui pddablæ,
mâjé l erbæ d ôtr i bi kel kr im abominaMæ .
ryekm la môr n ete‘
kapablæ
d ekspié sô forfè. ô læ li i/ i fi byê vwizr
sæ/ô’
kæ o u særé pr‘
ùisâ u m izerablæ,
lé jujmâ dæ leur ou râ drô’
bld,u nwiz r
i l c rie le baro de la foule,résume la pla idoi rie du loup et tradu it
l ’ horreur qu ’ e l l e i n sp i re pour l e crime du baudet ; i l s’
attendrit
enfin sur l e sort du malheureux animal et conclut par un trai t
de sat i re .
La voix du l ion,personnage grave par son métier et par les
circonstances,sera prise dans les notes basses . Un seul senti
men t l ’an ime,t rouver un e vict ime exp iato i re autre que lu i . Sa
confession étalée avec une certain e audace n ’est pas sans réti
cence ; et l a rapid ité de sa conclusion dévo i le suffisamment ses
secrètes préoccupat ion s .I l ne reste p lus pour les deux autres personnages que les
registres supérieurs . Une vo ix a igue convien t bien au renard
court isan,habitué aux flatteries qui se d iss imulen t , aux accusa
t ions qu i prennent des a irs hypocrites .
I 98 MARGUER ITE DE SA INT-GENES
Enfin on réserve ra à l ane , na1f et scrupuleux,l a voix Butée
qu i,produite par un e tension excess ive des cordes voca les , est
émise nature l lemen t dans l a contra inte et la peur .M . Delaunay a su , avec un grand art , produire toutes ces voix
d ifféren tes et leur a donné les nuances don t e l les son t suscep
tibles .
COMMENTAIRE PHONÉTIQUE
Nous connaissons déj à par plusieurs analyses les tra its sa i l lan tsde la prononciat ion de M . Delaunay ; i l n e reste donc à re leverque quelques faits nouveaux .
Dans le déb i t l en t et solennel du début , les e moyens son t
devenus ouverts sve‘l pe‘st
Non seulement des ce muets se son t conservés,mais i l y en a
eu d’
introdu its qu i n ’ex i sten t pas ko‘
seyœ ( I 5 ) , syélæ
L’accent d ’un m or a été porté de l ’avant—dern ière sy l labe sur lapremière l’istwà rœA remarque r les nombreux ce qui se trouven t à la fin des vers
pour des mots où i l s auraient dû tomber tèm ( 3 ) , kmnunæ
êduljä sæ (2 afi n : (27) .justisæ délika tesæ (3 espesa (3piùisâ sæ (4 suoænâ sæ
Deux mots on t reç u une p rononciation tout à fait a rchaïquem
'
yæ doiya‘
L’
l,qu i est tombée dans la prononciat ion vu lgaire
,est so igneu
s ement conservée
i l fd (4) , kæ m aue‘
l i l fè kelkæfwa kelkædyâbl
kel/zoe pœ
L’
œ de pæti que beaucoup d’auteurs retranchen t tou jours est
très fortement marqué
V. 5 . Achi ron présente un intérêt par t icu l ier . Avant la
Renaissance,le ch grec , su iv i de e i , se pronon ç a it ch en franç ai s .
CH RON IQUE
PAR IS . Laboratoi re de Phonétique expér imenta le. M. de H oyos ,professeur de phys io log ie et sous-directeur de l ’Ecole norma le sa pér ieure de Madr id , étud ie la p rononciation casti l lane et les m éthodesen u sage dans la phonétique expér imenta le, en vue d
’ instal ler un
labo rato ire dans son pays .
En outre,ont p ris part aux travaux du Laborato ire, MM. Mayo , de
Londres,et M. Michal , étudiant de l
’
U nivers ité a l lem ande de PragueSA INT-PETERSBO U RG . Cabinet de phonétique expér imentale de l’ Univer
sité . M . S’
cerba , d irecteur , enr ich it son Laborato ire des apparei lsles p lus récents et les m ieux cho is is .
SAN FRANC ISCO . Museum d’
Anthropolog ie. Ce laborato ire, spéc ialement fondé pour l
’étude des langues indigènes de la Ca l ifo rn ie, ad é jà produit p lusieu rs travaux . N ous venons de recevo i r Phonetics
of theMicronesian language of the Ma rsha ll islands . Phonetics constituents
of the native languages of California , Phonetics elements of the Mohave
l anguage, par M . A.—L . K roeber (U n ivers ity o f Ca l iforn ia pub l icat ion ,
MADR ID . La ] unta de ampliacion de estudios e investigaciones c ientifl cas a
_
accordé une'
bourse pou r l ’étude de la phonétique expé rimen
ta le au Co l lègede France à M. Tom as N avarro .
U n I nstitut dephi lolog ierouma inea été fondée auprès de la Facu ltéd es Lettres de l’U nivers ité de Pari s sous les ausp ices du gouvernem entroum ain . La d1rec t10n en a été confiée à M. MAR IO ROQ U ES , professeurde langue roum aine l
’
Ec ole des Langues o r ienta les .
Vo ic i la l iste des quelques comm un icat ions de phonétique faitesà la XVI° sess ion du Cong rès internationa l des Or ienta listes tenue à Athènesdu 7 au 14 avr i l dern ier : H U BERT PERN OT , L a prononciation athénienne
moderne, avec pro jections . M . DI H IGO,H istoire de la phonétique du
langage populaire à Cuba . N . DECAVALLA, L
’
a llongement consonantique
(redoublementdes consonnes) eng recmoderne. ATH BOUTO U RAS , Letsitacisme
(pa lata lisation) dans la langueg recque. U n com pte rendu déta i l lé de ces
commun ications paraîtra dans les Actes du Cong rè s dont la publ ication est procha ine .
Le Gérant J . ROU SSELOT .
MACON,F R OTAT F RERES
, IMPR IMEU R S .
CONTRIBUTION A L’
ETUDE
DES INTONATIONS SERBES
Les i ntonations serbes ont susci té depu is longtemps un grand
intérêt chez les l ingu i stes qu i s ’occupen t de l ’h istoire des l anguesslaves ; mais c
’est M . Gauthiot l e premier qu i a tenté d ’ en don
ner une défin i tion p lus exacte et plus p récise au moyen desméthodes fourn ies par l a phonétique expérimen tale . Dans sasavan te Étude sur les intona tions serbes (Mémoi res de la Soc iété de
L ing uistiqzæ,XI
,p . 3 3 6
-
3 5 i l a exposé les résu l tat s de ses
recherches sur plusieurs mots serbes en montran t par des sché
mas les variat ion s de l a hauteur musica le et de l ’ in tensi té des
syl labes accen tuées (p . 3 3 7 Ces recherches,d ’une pré
c ision j usqu ’ i c i inusi tée dans l a ph i lologie slave , ont s ervi debase à M . Gau th iot et à M . Me i l le t
,dans l a secondepartie de
l’
art icl e ci té,pour des conclusions importan tes sur l ’ évolution
h istorique de l ’accen t i ndo—européen et slave .
Cependan t,l a défin ition des i n tonations serbes due à M . Gau
th iot , quoique se fondan t su r les recherches les p lus parfaites qu iaien t é té faites j usqu ’ alors
,fu t bientdt
'
l’
objet de d iverses crit iques .
M . Popovici,alors
,renouvela les recherches expérimenta les au
Laboratoire du Col lège de Fran ce avec les mêmes apparei l s don ts’éta i t se rvi M . Gauthiot , et fut condu it à une conclusion tou t
autre v . La Parole,I 902 : Sur l
’
accent en serbo—croate, p . 29 9
I l faut aj oute r que les rech erches de M . Popovici ne porraien t que sur l a hauteur de l ’accen t désign é par
Les doutes une fois confi rmés par ces recherches nouvel les , ou
t rouva dans l a su ite une constante réserve à l’ égard du trava i l de
M . Gauthio t auprès des ph i lo logues et phonéticiens slaves bien
que chacun ne fi t qu’
accepter une O p in ion insuffisamment demonRevue dephonétique.
202 M . IVCOVITCH
trée. Au l ieu de renouve ler les expéri ences pour arriver à des
conclusions sûres e t préc ises,on continua à se con tenter d ’
obser
vations vagues et général es,résu ltats de l a simp l e aud it ion
,en
dédaignan t la phonétique expérimentale. C ’est ce que montre
très bien l’
ouvrage de M . O . Broc h sur l a phonétique slave,
pa ru en russe par les soins de l’Académ ie impérial e (Olcherk physiolog iy i slavyanskoy ryétchi , S
‘—Péters bourg , 1 9 10) et t radui t ensu ite
en al lemand (S lavischePhonetilc, H e ide lberg, 1 9 1 l ivre accuei l l i
avec faveur dans l e monde des l ingu istes .
Frappé par l e trava i l de M . Gau thiot et guidé auss i par les
recherc hes dialec to log iques que j’a i entrep rises , j
’a i cru que la
quest ion n ’étai t pas c lose,e t me su is rendu en France pour l’étu
d ier expérimen ta lemen t . Ap rès avo i r passé deux mois à G renoble
,j e su is venu à Paris au Laborato i re de Phoné t ique du Col
l ège de France,Où j ’ a i pu enfin réa l iser mon dési r .
Avan t d ’exposer ce que j ’a i fa it à ce su j et,i l conviend ra it de
di re quelques mots du trava i l de M . Gau thio t en général .
Les procédés-employés par lu i son t te ls qu ’ i l s ont pu avec rai
ou soulever des doutes , et qu’ i l s appel len t quelques remarques .
M . Gauthio t nous d i t , par exemp le , qu’ i l a analysé le serbe
te l que le parlen t les gens instrui ts à Belgrade sur la pronon
c iation d ’un Serbe né à Be lg rade , qui a fai t toutes ses études
dans sa vi l le na ta le Une quest ion se pose immédiatementpeut—on d ’ap rès la prononciat ion d ’un seul Belg rad ien instrui t
général iser pour toute la cl asse des gens instru i ts de Belgrade Cettevi l l e étan t récente
,colon isée de toutes les régions serbes au cours
de ces dern iers ci nquante ans,présente une populat ion mix te au
poin t de vue l ingu ist ique,une véri tab le biga rrure d ia lecta le
,
surtou t à l ’ égard des in tonat ions . Les gens instru i ts de Belgrade ,i ssus tout récemment du peuple e t forman t un e c lasse sans tra
d irions l inguist iques part icu l ières , possèden t une prononci at ionqu i
,par su ite
,ne peut encore être et n ’est en véri té qu ’à peu
près un ifiée,quand e l le n ’est pas t rès variée . I l est don c fort dan
204 M. IVCOVITCH
cette aire l inguist ique ce qu i ne m ’ a pas été d iffici le à Paris où
se rencon trent tou j ours un g rand nombre de mes compatriotes,de passage ou autremen t . A la véri té
,mes su j ets ont été auss i des
gens instru its qu i on t passé par les écoles e t don t le l angage,
par su i te,a forcémen t sub i que lques influen ces ; mais , malgré
cet te réserve , i l n e faut pas oubl ier que le cadre de la langue
l i ttéraire serbo—croate es t assez large,car e l l e comprend tous
les parlers chtokav iens,et qu ’ el le est plu tôt caractéri sée par sa
morphologie et sa syn taxe que par sa phonét ique . Pou r ce l le-ci
les nuances régionales n e sont pas in te rd i tes, de sorte que les
Serbes et Croates i nstru its conserven t dans la p lupart des cas
l a prononciat ion de leur rég i on natal e . C’est à cause de ce la que
mes matériaux présen ten t auss i,p lus ou moins , les i n tonations
des d ifféren ts parlers chtokav iens . I ls pourron t pa r suite,en rai
son de leur nombre,servi r ’a défin i r de la faç on la plus vrai
semblable les i n tonat ions serbo—croates te l les qu ’el les se présenten t dans la bouche des gen s instru i ts et
,dan s une certa ine
mesure , nous rense igner aussi sur les d ivergences d ia lecta les . Onpourra
,enfin
,j e l ’ espère
,en t ire r que lques con clusions h istoriques .
Par contre,c ’est l e choix des 111015 frappés de la même in to
nat ion qu i a é té restrei n t dans mes recherches . Je n’a i étudié
que quelques mots,iso lés ou en d iscours su ivi
,pou r chaque pro
nonc iation . Ce sont les mêmes qu i on t été en registrés plusieurs
fois,dans l ’ in ten tion d ’ établ i r les d ifférences en tre les prononc ia
1 . Des renseignem ents plus étendu s sur la langue serbo- c roate et sur ses
dialec tes se trouvent dans les art ic les et ouv rages su ivants P . BOYER,La
lang ueet la l i ttéra ture en Rasnic-H er zegov ine (avec une carte représentant l
’
ex
tension géograph ique de la langue serbo-croate) . Revue g énérale des Sciences,
1900 , p . 3 3 5—
34 3 .A . BÉL ITCH , Ca r te d ialectolog ique de la lang ue serbe (avec
explications lingu istiques et h isto riques) , en russe,édit ion de l
’
Académ ie im pe
r iale de Sa int—Pétersbourg , 1 90 3 . A . BÉL ITCH,Les d ia lectes serbes ou croates
,
dans le Glas LXXVI I I de l’
Académ ie royale de Serbie,1908 , p . 60— 164 .
M. RECH ETAR,Le dialecte chtokav iw,
en a llem and,éd ité par l
’
Académ ie de
V ienne,1907 ,
A . BÉL ITCH ,Les nouvelles recher ches sur les d ialectes serbo-croates
(avec une carte et plusieurs schém as) , Revue slav istz‘
que, C racovie, 19 10 , I II ,p . 82- 10 3 .
LES IN TON AT IONS SERBES 20 5
t ions de mes d ivers su j ets . De p lus,pou r évi ter tout embarras
qu i pourra it proven i r du t imbre des voye lles accen tuées, jé me
suis borné a étud ie r un e seu le voye l le portan t l’accen t,l a voye l l e
a . De cette man ière , l es e rreu rs son t réduites au min imum .
Les tracés ont été analysés au microscope,période par période .
Pour obten ir une plus grande cert itude dans l es ch iffres , j e les
a i contrôlés à plusieurs reprises , e t j e ne citerai ici que ceux qu ise son t t rouvés confi rmés dan s chaque mesure nouve l le .
Les expériences et l es analyses des tracés on t été fa i tes au
Laborato i re du Col lège de France,grâ ce à l’am abi lité de M . l ’abbé
Rousse lot,qui non seulement a mis à ma disposit ion tous les
appare i ls nécessa i res , m a is , encore , a b ien voulu con sacrer à m’ ai
der um temps précieux . Les en regist rements son t dus à M . Chlum
sk'
y . Je profi te de cette occasion pour les remercier l ’un et
l ’autre de leur appu i et de leurs consei ls,don t j e me suis serv i
l argemen t .
L’
ACCENT
Dan s son exposé M . Gauth io t nous commun ique les résu l tats
su ivan ts de ses recherches su r ce t accen t
Les syl labes frappées de l’ intonat ion sont en fa i t ce l les
qui ne son t pas intonées , mais s imp l ement frappées‘
a l a fois de
l’
ic tus e t du En serbe l a tranche marquée d ’un ne
montre j amais au cune varia t ion in tér ieure so it d’ i ntensité, soi t
de hauteur,qu ’ el l e soi t d ’a i l leurs con tenue dans un polysy l labe ,
dans un disy llabe ou dans un La seu l e carac té
r istique des syl labes de ce genre est d’ être nettemen t coupées
des syl l abes su ivan tes par leur in tens ité e t leur hau teu r propres . .
Le schéma de la sy l labe in i t i ale du mot èt0 , donné comme
exemple typique parmi beaucoup d ’ au tres semblables pré
sen te deux l ignes paral lè les,l ’une désignan t la hauteur et l
’
autre
l ’ in ten sit é .
M . Popovici,dans sa no te
,a trouvé que la hauteur descend
206 M . IVCOVITCH
dans les mots uho et ôko , mais qu’el l e mon te d ’un ton dans
brä c'
a,d ’une t ie rce dans ë to
,et d ’une quarte dans z
'
aba M . Po
povici n e nous di t rien de l ’ in tensité des sy l labes étud iées .
Quan t à moi , j’ a i chois i pou r l ’é tude de l ’accen t l es mots
àd (la nausée) e t gä dan (dégoûtan t) , pour lesque ls j e possèdeplusieurs expériences .
Les voici analysées .
SUJET A .
Ivcov itch,professeu r
,domici l i é à Belgrade
,originai re d’
O S
syék en Croat ie ; ses paren ts son t de G l in a en Croat ie . Les en re
gistrements de sa prononciat ion on t é té fai t s au grand enregis
t reu r du Laborato i re,avec la plaque de mica . J e donnerai i c i
t rois exemples pour lemot gad ain s i que pour g adan . Les ch iffres
rep résen tan t l a h auteur musicale d ’une période son t su iv i s
des ch iffres i nd iquan t l ’ i nten sité (a : l) de cette même périodeen tre paren thèses .
Premier exemple : 140 140 142 148
1 5 0 1 5 3 1 5 3 15 5 15 5
15 5 15 5 15 5 15 5 1 5 3 1 5 0
148 14 3 1 3 8 ( 5 3 )Deuxième exemple : 1 2 5 1 26 1 28 1 3 5
140 1 42
148 148 1 46 1 46
1 43 142 1 3 3 (64)Troisième exemple : 1 1 7 1 17 1 29 1 3 0
1 3 6 1 43
15 0 15 2 15 2
15 2 15 0 15 0 147 14 3 1 3 5
1 1 7 1 2 1
1 . Pour les notes correspondantes, voir Rousselot , Pr incipes, I , p . 12 .
208 M . IVCOVITCH
g ad
Premier exemple : 127 1 3 7 148
1 66 1 77 1 77 1 8 3 186 186
186 186 186 186 186
18 3 1 8 3 1 8 3 ( 3 00) 1 83 1 77 1 7 1
1 66 1 60
Deuxième exemple 1 26 1 29 1 3 2 1 3 5
1 5 1
15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5
(205 ) 1 5 1 143
1 3 2
41 9 1 1 5 1 1 5 3 1 5 5
1 5 8 1 60 1 6 3 165 165 165
165 165 16 5 1 60 1 5 0
( 1 20)dan : 1 26 1 20 1 1 2
108 108 108 108 106 106
( 5 1)
SUJET C .
M i lan Popovitch,offi cier de l ’armée serbe
,né et él evé ‘a
Belgrade ‘. D ia l ecte ékav ien . Plaque de mica .
gad
Premier exemp l e : 1 3 4 1 3 4 13 5 13 5
13 5 13 5 13 5 1 3 2 1 3 0 1 26
(7 1 )Deux1eme exemp l e : 1 5 7 1 5 7 1 5 9 161
1 . Les j ou rnaux annoncent que M . M i lan Popov i tch v ient d ’ être tué à l ’ennem i , dansl’
un des prem iers engagem ents de la guerre contre les Turcs . (N . de la R .)
LES INTONAT IONS SERBES 209
161
161 1 5 9 1 5 7 1 5 7 ( 1 14)
ga : 1 27 1 26 1 2 3 1 24 13 2
13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 1 29
1 1 9’
1 1 6
dan : 104 102 100 98 9 3 89
87 ( 3 1 )
SU )ET D .
Miodrague Vassi tch, c ommerç an t de Valvévo en Serb ie . D ialecte ékav ien Membrane de caoutchouc .
gad
1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7
1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 60
1 60 1 60 1 60 166
166 166 166 166 166
166 1 64
1 5 7 1 5 7 1 3 7 ( 1 5 0)
gadan .
ga : 1 1 7 1 60 1 66 1 66 1 66
1 66 1 66 1 66 1 66 171 171
171 171 171
171 171 1 70 1 6 5 1 5 9 1 5 5
( 187)dan : 148 148 144
144 144 1 4 1 1 4 1 14 1 1 3 4
1 34 1 3 0 1 27
2 10 M . IVCOVITCH
SUJET E .
N inho Péri tch, docteur en droi t à Belgrade , né à Boy i tchi enSerb ie, aux envi rons de Chabatse, é levé à Chabatse et à Belgrade
.
D ia lecte ékavien . Pl aque de mica .
F IG . 2 .
G raph iq ue représentant la hau teu r m us ica le et I ntens i té de la voyel le a du m ot g ad
(dans la prononc iation du su jet A,p rem ier exem p le
,le m ême q ue fig . La l igne
su pér ieure représente la h au teu r m us ica le a gauche,à côté du graph ique, sont i nd iquées
les notes parcourues .— La l igne inférieure rep résente l ’ évo lution de l ’ intens i té . Chaque
carré et ch aque po int ou astér ique correspond à u ne période dont l ’o rd re est m arqué en
bas .
gadan
ga : 1 24 1 24 1 2 5 1 26 1 29
1 3 1 1 3 1 1 3 1 13 3
13 3 13 3 13 3 13 3 1 3 2
1 28 1 22 1 1 8
dan : 100 100 99 92 90 8986 8 3 001 8 1 (3 2)
2 I 2 M . IVCOVITCH
t h iot,s
’
i l n ’a tenu compte que du cen tre de la voye l l e,a insi que
nous le supposons . Nous n’
avons pas trouvé,comme M . P0po
vici,d ’ exem p l e offran t l ’abai ssement de la hauteur musicale pour
la tenue . N ous ne vou lons pas con teste r l a j ustesse de ses mesures,
mais son su j et a dû avoi r une prononciat ion tout à fai t particulière
,que nous n ’avons pu constater n i dan s nos expériences n i
par notre ore i l l e .
Il . L ’ in ten si t é , pour la maj ori té des cas ( 1 1 sur su it la
h auteur musical e,c
’
est —di re qu ’ e l le augmente au commence
ment,se m ain t ien t au cen tre et devien t de plus en plus faib le
vers la fin . La minori té des cas présen te une augmentat ion de
force aussi pou r le cen tre . M . Gau thiot n ’ava it donc pas tout àfai t ra ison de d i re que l ’ i n tens ité reste i nvariable pour le noyaude la voyel le ; comparer la prononciat ion du su j et C .
III . Dans l es d isy1abes l a syl labe i naccen tuée est p lus graveet plus fa ible que la précédente , ce qu i concorde ent ièremen t avecles observations de M . Gau th iot .
MILOCH E Ivc ovrrcn .
COMPARAISON DES TRACES
DU PH ONOGRAPH E ET DU PETIT TAMBOUR
Les avan tages du phonographe son t connus l ’ en registremen tfaci le dans l a ci re et la reproduction possib le de ce qui a été en re
gistré , fa i t qui permet d’avoi r un certa i n con trôle de la qual i té
de l ’ enreg ist remen t et de cho isi r ce lu i qu i convien t l e mieux .
Toutefois i l n ’es t pas san s inconvén ien ts . Son tracé n ’est pasvis ib le à l’oei l nu . Pour être uti l isab le
,i l doi t ê t re transcri t
,trava i l
qu i demande l ’emploi d ’un appare i l spécia l,beaucoup de précau
t ion s et beaucoup de temps (voi r le 2° fascicu le de l a Revue p . 147
et Même transcrit , l e tracé phonograph ique laisse beaucoupà dési re r . Comme tout t racé un ique
,i l ne nous fixe pas su r l es
l imites des sons,su r la durée exacte des explosions
,sur l a part
exacte que prend la cavi t é nasale dans l a production des sons .
La forme des v ibrat ion s,i l es t vra i
,nous renseigne p lus ou moins
bien sur le côté physique des sons,m a is la même forme vibra
to i re ne nous d i t ri en sur l e côté physiologique toutefois s i
importan t à connaî tre .
Pour nous rense igner sur l a qual ité des sons à ce double poin t
de vue,l ’emp lo i de l ’appare i l en registreur avec ses d i fféren ts tam
bours est ind ispensab le . Ainsi,s i on lu i demande des ren seigne
ments su r le côté physiqu e,c ’est le tambour mun i d
’
une mem
brane rigide qu i peu t donner l a réponse en dessinant un tracésemblab le à ce lu i qu ’on ob tien t lorsqu ’on transcri t un si l lon phonographique ou g ram ophonique, pui sque ce tambour peut réaliser l es mêmes condi t ions que le recorder du phonographe oudu gramophone . Ma is, tand is qu
’avec ces dern iers i l faut , non
pas des heu res,mais des j ou rs pour avoi r une transcrip t ion
l is ibl e d ’un morceau suivi,sur l ’apparei l en registreur quelques
2 14 CH LUMSKY
minutes suffisen t pour arriver au même but,avan tage qu i n ’est
sû remen t pas négl igeable . En second l ieu , on n’est pas forcé
,
comme au phonog raphe , de se con ten te r d’un tracé un ique
,
ce lu i de la vo ix . On peut avoi r l ’enregis trement s imu ltané dut ravai l de plusi eu rs organes phonateurs et a in s i tous les témoins
don t on a besoin pour se rend re compte du côté physiologiquedu langage . Dans ce dern ie r but
,ce son t des tambours à mem
bran e de caoutchou c qui renden t se rvice .
La seule chose qu i manque aux t racés de l ’appare i l enreg is
treur, c’est la faci l i té de la rep roduct ion sonore . El l e n ’est pas
impossible,comme le prouve la si rène a ondes de Kônig qu i a
été employée dans ce but (Pr inc ipes , t . II,p . 1 On pourrai t
app l iquer aussi le procédé de M . Lifchi tz , analogue au précéden t
(Revue de phonétique, t . I , p . ou bien recouri r à l’appareil
reproducteu r de M. Sc ripture (Resea rches in Phonetics , 1 906 , p . 5 3 et
Seulement cette reproduct ion ne peut pas sefa ire imm édiatemen t
,puis e l le demande du temps e t de l ’argen t .
H eureusement pour nous,cette reproduction sonore est rare
ment ind ispensable,surtout s ’ i l s ’ag i t de l
’étude des mouvements
organ iques pendan t la p roduct ion de la parole . En i nt rodu isan t
une ampoule en tre l es lèvres ou p lus loin,entre la langue e t le
pa la is,nous savons
,sans avoi r même recours à la reproduction
sonore,que nous m odifions p lu s ou moin s l a prononciat ion ,
mais ce qui nous importe,ce n ’est pas l a perfect ion du m ouve
m ent vibrato ire,mais la faç on don t se comporten t les l èvres ou la
langue pendan t l ’émission des sons . Là où l ’on sen t le besoin dese rendre comp t e de la qual ité de l ’en regi stremen t
,on a un moyen
commode pour tourner l a d ifficu l té en mettan t à p rofi t l e phonog raphe,
suivant le p rocédé indiqué dan s les Pr incipes,t . I ,
p . 1 1 5 On réun i t les deux appare i l s au moyen de deux tuy auxde caoutchouc
,mis en commun icat ion avec u n apparei l récepteur
de la parole (embouchure ou enton noir) . Ains i on obtien t deuxtracés s imu ltanés e t comparables des mêm es sons l ’un que l ’on
21 6 CHLUMSK Ÿ
in suffisance à cet égard a été re levée une fois de p l us dans la Revuede Phonétique, t . II , p . 80 et su iv . La figure 1 de l ’arti c le en question (p . 8 1 ) permet de comparer le trava i l de ces tambours avec
ce lu i d es pe t its et montre bien en quoi,pour l ’enregistremen t
de l a voix,les pet i ts sont’ préférables on y voit qu ’ i l s n ’
altèrent
n i n’
effacen t les vibra tions,qu ’ i l s donnen t les harm on iques
,en
out re qu ’ i l s esqu issen t auss i un peu les explosions . Pour les avan
tages et la const ruction des pet i ts tambours,voir Pr incipes, t . II ,
p . 1 1 62 et 1 1 6 3 e t la Revue de Phonétique, t . I , p . 3 8 1 et t . II ,p . 1 2 . I l est cla i r que ce qui rend le s pet i ts tambou rs p lu s aptes
à l’enreg istrem eu t de la voix , ce son t su rtou t les faibles dimen
sions de la cuve tte qu i rédu isen t l ’ é lastic i té e t d im inuen t l e m on
vement propre de la membran e . Mai s l e caoutchouc,étan t tou
j ours su j e t à caution,un con trô le de l a fidél i té de l ’en reg istremen t
s’ impose .
Ayan t eu pendan t plus d ’une année à ma disposi t ion l ’appa
rei l Lioret construi t pour l e l aborato i re du Col lège de France et
m’
étant rendu comp te qu ’ i l con st i tue un bon in strumen t pourla transcript ion des tracés du phonographe
,j ’en ai profi té pour
comparer ceux-ci avec les t racés des peti ts tambours dans l ’espoi rde j uger la valeur rée l l e des un s pa r les autres . Dans ce bu t, j
’a i
fai t deu x expériences,su ivan t le procédé des Pr incipes décri t plus
haut,l ’une pour la prononcia tion normale
,l ’autre pour la pro
nonc iation forte . Afin de compléter les renseignements dé j ài ndiqués
,j ’ aj ou te que la d istance de l ’apparei l récepteur de la
parole par rapport aux deux appare i l s écrivants n ’é tai t pas éga lele condu it aérien commun iquan t avec l e peti t tam bour étai t re lat ivem ent court ( 3 0 ce lu i qu i a l l a i t au recorder du phonographe étai t de beaucoup p lus long ( 1 5 0 d isposi tion d ictéepa r la p lace fixe des deux moteurs du laboratoi re . Les mots sou
mis à l ’ana lyse dans les deux cas on t été les m êmes , c’est— ‘
a-d ire
s’
ufr'i r‘ = cafâ i , contremaître attaché à l a d irection d’un domaine)
p ronon cé deux fois , Vas’
a ta voeu/a,nom propre) , puis une
PHONOGRAPH E ET PET IT TAMBOUR 217
phrase Rada Vas’
a ta chvâ tâ (c”
vdtci) ga leci za t voborsleo Le con
sei l ler VaSata s’
empresse d’
i n terd ire l ’en trée du bois) . Onremarque que
,sauf l e dern ie r mot
,voborsko
,ce sont partout les
voyel les a et d qu i formen t le noyau des sy l labes . L’
uti li té de ce
choix se ra expl iquée p lus loin . L’ en registremen t fin i, j
’
ai procédé
à la t ranscription du tracé phonograph ique avec l es précautions
requi ses , i nd iquées dans l es Rema rques sur l’
apparei l Lioret (Revue,t . II , p . 147 et J ’ a j oute seulement que
,en moyenne
,chaque
syl labe brève a demandé une demi -heure,chaque syl labe longue
F IG . 1 .
i a du m ot i afa i* .
Prononc iat ion à vo i x m oyenne. Enregi stré au phonographe,transc r i t au m oyen de
l ’apparei l L ioret et reprodu i t sans au cun agrand issem en t . Ap rés la 2 1°v i brat ion on
vo i t enco re un léger m ouvem ent correspondant à une v ib ration . I l en est de m êm e
fi g . 2 .
tro is quarts d ’heure,non compris l e travai l de réglage et les
autres t ravaux ind ispensab les . Pour le réglage , i l faut d ire que
c’ est une opérat ion dél icate,qu i
,su ivan t les c i rconstances , peut
se fai re rap idemen t, ou quelquefois prendre plusieurs heures .
Après avo ir rendu a ins i le tracé phonograph ique l i s ib le lu i auss ià l ’œ i l nu
,j ’ a i pu aborder l es mesures . Pour l e tracé du phono
graphe j e me su is servi d ’un décimètre micrométrique donnan t
des d ixièmes de mi l l imètre et d ’une grosse loupe qu i permettai t
de dist inguer nettemen t des demi—d ix ièmes de mi l l imètre ; pourcelu i du peti t t ambour i l m ’a fal lu recourir au microscope don t
le micromètre donnai t 5 d ivi s ions pour 2 dixièmes de mil l i
mè tre .
Revue de phonétique.
2 1 8 CH LUMSK Ÿ
Procédons main tenan t à l ’examen de la prenuere expérience .
Pour que l ’on puisse se rendre compte de la qua l i té de l’enregist remeur
,j e donne ic i deux rep roduct ions de la p remière syllabe
du mot Ëafâ r‘
,l ’une (fig . 1 ) représen tant le tracé phonograph ique
agrand i 1 5 0 fois en hauteu r au moyen du transcripteur L iOret,l ’autre (fig . 2) offran t le tracé du pet i t tambour avec des vibrat ions agrand ies seulement 28 fois en hauteur
,c ’est—à— d ire 7 fois
par l e levie r du tambou r et 4 fois par la photog raph ie . En comparan t les vibrations des deux tracés
,on y constatera une certa ine
ressemblance on voi t,dans les deux cas
,au commencemen t du
tracé d ’abord une vibrat ion i ndécise (non marquée) , l a suivan te
F IG . 2 .
Mêm e sy llabe quefig . 1 .
Enreg istrem ent s im u l tané à celu i de la fi g . 1,avec le pet it tam bour Rousselot . Agrand i
4 fo is par la photograph ie et rep rodu i t sa ns auc une retou che .
(numéro 1) un peu p lus clai re , ensu ite une autre (2 ) déj à tout àfai t nette , carac tér1see par une grande dent et deux petites , formequ i se conse rve pour le corps de la voyel l e en reg istrée par le peti ttambour
,m a is qu i se modifie un peu sur le tracé du phonographe
en ce sens que les deux petites dents y sont dédoublées e t se présen ten t comme deux groupes pour garder a in s i l ’aspect correspondan t a ce lui des vibra t ion s du peti t tambour . La correspon
dance me pouvai t n ature l lement êt re p lus comp l è te , vu la d ifférence de vi tesse des deux apparei l s
,aussi b i en que la d ifférence
d ’agrand issement . Dans ces condi t ions,i l fau t reconnaître qu ’e l l e
220 CH LUMSKŸ
c ’est— à—d ire au bord supérieur , de sorte que chaque amp l i tudedouble se trouve ainsi augmentée de l ’ épaisseu r du tracé
,à
savo i r de 4 ou 5 cent ièmes de mi l l imètre . En trava i l lan t a in sineuf heures par j our
,l orsque j e fus bien habi tué , j e fa isa i s ord i
nairement deux sy l labes . Enfin i l est u t i le de di re que pourl ’ enregi stremen t l
’
embouchure se trouva i t légèrement appl iquéecontre les lèvres
,par conséquen t ne gêna i t pas du tou t la pro
nonc iation . La mei l leu re preuve de l ’absence de tou te gêne , m’
e
ta i t auss i fourn ie par ce fai t que le reproducteu r phonograph ique
répétai t mes paroles à mon en tière sat isfact ion .
Après ces expl i cat ion s pré l im inaires,voic i les ch iffres donnan t
la l ongueur (L) , l’ampl itude double (A) des vibrat ion s , ce tte
dern ière deux fois d ’abord dans son agrandissement respectif,ensu ite san s cet agrand issement pour faci l i ter a ins i l a comparai sondes ampl i tudes rée l les des mem branes des deux appare i ls .
MOTS ISOLÉS
s‘
a du 1er i afdr‘
PETIT TAMBO U RA d
’
Vibrat ion AL A
IV
1 5 0 7
en div isions du en d ixièmes
en d ix1em e5 de m i llim ètrem 1c rom etre de mm .
222 CH LUMSK Ÿ
PHONOGRAPHE PET IT TAMBOURA I /2 d1v
la du 2°
Passage s”-a
1
Vo velle a
1 . Vo irfig . I et IJ
Vibration
Passage s‘
-a
PHONOGRAPH E ET PET IT TAMBOUR
PHONOGRAPH E PET IT
— sa de Va i ata
-ta de Vai a ta
22 5
2 3 6 CH LUMSK Ÿ
PHONOGRAPHE PET IT TAM BOU RA d iv .
A 7
3
3 I /2 0317
3 0314
2
2
2
2
2
2
2
1
1
Ces ch iff res apporten t les renseignements su ivants
1° Le nombre de vibrat ions en regi strées par les deux appa
re i l s est éga l pour les sons correspondants,par conséquen t
,l e
peti t tambour est aussi fidèle que l e phonograph e,n
’
ajoutant pasdavantage que l ’autre .
PHONOGRAPHE ET PET IT TAMBOUR 2 3 7
2° La longueur des vib rat ions , et par suite la hauteur musi
cale , est dans les deux cas , dans u n rapport constan t . S i l’on
trouve parfois des écarts , c’ es t qu ’ i l s son t inévitab les . I ls sont dus
d ’abord à ce fai t que les deux appare i l s n ’ é taien t pas mns par unseu l moteu r ; du mom ent que l
’on en a deux d i fférents (dans
nos expér iences c’
é ta i t u ne turb ine pour l ’appare i l en regis treur,
un moteu r à po ids pour le phonographe) , l a marche n’est j amais
tout a fai t pare i l le . L ’au tre cause de ces écar ts est l a d ifférence
de l ’agrand issement . Ce’
dern ie r,étan t de 1 5 0 fois pour l e pho
nog raphe, donnai t d es angl es plu s a igus et faisa it a insi mieux
ressort i r les l im ites des v ibrat ions que ne le permettai t le pet i tagrand issemen t du peti t tambour . Par conséquent l es mesures
,
surtou t celles des vibra t ions t rop pet i tes,deva ien t forcément êt re
moins préc ises pour ce dern ie r . Toutefois,même là Où un cer
tai n désaccord ex i ste en tre les deux sortes de tracés,i l est
minime et par la nég l igeable . Les ch iffres parlent donc en faveur
du fa i t généralemen t admis que non seulement le phonographe ,mais aussi l e pet i t tambour peut servi r pour l
’
étude de la durée
e t de l a hauteu r musica l e des sons .
3° Les ampl itudes don nées par l e peti t tambour son t p lus
fortes que cel les du phonographe . On l e voi t b ien sur les tablesde réduction qu i représen ten t les ampl i tudes rée l les des deuxappare i l s . Le fa i t n ’ a rien d ’étonnant
,puisque le t ambour se
trouvait p lus près de la sou rce sonore l e caoutch ouc pouvai tpar conséquen t céder plus faci l emen t aux impuls ions du mouve
men t v ibrato ire que la p laque en verre . Ce qui est p lus intéressant c ’est qu’ i l y a un para l l é l i sme constan t en tre les ampl itudes
des deux sortes de tracés : s i l a force augmente pour le phono
graph e,une augmentation analogue s ’annonce ordinai remen t
aussi sur l e t racé du petit tambour e t in versement . I l s’
ensu i t
qu ’ i l y a un rapport constan t en tre les ampl i tudes correspon
dantes : ce l les du corps des voye l les son t d ’ord inaire de 2 à 4 fois
p lus grandes pour l e peti t tambour que pour l e phonographe , l es
3 8 CH LUMSR'
Y
vibrations voca l iques l es p lus fortes le sont seu lement 2 51 3 fois ;ce l les des passages , de 4 à 7 fois .Toutefois i l y a des endroi ts où le paral lé l i sme ment ionné
paraî t être t roublé ; voi r par exemp l e les 1 0° e t 1 1 ° vib rat ion s de
la syl labe ta du Ier i a dr . ou bien les 1 3
° e t 1 7° de la
même syl labe du 2° i afâ i . etc . Mais ce trouble n ’ est q u
’
apparent .
A ces endro i ts,i l y a ord ina iremen t un peti t changement de
l ’ épaisseu r du tracé ou bien une érafiure sur le bord,à peine
vi si ble sous l a l oupe,ma15 appréciab le au microscope . Une pet i te
inégal i té de l a couche du noir de fumée peu t faci l ement amenerce résu l tat . H eureusement les erreurs possibles n e dépassen t pas
d ’ordina ire d ivis ion du micromètre et ne peuven t sérieuse
ment troub ler le rapport des deux sortes d’
am plitudes . Le seu l
cas qu i pu isse paraî tre p lu s embarrassan t,est celu i de la sy l labe
lui du mot ra lrdçaL Là l es ampl i tudes augmen ten t presque j usqu ’ à l a fin de la voyel le (c
’ est -d ire j usqu ’à l a 2 3° vibrat ion)
pour le phonographe . tand is que pour l e peti t tambour ce tteaugmen tation ne va pas s i lo in el le dépasse à peine l e premiert iers (l es p remières 7 v i brations) . Ensui te la force ba isse un peu
pour se mainten i r s ta t ionnai re j usqu ’ à l a 23° vibration
,et ce
n ’ est qu ’ap rès,à parti r de la 24
° vibra t ion,que les deux appa
rei ls tomben t de nouveau d ’accord,en montran t s imultanément
la d im inut ion de la force v ibrato ire . La différence est donc dans
le corps de la voye l le e t,en un m or. e l l e consiste en ce que le
peti t tambour i nd ique le main tien de l a force après l’accro issement in itia l
,le phonographe une légère augmentat ion qu i se
poursu it pendan t le même temps . Ce cas excep tionnel méri te’ être examiné sur d ’autres exemp les et j e me propose d ’y reve
n i r dans un art ic le prochain . Au reste , l e désaccord est loin d’ être
grave,pu isqu ’ i l ne détru i t pas l e rapport constaté pour les ampl i
tudes de tou tes les autres voye l les examinées : l es ampl i tudes
du peti t tambour son t ici de 2 à 3 fois plus grandes que pour lephonograph e .
240 CH LUMSK Ÿ
—
1a t
vo
-bor
sleo
Sauf pour le mot zahdza t, d iscuté plus haut , on vo it que les
deux apparei l s son t complètemen t d ’accord ; i l s d istri buent la
force de la m ême façon et re lèvent ord inairemen t l a premièresy l labe du mot
,ce qu i correspond à l ’ i n tens i té te l l e qu ’on l ’en
tend réel lemen t en tchèque . C ’est donc une nouve l l e confi rmation de la fidél ité des deux appare il s au po in t de vue de l ’ eu re
g istrement de l ’ in tensité . Q uan t au mot él im iné , s i l’on examine
l es ch iffres donnés plus haut,on con state un fai t su rprenan t à
p remière vue,à savoi r que le tracé du pet it tambour se rapp roche
l e p l us —de la réa l i té : tand i s qu ’au phonographe,l ’ i n ten sité te l le
que j e l a sens dans l e mot mhdza t, est renversée , et se transporte
de la prem ière syl labe sur l a deux1em e,l e pet i t tambour au con
trai re donne une pu issance égale aux deux prem ières,ce qu i cor
respond mieux à l ’ imp ress ion audit ive . Pour ce tte question i l
n ’est pas sans in térêt de relever la faç on don t se son t comportésles deux apparei l s par rapport aux mots du même type que
; a/râ zat, qu i sont l es deux njar. Dans ces deux mots,nous avon s
,
comme pour {ahd( at, d’abord une sy l labe brève accen tuée
,
ensuite une longue non accen tuée . Or,pour ces deux m ors
,l e
peti t tambour comme le phonographe,sa isissan t b ie n l ’ i ntensité
en tendue,renforcen t l a première sy l labe . Comme le peti t tam
bour agit auss i de la même faç on dan s un tro isième cas analogueà savoi r dans {aleaza t, i l est permis de supposer que son traceest j uste et que le désaccord avec le phonographe n ’est dû qu ’àun acciden t . J ’aurai du reste b ien tôt l ’occas ion d ’
y reven ir .
Après l ’examen des voyel les,i l y aura it un mot à d ire des
PHONOGRAPH E ET PET IT TAMBOU R 24 1
consonnes . Mais l e nom bre d ’exemples examinés é tan t restre in te t le paral lé l i sme b ien vis ibl e , correspondan t aux nuanc es consonantiques mentionnées p l us haut
,j e ne m ’y a rrê te pas .
La comparaison serai t i ncomplète sans l etude des tracés de la
prononcia tionforte. L ’ expérience nécessaire a été faire de la mêmefaç on que la précédente , avec la d ifférence , b ien en tendu , de
l ’ in tensité . J’
insiste i c i su r l e fai t que,pour cette expérience
,l a
prononciat ion a été très forte : j ’ai pour ain s i d ire crié dans l ’embouchure
,qu i
,tout en étan t légèrement appl iquée aux lèvres
,
n ’ é ta it percée d ’aucun t rou pour ne pas affaib l i r l ’ in tensité du
F IG . 3 .
Sa du mot Ï afâ ixP rononc iat ion forte. En reg i stré au phonographe, transc r it au m oyen de l ’apparei l L ioret
et rep rodu i t sans agrand i ssem ent n i retouche .
son . L ’ effet de la force emp l oyée se man i feste sur le phonogaphed
’
une faç on particul ière les sy l l abes les p lus in tenses on t souven t plusieurs vi brations t ronquées
,donc d iminuées dans leur
amp l i tude,moins par la rés istance de la ci re que par le réglage
de la pro fondeur du si l lon,qu i
,suffisan t pou r la prononcia tion
normale,ne l ’ éta i t pas partou t pou r la forte , surtout là où la
force de la vo ix e t par conséquent auss i les écarts de la p l aquev ibrante devenaien t excessifs . A ces endroits , l e saph i r quitta it la
ci re pour une portion,min ime i l est v rai
,de son mouvemen t
négatif,m a is assez g rande cependan t pour que les vibrations
242 GB LUMSR Ÿ
en registrées perd issent leur forme symétrique,en offran t un
côté pointu,e t l ’ autre Côté , l e côté opposé, avec des poin tes
coupées . On peut juger de la pe rte subie d ’après la torme des
vibrations . Là où la poin te n ’ est qu’un peu émoussée,l a perte est
très peti te . Si au contra1re , l a poin te est comme coupée , la perte
est considérab le,de so rte que même les vibrations incomplètes
donnent des i nd icat ion s n écessai res sur le rapport des ampl i tudes
et peuven t être uti l isées . Toutefois pour les mots iso lés,j ’a i pré
féré ne me servi r que d ’exemples ayan t partout des vibration s
complètes (voir fig . Pour la ph rase j e n ’ai pas eu cette poss ibilité de choix . Dans ce dern ie r cas
, j’
indique l es syl l abes où
F IG . 4 .
Mêm e sy llabe que fig . 3 .
Enregi strem ent s im u ltané à celu i de la fi g . 3 , avec le pet it tam bour Rousselot . Agrand i4 fo is par la photograph ie et rep rodu it sans au c une retou ch e .
les v ibrat ions son t tronquées auss i b ien que le deg ré de la perte .
Su r l e tracé du peti t tambour (fig . même pour la pronou
c iation excessivement forte , une in spect ion sommaire ne révèler ien d’
anorm al,sauf l a forme des v ibrat ion s qu i ressemblen t
moins à cel les du phonographe . Cette d ifféren ce se trah it aussi
dans les mesures qui su iven t .
Va de Va5a ta
PHONOGRAPH E PET IT TAMBOU RA I /2 d iv .
246
PHONOGRAPH E
Consonne b (explosion)1 re
2€ 8 5
Voyelle 0
1 1e 87
2e 86
3e 86
4e 8 5
se 8 5
6e 8 5
7e 86
8C 86
9e 87
10€ 88
1 1e 88
1 2 6 89
1 3 3 90
14e
92
1 5e
9 3
N .
-B . Les v ibrations
phonographe.
CH LUMSK Y
PET IT TAMBOURA
27 9
26 1 1
2 5 1 3
2 5 16
2 5 1 8
26 1 8
2 5 1 8
2 5 18
26 18
26 18
26 1 8
27 1 7
27 16
27 1 5
27 14
sont légèrem ent ém oussées
248 CH LUMSK Ÿ
Comme on peut l e voir,j e me su is1 d ispensé de donner tous
les ch iffres , non seu lemen t par économie de p lace , mais aussi
pu isque ce n ’ est plus n écessaire . I l m ’a paru suffisan t de repré
senter les deux types de mots que l ’on t rouve en comparan t lest racés l ’un de ces types correspond à un excès de force (exemplevoborsko) , l
’autre à une prononciation moins exagérée , se rappro
chan t de l a prononciation normale (exemple Va i a ta , emprun té
comme le p remier au d iscours sui vi) .
Or , on trouve de nouveau , comme pour l’expérience précé
den te,que
1° Les deux apparei ls sont d ’accord quant au nombre de vibra
t ion s des sons correspondants .
2° La longueur des vibration s
,et par suite la hauteur musi
cale,est dan s l es deux cas dans —
um rapport constan t , abstractionfaite des pet i ts écarts ment ionnés 1 p ropos de la première expé
r ience. Donc , la prononciat ion forte ne détru i t pas non plusl ’accord des deux appare i l s pour ’étude de la duréeet de l a hau
teur musica le des sons .
3° Les ampl itudes offren t un para l l él isme moins complet que
celles de la prononciat ion normale . Les exemples choisi s l e
montren t suffi samment . Toutefois on le voi t assez b ien conservépour les consonnes
,et pui s pour la p lupart des voyel les ( 10 sur
1 7 mesurées) . Pour ces dern ières,le s excursion s de l a plaqu e pho
nog raphique arr ivaien t à égaler cel les du peti t tambour, leu r rap
port étan t exprimé app rox imativement par 1 1 . Voir les ch iffres
pour Va 5ata . C ’ est j ustemen t le cas où la prononciation n ’ étai t
pas encore excessive,comme j ’a i pu m ’en convaincre en faisan t
parler l ’enregistrement phonograph ique . On ne rencont re des
écarts avec l e rapport i ndiq’
ué que pour les passages . Le com
m encem ent des implosions,par exemp l e
,p résen te un accroisse
men t d’
am plitudes qu i ne se produ it pas pour le phonographe .
On voi t b ien ce pet i t désaccord à l ’oei l nu,en comparan t à ce
poin t de vue les figu res 3 et 4 . Mais ce désaccord ne touche que
PRON OGRAPIIE ET PETIT TAMBOUR 249
2 ou 3 vib rat ions du commencement de l’
implosion à la fin lesdeux tracés son t d
’
acco rd . On remarque auss i un pe t it écart pourles explosions . Ces d ifférences , on le devine bien ,
do iv en t êt reattribuées à l a poussée d ’air qu i se produ it pou r ces sortes de
passages et qui est n atu re l l emen t plus sensib le avec le tambour,
en raison de son é last i ci té e t de son moindre éloign ement de la
source sonore . L’ i nfluen ce de la poussée d ’ai r sur le caoutchouc
a été bien rem arquée par M . Rousse lot e t men tionnée dans les
Pr incipes, p . 106 1 . Toutefois ces d ifférences sont ordinairementpeu considérabl es et surtout e l les ne touchent pas l e corps desvoye l les
,Où l e rapport fixe se main t ien t . Par con tre . les voyel les
où la force atteignai t son maximum,s
’
écartent de ce paral lél isme
aussi pour le corps voca l ique : voi r l ’exemp l e voborsko, où pour lapremière voyel le , l es ampl itudes du tambour son t de a
fois plus grandes que ce l l es du phonographe pour la seconde
el les le son t de 4 à pour la dern ière de 5 à 3 fois . On estavert i
,du reste
,de ce changemen t par la forme des v ibrat ions
qu i dans l es cas ana logues , perdent l eur aspect habitue l pour nep lus ressembler à ce l les du phonog raphe. Lequel des deux appa
rei l s a raison ? J’
inc line pour le phonographe , parce que le rapport des in tensités senties par mo i se trouve détru i t sur le tracédu pet i t tambour . Mais ce poin t demandera i t auss i de nouve llesexpériences et avec d ’ autres apparei l s . En attendan t , j e crois quela force exagérée
’
du son et d u courant d ’a ir,dépassant la capa
cité du peti t tambou r a rendu cette expérience inuti l isable Le
phonographe a été moins imp ressionné dans ces condit ions désavàntageuses pour le peti t tambour , j ustement par son grand élo i
gnem ent de la source sonore . Mais s i l ’on fai t des expériences àl a m ême distance on constate aussi que la p laque du phonographeou du gramophone s
’
affo le comme le p rouve , par exemp le,pour le gramophone p lusieurs tracés de M . Scripture donnés
dans ses Éléments .
Comme conclusion,nous pouvon s dire que
,même pour la pro
Revue de phonétique.1 6
2 5 0 CH LUMSK Ÿ
nonc iation forte on peut s’en rapporter
,quoique avec
d iscrét ion aux tracés des deux appare i l s,tant que la forme
vibrations n ’est pas détru i te .
Jos . CH LUMSK Ÿ .
2 5 2 j . GH LUMSR Ÿ
pos i t ion,les brèves e l les-mêmes se rapprochen t souven t des
longues,ce qu i s’expl ique aisémen t par le passage len t au repos
des organes phonateurs . Cette restric tion fai te , on a comparé l e
reste d ’abord les syl labes vo is ines brèves ouve rtes , don t la pre
mière porte l ’accen t et don t l a seconde est atone . Pour ce l les- ci
on serai t ten té , à l’ore i l le
,de leur attribue r l a même durée
,
cependan t les ch iffres mon tren t qu ’ i l y a une d ifférence l es
ton iques sont tou jours plus longues , parfo is deux fois autan t queles atones . C ’es t surtout l ’ exemple : na m lhavém , sur (l
’ horizon)nuageux qui est très i nstructif. Pour ce dern ie r par hasard , l a
prononci at ion a été d i fféren te . J ’a i accen tué la p réposi t ion na,
c’
est-à-d i re la première syl labe du groupe,comme on le fai t géné
ralement en tchèque ; mon compatriote a obéi à l a prononc ia
t ion d ia lecta le e t a mis en re l ief non pas la préposi tion na, mais
la sy l labe suiv ante,e t les mesures ont donné ceci en cent ièmes de
seconde
n passage de n vers a a m pass . de rn vers l l avec son pass . vers
C : 20 1 2 7S 5 6 9 14
Soit comme durée des syl labes
C : un 3 3 m l 1 7 5 na 1 3 , ml 24
Ainsi qu ’on peut le voi r , la préposit ion accen tuée par moi estdeux fois p lus longue que la sy l labe atone . Chez mon compa
trio te le rapport es t in tervert i c ’ est la préposit ion qu i est de
moi tié p lus courte que l a syl labe su ivan te,devenue ton ique .
Non moins intéressante est la comparaison d ’une autre série
de syl labes voisines dont la première est accen tuée , mais brève àl ’orei l le
,l a seconde longue , mais atone . Le rapport de cette sorte
de syl labes a int rigué assez souven t les savants à cause du fai t
que la longueu r de la seconde atone représen te la trace de l ’ accen t
prim itif,l’
accentuation sur la p remière sy l labe,générale aujour
MESURES DES SONS ET SYLLABES TCBEQUES 2 5 3
d’
hu i , étan t rel at ivement récen te . Ains i l e mot Par i s qui sign ifie
Pari s ava it auparavan t l’
accen t d ’ in tensité sur la seconde
comme son origin al français . Auj ourd ’ hu i l ’ in tensité se t rouve
déplacée su r la première . O r, s i l’on mesure l a sy l labe ent ière
en tenan t compte de la voyel le et de la consonne,on con state
que l ’accent d ’ in ten si té tend,ou bien à égal iser les durées , de
sorte que l a brève ne d iffère pas beaucoup de sa longue , ou b ien
qu ’ i l va encore plus lo in et qu ’ i l i n tervert i t l e rapport la préten
due brève ton ique dure parfois p lus longtemps que sa prétendue
longue non accentuée .
Conclusion La comparaison des exemples montre que la
durée en tchèque n ’ a pas une val eur indépendan te , mais qu’
e l l e
F IG . 1 .
papa .
En h au t , nez en ba s , bou che.
est en général dominée par l’accent d ’ i n ten si té , ce qu i est un e
nouvel le confirmation des résu lta ts auxque l s son t arrivés , par uneautre voie
,deux expér imen tateurs tchèques
,MM . Kr:i l et Mares
(cf. Rousselot , Pr incipes , p . 109 , et Scr ipture , Éléments , p .
Le travai l en question renferme de p l u s1° La revi sion du mode de dél im ite r les sons, question qu i a
été t ra itée à part dan s l e fascicul e précédent de la Revue, p . 80
et su iv .
2° Une ind ication sur la façon don t les sourdes in i tia les peuven t
être mesurées d ’après la forme du courant phonateur . On voi tpar exempl e que pour le p i n i t ia l (fig . 1 ) l
’
occ lus ion nasa le n’
est
accompl ie qu ’après l’occ lusion bucca le . Donc , tout ce qui précède n ’est qu’une préparat ion . C ’est seu l ement avec l a ferme ture
2 5 4 CH LUMSR’
Y
du nez que les organes on t pris l a posi tion pour l a consonne
c’
est a lors a parti r de ce moment- l ‘a qu ’ i l fau t mesure r sa durée .
La j ustesse de cet te mesure ressort aussi de la comparaison avecl es sonores (fig .
3° La revision de mon é tude in ti tu lée : Ana lyse du courant
d’
a i r phona teur en tchèque, publ iée dan s l a Parole, 1 902 . Cette
étude est sort ie des expérien ces fai tes su r des sy l l abes e t des motsi so l és L ’analyse des voye l les y repose surtou t su r la forme dan slaquel le e l les se p résen ten t à la finale
,où tout nature l lemen t l a
tendance des organes resp i ra toi res à reprendre leur fonc tionnemen t régul ie r, en tr
’ouvre prématurémen t la cavi té n asal e e td ivise ain si l e cou ran t sonore en d eux . C ’ est ce qui m ’ a amené :
‘
I
F IG . 2.
baba .
En hau t , nez ; en bas , bou che.
supposer que,pour chaque voyel le
,i l y aura it un doubl e couran t
,
l’
un buccal,l ’autre nasal . Les expériences posté rieures sur le d is
cours su iv i restre ignen t la conclusion énoncée auparavan t,en
mon tran t que ce doubl e couran t ex i ste seul emen t pour les
voyel les fi nales avant une pose ; à l’ in térieur du mot i l n e se
produ i t que sous l ’ influence d ’une nasale vo isin e , non ai l leurs .
Les toutes peti tes v ibration s qu i accompagnen t chaque voye l l esur l e tracé du nez
,n
’
expr im ent que la résonnance commun iquée
à la cavi té nasale .
Q uan t aux con sonnes , l a révision mon tre que la conclusionpubl iée en 1 902 est val ab le , el le aussi , seu lemen t dans les l imites
des expériences qu i on t servi à l’établir . Toutefois , m ême dansl e discours su ivi en tchèque
,ce doub le couran t est possib le . Ma is
dans ce cas-là ce double couran t n’ est qu’une parti culari té de la
prononciat ion individue l l e .
Ç B LUMSRŸ
FIG . 4 .
v zennors dans le m ot nof .
lin haut , nez en bas , bouche.
F IG . 5 .
thur ing ien dans le m o t loc”
.
lin h au t , nez ; en bas , bo uche.
F IG . 6 .
su issedans le 1110 1 [ op] .
En h au t , nez ; en bas , bouche .
F IG . 7 .
5 espagnol dans le m o t €uan .
En haut,nez en bas , bou che.
F ig . 4 , 5 , 6 , 7 reprodu i tes sans aucun agrand issement et sans aucune retou che.
MESURES DES SONS ET SYLLABES TCH EQ UES 2 5 7
aussi de su ivre l’
i nfluen ce des consonnes nasales,
’
an térieures et
postérieures , pures et moui l lées, sur les voyel les e t les consonnesvoisines .
L’art icle sur l e r tchèque paru dan s la Revue 1 9 1 1 y trouveaussi son complément .
5° Le résu l tat des expéri ences sur etchèque (écr i t ch) . Dans l a
figure 3 on voi t de pet ites vi brat ions con sonan tiques , mais sans
les ondu lations qu i caractér isen t ord inai rement l e t‘ al lemand
(fig . 4 , 5 , 6) ou la jota espagnol e (fig . La comparaison deces figures permet de devin er que le frottemen t pour l e 5 tchèquedoi t être moins fort e t l e son moins dur que celu i du 5 al lemand
ou espagnol . Les expériences expl iquen t a insi la d ifférence de
l’
imp ression acoust ique donnée par les son s comparés .
6° La constatation d ’un h e t d ’un y accidentel lement assourd is,aussi bien que d ’ autres assourdi ssements mo ins notables de con
sonnes dans les sy l labes p lus fortemen t accen tuées ou bien quel
quefo is après un e sourde .
7° La mise au poin t d ’une remarque de M . Meyer sur le b
tch èque pub l iée dans son art i cl e S timmhaftes h (DieN eueren Sprathen Où i l parl e d’un h t ch èque sonore aussi à l a finale .
O r , l’orei l le et les expériences démontren t qu ’ i l n ’y a pas de ‘
h
sonore à la fina le en tchèque,chaque h final s’y assourdissan t e t
devenan t ô. L’
o rthographe tchèque dans ce cas- là , comme dansbeaucoup d ’aut res
,n ’ est pas phonétique et conserve l e signe
t rompeur de h à l a finale .
8 ° La constatat ion expérimentale de l ’existence des occlusives
la ry ng iennes en tchèque . Le coup de glotte est b ien rendu dans
la figure 8 qu i représen te deux mots commen ç ant par une
voyel le a nni (a et, uni même pas) . Pour avoir des ind i
cat ions plus com p lè tes,j ’ a i employé t ro i s p lumes dont l ’une
en regi stra i t l e courant d ’ai r nasa l (tracé inférieur) , les deuxautres l e couran t d ’ air buccal d iv isé en deux pour avoir unel igne presque droite avec des vibrat ion s vocal iques e t une courbe ,
2 5 8 CH LUMSR Ÿ
marquan t l es poussées d ’ai r des exp l o si on s . Les part ies presquehorizon ta les de ce tte courbe
,l imi tées par la et la pui s pa r
l a 3°et l a 4° perpend icu la i res représen ten t les deux occlusions
successives de la g l otte se produisan t a van t la voye l le . La mon
tée brusque de l a cou rbe exp rime l ’ exp losi on et le commencement de la voyel le . Très in st ructive ic i es t l a comp araison de g]avec les deux art icu lat ion s la ryngiennes l a fermeture de y a lamême forme que les deux occlusives l aryngiennes .
F IG . 8 .
a ag i .
Rep rodu it sans aucune reto uche .
1 et 2 , un doub le tra cé du co urant bu cca l 1 . donné par le grand tam bou r 2, pa r le
peti t tambour ; 3 , nez ; 4 , d iapason (200 v . Entre la I”et la 2
°et entre la 3
°et la
4° perpend ic u la i re, occ lu s ive laryngienne.
1 0° La constatat ion des voyellesb réves sombres que l
’
on n ecri t pasen tchèque et qu i n ’ en ex i sten t pas moins . Ces voyel les se ren
con tren t : a) au commencemen t de quelques consonnes in i tiales,te l les que r et i ; b) dans quelques groupes de consonnes : ain si ,si l ’on enregistre par exemple le mot tma ténèbres
,obscu ri té
on trouve en tre t et m une voye l l e brève que l ’on en tend aussià l ’orei l le et que j e serais ten té de comparer au '
6 du vieux slave .
I l en est de même entre d et b,en tre 43 et d , etc . Le groupe le
plu s importan t est celu i qu i es t formé par une consonne r .
La durée de ces voyel les brèves sombres varie et avec e l le auss i
la netteté de l ’ impression audit ive .
D ICTIONNAIRE
DE LA PRONONCIATION FRANÇ AISE
(S ui te. )
(Groupe bd ; a de —a tion ; i de -a tion sy , l moui llée, y , en généra l
consonnes lingua les, g roupes avec v et consonnes mou i llées ; finales-en,
—
ge et—e.)
ABD ICAT ION a b a'10 . i le à
s y a
et h d i le e'
cl 6 . h d 0 171 10 . e
n
ABDOM INAL a b 6 . d 9 0 m
72 et
ABI) U CTEU R a h d u 5 .
( i’7'
ABDUCT ION a h a’
u 5 . s
y 5 1 4 .
—ahe,e‘
ib san s excepti on (Lanoue , 1 69 6 ,Littré
,Diet .
excepté astrolâ he (Dem andre,1 769 , Napoléon Landais , Gram .
1 843 , mais non Diet. D’
O livet a j oute crabe, que j e ne
ret rouve avec un et g rave, que dan s P. Passy (Diet . ph.) à côté de
l’
a aigu long ou moyen .
ABÊCÉDAIRE a h e 5 e d
ër 3 3 3 7
a 9 . b 9 . e ajet h ey
et h 1 0 . e y é
LA PRONONC IATION FRANÇAISE 26 1
1° Groupe bd . Sur certa in s tracés du souffle buccal
,la d is
tinction de b et de ci se fai t sans peine . Même,dans des condit ions
favorables, par exemple (fi c . l es d ifférences d’
in tensi té e t
Ag r°
F IG . 40 .
G roupe bd
Les dermeres v ibrations de l’
a ini tia l ont é té conservées .
Les v ibrations nasa les peuvent ten ir l ieu de c el les du la rynx .
3 . abdomen a été prononcé avec un a: final .
de sonori té se montren t très bien n ° 1,
p lus grande in tensitéappart ien t au b n
° 52, 3 et 4, au il ; n ° 3 , une peti te explosion
étouffée apparaî t,reconnaissab le à l ’accroissemen t d ’ampl i tude
des vibrat ion s . Chose in téressan te,nous avons (fig . 4 1) une
sorte de d sp irant s inon au poin t de vue acoustique du moins
2 62 L ’ABBE ROU SSELOT
au poin t de vue articu latoire car l em ission de l’air
,pendan t ce
qui devra i t être l’occ lusion,est t rès n otabl e .
Les mesures re l evées c i— dessus n ’ on t pas été prises sur les tracés
reproduits . La figure 40 nous donne un centième de seconde
pour b et d n ° 1 . 7 e t 8 , 5 n ° 2 . et n° 3
3—
5 .
(avec l’exp los ion et 6 ; fig . 4 1 .
—
9 et
A ne considérer que la l igne de la bouche,on pourrai t être
ten té de cro i re que les sonores e t d s’
assourdissent par leur rap
prochement . Ce sera it une e rreur ; car la l igne du nez , l‘a où el l e
est t rès n ette 1, 3 , montre très b ien que dans ces
exemples l ’act ivi té laryngienne n ’est en rien d iminuée . L’
affa i
blissement des vibration s bucca les t ien t à des degrés différents de
l’
occ lus ion .
2° L
’
a de -a tion . Cette fi nale est empruntée du latin ; et ,tand is que la forme fran ç a ise -a ison (raison) est si douce à nos
o re i l les, elle a conservé pour nous quelque chose d
’
étranger , je
d ira is presque de barbare . Aussi la prononciat ion n ’en est pas
encore b ien fixée . Les uns fon t l’a graveet l ong (à), l es autres
moyen et bref (à) . Ce sont les extrêmes le premier semblel ou rd , l e second trop pointu . La bonne prononciat ion parisienn eest un à bref ou de durée moyenne .
Au XVI° s iècle
,l e Lyonnais Maigret ( 1 5 5 0) ch icane Pel letier
du Man s à propos de na tion . Le mot éta i t dé j à ancien dan s l alangue i l ava i t é té i n trodui t au x 11
° sièc le par le traducteur du
Psaut ier d ’
O xford . Mais à L iyo”
,comme on disai t san s doute
a lors et comme l ’ on di t au j ourd ’hui on ne pouva i t croi re que
la p remière voyel le de ce mot nacion fût plus longe que sa
penult ime et l ’on trouvai t cet a court en regard de nritzj (Th .
II,p . Pour le Poitevin Le Gaygnard l
’
a est long ,c ’est— à—d ire grave .
1 . J’
ai noté la fo rm e l iyô à Lyon m êm e,et je trouve dans le D iet . des R inu s
de L . Cayotte ( 1906) la transc r iption L i ion (p . XV I I), q ui est no rmale pour
l’
auteur .
264 L’ABBE ROU SSELOT
évei l lée . D ’après lu i (Pa r lers Par isiens) , M . Loy son hési ta i t en tre
à (pâ te) et à (patte) ; de même , Pau l Des j a rd in s l isai t modula t ionavec à e t conversa t ion avec à ; Zola prononça i t soi t avec un a
mi-fermé (généra t ion) soi t avec un a ouvert celu i de a cte
(sensa tion) l’
a de acte n ’est pou r moi qu ’un a moyen bref
Ren an avai t un a ouvert, Mgr d’
H u lst un a moyen de timbre e t
de quan t i té . J ’a i noté l a même qual i té de l’a dans une leçonde l ’ abbé de B rogl i e Gas ton Pari s un a ferm é moyen
Rod ne prolongeait pas trop l’a , un a plus ou moin s fermé
R i tter employa i t l ’à ; enfin moi -même , j e me sera is se rv i d’un (1
ouvert moyen (a cte) dan s généra t ion,sensa t ion , d
’
un et
fermé moyen (pas) dans conversa tion , d’un à fermé long
(pâ te) dan s propaga t ion,assimi la t ion .
J ’avoue que , pour ce qu i me con cerne , les notation s de
M . Koschwi tz m ’
é tonnent . Nature l lemen t,j e ne puis parler
‘
que
de ma prononciat ion voulue, et non de m aç prononc iat ion réelle
,
ce l le qu’
écou tait M . Koschwi tz . O r , dans les m ots en a tion ou
assion, j’a i tou j ours l ’ i n tent ion de donner un a g rave, celu i de
pas ou de pa sse. J ’ avoue que la d ifférence de quan t i té en tre ces
deux mots et passion est pou r moi peu sensibl e tou t en étan tnotable d ’ après les ch iffres su ivants
,qu i exprimen t les du rées nor
males en cen t ièmes de seconde,pou r 5 tracés
Pas 3 7 3 7
Pas r = 40 3 4 4 1 3 6
pa ssion 1 7 1 7 1 6
Mon a de passion , que j e veux faire grave , est don c bref, en dehors
des cas où i l recevra it l ’accent orato ire . Et c’est ce qu ’ i l importe
de noter dans un d ict ionnai re . Dans abdica tion (mot assez long) ,mon a a été encore plus court ( 1 Pour ce qu i est du timbre
réel , l a question est moins a isée . Je ne m’y arrêtera i pas ici , car
j e n e puis l a séparer d ’une étude généra le . Mais, comme une
modifi cation dans la quant i té peti t. très b ien en traîner une légère
LA PRONONCIATION FRANÇA I SE 26 5
at ion de t imbre, i l ne m’en coûte pas de penser que les
us notées par M . Koschwi t z n ’aien t que lque réal i t é,tout
en étan t,à ce que j e cro is , fort exagérées .
3° L
’
i de -a tion. Nous avons déj à vu,qu ’ i l éta i t l ong pou r
Meig ret . En général , - ion et ions son t d issy l l abes, excepté auxim parf. , condit . et sub j . des v erbes (Lanoue , Dé j à
,Du
Val admet la d iph tongue dan s l es noms pion- nier,cham—pion (Th .
I,
Mais Chifii et ( 1 5 6 9) maint ien t la règle io,
'
dit- il,efi
d iph tongue aux Verbes Ai l leurs i l ne l ’eft pas comme,
lion,les paflions , 81e. (Ed . de 1 69 1 , p . De l a Touche
( 1 5 9 6) aj oute cette restrict ion en profe on prononce tou j ours
comme fi ce n’
étai t qu ’ une fy labe (p . Billecoq ( 1 7 1 1)précise on ne fa it pas trop fonner l ’ i dans la converfationmais en lifant des vers
,l ’ i l ’ o fe prononcen t diftinc tement
(p . Restaur est encore plu s expl ici te ion ne fai t qu ’une
syl labe dans le d iscours fam i l ier,mais i l doi t néœ ffairement
en former deux dans la poéfie dans le difcours fontenu ( 17 3 2 ,p . De Wai l ly n
’
oppose p lus que les vers e t la prose ( 1 76 5 ,p . Et dans ce cas
,Féraud remarque que ti est extrême
ment bref (Tom . II , aver tis . ) Même en p rose,Domergue
(an V) figure dans ses tran script ion s phonét iques - ion par unevoyel le (p . 3 5 6) et reprodu i t la règl e de Chifflet (p .
Les t ra i tés de versification e t les dic t10nnarres conti nuen t à fai reion de deux sy l l abes . Pau l Passy écri t tou j ours avec un 3 1 . Les
lecteurs de M . Koschv v it z on t fa it l a même réduction dans la
prose,y compris Got . Mai s ce dern ier aura it réci té yô (inven
t ion) et iô (vision , action) dans les vers . Parmi les poètes , Born ie r e t Su l ly Prudhomme on t lu
,l ’un si lâ sioé. l
’
au tre répudiyé :
pour eux,l a conservat ion de la voyel l e ( io) dans la lecture poétique
n ’est donc pas douteuse . Actuel lemen t un auteu r de la Comédie
F rança ise apporte un soin marqué à prononcer l’
i au l i eu de y .
Quoi qu’ i l en so i t
,iô
‘
n ’est plus à Par is qu ’un archmsm e de lettré ,qu i nous coûte un cer ta i n effort
,quand i l n ’est pas un prov i n
Revue de phonétique.
I 7
2 66 L ’ABBE ROU SSELOT
c ialism e. A cet égard , j e pu is signaler un viei l a rch i tecte , né àS t rasbourg , élevé à Nan cy et établ i à Paris depuis p lus de quaran teans : i l a effacé tous les tra i ts d ia l ectaux de son frança is
,sau f celu i
ci,
— ci -si— ô.
I l y aura it donc i n térêt à feui l lete r l’Atlas ling . de la F rance.
L’
enquête d i recte manque ; m a is on peu t juger par analogie . L’
i
est conservé dans quelques l ocal i tés du Nord Belgique (viandemend ian t) , Ardennes , Meuse (mend ian t) ; dans la région lyonnaise
,Jura
, Suisse , Rhône , Isère , D rôme , Ardèch e et plus auSud (mend ian t) , Rhône , Loi re , Saône-et-Loi re
,Ain
, Suisse
(scieu r de long) ; dans le Sud-Est (scorpion) . Cet i est noté
moyen bref ou l ong,ou b ien fermé long dans le Nord (mend iant) ;
fermé bref, tan tôt atone , tan tôt ton ique , ou su iv i d’un y dans l a
région lyonna ise et le Sud (mend iant , sc ieu r, scorpion) .
4°sy , y , en généra l les consonnes lingua les , les g roupes avec y ,
et les consonnes moui llées . J’
a i pour étudier ces d iverses articulat ions
,des faci l i tés que sans doute on ne m ’
env iera pas , mais
dont j e profi te avec pla is ir . G râce à deux pet i tes fenê t res quej ’ouvre à volonté
,j e voi s très b ien les mouvements de l a langue
qu i,à l ’état normal
,son t cachés en haut et en bas par la barrière
des den ts . Comme d ’o rdinai re ces fen êtres son t fe rmées , j e n’
a i
pas à craindre qu ’el l es a ien t mod ifié les arti cul ation s,et j e pu is
m’
observer en toute sécuri té . Puisque l ’occasion s ’en présente , j e
vais étud ie r tous les cas pour lesquels j e puis trouver en moimême une solu t ion le 3
1
,les consonnes dures , c , j , 5
,t, d ,
u,leu r combinaison avec 3 1 et les mou i l lées y , l es seules que j e
possède . Aux i nd icat ion s su r les mouvements d e la langue j’
ajou
tera i quelques précisions concernan t I° l
’
écar tem ent des
m âchoi res considéré au n iveau des den ts de devan t, qu i à l
’état
de repos s ’
ajustent à peu près ; 2° l a l im ite
,en avant
,du poin t
d ’articu lat ion déterm iné,d ’après le t ranchan t de la den t du
mil ieu,au moyen de bandes de papie r bleu de tournesol 3
° enfin
l ’ouverture des lèvres,et , quand i l y a l ieu , l eur proj ect ion en
2 68 L ’ABBE ROUSSELOT
r de la pointe de la langue. Poin t d’
articulat ion , Les
bords de la langue s ’ appu ien t de chaque côté le l ong des dentssupérieures ; et l a poin te red ressée reste l ibre . Ouverture deslèvres
, 5 3mm sur
l . Poin t d ’articulation,8mm des den ts . La poin te de la
langue s ’appuie con tre le palai s ; et l es côtés , se relâchant , netouchen t pas l e palais au n iveau des grosses molaires . Ouverturedes lèvres
, 5 3"‘m sur 10 .
t,d et n. Le poin t d ’articulation atte in t les den ts . A ma
g rande surprise ,j e m ’aperçois que j e porte la po in te de ma
langue en bas pou r le t, en hau t pour d et n . I l m ’ arrive aussi
d’
art icu ler le t derriè re les dents supérieures . La langu e dans l es
deux cas,app l ique l a face supérieure de sa poin te con tre l e pal a is .
Ouverture des lèvres , su r 10 .
k, g . Poin t d ’art iculation, 4 pour le lc
, 40 pour le g .
Pendan t q ue la racin e S’
é ève l a pointe se rou le en bas e t s ’appl iqueplus ou moins fortement su r le p l an ch er de la bouche à 10mm pourle,à 8 pour g ,
de l a face i n terne des dents .
D ’une façon générale , l’ art iculat i on s
’
affa iblit de l a forte à l a
douce .
Consonne y . Q uand on passe lentement d’une consonne à un
y , les deux articu lations son t tou j ours reconnaissables mais j am aisle y n
’est l e mêmequ ’à l ’état isolé . Le mouvement parai t constamment affaib l i du côté de la pointe de la langue . Sauf ap rès t
,on la
voi t s ’
avancer vers les den ts,mais d ’un mouvement modéré : pour
ey , par exem p le, el le s ’arrête à 2 mm . el le touche légèremen t
pour les aut res g roupes . La partie dorsa le s ’élève d ’une fa ç on
variée,p lus dans ey que dans sy et dans celu i— c i p lus que dans les
autres groupes (ty , dy , ny , ly , ry) , le bord de la poin te ne depassan t pas pour ces dern iers le tranchan t des den ts
,bien loin d ’at
te indre le p lancher de l a bouche .
J ’ai étudié spécialement sy que j’ai com paré à si
,en même temp s
que j e comparais y et j , y et moui llée. Je me suis servi a cet
LA PRONONC IAT ION FRANÇA ISE 269
effet de mes pe t i tes ampoules et j ’a i exp loré le bord antérieur etle mi l ieu du palais . Les mots qu i ont été in scri ts sont pà sô
passon s (fig . 42 et 43 , 1 ) , pàriô (fig . et pâ syä passions
(fig . 42 et 43 , abelaj e t aheyaj abei llage (fig . 4 5 etLe rapprochement des tracés permet p l usieurs constatations
An I, | 7
F IG . 42 .
Com para ison de s et sy .
M o uvem ents de la l angue (L) derr ière les dents .
in téressan tes 1° En avan t (fig . en arr1ere (fig . la
langue se soulève pour le y au -dessus de la position de l’
s, ce
qu ’e l le ne fa it pas pour l’i dans pàsiô (fig . 44) cel ui—c i demande
une élévation de la poin te derr ière les dents ( 1 ) tandis que le doss ’aba isse sous le mil i eu du pa lai s 2
° Mesurés de l’ im plos ion à l ’exp los ion
,l es deux m ouvemen ts du g roupe sy n
’
ex igent
pas p lus de temps que ce lui de l’s i so lée (fig . 42 et 3° Le
y est très court dans sy depuis l ’ apparition des vibration s jusqu’
àla posit ion de 5
,i l n ’a guère duré que 6 centièmes de seconde, la
270 L ’ABB '
E ROU SSELOT
moine du son transi to i re de s a 5 dans pà sô ; l a voyel le , au contra ire
,est très longue
,1 6 ou 1 7 cs . (fig . cec i ‘ exp l ique trè s
b ien comment l’ i de a tion étai t long au moment de l ’emp runt,
et comment en s’
abrégeant i l est passé à )1 . 4° Sous le mil ieu
du pa la is , l a l angue s ’élève p lus pour sy que pour le s imp l e
Ag rt
FIG . 4 3 .
Com paraison de s et sy .
Mouvem ents de la l angue (L) sous le m i l ieu du pal a is .
’
comparez (fig . 43 et 4 5 , abeyaj) ; et , de fai t , l e 41 ne com
mence pas au poin t culminant de l ’articu lation mais après uncomm encement de détente (fig . 42 et 43 ) comp . avec le passage
de s à i (fig . 44, 5° Nous avons donc ap rès l’s , qui est ré
du ite à l a seu le tension,et à une faibl e tenue
,l a tension d ’un
autre son qui est produ it dans un canal p lus étroit e t qu i se continue j usqu’au y . 6° Ce son de passage
,qu i t ien t d ’un côté à
l’
s,de l ’autre au y ,
se confond dan s notre appréc iat ion avec s
to L ’ABBE ROU SSELOT
FIG . 4 5 .
F IG, 46 .
Com paraison de y et j final
1, (ah]elaj . 2Î[abJeyaj .
Mouvem ents de la l angue (L) p r i s so us le m i l ieu du pa l a i s .
Ag r‘
LA PRONONC IAT ION FRANÇA I SE 27 3
Ma is l e y est- i l dans l a réa l i té en partie sourd ? Les tracésseul s peuven t nous renseigner . Considérons d ’abord le groupesi (fig . En avan t ( 1) , l a l angue cont inue pour l
’
i son mouve
men t ascensionnel sans qu’
i l y ai t d ’arrêt sensible entre le maximum de tension de l a consonne e t le c ommencemen t de la
voyel le . En arriè re la langue a besoin de s’
abaisser pour l’i,
et i l y a une dé ten te sen si bl e . Ce— temps,on n ’en peut douter
,
appart ien t à l’s . JeraiS011nerais de même pour pàsô, tracé pris enarrière (fig . 4 3 ) et en avan t (fig . 42) l e s ifflement sourd se continue depu is l e maximum de tension j usqu ’à l ’appari t ion desvibrati ons du la rynx . Q ue se passe- t- i l dan s pàsyô ? Le temps
écou lé entre l e maximum de tension de l’s e t les prem ieres v ibra
t ions laryngiennes est aux deux n iveaux environ moitié p luscourt pour sy que pour s : 1 cs , 7 5 con tre (fig .
con tre 7 (fig . La v oyel le ô,exigean t l e recu l de la langue
,
est p lus lo in de l a posit ion de l’s que ne son t i et y . Entre lesdeux durées de sy ( I , 7 5 et 3 , l e tracé de si nous permet de
choisi r cel l e qu i répond à la force acrive qu i a produ it le sonc ’est l a première . O r ce cen tième trois quarts de seconde ne peutê tre attri bué qu ’au bruit consonnantique p réparé . par l a tension
précédente , c’est-à-d i re auy , qu i , privé des vibration s laryng iennes ,
ne se t rouve ê tre qu ’un 5 . Mais est—ce tout Ce rf n’
aurait- il pascommen cé p lus tôt ? J e
_
l e crois . La langue,préparant sa déten te ,
a dépassé le point de tension . Le vra i début m e paraî t situé enavan t sur l e tracé en un poin t correspondant à l ’exp losion , soi t a1 cs . 5 ; ce qu i porte la part ie sourde du y à 3 , 2 . C ’ est fort
peu . Et pra tiquemen t,i l faùt considérer le y comme entièrement
sonore,s i l ’on veut év i ter la p rononciat ion dure des gens du N ord .
Je rem ets à une occasion plus favorable la délim itat ion‘
r igou
reuse du y du côté de la voyel l e .
Lomsonnes mou i llées nl .A la différence de ny ly , qui exigen t
deux mouvements art icu latoi res successifs,la pointe de la langue
se portan t d ’abord en haut,puis en bas, y n
’
en demandent
274 L ’ABBE ROU SSELOT
qu ’un,l a pointe de la langue se p laç an t dès le début en bas . O n
peut souten i r l a consonne mouil l ée ; on ne peut pas souten ir legroupe .
n. Po in t d ’articulat ion de 4 a 8 m n Les bords de lalangue s ’app l iquent tout autour des arcades dentaires . Ouve rturedes lèvres
, 5 3 mm . sur 1 0 .
— Point d ’art iculat ion de 6 à 1 1 mm . La poin te de la langue
est fixée . Les bords sont l ibres de chaque côté . On les voi t t remblotte r pendant l ’art i culation soutenue . Ouverture des lèvresmm . sur 10 .
F IG . 47 .
L,moui llée : I
,angoum o isine. 2
,espagno le. basque.
N°2 . Com parez l ’l m o u i l lée cata lane
,p . 66 .
N °
3 l m ou i l lée dans ivili ( I ) . La var iante (2) a p rodu i t à l ‘orei l le l ’effet deCom pa rez H . PERN OT , l nétiq . des par lers de Chin, p . 3 36
—
3 3 8 .
I l ne suffi t pas, pour l
’
l, de dél imite r l a région d’
ar ticu lat ion en
avant . C ’est en arrière que se remarquen t les p lus grandes d ifférenees . Q uelques— unes ont été pub l iées dans les Pr incipes (p . 6 1
Je pourra is en a j outer d’ au tres . Q u
’ i l me suffise de rep rodu i re,
avec l e tracé de mon pala i s,deux exemples nouveaux l ’un de
M . de H oyos né à Rainosa (Vi ei l le Cast i l le), et l’autre de M . l ’abbé
de Vi vié , basque , né à Sain t-Pala is (Basses—Py rénées) , (fig .
parce que j e viens de comparer atten t ivement l ’arti culat ionavec l ’ effet acoust ique. Pour moi
,tou t l e cen tre du palais
est touché par le dos de la l angu e ; pour les deux autres , la par
276 L ’ABBE ROU SSELOT
par un son l iqu ide que nos ancestres appelo ient mignard
(Maupas, chez Th . II , p . ou par un fou gras,que d ’autres
appel len t l iqu ide ; d’autres m oüillé (Chifflet, 1 6 5 9 , p . 2 66) .
L ’abbé de Dangeau fixa le nom et proposa,comme signe
,l es
deux Il (seeond disc .
,p . S i l ’on avait su iv i son consei l
,des
erreurs de lecture aura ient été évi tées . Ain si , parexemple , S ully ,
qu i ava i t nue l moui l lée , n’ est p lus compris par Lemare ( 1 8 1 9 )
contre toutes les analogies,d i t— i l , ll est moui l l ée dans Sutly
Et dans le G i raud—Duvivier de 1 848 , une note averti t que Su llyne doit pas prendre l e son mou i l l é , malgré l
’opin ion con trai re
de quelques grammairien s
I l semblera it,d ’après l es descri ptions sommai res des g ramm ai
rien s,que l’ l moui l lée se présen tai t sous deux formes ou à deux
étapes d ifférentes .
Les plus an cien s témoignages fon t cro i re qu ’on y sentai t de
l’
i (Palsgrave 1 5 30 , Bovel les 1 5 3 5 , H . Esti en ne 1 5 82 ,de Beze
1 5 84 ,Garn ier 1 607 ; i l faut fa i re un peu fentir l ’ i d i t Billecoq ,
un siècle p lus tard (Rég les de la pron . 17 1 1 , p . Cette pro
nonc iation,condamnée parWa i lly (mélienr , ta lieur) dans sa gram
maire (1769 , p . 404) est fortement appuyée par Beauzee ( 17 67)Dans l es m o tsfeui llago, Ceux qui parlen t l e m ieux
ne font en tendre :‘
t mon orei l le que l ’ art iculat ion ord inai re l,
fu iv ie des d iph tongues iage, Dans les mots pa i lle,
on y en ten d aifém ent un e d iphtongue pronon cée pa lieu,
(Gramm ,gén .
,p . 8 5 Peut— être de la Touche avai t
i l en vue le même son quand i l d isa i t ( 1 69 6) que l’
l moui l lée se
forme en approchan t l a langue des dents (L’
Ar t debien par ler,
P 1 7)L
’
l moui l lée , tel le que j e l’
art icu le,a été décri te par Sa in t—Liens,
dès 1 5 80 : el l e n e se p rononce pas,dit— i l
,par le bou t de la
langue,mais en touchant l e pa l ais vers l e m i l i eu de la langue .
Maupas ( 1 62 5 ) reprodu i t la même descrip tion . H indret ( 1 687)aj ou te un t rait importan t au l ieu de se redresser par le bout
LA PRONONCIAT ION FRANÇA ISE 277
vers le pala is , el le (la langue) se recourbe vers les den ts d’en bas
et s’
élargit par le bout e t vers le m il ieu Et Roche ( 1777) com
plète la défin it ion en disan t que l ’ ne forme qu ’une
seule art i culation » , tandis que dans li on fai t en tend re d ist in ctement l’ l et l’ i (Thurot , I I, 29 3 Domergue est du même
sentimen t : l es son s mouil l és,di t— il
,se prononcen t sans i
(P 442)Mais l’ l moui l lée n ’
exi sta i t dé j à plus dans la pet ite bourgeois iede Paris où , su ivan t H indret on trouve beaucoup de
en . qui . . d isen t ba tavon, postiyon , bouta iye, bouyou (Th . II,
29 8) Le ch angemen t de l’l moui l lée en y était donc dé j à ancien .
U
D
A quel le époque pourrait— i l remonter I l est d iffi ci le de le d ire .
Deux mots cités par Thu ro t, g raye (I , 3 29) et tava iole (I , 3 4)
nous reporteraien t le premie1 a 1 5 72 , l e second‘a 1 6 3 3 . Ma i s que
prouven t— i l s ? L ’un est d ialecta l l ’autre i ta l ien . Et l ’on ignore
quel le prononciat ion i l s représen tent . Les Mazarinades sont desdocuments p lus sûrs . Sans doute
,el les attendent pour être m ises
en valeur une étude sérieuse des parlers de la ban l ieue parisienne ;mais e l les suffi sen t pour nous apprendre que l ’] moui l lée éta itremplacée par y au moin s dan s certains mots et par certa inespersonnes à Sain t-Ouen et à Montmorency
,tandis qu ’el le serai t
conservée à Pant in et à Sain t—Germain . Sans accorder un e
orthographe évidemment fan taisiste une rigueur qu ’el le n’
a pas ,i l me paraît bon de noter : que
,sauf erreur, nous comptons 3
mots avec y contre 5 9 avec l moui l lée ; que taye, tayon,layer ,
ba taye, voyant son t constamment écrits avec y ; que baye, buyer
figuren t 1 0 fois sur 14 que,dans une expression trivia le , nous
l isons paye et payard que,a côté de voulaye, aye, trava ie, crayon,
bouion,deponie, Argenteuye, veuye (vei l le) , g r iade, habiyé, nous
avons mura i lle, a i lle, pia illa it, pa troui llan, gasoui lle, Arg enteui l,ou; ei lle ou orei lle (toutes les fois) r évei llera is etc
'. Je ne voudrais
Je c ite d’
aprés l’
éd it ion desD ix conférences enpatois , donnée par M. Rosset ,
5 80 L’
ABBÊ ROÜ'
SSÊLÔ T
pas ins ister su r ces rapp rochements q u i pourra ien t ê tre fortu i ts ,mais je su is tenté , je l
’
avoue, d’
y vo i r les ind ices du débu t d’
une
évo lu t ion phonétique, caractérisé par ce fai t que le son ancienn
’
est pas enco re devenu i mprononçable et que le nouveau n’
es t
pas exclus if, le premier appartenan t à la pleine conscience et
servant ponr un parler énergique, le second plus i nst incti f réservéau langage famil ier qu i s
’
abandonne. je ne serai s pas étonné non
plus que l’évo lu tion fut part ie de la Cité pou r se propager p lus
d u mo ins rapidemen t dans toutes les di rections que, dans Paris
même, el le eût en des fo yers d
’élection , sais issant les famil les
les plus anciennes , avan t de gagner les nouveaux venus . C ’
estce que j
’
a i observé pour l ’évo lu t ion de l ’! mou i l lée vers y dan s la
val l ée du Son et a i l leurs .
Aprés H indret, Le Paris ien Bo ind in ( 1 709) signale, sans le
blâmer , le reproche qu’
on fai t au peuple de Paris de subst i tuermal à propos le y aux deux ll mou i l l ées , en prononçan t non
chalamant Versa yes, de la Pou r De Longue ( 1 7 2 3 ) cette
dialecte decouvre, dans les compagnies , la basse bourgeo is ie et
les personnes sans éducation Restant de Beauvais , s’ i nd igne
Rien n’
eft p lus défag réable que cette prononciat ion
i l paroît pas que l’
on ait beaucoup d’
attent ion à rom
pre de bonne heu re dans les enfants,une hab i tude dont i ls ont
honte, quand ils en trent dans le monde, dont i l eft rare qu’ i ls
le défaffent aifém ent (2° éd .
,p . Au con tra i re, Bou liette
( 1 760) trouve le y beaucoup plu s doux (Sons du F r .
, p .
60) et attribue cette prononciat ion su rtou t aux femmes mo l les
et dél icates (Th .
,II
,I l est aifé d ’
obferver,d it Duc los , que
les enfans cens don t la prononciat ion eft fo i b le l âche,difent
pa ie (Gram . gén .,1 768 , p . De Vai l ly condamne les deux
prononciat ions par y et par ly : c’
eft m al prononcer, dit — i l, l’
l
mou i l lée quede prononcer mei lleur , ta i lleur , Ver/ a i lles,feui llet , (Tccomme s
’ i l y ava i t méli eur,la lieur
,Verfare, feuïet ; ou comme
s’
i l y avai t méyeur , taïeur , feuïet (Pr inc . gén . et partie. de la
Lang . Fr . , 3° éd .
,1766 , p .
LA PRONONCIAT ION FRANÇA ISE 28 1
Féraud , lui auss i , dénonce la prononciat ion avec y comme trèsvicieuse et renvo ieau g li i tal ien ( 176 1 et 1787 L) . Son compatrioteDomergue conserve aussi
'
l’
l mou i l lée. Roland ( 1 8 1 2) répèteà chaque arti c le mou i l lez les Il G i raud—Duvivier ( 1827) condamne ly et y . Enfin Littré , pou r clore la série, d i t A Paris
,
on prononce souvent comme un y : bou- te—
ye, a-
yeur ; partou t jepréviens con t re cette prononciation vicieuse (p . mx) . Mais, ou
sa recommandat ion a été va ine, ou el le a fa i t adopter par deslecteu rs t rop doci les un ly . N u l ne peu t , sans l ’entendre
,s ’ ima
giner le vra i son de l’ l mou i l lée.
Le premier au teu r de dict ionnai re qu i accepte franchement le
y, c’
est,am a connai ssance
,Napo l éon Landais
On a imerai t à connaitre ce q ui reste encore du domaine deWmou i l lée ; et natu rel lement on se tou rne du côté de l’Atlas lin
guistique. C ’
es t ce que j’
a i fa i t . J’
ai cho is i 26 mots suscept ibles
de con ten ir une l moui llée sans ê tre exposés à des i nfluences analogiques, et je les ai réun is sur une seu le carte (fig . Des
signes spéc iaux ind iqnent le nombre des mo ts recuei l l is avec une
et des ch iffres,le nom des loca l ités et les mo ts . Sans dou te,
plus ieu rs de ces mo ts manquen t dans certaines régions, et i l ne
suffi rai t pas de compter ceux qu i se rencont rent en un l ieu pou r
juger de la vi tal i té de l’ l mou i l l ée. Mai s dans l’
ensemble la carte
donne une imageassez exactedu phénomène. L’
l mou i l lée paraî t
encore so l i de dans une po rt ion de la Meuse, dans le Nord , princ ipalement dans le Pas—de—Calais et la Somme
, dans le Co tentin ,
en Vendée,sur le versant nord du Plateau Central , au nord de la
Lo i re, du Rhône, aux environs de Mâcon,
au sud du Jura et en
Su isse. Ma i s la rareté des exemples recuei l l is dans la plus grande
part ie de la Meuse, en Belgique, en Normand ie, en Bretagne, dansla Vienne, la Charen te—Inférieu re, prouvé que dans ces pays
l ’évo lu t ion est dé j à à un degré avancé . C’
est tou t ce que l’
on peu tdemander d ’
une enquête fo rcémen t sommai re ; et i l y a l ieu de
savo i r gré aux va i l lants au teu rs de l’
Atlas et à leu r cou rageuxRevue de phonétique.
1 8
2 82 L’
ABBÈ ROU SSELOT
éditeu r de cet te vue générale qu i complète si heu reusement nosenqu êtes particu l ières . Pou r montrer comment s
’
accom plit le
passage de l’
l mou i llée à y , je pou rrais résumer l ’étude publ iéedans m es Modif . ph. du lang . (p . 200 et mais j ’a ime
mieux recouri r à une explorat ion plu s récente qu i confi rme la
première. Dans les Côtes-du -No rd,les choses se sont passées
comme dans la Charente . L’
l mou i l l ée est en train de d isparaî tre à
Pord ic . Vo i ci dans quel les cond i t ions j’
ai pu étud ier le fai t . Je
passai en 189 5 une so i rée dans la famil le d’
un de m es amis
M . l ’abbé Al lain . I l y avai t là la grand ’mere,le fi l s aîné Fran
co is (46 ans) et sa femme,la fi l le Franço ise (4 1 ans), le
jeune fi l s,mon am i (environ 3 5 ans) , les pet its—enfants ( 1 8 . 1 6
et 1 3 ans) . L’
lmoui llée n’
existe plus pou r les jeunes (t)e viei l le »,
veyes viei l lesse trâoàyô travai l lons el le est vivante encore
chez la g rand’
m ère, le fi ls et la bru (vel, oder , lrâoàjô) ; dans la
langue cou rante, el le est atteinte pour la fi l le et n’
ex iste plus pou rle jeune fi l s , b ien qu
’ i ls so ient capables de la prononcer (lrâoàlâ)Mais tous
, y com pris la g rand’
rnère d isent Irâvàye trava i l lez » .
J’
a i observé plu s a ttent ivemen t Franço is,sa sœu r et son frère.
J’
a i su rpris Franço is auss i d isan t trâvàya‘
z—r à côté de !râvàla
‘
er et
trâoàl«z i , mais i l a d it cons tamment orel o rei l le Son frère, lu i ,
d isai t orey . Quant à sa soeu r,su r cinq fo is qu ’
el le a prononcé le
m o t,el le a d i t orel t ro is fo is et orey deux fo is . C
’
est donc el le qu i
date le triomphe de ’ évo lu t ion,et la fixe à l ’année 18 5 4 pour la
famil le. Po rd i c ne figu re pas su r la cartedeM . G illiéron ; la loca
l i té la plu s vo is ine est Plouvara où l’ l mou i l l ée n ’
a été en tendue
que dans boutei lle ; c’
est à peu près la même date et la même
é tape que pou r M . l ’abbé Al lain .
J ’
au rais enco re à ment ionner quelques local i tés qu i nese trou
vent pas dans l’
Atlas et qu i sont intéressantes par leur pos i t ion
au nord de la Vienne, au sud de l’
Indre-et— Lo i re et dans l’
Indre.
Je les marque d’
une“
cro ix su r m a carte.
U n po int importan t et pou r lequel je su is en désacco rd avec
284 L’
ABBÉ ROUSSELOT
n,n°
7) nous avert it q ue l’
n se détache de l’
e qu i précède et
qu’
ou prononce comme s’
i l y avai t à la fin un e
ame—ne qu ’ i l fau t prononcer fort vi te (Diet . g ramm .,
L’
e
muet sent i par Ferand , je l’
ai art icu l é à m on insu (fig . I l semblerait donc q u
’
à la fo rme amä n,antérieu re au xv 1° srecle
,ait suc
cédé amên q ui aurai t about i à amê par chu te de la nasa le (fo rme
rejetée) et à amen par réact ion savante, forme au jou rd ’ hu i courante. O n comprendrai t de la so rte les hés itations de l
’
u sage
(Th . II, 47 3 et passim ,
l iv . VI) .
Des mots de cette série,un est devenu tou t a fai t français , exa
men, que des étrangers seu ls prononcent encore exame
‘
n ; un au t re
l ’est devenu à mo i t ié,hymen, qu i reço i t les deux prononciat ions
i—mén’
; selon qqns , i—min (Diet . Jesu i s parmi les quelques
uns,a i n s i que les poètes .
4° F ina les —
geet-e. La sy l labe -
gefi na le d’
un m ot (abeillage) perd
o rd ina i rement son c muet , et le 7°
devient en part ie sou rd (fig .
Mais cela ne l ’empêche pas de paraî tre en tièrement -sono re à l’
o
rei lle. On ne l ’en tend sou rd que dans la bouche des Français du
Nord , des Belges et de certains étrangers qu i redou ten t de fai re
en tendre un ce final . Le mei l leu r moyen de se co rriger est juste
men t pour eux de res t ituer cet ce, qu i d isparaî tra de lui-même
dans une prononciat ion rapideet qu i , du reste, nous déplaî t mo ins
qu ’
un e . La sonori té du j final est variab le, mo indre dans le
premier exemple que dans le second el le ne dépasse pas le po in tcu lminant de la pression o rgan ique. La seconde part ie de l ’ar
t icu lation est sou rde,mais douce ; ce qu i l
’
empêche de donner
l ’ impression du
Dans une prononc iat ion énergique ou dans un d iscours des
t ineà un grand aud i to i re, on entend souvent quelque chose comme
un .e dans les mo ts terminés par une consonne su ivie de la voyel le
muette ou même sans cet te voyel le. Jusqu ’ i c i i l m ’
a été diffi c i le
en dehors des procédés graphiques de d ist inguer l ’explosion fo rte
de la consonne et d’
un ce final : l ’o rei l le’
s’
y trompe. Les obser
LA PRONONC IAT ION FRANÇA ISE 28 5
vations q ue j’
ai fai tes plus haut (n°
3 ) m’
ont permis de levercette difli culté . L
’
æ fi na l correspond à la posi t ion de repos queprend la langue après l ’explos ion . Aussi la d ifférence
,de ce côté
est—el le peu sensible. I l y en a unecependan t la langue se remise
(que l’
on m e passe cet te expression) mo l lemen t après l’
explosion,
tand is qu’
el le se ma in t ien t ferme pou r l ’émiss ion de l’æ . Mais les
lèvres donnent des i nd icat ions précises et faci les à observer el les
garden t pou r l’
explos ion la pos i t ion normale de la consonne,et
prennent pou r l’
æ cel le qu i convient à cette voyel le et qu i est
t rès caractérist ique. On peu t donc faci lement d istinguer, par
exemple, as on at, avec une explosion forte, de nsw,a tæ .
L’
abbé ROU SSELOT .
(à suivre)
TABLEAU SOMMAIRE DES SON S FRAN ÇAIS
VOYELLES
Les voyel les sont pa rcs ou nasa les . Les voyel les pures sont
prod u i tes par un cou rant d’
a i r passan t par la bouche seu lement ;les voyel les nasa les, par un cou ran t d ’
a i r passant a,la fo is par la
bouche et par le nez .
Exemples a,o (pu res) ; an,
on (nasales) .
O n peu t juger de la d ifférence en recevant l ’a i r sur un miro i r .Les voyel les sont toniques ou a tones .
La voyel le ton ique d’
un m ot est cel le qu i reço i t l’
effort de lavo ix . C ’
est la dern ière voyel le sans compter l’
e muet fi nal .
Exemple véri table,véritablement (à ) .
Les voyel les qu i ne sont pas toniques sont atones .
Exemple dans vér itable,les atones son t e i e et dans
fol lement,ce son t e
'
,i, a ,
e.
VOYELLE a TON IQUE
a MOYEN
La langue est étendue su r le plancher de la bouche et touche
les dents . Les l èvres son t ouvertes san s effort .
1°a su iv i de deux ou seu lement d ’
une consonne finale pro
noncée. (L’
e muet ne compte pas)tact
,acte
,axe
,rapt
,apte
,asthme
,casque, calme, calque, valse,
hal te,barbe
,arc
,farce
,marche, charge, épargne, arme
, lucarne,carpe
,carte.
lac , sac,chaque
,cénac le
,… orac le
,obstacle
,spectacle, fiacre,
chatte,cravate, nappe, i l frappe.
carafe,agrafe, face, audace
,glace
,vivace
,embrasse, chasse,
crasse,qu ’ i l fasse, pai l lasse, cu i rasse, hache, tache, i l crache.
288 MARGUER ITE DE SA INT-GEN È S
âge, Havre, cadavre, i l navre.
bâ t,appât
,dégât
,mât .
chocolat (mot t i ré de l ’espagno l), fa, la (no tes de mus ique) ,bêta .
2°a s prononcée, a se ou {e hélas base
,i l embrase
,case
,
n jase,i l écrase
,rase
,envase
,la vase
,phrase
, gaz , la gaze.
3°a s muet te (c
’
es t la règle généra le) bas,cas
,fracas , glas,
verg las, las, coutelas, l i las , amas , Damas , ananas , cadenas , cabas ,
pas , appas , compas, repas, haras, t répas , ras,tas
,fatras , plâtras,
canevas .
4°a + i lle (c
’
es t la règle générale) i l bai l le,i l bâi l le
,i l brai l le
i l se débra i l le, qu inca i lle, racai l le, rocai l le,fiançai l les
,accordai l les ,
mangea i l le, i l c riai l le, i l p iai l le, vo lai l le. mai l le,i l chamai l le
,
l ima i l le,marm a i l le
,mai l le
,i l rima i l le
,pai l le
,ouaille
,i l m i l le
,
broussai l les,cisai l les
,tai l le
,batai l le
,ent rai l les
,victua i l les .
à CHANTANT
Langue l égèrement po rtée en avant . Co ins des lèvres reti rés en
arrière.
1°a r car
,char , par , brancar(d) , je par(s) , ar(t), i l par(t) ,
qua r(t) , barbare, déclare, fanfare.
2°a + v
, g ,peu t avo i r ce t imbre cave
,cage.
D iphtongue oz .
1°avec a moyen (wa) quo ique, i l bo i te dro i te, bo î te, clo î tre,
accro î tre.
so if,co iffe
,i l d éco iffe
,ango isse
,paro i sse
,i l fro isse
,qu ’ i l
cro isse.
po i l,vo i le, to i le, moel le, poêle, fro ide, qu
’ i l jo igne, élo igne,témo igne, avo ine, mo ine, chano ine.
qu ’ i l bo ive, do ive, reço ive, po ivre.
tu vo is , tu bo is,aux abo i s, j
’
aperço is, je cro i s, tu do i s , fo is ,
sou s FRANÇA IS 289
parfo is , albigeo i s , bourgeo is, vi l lageo i s, Gau lo is , Champeno is ,Bavaro is, Arto is , Louvo i s, carquo is, vo ix , cro ix, cho ix , les détro i ts,do igts
,endro i ts, to i ts , explo i ts .
. coi , fo i , do i(gt), lo i , tou rno i , emplo i, abo i
, effro i,beffro i ,
émo i , ro i, désarro i , paro i , octro i
,convo i
,fro i(d) , i l do i(t), i l
bo i(t) , i l cro î(t) , i l décro î(t ), i l vo i(t) , adro i(t) , to i(t), to i,
m o i .
2°avec a appuy é (roti) bo is
,mo is
,po ids , po is et empo i s
,
tro i s,no ix
,po ix .
3°avec à chan tan t (wa) cho i r
,cou lo i r
,no i r , so i r , bo i re
po i re,cro i re
,mâcho i re.
i l cro ise, no ise, to ise, vil lageo ise, bou rgeo ise, Pon to i se, tur
quo ise, Ambo ise.
ATONE
Compara ison des toniques et des atones
tây (i l tai l le) , tayä blæ (ta i l lable) ; buti ly (batai l le) , batàyô (batai llon) .
pwàvm (po ivre) , piuä vr iye‘
r (po iv rrere) ; bzoazæ (i l bo ise) , bwä z r i
(bo iser ie) ; mwà læ (moel le) , mwä laêzmâ (nroelleusem ent) .
1°a moyen chari té
,chapitre, papier, cha rpie, a rt i l leur, mar
mite,a rtichaud, prudemment (prudamâ ) , so lennel (rolanel) ,
benni r (unir) , nenn i (nani) .
(u a) oi seau ,poisson , poison ,
toison , entrecrois(e)ment , tour
noi(e)m ent , no toi r(e)men t , oratoir(e)m ent,déploi(e)ment .
' 2° a appuyé châ teau
,bâ ton,
pâ ti r,ba ron,
ba ronne,ba ronn ie
,
maçon ,co l ima çon
,maçonner, bazar, ca rrosse, ca ro tte, cassero le,
bra s ier,na t ion
,exp lorat ion, cons idéra t ion ,
obst ina t ion .
acca bler,cadenasser , ta i l leu r , flaner, la cer, lacet, en lacer, enla
cemen t , lassi tude, matelasser , pa i l ler, pa i l lasse, pa i l lasson , ca s
sette,espacer
,fâ cher
,fâ cherie
,fo lâ trer
,pâmo ison , opiniâ tre
ment .
2 90 MARGUER ITE DE SA INT-GEN ÈS
VOYELLE e TON IQUE
MOYEN
La langue s’ é lève en avant et les co ins des l èvres s é cartent
1°e, e, a i , ei+ 2 ou 1 consonnes infect
,insecte
,s i lex
,biceps
,
modeste, leste, quel que, terres tre, ferme, caverne, serpe, verte,tertre
,i l conserve.
bec,sec
,secrète
,planète
,trompette
,i l achète
,tab lette
,dette,
défa i te, i l souhai te, tra ite, pièt re, mètre, met t re,l èpre.
Joseph , chef, bref, trèfle, faiblesse, sagesse,adresse
,messe
,i l
cesse, princesse, comtesse, duchesse, dées s e, con fesse, cesse, flèche.
bel,réel , ciel , appel , tel, bel le,
tel le,el le, a i le, bègue, espiègle,
aigle,seigle
,a igre
,i l cède
,t iède, remède, cèdre, laide, raide,
fa i b le,célèbre
,i l daigne
,i l baigne
,qu ’ i l c raigne
,règne
,saigne,
chienne,Rennes
,i l mène
,balei ne
,peine
,veine
,saine
,i l sème
,
i l aime.
fève, i l achève, i l crève, en lève, chèvre, l i evre, o rfèvre, so lfège,piège
,co l l ège
,neige
,beige
,pèse
,t reize.
2°e+ i l parei l
,so lei l
,o rtei l
,sommei l
,consei l
,parei l le, i l
consei l le,i l sommei l le.
3° Les personnes des fu turs aura i
,chaulera i
,etc .
é APPUYÉ
La langue s’élèveencore et les l èvres s é carten t p lus que pou r e.
1° Les e des fi na les -és,
-e( , et de quelques finales —a is 1° chan
tés,bontés
,vérités
,blés
,vous chantez
,vou s chanteriez , nez
,
je sa i s tu sais,des gea is , gai s .
2°efinal on er a imé
,chanté
,bouché , pressé, aime(r), chan
te(r) , bouche(r) , presse(r), épicie(r) , ho rloge(r) , pommie(r) ,ceris ie(r), etc .
3° ée a imée
,chantée
,bouchée
,assemblée
,tablée, pincée,
n ichée,fumée.
292 MARGUER ITE DE SA INT-GENES
ATONE
Comparaison des atones et des toniqueskét (i l quête) , kËté (quêter) , ke
”
tâer (quêteu r) .
g rêf ( i l greffe) , g rife (greffer), g réfwz‘
z r (greffo i r) .
grÈl ( i l grêle) , g rËlé (grêler) , g rêlô (grêlon) .
pÈe ( i l pêche) , péeé (pêcher) , pêer i (pêcherie) .
e moyen : espérer,flétrir , gélat ine, péri l , a igu i l le
,a imable
,
ba igno i re, avén(e)ment , béga i(e)ment (bég émà ), nous mettons .
é appuy é têtu (têtu) , pêcheu r m es,tes
,ses
,les
,ces
dans la langue commune.
é chantan t fa îtage, fra is ier , fra îcheur , enterrer , en terrement ,erreu r
,err(e)ments , verr(e)rie, mes , tes , ses , les , ces dans la d i ction .
e on é. éta ler,étrennes
,étréc ir (Êtrésir) , érein ter , déjeuner
débander,déco l l(e) ter , défense, déda igneu sement (dédé
no'
egmä ) , œcuménique,œdème
,œsophage.
VOYELLE o TON IQUE
0 M O Y E N
Langue en arr i ere, co ins des l èvres avancés
1°0 2 ou 1 con sonne docte, dogme, adopte, k iosque,
po ste,so lde
,go lfe
,réco l te. po rc , fo rce, ento rse, i l éco rche, co rde,
borgne,corne, po rte
bloc,coq ,
choc , roc , coque, médiocre, dot, i l dote, houe,co tte
,no t re, votre, myope, propre.
étoffe, girofle, coffre, négoce, féroce, roche.
col, bol, mol,obo le
,éco le
,drogue, mode, robe, noble, besogne,
madone,Baby lone, bonne, au to(m)ne, homme, pomme, R ome
,
somme,économe.
i l i nnove,éloge
,horloge, déloge.
2°au dans Pau l
,ho locau ste.
3°um ame : album ,
Opi um,rhum
,pensum .
sous FRAN ÇA IS 29 3
Ô APPUYÉ
Langue p lus en arr iere que pour 0 ; lèvres plus rapprochées et
avancées .
1° 6, au : hôte, cô te, i l ôte, le nôtre
,rauque
,hau te, i l sau te.
drô le, geôle, pô le, tô le, i l rode, dôme, Vendôme, diplôme,
fantôme, Gau le, sau le, i l m iau le, fraude, émeraude, Claude, i l
échaude, anne, baume, chauve, fauve, mauve, i l sauve, pauvregau che, ébauche, i l chevauche, Beauce, sauce, i l exauce, i l
cause,clause, pause.
2°os consonne Cosne
,Vosges .
3°os final
,ose
,osse Lesbos
,close
,chose
,dose. prose, rose, i l
ose, i l pose, fosse, grosse, i l endosse.
4° Les fina les p luriel les -aus
,
—aux,
—eaux ,—ots
étaus, aux , chevaux , signaux , anneaux , fléaux , chevaux , agneaux ,peaux , po ts , gigo ts, gou lo ts , chario ts , id io ts , dévo ts .
5°ot final pot, gigo t , gou lo t , chariot, id iot , dévot .
6° one et onze dans des mo ts empruntés amazone, zone, id iome,hippodrome, axiome, b inome, arome, atome.
ô CHANTANT
Pos i t ion de la langue et des l èvres entre a et 0°
o+ r : or,déco r
,tréso r , i l dore, dép lore, o r(s) , a lor(s)
déco r(s), fo r(t) , mor(t) , por(t) , i l mor(d), fo r(ts), mor(ts) .
Pour plusieu rs, o ve, ge innove, horloge.
ATONE
Compara ison des ton iques et des atones
dbr (i l dore) , doré (dorer) .
o'
mônæ (aumône) , o'
monri (aumônerie) .
kot (côte) , kôtô (co teau) , kétle‘
t (cô telet te) .
2 94 MARGUER ITE DE SA INT-GEN ÈS
o : obéi r , occuper , offri r,oracle, orei l le
,ord inai re
, ortei l,ort ie,
hôpi tal , aurore, auspice, laurier“
,austère
,austra l
,j ’aurai , augm en
tat ion,authentique.
.5 : hôtel,Hôtel-D ieu ,
hôtesse,
odieux, odeu r , ter
m inaison en —otion (émotion , not ion , potion , dévot ion) , ossements ,osei l le
,caut ion , auss i , autan t
,auteur, autographe
, autocrate,hauteu r
,Autriche
,autruche
, je saurai,pauvremen t .
VOYELLE œ TON IQUE
ce M O Y E N
Langue dans la pos i tion de é lèvres dans cel le de l’o
eu,œu 2 ou 1 con sonne i l heurte, meu rtre, peuple, neuf,
veu f, œ uf,boeuf
,aveugle
,fleuve
,neuve, épreu ve, veuve, œuvre,
cou leuvre.
eu,a: (i l, i lle) deu i l , œ i l
,qu ’ i l veu i l le
,feu i l le.
a APPUYÉ
Langue dans la pos i t ion de é ; lèvres dans cel le de o'
1° Les finales pluriel les -eus
,-eux
,—æu(d)s b leus , tu
veux , heureux , affreux , yeux , deux , creux , ceux , œufs,bœ ufs
,
nœuds,feux
,D ieux .
2° case creu se,précieu se, berceuse, brodeuse.
3°eue bleue
,l ieue
,queue.
4°eu
,æu final vœ u ,
nœ u(d) , bleu ,feu
,mil ieu
,pien, jeu ,
D ieu , aveu , cheveu , neveu ,i l p leu(t) , l ieu .
5° meu te
,feu t re
,neu tre.
de CHANTAN T
Langue dans la pos i tion dea ou é ; l èvres dans cel le de à .
eu r : peu r, fleu r , pécheu r, ardeu r, i l p leu re, beurre, fleur(s) ,pécheu r(s) , plus ieu r(s) , ai l leu r(s) heur(t), i l meu r(t) .
Plu sieurs disent de même eu v fleuve, neuve, etc .
29 6 MARGUERITE DE SA INT-GENES
1° i 2 ou 1 consonne i l d icte, Fél ix , énigme
,écl ipse
,
crypte, isthme,l iste, bistre, fi l tre
,i l affirme
,c irque
,my rte.
publ ic , Frédéric, publ ique, art icle,hu i t , d icte, i l habite, i l
réc i te, l itre, épît re, pupitre, hu î tre, pipe, partic ipe, i l ant icipe, i l
d issipe, trip le.
nat if,captif
,narf, vis , écrevisse, sui sse, qu
’ i l v iei l l isse, jus
tice,vice
,service, riche .
i l , fi l,hab i le
,doci le, mil le, vaci l le, t ranqu i l le, d igne, figue,
tigre.
gencive, arch ives, grive, i l en jol ive,
ivre,givre
,l ivre
,su ivre
,
cu ivre,vivre
,t ige
,vertige
,i l co rrige, i l obl ige.
2° i lle: fi l le
,bi l le
,coqu i l le
,scinti l le.
i APPUYÉ
Langue auss i é levée que possib le par la po i n te co ins des
l èvres très écartés .
1° i + r : haïr, subi r
,accouri r
,durci r , é l ixi r, ire
,cire
,i l
déchi re,décrire
,d ire, z éphire, navi re.
2° i 5
,se lis
,j ad is
,m ai s
,gratis
,grise
,mise
,cerise,
sott ise, i l vise, i l improvise.
3° i + s du plur iel : des cris, soucis , sou rci l s , écr its, fru i ts ,
fleu ris,prix , crucifix , riz , bu i s .
4° i + e : fin ie, fleu rie, bouffie, engou rdie
,amie
,l ie, m ie,
man ie,bou langerie
,hor logerie
,épicer ie.
O n donne encore un i mais bref on un i m oyen à :1° i I consonne sono re : acide, perfide, vide, bride, mo rbide.
bribe,scribe
,cible
,él igib le
,fibre
,l ibre
,i l v ibre
,digne, signe,
l igne, vigne, i l assigne, cabine, racine, i l devine, i l dîne, cime,subl ime
,infime
,l ime
,dîme, abîme.
2° i fina l fin i
,fleu ri
,bouffi
,engou rd i , am i .
sous FRANÇA IS 297
ATONE
Compara ison des ton iques et des atones
gr i (gris) , g r iz ciy (grisai l les) .
mænwz'
z ( i l menu ise), mâ nroïz r i (menu iserie) .
i m id i,m i— part ie, d i ligence, d iscrét ion ,
d ivin .
VOYELLE TON IQUE
i l MOYEN
Langue au fond de la bouche lèvres a l longées et rapprochées
1°ou 2 ou I consonne langouste
,sou rce, bourse, fou rche,
lou rde,cou rte.
bou c, i l b route, i l écou te, i l dou te, croûte, voûte, i l goûte,lou tre
,pou tre
,ou tre, soupe, t roupe, coup le.
touffe,i l soufii e
,gouffre, mousse, rousse, i l tousse, douce,
pouce, bou che, souche.
bou le,pou le
,i l cou le
,i l crou le, fougue, coude, coudre,
foudre,poudre
,absoudre, double, c lown,
groom .
louve, i l couve, prouve, t rouve, couvre, gouge, rouge, i l
bouge.
2°ou i l, i lle : fenou i l , hou i l le, il fou i l le.
3°ou fina l cou ,
chou ,c lou ,
écrou,fou , flou , grigou , g lou
g lou ,bi jou ,
fi lon,cai l lou
,chou
,genou ,
hibou, pou , loup—garou ,
son,matou
,t rou
a APPUYÉ
Langue auss i en arr i ere et l èvres au ssi a l longées que pos
s ib le
I°ou+ r : amou r
,labou r
,tambou r, four , tou r, je labou re,
que j’
accoure, je savou re,
bour(g) , cou r(s), alentou r(s),cour(t) , lou r(d), sou r(ds) , cou r(t)s , lou r(d)s .
Revue de phonétique.
298 MARGUER ITE DE SA INT-GENES
2°ou se: blouse, épouse, ventouse, douze.
3°ou s, x : cons , clou s , sous, verrous, genoux , choux ,
doux , j aloux , époux , roux , toux , houx .
4°ou+ e: boue, joue, houe, i l secoue, i l échoue, c lone,
i l
loue.
ATONE
Comparaison des ton iques et des atones
miy (rou i l le) , rüya'
e (rou illeux) .
âgei (i l s’
engoue) , agume‘
i (engouement) .
âmi (i l s’
enroue) , am‘
ima (enrouement) .
riewi (i l dévoue) , dém‘
irrzâ (dévouement) .
u oubl i, ouragan,
ourler , out i l , ouvrier .
et ou a brou i l lard,broui l lon .
VOYELLE Il TON IQUE
I l MOYEN
Langue dans la pos i t ion de é ou i ; l èvres dans cel le de u
u 2 ou 1 consonne : luxe,musc le, buste, juste, sépu l cre
,i l
d ivu lgue, cu lte, i l insu l te, turc , absu rde, i l purge, noctu rne.
duc,su c , caduque, perruque, sucre
,hu tte
,chu te, flû te,
fi l
affû te,huppe
,jupe
,dupe,
truffe, m ufle, Pru sse, russe,i l su ce
,puce, hu che, ruche, bûche,
embû che.
nu l,consu l , mu le
,tu l le, i l brûle, i l conjugu e, rude, prude,
apti tude, étude, so l itude, cube, i l répugne, une, lune, brume,
i l fum e.
cuve,étuve
,Vésuve, refuge, déluge, juge.
a APPUYÉ
Langue dans la pos i t ion de i l èvres dans cel le dea.
I°u r : dur , sûr, mû r , pur, m ur, azu r, du re, sûre, mû re,
MARGUER ITE DE SAINT-GENES
2°ein serein .
3°en : dans des mots du midi ou du nord ou empruntés récem
ment Agen,Penthièvre, ben jo in .
4° in : vin , enfin ,
chemin .
VOYELLE 0
Langue dans la pos i t ion de l’
a . Vo ie nasa le l i bre.
ou,am : bon , bombe, prompt .
um lumbago , Humbert .
VOYELLE
Langue dans la pos i t ion de de. Vo ie nasale l ibre.
I ° eun,eum : jeun .
2°un
,un: un
, parfum .
Dans certains mo ts l iés entre eux,la voyel le peu t
nasal ité .
Mon am i mon am i ou mo nann .
un am i : a?n am i ou œn ann .
D IPHTONGUES NASALES
yâ (Christian,
yé (chrétien, bien , etc .
u rê (moins, point , poing,
Sa int-Ouen (sêt—wê) .
MOD IF ICATION DU TIMBRE
SOUS L ’
IN ELUENCE DE L’
AÇ Ç ENT
1° En devenant atones
,les voyel les chantantes ou appuyées
sau f“
à et a’
: s’
affaiblissent en moyennes
sous FRANÇA I S 30 1
é en e (la bâ té la bonté ma is la hâte d ka‘
er la bonté decœ ur
b et o en a : (leo‘
r corps korsé corset kôt côtek5 tlétæ côtelette
de et a en ae(peer peur pæraî peu reux le foê feu et
un fæ d iwa feu de jo ie
i en i (m idi mid i et m idi soné midi sonnai t
a en n (bu boue bua'
e boueux
i l en u (i l a pu i l a pu et i l a pu ou ir i l a pu veni r
Ma i s È sechange en é (tu’
et tête tetu tê tu me‘ ma is et mé
wi mai s ou i fe lé fais—les i l foléfer i l fau t les fai reEt de en de (plein p leu r et pleine pleu rer
L’
analogie et l ’édu cat ion amènent un certain nombre d’
excep
t i0ns par exemple me‘
,te
‘
, sé, lè, etc . m es,tes
,ses
,les
2° En recevan t l ’accent et en se pro longean t , les voyel les
moyennes deviennen t chan tan tes , à l’
exception de i,u,u, qu i
deviennen t appuy ées
a (iran cave o la be‘
l kâv oh la bel le cave ! s é
admirâblæ c’est admirablee(la: solêy é bô le so lei l est beau ok i l e bô, lœ sol
‘
èy 0h '
qu ’ i l est beau le so lei lo (el é bon el le est bonne et avec emphase : el é bônan’
œ (i ce vyëdre je viendra i et en insis tant : roi [à vyêdre ou i !
je viendrai
i (i l a moviemm I l a mauvaise mine et lentement kel
minœ ! quel le mine
CON SONN ES
Deux classes les constr ictives, si le cou ran t d’
ai r est seu le
men t resserre' dans la bouche en un po in t part icu l ier pour chaque
espèce, 1, f, 5, j , etc . ; les occlusives , s i le couran t d
’
ai r est
3 02 MARGUER ITE DE SA INT- GENES
interrompu par la fermeture de la bouche et l ibéré brusquemen t,
p, t,_
k,etc . O n appel le enco re les premières continues parce
qu ’
el les peuvent être cont inuées i ndéfin iment , fr icati—ves, parce
qu ’
el les sont des bru i ts de fric t ion les secondes muettes,parce
qu ’
on ne d istingue pas leur son , iso l é d ’
une voyel le quel
conque, explosives, parce qu’
el les font explos ion .
ne se prononce jamai s ho rs de la déclamat ion et d’
un
effo rt vou l u . aspirée empêche seu lemen t la l iaison .
CON STRICTIVES
SEM I-VOYELLES
Les semi—vovel les son t des voyel les consonnifiées ; el les diffèrent des voyel les, en ce qu ’
el les ne font pas sy l labe. Comparez
la joie ( jura) en une sy l labe avec joua (jua) en deux sy l labes .
y
Le son y (yo t) est représen té par i , z, y , et par tou tes les
façons d ’écri re l’ l moui l l ée (i ll, ll, i l , ih, g li) d iamant,en t ier ,
fa-i‘
ence,a—i
‘
eul,ba— ionnette, bata—i ll-ou
,m ou-i ll—er
,rou — i ll—e
,
bi-ll—ard , fi-ll—e, deu-i l , so le- i l , M i—lb-au , de Bro-
gli—e .
U ne mauva i se lecture nous fai t d i re Castigl ione.
Le ro s ecri t ou , 0, u,ro et wh : oui
,jouer , moi
,poing
,etc . ;
l ingual,équateu r
,quadragésimal
,Guadelou pe
,alguazi l
,guano
,
tramway , whist , wal lon,Waterloo , etc .
Le i i) est écri t par u pu is,hu i le, ju i n , consangu in i té , inextin
guible, équid is tant, questure; équ i tation, Guet , de Vogué , de
Gu ise.
3 04 MARGUER ITE DE SA INT—GENES
La consonne s est représentée par 5 , ss,c, c, se, t, et x : si
,
scander, espérer,tens ion
,considérer, vra isemblable, tourneso l ,
an t isoc ia l ; assez , roussi r, cep , c i re, cy près , force, acc i dent , acces
so ire ; façade, leçon ,reçu ; sc ience, sceptique ; nup tial , minu t ie,
confiden tiel,prétentieux
,égy ptien ,
action,dévotion
,patien t
,
sat iété,etc . ,
bal bu tier,initier ; so ixante, Auxerre, Bruxel les .
Même posi t ion que pour s ; mo ins de force,et
,en plus
,vibra
tions du lary nx .
Le son est figu ré par s,x : zèle
,zéro
,d izaine
,horizon
,
Balç ac ; gag ; rose, heu reuse, désagréable (des anges , venez avec
nous,
Alsace,Arsace, balsamine, balsamique et les composés de la
part icu le trans voyelle t ransact ion, t ransiger deux ième,s ix i ème
,d ix ième ; heu reux enfant , doux am i
,etc . (dans les l ia i
sons) .
CH U INTANTES
Langue dans une posit ion vo is ine de cel le de s,mais la
relevée,le contact des bo rds avec le pala i s se fai san t en
et sur une su rface plus étendue, l èvres pro jetées en avan t
serrées aux co ins sur les mâcho i res .
Le 5 est écri t par ch. sh, sch
chapeau ,chercher
,chimère, archiduc , archi tecte, chérif.
shér iff shako .
schlague, schéma, schisme,schis te.
Même posi t ion que pour e, avec mo ins de press ion , et , en
plus , avec des vibrations du larynx .
sous FRANÇA IS 3 0 5
Le son f est figuré par g (devan t e, i) , ge
jour, jeune ;
gendre, g éan t , g ib ier ;
geôle, geôl ier , mangeons , gageu re
OCCLUS IVES
Labia les .
P
Lèvres pressées l ’une con tre l ’au tre ; el les se séparent b ru squement
papa,pape
,pipe, pampre, peupl ier , exemption,
septuagénai re,co rruption
cap, croup , Gap .
Même posi t ion que pou r p, avec une press ion mo indre,et
,
en plus,avec des v ibrat ion s du larynx pendan t l
’
occ lusion (fer
m eture de la bou che) et au moment de l ’explos ion
barbe,bai l
,bibelo t
,bras
,branche
,blanc
,table
,sable,
sabre,
cab,club .
Denta les .
La pointe de la langue est appuy ée sur le palai s derr iere les
dents,el le s
’
en détache brusquement .
Le t s’écri t auss i th, d
tête,têtu ,
tan te, tranche, tra i te,tr i cher
,trou , t roubler , t rou
ver
ques tion,combust ion
,châtier
,mo i t i e
,bonnetier, chrétien .
théo logie,Théophi le ;
3 06 MARGUER ITE DE SA INT—GENES
sept,hu i t
,acon i t
,bru t , compact, contact , intact , correc t ,
infect,strict
,Chri st
,Ouest .
grand homme, etc . (dans les l ia isons) .
(1
Même posi tion que pour t, avec mo ins de press ion ,et
,en
avec des vibrations du lary nx comme pou r le b
dada,dedans
,démodé, d inde, do rmir, dragée, dresser ,
ner,dro i t
,drôle
,dru ide .
Sud,Alfred , Dav id .
Guttura les .
le
Le dos de la langue est appuyé cont re le pala is en arriè re,
dans le vo is inage du gos ier ; i l s’
en séparé avec fo rce.
Le le s’écrit c
, qu , le, ch, ich, q , g : câble, canti que, cou , coude,
craindre,c ru
,c loche
,cl imat
, qu i , quatre,qua l ité
,équ i l ibre.
kép i , k i logramme, k i rsch ,K léber
,Christ
,chaos
,archiépisco
pal, Zacharie, khan ,khéd ive ;
sac,sec
,bec , choc , Cognac , Munich
,Roch
,cinq , coq, Bou rg ,
sous le joug , le sang humain,etc . (dans les l iai sons) .
Même pos it ion que pou r le, mo ins de press ion,et vibration du .
larynx en plus, comme pou r le b.
Le g s’ écri t g , gu , ghi , gh, c
ga le, gorge, gou lu ,ingurgrter , g lace, suggest ion ,
augmenter,stag nant , g râce, g racieux .
guerre, g uet , guéri te, morgue, guide, guimauve,sangu in,
Guy
Engh ien (âgé) ghetto ;second ,
seconder, etc .
3 08 MA RGUER ITE DE SA INT-GEN ÈS
SUPPLEMENT
POUR LES EXERCICES SUR LES CONSONNES
y . d iadème,action
,pied ,
mien,t ien
,sien
,l ien , paren ,
Sou i l ler, rou i l l é , aigu i l le,angu i l le, o rtei l , parei l , consei l , som
mei l .
Évi ter le y dans o sci l ler,osci l lat ion
,vaci l ler , Napo léon ,
Odéon (q ue des étrangers prononcentw. douane
,gouai l ler, louage, louange, joai l l ier , moel le,
moel leux,poêle
,poêlon
,fouet .
‘
ZÏt . écuel le,suai re
,annuai re
,bu is
,bu i sson ,
bu issonn ière,
cu i r,cu i re
,cu isson
,fu i r
,hu is
,hu iss ier
,lu i , lu i re, nu i re, ru is
seau , su ie,su ivre, sui te, tu i le, Tu i leries, t ru i te.
r arrière, barbare, Bernard , b rancard , brocard , Ferrare,grognard
,margrave, proverbe, raid i r , ra jeun i r , raga i l lard i r, rap
porteu r , rarement , raréfier , rareté , rarissime, rasséréner, réap
par ition,réarmer
,rébarbatif
,réforme
,réfracta i re
,regard , regar
der, rempart, remarque,renard , retard , réverbère, richard , ri re,
ronron,rura l , sou ri re, etc . Qu i terre a, guerre a . Sa
croupe se recou rbe en pl is to rtueux . (RACINE )
U n doci le ru i sseau qu i sur un l i t p ierreux
Tombe,écume
,et rou lant avec un doux mu rmu re,
Des champs désa l térés ranime la verdu re.
(DEL I LLE .)
l . Al lelu ia , an ima l cu le,cel lu le
,clavicu le, cl ientèle, co l la
téral, co l légiale, co lonel , cel lu la i re, é lectoral, él igib le, falbala,filial
,fi loselle
,Boréal , fo l l icu le, globu le, latéra l , latéralement ,
l égal,l éga lemen t
,l égis lateu r
,l ibel le
,l ibéra l , l ibéra lement , l i las,
l i l iacée,Lil le
,l i l l i pu tien
,l i ttéral
,l i ttora l , local , logeable, longi
tudinal,loyal , loya lement , mo lécu le, para l lè le, pel l i cu le, pi lu le,
pu l lu le,po l ich inel le, vio loncel le, vo lat i le, etc .
SONS FRANÇ A IS 309
Angèle,Marcel le, chancel le, pel le, tel le,
modèle, chapel le,harcel le, morcel le, n ivel le
,cruel le
,fidèle
,écuel le, prunel le, éter
nel le,jumel le, révè le.
falsifier,fanfare
,fanfaron
,fanfaronade, fanfrel uche,
fieffé,fifre
,s ifflet
,soufflet , souffl e, soufre, gouffre, frou frou ,
fra is
fran c , faux , fée, foi , faim , affo ler , affl iger, fifi,du fin fond nefle.
trèfle,confl i t, etc . Un fra is parfum sorta i t des touffes d aspbo
dèles . (V. HUGO . )v raviver , va lve, vavasseu r, verve, verveine, veuve, v ivace,
vivac i té,v ivandrere
,v ivan t
,vivat
,vive
,v i vement
,vivier
,v ivo
ter,v ivre, etc .
5 . assassinat,assomption
,cassat ion , cess ion,
cécité,chas
seresse, concess ion , cen t sou s , dispenser , d ispers ion ,d isposer
,
disso lu t ion,dis tancer
,facét ie, i ns truction , laisser-passer, posses
sent,princesse, rassas ier, sacerdo ce, salsifis
,Samson
,saucisson ,
science, sc ission , seneçon,sens dessus dessou s
,soumission
,sus
cite,superst i t ieux , suspicion . Pour qu i son t ces serpents
qu i s ifflen t sur nos tê tes ? (RACINE ) Ciel ! si cec i se sai t,
ses so ins sont san s succès . I l faisai t sonner sa sonnette.
(LA FONTAINE .) Po l issez— le san s cesse et le repo l i ssez .
(BO ILEAU .) Tu veux serv i r,vas , sers , et m e la isse en repos .
(RACINE ) Le sort,d i t— ou ,
l’
a mise en ses sévères main s .
(RACINE )
et m es peines
Ont pour but son p lai s ir ain s i que son beso in
(LA F . x,
ch. chasse—mouches,chercher
,chevaucher
,chevau chée
,
ch inch i l la,chucho tement , chu choter , chucho terie, revêche,
rêche,
chou,ch ien , ch i che, juch é , chat , chapeau ,
châ teau ,chai r
,chéri r .
j . adjuger,jaser , jon chée, Georgette, jou j ou ,
j uge, juge
ment , j u jube, gymnast ique, ju rer , Geo rges , agio tage, Ju les, Judas ,Jérusalem , j ambon , jo l i , An jou ,
jouer,j our, j oue, loge, logis ,
3 10 MARGUER ITE DE SA INT-GENES
plonge,rouge,
ronge,S Iege, hege, genoux , jou te, agi ter
,large
,
plage,rage.
p . apoplexie,hippopo tame
,pal per
,papa
,pape, pampre,
pal p i tant , parapet , paraplu ie, pap i l lon,papeterie
,papier
,pépin
,
péripé tie,peuple
,peupl ier , pioupiou ,
pomper,pipe
,p iperie
, pou
pée, pou rpo int , prin cipe, propice, propos , propre, soupape.
Pet i te pomme d ’
api,quand te dépet ite
— pomme-d’
apieras-tu ?
Je me dépetite—pomme—d
’
apierai quand je pourrai .
b. baba,babil
,babi l ler
,bal bu tier
,bambin
,bambou
,bar
bare,barbarie
,barbe
,barbiche, barbier
,barb i l lon
,barbo ter
,
barbu,bébé
,bâche
,bibelo t
,bibl io thèque
,bi l boquet
,bim belote
r ie,bobo ,
bombarder,bombe
,bonbonne, Bou rboule, breb is ,
bouche,bou i l lon
,bain
,bon
,bas
,arabe
,sy l labe, soc iable, aimab le,
sable,sabre
,Bretagne
,table
,blason ,
biberon .
t. act iv i té,aristocrat ie
,attentat
,attrister
,cantatrice
,catas
tr0phe, con tenter , contracter, entê té , é t iquet te, lat i tude, mu l t i
plica teur, Tartarin de Ta rascon ,tâ ter , tact ique, taffetas , tante,
tâ tonner,tes tament
,tenter
,testateur
,tête
,t éter , tê tu ,
tim id i té,
t i tuber,ti tu lai re
,t in ter
,to i ture
,total
,tou te
,tou tou
,traducteu r,
travai l , tremble, t rou ble, t ruel le, t riple, trinquer, t rêve, traire,trèfle
,t ra i ter, tréteau ,
t ripo ter , tr iste,t ro tter
,tu teur , tu trice, tu te
lai re. Le ri z tâ té tenta le rat,le rat tenté tâ ta le r iz .
Q u’
attend— on donc tant ? Que ne la tend -on donc tô t (la
chaine) ?
d . dada,dédaigner
,dédain
,déda le
,dedans
,dédier , déd i t,
dédommager,déduct ion
,démodé
,des iderata
,dél i re
,descendant,
diadème,D idon
,d indon , dissuader , dodel iner ,
‘ dodu,bidon
,
baudet, Daudet D idero t,dés i rer
,dinde
,craindre
,pla indre
,
feindre, rôder , dem ontrer,discu ter
,rude
,prude
,dru ide, peindre,
plaider , pendre, rendre, etc . B idon dîna,d it- ou ,d u dos d
’
un
dodu dindon . Q u i dort d îne.
le. acoustique, cacao , cal ca i re, ca lquer , cant ique, ca raco le,Carcassonne, carcasse, caricatu re, Caucase, caust ique, coca , cocon,
concou rs , cosmétique, cou cou .
CHRONIQUE
Pa r is . La troisiemeréunion dephonétiquea eu l ieu le 9 ju i l let dernierau Co l lège de France. Le Laborato ire ne pouvant conten ir les nom
breux pro fesseu rs , pou r la p lupart étrangers , qu i avaient répondu àl ’appel des organisateurs , force a été de se transporter dans une sa l lep lus spacieuse. L ’
ordre du jo ur portait la transcription phonétique.
M . l’
abbé Rousselot a passé en revue les d ifférents systèmes em p loyés ,en part iculier celu i du Ma ître phonétique et celui de la Revue des
patois gallo-romans i l en a ind iqué les inconvénients en ins istant su rc e fait qu ’ i l ne s
’
agit pas dedonner la préférence exc lus ive à tel ou tel
système, m ais uniquem ent de rechercher par un cho ix jud icieux lesam é l iorations dés irab les . Les deux réun ions de l ’année précédenteconsacrées aux voyel les ayant donné des résu l tats satisfai sants , i l restedans cel le-ci à s ’
occuper des consonnes .
Pour aborder le prob lème,M . l ’abbé Rousselot propo se de pareou
rir les principaux groupes de sons et de rechercher quel s signes conv iendraient le m ieu x , sans entrer dans le déta i l des nuances que peuventprendre ces sons .
Sem i-ooyd les ce (t o i) , tu (u li) , y (ta i l le) . M . Rou sselot trouve lesdeu x po ints sur le tu étrangers au système o rd inairement em p loyédans la Revue et voudrait rem p lacer ce s igne par un cv de forme spé
c iale. M. Perno t préférerait garder la notation tit , qui lu i sem ble assezexpress ive.
Occ lusives . Les s ignes h, p, d , Ô ,
k restent intacts .
Il en est de m ême de r et de l,de m et de n . Pou r l’n guttural
M. Rou sselot propose q .
Constr ictives . Les s ignes f et v , s et restent intacts . Pou r c et j ,M . l ’abbé Rou sselot ne s ’
oppo serait pas à un changem ent , par exem p leà la p lace de 6 . M. Pernot et Mm e de S a int-Genè s garderaient p lus
v o lontiers les graph ies et En ce qu i concerne ê et É, M Rousselotpropo se x et x ,
M . Pernor s ’
aoppose l ’em p lo i du y_ gg rec et recom
m ande c et c , aquo i un professeur a l lem and oppose la p
b
o ss ibi lité d’
une
c onfus ion avec l ’emp lo i c ourant de ces deu x s ignes . Resterait :‘I trouver une sonore convenab le. M . Cabaton consei l le de conserver ce q uel’
on a dé j à.
La suite de la discuss ion est rem ise à la réunion su ivante
LeGérant J . RO U S SELOT .
MACO N , FROTAT FRERES,IMPR IMEU RS .
LA DÉCLAMATION DU VERS FRAN ÇAIS A LA FIN
DU XVIIe SIECLE.
Dans la seconde mo ine du xv11°srec le
,les principes Su r lesquels
se base l ’esthé t ique class ique ont sub i des atteintes assez graves .
L’
art, d’
une façon généra le,évo lue vers des fo rmes mo in s gu in
dées et mo ins ra ides . Des man ifestat ions d iverses, que tou t le
monde a présentes à la mémo i re,prouven t que l
’
espri t d’
abstrac
tion et l’
intellec tualité pu rene règnen t p lus avec la même souve
ra ineté , mais qu’
au con trai re des beso ins de sens i b i l i té apparaissent . La société françai se, sans tou tefo is répudier complète
men t son idéa l de ra ison,prend par degrés le goû t du pla is i r
émot if et se déshabi tue peu à peu de la somptuosi té et du
faste.
I l va de so i qu ’ i l ne s ’agit encore que de faib les ind ices . Cepen
dan t le vers françai s sub it les conséquences de ce mouvement
que je s igna le. Jusqu ’
en 1 660 on m e fera créd it de cette
démonstration que jemeproposed ’
appo rter un j ou r la déclama
t ion n’
a accordé à l’
alexandrin que deux temps fo rts, à la s ixièmesy l labe et a la douzième
,sans accents i n tér ieurs , le premier
hémistiche formant mu s ica lement une phrase ascendante, le
second une ph rase descendan te tou t au p lus est- i l permis à lavo ix d ’ insister su r les exclamat ions du texte, à cond i t ion qu
’
el les
ne so ien t po int prodiguées , et cela cons t i tue la seu le exception
admise par les cri t iques .
I l fau t cependan t vo i r dans certa ines pages de Le Labou reu r le
signe ou plu tô t le dés i r d’
une transfo rmat ion procha ine. Déj àen 1 640 La Mesnardière, d
’
un c lass i cisme pou rtant s i net , incl ine
à une déclamat ion vivan te qu i n’
est pas cel le de son temps ,
et i l évoque,comme on peut s
’
y attendre, l’
au tor i té desRevue de phonétique.
3 14 GE0RGES LOTE
Anciens . I l loue chez les Grecs leu rs exclamat ions fréquentes ,leurs changements de mesure, leu rs termes s i path ét iques
,
et leurs d iscours interrompus par les soupirs redoubl és
et i l ajou te Mais je ne sç ai s i les o rei l les de nos juges del i
cats 2
pourro ient sou ffri r sur la scène c inq ou six exclamat ions
poussées dans un seu l vers ; s i les cri s , les gémissements, lessanglots ne sero ien t po int désagréables au jugement de ces
mess ieu rs
Tel les sont les cond it ions générales selon lesquel les s’
es t
accompl ie la réforme. I l y en a d’
autres plus part icu l ières . Pou r
b ien saisi r ce qu i va su ivre, i l fau t en effet ne pas o ubl ier q ue
les vers au début du XV I I" s i ècle,présenten t dé j à en fa it
quelques brisu res à d ’
au tres places qu’
à l’
hém istiche. El les sont
sans dou te t rès rares,mais el les son t suffisamment at testées
pou r qu’ i l n’
y ait aucun dou te à c et égard . Les changements d’
in
terlocuteurs,lorsqu ’ i ls se produ isent dans la t ragéd ie en un au tre
l ieu qu’
à la césure,produ isent le même résu l tat q ue les exclama
t ions . De tels exemples son t peu fréquents , ma is on en rencont re
cependan t chez Co rnei l le
NER INEV0tre pays vous ha it, votre époux est sans fo i
Dans un si grand m a lheur que vous reste-t— il ?
MÉDÉE
Mo i,
Mo i , dis— je, et c’
est assez . (Médée, I ,
I l fau t signaler d ’
une façon analogue les vers con tenant des
rejets par i n terruption ou par suspension , c’
est— à- di re les enjam
bements permis , selon les ty pes su ivants q ue j’
emprunte a
Co rnei l le
N e raillons po int le fru it qu i t’
en est dem euréVaut m a is revenons à notrehum eur chagrine. (Méli te, VI , 1Et que de m a m ain propre une âm e si fidèleReço ive. mais d ’
où vient quetoutm on corps chancel le?(I bid I V,
La Mesnardière,Poétique, 1640 , p . 3 7 .
I l s ’
agi t des critiques de son tem ps .
3 1 6 GEORGES LOTE
des inflexions dures , une vo lubi l i té de langue qu i préc ipitortt rop sa déclamation , le rendo ient, de ce côté
,fo rt inférieu r
aux acteu rs de l’H ôtel de Bou rgogne. I l se rendi t just ice,et se
renferma dans un gen re où ses dé fau ts é to ient plus supportables
Ce ne fut pas sans lu tte, nous al lons le vo i r . Mais au cont ra i re,
poursu i tM11° Po isson,« par la vérité des sent iments , par l
’
intelli
gence des expressions,et par tou tes les finesses de l
’
art,i l sédu i
so i t les spectateu rs,au po int qu
’ i ls nedistinguo ient plus le person
nage représenté de l ’ac teu r qu i le représento it Ces avantages
et ces défau ts su ffiraient à expl iquer la campagne que mena
Mo l ière i l fau t ajou ter d ’
ai l leu rs que ses goûts personnels,son
amour de la nature et de la véri té l ’au raient à eux seu l s poussé
dan s la vo ie où i l s ’engagea .
Dès 1 6 5 0 ,dans les Pre'cz
‘
euses r idicules,i l se pose en cri t ique,
et fai t louer par Mascar ille, personnage rid icu le, ses confrères
de l’
H ôtel de Bourgogne,les seu ls
,affirm e— t— i l i ron iquement
,
qu i so ient capables de donner à un vers tou te sa va leur en lefa isantronfler selon les règles , car i ls saven t que déclarner n
’
est po int
réci ter comme l’on par le . Mais en même temps i l s ’
efforçait lu i
même,lo rsqu ’ i l j ouai t des tragédies
,de réfo rmer les habi tudes
du théâtre. La seu le tentat ive qu i nous so i t connuefi t tomber Don
Garcie de N avar re. M . Despo is , dans son édit ion deMo l i ère,ne
para î t pas trop s’
avancer en affirmant que l’échec de cet te pièce
sérieusedo i t ê tre impu té pour une bonne part au système dedécl a
mat ion de l ’auteu r . I l formu le à ce propos une remarque don t
l ’ importance n’
échappera pas c’est que Mo l i ère, quand i l
remit son œuvre à la scène deux années plus tard fi t co ïn c ider
cet te reprise avec la première et la seconde representation de
l’
Impromptu de Versa i lles,véritable plaidoyer d
’
un tou r très
personnel,où i l s
’
en prenait très vivement à ses détracteu rs en
même temps qu’ i l marquai t la po rtée du débat << Ï Je leu r
abandonne,l isons— nous de bon cœu r mes ouvrages ,
’
ma
1 . I mpromptu , sc . 5
DECLAMATION DU VERS FRANÇA IS 3 17
figu re, m es gestes,mes paro les
,m on ton de vo ix
,et m a
façon de réci ter , pou r en fai re et dire ce qu’ i l leu r plai ra
,s ’ i l s
en peuvent t i rer quelque avan tage ; je ne m’
oppose po in t à
tou tes ces choses , et je sera i ravi que cela pu isse ravi r le mondeI l fau t comprendre qu ’
après ce dern ier combat Mo l ière étai t
décidé à s’
avouer va in cu . D ’
après M"° Po isson c ’es t en effet
ce qu i arriva . Don Ga rcie, on le sai t,tomba une seconde fo is
,
ma is les vers condamnés par le pub l ic furen t applaudis quand
l ’au teu r les eu t t ransportés dans le Misanthrope.
Les leçons de l’
Impromptu de Versa i lles va lent cependant
qu ’
on s’
y arrête. Mo l iè re,dans ce court lever de rideau
,prend à
part ie les acteu rs les plu s répu tés de Paris Montfleury , Beauchâteau
,Hau teroche
,deVi l l iers etM"° Beauchâteau . I l les connait
,
eux et leu r man ière ; leu r art,i l le d it tou t hau t
,lu i semble
affecté et ampou l é . La première scène de l ’ouvrage est cel le où
i l a condensé sa doctr ine. I l suppose qu ’
un poète vien t présenter
une t ragédie a une t roupe de comédiens récemmen t arrivés de
provin ce. Ce poète a le ton de vo ix sen tencieux et'
Du Cro isy ,chargé de représenter son personnage
,est averti qu i l do i t conserver
cette exacti tude de p rononc iat ion qu i appu ie sur tou tes les
syllabes selon le goût de l ’époque. I l s ’agi t de t rouver un ro i
de tragéd ie qu i pu isse se charger du rôle principa l de façon àméri ter l
’
approbation de la fou le. Mais le poète est déçu dans son
attente : l’
acteur auquel i l s ’adresse a le défau t de parler d ’
unevo ix trop naturel le,
tand is que, pou r plai re aux spectateu rs,i l
faudrai t d i re les choses avec emphase appuyer sur le dern ier
vers de la ti rade,et pousser des éclat s de vo ix . A propos du dia
logue deN icom ède et d’
Araspe, les deux conceptions s’
opposen t0
Mars,m onsreu r , I l me semble q u un ro i qu i s entret1ent tou t
seu l avec son capitaine des gardes parle un peu plus humaine
ment et ne prend guère ce ton démon iaque.
— Vous ne savez ce
que c’
est . Al lez-vou s-em réci ter comme vou s fai tes , Vou s verrez
si vous ferez fai re aucunAh
1 . Impromptu ,sc . I .
3 18 GEORGES LOTE
On vo i t par ce texte où tendent les efforts de Mo l iè re. I l déclare
la guerre au genre noble, défend une d ict ion s imple,une réci ta
t ion qu i , le cas échéant,rabai ssera le ton pompeux de la t ragéd ie
pou r le rapprocher de celu i de la coméd ie. Nou s savons qu ’ i l se
heu rta a l’
intransigeance du goût contempora in; l’
on trouva
inconvenant qu ’
un ro i de tragédie parlât comme Scapin,et l
’
on
vit dans le nouveau sy stème une at tein te au p r i n cipe de la sépa
ration des gen res . U n garçon nommé Mo l i ère,d i t Tallem ant
des Réaux fai t des pièces où i l y a de l’esprit ce n ’
est pas un
mervei l leux acteu r,si ce n
’
est pou r le r id icu le. I l n’
y a que sa
troupe qu i joue ses pièces el les sont comiques Montfleury , le
fi l s du comédien , se montra p lus dur dans son lmpromptu de
l’
H ôtel de Condé. Usan t des procédés i ron iques dont les Préc ieusesr idicules lu i avaient donné le modèle, i l int rodu isi t su r la scène un
personnage bu rlesque qu i prétendai t cri t iquer l’
H ôtel de Bourgogne en remarquan t que dans ce théâtre on s
’
appliquait surtou t
au genre sérieux et qu ’
on y riai t seu lemen t au comique
Ma is au Pala is—Royal , quandMohereest des deux ,On r it dans le com ique et dans le sérieux . (Sc . I I .)
Qu ’ importe cependant les leçons deMohere devaien t po rter
leurs fru i ts i l échoua sans dou te parce qu ’ i l avai t vou lu opérer
une révo lu t ion trop profonde. D ’
au tres,tels q ue son élève Baron ,
su rent profiter des ind ications qu ’ i l avai t données et réu ssi ren t
davantage auprès du publ ic . I l fau t vo i r dans le l ivre de Grimarest
,dont je parlerai p lu s lo in , le résu l tat in d irect et probable
ment atténué des enseignements du m aitre.
Au demeurant i l est assez d iffi ci le de caractériser dans tous ses
détai ls la déclamat ion que Mo l ière incu l quai t à sa troupe,car
les documents que nou s possédons ne son t pas assez précis . Plu s
hardie que cel le qu’
on va men t ionner,on peut présumer qu
’
el le
lu i est analogue. Su r cette derni ère nous sommes éclai rés par
I . Tallem ant des Réaux , éd . Monm erqué tom e X, p. 5 1 .
3 20 GEORGES LOTE
Racine le fi l s du poète Cette femme 11 etoi t po in t néeactrice.
La nature ne lu i avo i t donné que la beau té, la vo ix et la mémo i redu reste
,el le avo i t s i peu d
’
esprit , qu’ i l fa l lo ir lui fai re en tendre
les vers qu ’
el le avo i t à d ire et lu i en donner le ton . Tou t lemonde sa i t le talent q ue mon père avo i t pour la déclamat ion
,
dont i l donna le vrai goût aux comédiens capables de le"
prendre
comme i l avo i t formé Baron , i l avo i t fo rmé la Chamm ê lay ,
mais avec beau coup p lus de peine. I l lui faiso it d ’
abo rd com
prendre les vers qu’
el le avo i t à dire,lu i m ontro it les gestes et
lu i dic toit les tons , que même i l no to i t . L’
écolière,fidèleà ses
leçons , quo i qu’
Actrice par art,sur le théâtre paroisso it i nsp irée
par la natu re.
Donc le fai t même de l’
enseignemen t donné n ’
est po i n t discutable et nous avons la cert i tude que Rac ine agit en réformateu r .
Mais i l serai t presque impossible de se fai re une idée des nou
veautés qu’ i l i n trodu is i t dans la déclamation ,s i nous en étions
rédu i ts aux opinions des écriva ins et des cri tiques c’es t à une
au t re source, nous le verrons , qu’
il faut remon ter pou r rencon trer
une image exacte de la d ict ion rac in ienne. En effet,certai n s
auteu rs se contredisent ï d’
au tres ne nous appo rten t qu’
un juge
ment trop généra l ou bien encore une véri té man ifestement a l te
rée. Vo l tai re par exemple hésite ent re l’é loge et le blâme. DanssonDict ionna irephi losophzÿ ue
‘
,i l cons idère la Cham pmeslé comme
étan t l ’actrice qu i a po ssédé le p lus parfa i tement la mélopéethéâtra le en honneu r au XV I I° s iècle, mais ai l leu rs 3
,sans dou te
pour flatter les éto i les de son temps,i l dénonce
Ses accents am oureux et ses sons affétésEcho des fades vers queLam bert a notés .
La Fontaineeu t beaucoup d’
obl igat ions à la célèbre comédienne ;el le lu i fi t continuer ses Contes et i l ne cessa pas de fréquenter
1 . Lou is Rac ine, Mémoi res sur la v iedej ean Rac ine, éd . deGenève, 1 747 . p . 1 10 .
2 . Au m ot chant.
_3 . Épître ci M
lle Cla i ron .
DÉCLAMATION DU VERS FRANÇA IS 3 2 1
chez el le quand Bo i leau et Rac ine eu ren t qu i t té la mai son . Pou rel le i l écrivi t en vers la déd icace de Belphégor , où, tou t en l
’
assuran t qu
’
el le régnera longtemps dans la mémo i re i l exprime
son admirat ion en termes assez vagues .
Boi leau se conten te de nous d ire que la Champmeslé , quand
el le joua i t Iphzgeme en Aulz‘
de, faisai t p leu rer la sal le. Tous ces
déta i ls son t inté ressan ts, su rtou t le suffrage de La Fon taine,
l ’ homme de la s impl ic i té , de la véri té et du natu rel . Vo i c i cependant qu i est p lus précis Ceux , écri t Lou is Racine qu i s
’
im a
g inent que la déc lamat ion que m on père avo i t in trodu i te sur le
théâtre éto it enflée et chan tante,son t , je cro is, dans l
’
erreur .
I ls en jugent par la Duclos, é lève de la Chamm êlay , et ne font
pas at tention q ue la Chamm êlay , quand el le eu t perdu son
maî t re 3,ne fut p lus la même
,et que, venue sur l ’âge
,el le pous
so i t de grands éclats de vo ix qu i donnèren t un faux-goût auxcoméd iens . Cependan t ces l ignes ne do ivent pas être acceptéessans d iscu ssion . Comme le remarque judicieusement M . Romai nRo l land 4
,Lou is Racine, en s
’
opposant à l ’opin ion reçue,n ’
est
pas t rès affi rm atif. De p lu s,i l ne n ie pas qu a une certa ine époque
l ’actrice n’
a i t chanté et même crié ses rô les . Ma i s nous possé
dons un texte qu i nou s confi rme ceShabitudes . Les frères Parfaic t S
ci ten t en effet l ’au teu r des Entretiens ga lants , parus en 1 68 1,et
transcrivent ce passage Le réci t des comédiens, dans le tragique,est une manière de chant, et vous m
’
avouerez bien que la Champ
meslé ne vou s plairo it pas tant , s i el le avo i t une vo ix mo in s
agréab le, mai s el le sai t la condu i re avec beau coup d ’
art et el le ydonne à propos des inflexions s i naturel les, qu
’ i l semble qu ’
el le
I . Epître VI I , v . 3—6 .
2 . Op . cit .,ib .
I l faut entendre quand el le abandonnaRac ine pour le com tede C lerm ontTonnerre en 1678 .
4 . R omain Ro l land, N otes sur Lully (Mercure mus ical
,1 5 janvier
p . 6 . Je signa le tout de su ite ce bel artic le qu i m’
a été d’
un très U ti lesecours .
5 . Les frères Parfaic t , H istoi re du thea'
tre,année 1708 .
3 22 GEORGES LOTE
ai t vraimen t dans le cœu r une pass ion qu i n’
est que dans sa
bou che. Or,à cette époque, el le é ta i t à peine séparée de son
maî t re dont i l n ’
est pas poss ib le qu’
el le eût si vite désappris lesleçons . Lou is Rac ine, ne l
’
oublions pas , écri t au XVI IIe s iècled ’
après des t rad i t ions de famil le, et i l a tendance à interpréterces traditions de la manière la plus favorable à la mémo i re paternel le. I l fau t su r tou t se souven i r qu ’ i l s
’
agit essentiel lement
d ’
une époque de transi t ion ,et que la réfo rme ne pouva it être
rad icale. N ou s montrerons qu’
en effet el le ne l’
a pas été .
A côté de la Champmeslé , i l fau t nommer Baron,l’
un des
art isans les plus certains du progrès accompl i . Celu i—c i encore a
dû sa formation à l ’éco le de 1 660,en particu l ier à Racine et à
Mo l ière : on vo i t a ins i à quel groupe i l appart ient . C ’
est un des
noms les plus i l lustres du théâ tre. Fi ls d ’
un comédien connu ,
i l naqu i t en 1 6 5 3 et fu t o rphel in de bonne heu re. Lou is Racineattribue un iquement à son père Jean Racine l ’honneu r d ’
avo i r
été son m ai tre. Sans dou te Racine l ’a ida de ses indi cations,mais
l ’ influence de Mo l ière fu t au t rement profonde,et nous en pou
vons juger grâce à Grim arest . D ’
après cet au teur Baron,tou t
enfant,fut recuei l l i par Mo l ière
, qu i le t i ra de la troupe de laRais i n où i l ava i t été engagé . Dès 1 666
,i l j oueMélicerte à Saint
Germain en compagnie de son pro tecteu r ; mais i l se brou i l le
avec Armande Béjart et retourne chez la Ra isin ; de temps en
temps i l reparaî t pou rtant dans la mai son d ’
Auteu i l . En 1 670 ,
Mo l ière le fait r even i r de province et l’
engage à son théâ tre
comme membre régu l ier, car i l avai t reconnu en lu i des donséminents . De ce j ou r ce furen t des consei ls constants, car , nous di t
Grim arest , on ne peu t s’ imaginer avec quel so in Mo l iè re
s’
appliquoit à le former dans les mœu rs comme dans sa profè s
s ion Baron assista son m aitre mou ran t , pu is ensu i te i l passa à
1 . Lou is Rac ine, op . ci t .,ih .
2 . G rimarest, Vie de Molière,Grimarest était en relations avec Baron et
i l a été renseigné par lu i .
3 24 GEORGES LOTE
tradu isen t : su r le terrain de la déclamat ion theatra le commed ’
une façon générale en art,tou j ours conservateu rs et novateu rs
se sont t rouvés aux prises . En tou t cas,i l ne fau t r ien exagérer ,
et surtou t ne po i n t p rendre Baron pou r un parfa i t diseur au sens
moderne du mo t . Vo l tai re,l
’
opposant â Mlle Lecod vreur , affi rmaqu ’ i l avai t été noble et décent et rien de plus Apparem
men t tou tes ces Opin ions sont j ustes,l ’enthousiasme comme la
cri t ique,et el les s’expl iquent selon le po int de compara ison
cho is i . Ce qu’ i l y a de sûr,c’est q ue Baron ,
élève à la fo is de
Mo l iè re et deRacine, réa l isa sur l ’ensemble des comédiens de son
temps un énorme progrès mais pou r le juger , lo in de le séparer
de son époque,i l ne fau t j amais perdre de vue l
’
état de la scène
au moment où i l y monta . C ’
es t seu lement dans le cadre du
XV I I ° s iècle qu ’ i l est grand,et de nos j ou rs le mo indre acteu r
,
nous essaierons de le mon trer , t rouverai t sans peine ce dont on
lu i a fa i t une glo i re.
En deho rs des témo ignages que nous possédons sur les hommes
don t i l vient d ’ ê tre quest ion, un l ivre nous est d’
une grande u t i
l i té pour connai t re l ’art de la déclamation vers la fin du règne de
Louis XIV. C’
est le Tra ité du réci tatif que Grim arest publ ia en
1 709 . De Grim arest nous savons peu de chose. I l naqu i t en 16 5 9et mou ru t en 1 7 1 3 i l ava i t donc quato rze ans lorsque Mo l i ère
ferma les yeux ce n’
est donc pas ce m aître qu i , d irectement , a
fo rmé son goût . De son vivan t,professeu r de langues à Paris et
ci cerone des étrangers de marque qu i vis i ta ien t la capitale,'
i l
fu t , on peu t le supposer,un ass idu des représentat ions drama
t iques et l ’ i n térêt qu ’ i l a pris aux choses du théâtre nous est
suffisamment a t testé par son ouvrage. Q u’ i l ait été en relations
avec Baron , cela est hors dedoute, pu isqu’ i l l’a déclaré lu i—même.
Ce fai t nous i nd ique à quel le éco le i l se rat tache. S i même son
1 . Appel à toutes les nations de l’
Europe, 1 76 1 .
2 . Ja], D ictionna i re cr itiquede biog raphieet d’
histoi re.
DECLAMAT ION DU VERS FRANÇA IS 3 2 5
tra ité du récita tif , que l’
abbé Goujet louai t enco re au mil ieu duXV I II“ s iècle, ne Suffisai t pas a nous renseigner clai remen t à
ce su jet , certain s passages de la Vie deMolière seraient d ’
une evidence abso lue. Grim arest appartient donc sans discuss ion au
groupe que nous venons de défin i r ; son l ivre est d ’
au tant p lusprécieux que, pou r l
’ époque de transition dont nous nous occu
pons , c’
est le seu l ouvrage d idact iqueoù se reflètent les préoccu
pations des réformateu rs .
Enfin cet exposé ne sera i t pas complet s’
i l ne faisai t une largeplace à l ’opéra et à Lu l l i . Celu i — c i é tai t un Ita l ien qu i naqu i t en1 6 3 3 à Florence, où son père exerçai t la profession de meun ier .I l v int en France tou t jeune et fut d ’
abord marm i ton chez M““
de Montpens ier . C’
es t de là qu ’ i l so rti t pou r entrer au service duroi et pou r créer un genre nouveau . Lu l l i
,i l faut le no ter , est l
’
un
des grands art istes classiques, et l
’
on ne peut le séparer de l ’éco le
de 1 660 . I l a été en relat ions avec La Fontaine, mai s s ’est broui l lé
avec lu i , parce que, après lu i avo i r commandé l’
Opéra deDaphne,
i l a refusé ce l ivret pou r accep ter l’
Alceste de Qu inau l t, cu isantebrû lu re d ’
amou r— propre, affron t que le poète ne lu i pardonna
j amai s I l connu t auss i t rès étro i tement Mo l i ère, dont i l fu t
longtemps le co l laborateur en 1 664 i ls donnèren t ensemble la
Pr incesse d’
Elide,pu is les deux a rt i stes se séparèren t , le caractère
du mus ic ien n’étant pas des p lus fac i les . Q uant aux rappor ts
”
avec
Racine, je les précisera i p lus lo i n . Retenons pou r l
’
instan t que
Lu l l i com poSe ses premiers Opéras a peu près au moment où
Rac ine m et à la scène ses tragéd ies , au plus for t de la l iaison avec
la Cham pmeslé .
I l n ’
est cependan t pas ind iffé rent , à cause de ce qu i va su ivre,d ’ i nd iquer quel le a été l ’origine de l
’
opéra . I l se man ifesta . d’
a
bOrd en Ital ie -et ses fondateu rs ne .virent primitivement dan s la
musique qu ’
u n moyen de rehau sser les passions du poème.
Tel le fut en effet l ’ idée directri ce de R inucc ini ‘. Son am i Péri
1 . Cf. La Fontaine,le F lorentin .
2 . Rom a in Rolland , Les or ig ines du théâ tre ly r iquemoderne, p . 76 .
326 GEORGES LOTE
avoue en ou t re la vo lonté d’ imiter les Anciens
,car , nous d it
i l,les Grecs et les Romains chan taient sur la scène leurs tragéd iesd
’
un ton plu s relevé que le parler ord inai re et mo i ns régul i ère
ment dessiné que les pu res mélod ies du chant On vo i t imm édiatement la conséquence de cette nouveau té et *
l’ immense sigu i
ficat ion qu’
el le deva i t avo i r le jour où el le se trouvera i t en pré
sence du classic isme françai s . El le deva i t , étant donnée la con
ception pu remen t i n tel lectuel le et abstra i te que le XVI Ie siècle
ava i t de l ’art , apparaî tre comme un composé hybride, comme
foncièrement en désacco rd avec l ’esthétique de raison qu i dédai
gna it de s’
adresser aux sens . C ’
est b ien l à ce q u i arr iva . On sai tquel le résistance lu i opposèren t des hommes comme Saint—Ev re
mond et La Fonta ine. L’
espri t,écri t le premier ne pouvan t
concevo i r un héros qu i chante, s’
attache à celu i qu i le fai t chanter
, et on ne sau ro i t n ier qu ’
aux représentat ions du PalaisRoyal , on ne songe cent fo is p lus à Lu l l i q u
’
à Thésée ni à Cadmns Mai s La Fontaine
,dans son épî tre a de N iert ‘
,est plu s
catégor ique enco re et blâme cemélange de genres
Car ne vaut—il pas m ieux , dis—mo i ce qui t'en sem ble,
Qu ’
on ne pu isse saisit tous les pla isirs ensem ble,
Et que, pour en goûter les douceurs purement,I l fa i l le les avo ir chacun séparémentLa m usique en sera d
’
autant m ieux concertéeLa grave tragéd ie, à son point rem ontée
,
Aura les beaux su jets,les nobles sentiments
,
Les vers m ajestueux,les heureux dénoûm ents .
Malgré les motifs d’
inim itié personnel le qu i pouvaien t pousser
La Fontaine à condamner au ssi sévèremen t la tentat ive de Lu l l i,
ce passage n’
en est pas mo ins très i n téressan t . I l mon tre combien
i l a été diffici le à un espri t t rès l ib re de rompre avec les habi
Indes de son époque, et combien la déclamation de la Champ
1 . Mélanges de'
l i ttératureet de cr i tique sur les opéras .
2 . EpttreXI I sur l’
opéra (adressée au musi c ien de N iert ,
3 28 GEORGES LOTE
dée directrice de Lu l l i lo rsqu’ i l fonda la tragéd ie en mu sique. I l
s’
exprime a insi Quel le est la beau té de la mu sique des
opera C ’
est d ’
achever de rendre,de la poés ie de ces opera , une
peinture vraiment parlante. C’
est,pou r a insi dirê ÿ de la retoucher ,
de lu i donner les dern ières cou leu rs . Or,comment la mus ique
repei ndra—t-el le la Poésie,commen t s ’
entreserv iront-el les,à mo ins
qu ’
on ne les lie avec une extrême justesse,à mo ins qu ’
el les ne
se mêlen t ensemble par l’
acco rd le plus parfai t Leseu l secret
est d’
appl iquer aux paro les des tous s i propo rt ionnés, que la Poés ie
so i t con fondue et revive dans la La Poés ie et la
Mus ique m al l iées se séparent l ’une et l ’au tre,m on attent ion
langu i t en se d ivisant 2 Ce problème ava i t inqu ié té les art istes
du XV I° s i ècle,ma is i ls n
’
avaien t pas réussi à étab l i r un sy s
tème sat isfaisant . Lu l l i à son tou r , ne t rouvant avan t lu i aucune
tradit ion fixée et créant pou r a ins i le genre de tou tes pièces,dut
auss i s’
occuper de la quest ion ,songer à la façon don t i l réglerai t
les rapports du vers et de la mus ique. O r le réc i tatif, partie fondamen tale de la tragéd ie chan tée, do i t conserver au texte son aspec t
o rd inai re,ne pas é touffer les mo t s sous les sons : i l est avan t
tout une déclamat ion notée. I l est donc parfai temen t concevable
que Lu l l i s’
inspirât des spéc ia l is tes et des comédiens de son
temps . Mai s à qu i devai t- i l recou ri r ? Aux acteurs de l’H ôtel—de
Bourgogne,à ceux qu i main tenaien t au théâtre une d ict ion
emphat ique et ampou l ée Evidemmen t non,et
,pu isque l ’opéra
marque une évo lu t ion du goût vers l ’émo t ion et le naturel , i l
devai t nécessai remen t se tou rner vers ceux qu i s’
efforç aient , d’
une
façon paral lè le, de réfo rmer la di ct ion dramat ique. Influencé par
le cercle où i l v ivai t , connai ssant les préoccupations des princi
paux écrivains de Son tem ps, c’
est d ’
après leu rs avi s qu ’ i l aura
1 . Op . ci t., p . 269 .
2 . Au fond,le po int de vue deLa Fonta ine et celu i de Lecerf deLa Vievi l le
sOnt sem blables tous les deu x veu lent l ’un ité d ’ impress ion m a is cette un itéd
’ im press ion ,La Fonta ine conteste qu
’
el le so i t dans l ’opéra, tand is que
Lecer f l’
y découvre.
DECLAMATION DU VERS FRANÇ A I S 3 29
travai l l é . I l au ra en les consei l s d irects deMohere et sans’
d0fi te
ceux de Rac ine. Mais la déclamat ion même de ce dernier , parl ’ i n termédiai re de la Champm êlé, devient la base du réci tat i ftel que le compose Lu l l i . Cela , nous le savons de sou rce sûreI l allo it , nous d it Lecerf de la Vievi l le, se former à la Comédie
sur les tous de la Cham pm eslé et i l a prononcé lu i—même un
m o t célèbre que nous rappo rte M . Roma in Ro l land S i vousvou lez bien chanter m a mu s ique
,a l lez entendre la Champ
mesle
Tous les détai ls qu i précèdent ne son t pas inut i les . Ils nous
font vo i r sous quel les cond i tions s’
est accompl i le‘mouvement
que nou s a l lons défin i r, quels en ont été les promo teu rs et les
art isans . Au po in t où nous en sommes,nous pouvons su ivre
l ’évo lu tion des vers français à la fin du XV I I ° s iècle. Nou s t i rerons nos princ ipaux documents des opéras de Lu l l i
,don t nous
savons qu ’ i ls reflèten t l ’art deMo l ière et p lus précisément encore
celu i de Racine. Nous éclai rerons et nous complé terons nos
recherches en nous a idan t de Grim arest et des quelques détai ls
qu i nou s ont é té t ransm is su r la d ict ion de Baron . Nous feronsressorti r que la déclamat ion des novateurs
,ma lgré les profondes
modificat ions qu ’ i ls in t rodu isent au théâtre,est demeu rée une
mélopée. Vo l tai re nous en averti t d ’
ai l leu rs et soutient de son
autori té les pages qu i précèdent : Cet te mélopée, écri t- il en
parlant des acteurs du temps qu i nous o ccupe,ressemblai t à la
déclamat ion d ’
au jourd ’
hu i beaucoup mo ins que norre réc i t
moderne ne ressemble à la man iè re dont on l i t la gazette. Je
ne pu is mieux comparer cet te espèce de chan t qu’
à l’
adm i rable
réci tat if de Lu l l i .
I . R . Ro l land , Or ig ines du théâ tre ly r iquemoderne, p . 260, etMercuremus ical ,
p. 4 .
2 . Vo lta ire,D ictionna ire phi losophique, au m ot : chant.
Revue dephonétique.
3 30 GEORGES LOTE
Si l’
on ouvre Alceste,ou Thésée
,ou Bellérophon,
ce qu i frapped ’
abord , c’
est que Lu l l i marque les accents intérieu rs quej usque—là l ’art dramatique, du mo in s dans les genres noblesles seu l s qu i comptassent ne connaissai t pas . I l est le pre
mier musicien français qu i sache sur quel les sy llabes tomben t leston iques de notre langue. Cet te constatation est d’
une importance
qu i n’
échappera à personne. Le fai t en lu i-même s’
expl ique parfaitement s i l’on veu t b ien se souven i r de quels modèles Lu l l i
s’
est i nspiré . La preuve est désormai s acqu ise que lepprinc ipal but
des efforts de Racine et de Mo l i è re a été de rompre les l ignes
compactes de six sy l labes terminées chacune, dans l’
alexandrin ,
par la césure et par la rime. C ’
est presque un iquement par là
que la Champmeslé et Baron , nous aurons l ’occasion de le m on
trer,
se sont d istingués de leurs confrères . C’
est d ’
ai l leu rs le
pédantisme d ’
une prononciat ion non—accentuée que Mo l i ère
dénonçai t chez les poètes,comme au trefo is Bruscam bille La
date de la t ransformat ion opérée est en effet certaine, et i l fau t
la placer aux environs de 1 660 . Aj ou tons que c’
est peu t—être la
plus cons idérable conquête du vers françai s moderne,en tou t cas
qu ’
el le n’
au ra de comparab le que cel les du romantisme.
Mais i l faut ent rer dans le détai l et présenter un échanti l lon de
la man ièredeLu l l i . Je lu i emprun te un fragmen t de Proserpine 3
LA D ISCO RDE
Orguei l leuse Victo ire, est— ce à toi d’
entreprendre,De m ettre la Discorde aux fers
A quels honneurs sans m o i peux- tu jama is prétendre
1 . Du prédécesseur imm éd iat de Lu l l i à la d irection de l’
Opéra , Cam bert,nous possédons le prem ier actedePomane( 167 1) et leprem ier ac tedes Pla isi rs et
Peines de Ces tex tes , publ iés par Weekerlin, paraissent dém en
ti r formel lement notre rem arque et présentent une m étrique à peu près cor
rec te. C ’
est queWeckerlin a rem an ié les deux ouvrages i l nous le ditafin de rem éd ier à une prosod ie qu
’ i l qual ifie d’ inchantable au jourd ’hu i
(c f. Préf ace de Pomane, p . On se rendra com pte du sty le réel de Cam berten sereportant aux deux exem ples c i tés par l ’éd iteur (ih.
,et l
’
on m esu
rera a ins i tout leprogrès accompl i par Lu l l i .2 . Textes c ités plus haut , p . 3 1 5 et 3 17 .
3 . Paro les deQu inau lt .,
3 3 2 GEORGES LOTE
Les sy l labes atones nou s ret iendront d ’
abo rd,mais el les ne
méritent que de cou rtes observat ions . O n remarquera qu ’
el lessont quelquefo i s de valeu r inégale, mai s que du mo ins Lu l l i aso in de les constru i re en progress ion tempo rel le, confo rmément
aux lo is générales de la déclamat ion En d ’
au tres termes si dans
un groupe métrique la première syl labe a la va leur d ’
une double
croche,la seconde pou rra ê t re no tée par une croche, et la ton ique
viendra ensu i te avec les caractères que nou s a l lons lu i recon
naitre plus lo in . Cet o rdre est rarement t roublé , sauf pour des
raisons qu ’
on peu t a isément défini r °. Q uan t à l ’e muet, i l fau t
no ter que, quant à la du rée, le mu s icien le rattache non po int à
la ton ique dont i l est précédé , mais à la mesure ry thmique su i
vante dont i l parait fo rmer le premier é lément (v . I ) ; à la rime,i l semble rejeté au début du vers subséquent (v . ce qu i
atteste la fo rce avec laquel le i l était prononcé 3
Les sy l labes accentuées sont p lus intéressantes . Aux endroi ts
où el les se rencontrent,el les sont parfai temen t logiques et co in
c ident avec les coupes de sens . Lu l l i , pou r les marquer,emplo ie
indifféremment deux procédés . Ou b ien i l ne leu r acco rde aucun
privi lège tempo rel , mais i l les place au premier temps de la
mesu re mus icale, à cause du frappé dynamique qu i s’
y rencontre.
En vo ic i un exemple,à la tro is ième sy l labe de ce vers
Dans un jour de triomphe, au m i l ieu des pla is irs . (Arm ide, I , I . )
Dan s u n j ou r d e tr i om -
phe_a t t m i l i eu d e s plu i e a i r s
O u bien au contra i re i l fai t de la tonique une longue,et el le
émerge a ins i au— dessus des syl labes vo is ines . Le fragmen t deProserpine transcri t plus hau t présente de nombreux cas de ce
1 . Je renvo ie à m on ouvrage L’
alexandr in français, 1, p . 74-76 .
2 . Cf . p . 3 34 .
3 . Lul l i l’a tténue pourtant quelquefo is en le ba issant de ton par rapport àla ton ique antécédente. Lecerf de la Vievi l le se pla int qu
’ i l alourd it la musique.
DECLAMAT ION DU VERS FRANÇA IS 3 3 3
tra i temen t . Je donne un alexandrin dont tou s les temps marqu éssont reconna issables à leu r du rée plus grande
Revenez , m a ra ison,revenez pour jam a is ! (Atys, I V ,
R é -v e ma s,r ua r a i -s ou
,r e—v e n ez p
ou r j am u s
Cette accentuation , dans ses deux fo rmes , est très net te,et el le
est caractéri stique du s ty le de Lu l l i ; el le ne supporte n i fiorituresn i ornements ; el le est dans une man iè re nettoyée et nue qu i
co rrespond évidemment à la déclamat ion . Lecerf de la Viév i lle
nous at teste la vo lonté du mus i cien d ev iter les o rnemen ts
qu’
adm ettaient ses prédécesseurs Lu l ly , nous d it- i l envoya i t
tou tes ses actri ces à Lambert , pou r qu’
i l leu r apprit sa propreté
du chan t . Lambert leur faisa i t de temps en temps cou ler un pet i t
agrément dans le réci tat if de Lu l ly , et les actri ces hasardaient defai re passer ces embel l issements aux répéti t ions . Morb leu
,
mesdemo isel les , d isai t Lu l ly , se servan t quel quefo is d’
un termemo ins po l i que celu i-l
‘
a,et se levan t fougueux de sa chaise i l n ’
y
a pas comme cela dans votre papier ; et, ven treb leu ! po i n t debroder ie m on réc i tat if n ’
es t fai t que pou r parler, je veux qu’ i l
so i t tou t uni .
I l est no table que les exclamat ions du passage de Proserpine
ci té plu s hau t reço iven t une valeur tempo rel le relat ivemen t con
s idérable qu ’
el les s ’ é lèven t mus icalement au-dessus des sy l labes
avo i s inantes,et ceci est encore cOnform é à ce que nou s savons
de la dict ion du XVI I ° siècle, pu i sque, bien avan t la Champmeslé,
les mouvements pathétiques s ’
isolaient déj à de l’hém ist iche auqueli l s appar tenaient . I l fau t a jou ter
,d ’
une man ière généra le, que sauf
ces acciden ts,le vers frança is , tel que nous le conserve la mu sique
de Lu l l i,demeure raide et san s souplesse. Mais , d
’
autre part, avant
d ’ i n sister su r ce caractère et demon trer à quels signes i l se révèle,
1 . C ité par M. Rom a in Rol land , Mercure musica l, p . 1 I .2 . LeAh ! des v . 4 , 10 et 14 .
3 3 4 GEORGES LOTE
i l n’
est po in t indifférent de fa i re observer qu ’
une certaine chaleurde débi t , encore que fo rt modérée
, se trah i t par des i nd ices certa ins . J
’
ai di t a i l leu rs que dans not re déclamat ion actuel le leston i ques se dép lacent , so i t en pa rt ie, so i t tota lement
,sous l’ in
fluence de l’
emphase et de l ’émo tion . Ces i n tonat ions o rato i resont été no tées, quo ique peu fréquemment
, par l’
at ten tion scrn
puleuse de Lu l l i , et sans dou te dans la propo rtion où el les apparaissaient dans la bouche de ses modè les . I l les marque quelq uefo i s par la durée. Sous cet aspect je les rencontre dans no trefragmen t de Proserpine
‘
, comme auss i dans les t ranscrip tions
puremen t quan titat ives de M . R . Ro l land,chez qu i je t rouve 3 ces
deux vers d ’
Atys et ce vers de Cadmus
l‘
l l J—‘r ï
3’
a i l’”i l e d e l’
… r eu r Don t s on c œ u r es t I’
ll
(AtyS)
t 1‘
t‘
tt'
l‘
1C'c
’:t a as c : pou r p i on -r i r c on . tent
(Cadmus)
Ces valeu rs concorden t abso lument , par leur place, avec ce
qu e l’
analyse phonétique de la déclamat ion d’
au jou rd ’ hu i nous alaissé apercevo i r . O n sen t que la vo ix , avan t d
’
articu ler la ton ique,pren d son po in t d ’
appu i su r la consonne 4par laquel le débu te le
membre métrique. Cependant l ’effo rt n’
es t pas assez vigou reux
pou r dépou i l ler complètemen t la sy l labe accentuée de sa durée
norma le,et cet te sy l labe reste longue.
Mai s Lu l l i connaî t au ss i un au tre procédé pou r tradu i re les
phénomènes orato i res ; i l sa i t exprimer’émo tion sou s son aspect
musical en rendant plus aigu l’
un des é lémen ts qu i , dans un
groupe rythmique, précèdent letemps fort . Son réci tat if, i ci enco re,
1 . Cf. L’
alexandr in f rança is, ch . XI .
2 . Après (v . quand (v . où la prem i ere sy l labe du groupe rythm iquesub it un léger a l longement .3 . Mercure musica l, p . 12- 1 3 .
4 . Dont S’
est C’
est Pour .
3 3 6 GEORGES LOTE
comme nous au rons d’
abondantes occasions de le fai re ressort i r,
pers i ste enco re j usqu’à un certain po int , et , parm i les hypo thèques
don t i l continue de grever le vers , nous signalerons d’
abo rd cel les
qui ont trai t à l’
accen t .
I l est très remarquable que parfo i s nous rencontrons encore de
longues su i tes de svllabes atones que ne vient couper aucune
toni que ; i l arrive même que l’
hém istiche tou t entier forme un
bloc compact où nu l le brisu re ne se révèle : i l demeure d’
un seu l
morceau et s’
étend en une longue l igne invertébrée. S i l’
on se
reporte au fragment de Proserpine t ranscri t plus hau t, on no tera
que l’
accent manque sur les mots su ivants mettre(v . 2) honneurs
et peux- tu (v . 3 cet alexandrin ne comporte que deux temps
marqués) ; la pa ix (V . 5 , I I et tes soins (v . laur iers (v .
la g loire (v . D ’
autre part , à propos des termes pathét iques ou
des mouvements ana logues,l’
Académ ie,dans sa cri t ique du Cid,
se prononça i t cont re un emplo i trop généra l i sé de ces fo rmu les
de pass ion , sans dou te con tra i res a la décence de l’
art class ique.
Or Lu l l i négl ige parfo i s de marquer par un accent les impérat ifs
ou les exclamations du texte ; i l le fai t même en cas de répéti
t ion,a lors que la ponctuat ion sépare les deux termes successifs .
J’
emprunte‘
a Armide deux exemples de ce tra i tement s ingu l ier
pou r nos habi tudes, mais qu i ne sau ra i t nous étonner ou tre
mesu re s i nous songeons â l’étro itesse de la conception esthétique
du XV I I° s iècle. Ce sont ces vers
Sortez , sortez de votre erreur ( I I I ,Fuyez , plaisirs , fuyez , perdez tous vos attra its (V ,
V- V— V
$ or-lez.svr lez d ev oir : e r r eu r Fu o
yez _pl z i -str s _l’
n ye z .per d e: laut—von t tra il!
La césu re et la rime, s i l’
on considère le récitatif de Lu l l i ,at testent , el les auss i , que la transfo rmation de la déclamat ion dra
matique est lo in d’
avo i r é té rad ica le. La césure nous occupera
DECLAMAT ION DU VERS FRANÇA I S 337
d ’
abord . On sai t quel le importance lu i acco rde la poésiefrançaise, quel rô le el le joue dans l
’
alexandrin et le décasyl labe,
où originai rement el le permet à l ’o rei l le de compter les éléments
du vers . I l est évident que, pou r Lu l l i , l’
alexandrin con t inue dese décomposer essen tiel lement en deux part ies égales
,et que, à
l ’ in térieu r des hémistiches , les accen ts ry thmiques n ’
on t qu ’
un
rôle accesso ire. Pou r marquer la césu re,lem us icien usedeplu sieurs
procédés . Le premier consiste à fa i re de la s ixième sy l labe une
longue, et ce tra i tement se ren contre assez souvent pou r q u’ i l
so it inu t i le d’
y i nsister Quelquefo is au contrai re,lo rsque les
nécess i tés de la mesu re empêchent tou te au tre notat ion,Lu l l i
se contente, à d urées égales , de d istinguer la ton ique médiane
par une élévation de l’
acu i té . De cet artifice assez rare, je donnerai
au mo in s cet exemple
H é las ! que mon am our est d i fférent du s ien .
(Arm ide,I I I
,
H è - l a s q u e m on a —m ou r es t d i f— fê -r m l d u s ien
Su rtou t , et c’
est le cas le plus fréquent, i l s’
efforce de fai re com
c ider l ’hém istiche avec le premier temps d’
une mesu re, à cau se
du frappé dynamique qu i affecte cet te place et que renforce
l ’accord des i nstrumen ts . I l peu t y avo i r en ou tre accro issemen t
de la du rée par rapport aux élémen ts vo isins , mais auss i
b ien cela n’
est pas nécessai re, et, dans l’
espri t de Lu l l i , la
posi tion que je viens de défin i r suffi t à fai re naî tre l’
effet cher
ché . Ce tro i s ième procédé se présen te donc sous deux aspects dif
férents,l’
un avec a l longemen t de la sy l labe (I) , l’
au t re sans rien
de,tel (Il)
1 . Cf. Proserpine,-texte ’
c ité , V . 1 .
3 3 8 GEORGES LOTE
Montrez-vous a ses yeux , soyez tém o in vous(Arm ide, I I I ,
S i la guerre aujourd’
huy fa it cra indre ses ravages ,C ’
est aux bords du Jourda in qu’ i ls do i vent s ’
arrêter .(Arm ide, I I I ,
s er -r ê ter
On jugera des inten tions de Lu l l i par un a lexandrin très cu rieux
où i l n’
a pas fai t à la césure l’
élision exigée par le texte ; l’
e
muet y a la même valeu r tempo rel le q ue la ton ique de l’
hém is
ti che,et seu les les atones du groupe ry thmique su ivan t sont mo ins
longues . Cependant c’est la six ième sy l labe qu i supporte l’
accent ,car el le coïnc ide avec le premier temps de la mesu re el le conserve
a i ns i une impo rtance plu s grande que l’é lémen t fémini n qu i lu i
succède. Vo ic i ce vers
Dans un jour de triomphe, au m i l ieu des (Arm ide, I ,
Dans un j ou r lt i 6m -
phe au m i lim'
d es plai s ir :
I l est extrêmemen t rare, que la césure, dans le réci tat if, so i t
négl igée,et je n
’
y ai rencon tré,au cou rs d’
un examen at tent if
de la parti tion d’
Armide, que deux infractions aux principes du
vers c lassique. Ces infractions, on peu t le supposer , son t dues
aux nécess i tés de la phrase mu si cale, à la d iffi cu l té où l ’au teu r
s ’est trouvé de placer la sy l labe forte à l ’endro it convenable ou
3 40 GEORGES LOTE
1 660 ,le texte ne peu t entrainer l
’
affaiblissem ent ou la suppres
s ion du repos exigé par les règles ; mai s au contra i re ce repos
domine la phrase, et l’
on n’ hési te pas à massacrer le vers pou r
le fai re entrer dans son cadre trad itionnel . Ains i , tandis que nous
au rions tendance à couper de la man ière su ivante
I l nous invi te aux jeux ’
qu’
on lui prépare (Arm ide, Pré lude.)N on ! I l faut appeler la H a ine à m on secours I I I ,
Lu l l i écri t bravement , selon l’
usage des comédiens ses modèles
i l fu i t t y pO- l8 1‘ I‘ H i m : nw u s o em :
De ces deux exemples le second est le plus caractéristique, et l’
on
remarquera que le mm la H a ine,mo t importan t et qu i méritai t
d ’être m is en rel ief,a été complètement négl igé .
Après ce qu i précède, la rime ne nous retiendra pas longtemps .
El le est trai tée avec au tant de so in que la césure et se no te de la
même façon so i t par un accro issement de la va leu r tempo rel le,spécialement à la fin de la phrase grammat icale
,là où le sens est
réel lement terminé,so i t par une simple coexis tence avec le pre
mier temps d ’
une mesu re, sans al longement aucun, mais confor
m ém ent à l ’accentuation in tensive de la mu s ique. L’
e muet,
dans les rimes fémin ines , peu t recevo i r la même du rée que la
ton ique don t i l est précédé,mais i l demeu re cependant atone, car
jamais i l ne tombe sur un renforcement dynamique tou tefoisl ’ importance à lu i concédée par Lu l l i nous atteste la vi tal i té qu
’ i l
conservai t au décl in du XV I I ° s i èc le.
I l ressort de ces observations que le vers françai s , à la fin du
règne de Lou is XIV,a évo lué avec la p lus grande modérat ion ,
1 . On se reportera aux textes m usicaux c ités plus haut .
DECLAMAT I ON DU VERS FRANÇ AIS 34 1
et qu’
i l s’
es t p l ié , avec le p lus entier respect , aux serv itudes dela césu re et de la rime
,les deux accents qui le gouvernen t .
L’
absence de variété , le manque de souplesse don t i l témo igneencore, ont vivement frappé M . Roma i n Ro l land : On a loué
,
écrit—i l la vers ification de Mais,en dépi t de tou s
ses efforts, sa déc lamat ion , tradu i te en mus ique par Lu l l i , est
dominée,comme tou te la déclamation du temps
, par l’
accentua
t ion exagérée de la rime dans les vers cou rts,de la césu re et de
la rime dans les vers de douze sy l labes . On trouve dans les opéras
de Lu l l i des steppes de récitat ifs et d ’
airs,où le premier temps
de chaque mesu re tombe avec une ra ideur imp lacable su r la
r ime,ou su r la césu re de l’hexam ètre. C ’
est d ’
une monoton ieaccablante ; et s i c
’
est ains i que la Cham pm eslé déclama i t Racine,
nous au rions quelque peine au jou rd ’
hu i à l ’entendre sans bâi l ler .
Cette dern ière idée, que M . Romain Ro l land présen te sous fo rmed
’
hypothèse, s’ impose à nous avec tou te la fo rce d ’
une cert i tude ;c
’
est_
bien a ins i que la Cham pmeslé interprétai t les poè tes et,en
ce fa isant , el le se conformai t aux indi cat ions de Racine,car
j amais au cune révo lu t ion n ’
est complète et les novateurs,tou
j ou rs,respectent jusqu
’
à un certain po int la trad it ion établ ie. Le
mu sic ien d ’
Armide nous donne d’
ai l leu rs des indicat ions trop
précises et su rtou t trop constantes pou r nous permettre de cro i re
qu ’ i l ne fu t pas un témo in fidèle.
Cependan t i l y a p lus . J’
ai d it que l’
alexandrin , à l ’époque clas
sique,sedécomposai t en deux phrases mélod iques , l
’
uneascendante
jusqu ’à la césure,l ’au t re descendan te j usqu
’à la rime. Cette d iction
sema i nt int fo r t longtemps et le souven i r n’
en avai t po int enco redis
paru lo rsqueAndrieux s’
efforç ait de la décri re, d isan t2 qu ’
el le con
sistait a couper le vers en deux part ies tou jou rs éga les , à marquerconstammen t l’hém i st iche, en élevant et aba issant la vo ix tou r à
tou r,ce qu i formeunecanti lène i nsupportable par son uniformité
1 . Cf. Mercure musical, p . 1 1—12 .
2 . N oti ce sur Mlle Cla i r0n ,en tête des Mémoi res de cette ac tri ce.
3 42 GEORGES LOTE
O r Lou is Racine, dans un passage que j’
ai cité,laisse entendre
que son père fu t l ’ennemi de cette déclamat ion chantante. Que
faut- i l penser de cet te assertion On do i t se souveni r que Lou isRacine écri t au XV I I I° siècle, à un momen t où le goût a évo lué
et où certains cr i t iques tenten t de susc iter une nouvel le réforme.
A cette quest ion de savo i r s i,sur le po int don t i l s ’
agit,Jean
Racine fut vraimen t un précu rseu r, le réc i tat ifde Lu l l i , d’
acco rd
avec l ’auteu r des Entretiens ga lants , nous appo rte une réponsenégat ive. I l es t en effet très remarquable que le schéma du verschan té s ’ impose t rès fréquemment à Lu l l i
,malgré les dérogat ions
que la mus ique entraine forcémen t et la l i berté natu rel le dont el le
jou i t . Lepassage deProserpine t ranscri t p lus hau t cont ient p lusieu rs
a lexandrins conçus selon la formu le que je viens de d ire Sans
dou te i l ne fau t pas s’
attend re à rencontrer sans cesse comme
une man ière de gamme qu i , commençant à s’é lever dès la pre
mière sy l labe, a tteint son po int cu lm inant sur la s ix1em e et
s ’abaisse ensu i te progress ivement jusqu ’à la douz ième. Ce type se
rencon tre,ma is le p lu s souvent , i l sub it quel ques a l té rat ions
tou tefo is , même dans ce dern ier cas, on reconnaî t faci lemen t la
modu lation o rigina le que s’
efforce de rendre le mu sic ien el le se
pou rsu i t parfo i s sur une su i te de p lusieu rs vers . J’
em prunte ces
alexandrins à l ’opéra d’
Armide
Dans un jour de triom phe, au m i l ieu des p la isirs,Q ui peut vous inspirer une som bre tristesse ?La g lo ire, la grandeur, la beauté , la jeunesse,
Tous les biens com blent vos dés irs .
I . V . 1, 7 , 8 , 9 .
344 GEORGES LOTE
qu ’
el le s’
est imposée à Lu l l i , a bien souvent en levé à sa musique
la vérité qu ’
on en attendrai t . J .
—J . Rousseau ,c rrt1que d
’
Arm ide,
en a blâmé ce vers
Plus je le vo is , plus m a vengeance est va ine.
I l a reproché â Lu l l i de n’
avo i r pas fai t s’ é lever vio lemment la
phrase jusqu ’
au m o t vengeance pou r la la isser retomber ensu ite
doucement sur va ine. L’
observat ion est t rès j uste,mai s la césure
se dressai t comme un obstacle devan t le mu sic ien,et el le l’a
empêché d’
accorder au texte tou te sa va leur émot ive. Le”
même
Rousseau a protesté éga lement con tre les chutes un iformes de la
vo ix à la fin des vers,
ces cadences parfai tes qu i tomben t s i
lou rdement et son t la mort de l ’expression Ici encore i l a
rai son,mais l ’esthét ique c lass ique en est seu le responsable
c’est el le qu i ramena i t invincib lement le réci tat if vers ces formu les
mono tones .
Le pathétique de la déclamat ion ,pendan t la période qu i nous
occupe, est donc en somme assez maigre. Nous en jugerons
encore, d’
après l ’opéra, par la d ispos i t ion et la valeur des s i lences,
qu i son t tou j ou rs , dans les parti t ions de Lu l l i , commandés non
po int par les nécess ités de la respirat ion 3,ma is par la qual i té
l i ttérai re du texte proposé . Q ue les réfo rmateurs , à la fin du XV I I"
s iècle,aien t réa l isé sur ce chapitre un progrès cons idé rable,
cela
n ’
est po int dou teux . Gr im arest,trai tant de la quest ion
,fait bien
senti r qu ’ i l défend des idées nouvel les . Écou tons- le C’
est un
grand agrément,écri t—il 4
, de ménager à propos des s i lences, et
N ous vous Seigneur, vous changez de visageje la comm entera i plus lo in à un autre po int de vue. Mais je do is fa ire obser
ver dès m a intenant que, au l ieu de porter atteinte à la suspens ion de l’
hém is
t iche,el le est au contra ire ca lcu lée de façon à la fa ire valo ir et qu
’
el le la res
peete en effet .I . J . .
—J Rousseau ,Lettre sur la musiquefrança ise.
2. lb .
3 . Pour renouveler ses provis ions d ’
a ir,le chanteur .do i t donc prendre sur la
va leur des n0tes . I l e n est de m ême au jourd ’hu i . ”
4 . Traité du récitatif, VI I .
DECLAMATION DU VERS FRANÇ A I S 3 4 5
des soupi rs dans les grands mouvemen ts , comme on a accou tumé
de le fa i re dans — la mu s ique. Tou te la scène de Phèdre avec sa
confidente do i t ê tre o rnée, dans la prononciat ion ,de ces soupirs
et de ces s i lences, p lu tôt que de réci ter avec emphase tou s lesvers qu ’
el le con t ient, comme fon t presque tou tes les personnes
qu i se mêlent de déclamer . Car cetteman ière de prononcer enfléene marque po in t assez l ’éta t v io len t où Phèdre se t rouve
,et ne
convient pas la s ituat ion d ’
une femme prê te à m ouri r de lapass ion qu i la dévore. Quand on veu t trop fa i re va lo i r le vers ,on d iminue l ’effet de la pass ion i l m e semble qu ’
une vo ix p la int ive et fo ib le, entrecoupée de s i lences et de soupirs
,expose beau
coup m ieux au spectateu r les mouvements dou lou reux de cette
scène.
Vo i là don c la théo rie, et el le no us fa i t assez vo i r à quel po intel le se sépare de l ’u sage reçu ,
pu isqu ’
el le se présente avec tou tes
les apparences d ’
une nouveau té . I l fau t en conclu re qu ’
avant
Racine et Moh ere,la tragéd ie ne connai t pas, ou presque pas , les
pauses express i ves . Exam i nons cependant la pratique, et nous
al lons nou s rendre compte que la réfo rme reste enco re t imide,
q ue l’
on a b ien de la peine à briser les masses compactes du
vers,et q ue les l ibertés modernes son t b ien lo in d
’ ê tre con
qu ises .
A en cro i re Grim arest,la prem iere cond i t ion d ’
une bonne
lectu re est de marquer exactement la ponctuat ion , d’
acco rder la
plu s longue pause au po int , un mo indre repos aux deux points ,plus de si lence au po in t et v irgu le qu
’
à la virgu le, laquel le est
presque impercepti ble I l fau t observer cette maxime dans la
Poés ie,a jou te—t— i l
,encore plus que dans la Prose parce que l
’
on
ne do i t po int , pou r b ien réci ter des vers , s’
arrê ter à la r ime ny
la césu re, à mo ins qu’ i l n’
y ai t un po in t,et que le sens ne so i t
parfa i t . Ce n’
est pas ce que les lecteu rs ord inai res observent ; i ls
ont accou tumé de b ien fai re sonner l’
un et l ’au t re. Cela est
1 . Op . ci t. , I I I .Revue de phonétique.
346 GEORGES LOTE
parler d’
or,et ces enseignemen ts , si on les prenai t au pied de la
lettre,ne tendraien t rien mo ins
,dans la poés ie
, qu’
à rendre domi
nantes les coupes de phrase, au l ieu des coupes a place fixe ex i
gees par l’
usage. Tou tefo is,s i l’on cons idère l ’appl icat ion
, on est
confondu en constatant combien Grim arest manque de hard iesse.
Vo ic i un passage de Bo i leau t ranscri t par lu i avec les ponctuat ions tel les qu ’ i l les note à l ’ i n térieu r du vers
Votre race est connue.
Depu is quand ? Répondez Depu is m i l le ans ent iers ;Et vous pouvez fourn ir ? Deux fo is sei ze quart iers .
C ’
est beaucoup m ais enfin les preuves en sont c la ires ;Tous les l ivres sont pleins des t itres de vos pères .
Leurs nom s sont échappés du naufrage des tem s
Ma is, qu i m
’
assurera qu’
en ce long cerc le
Sauf dans les deux dern iers a lexandrins , i l n’
y a r ien là qu i neso i t conforme à la plus étro i te trad it ion . De nos jou rs le plus
obscur comédien aurai t et i l n ’
est pas beso i n d’ i nsi ster
d '
au t res audaces
Mais enfin venons—eu à l ’opéra et aux documents qu ’ i l nous
apporte Lecerf de la Viévi llenous avert it que Lu l l i est un témo in
très exact,car dans sa musique, nou s d i t— i l in terruptions
,
soupirs,pau se
,le mo indre demi—soupi r a sa beau té Ceci
semble beau coup promettre. On remarquera en effet,s i l
’
on se
reporte au fragmen t de Proserpine transcri t plus hau t, que le
s i lence expressif ne double pas la césu re et la rime, mais qu ’ i l
sou l igne su rtou t les exclamat ions du texte. Aux exemples con
tenus dans ce passage, je jo i ndra i les deux su ivan ts , pris au hasard
dans Armide
Q uoy Céder sans rien entreprendre ? ( I I I ,Arm ide
,vous m ’
allez qu itter ? (V,
1 . l b.
2 . Op . ci t. , I , p . 67 .
3 48 GEORGES LOTE
Cen t ans p lus_
tard les mus ic iens rendron t les m ouvementé de
pass ion les plus vio lents par des répéti t ions de mo ts doubles ou
t riples,avec chaque fo is un long si lence. Pou r le moment les vers
restent lou rds et mass ifs ; i l s se succèden t pour a ins i d i re sans
in terruption comme s’ i l s étaien t l iés les uns aux au tres et chacun
dans tou tes ses part ies . A pei ne, dans toute la parti t ion d’
Armide,
rencontre—t-ou deux réci tatifs où Lu l l i admet des pauses fré
quentes , afin de rendre l’
exceptionnelle agitat ion des sent iments .
L’
un se t rouve au second acte (Enfin, il est en ma
l ’autre est tou t à la fin de la tragédie, lo rsque Renaud qu i t tel ’héroïne. Je donne ce dernier fragment .
Renaud ! C iel ! ô m ortel le peine !Vous partez , Renaud ,
vous partez !Dém ons ! su ivez ses pas, vo lez et l
’
arrê tez !
H é las ! tout me trahit et m a pu issance est va ine !Renaud ! c iel ! 0m ortel le peine !Mes cris ne sont pas écoutésVous partez , Renaud , vous partez (V , 4
c r i : n e s on t pa s e -cou te’
: N ou s
C’
est là le max imum de ce que l’
art classique peu t concéder .
Or les plus fort s si lences ne dépassen t po int la va leu r d’
un temps ,et ils ne lai ssen t aucune place pour un jeu muet qu i sera i t p lu s
express ifque les paro les . Je le répète, une d ict ion auss i ha letante
et auss i entrecoupée est extrêmemen t rare chez Lu l li , et cepenj
DECLAMATI ON DU VER S FRANÇA I S 3 49
dant,lorsque nou s la rencont rons , de quel pathétique restrein t
n’
es t-el le pas la preuve. Vis i b lemen t le music ien n’
établit pas de
d ifférence ent re les sent iments qu i se dispu tent le cœu r d’
Ar
mide. Qu’
el le s’
adresse à Renaud ou aux Démons , qu’
el le se
lamente sur son impu i ssance ou qu ’
el le veu i l le lu tter contre lesort pou r reten i r son amant
,partou t le mouvemen t reste le
même et les interru ptions semblables .
Ces i nsuffisances ont frappé J .
—J . Rou sseau . Examinan t le rec itat if du second acte dans la m ême tragédie, i l y a cri tiqué une
certai ne pauvreté dans le rendu de l ’ émot ion . A propos de ce
dist ique
Par lui tous m es captifs sont sort is d’
esclavage
Qu ’ i l éprouve toute ma rage !
i l fai t cette remarque Le mu sic ien a bien vu qu ’ i l fallo itmett re un i n terval le en t re ces deux vers et les précédens , et i l afai t un s i lence qu ’ i l n ’
a rempl i de r ien , dans un moment où
Arm ide avo i t tan t de choses à sent i r , et par conséquen t l’
or
chestre à exprimer . Après cette pause,i l recommenceexactement
sur le même ton,su r le même accord,su r la même note par où
i l vien t de fin ir . D ’
une man i ère généra le tou te la scène lu i
semble m al conçue. I l reproche à Lu l l i de n y avo i r pas reprodu i t
ni°
opp05 é suffisammen t les deux passions qu i partagen t Arm ide,
l ’amou r et la haine,comme aussi den
’
avo i r po i n t rompu les
l iai sons harmon iques en tre les d ifférentes par t ies du vers graves
erreurs selon lu i, a lors que le déso rdre et l’
agitat ion devraient
marquer tou t le passage. I l faut vo i r cependan t dans tous ces reci
tatifs d’
opéra l ’ image exacte de la déc lamat ion tel le que l’
entend
l’
éc01e de 1 660 . Des comédiens qu’
el le a fo rmés, Baron est sans
dou te celu i qu i a osé le plus de s i lences et qu i a été le plus révo
lu ti0nnaire. Du mo i ns on peu t le supposer d’
après les i ndications
quenou s fou rn i t l’
abbé d ’
Allainval La demo isel le Lecon
1 . Lettre sur la musiquef rança ise.
3 5 0 GEORGES LOTE
v reur , nou s d it- i l ‘
,avo i t l ’espri t El le n
’
a jamai s gâté
de vers en les réci tant el le ne les faiso it sent i r qu’
autant qu’
i l
le fallo i t,et el le ne se donno it po int la peine de les a l longer par
des oh ah eh que Baron in trodu is i t dans ses dern ières années .
I l m e reste, pou r tou te cette période, à rechercher comment
les acteu rs u t i l isaien t leu r vo ix,quel part i i ls en savaien t t i rer
,à
quel les règles obéissai t l ’art dramatique. Tou t d ’
abord les novateurs laissen t intacts le principe de la séparat ion des genres . Gr imarest d ist ingue so igneusemen t la comédie de la tragédie
,et la
comédie el le—même se présen te sous deux aspects b ien t ranchés
el le est bu rlesque ou sérieuse,et dans ce dern ier cas el le se rap
proche de la t ragédie. Dans ses formes les plu s caractéristiques,
el le do i t rendre avec précis ion le parler o rd inai re des personnages ,copier exactemen t les intonations par où i l s sont reconnaissables .
Ce son t là les préoccu pat ions deMo l iè re et les leçons qu ’ i l donne
à sa troupe Ce n’
est po int l à le ton d’
un marqu is,l isons-nous
dans l’Impromptu de Versa i lles . I l fau t le prendre un peu p lu s
hau t O u enco re : Bon , Vo i là l’
au tre qu i prend le ton de
marqu i s Vou s ai-je pas d it que vous fai tes un rôle où l’
on do i t
parler natu rel lemen t Mais Grim arest descend dans le détai l .
I l spécifie que la vo ix com ique cons iste à imiter parfai tement lechevrotement d
’
un viei l lard,le ton d
’
un fat,d
’
un pet i t m ai tre,
d’
un impo rtant , la prononciat ion traînante d’
un No rmand,
l ’accent de fau sset d ’
un Gascon ou‘
d’
un ivrogne, la lourdeu r d’
un
Su isse, d’
un va let d’
un paysan .
Quant à la tragedie, qu i nou s importe su rtou t, l’ idéal esthétique
ne paraî t pas avo i r beau coup changé depu is 1 600 . C ’
est tou
jours, dans l es grandes l ignes,le même art intel lectuel, visan t
1 Lettre sur Baron etJla demoiselle Lecouvreur .
2 . Impromptu, ç sc . I I I et IV .
3 5 2 GEORGES LOTE
Baron essaya de rompre avec ces préceptes I l déc lamai t
quelquefo is le même couplet,nous di t Ti ton du Ti l let de deux
ou tro is mani ères différentes , qu i étaien t égalemen t applaudies .
Mo l iè re lu i-même mais dans la comédie, comme sans dou teBaron tenta
,au témo ignage deM"° Po isson quelques nou
veau tés : Pour varier ses inflex ions,i l mit le premier en uSage
certains tons inus i tés, q u i le firent d ’
abord accuser d ’
un peu d’
af
fec tation,ma is auxquels on s
’
habitua . Cependant,dans l’en
semble, i l n’
y eu t pas de changement , et l’
on conserva l ’ancien
u sage. Gr im arest en effet , qu i c lasse un certa in nombre d rntona
t ions,ne s
’écarte pas des grands principes de l’
art class ique ; i l lus
t rant ses enseignements par des exemples un iquement pris à la
tragéd ie,i l ne conço i t po int que les tons définis par lu i pu i ssent
cesser à un momen t quelconque de s’
appl iquer aux sentiments
qu’ i l énumère,et ses indicat ions sont va lables pou r des fragments
tou t ent iers,sans variat ions part icu l ières d ’
un vers à l ’au tre.
I l admet d ’
abo rd des di fférences d ’ intensi té . Selon lu i l ’amou r
compo rte tro is expressions possib les s i l’on en ressent la dou
ceu r,la vo ix do i t ê tre flatteuse et tendre ; s
’
i l donne de la jo ie ,la vo ix do i t être gaie ; s i l
’
on soufl re, el le do i t ê tre plaint ive. La
haine veu t de la rudesse,de
’âpreté et de la sévéri té . Quant audés i r
,i l fau t d istinguer : ou bien i l p rovien t de l ’amou r
,et alors
i l exige une certa ine modérat ion ; ou bien i l est provoqué par la
rés istance,et a lo rs i l se t radu i t ‘
a peu près comme la co lère ; ou
bien i l se garde de tou t excès, et dans ce cas , i l fau t le rendre par
des inflex ions dénuées de véhémence ; ou bien i l est langu i ssan t
et,comme tel, i l demande une vo ix dou ce et in terrompue . Pu is
viennen t la jo ie,avec des tous p lei ns et faci les , sans t rop de force ;
1 . Titou du Ti l let, Elog e histor iqued’
Adr ienne Lecouvreur (c ité par MonvalPréface aux lettres de l ’actrice) i l ne peut s
’
ag ir ic i que du Baron des dern ièresannées .
2 . Mer cure de F rance, m ai 1 740 .
3 . Tra i té du r éc i tatif , VI I I . J’
em ploie les termes m êmes de Grimarest , ou
bien leurs équ ivalents les plus exacts .
DECLAMAT ION DU VERS FRANÇAI S 3 5 3
la tristesse,avec des intonat ions fai b les, traî nantes et plain t ives ;la confiance, avec uneexpression fermeet éclatante ; ledésespo i r,
qu i veu t des teintes ou t rées et vio lentes ; la j alousie, pou r laquel leconvien t une vo ix hard ie ; la co l ère, qu i exiged es éclats et de lav éhémen
'
ce, pou rvu tou tefo is qu ’
el le n’
ai lle po i n t sans la vo lontéde se venger Enfin , lo rsque le texte contient une gradat ion ,Grim arest recommande une paro le pleine et sans t imidi té qu i se
renforce progress ivemen t jusqu ’
au dern ier terme de la figu re.
Quan t à la hau teur mu sicale, les prescript ions ne sont pasmo ins précises . Grim arest
,et i l est le premier à le fai re
,condamne
la vo ix de fausset . Plus part icu l ièremen t i l nou s indique comment
les comédiens do iven t se serv i r de leu r o rgane selon les sent imen ts
qu ’ i l leu r fau t tradu i re. La haine réclam e parfo is une vo ix sourde
et gron dante ; le désespo i r veu t des intonations aiguë s ; la co lè re,s i el le est simple
,do i t se mouvo i r dans des no tes hautes ; s i au
con t rai re el le compo rte une menace, el le exige des tous ému s et
médiocrement élevés ; l’ i ronie ne va pas sans des inflex ions traî
nan tes accompagnées d’
un demi— sou ri re Quan t aux figùres
de rh étorique, el les ne son t pas ou bl iées et son t l’
Objet de
remarques minu t ieuses . I l sied que pou r l’
apostrophe, l’
anthi
th èse, le serment , on use du p lein médium, que pou r l
’ i n ter
rogat ion et l’
exc lam ation,tou t en observan t les degrés de force
convenab les, on déclame sur des notes é levées
Vo i là,semble—t—i l
,bien des nuances, et l
’
on peut découvrir
dans ces préceptes tous les germes de l’
art dramat ique moderne.
I l est évident,d ’
après ce qui précède, que dès la fin du
XV I I ° s iècle on commence à senti r quel s effets on peu t ti rer de
l ’ in tensité et de la hau teu r mu sicale pou r rendre sensibles à
l ’orei l le les d iverses passions humai nes . Mais ce ne son t encore
que des vel l é i tés, car de t rès impor tants correctifs v iennen t l imi
1 . On se reportera aux textes d ’
Arm z‘
de c ités p lus haut , et l’
on verra queLu l l i
,le plus généralem ent
,ne m anque pas de conférer une acu ité plus grande
aux exc lamations et aux termes pathétiques .
3 5 4 GEORGES LOTE
ter la l iberté de l ’acteu r en ann ih i lant pou r a ins i d ire les conces
si0ns théoriques qu ’
on lu i fai t . De la so rte les tirades des t raged ies continuent " ê tre comme des solos de virtuose où le comédiendo i t surtou t fai re valo ir un organe sonoreet bien t imbré . Grim arest
en eflet nous découvre le princi pe supérieu r qu i conserve à lapoésie, dans les grands genres , une expression un iforme et rud i
m entaire. Ce qu i fai t la d ifférence du comi que et du tragique,
nous d it- i l expressément,
c ’est la d ifférence des personnes etdes caractères : le ro i
,le héros
,le grand homme, n
’
on t po int le
ton du bourgeo is celu i— cy ne prononce po in t comme un
paysan , comme un va let . C ’
est cette d i fférence, qu i est plus
étendue dans le comique que dans le sérieux, qu i m e fero it dire
qu’ i l est plus di ffici le de déclamer ou réci ter une comédie qu’
une
t ragédie Cet te dern i ère phrase est d ’
une portée cons idérableains i
,dans la t ragédie
,tou s les personnages étant d ’
u ne condi t ion
éminente,ne peuven t parler qu ’
avec cet te ma jesté sou tenue,avec
cette un i té de ton qu i est l’
un des caractères les plus essen tiels de
l ’esthét ique c lass ique.
Cons idérons cependant le déta i l . Avant la réfo rme tentée par
Mol ière et par Rac ine, la déclamat ion étai t emphat ique et véhé
mente, selon l’ idée abstraite,
nettemen t exposée par d’
Au bignac ,
que l’
on se faisai t de la dign ité roya le. L’
I rnpromptu de Versa i lles
ava i t essay é de réagir . Mais Mo l ière fu t impu issant à convaincre
le pu bl i c et , pou r rappeler le témo ignage de Mlle Po isson ,i l se
renferma dans un genre où ses défau ts é ta ien t p lus supportables
Sûr le chapitre de la dépensede force, Grim arest s’
expliqde clai re
ment : Comme les spectacles , d it- i l , se donnen t dans des l ieux
beau coup plu s vastes que ceux où l’
on fai t des un acteu r
do i t avo i r une po rtée de vo ix beau coup p lus forte que celu i qu i
fa i t une lectu re. C’
es t implici tement une invi tat ion a crier
Mai s voici qu i est mieux encore Qu’
un acteur ne négl ige
1 . Op . ci t.,ih
3 5 6 GEORGES LOTE
paro le, et i l n’
y a pom t d’
a rt si el les ne sont exactement obser
vées . Donc s i Grim arest nous parle d’
intonations graves et d’
in
fiex ions a iguë s, i l ne peut s’
agi r là que de cas exceptionnels , car
les ports de vo ix et les grands interv al les cont inuent d ’être à lamode
,tandis qu ’
on n’
a ime pas une paro le don t les mouvements
n’
em brassent qu ’
un pet i t nombre de tons .
°
Sur ce po in t Grim arest
n ’
hés i te pas Dans la déclamat ion , nous d it- i l l ’étendue dela vo ix do i t être plus forte que cel le du réci t part i cu l ier . Pou rlu i le comédien idéal est celu i qu i possède un o rgane comparable
à Celu i d’
un chanteu r,de façon qu ’ i l pu isse parcourir p lusieu rs
octaves en produ isant partou t la même pu reté et la même ampleur
de son : I l y a même beaucoup d ’
o rganes,l isons—nous
2
, qui
peuvent fou rni r une vo ix fo rt nette et trés-gracieuse dans le plus
hau t ton de la déclamat ion, qu i dans le bas sont confuses et
obscu res . Et d ’
au tres,au contrai re
, qu i ont le bas de la vo ix fo rt
d istinct et agréable, qu i sont fausses et confu ses dans le hau t . A
cette observat ion i l fau t jo indre la su ivante, qu i a plus part icu
lièrem ent trai t au timbre Les vo ix trop clai res ne devro ient
jamai s.
prendre de grans ro l les , parce qu ’
el les ne conviennent
po in t à la noblesse des personnages que l’
on m et su r la scène, et
parce qu ’
el les ne son t po in t su sceptib les d’
inflec tions assez sen
s ib les pou r trai ter une passion ä Rappelons enfin que si Mo l i ère
échoua dans la tragédie, c’
est qu ’ i l posséda i t un organe dur et
sou rd et qu ’ i l y variai t trop ses in tonations i l resso rt de tou t
cec i que, su r le pomr qu i nous occupe, i l n’
y a pas eu ruptu re
complète avec le passé .
Les variations de vitesse au ra ient pu être d’
un grand secou rs
pour donner aux passions l’
express ion qu i leu r convien t . Or i lsemble bien qu ’
elles so ien t encore inconnues dans la tragédie, où
l’
on aime avant tou t les mouvements lents,les seu l s qu i so ient
I . Op . c i t . ,i l) .
2 . Op. c i t.,ib.
3 . Ains i Lulli a écrit le grand prem ier rôle de son Cadmus pour une vo i xde baryton . U n music ien d ’
au jourd ’
hu i cho isira it un ténor .
DÉCLAMATION DU vmrs FRAN Ç AIS 3 37
conformes à la noblesse de l ’action . Mohere,et je reviens au
témo ignage de Mlle Po isson avait une vo l ubi l i té de langue qu iprécipi tai t trop sa déclamation . Mais su r ce po int i l céda au goû trégnant, et i l se p l ia , avec peine i l est vra i
,aux exigences du
publ ic . I l eût même,affi rme la même actrice
,bien des difficu l
tés à y réuss ir , et ne se co rrigea de cette vo lub i l i té,si contra i re
à la bel le art icu lat ion , que par des efib rts cont inuel s . Ic i enco rei l nous fau t consu l ter Grim arest . I l i nsiste su r la nécess ité d’
un
débi t ma jestueux et pesan t : La langue franço ise,écri t—i l 2
,veu t
ê tre prononcée gravement et noblemen t ainsi i l ne fau t j amais
préa p1ter son réc i t car non seu lement l ’auditeur ne pourro i t
su ivre,mai s encore i l est rare qu
’
en p réc ipitant sa paro le, on pu issedonner à chaque s i labe sa quanti té dans sa ju ste propo rt ion .
Ce que nous savons des comédiens,pendant cette période de
t ransi t ion,confirme l ’exposé théorique qu i précède . Les cri
tiques nous ont transm is quelques -unes de leurs intonat ions,
mais les trouva i l les q u i ont susci té le plu s d’
en thousiasme,cel les
que l’
on a no tées comme des i nventions heu reuses et d ’
une per
fec tion tou te exceptionnel le, ne nou s para issen t po int dépasser
ce que le théâ tre moderne nous fai t entendre j ournel lement . Et
cependant l’on voudra bien réfléch i r que, si el les nous ont été
conservées,c’est qu ’
el les dépassaient de beaucoup les productions
de l’
époque. De ces in tonat ions la plu s remarquable est cel le q u
Rac ine ava i t enseignée à la Champmeslé,et que nous connaissons
par l’
abbé Du Bos . El le t i re tou te sa va leu r de l’_
0pposi tion de deux
registres, du contraste entre des no tes aigu ë s et des no tes graves
vio lemment j uxtaposées . Racine,nous d i t l
’
abbé Du Bos 3 , avo i t
appri s à la Cham pm eslé à baisser la vo ix en prononçant les vers
su ivants,et cela encore plus que le sens ne semble ledemander
1 . Mercure de F rance,m ai 1740 .
2 . Op . ci t.,ib. L
’
opéra de Lu l l i juxtapose parfo is , mais rarement, des’
m ou
vem ents d i fférents . Cf. , à propos d’
Arm ide, quelques observations de Lou isRac ine : Réflex ions sur la poesie, Paris , 1 747 , t . I I I , p . 167
— 170 .
3 . Du BOB. Réflex ions cr i tiques sur la poés ie et la peinture, I I I , 144 .
U)
V\
03
GEORGES LOTE
S i le sort ne m ’
eût donnée à vous,
Mon bonheur dépendo it de l’
avo ir pour époux .
Avant que votre am our m ’
eût envoyé ce gage,
N ous nous
afin qu ’
el le pû t prendre faci lement un ton à l’oc tave au—dessus decelu i sur lequel el le avo i t d i t ces paro les N ous nous a im i0m
,
pour prononcer Seigneur , vous changez de visage Ce port
de vo ix extrao rdina i re dans la déclamat ion éto it excel len t pou r
marquer le déso rdre-d ’
espri t ou Monime do i t être dans l ’ i n stan t
qu ’
el le aperço i t q ue sa faci l i té à cro i re M i thridate, qu i ne cher
cho i t qu’
à ti rer son secret,vien t de jeter el leet son amant dans un
péri l extrême. L’
effet à coup sû r est saisi ssan t,mai s i l ne change
rien au principe du vers chanté nous avons affa i re à l’
un de ces
grands in terval les qu’
aim ait l ’époque. I l n ’
a d ’
au t re mérite qued ’être ic i en s i tuat ion , et d
’
avo i r é té préparé,su r les vers précé
den ts, par une mélodie part icu l ièremen t grave qu i lui donne tou t
son rel ief ; la modu lat ion,au l ieu d ’être continue
,procède par
un sau t brusque, ma is el le ne change que dans son degré, non
pas dans sa nature .
Ces nuances cependan t , dans la d ict ion de la Champmeslé,
étaient sans dou te très rares . L ’
au teu r des Entretiens ga lans en
1 68 1 vante la souplesse de son o rgane ; i l déclare qu’ i l n ’étai t po int
nécessai re de lu i fai re ces recommandations de Bo i leau
I l faut dans la dou leur que vous vous aba iss iez ;Pour m ériter des p leurs , i l faut que vous pleuriez ,
car el le s’
en acqu i t tai t natu rel lement et fort b ien ,de tel le façon
que les audi teu rs versa ient des larmes . Ma is tou t est relat if,et
,au
momen t où l’
art dramat ique commençai t à évo luer , i l fa l la i tapparemment peu de chose pou r émouvo i r les spectateu rs . Des
détai ls p lu s précis nou s permetten t d ’
en juger . Lou is Racine ne
nie pas qu’
el le pou ssa i t de grands éclats de vo ix et qu ’
el le avai t
une déclamat ion enflée et chantante. Le souven ir s’
en perpétua
3 60 GEORGES LOTE
gan te criai l lerie qu i passe à chaque instant de bas en hau t et dehau t en bas
,parcou rt sans su jet tou te l ’étendue de la vo ix
Mai s vo i ci une derniè re at taque,très j uste au po int de vue
abso lu,mai s non pas s i l
’
on considère l ’époque où le mus i cien a
accompli son oeuvre D i tes-m o i , je vous prie, quel rapport
vou s pouvez t rouver en tre ce réci tat if et no tre déc lamation .
Commen t concevrez—vou s jama is que la langue française, dont
l ’accent est s i uni , si s imple, s i modeste,s i peu chantan t , so i t
b ien rendue par les bruyan tes et criardes intonations de la paro le
et ces tons sou tenu s et renflés , ou plu tô t ces cris éternels qu i font
le t issu de cette part ie de n0tre mus ique encore p lus même que
des a i rs ? Qu’
on m e montre au mo ins quelque côté par lequel on
pu isse ra isonnablemen t vanter ce mervei l leux réci tat if français
dont l’
invention fai t la glo i re de Lu l l i
De Baron ce que nous savons est peu de chose. Son jeu suffi
sai t à Racine qu i voya i t en lu i un comédien supérieu r à tou s les
autres acteurs du temps, et qu i s’
en remettai t à son génie, sans
indications particu l ières, pou r trouver les inflexions convenables
I l est sûr qu’
à la fin de sa carr ière,i l se permit des audaces que
la Cham pm eslé n’
avai t pas connues . I l ne crut po i n t qu’ i l étai t
obl igato i re de tou j ours crier,et i l osa, lorsque la s i tuation l
’
exi
gea it , par ler avec une fo rce modérée. D’
H annetaire nous apprend
que le publ i c lu i marqua quelque rés istance Comme i l diso i t
fort bas ce vers
O ui , c’
est Ag amemnon,c
’
est ton ro i qu i t’
éveille,
on lu i cria Plus haut S i je le disois plu s haut , je le diro is
plus m al,répond it— il fro idemen t
,et i l cont inua son rô le 2
.
Rémond de Sain t—Al b ine nous rapporte également qu ’ i l tâcha i t
1 D’
H annetaire l‘
a r t du coméd ien (2° éd it . , p . 32 3) faisant répéter une deses p i èces , R ac ine setourna vers Baron et lu i d it Pour vous
,m ons ieur
, je n’
a i
po int d’ instruct ions à vous donner votre âmeet votre gén ie vous en d iront plus
que m es leçons n ’
en pourro ient fa ire entendre .
2 . D’
H annetaire,ih.
, p . 1 67 .
3 . Rémond de Sainte—Alb ine Le Comédien,I I
, 1 2 . Cf . aussi Cham fort et de
DÈCLAMA'Ï IÔ N D! VERS FRANÇAIS 3 61
d ’ interpréter la poésie en tenan t compte du sens . Lorsqù’
au der
n ier acte de Polyeuc le Sévère d i t à Fél ix et à Pau l i ne
Servez b ien vo tre D ieu , servez votre monarque,
Baron prononça i t le premier hémist iche en ph i losophe to l érant,
peu sou c ieux de foi rel igieuse, mai s au con trai re i l enfiait le tonsur la fin de l
’
alexandrin, voulan t marquer par là que la fidél i té
à l ’empereu r est un devo i r don t on ne peu t se d ispenser .D ’
après Chamfo rt et de la Porte,lOrsqu
’
il adressai t à Andromaque cet alexandrin
Madam e, en l’
em brassant,songez à le sauver
,
i l em ployai t, au l ieu de la menace,l ’express ion pathét ique de
l m térêt et de la p it ié ; i l a jou ta i t même au premier hémisticheun geste tou chant, semblant ten i r Astyanax entre ses main s et leprésenter à sa mère. Tou t cela
,sans dou te
,n ’
est pas m al mai s,
encore une fo is, s i je cesse de cons idérer l’époque
, je ne voi s pas
dans ces i n tonations le signe d’
un bien grand ta len t .
I l es t temps de résumer et de conclure. Les pages qu i pré
cèdent ont montré quel le fu t l’évo lution de l ’art dramat ique et
du vers frança is dans les derni ères années du XV I I° s i ècle.
O n cont inua d ’
a imer les cris forcenés , les mod u lat ions
grande é tendue tona le q u i ava ient charmé les contempo rains
de R ichel ieu . Les ports de vo ix , qu i permet taien t d’
apprécier
les ressources d ’
un bel organe,conservèrent la faveur du publ ic .
De plus,ce que les d ivers témo ignages fon t lumineusement
ressort ir , c’
est que, malgré les enseignements de Mo l ière
et les hard iesses parfo i s agress ives de Baron , la tragéd ie demeurafidèle à son ancien idéa l de pompe et de m agnificence. Et cepen
dan t,sur un po int
,les novateurs eu rent ga in de cause; sur un
po in t, tou jou rs dans le cadre de la décence et de la ma jesté c las
la Porte D ictionna i re dramatique au m ot déclamation , qu i mentionnentaussi ce tra it .
Revue de phonétique
3 62 GEORGES LOTE
s iques , leurs effo rts vers le natu rel et la vérité abou t irent à u n résul
tat . Mo l ière,Rac ine et la Cham pm eslé furen t les artisans les p lus
act ifs de cet te réforme, et le premier n’
échoua que pour avo i r ététrop rad ica l . Ma i s du j ou r où la cé lèbre actrice dont s ’
inspira
Lu l l i réuss i t à fai re applaudi r une déclamat ion nouvel le,de ce
moment un grand pas fut accompl i . Par les documents qu’ i l nou s
appo rte,le réc itatif d ’
opéra nous prouve un fai t considérab le sur
lequel i l nous fau t revenir une dern iè refo is . Sous les influences
que j’
a i di tes et par l’
action de quelques comédiens,l’
alexandrin
françai s cesse de s’
art icu ler uniquemen t sur deux po ints im
m uables,ma i s i l connaî t , à l
’ intérieur de ses hémist iches,des
accents mobi les q u i var ient avec la phrase. C ’
es t le progrès le p lu s
certain que nous ayons no té,et i l va renouveler l ’art moderne.
On aperço i t,sans qu ’ i l so i t nécessai re d’
y appuyer davantage,
que cette l iberté acqu ise par le vers augmente singu l iè rement
pou r l ’aven i r ses capaci tés d’
expression,et les intonat ions ora
to i res que nous avons relevées dans la mus ique de Lu l l i, quo ique
bien rares encore, l’
annoncent d ’
une façon suffisante c ’est donc
la porte ouverte au pathétique dans la d ict ion , un moyen qu ’
au
ront les nuances de se mani fester à l ’o rei l le, une v ie infiniment
ri che et diverse q u i désormais peu t an imer la paro le.
Mais d’
au tre part c’
est la ru ine d’
un sy stème et la conso l ida
t ion de l ’ i llogism e déj à menaçan t . Le princ i pe fondamenta l de la
versification frança ise s’écrou le. A l ’o rigine el le a été basée sur le
sy l labisme, avec valeu r égale des syl labes au tres que la césu re et
la r ime. Ces deux temps marqués supportaien t après eux une
sy l labe fémin ine en surnombre. O n a commencé par supprimer
ce privi lège de l’hém istiche et,de ce fai t
,une certaine d ispari té
s ’est déj à introdu i te. La declamation accen tuel le,amorcée déj à
par le rel ief des termes exclamatifs,va plus lo in encore et pro
du i t l’ incohérence : dès l’ i nstant où el le s
’é tabl i t , les accents du
vers ont des propriétés d ifférentes : celu i de la rime admet après
lu i un é lément fémin in qu i ne compte pas ; mai s cet élément
PH ONÉTIQUEMALGACHE ‘
Ce travai l date de 1 904 . I l form ait un artic le de 9 5 pages , d’
un fo r
m at p lus grand que celui de la Revue de Phonétique, et éta it en bon àtirer quand La Pa role fut brusquement supprim ée . Comm uniqué en
épreuves , i l a dé jà été s igna lé et m is à p rofi t . Pour ce m otif et pourlu i conserver sa date et son carac tère
, je m’
abstiens d’
y faire aucunc h angem ent m êm e dans la graph ie, les réform es proposées par
l’
Académ ie m a lgac he étant po stérieures .
Les expériences u t i l isées dans cette étude ont été fai tes avec le
concou rs ind ispensable et t rès empressé de m on confrère à la
Société de l ingu ist ique, M . G . Ferrand,ancien résident à Mada
gascar, au teu r d ’
une grammai re malgache. C’
est à cet te gram
maire que je renvo ie pou r l’étude prél iminai re de la langue
ï En
attendan t quelque au tre rencont re heu reuse, je ne pu is m
’
occuper
pou r cette fo is que du d ia lecte Mér ina et de celu i des Betsi leo .
D IALECTE MÉRINA
Les su jets qu i , à la demande de M . Ferrand,ont bien vou lu
se prêter et très a imablement,à m es expériences sont
A. M . Randriam paranv, né à Tananar ive le 1“r novembre
1 87 3 , de la caste no ble des Zana— dRalam bo : i l a étud ié le m al
gache à l ’éco le pro testante angla ise,pu i s le frança is à l ’éco le des
Frères . I l est en France depu is le mo i s d ’
avri l 1 900 .
I . La langue m alga che fa i t part ie de la fam i l le des langues océaniennes , qu ise d ivisent en tro is g roupes 1 er groupe polyne
'
sien (N ouvel le-Zé lande, î lesTonga , Sam oa , de la Soc iété , Tah i ti , Gam b ier , Marqu ises, H awa ï) ; 2° groupeme
'
lane'
sien com prenant a) les langues des î les Vit i ; {3) les langues des N ouvel les- H ébrides, des î les Salom on
,G i lbert
,Caro l ines
,Marshal l 3 e groupemalai s
(Form ose,Luçon ,
Ph i l ipp ines , presqu’ î le de Malacca
,Sum atra , j ava ,
Flores,Tim or
,Bornéo
,Cé lèbres
,Molusques, Tim or- Laout
,enfin Madagascar) . Vo ir
FR IEDRICH MüL LER ,Grundr i
‘
ss der Sprachwissenschaft . 2e part ie, p . 1 -160 .
2 . Essa i de g rammai remalgache. Paris,Ernest Leroux , 190 3 .
PHONÉT IQUE,
MAI_. GAGH E 3 6 5
B . M . RaOny—La lao i l a d ix—neuf ans
,n
’
a qu i tté Tananarive
que pou r ven i r en France au Con servato i re de mus ique,envoyé
par la co lon ie. Son grand—père étai t chef des Peti ts a ides decamp du premier m inist re ; son père, chef de mus ique de laRei ne.
C .
nar ive, mais dans le Vakin isaony à Antanjombato ,i l appart ient
M . Rajoelina il a vingt—hu i t ans ; né tou t près de Tana
à une fami l le hova (c’
es t—à—d ire à une caste don t les membres
ne sont ni nobles , n i esclaves) ; i l a été élevé au co l lège d’
Am bo
h ipo,chez les j ésu i tes , et n
’
est à Paris que depu is d ix mo is .
J’
ai l imité m es expériences à l ’observation des mouvements de
la langue à l ’a ide du palais art ificiel,et à l ’ inscription du double
cou ran t d ’
ai r sortan t par la bou che et par le nez . je n’
ai pas pris
les vibrations du larynx , qu i se montren t très nettemen t sur la
l igne nasale.
Lorsque je ci te des exemples, j
’
indique tou jou rs , par l’
une des
tro is let t res A,B,C
,à qu i je les do is . U ne indicat ion i so lée de
l’
un des t ro i s su jets ne suppose pas u ne d ivergence pour les
au tres,s i el le n
’
est pas s ignal ée l ’exemple peu t manquer ou
n ’ ê tre pas concluan t .
FIG . 1 .
Echel le pou r les tracés d u d ialec te m ér ina seu lem ent .
Chaque vibration s imp le égale de seconde.
Dans tous les t racés que je reprodu is celu i , du hau t de la
figu re représente invariablement le souffle qu i est sort i par la
bou che ; celu i du bas, le souffle nasa l .
La du rée est comptée en centièmes de seconde, su ivan t 1echel le
du temps reprodu i te (fig . 1) où chaque vibration complète est
de de seconde.
3 66 L ’ABBE ROU SSELOT
Les mots i so lés inscri ts su r l ’apparei l enregistreu r son t les suivan ts
abo, je (fig . 62 et
antsy , hache (fig . 5 , 7 , 1 74,
aty , i c i (fig .
bihy , an imal (fig . 3 7 , 67 , 106 , 107 , 1 5 0 ,
didy , lo i (fig . 3 8, 7 1 , 10 1 , 10 3 , 1 5 2 ,
fafa , action de balayer (fig . 9 7 ,
fefy , c lô tu re (fig . 5 3 ,
gaga ,étonné (fig . 42 ,
1 04 , 1 0 5 , 1 10,
ha rana,corai l (fig . 4 3 , 64
jejy , sorte d’ in strument de mus ique (fig . 3 6 , 1 1 1 1 14, 1 76
I 77)hetuka
,nom de femme (fig . 3 9 , 74 ,
kiraro, sou l ier (fig .
lela,langue (fig . 48 , 9 1 , 9 3 , 94 ,
mandeha , al ler (fig . 8
mandray , saisi r (fig . 89 ,
mamy , doux (fig . 3 0
mamo, ivre.
mihahy, porter sur le dos (fig . 3 3-
3 5 , 44 , 4 5 , 10 8,
midoo’
0,m o t forgé art ificiel lement (fig 5 6 ,
mi tete, cou ler gou tte à gou t te (fig .
mpampianatra , professeu r (fig . 1 8—2 1,1 1 6
,147,
mpandehu , voyageu r (fig . 40 , 1 1 7 , 1 3 5 , 1 3 6, 1 98 ,
nana , pus (fig .
neny , mère.
ng igina , obscur (fig . 90 ,
papango, éperv ier (fig . 1 5-1 7 , 1 34,
ra ry , mal (fig . 5 0-
5 2 ,
ro m,sal ive (fig . 9 5
sasa , action de laver (fig . 5 8 ,
tety, bou ton syph i l i t ique (fig . 70 ,
3 68 L’
ABBÉ ROU SSELOT
FIG . 2 .
1 a .
— a o . 3 r .
—
4 e.
—
5 é.
—
7 i .
Dans les figures des palais artific iels , les parties omb rées représentent certa ines rég ionstouchées par la langue. Ic i , par exem ple, tou te la partie om brée (A) a été touchée pourl ’art icu lat ion de l
’
i . Le contac tf’
pour les au t res voyel les est l im i té pa r d iverses l ignesd ist inguées par les ch iffres . Ains i pou r a la lang ue a touché depu is le bord de la figureju squ ’
à pou r e, depu is la rangée des dents jusqu ’
à etc .
F IG . 4 .
Voyel le a' (quelques pér iodes seu lem ent) .
1 Ldt mu. 2 ari
PHONÉT IQUE MALGACHE3 69
tou cher le pa lai s . On ne recuei l le aucune t race sur le palai s art ific iel pour d o(A) , 6 (C) . Mai s on peu t reconnaî t re ti (A,
C) o,u,22 (B) et sou pçonner l ’é lévat ion progress ive du dos de la
langue (fig .
FI G . 6 .
FIG . 7 .
Les l ignes po inti l lées m arquent le synch ron ism e su r les tracés de la bouche et du
nez , excepté dans les c as où l ’ am pl itude est très d ifférente alors i l faut opérer une cor
rec tion comm e pour la figure 1 4 r .
S’
i l arr ive que des vibrat ions s igna lées dans le tex te m anquent dans la fig ure, c’
est
au texte q u ’ i l fau t s ’
en rap por ter , car i l a été fai t su r les tracés o r ig inaux . Le cl ichage a
pu fa ire d i r—paraître des vib rations très fi nes .
La nasa l i té est m arqu ée par le déplacem ent d e la l ig ne nasa le (preuve que le cou rantd
’
a i r passe par le nez ) et pa r les vibra tions q u i la recouvrent . El le a pour mesu re l’
am
pleur des tracés et cel le des vibrat ions .
Pour reconnai tre la p résence ou l ’ ab sence d ’
une n après la nasale, com parez les fig ures
6 et 5 . La nasale est enti è re (fig . el le es t p resque com plètement tom bée, ou p lutôtabsorbée par la voyel le (fig .
Ces ind ica tions suffi sent , j 'espè re, pour fa i re comprendre les au tres fi gu res . Je ne le
répétera i pas .
Toutes ces voyel les sonnen t à peu près comme en français .
Ainsi,pou r l imi ter la compara ison graph ique à l
’
ail don t la figu re
est très connue, voyez les a (B) de ldana (lavina) n ié et de
3 70 L ’ A BBE ROU SSELOT
d{ i (az y) lui au cas direct (fig . L’
ana lyse complète desvoyel les est t rop complexe pou r que je pu isse m
’
y l ivrer en ce
momen t . J ’
espère pouvo i r y reveni r .
Je n’
ai trouvé de franchement nasales que les voyel les à et a
â . antsy : â i i A (fig . rîns°i B (fig . 5 57 C (fig . La
FIG . 8 .
a (B
n asal i té commence comme en français dès le débu t de la voyel le ;el le peu t se term iner ou à peu près avec el le (A,
C) de même quedans no t re m ot anse (â 5 æ) , ma is el le peu t aussi se continuer après
(B), c’
est—à-d i re qu’
el le peu t abso rber ou la isser subs ister la
consonne nasa le. Ce caractère n’
a rien de fixe nous y rev ien
drons à propos de l’
a .
Mandeha mânde‘
ha A (fig . mande'
fu B (fig . mâ ndèa C
(fig . Après une m , la voyel le est natu rel lement nasale dès
le débu t ; ma is , i c i , el le est en p lus su iv ie d ’
une n .
Tsongana saanganâ A (fig . C (fig . sanganâ B
PHONETIQUE MAI .GACH Ë
a p a n g
F IG . 16 .
a p [i
1 17 .
71
“i t
[ l
12
(B
72 i t
r’
a (B
a (B
U…)
374 L ’ABBE ROU SSELOT
liser cet a,car la nasal isat ion s
’
accentue au fur et à mesu re qu ’ i l
répète les mots . Durant la révo lu t ion du cyl indre,i l a prononcé
le m ot s ix fo i s o r a est pur la 2°et la 3
° fo is ; i l se nasal ise lala 5
eet la 6 €
(fig . Dans mpandeha , l’
a se ressentdu vo i s inage de l’m (A) . Vo i r m (fig .
Pro . 20 .
p a ni p 3'
ti 11 a (B
FIG . 2 1 .
Dans les légendes placées so us les fi g u res , je représente rég u l i erem ent le tr malgachepar 7
°
ou et le .f r par 7" S i j
’
a i pr is ce pa rti , ce n’
es t pas pou r rect ifier le texte qu i presente une g raph ie plu s juste,
m a is pou r éviter de nouveaux retards a l ’ im pression .
et . Tôndra (fig . 2 2) et (fig . 2 3 ) A ; B
(fig . (fig . 2 5 ) et tain… (fig . La’
nasalisation
est complète pou r B ,incomplète pour A s ix fo i s su r hu i t cas et
pour C cinq fo is sur s ix cas , nu l le pou r A deux fo is , pou r C une
fo i s . Dans tondro do igt l’
u est res té pur ou fai blemen t nasa
lisé pour A quat re fo i s contre deux u i i, pou r C tro i s fo is contre
deux ; une fo is même l’
n su ivan te a été presque entièrement
absorbée (fig . C ’
est l ’effet de la répét i tion d ’
une sy llabe qu i
PHONÉT—IQÜE £MAI‘
.GACH E
L’
a -nasa le — cous . est donc presque constamment nasal :
L’
u dans les mêmes cond it ions l ’est mo ins sûrement , . mai s -
pra
tiquement i l do i t ê tre considéré comme tel .
En dehors de ce cas,les voyel les son t entendues pu res quo ique
l ’ influence d’
une nasa le suffise à les nasal iser p lus ou mo ins .
t m p n i
La pos it ion O ù l ’ infect ion nasa le se produ i t avec le p lus d’ in
tensi té,c ’est entre deux consonnes nasales m on 11 .
Dans mamy , m4îmi , A,B,C (fig . 3 0 la résonance nasa le
est à peu près égale en intens i té à cel le de la bou che (A,B) , el le
est plus forte(C) . I l en est demême pou r mamo,mdmz2(A, B , C) ;
(A,B), ntînæ (C) ; neny , nêni (A, B, C) . Cependan t
peu exercée ne sent i rai t pas la nasa l isation . C ’
est q ue
at tent ion est abso rbée par la fo rte nasal i té des consonnes v oisines.=
La voyel le fina le, après une nasa le est-égalemen t très .nasa l isée‘
fig . 3 0 Ici encore. l’ i nfluence nasa le est d ouble c el le de
Revue de phonétique. 24
378 L’AB
'
BÈ ROUSSELOT
la consonne précédente, et cel le de l’
expirat ion qu i tend à nasaliser les voyel les finales (vo i r fig . 3 6
La voyel le précédée ou même su iv ie d ’
une nasale se nasa lise,
exemples
FIG . 3 2 .
h a i (M
FIG . 3 3 .
dans mpampiana lia (fig .
“
t 8 La nasa l isation du
second a est constante chez les tro i s su jets A,B, C , cel le du pre
m ier est un peu mo indre chez A.
mibaby, mîha'
hi A, B , C (fig . 3 3 De mêmemi tete.
380 L’ABBE ROUSSELOT
Les voyel les finales se nasa l isent plus ou mo ins sous l ’ influencede l
’
acte expirato i re qu i provoque l’
abaissemen t du vo i le dupa lais avan t la fin de la voyel le. Je ci terai comme caractéristiquesâeî i (gegy) A (fig . bibi B (fig . 3 7) (hiby) didi C (fig .
Cet te nasal i té est d ’
o rdinai re mo ins importante et se produ i td
’
une façon i rrégu l iè re pou r les mo ts et pour les su jets . El le
d i (C
FIG . 38 .
a le à
semble la p lu s forte chez B ; même pou r lui , el le est constante
dans hihy . Chez les tro i s su jets , el le est part icu l ièrement marquée
pour i final . Cela s’
expl ique pou r conserver la pu reté de l’
i , i l
fau t é lever considérablemen t le vo i le du palais ; le mo i ndre relâ
chement devient a lors sensi ble. L’
n,aussi
,se nasal ise faci lement .
L’
æ paraî t assez généra lemen t nasal i sé chez B , mo ins souven tchez A, raremen t chez C .
L’
effo rt demandé pour l ’art icu lation d ’
une consonne suffi t
pour fai re abai sser le vo i le du palais et provoquer une légère
nasal i té . Le_phénom ène est surtou t marqué chez B , par exemple,
PHONÉTIQUE MALGACHE 3 8 1
dans êétaka (fig . L’
aspiration forte favorise au ss i la nasal i té . Ains i dans mandeha , l
’
a fina l est tou jou rs nasal i sé pou r B,
qu i a l asp1rat10n tel lement fo rte qu el le est la plupart du tempssou rde (fig . mais , l
’
aspirat ion n’
ex istant pas chez C , l’
a
n est pas nasal isé .
(A.)"t:
Qt
Qt
FIG . 4 1 .
Unem in i t iale su ivie d’
un p, agit sur la voyel le su ivante, même
quand el le est sou rde mpâ nde‘
à A (fig .
Les voyel les fina les tenden t à s’
assourdi r et à d isparaî tre. A la
s imple aud i t ion,le fai t se constate sans peine. Pendant que je
me faisai s répéter les mots inscr i ts, j
’
ai entendu mpampiana tru
tou jours sans l’a fina l A, B, C ; de même tra tra , fafa , nana sans a
B,avec ou
“
sans a C,tsara , zaza ,
harana san s a B, rom , lela avec
ou sans a C . C ’
est donc B qu i assourd it le plu s la voyel le finale
a , et A qu i l’
assourdit le moin s .
3 82 L’ABBE ROU SSELOT
’Les expériencesnou s donnen t desrésul tats naturel lement plus
pré cis . Je passe en revue les tracés de nos tro i s su jets .
'
A. L’
a de mpampianatra est ent ièrement sourd deux foissur t ro i s celu i de zaza l
’
est devenu la s ixième fo is que le m ot
a été répété (fig . Ce qu i fai t l’ in térêt de -cet te figure
,c ’es t
qu’
el le nou s mont re pou r le souffle le t racé ord inai re de lavoyel le i l ne manque que les vib rations du lary nx . L
’
a a été ici
FIG . 42 .
chuchoté et non supprimé entièrement . U ne étape in termédiai re
nous est fou rn i e par gaga (fig . 42) et oava (fig . L’
a final de
tra tra (fig . 1 16) est également bien amo indri .
A ne diminue considérab lement et ne laisse tomber que l’
a
et encore assez raremen t .
B . L’
a final de mpampiana tra est en ti eremen t tombé … Celu i
de harana tombe également, mais i l peu t auss i n etre que chu
chote(fig . On vo i t net tement sur le tracé l’
explosion—
qu i
L’ABBE ROU SSELOT
Ces réserves fa i tes, nou s pouvons poser les règles su ivantesL
’
atone finale n’
est pas muet te après deux consonnes dans
les mots de deux syl labes ; mais el le peu t le deveni r dans ceux
de t ro i s . Exemple, papango, où el le a été sonore une fo is , de fa ibleSonori té une fo i s , sou rde une fo is .
2° Les°
atones i u précédées d ’
une consonne sonore ne sont
pas muet tes dans les mo ts de deux sy l labes (hihy , d idy , ra ry ,
jejy , kira ro, wow) mais el les peuven t le deveni r dans les mo ts detro is syl labes: m ihahy , où l
’
i est sonore deux fo i s,sou rd tro i s fo i s ;
midodo, où l’
u est sono re quatre fo i s , sou rd deux fo i s .
3° L
’
atone finale a,précédée d ’
une consonne sonore peu t
s’
amo indrir dan s les mots de deux sy l labes , comme dans ceux
de t ro i s gaga deux fo i s cont re tro i s , vaoa une fo i s contre quatre,
lela deux fo is contre cinq , tsara deux fo i s contre deux et les cinq
cas de rora .
4° Après une consonne sou rde spi ran te ou mi—occ lusive
,les
voyel les atones sont tou jours sonores (fefy , antsy , aho, fafa , sasa) .
5° Après une occ lu s ive sou rde et dans les mo ts de deux sy l
labes , l’
i est sou rd une fo i s contre cinq (tety) , l’
a est sourd tro is fo is
con tre tro i s (Ma tra) ; dans les mo ts de t ro i s sy l labes , a est sourd
quatre fo i s con tre deux (laetaka ) .
Cet tegradat ion est conforme à ce qu ’
on est en dro i t d ’
attendre.
Seu le, la so l id i té relative de l’
i et de l’
n par rappor t à l’
a serai t su r
prenan te pou r un roman iste, qui sai t que l’
a a é té la plus so l ide
des voyel les lat ines dans l’évo lu tion du frança is . Mai s i l fau t son
ger que l’
a malgache se change en 03 avant de s’
am uïr,tandis
que no tre a s’étai t b ien conservé quand l’i et l’a atones du lati n
étaient déjà. tombés . Depu i s que l’
a lat in est devenu ce chez nous,i l a bien perdu de sa so l id ité i l est a son tou r en vo ie de dispa
rai tre.
La transfo rmation de l’
a final atone en ce est presque un fai t
accompl i dans la prononciat ion de C ; je n’
ai noté l’a qu ’
une fo i s,dans tsara partout ai l leurs j
’
ai entendu ce, B a di t quatre fo is _5
_
eul_e
PH ONÉT IQUE MALGAa -
3 8 5
men t a (Ëe'
taka , s’
â ñgana , nana , mâ ndâ‘
a) et onze fo is ce ou b ien i l alaissé utom ber
'
la voyel le (lè/ce, saræ,ng iz næ, ruîræ, gdgæ ,
sâ sæ,tdr ,
z â z,’
aran, tat, teînî , faf, nav) . C ’
es t A qu i a lemieux conservéla voyel le (sept fo is con tre hu i t) s
’
dr‘
zgand , ndna , mâ nde‘
ha,
léla, ,
ng izna , rdra , gaga ,sdsa , s
‘
ara , zaza ,°
aranœ,îdfæ ,
tûnîæ,
fafæ) . Saufgagæ (A) et gagne(B) ainsi que sdsæ (A et B), les mots
qu i ont un ce pou r A ont perdu leu r voyel le pou r B . Au po intde vue de la conservat ion de l’a
,nos tro is su jets se classent
ainsi A,B,C .
Quel le est la cause de cet affai b l issemen t et de l’am nrssement
de la voyel le atone finale On songe avan t tou t a la chercherdans la fo rce de l ’accen t , et les fai ts semblen t d ’
accord avec cettesuppos i tion . A premièrevue pourtan t
,i l semble que l
’
accent musical do ive être lai ssé de côté i l paraî t du reste le même à peuprès pou r les tro i s su jets . D ’
au tre part,l ’accen t de force, qui est
t rès considé rable dans C ,est relat ivement fa ib le dans A et B , et
cette ra ison ne suffi t pas pou r exp l iquer la différence qu i existe
entre ces deux dern iers . Afin de permettre la comparaison, j
’
ai
mesu ré quel ques mots pou r la du rée et la hau teur musi cale.
Sans rechercher une rigueu r absolue\ que le genre d
’ inscrip tion
ad0pté ne comporte pas, j’
ai essay é de ne prendre que la voyel le
seu le séparée de l ’explosion de la consonne précéden te. Avec des
t racés auss i rédu i ts , la cert itude manque su r ce po i n t mai s je
m e hâte d ’
a jou ter que l’
erreu r ne peu t être grande et do it être
considérée comme prat iquemen t nu l le. La durée est exprimée
en centièmes de seconde. P ou r la hau teu r mus icale, je m e su i s
borné à compter les v ib rat ions qu i se t rouvent dans une part ie
moyenne de la voyel le pendant un demi-d ixième de seconde et
j’
ai'
ram ené tous les ch iffres à l ’un ité du temps, à la seconde. Je
n ’ i nd ique donc qu’
une hau teur moyenne, en vibrations s imples .
Mais cela suffi t tou t à fai t pou r l’
objet que je me propose. Vo ic i
les mots que j’
ai ai ns i mesurés
3 86
Du rée des voyellesCenti
'
emes de seconde
‘
L ’
ABBE R0tfssfl‘
oi °
1 3
I 7
48
tan
14
8
3 8
tsan ga
8 6 10
8 7 1 2
1 9 9 10
man de ha
1 1 1 1 1 5
4 I 4
14 28 14
pa pan—
go
8 1 8 1 8
7 3 1 2
1 1 24
Hauteu r mus icaleV ib rations (v . pendant une seconde:
3 00
3 60
3 40 260”
fina —dnz
3 20 200
3 30 2 14
3 60 220
tsan ga na
280 200 200
3 20 280 200
3 20 240 200
1nan de ha
240 3 00 200
280 3 60 240
3 20 3 60 240
3 88 L’ABBE ROU SSELOT
verions une d ifférence entre A et les deux au tres su jets,so i t
60 au l ieu de 80 .
Enfin,nous remarquerons que la pro longation de durée dans
une finale, comme on l’
observe chez B , ne nu i t pas à sa qual i té
d’
atone ; en effet , le son va en mouran t et se rédu i t à une très
fai b le intensi té .
i d ‘I l d et (A» )
FIG . 46 .
Je ne voudrais pas qu i t ter les voyel les sans s ignaler un fai t
remarquable chez A, c’
est la rédu ction étonnante de la sy l labemi atone dans m ihdhi , mi lttç
‘
,m ideîdu
, où l’
on arrive à ne plusl i re qu’
un son très cou rt (à pei ne 4 centièmes de seconde) à lafo i s buccal et nasal
,tenan t de l’m et de l
’
i . Comparez mihàhi
(fig . 3 3 ) et m idu'
du (fig .
(A suivre) . L’
abbé ROU SSELOT.
COURS
DE GRAMOPH ON IE
L’
AGON IE
DE SU L t Y PI<U DH OMME
Vous qu i m’
a id rez dans i l lO l l ago n ie,
N e m e d ites r ien .
Fai tes que j’
entende un peu d’harmonie
,
Et je mou rrai b ien
5 La musique apa ise,enchante et dél ie
Des choses d ’
en bas .
Bercez m a dou leur je vou s en suppl ie,N e lu i parlez pas .
‘
Je su i s las des mo ts, je su 1s las d ’
en tendre
Ce qui peu t ment i r ;J ’
a ime mieux les sons qu’
au l ieu de comprendre0 0
Je 11 at qu à sent i r .
U ne mélodie où l ’âme se plonge
Et qu i , sans effort
1 5 Me fera passer du dél ire au songe,Du songe à la mort .
Vou s i rez chercher m a pauvre nourrice
Q ui mène un troupeau,Et vou s lu i d irez que c
’
est mon caprice
Au bord du tombeau ,
390 MARGUERITE DE SAINT-GEN ÈS
D’
entendre chanter tou t bas,de sa bouche
,
Un air d ’
au t refo i s ,S imple et mono tone
,un doux air qu i touche
Avec peu de vo ix .
Vous la t rouverez les gens des chaumières
Viven t t rès longtemps ;Et je su i s du monde où l
’
on ne vit guère
Plus ieu rs fo i s vingt ans .
Vous nous lai sserez tous les deux ensemble.
Nos cœu rs s ’
uni ront
El le chantera d ’
un accent qu i t remble,La mai n su r son front .
Lors el le sera peu t-être la seu le
Qu i m’
a ime tou jours ,
3 5 Et je m’
en i ra i dans son chan t d’
areule
Vers mes premiers j ours .
Pou r ne pas sent i r, à m a dern iere heure,
Q ue m on cœu r se fend ,Pour ne p lus penser , pou r que l
’
homme meure
Comme est né l’
enfan t
Vou s qu i m’
aiderez dans m on agon ie,N e m e d i tes tien ;
Fai tes que j’
entende un peu d’
harmon ie
Et je mourra i b ien .
[Les Solitudes.](D it pa r M . Le Bargy de la Comédie
-França ise, d’
après un disque
de la Société du Gramophone.)
3 92 MARGUER ITE DE SAÎNT—GENËS
m la truvré ; lé jâ dè eo'
myèr
m’
væ trè tara
e jœ sûd d cä môd u l ô næ vi gär
pldsya‘
u*
fwa né! d .
ou nu lèsré, t22lè deez â sâ‘
hlæ
nô kcÈr s unirä ,‘
el c â tra , d d'
en aksâ ki trâ hlœ
la mesur [m5 ] fr 5
lwz el —av a [ ur l élue la sa l
ki (un. luflir
e jæ m du tre d à sô ed d ayæl
vér me‘
prœmyé für .
pair næpd sâ tir,a nia dernyêr â:r
kæ uzô kâ?r sæ fâ ,
°
[nir næ plupä se pai r kæ l om tinier,
kom à ne l dfd .
ou,ki m èdré
,dd môn agoni ,
næ m ditœ
fer, ka: j arad a pas d armani
e j æ mur re'
hyê .
DICTION ET COMMENTAIRE PHON ÉTIQUE
Ce morceau ,d
’
un caractè re un iforme,est faci le à d ire.
La paro le d ’
un malade do i t être lente —
et sa vo ix oppressée
tombe avec les finales . Ce caractère est très frappan t dans la dic
t ion deM . Le Bargy . On y sen t comme un s ouven i r de la pro
n0nc iation popu la i rede Paris .
COURS DE GRAMOPH ON IE 3 9 3’
C’
est encoreun trai t b ien paris ien et popu lai re que le redoublement de l’ i dans je si bi l ld (str .
M . Le Bargy prononce mon agoni , comme M . Delaunay sô n
dho”
np wê et M° ”S . B . sôn æy rô .
L’
œ muet donne l ieu à plusieu rs observat ions . Je résumeI° I l est conservé après deux consonnes
entendre (9 , 2,I ) , comprendre ( 1 I ) , pauvre ensemble
tremble peut-être2° I l tombe tou jou rs dans l ’ intérieu r d ’
un m ot,entre deux
consonnes s imples a idrez ( I , me fra trouvrez
la issrez (2 ,chantra El le sera (3 3 ) avec son ne
,ne con
st i tne pas une except ion . L’
æ final de elle étant tombé,i l se
trouve que l’
æ de sera est précédé de deux consonnes .
3° L
’
æ muet fina l précédé d ’
une simple consonne tombe
tou jou rs à la fin et assez souvent dans le corps du vers fai tes
que el le chant ra el le sera qu i
m ’
a ime tou jou rs pou r q ue l’
hommemeu re
L’
æ muet n’
est guère conservé dans le corps du vers que l à où
i l est nécessai re pour l ’harmon ie en rai son d’
un groupe de con
sonnes .
N e m e dites rien (2) r i compte pour deux consonnes .
Vivent très longtemps
4° L
’
œ muet des monosy l labes est conservé , sauf un , à la der
nière strophe N e me d ites rien Cet ce avai t été gardé à la
première N e m ed i tes rienRemarquer enfin que le fu tu r mour ra i a un e moyen à la
1r estrophe où la vo ix po rte su r la 1
resyl labe jemour rai bien
et un e‘
fermé à la dern iè reparce que c’
est lu i q u i reço i t l’
accent
jem ou rrai bien
Revue dephonétique
MARGUER ITE DE SA INT-GENES
PH ÈDRE
DE R A C I N E
Ou i , prince, je langu is , je brû le pou r Thésée
Je l’
a ime,non po int tel que l
’
ont vu les enfers ,Vo lage ado rateu r de mille objets divers ,
Qu i va du dieu des mo rts déshono rer la couche
5 Mai s fidèle,mai s fier , et m ême un peu farou che,
Charmant , jeune, traînant tous les cœu rs après so i ,Tel qu ’
on dépeint nos d ieux,ou tel que je vous vo i .
I l avait vo tre port , vos yeux , vo tre langage ;Cette noble pudeu r co lora i t son visage
10 Lo rsque de no tre Crète i l t raversa les flo ts,
D igne su jet des vœux des fi l les deM ino s .
Q ue fai s iez—vous a lors ? Pourquo i , sans H ippoly te,Des héros de la Grèce assembla—t- il l ’é l ite
Pourquo i , t rop jeune encor,ne pû tes—vous a lors
1 5 Entrer dans le vaisseau qu i le mit su r nos bords
Par vou s au rai t péri le monstre de la Crète,
Malgré tous les détours de sa vas te retrai te
Pou r en développer l ’embarras incer tain,
Ma sœur du fi l fatal eût armé vo tre main ;20 Mai s non : dans ce dessein je l
’
au rai s devancée
L’
amou r m ’
en eût d’
abo rd inspiré la pensée ;C ’
es t m o i , prince, c’
est m o i,dont l ’u ti le secou rs
Vous eût du labv rinthe enseigné les détou rs .
Q ue de so ins m’
eùt coû tés cet te tê te charmante '
25 U n fi l n ’
eût po int assez rassuré vo t re aman teCompagne du péri l qu
’ i l vous fal lai t chercher .Mo i—même devan t vous j ’aurais vou lu marcher ;Et Phèdre, au Laby rinthe avec vous descendue,
Se serai t avec vou s retrouvée ou perdue.
(Dit pa r Sarah Bernhardt (Berna rt) d’
après un disque
Société du Phonographe. )
3 96 MARGUER ITE DE SAINT—GEN ÈS
DICTION ET COMMENTAIRE PHON ÉTIQUE
C’
est a donner les d iverses infiex ions de la vo ix , qu i con
viennent à ce mo rceau , qu’ I l fau t s ’
appl iquer . M… S . B . y excel le.
La tendresse de Phèdre est exprimée avec une émotion contenueet diss imu l ée d ’
abo rd,pu is de plu s en plus ardente
,jusqu ’à la
déclarat ion finale,faire d ’
une vo ix fai ble et rendue plus impres
s ionnante encore par l’éclat qu i précède
C’
est moi Pr ince,etc .
Enfin avec un abandon enthous iaste,el le se déclare prête à se
sacrifier pou r H i ppo ly te.
Nous avons peu de chose à relever dans ce morceau,au
po int de vue phonétique,après tout ce que nous avons déj à
dit .
No tons la recherche de l’archarque et du famil ier . Mm e S . B .
rétabl i t l’rr muet fina l dan s descendue et perdue
El le redouble 1 dans llangu is Cette fo rme popu lai remarque admirablement la mo l lesse et l ’abandon . Comparez LeBargy Je su is [ las des mo ts
, je su is [ las d’
entendreMA RGUER ITE DE SA INT—GENES
COMPTE RENDU
H . GUTZMAN N et H . STR U YCKEN : Über d ie Bez iehung en der exper imentellen
Phonetik z u r La ryng olog ie. Ex tra i t de l’Archiv für Lary ngo log ie, 2 5€ tom e
,2c
fasc icu le, 5 2 pages , ihL
’ im portance de la phoné tique expérim entale a été form el lem ent reconnueau Congrès de Laryngo log ie qu i a eu l ieu à Berlin du 30 août au 2 septem bre19 1 1 . Le com ité du Congrès ne s
’
est pas seu lement préoccupé de réun ir desdocum ents sur les m éthodes et une r iche co l lect ion d
’
apparei ls em ployés dansla phonét ique expérim entale, i l a auss i cho is i deux rapporteurs pour tra iter laquest ion des relat ions qu i ex istent entre la phonétique expér imentaleet la larvngo log ie et i l a m is leurs rappo rts en tête de son o rd re du jour .
Ce fa it intéressant trouve son expl ication dans la part ie générale du prem ierra ppo rt de l
’
ém inent laryngo log iste de Berl in ,M. H . Gutzm ann ,
à la page 2
Quand le com i té internat iona l chargea it M. S truy cken et m o i d’
écrire lerapport sur les relations de la phoné tiq ue expér im enta le avec la laryngolog ie,les lary ngo log istes auto r isés qu i fo rm a ien t le com ité
,étaient m an ifestem ent
pénétrés de la convic t ion qu’ i ls se trouva ient laen face d ’
un é larg issem ent poss ib le de la sc ience laryngo log ique, é larg issement qu i , depu is de longues annéesa été tou jours tenté par de petits côtés je rappel le seulem ent les expériencesphonét iques du m aitre C zerm ak m a is sans avo ir été j usqu ’à présent entrepris aussi généra lem ent qu
’ i l l ’aura it m éri té dans l ’ intérêt des laryngo log isteseux-m êmes . I l v a entre la laryngo log ie et la phonétique expérimenta leune relat ion
,un rapport p lus intime que celu i qu i ex iste avec la psy cho log ie
ou la m édec ine générale, ou m êm e avec la l ingu istique Dans la phoné
t ique m êm e,les savants de l ’anc ienne éco le gardent encore une attitude réser
vée par rapport aux expériences , bien qu ’ i l so i t tout à fait c la ir que l’
observationimmédia te
,m êm e la plus so igneuse et la plus exercée, est incapable de sa isir
,
avec une préc ision suffi sante,les phénom ènes de la paro le dans la suc cess ion
rap ide de toutes leurs propriétés (F . K r i ig er ) . La cause en est due en partie à ceque la posit ion exacte des questions phy s iolog iques et les d iffi cu ltés inhérentesà certa ins problèm es sont tra itées par beaucoup de phonétic iens comme inexis
tantes,comm e si tout le m onde
, grâ ce à son observation personnel le, pouva itind iquer tout de su ite ou et comm ent les d ifférents sons se produ isent, tand isque le phy s io log iste sa it qu
’ i l s ’
ag it là dequestions d iffi c i les , non réso lues encore(N agel) . En partie, cette opposition (ablehnende H altung) a son origine en ce
que l’
on ava it ent ièrem ent m éconnu la nature de la phonét ique expér imenta le.
Car on cro it devo ir la restreindre à l ’emplo i de d ifférents apparei ls enreg istreurs .
8 3 9 COMPTE RENDU
C ’
est ainsr que s’
exprime le phonétic ien dano isM. O . ]espersen dans sa conceptiontout à fa it étro ite de son Instrum enta lphouetik
’ i l a imerait m ieux probablem ent employer le terme donné par lu i en note
‘Masch inenphonetik’
,cependan t
i l trouve lu i—m êm e que ce term e pourra it être cons idéré comm e une injure.
Dans la phonétique expérim enta le I l s’
ag i t en prem ière l igne non pas du tout
de m ach ines ou d’
apparei ls , m a is en princ ipe de l ’expé r ience. C ’
est donc à bondro it que M. Paruoncelli—Gulz ia a protesté contre cette déform ation des fai ts .
Pour fa ire une expérience, i l est vra i . i l faut dans la plupart des cas des apparei ls
,m a is l ’esse ntiel de tout ce qui est expér imental est non pas dans ces der nier s
ma i s dans l’
idée d’
a r r iver i l une expér ienceg rdce i l leur emploi (p .
Ce préc ieux tém o ignage est à noœ r,bien qu
’ i l vienne d ’
un expérimentateurnon l ingu iste. Les paroles deM. Gu l z mann qu i n
’
est pas suspec t , pourront donner à réfléch ir .
Après ces général i tés , M. Gutzm ann aborde sa propre tâ che,c
’
est-à-d ire lecôté phys iologique de la question , la part ie acoust ique ayant été confiée à unautre rapporteur d
’
une com pétence bien connue,M. S truy cken, et i l m ontre
comm ent les observations et les expériences phonétiques peuvent êtreut i l isées dans la lary ngo log ie. Ains i , à propos des m alad ies de la vo ixdues aux défauts respirato ires i l rel ève comment la m éthode graphique peut
donner, en ce qu i concerne l’
expirat ion ,des ind ications su r des phénom ènes par
t iculiers qu i ava ient échappé à l’
observat ion (p . plus lo in aussi i l ind ique ce
que l’
on peut tirer des mesures fa ites sur la dépense d’
a ir dans la paro le (p . 10— 1
i l m ontrede m êm e comm ent la s im ple étude des m ouvem ents du larynx peutavo ir son im portance dans la thérapeutique (p. 1 5 ) et comm ent l
’
analvse du
courant d ’
a ir phonateur peut donner, el le auss i , des ind icat ions uti les au m édec in(p . Pour expl iquer les d ifférents m odes de l ’attaque des voyel les , i l ajoutedes figures (p . 16
,1 7 , 1 8) et fait rem arquer de nouveau q ue c
’
est par la courbeque l
’
on obtient l ’ im age imm éd iate des phénom ènes qui se passent à la g lo tteet qui ne sont pas accessi bles à l ’observation s im ple (p . Après cela
,i l énu
m ère les procédés phonétiques qu i peuvent trouver une appl ication c l in iqueimm éd iate; par exem ple si l
’
on étud ie la resp iration ,on fa it expirer le m alade
pendant qu’ i l chucho te une voyel le et l
’
on contrôle la durée de l ’expiration au
m oyen d’
une m ontre ou b ien on exam ine la vo ix au m oyen d’
un d iapasonetc . Arrivé aux m éthodes relatives aux m ouvements buccaux , i l fa i t ressor tir queleur base est donnée par les apparei ls sortis de l
’
éco leMarcy ,ceux deMM. Rosa
pel ly et Rousselot (p . Pour ce chap itre connu i l renvo ie au rapport deM .
Zwaardem aker, présenté au Congrès deBudapest en 1 909 . Enfin i l m entionne les
nouvel les expér iences fa ites avec les rayons X et exécutées par MM. Barth et
Meyer, la photograph ie extérieure de la bouche pendant la prononc iation dessons
,l ’enreg istrement des m ouvem ents buccaux , l ’ importance des d ifférentes
parties de la cavité buccale pour la produc tion du son,les expériences de M.
Biebendt sur la force avec laquel le le vo i le du pala is s’
appl ique contre la paro idu phary nx , l
’
épreuve a— i deM. Gutzm ann pour déterm iner le fonct ionne
400 COMPTE RENDU
Quant aux courbes , el les do ivent être fa ites de sorte qu’
une analyse m athé
mat ique so it réel lem ent poss i ble. Les courbes des flammes,les cerc les de fum ée
(Rusz ringe) et d’
autres sem blables ne s’
v prêtent pas du tout et ne peuventservir que pour déterm iner la hauteur m us icale des ampl i tudes prononcées lep lus fortem ent au po int de vue phy sique cependant le ton ob tenu n
’
a pas
beso in pour cela d’être identique avec la hauteur m us ica le de la vo ix ,
Pour q u’
une courbepu isse servir à l ’ana lyse m athém at ique i l faut le concoursdes cond itions su ivantes 10 El le do it avo ir des l im i tes suffi samment nettes pourla m esure des ordonnées ; 20 on do it prendre indépendamm ent une courbes im u l tanée du tem ps ou bien déterm iner la vi tesse de l ’enreg istrement d ’
une
autre façon 30 le po int écrivant (po int lum ineux , po inte) ne do it pas dépasser
une certa ine m esure par rapport au nom bre des ordonnées . S i un po int lum ineux a p . e. un d ix ième de mm . de d iam ètre dans la d irect ion de l ’enreg istrem ent et si une période a 5 mm . de longueur , on ne peut em ployer que 5 0
ordonnées comm e m ax im um 40 avant l’enreg rstrement
,le po int écrivant do i t
être exam iné avec so in par rapport la d irec tion de son m ouvem ent ce mou
vement ne do it être qu’
exac tem ent vert ica l par rapport a la d irection du m ou
vem ent du film récepteur (ou bien de la plaque) et ne do it représenter aucunefigure de L issajou . Dans le dern ier cas l’analvse m athém atique ind iquerait dessons com posants faux ; 5 ° l
’
agrand issement , surtout s’
i l se fa it pendant l’
enre
g istrement d’
une faç on m écan ique ou par l’ induc t ion m agnétique do it être exa
m iné après, par rapport à ses défauts 60 on do it pouvo ir transformer les courbesen son 7
0 les sons jusqu’à 6000 vibrations doubles de force modérée
,do ivent
sûrement se retrouver dans la courbe (les sons com posants des 5
Les m éthodes d ’
agrand issem ent pour l’
étude des courbes sonores m ic roscop iques , m éthodes que l
’
on em plo ie so it pendant l’
enreg istrem ent so it plus tard ,peuvent se d iv iser en quatre séries 10 Mouvem ent angula ire des petits m iro irs .
2° sy stèmes opt iques (m icroscope, té lescope) ; 3 0 d im inution du lum en (entonno ir
,capsu le de Kon ig) et réfléch issem ent ; 4
° induc tion é lectromagnétique(té léphone, m icrophone, ga lvanom ètre à boy aux , osc i l lographe) .
Le tro is ième m ode d’
agrand issem ent est enti èrem ent à rejeter ; les ang les duréfléch issem ent dans un entonno ir deviennent s i grands au bout le p lus étro itqu
’ i l n ’
y a p lus de renforcement de force éga le pour tous les sons . L’
ag rand is
sem ent é lec trom agnétique change la courbe dans une m esure assez considerable et dans les ga lvanom ètres à boy aux très sens i bles , i l n’
est presque plusaccessi ble au contrôle.
Ce ne sont que les observations du m ouvem ent aérien au m oy en des sy stèmes
optiques tels que celu i de R aps ou celu i deTôpler qui peuvent donner des im ages
exactes . Malheureusem ent ces im ages sont tr0p peu nettes pour que l’
on pu i sseapercevo ir les petites am pl itudes des sons com posants supérieursAins i qu
’
on le vo it,les deux rapports tém o ignent de l
’ intérêt que la phonét ique expérimentale évei l le dans les m i l ieux m éd icaux . C ’
est un fait dont ont
n’
a qu’
a seré jou ir et qui ne m anquera pas non p lus d’être bien appréc ié par les
l ingu istes . I l produ ira au m i l ieu d ’
eux un retent issem ent saluta ire.
Jos . CH LUMSKŸ
TABLE DES FIGURES
K aneka toku
Groupe d’
Arnos
I .
2 .
3 . Terri to i re des Amos .
4 . Apparei l enregistreu r de vo vage
5 Tambour insc ripteur .
6 . Voyel le nasal isée (a ,a) .
7 . Voyel le nasal isée (6 ,8- 1 1 . Spirantes
1 2 . Fausse aspi rat ion .
1 3 S ifflante
14 . S ifflan te sou rde .
1 5 . S iffiante sonoreI 6 . Siffiantemi— sono re
7-20 . Semi—o cclus ives s iffian tes
22- 2 5 . Semi—Occlus i ve vibrante26 . Occlus ive gu ttu ral27
- 28 . Occ lus ive dentale in i t iale .
29 . Occlus ive labia le médiale
3 0-
3 1 Occlusive lab iale finale
3 2 . Occlus ive dentale finale
3 3 . p fina l devenu spi rant
3 4 . t final devenu spirant .
3 5 Nasale finale
3 6 . Nasale gu ttura le comparée à la dentale
3 7-
3 8 . Prononciat ions catalanes (palais artificiel) .
3 9 . Tracé du m o t papa
402 TABLE DES FIGURES
40 . papa prononcé par un Al lemand de Vienne .
4 1 . upon prononcé par un Américain
42 . Calque des tracés de M . Meyer
43 . Spéc imen des tracés de M . Wagner
44 . apa
4 5-
46 . Apparei l de M . Garten
47 . Variat ion du tracé par l’
asso urdissem ent de la mem
brane . 9 5
48 . i chan té . 9 5
49 . seb . 9 6
5 0—
5 2 . Apparei l du Dr S t ruycken . 142- 14 3
5 3 . Abaque logari thmique de correc tion 144
5 6 . Enregistreu r phonograph ique, système Llo ret . 148
5 7 . Levier double de l ’apparei l Lio ret 1 5 0
5 8-
5 9 . Consonne explos ive ent re voyel les . 1 64— 1 6 5
6o -6 1 . Consonne implos ive entre vovel les 1 66
62—6 3 . Consonne implos ive devant une consonne . 1 67- 1 68
64 . Consonne implos ive et explos ive devant une con
6 5 . Consonne explos ive devant une consonne .
6 6 . Douce et fo rte devant une fo rte
Douce et forte devant une douce
68 . Douce et fo rte devant une fo rte. .
69 . Douce et fo rte devan t deux fo rtes .
70 . Arti cu lat ion du t et du (I'
.
7 1 Sono re devenue sou rde devan t m
72 . Sou rde su iv ie d ’
une au tre sou rde .
Varié tés dans la sono ri té d ’
une sou rde .
Sonorisat ion progress ive d ’
une s
7 5 Assou rd issement d ’
une consonne qu i a sonorisé u ne
sou rde .
76 . Assou rdis æmen t d ’
une Sono re
77 . D ist inction de la sono re et de la sourde conservée
404 TABLE DES F IGURES
1 20- 1 2 1 . pâpângu . …
1 22 . pampyâ naî'
a
1 2 3 . mpampyânu
124 .
1 2 5 . mpä mpyâ na
1 26 . tm înîa
1 27— 1 28 . teZnî a .
1 29 . tuûnî a
1 3 0— 1 3 1 . ta nfu
1 3 2 . tûmpfintâni …
1 3 3 . tûmpüm ztâ ni …
1 34 . mam :
1 3 5- 1 3 6 .
1 3 7— 1 3 9 . mîbâbi
140 , âeâî
14 1 . bibi
142 . didi
143 .
144 .
14 5 . {d(æ .
1 46 . gâgæ
147 .
148 .
149 .
1 5 0 .
3 78-
3 7 9 .
TABLE DES MATIÈRES
Phoné tique d ’
un groupe d’
A1nos (avec 3 6 par l’
Abbé
Rousselot
É tude de prononciat ions catalanes à l ’aide du palais a rt ifi
ciel (avec 2 par P . Barnils
La mesu re des du rées r y thmiques dans le vers , par Paul
Verr ier .
Observat ions sur les insert ions de consonnes en suédo is
moderne, par Pau l Ver r ier
La question du passage des sons (avec 6 par
J . Chlum sk ÿL’
apparei l de M . GARTEN pour l ’enregist rement photogra
ph ique de la paro le (avec 5 par J . Chlumsk ÿ .
Chron iqueNo tes de phonét ique h istorique . ludo—eu ropéen et semi
t ique, par A. Cuny
Une var iat ion métrique i nversion de l ’accent par
Paul Verr ier
Changement de i s en le à Del phes , par Hubert Pernot .
Apparei l du Dr STRUYCK EN pou r la pho tographie des vi bra
t ion s sono res (avec 4 par S
Remarques sur l ’apparei l LIORET (avec 2 par
J . Chlumsk ÿ .
Té léphone écrivan t . B ib l iograph ie, par J . Chlumsk ÿ .
D i ct ionnai re de la prononciation française (sui te) (avec2 3 par l
’
Abbé Rousselot
Cours de gramophon ic , par Marguer ite de Saint—Genes .
Chron ique
406 TABLE DES MAT IÈRES
Contribut ion à l ’étude des in tonat ions serbes (avec 2
par Miloche lvcovitch
Compara ison des tracés du phonographe et du pet it tambou r (avec 4 par J . Chlumskÿ
Essai de mesu re des sons et sy l labes tchèques dans le dis
cou rs su iv i (avec 8 par J . Chlumsk ÿD i ct ionnai re de la prononciat ion françai se (m i le) (avec
9 par l’
Abbé Rousselot
Tableau sommai re des sons du français , par Margueritede Saint-Genes …
Chronique
La déclamat ion du vers français à la fin du XV I I“ s i ècle,
par Georges Lote
Phonétique malgache . Voyel les du d ia lecte merina
(avec 46 par l’
Abbé Rousselot .
Co urs de g ram ophonie, par Marguer ite de Saint—Genès …
Compte rendu,GUTZMANN et STRUYCKEN
,Über d ieBez iebmr
gen der exp wimm lelhw Phone/ik ( ur Lnr rngolog ir , par
J . Chlumsk ÿTable des figures .
Table des mat ières
Index alphabé tique
Transcri ption phonétique
408 INDEX ALPHA BÉT IQU E
bs et ps , 1 70, 1 72 . muet
Catalan, 5 0
-68 .
Consonnes intervocal iques , 1 6 3 ;mou i llées , 4 1 . Groupes
de 1 5 9 sqq ; expériences,
1 87 ; va leu r des j ugementsde l ’o rei l le, 1 88 . Consonne
+ y ,2 68
,27 5 .
Contaminat ion de deux fo rmes
phonétiques dans des parlersvo i sins
,1 20 .
Courant d ’
ai r phonateur en
tchèque,2 5 4 .
d catalan,64 ; français , 268
,
306 .
Dél imi tation des sons,80 sqq .
D ifférences d ialecta les à l ’ interieu r de l ’ indo—eu ropéen
(doctrine de M . A. Mei l let) ,1 1 1
,n . 2 .
D ifférenciation de sonante à
voyel le en sansk ri t et en german ique
,1 1 2 .
D i ss imi lation aud i tive, 1 90 ;
o rgan ique,1 79 ; a dis
tance dans les rac ines indoeu ropéennes , 1 3 1 .
dp et tp au palais artific iel,1 74 .
Durée. 2 1 9 et t imbre, 1 7et art icu lat ion, 5 4
comparée des voyel les l ibreset entravées , 5 9 ; rvth
m iques 69 .
e frança is,290 sqq .
final , 19 8 , 284 , 3 9 3 .
é catalan ,
e 0 zéro,seu le vraie voyel le
indo—européenne,1 20, 1 2 3 ,
—en final en français,28 3 .
Enregist rement . Expérienceavecl’
enregistreu r et le phonog ra
phe accouplés,
1 2 . Contrô lede l
’
2 1 3— 2 1 6 ; des m on
vem ents o rganiques , 2 1 5
de la vo ix,2 1 5 prin
c ipes de l’
1 5 8 ; s imu ltane du travai l des o rganesphonateu rs , 2 14 .
Enseignement de la phonet1queen Au triche
, 97 .
Épenthèse en suédo is , 77 .
Explosion cond it ionnée par la
voyel le,1 6 3 .
Caractère laryngual de
indo—eu ropéen,
1 1 6,
1 24 ,
1 2 5 sa fonction consonan
tique, 102- 107 , 109— 1 12,
1 1 7 , 1 1 9 ; sa fonct ion vocal ique
,102 . Tr iple t imbre de
9 en indo -européen (greca,o) , 1 22 , 1 23 , 1 24 . Tra i
tement indo-européen de y,zu
,m
,n,r 9 devant
consonne, 102 , 1 1 7 .
3 . Trai temen t de en tokharien
,1 1 3
— 1 20 . Trai tementde i ndo-eur . en seconde Syl
INDEX ALPHA BÉT IQUE
labe dans l ’osco —ombrien,
1 22 .
re français , 294 sqq .
[ français , 3 0 3 .
Fina les ; vo i r abe, e muet, en
ge. Voyel les tombées, 3 84
Forme des racines indo -eu r
(règledeF . deSaussure) , 1 28 ,
1 3 0 .
Fractures en vieux norro is et
en viei l anglai s, 7 6 .
Français . Tab leau sommai redes sons du 2 86 sqq . abcès
,
abscisse, 1 5 9 sqq . abdiea î ion,
abdiquer , abdomen,abdom i
na l , abducteur , abduct ion,abe
cédaire,abei llage, abei lle, abei l
ler,260 sqq . ; Ache
'
ron,1 9 8
teste, 103 no te.
g français, 268 , 3 06 .
Gau lo i s arganto 1 1 2 n .
—
ge final en français , 284 .
G l ide,vo i r Passage.
Gotique bindan,107 broÿ a r ,
1 1 3 daddian ,1 1 2 daùbla r ,
1 1 7 ; hi lpan,107 ; (vba .
bnapj N apf, bweit(s)all . weiss, angl . w(h)ite, 1 1 1kinnas, 1 20 ; m i tan
,104 ;
sind,106 ; skaba
,1 1 2 ; séle
jan, 1 0 2 ta i/ms, 1 3 0 ; (vha .
umbi,1 1 2 (v . norro is
uefa , 10 5 ) g . wahsja ,wôbs ,
1 1 2 ; wa irpan, 107 (vha . wé
Revue de phonétique
ban,
vba . [gwein]-z ng ,
Gramophonie, 1 92 sqq .,2 1 3 ,
sqq . ; lectu re destracés
,2 1 5 .
Grec ancien 1 1 1‘
I 1 I,I 1 5 â(F)âcm v
1 1 2 ; &p.cpi , I I I , I I 3 ;:z p.cpm ,
1 1 3 ÔZP‘
(UPOÇ , ôipy uç oç ,
1 1 2 n . ; âipor pcv , 1 2 1,
1 2 3
1 1 2 abÈ,w, I I I
,
1 1 5*
! 3 VU ç , 1 20 ; 8auâ c a r, 1 2 3 ;
1 2 1,1 2 3 ; Sym ,
1 1 9 ;
i;J .âv , êc r â , éc u ,
t06t, I I S ;
1 10 . n . 1 ; sim,1 1 6 °
) .ur ç ov, 10 5 n . ; ët éç , 1 22 ;
(âvéoua a) , I 02 ; Os
-: 5 ç , 1 08
,1 2 1 , 1 22
,1 2 3 ;
0'
f'
3ç , Ô r,r ôç , 109 ; Ouy i r ep
Ouvri r /79 , 1 1 3 , 1 1 7 ,1 20
’
ia cn,
1 1 5 ; i'
n.sv, 1 1 5 ; p.02xoua r,
I 1 2 ; p.e'
ya ç , 1 20 ; ôp.bc a 1,
ôgaé uov.a , I 2 I ; 7: 1‘
tép I I 3 ;
sm t p-i,1 2 3 ; ne€6w
,m Oñva r,
I
rc a: âvvupa , 1 2 1 eu'
00p a r,
107 ; 0t 1 1 5 ; , 10 3 , I I I , 1 1 9 ,
1 2 1 . 1 2 3 ; Üçñ, 10 5 ç a pâr pa ,
O2 ; 7c âpôm,ar paÜeâv 102 ;
e un, 1 06 ; z ur s ç . 1 06 .
G rec moderne : m ar ç z êârm,xc
ç ape: pov, 1 1 7 II . ;
ü
t arô, a our c oüpr, Kw‘
tas ç ,
: sr auiuar a , r aa p.avr âv z , 1 3 9
aavr igl a , r c îwa , 140 .
26
410
h am o ,24 sqq . frança is,
302 tchèque,2 5 7 . In
tercalat ion de entre deuxvoyel les de même natu re
,
2 2 .
Haleine. Emiss ion d ’ dans leslangues scand inaves, 77 sqq .
Hau teu r musi cale,2 3 7 , 248 ;
en serbe,
2 1 1 dansles vers . 3 5 3 .
Hébreu pâqad, 1 3 1 pâ qah,1 3 1 ; qâ /a l , 1 27 ; sâ haq , 1 28 ;
yiqtol , 1 27 .
Hongro is . Phonétique d i i 8 8 .
hop, 92 .
i catalan, 5 4 , 5 6 ; français,
29 5 sqq de a tio n,26 5 .
i y , 20 .
Implosion, 9 2 condi t ionnée
par la voyel le, 1 6 3 .
Implo s ive. Consonnes 1 67
1 69 .
Indo—européen *bhéreti ,
*bhe
'
r
ti,103 n . 1 1 7
n . ;*bhûtôs
,10 3 , 1 1 7 ;
’
dhu
gâ ter 1 20 ;*
génus , 1 20 ;*
g ,hnnd mti , 1 06 d ial .*
g ä'
ous
thés,1 0 3 n . ;
*imés
,p . 1 1 5
*itg) , 1 22 n . ;
”kä
’e,
*k3”ôs
,
1 2 1 n . ;*
mbhi ,*
gmbhi , 1 1 1 ,
1 1 3*megÿ 1 20
*mfl ôs,
10 3 ;*
pgtir 1 1 3 ; _
*
pf thûs
1 1 9*
plnä oni*
plnâm i , 104 , 1 0 5 ;*se
'
nti,
INDEX ALPHABÉT IQUE
104 ;*s1êtôs, 1 1 9 ;
s ig*t0
'
s (stÏ nÔ s) , 1 02,
10 3 ,
1 1 7 ;*steAtnm
*sthâ tum
,
10 3 n . ;*ubh tri 1 26 ;
*wélutrom,
10 5 n .
*wlné
a nni,
10 5 ;*
yuneg zmi , 104 .
Insert ion de consonnes, 7 6
sqq .
Intens i té,2 1
,2 1 2
,2 1 9 , 2 3 7 ,
2 3 9-240 , 248
-249 ; phys iolog iq ue,
14 5- 146
—
phys ique
,1 46 . Influence de l ’
su r la du rée,2 5 1
— 2 5 3 .
lnterd épendance de la phonétique et de la mo rpho logie
,
106 , 107 , 109 , 1 10 .
In terprétat ion de la loi de
Bartho lom ae (assimi lat ionconsonantique progressive) ,1 26 .
Inversion de l ’accen t,1 3 3 sqq .
6 3 ;j cata lan, frança i s ,
267, 3 04 .
catalan,6 5 .
le am o, 4 1 angla is et a l le
mand,82 ; français
,268 ,
306 .
6 aïno, 24 , 2 5 , 26
,27 ; al
lem and,espagno l et tchèque,
2 5 5—2 5 7
5 -9 f en aïn0,24 .
Z‘
h en aïno,24 .
ê aïno , 3 2 .
Ê aïno ,
41 2
Métrique, 69 sqq .
,1 3 3 sqq .
,
3 1 3 sq q .
M i ro i rs,1 5 8 .
n cata lan,62 ;
—français 268 .
N asa les . Consonnes en aïno ,
49 , en fran ça i s , 3 07 ; voyel leset d iphtongues en français
,
29 9 sqq . Nasal isation,14 , 1 8 ,
3 70 . Influencedes consonnestchèques su r les voyel les et
les consonnes vo is ines , 2 5 7 .
Résonance nasa le et nasal i té ,2 5 4
Norro is (vieux) , 76 .
y catalan ,66 ;
—français , 27 3 ,
3 07
o français,290 sqq . Echange de
o et de n en aïno,1 3 .
Occlu s ives en aïno, 3 9 sqq . ;
devenant spirante, 4 5 sq q . ;
denta le finale, 44 ;
labiale finale, 44 ; nasale
finale, 48 ; nasale gu ttu
rale, 48 ; laryngiennes entchèque 2 5 7
-2 5 8 .
Ombrien i teh,1 22 n .
Osque faolad, 1 22 ; GEN ETAÎ,
1 1 7 , 1 22,1 2 3 , poterei
'
,1 22 ;
set , 106 .
p am o, 42
-
4 5 ;-français , 82 ,
30 5 ;-Slave
,8 1
,82 ; im plo
sif, 9 2
p / en am o , 40 .
INDEX ALPHABÉTIQUE
Palatal isat ion ‘
de le, 1 3 9 .
Paral lé l i sme parfai t ent re les
sonantes (y, w,m
,n,r)
en ind .
—eu r .,107 .
Passage de la consonne à la .
voyel le,8 3 , 84 , 9 2 de la
voyel le a la consonne,8 5
9 3 , 1 74 de s à y , 270 .
pd et bd,1 7 1 .
Phonétique expérimenta le et
laryngo logie, 3 97 sqq .
Phonograph ie et audit ion , 1 99 .
Po ints de contact ent re les sy s
tèmes mo rpho logiques de
l ’ ind .
-eur . et du sémitique,
1 3 2 .
Poss ibi l i té de conci l ier les sy s
tèm es phonétiques ind -eu r .
et sémitique, 1 3 1 .
Poss ib i l ité phys io logique de Aen ind —eur de igi , pro
venan t denr a,
a,1 1 6
1 2 5 .
ps et bs , 170 ,
Q uan ti té , vo i r durée.
r am o, 3 6 sqq . ;
— cata lan,6 1
sqq . ;- frança is
,268
, 3 0 3 ;Êsy
' l
labique en tchèque. Echan
ge entre -et l en aïno , 3 6 .
catalan,62 .
Redoublement de voyel le finale,
2 2 .
Ry thme,69 sqq .
,100 .
f . 3 7 , 3 8 , 3 9
INDEX ALPH ABÈTIQ U E
s‘
a1no ,28 , -catalan
,6 3 ;
— franç ais
,267 , 3 0 3 .
s et sy , 269 , 270 .
s h,10 3 no te.
s
5 5 , 28 .
Sanskri t abhi,1 1 1 adhwgâ t
107 ; ag refi hd 108 ; ahdm,
1 1 9 , 1 20 ; dha ti , 1 1 1 ; â kafl ,
1 1 2 ; bhdra l i , bhâ r ti , 10 3 II . ;
bhz“
irjah, 1 1 7 ; bhrâ ta r 1 1 3 ;
bodheya 1 1 2 ca 1 2 1 n . ; eve'
lo
1 1 1 devastd t 106 ; dhdva ti ,
1 1 2 ; dubi tâ r dubita,
1 1 3 ,
1 1 7 , 1 20 ; dyngdt 1 07 ; edhi ,
1 1 5 e'
m i,1 1 0 n . 1 g îr , 107 ,
1 08 ; gosthdh, 1 0 3 n .
,108 ;
g rabhîta r 104 g ;rbhnîmah ,
104 hdm i 1 20 ; hitdh, 108 ;
hotmn,106 ; hui /th, I O6 ; i z_ndh
1 1 5 ;—i t 108 : i i i
,1 2 2 n . ;
jdnitnm ,1 1 7 , 1 2 2 ; hdi) , 1 2 1
n . mahdnt 1 20 ; dima ,104
pâ çya l i , 1 3 0 ; pimsmah, 104 ;
pi tâ r 1 1 3 pwâm i , 104 ,
10 5 ; pfl hûh, pfl hioi , 1 1 9 ; pâ‘
r,
107 , 108 ; raja td1n 1 1 2 11
samhdt 1 07 ; sthä /nm,10 ,
n . sthitâh, 10 3 sti rnâh, 102 ;tistha ti , 1 14 ,
1 1 9 ti ,sthâ m i ,
1 1 9 ; nbindti,
1 10 ; u/e,sâ ti
,
1 1 1 ; uma 10 5 ; zi rnavâ bhi
10 5 , 1 26 ; vajrabhfl 1 06 '
eâkmti , 1 1 1 ; vôr utram ,1 0 5
n . vdya ti , 10 5 vâ tmn,10 5
w’
o iseau ’
, 1 1 1 ; v içvaj i t
4 1
1 0 6 wuôm i , 10 5 ydnti , 1 1 5 ;yuudjuz i , 104 .
Sc indement de phonèmes (casde poss ib i l i té et d
’
im poss ibi
l i té) , 1 2 1 .
Semi- occlus ives . Varié tés de,
3 1 , 3 6 .
Sémit ique,10 1 sqq .
- commun
*DaH ak 1 28 .
Serbe,100 . Intonations 20 1
sqq . god , 206 sq q . ; gadan ,
207 sqq .
s i,27 1 .
SitRantes . Varié tés de 28 sqq .
S lave (Lituan ien) v . sl .*brèza
( I‘
. berèça , l i t . be'
räas) , 1 1 7 ,
1 2 1 ; tchèque î lyf i , 1 1 2 ; v .
s l . dojo, 1 1 2 ; v . sl . dus/ i ( l i t .dukt5 ) , 1 1 7 ; v . sl . mrùlvû
10 3 ; v . sl . peleg , peëetñ ,1 2 1
II . ; I'
. d ialecta l pasa l i , v . s l .
pagi ti , s l . comm .
*1
’
0?nñ (I‘
.
—
vo'
ron,l i t . va i nas
,1 2 1 .
Sono res . assou rd ie ,1 8 1 ,
1 82 ; assourd ie devant1 7 7 ; tendant à s
’
assou r
di r entre vovel les , 42 ; sonoresonore
,176 , 1 78 , com
parée a sourde sonore,1 89 .
Sonore sourde, 1 5 9 , 177 ,
1 8 3 , comparée a voyelle
sourde,1 84 . Compara ison de
sonore sourdeet de sourde
sourde,1 8 3 . Sonore deux
sourdes, 1 78 , 1 8 2 . Sono risat ion progressive de s
,1 80 .
4 14
Sono ri té sans valeu r s ignifica
t ive,2 3 .
Sons . Côté phys io logique des2 1 3 , 2 14 ; phy sique, 2 1 3 .
Souffl e pou r sonore sourde et
sourde sonore, 1 8 5 ter
minant une vovelle finale,
77
Sourde sonore,1 7 9 .
Suédo is . Insertion de consonnesen 76 sqq .
sy. Passage de s à 31, 270 .
Sy l labat ion ,1 9 9 .
Sy l labe, 87 . Mesu re des en
tchèque,2 5 1
—2 5 3 .
et catalan,6 5 ;
— franca is ,
3 04 .
catalan . 6 5 .
am o, 4 1 , 44 ;
—al lemand,an
glais,français
,s lave
,8 2
- cata lan,64 ;
-frança is , 268 ,
30 5
t L’ en grec, 3 9 .
Tambou rs . Grands 2 1 5 , 2 1 6 ;
moyens 2 1 5 , 2 1 6 ; pet its
7 , 2 1 5 , 2 1 6 . Tracés du
pet i t 2 1 8,242 à m em
brane flex ible,2 14 , 2 1 5 ;
à membrane rigide ,2 1 3 ,
2 1 5 ; Marey ,2 1 5
Rou sselo t, 2 1 5 , 2 1 6,2 1 8 .
INDEX ALPH ABÈTIQU E
11 frança is,29 7 sqq . variante
de i en aino ,1 3 .
u—w
,20 .
—
v franç a is , 3 0 3 .
Vén i t ien eolaz zou,1 3 8 .
Vers français à la fin du X\'
111°
siècle, 3 1 3 sqq .
Tracés du Rousselo t , 2 1 8
Tchèque : aani , 2 5 7 , 2 5 8 ; hop,
92 ; chacha fa îa) 2 5 5 ;
2 5 7 ; ehvâ îd , 2 1 7 , 23 0-2 3 2 ,
2 3 9 na m lhavém,2 5 2 Paris
,
2 5 3 ; rade,2 1 7 , 226
,227 ,
2 3 9 ; S rb, 2 5 9 ; refer, 2 1 6,
2 1 7 , 2 1 8 , 220—224 ,
2 3 9 ; tma ,
2 5 8 ; Vaso/a , 2 1 6,224
— 2 30 ,
2 3 9 , 242-24 5 voborsko
,2 1 7 ,
2 34-2 3 6 , 240 , 24 5
-247 ; z a
kâ { (tt, 2 1 7 , 2 3 2— 2 3 4 , 240 .
Timbre,100 ; et quan ti té
,
Ip et dp au palais art ificiel,1 74 .
Fokharien a…pi , ampe, 1 1 3 ;
cleaea r thàeer 1 1 3 ; ma lai
(à co rriger ains i) , 1 20 n . ;
pa rti r 1 1 3 ; procur 1 13
.
Traces de fo rmes de racines antér ieu res a la règle de F . de
Saussu re, 1 3 0 .
Tracés . Lectu re des 2 1 5 .
s k a Del phes, 1 3 9 .
te te”
,140 .
'ΑRANSCRIPTION PHONÉTIQUE
Musi que. V. D .
,v i brat ion double. V. S .
,v ibrat ion s imple.
Traces . D,diapason . B
,bouche. I larynx . N
,nez .
Alphabet . Sauf ind icat ion con trai re,les let t res ont la même
valeu r qu ’
en français .
Voyelles a (ou en (en LI (russe) .
Semi -voyelles : u, u, i (presque voyel les) ; fr . ou i) , en (fr .
puis) , y (yod) .
Consonnes n u gu ttu ral) .
à et (7°
1 et 6 (ch
(eh doux 5 (ch dur (g continu) .
b etp (b et p con t inu s) .
f (r grasseyé), (vo i sin de f) , r (tchèque) .
1) ou aspirat ion .
Signes diacr itiques . Voyel le ouverte ou grave (à) , fermée oua iguë m oyenne(sans s igne, a) ; nasale (a), demi
accen tuée (a) ; longue (à ), brève (à), moyenne ou sanss igne (ii o u a) . Consonne mou i l lée (l), semi— occ lus ive (à
le en un son, i dj en un son Interden ta les (s , Varia
t ion de sonori té
0 hau teur musi cale ou ton,ton seconda i re. A intensité , A
intensi té secondai re, s i lence.
Sons intermédia i res : let tres superposées .
Sons mou rants ou nai ssants pet i ts caractè res .
Sons inspirato ires : let tres renversées .
La va leur des ca ractères non mentionnés ic i est indiquée dans les a r ticles ou i ls
sont employés .
MACON ,PR OTAT F R ÈR ES , IMPR IMEU R S