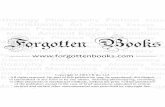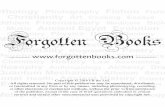LIslam Et les Races - Forgotten Books
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LIslam Et les Races - Forgotten Books
DU MÊME AUTEUR
PI E RRE REDAN La Cilic ie et le Pro blème olioman . Paris ,Gauthier 10 fr .
P. J . ANDRÉ E tudes sur la C ilic ie .
1 ° Notes introductives à l ’étude des Ansarieh (pub lié par l
’
Asie française) .2° Le Sandjak de D j e b el—Bereket (Asie française) .
3° Caractères de la guerre en Cilicie (Asie française) .4° Les Tcherkesses et les Kurdes (en préparat ion) .
En collab oration avec J . CAMPARDOU
1 ° No tes introductives à l ’étude de la région de Taza(Maroc) .
2° Notes sur quelques m onuments anciens de Taza
(Afrique française , aoû t
En achèvement
Aux Confins du pays berbère.
CAPITA INE D’
INFANTER IE COLONIALE(PIERRE REDAN)
L’
I SLAM
ET LES RA CES
TOME SECOND
LES RAMEAUX
(MOUVEMENTS RÉGIONAUX ET SECTE S )
L IBRA IR IE OR IENTAL ISTE
PA U L G E U TH N E R
1 3,RUE JACOB PARIS
,1 922
L’
ISLAM ET LES BACES
LES HAMEAUX
(MOUVEMENTS RÉGIONAUX ET SECTES)
INTRODUCTI ON .
I l existe au sein de toute grande reli gi on une force
di ssolvante , celle même qui a servi le plus pui ssammentà la constituer d
’
ab ord a la place d ’ une autre : l ’ indé
pendance du j ugement individuel Cette force
dissolvante se fit sentir dés qu e les successeurs de Maho
met eurent oubli é son ascendant personnel, des que des
races étrangères converties à l’
Islam eurent apporté
leur esprit critique d ans l’
étude de la doctrine .
Les d iv is ions poli tiques . Le premier élément de
divi sion fut la raison politique . L’
Imam at avai t été
transmis , sel on les ort hodox es ottomans , des Arabes aux
Turcs par une séri e d’
usurpat ions qui rompirent l’unité
politique et religi euse de l’
Islam . Mahomet , en élevant
sa famille au premi er rang dans La Mekke , avait enlevé
le pouvoir à des clans riches et puissants qui , après
avoir d’
abord vai nement lutté contre lui , embrassé
rent la nouvelle religi on , les uns par conviction réelle,
(1 ) Guy an , L’
I rrélig ion de l’
a ve n ir, In t rod ., p . XV I I I .
2 INTRODUCT ION
l es autres par ambition raisonnée . Ces clans , semblables
à tous les co i s qui se partagent le monde arabe, tirèrentparti de toutes les occasions pour augmenter leur i n
fluence , finirent par s’ emparer du khalifat , au détriment
de la descendance naturelle du Prophète . Tels furent
les Om ey y ade s, t els furent les Abbassides .
Les familles dépossédées du trône s’
enfuy aient , al
laient chercher refuge dans une contrée éloignée ou dans
une provi nce qu i leur restait fidèle . L’
islam ism e , dans
son lib éralisme, n’ avait pas éteint les particularismes
lo caux chez les peuples soum is e t convertis . Les—fugitifsétaient accueilli s au mieux par ces peuples qu i pro fi
t aient de leur arrivée pour affi rmer leur vitalité, leurdésir d ’ indépendance , et , sous un prétexte de secours
à donner aux princes dépo ssédés , entraient en lutte
ouverte contre le pouvoir central . D es états dissidents se
formèrent ainsi ceux des Alides en Arabie, en Perse, ceux
des Om ey y ac‘e s en Afrique, en Espagne . En même temps,
a la faveur des rivalités et des luttes affaib li ssantes,les gouverneurs des provinces éloignées fondaient des
dynasties d ’ abord vassales , rapidement indépendantes .
Lorsqu’
enfin les Turco-Mongols vinrent porter le
dernier coup à l ’ empire abbasside, lorsque l’
Ot t om an
Sélim se fut emparé de l’
im am at , le pouvoir spirituel
et temporel des premiers khalifes ne représentait plus
qu ’un fantôme traditionnel . Les Ottomans se considè
r ent comme les héritiers du khalifat . Or en dehors de
toutes les dissi dences arab es , les Turco-Mongols lai s
sèrent aussi dans l’
émi e t t em ent du khanat, des grou
pem en t s musu lmans sur des terres j amais soumises aux
Ottomans . En Chine, en Afghani stan , en Russie, dansl’
Inde vivent des communautés musulmanes grandies en
dehors de l’ ob éissance directe à l
’
im am at . Dans l’
int é
INTRODUCT ION 3
ri eur même de l’ empire ottoman , le s Arabes refusent
au surplus le droit aux Turcs de se parer des trophées
de leur victoire militaire .
Il existe donc, en dehors de l’
im am at ot t oman,une
séri e d ’ évolutions particulières musulmanes,découlant
les unes de l ’ expansion arabe, les autres de l’expansion
turco-mongole .
Les d iv is ions par l’
e3pr i i et la cri tique . Les év éne
ments politiques né furent pas les seuls à rompre l ’unité,
à diminuer la valeur de l’
im amat . L’
Islam fut à l ’ori
gine une religion de nomades , faite pour des —nomades .
Lorsque des peuples sédentaires convertis se furent
introduits dans la communauté, lorsqu’
aux Sémitess’
ajout èrent des Aryens , Hindous , Persans ou Grecs , des
Egyptiens , des Berbères, l’ influence de l ’ esprit parti
culier des races se fit sentir . Les nouveaux venus sou
miren t à une critique approfondie les préceptes du Ccran ,
les adaptèrent à leurs propres concept ions . L’
ex
t rêm e simplicité des éléments constitutifs de la religi on
musulmane, son cadre v aste, flexible et mobile, permit
à chacun d ’y faire entrer sans le rompre, ses i dées , ses
convictions , ses espérances , sans trop les violenter,pourvu qu ’ elles ne tiennent ni de l
’
athéism e , ni de l’ ido
lâ trie
Les prem iers commentateu rs formèrent simplement
des écoles rivales les philosophes eux durent se sou
mettre à la discipline générale ; mais une aggravation
dans les différences de compréhension se produisit lors
que la critique se compliqua de questions de politique
ou de rivalités de races . I l est assez difficile souvent
(1 ) P. Hu gu eney , Chr is tus .
4 INTRODU CT ION
de les séparer les unes des autres . L ’ apport étranger
cause nécessairement dans ces conditions l ’ apparition
de sectes . Ou bien ces sectes sont une so rte de franc
maçonnerie, de mutualité , ou bien elles sont la mani
fest at ion extérieure d’
agit at ions politiques .
Qu ’ est devenue la civilisation dite arabe au mi lieu
de toutes ces divergences allant en s’
aggrav an t Sousle gouvernement des khalifes arabes , l
’ apogée de l’
em
pire fut marquée par le développement des études . Mais
l ’ étude des sciences étrangères et profanes , la diale c
tique , la casuistique marquèrent le commencement du
déclin . L’
Islam avait porté aux peuples soumis une
morale et une loi . L ’ indépendance reconquise garda
la do ctrine , mais dans chaque contrée, la civi lisation ,touj ours à base musulmane , devint une adaptation
à l ’ évolution générale des aspirations particulières de
la'
race . D e même qu’ il existe un art mauresque, un
art persan , un art égypt o—arabe , de même la pensée,les tendances politiques , ob éissent à un idéal local sous
le grand voile commun de la religion islamique .
PREMIÈRE PARTIE
LES SCHI SMES ET LES SECTES
CHAPITRE PREMIER
KHAREDJ ISME ET CHYISME
l . LE S D IVERGENCES ARABES .
Les théologiens musulm ans , d’
après un hadith de
Mahom et, indi quent l’
exi stence de 73 sectes . Ce chif
fre s erait une perfection v is—à-vis du christianisme quin ’ en aurait que 72, et du j udaïsme qui n
’
en aurait que71 Exact ou non , ce chiffre montre que de bonneheure les div isions furent nombreuses dans l ’ Islam . Le
monde musulman s ’ est touj ours divisé en deux grandsgroupes les orthodoxes , les schi smatiques . Déj à, avant
Mahomet, les Arabes se partageaient en deux races
ennemies : les Yém éni t es, parmi lesquels se comptent
les Médinois, et les Maadit e s . Les deux fractions por
t aient dans chaque régi on des noms différents en Syriep ar exemple, les représentants du parti y ém éni te s
’
ap
p elaient Kelb it es, les Caïsit es au contraire se récla
m ai ent de Maad
Dès les débuts de l’histoire musulmane, la discussion
(1 ) Dozy , Op . c it . , p . l96 . Dan s l e che lle de s religion s le sMusu lm an s placen t t ou j ours dan s l
’
ordre de v aleur a leurs y eux
l’
Islam , le Chr ist ian ism e , le Ju daïsm e .
(2) V . Piqu e t .
6 L’
I SLAM ET LES RACES
porta sur les droits d’
Ali à l’
héritage de Mahomet .
Maowiy a fut soutenu par les Kelb i t es qui , a Kairouan ,en Espagne, en S icile, rivalisèrent à toutes les époquesde l
’histoire avec les Caïsit e s . Ces derniers , appelés aussiCaïsani t e s, attribuaient à Ali et à sa descendance « une
science occulte surhuni aine , une connaissance qui, seule ,éclaircit le sens intime de la révélation divine , mais qui
exige de ses adeptes une foi aussi grande et une ob éis
sance aussi absolue aux dépositaires de ce savoir. qu’
à la
lettre du Coran Ces divergences furent l’ origine du
premi er schisme : tous les mécontents se groupèrent
autour d’
Al i trois fois évincé du pouvoir .
Mais à la suite de l’arbitrage qui donna le pouvoir
à l’
Om ey y ade Maowiya , un certain nombre des parti
sans d’
Ali se séparèrent de lui sous prétexte que ce
derni er avait remis à la décision des hommes ce qui nedevait apparteni r qu ’ à Dieu . Au nombre de en
viron , ils sortirent donc des rangs des Alides e t
furent appelés Kharedp t es, du verb e arabe kharadja
sortir .
I I ..
LE KHARED J ISME .
Les Kharedp t e s renient également les Sunni tes ou
Orthodoxes , et les Chy i t es ou partisans d’
Ali . Il s ne
reconnaissent comme khalifes que l es trois premiers
souverains de l ’ Islam et nient toute valeur à l’
imamat
héréditaire . Pour eux, doit être seul souverain e t pon
tife l’
élu de la communauté . Leur hostilité envers Aliles poussa même à déclarer qu ’un Musulman quelconque
pouvai t exercer l ’autorité religieuse sans qu ’ il lui i nt
(1 ) D e Boe r , op . c i t . , I I I . 2. 1 . V . plus loin , Ism aïlien s
KHAREDJI SME ET CHY I SME 7
nécessaire d ’
appartenir à la famille du Prophète . Ils se
divisèrent sur la question de l ’ unité de Dieu et de se s ju
gem en t s en sept sectes différentes Naturellement cha
que groupe de Kharedj it es en vint à reconnaître comme
imam des personnalités différentes dans le sud de l ’Ara
bie, dans les îles occ identales e t sur les côtes africaines
de l’
Océan Indien , en Afrique du Nord , régnèrent des
souverains kharedp t es . Ce schisme eut nettement desc auses politiques et se développa de même pour des
raisons politiques .
Le kharedj ism e , au début de son histoire nommé
aussi ouahb ism e qu ’ i l ne faut pas confondre avec
le wahab isme du Nedjd, comprit d ès l’ origine deux
sectes'
distinctes , la première celle des Ib adites , la deuxi è
m e celle des Safarit es, du nom de leurs chefs respectifs ,Abd Allah b en lb ad et Abd Allah ben Safar . Aprè savoir été en honneur dans les royaumes du Maroc , de
la Berb érie et de la Tripolit aine , le kharedj isme existe
encore à Dj erba , au Mzab , à Oman , Mascate et à Zan
zibar . Nous retrouverons son histoire en étudiant celle
des Musulmans dans l ’Océan Indien .
En Afrique du Nord la secte contrebalança longtempsl’
orthodox ie . Sous le khalife Hisham (724 les Ber
hères , conduits par les Kharedj it es émigrés chez eux .
se révoltèren t et empêchèrent les armées musulmanes
d’
aller venger l’
échec de Poitiers . Lors de la première
période abbasside, i l se créa dans les provinces afri
caines un certain nombre d’
Et at s indépendants pro
fessant les différentes formes de la doctrine dissidente
(l ) Azraqi t e s, Moakkim a, Baïha ssia , Nadjda t e s, Safari t e s, Ib ad it e s, Adj arida .
(2) Du n om d’
Ab d allah b en Ouahb , che f du m ouv em en t .
(3) En fai t , c omm e l’
a rem arqué M. Merc ier, c e m o uv em en t
représen t e b eau coup plus un e réac t ion du part icu larisme afri
8 L’
ISLAM ET LES RACES
Partout où ils se trouvaient, les Kharedp t es, qui assassinèrent Ali et tentèrent de faire disparaître Maowiya
et Amrou , traitaient les Musulmans avec plus de cruauté
qu ’ ils ne traitaient le s Chrétiens et les Juifs . Un Kha
redj it e tuait—il un porc, il payait le dommage, dit un
auteur arabe , mais il pouvait en toute liberté massa
crer femmes et enfants , réduire des Musulmans en é s
clav age , quoique la loi le défende absolument ! Enrevanche, Orthodoxes et Chyi t e s traquèrent, exécu
t è rent de tell e sorte les dissidents que les Kharedj it es
finirent par être chassés de leurs anciens domaines .Les restes de la communauté kharedj it e en Afrique
du Nord sont au Mzab sous l’
autorité française depuis1882 et font partie du cercle de Laghouat . Comme leurs
frères d’
Om an , les Mzab it es se donnent le nom d’
l b adis,
d’
après Abd Allah ibn Ibad qui vécut à la fin du Moyen
Age Leur territoire est divisé en paroisses avec aucentre une mosquée . Les douze paroisses sont dirigées pardouze azzab s, ou ermites , présidés par un cheikh . Trois
d’
entre eux sont chargés de l’
instruct ion ,_
un autre con
duit la prière, un autre appelle les fidèles à cette der
nière , cinq lavent les morts , deux surveillen t les revenusdes mosquées . Le cheikh rend la j ustice aidé de quatre
azzab s . La peine de mort n ’ existe pas . Les châtiments
consistent en amendes , en peines corporell es . L’
excom
municat ion est très redoutée, car elle implique le bannissem ent . Le pardon est accordé aux coupables , lors
que le conseil les j uge suffisamment venus au repentir .
Les Mzab it es, agriculteurs patients, on t su faire de la
ca in , b erb ère , c on t re le s c onqu éran t s arab e s , sém i t e s, qu’
un e
S im ple réb elli on de gou v ern eu r à su lt an . V . H i s to i re de l’
Ain
que du Nord .
(1 ) Henri D uv eyrier No te sur le s chism e i bahdite , B ulle t in
de la S oc iété de Géographie , 1 878, Sesérie, t om e XV I, p . 74 .
KHAREDJ I SME ET CHY I SME 9
région aride dans laquelle ils s e t aient réfugi é s, loin
de tout groupement, une série d’
oasis riches et fertiles .
En outre il s partent s ’ installer comme marchands dansles villes algériennes et sont réputés pour leurs aptitudescommerciales .
Le point caractéri stique de la doctrine est l ’at t rib u
tion à l ’homme du pouvoir d ’ agir Les théologi ens
de la secte exigent l ’ interprétation stricte du Coran ,condamnent les saints , les derviches , les ordres religieuxet le culte des tombeaux . Les Mzab it es reconnaissent
comme pontife souverain l ’ imam de Mascate .
En Tripolit aine , au Dj ebel Nefou ça , existait une assezimportante aggloméra t ion kharedj it e . Sous la direc
tion de Sliman el Barouni,ces Kharedj it es se rallièrent
aux Italiens pour échapper en Lybie aux persécutions
des Sunnites et des Senoussist es . Les Italiens laissère i1t
leurs ennemis massacrer ou disperser ces malheureux .
Les débris des Kharedj it e s essayèrent de passer en Tu
nisie . L ’entrée du territoire leur fut refusée par les Fran
çais . Les puissances européennes voulaient sans doute
ne pas déplaire aux Turcs et aux Senoussist es,tout au
moins ne pas créer de complications . Les Kharedj ia
errent maintenant en Tripolit aine , dispersés et l amen
tables . Il est curieux de les avoir vu se rallier aux Ita
l iens tandis que leurs frères en Algérie sont plutôt opposés aux Français . Il semble que ce cas est un des
rares où la politique musulmane italienne ait paruemeilleure que la nôtre
,et encore l ’ It alie n ’a pas en le
mérite de persévérer .
En Orient,les Kharedj it es ont fondé les imamats d e
Mascate et d’
Oman , les sultanats de Zanzibar et de la
(1 ) D epon t e t Coppolan i , p . 53.
1 0 L’
ISLAM ET LES RACES
côte orientale d ’
Afrique . Les Arabes e t les Souahélis
de ces régions sont auj ourd’
hui généralement o rtho
doxe s , mais beaucoup d’
entre eux sont encore lbadites
ou Bey azi (Abaz i) . Cette dernière secte tire son nom
de son fondateur Abdullah b en Yahya ben Abaz . Fumer
e st pour eux un péché,b ien que ce soit plutôt une croy an
ce wahabite . Mai s la divergence capitale entre eux et
les Sunnites consiste en leurs théories sur le libre arbi treils pensent qu ’un Musulman quelconque peut exercer
l ’autorité religieuse sans appartenir à la tri bu de Maho
met .
La négation de la transmiss ion de l’
imamat selon le
p rincipe du consentement général (orthodoxie) , la ré
cusat ion des droits d ’
Ali à l ’héritage du Prophète , con
d amnaient le kharedj isme à n ’ être qu’
une secte pro
t est at aire . Elle durerait aussi longtemps que se main
tiendrait le fanatisme de ses adeptes , c’ est-à-dire aussi
longtemps que demeureraient les causes de ce fana
tisme : or c ’ est une question de personne qui opposait
à l ’ origine les Kharedj it es aux autres Musulmans . Lors
que les personnalités en cause eurent disparu , la secte
n ’ eut aucune base pour construire , puisqu’ elle n ’ était
q u’
une négation et non pas l ’ affi rmation d ’ une oeuvre
de v ie . Elle n ’ est plus qu’une défense du premier Islam
cependant les liens secrets qui unissen t entre e lles les
d ifférentes communautés kharedj it es en font une secte
e ncore importante dans le monde musulman , mai s localisée dans un rayon d ’ action étroit . Ce rayon d
’ action
v a cependant du Mzab à Dj erba (Afrique du Nord fran
ça ise ) , du Dj ebel Ne fouça (Tripolit aine ) , à Masca te”
e t
à Zanzibar en passant par l ’Yém en . C ’ est pourquoi
malgré tout, l’ étude et la surveillance des Kharedj i tes
ne doi t pas ê tre négligée .
KHARE D J I SME ET CHYI SME 1 1
I I I . LE S AL ID E S .
Les Musulmans restés fidèles à Ali formèrent un groupement b eaucoup plus important que celui des dissi
dents kharedj it es . Ils s ’appe lèrent Chy it es, de Shi a par
ti sans . Ils récusent la légitimi té des khalifes acceptée par
les Sunni tes ou Orthodoxes . Les successeurs de Mahom et reçurent l ’ Imamat par suite de l
’ obéissance au prin
cipe d ’
ljma, ou consentement général . Mai s les Chy i t es
qui admettent encore la désignation d’
Ab ou Bekr comme
khali fe , parce qu’ i l récita la prière à la place du Pro
phè t e mourant, se basent sur l’
hérédit é féminine pour
reconnaître la souverai neté du fils adoptif et gendre
de Mahomet, Ali , écarté trois fois du pouvo ir par l’
am
bitiou des Om ey y ades . Le schi sme chy i t e a une origine
nettement politi que : les Chy i t es sont avant tout des
Alides .
Après l’
assassinat d’
Ali par les Kharedj it e s son
deuxième fil s Hossein se révolta contre l’
Om eyy ade
Yézi d mais perdit la v i e dans sa tentative pour
conquérir le trône . Ali et Hossein reposent en Mesopo
tam i e près de l ’ ancienne capitale alide de Koufa , à
Kerb elah et Nedj ef devenus les li eux saints du chy ism e .
Le parti alid e poursuivit son existence historique j us
que vers 1502 après J .—C. Il se ruina complètement
alors dans le royaume de Perse contre l’
Islam sunnite
Un des petit s—fils d’
Ali , Zai d , donna nai ssance à une
dynastie chy it e qui régna sur l’
Yém en à Saada de 893à 1300 après J .
-C . , date à laquelle le royaume fu t in
corporé à l’
Egy pt e . A partir de 1360 l a suzerai ne t é sur
(1 ) De Bo er , Op . c i t . , chap . I I I, 2 . 1 .
1 2 L’
ISLAM . ET LES RACES
la région fut exercée par les Turcs , l esquels ne s ’ en
sont j amais rendus maîtres réellement .
En dehors des Zaïdit es, nombreuse est la descendanced
’
Ali e t de Fatima , fille de Mahomet, à laquelle essaien t
de se rattacher toutes les grandes familles musulmanes
et les fondateurs des royaumes nouveaux D e s Fa
timides existent encore à La Mekke et à Médine dans
la région desquelles le fils aîné d’
Al i , trop faible pour
résister aux Om eyy ades, consenti t à se retirer en 66 1
moyennant une pension importante .
Le chy ism e domine auj ourd ’hu i dans l ’ Inde et surtout en Perse , où sa doctrine est religion offi cielle depuis1499 . Les Alides se prétendent là dans leur fief depuis
que leur famill e s ’ est uni e par mariage à celle de Yez
guerd , le roi de Perse chassé de son domai ne par l’
ex
pansion arab e des premiers âges . A l’heure actuelle , le
chy ism e a complètement disparu de l ’Afrique sur laquelle
ont régné longtemps des souverains fat imides, mai s sa
puissance s’
accroît en Orient .
IV . LE CHY I SME .
Le chy ism e récuse la légitimité des khalifes autres qu e
les Alides (2) par là même ne croit pas à l’
authenticité
des hadiths recueilli s par les souverains orthodoxes
mai s malgré ces négations il a une existence plus durabl eque celle du kharedj ism e . Il s
’ appuie sur l ’ imam at d’
Ali
et de ses héritiers . Auj ourd ’hui encore,le martyre du
(1 ) Il fau t n o t er qu’
une de sc endan c e fa t im ide e s t o r thodox e .
Nou s la re t rouv e ron s au Maro c .
(2) Om ar e t O thm an son t a in si récu sés . Ab ou Bekr , sans ê t re
posi t iv em en t r eco nnu , e s t c ep endan t adm is c omm e ay an t pré
sidé la prière à la pla ce de Mahom e t .
1 4 L’
I SLAM ET LES RACES
que le sunnism e . Il proscrit aussi l ’usage du vin et
la figuration des êtres v ivants , mais de fa çon moins
sévère, et sa diversité se montre dans la multitude de
s e ctes (1 ) qui sont issues de lui . Une des plu s curi euses
est celle des Ismaïliens .
Les I sma i liens . Les Ism aïliens ont une concepti on
spiritualisée de 1 1slam ism e . Ils prétendent descendre
d’
Ismai‘
l, frère de l’ imam Moussa , petit—neveu de Zaïd,
quatrième enfant de la li gnée d’
Hossein , fils d’
Ali .
Malgré son élasticité, le Coran leur semble être un
formulaire trop rigide . Ils ont alors doublé la doctrine
du Prophète d’
un enseignement plus épuré . D ’ après
eux, Mahomet reçut la révélation et la transmit aux
hommes . Mais à cô t é de lui se trouvait Ali qui donnait
à quelques initiés seulement la vraie signification des
principes émis ; il montrait à ses fidèles qu’ au-dessus
du Dieu adoré par le vulgaire, il existait une Essencedivine unique vers laquelle tendaient les hommes .
Les prophètes sont des hommes surgis à la volonté du
Tout—Puissant pour mener sur le chemin conduisantà Lui les hommes , qui , livrés à eux—mêmes , ne pour
raient et ne sauraient longtemps suivre la route v éri
table sans commettre d ’ erreur . Chaque envoyé aecom
plissait sa mission ; un nouveau mahdi lui succédai t
plus tard dès que le besoin se faisait sentir de sa pré
sence . Comme le Coran l ’ indique, le j udaïsme , le christ ianisme , l
’ i slamisme, sont autant d’ étapes vers la v ê
rité, autant de stations vers le progrès , le rapproche
men t de D ieu . Un nouveau mahdi viendra sans nul
(1 ) Le chy ism e se div ise en 3 sec t e s prin c ipale s : Ghou le t ,ou t rés ) , Ze 1dia e t Im am ïa ,
le s u e ls se sub div isen t à leu r t our enqun grand n om b re de groupem en t s .
KHARED J ISME ET CHYISME 1 5
doute accélérer la marche i déale vers le Bien . Cette
croyance au mahdism e au messianisme, répanduedans tout l ’Orient , dans toutes les reli gions o rientales,est encore sensible chez les Musulmans actuels .
La plus célèb re des dynasties ism aïliennes est cell e
de s Oub aîdis ou Fat im ides qui prétendaient descendrede Fatima , fille de Mahomet, épouse d
’
Ali . Cette dynastie régna en Egypte où d ès 769 elle fonda le Caire .Le code fat im ide ressemble assez à la doctrine ortho
doxe , mai s l a forme de chy i sm e qui est représentée
dans les principes contient des éléments mystiques
inhabituel s à l ’ Islam sunnite . Un l ong processus d’
ini
t iat ions dans la secte est graduellement imposé au néo
phyte à mesure qu’ il prouve sa valeur . Un des mystères
ismaïliens est que Dieu s’ es t incarné dans Ali lui —m ème
ou dans l ’un de ses descendants . Sur la donnée qu ’ untel per sonnage ne peut mourir, est née la doctri ne ç a
ract érist ique d’un imam caché, faussement cru mort,
mai s encore vivant, et prêt à reparaître pour remettre
l’
humanité dans le droit chemin vers Dieu . Cette croy an
ce s’
est répandue dans le monde chyit e , qui fête à cer
tai ns j ours la réincarnation d’
Ali , idée venue san s doute
de l’
Inde ou de la Perse, à moins que ce ne soit un
vieux reste de'
la mythologie égyptienne .
Le mahdi chy ite . Une curieuse mani festati on du
chy ism e fut le m ahdism e fat im ide . Dans tout l ’Ori ent
était répandue l ’ idée de la venue avant la fin du
monde d’
un souverain idéal , restaurateur de l’
Islam
Le Coran , empruntant la croyance j uive du messia
(1 ) Cf Jam es Darm e st e t er Le M ahdi depu is les or igines de»
l’I slam j usqu
’
à nos j ours . Paris, Leroux , 1885 .
1 6 L’
I SLAM ET LES RACES
nisme , indiquait aux orthodoxes qu’ un nouvel envoyé
de Dieu viendrait régénérer l’
Islam . Le chy ism e , lui ,avait admis une progression régulière vers Dieu grâceà la prédication successive de prophètes se succédant
sur la terre, le dernier étant touj ours supérieur à ses
prédécesseurs . La croyance à l’
imam caché, conservée
par les Alides, renforçait cette idée de l’
Env oy é promis
par Dieu , du Mahdi que les conceptions philosophiques
du soufism e (1 ) considéraient comme nécessai re à l’
ex
tension de l ’ adoration vers la nature divi ne . Orthodoxes
et Schismatiques attendent le mahdi . Mais , naturellement, tel qui est le Messie pour une secte ne sera pasreconnu par une autre ; et la réciproque est j uste . Le
monde musulman v i t ainsi surgir une quantité de faux
prophètes qui eurent leur moment de splendeur , mais
disparurent comme des étoiles filant es .
Un des mahdis les plus célèbres et les plus caract é
rist iques parce qu’ il indique nettement le caractère
politique du mouvement chyi t e fat im ide , fut Obeid
Allah . D ’ après la doctrine dite duodénarism e , les Chyi
tes comptaient douze imams depuis Ali . Le dernier,mystérieusement disparu , devait rev enir un j our pour
faire renaître la j ustice sur la terre . M . Piquet dit que
les Chyi t es, divisés en plusieurs sectes , avaient une
école ne comptant que -six imams , le septième désigné
pour succéder à son père, étant mort avant ce dernier .
Le troisième imam caché vivait à Salem ia en Syrievers la fin du IX e siècle . Son fils fut le mahdi qu i s
’ap
puya sur les Berbères d ’
Afrique pour créerun immense
empire qui s ’
ét endit des Syrtes au Maroc et fut l ’ origine de la dynastie fat imide qui régna plus tard en
(1 ) V . chapit re suiv an t Le Mys t ic ism e da ns l’
Is lam .
KHARED J I SME ET CHY I SME 1 7
Egypte . Ce mouvement, dont la vieill e prédiction Le
soleil se l èvera à l’
Occident ! préparai t l’
apparit ion ,eut un caractère uni quement temporel . Le schisme
chyi t e , dont l’ origine étai t politique, ne devait avoi r
des mahdis préoccupés de spiritualisme que dans les
viei ll es terres de la mystique, en Perse, dans laquelle
apparut beaucoup plus tard le mahdi el Bab .
Les Druses D e l a croyance à l’
imam caché
est i ssue la secte des Druses qui vivent au Liban dans
l’
attente d ’un nouveau prophète, n’ étant satisfai ts ni
par la Bible, ni par le Coran .
Les H aschichim .
'
Les Haschi chim (nom qui a donné
le françai s assassins , de l’
arab e haschi ch , chanvre, herb e)sont des Ism ai liens . Pour eux , le Vieux (2) de la mon
tagne, le Cheikh el Dj eb el, était un nouveau prophète
venu après Mahomet pour fai
re franchi r aux hommes
un nouveau degré vers Dieu . Le chef de la s ect e eni
v rai t ses séides avec l’
herb e magique qui leur donnait
l’
ex t ase et les mettai t au pouvoir complet du maître .
Ce derni er en profitait pour leur faire commettre lescrimes les plus sangui nai res . L
’
As ie Mineure fut terrorisée par les Haschi chim du X I e au X I I I e siècles .
Le duodenar isme . Le duodenari sm e est une des
formes du chy ism e qui refuse tout compromis avec
l’
orthodoxie . Douze souverains doivent être reconnus
après Mahomet, mais Ali est le seul qui ait réellement
(1 ) S . Re in ach , Orphe us .
(2) Che ikh sign ifi e à la fois che f e t v ie illard . Dan s la soc i é t é
pa t riarcale le s che fs son t le s v ie illards .
1 8 L’
I SLAM ET LES RACES
régné . Le douzi ème est encore inconnu , si bien que la
doctrine n’
at t aqu e pas en réalité le khalife régnant .
Les M otawilah. En Syrie , l es Mot awi lah , d’
o rigine
obscure et peu nombreux, pri rent le parti des Croisés
chrétiens contre les autres Musulmans . Il s p rétendent
être les descendants directs des personnages auxquels ,dans les premiers temps de l ’ Islam , fut donné le nom
de Shiah ou partisans d ’
Ali . Ils disent représenter la
plus ancienne forme de chy ism e , mais ne sont qu’une
secte sans importance .
Le chy ism e comprend ainsi une qu antité de sectes
presque infinie , car il peut s’ adapter à toutes les con
cept ions de l’ esprit humai n . La pensée libre chy it e a
même conduit certai nes fractions à une interprétation
vraiment singulière des textes islamiques . Nous citerons
comme exemple les sectes di tes de Mollah Zekki et
Rouehânia .
M ollah Z ekki . La secte de Mollah Zekki , souvent
confondue avec le soufism e , port e le nom de son grand
patron résidant à Kaboul . Ses membres pensent quetous les prophètes sont des imposteurs et toute rév é
lation nu conte fait à plaisir . Ils paraissent douter forte
ment d ’un état futur et même de l’
exi stence de Dieu
Leur exi stence remonte à une haute antiquité et leurs
dogmes représentent les i dées d’un vieux poète, nommé
Khe i‘
oum , don t les œuvres manifestent une grande im
piété . Khei‘
oum insiste particuli èrement sur l’ ex istence
du mal , accuse l’
E t re suprême d ’ en être la source, en
des termes difficiles à reproduire . Les sectateurs de
(1 ) V . Perrin , L’
Afghan is ta n .
KHARED J I SME ET CHY I SME 1 9
Mollah Zekki se rencontrent en A fgham st an : ils pro
fit ent habilement, dit M. Perrin , de leur incrédulité
et de leur absence de toute crainte de Dieu ou de l ’ enfer ,pour être le s scélérats les plus dissolus de tout le pays .
S ecie Rouehân ia La secte Rouehâni a fit grand
bruit en Hindoust an au XV I e siècle , mais est auj ourd’hui
à peu près éteinte . Elle eut pour fondateur, du temps
de l’
empereur mogol Akbar, Bay asid Ansari qui reçut
de ses adversaires le nom de Piri—Tarik , apôtre des té
nè b res, comme antinomie de celui de Piri—Ronchan ,apôtre de l a lumi ère, qu
’ i l se donnait à lui -même . Sadoctrine étai t celle du sou fi sme, mais , comme il y aj ou
ta it le princip e de la transmigration des âm es, il est
probable qu’
il avait puisé sa croyance chez les Yogisou philosophes hi ndous . Sur ses enseignements les Rouchâni ens ont greffé quelques doctrines : 1 ° la m ani fe s
tation la plus complète de la divini té s’
opère dans le s
saints personnages et d ’une mani ère toute particuli ère
en eux, R ou ehâni ens 2° tous ceux qui ne partagent
pas la foi de la secte peuvent être considérés comme
morts . En conséquence,leurs biens deviennent la pro
priét é des Rou ehâniens, qui seuls survivent . Ces demi
héritiers se croient donc autorisés à s’
emparer selon
leur bon plai sir des biens appartenant aux prétendus
décédés, et sans aucun égard pour ceux qui ont la pré
tention de vivre en dehors des décisions du Piri . Les
armées des Grands Mogols eurent facilement raison des
Rouehâniens . Cependant on en trouvai t encore quelques
uns vers 1850 dans les environs de Peshawer.
(1 ) D’
après N. Perrin , L’
Afghan is tan .
20 L’
I SLAM ET LES RACES
L ’ examen de ces deux derni ères sec t es mo ntre j us
qu ’ à quel point peuvent parvenir des adeptes du chy isme ,mais ce derni er s
’
es t réservé une part plus estimable
dans le domai ne de la pensée . L ’histoire de la Perse
contemporai ne est rempli e de la plus belle floraison du
mouvement chy i t e avec le b ab isme don t le mahdiatteint les plus hautes cimes de la réflexion et de l
’
i dée .
Dans les sectes , dit M . Guy au , on trouve en effet plus
de raisonnement, d’
induct i ons hardies , d’
élans actifs
de la pensée : hors du dogme , le meill eur de la v i e reli
gi euse se propage, lutte incessante des idées , mouvement e t progrès de l
’
esprit, non universalité des dogmes,mai s liberté des croyances . La pensée libre se retrouve
dans le chyi sm e non rituali sé , a in flué dans le dév eloppement des mouvements nationaux et régionaux par
l’
appariti on de tous ses mahdis , incarnations d’
Al i , s’
est
retrouvée même dans l’
orthodoxie officielle par l’
entrée
en ligne d ’
un mouvement phi losophi que commun au
sunni sme et au chyism e , le soufism e .
(1 ) V . M ouvemen ts rég iona uæ . La Perse .
20 L’
ISLAM ET LES RA CES
L ’ examen de ces deux dernières sec t es mo ntre j usqu ’ à quel point peuvent parvenir des adeptes du chy isme ,mais ce dernier s
’ es t réservé une part plus estimable
dans le domaine de la pensée . L’
histoire de la Perse
contemporaine est remplie de la plus belle floraison dumouvement chyi t e avec le b ab ism e don t le mahdiatteint les plus hautes cimes de la ré flexi on e t de l
’
i dée .
Dans les sectes , dit M . Guyan , on trouve en eff et plus
de raisonnement, d’
induct ions hardies, d’
élans actifs
de la pensée : hors du dogme , le meilleur de la v i e reli
gi euse se propage, lutte incessante des idées, mouve
ment et progrès de l’ esprit, non universalité des dogmes,
mais liberté des croyances . La pensée libre se retrouve
dans le chy ism e non ritual i sé , a influé dans le dév eloppement des mouvements nationaux et régionaux par
l’
apparition de tous ses mahdis , incarnations d’
Ali , s’
est
retrouvée même dans l ’ orthodoxie offi cielle par l’
entrée
en ligne d’
un mouvement philosophique commun au
sunni sm e et au chyi sm e , le soufism e .
(1 ) V . Mouvem en ts rég ionaux . La Perse .
CHAPITRE I I
LE MYSTIC ISME DANS L ’
ISLAM
SOUFISME ET CONFRÉR IES RELIGIEUSES
I . LE SOUF I SME .
L’
idolât re Oçaid, fils de Hoda1r el Ko taïb , fichesa pique en terre et s
’
assit z Que faut—il faire pour en
trer dans cet te religion , demanda-t -il à MoSsab ,fils
d’
Omaïr, qui venait de lui expliquer les principes fon
dam ent aux du Coran Te purifier avec de l ’ eau,
répondit Mossab , déclarer qu’
il n’
y a pas d ’ autre Dieu
qu’
Allah et que Mohammed est son prophète . Ainsi
se posèrent les premières bases de l’
une des plus grandes
religions qui se partagent l’
humanité
Depuis ces temps pri mitifs Où l ’ Islam n ’ avait besoin
ni de prêtre , ni de mosquée, la discussion et la spiri
t ualit é se sont introduits parmi la simplicité des dogmes .
Déj à,les lacunes nombreuses du Coran avaient permis
à de grandes écoles de se former dans l ’ orthodox ie par
la controverse . Les ri vali tés politiques avaient amené
des schismes importants . L’ in fluence des
’
Persans, des
Hindous , des Egyptiens, se manifesta à son tour dans
l’
Islam par un mysticisme inhabituel aux premiers âges
de la religion de Mahomet . Les Arabes , poètes et sen
suels, s’
emparè rent de ces i dées avec un enthousiasme
remarquable . Du Golfe Persique à l’
At lant ique , le mys
(1 ) D epon t e t Copp o lan i , Les Confrér ies relig ieuses musu l
manes . Alger , Jourdan , 1 897, Préfac e , p . 7 .
22 L’
I SLAM ET LES RACES
t icism e donna naissance à un courant (1 Idées dont l ’ in
fluence se fait encore sentir auj ourd’
hui , le soufism e .
Le mouvement eut peut— être son origine en Syriesous les in fluences chrétiennes qui prêchaient l
’
ascé
tisme et l ’ état monacal . Les purs nomades répugnent
assez à cet amoindrissement de la personne physique .
Néanmoins , il se trouva parmi les nouveaux convertis
sédentaires , parmi les illuminés , des gens qui dépassèrent
la volonté du Prophète . Malgré la défense de Mahomet
Pas de guerres dans l’
Islam , la guerre sainte e st
le monachisme de l’
Islam ! des Musulmans v ou
lurent se consacrer uniquemen t à Dieu dans un renon
cement absolu aux biens et aux j oies terrestres . Cette
tendance à l’
ascét ism e parvint à son apogée en Perse .
Ce fut vers l’ année 700 qu
’
une femme nommée Rab iâ
développa et mena à leur réali sation les idées de mona
chi sme dans l’
Islam , en un mouvement qui fut appelé
soufism e . Les Soufis , d’
après certains auteurs , tirent
leur nom de l’
arab e sont signifiant laine,avec laquelle
leurs vêtements sont fabriqués . D ’ autres auteurs veulent
voir dans le mot soufi l ’ équivalent du grec aoe oç sage ;la civilisation grecque avai t fort ement agi sur la Perse
et l’
Asie Mineure et il est possible que Soufi ait cette
derni ère origi ne, d’ autant plus que les prem i ers Musul
mans , partisans de l’
état monacal , se donnai ent à eux
mêmes la dénomination de Seddikia sages .
Quoi qu’
il en soit, le soufism e que de Wq appelle
la mystique orthodoxe (1 ) n’ est pas le fruit du Coran .
Il résulte des trois grandes in fluences indienne,néo
platonici enne , chrétienne, cette derni è re lui donnant
sa physionomie caractéristique l e but du soufism e
(1 ) D e Wulf, H isto ire de la Philosophie m édi é va le , 46 éd l i . ,
Paris , Louv ain , 191 2, p . 279 .
LE MYST IC I SME DANS L’
I SLAM 23
ou t essououof nom sous le quel le mysticisme s ’ est
introduit dans la langue arab e, est de mettre dans
la conscience de l’
homme l’
esprit caché de la loi en
accord avec la lettre e t d ’ arriver par de s pratiques pieu
ses a un état de pureté morale et de spirituali sme tel
que l’ on puisse voir Dieu face à face et sans voiles et
s ’unir a lui (1 ) L’
anéant issem ent de l ’ individu en
Dieu est la récompense promise le monde n ’ est qu ’ une
illusio n e t tous les efforts de l’
homme doivent tendre
vers l ’ ex t ase suprême . L ’ ensemble forme une doctri ne
idéali ste par laquelle l’
esprit sensuel et rêveur des Orien
taux se laissa facilemen t tenter .
Nous avons v u quelle influence le soufism e eut sur
les sectes chyi t es, telles que celle des Ism ailiens ou les
fameux Mollah Zekki . Mais ce ne fu t pas seulement
dans le schisme qu e se manifesta l’
l lm el Baqa ou el
Fana science de rester ou de périr, comm e l’
appellent
ses fidèles , c e fut aussi dans le monde orthodoxe
D’
abord , de nombreux ascètes se réfugièrent dans le
désert, comme aux temps de s prem iers chrétiens .‘ La
recherche de pratiques pieuses pour l’ accès à une pureté
morale plus parfaite séduisait l’ esprit de tous les pen
scurs . L ’
ascét ism e , la pauvreté , les prières , les morti
ficat ions, préparaient les âmes , émanations de Dieu , à
se rapprocher de plus en plus de la divini té par des
extases successives,à se réunir à lui par l ’ amour . Un
certai n nombre de philosophes musulmans célèb res,dont
Av erro è s, se rattachent au monde soufit e
Dieu absorb e tout . Autant que l ’ on peut en j uger
(1 ) Depon t e t Coppo lan i , op . c i t . , p . X , Préface .
(2) Le s prem iers soufis a ffirm a ien t leur carac t ère d ’
orthodox es,m ais l ’ éco le Rab iâ ét ait chy i t e .
(3) V . Les phi l0 3 0plæ 3 musu lm a ns , t om e I , chapi t re V I I I .
24 L’
I SLAM ET LES RACES
par les enseignements mystérieux du soufism e , les oh
j ets animés ou inanimés doivent être considérés comme
surnaturels . Il n ’ est qu’un être réel , Dieu , qui se ma
nifest e sous une foule de formes à l’ âme humaine , por
tion elle—même de l’ essence divine . Les idées spécula
t iv es des Soufis vont j usqu’ à l
’
exalt at ion . I ls admirent
Dieu en tout , et à force de méditer sur ses attributs ,de le poursuivre sous toutes ses formes , ils s
’
imaginent
parvenir à un amour inefiab le de la divinité , e t même
à une union intime avec sa substance La consé
quence de cette théorie est de les amener à considérer
les dogmes particuliers de toute croyance comme su
perflus, à n’
av orr aucun rite religi eux, à n’
at t acher que
peu d’ importance à la forme sous laquelle les pensées
se dirigent vers Dieu , pourvu que sa grandeur et sa
bonté puissent être contemplées .Cependant un fait curieux se présente . Cette indé
pendance , si large en apparence , n’
empêche pas l ’atta
chem ent sincère des Soufis à la doctrine de l’
Islam .
Souvent les prêtres persans , les Mollahs leur ont tendudes pièges pour le s amener à commettre des infractions
à la loi musulmane, mais ils n’
ont j amais réussi . Elphins
tone cite le cas d ’
un Soufi qui , après s’
être étendu avec
complaisance sur les mérites excellents de la règle sou
fit e et sur le caractère généreux et large des actions
humaines dont elle est le mobile , ne montra pas moins
d’
ardeur, quelques instants après et devant la même
compagnie , pour défendre chaque dogme de la religion
musulmane , e t repoussa avec horreur l’
idée d ’un doute
sur l’
éternité du feu de l’
enfer . Quant à la diffi culté de
concili er cette croyance avec l ’ idée que rien n’ existe
(1 ) Cfr . N. Perrin ,L
’
Afghan is tan , c i t an t Elphin st on e .
LE MYST IC ISME DAN S L ’
I SLAM 25
sinon Dieu,il dit que le système soufi était certainement
vrai,mais qu e l
’ existence du feu éternel de l’
enfer étai t
prouvée par les paroles de Dieu lui-même .
Il faut donc admettre que malgré leurs tendances
phi losophiques au panthéisme et au fatalisme absolu ,leur croyance au t ouhi d ou unité ab solue de Dieu
absorbant tout les Soufis sont de fervents musul
mans . Cependant l’
expansion trop considérable de
l eur mystique a causé dans le monde musulman , sun
ni te ou chy it e , une d éformation de l’
esprit religieux
des premiers âges de l’
Islam . Les ascètes , les moines ,ont été peu à peu remplacés par des individus appe
lés derouichs (derviches) , walis , lesquels errant de
ville en ville, de tentes en tentes , ont j oint à la m édi
tation la pratique d’
exercices religi eux qui à l ’ originedevaient servi r à donner l
’
ex t ase ; et plus tard n’ ont
souvent plus été qu’
un ritualisme d’
où l ’ imagination
a chassé la rai son . Tels sont les dervi ches hurleurs, tourneurs, et tous ces ascètes , fanatiques ou imposteurs quiont fait entrer dans la religi on des pratiques de j on
glerie qui n’ ont plus guère rien de religieux . En dehors
de ces derviches , les ascètes sont devenus des personmages religieux révérés des tribus voisines de leur re
traite . La seule noblesse de l’
Islam était celle représentée
par la descendance du Prophète, dont les membres s’ ap
pelaient cheurfa (chérif au si ngulier) en Occident, seyyiden Ori ent . Les personnages revêtus par leur entourage
d ’un caractère sacré , acceptés comme tels par le consent ement des tribus , ont en dehors des cheurfa pri s
une importance considérable dans l ’ Islam . Les zaouïas,en Turquie t ekki é, sortes de couvents , d
’ écoles,d ’ au
berges aussi , dans lesquelles ils habitaient, sont devenues
de véritables sanctuaires .
26 L’
ISLAM ET LES RACES
Les descendants du Prophète, les personnages sacrés
appelés marabouts , santons , ont en leur pouvoir un don
divin de bénédiction appelé baraka , lequel se transmet
de père à fils, et souvent même dans cer tains cas , de
marabout à tel homme de son entourage , j ugé plus
digne de la recevoir qu e sa parenté . A la mort de ces
nobles religieux , leurs tomb eaux reçoivent une sorte
de culte qui a quelque peu contribué à obscurcir les
dogmes corani ques . A l’
Islam ont été ainsi rattachés
un certain nombre de saints locaux qui j amai s n’ avaient
été Musulmans . En Afrique du Nord , le m arab ou tism e
a perm is la continuation de croyances antérieures à
l’
Islam .
C ’ est que le soufism e avait porté son influence dans tout
le monde musulman . En Afrique du Nord il se répandit
avec rapidité notamment au x rv ° siècle . L ’
ordre des
D erqaoua le propagea avec enthousiasme à la fin du
XV I I I e siècle ; le bey de Mascara lutta contre eux à
Tlemsen ; par contre , le sultan d’
lfriky a les reconnut à
Tunis C ’ est v raisemblablement le soufism e qui a
imprégné l’
Islam du fatalisme que l’ on reproche à tort
à l’
enseignement de Mahomet . Le système de Dieu ah
sorb ant tout devait mener à cette résignation que le
Prophète n ’ avait j amais admi se ai nsi . L’ idée fataliste
p réparait à l’ obéissance aux ordres des émanations de
la divinité .
En eff et tous les hommes ne peuvent arriver d ’ euxm êmes à l ’ ex t ase . Ils ont b esOin d ’ interm édiai res qui
l eur expli quent le monothéisme parfait . Le soufisme
était parvenu a une dualité de religion, simple pour le
c ommun des mortels , épurée pour les maîtres, pour les
( 1 ) V . Pique t , op . c i t . , p 1 97.
28 L’
ISLAM ET LES RACES
tissant de leur politique spirituelle ou temporelle se
marque par l ’apparition d’
env oy és spéciaux de la divi
mi té qui doivent réformer le monde islamique, chasser
à l ’ occasion l ’ Infidè le envahisseur ce sont les mahdis ,dont tout l ’Orient attend perpétuellement la venue de
puis les temps j udaïques j usqu ’ à nos j ours .
I l . LE S CONFRÉR IES REL IG IEUSES .
H ie rarchie des ordres Dans les premiers âges de
l ’ expansion islamique, on ne comptait pas moins de73 sectes ou ordres religieux se recrutant dans toutes
les classes de la société et se groupant autour de cer
taines familles religi euses . Auj ourd ’hui le monde mu
sulman est rempli des constructions faites par les or
dres religieux : les zaouïas de l’
Afrique du Nord , les
t ekkié de Turquie, les khanaks d’
Orient . Ce sont à
la fois des endroits sacrés qui renferment à l ’ occasion
le tombeau ou des reliques du saint, des lieux de réunion
pour l ’accomplissem ent des pratiques rituelles , de s écoles
d’
un degré plus ou moins élevé et des hôtelleries . Toute
cette organisation tisse une véritable trame sur le monde
islamique
Le superi eur de la confrérie, le cheikh, peu t résider
dans un autre endroit que la zaouïa . Il est le maître
absolu et ne consent à recevoir d ’ ordres que de Dieu .
On comprend facilement qu ’une telle conception ait
facilité la désagréga tion de la puissance temporelle de
l’
Islam . Le khalife ou vicaire est le coadj uteur du cheikh
et le remplace à toute o ccasion dans laquelle ce dernier
ne v ent ou’
ne daigne paraître . Le naïb ou intérimaire
remplit le s fonctions du khalifa sans en avoir le titre et
l’
investiture offi ciels . Le m oqaddem (au pluriel m oqad
LE MYST IC ISME DANS L ’
I SLAM 29
dim) est l’ agent du cheikh dans toutes les localités où se
trouvent des affi li és . C ’ est lui qui est chargé d’
adm inis
trer la zaouïa , de transmettre les ordres du mai tre , de
diri ger les exercices des frères , d’
in i tier les néophytes .
Les m oqaddim peuvent être remplacés par un nath,au pluriel naïoub . Enfin le s chaouch et rokkab sont
des plantons , des ém issai res , chargés des commissions
du m oqaddem .
Au-dessous de cette hi érarchi e sont les frères (khouan
en Afrique du Nord , derouich en Ori ent, foqra, de
fakir, pauvre , chez les Qadria , ashab , compagnons chez
les Tidjania) . Les femmes peuvent être admises dans
la confréri e . Ce sont les kh aouni‘
at (sœurs) . Les mem
bres des tri bus qui admettent l ’ autorité du sai nt sont
les Kh oddam . L’
aspirant à l’ i nitiati on est le mourid .
D e même que les mosquées du culte régulier, les zaouïa
possèdent des biens immobili ers . Ce sont les habous
dont les revenus servent à l ’ entretien des lieux saints .
Les dons sont admis par cession entière d ’une propriété,ou par fraction quelconque soit des terres , soit des res
sources du sol . Enfin tous les adeptes doivent payerla ziara , sorte d
’ impôt spécial , dont la somme dépasse
souvent de beaucoup les impositions offi cielles et que
pourtant j amais un khouan n ’ a refusé de payer .Telle est la hi érarchi e apparente de ces ordres reli
gieux qui se sont développés en grand nombre à mesureque s ’ étendait l ’ expansion islamique .
Organ isation de l’
ordre. Un ordre doit seulement,pour être reconnu , faire preuve d
’
orthodoxi e musul
mane et c ’ est là chose facil e : il suffi t que le fondateur
ait suivi l ’ enseignement d ’
un docteur orthodoxe connu .
Il étab lit alors une sorte de filiation ou chaîne mystique
30 L’
ISLAM E I‘ LES RACES
remontant j usqu ’ au Prophète lui—même ; l’ excellence
de la doctrine enseignée se trouve ainsi affi rmée . Les
ordres religieux principaux se réclament, soit d’un des
premiers khalifes , Abou Bekr ou Omar, soit directement
d ’une révélation div ine qui , en général , s’ est effectuée
par l’
entremise de Si di El Khadir, le prophète ElieCelui—ci , selon la croyance musulmane , a bu à la source
de la vie et a été ex empté de la mort . Sa personnalités’
est dédoublée : Elias erre sur la terre ; El Khadir v i tau fond de la m er . Un j our par an , les deux personna
lités se rencontrent pour se concerter, et El Khadirdevient l ’ intermédiaire entre Dieu et les hommes , leurdonne le pouvoir de faire des (2)Lorsque les plus parfaits d ’ entre les Soufis (3) se sont
purifiés du matérialisme humain , et que Dieu a daigné
leur déléguer une étincelle de son pouvoir divin , la b a
raka , ils peuvent alors servir d’ intermédiaires pour per
fe ct ionner les hommes ; ils groupent alors autour d’ eux
des disciples , appelés khouan , frères . Sous la haute aut orit é du cheikh , les aspirants (mouri d) à l
’ ordre doi
vent subir une initi ation progressive (ouerd) qui les
élève peu à peu vers le monde surnaturel . Ils ne de
viennent khouan qu ’après avoir fait leurs preuves . Le
cheikh communique à ses frères la formule que lui o nt
révélée Dieu ou bien El Khadir cette formule est le dikr,moyen infaillible d ’ atteindre l ex t ase et de parveni r
à l’
i dentification parfaite avec la nature divine . Le dikr
est le pivot réel du soufism e Il consiste en
une prière répétée un certain nombre de fois , d’une
cer taine manière, suivant les ordres , dont la répét i
(1 ) Mahom e t adm e t t a it le s prophè t e s an t érieurs à lu i .
(2) V . Piqu e t , Le s C iv ilisa t ions de l’
Afr ique du Nord, p . 48 .
(3) Originairem en t le ur nom ét a i t fokra , plurie l de fakir,,pa uv re
(4) D epon t e t Coppolan i , Op . c i t .
, p . 88 e t suiv an t es .
LE MYSTI C I SME DANS L ’
I SLAM 3 1
tion multiple doit amener la sat isfaction pleine et eu
t i è re du d ésir par la vert u mystérieuse et in effableattachée à cette oraison
Suivant son degré d ’
initi ati on , le khouan prononce
le dikr vocal qui est un simple énoncé sans valeur, ledikr d
’
adorat ion , lequel est prononcé avec une intense
conviction le dikr émi s avec le concours de tous les
organes , reservé aux seuls élus de Dieu . L ’ ensemble de
la baraka , de l’
ouerd et du dikr forme El Tariqa , c’ est
à—dire le chemin , l a règle de la vie, dont les pri ncipesfondamentaux spéciaux à chaque ordre reposent dans
l’
ouaçia . L’
oua çia est un recueil qu e p ossède le détenteur
de la Tari qa , le maitre , le cheikh de tout le groupe
ment . Le groupement des fidèles lui est dévoué corps
et âme ; en effet tout homme qui ne se fait pas con
duire par un directeur spirituel est coupable de ré
belli on envers Dieu , car il n e saurai t, sans guide , par
venir e u chemin du salut, possédai t—il, dans la mémoire,mill e ouv rages de théologie Ce dernier précepte in
dique l’
in fluence du cheikh sur les affi l iés auxquels il
peut faire accomplir toute espèce de besognes .
Les ordres . Les ordres religi eux nés de la diffusion
de l’
enseignement soufit e couvrent le monde musulman
enti er . Les cinq principaux sont : les Qadria , aux doc
trines humani taires remplies de pitié , d’
ab négat ion ,
de charité ; les Khelouat ia, contemplateurs et ex tat i
ques les Chade lia, spirit ualiste s ; les Naqe chab endia ,
éclectiques ; et les Saharaouardia, lesquels possèdent
les doctrines panthéistes les plus avancées . Ces cinq
ordres se sub divisent à leur tour en des branches mul
(1 -2) D epon t e t Coppolan i , Op . c it .; p . 86 e t su iv an t e s .
32 L’
I SLAM ET LES RACES
tiples qui , toutes , amènent leurs néophytes au féna ,
c ’ est—à—dire à'
l ’ union mystique avec Dieu .
Aux Indes , les ordres musulmans les plus importants
sont les Chischt iy a , les Madariy a, les Akhb ariya, les
Qadria . Au Turkestan , les Naqechab endia, ont suivi
l’
invasion mongole, ont pris Bokhara pour srege e t ont
fait porter leur propagande sur les races ouralo-alt aïques .
En Chine, l’ on croit que la société secrète Thien ti Hai ,
fondée au x v rr° siècle pour la restauration des Ming
contre les Ching , a une branche musulmane affi liée aux
ordres religieux ; en Turquie la secte des Bekt achiya
a une grosse in fluence . En Nubie , dans le Kordofan ,les Em irghaniy a sont une confrérie fondée par un dis
ciple d’
Ahmed ben Idriss , celui qui forma le fondateur
du senoussism e . Les Saadia , les Badasnia sont répandusau SoudanLorsque les ordres religieux perdent leur caractère
uniquement mystique, pour se mêler à la v ie politique ,il est coutume de leur donner le nom de « confréri es » . EnAfrique du Nord , parmi les confréries les plus connuessont les Qadria et leurs dérivés, les A1ssaoua , les Rahmania et les Tidjania, tous les deux sous-branches des
Khelouat ia, les D erqaoua venus des Chadelia , ainsi que
les Taïb ia et les Cheikhia, et enfin les Senoussïa issusdes Khadir
‘
r‘
a .
Les Qadria . Les Qadria tirent leur nom de S iMohammed Abd el Qader el Dj ilani, né à Dj il (2) p rès
de Baghdad en 47 1 de l’
Hégire , mort en 56 1 (1079—1 166
ap . J . C’était un chérif qui resta touj ours pauvre
(1 ) Le Châ t e lie r, L’
Islam a u X IX€ s iècle . X . Le ro ux , Paris ,1 888.
(2) D’
où le nom de s adept es Dj ilala ou Qadria .
LE MYST IC I SME DANS L’
I SLAM 33
et se livra pendant toute son exi stence aux œuvres de
piété et de propagande reli gi euse . MM . Depont et Cop
polani (op . ci t . , p . 294) résumen t ainsi son enseignement
abnégation de l ’ être au profit de Dieu , mysticismeextatique aboutissant à l ’hystérie au moyen de pratiques enseignées dans des zaouïa ayant une certai ne
analogie avec les monastères chrétiens, pri ncipes phi
lanthropiques développés au plus haut degré, sans distinction de race ni de religion , une charité ardente, une
piété rigoureuse, une humi lité de tous les instants, et
par sui te une douceur d’ âme qui en ont fait le saint
le plus populai re et le plus révéré de l ’ Islam
L’
ouerd imposé par Si Abd el Qader Dj ilani conduitrapidement à l ’ ex t ase . Les affi li és portent leur tête alter
nativement de droite à gauche en répétant Allah , Al
lahou , Allahi , en augmentant à mesure la cadence du
hochement de la tête et la force des cris . A la fin une
sorte de congestion les frappe e t il s tombent extasiés .
Les Khouan deviennent de véritables illuminés qui se
croient réellement par moments absorbés en Dieu . Les
Qadria répèten t encore dans leurs réunions de véritables
litanies compo sées de versets du Coran .
Les Qadria sont répandus en Turquie , en Arabie, en
Extrême-Orient , du Turkestan aux Iles de la Sonde .
Ils progressent encore au Yun-nam . Leurs chefs de Tri
poli t ai ne et d’
Egypt e dépendent des Zaou i‘
as tunisiennes .
Les innombrables groupements qadria d’
Algérie , de
Tunisie, du Maroc semblent sans lien bien direct entre
eux . Les Moqaddim de Tunisie portent leur in fluence
j usque chez les Touareg, ceux du Maroc j usqu’
au Soudan e t dans l ’Adrar.
On peut dire que les Qadri a ex ercent depuis le'
x v ° siècle une grosse propagande pour l’
Islam dans le
34 L’
ISLAM ET LES RACES
Sahara et le Soudan . La fam euse Zaou1a de Kounta
forme des élèves qu i sont célèbres . Les Bakkala , bran
che des Qadria , ont dans tout le bassin du Niger et de
l’
Oued Noun , dans le Sahara occidental , le monopole del ’ enseignemen t . Auprès de tous les chefs noirs résident
des marabouts , des légi stes , des secrétaires, dont la
formation est qadrienne .
Le mahdi . L’
apogée de la puissance politique des
Qadria en Afrique fut atteinte vers 1880, date à laquell e
un dervi che du Soudan Egyptien fonda un éta t arabonoir et se proclama mahdi . I l souleva si bien l
’
enthou
siasm e guerrier des Soudanais que l’
Egypt e en perdi t le
contrôle sur le Soudan , la Nubie et le Haut-Nil (1883)L
’
Anglais Gordon pacha , celui qui avait combattu les
Taï Pings en Chi ne, périt à Khar toum où l ’ avait envoyé
le khédi ve contre les traitants arabes , marchands de
chai r humai ne . Il fallut la victoire britannique d ’
Om
durman pour que le général Ki tchener mît fin à f’ agita
tion des mahdistes
Le mahdi avait tenté une grande entreprise il savai t
l’
Arab e hostile au Turc auquel il refuse le titre de Mu
sulm an . Les lettrés arabes prétendent que le Turc , bien
plus que le Chrétien , est celui qui entrave le dévelop
pement de l’
Islam . Peut-être aussi les Arabes regret
tent-ils la disparition des khali fes remplacés par les
sultans ottomans . Le mahdi de Khartoum voulut le
réveil de l ’ i dée arab e : J’
at t est e devant Dieu et de
vant lê Prophète que j’
ai pris le sabre, non dans le but
de fonder un empire terrestre, ni pour amasser des ri
chesses , ou posséder un somptueux palais , mai s afin
(1 ) Cfr . Henr i Dehéra in , Le Souda n Or ie n ta l sous la dom ina
t ion madhis te,dan s E tudes sur l
’Afr ique (Paris, p . 73-106.
LE MYST IC ISME DANS L’
I SLAM 35
d’
aider et de consoler les Croyants de l ’ esclavage , à cause
de l’
esclavage dans lequel le tiennent les Infidè le s, etpour rétablir l
’
empire des Musulmans dans son ancienne
splendeur . Je suis donc décidé à porter ce sabre de
Khartoum à Berber . J ’ irai ensui te à Dongola , au Caire
et à Alexandrie, en rétablissant la loi et le gouverne
ment musulmans dans toutes les cités . De l’
Egypt e ,
j e me dirigerai vers la terre du Prophète afin d’
en chas
ser les Turcs dont le gouv ernement n ’ est pas meilleur
que celui des Infidè les et j e rendrai à l’
Islam l’
Arab i e
avec ses deux cités sai ntes : La Mekke et Médine . Fils
d’
l smai‘
l , vous pouvez vous attendre à m e voir bientôt
au milieu de vous , armé du sabre de la foi ! (1 )On retrouve dans les sentiments du madhi les idées
de S i Ab d el Qader Dj ilali , mai s passées dans le domaine des réalisations terrestres . Les Qadria ne furent
pas soutenus par les autres ordres religieux et ont perdubeaucoup dans cette entrepri se . Ils n ’ en restent pas
moins un groupement puissant, et si , dans leurs mani
fest at ions soudanaises , ils ont eu des agitations xéno
phob es, en Afrique du Nord ils n’ ont j amais cessé, d
’
ac
cord eu cela avec leurs doctrines humanitai res , d’
être
en de très bons rapports avec les autorités françaises .
Les A zssaoua . S i Mohammed ben Arssa naquit àMeknès au rx ° srecle de l
’
H égire et y mourut vers 1523
de l ’ ère chrétienne . Ce fut un grand voyageur qui , de
l’
Orient à l ’Occident , vi sita tous les centres , groupantautour de lui les mécontents . Grand my stique , than
mat urge , i l fonda un ordre qui ne cessa j amais d’
être
favorisé par les sultans marocai ns auxquels les Ai ssaoua
(1 ) Den is de Riv oyre . V . Bi bliographie .
36 L’
I SLAM ET LES RACES
semblent avoir touj ours été dévoués . Si Mohammed étaitun fervent adepte de s doctrines spiritualistes chade
b ennes , mais il fut vivement frappé par les pratiques
rituelles des Qadria . Il leur emprunta donc leur formule
qui donne l’
ex t ase . Aux yeux des simples , le cheikh
fini t par être une véritable incarnation div ine et son
tombeau à Meknès j ouit d’
un grand renom , sert de
lieu de pèlerinage pour les affi liés qui s ’y rendent de
toutes les zaouïa marocaines .
A certaines dates , les Ai ssaoua pratiquaient leurs cê
rém onies extatiques le long des rues . A Taza (Maroc)le cor tège se déroulai t au début du printemps , au m ili eu
de cérémoni es indescriptibles dans lesquelles s’
exal
t aient à tel point les spectateurs eux—mêmes qu’ ils ris
quaient de tomber dans l’
hystérie Peut-être faut-il
voir dans ces rites la survivance d’
ant iques saturnales ,des vieilles fêtes du renouveau ! Quoi qu ’ i l en soit
,les
Aïssaoua doivent désormais se livrer à leurs exercices
uniquement dans leurs zaou1as . C’
est à eux que se rat
tachent ces exaltés qui se percent d ’ aiguilles en pleine
chair, passent au mn ieu de tisons rougi s mais ces abou
t issant s hystériques ne doivent pas fai re oublier la doc
trine humanitaire qu i est à la base de l ’ enseignement .
En dehors de leurs exercices , les Aïssaoua sont généralem ent des gens calmes qui , au Maroc , ne semblent
pas faire d ’ opposition aux Français . Leur confrérie a
touj ours été fidèle au sultan reconnu .
Les zaouïa des Ai ssaoua se rencontrent en Algérie ,en Tripolit aine , en Egypte , de moins en moins nom
b reuses a mesure que l’
on s’
avance vers l ’Orient . A La
Mekke il n’
existe qu’
une hôtellerie—école de la confréri e .
(1 ) Pie rre Redan , A ux confins du pay s ber bère , Le s Ai ssa ou a .
LE MYSTI C I SME DAN S L ’
ISLAM 37
Les Rahman ia . Les Rahmania se rattachent à laconfrérie-mère des Khelouat ia qui apparu rent dans
le monde musulman envi ron un siècle après les Qadria .
Le fondateur de l ’ ordre n ’ était plus un chérif comme
chez ces derniers , mais un véritable ascète à la recherchede l
’
anéant issem ent corporel pour la plus grande puri
fication de l ’ âme . Mohammed el Khelouat i , le solitaire
persan , fut l’
inst iga teur du mouvement que développa
Omar el Khelouat i (mort en 800 de l’
Hégîre , 1397—98
ap . J . Le vieux panthéisme persan se retrouve sousle voile du soufism e épuré . Les tendances générales des
Khelouat ia sont : au point de vue temporel le ser
ment avec toutes ses vérités , l’ engagement sacré, le
pacte entre le cheikh et le néophyte , la connaissance des
sept noms de Dieu correspondant aux sept qualités
cachées de l ’ âme, et le secret absolu . D’
où, en morale
ob struction intellectuelle et asservissement de l’
huma
nit é ; et en politique : opposition systématique à tout
progrès, fanatisme exalté, et comme conséquences im
médiates , persécution à tout ce qui touche au pouvoir
temporel , d’ autant plus dangereuse qu ’ elle ne se mani
feste qu’
après avoir été longuement méditée dans le
mystère et les (1 )Les Rahmania sont issus des Khelouat ia . Leur fon
dateur fut un Kabyle d’
Algérie , S i Mohammed benAbderrahman , né à Aï t Smai l vers 1 126
qui fut él ève des Khelouat ia . Ce fut un thaumaturge
renommé qui voyagea au Soudan , au Hedj az , aux Indes ,en Turquie et revint faire du prosélytisme dans ses m oh
t agnes natales . La Kabylie et Alger furent l’ ob j et d
’
une
véritable propagande malgré les efforts des Turcs alors
(1 ) Depon t e t Coppo lan i, op . c it ., p . 373.
36 L'
I S I M ET LES RACES
semblent avoir to u jo u rét é dévoués . Si Mohammed étaitun fervent a de p t e doctri nes spiri tualistes chadeb ennes , mai s I l fu t émeut frappé par les pratiquesri tuelles de s Q ad n Meur emprunta donc leur formulequi donne l
‘
e x t :… .\x yeux des simples, le cheikh
finit par être une u nab le i ncarnat ion divine et sontombeau à Mekne s i t d
’
un grand renom, sert de
lieu de pèlerinage pm les affi li és qui s ’y rendent detoutes les zaou ra m a rm ines .
A certaine s da t e s . l -Ai ssa oua pratiquaient leurscé
rémon ie s e xt a t iqu« s le mg de s rues . A Taza (Maroc)le co r tège se dé ro ula i t d éb ut du printemps , au milieu
de cérémonie s i l i t lem rrt ib les dans lesquelles s’
cxal
t aient à tel po int le s : t a t eurs eux—mêmes qu’ils ris
quaie nt de tombe r rl.m s’
hv st érie Peut—être faut—il
voir dans ces rite s la s ur vivance d’
anti ques saturnales,
des vieilles fête s du ve au ! Quoi qu’ il en soit, les
Aïssaoua doiven t ( li‘w —l l l iS se livrer à leurs exercices
uniquement dans le u rs 2 ) ufas . C’ est à eux que se rat
ta chent ces exaltés «,o u percent d ’ aiguilles en
chair, passent au mil i e u '. ti sons rougis
t issant s hystérique s ne dur ent pas
trine humanitaire qui e s'
En dehors de leurs e xe r
râ lement des gens ca
pas faire d ’ o
tou j ours étéLes zaouïa
en Trip
b reuse s
LE MYST I C I SME DANS 1 M M 37
Les Rahman ia . Les Rahm ani r rattachent à la
confrérie—mère des Khelouat ia q apparurent dans
le monde musulman envi ron un siè après les Qadria.
Le fondateur de l’ ordre n
’
était pl chérif comme
chez ces derniers , mais un véritable Q t e à la recherche
de l’
anéant issem ent corporel pour fins grande puri
fication de l ’ âme . Mohammed e l K o uati , le solitaiœ
persan , fut l’
inst iga teur du mouver e t que développa
Omar el Khelouat i (mort en 800 d’
Hégire , 1397-Œ
ap . J . Le vieux panthéisme per se retrouve M
l e voile du soufisrne épuré . Les t en c e s généralœ de
Khelouat ia so nt : au point de t emporel : le 38
ment avec toutes ses vérités , l e gement sacré.
pacte entre le cheikh et le néophy tsept noms de D ieu corre spondar
mité e t en politique : opposition sy émati
progrès , fanatisme exalté , et
médiates , persécution à tout
38 L’
I SLAM ET LES RACES
établis en Algérie . A la mort de S i Mohammed , lesOttomans
,voulant éviter que son tombeau dev int un
lieu de pèlerinage , un centre de rébellions , substituèrent
un autre corps au sien dans le catafalque d’
Ai‘
t Smai let enterrèrent le thaumaturge au Hamma , près d
’
Alge r .
D ’ où la légende de s deux tombeaux de S i Mohammedben Abderrahman surnommé Abou Qob rin (le père
de s deux tombeaux) . Au lieu de n ’ avoir qu’un seul centre
d ’ attraction,les Rahmani a en eurent deux ; cependant
la zaouïa du Dj urdj ura semble ê tre la zaou1a—mère par
excellence.
D e tous temps les Rahmania on t été les interprètes
du mouvement d ’ indépendance berbère , contre les Turcs ,contre les Européens , contre l es Français . Notammenten 1871 , le cheikh el Haddad (Si Mohammed Am ziam ) ,maître de la confrérie , _ fu t l
’ âme du soulèvement desKhouans du Tell et de Kabyli e après avoir réussi à
établir une entente avec les nobles (dj ouad) du MO
krani . Vaincu , avec ce dernier, le cheikh fut déporté
à la Nouvelle-Calédonie ,d’
où i l s’
evada . Et ab li aD j eddah
il obtint son pardon et mourut à Paris en 1895 .
La zaouïa-mère fut fermée par ordre supérieur et
les Moqaddim , en l’
absence du cheikh , se considérèrent
comme le s chefs de véritables petites principautés . Enmoins d ’un siècle les Rahmani a avaient englobé la plusgrande partie de la population indigène d ’
Algéri e , mais
à l ’heure ac tuelle , ils ne forment plus qu’une sorte
d’
église nationale divisée en plus de vingt diocèses ,avec ses maîtrises , ses évêques et ses vicaires ; mais
une église sans unité de direction , désagrégée , dont les
représentants sont séparés par des rivalités intes t ineset di rigent des chapelles indépendantes qui rivalisent
d’
audace et multipli ent leur moyen d ’ action pour attirer
40 L’
I SLAM ET LES RACES
de répétitions rituelles de mots ou de phrases sont toute
la liturgie . Le fait significatif qui se dégage de l’
ense i
gnem ent e s t que tous le s échelons mystiques des autres
confréries, qui faisaient transmettre la baraka à tra
vers les âges, sont supprimés . Le Tidj ani saute d’
un
bond à Mahomet et ses adeptes ne doivent p as recon
naître d’ autre loi que la sienne .
Le résultat est que les Khouans du Tidj ani , malgré
l ’ affiliation de leur maître à des voies extatiques , sont
plutôt les suj ets d’un souverain politique auquel il s
sont li es pa r l’ engagement . La doctrine est contenue
dans le bréviai re appelé El Kounnach . L ’ esprit généralde la secte est un libérali sme inhabituel aux autres confréries . Plus de pénitences, de macérations , de retraites
pénibles, mais seulement une loi simple qui se plie à
toutes les intelligences . La propagande de l’ ordre devai t
donc avoir de grands résultats .
Dès qu ’ il se crut investi de la confiance divine, lecheikh el Tidj ani agit en véritable successeur de Mahomet, convertit de nombreux ahb ab compagnons
qu’
il nomma ainsi en souvenir des fidèles du Prophète ,parcourut en soldat, beaucoup plus qu
’ en professeur,
le Touat, le Sahara et l’
Afrique du Nord . Il quitta Aïn
Mahdi à la suite de dissensions intérieures pour se
retirer à Fez , ville dans laquelle il eut une réussite consacrée par l
’
approbation du sultan Moulay Sliman . Il
mourut dans sa nouvelle zaouïa le 1 9 septembre 1815 ,
laissant une confrérie assez puissante pour inquiétersérieusement la puissance turque .Avant de mourir, le cheikh el Tidj ani , préoccupé
des intérêts de son ordre, en laissa la direction à sonplus habile m oqaddem , Si d El Hadj Ali b en El HadjAi ssa , originaire de Yambo (Arabie) et déj à grand-maître
LE MYST I C ISME DAN S L’
I SLAM 41
de 1 1mport ant e zaou1a de Temacin dans l’ oued Rhir .
Son testament portait qu ’ après la mort de son successeur, les chefs suprêmes de la confréri e seraient alter
nativement choisis parmi les membres de sa famille,alors composée de deux fil s en bas âge , e t ceux de la
descendance de son khalifa Si d E l Hadj Ali . D e là ,deux branches-mères ayant pour maîtri ses principales
Aïn Mahdi et Temacin L ’ unité de direction de
la confrérie fut rompue par cette clause du testament .
Néanmoins , sous des chioukhs remarquables , les Tid
j ania étendirent leurs ramifications de toutes parts, en
Afrique centrale, en Arabie . Ils se chargèrent de la pro
t e c t ion du commerce et des caravanes par leurs zaouïas
d’
Algérie et du Maroc avec Tombouctou par l’
Adrar,
amenant ainsi à la confrérie d ’ immenses richesses . De
1 830 à 1845 , leur Influence convertit de nombreux noirs
à l’
Islam . L’
enseignement de ses professeurs se déve
loppe, pénètre même en Asie, après avoir conquis le
continent afri cain . Du Maro c au Bornou , dan s tout le
pays des Touareg , le nom du Tidj ani est révéré
A dater de 1853 des rivalités entre Aïn Mahdi et Te
macin rompirent la cohésion de l ’ ordre . Les chefs spirit uels algériens furent débordés par les m oqaddim du
S oudan et du Maroc ;Fez devint un des centres directeurs de l a secte . Mais alo rs , avec le déplacement de
l’
influence, l a p oliti que changea . Les Tidjania aux do c
trines libérales avaient touj ours donné des marques
de sympathie à la France . Lors de la lutte avec l’
ém ir
Abd el Qader, peut—être par j alousie et rivalité avecles Qadria qui soutenaient ce dernier dont le père Ma
hi eddin était le représentant, les Tidjania furent par
(1 ) D epon t e t Coppolan i, p . 421 .
42 L’
I S LAM ET LES RACES
t i sans des Françai s . Après avoir soutenu des sreges vic
t orieux dans Ain-Mahdi et chassé l’
ém ir du Sahara ,les chefs de l
’ ordre nous aidèrent à occuper pacifique
ment Biskra , à soumettre les Larbaa et les Ouled Nay 1,à pénétrer chez les Touareg mais l ’ enseignement donné
à la zaouïa de Fez était nettement xénophobe .
Au Soudan , El Hadj Omar,Ahmadou Che ikhou étaient
Tidjania , m oqaddim de la zaouïa de Fez . Les pro i es
seurs . t idjania dominent encore dans les écoles du Son
dan . Les Maures , le s Peuhls sont acquis à leur influence .
Au Maroc même, les Branè s, les Tsoul et bien d’ aut res
sont en grande partie affi li és à l ’ ordre . Il est curieux
d ’ ailleurs d ’ étudier combien les Tidjani a algériens , nom
breux dans les rangs français, ont pu ai der la pénétra
tion au Maroc par leurs affil iations avec les Marocai ns .
Il est à souhaiter que les chefs spi rituels des Tidjania
qui ont touj ours fait preuve d’
un grand loyalisme pour
nous , reprennent la direction générale de la confrérie ,ce dont la France ne pourrai t sans doute pas avoir
à se plaindre
D erqaoua . Le prototype de la confréri e opposée
aux Français est celle des D erqaoua . Ce t ordre est peu
répandu en Algérie , mai s très développé au Maroc . La
plus grande maj orité de s villes du Protectorat chérifien
ont une zaouïa affi liée . Des corporations entières, no
tamment à Fez , appartiennent aux D erqaoua, lesquels
à Taza résident dans un quartier séparé des autres par
une muraille et des portes solides . Les D erqaoua repré
sentent en quelque sorte le parti avancé qui ne veut
supporter aucun pouvoir étranger, arabe, turc ou chré
tien . Naturellement les Berbères marocains se sont affi
l iés en grand nombre à cet ordre qui satisfai sait leurs
LE MYST IC I SME DAN S L ’
I SLAM 43
desidera ta . Les Ait Atta , les Ai t Izdeg, le s A i t Youssi ,les Beni Mguild, de l
’
At las, les Beni Suassem, les Gue
zennaïa , les Mtalsa , les Gb iata , sont en grande partie
Derqaoua ou soumis à leur influence . S i le roghi BouHamara réussit aussi longtemps dans ses entreprises ,c ’ est que , D erqaoui , il fut ai dé par la secte , ennemie
naturelle du sultan pui sque ce souverain représentait
au Maroc le pouvoir existant . D e 19 15 à 1 9 18, il est
possible que le fameux Abd el Malek qui opéra contre
nous sur le front nord de la trouée de Taza , aidé par
les agents et l’
or al lemand , ait réussi sa j onction avec
les Ghi at a habitant au sud de l’
Innaouen par l ’ inter
m édiaire des D erqaoua . En effet son grand-père Mahied
din était affi li é à la secte et lui—même, tirant parti de
la réputation de sa famille, put parvenir sur ces bases
à li guer contre l ’ env ahi sseur des tribus irré ductib l es
j usque-là . Au Touat, au Gourara , au Sahara j usqu’
à
Tombouctou , en Algéri e, en Tunisie, en Egypte , à LaMekke, les zaou1a derqaoua ont un e grosse influence .
L’
ordre des D erqaoua dérive de la confréri e—mère
des Chadelia . L ’ école mystique chadelienne a comme
doctrines un spiritualisme épuré, l’ abandon de l
’
être
au profit de Dieu , la pri ère à toute heure, en tous li eux,et en toutes circonstances , afin de vivre en union cons
tante avec la Divini té . C ’ est l ’ ét ernelle ex t ase ,'
m ais
l’
ex t ase sans transports mystiques , l’
ex t ase provoquée
par ce t arden t amour de la divinité, qui éloigne du
monde et pro cure des sensations inexprimables . Chez
les Chadeli a point de kheloua cellule souterraine
point de pratiques bruyantes, point de j ongleries la
vie errante et contemplative, avec, pour profession de
foi , l’
unité de Dieu (t ouahid) et pour enseignement, le
44 L’
ISLAM ET LES RACES
t e ssououof, ou science du spiritualism e ,qui doit conduire
le néophyte à vivre dans l ’ essence divineL ’unité de Dieu est si respectée chez les D erqaoua
qu ’ ils suppriment la seconde partie de la formule du
t ouahid I l n ’y a Dieu que D ieu , disent-ils , et ils n’ aj on
tent pas Mahomet est son prophète . Cette suppression
indique l’ esprit particulari ste de la secte .
Au Maroc,la science spiritualiste des Chadelia semble
s ’ être dispersée au profit du m arab out ism e local ; et
ce fait entre pour beaucoup dans l ’ énorme diffusio n
de son influence . Nombre de chorfa , de saints locaux ,
inféodés au Maghzen , ont conservé l’ enseignement, mais
un faqih , réputé dans tout l’ ouest africai n pour sa sain
teté et Ses études théologiques, Ab ou’
l’-Hassan Moulay
ali b en Abderrahman el Dj emal el Fasi , et son élève
Moulay el Arb i ben Ahmed el D erqaoui (X I I I e siècle del’
Hégire) , tombèrent dans un puritanisme étroit, fon
dè rent l ’ ordre des D erqaoua . Ce sont eux qui créèrent
ces dervi ches exaltés, lesquels n’
adm et t ent aucun j oug,prêchent une espèce de sociali sme en haillons et com
battent même les Musulmans non affi liés à leurs doc
trines rétrogrades .En Algérie, au Sahara , au Maroc, ils sont de toutes
les agitations et de toutes les ligues xénophobes . Les
Turcs eurent à souffri r de leurs attaques , les Français
à leur tour les retrouvent devant eux, comme les sultans
chérifiens les eurent autrefois . Il est possible que lorsque
l’
At las sera réduit , les dernières forteresses derqaoua
puissent être surveillées facilement mais à l’
heure
actuelle la secte représente un danger parce qu’
ayant
le prétexte de la guerre, elle a une grande action sur
(1 ) Depon t e t Coppolani, op . c it .
, p . 443 .
LE MYST I C ISME DANS L’
I SLAM 45
les populations . L’ influence des autres confréri es ne
suffit pas touj ours à les contrebalancer chez les Ber
b ères j aloux de leur particulari sme .
Taïb ia . L ’ ordre des Taïb ia (du nom de Moulay
Tayeb) est issu d’ un chérif qui , pour des motifs poli ti
ques, fit dériver des Chadeli a une branche purement
marocai ne . En effet le sultan du Maghreb el Aqsa , chériflui aussi descendant d
’
Idri ss, avai t b esoin d’
appui Spi
rituel e t temporel . Moulay Ab d Allah Ech chérif b enIbrahim ,
mort en 1879 de l’ ère chr étienne, et son petit
fils Moul ay Tayeb créèrent et développèrent la con
frérie qui eut pour but d’
être une sorte d’
égli se na
t ionale mettant son influence au service de la cour de
Fez ou la lui retirant selon les circonstances (1 ) Les
sultans reconnai ssent si bien l’
autori té spirituell e des
chéri fs t aïb ia qu e ce sont ces derniers qui leur donnent
en quelque sorte l’
investiture aux prem iers j ours de
leur règne . En échange , les souverains ont continuellement augm enté les privilèges des chorfas d
’
Ouazzan .
Ouazzan est le siège de l a confréri e . La zaouïa fut
fondée par Moulay Tayeb , qu i avai t d’
abord étudié à
Dar el A ’ lem (la mai son de la science) , créée par Idriss
et d ’ où sort ai ent les chorfa prédi cateurs qui allai ent
propager l ’ o rthodoxie musulmane dans tout le Ma
ghreb La mai son régnan te marocaine étai t ainsi
reconnue comme la seule orthodoxe en pays d ’
l slam
aux dépens des sul tans turcs de Constantinople . A la
suite d ’un rêve dans lequel Mahomet apparut à Moulay
Tayeb , ce dernier bâtit le Dar ed Dahman , la mai son
de la sécurité à Ouazzan . Dans la zaouïa , le spirituel
(1 -2 ) D epon t e t Coppolan i , Op . c i t .
, p . 484 .
46 L’
I SLAM ET LES RACES
et le temporel ont chacun leur chef particulier desquels
ressortent tous les habitants de la région d ’
Ouazzan ,
et dont les j ugements prononcés avec l ’ assistance du
tribunal des chorfas sont révérés dans la plus grande
partie du Maroc et même de l ’Oranie .
I l est inutile de rappeler avec qu elle continuité dans
l ’ action,les chorfas d
’
Ouazzan ont soutenu la politique
française en Afrique du Nord . D’
abord ils ont spon t a
ném ent mis leurs zaouïas algériennes et marocaines
sous la j uridiction éventuelle de la légation de Tanger
d ’une part, du gouvernement général de l’
Algérie , d’ au
t re part . Les voyages du chérif Ab dessclem en Algérie ,au Touat, les randonnées de leurs m oqaddim ont de
tous temps favoris é notre pénétration . En 19 15 encore
,ces chorfas se sont opposés aux agitations des
Abd el Malek payés par l’
Allem agne . Les zaouïas des
Taïb ia sont nombreuses en Oranie,où leur action est
considérable, et dans toute la zone comprise entre Fez
et la frontière oranaise . Parmi les tribus soumises , les
Hay a1na, les Ahl Meknassa , les Branè s, les Ahl Taza , les
Haouara , les Beni Snassen , les Zemmour, reconnai ssent
leur autorité parmi les tribus insoum i ses , les Ghiat a , Ma
ghraoua , Beni bou Yahi , Beni Ouaraïn ont de tous tempsrespecté les envoyés des chorfas d
’
Ouazzan . Au .mo
ment où l ’Allem agne souleva contre nous l’ esprit in
dépendant des tribus berbères , les Taïb ia , amis des
Français , perdirent sans nul doute un peu le contact
avec leurs affi liés de la montagne ; mai s leur prestige
religieux resté in tact put et peut servi r d Intermédiaire
le j our Où les irréductibles commencent à reconnaître
les bienfaits de la pénétration française et cherchent à se
rapprocher de nos postes . Enfin dans le Riff, en zoneespagnole, chez les Gellaïa , chez les Keb dana, les chor
fas d’
Ouazzan ont de nombreux adeptes .
48 L’
I SLAM ET LES RACES
b outique resta dans l ’ expect at iv e à notre égard , avec
une attitude semi-indépendante ; mais les oasis du sud
une fois occupés par nous, les Oulad S idi Cheikh se sont
franchement ralli és à nous et nous ont aidés dans la
pacification du Sahara et du Maroc - par leur influence
et par leurs armes .
Au Maroc notamment leur aide est appréciable . A
El Aïoun Sidi Mellouk se trouvait devant nous le fameux Bou Amama qui , de 1881 à 1 906 ,fut notre ennemi .
Né à Figuig vers 1840, le célèbre agitateur descendait
de Sidi Tadj , un des fils du grand Sidi Cheikh . En 1881i l sut se rallier les mécontents , au moment où les é s
prit s étaient surexcités en Oranie . A la soumission
des Oulad S idi Cheikh , il se réfugi a avec ses partisansà Figuig , d
’ où la colonne O’
Connor devait le débusquer.
C ’ est alors qu’ il vint s ’ établir à El Aïoun Sidi Mellouk
,
entre Oudj da et Taourirt . Ses partisans forment unesons-division des Che ikhia , appelés Amamia , comme
les Che ikhia eux-mêmes étaient i ssus des Chadelia . Les
Amamïa ont un dikr, un chapelet spéciaux, mais au
contraire de celle de leurs aïeux, leur doctrine prêche
la haine du Chrétien , à la manière du senoussism e .
A la mort de B on Amama qui fut enseveli à El Aïoun ,
son fils S i Tayeb hérita de la baraka , mais accepta bientôt de faire sa soumission aux Français . La Légion
d ’honneur l ’ a récompensé de son loyalisme . De 19 13
à 19 18, les Amam ïa, de même que les Oulad Si di Cheikhd
’
Algérie , on t fourni de nombreux contingents aux goums
et maghzens combattant sur la Moulouy a e t l’
Inna
ouen , et leur fidélité est restée aussi complète qu ’ il se
peut . Dès que le chef de ces confréries ou de ces aris
t ocrat ie s féodales s’ est rallié, ses fidèles le suivent avec
un dévouement complet, dans la paix comme ils l’
an
LE MYST IC ISME DANS L’
I SLAM 49
raient fait dans la guerre . S i Tayeb Bou Amama recueillela ziara auprès du tombeau de son père ; son influence
s’
étend j usqu ’ à Taza , chez les Branè s et chez les Tsoul .
Les S enoussïa . Les Senoussra sont un exemple
frappant des sectes issues de l ’ ent rev u e d ’un mystique
avec le fameux E l Khadir, le prophète E li e dédoublé .
Le chéri f marocain Abd el Aziz b en D eb b ahg fonda la
secte des Khadiria à Fez à la fin du xv1 1 ° siècle . Après
une séri e de transmissions de la direction spiri tuelle ,vers 1835 , en Arabie où s
’ était rendu le cheikh , les
Khadiria se scindèrent en deux branches : les Mirgha
nia et le s Senoussïa .
Les Senoussïa sont les disciples de S i Mohammed benAli b en Senoussi , lequel avait suivi son maître dansl’
Yém en . Le Senoussi était “
né en Algérie au douar
Thorch dans l ’ arrondissement de Mostaganem . A l’
âge
de trente ans , il avait quitté sa fami ll e pour suivre le
chef qu ’ il s ’ était donné . En 1848, en butte , comme cedernier, aux persécutions du clergé m aléki t e de La
Mekke, il se rendit en Tripolit ai ne dans le Dj ebel Lakh
dar, où il fonda une zaouïa . Sa réputation grandit et enmême temps que se développa son influence , s
’
élev èrent
les constructions de son ordre dans t out e la Tripoli t aine ,à Ghat, à Ghadam ès, à In Salah, en Arabie . Vers 1 855 ,il s
’
établit à D jaghb oub , à 15 j ours de marche dans le
sud à partir de Benghazi . Ses qualités et son ascen dantpersonnel furent si grands qu ’ aucun de se s fidèles ne
voul ut croire à sa mort en 1859 .
Le cheikh é s-Senoussi admet le rite m alékit e , mai s
o rdonne un puritani sme sévère . C’ est à ce titre qu
’
il
concurrence auj ourd ’hui le wahab ism e‘ dans le Nedj d .
Le rituel commande : « de 1 ° porter son chapelet et ne
50 L '
I SL ] ET LES RACES
pas le suspe ndre au e n ; 2° n’ avoir dans le s réunions
ni tambour. ni aucune spece d’
in strument de musi que ;
3° ne pas danse r : 4° 11 pas chante r ; 5° ne pas fume r ;
6° ne pas priser n : ras b oire de café (le thé est per
m is) (1 ) Tel qui v a entrer dans l a confrérie des Se
noussïa doit s’
_
v prep .e r par la prière , le j eûne e t l’
an
m ône . L’ usage de la so ici e s broderi es d
’
o r et d’
argent est
formellement interdit a néophy t e . S’
il se sert d’
une
montre , il faut que le v ouv ercles soient de cuivre , lachai ne en fer ou en ar r l
’
usage du pain trop cuit outrop brûlé , celui des hrssons al cooli ques , lui est aussidéfendu . L
’
ob ligation e comb attre les infidè les lui est
rappelée . et le ciel prr ri s s’
il succomb e dans la lutte .
S i le futur frère . s lr.e tment su rveill é du reste, ne s’
é
carte en rien de ce s «hposi t ions, le
cons cription le recoit olennellem en
p rend les mains du n dispsi ennes , lui rapp
deux autres que
entre les mains
les mains du
on com
50 L’
I S LAM ET LES RACES
pas le suspe ndre au cou ; 2° n’ avoi r dans les réunions
ni tambour, ni aucune espèce d’ in strument de musique
3° ne pas danser ; 4° ne pas chanter ; 5° ne pas fumer ;6° ne pas priser 7° ne pas boire de café (le thé est per
mis) (1 ) Tel qu i veut entrer dans la confrérie des Senoussïa doit s
’
y préparer par la prière , le j eûne et l’
au
m ône . L ’ usage de la soie ,des broderies d’
or et d’
argent est
formellement interdit au néophy te . S ’ il se sert d ’une
montre , il faut que les couvercles soient de cuivre , la
chaîne en fer ou en acier l’
usage du pain trop cu it ou
trop brûlé, celui de s boissons alcooliques , lui est aussi
défendu . L ’ obligation de combattre les infidéles lui est
rappelée , et le ciel promis s’ il succombe dans la lutte .
Si le futur frére , stri ctement surveillé du reste , ne s’
é
carte eu rien de ces dispositions , le cheikh de sa cir
conscription le reçoit solennellemen t . A cet effet , il
prend les mains du nouveau disciple , les serre dans les
siennes , lui rappelle les préceptes qui précédent et les
deux autres qu e voici : Que ton attitude en présence
du Cheikh soit celle de l’
esclave devant son roi . Soisentre les mains de ton cheikh comme un cadavre entre
les mains du laveur de morts qui le tourne et le retourne
à son gré ! Un certain nombre de formalités à
remplir dans la prière , de répétitions rituelles de mots
accompagnent l ’ enseignement . Rien qu ’ en Tripolit aine ,on comptait seulement , en 1880, vingt— deux zaouïas
senoussist e s e t leur nombre s ’ est considérablement accru
depuis . L’
influence de la confrérie s ’ étend sur toute
(1 ) Depon t e t Coppo lan i, p . 554.
(2) D r Pasqu a , Re v u e de géographie , Paris, av ril 1880, p . 285 .
Cfr . Hen ri D uv e y rier, La confrér ie m us ulma ne de S i d i, !Mohamm ed ben.
’a li es Senouss i e t son doma ine géographique en l
’
a n née
1300 de l’
hég ire 1883 de notre ère . (Bu ll . S oc . Géogr . ,1 884,
p . 1 45, av e c car t e . )
LE MYST IC I SME DAN S L’
} SLAM 5 1
l’
Afrique musulmane et même sur l’
Arab ie , où , dans le
Nedjd , le senoussism e commence à remplacer le waha
bisme . Le presti ge du Cheikh és—Senouss i est t el , qu’ un
Khouan ne verrait p eut—être aucun inconvéni ent à in
v oquer en vain le nom du Prophète , mai s n’
oserai t ja
mai s j urer, autrement qu’
en toute sincéri té, par celu
de Sidi Senoussi , le khalifa de D jaghb oub !Le se nou ssism e a un but réformateur : débarrasser
l’
Islam de toutes le s impuretés qui s’y sont int roduites
à travers les âge s . Par conséquent le s affiliés de la sect e
sont devenus les plus fermes soutiens du pani slafm‘
sme
arabe . L’
im am at des premi ers âges doi t être reconsti tué,aux dépens des Chrétien s sans dout e , mais aussi des
Turcs qui o nt usurpé le pouvoir islamique . Dans c e
sens , les Senoussïa ont tenté de fonder au cœur de l’
Afri
que un véritable état , refuge des vrai s Musulmans .
M . Le Chateli er pouvait écrire : Les dénominations
d’
empire théocrati que, d’
im ama t ,_peuv ent fort ex acte
ment s ’ appli quer au domaine africain du senoussism e .
Elles représentent beaucoup plus qu ’une figure , et , à
peu de réserves prés , sont d’une entière exactitude .
Il se produi t réellement une agglomération poli t ique,au sens i slamique du mot, des populations afri cai nes
de la zone sahari enne , so us la direction du grand maître
de la confrérie A ce t égard le senoussisme a pri s
en Afri que une organi sation commerciale . D es pos tes
servent de refuges aux caravanes qui sont protégées
par des affi li és . Des bandes tirent du pays toutes l es
ressources possibles . De là l’ opposit ion de la secte à
l’
avance européenne qui a fait ce ss er certains petitstrafics comm e la traite des noirs .
(1 ) Le Châ t eüer, L’
I s lam a u X IX e S t eele . Paris, Leroux .
2 L’
I SLAM ET LES RACES
La secte accumula des forces et un matériel de guerre
considérables au nord-est de l ’Afrique , dans le triangle
compris entre la Tripolit aine , le Ouadaï et le SoudanEgyptien . Le s Turcs finirent par ne plus ê tre considérés
comm e de s ennem ispar le s deux ñls du fondat eur de la sec t e ,
lesquels , en v ue des buts communs à atteindre , adop
t è rent une at titude conciliatrice à l’
égard de s O ttomans .
Pendant la guerre 19 14— 18, les Senoussis, âm e de la
résistance contre les Italiens en Tripoli t aine , crurent
le moment venu pour attaquer les Anglais en Egypte .Leurs premiers succès furent éphémères ; les revers
suivirent bientôt . Atteinte à travers les sables dans ses
repaires les plus éloignés par les auto-mitrailleuses b ri
tanni ques , la puissance militaire senoussïa fut écrasée,fin d ’un rêve d ’
empire
Malgré le dépar t du grand Senoussist e transpor t é en
Asie par un sous—marin allemand,la secte n e désarma
point,bien que forcée de revenir aux ag issements se
cre t s . En Cy rénaïque elle se reforma sous la direction
de Sidi Driss es Senoussi . Avec ce dernier,le s Italien s
ont réalis é leur théorie d ’amitié à tout prix avec les
Musulmans . Ils ont reconnu Si di D riss comme émir del a Cy rénaique . Ce prince e st en fait le souverain et le
maître du pays . Pour cette politique , les Italiens ont
abandonné leurs alliés kharedj i tes ; i l ne semble pas
cependant qu ’ ils aient tiré de grands pro fi ts de cetteméthode
,au contraire . Les Senoussist e s profitent de l a
situation pour se renforcer de nouveau ; en 1920 il s
semblent notamment favoriser l ’agitation en Egypte .
Ils agissent également en Asie
(1 ) Un e ét ude de s lu t t e s en t r e Angla is e t Sen ou ssis t e s a ét é
pu bhe e par Charle s S t ién on . Les campa gnes d’
Or ien t e t les in
térêts de l’
E n ten te , Paris, Pay o t , 1918.
(2) Les I t alien s v ienn en t (m a i 1 922) de reprendre la lu t t e
c on tre le s Senoussist e s e n Tr ipoli t ain e .
54 L’
ISLAM ET LES RACES
nant sur la surface des terres d’
lslam , ce khalife serait
peut—être assuré de l’ obéissance dans tous les pays
d’
Asie ou d’
Afrique . Quel levier alors pour le pantou
ranisme
Au début de l’année 1 922, le cheikh senoussis t e a
même été nommé par le gouvernement d’
Angora ma
rechal ottoman e t chargé du commandement des tribus
arabes de l’
Irak,lesquelles se libéreraient du j oug b ri
tannique . Sans doute aussi ce commandement visait
l a Syrie e t peut—être plus loin encore , pro fitant des agi
t at ions arabes au Levant et des tendances de certains
Africains du il ne faut pas oublier que Kém al
a prononcé en avril 1922 un discours dans lequel il réconnaissait somme toute aux Tunisiens le droit de s e
rendre libres de la Mais il semble que les affi
liés arabes reprochent eu ce moment au grand Semon ssist e d
’
inféoder une confrérie arabe à une politique tou
ranienne . Une fois de plus les rivalités de sectes et de
races empêcheraient ainsi de se parfaire l ’unité agis
sante de l ’ Islam .
En effet , heureusement , les sectes de ce genre ont desennemis hérédi taires , férocement j aloux de tout succès
chez leurs rivaux . En 1885 , les Senoussïa ne voulurent
pas soutenir à Khartoum le mahdi des Qadria de meme
ils refusèrent de soutenir les Ottomans contre les Russes . 11 est probable qu
’
à leur tour, les autres confréries
surtout si nous les aidons ne tiendront pas à
voir se développer l ’ influence des Senoussist es, ce qui ,naturellement, diminuerait leur influence parti culière
et leurs propres revenus .
LE MYSTIC ISME D AN-S L’
i SLAM 55
INFLUENCE DES CONFRÉR IES REL I G IEUSES .
Les confréries religieuses mus ulmanes sont les agents
le s plus actifs de la rénovation musulmane . Depuis que
les imams ont perdu le khalifat et que le panislamisme
ottoman n ’ a pu réussir à réunir les}
Musulmans sous
une seule autorité , ce sont ell es qui ont converti à la
doctrine islamique des milliers et des milliers d’
Asia
tiques et d ’
Africains . Dans le continent d ’
Afrique , Se
noussïa, Qadria , Tidj ania redonnent à l’
Islam une vita
lité nouvelle dans ses anciens foyers arabes , en allument
sans cesse de nouveaux chez les noirs . C’ es t une seconde
hégire . Mahomet regagne en Afrique tout ce qu’ il a
perdu en EuropeLa secte est un instrument de propagande redoutable
dont on retrouve les agissements dans toutes les agi
t at ions, dans toutes les dissidences . Le danger du se
noussism e , comme de tous les ordres similaires , est d’ être
une affi liation secrète , aux décisions sévèrement gardées, dont les mots de passe, les mots d
’ ordre , circulent
avec une rapidité inconcevable , avec une sûreté insoup
çonnée , par le couvert de frères voyageurs , de derviches ,de j ongleur s , de musiciens ambulants . Le cri d
’ alarme
est au besoin j eté de cime en cime, de dune en dune,par le trille d
’
un berger ; les rassemblements, les com
bats sont ordonnés par des feux allumés de hauteur
en hauteur, télégraphie rapide et sû re, que les an ciens
ont connue, que les Africains ont conservée .
Cependant cet instrum ent de propagande, qui auraitpu devenir une arme politi que excessivement dange
reuse, est resté sans effet, malgré d’
éphém ères succès
(1 ) De Vogu é, Les I ndes no ires , Revue des Deuæ-M ondes,nov em b re 1 890.
56 L’
i SLAM ET LES RACES
lo caux . En e ffe t si les Senoussia , les D erqaoua, les Rahmania se sont montré xénophobes , d
’
autres confrérie s
comme celles des Qadria restent dans l’
expe ct at iv e cer
taines encore , telles que les Che ikhia , les Taïb ia , les Tid
j ania et même les Aïssaoua , semblent s’
être ralli ées au
conquérant dans un but intéressé . Ces ordres se j a
lousent les uns les autres , « et si leurs khouans , sous
le costume de musiciens, de j ongleurs , de moines er
rants , s’ en vont recruter de s adeptes dans les douars
ou dans les ksours, leur propagande s’
exerce autant
contre l ’ activité des confréries rivales que contre l’ en
v ahisseur européen .
Il n ’ en reste pas moins vrai que les m v s térieux agis
sem ent s des confréries religieuses musulmanes doivent
être particulièrement surveillés . Les zaouïas , les con
vents , répandus dans tout le monde islamique , des côtes
du Pacifique aux rivages de l’
At lant ique , sont res tés
les lieux d ’ asile, les refuges non pas de la religion offi
cielle, mais d’un Islam adapté au particularisme local
des races . Des ordres nouveaux sont issus de s confré
ries-mères pour répondre à un besoin religi eux , politi
que , momentané ;d’
autres se forment encore pour s ’ adap
t er à de nouvelles aspirations .
Il est donc nécessaire , à qui veut commander en pays
d’
Islam , de se tenir au courant des agissements des
chioukhs, des m oqaddim et des khouans . C ’ est une
tâche rude , dangereuse même quelquefois , mais indispensable . Les chefs appelés à administrer des territoires
peuplés de Musulmans doivent connaître les tenants et
aboutissants des confréries sur leur zone d’
ac tion , m ém e
petite s ’ il s veulent ne pas être surpris a un moment
(1 ) Par ex em ple , e n Tu n isie , av an t de n omm e r u n fon c t ion
n a i re i n d i gèn e , i l fau t c onn aît re se s a ffi li a t i on s possi b le s e t c e lle s
de s m em b re s de sa fam ille .
LE MYST IC I SME DAN S L ’
i SLAM 57
donné par des agissements , des menées qu’ avec une
attention soutenue ils auraient pu prévoir . Mai s il ne
faut j amais intervenir dans l’
organisation , dans le choix
et la nomination des m oqaddim , ce qui pourrait blesser
la susceptibilité religieuse des adeptes , nous aliéner les
chefs de la confrérie . Une indifférence affec t ée , mais
vigi lante, semble être la meilleure ligne de conduite à
adopter ai nsi les m oqaddim ne prendront pas un relief
qu’
i ls n’
ont pas , et peut-être , par suite de l’
évolution
naturelle des cho ses , verrons-nous ces ordres religieux
se modifier, se transformer au bout de quelques géné
rations
La haine e t l ’horreur du nom chrétien , augmentéesà la suite de l ’ installation des Européens en Afrique,semble devoir faire place peu à peu à d
’
autres senti
ments . Les aumônes moins nombreuses dans les con
frérie s algéri ennes font peut—être prévoir le délaisse
ment de s ordres religi eux lorsque ce s derniers n’ auront
plus.
leur influence politique . Groupées autour de
chorfa , de marabouts , de santons , de personnages à
baraka locaux, ce sont de véritables asso ciations que
ces confréri es , et elles répondaient à un besoin . Ces
mutuelles existaient bien avant l ’ Islam , parmi les
caravaniers obligés à voyager, à trouver aide et assis
tance en des lieux très éloignés de leur demeure fami
liale . Les communautés sacerdotales de la Chaldee, dit
M . Poinsard , avaient ainsi créé une sorte de franc
maçonneri e pour encourager et soutenir les commer
cants et les transporteurs .Avec l ’ i slamisme apporté par un chamelier de La
Mekke, la tradition se continua puisqu’ elle était utile
(1 ) V . Te b e ssa , B ibl iographie .
58 L’
i SLAM ET LES RACES
et b onne . Mais , avec le développement des idées , ce s
associations ne furent\
plus se ulement des mutuelles.
Les personnages à baraka , devenus les centres des grou
pem ent s, continuèrent à ordonner l’
ent r’
aide entre leurs
affi liés , mais surtout au profit du cheikh, et leurs préoc
cupat ions d’ ordre politique entraînèrent la suite des
fidèles après eux . Auj ourd’
hui la sécurité établie permet
aux individualités d’
être libres e t de vivre suivant leurs
propres concepti ons , sans se rattacher obligatoirement
à une association puissante . Les mutuelles ont changé
de but de même l’
int ensifica t ion de l’
in struction donnée
a ouvert bien de s esprits qui ne veulent plu s être un
cadavre entre les mai ns du cheikh » . C’
est pourquoi si
les confréries religieuses musulmanes ont pu paraître
d angereuses à un mome nt do nné , elle s le so nt beaucoup
mo ins, et resteront inopérantes tant que leurs dirigeants
se ro nt rivaux le s uns de s autres .
IV . LE WAHAB I SME .
—Les manifes tations du mouvement soufit e eurent na
t urellem ent pour conséquence des réactions . U ne ten
t at iv e hardie pour ramener l ’ Islam à sa simplicité pre
mière fut l’
œuvre au XV I I I e siècle d’
Ab d ul \Vahab ,fondateur de la secte des Wahabites Née dans le
Nedj d en Arabie centrale, elle se rattache à la doctrine
hanbalite mais pousse le rigorisme à un degré
extrême . Les Wahabites sont convaincus que les com
(1 ) Il ne fau t pa s c on fondre le s Wah ab i t es du Nedj d a v ec le s
Ouahb i t e s , prem i e r n om de s Khare dj i t e s apnè s le schism e alid e .
Pour év i t e r de s c o n fus ion s, j’
em plo ie un e t ran scrip t ion différen t epo ur le s deux gro upem e n t s .
(2) V . t om e I, p . 121 .
LE MYST IC I SME D AN S L’
i SLAM 59
m enta t eurs du Coran l’
ont corrompu par et dans leurs
appréciations ; la do ctrine de Mahomet a été vici ée par
des al liages impurs des pratiques religi euses ordonnées
bien après le Prophète ont altéré son œuvre . Abd ul
Wahab,dit M . de Sai nt—Marün , résolut de ramener la
foi à sa simplicité premi ère et d’
arracher son pays aux
ténèbres de la superstition .
En même temps , le wahab ism e voul ai t mener une
active campagne contre le culte des tomb eaux de per
sonnages à baraka , contre celui des reliques . Le sou
fism e avait abouti à c es manifestati ons locales de la
religion ;mai s , par une curieuse rét ro—action , après avoir
permi s le développement de s i dées particularistes qu e
mettaient en œuvre les Wahabites , i l atti rai t mainte
tenant sur lui la fureur des nouveaux schi smatiques . La
nouvelle réforme qu ’ on a voulu quelquefois appeler
le protestantisme de l’
Islam , condamnait le luxe e t la
corruption des mœurs , interdisai t même le tab ac queMahomet sans doute aurai t condamné s
’
i l l’
avait connu
A cette doctrine sévère qui ne voulai t point d ’ inter
m édiaire entre l’homme e t son créateur, qui faisai t dé
pendre les tribus de Dieu seul , les Arabes du centre
de l’
Arab ie se ralli èrent avec un fanatisme rappelant
les prem iers âges de l’
Islam . Ils se réservaient le nom
sacré de Musulmans , traitant leurs ennemi s de Tur cs
impurs , d’
infidèles , de kafirs La hai ne des Arabes,race ari stocratique de la religi on islamique , intervenai t
contre les Ottomans usurpateurs du khalifat . Peut
être aussi , les croyances l ocal es , qui s’ étai ent mani
fest ées avant Mahomet dans les oas i s du Nedjd par
(1 ) Du m o t Kafir , in fidèle , es t v enu le nom des Ca fre s .
60 L’
i SLAM ET LES RACES
l’
adoration de l i d0 1é des Benou Bahia au temple deRodha , transportée ensu i t e à la Kaaba , ont—elles euune in fluence dans l ’ établissement d ’une doctrine sé
parat ist e .
Quoi qu ’ il en soit, les protestants de l ’ Islam en
trè rent en lutte vers 1800 contre les Ottomans , s’ em
parèrent de La Mekke , de Médine, renversèrent la Pierre
Noire , ruinèrent le tombeau de Mahomet . Il s rasèrent
de même les sanctuai res chy it es de Kerbela . Le sultan
de Constantinople, impuissant à réduire les Wahabites ,chargea de ce soin ” le vi ce-roi d
’
Egypt e Méhém e t Ali ,lequel y parvint en 1818 .
La doctrine a survécu aux visées politiques du Nedjd .
Elle subit même une curieuse et sensible renai ssance
vers 1900 . En 1913, le j eune émir wahabite , après avoirchassé du Hasa les gouverneurs turcs , s
’
offrit à payer
à la Porte un loyal tribut de vassalité . Le j ournal Le
Temps du 22 novembre 19 13 signalait que , si le sultan
repoussait les demandes du chef, il risquait de voir
lui échapper d ’ immenses territoires . I l serait curi eux
d ’ étudier les agissements de s Wahabites pendant les
campagnes des Alliés en Mésopotamie et en Syrie e t l eurs
relations avec le roi du Hi djaz . Il faut remar quer cc
pendant que depuis une vingtaine d’années s ’ était dressé
en Arabie centrale un nouveau rival du wahab ism e ,
le senoussism e , et que probablement les deux sectes
ont dû se nuire l ’une à l ’ autre .
En 19 16 et en 19 17 les Wahabites eurent une attitudeamicale v is—à-vis du malik Hussein Ils vinrent en
grand nombre au pèlerinage de j uillet 19 17,avec le fils
(1 ) Ce s ren se ign em e n t s m e son t fourn is par le Co lon e l Brém ond , chef de la m ission franç a i se près le r0 1 du Hidj a z, en1 91 6- 1 91 7 .
62 L’
i SLAM ET LES RACES
Antérieure , les Wahab ites restent , avec les Tur cs , les
seul s éléments forts et organisés capables réellement
de combattre (1 )Depuis
,les Anglai s ont su agi r sur les Wahabites .
L’
émi r du Nedjd a été reconnu sultan par le roi d’
An
gle t erre . Les deux souverai ns ont , en 1920 , échan gé
des messages très am icaux , ce qui n’
empêche touj ours
pas des partis wahabites d’
attaquer les vi llages soumis
aux Chérifie ns . La politique arabe inaugurée en 1909
par Lord Curzon , alors vice—roi des Indes , continue à
poursui vre ses buts avec une implacable rectitude . Le
colonel Lawrence, chargé de la question arabe , pe ut
être fier de son œuv re . Les Ar abes sont pour ai nsi dire
tous dans la main de l’
Angle t erre et garderont bien
la route terrestre de s Indes contre l’
Allem and et ses
serviteurs Jeunes-Turcs .
(1 ) De s essais d ’
en t en t e on t lieu en c e m om en t en t re Française t Wahab it e s .
CHAPITRE I I I
LES TRANSFORMATIONS MYSTIQUESDE L
’
ISLAM
Les conséquences premi è res du mouvement soufi te
furent sans tenir compte de l’
apparition des ordres
mystiques qui couvrent l’
Afrique et l’
Asie , sans tenir
comp te également de l’
actuelle propagande qu i convertit
le s noirs furent la décentralisation et l’
ém ie t t em ent
progressifs de l’
Islam . Sous le prétexte de Dieu ah
sorb ant tout le soufism e a favorisé l ’ éclosion de la
pensée chez l ’ indivi du , le développement de localisations
qui ont dirigé la religion vers l’
adaptation au particu
larism e de la race . Ce furent d’
abord les confréries,les
mahdism es, les révolutions qui , sous le couvert de prin
cipe s religieux, amenèrent le s peuples aux réalisations
temporelles . Ce sont les Wahabites du Nedj d, les Babis
tes de Perse , ce sont tous les mouvements régionaux
des sectes et des Mais c ’ est aussi , sous prétexte
de soufism e , la survivance des anciens rites , des reli
gions mortes , c’
est la survivance du paganisme dans
l’
Islam . L’
Islam primit i f a perdu sa pureté , s’ est trans
formé sous l ’ influence mystique du passé .
A Java , la vieille foi animiste populaire n ’ a,dans
la grande masse , rien perdu de sa force et le culte de la
nature , l’ adoration des esprits sont encore auj ourd’hui
en honneur chez les Jav anais qui le s pratiquent à l ’ abri
de l’
Islam En Arabie , les saints actuels sont pour
(1 ) E . Mon t e t , De l e ta t présen t e t de l’
a ven ir de l’
I slam , p . 40 .
Paris , Ge n thn er , 1 91 1 .
64 L’
i S LAM ET LES RACES
la plupart ceux du passé . Les Touareg ont gardé toutes
l es superstitions ant éislam iques ; ils croient aux mau
vais génies ce qui d ’ ailleurs fut emprunté par l ’ Islam
aux vieilles croyances d ’
Arab ie mais pour les co n
j urer ont recours comme les nègres fé t i chistes à la
musique,paient des art is tes indigènes pour le s éloi
guer Les Massalis de l’
Afrique centrale qui pra
tiquen t le cannibalisme n’ ont certes pas emprunté cette
pratique à l’
Islam . Alors que les Musulmans de Java
ont des arbres fétiches e t continuent à représenter la
figure humaine à la mode antique de l’
hindouism e , de
leur côté sur la côte orientale d’
Afrique , des Musulmans
somalis et hindous possèdent encore des images de la
Vache sacrée .
Sous un grand nombre de superstiti ons , de coutumeslo cales , ne pourrait—on pas retrouver la croyance mono
théiste de l a religion épurée des prêtres égy p tiens ; ou
bien encore la religion mystérieuse de Mithra , celle qui ,selon Renan , aurait sans doute conquis le monde si lechristianisme n ’ avait ex i sté Aux trois premiers siècles
après Jésus-Christ, l’
influence de Mithra , le Dieu solaire ,se retrouvait dans le monde : en particuli er le s initia
tions terribles des thauma turges m ithriat es on t peut
être serv i de modèles aux rites ini t iateurs des Soufi te s
et des chefs de confréries musulmanes .
Le culte antique du tonnerre se retrouve dans la
conception chy it e d’
Ali commandant aux éclairs ; le
vieux mythe solai re d ’
Adom s, du soleil mourant et
renaissant, du printemps succédant à l’hiver, c
’ est l ’his
toire d’
Hossein , fils d’
Ali , assassiné à‘
Kerbela , et dont
(1 ) A . Ko en en , Re v ue de l’
H isto ire des re l ig ions, t . 6, p . 28-29 .
Depon t e t Coppo lan i, p . 101 .
LES TRANSFORMAT IONS MYST IQUES DE L’
i SLAM 65
l e sang donne sa teinte pourprée au ciel crépusculaire .
C ’ est auprès de Kerbela , la mosquée du soleil cons
truite à l’ endroit où se trouvait Ali quand il arrêta
l ’ astre lumineux, tel le Josne de la Bible .
En Egypte se continue le culte des serpents sacrés ;de même en Oranie . Et ne faut—il pas voir dans laprédilection de cert ains ordres pour ces reptiles, la
continuité des anciennes conceptions A la côte
d’
Iv oire , d’ après le capitaine Adam , de 1
’ Infanteriecoloniale survivrait le culte du bœuf Apis , apport élà par les grandes migrations venues de l ’Est .
Le chat,dont ne parle j amais la Bible
,est un animal
révéré par les Musulmans . En Tunisie notamment (2)la multiplicité e t la confiance des chats frappe le nouvel
arrivant d ’
Europe . A Ben Gardane court la tradition
suivante : Le chat a une âm e comme l ’homme . Il est
musulman e t fait ses ablutions en se tournant vers
l’
Orien t ; s’ il se tourne d ’un autre côté
,ce n ’est qu
’
une
erreur de sa part . Le chat ne doit pas manger de porc,
et s ’ il en mange,le péché est pour son maître . Il ne doit
pas manger les souris,animal immonde
,et son maître
doit lui enlever les bêtes tuées pour lui éviter un péché
cependant en tuant les souris,le chat est agréable à
Dieu . Le chat est susceptible de prendre l a religion de
son maître aussi ne pourra-t -on faire cadeau à un B on
mi de j eunes chats que s ’ ils sont déj à bons Musulmans,
ce qui se reconnaît à ce qu ’ ils font leurs ablutions . S iun Roumi possède un chat trop j eune
,il est méritoire
de le lui prendre pour le faire élever par une chatte
(1 ) Con féren c e fai t e à l’
Ec ole c olon iale fran çaise de Neu châ t e l,o c tob re 1918.
(2) Je t ien s c e s rense ign em e n t s du m édecin -m aj or Mille t -Horsin , c orre 5pondan t du Muséum na t ional d ’
Hist oire Nat ur elle .
66 L’
i SLAM ET LES RA CES
musulmane . Les chats qu i v ivent à 1 etat sauvage sont
des infidè le s il est b on de les tuer , mais c’
est être agréa
b le à Dieu que de capturer les j eunes pour les élever
d ans la foi . Le s chats errants qui , trop vieux pour chas
s er , se réfugient dans un d ouar , sont les envoyés de Die u .
On ente rre le chat qui meurt ; on ne laisse pas le c a
dav re abandonné comme i l se fai t pour le chien
Les tirailleur s ne mangent j am ais les chats et Sidi Catous revient souvent dans le s ch ansons de marche des
contingents tun isiens . En Orie nt également le chat estvénéré .
La raison de ce respect des Musulmans pour le s chats
est que le Prophète ordonna de protéger ces an imaux
utiles pour prot éger les tentes contre les rongeurs e t
les s erpents . Peut-être faut- il voir encore en cette tra
dition une réminiscence du culte j adis rendu au chat
par les Egyptiens,vraisemblablement dans le même
but ut i litai re .
La survivance du passé se manifeste surtout dans
le culte des saints . Aux Indes , certains personnages
sacrés b rahmaniques se sont mués en saints musulmans .
Ce s manifestations sont diff érent es d e l ’ apparition des
ascètes et des santons , chefs de confréries . Les deux
mouvements p roc èdent l’un de l
’ autre et se son t ai dés
mutuellement, mais il est évident qu’ il y a dans ces
manifestations une survivance du polythéisme ancien
dans le monothéisme islamique . En Afri que du Nord ,le cu lte des saints est l ’ enveloppe sous laquelle les
restes survivants des religions vaincues se sont main
tenus dans l’ Islam C ’ est une des raisons pour les
(1 ) Le Do c t eu r Mi lle t a m êm e v u deux cha t s en t errés la pa t t e
dro i t e de d evan t le v ée en l’
air
(2) .Muhammedan ische S tudien, t . I I, p .
‘
275—378, Halle , 1890
LES TRANSFORMAT ION S MYSTIQUES D E L’
1 5 LAM 67
quel les les m arabouts se sont si facilement implantés
dans ces régions . Le fétichism e anci en se retrouve,
en Afrique du Nord , «Où se rencontrent non seulement
des m arabouts—hommes , mais encore des marab outs
ch oses . Combien d’ arbres , de rochers , de sources, aux
quels les indigènes ont cons ervé leur caractère sacré
pré—islamique ! L’
Afrique du Nord e st ainsi rempli e
de kerkours .
Le kerkou r e st une e ncei nte de pi erres posées à même
le sol au cent re un a rbre ou mêm e quelque fois un pieu
auquel s ’ accrochent d e s ex—voto , chiffons , lan ières ,cheveux, br in s de lain e, e t c . Lorsqu
’une enceinte de
ce tte sorte contient une k oubba (peti te bâtisse à cou
po le) , elle prend le nom de haouit a . La légende veut
que le kerkour s oit hanté par des”
revenant s , fantômes
de gens ayant péri de mort violente . C es mauvai s gé
nies sont nuisibles à ceux qui les rencon trent Le
passan t doit j eter une pierre s ur le kerkour, car l’ en
tassement des caill oux empêchera le fantôme de sortir
du sol . L ’
am oncellem en t des offrandes faites ai nsi par
les voyageurs fin it par don ner une masse croulante qui
s ’ éta le , g agne sur l a Le passant s ’é cart e , conti
nue à j eter’
e st al ors le redj em
Ces kerkours, «ces arbres sacrés , ces sources, représentent
des reste s du paganisme ancien . De -même que le christia
ni sm e accepta a vec la qualit é d e saints les pers onnages
révérés des Bretons , en les rebaptisant, a insi l ’ Islam
donna le nom de mzara à ces endroits vénérés , les
toléra comme de s li eux que l’ on pouvait visiter; puis , après
E . Mon t e t , Le cu lt e des sai n ts m usu lm an s , p. 52 . Pari s, Ge n t hner,191 1 .
(1 ) V . Mauchamp, Sorceller ie a u Ma roc .
Consul t er'
le t om e I du M arra‘
kœh d’
Edm ond 'Dowt t é.
musu lm ane . L e s c ha qui v i
d e s infidè les il e s t l o de les
b l e à Dieu que de « pt nre r
d ans la foi . Les cha t ‘rrant s
ser, se réfugien t dan. u d oua
On enterre le chat
dav re abando nné en. m e
Les tiraille urs ne maqent
tou s revient souv e nt ans le s ch
contingents t un isie ns En Orient
vénéré .
La raison de ce re ! e t des Musul in
est que le Prophè t e « donna de prof
utiles pour pro . ( ge r s t entes contr
les serpents . Peut-i tu faut - il voir enc
dition une rén1inisce r.e du culte j adi .
par les Egyptiens , n isemb lab lem ent
but uti li t aire .
La survivance du l ssé se man ifestle culte des saints . Xx Indes , certai .
sacrés b rahmaniques sero nt mués en sa ir
Ce s manifestations son différentes de l’
.
ascètes e t des santons chefs de
mouvements proc è den
mutuellement , mai s il
manifestations une
dans le
le cu lte
restes s
tenus d
68 L’
i SLAM ET LES RACES
avoir converti les hommes , il accepta leurs croyances .
Le poisson est encore un signe traditionnel . Les Chré
tiens l ’ avaient pris comme signe de reconnaissance . Or
le poisson e s t le signe mystérieux d’
anciennes associa
tions e t d’ anciens rites . Ne retrouve-t —ou pas dans le
t ot ét ism e animal le poisson comme caractère distinctif
des confédérations Déj à les invasions qui envahirent
l’
Afrique noire , aux temps mystérieux de l’
histoire ,marchaient en avant, venues d
’
Asie , sous le signe : du
lamantin , du poisson ! Ne serait-ce pas l’
antique idée
chaldéenne,orientale, de l
’ élément marin , source de
toute vie et de toute civilisation ? En tout cas , le cultedu poisson , adopté par les Chrétiens , est passé chez les
Musulmans . En Afrique du Nord , on voit , à l’
entrée des
maisons indigènes , une queue de poisson dessinée sur
le mur, pour porter bonheur aux habitants . Et cettemain de Fatma , dans laquelle on a voulu chercher des
explications mystiques , philosophiques , peut-être serait
cc cette queue de poisson incomprise, transformée en
une main aux doigts j oints , au pouce
Rome avai t déj à accepté dans son Panthéon les div init és locales . Mithra avait in fluencé les croyances
locales . D ’ où que viennent les croyances solaires , im
portées d’
Asie , venues d’
Egypt e , ou nées dans le pays ,i l semble que le soleil , auquel Mahomet a peut—être
rendu hommage en ordonnant à son lever la prière du
fedj er, fasse encore quelque impression sur les indigènes
et comme souvent le culte des ancêtres semble uni a
celui du feu , germe de la v ie , créateur de la continuité
de l’
espèce , de l’
effort, peut—être les lieux sacrés (mzara) ,sur lesquels l
’
indigène vient trancher la gorge à quelque
mouton , à quelque poulet, déposer des ex-voto , servent
ils dans l’
Islam de prétexte à l ’ antique croyance de la
LES TRANSFORMAT IONS MYSTIQUES DE L’
i SLAM 69
terre fécondée par le soleil, des ancêtres nés et profitant de cette fécondation , transmission de toute forceet de toute v ie . D ’ ai lleurs , le culte du passé se retrouve
di stinct en certains points . Les ancêtres sont encorehonorés par les Mzab it es qui , à certaines époques , se
réunissent pour la zerda , sorte d’
agapes.
La zerda , réunion solennelle ayant un but religieuxaccompagnée d ’un repas se fai t en d
’
autres cir
constances de la v i e musulmane . Les saturnales , les
fêtes champêtres de l’ anti quité , exi stent encore sous
le voile islamique . Les réj ouissances à l’
occasion du
printemps ont dû être reconnues j adis en Syrie et enPerse par les khali fes , gardiens de l
’
orthodoxie . En Afrique du Nord , à l
’ occasion des semailles d’
automne , à
la fin des récoltes d ’ été, au solstice d’ été alors qu ’ en
France s ’ allument les feux de la St-Jean , vieux restedu culte du feu , ou de Mithra , à la nouvell e lune les
Arabo-Berbères s ’ offrent des repas plantureux, font
parler la poudre en des fantasias échevelées . D e même
à Taza (Maroc) , pour les premières roses, au début du
printemps, les habitant s de la vi ll e cessent tout travail ,et fleuri s des premières fleurs processionnent
Du même genre est la coutume qu ’ ont les bergers
arabes à la cani cule d ’ aller se baigner ave c leurs trou
peaux, à l a mer ou au premier fleuve v enu,fussent -ils
même distants de soixante à cent ki lomètres .
Le fameux carnaval des Ri ffains ne rappelle—t —il pas
les anti ques saturnales et la tradition suivante ne semblet —elle pas un souvenir des anciens mystères célébrés à
Rome ,en Grè ce ,dans l’
Inde A l ’ instar de peuples d’
Asie
(1 ) D epon t e t Coppolan i , op . c it . , p . 1 14, no t e 1 .
70 L’
iS LAM ET LE S RA C ES
Mineu re ayant subi l’
em pris e byzanti ne certain estribus maro cai nes p ratiq ue nt enc ore ce que leurs voisin es
nomment la nuit de l’
ho rreur . A un e certaine dat e de
l ’année et di t -on, ceci se passe encore dans un e casbah
voisine de Taza dont le s habit ants mangent . la chair du
porc, et sont mépr is és par les gens des autres frac tionshommes , femmes , enfa nts se réuni ssent dan s une
grand e salle . Des rites mystérieux se déroulent, à l’
issue
desquel s une sorte d’
hy sté ri e gagn e les fanaüques.Lorsque
les assi st ants , au milieu de hurlem ents , des danses mystique s, ont atteint le paroxysme de l a surex citati on,la nuit totale s e fait ; hommes e t femmes s
’
accouplent
au e t ,le lendem ai n, chacun retourne à se s oc cu
pati ons sans che rc her à reconnaître son associ é de la
veille . Du même genre sont les cérémonies réservées
aux seuls initiés , qui dans c ertai ne s sectes , livrent le s
femm es à l’
im pudic it é lubrique des affi liés so us le prétexte de donne r la m aternité aux infé conde s et autres
rai sons semblables. Mais ce n ’
est plus l’
Islam qui est
en cause ; il ne saurait être que stion de l’
at t aquer sur
de t els suje ts .
I l es t tentant de pense r qu’en Afrique du Nord no
tamment,les vieille s c royances ont lai ssé une emprein te
durab le . L’
Islam n ’a pas fail l i à la règle au lieu d’
êt re
modifié par le nouveau ve nu,le contin e nt africain a
réagi dans le moule où étaie nt ven ues déj à se pe rdre ,
se tran sfo rmer tan t de civilisations di fféren tes,l’
Islam
a ét é également obligé de sub ir l’empreinte de s tem ps
pass és .
Les gén ies . La superstition ne s ’ attache pas seule
(1 ) V . P.—J. André, Les Ansar ieh de C il ic ie, Bulle t in de l
’
As ie
fra nça ise, Paris, juillet -aoû t
LES TRANSFORMAT IONS MYST IQ UES DE L’
I SLAM 71
ment aux m ara , aux kerkour, redj em , arbres ,, source s
fétiches . Bie n que la sorcellerie soit nettement condam
née par le Coran Celui qui croit à la sorcellerie do nn e
u n démenti et fait affro nt à prophètes de
nombreuses pratiques se retrouve nt dans la médecine
les porte—bonheur les cuvo-û t em ent s, toutes choses qu e
le Moyen Age chretien connut, et que l’
instruction se ulefait p érir .
Le pouvoir des pointes se retrouve en Afrique du
Nord . On connaît le geste contraire à la j ettatura . Che z
les Musulmans , la corne de gazelle est un préservatif
contre le mauvais sort . L ’ enfant nouveau—né a un
p ouvoir presque surnaturel . S’
il est posé sur les genoux
d’
un humain sans que ce dernie r s’ en aperçoive , il ne
peut qu’
ac céder aux demande s de celui qui lui a con fié
le b ébé . La vieille croyance franç aise de l’œuf de coq
se retrouve au Maroc… Si un coq reste pendant sept ans
dans une basse-cour, il pond un œuf d’
or dont il faut
s’
emparer sans tarder car les génies le guettent ; avec
lui , les trésors amasses par ces derniers peuvent être
découverts par l ’homme possesseur de l ’œuf . Il n ’ auraqu
’
à le poser sur le sol ; S’
il y a des trésors en dessous ,la terre s ’ ouvrira .
Cette légende nous amène aux génies . Le Coran lui
même parle des anges , des génies mais les légendes
qui courent le monde sur les esprits , les dj inns , ont
continué à subsister dans l ’ islamisme . Les génies se
retrouvent dans tous les contes arabes,dans les pres
t igieuses Mille et une Nuits comme dans les derniers
récits populaires . - Il semble que cette croyance aux gé
nies soit un merveilleux épanouissement de l’
im agina
(1 ) Mauchamp , S orce ller ie a u M aroc .
72 L’
i SLAM ET LES RACES
tion orientale , qui aime à mêler le surnaturel à la v i e
de tous les j ours . Les génies font partie beaucoup plus
du folk—lore particulier à chaque peuple musulman que
de la théologie islamique et c’
est, semble— t -il, locale
ment qu’ ils doivent être étudiés .
L ’ intervention de toutes ces superstitions , sorcelleri es ,croyances , permet de com prendre ce que peut être
le fanatisme dans le monde musulman .
Ce fanatisme ne sera plus l ’exagérat ion d’un senti
ment unique , mais sera , dans les cas où il ex istera , un
mélange d ’ idées,de conceptions
,de suj étions souvent
très difficiles à déterminer . Ainsi que nous l’avons mon
tré déja,le fanatisme musulman se montre le plus sou
vent non dans les individualités,mais dans les foules .
Et ce résultat paraît bien être une des conséquences duparticularisme introduit dans l
’
Islam par les confré
ries religieuses e t par la survivance d ’un état mystique
dépendant des races,les quels ne peuvent guère se faire
j our que dans l’âme des foules .
CHAPITRE IV
LE FANATISME MUSULMAN
LA GUERRE SA INTE PEND ANT LA GUERRE M OND IALE
Le fanatisme a certainement existé aux débuts de
l ’ expansion islamique , mais pendant la guerre de 19 14—18,pourquoi la proclamation de la guerre sainte par les
Ottomans n ’ a—t —elle pas été suivie d ’un soulèvement
général
La lutte des Arabes contre les Turcs , l’accueil em
pressé fait par les habitants de La Mekke aux délégués
musulmans de l ’Afriqu e du Nord surprennent les non
initiés qui se demandent pourquoi l’ i slamisme , repré
sen té , semble—t -il, par le sultan ottoman de Turquie ,n ’ a pas réuni , dans un seul élan contre l
’
oppresseur,
tous les peuples soumis à sa loi . Bien plus , les Arabes
musulmans soutiennent une guerre acharnée contre les
Turcs, Musulmans comme eux . L’
islam ism e n ’ était
donc pas le Tout unique qui pouvait soulever l ’ arme
brandie séculairement contre les infidèles, la guerre
sainte A ces di ff érentes questions , voici ce que l’ on
peut répondre
1 ° Le sultan ottoman de Constantinople se considé
rait comme le souverain , le pon t ife , en un mot l’ imam
de tout le monde musulman . Ce titre , son ancêtre
Sélim I e r l ’ avai t acquis en 15 17 dans la ville du Caire
du dernier membre de la famille des Abbassides, autrefois maîtresse du khalifat arabe et réfugiée à la cour
74 L’
i SLAM ET LES RACES
de s rois m am eluks d’
Egypt e . L’
acquisition de l’
Imam at
devait,dans l ’ esprit de s Turcs , leur attrib uer le pouvoir
spirituel et tempo rel réservé j usque—là au khalife arabe .
Pleins de cette croyance surannée , les Allemands espe
rè rent sans doute , en entraînant les Ot t omans dans la
guerre mondiale, soulever à la voix de l’
imam , héritier
de Mahomet , toutes les populations musulmanes sou
mises à la France , à l’
Angle t e rre , à la Russie .
Pour donner plus de force encore à cette v oix , les
Allemands et les Jennes-Turcs , leurs fidèles , répandirent
dans tout le monde islamique une série d’
opuscule s et
de brochu res en turc , en arabe , en persan , en arménien ,en kurde , dont des millions d
’ exemplaires furent dis
t rib ués gratuitement en Asie et en Afrique, notamment
en Afrique du Nord , pour démontrer la néc essité de
combattre les ennemis du khalife , donc du sultan de
Constantinople , tout en ménageant les Alliés chrétie ns
de ce dernier .
Le 29 octobre 1 9 14, était publi ée à Constantinoplela fe t oua , ou texte sacré proclamant la guerre sainte
contre l’
infidè le . Quelques tribus répondirent à l’ appel ,comptant sur des butins prochains , mais en fait lemo nde islamique ne bougea pas . D
’ abord le parti j eune
turc, quoique à la tête du gouvernement, ne formait
qu’
une minorité ensuite les Arabes récusaient au sultan
la qualité d’
lm am .
2° Depuis une quinzaine d’ années les Arabes avaie nt
rep ris conscience de leur valeur, aidé s e n cela par la
propagande active de l ’Angle t e rre . Les généraux turcs
s’
épuisaien t à réduire les révoltes « qui faisaie nt la
tache d’
huile dans les dé serts, de l’
Yém e n aux rives du
Golfe Persique En 19 1 1 dans l’Yém en ,l ’ im am
(1 ) ev ue he bdomada ire , 18 j an v ie r 1913, L’
in térêt de la F ra nce,
76 L’
I S LAM ET LES RACES
d ’ autrefois avec les humiliations et la misère d ’
aujour
d’
hui sous le j oug ruineux de l’
Osmanli
Telles étaient les tendances arabes avant la procla
mation de la guerre sainte à Constantinople le 29 oc
tobre 19 14 . A ces mouvements politiques répondit im
m édiat em ent l’
appoint des chefs religieux
Les Arabes n’
ob éiren t donc pas au commandement
ottoman . S i l es sédentaires de l ’Et at turc furent obligésde fournir des contingen ts , le s nomades plus j aloux de
leur indépendance , plus difficiles aussi à atteindre, res
t érent indiñérent s à la fe t oua . La plupart des Arabes
se rallièrent complètement à l ’ action contre le s Os
manli s, se 10 1gn1rent aux Anglais et surtout à l’
ém ir
de La Mekke (3) qui représente , sinon le nouveau sou
verain spirituel de l ’ Islam arab e , tout au moins un
roi arabe opposé au sultan turc et grâce auquel les Bé
douins pensent continuer à vivre leur ère coutumière
d’
indépendance et de pillages .
S i ces Arabes , au fond peu croyants , comme s’
en
étaient rendus comp te eux—mêmes Mahomet et ses
successeurs , n’ avaient pas répondu à la fe t oua, peut
être é tait-ce la normale . Mais il existe dans l’
Islam
des sectes importan tes , des ordres religi eux au fana
tisme bien connu qu i auraient pu s’
ex t érioriser de
l’
antique querell e de races entre Ottomans et Arabes .
3° Intolérance e t fanatisme devaient d ’ après certains
être sinon les caractères dominants de l ’ Islam , tout au
moins ses conséquences naturelles .
On a souvent pris les Musulmans pour des fanatiques
(1 ) Ren é Pinon , c i t é par Han o t aux , Revue he bdomada ire .
(2) Vo ir t om e I , p .263, l’
étude sur la fe toua. du Che ik hu l I s lam .
(3) V . Jou rna l de Gen ève ,_
La gue rre en A ra b ie (28 j u in e t 3 j u ille t 1 918, signé L .
LE FANAT ISME MUSULMAN 77
aveugles poussés par leurs mahdis à n e rêver que sang
et massacres pour chasser l’
in fi déle du monde islami
que . Il faut comprendre _ que le Musulman a senti l’ im
possibilité de s ’ opposer à notre force ; il se contente
de ne pas permettre l’
empri se sur sa personnalité . Le
Musulman reste à côté de l’
Européen conquérant , mai s
si ce dernier ne touche pas à ses coutumes , à sa religi on ,le premier s
’ en remettra à Dieu qui a permi s la défaitetemporelle de son fidèle . Il est à remarquer que cette
conception tend à changer depuis l es succès diploma
tiques des Kém ali st e s sur les Françai s succès
que les Musulmans considèrent comme obtenus par la
force .
D ’ ailleurs à l ’ origine de la doctrine islami que les con
quérants musulmans n’
imposai ent même pas leur reli
gion aux peuples soumis . Les peuples rencontrés par
les arm ées , dit M . de Castries , étai ent mis dans la triple
alternative ou de se convertir au Coran , ou de garder
leur religion en payant un tribut, ou de s’ en remettre
au sort des armées . Le prophète Mahomet n ’ avait
d ’ autre but que de substituer le culte de Dieu uni que
à celui des idoles . Les détenteurs d’
écritures sai ntes ,Chrétiens e t Juifs trouvai ent grâce à ses yeux .
Le fanatisme pousse les adeptes d’
une religion à conver
tir de gré ou de force, par tous les moyens , ceux qui ne
croient pas comme eux : dans de telles conditions l’ is
lami sme est plutôt tolérant . M . E . Mercier reconnaît
que la tolérance est le fond de la doctrine islamique .
De nos j ours encore, les adorateurs d’un Dieu uni que
peuvent vivre en paix en terre musulmane arabe .
L’
Arab e se croit touj ours d’une race supérieure a toutes
(1 ) Le s Ju i fs furen t perséc u t és plu s t ard . Vo ir t om e I , p . 34,m ais le s t a t u t de s Ahl Ki t ab re s t a le m êm e .
78 L’
i SLAM ET LES RACES
le s autres , mais cette confiance en soi a une origine
politique , provient du temps où les Arabes é tai ent les
maîtres incont estés d’un monde .
Quant a la prétendue haine religieuse, au fana ti sme
auxquels certains ont voulu attribuer la responsabilité
de la rési stance et des révoltes que les Français par
exemple ont eu à supporter en Algéri e , M. Merci er fait
encore j ustement remarquer que ce n ’ est pas sur c es
cause s qu’ i l faut faire reposer l eclat des meurtres et
des guerres . Il faut en v oir l ’ origi ne dans les maladresses ,les ordres blessants , les fautes admi nistratives , igno
rants des coutumes séculai res , dans le s er reurs de tous
genres qui n’ ont pas manqué dans les débuts d
’une po
liti que non encore ad aptée aux besoins indigènes . Les
Anglais ont souvent eux aussi payé durement ces er
reurs, comme dans la révolte des Cipayes de l’
Inde .
A cause de ce s fautes , réelles ou imag inaires , pour
des raisons politiques ou personnelles à un agitateur
foll ement ambitieux , des mouvements restreints se
sont produits au moment de la guerre mondiale dans
les territoires musulmans, français ou anglais . Mais c e
ne furent que des agitat ions lo cales , l esquelles ne revê
t irent jamai s un caractère d’ ensemble . Ces explosi ons
sont naturelles chez des suj ets qu’ il est facile de t raiter
de fanatiqu es pour faire oublier ses propres erreurs ,leur propre parti cularisme et leur amour de l ’ indépen
dance . Ces explosions n’ ont pas une origine religi euse,
ne sont pas du fanatisme elles on t de s raisons presqueuniquement politiques . Vo ilà pour le monde arabe.
Il en est autr ement en Asi e Mi neure où , comme nous
l’
avons montré dans le t ome I , les'
I‘
urco—Mongols n’
ont
pas continué à observer la primi tive tolérance des Arabes .
Pour des raisons politiques, ils vont voulu écraser les
LE FANAT I SME MU SUI .MAN 79
parti cul ari sme; qui les gênai ent ;ils ont soul evé alors le
fanati sme int oléraut de leurs p euplades farouches contre
les Arméniens , les Syri ens , les Maronites .
4° De 1 900 à 19 10 , on a souvent fai t un épouvantai l
du fanati sme musulm an . M . Dicey de Londres écri
vai t (1 ) Des Anglai s ont fini par ouvrir les yeux et
par reconnaître que les neuf dixièmes des fellah s d’
E
gypt e se lèverai ent contre eux s’
ils avai ent affaire au
sul tan , comme cela a fai lli se produir e lors d e l’
o ccu
pati on d’
Akab a . Tout le bien qu e l’
Angle t erre a pu
fair e au pays sera compté pour ri en le j our où l’
Islam
commande ra . Le B ulle1în de la S ociété de géographie
d’
A lger sign alai t : Il faut j et er un rapi de coup d’œil
sur le monde musulman , en particulier sur l’ évolution
qui s’
y manif este, évoluti on dont la grasi t é n’ est pas
soupçonnée en F ran ce . En eff et , un chef à Stamboul ,un cœur bien fi xa nt à La Mekke , la vi ll e sainte, des
essaims d ’
adept e s v igoureux e t pro lifiques dans tous
les pays du m onde , une reli gion bien vivante , un fana
ti sme poussé à la folie , fai san t luire aux yeux des
Croyants l’
espoir que le Coran d ev iendra la loi des
mondes , voilà l’
Islam !
Dans ces derni ères année s , l’ on a fai t j usti ce de ce t
épouv ant afi suranné du fanatisme musulman e t du
soulèvement général du Croi ssant contre la Croix . Dans
tout l’
islamisme , sous l’
appareut couvert de dogmes
int angibles, il exi st e une mul ti pli cité de sectes , un dé
v eloppem ent ex cessif de’ confréri es reli gieuses rival es
qu i ont perdu de v ue le but religi eux primiti f pour
n’
être plus en réalité que des associati on s politi ques .
Que chacun e d’
entr e ell es so nge à reprendr e un pou
voir temp orel sous un prétexte religieux, c’
e st possihhe t
(1 ) Bu lle t in de la Soc iété de géographie d’
Alger , sem e s t re .
80 L’
i SLAM ET LES RACES
Il est même probable que les aspirations lo cales sontsoutenues par la confrérie l ocale . Mais cette extensionmême des sectes , l
’ apparition du culte des sa1nts locaux,des marabouts , ont tué l
’unité primitive de l’
islamisme ,unité qui ne se reformera sans doute plus à la voix
d e quelque imam génial , puisque celui-là même sera
contre-battu par les chefs des ordres rivaux . Mahomet
avait prévu le danger lorsqu ’ il avait interdit les moineset les santons . Le m arab out ism e a dispersé les efforts
de l’
Islam en outre, les puissances européennes j ouent
des ambitions opposées des hommes saints , et maintien
nent ainsi dans leurdiv ision lesMusulm anslesplus croy ant s .
Et les masses populaires suivent bien plus les ordresde leurs santons qu ’ elles ne se préoccupent des dogmes
originels du Coran . Ce ne sont plus des fanatiques aux
quels l’
on a affaire, mais ce sont des hommes soumis
à toutes les passions politiques de l ’heure . Le vrai
croyant musulman ne parle j amais de religion , mépriseuniquement ceux qui ne croient à rien , d
’ accord en
cela avec les préceptes coraniques ; les lettrés , les gram
mairiens peuvent discuter à l ’ ombre des mosquées ou
des zaouïas sur quelque point subtil de grammaire ,commenter quelque verset douteux, ce ne sont pas eux
qui pousseront les masses à la rébellion . L ’ ambition
et l’
esprit de domination seuls p oussent certains au
simulacre du fanatisme .
5 ° On a souvent pris pour du fanatisme ce qui n’
est
au fond que la tendance moderniste des Musulmans
à prendre part eux—mêmes aux discussions adm inis
t rat iv es qui les touchent . Depuis que le Président Wilsona émis ses fameux principes , si les Musulmans ne récla
ment pas encore partout le Self government les
gens instruits qui ne manquent pas dans l ’Afrique du
LE FANATI SME MUSULMAN 81
Nord française revendi quent une plus large part dans
la gestion de l eurs intérêts sans perdre leur statut spé
cial de Musulmans vivant sous la loi française . Ils v en
lent se man er, hériter, etc . , comm e l’
ordonne leur loi
religieuse,intim ement uni e chez eux à la loi civil e . Or la
loi française, cell e qui fait le citoyen français , a ses ori
gines profondes dans la morale chrétienne,dissemblable
souvent des ordonnances coraniques . Dans ces condi
tions,il faut comprendre que les Musulmans cherchent
à trouver la meill eure formule pour vivre en harmonieavec ceux qu i leur ont apporté un bien-être et un
progrès diff érents de leurs conceptions primi tives .
La hai ne existe certainement encore chez les'
Turco
Mongols ralli és par les Jeunes—Turcs . Peut-être existe—t —il
encore dans les âm es musulmanes arab es ou berb ères
un vieux levain de hai nes contre le Chrétien conquérant,mais il faut avouer que ces indigènes afri cains qui ont
versé sans compter leur sang sur tous les champs de
bataill e de la guerre mondial e, ont bien droit à quel
ques compensations , à un véritab le crédit de loyalisme .Aussi l ’ année 19 18 a-t -elle vu l
’ appli cation d ’un grand
programme de politique indigène destiné à récompenser
les Musulmans algériens de leur concours loyal et cons
tant à la Métropole envahi e Ce geste de la France
reconnaissante efface toutes les espérances conçues par
l’
Al lemand , in stigateur de la guerre sainte, et prépare
pour l’
aveni r une seconde France industrieuse et fé
coude , dans l ’ ombre chaude de l’
Islam Et les nouvelles entrepris es des Communistes , des Bolchevistes ne
(1 ) V . Le Temps , Raymond Recou ly , j u in 1918 .
Le Jou rna l de Ge nève , La F ra nce e t l’
Algér ie , Ren é Pay o t ,1 1 ju ille t 191 8 ; Le Journa l de s in ternés fra n ça is , n°8 1 8 e t 20 ,L
’
Afr ique du Nord e t la gue rre , Luc ien Broche . Neu châ t e l, 1 91 8 .
6
82 L I‘
. I ET L£S RACES
pourr ont -aire oub lie : ax Arab es que leu r réel in térêt
se trouv e dans une r r m a tio n étro it e ave c la France.
f ïC LUSI ON .
Le fana t isme n’
a pu re rév eillé dans la guerre sainte
par sui te de s s lami que s . Le khan d’
Afgha
nis tan a e ssav è e n 19L Ï e ravi r au sul tan de Stamboul
son titre de Command des Crov ant s.
Mai s il ne faut pas fo ndre pani sl ami sme,idée po
li t ique ,ge rmano -b ok h i ko—kém alist e
,avec l
’
Islam,
i d ée reli gieuse ne com ' t an t plu s l’
unité polit iq ue .Les
concessions répétée s nous avo ns fai tes aux Kéma
li st es,e t qui le s on t lt rement amenés à se considérer
comme nos vainqueurs . n t co ntri
po li t ique pani slam ique wi menace
b oul à Madra s,de Tun i à Rab at
de Rabat en 192 1 . on
Nous avons lai ssé se
Angora qui fini ra it
pas la rés olution d
est pour nous une
mes ai dés par
L’
Islam n’
a
divis ent dcroya
ment
mun ,bien
82 L’
i SLAM ET LES RACES
pourront fai re oublier aux Arabes que leur réel in térê tse trouve dans une collab oration étroite avec la France .
CONCLUS ION .
Le fanatisme n’
a pu être réveillé dans la guerre sai nte
par suite des divisi ons islamiques . Le khan d ’
Afgha
ni stan a essayé en 1920 de ravi r au sultan de Stamboul
son titre de Commandeur des Croyants .
Mais il ne faut pas confondre panislamisme,i dée po
lit ique , germano-b olchev îko—kémalist e,avec l
’
Islam,
idée religieuse ne comportant plus l’
unité polit ique .Les
concessions répétées que nous avons faites aux Kéma
l istes,e t qui les ont logi quement amenés à se considérer
comme nos vainqueurs,ont co ntrib ué à développer la
politique panislamique qui menace auj ourd’hui de Ka
boul a Madras,de Tunis à Rabat : même au Maghzen
de Rabat,en 1 921
,on évoquait l
’
Egy pt e et Fouad I“ .
Nous avons lai ss é se constituer le bloc Berlin—Moscou
Angora qui finira it par nous écraser si nous ne prenions
pas la résolution de le briser et de le dissocier,ce qui
est pour nous une nécessité absolue . En cela nous sommes aidés par l ’ Islam lui—même .
L’
Islam n ’ a pas échappé aux rivalités économiques quidivisent depuis longtemps l
’
Europe et l’
Amérique . La
croyance au Coran peut touj ours permettre à un m o
ment donné une union éphémère contre un ennemi com
mun , mais les rivalités et les dissensions reparaîtront
bien vite,car elles sont fondamentales .
Les schismes qui ont séparé l ’ Islam en des branches
diverses ont diversifié la doctrine, ont atteint qu ’ ils le
veuillent ou non l ’ intégrité du dogme . Sous le couvert d
’
orthodoxi e , le soufisme a orienté les âmes vers
LE FANAT ISME MUSULMAN 83
les plus dangereux ennemis de l’
unité islamique,vers
les confréries reli gieuses devenues des associations dontles membres sont plutôt les esclaves de leurs chi oukhs
que les fidèles ob servateurs de la loi du Prophète .
Comme le spirituel et le temporel sont intimement
unis dans l ’ Islam , tous ces groupements religi eux eurent
des vi sées politiques . Ils ont aidé, favorisé l’ éclosion
des mouvements nationaux chez les races converties .
Les particularismes locaux se sont aidés des prétextes
religieux pour revendiquer leur autonomie ; les aspiration s lo cales se sont fait j our à l
’
ai de des m ahdism e s,
des o rdres , des confréries . C’
est pourqu oi l ’ étude des
schismes devait précéder cell e des mouvements régio
naux .
CHAPITRE V
LA QUESTION ARAB E (1 )
Nous avons v u dans l e tude de l’ expansion turco
mongole combien les Tourani ens (2) avaient peu soumis les Arabes à leur suzeraineté . A partir de 1879,
Sultan Abd ul Hamid chercha à trouver en Asie lescompensations aux pertes subies p ar la Turquie en Europe . Il inaugura en Turquie et en Arabie la politique
dite des chem ins de fer L’ état ottoman est à base mi
lit ari st e : le s voie s ferrées doivent servir à porter rapidement les troupes de l
’
Empire sur les li eux où des
minorités menacent l ’ intégrité du sultanat . Bien que
construit sous le prétexte de conduire plus facilement
les pèlerins v ers . La Mekke et Médine , le chemin de fer
du Hedj az étai t une arme de l’ impériali sme ottoman
contre les révoltes p erpétuelles des Arabes . A l’
inst iga
tion de l ’Allem agne , le sultan avai t organi sé la Turquieen corps d
’
armées ; le 6° eut son siège à Baghdad , le
7° devait teni r Sanaa dans l’Yém en . L’
All em agne pré
parait par ces moyens l ’ o ssature du Baghdad-bahn con
t re l’
Anglet erre .
Le gouvernement b ritanni que avait depuis longtempsprévu ces tentatives germano-turques . Dé j à
,en 1812, des
relations avaient été nouées avec les chefs arabes de la
(1 ) Lire la rem arquab le ét ude du Co lon e l E . Brem on d L’
in ter
ven t ion a ra be et chér ifienne da ns la gue rre 19 1 4—1 91 5 . Paris , 1 920 .
(2 ) To uran che z le s écriv a ins ara b e s se di t par oppo si t ion àIran e t signi fie t o ut c e qu i se t rou v e au no rd de l
’
Iran . C’
est
une anc ren ne t erm i n ol ogie persa ne .
88 L’
i SLAM ET LES RACES
péninsule . Des voyageurs britanniques avaient parcouru l ’Arab ie . Lord e t lady Burton atteignirent même
les oasis fermées des Wahabites au Nedjd . Depuis la
défaite russe en Mandchourie l’
Angle t erre ne
craignait plus dans le Proche Orient que l ’Allemagne
appuyée sur la Turquie . Dès cette époque , la Grande
Bretagne essaya d ’ organi ser les Arabes d’
Arab ie contre
les Germano—Turcs .
Déj à l ’ém ir wahabite Ibn Saoud s etait alli é au cheikhde Kouwe i t , alli é du Gouvernement des Indes . Cet émirfonda cônt re les Ottomans dès 1904 un empire des con
fins de la Mésopotamie à ceux de la Syrie . En 1905
d’
autre part les Yém énit es infligeaient aux Turcs des
défaites sévères . Les garnisons de l’
Assy r et du Hedj az
furent bloquées par les Arabes .
A cette époque , se poursuivit un véritable réveil national arabe , appuyé par des publications en Europe . L
’
An
gle t erre soutenait sans doute en dessous le mouvement ,car de cette époque , datent en t re elle et la Turquie
poussée par l ’Allemagne les incidents de Kouwe i t dans
le Golfe Persique et de Tabah sur la Mer Rouge .En 1 907 , se produisit une accalmie . Le sultan de
Stamboul reçut la délégation du Yémen et promit dene laisser que quelques garnisons dans le pays . Les Ot
tomans ne devinrent d’ ailleurs pas plus libres de cir
culer . Les révolutions j eunes—turques de 1908 a l 909
ne comblèrent pas le fossé entre Ottomans et Arabes .
Les députés arabes firent touj ours bloc avec les non
Turcs, soutenant la politique des petites nationalités .
Les Jeunes—Turcs saisirent bien vite cette mentalité des
Arabes;et reprenant la politique d’
Ab dul Hamid , cher
chérent à t urquiser l’
Arab ie ; ils interdirent de leur
mieux les fonctions publiques aux Arabes, e t t ent è ren t
90 L’
I SLAM ET LES RA CES
3° Attribution aux Arabes d ’
un certain nombre
de sièges de députés et de sénateurs .
Naturellement les Jeunes—Turcs manquèrent encore
une fois à leur signature . Aussi ne faut—il pas s ’ étonner
si les Arabes marchèrent aux côtés des Alliés contre
l’
Allemagne et la Turqui e dans la guerre 1914—18 . La
guerre pour eux ne faisait que s’ étendre .
Le gran d chérif de La Mekke, Hussein, était en fonc
tions depuis 1909 . Pour bien mon trer la mentalité isla
mique , laquelle n’
est j amai s satisfai te d’
une victoire de
Chrétiens sur des Musulm ans , i l est b on de sig naler que
cet Hussein apprenan t l ’ entrée des Ang lais à Baghdad
s’
écria C ’ est un désastre Hussein n’ a j amais été
t urcophob e . Il s ’ est montré ennem i des Jeunes—Turcs ,
mai s a touj our s témoigné la plus v i ve adm ira tion pour
Abd ul Hamid .
C’
est autour de cet Hussein que se concentra la ré
sist ance arabe . La Grande—Bretagne fut représentée près
de lui à D j eddah par le li eutenant— colone l Wilson , gou
v erneur de la province de la Mer Rouge (Red—Sea à
Port- Soudan) , qui était venu en cette ville comme chefdu Pilgrimage office . Le colonel Lawrence
, qui s’
atta
cha si fortement à la politique arabe et devi nt célèbre
depuis,étai t un profes seur d
’
Oxford qu i avait depuis
de longues années ex écuté de s fouille s archéologiques
à Palmyre . I l y reprenait les traditions de Lady Stanhope (1 ) et s
’étai t lié avec les Arab es,en particulier avec
Fay sal . Lawrence s’est montré francophobe , ou plutô t
très colon ial anglais . Il n ’ avait aucune sympathie pour
sir Mark-Sykes,le meilleur connaisseur de la Turquie ,
(1 ) Lady S t anhope , sœ u r de Pi t t , s e t a it in s t alléc au Lib an , e t
s e t ait v e rs 181 2— 13 créé une gr o sse in flu en c e dan s la r égion . Elle
fi t éche c à La sca ris , l’
env oy é de Napo léon 1er
e n Orie n t pourouv r ir la ro u t e de s Indes .
LA QUEST ION ARABE 9 1
riche financier francophile,dont les égards pour l a
France étaient mal vus de ses compatr i otes coloniaux .
L ’
emir Hu s sein,malgré les avances faites par les Bri
tanniques , lesqu els payaient davantage et étaient sur
place,montra touj ours à la mission française une sym
pathi c profonde,cherchant ainsi à maintenir son inde
pendance par une attitude égale envers les grandes
puissances . Le colonel Bremond,chef de la mission
françai se,en profita pour prendre sur l emir une réelle
influence,et fit ex écuter avec succès par nos ressortis
sants le s pèlerinages à La Mekke de 1 9 16 et de 1 9 17 .
Enver pacha craignait la valeur de l ’ émir Husseinaussi fit -il à Constantinople nommer contre lui Grand
Chérif de La Mekke , le chef de la famille chérifienne
de s Aoun , rivale d’
Hussein , Ha1dar pacha , complète
ment rallié aux Germano—Turcs .
Le 10 j uin 19 1 6 les hostilités commençai ent of ficielle
ment . Les Turcs étaient obligés d ’ évacuer le Hedj az ,mais avaient montré le peu de développement de leur
sens religieux en b ombardant la kaab ah de La Mekke .
Par contre les Ottomans se maintenaient à Médine .
Le grand chérif de La Mekke lançait des proclama
tions dénonçant les tromperi es et la mauvaise foi des
Jeunes—Turcs . Pour répondre aux aspirati ons des Arabes ,il se faisai t pro clamer malik el arab , roi des Arabes .
L’
Anglet erre lui reconnut ce titre de malik après de lon
gues négociations,mais lui refusa la qualification de
D je llala , maj esté . La France accorda satisfaction au Ma
lik sur les deux points ;mais le s deux puissances eu
ropéennes lui dénièrent la qualité de roi des Arabes
et ne lui reconnurent que celle de Roi du Hedj az .
Les troupes arabes conduites par l emir Faysal ne
menère nt évidemment pas la grande guerre contre le s
92 I SLAM ET LES RACES
Ottomans ; cepenant elles génè rent considérablement
les Germano-Turc par leurs raids e t leurs razzias .A la conclusion l e l
’ armistice avec la Turquie (octobre Fay sa l
*
eçut au même titre que le s Anglais
et les Françai s n e zone des territoires turcs occupésà administrer : c c furent les gouvernements de Damas
et d ’
Alep, t oujo us sous le haut commandement du
maréchal Allenb y (l 9 l 9) . C’
est de cette époque que
datent les prem iè r fri ctions entre Françai s e t Chérifiens .
Les Arabes comt aien t sur la formation d’
un
arabe, allaient reme j usqu’ à r
sous le prétexte qe ce pay
bre des leurs (ansäeh)bri tanniques ne
mettre de l’
huil
le malentendu d
les promesses
de 19 1 6 , qu’
n
1920 , le gêné
trônait Faysa
Les Anglais
testèrent
politique
le monde
et le nom
frère Abd
que le
vint ai
92 L’
I SLAM ET LES RACES
Ottomans cependant elles génèrent considérablement
les Germano—Turcs par leurs raids et leurs razzias .
A la conclusion de l’
armistice avec la Turqui e (octo
bre Faysal reçut au même titre que les Anglai s
et les Françai s une zone des territoires turcs occupésà administrer : ce furent les gouvernements de Damas
et d’
Alep, touj ours sous le haut commandement du
maréchal Allenby C ’ est de cette époque que
datent les prem i ères frictions entre Françai s et Chérifiens .
Les Arabes comptaien t sur la formation d’un Etat
arabe, allai ent même j usqu’ à revendiquer la Cilicie
sous le prétexte que ce pays comprenai t un grand nom
bre des leurs (ansarieh) Il est probable que les agents
bri tanniques ne se montrèrent pas touj ours disposés à
mettre de l’
huile dans les rouages ; touj ours est—il que
le malentendu devint tel entre les Chérifiens rappelant
les promesses fai tes et les Français forts des accords
de 19 16 , qu’une colonne fut j ugée indispensable . En
1920, le général Gouraud marchait sur Damas et dé
trônait Faysal , lequel venait de se fai re nommer roi .
Les Anglai s avaient laissé faire la colonne mais protestèrent contre l
’
expulsion de Faysal . Fidèles à leur
politique implacable de dresser le monde arabe contre
le monde touranien , lesBritanniques recueillirent Fay sal
et le nommèrent roi de Baghdad . En même temps sonfrère Abdullah recevait la Transjordanie . I l est certain
que le mouvement arabe si bien disposé pour nous de
vint ainsi francophobe .
Or si l’
on considère une carte du monde musulman ,i l est facile de constater que nous sommes dans l
’ axe
du monde arabe, et que le mouvement turc n’ est pour
nous qu ’un mouvement périphéri que . Entre l ’ amitié
(1 ) Sur le s Ansarieh v oir P . J . André, Les Ans ar ieh de C il ic ie,dans l
’
A s ie fra n ça ise , ju ille t -aoû t 1 921 .
LA QUEST ION ARABE 93
turque et l’
am i t 1 e arabe, il semblait préférable de choi
sir l ’ amitié arab e . L’
host ili t é chérifienne a eu commecontre—coup immédiat de fermer aux Musulmans fran
çai s le pèlerinage de La Mekke , car le roi Hussein a
naturellement pri s fai t et cause pour son fils . Cette
situation ne saurait se prolonger sans danger pour nous,
car le pèlerinage est indispensable aux Musulmans .
Les Britanniques ont cherché à pousser plus loin leur
politique d’
emprise ; il leur apparut désirable de re for
mer le khalifat arab e au détriment du khalifat otto
man institué par droit de conquê te . Mais ce n ’ est pas
chose facile : d’ après les principes islami ques, l
’ ijma
ou consentement universel est nécessai re pour la dési
gnat ion du khalife dans la f amille du Prophète en l’
ab
sence de tout facteur héréditai re . C ’ est pourquoi fut
essayée la réunion d ’un Congrès islamique à La Mekke
pour désigner le khalife arabe . Cette tentative a l ’ air
d ’ avoir échoué , car les Musulmans ne peuvent supporter
une immixtion étrangère dans les aff aires religieuses .
Il est à remarquer d ’ai lleurs que Moustafa Kémal n ’ a
pas mieux réussi dans sa réunion de Congrès islami que .
La situation est tell e : quoique déconsidéré , le sul
tan ottoman reste le khalife, parce que la Turquie est
le dernier grand Etat libre musulman . Sa déconsi
dérat ion se montre en ce sens qu ’ en Afghani stan
comme en Arabie , les princes tentent de rev iv ifier le
titre de Commandeur des Croyants . Gardons-nous d ’ agi rdans un sens ou dans un autre . Les Musulmans seuls
ont qualité pour désigner leur khali fe ; toute action de
notre part dresserait vraisemblablement contre nous
même nos ami s d’
Islam . Bornons-nous à constater l ’hos
t ilit é entre Turcs et Arabes , et l’ éveil des part icula
ri smes nationaux dans tout le monde musulman .
CHAPITRE V I
L’
ÉGYPTE ET LA TR IPOLITA INE
I . L’
ÉGY PTE .
L’
Egyp te pharaonique , romaine, byzantine, fut une
proie facil e pour l’
Islam . En 639 , un des lieutenantsdu khalife Omar
,Amrou ibn el A s, pénétra dans la vallée
du Nil . L ’
Egypt e était alors un pays mal administré,ravagé par les discussions religieuses , ruiné par les exac
tions des légats impériaux byzantins . Aussi , comme
en Syrie, la population accueillit favorablement lesenvahisseurs . La conquête fut rapide : les Arabes se
mirent immédiatement à l ’œuvre ; i ls apportaient en
effet avec eux une civilisation o riginale . La lettre par
laquelle Amrou fit hommage de sa conquête au khalife
est une pure m erv eille .La j ustice avec laquelle les Arabes
administrèrent le pays et le relevèrent de ses ruines
déterminèrent de nombreuses conversions à l’
Islam ,
rallièrent les Egyptiens à leur domination , tant et sibien que l
’
Egypt e prit le caractère complet d’un pays
arabe . La langue arab e devint sans heurts la langue
de tous elle-même s’
arab isa . ll est vrai
(1 ) Le s Copt e s chrét iens, de scendan t s des an cien s Egypt ie n s,on t con se rv é la lan gu e pharaoniqu e ju squ
’
au c omm en cem en t
du X IX° siècle ; ils la parlaien t enc ore en par t ie à l’
époqu e de
Bonapar t e c’
es t c e qu i a pe rm is à Cham po ll ion de déchiffrerle s hiéroglyphes en u t ilisan t leur v ocab u laire . Ac t u ellem en t le s
Copt e s parlen t arab e , leu r langu e propre n’
ay an t plus que le
cara c t ère de la langue sacrée . Dan s le m ouv em en t ac tu el les
Copt es chrét iens se son t unis aux Musulm ans, quo iqu’
av ec peu
d’
ardeur .
96 L’
ISLAM ET LES RACES
v erneurs, l m capacit é et la faiblesse des khalifes dans
leur capitale de Baghdad d ’ où ils assistaient impassibles
à la préparation des invasions turco—mongoles , empê
chérent la concentration des Musulmans contre les
Croisés . Cependant à part la prise de Damiette par
saint Louis en 1250, les Chrétiens ne purent cependant
pas grand’
chose contre l ’Egypt e .
En 1254 la dynastie mam eluk remplaça la dynastie
eyy oub i t e . Les sultans mam eluks rendirent un grand
service au monde occidental en écrasant à plusieurs
reprises les Mongols qui envahissaient l ’Afrique à son
tour . Sous les Mam eluks, l’
Egypt e reste une grande puis
sance commerciale mais au début du XV e siècle le
sultan Bours b eg interdit à ses suj ets le commerce des
produits de l ’ Inde Son but était de faire un monopole d ’ état afin de tirer de ce commerce de s bénéfices
plus considérables . Il tarit par cette imprudence la
source la plus claire de ses revenus . Les négociants
francs limitèrent en effet leurs achats au strict néces
saire . Ce fut le début de la décadence de l’
Egypt e comme
puissance de transit entre l ’Orient et l’
Occident . La
découverte de la route des Indes par le Cap de Bonne
Espérance fi t le reste . Sur le conseil des Vénitiens j alouxdes Portugais , les Mam eluks envoyèrent des flottes dans
l’
Océan Indien,mais furent battus .
Vaincus sur mer par les Portugais,les Mam eluks le
furent sur terre par les Turcs,héritiers de s Mongols .
Toman b ey fut écrasé par Sélim I e r qui en 15 12 fit de
l’
Egypt e une province ottomane . A cette époque comm ençèrent la désorganisation et l
’
appauv rissem ent de l ’E
gypt e les b eys et les fonctionnaires turcs ne cherchant
qu’
à faire rapidement fortune, laissaient les canaux
s’
ensab ler et le pays sans travaux publics . L ’
adminis
L’
ÉGYPTE ET LA TR IPOLITA IN E 97
trati on turque ne réussit pas à l’
Egypt e qui perdit en
peu de temps les résultats de la sage organi sation arabe .
En s’
emparant du Cai re Selim I er trouva à
la cour des Mam eluks le derni er descendant des Abbas
sides . En effet, lorsqu’
Oulagou Khan se fut emparé
de Baghdad et eut fai t étrangler le derni er Ab basside
régnant , un descendant de l’
avant—derni er souverai n
éta it all é chercher refuge au Cai re ;Sultan B eïb ars l’ avai t
accueilli et fait proclamer kh alife sous le nom d’
El Mos
tamsir . Se s successeurs , au nombre de seiz e, héritèrent
de ce titre illusoire e t restèrent sans in fluence en Egypte .
Sultan Sélim , réalisant la pensée de Tam erlan , s’ empara
du khalife qu ’ il emmena avec lui , et lui acheta son ti tre .
C ’ est ai nsi que le khalifat passa des Arabes aux Otto
mans . Les Turcs prirent par la force la qualité héré
di t ai re d’
im am réservée à la descendance du Prophète .
Malgré le transfert du dernier khalife , le Cai re, après
la conquête turque, resta le centre de l’
enseignement
théologique musulman avec la mosquée d’
Al Ahzar,tandi s qu e Constantinople prenait sa place et celle deBaghdad comme capital e
'
politi que de l ’ Islam
Depuis lors , l’histoire de l
’
Egypt e fut celle d’
une pro
vince turque . L ’ expédition de Bonaparte chassa un
instant les Ottomans de la vallée du Nil , mai s en 1801une armée anglai se restaura les Turcs . Les querelles
qui sui virent se terminèrent par l ’ arrivée au trône d’
un
Albanai s , Méhém et Ali Cet aventurier de génie , par
des guerres successives , voulut reformer un empire
d’
Orient puissant, soutenu par la France , et ce fut laun
(1 ) Il e st u t ile de rappeler la présence de Seb ast ian i à Constan t in ople en 1 805 , e t qu e l
’
in sistan c e des Anglai s à v ou lo ir
rest er en Egyp t e am ena la rupture qu i fu t le d éb u t de la for t un e
du Mam eluk alb anais Méhém e t Ali .
98 L’
I S LAM ET LES RACES
cé lèbre épisode de la Question d’
Orient . L’
Anglet e rre et
la Russie tenaient au maintien de la Turqui e la Francedut abandonner son protégé . Malgré les victoires de
son fi ls Ibrahim qui parvint devan t Constanti nople ,Méhém e t Ali d dut se contente r du khédivat d ’
Egypt e .
L’
Egypt e redevenait du moins un Etat .Le successeur de Méhém e t Ali , Ismai l pacha , fit appel
à la France et à l ’Anglet erre . L ’ on peut di re même que
la France avait une situation priv il égi ée en Egyp te,où se s éducat eurs , ses savants tenai ent la première place .
Mai s en 1882, l’
Anglet erre fut seule à fourni r au khédive
régnant l ’ appui de ses troupes contre des insurrecti ons
depui s , les soldats b ritanni qu es n’
ont plus quitté l’
E
gypt e peu à peu les Anglai s ont remplacé les Françai s ,si bien qu ’ en échange de la reconnai ssance de se s droits
sur le Maroc la France a dû admettre en fai t le
protectorat de l’
Angle t erre sur la vallée du Nil .
Depuis 19 14 , date à laquelle Abbas H ilmi resta à
Constantinople près des Turcs , il n’
y a plus de khédiv e
en Egypte , mai s un Sultan . Le Sul tanat d ’
Egy pt e fut
pro clamé pour rendre défini t ive la rup ture po li tique e t
dissoudre les li ens entre le khalif a t e t l ’Egypt e . Le sul
tan fut Hussein Kemal I“ ;le prince régnant actuel es t
Fouad l e r
Cependant il ne semble pas que les Anglai s aie nt
réu ss i à s ’ attache r les sympathi es égypti ennes . L’ accueil
ré servé par les Egypti ens aux Senoussistes pendant la
guerre mondial e, la néces si té pour les Anglai s de rem
placer le khédive , les émeutes d’
Alexandrie et du Cai re
sont autant d ’ indi cations contrai res . Il ne semble pas
non plus que les Egyptiens aient be aucoup pardonnéaux Britanniques les Labour Corps où des mill i ers
d’
Egypt iens ont travai llé sous le fouet pen dant la guerre .
En outre le président Wilson en écrivant les q uato rze
98 L’
I SLAM ET LES RACES
cé lèbre épisode de la Question d’
Orient . L’
Anglete rre et
la Russie tenaient au maintien de la Turquie la Francedut ab andonner son protégé . Malgré les vi ctoires de
son fils Ibrahim qui parv int devant Constantinople,Méhéme t Alid dut se contenter du khédivat d
’
Egypt e .
L’
Egypt e redevenait du moins un Etat .Le successeur de Méhém et Ali , Ismai l pacha , fit appel
à la France et à l ’Anglet erre . L ’ on peut dire même que
la France avait une situation privilégi ée en Egypte,où ses éducateurs , ses savants tenai ent la première place .
Mais en 1882, l’
Anglet erre fut seule à fourni r au khédive
régnant l ’ appui de ses troupes contre des insurrecti ons
depuis , les soldats britanniques n’
ont plus quitté l’
E
gyp t e peu à peu les Anglais ont remplacé les Français ,si bien qu ’ en échange de la reconnai ssance de se s droits
sur le Maro c la France a dû admettre en fait le
protectorat de l ’Anglet erre sur la vallée du Nil .
Depuis 19 14 , date à laquell e Abbas Hilmi resta à
Constantinople près des Turcs , il n’y a plus de khédiv e
en Egypte , mais un Sultan . Le Sultanat d ’
Egy pt e fut
pro clamé pour rendre défini t ive la rup ture po litique et
dis soudre le s li ens e ntre le khal ifa t e t l’
Egypt e . Le 1 e r sul
tan fut Hussein Kemal I er ;le prince régnant actuel est
Fouad I e r
Cependant il ne semble pas que les Anglai s a ient
réussi à s ’ attacher les sym pathies égyptiennes . L’ accueil
ré servé pa r les Egyptiens aux Senoussist es pendant laguerre mondiale, la nécessi té pour les Anglai s de rem
placer le khédive, les émeutes d’
Alexandrie et du Caire
sont autant d ’ indications contraires . Il ne semble pas
non plus que les Egyptiens aient b e aucoup pardonnéaux Britanniques les Labour Corps où des milliers
d’
Egypt iens ont travaillé sous le fouet pe nd ant la guerre .
En outre le président Wilson en écrivant les q uatorze
L’
ÉGYPTE ET LA TR IPOL ITA INE 99
points de'
son proj et de pai x n ’ avait sans doute pas
prévu quelle arme il donnait au monde musulm an , et
les plénipotentiaires alliés n ’ avai ent sans doute pas
prévu en les acceptant,quelles conséquences allaient
découler de cette utopie généreuse évidemment, mai s
peu en harmonie avec les réalités présentes . Le progrès
doit découler d’
une évolution , et dans le monde colonial
doit être la résultante d ’un bienfait du gouvernement
mais non pas un apport de l ’ extéri eur .
Quoi qu’
il en soit, le nouveau khédive d’
Egypt e , ap
puye par tout son peuple,sut faire comprendre au gou
v ernem en t b ri t ann1que que le pays réclamait son au
t onom ie . Le maréchal Allenby, commandant les forces
alliées en Sy rie-Cillcie£rentra au Caire en 1 9 19 , a lasuite de l
’
accord franco-anglais au suj et du Levant, et
remplaça sir ReginaldWingate comme Haut-Commissai reen Egypte . Une commission spéciale fut envoyée d ’
An
glet erre sous la présidence de lord Milner (19 1 9—20)pour étudier les moyens de faire concorder les aspira
tions locales avec les besoins du Royaume-Uni . Cettecommi ssion termina ses travaux (août 1920) sans grandsuccès . Mais quand bien même une entente serait ac
t ue llem en t réalisée, i l n’ en reste pas moins vrai que la
suprématie anglo-saxonne a ét é touchée . I l est prob able
que les Egyptiens sont encouragés par les Allemandset les nationalistes turcs . I l est à noter également que
Fouad I°r est offici er italien et fut candidat au trône
d’
Alb anie pour le compte de l’
It ali e ; même li vrés à eux
seuls , i l est hors de doute que l’ autonomie locale sera de
plus en plus réclamée par les Musulmans lo caux et qu’
ils
obtiendront leur self government L’
emprisonnem ent
du leader égyptien Zaghloul pacha et les démonst ra
tions qui suivirent ont montré que tout le peuple égyp
1 00 L’
I SLAM ET LES RACES
tien s ’ est rangé derri è re ses chefs . Les Anglais se main
tiennent par la force,mais en terre d
’
Islam la force est
bien, a condition de n
’ être qu’
une sanction . La force ne
doit pas empêcher la po litique d’
entente . Comment les
Anglais sortiront-ils de cette situation dangereuse , sur
tout maintenant que les prétendues victoires de Mous
tafa Kém al ont redonné confiance à l’
Islam Beaucoup
de sang sans doute coulera avant que la question égy ptienne ne soit réglée . Nous avons tout intérêt à ce
qu ’ elle le soit rapidement, car notre monde musulman
suit d ’un œil attentif ce qui se passe dans le Proche
Orient .
Cependant la politique avisée du maréchal Allenby
semble avoir rétabli provisoirement la paix : le m aré
chal a pu faire reconnaître par le Gouvernement de
Londres la constitution en Egypte d ’une sorte d’
E t at
indépendant,Etat dont les Britanniques gardent le
contrôle au point de vue militaire et économique . La
politique implacable de l’
Angle t erre dans le Pro che
Orient s ’explique facilement : le sol de l’
Angle t erre ne
produit pas suffisamment pour nourrir les Anglai s ;pour ce s derniers la route des Indes représente l a
route du b oulanger quiconque se dressera sur cette
route devra être écarté . S i l ’on veut bien se rappeler
ce concept,ou s
’
expliquera facilement les apparentes
contradictions de l a politique anglaise en Orient et
leurs conséquences .
I I . LA TR IPOLITA INE
Les Italiens sont débarqués à Tripoli en automne 19 1 1
(1 ) Je r em erc ie le Colon e l Brém ond d’
av oir b ien v ou lu m e
c on fi e r s e s n o t e s sur la Tripolit a in e e t t ien s à r endre homm ageà c e par fait c onna isseur de s cho se s m usulm ane s .
102 L’
ISLAM ET LES RA CES
On se trouve à présen t dans la situation suivante
En Cy rénaïque le souverain e st Seyyid Idris,grand
cheikh des Senoussia,qui va à Rome fréquemment.
En Tripoli t aine , les Musulmans arabes ont détruit
les Berbères ibadites du Dj ebel Ne fouça ,qui s ’ étaient
alliés aux Italiens : les Ital iens n’
ont a peu près ri en
fait pour les en empêcher .
Il s ’est réuni à Garian un congrès arabe (les Berbères
en sont exclus,c ’est—à-dire la maj orité de la population)
qui a eu une attitude peu amicale pour les Italiens .
Ceux—ci n’
oc cùpent que Tripoli , avec Tadjourah e t
Aïn Zabra comme avancées,Homs et Misrat a
,lequ el
vient d ’être réoccupé . La garnison de Garian a été ri se
(150 hommes) et vient d’
être rendue moins 12 officiers
gardés comme otages .
L’
It alie semble vouloir reveni r ces temps- ci à la m a
nière forte,et a fait réoccuper Mi srat a-Marine .
L’
It ali e n e veut pas faire la conquête de la LYb I Û ,
trop pauvre . Elle laisse toute lib erté aux chefs indigènes,
avec le droit de se servir du drapeau itali en,bien qu
’elle
n ’ait aucun moyen de contrôle ou d ’action ; ce q ui
amènera de s difficultés évi dentes avec le s Françai s de
Tunisie ou du Tchad et le s Anglais d ’
Egy pt e .
Elle se propose par cet acte de lib éralisme,qui mar
que son impuissance , d’
attirer à elle toute l ’opinion
musulmane .
Le député G . Sanarelli (I llustrazione Colon iale , août1919) écrit
L’
orgue il de race des Anglais et des rançais ne
leur permettra j amai s de concevoir quelque chose de
semblable à la tutelle de la liberté arab e que nous avons
promise en 19 1 1 et qu ’auj ourd ’hui fi nalemen t nous
avons commencé à réaliser (après 8 ans
L’
ÉGYPTE ET LA TRIPOL I TA INE 103
Ce qui devra unir les deux nations italienne et arabe,c e
sera le programme politique vraiment islamique de l alutte contre le désert au moyen de grands travaux hydrauliques consistant à dériver vers le Nord par un
nouveau Nil,l ’eau des lacs équatoriaux
L’
It alie espère des compensations orientales ; s o n
rêve est de se faire la servante du panislamisme e t d’
e n
tirer sans frais les profits .
La France a montré dans l’
Afrique du Nord la vraie
politique à suivre . Elle s ’est laissée entraîner en Orientpar l ’exemple de l ’ It al ie . Lionello de Benedetti a ré
pondu à ces rêves illogiques : Comment les indigènes
peuvent—ils croire que nous soyons les défenseurs qua
lifiés des droits des Musulmans dans le monde des na
tions,alors que nous n
’
arr ivons pas seulem en t à nous
fa ire respecter d’
eux—m êm es dans notre propre colon ie,
dans un terri to ire soum is à la souvera ineté i talienne
(Lo Statuto dell a Tripolitania e della Cirenaica) .Le danger des rêveries ital iennes
,c ’est qu
’elles sont
basées sur la fin de s colonies européennes en pays m u
sulman à bref délai . Au premier soulèvement,d ’ailleurs
,
tout l eur château de cartes s’
écroulera,puisqu
’ ils sont
hors o.
’
ét at,de propos délib éré
,de se d éfendre . C ’est l e
retour pur et simple à la situation des puissances chrétiennes vis-à-vis des pirates barbaresques ou ottom ans
avant 1815 on sait ce qu’elle a été . L
’
It alie elle-mêmes’
en rend compte et maintenant que sa désorganisationsociale s
’
at t énue,ell e recommence à sentir la nécessit é
de faire senti r sa volonté en Tripolit aine : ce qu’elle y
a fait de 1 9 15 à 1 921 est un simple défi au bon sens,
et ell e y a gaspill é en utopies des sommes plus élevées
(1 ) Un e M iss ion en Tr ipoli ta ine, par Cam ille Fidel .
1 04 L’
I SLAM ET LES RACES
que celles qui auraient été nécessaires pour obtenir un
résultat sérieux
Actuellement,l’
Agence Reuter publieMalte
,22 mai 1922 .
Les Italiens ont déclanché en Tripolit aine une grande
offensive contre les Arabes rebelles . Les forces italiennes
sont composées principalement,semble—t — il
,de levées
locales,d
’
Ery thréens , renforcés par quelques régiments
italiens . Le s opérations sont sous la direction du général
Badoglio . Les Italiens emploient de nombreux avions
de bombardement et infligent par ce moyen de lourdespertes à l ’ennemi .
Tôt ou tard,une réaction semblable devra se faire
en Orient,e t il faut rendre ce tte j ustice à la politique
anglai se qu’
elle aura été la seul e à ne j amais se laisser
leurrer par d ’autres espoirs .
(1 ) Il e st à n o t er qu e le che ikh Idriss, grand che f apparen t
de s Sen ou ssis , su it t ou j our s le s dire c t iv e s du Gran d Sen o ussipar ti en Turqu ie pendan t la gu erre m ondiale e t ac t u ell em en t en
lia ison dire c t e av e c Moust a fa Kem al e t Env er pa cha .
1 06 L’
ISLAM ET LES RACES
Afriky a ou Ifriky a , les territo i res dépendants d e l’
an
cienne Africa . L’
l frikya des auteurs musulmans com
prend d’ après les dénom inations actuelles , les ré
gences de Tripoli et de Tunis , la partie orientale de
l’
Al gérie j usqu’ à Miliana , l
’
Egypt e dont l’histoire est
unie à celle de l’
Asie Mineure , restant à part . Le Maroc
actuel,ou Maghreb el Aqca , c
’
est-à-dire le Couchant le
plus éloigné, ne fut j amais soumis par les Arab es et
resta la forteresse de la race berbère .
LA NATI ON BERBÈRE AV ANT LÎ SLAM I SM E .
1 0 E thnographie et religion . Quelle est cette race
b erbère dont le renom d’
indépendance, de fierté, d’
oe i
niât ret é, s’ est conservé j usqu ’ à nos j ours Quelle est
cette nation dont l ’histoire , d’
après Ibn el Khaldoun,
est celle de l ’Afrique du Nord , cette race qui , sur les
pentes de l’
A t las marocain , s’
oppose encore à l’
avancée
de nos soldats
On ignore trop souvent dans le public quels sont les
groupements ethniques qui se sont fondus dans le creuset
de l’
A frique du Nord .Pour ceux qu i ne se sont pas livrés'
un peu à l’
étude desMusulmans d’
Af ri que , Turcs , Arabes,Berbères , Maures , sont des désignations sans valeur pro
pre , alors qu’ au contraire ces dénominations recouvrent
des types , dés peuples bien différents . En dehors deconquérants musulmans arabes , turcs , bien d
’ autr es
envahi sseurs les ont précédés , les ont accompagnés, les
ont suivis dans le bassin méditerranéen . Passant rapi
dement comme un flot destructeur, ou s’
inst allant dans
les régions conquises , ces peuples o nt laissé des traces
en Afrique du Nord .
L ’AFR IQUE DU NORD ET L’
I SLAM 107
S Il existe une région dans laquelle les mouvementsmigrateurs ont agi sur l
’
ethnographi e locale, c’ est sans
nul doute en Ifriky a, au Maroc , où se rencontre une
mosaïque de types ethni ques , résultant de la juxt aposi
tion e t du contact des races .Jusqu ’ à nos j ours , on a basé l
’
étude de l ’ e thnographi e
sur les div ersificat ions des types physiques , crânes plus
ou moins allongés , arrondis , poils , cheveux de diffé
rente couleur, pigmentation , structure et autres ca
ract ères purement matéri els . Ces bases étaient sans
nul doute suffisantes à la limite de la préhistoire et de
l ’hi stoire , lorsque les ty pes ne s’
étai ent pas encore m e
langés, lorsque les cerveaux de l’
humani té apprenaient
encore à penser, bégayaient en des embryons de phrases
des embryons d’
i dées . Mais à l’
heure actuelle, il serait
peut être nécessai re d’ appliquer une autre classification ,
tenant compte du m oral,du mental pour la création d’
un
nouveau type ethnique . En effet les idées, les mœurs,les
coutumes, la langue, la religi on , m odifient lentement,mai s inéluctablement, un type déterm iné , lo rsqu
’
il se
trouve en contact avec un autre type plus avancé que
lui en civili sation .
C’
est ainsi que l’
e thnographie de l’
Afrique du Nord
a é té modifiée par un élément extérieur, par la religio n ,l’
islamisme . Jusqu’ à l ’ expansion du musulmani sm e dans
le bassin occidental de la Méditerranée, les invasions
successives des armées venues d’
It alie ou d’
Asie , le s
hordes venues d’
Espagne , de l’
Europe nordi que , avai ent
conqui s le Maroc, l’
Ifriky a , mai s n’
avaient eu qu’
une
influence relat ive sur les races aborigènes . Au con traire
l’
Islam”ni veleur, égalitai re, après s
’ être imposé par l a
force des armes avec son code religieux, politique, so
cial , a pénétré peu à peu les populations , les a modi
108 L’
I SLAM ET LES RACES
fiée s plus ou moins sensiblement dans leurs habitudes ,leurs coutumes , l eurs mœurs . La communauté de reli
gion , de convictions profondes ou superficielles , a per
mis aux Sémites , Arabes et Syriaques , de se mêler plus
facilement aux Berbères , aux Romano—Berbères de l’
Afri
que du Nord . L’
Islam a fondu ainsi dans un même
creuset tous les restes des migrations passées , a réussi ,mieux que le christianisme , à la formation d
’ un type
nouveau qui , s’ il ne présente pas un type réellement
ethnographique, est néanmoins nettement caractérisé
le Musulman de l ’Afriqu e du Nord .
Comment s ’ est faite la création de ce nouveau type
La désignation de l ’ Ifriky a par les auteurs musulmans
nous donne la marche à suivre pour l’
étude hi storique
de ces régions . Nous devrons étudier l’
Egypt e séparé
ment, puis l’
l friky a avec la Tripoli t aine disputée entre
elle et l’
Egypt e , le Maroc dans ses luttes avec l’
Ifriky a ,
le Maroc auquel par suite d’une série de circonstances
politiques , doit se rattacher l ’Espagne .
20 Les or ig in es de la race berb ère . L’
Ifriky a et le Ma
roc, qui dans l’
Ouest continuent l’
Egypt e et la Tripoli
taine, sont les fiefs de la race berbère . Il est diffi cile de
connaître les origines de la race berbère . Qu ’ elle ait été
formée de deux groupes humains , l’un venu du Sahara
vers le nord , l’ autre de L‘Eur ope méridionale vers l e
sud qu ’ elle ait été modifiée sur les pent esse pt en
t rionales de l’
At las par un apport de blonds partis du
nord de l ’Europe , par des Ibères , il n’ en reste pas moins
(1 ) V . Tisso t , Gé0 graphie compa rée de la prov ince roma ine
d’
Afr ique , 1 888, t . I , p . 402 .
1 10 L’
I SLAM ET LES RACES
les peuples de leur race . Sédentaires , semi —nomadesou nomades , célèbres dans l
’
antiquité par leur aptitude
au commerce et leur esprit de négoce , ils se divisai ent
en tribus dont les rivalités j oi ntes à celles des clans
(co i s) , aux ambiti ons particuli ères des chefs locaux ,
empêchèrent de tous temps l ’ établissemen t d ’une gran
de nationalité indigène (1 )En e ffe t , les Berbères , monogames , ont le sentiment
de l’
individuali sme poussé au plus haut degré . S ’
ils
acceptent, pour la court e durée d’
expédit ions de guerre
ou de pillage, l’ autorité précaire autant que tempo
raire de chefs désignés par le choix (amrars) , il s rev ien
nent bien vite à leur état anarchique de trib us , de clans ,de familles , divisés à l
’ infini , très fermés , j aloux les uns
des autres , soumis quand il leur plaît à l’unique direc
tion d’
assemb lées bruyantes , appelées dj em aas .
L etat social anarchique des Berbères a causé le succès
des conquérants qui se succédèrent en Afri que du Nord ,Carthaginois , Romains , Byzantins , Vandales , Goths,Musulmans . Cependant le particularisme, le caractère
de la race sont tels que j amais les Berbères n’ ont été
réellement entamés par les envahisseurs . Devant ces
derniers , ils refluaient dans les montagnes diffi cilement
accessibles , se reformaient derrière l ’assai llant par un
retour offensif, maintenant leur indépendance par un
mouvement perpétuel de flux et de reflux . C ’ est p our
quoi , s’ il s ’ es t créé sous la domination latine un type
romano—berbère c ’ est moins par méti ssage que par
(1 ) V . Poin sard, op c it . , t . 1, Las Ber bères .
(2) V . Le S t A ugus t in d e M. Lo uis Ber t rand (Fay ard ,
po ur un e b e lle r e co n st it u t ion de la v ie so ciale rom ano -b erb ère .
J . Campardou e t P.-J . André, Notes his tor iques sur Taza , dans
le Bulle t in de l’
Afr ique frança ise , sept em b re 1 91 5 .
L ’AFR IQUE DU NORD ET L’
I SLAM 1 1 1
une influence de l’
esprit latin chrétien sur le Be rbère ,prenant dans la civili sation offerte ce qui lui semblait
convenir à ses goûts . Il n’
est pas b esoin que les sangs
soient mélangés pour que l’ influence d ’une race sur
une autre se mani feste l’
esprit d ’une civili sati on influe
sur la race la moins civi lisée . C’
est en ce sens qu’
exi sta
une modification du Berbère autochtone par la ci v ili
s ation romai ne . Massinissa déj à avai t rendu sédentairesses nomades d
’
ailleurs en dehors de son influence mo
ral e , Rome envoya des colons . On a évalué arbitrairement l a population romaine pure en Afrique à 4 mi l
lions d’
âm es au moment de l’ invasion vandale . Il est
à noter qu’
act u ellem ent les Européens du Nord: Afri quefrançais sont plus d
’
un million en face de 9 millions
d”indigè nes et forment ainsi en moins d
’un siècle le
dixi ème de la population . Le Berbère , cependant,conserva sa manière de vivre, ses mœurs , ses coutumes
sous la domination romaine, et réagit contre elle dès
qu ’ il lui fut possible de le faire .
40 Les B erbères et le chr istian ism e La preuve en
fut donnée lorsque l’
autorité des Césars commença à
décroître aux derniers siècles de l ’ empire . Le s Berbère s
s ’ étaient convertis au christ ianism e ,m ais leur obéissance'
aux dogmes ne fut j amais par faite . Ils embrassèrent
surtout les doctrines hérétiques du donatisme (1 ) et de
(1 ) D ona t isme ,du n om de l é v êq ue de Car t ha ge Dona t 80 11
hérésie s’
ab a t t i t presqu e ex c lusiv eme n t sur l’
église d’
Afr iqu e e t
fu t c on dam n ée a u c on c ile d’
Hippon e . Elle fu t c om b a t t u e par S t
Au gu st in , e n 400 . Le s Don a t is t e s se fa isa ien t de l’
Eglise une n o
t ion e x clu siv em e n t sub j e c t iv e . L’
Eglise n’
a d’
ex is t e n c e rée lle qu e
dan s l’
âm e d e s Just e s . L’
e ffic a ci t é de s sacrem en t s dépen d des dis
posi t ion s d e c e lu i qu i le s donn e . Tou t péche ur n e fai t pa s par t ie del’
Eglise . Le s Don a t ist e s form èren t d e s b ande s fana t iqu e s (Circo nee llion s ) qu i m iren t la prov in ce d e Car t hage à fe u e t à sange t furen t réprim és av e c la dern i ère rigu eu r (Edit s de 414-428)
1 12 L’
ISLAM ET LES RACES
l’
arianism e c etait un moyen d ’ affirmer leur parti
cularism e , leur désir d’ autonomie , d
’ indépendance , par
opposition aux enseignements officiels des gouvernants .
Il serait intéressant de vérifier si le concile d ’
Hippone
(330 ap . J —C. ) n'
a pas conservé les noms des 70 évêques
chrétiens d ’
Afrique du Nord pour savoir si en partie
leurs évêchés ne coïncideraient pas avec des dj em aas
berbères Des chrétiens indigènes résidèrent à Tunis
jusqu’
â l epoque de Charles—Quint . Un évêque chré t ien
(1 ) Ar ia n ism e . Du n om de l é v êqu e Ariu sf On lsav a i t pa r lesliv re s sac rés, par l
’
his t o ire , que Jésu s-Chris t 1 0 e s t homm e ;2° e s t fils de D ieu . Beau c oup d
’
hérésie s son t n ée s au déb u t du
Chris t ian ism e , de la t en t a t iv e de c on c ilier , d’
expliqu er c e t t e an t in om ie e t de form u ler le do gm e .
1 ° Le s Pho t in iens disaie n t Jésu s e s t n é homm e , m a is e n su i t eD ieu l
’
a adop t é e t ain si i l e s t de v en u Chris t e t F ils de D ieu . »
D’
où a t t aqu e s v iv e s de s Père s . Alors le s Arien s e ssay èren t deprendre u n e n ou v e lle e t m e illeure po si t ion .
2° Le s Ar ien s c on cèden t qu e le Fils de D ieu a ex is t é av an t
l’
in c arn a t ion , m ais seu lem en t c omm e un e créa ture prem ière e t
supérieure e t par qu i d’
a ille urs t ou t le re s t e eu t ét é c réé
(Théo logie dogm a t iqu e de Christ ian Pe sch . 8 . J . D e ver boinca rna to D e personae div ina e e t na tu ra e humana e in Chr istoun ione . )3° Con t r e le s Arien s , le s polém iqu e s de S t Athan ase , de S t Ba
sile , de S t Grégoir e de Na z ian z e am èn en t la form u le o r t hodox e
Un ion de s de ua: na tu res , div in e e t hum ain e , m a is e n une se ule
person ne div in e , la 2° pe rsonn e de la Sain t e Trini t é .
(2) Le s re s t e s du chris t ian ism e sub sis t ère n t dan s le s m on t a
gn e s de l’
A t las ju squ’
au règn e d’
ldriss (v ers 804 ap . J .-C. ) e t
m êm e au de là . Ib n e l Khaldoun parle de s Chré t iens b e rb ère s,m a is nous n
’
av on s pas de donn ée s précise s (V . No tes his tor iquess ur Ta za , Afr ique fra n ça ise , sep t em b reAu m om e n t où le s Fa t im ide s fonden t le Ca ire , il ex ist ai t en
Ifriqy a c inq év êqu e s en fon c t ion s . El Calaa ét ai t peuplée dechrét ien s Berb ère s . Au X i e siècle les Hamm adi t e s en t rèren t en
re la t ion s av e c le Sa in t —Siège pour a t t irer che z eux le s comm e r
can t s chrét ie ns .
Somm e t ou t e le s m auv aise s re la t ion s de la Berb érie av ec lachrét ien t é sem b le n t da t er de s a t t aqu e s por t ugaise s e t e spagn olese t de l
’
arr iv ée de s Turc s en Afriqu e .
1 1 4 L’
I SLA M ET LES RACES
villes de la Tunisie actuelle, mai s il s furent rapidement
absorbés dans cette contrée par les mas ses qui les en
t ouraient .
Tout autres furent les Byzantins . C’
est un e curieuse
histo ire que celle de cette ville où se réfugi èrent les
derniers re stes de l’auto rité de s empereurs latins . Lors
que Rome fut tombée sous les coups des Barbares, la
ville où s ’ était consacré le double de la divinité césa
rienne, la Rome orientale , la fastueuse Byzanceresta l ’unique héritière de la domination impériale .
Placée comme un brise- lames en face de la marée
asiatique, elle résista tour à tour à tous le s remous , a
tous le s flux , à tous les reflux , à tous les flots mon
tants partis de l’
Asie centrale, tenta même de main
tenir les droits de la Rome antique sur le bassin medit e rranéen . La tradition impériale explique les tenta
tives fai t es par les Byzantins pour reconquér ir le do
maine afri cai n des Césars . Mai s cet essai louable de
résurrection de l’ impéri ali sme latin ne réussit qu ’à main
tenir des gouverneurs , des soldats un peu plus long
temps dans les places fortes de l’
Afrique du No rd .
Lorsque les Arabes , après s’
être heurtés au nord à l’
im
prenable Byzance, détournèrent leur flot envahi sseur
ve rs l ’Ouest , ils n’ eurent aucune pe ine â chasser d
’
Afri
que les faibles force s des comtes byzantins qui n’
avaient
eu ni le temps, ni l’ autorité nécessaires pour affermir
leurs relations avec les Berbè res .
En résumé, la nati on berbère reçu t de Rome la civilisation chrétienne qu i ne put se maintenir, se deve
lopper en Afrique du Nord par suite de la dég énères
cenc e de l ’ emp ire romai n , de l’
aflaib li ssem ent du pou
(1 ) Ku r t’
n , H is to ire de la Civ il isat io n , Byzance .
L ’AFR IQUE DU NOR D E T L’
I SLAM 1 15
v oir ce ntral, des schismes du chr istiani sme . E nfin la
ruée des Barbares , qui dét ruisit le cerveau directeur,favorisa le réveil de l
’
indépendance des Berbères ; ce s
de rni ers rev inrent â leurs anciennes croyances qu’ ils n ’
a
v ai ent pas eu le temps ni le voul oi r d’ oublier p endan t
le court règne du christianisme . Ils retr ouvèrent na
pi dem ent leur état anarchique antéri eur, sans être
c apables de créer une grande nationali té indigène . Mais
d e cet te époque troublée de c es invasions, de ces
guerres se succédant sans répit , da te la ruine , le dé
peuplement de cette province rom aine j adis si
pro spère, état lamentable dans lequel elle est rest ée
ju squ’ à nos jo urs .
LA CONQUÊTE MUSULMANE V ER S L ’ OUEST .
1 0 La conquête ara be en I fr ikya Au moment où
le s Arabes envahissaient la Cy réna1que , la Tripolit aine
e t att eignai ent la Tunisie actuelle, les Byzantins avaient
ramené leurs garnisons dans les villes de la côte, les
Berbères étaient divisés en états indigènes ayant cha
cun leur organisation propre . Le christ ianism e ,qui avait
domin é à la fin de l’ occupation latine , se perdait dans
les discussions stériles de l’
arianism e et du donatisme
Le premie r rai d arabe dans le sud de l’
Ifriky a eut
lieu en 647 ap . J .-C . (25 de l
’
Hégire ) . La conquête de
Il e s t à rem arquer q ue l’
arian ism e fu t alo rs la form e d om i
.n an t e du chris t ian ism e . C’
e s t Clov is, le j er e n Gaul e , qui s e fi t
chrét ien rom ain pour se c on ci lier les év êqu e s . Burgondes , Go ths,V and ales, Lom b ards, Berb èr e s, ét ai ent ar iens . C
’
e st c e q ui e x
pliqu e le su cc ès de l ’ Islam qu i , re connaissan t Jésu s c omm e un
proph è t e , n’
appor t ai t av ec Mahom e t qu’
un pr 0phè t e de plu s,un e r eligion sim pl ist e e t un m oyen de la t t e c on t re les dom in a t eurs .
1 l6 L’
I SLAM ET LES RACES
709 à 713 n ’ eut rien de désordonné comme l m v asion
qui suivit au x re siècle . Elle fut eff ectuée par de v éri
tables armées bien organisées , bien commandées , en
v oy ées par les khalifes , souverains alors incontestés
de l ’ Islam . En 669 , Abdallah parcourt l’
Est de l’
Ifriky a,
fonde Kairouan . Sous des généraux tel s que Sidi Okbaben Nafi, célébré encore auj ourd
’hui dans les légendes
algériennes et marocaines , Moussa b en Nou‘
ir ou Nou
sai r, les troupes des khalifes refoulèrent les autochtones
dans la montagne , détruisirent sans peine les faibles
forces des comtes byzantins . Les Berbères , sous le com
mandement de Koce ila , chef de la tribu des Aoureb a,furent défaits , et se convertirent à l
’
Islam , obligés par
le glaive de se soumettre à la loi du Prophète de La
Mekke . En 705 , Hassan , gouverneur de l’
Egypt e , con
quier t définitivement la B erb érie , prend Carthage dont
la chute marque la disparition de la domination b y zan
tine en Afrique du Nord . Les Berbères luttèrent encore
quelque temps , notamment dans l’
Aurè s sous le com
mandement de leur reine restée fameuse, la Kahenah ,
mais ce fut sans succès .
2° Con tinuation de la conquête d’
Espagne . Enl’
an 665 , Abdallah , poussant son cheval dans l’
At lan
tique, s’
était écrié : Tu le vois , 6 Dieu , la mer seule
m’
arrête En 706 , Moussa prit Tanger . Pour renforcer ces contingents , le général profita de l
’
e3pri t
guerrier des indigènes , de leur amour du butin , pourenrôler les Berbères marocains sous les ordres d ’un
nommé Tarik . La trahison du comte Julien à Ceuta
(1 ) V . Ro is ca tho liques , d’
Isa belle ! re à Philippe I I . Par is ,Grassar t , 1895 , p . 1 4 .
1 18 L’
I S LAM ET LES RACES
v asion arab e, afi aib li t les forces musulmanes en les
détournant de la conquête par la nécessité de soumet tre
le s révoltés et sauva sans. doute l’
empire des Francs
contre lesquels les khalifes ne purent envoyer des
renforts , des généraux , pour venger l’
échec de Poitiers .
Les Arabes n’
insist ai ent j amais sur un premier re
vers, ne s
’
acharnaient pas s’
ils voyaient le succès im
mé diat impossible , revenaient en arrière pour repartir
plus forts et rompre la résistance sous le nombre e t la
valeur . La tactique hab ituelle ne put être employée
en Gaule par suite de la révolte berbère ; cependant
pendan t de l o ngues années , les Sarrasins se m ain
tinrent dans le m idi de la France actuelle , remontèrent
la vallée du Rhône j usqu’ au département de l
’
A in (1 )d ’ auj ourd ’hui , livrèrent aux chevali ers chré ti ens des
combats sans nombre dont les récits emplissent le s lê
gendes, les chansons de geste des temps moyenâgeux .
Ayant échoué par la tr ouée de Poitiers,les Musul
mans de la Sept imahie remontèrent la vallée de la Saôneon les vit a Dij on et a Lyon qui fut pris e t brûlé .
Charles—Mar tel reprit Avignon , rempo rta une victo ire
sur la Berre,mais échoua devant Narbonne (735 Les
Arabes reconquirent Arl es en 737 et oc enpèrent la Pro
vence . Charles—Martel et le ro i de s Lomb ards,Lu i tprand ,
l es b attirent en 739 . Mais le royaume de Fraxine t,près
Saint-Tropez,se mai
‘
ntint indépendant ; en 942 ces
Musulmans s ’emparaient encore de Fréj us et de Te ulon
(1 ) Pon t -de—Vau x a c omm e arm e s u n c roi ssan t d’
arge n t sur
fond d’
a zur . Fau t il v o ir dan s c e fai t un e in flu en c e sarrasin eAprès Po i t ie rs , de s Mu su lm an s se fix è ren t au ssi , paraît
—il, dan s la
région de Chât eauro ux . Ils se c on v er t ire n t plu s t ard au ca tholi
c i sm e e t fondèren t l ’ab b ay e de Deals . Dan s le pay s le s ha b i t an t sde ce t t e sor t e so n t e n c ore con sidérés c omm e de sc endan t s de s
Arab e s e t appelés Tu rqa in s
L ’AFR IQUE DU NORD ET L’
i SLAM 1 19
e t pénétraient j usqu’en Suisse où arrivaient les Hon
grois par l’
Est .
A l ’ orient de l’
Europe , Byzance avai t arrêté la ruée
arabe , avait forcé l’
Islam à trouver une autre route
pour so n expansion à travers le monde . Les Musulmans
avaient alo rs reflué en Afrique, avaient atteint de nou
ve au l’
Europe à l’
Occident par un chemin détourné
le l ong de la Médite rranée . Mais leur passage à travers
des peuplades belliqueuses afi’
aib lirent l eur puissance
guerrière , les livrèrent loin de leur base, diminués , et gênés
déj à par leurs conquêtes m êm e s,à l
’ effort d ’un peuple na is
sant , plein de valeur et de loi dans sa destinée . Mais
qu e se serait-il passé si la vague islamique ne s’
était
pas heurtée de 673 à 7 17 à la digue byzantine si
l’
env e loppem ent dé l ’Europe tenté par l’
Est et pa r
l’
Ouest avait réussi La Germanie qui eu t tant de mal
à se débarrasser de l ’ in fluence byzantine conquise,
aurai t eu encore plus de mal à se lib érer de l’
emprise
musulmane . L ’histoire du monde était changée . Les
Byzantins , les Francs de Charles-Martel ont donc un
rôle égal dans l’
endiguem en t de la grande poussée islamique . Les uns et les autres ont permis à la civilisation
chrétienne , moderne, de devenir ce qu’ elle est dev enue .
LUTTES POUR L’
INDÉPENDANCE BERBÈRE .
1 0 Le prétexte religieux .— L elan arabe une fois rompu
p ar suite de l’
arrêt général de l ’ expansion en Occident et
e n Orient, les Musulmans manquèrent du souffle nécessaire pour reprendre la conquête de nouveaux pays .
(1 ) Le s Turcs prir en t b ien By zan c e , m ais à c e t t e ép oqu e l’
un i t é
islam i qu e é t ait rom pu e .
(2) V . Ku r th, H is to ire de la Civ ilisa t ion . Byzanc e . Les Germa ins .
120 L’
ISLAM ET LES RACES
Guerriers,nomades par nature , pas assez nombreux
pour organiser,adminis trer les régions soumises , ils
ne purent longtemps mainteni r leur domination sur
des populations aussi particularistes que celles de l’
Afri
que du Nord . Les Berbères se laissèrent un instant en
traîner à la suite des Arabes par l’
amour du pillage e t
du butin , mais , même convertis à l’
Islam , revinrent
bien vite à leur chère indépendance .
Comme dans tout le monde musulman , l m fluence
d ’une race va s ’ imposer à l’
islamisme , l’
ent raîner dans
son évolution particulière . Dès que les Berbères com
m encèrent à réagir contre le pouvoir central des kha
lifes , l’histoire de l
’
Afrique du Nord , comme dit Ibn el
Khaldoun , n’ est plus que celle des tribus qui tour à
tour s ’ emparent de l’
autorité .
Les mouvements politiques eurent d ’ailleurs presque
touj ours comme prétex tes des agitations religieuses .
De même qu ’ ils avaient opposé à l ’ orthodoxi e chré
tienne les doctrines hérétiques de Donat et d ’
Arius,
de même, les Berbères opposèrent a l’ orthodox ie m u
sulm ane de leurs vainqueurs les allégations dissidentes
du kharedj ism e d ’ abord , du chy ism e ensuite , moyens
de ne pas reconnaître l’
autorité temporelle de s khalifes ,en récusant leur pouvoir spirituel . Comme l
’
imam at
consiste en la réunion de ces deux pouvoirs en un seul ,les Berbères avaient une ex cuse, une base toute trouvée
pour revendiquer leur indépendance à la faveur de
l’
añaib lissem ent du pouvoir des Souverains Pontifes del’
Islam .
20 L es révoltes con tre les gouverneurs arabes . Jus
qu’
en 1’
année 800, la Berb érie fut soumi se à l’
autorité
précaire de gouverneurs arabes , nommés par les kha
1 22 L’
i SLAM ET LES RACES
dans la région aprè s le passage de s armées musulmanes
organisées . La race indigène, dont les révoltes sans nom
b re contre les gouverneurs des —khalifes indiquaient
l ’ agitation profonde , tendait à recouvrer son antono
m ie . Cette réaction eut son aboutissant dans le mou
vement fat im ide devant lequel disparut en 909 le de r
nier des Aghlabites .
3° Les‘
F ai im ides . Le troisi eme imam caché chyi
t e vivait au IX e siècle en Syrie (1 1 1 e et I v e siècle de
l’
Hégire ) . Son fils Ob éid Allah résolut de lutter contre
les orthodoxes p our reprendre l ’ autorité souve raine
usurpée par les khali fes aux dépens des descendants
d’
Ali . De tous temps , les Berb ères d’
Afrique avaient
reçu avec enthousiasme les membres de s grandes i a
milles arabes en rébell ion con tre le s khalifes , Om ey yades
ou Idrissid‘
e s . Il en fut de même lorsqu’
Ob éid Allah ,descendant du Prophète par sa fille Fatima et son
gendre Ali , d’
où le nom de Fat im ide s donné à la dynastie , vint au x e siècle prêcher la guerre contre les
Orthod ox es au nom du chyi sm e . Les Berbères ne man
qu èrent pas cette fois encore l’ occasion offerte de chas
ser les Arabes de l’
Afrique du Nord , sous le prétexte
de lutter contre l ’ orthodox ie
La B erb érie croyait à la venue d ’ un mahdi . Ob ei d
Allah devint l ’ apôt re des Berbères qui , groupés sous
les ordres de son lieutenant Abou Abd Allah, oommen
c è rent par résister victorieusement aux Aghlabites de
Kairouan, finirent par les renverser du trône sous la
condui te du mahdi arabe . Le mouvement fat im ide ,
a ppuyé sur la tribu berbè re des Ketama, représente
(1 ) v . v . Pique t , op . c i t . , p . 95 e t 1 02 .
L ’AFR IQUE DU NORD ET L’
I SLA 3I 123
une réa ction de l’
indépendance b erbè re , défendue par
des soldats berbères , contre le conqu érant oriental .
Dès lors,l’
Ii riky a fut gouvernée par des princes d’
on
gin e arab e sans doute , mais de tendances franchement
berbères . Ce fait explique les luttes continuelles que les
Fat imi des berbères chy it e s engagèrent contre le s kha
lifes de Baghdad , arabes et sunni tes . On di rait que la
Berb érie à peine délivrée du j oug de l’
env ahi sseur n’
o se
pas encore confier ses destinées à des chefs de son sang .
Ses hésitations , son manque absolu de foi en se s ran
des fam illes, lui font prendre un moyen terme : avoir
des princes arabes à tendances poli tiques berbères , j us
qu ’ à ce que—par la force de s choses , la Be rb érie puisse
se diriger avec ses propres forces .
Obeid Allah reçut la soumissi on de toute la B erb érie ,cell e de la région de Fez où régnai ent les Idrissides
Les successeurs du mahdi , après avoir lancé leurs tribus
fidèles sur le Maroc révo lté , soum i s le s rois de Sij ilm asa ,
Tiharet , se retournèrent vers l’
Ori ent , soumi rent l’
E
gypt e où El Moezz transporta le siège de son gouverne
ment , l oin de l’
orthodoxe Kairouan , dans une nouvell e
vill e qu ’ il nomma El Kahera , la Triomphante, le Cai re .
Le Fat im ide laissai t le commandement des tribus b er
b è res aux chefs des tribus soumises , comme faisaient
déj à les Romai ns . L ’
Ifriky a échut en lot au Sanhadj a
Bologuin ben Ziri . Le s Berbères , sous les Fat imide s, ré
gnai ent dans leur pays : mais avec le nouveau régime
c ’ est une autre tribu que celle des Ketam a , la tribu
des Sanhadja , qui prend la suprématie en l ffiky a et
donne nai ssance à la dynastie nouvelle des Z i r ides .
4° Les Z irides . Ce Bologuin étai t le fils d ’un mara
bout vénéré , Ziri b en Menad , qui a donné son nom à la
1 24 L’
I SLAM ET LES RACES
dynastie des Ziride s . Gouverneur de l’
Ifriky a pour le
compte des Fat imide s résidant en Egypte, le Sanhadj iessaya naturell ement d
’ établir son indépendance . Les
Fat im ides suzerains étaient Chy it es . Bologuin et ses
successeurs tirèrent parti de l’
opposition religieuse pour
grouper autour d ’ eux les indépendants b erbères . Ils
se posèrent en soutiens de l’
orthodoxie contre le chyi sm e
fat imi de . Rapidement se j oigni rent aux Zirides, les Berhères qui , pour retourner à leur indépendance, par hai ne
de l’
étranger, ai dèrent les nouveaux champions de la
foi sunnite à se séparer des souverai ns du Cai re .
Le chy ism e disparut ainsi de l’
Afrique du Nord . L ’ or
t hodoxi e resta seule maîtresse de ces régions . En effet ,dans les siècles qui suivirent, les Berbères n
’ eurent à
lutter qu e les uns contre les autres , comme avant l’
Is
lam . Quand les Turcs apparurent , les indigè nes n ’ eurent
pas b esoin de se baser sur une secte dissidente pour
j ustifier la guerre : les Turcs avaient rompu la trans
mission légale de l’
im am at , leur sultan n’ était même
pas reconnu comme imam par la maj orité des Sunni tes .Ils ne pouvaient donc se poser en soutiens de la foi ,en souverains légaux de tous les Musulmans . Avec le
chy i sm e éclairé des Fat im ides, disparut de l’
Afrique
du Nord la tolérance envers le s Chrétiens . L ’
int olérance
devait apparaître plus tard , après les combats avec les
Portugais , avec les Espagnols , s’
affirmer après l ’ arrivee
des Turcs .
Les Sanhadja , devenus les maîtres de l’
Ifriky a avec
les Zirides, fondèrent deux royaumes celui du sud avec
Kai rouan et El Mehdia , celui du nord avec El Q elâaet Bougi e . Le royaume du sud disparut bientôt sous
les coups des Normands de Sicile et des Arabes venusd
’
Orient .
126 L’
I SLA M ET LES RACES
e t du sang berbère, d’
une façon plus ou moins complète
suivant les régions, action sensible surtout dans les
plaines . En même temps , les mœurs , les coutumes des
Arabes dont le code éta it l’
Islam , s’
in troduisiren t da
vantage par cette fusion dans la nation berbère , favo
risant s inon sa pénétration , tout au moins son islamisa
tion . Certains groupes berbères s’
arab isè rent , mais , par
contre , cer taines tribus arabes , au contact d’
au t och
tones plus nombreux , se b e rb érisè rent , tout en influant
sur leurs voisins .
S i les autochtones firent d’
abo rd le vide devant les
envahisseurs , se réfugièrent dans les montagnes inac
cessibles à la cavaleri e de s nomades , ils te ntèrent, une
foi s le premier choc le plus néfaste évité, des
retours o ffensifs vers les plaines qu i se traduisirent par
l a formation d’
îlo t s d e ra ce a rabe au mili eu du flot
berbère .
L ’ in fluence des deux races l’
une sur l ’ autre se ma
nifest a surtout à la périphéri e de ces îlots , facilitée par
la communauté de religion , laquelle avait déterminé
un régime social assez semblable . L’
Islam , religion de
nomades , de semi—nomade s , de semi-s édentaires , con
venait aux Berbères qui t rouy ai ent dans les dogmes
coraniques la tolérance, la lib erté , nécessaires au libre
développement de leur particula risme . L’
Islam , de son
côté , favorisa la fusion ethnographique et so ciale. Il
s’
établit bientôt une espèce d ’ équilibre dans leque l trou
v è rent peu à peu leur place le s anciennes tribu s cou
pees , séparées les unes des autres d’ abord p ar la
ruée hilali enne , ensu ite par le retour offensif berb ère,équilibre maintenu à grand
’
peine par le tassement de
cette mosaïque de familles , de clans , de tr ibus , origine
de l’
anarchie actuelle de la Berb érie , impossible a com
L’
A FRi Q UE DU NORD ET L’
I SLAM 127
prendre sans l e t ude de ces grands mouvements de
peuples .
La deuxi ème conséquence de l’
i nvasion des Hilal et
des Sole im est d ’ avoir transformé l ’hi stoire poli ti quede l
’
Afrique du Nord . L’
éparpillem ent , le morcell eme nt
des tribus déterminèrent naturell ement l ’ anarchie po
li t ique . Les Hilal , les Soleim , venus par le sud , causère nt
la rupture de l ’ ancien ordre étab li , précipitèrent les
tribus berbères les unes contre les autres jusqu’ à ce
que chacune d ’ ell es eû t trouvé sa place , son territoire,ses terrains de parcours , ai t fait respecter, reconnaître
le nouvel ordre essayé . Mai s ces poussées successives
provo quèrent de grandes migrations qui renversèrent
les dynast i es régnantes , établi rent de nouveaux trônes
sur le s rui nes de s anciens .
L’
amour d es Berbères pour leur in dépendance, les
prétex tes religieux qu’ i ls invoquèrent pour les luttes
politiques ont donc ab outi à une transformation pro
fonde de l’
Afri que du Nord qu i s’ est islam i sée plutô t
par sui te de l’agitation berbère qu e par l
’ action directedes Ar abes . L ’
i nvasion hi laii enne est un événement
capital dans l ’hi stoire de la B erb érie , mai s cette entrée
en ligne d’
Arab es pil lards ne réussit cependant pas à
empêcher les Berbères de régner sur leur co ntrée . D e
nouvelles tribus deviendront souve raines , mais en som
m e , elles profiteront de l’ anarchi e pour établir de s
empires plus pui ssants qu e ceux qui av aient jusque-là
exi sté dans la B erb éri e .
LE S G RANDES DYNA STIES BERBÈRES .
1° Les dynasties de l’
Ouest. Le passage des pre
miè res armée s arabes réguli ères n’
avait fait subi r
28 L’
ISLAM ET LES RACES
aucune transformation à l’
Afrique du Nord . L i slam i
sation des Berbères se poursu iv it ,m ais avec une absence
de continuité déterminée par l’
action du kharedj ism e
et du chy ism e . L ’ invasion des Hilal , des Soleim , mo
difia profondément l’
état existant en Afrique du Nord .
Ce n ’ est pas que les Berbères se soient arabisés en grand
nombre ils b erb érisèrent plutôt les Arabes au point
de v ue ethnographique mais la poussée des nomadesdisj oignit, sépara , dislo qua le s groupements établis ,facilitant l ’ introduction des coutumes islamiques dans
le monde indigène . La religion , la langue même des
Arabes se sont ainsi introduites solidement en Afrique
du Nord ; de nouveaux groupes ethniques ont été for
m ês, mais l’ esprit b erbère e s t resté le même .
Les Hilal , les Soleim furent moins des acteurs quedes spectateurs dans les luttes pour la souveraineté .
Ce sont touj ours des Berbères , sans prête-nom arabe
cette fois, qui veulent diriger la nation berbère, et s’ ils
cherchent à prendre des titres des noms de charge,de fonctions , j usqu
’ alors réserves aux seuls khalifes de
race arabe, c’
est que l’
islam isat ion est devenue assez
profonde en Afrique du Nord , pour que les souverains
se servent de ces noms faisant touj ours impression sur
les Musulmans , pour affermir leur autorité . Que le B er
b ère soit superficiellement ou profondément croyant,convaincu de la vérité de l
’
Islam , le chef parvenu au
trône cherchera touj ours à se rattacher par une filiation
spirituelle ou par des liens du sang à quelque grande
famille arabe, aristocratie de l’ islamisme .
Les dynasties berbères du Maroc, de Tlemsen , de
Tunis , brillèrent par leur éclat, favorisèrent les arts,les sciences , eurent une puissance réelle, mais conser
v èrent dans l ’ Islam les défauts des anciens Berbères
0 L’
I SLA 3 I ET LES CES
pour,en 1025 , être chassée du t rôn par la grande poussée
berbère marocai ne .
Une nouvelle dynastie était a} arue en effet dans la
B erb érie de l’
Ouest . Les Alides : v olt és à La Mekke
contre les Abbassides avaient ét massacrés , mai s un
descendant de l ’ époux de Fatim . :éussit à s’
enfui r au
Maroc, s’ établit à Oulili , l
’
ancî m e Volubili s . Avec
l ’ appui des Berbères touj ours prêt à embrasser les doc
trines dissidentes , I driss fonda u royaume kharedj it e
puissant qui,de 788 à 971 , s
’
ét e . it sur tout l’
Ouest
de l’
Afrique du Nord . La hai ne 3s Abbassides pour
suivit Idriss j usque dans son em]‘
e . Le souverai n fut
empoisonné,parai t-il, sur l
’
ordn du khali fe Haroun
al Raschid , et enseveli au D j eb c Zerhoun . I driss est
devenu le plus grand saint du - r‘
oc e t son tombeau
un li eu de pèlerinage . Son fi l s p : rhum e , I driss I l , né
d ’une femme berb ère, lui succéda . t fonda Fez en 808.
A ce tte époque , la dynastie fat izide était puissante .
Elle fit un louable effort p our aniser l ’Afrique du
Nord , fut amenée à combattre ar Iaroc . Le s Chy it es
fat imi des de Kairouan s’
appuy è rer. sur la grande tribu
des Meknassa , qui habitaient la ré; .n de la Moulouya,
pour essayer d’
afferm i r leur aut or ê dans la contrée.
L’
empire idrisside , en 9 10 , était dor. attaqué à la fois par
les Fat im ide s et par les Om ev v ade .
’Espagne . Ces der
niers amenèrent à l eur cause les l\ xnassa ,qui proc la
m èren t leur autori té à Fez en 9412 Dès lors , le s Fati
mides, dans une politique d’
équilzre , cherchèrent à
maintenir les souverains idrissides aour fai re contre
poids aux Omeyy ade s . Mais les Id .ssides reconnurent
eux—mêmes la suzerai neté des souv rains de l’
Espagne
musulmane . Ce fut une è re de tem s troublés où les
Berbères , partagés entre les divers p1 t endant s au trône ,
L A l"
restèrent au for
puyait uniqu em
reconnaître um
ficace .
Après les t e 1 l
des Ziride s , le
tion om eyy ade
obéissance dar
demeuraient cn
princes de race
purement b e rl
LesM usulma:
le sud saharien
Lemt ouna , Gu e
tenant à la far
région du Nig
portants , de v i t
b ouct ou ,est rest
Quand les Fa i'
le siège de leu r
rouan réagit
dala adop ta
revi nt fonde1
négal
Le marabou
leur do ctrine
des armes . Ils
(1 ) Tran script iles gen s du rb a
(2) V . V . Piqu «
(3) On a chere ]
fa ire v en ir de S
de le rappor t e r
DU NORD ET L’
ISLAM 13 1
t ent ifs à cette politique qui s ’ ap
ar tell e ou telle tribu pour faire
Eté souvent plu s nominative qu’
e f
pagno le dev enu e usu e lle pour El Mrab t in ,
o . c i t . , p 1 29 .
t ym o lo gi e du m o t Sén égal qu’
on a v ou lu
adj a . Il sem b le rai t plus logique peu t -êt remmde t rib u Zénaga .
s des Chy it e s Fat im ide s arabes ,c b el Aqsa resta sou s la dominamb le n
’
avoir pas obtenu une réelle
le pays . La plupart des tribus
touj ours indépendantes,et l es
firent bientôt place aux dynasties
comme en Ilriky a .
Sénégal .Les A lmorav ides (l ) . Dans
Arab es , les Berbères , nomades
des Sanhadja (2) au litham appar
Zénéit e — s’
ét aient étendus vers la
vaie nt fondé des groupements im
le s royaumes dont la capitale , Tom
1 signe irrécusable de leur puissance .
es chy it e s transportèrent au Caire
ve rnem e nt , et que l’
ort hodoxe Kai
leur influence , un notable des Gue
ette vill e les doctrines sunnit e s,puis
ouv ent (rbat) de ce rite sur le Sé
ses adeptes déci dèrent de répan dre
urit anism e austère par la force'
ert irent d’
abord les noirs du Haut
130 L’
I SLAM ET LES RACES
pour,en 1025 , être chassée du trône par la grande poussée
berb ère marocaine .
Une nouvelle dynastie éta it apparue en eff et dans la
Berb érie de l’
Ouest . Les Ali des révoltés à La Mekke
contre les Abbassides avaient été massacrés , mais un
descendant de l’ époux de Fatima réussit à s ’ enfuir au
Maroc s ’ établi t à Oulili , l’ ancienne Volubili s . Avec
l ’ appui des Berbères touj ours prêts à embrasser les doc
trines dissidentes , I driss fonda un royaume kharedj it e
puissant qui , de 788 à 971 , s’
ét endit sur tout l’
Ouest
de l’
Afriqu e du Nord . La hai ne des Abbassides pour
suivit Idriss j usque dans son empire . Le souverain fut
empo isonné, paraît—il, sur l’
ordre du khali fe Haroun
al Raschid , et enseveli au Dj ebel Zerhoun . Idri ss est
devenu le plus grand saint du Maroc e t son tombeau
un lieu de pèlerinage . Son fi ls posthume , Idriss I l , néd ’une femme berbère, lui succéda , et fonda Fez en 808 .
A cette époque , la dynastie fat im ide était puissante .
Elle fit un louable effort pour organiser l ’Afrique du
Nord , fut amenée à combattre au Maroc . Les Chy it es
fat im ide s de Kairouan s’
appuy è rent sur la grande tribu
des Meknassa , qui habitaient la région de la Moulouy a ,
pour essayer d ’
affermi r leur autorité dans la contrée .
L ’ empire idrisside , en 9 10 , était donc attaqué à la fois par
les Fat im ides et par les Om ey y ade s d’
E spagne . Ces der
niers am enèœ n t à leur cause les Meknassa , qu i proc la
m è rent leur autorité a F ez en 942 . Dès lors , les Fati
mides , dans un e po litique d ’ équilibre, cherchèren t à
maintenir les souverains i drissides pour faire contre
poids aux Om eyy ades . Mais les Idrissid‘
es rec onnure nt
eux-mêmes la suzeraineté des souverains de l’
Espagne
musulmane . Ce fut une ère de temps troub l és où les
Berbères , partagés entre les divers prétendants au trô ne ,
1 32 L’
I SLAM ET LES RACES
Sénégal , remontèrent vers le nord , s’
emparè rent du
Tafilel t , apparurent enfin en 1056 dans le Sous , sous lecommandement de Ibn Tachfin qui fonda Marrakech
en 1062 . En 1084 la secte nouvelle , celle des Almoravides
,avait conquis le Maroc en 1090 , elle s
’
était emparé
de l’
Espagne . La belle civ ilisation andalouse , qui avait
fl euri dans ce dernier pays sous l’
hab ile protection des
khalifes om ey y ades de Cordoue , s’
ét e igni t avec eux .
Youssef ben Tachfin écrasa Al phonse VI de Castille àla bataille de Zallarca , mais fut rappelé au Maro c par
le s révoltes habituelles .
L ’ invasion almorav ide,comme toutes celles qu i sui
v i rent,y compris les tentatives de Ma el Aïn in
,e l Hiba
,
Me r eb i R eb b o,représente un phénomène normal
,
semblable en Asie aux mouvements des Araméens,des
Nab at éens,des Mongols
,des Arabes de Faysal vers
Damas et Baghdad : les déserts sont des centres de ré
pulsion ; à leurs lim ites , sans cesse , se présentent des
mouvements vers la périphérie . Encore auj ourd ’
hui,
au Maroc,les Beni Mguild poussent les Beni Mtir qui
poussent les Beni Hassen qui poussent enfin les Gharb
vers le nord .
A l’
Ouest , les Almoravides se heurt èrent aux Zirides
de Bougi e . Les malheureuses régions de l’
Afrique du
Nord , du Maghreb central , déj à ravagées par les inva
sions , furent dès lors le théâtre des luttes entre les sou
v erains du Maghreb el Aqca et ceux de l’
Ifriky a .
Les Ziride s s’
ét ab lirent à Tlemsen . Néanmoins , vers 1 1 1 ,les Almoravides étaient à l ’ apogée de leur puissance
Youssef b en Tachfin prit le titre d ’
Emir el Moum enin,
Commandeur des Croyants La division de l’
em
pire musulman était marquée par la présence de trois
commandeurs des Croyants, le l e lt à Baghdad , le 2e au
L ’AFR IQUE DU NORD ET L’
I SLAM 133
Caire (chy it e ) , le 3e à Fez . Il semble que ne recon
naissant plus l ’ autorité du souverain pontife de l ’ Islam ,
les Musulmans tendaient cependant à se grouper autour
du titre j adis si respecté par le monde islamique tout
entier . De leur côté , les souverains cherchaient à pro
fit er du prestige religieux pour afferm 1r leur autorité
poli t ique , si grande est dans l’
Islam l’union des deux
principes .
Cependant, la dynastie’
almoravide avait apporté
avec elle, du Sahara , les tendances polythéistes des Berb ères superficiellem ent islamisés . En eff et, surtout auMaroc , où les compartiments montagneux conservaient
mieux que partout ailleurs le particularisme local , l’ i s
lamism e ne se présentait plus , en Berb érie , comme auxpremiers temps de la conquête . Les réactions contre
le conquérant ne prenaient plus la forme d’une hérésie
classée comme le chy isme ou le kharedj ism e . Les pré
cept es coraniques avaient été adaptés plus ou moins
vaguement aux croyances des tribus dont la plupart
av aient leur prophète particulier, même leur Coran
rédigé en langue berbère . L ’
Islam se transformait ainsi
peu à peu dans son essence et dans sa forme . Les Be
hères , qui avaient si bien réagi contre l’ in fluence ethni
que des Arabes , étaient en train de modifier suivant
leur propre concept les i dées venues d’
Orient . Une
réaction devait se produire . Ce fut celle des Almohades
ou Unitaire s (1 )
4 0 Les Almohades . Rena issance de l’
I slam . Le mou
vement almohade représente encore une réaction poli
tique sous un prétexte religieux . Une tribu du grand
(1 ) Transcript ion espagnole dev enu e usuelle pour El Mouhaiddin .
1 34 L'
I S I A.\I ET LE S RA CE S
Atlas, cell e des Masm ouda s
’
empara du pouvoir , don
nant rai son à la théori e (1 Ib n el Khaldoun : l’
his t oi re
de l’
Afrique du Nord e st cell e des trib us qui t our à tour
y prirent le p ouvoi r . L'
n Berb ère des Masm ouda , nomm é
Ib n Toumert, après avoir voyagé dans le monde mu
sulman de Tunis à Cordoue, se déclar a le mahdi
certi fie être le 129 imam caché, e t comme, en c es régio ns ,un agi ta teur trouve facil em en t des par tisans , groupe
autour d e lu i assez de monde pour s’
att aquer à l’
em
pi re alm oravide . Ib n Toum ert , qui avait subi l’
in fluence
soufit e , commence par prêcher en montagne leurs doc
trines mysti ques . Hab il e poli tique en même temps,
profitan t de l’
exemple de l a tribu des B eghouata qui
avai t tradui t le Coran en tam azir t, il fit écrire en
berbère les préceptes qu’
il en seignai t, fla t ta nt ainsi
le
particular i sme de s e s fr è res . Ce s dern i e rs formèrent la
secte di te El Mouahedoun par tisans de l a doctrin e
de l’
un i té de Dieu, d’ où l ’ on a fai t Almohades .
Le dis ciple d ’ ib n Toum ert , Ab d el Moum en ( i l 30—52"
se débarras sa défini tivem ent des Almorav i des en 1 137,leur fai sant sub i r un e défai te complèt e, puis il recon
qui t l’
Espagne en 1 132 . Ce fils de poti er reforma l’
em
pi re des Alm orav i des en rédu i sant l ’ Iiriky a , prenant
Bougi e en 1 1 60 . La dynasti e des Hammadi t e s Zirides
di spar ut avec l a pri se de leur capital e .
Abd el ‘. .Ioum en , que l’
on a souv ent appelé le Char le
magn e de l’
Afri qu e du Nord , fit partout régne r l’
ordre
(1 Le RRo gui e n 1 9 '9 de v ai t suiv re la m êm e fil ière . Ro gui e s t
le n om d’
un prét endan t de la tr ib u des Se fb an (Gharb ) en 1862qui appar t e nai t à la frac ti on des Ro uga, Dj elil er Ro gu i . Ilpéri t a
s sa ssin é au Dj eb e l Ze rhoun sous Sidi Mohamm ed . Depu islors , to u s la: a gi ta t eurs on t é t é dési gn és par le Ma ghz en e t ses
part isans sous le nom de Rogui , pour indiqu er comm en t l’
on
env i sa ge la fin de le ur a v en tur e . Te l fut le cas d’
aifl e 11 ’S en 1939du Ro
c
gui Dj e lali b en Dris s .
134 L’
i SLAM ET LES RACES
Atlas,celle des Masm ouda , s
’
empara du pouvoir, don
nant rai son à la théori e d’
Ib n el Khaldoun : l’
his t oire
de l’
Afrique du Nord est celle des tribus qui tour à tour
y prirent le pouvoir . Un Berbère des Masm ouda , nommé
Ibn Toum e rt , après avoir voyagé dans le monde mu
sulman de Tunis à Cordoue , se déclara le mahdi
cert ifia ê tre le 12 9 imam caché, e t comme , en ces régio ns ,un agita teur trouve facilement de s partisans , groupa
autour de lui assez de monde pour s’ attaquer à t
’
em
pire almoravide . Ibn Toumert, qui avait subi l’
influence
soufit e , commença par prêcher en montagne leurs doc
trines mystiques . Habile politique en même temps ,profitant de l
’
exemple de la tribu des B eghouat a qui
avait traduit le Coran en tamazirt, il fit écrire en
berbère les préceptes qu’ i l enseignait, flat t ant ainsi le
particulari sme de ses frères . Ces dern iers formèren t la
secte dite El Mouahedoun partisans de la doctrine
de l ’unité de Dieu , d’ où l ’ on a fait Almohades .
Le disciple d’
Ib n Toumert, Abd el Moumen ( 1 130—5223)se débarrassa définitivement des Almoravides en 1 137,leur faisant subir une défaite complète , puis il recon
quit l’
Espagne en 1 132 . Ce fils de potier reforma l’
em
pire des Almoravides en réduisant l’
Ifriky a , prenant
Bougie en 1 160 . La dynastie des Hamm adit e s Zirides
disparut avec la prise de leur capitale .
Abd el Moumen , que l’ on a souvent appelé le Charle
magne de l’
Afrique du Nord , fit partout régner l’ ordre
(1 ) Le B ogu i e n 1 900 de v a i t su iv re la m êm e fi lière . Rogu i e s t
le n om d’
un prét e ndan t de la t rib u des Seflîan (Gharb ) e n 1862,qui appar t en a i t à la frac t ion de s Ro uga , Dj e lil er Ro gui . Il
périt a ssassin é au Dj eb e l Zerhoun sou s Sidi Mohamm ed . Depuislors, t ou s le s agi ta t eurs on t é té désign és par le Maghzen e t ses
part isan s sou s le n om de Rogu i , pour indiqu er c om m e n t l’
on
env isage la fin de le ur av e n t ure . Te l fu t le c as d’
a ille i rs en 1 909du B ogui Dj e lali b en Driss .
L ’AFR IQUE DU NORD ET L’
I SLAM 1 35
et la sécurité . Ce fut en Afrique du Nord une véritable
renaissance de l’
Islam uni .
Ses successeurs , Abou Yacoub YoussefYacoub el Mansour furent aussi de grands
souverains . Le derni er se rendit célèbre par se s con
quêtes en Espagne où il éleva comme au Maro c de
splendides monuments . C’
est de cette époque qu e datent
la Kou t oub ia de Marrakech , la Giralda de Séville , l atour Hassan de Rabat, nouvelle cité fondée par le sultan .
La décadence des Almohades se fit bientôt sentir .
Les derniers Almoravides dispersés par El Mansoursoulevèrent les Arabes du sud de l ’ Ifriky a contre les
Almohades . El Mansour reconquit le pavs j usqu’
à Ga
b è s, mais les Arab es , j aloux des Berbères , continuèrent
à mener une agitation néfaste en Afrique du Nord . Le s
Chrétiens attaquaient violemment en Espagne l ’ autorite des sultans marocains . En 12 12 , le pouvoir ma
ghréb in recevait une atteinte sensible à la bataille de
Las Navas de Tolosa . Enfin , l’ arrivée par la trouée de
la Moulouy a d’une nouvelle famille, celle des Beni Merin
ou Merinides, précipita la chute des Almohades , dans
le déclin desquels se détache la personnalité d’
El Ma
moun . D e même que les Almohades avaient chassé les
A lmoravides , de même les Almohades furent chassés
à leur tour par lesMérinides ,v enus eux aussi du Sahara .
Encore plus que chez le s Turcs , où les traditio ns b yzant ine s avaient déformé le gouvernement, tou t rappe
lait au Maghzen la vie sous la tente : m ême dans le
Dari
e l Maghzen, les sultans vivaien t comme en me .
halla (armée) tous les fon ctionnaires sont ceux dont on
a besoin quand on campe .
Le sultan devait être avant tout un soldat pour main
te nir son autorité sur des suj ets turbulents . Les chefs
136 L’
I S I.AM ET LES RACES
des grandes dynasties berbères durent perpétuellement
monter à cheval pour réduire les révoltés , les fomenta
teurs de troubles . Dès que le souverain devenai t trop
faible , un nouveau conquérant, prétextant la religionpour se rallier des adeptes , le remplaçait , cherchait àreconstruire l ’ empire désagrégé dans lequel le s tribus
tiraient parti de toutes les occasions pour refuser de
payer l ’ impôt e t partir en dissidence . L’ empire ne pou
vait s ’ organiser, s’
adm inist rer, il devait perpétuellement
être conquis . Dans ces conditions , une dynastie ne pou
vait durer sur le trône du Maghreb . Tel fut le sort des
familles régnantes qui se succédèrent en Afrique du
Nord .
Deux tribus nomades b erbères , qui avaient l’habitude
de venir chaque année se ravitailler dans le Tell , remon
t è rent en même temps du Sahara vers le nord , cel lesdes Béni Mérin et des Abd el Q uad . Les premiers ,profitant de l ’ anarchie constante , s
’ installèrent à Fez
en 1 248 avec Abou Yahya , et dix-huit ans plus tard àMarrakech où ils furent appelés par les Almohades eux
mêmes , qu’
ils devaient supplanter en se réclamant des
Hafsides de Tunis ; les seconds se fixèrent à Tlemsen .
Dès lors , trois royaumes se fondèrent sur les ruines de
l’
empire maghrébin , avec Tunis , Tlemsen et Fez pour
capitales respectives (XI I I e siècle) . Dans l’
Afrique du
Nord commencent ainsi à se dessiner la Tunisie , l’
Al
gérie , le Maro c actuels , ayant chacun leur histoire par
t iculi è re . La nation berbère, malgré ses tentatives rép _
é
t è e s, n’
a pu réussir à s’
unifier d’une façon durable sous
une autorité unique . Fat im ides, Zirides, Almoravides,Almohades , . sont autant d ’ acteurs qui marquen t les
aspirations du peuple berbère .
Les Berbères n’
en ont pas moins eu , au Maroc et en
138 L’
i SLAM ET LES RACES
tôt de la souveraineté Ce fut Abou Youssef Yakoub ,deuxième successeur d
’
Ab ou Yahya , qui leur enleva
Marrakech et battit au Telagh le s Abd el Q uad com
mandés par le célèbre Yaghm orasen fondateur
de l’ empire de Tlem sen .
Sous les Mérini des, des luttes incessantes s’
engagè rent
entre les trois empires de Tunis , de Tlemsen , de Fez ,sans qu
’ aucun des souverains parvint à établir sa supé
riori t é sur les autres de façon durable . Au Maroc , le s
successeurs les plus fameux d’
Ab ou Yahya (1248Abou Youssef (1258 Abou Yacoub (1286Abou Hassen (1331 Abou H eïnan (1350
Ab d el Aziz (1367 passèrent leur règne à sou
mettre les tribus révoltées , à mettre le siège devant
Tlemsen , à reprendre et à perdre l’
Espagne , d’
où les
Mérinides furent définitivement chassés en 1492 . A ces
luttes entre Berbères s’
aj out a , au x v e siècle et au début
du XV I e siècle , l’ entrée en ligne des Chrétiens notam
ment des Por tugais , qui s’
é tab lirent sur les cô t es maro
caines et lancèren t dans l’
intérieur des coups de sonde .
C ’ est l 'origine des for teresses-comp toirs commerciaux
semblables au Bastioun (3) de Taza . Ces Portugais
héritiers des Punique s,semb lent avoir parfai tement réuss1
dans leurs entrepri ses de pénétration marocaine .
Enfin les derniers souverains berb ères du Maroc disparurent sous les coups des agitateurs chérifiens, tou
(1 ) Le s de rn ie rs Alm ohade s se réfugièren t dan s la m on t agn e
du Tin e Me lle l , b e rc e au de leu r pu issan c e o ù plu s t ard 115 fu re n t
m is à m or t (V . Pi q u e t , p .
(2) L’
appari t ion de s Cas t illan s sur le s c ô t e s du Maro c da t e
de 1 263, da t e à laqu elle Alphon se X de Ca s t ille prend Safi . En
1 399, Enriqu e I I I pre nd Tét ouan ; on 1414, le s Por t ugais prennen t Mazagan .
(3) V . Bulle t in de l’
Afr ique fra n ça ise , sept em b re 1 91 5 . No t essur qu elqu es m onum en t s de Taza .
L ’AFR IQUE DU NORD ET L’
I SLAM 1 39
j ours nomades v enant du sud , de s Saadiens qui devaient
inaugurer au Maghreb el Aqsa , le régime de l’ autorité
de quelques Arabes descendant du Prophète sur la
masse berbère . Jusqu ’ à cette époque ,des mahdis avaient
surgi de la montagne , entraînant les Berbères à la lutte
contre le s envahi sseurs à quelque race qu’
ils appar
tiennent ; les grandes tribus b erbères du sud étaient
remontées vers le nord à la conquête des régi ons plus
riches que celles qu’
ils parcouraient, avaient fondé des
empires puissants , mais peu durables . Le caractère du
Berbère est instable en politique . Le s divisions de clans ,
de fam illes , de tribus , intervenaient bien vite pour faire
renaître l ’ anarchi e dont devaient à la fin profiter quel
ques ambitieux arabes . Cependant la masse berbère
restera inaccessible dans ses montagnes , jusqu’
au mo
ment de la pénétration française .
6° Tlemsen . Les A bd el Ouadites Au déb ut
du xm e siècle , les Abd el Q uad , Zénè t es comme les
Beni Méri n, s’ é taien t installés en tre la Moulouy a et le
Zab , puis se confinèrent après l’ invasion hilalienne au
près du Tafilelt . Les Almohades les chargèrent de com
battre les Beni Mérin menaçants . En échange de leursservices , les Abd el Q uad reçurent le droit de percevoir
l ’ impôt (kharadj ) sur un certain nombre de villes e t de
peuplades du Maghreb central . En 1227, ayant contribuéà réprimer la révolte de l ’A1m orav ide Ibn Ghamya , le s
Abd el Q uad reçurent des Almohades la région de Tlem
sen . l ls s ’y établirent de façon stable ; vers 1 240 , le chef
de la tribu , Yaghmorasen ben Zeyam, faisait de Tlemsen
le siège d ’un empire qui devait devenir célèbre par sa
pui ssance, ses luttes contre Fez et Tunis .
(1 ) V . V . Piqu e t , Op . c it . , p . 1 69 e t su iv .
140 L’
ISLAM ET LES RACES
Battu par les Hafside s de Tunis en 1242, Yaghmo
rasen reconnut la suzeraineté de ces princes et con
serva son royaume . D e concert avec les Mérinides , i l
battit l ’A1mohade Es Sa id qui s’
enfuit à Taza . Mai s
cette victoire permit aux Beni Mérin de devenir les
maîtres du Maghreb el Aqsa ; dès lors , les deux tribus ,Abd el Q uad et Beni Mérin , devaient entrer en conflit
pour la souv eraineté . Ce fut là l’
origine de ces guerres
sans nombre qu i j alonnèrent de combats et de meurtres
la route des sultans Tlemsen , Oudj da , Taza , Fez ,par la trouée de l ’ Innaouen . Aucun succès ne permit
aux rivaux d’
obtenir l ’ avantage , et chacun des souv e
rains ennemis s’
occupa bientôt de réduire simplement
ses ennem i s particuliers .
Mais,pri s entre les Hafsides et les Mérinides, les Abd
el Q uadit es s’
afiaib li rent et finirent par succomber de
vant les Espagnols apparus en Orani e au début du
XV 1 e siècle . L ’histoire des Abd el Q uad est caract éris
tique de l ’histoire des grandes tribus de l’ époque .
7° Tun is . Les H afs ides . Lorsque les Almoravides
chassés par les Almohades perdirent l ’ empire de la Ber
b érie , au XI I I e siècle entièrement entre les mains des
Almohades , un membre de la famille dépossédée , Ibn
Ghany a, se réfugia dans le sud tunisien . Le khalife
almohade En-Naser, fils d’
El Mansour, vint le pour
suivre j usque dans ces régions . Vainqueur, le sultan
m‘
aghrébin laissa comme gouverneur en Ifriky a un
nommé Abou Mohammed , fils d’
Ab ou Hafs . Mais ,a la
suite des défaites subies en Espagne, du relâchementde l
’
autorité almohade qui s’ ensuiv ît , les Hafsides s’
éri
gèrent en souverains indépendants avec Abou Zekeria (1236) ,qui pri t le titre d
’
ém ir. Les Hafsides devinrentb ientôt puissants, étendirent au XI I I e siècle leurs pos
L ’AFR IQUE DU NORD ET L’
I SLAM 14 1
sessions de l ’ Ifrikv a j usqu a Ceuta , Tanger et Sij ilm essa .
Ce furent des souverains éclairés , qu i favorisèrent les
art s , les sciences , le commerce , traitèrent avec Frédéric
Barberousse d ’
Allem agne , demandèrent à la papauté
des artisans chrétiens pour introduire leur art à Tuni s .
Ce fut cependant contre l’
Hafside Abou Abd Allah el
Most anser que fut dirigée l’
expédition de Sai nt—Louis àCarthage .
A ce moment , comme dit Ibn el Khaldoun , le kha
lffat de l’
Ori en t et de l’
Occident v enai t de succomber
L’
Espagne chrétienne avai t enlevé Cordoue , Valence
et Sévill e . Baghdad venai t d’
être pris par les Mongols .
Le chérif de La Mekke reconnut alors El Most anser
comme sultan de l’
Ifriky a . Les Almohades de Marra
kech dirent la prière au nom du Hafside , les cheikhs
m érini des de Fez en firent autant . Le roi des noirs,souverain de Kanem , seigneur du Bornou , lui envoya
des présents . L ’unité de l’
Islam s’
était rompue avec
la chute du pontife de Baghdad . Dans l ’ Inde , en
Perse, en Ifrikya, au Maroc , les souverains essayai ent
de la reformer à leur profit en s’
emparant du titre
d’
ém ir el Moum enin . Mai s l’
hi stoire ne peut reveni r
en arri ere : chaque race ay ant embrassé l’
Islam avait
apporté avec ell e son caractère et ses aspirations pro
pres son évolution s’
était particularisée dans le coin
du monde où elle régnai t .Le caractère général de l’
Islam
ne pouvai t plus être invoqué par l’
une de ces races . Le
titre de souverain pontife musulman pourra être saisi
par les souverains d’
Af rique ou d’
Asie , il ne correspon
dra plus dans l ’ Islam à la signification ancienne du
mot khalife , alors que les premiers imams successeurs
du Prophète lançai ent leurs armées de Croyants à la
conquête du monde infidèle . L ’
évolution générale de
142 L’
I SLAM ET LES RACES
l’
Islam s ’ est transformée en une série d ’ évolutions par
t iculiè res .
Les révoltes des Arabes en Ifriky a , l’ accès au pou
voir des Mérinides, puis l’ entrée en ligne des Chrétiens ,
cell e des Corsaires turcs , affaiblirent la monarchie b af
side qu i , s’ appuyant tour à tour sur ses ennemis de la
veille, finit par succomber en même temps que l’ in
fluence des Espagnols , ses derniers sou tiens en Afriquedu Nord à la fin du x v re siècle .
80 Les grandes dynasties berb ères . Ainsi ,aprè s avoir
victori eusement résisté à la conquête arabe , puisque ,s ’ ils acceptèrent l ’ Islam , les Berbères du mo ins réus
sirent à conserve r leur indépendance , les peuples de la
Berb érie ont cherché la formule de gouvernemen t la
plus favorable à leur caractère . Divisés en tribus rivales ,les Berbères furent donc en proie aux luttes de ces
tribus qui tour à tour cherchèrent à s ’ emparer des t er
rit oires les plus riches , de l’ autorité suzeraine que cette
possession comportait . L’
hi stoire des Berbères est celle
de leurs tribus qu i se succèdent au pouvoir . D ’ abord
des princes arab es dissidents furent acceptés comme
les plus capables de résister au conquérant .
Mais dès que le danger fut disparu , dès que les kha
lifes eurent renoncé à se faire obéir en“
Afrique du nord ,les gouverneurs dénouèrent les liens qui les attachaient
au suzerain , les grandes familles berbères fondèrent des
dynasties régnant de l a Tri polit aine à l’
Espagne . L’
em
pire conquis à cheval ne peut se gouverner à cheval .
Or le sultan , obligé de perpétuellement soumettre les
t ribus perpétuellemen t dissidentes à mesure que le souverain allait plus loin , n
’ av ai t pas le temps d’
organiser,
d’
administrer . S ’ appuyant sur une tribu pour régner,
1 42 II SLAM ET LES RACES
l’
Islam s’ est t ranæ rm ée en une série (1 evolutions par
t iculiè res .
Les révoltes de Arabes en Ifriky a, l’
accès au
voir des Mérinide =puis l’
entrée en ligne des C
celle des Corsaireäzurcs, affaiblirent la monarchi
side qui , s’
appuyant tour à tour sur ses ennemis
veille , finit par secom b er en même temps
fluence des ses derniers soutiens e
du Nord à la fin a XV I e si ècle .
8° Les grande s dnas i ies ber bères . Ai '
victo ri eusement n'
ast é à la conquête
s’
ils acceptère nt l’
i l am , les Berbères
sirent à conse rw \ur indépendanceBerb érie ont che 1 é la formule 6
plus favorable à leu caractère . D iv
les Berbères fure n donc en prf
tribus qui tour a t ar cherchè re
rit oire s les plus ric hs ,de l ’ aut
possession comport zt .
de leurs tribus qu ise
des princes arabes
les plus capables d
Mais dès que le
lifes eurent
les gouv ern
L ’AFR IQUE DU NO )
sa dynastie ne pouvait durer
puissance de la tribu . Mais , en
par suite des migrations , de n
touj ours un territoire , des 1
s ’ établir . Ces tribus , guerrière
par remplacer le clan au pouv .
Almoravides, Almohades , Mé
Mais quand , dans l a Berb é1
entre Tunis,Tlemsen et Fez,
gé en Afri que du Nord . Ce
b érie * les migrations arab e s ,Soleim, les randonnées des
donné naissance à une ethnog
LE S CON SEQUENCE S DE L'L’
ETHNOGRAPH I E
em
i l f o
.n po l
c i t .
, t . I .
aure s av e
Sénéga l e t
144 L’
ISLAM ET LES RACES
A cette répartition physique correspond une alter
nance ethnique . Dans le sud , aux confins du Saharaou dans le désert, des Berbères nomades , Touareg , Mau
rét aniens, errent avec leurs troupeaux au hasard des
pâturages . Plus au nord , ou in tercalées avec les précé
dents , des tribus arab es mènent la même v ie nomade .
Les Hilal, les Soleim vert us par le sud,laissè ren t derrière
eux des familles , des clans qu i régularisèrent peu à peu
leurs transhumances , sub sistèrent sur place en rapports
amicaux ou hostiles avec les autochtones . Le l ong des
cours d ’ eau souterrains , des îlots de verdure, les oasis
sont occupés par les sédentaires , ksouriens, de race métissée par les croisements avec les nomades ou les è s
claves noirs venus du Soudan . Sur les hauts plateaux,dans les montagnes aux pics neigeux dépassant parfo i s
comme au Maroc mètres , dans les compartiments
séparés par les chaînons escarpés , vit la pure nation
berbère, le plus important des groupes ethniques de
l’
Afrique du Nord , avec ses forteresses naturelles du
Maroc, de la Kabylie et de l’
Aurès, pendant que dans
les sahels vit la population composite et mêlée des régions côtières de la m e r.
2° Les B erb ères . Malgré les invasions , l’
islam isa
tion, m algré l
’
arab isat ion des groupes périphériques,
la nation b erb è re ,t ouj ours divisée en clans indépendants ,reste dans ses forteresses naturelles inat t eint e , à peine
entamée . Chez elle , le Coran , à pe ine lu , n’ a guère trans
formé les mœurs . Les sectes successives , les schi smes
de l’
Islam , ont montré aux Berbères , dès le début, la
valeur négative de la foi musulmane qu 115 estiment
cependant comme un voile commode pour leur indé
pendance .
146 L’
IS LAM ET LES RACES
Mais nomades et sédentaires , Arabes ou Berbères , errant
avec leurs troupeaux , enfermés dans les alvéoles de
leurs montagnes,purent sans doute trouver sous leur
tente , dans leur v illage , pendant un certain temps , l’ in
dust rie , les matières premières nécessa ires à la fabri
cation de tous les obj ets dont ils avaient besoin . Avec
le mélange des civilisations , par le contact de l’
Ori ent
et de l ’Occident , avec le développement du progrès , de
la civilisation sen sibles chez ces peuples , par la force
même des grandes migrations , par suit e des guerres
entre le Maghreb , l’
Espagne , l’
Ifriky a , l’
Egy pt e , les
b esoins grandirent , nécessitèrent l’ appariti on d ’ un non
v el organe social , sédentaire , rempli ssant les foncti ons
incompatibles avec la v ie nomade, surtout depuis l’
ap
parit ion , le développement des nouveaux beso ins .
D e même que dans la v ie nomade primitive, les K sou
riens remplirent ce rôle , furent les dépositaires des grains ,le s gardiens des richesses diffi ciles à transporter, dans
leur enceinte, forteresse—refuge ; de même il se dév e
loppa , dans les cités où j adis vécurent les RomanoBerbères , un nouveau type de commerçant , de négo
ciant , appelé à tirer parti des ri chesses naturelles de
l’
Afrique du Nord , le Maure .
4° Le M aure . Les Maures , qu’
il ne faut pas con
fondre avec les Maures connus des Romains (nomade sprimitifs du sud) , sont le produit du métissage de toutes
le s races qu i traversèrent la B erb érie , Romains , Vandales , Arabes , Chrétiens renégats ou esclaves , avec les
autochtones . Les mélanges de race ont déterminé un
type ethnique très reconnaissab le , au teint blanchi par
les occupat ions sédentaires dans les échoppes minus
cules , l’
exi stence paisible au milieu de murs protecteurs
L ’AFRI QUE D U NORD ET L’
I SLAM 1247
du so le il . Le s Maures musulm ans, généralemen t fort
lettrés , spécialisés dans la petit e fabrication , le pe t it
comm erce, eu rent p our rôle , dans la civilisation islam i
que parvenue j usqu’
à nos j ours , de fourni r d’ obj ets de
première nécess ité (l‘
y leur voi sin age imm édi at et les
marchés pé riodiques qu i se tiennent à intervalles rap
prochés , par exemple chaque semai n e , dans tous les
centre s , ou bien en pleine campagne, au croisem ent de s
pistes , au confluent des cours d’ eau . D ans ces so rt es
de foires se rencontrent montagnards , sédentaires , qui
profitent de l ’ occasion pour s’
ent re t enir des affaires de
la région , au b eso in discuter de la paix ou de la guerre .
Peu à pe u ,cert ains Maures ont étendu leur comm erce ,sont devenus de vérit ables négociants en gros . C ’ est à
leur instigation sans doute que les souverains de Tunis
entrèrent en rapport s avec la papauté pour déve lopper
les rapports commerciaux avec la chrétienté.’
A la fin
du X IX e siècle , beaucoup de Maures se renda ient en
France , en Angleterre , avaient des comptes courants
dans les banques de ces pays , princ ipalemen t à Mar
seille et à Manchester , sans que pour cela leur état
d ’ esp rit musulman fût entamé par l’ influence chrétienne .
Poussés par l ’ espri t d’
int rigue , de politi que avi sée
qui les distingua de tous temps , en mêm e temps que
leur intelligence et leur sens art ist ique‘
fac i lem ent dév e
loppé par la vie rêveuse et calme du sédentaire , le s
Maures , en relations constantes avec les tribus par le s
marchés, les Maures intermédiaires obligés , après ê tr earriv és dans les vi lles à former de véritab les clans , se
di sputèrent la directi on politi qu e, soit dans les affaire s
(1 ) V . Po in sard , Op . c i t . , t .
- l , Les M a ures . Il n e fau t pas c on
fo ndre n on plu s c es Maure s av e c le s pe uplade s qu’
il e st c onv enu
d’appe ler Maur es au Sén éga l e t en Maurit an ie .
148 L’
I SLAM ET LES RACES
locales,soit dans le gouvernement central lui-même .
Les Maures , qui dirigèrent l’
Espagne , font encore à la
cour des sultans marocains un cercle de fins lettrés , à
la politique subtile , habile à tirer parti des textes et des
paroles pour maintenir l ’ autorité du souverain au mi
lieu de la turbulence des tribus , des attaques des Chré
tiens, eu s
’ appuyant sur telle ou telle tribu pour réduire
les autres , politique qui a reçu de nos j ours le nom de
politique maghzen .
5 ° Les J uifs . Aux Berbères , aux Arabes , aux
Maures , il faut aj outer en Afrique du Nord un certain
nombre de Juifs , race méprisée , tenue à l’
écart , obligée
par une ordonnance des Abbassides à porter un couvre
chef spécial qu i les distingue des bons Musulmans .
Il serait curieux d ’ étudier comment les communautés
j uives sont venues s’
infiltrer en Afrique du Nord .
Il semble qu ’un certain nombre de tribus berbères ,avant l ’ islam isat ion , aient embrassé le juda1 5m e . Les
premiers Juifs. seraient apparus en Tunisie au I I e siècle
après Jésus—Christ, venant de la Cy rénaïque , chassés
par les persécutions . Le j udaïsme paru t aux Berbères
de cette époque, supérieur au christianisme , qui était
mal connu par eux, et surtout dans sa forme b y
zant ine . Les Berbères qui semblent avoir eu de tous
temps une tendance monothéiste, se rallièrent donc engrand nombre au j udaïsme . La nouvelle re ligion s
’
im
planta assez solidement’
en Berb érie , tellement qu’ au
moment de la conquête arab e ,la résist ance la plus farouche du particularisme berbère fut cell e de la Kahena (1 )de l
’
Aurè s,qui était j uive (V I I I e siècle ap . J . L’
Islam
(1 ) Ce n om n’
e st —il pas d’
o rigin e j u iv e . Kahena , Kohen , si
guiñe prê t re en héb reu .
L ’AFR IQUE DU NORD ET L’
I S LAM 1 49
fit rapidement disparaître de la Berb érie le juda15m e
qui se maintint cependant en certains points Enfin,
après la chute du royaume de Grenade en 1492, de
nombreux Juifs se réfugièrent d’
Espagne sur la côte
africaine, surtout au Maroc où ils formèrent à Fezmême une colonie . La grosse émigration j uive d ’
Espa
gne date de Phi lippe I I I (expulsion des Mouiscos) .
Le type ethni que héb ra1que n’ est pas pur en Afrique
du Nord il va du négroïde au sémite par suite du
contact de toutes les races avec le j udaïsme . Les Juifsvivent en communautés sédentai res , sont généralement
petits artisans et colporteurs . Certains , dans ce cas ,vivent sous la tente avec les nomades . Les Arabes, les
Berbères sont souvent la proie des Juifs usuriers . Par
contre , ces derniers sont souvent pillés par les premiers
qui rétablissent ainsi l ’ équilib re de la fortune .
Les Juifs au Maroc se répart issent en deux cat égo
ries
1 ° les auto chtones , habitant dans les m ellahs, ou
convertis à l ’ Islam
2° les émigrés d’
Espagne et de Portugal hab itanthors des m e llahs . En avri l 1922 on évaluait les Juifs aunombre de
Maro c , Algérie , Tunisie ,Turquie d
’
Asie , Palestine,
6° Turcs . Coulouglis . Conclus ion . On voit Combien
différente de l’ ancien ne Berb érie , de la Berb érie romaine ,
est l’
Afrique du Nord après la conquête arab e, l’ invasion
(1 ) Le Juda 1sm e e st c on sidéré par le s Mu su lm an s c omm e in fé
rieur a u Chr is t ian ism e . Le ju if qui se c on v e r t i t à l ’ Islam doi td
’
ab ord se c onv e r t ir au Chr ist ian ism e . Cependan t le cas n’
e s t
pas sign alé à m a connaissan c e au Maroc e t en Algérie .
150 L’
I SLAM ET LES RACE S
des Hilal et des S olenn , les mouvem ents de peuples
causés par l ’ étab li ssement des grandes dynas t ie s b er
bères. Après l’ apparition des corsaires turcs , la mosaïque
de races deviendra encore plus r ich e. Le métissage des
Turcs avec les sédentai res des villes donnera les Co u
louglis, différents des Maur es , lesquels seront les alli és
des Fran ça is La complex it é de la question afr icaine
de no s j ours provient de cett e j uxtapositio n , de cette
pénétrati on de races si différentes , éta nt donné surtout
qu e l e brillant de la civ i li sation maure, l’ éc lat du noma
disme arab e empêchère nt long temps les Européensd
’
apercev oir e t d e comprendre s ous les multiples aspects
de l’Afrique l a grande masse berbère qu i reste touj ours
le fond de la population de l’
Ifriky a et du Maghreb .
L’
OCCUPATION TURQUE EN ALGER IE .
Dans leurs luttes avec la chrétienté,les sultans otto
mans avai ent lancé leurs flottes en Méditerranée . Les
Espagnols s’
emparèrent de 1504 à 15 10 des côtes de
l’
Algérie . En 1 5 10 , les habitants de Bougie , fatigués
du j oug des étrangers , appelèrent les Turcs à leur se
cours . Alger fit de même . Les plus fameux amiraux
ottomans , les deux frères Barberousse rép ondirent à
l’
appel , pour échou er d’ abord devant Bougi e . Mais
Khair ed din Barb erousse s’
installa à Alger,fît pendre
Sélem b en Temi , prince régnant , s’ empara du pouvoir
avec ses corsai res,b at t i t l es Espagnols et établi t ainsi les
(1 ) Cav a ignac par ex .aTlem sen t in t av e c l ’ a ide de s Cou lou glis .
(2) D’
ai lleurs les Barb e rou sse , pa s plus qu e Dragu t , ou la plu
par t de s corsa ire s t urcs , n’
ét a ie n t de v éri t ab le s t u rc s, ma is b iendes re n éga t s chr ét iens . De m êm e les fam eux arab e s qui du Maroc parv inren t au Niger éta ien t de s E spa gno ls ren éga t s .
152 L’
ISLAM ET LB RA CES
pédit ion de 1664 commandée par le duc de Beauforts ’ empara de Dj idj elli , mai s renta aussitôt en France ;en1683, celle de Duquesne , maleé un premier succès
, ne
réussit pas m ieux à cause du muv ai s temps . En 1685 et1686 , d
’
Est rées et Tourville omb ardè rent Alger. LesEspagnols
,en 1 775 , furent mis complète déroute par les
Barbaresques , de même en 1 79 . En 1815 , les Etats
Unis ne réussirent pas m ieu En 1816 l’
Angleterre,chargée par l
’
Europe de répm er l ’ es clavage, envoya
une flotte formidable contre 3 Barbaresques, réussit
à'
détruire leurs bâtime nts . n is dut se reti rer aprèsque l
’
amiral anglais eu t fa it si;_ er au dey des conditions
de paix illusoires , car dès l‘
a nnée suivante les navires
corsaires reconstruits grav e ai de des
Marocains et des Tums ie ns . i umaient
mers . La puissance b arl »are squ « tait telle
l’
Espagne , la Hollande , la Suè r
avaient accepté de payer un i but
leurs vaisseaux de commerc e pussent
la Méditerranée .
Après 18 15 , l’
Europe parvin à rép irat erie
grâce à son union d t m ' Cette n’
avaitduré j usqu
’
alors que pa r la m is tente des euro
péennes qui cherchaient se concili onnes
grâc es des pira tes à l’
c lusu et au détriment desautres puissances . Dès que l
’
m on se fit,la piraterie
disparut . Sidi Mohamm e d l a «‘
e
‘
i v oua officiellement au
Maroc en 1820 . Ce t t e situ . l ion e l’
Europe devant lesCorsaires pourrait u t i lu n e n t c omparer à celle des
puissances de l’
En t en te inv an l Gouvernement d ’Angora (1920
Pendant que les marins en r res se fais aient ainsiredouter
, l’
Odjak étendait so n uv o ir dans l’ intérieur.
L ’AFR IQUE D I ) RD ET L ’ I S I.AN 53
Des expéditions suivies rent par établi r des b eys
vassaux à Constantine , l\ :ah , Tlemsen e t enfin Oran,
abandonné en 1 790 par Espagnols .
CONQUE RANÇA I SE .
Cette situation ne pou durer . Les deys devenaient
de plus en plus insolent Hussein—dey , arrivé au pou
voir en 1818, avait de trè auv aises dispositions envers
la France . En 1 793, des 1m erçant s i sraélites d’
Alger
av aient ,par l’ entremise d e maison de Marseille , fourni
des céréales au gouv ern ent français . Des diffi cultés
de payement s ’ étaient p 1 ites , car l’
E t at barbaresque
réclamait pour lui—mên suivant la coutume locale,
une somme rondelette , c est ée naturellement . Le j our
du Beïram les consuls é 1gers se rendirent au palais,
selon l ’hab itude , pour ce lim ent er le dey . Hussein ln
t erpella M . Deval , repré ant de la France, avec v éhé
mence, lui reprochant d e pas lui apporter une lettre
de son souverain . Le s’
oub lia j usqu’
à frapper le
consul au visage avec so c asse-mouche (30 avril
En juin ,une escadre ut devant Alger sans p ouvoir
tirer réparation de cet trage , malgré un blocus ri
goureux . Le gouv ernem français proposa au vi ce—roi
d’
Egypt e ,Méhém e t Ali , ( :hâtier les pirates e t de s’ em
parer des troi s régence… e vice—roi adhérait à ce plan
à la condition de gouv r er au nom du sultan ; l’
Eu
rope acceptait la com] 1 ison , mais l’
Anglet erre s’ op
posa avec une tell e fe r au proj et que la France dut
se faire j usti ce elle—m é
Le 1 4 j uin 1830 , la fl e de l’
amiral Duperré déb ar
qua l ’ armée du comte lourm ont à Si di Ferruch , près
d’
Alger . Le dey Husse capitula peu après la prise
1 52 L’
I SLAM ET LES RACES
pédit ion de 1664 commandée par le duc de Beaufort
s ’ empara de Dj idj elli , mais rentra aussitôt en France en
1683, celle de Duquesne , malgré un premi er succès , ne
réussit pas m ieux à cause du mauvais temps . En 1685 et1686 , d
’
Est rées e t Tourville bombardèrent Alger . Les
Espagnols,en 1775 , furent mis en complète déroute par les
Barbaresques , de même en 1779 . En 1815 , les EtatsUnis ne réussirent pas mieux . En 1816 l
’
Angle t erre ,
chargée par l ’Europe de réprimer l’
esclavage, envoya
une flotte formi dab le contre les Barbaresques , réussit
à détruire leurs bâtiments , mais dut se retirer après
que l ’ amiral anglai s eu t fait signer au dey des conditionsde paix illusoires, car dès l
’ année suivante les navires
corsai res reconstru i ts grâce à l ’ aide des Ottomans , des
Marocains et des Tuni siens , écumaient à nouveau les
mers . La puissance barbaresque était telle que la France,l’
Espagne , la Hollande, la Suède , l’
Anglet erre et Naples
avaient accepté de payer un tribut au dey pour que
l eurs vai sseaux de commerce pui ssent traverser en paixla Méditerranée .
Après 1815,l’
Europe parv int à réprimer la piraterie
grâce à son union dans ce but . Cette piraterie n ’avai t
duré j usqu ’alors que par la mésentente des nations euro
péennes qui cherchaient toutes à se concilier les bonnes
grâc es des pirates à l ’ex clusion et au détriment des
autres puissances . Dès que l ’union se fit,la piraterie
d isparut . Sidi Mohammed la désavoua officiellement auMaro c en 1820 . Cette situation de l
’
Europe devant les
Corsai res p ourrait utilement se comparer à celle des
puissances de l’
En t ent e devant le Gouvernement d ’
An
gora (1920
Pendant que les marins corsaires se faisaient ainsi
redouter, l'
Odj ak étendait son pouvoir dans l’ intérieur.
154 L’
I SLAM ET LES RACES
du Fort l ’Empereur et fu t autorisé à gagner Naples
e t Livourne avec sa famill e.Tous les Turcs partirent d ’
Alger à ce moment : l’
opi
nion publique le s vit s’en aller avec j oie . Il ne reste
rien d ’eux sinon quelques mosquées Où se réunissent
les quelques Hanéfit e s de l a région,l ’ensemble de l a
Berb érie étant m alékit e . Une de ces mosquées existe
à Constantine . Elle était misérable en 1902 .
Ainsi préluda la conquête de l’
Algérie qui devait don
ner à la France une de ses plus belles province s .
Nous ne suivrons pas le développement des campagnes
françaises en Algéri e,ni celle de Tunisie , ni la péné
tratio n du Maroc le but de notre travail était
d’
amener notre lecteur du début de l ’ Islam isme à l’
étude
des questio ns actuelles . Nous avons exposé comment,
de la conquête arabe primitive de l ’Af rique du Nord ,sont sorties l a Tuni sie
,l’
Algérie et le Maroc nous av ons
déterminé la complex ité de l’
e thnographi e en ces ré
gions et insisté sur le caractère permanent,inéb ran
lable de la race berbère,à peine touchée par les influen
ces étrangères e t gardant malgré toutes les pressions
son caract ère parti culariste et pe rsévérant .
Nous n ’avons pas l ’ intention maintenant de soulever
les grave s questions politico— sociales qui se posent à
l’
heure actuelle en Afrique du Nord française,mais
qu’
il nous soit perm i s de fai re un vœu,au moment où
la propagande j eune—turque,bolchevis te
,l’
éb ranlement
moral e t social causé par l a guerre mon diale , troublent
de trop nombreux esprits . Le dév oûm e nt avec lequel
les Musulmans français se sont battus contre l ’Alle
magne méri te récompense les lettrés musulmans rêventl’
auton omie ; mais le seul terrain d’entente peut être
trouvé d an s une coopération ab solue . Le cit oy ennat
L ’AFR IQUE DU NOR D ET L’
I SLAM 1 5 5
français est o uv ert aux Algéri ens qui ne pro fite nt guère
des avan tages proposés , car il s craignent de perdre le
statut musulman qui le s régit social ement . Notre vœu
serai t qu ’une formule soit tro uvée pour que , tout e n
étant citoyens français politiquement , le s Musulmans
puissent cons erv er leur st atut personnel civil et reli
gieux . I l s erai t peut—être b on encore que s i les Africains
du Nord arrivent ai ns i à la réali satio n d ’une v ie poli
tique réelle , un parlement africain soit créé , avec comme
résultante l ’ étab lissement d ’un régime genre Domi
nion qu i donne satisfaction à toutes les aspirations .
Plus l ’ élément musulman s’
inst ruira e t voyagera,plus
il tendra a réaliser ses aspirations particulières ;… e t pour
l es atteindre,plus il adhérera au mouvement général
islamique , s’ il ne trouve pas dans la Métropole la v o
lon t é ferme d’une coopération étroite . D e leur côté les
Musulmans doivent être persuadés que les concessions
de la Métropole seront le résultat d e leur l oyali sme,et
non celui des agitations . Les bienfaits doivent provenir
non de l ’extérieur,mais de l
’
intérieur . Et nous qu i avonsv u en étudiant l
’
Islam et les Races la diversité dumonde islamique , nous devons être persuadés de la né
ce ssit é d’encourager
,en dehors du panislamisme
,les
tendances particularistes des Musulmans qui doivent
contribuer en ce qu i le s concerne à la prospérité de la
plus grande France .
Ainsi que l’
a indiqué M . Millerand,président de la
République , dans son récent voyage en Afrique du Nord ,rien n e peut se faire sans le temps . L ’
Islam,par suite
de son caractère fermé,est resté en dehors du mouve
ment de la civi li sation moderne ; il se trouve actuelle
ment dans la situation de l a chrétienté au Moyen Age
ses peuples ne conçoivent pas ou à peine l’
organisation
154
du Fort l’
Emp e t fut
et Livourne av sa fam ill e.Tous les Turd parti ren t d
’
Al
nion publique vit s ’en all er
rien d’
eux s in…uque lques
les quelque s l l ‘ éfit es de l a
Berb érie é lan l mlékiœ. Une
à Constantine . l ib éta i t m isérAi nsi préluda bœ nquêt e d e
ner à la France une de ses plus
Nous ne suivm
françaises en Al
tration du Ma
d’
amener no t
des quest
de la
sont 5
156 L’
ISLAM ET LES RACES
c ivi le indépendante de la religi on mis brusquement en
contact avec le monde moderne,malgré les frictions
inévitables,les peuples musulmans seront obligés d ’en
venir à cette conception,mettant l ’ i dée de nation avant
l ’ i dée de rel igion . I l nous appartient de ne pas créer
de malentendus irréparables et d ’aider les Musulmansdans cette transformation qui n ’est en somme qu ’uneapplication nouvelle du principe des nationalités .
CHAPITRE V I I I
L’
ISLAM CHEZ LES NO IRS
INTR ODUCTI ON .
L ’ expansion de l ’ Islam vers le centre de l ’Afri que a
suivi deux routes principales . La première part de Zanzibar et fut suivie par les trai t ants arabes , marchands
de bois d’
éb ène qui , à la recherche d’
esclaves, pour en
fourni r l ’Asie e t le nord de l’
Afrique , n’
oub lièrent pas
la propagande recommandée par le Coran . Après deux
années d ’ absence Stanley constatai t l ’ env ahi ssem ent du
Congo par les associés et les coreligionnaires de TippooTib , le fameux commerçant arabe, sultan réel ayant
sous ses ordres une véritable armée que l’
on nomma ,ne pouvant s
’
en débarrasser, gouverneur du Congo
belge . M . Trivier est encore plus formel : L ’ invasion
des Arabes s ’ accentue chaque j our davantage au trai n
où ils vont, ils seront loin bientôt et plus loin Les
avi s qui m ’ avaient été donnés j usqu’
à ce j our, de pro
v enance blanche, j aune ou noire, étaient tous les mêmes
sur l ’ env ahi ssement du pays par les Musulmans . EtM. Triv i er ne compte plus les villages traversés p ar lui ,commandés par des Arabes . Les randonnées des trai
tants dans le centre de l’
Afrique avai ent abouti à la
créati on de véritables royaumes musulmans , dont lefanatisme accru par les qualités mi li taires de chefs tels
que Ahmadou et Samory, nous a donné beaucoup demal dans notre avance du Sénégal au Niger, au Tchad .
156 L’
ISLAM ET LES RACES
c ivi le indépend t e de la religion ;mi s brusquement encontact ave c lc monde moderne
,malgré les frictions
i névitab le s .s euple s musulmans seront obligés d
’
en
venir à ce t t e m œpt ion ,mettant l
’idée de nation avant
l ’ i dée de r:-l ig i « Il nous appartient de ne pas créer
de malentendu rréparab les et d’
aider les Musulmansdans cette t ranmrmat ion qui n ’est en somme qu’uneapplication Ile du principe des nationalités.
158 L’
i SLAM ET LES RACES
La deum eme route suivie par l’
Islam dans sa propa
gat ion à travers le continent africain , le blad e s—soudan ,le pays noir, part du nord . Les confréries religieuses t e l
les que le senoussism e et la secte des Kadry a , avaient
retrouvé l ’ ardent esprit de prosélytisme des compagnons
du Prophète . Leur volonté de restaurer l ’ empire des
khalifes au centre de l’
Afrique , l oin des Chrétiens et
des Turcs , avait causé entre la Tripo lit aine et l’
Ouadaï
le rassemblement de groupes fana tiques prêts à porter
le glaive de l’
Islam sur les lnfidè les . L’
av ance momen
t anée des Italiens vers Ghadam è s et l’ action énergi qu e
des Gentil , des Lamy , d es Mol] en Afrique oc cidentale ,au Ouadai , avaient encerclé les Senoussist e s dans une
zone limitée . Mais leur action politique touj ours aussi
puissante s ’ est retrouvée dans tous les mouvements
dissidents de Tunisi e , du Soudan , et en général de l’
A fri
que du Nord .
Comment expli quer que les noirs fétichistes adoptent
avec tant de facilité la croyance de ceux qui les ont
tant persécutés Il est hors de doute que le s races noires
subissent à l ’heure actuelle un éveil confus , un lent be
soin d’
ascension à des échelons de v ie supérieure
Or le musulm anism e, qu i demande si peu à ses néo
phy t es, répond suffisamment à c e besoin . Sauf en cer
tains po ints , par ex emple dans l’
Ouganda et peut—être
au Zamb èze , la propagande chrétienne n’ obtient que
peu de résultats , et en core sont—ils peu durables , quand
elle agi t seule dans un milieu noir . Partou t où elle
do it lut ter avec l ’ expansion islamiq ue , ses gains sont
nuls ; ceux des Musulmans rapides et considérables .
C’
est un fait que l’
on ne peut nier . Les colonies euro
(1 ) De Vogüé, Le s I ndes no ires . Re vue des D e ux—M on dœ .
L ’ 1 5 LAM CHEZ LES N O IRS 9
péennes, ditM . de Vogüé, ne font pas exception au SierraLeone, où il n
’y a pas trente ans on n ’
eû t pas trouvé un
Musulman , on en compte auj ourd’hui D e même
au Lib éria . l l n ’ est si pe t it e bourgade de la côte de Bénin
qui n ’
ai t sa mosquée aux lieux où trônaient naguère
encore les di eux fétiches . Les nègres sont de grands
enfants , menés par deux passions : les femmes et la
boisson . Le Musulman leur interdit l ’ alcool , mais il leur
accorde la polygamie . Le Chrétien permet l ’ al cool , mai s
il prohib e le harem . Les pauvres noirs sont fort em
b arrassés ; l’ événement prouve qu ’ ils penchent vers le
harem .
A ces plaisirs sensuels , il faut aj outer la simplicité
de la doctrine monothéiste de l ’ Islam , facile à compren
dre pour les cerveaux primitifs du continent noir . A la
persuasion s’
est aj outée la force . Le prosélytisme mu
sulm an s’
est exercé autant par le fer qu e par la parole,et ce que l
’
Islam tien t , il ne le lâche plus . En Afrique ,plus de 59 mi llions de croyants sui vent l
’ enseignement
islamique . Les conversions sont de plus en plus nom
b reuses, malgré les efforts de s missions chrétiennes à
qui d ’ ailleurs il est quelquefois interdit, comme au Soudan égyptien , de prêcher les populations musulmanes
et permis seulement de se confiner aux fétichi stes e t
aux pay ens (d’
après Margoliou th) .
Le souffle puissant qui animait autrefois l’ immense
vague des Arabes qui , comme un vol de sauterelles , se
répandit sur l’
Asie et le bassin de la Méditerranée , est
venu , semble—t —il , v iv i fier les fanatiques affi li és aux
confréries religieuses de l’
Afrique tropicale pour les
animer d ’un esprit ardent de prosélyt isme .
160 L’
I SLAM ET LES ACES
A .L ’AFR IQUE NO IR FRANÇAISË .
L ’Afrique noire françai se a sb i l m f1uenée arab e
que,puis de l’Afrique du Nord , afin de Zanzibar aux
époques relativement récentes .
Parties d’
Egypt e , les tribu s araes remontèrent d’
une
part le Nil j usqu’
aux source s (1 grand fleuve, essai
mant de loin en loin leurs co lonie, se mélangeant avec
les populations indigènes ;quand lu s tard les traitantsarabes partirent de Zanzibar et e Dar Es Salam sur
les traces des grandes inv asion.< hynüañ tœ , ils trou
v êrent la région des Grands Lacs oute préparée à leur
propagande par cette p remière uva cee venue d’
Egypte.
D ’ autre part,d ’ au t res trib us part i s d
’
Egypt e suivirent
le Bahr el Gazal vers le Ouada i t le Baghirmi .
Ces dernières tribus t rou v è re n dans ces régions, et
dans les régi ons voisines , un dou le élément, l’
élément
berbère et l ’ élément noir . Les Benè res méditerranéens
avaient naturellemen t essaimé v e r le centre du conti
nent Tout comme les Arab es, i avaient de grandes
tribus nomades guerriè res qui as. rv issaient les séden
taires . L ’ action arabe musulm an se porta d’
abord,
semble—il, sur les éléments noirs . . e mélange des nou
veaux venus avec ces derniers dana les Choua l’
ac
tion fut moins facile sur les Be rb ce s .
Les Berbères sont très part icula st es et ne subissentl’
env ahisseur que par la force . Les‘
ouareg, les Tib bous,
(1 ) Le s Berb ères form èren t , sem b le — b i] la popula t io
t e au d’Auv ergne . Cer
t a :n s au t eurs pré t enden t que le s Be rb ère v e naien t du Sud, mais0
mon n es t m 0 1 n s cer t a i n
160 L’
I SLAM ET LES RACES
A . L ’AFR IQUE NO IRE FRANÇA I SE .
L’
Afrique noire française a subi l m fluence arab e
venue d’
Egypt e aux premiers âges de l’
époque islami
que,puis de l ’Afrique du Nord , enfi n de Zanzibar aux
époques relativement récentes .
Parties d’
Egypt e , les tribus arabes remontèrent d’
une
part le Nil j usqu’
aux source s du grand fleuve, essa imant de loin en loin leurs colonies , se mélangeant avec
les populations indigènes ;quand plus tard les traitantsarabes partirent de Zanzibar et de Dar Es Salam surles traces des grandes invasions hym iari te s, ils trou
v èrent la région des Grands Lacs toute préparée à leur
propagande par cette première avancée venue d’
Egypt e .
D ’ autre part , d’ autres tribus parties d
’
Egypt e suivirent
le Bahr el Gazal vers le Ouadaï e t le Baghirmi .
Ces dernières tribus trouvèrent dans ces régions , et
dans les régions voisines , un double élément, l’ élément
berbère et l ’ élément noir . Les Berbères méditerranéens
avai ent naturellemen t essaimé vers le centre du continent Tout comme les Arabes , ils avaient de grandes
tribus nomades guerrières qui asservissaient les séden
taires . L’ action arabe musulmane se porta d
’ abord ,semble—il, sur les éléments noirs . Le mélange des nou
veaux venus avec ces derniers donna les Choua l ’ ac
tion fut moins facile sur les Berbères .
Les Berbères sont très particularistes et ne subissent
l’
env ahisseur que par la force . Les Touareg , les Tib b ous,
(1 ) Le s Berb ères form èren t , sem b le- t -il, la popula t ion au t o ch
t one hab i t an t du N il (Berb erah) au pla t eau d’
Auv e rgne . Cert a ins au t eurs prét enden t qu e les Berb ère s v enaien t du Sud, m a isrien n
’
e s t m o in s ce rt ain
L’
I SLAM CHEZ LES NO IR S 1 6 1
chez lesquels se retrouvent encore les ves t iges des au
ciennes dj emaas (assemblées) berbères , livrèrent desluttes terribles aux envahisseurs . Il fallut des vagues
renouvelées d ’
Arab e s pour faire brèche dans les îlots
berbères , et encore maintenant dans les pratiques islam iques des plus fanatiques de ces peuples , peuvent se
retrouver les anciennes croyances ou superstitions ber
hères .
La rapidité avec laquelle l’
Islam étendit (1 ) son do
maine spirituel sur l ’Afrique du Nord et sur le Soudan
est remarquable . Dès la première invasion d ’
0 kb a en
Afrique du Nord (vers les Berbères du Saharaoccidental Sanhadja et Lem t ouna étaient touchéspar la propagande islamique . Les Sanhadja se firent à
leur tour les propagateurs de la nouvelle religion . Dès
le X e siècle après J .
-C . (IV 9 de l ’Hégire) ,ils avaient fondé
entre Tagant et Oualata un empire commandant à dix
huit royautés nègres . Il s furent rej etés dans le désert
par les Soussous, mais il s avaient apporté en ces régi ons
la civilisation islamique .
L ’ empire senhadj i fut remplacé par l’ empire noir de
Tombouctou . Au V I I I e siècle après J —C. , le célèbre voya
geur arabe Ibn Bat out a signale un grand Etat mu
sulman à Mellé . Le roi Koukou Moussa se rend à La
Mekke , entretient des relations avec les khalifes d’
E
gy pt e et les émirs du Maroc . Son empire comprenaittrois grandes provinces divisées chacune en douze sul
t anat s . Les chroniqueurs musulmans s’ accordent à v an
ter les richesses de l ’ empire soudanais , à célébrer com
(1 ) Po ur l e t ude de l’
Afriqu e n oire fran çaise , j e su is l’
ou v rage
du Ct O . Mey n ie r , L’
Afr iqu e n o ire . Paris , Flam m arion , 1 91 1 , e t
De lafosse , Les No irs de l’
Afr ique , Collec t ion Pay o t , Paris, 1922.
162 L’
ISLAM ET LES RACES
bien les lettres , les sciences et les arts ont une place
importante dans les préoccupations de l ’E t at . M . Le
Chât elie r veut réserver surtout aux Berbères et aux
Arabes venus du nord , qui form aient la classe élevée
de la société la gloire de cette civilisation , mai s il
est probable qu en Afrique noire, comme dans les autres
terres d’
Islam , les aspirations particulières des peuples
se sont fait j our sous l ’ égide islamique . Le x 1v € si ècle
marqua au Soudan comme en Afrique l’
apogée berbère .
Les savants soudanais rivalisèrent alors de science avec
les docteurs musulmans . De cette époque datent en ar
chit ec t ure les mosquées de Gao et de Tombouctou .
Au XV I e s1ecle les Songha1 avec comme villes Gao,Tombouctou et Dienné s ’ emparent du pouvoir. ElHadj Mohammed, chef de la lignée des Askia , prend
l’
Islam comme un nouveau moyen de domination , en
courage ainsi que ses successeurs la diffusion de l’
Islam .
Une civili sation éclatante répondit aux efforts des chefs
et des savants songhaï . L ’ empire s ’ étendait du Tchad
a l’
At lant ique ; le commerce était florissant . Parmi les
écrivains soudanais , Abderrahman ben Abdallah , au
teur du fam eux Tarikh es Soudan , mentionne lon
guem ent les mérites des savants , pieux commentateurs
du Coran,marabouts éminents , j urisconsultes , histo
riens qui à son époque faisaient la gloire de Dienné,
de Tombouctou e t de Gao
Pendant que l’
Islam florissait ainsi entre le Sénégalet le Niger sous l ’ impulsion des Berbères convertis par
les successeurs d’
0 kb a , la religion musulmane , sous l’
im
pét ueuse poussée des Hilal et des Soleim , prenait en
Afrique du Nord une extension considérable . Les sul
tans marocains cherehèrent naturellement à s’
étendre
1 64 L’
I SLAM ET LES RACES
pachaliks marocains . Segou Sikoro devient leur capitale Le bassin du Sénégal , qui avait v u se
succéder plusieurs civilisations , quelques—unes pro s
pères,était envahi par les hordes maures (ainsi que
nous appelons les Arabo—Berb ères qui nomadisent entre
ce fleuve et le Maroc) . Là aussi les ruines s’
accumu
laient ; le désert , continuant sa route victorieuse vers
le sud , semblait devo ir avec les nomades arriver j us
qu ’ au golfe de Guinée .
Dans le Soudan oriental , le Bornou , quoique moins
riche , moins prospère que naguère , conservait encore
son rang de monarchie organisée . mais contenait à grand
peine les efforts des Le Baguirmi , le
Ouadaï, le Darfour atteignaient ou étaient sur le point
d ’ atteindre le plus haut degré de prospéri té . Seules , lesguerres les empêchaient de former des sociétés aussi
civili sées que celle des anciens Songha‘
i . Les sultanats
de l’
Est vivaient séparés de tous le s autres , s’
av ilisSantde plus en plus par la traite de s esclaves .
C ’ est alors qu’
apparurent les Peuhls ou Foulb è s . Dans
le courant du XV I I I e siècle l ’ Islam s’
int roduisit au Fouta
D jalon , berceau des Peuhls . L’
Alm am y (1 ) Abd el Qader
fonde un Etat musulman duquel découlera le grandempire d
’
El Hadj Omar . Les Peuhls s’ attachent à l ’ étude
des textes coraniques et deviennent un peuple ex t rê
m em ent religieux . Au début du X IX e siècle , Othman
Dan Fodie, véritable prophète mystique , soulève les
Peuhls au nom de l’
Islam et proclame la guerre sainte .
Ce fut un enthousiasme délirant chez les Peuhls . Un
immense empire , du Bornou au Mossi , du désert à
l’
Adamaoua compris , récompensa leurs effor ts .
(l ) Alm any e st une al téra t ion de l’
arab e Il Im am .
L’
I SLAM CHEZ LES NO IRS 1 65
Malheureusement, la guerre sainte ne civili se pas les
populations , elle les exterm ine ou les réduit à l ’ état
d ’ esclaves . Othman Dan Fodi é,v ie illi , partagea son em
pire entre ses fils , mais aucune idée créatrice ne permit
de construire sur ses ruines . L’
Empire foulb é subit le
sort de tous les empires du Niger ; il se désorganisa
bientôt en une poussière de principautés .
Sokoto déclinait déj à lorsqu ’
un nouveau prophète se
révéla chez les Peuhls de l’
ouest, le fameux El HadjOmar . Ce nouvel imam fut rej eté vers l ’ est par le géné
ral Faidherbe . Il se vengea sur les royaumes noirs , en
1855 s ’ empara de Tombouctou et étendit son empire de
Tombouctou au golfe de Guinée , du Sénégal à Sikassoet au Mossi . El Hadj Omar, avant tout guerrier, ne sutpas construire . Son neveu Tidiani prit une partie duterritoire . Son fils Ahmadou Cheikhou régna sur Segou .
Le D j ihad prit le caractère de razzias d’
esclaves contre
lesquelles combattirent les Français du Sénégal .Les nomades maures ou touareg profit èrent encore
de l ’ anarchie pour avancer vers le fleuv e ;Sam ory com
mence ses conquêtes . Depuis 1886 , les eff orts des mar
souins français nous ont valu la conquête du Soudan .
Moins que partout dans le monde , l’
Islam avai t réussi
en pays noir à fonder une civ i li sati on stable . Les Ma
rocains n ’ avaient fait que passer . La religion de Maho
met était, il est vrai , parvenue au Soudan , par l’ inter
m édiaire de pillards et elle avait sans doute perdu ainsi
de sa force civ ilisat n ce .En Perse , dans l’
Inde , en B erb é
ri e , les conquérants avaient appo rté l’
Islam , mais les ci
v i li sat ions locales avaient continué leur développ ement
propre sous le voile islam ique .Ainsi s ’ explique la florai so n
incomparable des diff érents peuples sous l’
Islam a rabe .
Au pays noir la civi lisation a laissé des traces, mai s
1 64 L’
I SLM ET LE S RACES
pachaliks marocains . Segou S ikoro devient leur capi
tale Le ba in du Sénégal , qui avait vu se
succéder plu sieurs v i lisat ions , quelques—unes pros
pères , était envahi ar les hordes maures (ainsi que
nous appelons les Arb o—Berbères qui nomadisent entre
ce fleuve et le Man u) . Là aussi les ruines s’
accumu
l aient ; l e déser t , w inuan t sa route vi ctorieuse vers
le sud,semblait de i r avec l es nomades arriver jus
qu ’ au golfe de Guin
Dans le So udan d ental , le Bornou , quoique moins
riche,moins pro spè : que naguère , conservait encore
so n rang de mo nan l e o rganisée , mais contenait à grand
peine les e ffo rts d Le Baguirmi, le
Ouada i , le Da rfo u r t t e ignaie nt ou étaient sur le point
d ’ atteindre le plus l u t degré de p ro spéri té . Seules, les
guerres les em pu'h e nt de fo rmer des sociétés aussi
civili s ées que c e lle e s anciens Songhaï . Les sultanats
de l’
Est viva ie nt h t arés de tous les autres , s’
av iliSsant
de plus en plus p la traite des esclaves .
C ’ est alo rs qu’
a…rure nt l es Peuhls ou Foulb ès. Dans
le courant du x v m *siè c le l'
Islam s’
int roduisit au Fouta
D j alo n ,berce au d.Pe nnls . L
’
Almamy (1 ) Ab d el Qader
fonde un E ta t in u lman duquel découlera le grand
empire d’
El Had ] b ar . Les Pe uhls s’
attachent à l’
étude
des textes co rq° S et dev i ennent un peuple extrê
m em e n t re ligieux \u début du x i x e siècle, Othman
Dan Fod ié , v (—n l . le prophète myst ique ,soulève les
Pennls au nom « le I slam et pro clame la guerre sainte
Ce fut un e n t ln a sme d éli rant chez les Peuhls. Un
immense empi h . u Bornou au Mossi , du désertà
l’
Adamaoua c om ; 5 , récompensa leurs effor ts .
—\lm s nv e s t u n téra t ion de l’
arab e Il Im am .
166 L’
I SLAM ET LES RACES
les noirs n eta ient san s dout e pas encore aptes à as si
miler à l’
Islam leur s conceptions propres du monde .
Peut—être faut-il expliquer ainsi que des sociétés certai
nement supérieures comme celles des Songhaï, n’ aient
laissé aucun Etat fermeme nt organisé avec l ’ aide del’
Islam .
Au point de v u e colonial françai s, peut—être vaut—i l
mieux que les événements se soient passés ainsi,car
,
si le Soudan avait été entièrement et profondéme ntislamisé , nous aurions pu nous fai re aimer, servir de
c onseillers et de guides , mais j amais nous n’ aurions pu
aussi bien assimiler à no tre patrie ces populations non
mu sulmanes qui sont notre souti en le plus soli de . L’
Is
lam crée une diff érence entre Musulmans et Chrétiens .
Quoi qu ’ on fasse , la civi li sation chrétienne et la civilisa
tion islamique procèdent de bases différente s , et tout
en étant en excellents termes avec les Musulm ans , i l
est facile de const at er ,en pays noir, que l es populatio n s
fétichistes par exemple Se donnent plus entièreme nt à
nous que les islamiques .
Somme toute,après une période d
’
engouement i sla
m ique,qui nous avait porté à favoriser le développement
de l ’ Islam en Afrique , il a fallu reconnaître qu’une erreur
p olitique étai t peut-être comm ise . Le noir n’
adopt e que
les formes extérieures de la religi on mais devenu Musul
man,il tomb e entre les mai ns de dirigeants qui peuvent
facilement devenir défavorables à notre cause,alors que
les dirigeants chrétiens ou non—musulmans ont au co ntraire intérêt à s ’appuyer sur notre autorité .
Jusqu ’ à présent , en Afrique Occidentale Française ,l e panislamisme n
’
a guère été inquiétant L’
action
(1 ) M. Dela fo sse , Les po in ts s om bres de l’
hor izon en Afr iqu eOcc iden ta le F ra nca ise .Bzd ie t in de l
’A/r ique F ran ça is e, juin 1 922 .
L’
I SLAM CHEZ LES NO IRS 167
d es marabouts locaux a été et sera sans doute encore
beaucoup plus puissante qu’ un mot d ’ ordre venu de
Constantinople ou de La Mekke , ou de quelque autre
métropole lointaine de l’
Islam sur le noir b e auco upplus éc lectique en religi on que le musulman blanc . Ce
pendant l ’ esprit de national isme créé dans l ’ Islam pa r
le mouvement d’
Angora mène à un panislam isme pol i
tique qui peut devenir dangereux à un moment donné .
C ’ est pourquoi la mentalité des marab outs et les menées
des Senou ssist es , propagandistes de ce panislamisme ,doivent être étroitement surveil lées .
B . LE CENTRE DU CONTINENT NO IR
L ’ expansion isl amique dans le centre du continent
afri cain se fit par l’
intermédiaire des traitants arabes
de l ’Océan Indien . En plus du commerce d e s épices ,ces marchands fai sai ent surtout la trai te des noirs . Eneffet, si la Turquie et le monde musulman réclamaient
encore des eunuques , des femmes et des travailleurs ,surtout, l
’
Amérique , manquant de bras pour ses plan
t at ions, demandait à tout prix des noirs esclaves . Il
exista des contrats entre les gouvernements européens
et des compagni es privées formées dans ce but . Un
contrat aurait été ainsi signé en 15 17 entre Charles
Quint et l ’un de ses compatriotes des Flandres .
La traite se fai sai t par les ports autour de l ’A frique .
Mais l’
Angle t erre la proscrivit en 1807, les Congrès de
Vienne (1815) et de Vérone (1822) sanctionnèrent 1 1nt erdict ion . La conférence géographique de Bruxelles e n
(1 ) D ‘ Hinde , The fa ll of the Con go a ra bes ; Ren é Du b reucq ,A trave rs le Congo belge . Brux e lle s , j u i lle t 1909 , sou s le pa t ronagede l
’
Expan sion b elge ; A . J. Wau t ers, L’
E ta t indépenda n t duCongo . Bruxe lle s, Falk fils , 1899 .
1 68 L’
I SLAM ET LES RACES
1876 e t la conférence de Berlin la renouvelèrent . Enfinl’
Eney clique du 5 mai 1888 de Léon X I I I , adressée aux
évêques du Brésil , la condamnait formellement . L’ ac t ion
religieuse se montrait également sous une forme active
avec le cardinal Lavigerie , évêque de Car thage .
Ces dispositions de l’
Europe , accompagnées d’
e ffi
caces croisières de guerre contre les navires négriers ,fermèrent b ient ô t à la trai te les ports de l
’
A t lan t ique . La
question fut plus diffi cile à résoudre dans l’
Océan Indien ,en raison de l
’
existence sur les côtes d ’
E t at s arabes ta
v orab les à la traite .
D e Khartoum , sur le Haut—Nil , partaient ainsi au
nuellement des expéditions armées vers les bassins de
l’
Uele et du Bahr el Gazal . Ces expéditions installai ent
des postes (zeribas) portant le nom du chef, réduisaient
les indigènes par la force à l’
état d ’ esclaves . Il fallut
toute la campagne anti—esclavagi ste du général Gordon
pour mettre fin à ces agissements mais ce ne fut réel
lement qu’
e n 1878, que Gessi pacha put réellemen t sup
primer la traite au sud de Khartoum .
Le véritable centre esclavagiste fut Zanzibar . Vers
1830, les Arabes de ce sultanat, parcourant l’
Afrique
à la recherche de l’
iv oire , arrivèrent dans l’
Uny any em b e
et s’
ét ab li rent à Tabora . Dix ans plus tard ils é taient
au Tangani ka (à Udj idj i) . En 1868 le mét i s D ougemb is’
ét ab lissait à Nyangwe, bientôt suivi d’ autres trai
tants . Livingstone en 1871 trouva cette colonie arabe
très prospère . Stanley raconte longuement les horreurscommises par elle dans le Manyema .
De 1830 à 1872,1e commerce de l ’ iv oire et celui des
esclaves deviennent inséparables , car les t rait ant s ayant
besoin de porteurs pour amener les défenses à la côte,trouvent très pratique d ’ amener en même temps un
170
d’
Udj i d ii . L’
aeti
patio u belge du
En oc t ob r
des partis
kandi . Par
le capitaine
Des chefs indigèm
prit bientôt un ca1
fallait en finir . La
par l ’ offensive de
colonne congolaise
indigènes du Haut
e t marcha vers les
bats , i l chassa les
Lualaba , franchit
14 j anvier 1894 , à
infligea à Rumaliade la déroute p our
j oint de Dhanis ,tale de l
’
Et at . P
t orit é belge aux
t orieusem ent la
pagne arabe dur
incontestée des
biles politiques .
dispersés . L
En mêmecelle des
l’
Océan
Les tr
routes
a m
son
es,sou s le com
tête de sol da ts
lés par te rre
appo r
la mo
l’
in di
o nt
d'
arm es
MAND E .
t la
rb e sui
and o n
lacs se
la sup
lemands à
à l’
autorit é
d e commercees so nt passée s
nnent p our rai
car chez be au
t considérées commeant Bührer
,le nom
li t en 19 13 à environ
ce t t e c ampa gn e le rem ar
b rer, L’
Afr ique or ien t a le'aris, 1 922.
ipit re I I I .
170 L’
I SLAM ET LES RACES
d’
Udj idn. L ’ action de la soc 1 e t é se termina par l ’ occu
patiou belge du Manyema .
En octobre l 89 1,1e capitaine Pont hier se heurte à
des partis arabes qu’
il défait au confluent du Bomo
kandi . Par cont re ,en avri l 1892
,Sultan Rum aliza b at
le capitaine Jacques à Towa . Les confl its se multiplient .
Des chefs indigènes se rallient aux Arabes . La lutte
prit bientôt un caractère de guerre à outrance . Mais il
fallait en finir . La question arabe fut promptement réglée
par l’ offensive de Dhanis . En 1892, à la tête d
’une
colonne congola ise , appuyée par les puissants chefs
indigènes du Haut-Sankuru , Dhanis partit de Lusamboet marcha vers les bomas arabes ; après maints com
bats, il chassa les esclavagi stes de l
'
Ent re-Lomani et
Lualaba , franchit le fleuve en face de Nyangwe et le
14 j anvier 1894, à deux j ours au sud-est de Kasongo ,infligea à Rum aliza un échec décisif . Ce fut le signal
de la déroute pour les esclavagiste s que Lothaire , l’ ad
j oint de Dhanis , poursuivit j usqu’
à la frontière ori en
tale de l ’Et at . Pendant ce t emps ,Chalt in affirmait l’ au
torite belge aux St anlev’
Falls et Jacques occupait vic
t orieusem ent la rive Ouest du Tanganika . La cam
pagne arabe dura 1 9 mois e t se termina par la victoire
incontestée des Belges , lesquels s’
étaient montrés ha
biles politiques . Tous le s chefs arabes étaient tués o u
dispersés . Le vieux Tippo—Tib s’
inst allait à Zanzibar .
En même temps l ’ installation des Anglais à Mombassa ,celle des Allemands à Dar Es Salam fermaient dansl’
Océan Indien la route des esclaves .
Les traitants ont ouvert à la pénétration européenne le s
routes du continent noir . L’
Islam dans le centre Afrique
a mo ins été civ ilisateur qu’
explorat eur mais néanmoins
son rôle fut considérable et mérite d ’ être signalé .
1 72 L’
I SLAM ET LES RACES
âme s ; Dar es Salam ,considéré comme très
islamisé,ne comptait qu
’enviro n de Musulmans .
Cependant,l ’ influence arabe se retrouvait en c e sens
que dans chaque v illage il était bien rare que l’
on ne
trouve pas un ou deux indigènes parlant l ’arabe ou le
souahéli ; on peut dire en somme que le souahéli étaitcompris partout .
Une remarque intéressante e st à faire sur la politique
suivie par les Allemands à l’égard de leurs su j ets mu
sulmans . Alors qu ’en Turqu ie , les Allemands se posaien t
en défenseurs du Croissant,au contraire dans leurs pos
sessions est—africaine s,ils semblaient s ’eff orcer de limiter
la propagande islamique . Cette tendance se découvre
dans une circulaire du gouverneur Schnée adressée à
tous ses chefs de poste .
L’
Islam représente évidemment un progrès pour les
fétichistes et les pay ens en ce sens son prosélytisme
serait à encourager ; en outre l’
Islam donne l’autorité
à quelques individualités qu’
il est plus facile pour un
chef de po ste de surveiller et de diriger . Mais l ’ Islam
représente une arme à deux tranchants : l ’ Islam im
prime aux masses un esprit particulier , des tendances ,contre lesquels il n
’est plus possible de réagir . Le chris
t ianism e fait des noirs des hommes moins guerriers peut
être,mais plus m aniables . Le gouverneur allemand avait
sans doute saisi ces nuances ; c’
est pourquoi il essaya
de limiter l’expansion islamique .
En tout cas il est utile de remarquer que si les Allemands eurent dans l ’Est africain de nombreux désert eurs
,c ’est le seul point où ils a ient trouvé un réel
concours parmi les indigènes : la raison est donnée enc e sens que le s Allemands faisaient du soldat la caste
supérieure e t que l eurs ashris étaient réellement con
vaincus de leur supériorité sur le res te des noirs .
CHAPITRE IX
L’
ISLAM EN ABYSS INIE
L’
A byss in ie . Le développemen t de la conquête
musulmane ne fit qu’
e ffleurer l’
Ab y ssini e . La grande
ruée arab e vers l’
Egyp t e et l’
l friqy a (Afrique du Nord
moins l’
Egypt e) toucha bien le massif montagneux ,
mais ne put y pénétrer . Les hordes nomades de cava
l iers furent nécessairement entraînées par le déroule
ment des plaines vers l’
Ouest .
L’
Ab y ssm 1e , j adis appelée Nigritic ou Ethiopie,a
touj ours été une réunion d’
états féodaux pratiquement
indépendants les uns des aut res,don t Gondar et Choa
sont les plus importants . La population , de type très
mélangé,depuis le blond , le cuivré, j usqu
’
au nègre crépu ,parle de nombreux dialectes dont les plus répandus ,ceux d ’
Amhara et de Tigré, semblent sortir du même
idiome que celui des inscriptions des ruines d ’
Axum .
Autour du massif montagneux grav 1 t ent au Sud et àl’
Est les tribus errantes des Gallas et des Somalis , tandis
qu ’ à l’
Ouest , les frontières restées incertaines entre l’
E
gypt e et l’
Ab y ssinie lai ssent les tribus nomades de la
région livrées aux pillages des guerriers de l ’un et de
l’
autre pays .
L’
A byss in ie chrétienne en A ra b ie . Dans l ’ anti
quité abyssine apparaît, légendaire , la figure des vieux
rois d ’
Axum mi—Césars, mi-pontifes , auxquels le Moyen
Age avait decerné le nom de Prêtre Jean D e race
caucasique comme leur peuple, les rois d’
Axum ,ville
1 72 L $LAM ET LES RACES
300 000 âme s ; D . es Salam,c onsid éré comme très
islamisé,ne compt zt qu
’
enviro n de Musulmans.
Cependant,l
’
inflence arabe se retrouvait en ce sens
que dans chaque Mage il était bien rare que l’
on ne
trouve pas un ou eux indigènes parlant l’
arabe ou le
souahéli ; on p eut ire en somme que le souahéli était
compris partout .
Une remarque inâressan t e e st à faire sur la politique
suivie par les Alle ands à l’
égard de leurs suj ets mu
sulmans . Alors qu’
. Turquie ,le s Allemands se posaient
en défenseurs du (‘
n issant,au contraire dans leurs pos
sessions est—africairs,ils semblaient s ’efforcer de limiter
la propagande islmique . Cette tendance se découvre
dans une circulaire du gouverneur Schnée adressée“
à
tous ses chefs de pst e .
L’
Islam représe n : évidemment un progrès pour les
fétichistes et les païens ; en ce sens son prosélytisme
serait à encourager en outre l’
Islam donne l’autorité
à quelques indiv iduli t és qu’ il est plus facile pour un
chef de poste de srv e iller et de diriger . Mais l’
Islam
représente une arm à deux tranchants : l’
Islam imprime aux masses u esprit partien
contre lesquels il n'
st plus po
t ianism e fait des n
être,mais plus m
sans doute saisi il’
essaya
I'M rxr «.e s RACES
ul luM drum ln province de'
l’
igre, à l’
orient du fiere
(« fuie n t enco re puissants à l'
époque des C)'i
umlm. l .…n‘
a suppo rts av e c les Grecs d’
Alexandrie , aec
l ‘empire rmnuln lui-mômo,nv aient été suivis de l’ea
« lu e ln‘ls l lnnisnie en ces régions . En cet
depu is plus de qunlo rze siè c les , le peuple abyssin IQferme un rlle enl lm lique o rie ntal , o ù
\‘tl llll t i l
‘
l tl uvr e ln e lu‘éli e tnlé . par su it e de l’
…un. i l laisse péné t re r l‘
ure t‘ superstit ions coptes, g
rc
ques . j udaïques. e l uu’
uue force pratiques pay enrîesml'
N leb lsles. ee chris tianis me bâtard qui fut i nta
par les lill l1iopie us en Arab ie
dominat ion de plusiems siè cle s . Il n a maiheureusemüt
M ure nu\ eouuuuu:m lœ e lmét ienues du Yémen que e
h‘
uisil la co nquê te musulumne . L æs r ois
par les Amie—rm s ram fort e .
due tts—n q…s‘
asduuls œ pe udau
su uns—à
»i «: Muh cimmw‘
. au: « su m mmäm Je:
tent. qbewhe r :mugp mmv s à :De tente ! mins—i «i
‘
mîleum n… m,un les nes—secu
\Q i t;t æ2n… .;îl i i
L’
I SLAM EN ABYS S IN IE 175
leurs croyance s , revinrent plus tard à La Mekke à la
uv e lle de l’
entente survenu e entre Mahomet et ses enne
I s . Les Arabes avaient déj à en maille à partir avec les
ay ssins, lorsque les rois d’
Axum avaient conquis l ’Ara
e Heureuse La Mekke ou Baccah et son Dieu Allah
a ient acquis une grande renommée par leur surna
relle résistance à une expédition éthiopienne dont
but avait été la destruction du culte .
Les Musulman s avaient effl euré le bloc abyssin en
mv ert issant à leur foi l es tribu s nomades de l a p éri
nérie ; maîtres de l’
Egypt e , il s livrèrent sans grand
1ccè s de nombreux combats aux montagnards . L’
Islam
e put conquérir l’
anc ienne Nigritic , mais l’ invasion
e la vallée du Nil eut une influence désa streuse sur les
es tinées religieuses de s Abyssins : l’
Eglise copte d’
E
ypt e fut oppri mée par les Musulmans . Or , de cette
erniè re dépend hiérarchiquement l’
Eglise d’
Ab y ssin ie .
L’
ab ouna (notre père en arabe) , chef religieux de
Ab y ssini e , devant canoniquem ent recevoir l’
inv e st i
ure du patriarche alexan drin , et le grand régulateur
e l’
Eglise abyssine au X I I e siècle , saint Thecla Harma
Iot , ayant décidé que l’
ab ouna serait touj ours un ét ran
er probablement pour év iter le népotisme des gran
les familles féodales il en résulta une situation facile
prévoir . Le clergé abyssin , généralement docte , cu
i eux d ’ études théologiques , qui aurai t inventé la scho
ast iqu e si ell e n ’ avait pas exi sté , se trouva sub ordonné
à des moines ignorants et hautains , sortis des tri stes
ouv ent s coptes où l’
on façonnait encore , il y a cin
quante ans de s eunuques pour les harems mu
sulmans . Sept siècles durant , l’
Ab y ssinie fut stérilisée ,notamment dans la théologi e , le droit et l
’
histoire na
tionale . Les Port ugais , qui , dès le début de
n u m-M n n rla e'ÎRÊA
174 L’
ISLAM ET LES RACES
située dans la province de Tigré , à l’
orient du fleuve
Takazzé, étaient encore puissants à l’ époque des Croi
sades . Leurs rapports avec les Grecs d’
Alexandrie , avec
l ’ empire romain lui-m êm e,av aient été suivis de l
’
ét a
b lissem ent du christianisme en ces régions . En effetdepuis plus de quatorze siècles , le peuple abyssin pro
fesse un rite catholique oriental , où l’ interruption des
rapports avec la chrétienté par suite de l ’ essor musul
man , a laissé pénétrer force superstitions coptes , grec
ques , j udaïques , et même force pratiques pay ennes ou
fétichistes . C ’ est ce christianisme bâtard qui fut intro
duit par les É thiopiens en Arabie Heureuse lors de leur
domination de plusieurs siècles . Il n ’ a malheureusement
pas lai ssé de traces , ayant simplement donné nais
sance aux communautés chrétiennes du Yémen que dét ru isit la conquête musulmane . Les roi s d
’
Axum furent
renversés par les Amharas , race forte , dure et belli
queuse , qui s’
assim ila cependant au peuple subj ugué et
l’
union se fit dans la lutte contre les grands Etats islam ique s qui attaquaient le massif abyssin à l
’
Est et au
couchant , ainsi que contre les Danakil s e t les Gallas ,d
’
abord païens , ensuite musulmans , qui le débordaien t
au midi .
M usulmans et A byss ins . Les premiers rapports
historiques entre les Musulmans e t les Abyssins eurent
lieu vers 6 15—1 6 , quand , à la suite des vexations con
t inue lles de l ’ aristocratie m ekkoise envers les partisans
de Mohammed , un certain nombre de ces derniers du
rent chercher refuge auprès du Négus d’
Ab y ssinie . Le
potentat refusa d ’ ailleurs la demande d’
ex t radit ion faite
par les persécuteurs . Quelques—uns des réfugiés se con
v ert irent au chris tianisme, mais la plupart, restés fidèles
176 L’
IS LAM ET LES RACES
l eurs cro isières , avaient fréquenté les marchés abyssins
en t enant leurs expéditions secrètes et avaient au
XV I e siècle sauvé la monarchie éthiopienne , essayèrent
bien au trefois d’
introduire dans le pays les Jésuites ,mai s ces derniers furent rapidement chassés à cause de
leurs cruautés .
L’
I slam con tempora in . Malgré la christianisation
de l ’Ab y ssinie , un certain nomb re de Musulmans habi
t aient le pays . En 1843, l’
Edin burgh Rev iew signale à
Gondar et dans les villes frontières des marchands —m u
sulm ans et étrangers , mêlés aux commerçants coptes
ou Juifs . En plus , d’
après G . Lej ean , un certain nomb re
de cités de l’
intérieur étaient musulmanes , soit en
totali té comme Derita , Em fras, Alit iou-Amba , Haoussa ,soit en partie comme Gondar ou Mahdera—Mariam . Ces
Musulmans occupaient en ces régions exactement la
même situation subalterne que les Chrétien s en Orient
dan s les é tats soumis à l’
Islam . Restés depuis des
siècles étrangers au métier des armes , ils n’ avaient j a
mais pris par t aux troubles de l’
empire , et se contem
t aient de s’ enri chir par le commerce qu ’ ils avaient en
partie monopolisé . Il est à remarquer d ’ ailleurs que la
moralité privée de ces Musulmans était généralement
supérieure à celle de la population chrétienne . D e même
les villes habitées par eux sont plus riches , plus indus
trieuses . Le commerce s’
y fait avec plus d ’ équité, les
transactions y sont plus sûres et les engagements plus
respectés . Cette supériorité intelligente et morale , dit
l’
Ed in burgh Rev iew de 1843 , leur a acquis la confiance
du gouvernement abyssin qui leur aff erma le revenu
des villes . Cependant par un décret d’ avril 1864, Théo
dore l I proscrivit l ’ islamisme dans toute l ’ étendue de
L’
I SLAM EN ABY S S IN I E 1 77
l ’ empire et déclara rebelles tous les Musulmans qui
n’
apost asiera ient pas en mangeant des viandes signa
lées connu e impures par le Coran .
Il faut voi r, s ans doute, dans cette attitude, une me
sure de représailles contre l’ action offensive des Egyp
tiens, qui de tous temps , s’
e fforcèrent d’ agir sur la péri
phérie du massif et même sur la côte de la Mer Rouge .Quoi qu ’ il en soit, les Musulmans , en apparence du moins ,se soumirent à Théodore I I . Il n
’
en reste pas moins
vrai qu’ ils reprirent rapidement leur c ondition d ’ au
t refois et le commerce musulman est encore florissant
en Ab y ssinie . Comme on le voit, l’
Islam n’
influa pas
b eaucoup sur les destinées de ce pays . I l n ’ en était
pas moins intéressant de mentionner la protection que
les potentats éthiopiens avaient accordée aux premiers
Musulmans et les luttes farouches qu i suivi rent la con
quête arabe de l ’Egypt e , luttes terribles qui se sont
poursuivies j usqu ’ à nos j ours .
Pendant la guerre de 19 14- 19 18,les Allemands tenté
rent d ’opérer eu Ab y ssinie : Ils avaient noué des rela
tions avec le s Musulmans du pays . Le Négus,Jésus
,
faible,dissolu
,se fit Musulman à leur instigation ; une
mission germano-turque se rendit auprès de lui . Mais
u ne réaction chrétienne se produisit et mit sur le trône
l a fille du Négus Menelik,qui restaura la religion chré
tienne . Avec le concours des Français et des Britanni
ques,notamment grâce à la surveillance des navires
de guerre,la mission allemande fut dispersée
,prise ou
tuée . L ’ex—négus Jésus dut s ’enfuir chez les Gallas ; i l
a été tué,dit-on
,dans un combat en 1 920 . Un Turc e t
s a femme,laiss és à Hodeïdah avec un code secret pour
communiquer avec les Al lemands d ’
E thiopie , revinrent
12
1 78 L’
ISLAM ET LES RACES
en 19 15 avec la compagnie de déb arquement de l’
Em
den et regagnèrent Const ant i 11 0 ple avec les marins de
von Mucke . Cette simple histoire permet de constater
avec quel soin les Allemands avaient tendu leur trame
autour des puissances de l’
En t ent e .
CHAPITRE X
LES SULTANATS DE L ’OCEAN IND IEN
De même qu ’ il existe une civilisation,une mentalité
méditerranéenne,il exi ste une unité dans l’Océan Indien
de l’
Oue st le s mêmes in fluences se retrouvent à D j eddah ,
à Souakim ,à Mascate
,à Oman
,à Bombay et à Zanzibar .
La mer réunit le s peuples que les distances terrestres ont
séparés j usqu’ à la construction d es routes e t des chemins
de fer .
Prem iers apports arabes . Malgré des traces d ’ in
fluence égyptienne et chi noise, les chronique s s’
accor
dent à attribuer la fondation des villes de la côte
aux Arabes et aux Persans La j uxtaposition de ces
deux noms n ’ a rien d’
étonnant, car tout l’
Orient est
rempli des conquêtes accomplies par ces deux peuples
unis pour la propagation de l ’ Islam , ou luttant entre
eux pour la suprématie . Dans l ’Afrique de l’
Est , les
Arabes sont les plus nombreux ; mai s la présence de
vrais Persans est établie . Burton a découvert une de
leurs inscriptions près de Tanga des monnaies de mêmeprovenance on t é té trouvées à Mélindi . Bien que ce ne
soit pas une preuve , car les Arabes originaires du sudde l
’
Arab ie auraient bien pu introduire avec eux l’
art
persan , il faut aussi signaler que les mosquées anciennes
(1 ) Le Gre c Pt olém ée v e rs 1 50 av an t J .-C. appelle l
’
Es t a fricain Azu ana e t c i t e le c ap Zin gis . A rappro che r du n om a rab e de
la c ô t e zan y , plurie l zunuy , sem b la b le au persan zang qui sign ifi en o ir (Lan e Po ole ) .
1 80 L’
I SLAM ET LES RACES
de la contrée sont , d’ après Eliott, d
’
architecture pe r
sane et non arabe . La tradition indique Makdishu
comme le plus vieil établissement construit sur la côte
ensuite Kilwa puis un ou deux siècles
plus tard Mombassa , Kilifi, Mélindi , les établissements
de l ’ archipel Lamu , Pate ou Pat t ak , S iu, Faza et Lamu .
Les premiers venus de race sémitique furent les H i
m y ari t es . I l existait, avant l’ ère musulmane , dans l
’
Ara
b ie méridionale , une population pastorale , convertie
en partie au j udaïsme e t hostile au christianisme : les
Himyarites . Chassés de leur pays à une date inconnue ,sans doute par une de ces révolutions intérieures si
fréquentes en Orient, ils avaient émigré tout le long
d e la côte afri caine . Ce sont peu t —être eux encore , di t
M . Lane Poole, qui construisirent Zymb ab ie et le s autres
cités auj ourd ’hui ruinées de la Rhodesia . Les habitants
d’
Oman , ville arabe de l’
Arab ie du sud , convertis au
musulmanisme , suivirent les traces de ces voyageurs .
Oman et Mascate, villes et terri t oires sur la mer,devant un hinterland désertique , ne pouvaient subsister
que par l’
Océan .
Les Om anais u t ilisèrent,comm e refuges , les baies les
mieux situées de la côte . Leurs plus vieux comptoirsfurent ainsi , dit-on , établis par les Emm ozéideS (Ammû
Saïd) d’
Oman . Badger citant le Fut ûh el Buldan ,
raconte que Sa1d et Sule ïm an, chefs d’
Om an , résistèrent
à El Haj j aj , gouverneur de l’
Irak , qu i attaqua leur
pays en 684, mais qu’
à la fin , il s furen t vaincus . Ils s’
em
b arquèrent alors avec leurs partisans pour la Terre
de Zanj où ils fondèrent un royaume musulman . La
(1 ) V . Krapf, Tra vels a ndM iss iona ry la bours , p . 252 Badge r,! mam a nd S ey y ids of Oman , p . XI I Huar t , H is to ire des A ra bes .
182 L’
i SLAM ET LES RACES
mais le Portugais , à tort ou à raison , soupçonna une
perfidie ,et inaugura la longue suite de querelles e t de
meurtres qu i devai t former l’
histoire des relations des
nouveaux venus et des Musulmans de la Ville de la
Guerre : Vasco eut quelque difficulté à entrer dans le
port, son vaisseau fut abordé par celui qui venait der
rière , et les pilotes confessèrent sous la torture qu’
ils
avaient reçu l ’ ordre de couler la flotte .
Le fond de cette aventure est diffi cile à expliquer .
Gama raconte que les pilotes furent mis à la torture .
On leur fit tomber sur la chair nue des gout telet tes de
graisse bouillante : il s avouèrent alors qu e des ordres
avaient été donnés de nous capturer dès notre entrée
au port Correa (1 ) raconte que le cheikh de Mozam
bique avait envoyé un coureur prévenir le sultan de
Mombassa de l ’ arrivée des Portugais,l’
inform ant q ue
Vasco était un brigand . Il est probab le que les Euro
péens, suivant leur habitude en ces temps d’ aventures ,
avaient commis quelques déprédations à Mozamb ique ,
e t que le cheikh avait prévenu ses voisins de se tenir
sur leurs gardes .
Cependant Correa aj oute que, après le départ de la
flotte portugaise de Mombassa , le roi , pour dissimuler
sa perfidie se prit de querelle av e c le s pilotes en la
présence d un Européen resté sur le rivage et ordonna
que ces marins soient battus de verges Le Portugais
qui apparaît dans cette relation était un condamné de
dr oit commun nommé Diaz qu i rej oignit plus tard
les comptoirs indiens de sa na t ion . Il faisait partie de
ces forçats envoyés avec Gama pour être aventurés dans
(1 ) Correa , Leuda s da India , t radu c t ion S tan le y pour la Hakluy t
Soc ie t y , 1879, p . 1 05 .
LES SULTANATS DE L ’OCEAN IND IEN 183
les endroits dangereux où l’
on avait besoin de savoirdans quelle mesure on pouvait se risquer .
S i la relation de Correa e st ex acte , il est difficile de
comprendre pour quel motif le sultan se serai t déclaré
sincèrement navré de ce qu’
il avai t désiré . Il n ’ avai t
aucune raison de dissimu ler sa perfidie ,e t si sa première
intention avait été d’
attaquer Gama , il aurai t proba
blement fait disparaître Diaz . Le fait que le roi de Mé
lindi reçut les Portugais avec autant d’
empressem ent
montre que les indi gènes ne leur étaient pas foncière
ment hostiles . En réalité, quand il se crée des malen
tendus entre Européens et Orientaux, la faute en est
généralement aux premiers .
En tout cas , Vasco da Gama, trouvant que nullerevanche n ’ étai t possib le ,c ingla vers Mélindi ou le sultan
du lieu le reçut avec empressement . Mais il ne voulut
pas toucher terre , par méfiance sans doute , et continua
sa route vers l ’ Inde , piloté par des navigateurs arabes
dont le plus célèbre fut Abd ul Medj id A son ré
t our,l’
année sui vante, il ne s’
arrê ta pas à Mombassa,
mais à Mélindi où il érigea une colonne de pierres en
rem ercîm ent d’ avoir échappé à la perfidie du sultan .
Camoens décrit l’
expédition de Gama dans ses Lus iadœ,
livres I I-V . Dans son livre I I il raconte l ’ essai de
trahi son du roi de Mombassa dont, grâce aux avi s
de Mercure, Vasco fut délivré . Dans les livres I I I-V ,
le navigateur fait au roi de Méli ndi un récit prolix e de
son voyage et de l’
état de l’
Europe . D ’ autres rense i
gnem ent s in diqueraient que les marins arabes qui pilo
t èren t Gama vers l’
Inde lui furent donnés par le sultan
(1 ) V . la remarquab le é t ude de M. G . Fe rrand , I bn M edj id,Pilo te de la m er . Geu thn er , Paris , 1 921 .
mai s le Portugais ,
perfidie et i
port, son vai
fi ère, et les pi
avaient re çu 1’
Le fond de ce t t
Gama raconte que
On leur fit tombe r
graisse b ou illante
avaient été donnés
au port Co rrea
b ique avait envoy
Mombassa de l’ anVasco étai t un b
péens , suivant le
av aien
184 L’
I SLAM ET LES RACES
de Mélindi qui esp érait, en se déb arrassant ainsi des
Européens , ne les voir j amais revenir de l’
Inde .
De nouvelles flottes portugaises suivirent celle de
Vasco da Gama et se m irent à conquéri r le pays pen
dant que d ’ autres continuaient l’
œuvre entreprise dans
les régions indiennes . C’ est ainsi que peu d
’ années après
le passage de Vasco , Mombassa eut à payer durement
l’
accident survenu au vaisseau portugais . La ville fut
mise à sac en 1 500 par Cabral , en 1 505 par Francisco
da Almeida , le premier vice-roi portugais de l’
Inde , en
1528 prise et brûlée après un siège de quatre mois par
Da Cunha , soutenu par le sultan de Mélindi . Vinrent
ensuite une cinquantaine d’ années paisibles pendant
lesquelles Mombassa et les autres villes de la côte purent
sans doute se reconstruire et redevenir prospères,mais
on ne possède pas de renseignements bien précis sur
l’
histoire de cette période .
S uprém atie portuga ise . Le contrôle de la côte
o rientale de l’
Océan Indien n’
en étai t pas moins passé
des mai ns des Arabes entre celles des Portugais . Lesultane deMom b assa était devenu leur vassal ainsi que
les princes de Mozambique, de Zanz ibar, de Kilwa , de
Sofala , de Barawa et de Lamu . En 157 1 , le vaste empireportugais en Orien t était divisé en trois gouvernementsle Gouvernement central , du cap Gardafui à Ceylan
,
avec Goa comme capitale ; le Gouvernement de l’
Est ,
du Pégou à la Chine, av e c Malacca comme capitale enfin
celui de l’
Ouest , comprenant la côte de l’
Afrique de
l’
Est , adminis trée de Mozambique
A ce moment, les Musulmans d’
Egypt'
e s m qu1e t è rent
(l ) Just u s S t rande s , D ie Por tug iesenze it von D e us tch—und
E ngl ish—Os t Afrzka . Berlin , D . Re im er, 1899.
LES SULTANATS DE L ’
OCEAN IND IEN 185
de l ’ avance portugaise . Depuis la plus haute antiquité,
la route de l’
Europe aux Indes passait par l’
Egypt e .
Les marchands romains avaient été des familiers de la
ligne Méditerranée—Mer Rouge-Côte de Malabar . Mai s
l ’ occupation de l’
Egypt e au V I I e siècle par les disc iples
de Mahomet avait coupé les communications com
m erciales entre l’
Europe et l’
Inde de l ’Est les échanges
ne purent se faire que par l’
entremise des Musulmans .
En Occident, les Vénitiens avaient le monopole de cecommerce de transit . La papauté avait défendu toutes
autres relations avec les Infidè les . Aussi dès le x v e siècle,
les Européens cherehè ren t-ils une au tre route par le
Cap de Bonne—Espérance , afin d’
échapper à l ’ emprise
islamique . Et si , en 1487, Bart holomeu Diaz de Novaesdoubla la pointe méri dionale de l
’
Afrique , si Mombassa
et les autres villes de la côte furent soli dement occu
pées, si en 15 10 Albuquerque s’ empara de Goa , ce ne
furent que des épisodes de la lutte séculaire m édit erra
néenne des Chrétiens et des Musulm ans, qui trouvèrent
en ces mers lointaines de nouveaux champs—clos .
Maîtres des mers , depuis le Cap de Bonne—Espérancej usqu
’ en Chi ne, les Portugais j alonnèrent les côtes de
forteresses , qui interdirent le passage,
à tout navire non
muni d ’un passe-port fourni par eux . Les voyageurs
arabes aussi bien que les commerçants européens éssay èrent en vain de chasser les envahisseurs et de ré
prendre leurs anciens privilèges .
Le dernier sultan mameluck d’
Egypt e Kansuh el
Ghuri , furieux de voir lui échapper le monopole du
transit entre l ’Europe e t l’
Inde , essaya d’ intervenir
i l résolut d e chasser les Portugais de la Mer Arabe
Ses appels à la papauté et ses traités avec ell e n ’ ayant
donné aucun résultat, il recourut aux armes . Les Ma
184 L’
ISAM ET LES RACES
de Mélindi qui e spérrt , en se d éb arrassant ainsi desEuropéens , ne les v u j amais revenir de l
’
Inde .
De nouvelles flot i s portugaises suivi rent celle de
Vasco da Gama et s mirent à conquérir le pays pen
dant que d ’ autres co t inuaient l’
œuvre entreprise dans
les régions indiennes . l’
est ainsi que peu d’
années après
le passage de Vasco , .Vl omb assa eut à payer durement
l ’ accident survenu vaisseau portugais . La ville fut
mise à sac en 1 500 pr Cabral , en 1 505 par Francisco
da Almeida , le prem r vice-roi portugais de l’
Inde , en
1528 prise e t brûlée près un siège de quatre mois par
Da Cunha , soutenu ar le sultan de Mélindi . Vinrent
ensuite une cinquanaine d’
années paisibles pendant
lesquelles Mombassa c les autres villes de l a côte purent
sans doute se recons uire et redevenir prospères , mais
on ne possède pas renseignements bien précis sur
l’
histoire de cette péo de .
S upre'
matie porlug ise . Le contrôle de la côte
orientale de l’
Océan adieu n ’ en était pas moins passédes mains des Arab c entre celles des Portugais . Le
sultane deMomb assa tait devenu leur vassal ainsi que
les princes de Mozam ique , de Zanzibar, de Kilwa , deSofala , de Barawa et e Lamu . En 1 571 , le vaste emportugais en Orien t et it divisé en trois
le Gouvernement cenral , du cap
avec Goa comme cadale ; le Gouverne
du Pegou à la Chine, ae c Malacca comme c
celui de l ’Ouest , com renant la côte de
l’
Est , adminis trée de Mozambique
A ce moment, les Msulm ans d’
Egyp
(1 ) Ju st u s St rande s , ll:€ Por tug iesenze it
E n gl ish—Os t Afrika . Berli. D . Re im er, 1899.
186 L’
IS LAM ET LES RACES
m eluks ma in tinrent longtemps une flotte de guerre
dans la Mer Rouge , mais furent définitivement vaincusen 1509 par d
’
Alm e ida . Ce fut la fin du commerce de
transit par l’
Egypt e .
Plus tard,les Turcs cherchèrent à reprendre la m ai
t rise des mers orientales . Pendant qu’
en Méditerranée ,Barberousse battait Doria , le sultan Solin1an I I I fit
construire sur la Mer Rouge par Solim an,pacha d
’
Egy pt e ,
80 vaisseaux pour dominer l’
Arab ie e t menacer les
Indes . Ces navires prirent Aden , ravagèrent le s comp
t oirs portugai s de l’
Inde et rentrèrent a Suez chargésde dépouilles , mais ce ne fut là que des rai ds . Les Por
tugais restèrent les maîtres de la situation . Toutefo is le
v ainqueur portait en lui la germe de son déclin . Les
établissements portugais qu i , depuis le Cap de Bonne
Espérance j usqu’ en Chine , j alonnaient le s mers , n
’ étaient
que des forteresses et des comptoirs commerciaux d’ où
les conquérants ne cherchaient nullement à sortir pour
colon iser dans l ’ intérieur .
Cependant si l ’ on considère qu’ au Maroc
,les Portugais
ont eu une politique indigène remarquable , quand on
constate ce qu’ ils firent avec des moyens m isérab les
,i l
est diffi cile d ’ admettre qu ’ ils ne surent pas établi r dans
l’
Océan Indien une méthode politique suffisante pourpénétrer le pays
,surtout si l ’ on tient compte de
l epoque : XVe siècle
,fin de la guerre de Cent ans . Sans
doute,les Portugais
,attirés par l
’
Inde et par la Chine,ne
considéraient les côtes de l ’OcéanIndien que comme lieu
d’escales
,ou bien encore les Arabes et les Européens qui
leur succédèrent avaient— ils intérêt à leur faire la réputa
tion de cruauté e t d ’ incapacité qu’ i ls ont conservée dans
ces régio ns
Quoi qu’ il en soit
,un pouvoir uniquement basé
LES SULTANATS DE L ’OCEAN IND IEN 187
sur la force ne peut ê tre maintenu que 3 11 empêche
toute puissance ennemie de se développer auprès de
lui ou de l ’approcher . Les Portugai s , menacés en Europe, trouvant sur les mers des rivaux comme les
Hollandais , les Espagnols , les Français et les Anglais ,n e pouvai ent conserver la mai trise de l
’
Océan Indien
que tan t ces régions resterai en t à peu près inconnues en
Occident . Mais en Orient aussi ils trouvaient un redou
table ennemi , l’
Islam . Sur l a côte oriental e de l’
Afrique ,
les Port ugai s virent les Musulmans essayer de retrouver
leur pui ssance .
L es Turcs . Le grand mouvement t ure, q u i
,en
Asie Mineure, rev i v ifia l’
Islam endorm i, n’
eut pas d ’ in
fluence sur les destinées de la côte E st . Le contre-coup
s ’ en fit cependant sentir vers la fin du XV I e siècle par
l ’ apparition de corsaires qui vinrent j ouer leur par ti e
dans le drame monotone du pillage de la côte . En 1 585 ,arriva dans la région un nommé Mirale Beque ou
Ali B ey qui imposa un tribut à Mombassa , Lamu , Faza
et Jumbo (Kismayu) , au nom du sultan ottoman . I l
chassa le s Portugais d’
un grand nombre de leurs établis
sem ent s, et quand il s’
en retourna dans la Mer Rougel ’ année suivante , il y emmena avec lui cinquante captifs
portugai s et environ six cent mi lle livres de butin . Le
vice—roi de l’
Inde envoya de Goa une fl otte qui,ne trou
vant plus les Turcs , brûla Mombassa sans doute pour
la punir d ’ avoir été brûlée par Mirale Beque .
Cette même année arriva du sud du Zam
b èze une tribu de féroces guerriers les Zim b as . On
possède peu de renseignements sur cette tribu . On dit
(1 ) Il sem b lerait qu e le s indigèn e s aie n t pris p our un n om
l’
appe lla t ion hon orifiqu e de c e che f de m e r am ira l b ek
188 L’
I SLAM ET LES RACES
que Madagascar fut envahi et occupé, avant l’arri vée
des Malais, par une tribu appelée Vazimba ou Bazimb a
qui peut être le même peuple .
De 1586 à 1589, ces Zim b as parcoururent l’
Est afri
cain e t atteignirent Melindi . Ils commencèrent par s ’ em
parer de Kilwa dont les habitants furent massacrés .
Après quoi , il s s’
en allèrent assiéger Mombassa . Pen
dant qu’ i ls s
’
y occupaient , campés à Makupa sur la
terre ferme, Ali Bey et ses Turcs revinrent en 1588 .
Ces derniers s’
installèrent à Bas Serani , à l’
extrémité
de l ’ île de Mombassa , et y construisirent un fort .
Quelque temps après , en mars 1589 , Thomas da SuzaCoutinho s ’ en vint à son t our dans ces parages avecvingt navires . Dès lors , il y eut, les uns à côté des autres ,trois rivaux assiégeant plus ou moins la Cité de la
Guerre Il semble que les Zimb as firent d ’ abord cause
commune avec les Portugais pour attaquer les Turcs .
Ali Bey et un certain nombre de ses compagnons furent
pris, les autres chassés .
Les Portugais combattirent alors les Zimb as avec
l ’ aide de la tribu noire des Wasegeju . Les Zim b as furent
entièrement e t à j amais défaits . Les Européens mirentà sac Kilifi
, qui ne s’ en releva pas et aussi encore une
fois Mombassa . Ahmad—Cheikh de Me li ndi fut nommé
roi de cette dernière ville à la place de Shaho ben Misham
, le dernier sultan de la vieille dyna stie
Les Portugais , reconnaissant l’
importance de Mom
bassa,y nommèrent un gouverneur européen et y cons
t ru isirent le fort ou citadelle qu i donne encore sa phy
sionom ie particulière à la ville . Commencé en 1 593, cet
ouvrage fut appelé fort de Jésus . Un blockhaus fut élevé
à Makupa contre la tribu des Wany ika .
188 L’
1 sAM ET LES RACES
que Madagascar fuænv ahi et o ccupé, avant l’arrivée
des Malais,par une i b u appelée Vazimba ou Bazimb a
qui peut être le mene peuple .
De 1 586 à 1589 , es Zimb as parcoururent l’
Est afri
cain e t atteignirent le lindi . Ils commencèrent par s’
em
parer de Kilwa do t les habitants furent massacrés .
Après quoi , ils s’
e r allèrent assiéger Mombassa . Pen
dant qu ’ i ls s’
y occo aient , campés à Makupa sur la
terre ferme,Ali Be et ses Turcs revinrent en 1588.
Ces derniers s’
inst ahrent à B as Serani , à l’
extrémité
de l ’ île de Momb ass et y construisirent un fort .
Quelque temps ap‘
as , en mars 1589 , Thomas da SuzaCoutinho s ’ en vint son t our dans ces parages avec
vingt navires . Dès lœ, i l y eut , les uns à côté des autres,troi s rivaux assiègent plus ou moins la Cité de la
Guerre Il semble ne les Zimbas firent d’ abord cause
commune avec les ort ugais pour attaquer les Turcs .
Ali Bey et un certai nombre de ses compagnons furent
p ris , les autres chases .
Les Portugais cr 1battirent alors les Zimb as avec
l ’ aide de la tribu noie. des Wasege ju . Les Zimb as furent
entièrement et à j al ais défaits . Les Européens mirentà sac Kilifi
, qui ne e n releva pas et aussi encore unefois Mombassa . Aln ad-Cheikh de Melindi fut
roi de cette derniè reville à la place d
ham , le dernier sulln de la vieill e
Les Portugais,reon
bassa , y nomm èr
t ruisirent le fort
le fugitif causa de grands e r:
faisant la guerre de co urse .
ces travaux,l ’ autre relatant cd de la ;
i : æ :r
en 1595 .
188 L’
I SLA ET LES RACES
Les traitants et l es v rageurs arab es qui avaient propagé l ’ Islam parmi les t ribus noires de l
’
intérieur en
allant chercher auprès Pelle s les esclaves et le s pro;
duits précieux de la fo t équatorial e, avaient pu con
t inuer leur commerce v ec les Portugais , mais ces der
niers , en faisant leurs achanges directeme nt avec lesnoirs
,avaient porté a tt u t e aux intérêts des Musulmans
qui , d’ un autre côté
,o aissaie nt avec peine aux Chre
tiens . En commerçan t l es Arabes propageaient leurfoi ; il s profi t è rent de la rem i è re occasion pour secouer
le j oug de leurs oppm seurs disséminés tout le long
d’
un empire maritime l ) p étendu pour eux, menacé de
tous côtés et dans lequ à cause de leurs cruautés, ils
n’
avaient pu se rallie r moun indigène
L’
imamal local . man et Mascate formaien t
alors un seul roy aume , ;uv erné par la famille des Yo
rubi (2) (Yu’
rab i ou Y arub ah) , qui combatt it avecsuccès contre les Pers 5 e t fi t même des incursionsauprès de Bombay . Cet famille appartenait à la secte
musulmane des Ibadhi u Bay azi . D’ après cette secte,
un homme pieux peu atteindre la haute situationd
’
imam sans qu ’ il lui n t nécessai re d ’ appartenir à la
tribu du Prophète ain . que l ’ ex ige le rite orthodoxe .
En vertu de cette doct ris que certai ns sul tans de l’
Inde
proclamèrent aussi de ur côté,et que les Sunnites
considèrent comme hér ique , les dirigeants de Mas
cate annoncèrent qu’
ils « v aient être pontifes aussi bien
que souverains . Leur t re séculaire était seyyid (0 11
(1 ) Pourt an t on re tro… la t ra ce d’
alli an c e s por t uga isesav e c de s ro i s ou des t rib u ndi gè n e s, m ais il sem b le qu e 0 6 5
a ll i an c e s n a i en t é t é qu e M wora ire s .
(2) V . Badge r , ! ma ns .: r Seyy rds of Om a n , p . 93 .
188 L’
I S I M ET LES RACES
Les traitants et les oy ageurs arab es qui avaient pro..
page l’
Islam parmi 1 tribus noires de l’
intérieur enallant chercher aupr«î d
’
elles les esclaves et les pro;
duits précieux de la i rêt équatoriale , avaient pu cou
tinner leur commerce vec les Portugais , mais ces derniers , en faisant leu r échanges directement avec lesnoirs
,avaient porté at inte aux intérêts des Musulmans
qui , d’
un autre côt é.b éissaie nt avec peine aux Chré
tiens . En comm ercan les Arabes propageaient leur
foi ; i ls pro fit è re n t de l prem i ère occasion pour secouer
le j oug de leurs opprsseurs disséminés tout le long
d’
un empire mari time rop étendu pour eux, menacé de
tous côtés et dans leqe l, à cause de leurs cruautés, ils
n’
avaient pu se rallie aucun indigène
L’
imam al local . Oman et Mascate formaient
alors un seul royaume gouverné par la famille des Yo
rubi (2) (Yu’
rab i ou qui combattit avecsuccès contre les Pe rs ns et fi t même des incursions
auprès de Bombay . Cc e famille appartenait à la secte
musulmane des Ib adb ou Bay azi . D’ après cette secte,
un homme pieux pe atteindre la haute situation
d’
imam sans qu ’ i l lui fi t nécessaire d’ appartenir à la
tribu du Prophète ah que l’ ex ige le rite orthodoxe .
En vertu de cette doc1 1 e que certai ns sul tans de l’
Inde
proclamèren t aussi de eur côté , et que les Sunnitesconsidèrent comme hé3t ique , le s dirigeants de Mas
cate annoncèrent qu’ ils ev aient être pontifes aussi bien
que souverains . Leur tre sécul aire était seyyid (0 11
(1 ) Pour t an t on re tro n e la trac e d’
allianc e s port uga i ses
av e c de s ro i s ou de s t rib u indigène s, m ais il sem b le que 0 6 5
alli an c e s n’
ai en t ét é qu e t I poraire s .
(2) V . Badge r, ! m a n s S ey y ids of Oma n , p . 93 .
LES SULTANATS DE ! JEAN IND IEN
moins correctement serd) , p D ou chef . Les ouv e r
tures de la députation des s de la côte ori ental e
d’
Afrique furent nat ure llem e i e n accueillies par cette
famille amb it ieuse ,e t le sey y'
l lt an ben Saïf qui avait
déj à chassé les Portugais de mate , envoya une fl otte
considérable contre leurs p s ion s afri caines .
Entre 1660 et 1690 , de D reux combats furent
livrés pour la prise des ville la côte qui furent in
cendiées suivant la formule l uelle , pendant que les
cités de l ’ archi pel Lama cha a i ent plusieurs fo is de
maîtres . Cependant l’
av anta resta aux Arabes qui ,le 15 mars 1696 , entrèrent s le port de Kilindini
et s’
e fforcèrent d’
enlever lhassa . Ce siège dura
trente—trois mois . Les Eur ns et deux mille ci nq
cents indigènes , parmi lesqu e ro i de Faza , se réfu
gièrent dans le fort Jésus , t 3 que les Arabes occu
paient la ville , Makupa , la c ell e de Nossa SenhoradasMerces au Ras Serain _ l e fort Saint-Joseph à
Ki lindiniLes Musulmans empêcher d
’
entrer au por t quatre
navires portugais qui se s ent è rent a Noel ; en
janv ier , la situation pénible assi égés fu t encore ag
gravée par une épi démie de t e . Tous les Européensmoururent, le commandant, d Antonio Mogo da Melho ,le dernier de tous ; en sep bre 1697, le fort étai t
seulement défendu par le ro e Faza et une poignée
d’
hommes . Juste à ce momen des renforts du Mozam
bique arrivèrent et parv inr à débarquer . Le siège
en fut prolongé de plus de nze mois , mai s la résis
tance fut vaine . Les Arabe énét rè rent dans le fort
le 12 décembre 1698,e t pa vent au fil de l
’
épée le s
(1 ) D’
après Elio t t .
188 L’
ISLAM ET LES RACES
Les traitants et les voyageurs arabes qu i avaient pro
pagé l ’ Islam parmi les tribus noires de l’
intérieur en
allant chercher auprès d ’ elles les esclaves et les pro
duits précieux de la forêt équatoriale , avaient pu con
tinner leur commerce avec les Portugais , mais ces der
niers , en faisant leurs échanges directement avec les
noirs,avaient porté atteinte aux intérêts desMusulmans
qui , d’un autre côt é
,ob éissaient avec peine aux Chré
tiens . En commerçant, l es Arabes propageai ent leurfoi ils profit è rent de la première occasion pour secouer
le j oug de leurs oppresseurs disséminés tout le long
d’
un empire maritime trop étendu pour eux, menacé de
tous côtés et dans lequel , a cause de leurs cruautés , ils
n’
avaient pu se rallier aucun indigène
L’
imamai local . Oman et Mascate formaien t
alors un seul roy aum e, gouv erné par la famille des Yo
rubi (2) (Yu’
rab i ou Ya ’
arub ah) , qui combatt it avec
succès contre les Persans et fi t même des incursions
auprès de Bombay . Cette famille appartenait à la secte
musulmane des Ibadhi ou Bay azi . D’ après cette secte ,
un homme pieux peut atteindre la haute situationd
’
imam sans qu ’ il lui soit nécessaire d’ appartenir à la
tribu du Prophète ainsi que l ’ ex ige le rite orthod ox e .
En vertu de cette doctri ne que certai ns sul tans de l’
Inde
proclamèrent aussi de leur côté , et que les Sunnitesconsidèrent comme hérétique , les dirigeants de Mas
cate annoncèrent qu’ ils devaient être pontifes aussi bien
que souverai ns . Leur titre séculaire était seyyid (ou
(1 ) Pourt an t on re t ro uv e la t race d’
alliance s por t uga ise sa v e c de s ro i s ou de s t rib u s indigèn e s, m a i s Il sem b le qu e c e s
a lli an c e s n’
a ien t é t é qu e t emporaire s .
(2) V . Badge r, ! m ans a nd Seyy ids of Oma n , p . 93 .
188 L’
ISLAM ET LES RACES
Les traitants et les voyageurs arabes qui avaient pro
page l’
Islam parmi les trib us noires de l’ intérieur en
allant chercher auprès d ’ elles les esclaves et les pro
duits précieux de la forêt équatoriale, avai ent pu con
tinner leur commerce avec les Portugais , mais ces der
niers , en faisant leurs échanges directement avec les
noirs,avaient porté atteinte aux intérêts de sMusulmans
qui , d’ un autre côté
,obéissaient avec peine aux Chré
tiens . En commerçant, les Arabes propageaient leurfoi ; i ls profit è rent de la premi ère occasion pour secouer
le j oug de leurs oppresseurs disséminés tout le long
d’
un empire maritime trop étendu pour eux, menacé de
tous côtés et dans lequel , a cause de leurs cruautés , ils
n’
avaient pu se ralli er aucun indigène
L’
imam al local. Oman et Masca te formaien t
alors un seul roy aume, gouv erné par la famille des Yo
rubi (2) (Yu’
rab i ou Ya’
arub ah) , qui combattit avec
succès contre le s Persans e t fi t même des incursions
auprès de Bombay . Cette famille appartenait à la secte
musulmane des Ibadhi ou B ay azi . D’ après cette secte,
un homme pieux peut atteindre la haute situationd
’
imam sans qu’ il lui soit nécessaire d
’
appartenir à la
tribu du Prophète ainsi que l’ ex ige le rite orthodox e .
En vertu de cette doctrine que certains sul tans de l’
Inde
proclamèrent aussi de leur côté , et que les Sunnitesconsidèrent comme hérétique , les dirigeants de Mas
cate annoncèrent qu ’ ils devaient être pontifes aussi bien
que souverains . Leur titre séculaire était seyyid (ou
(1 ) Po urt an t on re t ro uv e la t rac e cl’
aHi an c e s por t uga ise sav e c de s ro is ou de s t rib u s indigène s, m a i s Il sem b le qu e c es
allian c e s n’
aien t ét é qu e t em poraire s .
(2) V . Badger , ! ma ns a nd S eyy ids of Oma n , p . 93 .
LES SULTANATS DE L ’
OCEAN IND IEN
moins correctement se1d) , prince ou chef . Les ouv e r
tures de la députation des villes de la côte oriental e
d’
A fri qu e furent naturellement b i en accueilli es par cette
famille amb it ieuse , e t le seyyid Sultan ben Saïf qui avaitdéj à chassé les Portugais de Mascate , envoya une flotte
considérable contre leurs po ssessions africai nes .
Entre 1660 et 1 690, de nombreux comb ats furent
livrés pour la prise des villes de la côte qui furent in
c endiée s suivant la formule habituelle, pendant que les
cités de l ’ archi pel Lamu changeaient plusieurs fois de
maîtres . Cependant l ’ avantage resta aux Arabes qui ,le 15 mars 1 696 , entrèrent dans le port de Ki li ndini
et s’
e fforcèrent d ’ enlever Momb assa . Ce siège dura
trente-trois mois . Les Européens e t deux mi ll e cinqcents indigènes , parmi lesquels le roi de Faz a , se réfu
gièrent dans le fort Jésus , tandis qu e les Arabes occupaient la vi lle, Makupa , la chapell e de Nossa Senhoradas Merces au B as Seraîn
,e t le fort Sai nt—Joseph à
Ki lindini
Les Musulmans empêchèrent d ’ entrer au port quatre
navires portugai s qu i se présentèrent à Noël ; en
j anv i er , la situation pénible des assi égés fut encore ag
gravée par une épidémie de peste . Tous les Européensmoururent, le commandant, don Antonio Mogo daMelho ,le dernier de tous ; en septembre 1 697, le fort étai t
seulement défendu par le roi de Faza et une poignée
d’
hommes . Juste à ce moment, des renforts du Mozam
bique arrivèrent et parvinrent à débarquer . Le siège
en fut prolongé de plus de quinze mois , mai s la résis
tance fut vai ne . Les Arabes pénétrèrent dans le fort
le 12 décembre 1698,e t passèrent au fil de l
’ épée le s
(1 ) D’
après Elio t t .
18/Ï L’
I SLAM ET LES RACES
derniers survivants de la garnison , soit onze hommes
et deux femmes ! Une fl otte portugaise arriva de Goa
deux j ours après , mais l’
amiral voyant flotter sur le
fort de Mombassa l’
ét endard de l’
Islam , j ugea inutile
d ’ essayer de débarquer et se retira .
Les Arabes occupèrent alors Pemba , Zanzibar et Kilwa
et parvinrent en fait à chasser le s Portugais de toutes
leurs colonies de l ’Est afri cain , sauf de Mozambique .
Des walis ou gouverneurs furent placés par eux dans
les principales villes . Mombassa fut confiée à Nasir ben
Abdallah el Mazrui , chef de cette célèbre famille qui
devait j ouer un si grand rôle dans les destinées politi
ques de la côte lors de la révolte Mazrui en 1895,sous
la domination anglaise .
La prise du fort de Momb assa en 1 698 marque en
réali té la disparition du pouvoir des Portugais au nord
de Mozamb ique . Ils parvi nrent cependant à reprendre
la suprématie pendant deux ans de 1 727 à 1 729 après
plusieurs expéditions malheureuses , ils profit è ren t d’une
querelle entre le s Walis de Zanzibar et de Mombassa
pour réoccuper cette dernière ville ainsi que Pate . Mais
en 1729,1a population de Mombassa rappela les Arabes
qui chassèrent les Portugais pour la derni ère fois .
Une flotte dépêchée par le vice-roi de l’
Inde fut dé
truite par un ouragan . Une expédition envoyée de Mo
zamb ique pour reprendre Mombassa j ugea plus pru
dent de s ’ en retourner sans toucher terre .
Les Arabes , somme toute, n’ eurent guère de diffi 4
cult és à remplacer les Portugais sur la côte orientale
d’
Afrique . Ces Européens , comme touj ours tyranniquese t brutaux envers le s indigènes , étaient détestés par
eux . Il faut cependant signaler que souvent des naturels
contractèrent de s alliances avec eux , et que , non seu
194 L’
I S I .AM ET LES RACES
qu ête arabe en ces régions ne présente plus le caractère
de guerre sainte pour la propagation de la foi qui l ’ ani
mait en Afrique du Nord ou dans l’
Inde , il n’
en reste
pas moins vrai que les Arabes avaient un esprit env a
hisseur que ne connaissai ent pas les Portugais .
Les marins de Mascate et d ’
Om an étaient accout u
m és à parcouri r ces mers connues par leurs ancêtresdepuis des siècles . Le petit nombre des Arabes étai t
compensé par leur union et par l’ adaptation imm édiate
des nouveaux convertis à l ’ Islam . Ils ne se bornèrent
pas à s ’ installer sur la côte, mai s bien armés , pene
t rè rent sans crainte dans les forêts et les brousses de
l ’ intérieur, accaparant la direction des caravanes , le
commerce des esclaves , as suj et tissant parfoi s les tribus
lointaines en fondan t des royaumes de leur foi , po rtant
dans l ’Afrique séculairement ignorante, l’ écriture cora
nique , première apparence de civi li sation pour la pri
m it iv it é des noirs .
En dehors de la tentative, dont nous avons parlé ,des Portugais pour réoccuper Mombassa , une partie du
XV I I I e siècle se passa sans événement notable . Il y eut
naturellement de petits comb ats, mais sans plus d’ im
portance que d ’habitude . Ce fut une pério de d’
indépen
dance arab e sur la côte occidentale de l’
Océan Indien .
Mais comme on pouvait s ’y attendre en pays musul
man , suivant la similitude dans l’ évolution qui a régi
le s peuples ralli és à la foi de l ’ Islam , les li ens de vassa
lité qui unissaient la côte à Mascate se relâchèrent de
plus en plus j usqu’ en l ’ année 1740 . Alors Othman ben
Mohammed , le gouverneur Mazrui de Mombassa , et le
roi Nab ahan de Pate se déclarèrent indépendants . Non
moins natu rellement,les rebelles se mirent à lutter
entre eux pour la suprématie sans qu ’ il y eût de résultatappréciable .
LES SULTANATS DE L ’OCEAN IND IEN 1 95
Cette séparation co i ncida,sans doute
,avec une rév o
lut ion à Oman , révolution qui eut une grande impor
tance sur les destinées de l’
Est africain . Les Yorub i
furent remplacés sur le trône par les Bou Saïdi ou Ahl
Bou Sai di (ah] signi fi e famille) ,dont descendent , à l’heure
act uelle,les sultans de Zanz ibar . D
’
ab ord , ces Bou Saïdi
n e s’
occupèrent pas plus de leur domaine que ne l’ avaient
fait les Yorub i , mai s en 1785 , l’ imam Ahmad ben Saïd
se rendit à Mombassa e t força les Mazrui à le recon
naître comme souverain . Par la suite, les sultans eurent
sans doute en Arabie un certain nombre de difficultés
diffi ciles à résoudre , car Saïd b en Soltan , cinquième dela lignée , prit la résolution décisive de transférer sa
capitale à Zanzibar . Cette déterminati on eut pour pre
mier résultat d ’ accroître l ’ importance de l’
Est afri cain
en général , et de Zanzibar en particulier .
CHAPITRE X I
LE SULTANAT DE ZANZ IBAR ET MADAGASCAR
I . ZANZ IBAR .
Jusqu a cette époque , 1 11e de Zanzibar n’
avait j oué
qu ’ un rôle minime dans l’
histoire de la côte . Son nomSouahéli est Unguj a ou Terre des Noirs . Zanz ib ar estune variation de Zang ou Zanj en dialecte arabe . L ’ île
est très fert ile,m ais par malheur n
’
a pas de bons ports
et est très malsaine .
Zanzibar fut d ’ abord conquis pour le compte desPortugais par le corsaire Rav asco en 1503, puis défi
nit iv ement par da Lamos,six ans plus tard . En
réalité , les Portugais ne se soucièrent pas d ’y résider .
En 1 635 , le sultan de l’ île se rendit indépendant
,quoi
que en bons termes avec les Européens . Les Chrétiensfurent d ’ abord tolérés par lui dans ses possession s
,
mais vers 1 660, ils furent chassés ou massacrés .
Après la conquête de Mombassa par les Yorub i , Zan
zibar tomba aussi entre leurs mains et fut gouverné
par des walis envoyés d’
Arab ie . Au moment où SeyyidSaïd ben Soltan décida d ’y établir sa capitale , il n
’y
avait là , dit-on , qu’
une rangée de huttes en guise de
ville . Le prince fut sans doute guidé dans son choix
par l’
i dée que dans cette île négligée , il ne trouverait
pour le gêner dans son autorité aucune vieille famille
de dirigeants , comme les Mazrui . de Mombassa,ou les
grands de l’
archipel Lamu . De plus , la situation de
198 L’
ISLAM ET LES RACES
nale . Ne pouvant en finir par 1la force, il employa l a
ruse . L e gouverneur Mazrui et vingt—six des membresles plus importants de son parti furent attirés par de
faux serments sur le pont d’
un navire,et condui ts au
Golfe Persique sur les rivages duquel il s périrent en
exil . lCe t t e perfidie‘
brisa la puissan ce d es Mazrui,e t l
’
o n
n’ent endit presque plus parler d’ eux j usqu ’ en 1895
ils quit tèrent Momb assa . La branche aînée s ’ ét ablit 'à
Gas'
i au sud,=et la c adett e à Takaungu ,
au nord .
La dernière partie du règne de Saïd se passa à opérerdans ‘les îles d e l ’ archipel Lamu
,»où l
’
o ccupè rent une
suite i ninterrompue d ’ alliances compliquées , d e que
relle s —e t de gue rres peu claires . «Les habit ants d e l ’ ar
chipel , l’ aristocratie Nab ahan ,
‘
les Somali s et Sard,furent
continuellement en guerre les uns contre les autres . Enparticulier, les gens de Pat e , qui avaient rappelé l e sul
t an à leur aide c ont re ceux de Mombassa , s e révolt èrent
contre lui . Pat e e t Siu ne se soumirent à Zanzibar qu ’
en
1866 .
Sai d mourut en mer,—eu 1 856 . dans u ne croi si ere près
des î les Seychelles . *Ce fut sans aucun doute , dans l’
Est
africain,l’
Arab e le plus éminent «des temps modernes .
Int elligent, brave , tolérant puisqu’ il protégea les mis
sions chréti ennes , disposé à e ncourager le c ommerce ,il montra pendant son règne de réel les qualités dechef d
’
Et at encore qu’
ent achéesp arfois de perfid ie . Sontestament divisait son empire Oman était «donné a s on
fils a îné , Seyyid Twain ou Thuwayni ; Zanzibar et lacôte restaient au plus j eune de ses fils , Medj i d . Les de ux
frères entrèrent en rivalité et recoururent à l ’ arbitrage du
v i ce—roi de l‘ Inde , lord Canning, qui reconnut la validité
du t est am ent,e t déclara Zanzibar indépendant d ’
Oman .
L"arb it rage de lord Canning e t la division de l ’ em
LE SULTANAT D E ZANZIBAR ET MADAGASCAR 199
pire de Saïd marquent la date du déclin de la pui ssance arabe en Océan Indien . Le s Musulmans
,qui avaient
pu repousser les Portugai s et résister aux attaques des
Européens aux XV I I e e t XV I I I e siè cles,v ont pe rdre le
pouvoir temporel devant les grandes nations occide n
tal es modernes .
La pénétration europ éenne commença,vers le mi
lieu du X IX e siècle,par la série de grandes exploration s
qui ouv rirent aux Européens l ’ accès du conti nent noir .
De la côte orienta le d’
Afri que partirent les pionni ers
qui soulevèrent le voile dont furent si lo ngtemps revêtus
les Grands Lacs et les Sources du Nil . De hardis géographes e t missionnaires su iviren t les traces —des m ar
chauds d’
escl aves arabes en partant du p ays ci—de vant
allemand . Ce furent en 185 7 l’
Al lem and Krapft , les
Anglais Burton et Speke , Grant et Baker en 1864, en1882 le docte ur allemand Fishe r, e nfin en 1887 le
Hongrois Tleki . Et j e ne parle pas des Livingst one,des Slatine pa cha
,des Cameroun qui s
’
imm ort afisè rent
par leurs hardis voyages .
Ces explorations attirèrent l’
attention des gouverne
ments europée ns sur la côte e t en 1885,1’
Aflem agne ,
soucieuse d’
inaugure r une politique coloniale, profita
des traités que les marchands germai ns avaient signé
avec des chefs indigènes . Une charte de protec tion fut
accordée à la Société de coloni sation allemande quiavait acquis le dro it d
’user de ces traités .
D e son côté , l’
Angle t erre ne restai t pas inact ive . En1872, sous la suzeraineté de la v i ce— royauté de l ’ Inde ,la British India Steam Navigat i o n Company avai t
établi une ligne de navigation entre l ’Europe , Zanzibar
et l’
Inde . Cette Société fini t par obtenir du sultan une
conc ession de t errito ire . Le gouve rnement britannique ,
200 L’
ISLAM ET LES RACES
dit Eliott, ne fut pas d’
abord favorable à cet arran
gement . Cette même année 1877 vit la suppression de
la traite , acte gros de conséquences pour les Musul
mans de la côte .
En effet un des plus gros revenus du Seyy id était latax e imposée aux marchands d
’
esclaves , et ces derniers ,Arabes pour la plupart, formaient la plus grande partiedes riches influents de l
’
E st africain . La suppression de
la traite causa des troubles sans nombre dans la région ,mai s la victoire demeura à la cause de l
’
humanité . Il n ’ en
reste pas moins vrai que si les croisières des navires deguerre empêchèrent l ’ enlèvement des noirs sur une aussi
grande échelle qu ’ auparavant, Zanzibar resta pendant
longtemps encore un important marché d ’ esclaves , et
que sur la terre ferme, l’
esclavage sub sist e j usqu’
en ces
derni ères années .
L’
Angle t erre avai t fait , en 1875 , des représentations
à l ’Egypt e qu i avait inauguré une politique de conquête
en ces régions . Le khédive Ismai l Pacha , celui qui essaya
d ’ envahi r l’
Ab y ssinie et remplaça les soldats turcs
par les siens dans les postes de la côte africaine de laMer Rouge, voulut annexer la région nord de l
’
Est afri
cain e t y envoya quatre navires sous les ordres d’un
Ecossais du nom de Mac Ki llop Pacha . Cet officier dé
b arqua des troupes à Ki smayu et occupa la bouche du
Juba pendant environ trois mois . Mais devant les représent at ions de la Grande—Bretagne, l
’
Egypt e rappela ses
émissaires .
Les visées de l ’Anglet erre se firent bientôt j our, et
en 1886 fut signée avec l ’Allemagne , suivant l a poli
que d’
expansion conseillée par Bismarck,une conv e n
tion pour le partage de la côte .
Les possessions du sultan , c’ est-à-dire Zanzibar, Pem
202 L’
I SLAM ET LES RACES
Les Anglais , les Allemand s e t le s Italiens , s etant ai nsi
partagé les dépouilles des Sey y ids, n’
eurent plus qu’
à
s ’ organi ser en ces pays musulmans cédés à leur influence .
A la suite du meurtre de dix Allemands à Witu à la
fin de 1890 , une expédition britannique o c cupa les li eux .
Des missionnaires ouvrirent la route de l’
Ouganda qui fu t
bientôt occupée par la Briti sh East Afri ca CompanyEn 1893 , à la suite de l
’ expédition de sir Gerald Portal ,la Compagnie passa ses privilèges au gouvernement bri
tannique . En 1894 le protectorat fut proclam é , e t un
chemin de fer,comm encé en 1895
,atte ignit les Grands
Lacs en d écembre 1 901 . Il allait d e Mombassa à Port
Florence .
De mêm e la « Deutsch Ost Afrikanische Gesellschaft
v u les difficultés soulevées par l ’hostilité des trib us noi
res guerri ères , étai t b ientôt remplacée par l’
Et at alle
mand . D eux chemins de fer étai ent rapidement pous
sés : l’
un de Dar es Salam atteignait le Tanganika,et
l’
autre de Tanga le Kilimandj aro .
Mais les Musulmans avaient essayé de réagi r . Les
Mazru i et leurs partisans n ’ avaient que diffi cilementsupporté l
’
intrusion des Européens . L ’ activité mal com
prise des mi ssionnaires chrétiens servit de base aux
haines soulevées par la venue des étrangers , exacer
bées par la suppression de la traite . U ne révolte éclata .
Les Mazrui avai ent touj ours foi en la grandeur de leur
famille . Ils ne craignirent pas de lutter .
En 1895,Rachid ben Selim fut nommé par les An
glais wali de Takaungu , résidence de la b ranche ca
dette des Mazrui . Mai s les Arabes qui désiraien t comme
chef son parent,Mbarek de Tafaungu , candidat par
droit de primogéniture , prirent le s armes . Le soulève
ment dev int particulièrement grave quand la b ranche
LE SULTANAT DE Z ANZIBAR ET MAD AGA SCAR 203
a înée des Mazrui , celle d e Gasi , se j oignit :aux dissi
d ents . Mbarek de Gasi fut vaincu en 1896 par les An
glais,et Mb arek de Tafaungu se réfugia e n territo ire
allemand .
La rébellion d es Mazrui est un fait capi tal de l ’ b i s
t oire musulman e en ces régi ons . A la suite de leur v ie
toire sur les chefs indigènes , les Européens prirent tout el ’ influence j usqu
’ alo rs réservée aux Arabes . Avant ces
événements , la côte formait un Etat musulman protégé
c e ne fut ensuite qu’
une série de colonies divers es .Cette même année 1896 , Zanzibar étai t en p roie à la
guerre . A la m ort de Sultan Hamid b en Twain, son
parent Khalid usurpa le trône et s’
empar a du palais
a vec des forces armées . Il ne voulut pas se re ndre aux
représentations anglaises : la ville fut b omb ardée par
la flott e britannique Khalid s ’ enfuit au c onsulat
d’
Allemagne , et de là sur le territoire d e l’
Afrique ger
manique . Sultan Hamid fut placé sur le trône . A sa
m ort, il fut remplacé par son fils Ali qui avait été élevé“à Harrow en Angleterre .
En 1 897,eurent lieu les dernie rs événements m ili
t aires q ui intéressent l’
Islam . Le mouvement mahdiste,
qui fut ar rêté à Khartoum par lord Kit chener , a v ait
gagné l’
Ouganda . Emin Pacha avait laissé des fo rcesdans c ette région pour lutter contre les Mahdistes . Ces
troupes mal payées se révoltèrent . Les rois d’
Ouganda
e t d’
Ouny oro se j oignirent à elles . La guerre de répres
si on ne fut terminée qu ’ en 1899 . Ce fut le dernier effort
m usulman
(1 ) On v oy ai t e n c ore e n 1 912 à Zan zib ar, l e s t rac e s du b omhardem en t e t e n rade le s m â t s d
’
u n b â t im en t‘
c ou lé .
(2) Le pro t e c t ora t an glais sur Zan zib ar a ét é é t ab li e n 1890 .
Le pro t e c t ora t sur la cô t e e t l’
Ouganda dan s le s lim it e s a c t u elle se n 1 902.
204 L’
I SLAM ET LES RACES
A l ’ heure actuelle , il ne reste plus rien de l’ ancien
empire de Mascate et d ’
Oman . Le sultan est bien tou
j ours à Zanzib ar,m ais il règne dans un palais délabré
sous la surveillance de l’
Angle t erre . Les traitants arabes
e t les marchands,hindous venus s
’
installer dans l’
île ,n ’ en avaient pas moins réussi à faire de l ’ île le plus
grand entrepôt de l’
Océan Indien occidental . Cette su
prém at ie commerciale s’ est gardée souveraine j usqu ’ en
c es dernières années,où l
’
activité allemande a réussi
par des services directs entre Dar es Salam et Hambourg à échapper au contrôle du vieux port arabe . S iles marchands musulmans ne font plus dans l ’Afrique
équatoriale de ces longues randonnées qui aboutissaien t
à la ruine de régions entières ou à la création de v éri
tables royaumes , Si les caravaniers arab es ne ramènent
plus à la côte les ivoires,les plumes , les gommes et les
épices , leur activité est cependant restée entière . L ’ in
dust rie de l’
Islam n ’ est pas morte en c es contrées . Elles ’ est transformée : les Arabes ne sont plus les maîtres .
Mais ceux qui en Ab y ssinie ont su conquérir le contrôle
du marché sous un gouvernement hostile à leur foi ,ont, sous l
’ autorité bienveillante de l’
Europe , continué
à commercer et leurs efforts sont marqués de succès .
Au point de vue reli gieux, l’
Islam progresse encore
en Afrique équatoriale où il est en compétition directe
avec le christianisme . On a remarqué en effet que si
ce dernier fait de grands progrès dans les tribus qui
n’
ont encore reçu aucune foi monothéiste , i l lui est di ffi
cile d’
entamer les adeptes de l’
Islam . Les Arabes et
les Souahéli s sont généralement dans l’
Est africain de la
foi orthodoxe (Sunnis) , mais certains sont Ib ahdis
(1 ) Cfr. Badge r, ! ma ns a nd S eyy ids of Om a n,Appendic e B .
206 L’
I SLAM ET LES RACES
la côte , Ram inia et sa sœur seraient venus de La Mekk e
à Madagascar à la suite de la défaite des Alides au
V I I e siècle . Ils auraient laissé sur place une j arre en
terre et un animal en pierre qui renfermerai t des ma
nuscrit s arabes . En tout cas , semble—t —il, au XV I e siècle
le pays des Ant em oros était peuplé de ces Zafy Raminia .
Les Ant emoros conservent le Sorabe (probablem entcon traction de Sourate et de bé grand) , texte sacrémalgache de prières et de légendes écrit en caractères
arab es . Ils ont des amulettes avec sen tences écrites en
arabe .
Les Arabes Zafy Ram inia e t Zafy Kaz im ando , les
quels , d’
après la légende , vinrent plus tard de La Mekke
ou de l’
Est afri cain,s’
alli èrent aux femmes noires du
pays . Admettant la pluralité des épouses , ils créèrent
ainsi une race métissée . Dans l ’ extrême sud de l ’ îl e ,habitèrent les Anosy, rameau détaché des Zafy Ram inia .
S ’
il entre une grosse part de légende dans ces récits ,il est certain que les croisières de Mascate et d
’
Om an
touchèrent les Comores etMadagascar ,e t l’
Islam vint avec
elles . L ’
Islam se répandit facilement dans ces îles aux
populations métissées d ’arabe . Il faut sans doute at t ri
buer aux Omanais de la première époque la const ruc
tion de ces villes auj ourd ’hui disparues , dont les rui nes
ont été récemment signalées , notamment dans le Sumbirana (côte ouest) .
Madagascar et surtout la côte Ouest sont peuplés de
nombreux Anj ouanai s et C'
om oriens musulmans et
même d ’
Hindous chy i t es , dont les cérémonies ri tuelles
notamment pour l ’anniversaire de la mort d’
Ho ssein
sont caractéristiques en ces parages .
La loi du 12 j uillet 1912 a déclaré les îles Comores
LE SULTANAT DE ZANZIBAR ET MADAGASCAR 207
colonie française . Le sultan des Comores , Sa i d Ali , sev i t assigner comme rési dence Tananariv e où il habite
avec sa cour près de la mosqué e . Décoré de la Légion
d ’honneur, i l est pensionné par la France et groupe au
tour de lui un noyau musulman .
L ’ influence arab e a également touché la race conqué
rante des Hovas . C ’ est ainsi qu’ en langue hova , les j ours
de la semaine ont une appellation venue de l ’ arab e
H ova
Ala hady
Ala t sinanyAla talata
Ala robia
Ala kani syAla zoma
Ala sabotsy
Ala signifie j our en hova , i oum a le mêm e sens en
arabe . Les noms arabes désignant le zodiaque ont formé
également les mots hova indiquant le s lunes ou mois .
De même,quant it é d
’ expressions qu ’ il serait oiseux d ’
énu
m érer ! Un mot , baraka , le don divin de b énédiction
des Arabes , est passé en hova avec le sens de conside
ration ! Cette influence linguistique arab e avait été
déj à remarquée dans l’
Hindoust an où l’
urdu , langue
créée de toutes pièces pour servir de li en entre les dif
férent s peuples de la p éni nsule, fut formé de mots ara
bes,persans et hi ndous .
Les Hovas ont dans leur rite la circoncision , em
ploient la même coupe de cheveux que les Musulmans .
Il serai t infiniment intéressant d ’ étudier la Magie dans
la religion à Madagascar pour y rechercher les in
A ra b e
l oum el had .
l oum e t -tni ne .
l oum e t —tlata .
l oum el arba .
l oum el khemis .
l oum el j emaa .
l oum es— sebt .
208 L’
IS LAM ET LES RACES
fluences islamiques . I l serai t également curieux de
déterminer les apports réciproques des Musulmans
a rabes et des Musulmans hi ndous,nombreux dans l
’
île .
CONCLUS ION .
Tels sont les aboutissants de l ’ expansion arabe dans
l’
Océan Indien . L ’ étab lissement des nations européennes
sur les ruines de l’
empire des Seyy ids a déçu les espoirs
des Musulmans de la côte orientale qui , dépossédés de
toute influence politique, ont transformé leurs énergies
guerrières en énergies commerciales . Zanzibar, Dar es
Salam furent les points de départ des intrépides traitants arabes vers l
’
intéri eur du continent noir . Or,l’
ab out issant d’
une société composée d’
explorat eurs,
c ’ est le choix par ceux-ci du mode d’
exploitation le plus
commode et le plus rémunérateur (Prév ille) . Ce fut
l’
ab outi ssant des sultanats arab es de l’
Océan Indien
auxquels les Européens vinrent disputer les routes comm erciales dans la Croisade des Epices
2 10 L’
I SLAM ET LES RACES
des marins intrépides allaient chercher au fond de la
Me r Noire , sur les rives de laquelle les apportaient les
caravaniers mystérieux de terres ignorées, que des voya
geurs entreprenants achetaient en Egypte , sur les bordsde la Me r Rouge ou du Golfe Persique , figuraient les
épices , les aromates , inestimable cadeau que l’
Ori ent
faisait à l’
Occ ident , et dont ce dernier ne pouvait plus
se passer
VEN I SE . LE M ONOPOLE DES ÉP ICES .
Ven ise . Les deux zones d echange entre l ’Orient
et l’
Occident étaient donc la Mer Noire et la Mer Rouge,
trait d ’union entre l’
Europe et la Chine ou l’
Inde loin
t aines .Byzance , Alexandrie , au débouché des deux rou
tes commerciales , étaient les centres du marché . Mais
le monde latin n’
existait plus , la période antique avait
fai t place à l’
âge médiéval : l’
empire d’
August e avait
disparu sous les coups des Germains ; seul subsistait
celui des Byzantins , lequel étendait à l’
Ouest ses do
maines j usqu’
à l’
Adriat ique . Dans cette disparition des
pouvoirs établis par Rome , l’héritière du grand com
merce méditerranéen fut la seigneuri e de Venise, fondéevers 813 après Jésus—Christ .
Vassale de Byzance , Venise échappa à toutes les vi
(1 ) L’
Egy pt e pha raon iqu e av ait e u déj à sa cam pagn e des
épic e s . Le s scu lp t ure s du t emple de la re in e Ha t shopsi t o u àThèb es r eprésen t en t le pay s de Poun t duqu el un e e sc adre de
cinq n av ires lui rapport a 31 a rb re s à en c ens. de s m on c eaux d e
gomm e s arom a t iqu e s, de l’
éb èn e , de l’
iv o ire , d e l’
or v er t , de s
b o is préc ieux , d e la poudre d’
an t im o in e , de s singe s, de s lév rie rs ,des pen i x de léopard .
Ce t t e énum éra t ion , quinze siècle s av an t no t re è re , définit le sépic es m ais oub lie la soie . Le pay s de Poun t é ta i t e n Afriqu ee t serait prob ab lem en t l
’
Ab y ssin ie ou un t e rri t o ire plus au su d
LA CRO ISADE DES EPICES 21 1
cissit udes politiques des royaumes d ’
Oc cident . Cha r
lem agne , aprè s l’
avoir soumise, dut la resti tuer à l’ em
pire gree , et la se igneurie sut bient ôt s’ aff ranchir de la
tutelle byzantine . Ma lgré la rivali té de Pise et de Gênes ,Venise , de par sa situation maritime priv i légi ée , e t par
le génie de ses doges , se créa une influence preponde
rante sur les relations commerc ia le s d e l ’Europe avecl’
Orient . Par les tra ités de l ’an 992, signés avec les
Byzantins , Venise devint l’ intermédiaire obligé des
achats et des ventes .
S on m onopole comm ercial. Le dével oppement de
l’
expansron musulm ane vint troubler cette situation
un ique . L’
interdiction fut souvent donn ée p ar la pa
pau té de nouer des relations avec le monde islam i que .
Mais Veni s e, orientée vers Byzance par sa première
vassali té , brava la d éfense des Pap es de la mani ère
la plus catégor ique,e t resta t ouj ours dan s une po si
tion intermédi aire qui lui permi t de continuer à en
voyer se s navi res , ses marchands, ses ambassadeurs ,dans les ports et les vill es conquis p ar l
’
Islam . D es
conventions passées au mil ieu du av ec les
princes d’
Europe , notammen t avec les em per eu rs a lle
ma nds , lu i assuraient l e comm erc e continental de s épi
ces . L ’
in fluence politique de la Se igneu rie, ses conquête ssur les côtes d
’
Europe et d’
As ie , ses bases navale s
dans le s île s de la Méditerranée, lui donnai en t le
contrôle de la me r. La papauté dut recon naître à
Veni se , dan s son in terdiction de n ouer de s relation s
ave c le monde islam ique, le droit, le mono pole ex clusif , de
con tinuer av ec l es Musulmans les échanges accoutumés ,
tellemen t l ’Occident avait besoin des épices et des aromates .
2 12 L’
I SLAM ET LES RACES
Les routes des ép ices . Les conquêtes des Arabes
en Asie Mineure , en Egypte, interposèrent peu à peu
l’
Islam comme un écran entre l’
Orient bouddhique et
l’
Europe chrétienne Constantinople tenait touj ours ,
mais les deux grandes routes commerciales par les
quelles arrivaient à la Méditerranée les produits de la
Chine et de l’
Inde étaient fermées .
Les combats , les luttes , les révoltes qui se succédèrent
en Asie antérieure pour la chute des anciens empires
et la formation de nouveaux peuples , interdirent le
passage aux convois de commerçants . La route du Pé
Lou , ou Pent apole , celle du Nan—Sou , ou Hexapole ,
devinrent définitivement impossibles à fréquenter, lors
qu’
au X I I I e siècle les khanats de Transox iane se déve
loppèrent . La voie fut rouverte un instant par l’
orga
nisat ion méthodique des souverains mongols, successcurs de Gengis-Khan , pour se refermer de nouveau
lorsque les Khans , ayant opté pour la Chine bouddhi que,allèrent résider à Pékin , . abandonnant les régions nes
t orienne , musulmane, de l’
Occident de leur empire .
Restait la rou te de la Mer Rouge et du Golfe Persique par l
’
Egypt e . Les Arabe s, j adis caravaniers par
nécessité et par habitat, connaissai ent la val eur des
importations , celle des exportations , savai ent encore
mieux l’
importance considérable du transitaire, l’ in
t érêt à tirer de leur situation d ’ intermédiaire . Les Vé
mitiens , libres , par suite des privilèges de 1082 , d’
ache t er
et de vendre sur tous les territoires de l’ empire grec
sans payer aucun droit, cherchaient le moyen de s’ in
t roduire complètement dans l ’Orient musulman que
pénétraient déj à leurs marchands , allant àDamas, à A1ep,
(1 ) Lou is Au b er t , Pa ix j apona ise , Colin , Paris, 1 906 .
LA CRO ISADE D ES Ép rc r: s 2 15
l’
Occident , la République de Venise, se heurtait dansle développement de ses a ffaires à des d iffi cultés sans
nombre . Le s Hongro is éta ient arriv és qui at t e igni
rent l a Suisse et les Alpes à l’
Adriat ique , occupaient
Zara (1 170) les Allemands, sous l’
impulsi on d’
H enri VI ,fils de Barberousse , formaient le rêve presti gi eux d
’une
Allemagne oc cupant Thessalonique , Constanti nople et
la Terre sainte les Pisan s faisaient une concurrence
acharnée sur les routes maritimes , combattaient sans
répit les flottes des doges ; les Byzantins , après avo ir
été les protecteurs de la République , n’
avaient plus
qu’
injures et dédains pour elle les Arabes , d ivisés par
l ’ abaissement du khalifat en monarchi e selj oucide ,n ’ ex istaient en Méditerranée que sous l
’
autorité des
s ouverains d’
Egy pt e . Veni se devait donc, pour ouvrir
à nouveau la route de s épices , se débarrasser des Hou
grois , abaisser Constan tinople , diminuer l’
in fluence des
Egyptiens . La seigneuri e y employa tou tes se s forces hab ilem ent dirigées par le doge Dandol o (1 192 Sonacti on fut particuli èrement int éressant e dans la qua
t rièm e croisade .
Le pape Innocent I I I avait prêché la qua trrem e croi
sade à laquelle s’
étaient ralliés Philippe—Auguste de.
France , Richard Coeur de Lion d’
Angle t erre , Otton IV
d’
Allemagne . La mort du fils de Barbe rousse avait l‘
ait
disparaître avec lui son plan de dominati on universelle
et le nouvel empereur allemand avait promis son cou
cours . L’appa i des Vénitiens , maîtres à nouve au de la
m e r par leurs récentes vic toires sur les Pisans , étai t né
c e ssaire aux Croisés pour passer en Asie . En 120 1 , la
Seigneurie sut persuader à leurs chefs que les clefs de
Jér usalem étaien t à Constanti nople‘
et au Cai re .
En réalité , le fait était exac t . Les derniers Abbas
2 14 L’
i SLAM ET LES RACES
Le moment de la prédication était bien choi si . La
chrétienté avait vécu dans l’
attente de l’
anéant issem ent
général qui devait survenir en l’
an 1000 . La j oie de se
re trouver vivant aprè s , la date fatidique détermina
chez lesp euples d’
Oc c ident une explosion de sentiments
qui se manifestèrent par une renaissance des lettre s,des arts
,un réveil expansif de la foi A cet instant
pr écis , la nouvelle des cruautés commises en Terre
Sai nte pa r le troi sième souverai n fat imide d’
Egy pt e ,
El—Hakim , oub lieux de la tolérance hab ituelle musul
mane,proc -a ra aux souverains—pontife s le moyen de
fournir au monde chréti en le dérivatif nécessaire à sa
nouvelle activi té . La papauté crut le moment venu dereprendre à l
’
Islam les Lieux saints du christiani sm e .
C ’
étai t en: mêm e temps l ’ occasion de détourner de
l’
Europe vers l’
Asie la féodalité franque e t germanique
dont les princes ,. d’
une religion sans doute profonde mai s
irrespectueuse , ne craignaient pas d’ attaquer l a sou
v erai ne t é temporell e et même spirituelle de s successeurs
de Saint Pierre Si donc les premières Croisades, lacolonisation de la Syrie qui suivit, furent de s mouvemen ts dus à l ’ enthousiasme reli gieux, il n
’ en reste pas
moins vrai qu elles eurent des causes politiques e t éco »
nom iques impo ss ibles à nier, et qu’ entre autres rai sons ,
l’
influ ence de Venise ne fut pas étrangère à leur dév e
loppement .
I nfluen ce de Ven ise sur les Croisades . En effet ,la maîtresse du commerce de s épices entre l
’
Orient e t
(1 ) V . Du ruy , H is to ire de F ra n ce .
(2) Les Cro isés n e t rouv èren t pas dev an t eux l’
E t a t selj ouc 1de déj à dét ru i t , e t le s Egypt i en s furen t souv en t leurs alliés .
Ils euren t donc des crrc on s tan ces t rès fav orab les à leur a c t ion .
216 L’
i SLAM ET LES RACES
sides n ’ avaient a Baghdad qu’
une autorité spirituellebien diminuée les armées de l
’
Islam n’
é taien t plus
à craindre . L ’ empire byzantin , malgré les attaques
musulmanes , malgré ses dissenssions intestines , mal
gré les ruines amoncelées à l ’ intérieur par un régimefiscal déplorable qui épuisait les provinces au profit
de l’
Et at et de la plèbe, amante des seuls j eux du
cirque et des distributions de vivres qui les suivaientl ’ empire byzantin était encore assez fort pour tenir une
partie de l’
Asie Mineure . D ’un autre côté, les Fat im ides
d’
Egypt e , très puissants à cette époque, occupaient la
Syrie suivant la loi inéluctable qui rendait j adis la possession de cette province ind ispensable à qui voulaitla sécuri té de la vallée du Nil . Pour tenir solidement
la Terre sainte , i l était donc nécessaire de prendre Cons
t ant inople et le Caire . Où l’
habileté politique de Venise
éclatait, c’ est que la possession , ou tout au moins la
neutralité de ces villes, était indispensable pour que le
commerce des épices , les échanges consécutifs à ce trafic, reprissent toute leur splendeur . Byzance , bien que
du rite orthodoxe grec, était cependant chrétienne . Le
débarquement en Egypte fut donc plus facilement accept é par les Croisés moyennant inarcs d ’ar
gent, la cité de Saint-Marc s’
engageait à transporter
en Egypte l ’ armée des Croisés et à la ravitailler pendant un an (2)Le doge Dandolo profita de la diffi culté qu
’
avaient
les Barons à payer la somme fixée pour s ’ assurer en
payement le concours de l ’ armée contre Zara qui fut
prise . Les Vénitiens s’
ent endaient encore —avec le s Egyp
(1 ) V . G . Kur th , Les Or ig ines de la c iv ilisa t ion modern e . Lou
v a in , 1886, t . I , By zanc e .
(2) Diehl, Op . c i t . , p . 49 .
LA CRO I SADE D ES ÉPICES 2 17
tiens qui avaient les mêmes intérêts qu ’ eux au point de
v ue commercial , préférai ent donc une action contre leurs
ennemi s byzanti ns plutôt que contre les Fat im i des
Malgré l ’ opposition du pape Innocent , le doge mit alors
en év i dence un j eune prince grec, Alexis , qui s’
offrit
à conduire les Croisés à condition qu’ ils rétab lirai ent
sur le trône son père Isaac l ’Ange qui en avai t été pré
cipit é (1203) La Combinai son réussit : Byzance
fut prise le 18 j ui llet 1203. Veni se triomphait . En 1204,la République de Saint—Marc ét ait
,sans cont est e
,la maî
tresse du commerce des épices , parvenai t au fond de l a
Mer Noire,où elle échangeai t ses produits avec les Ta
tars,envahisseurs de la Russie, concluait des traités
‘
avec les Turcs d ’
Iconium , premi ers rapports annon
ciat eurs des commerces futurs avec les Ottomans .Quoi qu
’
il en soit, des croisades ressortirent la victoire ,la puissance , la grandeur de Veni se qui devait accaparer
le commerce des épices e t des aromates j usqu ’ à l ’ entrée
en ligne du Portugal . L ’ ouvert ure défini tive de la routedes Indes par le Cap de Bonne—Espérance n ’
eut lieu
qu ’ à la fin du x v e siècle . Jusqu ’ à cette époque, Venise,direct rice
,sinon instigatrice des croisades telles qu
’ elles
se firent, sut m anœuv rer de telle sorte en Orient qu’
elle
reprit auprès des Musulmans l’
in fluence et l ’ importance
que les anciens traités lui accordaient . Et dans sa riva
(1 ) L’ idée d ’
a t t aqu er la Sy rie par Le Caire fu t reprise par
Sain t Lou is, roi de Fran c e (1218 L’
échec de La Man so u
rah in t erdit l ’Egy p t e aux Croisés . Mai s le s Fa t im ide s originairesde la Tun isie ac t uell e d
’
où ét ait par t i le Mahdi Ob e id Allah,
fondat eur d e la dyn ast ie , ét a ien t wulnérab le s à l ’ ou e st de leurem pire . Le roi de Fran ce t en t a don c la cro isade de Tuni s, m a issan s succ ès .
(V . Pique t , Les”
C iv il isa t ions de l’
Afr ique du Nord, chapit re V I I,p . 94 e t
(2) Duruy ,H is to ire de France .
2 18 L’
I SLAM ET LES RACES
lité avec le Po rtugal , la République de Saint-Marc futbien plus l ’ alliée des pay ens ses associés , qu e celle
des Portugais chrétiens , parti s pour une nouvelle croi
sade commerciale .
VÉN ITIENS ET PORTUGA I S . LA LUTTE POUR LE
M ONOPOLE DU COMMER CE D ES ÉP ICES .
La cr ise économ ique . L’
Europe souffrai t du
contrôle économique de Venise et des Egyptiens sur lecommerce de s épices . La route de la Mer Rouge étaitseule ouverte aux m archands
, par suite du développe
ment des khanats turcs en Asie antérieure . Les transi
t aires savaient profiter de la situation ; les sultans , les
soudans de l’
Egypt e appliquaient des droits de douane
énormes sur les produi ts importés , fai sant ainsi renché
rir la valeur des marchandises au Caire et à Alexan
drie : Le s Vénitiens , payant fort cher les épices , les aro
mates , le s revendaient nécessairement plus cher encore
e n Europe . D ’ où un malai se économique persistant
sur la soci été chrétienne en pleine renaissance, à la
quelle le poivre , le gi ngembre , la cannelle, la noix muscade, la noix de galle , l
’
or, les pierres précieuses , res
t aient indispensables . Il ne fallait pas songer à aller
concurrencer les navires de la République de SaintMarc aux échelles du Levant les traités passés par elle
avec les prin ces grecs et les souverains musulmans lui
garantissaient une situation privilégiée, affermie par
l’
existence de co lonies marchandes vénitiennes essai
m ées dans toutes les villes importantes de l’
Asie Mi
neure et d’
Egy pt e ; la papauté reconnaissait en plus à
la Seigneurie le monopole ex clusif du commerce avecles Musulmans .
220 L’
I SLAM ET LES RACES
celles de la péninsule indienne, poursuivirent leur navi
gat ion aventureuse j usqu’ au détroit de Malacca et dans
les mers de Chine , véritable croisade à la conquête desrichesses de l ’Orien t , toison d
’ or promise aux Argo
nautes de l ’Océan In dien .
La lutte pour le m onopole des épices . Par ces ten
t acules j etées au delà des océans sur les pays fabuleux
d’
où venaient les épices , les Por tugai s tiraient de leur
vaste empire colonial toutes les précieuses denrées dont
ils inondèrent bientôt l ’Europe . On s’
ému t à Venis e
de telle sorte que des émissaires furent envoyés à Lis
b onne (1 ) pour recueilli r des informations précises sur
la route nouvellement découverte , des ambassadeurs
accrédités auprès du sultan d ’
Egypt e pour lui repré
senter le désastre financier menaçant à bref délai son
trésor et celui des doges , si le Portugal détournait ainsi
le commerce des épices des voies anciennement tracées .
La situation était d ’ autant plus grave que les Ottomans
menaçaient la vallée du Nil . Venise risquait de perdre
les privilèges commerciaux acquis par elle en Orient ;les Portugais , de leur côté , tenaient à - se réserver le
monopole ex clusif du marché de l ’ Inde , tout en offrant
aux Vénitiens de les approvisionner à leur tour .
Les représentations des doges à la cour des sultans
mame luks d’
Egypt e ne furent pas inutiles . Les Musul
mans souffraient, eux aussi , de l’ arrivée des Portugais
dans l’
Océan Indien . Sans rappeler la destruction desEtats arabes
.
de la côte orientale d ’
Afrique , Mozam
bique, Mombassa , Melindi , Kilwa et Zanzibar, de l a
soumission des royaumes islamiques de la côte des Ma
(1 ) V . D iehl, op . c it ., p . 189 .
LA CRO I SADE DES ÉPICES 22 1
lahars , la situation fai te par les Chréti ens aux marchands
arabes dans ces régions devenait impossib le . É tablis
sur des bases côti ères , embusqués dans la position stra
t égique des îles , les navires p ortugai s pourchassaient
toute embarcation marchande qui se risquait au trafic
de ces mers . Dès 1502, les Portugais , avec une part i e
de la flotte de Vasco da Gama , fermai ent le débouché
méridional de la Mer Rouge, s’
emparai ent en 1 506 de
l’
île de Socot ora, interdisant ainsi aux Egyptiens , et parconséquent aux Vénitiens
,la route des Indes .
En trée en ligne des M usulmans . Les souverains
m am eluks décidèrent d’
intervenir par la force des armes .
En 1504, sur le conseil de Venise, ils avaient bien songéà faire percer l ’ isthm e de Suez , mai s le proj et ne futpas poursuiv i . Leurs représentations , celles des doges
auprès de la papauté , rappelant les trai tés passés au
t refois et réservant le monopole du transit des épices ,n ’ ayant eu aucun succès , le sultan Kansuh el Ghuri
résolut de chasser les Portugais de la Mer arabe
Depui s longtemps, les Mam eluks maintenai ent une flotte
de guerre dans la Mer Rouge . L’
ami ral Husain fut eu
v oy é , en 1508,sur les côtes du Guj arat, province de
l’
Inde septentrionale, avec une flotte bien équipée, mont ée par des marins qui avaient souvent combattu les
Chrét iens en Méditerranée . Il fut ralli é dans ces parages
par la flotte du roi musulm an de Guj arat, commandée
par le gouverneur de D in , en dépit des efforts du capi
tai ne Lourenço d’
Alm ei da . Les Musulmans de l’
Inde ,
menacés dans le nord de la péninsule par l’ expansion
portugaise , profit ai ent de l’
occasion pour essayer de
rej eter l’
env ahi sseur.
222 L ’
15 LAM ET LES RA CES
Victo ire des Portuga is Les deux flottes réuni es ,supéri eures en nombre à celle des Chrétiens , la vai n
quiren t près du po rt de Chaul , aprè s un combat de
deux j ours , dans lequel péri t le fils du célèbre vice-roi
d’
Alme ida . Le 2 février 1509 , i l fut vengé par so n père,don Francis co , qui vainquit les flottes alli ées d
’
Egypt e
et de Guj arat L’
année suivante , le ro i de ce dernier
pays offrait à Albuquerque le port de Diu où fut ins
tallé un comptoir . La défaite de sMusulmans consacrai t,
pour un temps , le monopole des épices aux commerçants
portugais . Le retour offensif de s Musulmans vers l’
Afri
que, lorsque les Sey y ids de Mascate et d’
Om an reprirent
Mombassa et fondèrent le sultanat de Zanz ibar , eut beau
rej eter les Portugais d ’un grand nombre de leurs pos
sessions , la route des Indes par le Cap de Bonne-Esperance n ’ en restait pas moins ouverte .
D ’ ailleurs,Venise n
’
était plus assez puissante à ce
moment- là pour tirer parti de l ’ off ensive musulmane .
Les Ottomans s’
étaient emparés de l’
Egypt e (15 1 7)l es Turcs , maîtres de l
’
Asie , s’
é te ndaie nt en Europe ;l a République avait assez à faire pour défendre ses etab li ssem en t s en Méditerranée . Dès 15 10 , Lisbonne com
m e nçai t à approvisionner l’
Allem agne au débu t
du XV I e si ècle, le monopo le du commerce O rient éta it
nettement passé aux mains de s Portuga i s si la Medi
t e rranée éta it encore le centre du monde civili sé,le
cadre de c e mo nde était bi en agrandi .
La Croisade des épices avai t donc e u pour résultat
de faire abandonner la voie diffi c ile de terre pour une
route sans doute moins courte , mais plus pratique par
(1 ) Mo rse S t e phe n Alb reque ryrw . V . H is tory 0 / the M edia e va l
! n d ia .
222 L ’
15 LAM ET LES RACES
Victoire des Portuga is Le s deux flottes réunies ,supérieures en nombre à cell e des Chrétiens , la vain
quiren t près du port de Chaul , aprè s un combat de
deux j ours , dans lequel périt le fils du célèbre vice—roi
d’
Alm eida . Le 2 février 1509 , i l fut vengé par son père,don Francisco , qui vainquit les flottes alli ées d
’
Egypt e
et de Guj arat L’
année suivante , le roi de ce dernier
pays offrai t à Albuquerque le port de Diu où fut ins
tallé un comptoir . La défaite desMusulmans consacrait,
pour un temps, le monopole des épices aux commerçants
portugais . Le retour offensif de s Musulmans vers l ’Afri
que , lorsque les Sey y ids de Mascate et d’
Om an reprirent
Mombassa et fondèrent le sultanat de Zanz ib ar , eut beau
rej eter les Portugais d ’un grand nombre de leurs pos
sessions , la route des Indes par le Cap de Bonne-Espé
rance n ’ en restai t pas moins ouverte .
D ’ ai lleurs,Venise n
’
éta it plus assez puissante à ce
moment-là pour tirer parti de l’ offensive musulmane .
Les Ottomans s’
étai ent emparés de l ’Egypt e
l es Turcs , maîtres de l’
Asi e , s’
ét endai ent en Europe ;la Répub li que avait assez à faire pour défendre ses étab li ssem e nt s en Médi terranée . Dès 15 10 , Lisbonne com
m ençai t à approvisionner l’
Allem agne au déb u t
du XV I e siècle , le monopo le du commerce d Orient était
nettement passé aux mains des Portugai s si l a Médi
terranee était encore le centre du monde civili sé,le
cadre de ce monde était bien agrandi .
La Croisade des épices avait donc eu pour résultat
de faire abandonner la voie diffi ci le de terre p our une
route sans doute moins courte , mais plus pratique par
(1 ) Morse S t ephen s , Albuque rque . V . H is tory of the .Mediae val
I n d ia .
LA CRO I SADE 13 1—: s ÉP ICES 223
le sud de l ’Afrique surtout elle avait aff ranchi l’
Europe
de l’
intermédiai re des Musulmans, ouvert l’
Océan I n
dien , les m ers de Chine , à l’ activité industrielle et com
mercante des Espagnols,des Hollandais , des Françai s
et des Anglais , rivaux, héritiers et successeurs des Por
t ugais .
LA CRO I SAD E D E S ÉP ICES CONTEMPORA INE .
La croisade des épices ne persiste-t -elle pas encore
au xx e siècle La Seigneurie de Veni se avait proj etéle percement de l
’
isthm e de Suez , rêve conçu’
par les
Pharaons et les Grecs dès les âges les plus reculés . Au
jourd’
hui , d’
énormes navires de charge traversent la
mer des Arabes , doublent le cap qui fut celui des Tem
pètes , et qui n’ est plus , grâce à la vapeur , que celui de la
Bonne—Espérance du gain et des profits . N ’ est—ce plus
donc cette croisade des épices qui a poussé l ’Angle t erre ,la France , l
’
Allemagne , l’
It alie , à rivali ser de hardiesse,à lutter politiquement, diplomatiquement, pour s
’
ét a
blir sur toutes les côtes où j adis les Vasco da Gama ,les Almeida, les Albuquerque, établissaient d es points
d ’ appui . Aux Dupleix, aux La Bourdonnaye, aux Sur
cou i , ont succédé les explorateurs , les marchands , l es
officiers , marins , soldats , des flottes de guerre, des trou
pes coloniales , qui ont développé les connaissances sur
ces régions , planté le pavillon de leur patrie sur les
vieux comptoirs des épices .
Ce ne sont plus seulement le poivre, la cannelle, le
gingembre, l a cardamone, la noix muscade, l a noix de
galle, la vanille, le muse et le benj oin qui sont l’
attirance de ces mers où tant de sang coula pour l e li bre
224 L’
i SLAM ET LES RACES
trafic de s épices et des aromates ; mais ce sont encore
le coton, le j ute , les fi b res , le rafi a , les arachides , le
manio c,la canne à sucre , le riz , tous les produits de
l’
Afrique équatoriale , de Madagascar, de l’
Inde ou de
la Chine, aussi précieux maintenant que les perles , les
pierres précieuses , les diamants de la Colchide ou de
Golconde ; c’ est tout ce que le commerce et l ’ industri e
peuvent tirer de la richesse infinie des pays nouveaux
qui attirent là-bas les peuples occidentaux ; ce n’ est
plus seulement le monopole exclusif de transport, de
vente qui alimente et dé termi ne la rivalité des grandes
puissances , mais aussi la colonisation , la découverte de
nouveaux débouchés pour l’
Europe pléthorique . C ’ est
maintenant la re cherche du pétrole indispensable à la
v i e moderne
La croisade des épices s’
est élargie en un essor mon
dial , entraînant dans l’
orb e de s forts tous ceux qui
n’
ont pas le degré de civili sation e t de puissance né
cessaire à la résistance . Les besoins de l ’Europe se sont
centuplés depuis le temps où Venise accaparait le com
merce des épices , luttait avec le Portugal ; depui s le
siècle où Henri V I , fi ls de Barberousse , rêvait la marche
vers l ’Orient d’une Allemagne victorieuse . Les besoins
se sont centuplés depui s la première croisade des épices
l’
Occident veut tirer de l ’Ori en t tout ce qui est indis
pensable à son bien—être , à sa richesse , à son luxe
forcer les peuples indigènes à tirer par t i de s ressources
inexploitées de leur pays , les inonder en échange de ses
produits manufacturés .
(1 ) La Comm ission d’
enquêt e des E t a t s-Un is signale en 1922
qu e le m onde e st m e nacé de m anque r de pét ro le av an t v ing tan s si la c onsomm a t ion ac t u elle con t inu e e t s i de n ouv ell es
poches ne son t pas t rouv ée s de là c e s lu t t e s polit iques implacab le s pour la possession des t errains pét rolifère s .
TROIS IEME PAR TIE
LES MOUVEMENTS RÉGIONAUX I SL ÂLHQÙ ES I SSÎ SDE L ’EXPANSION TURCO—MONGOLE
Chapitre x i i i .
XVI I .
QUATR IÈME PARTIE
CONCLUS IONS GÉNÉRALES . IMPRESSIONS svn
L ’ISLAM ET SES TENDANCES ACTUELLES
L’
Islam en Extrême—Orient .
1 ° L’
Islam en Chi ne .
2° L’
Islam en Inde—Chi ne .
30 L’
Islam au Japon .
L’
Islam en Russ i e .
L’
Islam dans l’
Insuli nde .
L’
Inde musulmane .
La Perse , l’
Afghani sta n, le
Bélouchi stan .
CHAPITRE X I I I
L’
ISLAM EN EXTREME—OR IENT
I . L ’ ISLAM EN CH INE .
Les Arabes . Ce fut sous le règne du khali fe Wa
li d' I e r (705-715) que l’
Islam atteignit, pour la première
fois,les frontières de la Chine . Un des gouverneurs du
souverain , Al Haj j aj , envoya de l’
Irak (Chaldée) , v ers
71 1 , un général arabe, nommé Kout aïb ah , vers les ré
gions tatares . En même temps Al Haj j aj ordonnai t àson cousin Mohammed ben Kasim de marcher sur l ’Him
doust an . Walid n’
aut orisa ces expéditions lointai nesqu ’ avec une extrême répugnance, mai s fut convaincupar son gouverneur, lequel détermina ai nsi l
’ expansion
de l ’ Islam en Asie orientale
Les étendards musulmans furent portés de Samarcande à Kashgar de 71 1 à 714 à travers le Tian—Chan .
Les nomades tatars furent convertis de gré ou de force .
Kout aïb ah reçut même dans ses nouvelles conquêtes
une députation de l’ empereur de Chi ne lui demandant
des renseignements sur la religion qu ’ il professait . Les
historiens arabes rapportent que , v ers 715 , le général
envoya au Fils du Ciel des délégués qui exposèrent au
(1 ) La Chin e , du m oin s son n om , n’
ét ai t pas in connu e de Maho
m e t . N’
av ai t il pas di t . Cherche z la sc i en c e ju squ e dans laChin e ! Cependan t quand il adre ssa de s m e ssage s à t ou s le s
s ou v e ra in s pou r qu’
ils se c on v e r t isse n t , il Il’
en v oy a rien à l ’Emp e r c u r de c e pay s . Ye sgu erd I I I (ou Ye sdegu ert ) , s ouv erain de
Pe rse b a t tu par les Arab e s, fu t a ssassin é en 652, en e ssayan t des e réfugier prè s de l
’
Empereur chinois Taït song Ier
232 L’
ISLAM ET LES RACES
sion islamique fut fortement favorisée pa le mariage
de Turcs Oïgours avec des femmes chinoise. Le métis.
sage a donné naissance aux D oumganes, ont le typeethnique se rapproche du Chinois , et qui parlent la
langue chinoi se .
Gengis—Khan , en ouvrant à l’
Islam la ante de la
Chine,fut la cause de nombreuses conv æ ions dans
les provinces de l ’Est . La tolérance religieue du grand
conquérant poussa les Musulmans à se rence en grand
nombre en Extrême—Orient, où ils se marirent e t fer
mèrent un peuple i sl amique de race mélagée . Parmi
les émigrants furent de nombreux Persansqui apport èrent avec eux leur langue , devenue depu: la langue
savante des Musulmans de Chine . C’
est msi que les
manuels religieux sont publiés en persan et on en chi
nois . L’ arabe est seulement connu par le Cran qui ne
doit être traduit dans aucune langue , et pr des for
mules religieuses mécaniques . Sous les empreurs mongols , les Musulmans occupèrent les plus b ancs charges
dans l’
E t at et vécurent librement .Les récits de l
’
histoire musulmane dans les sœcles
qui suivirent sont généralement apocryphes . ependant ,
le célèbre voyageur arabe Ibn Bat out a trouva u XIV e siè
cle des Musulmans en de nombreuses régions e la Chine .
Des villes entières étaient converties à la fr de Mahomet . Ces fidèles avaient l ’habitude de paye l
’aumone
ordonnée par la religion et recevaient hospit lièrement ,suivant la loi coranique
,les voyageurs v enat des pays
d’
Islam , ce qui semblerait indiquer une cot inuit é et
une facilité de relations considérables avec le mondemusulman .
Lorsque furent tombées du pouvoir le dynaS’
ties
mongoles , l’
Islam n’
eut plus le même sucer parmi la
30 L’
ISLAM ET LES RACES
souverain et à ses ministres la doctrine du Coran e t le s
traditions fain iliè re s aux disciples de Mahomet . Eff rayépar les peintures guerrières que lui firent ces Musul
mans , l’
empereur aurait fait porter à Kou t aïb ah le tribut
demandé par ce général
Les premières relations des Musulmans et des Chinois ,le développement de l
’
Islam en Chine sont très peu con
nus . Néanmoins,il y eut des rapports continus entre
les deux mondes . L’
empereur avait,sans doute
,gardé
un souvenir vivace de l’ esprit militaire des guerriers
de Kou t aïb ah, car en 755 après J .-C . , menacé par le
rebelle An—Ln-Shan , Su Tsung demanda secours auxMusulmans . Un corp s de quat re mille hommes lui fut
envoyé par le khalife Mansour . Le souverain victori eux ,afin de montrer sa gratitude à ces soldats qui lui assu
rèrent la victoire, leur p ermit de se fixer à leur guise
dans les grandes villes de son empire . Ces Musulmans
se marièrent avec des Chi noises , mai s gardèrent leur
religion . Ils formèrent ainsi le premier noyau de l’
Islam
en Extrême—Orient .Un mouvement similaire de p énétration se poursui
vai t par m er . Des marins arabes , et surtout des navi
gat eurs persans , partis de Siraf dans le Golfe Persique ,vinrent de bonne heure, en longeant les côtes , fonder
des colonies sur les rivages de la Chine, par exemple
à Canton . Les Arabes de s ecours , envoyés par
l’
Ab b asside Mansour, se rendirent très probablement
par mer auprès de l’ empereur . Dans les siècles suivants ,
le courant d’
immigration de l’
Ouest vers l’
Est se pour
suiv it sans arrêt . Les foyers d’
Islam se renforcèrent ,mai s restèrent lo cali sés . La véritable pénétration futconsécutive à l
’
expansion des Turc o—Mongols .
(1 ) D’
après Mangoliou th.
L’
I SLAM EN EXTRÊME-OR IENT 231
Les Tun e-M ongols . A la disparition de Gengis
Khan et de Tam erlan, les Turcs ottomans reprirent les
proj ets grandioses des grands chefs de guerre, tandis
qu e les souverains mongols , après l’
usurpat ion de Khou
b ilaî, devenai ent une dynastie purement chinoise, celle
des Youen . D’
aill eurs les Youen furent év incés plus
tard du trône de Pékin par les lignées locales ou mand
choues . Les tribus mongols perdirent bientôt toute .in
fluence sur les sédentaires chi nois . Il ne reste plus à
l ’heure actuelle que des nomades soumi s à la Chine ou
à la Russie . Il n’ existe plus que le souveni r d
’une épo
pée grandiose et, au point de vue islamique, des îlots de
Musulm ans .
Nombreux ils Sent encore auj ourd’hui dans la régi on
de Hia-hin—Tse et de San-Tao-Ho,au nord du pays des
Ordos , sur les confins du désert de Mongoli e . Ces Mu z
sulm ans sont très redoutés ce furent eux qui,en 1900 ,
massacrèrent deux prêtres belges : profitant des trou
bles,l es Musulmans avaient acheté des femmes chré
tiennes chi noises que les Mi ssionnaires , paraît-il , voulu
rent à tout prix retrouver, d’ où le conflit .
La plus grande partie des Tatars musulmans est ac
t uellem ent soumise à la Russie . Au début de 19 17, les
Mongols russes ont demandé au gouvernement provi
sc ire, nommé par les révolutionnaires de Petersb ourg,leur autonomi e , dans un congrès de tous leurs princ e s
réunis à Irkout sk . Depuis l ’ intervention des Maxima
li stes , les Musulmans mongols ont suivi les différents
courants politiques en cherchant touj ours à rester indé
pendants .
La Chin e musulman e . La première mosquée côns
t rui te en Chi ne le fut dans le Chan-Si en 742. L’
expan
232 L’
I SLAM ET LES RACES
sion islamique fut fortement favoris ée par le mariage
de Turcs Oïgours avec des femmes chinoises . Le métis
sage a donné naissance aux D oumganes, dont le type
ethnique se rapproche du Chinois , et qui . parl ent la
langue chinoise .
Gengis—Khan,en ouvrant à l
’
Islam la route de la
Chine , fut la cause de nombreuses conversions dansles provinces de l ’Est . La tolérance religieuse du grand
conquérant poussa les Musulmans à se rendre en grand
nombre en Extrême—Orient, où ils se marièrent e t fe r
m èrent un peuple isl amique de race mélangée . Parmi
les émigrants furent de nombreux Persans qui apport è rent avec eux leur langue , devenue depuis la langue
savante des Musulmans de Chine . C ’ est ainsi que les
manuels religieux sont publiés en persan et non en chi
nois . L ’ arabe est seulement connu par le Coran qui ne
doit être traduit dans aucune langue, et par des for
mules religieuses mécaniques . Sous les empereurs mongols , les Musulmans occupèrent les plus hautes charges
dans l ’Et at et vécurent librement .Les récits de l
’
histoire musulmane dans les s1ecle s
qui suivirent sont généralement apocryphes . Cependant ,le célèbre voyageur arabe Ibn Bat out a trouva au x rv ° sie
cle des Musulmans en de nombreuses régions de la Chine .
Des villes entières étaient converties à la foi de Mahom et . Ces fidèles avaient l ’habitude de payer l
’ aumone
ordonnée par la religion et recevaient hospit aliè rem ent ,
suivant la loi coranique, les voyageurs venant des pays
d’
Islam , ce qui semblerait indiquer une continuité etune facilité de relations considérables avec le monde
musulman .
Lorsque furent tombées du pouvoir les dynasties
mongoles , l’
Islam n ’ eut plus le même succès parmi la
234 L’
I SLAM ET LES RACES
similaire . Ces derniers , bien qu’ au courant de tout c e
qu i se passe dans le monde islamique , ont échappé
j usqu ’ à présent , semble— t —il , à la formule ottomane .
Capables d ’ amélioration , au moment où une Chine nou
velle cherchait à s’
adapter aux progrès de la civilisation
européenne , ils ont profi té des mouvements j eunesrévolutionnaires pour revendiquer leurs dro its politiques
et sociaux .
Le gouvernement dut combattre durement contre
les D oumganes . En 1818,une première insurrection avait
éclaté déj à dans le Yun-nam , d’autres avaient suivi en
1856 qu i ne furent réprimées qu’ en 1872, au Chan- S i
de 1862 à 1878, au Turkestan en 1864 . C ’ est contre les
Musulmans Ta i —Pings que le colonel anglais Gordon
prêta son concours au gouvernement chi nois : il devait
succomber plus tard en Egypte à Khartoum , sous les
coups des Musulmans soudanais . En 1900, dans le ChanSi , au Turkestan , au Yun-nam , les adeptes du Coran
proñt è rent à nouveau des troubles pour affi rmer leur
vitalité . Beaucoup d’ entre eux ont péri dans les guerres ,
mais leur nombre grandit vite à nouveau : les Musul
mans achètent même, paraît—il, les enfants abandonnés
dans les famines par les Chinois , les élèvent dans leur
foi et repeuplent les territoires dévastés par les fl éaux ,
comme au Kouan-Toung
Il est assez difficile de les dénombrer . Les statistiques
varient assez fortement . Les Musulmans semblent être
une trentaine de millions en Chine . A Pékin même, o n
en compterait familles avec 13 mosquées . L’
isla
m ism e gagne de plus en plus en Chine par le nombre
de ses enfants et par le prosélytisme . Le grand principe
enseigné dans les brochures publiées en chinois , en per
(1 ) D’
aprè s Har tm ann .
L’
I SLAM EN EXTREME—OR IENT 235
san , en arabe, imprimées sur des b locs de bois et ré
pandues à des milli ers d’
exemplaires , e st : Allah veut
que l’
Islam triomphe à travers e t par la Chine ! (1 )Il est à remarquer qu ’ en Extrême-Orient, les Musul
mans représentent l ’ élément remuant e t turbulent . Leur
évolution historique est une de c es manifestations quifont comprendre l ’ impossibilité de l
’
enten te universelle
des Musulmans , trop divisés en sectes différentes , de
races trop diverses pour être dirigés vers un but com
mun . Chaque race a adapté l’
Islam à son caractère par
t iculier .
I l . L’
ISLAM EN IND O-CH INE .
Les généraux mongols assurèrent aux Khans l ’ au
t orit é sur le Yun—nam et le Tonkin . A la suite des sol
dats turco—mongols , l’
Islam pénétra en Indo—Chi‘
ne,m ais
à l ’heure actuelle on n’
y rencontre plus de Musulmans .
M . Dout t é pense cependant que les Chams , d’ origine
malaise , semble—t il, qui fondèrent l’ ancien empire de
Champa (Annam actuel) , et qui , chassés par le s Chinois ,les Cambodgiens , le s Annami tes , subsistent çà et là
en Inde -Chi ne e t au Siam , sont les derniers restes de
ces Musulmans retournés aux croyances primitives
MM. Russier et Brenier (3) disent : Un certain
nombre de Chams sont Musulmans . On les appelle Bani
(de l’
arabe beni , fils de l’
Islam ) . Les autres sont brahma
niques , mais leur islamisme ou leur brahmanisme est
(1 ) D’
après Har tm ann .
(2) D’
apr ès Margoliou t h .
(3) Ru ssier e t Bren ier , L’
I nde -Chin e fra n ça ise . Paris , Co lin ,
19 1 1 , p . 1 57 e t 1 58 . Une m o squée ex ist erait , m e dit —on ,a
Han 0 1 .
236 L’
I SLA ET LES RACES
très corrompu et se rédit presque uniquement aux con
t um es funéraires . Les ams b rahm anist es brûlent leurs
morts,les Chams mns mans le s enterrent .
An S iam on signale rue sur 6 mi lli ons d’
habitants,
un milli on est auj ourd ui musulman . Une immigrationvenant de Chine et l
’
archipel malais aurait causé
cette islam isation rap e .
I SLAM AU JAPON .
La prise de la Co r par les Mongols , la possessionde la Chine , perm ire n aux missionnaires musulmans
de p énétrer au Japnn . l. enr action est encore sensible
dans les îles,pu isqu
’
e 1 907 seulement on comptait
dans ce pays troi s mill e s de conversions à l’
islamisme .
Ce fait n’
était pas igm du monde islamique . M . Dicey
(Londres , 1908) raco n t que , pendant la guerre russe
j aponaise , tous les pen te s musulm ans , même ceux des
sources du Nil , ét a courant des
kado . Et l ’ on r croyance :
m ism e aura p m onv em
Quoi qu ’ i l e
p armi les pe
Japonais
sulmane .
doit êt
236 L’
I SLAM ET LES RACES
très corrompu et se réduit presque uniquement aux cou
t um es funéraires . Les Chams b rahmanist es brûlent leurs
morts , les Chams musulmans les enterrent .
An Siam on signale que sur 6 millions d’
habitants ,
un milli on est auj ourd ’hui musulman . Une imm igration
venant de Chine et de l’ archipel malais aurait causé
cette islam isation rapide .
L’
ISLAM AU JAPON .
La prise de la Corée par les Mongols , la possessi on
de la Chine, permirent aux missionnaires musulmans
de pénétrer au Japon . Leur action est encore sensible
dans les îles,pui squ ’ en 1 907 seulement on comptait
dans_cc pays trois millions de conversions à l
’ islam isme .
Ce fait n ’ était pas ignoré du monde islamique . M. Dicey
(Londres , 1908) raconte qu e , pendant la guerre russe
j aponaise, tous les p euples musulmans , même ceux des
sources du Nil , étaient au courant des victoires du Mikado . Et l ’ on rappelait la croyance : le réveil de l ’ islam ism e aura pour cause un mouvement de l ’Orient !
Quoi qu ’ il en soi t , l a doctrine de Mahomet se répand
parmi les peuples de race j aune , et fait plus grave, les
Japonais veulent jo uer un rôle dans la politique mu
sulmane . Grande puissance , le Japon estime qu’ il
doit être représenté dignement auprès de la SublimePorte . Constantinople est un bon point d ’ où observer
la politi que russe et l ’ intérêt que les Japonai s portent
à l’
Islam les rapproche du Commandeur des Croyants .
Ils entendent exploiter le prestige que leur a donné
dans le monde musulman comprimé par l ’Europe leur
victoire sur une nation chrétienne d’
Europe . Des en
v oy és j aponais étaient à La Mecque ces années der
L’
I SLAM EN EXTREME-OR IENT 237
meres . Des fils de Musulmans indiens vont s m st ruire
au Japon . Les Musulmans d’
Egypt e et de l’
Inde ont
rêvé de convertir le Japon qui , bien que peu di sposéà les écouter, ne les décourage pas . Les 30 mi lli ons de
Musulmans de la Chi ne ne serai ent pas des alli és m épri
sables . Le titre de protecteur de l’
Islam en Asie peut
être utile au mi kado et à son peuple . Le sultan,j usqu ’ ici ,
n ’ a pas accordé aux Japonais leur ambassade la Russi eet l ’Allemagne s
’y opposent, d’ autre part , les pays re
présentés à Constantinople par des ambassadeurs ont
droit aux Capitulations et le gouvernement turc cherche
à restreindre et même à abolir les privilèges d’ écoles ,
de missions , de cours consulaires qu’ il j uge contrai res
à la digni té d ’ un souverain indépendant
Ces lignes furent écrites en 1 908 ; de puis , la guerre
mondiale a changé bien des choses et le Japon n ’
a plus
les mêmes rai sons d ’ être au Bosphore pour surveiller
la Russie en pleine anarchie .
Cependant le Japon a un Haut—Commissaire à Const ant inople au même titre que les au t res puissances del’
Ent ent e . De même il s ’est intéressé à l ’existence desCapitulations que Moustafa Kemal a supprimées . Mais
les gouvernements intéressés contestent cette suppres
sion e t avai ent même étendu le régime à la Serbie , à laRoumanie et à la Yougo-Slavic . Le rôle du Japon auxcommi ssions de la Société des Nations ne permet plusde le considérer comme négligeable dans le règlement
des questions concernant le Proche Orient . L’
Allem agne ,
qui v isait pour son propre compte le protectorat mu
sulm an , n’ est plus là pour s
’
opposer aux menées
(1 ) Lou is Aub er t , Amér ica ins e t Japona is . Paris , Colin , 1 908.
Préfac e , p . 1 7 .
238 L’
ISLAM ET LES RACES
j aponaises . Les envoyés nippons qui , en 19 12, visitai ent
l e Caire , avaient de longs conciliabules avec les ét u
diant s d’
Al Ahzar, qui visitaient les groupements isla
m iques épars dans l’
Océan Indien , ont dû con tinuer
leur œuvre d ’ attrac t ion des Jeunes Musulmans afri cains
e t indiens vers les centres d ’ études j aponais . L’
Islam
est heureusement très divisé, mais il ex iste là un danger
pour l’
Ex t rêm e-Orient . Les Japonais peuvent appuyer
leur poli tique d’
in fluence sur les Musulmans asiatiques ,notamment en Chine Où ces derniers représentent l ’ élément avancé et remuant .
L ’amitié j aponaise devrait p articulièrement at tirer
l a France . En eff et depuis Charlemagne,depuis Fran
cois l a France a touj ours cherché en Orient une
alliance pour renforcer sa puissance . De ce princip e
découle la politique traditionnelle de la France en Tur
quie,l ’alliance avec la Russie . A mesure que les moy ens
de communication deviennent plus rapides,les peuples
alliés d ’
Ori en t peuvent être plus lointains . L ’ intérêt
de la France ne serai t—il pas de chercher au Japon les
sympathies et les alliances qui pourraient servir de
contre-poids au développement des puissances germa
niques L’ intérêt que le Japon porte aux choses d
’
Islam
indiquerait qu ’en ce qui concerne notamment l ’ équilib redu monde musulman
,nous ne saurions y perdre . La
création du bloc Berlin-Moscou—Angora,germano—russe
touranien,la signature du traité de Rapallo et sa con
vention militaire secrète,font voir la nécessité pour la
France de s ’ intéresser à la suggestion d’
une entente
avec le Japon .
Jusqn a présent on ne signal e aucune islamisation
de l’
Aust ralie ni de l’
Océanie . Par contre les Moluques,
L ’ I SUM ET
j aponaises . Les env ovs
le Caire , avaient de
diant s d’
Al Ahzar, q
m iques épars dans 1
leur oeuvre d ’
at t rac ti
et indiens vers les
est heureusement trpour l
’
Ex t rêm e—O
l eur politique d ’ inotamment en Cment avancé e
L ’amitié j apl a France . Ecois I“
,la
alliance po
découle la
quie,l ’all
'
de comn
alliés d
de la I
symp
W ASE 243
onques et lui envoyai ent
11t ernat iv es de suc
les Tatars de Cri
1 . Le sultan de Tur
héritier de l’
imamat ,
ais l’
avait p ratique
Il reven
e religieuse . Ça
fl mion de la Crimé e à
984 l a p ressi on de la
t l’
annexion à la
du nb an .
se co h na contre les peuples—ion d empire des tsars . Enwait a pied sur la Caspienne
De 1 786 819 , 1e Daghestan fut
s malgré d arouche rési stance de
1800 , ce f tl e tour de la Géorgie .
et Bakou ,1878 , à la fin de la
i e , Kars , Ba m , Ardahan sont oc
i scov i t es . D e 83 à 1876 , eut li eu la
des Russes v e ’
Orient qui leur livraTranscaspienn e s conduisant au mi
,
i es d ’ où l’
Ouzb egTam erlan avait j adi s
68, Sam arcande , l i lle célèbre de l’
Islam ,
e en 1876,1e Khokad annexé au Turkes
si le tsar Blanc v omit recueill i r l’
héritage
e Boiteux .
Icée lente et continue a peuple russe depui s
tion de Moscou au X I siècle , son expansio n
forêt, dans la terre ne dans la prairi e, sui
e colonisation e t d’
unemi se en val eur immé
CHAPITRE XIV
L’
ISLAM EN RUSS IE ET AU CAUCASE
La Horde d’
or . A la mort de Gengis-Khan (1227)une des hordes (ordon , troupe) qui composaient l
’ armée
de l ’Empereur Inflex ib le s’
était établie en Occident,
sur les territoires soumis aux Mongols , du Dnïepr
à la Caspienne . Le fils de Gengis Khan,Dj Où di , fut le
premier souverain régnant sur ces territoires . Puis
l e terrible Baty (mort en qui avait ravagé la
Russie , la Silésie , la Hongrie , devant lequel avaittremblé l ’Europe , avait constitué la Horde d
’ or en un
puissant empire qu ’ il dirigeait de sa capitale Saraï (leChât eau) , const ruit e sur un des bras de la Basse-Volga .
En 1260, lorsque l’
usurpat eur Khonb ilaï alla s’ établir
e n Chine , brisant ainsi avec les traditions de l’ empire
turco—mongol , la Horde d’ or rompit les li ens de vassalité
qui l’
unissaient au Khan, mais se démembra bientôt
sous le règne des successeurs de Baty qui l’ avait voulue
unie et puissante . La dernière tentative de rénovation
eut lieu au X IV e siècle sous le grand chef Ouzb eg , Ta
merlan,qui redonna une seconde période de prospérité
à la Horde, en rassemblant sous son autorité toutes
les tribus de sang turco—mongol .
L ’ invasion des Asiatiques convertis à l’
Islam faillit
avoir de graves conséquences en Russie . Les peuples
tatars firent connaî tre l ’ i slam i sme à la Russie païenne .
Le tsar Wladimir (972— 1015) souffrait alors de la crise
religieuse que traversait son royaume entier . Suivant
242 L’
I S LAM ET LES RACES
Crimée , pour acc omplir le rassemblement de la terre
russe Dès Ivan le Terrible (1462 ce se ra la ré
v anche du christianisme sur l’
islamisme . Pendan t que
dans un effort pa rallèle, l’
Au t riche e t la Hongrie arrê
taient les O ttomans , songeaient à les refouler, de même,un moment subj uguée par les Tatars , la Grande Russie,noyau de la Russie moderne , s
’
affranchit du j oug mon
gol , comm e les provinces danub iennes le firent du des
pot ism e turc . Depuis 1480 , date à laquelle Ivan battit
le khan Akhmet sur les bords de l’
Oka, la Russie, limitée à l ’Oue st par la Pologne, s
’
ét endit vers l’
Orie nt
j usqu ’ à la Caspienne e t l’
Oural , recueillan t les popu
lutions slaves qui fuyai ent les Tatars coloni sant
avec elles tout le bassin de la Volga , et vengeant dans
les luttes contre les princes de race mongole, toutes les
huniiliat i ons subies par leurs ancêtres .
D es truction de la puissance musulmane en Russ ie .
Ivan le Grand réunit bientôt à sa couronne Kazan et
les peuples turco—tatars qui en dépendaient D ’un
autre côté , en 1502, le khan de Crimée , alli é au tsar
contre ses frères de race , anéan tit si complètement ce
qui restait de la grande Horde , que Saraï, la capitale
de Baty dans laquelle les princes russes avaient rampe
devant les Mongols , est , depuis ce temps abandonnée
aux reptiles . A son tour , en 1521 , le khan de Crimée
fut assassiné par le khan des Nogai‘
s . En 1 523, Astrakhan tombait entre les mains du tsar Ivan dont Ba
hour, le Grand Mogol , descendant de Tamerlan , re cher
chait l ’ amitié , pendant que le conquérant de l’
Egypt e ,
(1 ) D’
aprè s Bourge ois .
(2) Tchérém isse s , Mordv e s , Tchouv ache s , Vo t iaks, Bachkyrs.
L’
I SLAM EN RUSS IE ET AU CAUCASE 3
Sélim I e r, le roi de France , Fran çœs I e r, lui envoyai ent
des ambassades .
Des luttes sans nombre avec des alternatives de suc
c è s et de revers s’
engagèrent entre les Tatars de Cri
m ée et les tsars successeurs“
d’
Iv an . Le sultan de Tur
quie avait acquis , en sa qualité d’
hérit ier de l’
imamat ,
le pouvoir temporel sur la Crimée , mais l’ avait p ratique
ment perdu par le traité de Kaïnardj i Il reven
diquait cependant encore la suprémati e religieuse . Ç a
therin e I l en 1 783 prononça la réunion de l a Crimée à
la couronne , mais il fallut en 1784 la pressi on de la
France pour que le sultan reconnût l’ annexion à la
Russie de cette contrée et du Kouban .
La croisade orthodox e se continua contre les peuples
islamiques pour l ’ extension de l’ empire des tsars . En
1722, Pierre le Grand avait pri s pied sur la Caspienne
à Derbend et Resht . De 1786 à l 819 , 1e Daghestan fut
soumi s par les Russes malgré la farouche résistance deSchamy I
- Imam . En 1800 , ce fut le tour de la Géorgie .
En 1806 , Derbend et Bakou , en 1878 , à la fin de la
guerre russo—turque, Kars , Batoum , Ardahan sont oc
cupés par les Moscov i t es . D e 1863 à 1876, eut lieu la
grande poussée des Russes vers l ’ori ent qui leur li vrale Turkestan , la Transcaspienne , le s conduisant au mi
lieu des steppes d ’ où l’
Onzb eg Tam erlan avait j adi s
surgi En 1868, Sam arcande , la ville célèbre de l’
Islam ,
était o ccupée , en 1876 ,le Khokand annexé au Turkes
tan , comme si le tsar Blanc voulait recueillir l’héritage
du Terrible Boiteux .
L’
av ancée lente et continue du peuple russe depui s
la fondation de Moscou au x 1n ° siècle, son expansio n
dans la forêt, dans la terre noire, dans la prai rie, sui
vi es d’
une colonisation e t d ’une —mise en valeur immé
244 L’
I SLAM ET LES RACES
diat e s des régions conquises sur les Mongols , laissées
incultes par ces derniers , ont démontré par ce qu’
en
ont fait les Russes , l’
inapt itude desa co—Tatars à créer
un empire durable . Les hordes , v enues d’
Asie s’
établi r
en Europe , imposèrent aux populations soum ises une
domination rude et dédaigneuse , les ont exploitées
par une sorte de servage sans issue , mais leur ont laissé
leur organisation familiale et communale, leur langue,leur religion , en un mot leur indiv i dualité sociale (l ) .
La réaction s ’ est produite dès que le caractère guerrier
des successeurs de Gengis—Khan se fut affai mais
l ’ emprise islamique importée par les Turco-Mongols estencore sensible en de nombreuses régi ons de la Russie .
L’
I slam dans la Russie con tempora ine . Les Mu
sulmans de Russie peuvent être estimés au nombre deseize millions d ’ âmes environ . Leurs agglomérations lesplus denses se rencontrent dans le bassin de la Volga ,autour de la Caspienne , en Crimée, dans le sud du Cau
case , au Turkestan . En Europe même, les Musulmansrusses se divisent en Tatars de Kazan , Nogaïs, Cri
méens On en rencontre encore en Lithuanie où
des Tatars disséminés , ayant co nservé la religion mu
sulmane mais adopté le costume polonais , subsistentencore Le noyau le plus important est celui de
la vieille ville tatare de Kazan sur la Volga Où exi ste
un centre scolaire musulman important ; à Tiflis se
groupent les Caucasiens ; enfin les 27 millions d’
he c
(1 ) Po in sard .
(2) Le s Noga 13 e t le s Cau casie n s du Nord m u sulm an s son t
év a lués par Vam b éry , 1 905 , à indiv idu s ; les Bachky rsde Kaz an , le s Ta t ars du Vo lga , à âm e s .
(3) V . Bérard, Relig ions m usulma n es , Le Pro blèm e russe , I l ,Revue de Pa r is , 1 5 m a rs 1905, p . 429 .
244 L’
I SLM ET LES RACES
diat es des régions coquises sur les Mo
incultes par ces déra ie s , ont démontré
ont fait les Russes , l’
inp t itnde
un empire durable . Ll hordes , venues d’
en Europe, imposè ren aux populations
domination rude et edaigneuse , les 0
par une sorte de servas sans issue , mais 1
leur organisation fami ale et communale, le’
leur religion , en un m o leur individualité sof
La réaction s ’ est prod 1t e dès que le caract è
des successeurs de Ge gi s—Khan se fut aff
l ’ emprise islamique im prt ée par les Tumo-l‘
encore sensible en de ombreuses régions d
L’
I slam dans la Buste con temporaine .
sulmans de Russie pencut être estimés auseize mil lions d ’ âmes e viron . Leurs agglon
plus d enses se rencontm t dans le bassin
autour de la Caspienne e n Crimée, dans le
case , au Turkestan . E 1 Eur0 pe même, les
russes se divisent en’
atars de Kazan ,méens On en renent re encore en Li
des Tatars disséminés , yant conservé lasulmane mais adopté cos
encore Le noy
la vieille v ille tatareun centre
groupent 1
L’
ISLAM EN RUSS IE U CA”…249
tares de Bokhara et de Kh forment
provinces musulmanes son t ori té de
gènes,vassaux de la Russie .
Russie
observé est le rite sunnite , e au
Tatars de Crimée restent c chers
mans russes . Le gouv ernem de
un grand mufti appointé à tête
groupements , subventi onnai b couventsù
les écoles et les confréries .
D’
après les voyageurs , le s na rs de Run e
gens sobres , pacifiqùes, trav. a ra, gén&a
artisans, petits commerçant onciergœ.
des , garçons de café , tandis e ceux d‘…
rnit e sesont nomades se hv rent à
asie ellespêche . Tous sont ferm emen royants, m qui j erésistance énergique à l ’ aet i des grandestiens orthodoxe s , font même
lux revorable auprès des habitants st ep de“ cut e proqu
’
eux .
tous lesJusqu
’
en ces dermères anu s, pétition ,ne portaient pas omb rage le n o 60
conse nt 1.laignaient
246 L’
I SLAM ET LES RACES
les moyens Cette tyrannie a causé de nombreux
mouvements d emigration vers la Turquie . M. Vam
b éry estime qu’
un demi—million de Musulmans a fui la
Russie par sui te de la persécution religieuse .
Au point de v ue social , l’
expansion du peuple slave
déterminai t un changement dans les conditions de la
v ie tatare . Par des expéditions répétées, les Russes ontobligé de proche en proche les nomades à se cantonner
dans un espace déterminé au lieu de parcourir librement
la s teppe . Cette contrainte amena les Tatars de l’
U
kraine et du Don , pu i s les Bachky rs de l’
Onral a une
t ransformation sociale . Les ressources de ces pasteurs
étaient diminuées par le rétrécissement de leur aire de
parcours . En Russie, se posait la même question qu’ en
Algéri e après la conquê t e française . Le nomadi sme devait laisser libres se s terrains de transhumance pour
l ’ installation de colons nouvellement venus . Les Slavesforcèrent les Tatars à restreindre leur vie pastorale .
Pour les empêcher de mourir de faim , le gouvernement
les employ a comme gardes f rontières , leur allouant une
solde en nature ou en argent . On leur facilita la cons
t ruc tion de demeures fixes , au moins pour l’hiver, l
’ ac
(1 ) Dan s un ar t icle de la Rev ue de Pa r is , 1 5 m ars 1 900 ,Le Pro blèm e russe , I l , Na t ion a li tés e t Rel ig ion s, M. V . Bérard
défend la poli t iqu e de s t sars qu i fu t t ou j our s t r ès t oléran t e , di t -il .Il av o u e c epe n dan t qu e la sain t e Russie n
’
a persécu t é qu e c er
t ains Tar t ar e s du Vo lga , le s Kérachin e s , qu i ,après c onv ersion àl’
o r thodox ie re t ourn a i en t aux pra t iqu e s m u su lm an e s Ils
a v aien t san s dou t e é t é t r ès m al c onv er t is . M . Bérard indiqu e en
ou t re qu e ls serv ic e s le s t sars on t su t irer de s agen t s m u su lm an s
en Perse , en Chin e , au Ca uca se c omm en t c e s dern iers v an t aien t
la puissan c e du t sar b lan c e t faisaien t de la propagande pour lu i ,e t c om m en t les Anglais, don t la polit iqu e en Arab ie e t en Egypt et ouj ours ét é si su iv ie , on t su pro fi t e r des plain t e s de s Ta t ars
ru sse s pour faire imm édia t em en t r e lev er le gan t par le s j ournaux
m usu lm an s du Caire .
248 L’
ISLAM ET LES RACES
tars . Les lois de l’
Islam , dit—il sont facilement
appli cables aux nécessités de la v ie moderne . L ’ arrêt
chez nous e s t uniquement dû aux mollahs qui se son
cient seulement de la lettre , et n’ ont j amais pénétré
l ’ esprit philo sophique de Nous resterons dans
cet état , ta nt que nous ne nous serons pas débarrassés
de ces prêtres fanatiques ; et tant que nous n’ aurons pas
obtenu pleine possession de la liberté de conscience,nous serons incapables d ’ avoir une religion vraie , une
politique vraie ! Les Musulmans des j ours actuels ne
vivent pas en vertu des prescriptions envoyées par Dieu ,mais d ’après les lois faites par les mollahs , v enues des
t emps ç passés . Il existe chez nous des hommes de Dieu
très pieux et très instruits , mais la grande maj orité est
composée de derviches Comme la plu
part d’entre nous ne savent pas l ’ arabe (langue dans
laquelle est écrit le Coran qui ne doit pas être traduit)nous ne lisons pas le Coran pour le comprendre en son
esprit, mais nous en récitons les versets comme des
Nous aut res Musulmans vi vons encore au
Moyen Age
Nos lois religieuses et ordonnances au suj et des fem
mes sont j ustes et libérales , mais elles sont mal appli
quées par les hommes d’ auj ourd ’hui . L ’
Islam n’
ordonne
pas la polygamie , mais la permet seulement sous certaines Actuellement nos femmes sont igne
rantes de leurs droits ; leurs époux, sans instruction ,sans frein , les considèrent comme de s esclaves , agissentauprès d
’
elles en tyrans contre l ’ esprit de l’
Islam . Notre
religion commande aux femmes de se v oiler la figure
(1 ) D’
après t radu c t ion anglaise du Professeur A . Vam b éry .
Budape s t , Un iv ersi t é, j an v ier 1 905 . Paru , Londre s, Nine t e en t hCen t ury , fév rier 1905 .
L’
I SLAM EN RUSS IE ET AU CAUCASE 249
et les mains , mai s ne leur défend pas de fréquenter leséc oles , les collèges , de professer, de se rendre aux m os
quées d ’ écouter les sermons , de dire la prière, de
visiter les marchés et d ’y commercer, de cultiver les
arts , d’
écri re même, enfin de prendre part aux guerres
et de se distinguer dans toutes les circonstances de la
v i e . Jadis de nombreuses Musulmanes ont été célèbres
comme poètes , artistes , musiciennes , comm erçantes
étudiantes , etc . Et l ’ auteur aj oute : La condition
de nos femmes est, malgré tout, plus heureuse que celledes Européennes en général , car les veuves et les vieillesfilles sont extrêmement rares chez nous
Ces aspirations de la classe musulmane instruite seretrouvent dans tous les pays d ’
Islam . En Russie ellesont coïncidé avec les transformations sociales qui j e
t èrent un grand nombre de déracinés dans les grandes
cités méridionales . Ces éléments se j oignirent aux rév o
lut ionnai res de 1 905 et publi èrent une véhémente pro
testation exprimant les griefs et les désirs de tous les
Musulmans vivant en Russie . Sous forme de pétition ,l eurs revendications paru rent au Caire dans le n° 60
du j ournal Le Turc . En résume les Tatars se plai gnaient
que la liberté de pensée, adm l se partout auj ourd’
hui ,leur soit refusée , que les droits précédemment accordés
(1 ) En c er t a in e s m osqu ée s de l’
Afriqu e du Nord, il ex ist e . un
em plac em en t réserv é aux femm e s .
Il n’
e st pas inu t il e de rappeler la no t e 4 de la soura t e XX ,
v erse t 24, de la t raduc t ion du Coran par Kazirmi ski . Ce t t e no t e
s’
appliqu e su iv an t la Sunna à une b elle femm e qu i priait auprèsdu Prophè t e à la m osqu ée , e t qu e c ert ains a t t endaien t pour la
v oir sort ir .
(2) Khadidja ,l epou se du Prophè t e , ét ai t n o t amm en t un e
c omm e r çan t e av i sée .
(3) V . à c e su j e t , Conférences franco-m a roca in es .
250 L’
ISLAM ET LES RA CES
par les tsars soient continuellement réduits par l’
aug
mentation constante de l a tyrannie gouvernementale ,en plein milieu du xx e siècle dans lequel règne l
’
esprit
d ’humanité . Après avoir énuméré les privilèges ai nsi
abolis,montré la propagande orthodoxe russe pour la
conversion des Tatars à la religi on officielle, la suppres
sion des tribunaux et écoles islamiques , les Musulmans
terminai ent leur pétition par un vibrant appel aux
grandes pui ssances européennes pour qu’ elles inter
cèdent en leur faveur, déclarant que si eux—mêmes
gagnerai ent en sat isfact ion , ] e tsar y gagnerait en sé
enrit é Cet appel fut remis en 1 905 au tsar, au sultan ,
aux puissances européennes .
Le gouvernement russe dut tenir compte du réveil
de ses populations musulmanes . Le droit de vote leur
fut accordé . Dans le s provinces Où les Musulmans de
m inaient par le nombre, ils purent élire à la Douma
une quantité de députés fix ée et garantie par l ’ autorité
centrale . A la Chambre siégèrent ainsi hu it ou dix dé
légués de leur foi . Ayant en principe des droits poli
t iques égaux à ceux des Chrétiens , les Musulmans ser
v aient dans l’ armée au même titre que ces derniers ,
étaient admis aux plus hauts grades sans qu’ il fût tenu
compte de leur religion . Cependant, par suite des an
ciennes conventions , les Tatars de Crimée continuèrentà former un régiment spécial de cavalerie .
La Révolution russe de 1917 a déterminé les Musulmans à rechercher leur unit é et leu r autonomie pa rti
cu liè re s, comme le firent a Irkont sk les pri nces mongols .
Bien que le gouvernement provisoire leur eût prom is
nu délégué à l’
Assem b lée constituante (j uin les
Tatars de la Volga , aussi bien que les Caucasiens et les
Transcaspiens , envoyèrent des dépu tés à la Conférence
252 L’
I SLAM ET LES RACES
républi ques de guerriers , lesquels , avec un peu d’aide , au
raient pu vivre et fournir de loyaux défenseurs à la cause
de l a j ustice . De même que les Arméni ens du Caucase,de même que les Assy ro-Chaldéens d
’
Ourmiah que le
Père Lazariste Decroo a conduits avec succès à la lutte
aux confins de la Perse et du Kurdistan , j usqu’ à la
liaison avec l ’ armée russe, de même les Géorgiens , demême les Tcherke sses, lesquels avaient préféré la mort
ou l ’ exi l plutôt qu e la servitude russe , de même lesTatars , ne reçurent des Alliés aucune assurance soli de
pour la reconnaissance de leurs droits .
Et pourtant le général Lüdendorff dans ses souv e
nirs (pages 238—39) reconnaît que la rupture des
communications pour l ’ envoi des p étroles entre Bakouet l ’Allem agne , par suite des entrepri ses arméniennes ,fut une des causes déterminantes de la défaite alle
mande . Pourtant les Musulmans du Caucase semblaient,après la défaite de la Turquie , disposés à cré er au Cau
case des états indépen dan ts .
Pourtant,pendant la guerre mondiale
,les Chrétiens
du Caucase avaient j oué un véritable rôle militai re en
ces régions : Les Arméniens et les Assy ro—Chaldéens
avai ent bravement combattu dans les rangs de l ’armée
russe à la débâcle qui su iv i t,en décembre 19 1 7
,1’aban
don du front par les troupes russes du Caucase,
le
gouvernement de Transcau casie,avec l ’aide des mis
sions alliées de Tiflis,décida de former des troupes
nationales pour se défendre con t re l ’inv asion turque ;les
corps arménien,géorgien
,et tartare furent fondés
(1 ) A. Poideb ard . Rôle m ili ta ire des A rmén iens s ur le fron t duCa uca se , après la défec t zon de l
’
a rm ée russe , dans la Revue des
E tudes armén iennes , 1920, t . I, fase . 2. Paris, Gen thner .
r.’
rsr. a sr EN RUSS IE ET AU CAU CAS E 253
Mais la Géo rgie,sentant l
’
incapacité des al li és d ’
ai der
les peuples caucas iens,se retourna bientôt
,au prin
temps,vers l ’All emagn e et la Rus sie b olcheviste ; les
Tatars,Musulm an s très t ravaill és par les agents
touraniens,
firent rapi dement cause comm une avec
les Turcs ; ils s’
eñ orcè rent d empêcher le rav ita i ll e
ment des Arméniens venan t de Perse et coupèrent le s
communications avec Tifli s . La Géorgie où les Tatar s
étai ent nombreux,ne les empêcha pas d
’
0pérer ainsi .
Le s Arméni ens restèrent seul s
L Arm ée arméni enne comprenai t trois divi sions
1 r e Divis ion à Alex andropol,général Are chefi’ .
2e à Erivan,général Silik oñ .
39 mobil e,général Andranik .
Brigade de cavalerie,co l onel Korganof .
L ’ensemble étai t commandé par le général Naz ar
b ékofî . Au sud,aux con fi ns de Perse e t de Turqui e ,
opérai ent les troupes assy ro-chal déennes comprenant
La brigade chal déenne,agha Petros
,
nestorienne Patri arche Marshim oun,
un bataillon arménien St éphan i an ;
ces troupes étai ent dirigées p ar un état maj or russe .
Mais ces derni ers soutiens de l’
indépendan ce du
Caucase étai ent bien peu dev ant l’ennem i à fin m ai
1 9 18,les Allemands débarquèrent qu inz e m ille hommes
a Poti pour teni r la ligne Batoum—Bak ou . Déj à
Turcs avai ent formé la Grande Armée caucasiennede l
’
Islam qu i , composée des div i sions venues de
Pal esti ne appuyée par le s irréguli ers Kurdes et Tatars ,finit par avoir rai son de l
’
héroîque résistance des Armé
niens . Ces derni ers résistèrent cinq mo is,de j anvier à
(1 ) He nry Barb y, Les er lra va ganœs bolchev iquæ et l’
épopée
a rmén ie nne . Paris , Alb in Miche l .
254 L’
i SLAM ET LES RACES
mai 19 18 . Ourm iah tomba le 5 août 19 18 , Bakou le
15 septembre . Une petite brigade anglaise,venue de
Perse,sou s le s ordres du général Dunst ervi lle
,parut
à Bakou du 5 au 17 août,trop tard cependant pour
sauver la ville .
Depuis,les peuples caucasiens ont essayé de vivre à
l etat libre en profitant de l ’ anarchie régnant aussi bien
en Turquie qu’ en Russie . Mais très vite le besoin
d’
aide se fit sentir, surtout que grandirent bientôt les
Bolchevistes d ’une part,les Kém alist es de l
’
autre . Le
Caucase est actuellement le point où se rej oignent
l ’ impérialisme moscovite et l ’ impérialisme touranien ,alliés pour une cause commune , la destruction de l
’ en
tente des puissances européennes .
Les Russes des Soviets semblent avoir repris pourl eur propre compte le rêve allemand de l
’
Islam au ser
vice des pangermanistes , mais cette fois pour la plu sgrande domination des Bolchevistes . D e 19 19 à 1920 se
multiplièrent les voyages des Commissaires du peuple,en Crimée, au Caucase , en Asie centrale , en Asie Mi
neure, en Perse , en Afghanistan , en Sibérie, peut-êtremême en Chine pour rallier les peuples musulmans autour des Soviets . Ceux qu i combattaient recevaient subsides e u or, munitions , m at ériel . A Kazan , sur la Volga ,
où résid e le grand Mufti des Musulmans de Russie ,Trotsky faisait fonder dès 1 920 une école militaire des
t inée à former des officiers musulmans de toutes nations .
Moustafa Kémal envoya à cette école un certain nombrede ses o f ficiers . A Kazan les élèves ne recevaient pas seu
lement une instruction militaire,mais ils étaient encore
spécialement instruits dans les doctrines b olchevistes
et dans la haine due à l’
Anglet erre et à la France . Dans
l’
armée étaient créés des régiments de chaque nationalité
256 L’
I SLAM ET LES RACES
Kemal paraît partout où ce dernier négocie . Enver afait aboutir les négociations kémalist es à Berlin
,à Mos
cou,au Turkestan
,en Afghanistan ; son titre actuel
de Président du Caucase musulman soviétique
lui permet en ce nœud vital des races,des rel igions
,
qu ’est le Caucase,d
’
agir dans tout l’
Orient,et de mettre
ce t Orient à la disposition de ses patrons . Kemal craintEnver et Enver
,s ’ il n ’avait pas une meilleure situa
tion,pourrait songer à renverser Kemal ; mais ces
hommes sont tous au service des mêmes ambitions etdoivent se supporter . Le paysan turc est foncièrement
hostile aux principes anarchiques,mais encore le b ol
chev isme est assez souple pour ne pas heurter de front
ceux dont il a besoin . D ’ailleurs la transformationrécente des Soviets en gouvernement autocratique e t
c apitaliste s ous la direction des Allemands ne fait
nullement prévoir la possibilité d ’une rupture Moscou
Angora,au contrai re . Le bloc puissamment outillé
de l’
Allem agne , de la Russie , de la Turquie , est à craindre .
Pour ces raisons,il est indispensable de suivre les
agissements des Soviets dans le monde musulman e t
l’
évolution des groupements islamiques en Russie etau Caucase . La nomination du Cheikh Senoussi
,comme
Président du Comité panislamique de Moscou,de ce
cheikh qui a déj à reçu le titre de maréchal d ’
empire
turc commandant les tribus arabes contre le s Francais et les Anglai s
,de ce cheikh contre lequel combat
tent les Italiens en Tripolit aine et qui a une si grosse
influence en Afrique,doit particulièrement attirer
l ’attention .
Au Caucase gît,semble—t -il
,le nœud de l a question
o rientale . Supposons que tous les groupements chré
L’
i SLAM EN RUSS IE ET AU CAUCASE 7
tiens puissent se rassembler,lutter
,être soutenus
,
qu’
au t our d ’eux'
s’
un issent les tribus musulmaneshostiles aux Turcs ce qui se f ait déj à
,le pantou
ranisme sera étouffé dans l ’œuf si les Grecs d’
Asie
Mineure agissent de même dans l ’Oue st,il est certain
que le bloc Angora—Moscou sera dissocié et la puissance
germanique affaib lie .
Crimée . La Crimée qui fut le dernier refuge de
l m dépendance musulmane en Russie a obtenu au débutde l
’
année 1922 la reconnaissance de son indépendance
par les Soviets . Le gouvernement de Moscou a ratifié
les 24 articles proposés par le Congrès national tatar
criméen comme devant servir de base aux institutions
de la nouvelle république . Cette république avait déj à
été votée par le Kourilt aï (assemblée de et prend
maintenant consistance .
Les langues officielles de la Républi que sont le tataret le russe . Sous le régime des tsars , les Tatars formaientun régiment de cavalerie indépendante . Le nouvel Etataura son armée à part avec des instructeurs russes .
Il est à noter que les Tatars de Crimée ont maintes
fois prononcé leur attachement au sultan khalife otto
man e t qu’ en Turquie existent de nombreux groupe
ments de Tatars crim éens partis de leur pays pour avoir
préféré l’
exi l à la servitude aux Moscov it es .
Kemal paraî
fait aboutir les nego
cou,au Turkest an ,
de Président du
lui permet en ce n
qu ’ est le Caucase,d
’
cet Orient à la disposit
Enver et Enver , s’
il 1
tion,pourrait songer
hommes sont tous au
doivent se supporter .
hostile aux principes
chev ism e est assez son
ceux dont il a besoi
récente des Soviets e r
capitaliste s ous la di
nullement prévoir l a p
Angora,au contraire .
de l ’Allemagne , de la I l
dre .
Pour ces raisons , il
agissements des Sov ietl’
évolution des groupe
au Caucase . La nomina
Président du Comité
cheikh qui a d éj à re ç 1
turc commandant lescais et les Anglais
,de
tent les Italiens en Tr
influence en Afrique
l’
attention .
Au Caucase gît,sem
o rientale . Supposons
CHAPITRE XV
L’
ISLAM DANS L ’ INSULINDE
L’
I SLAM I SAT ION .
Les Iles de la Sonde comprennent auj ourd ’hui plusde trente—six millions de Musulmans . Les groupements
les plus importants se trouvent à Java , Sumatra e t
Madura . Bornéo est islamisé sur tout son pourtour .
Les marins arabes et persans qui allaient en Chine, pas
saient par le détroit -
de Malacca , faisai ent escale dans
l’
Insuli nde . Ces navigateurs laissèrent dans le s îles de
n ombreux missionnaires qu i finirent par s’ installer dans
l ’ archipel malais . Les auteurs arabes indiquent que dès
l’
année 850 après Jésus—Christ, les Musulmans pénét rèrent dans ces régions , mais la véritab le expansionislamique n ’ eut lieu que beaucoup plus tard .
L’
Islam pénétra dans Sumatra vers 1 1 70, grâce à depuissantes missions venues de l ’ Inde
,A Java, le premier
missionnai re musulman , Malik Ibrahim , mort en 14 19,fut suivi de B aden Rahmat (1467) Les deux hom
m e s venaient de la côte du’
Malabar, région dans la
quelle régnait le rite shafe it e ce fut par suite ce sys
t èm e qu i fut introduit à Sumatra et à Java . Les mis
sionnaires, suivant l’ enseignement donné par le Coran ,
employèrent d ’ abord la persuasion , puis la force, dès
que leurs disciples furent assez nombreux pour imposer
leur volonté aux incrédules .
(l ) Har tm ann , der I slam ; Margoliou th, M ohammedan ism .
L’
I SLAM DAN S L ’
INSUL IND E 259
Des royaumes musulmans se fondèrent dans les îles .
Ibn Bat out a , dès 1436 ,signale l ’un d ’ entre eux sur la
côte septentrionale de Sumatra en 1 500, celui de Me
nang Kabau fut célèbre . Enfin en 1 5 18, les Hindous
qui étaient les maîtres du pouvoir en Insulinde , furent
chassés et remplacés par les Musulmans comme ils le
furent pareillement en Hindoust an . L’
Islam devint la
religion dominante au sud et au nord de Java , à Su
matra , gagna la périphérie de Bornéo , les Moluques,
les Philippines , les Soulouques, sans que les Hollandais
puissent arrêter cette islamisation .
I I . LE S EUR OPÉEN S EN IN SU L 1ND E .
La croisade des épices qui s etait poursuivie le long
des côtes orientales de l’
Afrique et de l’
Inde avait amené,
à la suite des Portugais , les Hollandais j usque dans
l’
Insulinde . Ces derniers atteignirent les îles de la Sondevers le mili eu du XV I e siècle , fondèrent Batavia en 16 10 .
En 1749 , un des princes indigènes ab diqua en leur i aveur ; la compagnie hollandaise de s Indes de l
’
Est , mai
tress e du privilège d’ exploitation dans l ’ archipel , essaya
d’
administrer la région , mais ne put tirer parti des avan
tages obtenus j usqu ’ en 1 758, date à laquelle, après de
violents combats,l es Hollandais réussirent à imposer
l eur autorité à toute l ’ île de Java . Se réservant le gou
v ernem ent direct de toutes les provinces°
côtières du
nord , ils rest aurerent dans l’ intérieur et dans les dis
t rict s méri dionaux,les princes indigènes qui furent
déclarés indépendants En 181 1 Java fut occu
pée par les Anglai s , mais restituée aux Hollandais par
le traité de Paris . D epuis ,cet t e époque , les Néerlandais
administrent les îles de la Sonde .
260 L’
I SLAM ET LES RACE S
I I I . LES MUSULMANS DE L’
INSUL IND E .
Le nombre des Musulmans dans l’
Insulinde augmente
annuellement . Le but commercial , politique , religieux , des
premières expéditions avait eu pour résultat le mariage
de nombreux Musulmans avec des femmes indigènes ,et par suite l
’ apparition de métis attachés au pays .
C ’ est par eux que l’
Islam a pri s un caractère spécial
dans ces régions . En raison dé leur énergi e , de leur for
tune bientôt gagnée, de leurs esclaves , les disciples de
Mahomet, au m ilieu d’une population native douce et
facile, acquirent bientôt une grande consideration et
l’
Islam avec eux . En conséquence , la persuasion j ointeà la force causa le succès de la nouvelle religion dans
l ’archipel malais .
Aux missionnaires venus de l’
Inde , à leurs deseen
dants , aux natifs convertis , s’ aj oute auj ourd ’hui un
nouvel élément, l’ élément purement arabe . A Java les
Arab es sont représentés le plus souvent par des émigrés
venus du Hadramaou t , province d’
Arab ie . l ls sont
à Java , dans les possessions extérieures
Ces Arabes sont avant tout des commerçants,venus
dans l’
archipel pour s ’ enrichir, et tiennent à retournerdans leur pays aussitôt que possible . Cette situation
les détermine à suivre une poli tique spéciale v is—à-vis dugouvernement . Malgré leur zèle religieux réel, ils cherchent
à ne pas se rendre défavorables les Hollandais dont ils
ont b esoin pour leurs affaires . Dans tous leurs actes , ils in
v oquent les préceptes coraniques qui peuvent leur ser
vir, mais même ceux d’ entre eux qui ont acquis sur les
(1 ) J . Cha ille y-Bc r t , Ja va e t ses ha b i ta n ts . Co lin , Paris, 1 900,
p . 1 04 .
262 L’
i SLAM ET LES RACES
représentations qui ne sont guère conformes au Coran .
Le climat est pour beaucoup dans cet amolli ssement d e
l’
ardeur musulmane . Les métis d’
arab es et de natif s
serai ent sans doute plus portés à se grouper, mais ce
serait sans doute pour des revendications poli tiques .
Une constatation se fait cependant : les naturels ont
le plus grand respect pour tous ceux qui ont approché
La Mekke et pour tous ceux qui proviennent des régions
voi sines de l a patri e du Prophète . Les Arabes du Ha
dram aout , pourtant éloignés du Hedj az , ont ainsi un
ascendant réel personnel sur les indigènes de l ’ archi
pel
Quoi qu’ il en soit, l
’ on peut dire que les Musulmans
ont, dans le s îles de la Sonde , accepté, après un certainnombre de révoltes , la domination hollandaise . Le fana
tisme musulman n’ existe pour ainsi dire pas , malgré
quelques explosions , dans l’
archipel mal ais . Peut—être
l’
Islam , au terme de sa course , n’
av ait -il plus assez de
force expansive pour soulever les nouveaux convertis
Peut—être encore, le climat amolli ssant, qui dans l’
Inde
avai t fai t perdre aux farouches conquérants nordiques
leur vigueur premiè re , le climat dévorateur d’ énergies ,
qui a créé,dans ces régions
,une race douce et facile
,
sauf quelques rares ex ceptions , peut—être le climat e st -i l
la cause de la fai blesse , de l’
inefil cacit é de l’
Islam en
ces régions
(1 ) D’
aprè s Chailley —Be r t , Op . c it .
— Le n om b r e de s pèler in saugm en t e e n ra ison de la fac ili t é de s m o y e ns de t ran spo r t .
Ann ée Jav a e t Madoura Po sse ssion s Ex t érieure s1 890 2 257 pèlerin s 3 528 pèlerins189 1
1 892 .
1893 . 4 . 766
1894 .
1 895 .
1 896 .
L’
i SLAM DANS L ’
1N SUL IND E 263
Les tendan ces modern es . Cependant,vers 1900 et les
années précédentes , on signalait aux îles de la Sondeune action plus v ive des confréries religieuses , une ré
crudescence du nombre de pèlerins se rendant à La
Mekke . Le panislamisme de l ’Ot t oman Abd ul Hamid
avait—il touché ces régions
Il semble qu ’ il se soit produit là un mouvement sem
b lab le à ceux qui se sont produits dans les autres pays
musulmans . La politique des ordres religieux s ’ est opposée
un peu partout à l’
occupation européenne de la fin du
X IX e siècle . Les moyens de transport étendus ont en même
temps facilité les voyages . Or les habitants de l ’ Insu
linde tiennent beaucoup au rite extérieur, à la conside
ration que proèure le titre de hadj i . Il ne faut sans
doute pas voir dans cette recrudescence de pèlerins une
conséquence du panislamisme ottoman . Chez les mét is
plus attachés aux revendications , chez les naturels let
t rés, ce mouvement indique sans doute comme ailleurs
les premières tentatives vers un essai de self—control
Mais il ne semble pas que le s indigènes arrivent de long
temps à un ré sultat tangible .
Pendant la guerre mondiale,i l y eut aux îles de l a
Sonde une sérieuse agitation d’
origine allemande,
laquelle a causé des appréhensions sérieuses au gouv er
nement hollandais . Il y eut d’
ailleurs à cette époque
des pourparlers importants entre le représentant des
Javanais a La Mekke, qui est un algérien , et le Consul
de Hollande à D j eddah . Cette influence hollandaise
par les Musulmans n ’était pas favorable à l’
Ent en t e,
et en particulier hostile à l’
Angle terre .
Les Hollandai s sont solidement établis dans l ’ Insu
linde . Ils ne pourraient en être chassés que par une
puissance militaire et navale considérable . Les Arabes
264 L ’ 1 5 LAM ET LES RACES
seuls sont impuissants . D’
ailleurs le gouvernement n ’ a
maintenu qu e très peu de princes musulmans e t sur
veille de très près ceux qui restent . Il possède en
M . Snoucke—Hurgronjc un islamisant des plus distingués
qui connaît à fond le s mouvements de l’
âme musulmane
et qu i connai t cette âm e la possède, l’
empêche de nuire ,et peut la diriger dans le sens le plus convenable aux
intérêts de la métropole . Cependant les progrès de
l’
Islam dans les Indes hollandaises sont considéra
bles . Il s ’y imprime des j ournaux en arab e . Dès 1 910,
le sultan marocain,Moulay Hafid recevait de c e pays
de s lettres,des j ournaux
,des télégrammes approuvant
sa répression de la révolte du Rogui Bou Hamara ,répression que l
’
Europe au contraire avait j ugée bar
bare e t féroce . Les pèlerins de Java constituent,à La
Mekke,le plus fort des groupements
,celui qui apporte
le plus d ’argent et dépense avec le plus de somptuosité .
Une colonie j avanaise importante demeure à La Mekke
et à Médine Pendant la guerre de 19 14-1 8,ell e n ’a
point dissimulé ses affinités germaniques . Le gouv er
nement hollandais . d’
ailleurs,comme celui de s Indes
anglaises,a marqué vis-à-vis des groupements musul
mans dépendant de lui une condescendance qui les
a enhardis,et en 1920 a causé de légitimes inqui études
,
(1 ) Le con sul de Hollande à Dj eddah, por t de La Mekke , ypossède , du fai t de l
’
im por t an ce de s capit aux impor t és par se s
r e ssor t issan t s, un e s it ua t ion de prem ier plan , qu i cau sa pendan t
la gu e rre des appréhension s asse z for t e s a u gouv ern em en t b rit ann iqu e pour qu e c e c on sul , capit ain e de frégat e en c on gé, a i t ét é
m i s dans l’
ob liga t ion de n e corre spondre av e c son gouv ern em e n t
qu’
en t 1 an çais e t san s se serv ir de c ode s chiffrés . Il de v a it e n ou t re
rem e t tre au Lieu t enan t -Co lonel b ri ta nniqu e Dj eddah c opie dec e qu
’
il écriv ait e t de c e qu’
il re c ev ai t,d e s précau t ions de v aien t
d’
ailleurs ê t re prise s au Caire pour répare r le s om i ss ions qu’
il
au ra i t pu c omm e t t re .
CHAPITRE XV I
L ’ INDE MUSULMANE
L’
Inde actuelle compte environ trois cents millions
d ’habitants dont plus du sixième e st musulman , soit
environ 50 millions de Musulmans . Neuf cents ans au
parav ant . l’
l slam n’ avait pas un adepte à l ’Est de l ’Hin
dus ; auj ourd’hui
,le roi d
’
Angle t erre possède plus de
suj et s musulmans que n’ en ont le sultan de Turquie
et le shah de Perse réunis .
Certains hi stori ens ont voulu voir dans la conquête
de l’
Inde par l ’ Islam ,moins une expansion voulue par
les chefs musulmans , que le résultat d’
un de ces cou
rants séculai res qui poussent de temps à autre les
trib us de l’
Asie centrale, Huns , Mongols ou Turcs , vers
l’
Europe ou la Chine . L’hi stoire démontre le contraire .
Si les conquérants arabes ne firent qu’
efileurer la terre
des radj ahs , leurs successeurs turcs , eux , firent de l’
Inde
un empire musulman , suivant une volonté rai sonnée .
Prem iers con tacts de l’
I slam et de l’
Inde . Les A ra
b es . Les marins arabes étaient des familiers des ports
hindous . L ’
Islam leur donna le prétexte de raids vers
les villes côtières , d’
où ils rapportèrent de grandes ri
chesses . Ai nsi sous le khali fe Omar, en 637, Tana (Bom
bay) fut pillé . Mais ces expéditions maritimes ne furent
guère que des aventures de corsaires : les Arabes cher
ehè rent la voie de terre par l’
Afghanist an actuel pour
atteindre les Indes . Ils furent longtemps retardés par
L ’ INDE MUSULMANE 267
la constitution physique du sol . En effet, si au v u e s1 e
cle , les Sarrasins bri sèrent presque toutes le s ré
sist ances humaines , ils furent souvent obligés de s’
arrê
t er devant le s ob s tacl es naturels . C‘
est ainsi que les
hautes cimes de l ’Hindou-Kousch sauvèrent longtemps
l’
Hindoust an .
Les attaques arabes dans l’
Est eurent lieu relative
ment tard car les Musulmans furent occupés par les
Berbères (1 Afri que j usqu’ à la fin du V I I e siècle . Cinq ans
avaient suffi pour soumettre la Syrie, d eux pour l’
E
gypt e , sept pour la Perse , mais Carthage dura plus d’
un
demi-siècle et les Berbères furent en perpétuelle révolte .
Aussi le s khalifes envoyaient-il s plutôt dans l ’Ouest leurs
forces disponibles . Cependant au . v 1 1 e siècle le Bélou
chist an (Makran) fut occupé, et en 664 Kaboul en Afgha
nistan fut enlevé . D e nombreuses conversions à l ’ Islam
suivirent la conquête .
Le premier succès arabe dans l ’ Inde com cida avec
deux autres succès importants d es Musulmans en des
régions opposées du globe . L’
Espagne gothique fut écra
sée en 7 10 à la batai lle du Guadale t e . Les étendards de
l’
Islam furent portés en 7 1 1- 1 4 de Sam arcande à Kashgar,dans le Turkestan chinois actuel . La vallée de l
’
Hindus
fut envahie en 712 . Ces trois succès marquent l ’ apogée
de la puissance omm ey y ade .
Le même Al Haj j aj , gouverneur de Chaldee (Irak) ,qui envoya vers le nord Ku t aïb ah porter l ’ Islam sur les
frontières tatares , chargea vers la même époque son
cousin Mohammed beri Kasim de marcher sur l’
Inde .
Cette continuité de v ues contre lesquelles d’ ailleurs le
khalife marqua quelque répugnance, prouve la volonté
de l’
expansion islamique vers l ’Hindoust an .
Mohammed ben Kazim conquit rapidement la vallée
26 3 L’
I SLAM ET LES RACES
de l’
Hindus . Les peuples soumis furent si bien traités
que la mémoire du général arabe est longtemps restée
populaire . Malheureusement Mohammed ben Kazim
périt victime d’
in t rigues de cour . Al Haj j aj lui—même
étai t mort . Les Arabes conquérants du S ind (7 14ne reçurent aucun renfort . Ils fondèrent alors des dy
nasties indépendantes dans la vallée de l’
Hindus . Ma
sondi vers le X e siècle signale leurs groupements .
Ainsi se termina la tenta tive d’
Al Haj j aj vers l ’ Inde .
L ’ affaire fut reprise trois siècles plus tard .
L es sultans de Ghazn i . Les armées de Moham
med ben Kazim étaient composées d’
Arab es . Les con
quérant s de l’
Inde furent de race turque c’ est de l
’
Af
ghanist an que partirent ces Turcs musulmans .
La chute de la dynastie ommey yade , le déplacement
de la capitale de Damas à Baghdad par les Abbassides ,furent suivis d ’un afflux d
’
influences persanes . Le dépla
cement de la capitale de Damas à Baghdad marqua la
reprise de la prédominance asiatique sur la civilisation
hellénique . Les Persans , plus souples , moins rudes que
les Arabes , remplacèrent ces derniers dans la plupart des
postes ; comme le pouvoir central devenait de plus en
plus faible, l es gouverneurs de provinces éloignées se
rendirent pratiquement indépendants du khalifat . Ils
fondèrent même de véritables dynasties dont la plus
puissante fut celle des Samanides dans la région de l’
Oxus .
En même temps , les khalifes s’
ent ourè re nt de prétorien s ,j eunes enfants turcs capturés sur les frontières nord—est
de l ’ empire et dressés au métier des armes . Les sultans
ottomans devaient plus tard reprendre cette institution en
créant les Janissaires, qui au lieu d’
être de j eunes enfants ,de race turque, furent de j eun e s Chrétiens recrutés de
270 L ’
1 5 LAM ET LES RACES
Les sultans de Ghor et de Ghazn i . Le frère cadet
du prince de Ghor fut placé sur le trône ruiné de Ghazni
(1 173 I l fut appelé sultan Mu izz cd-din ou encore
Mohammed de Ghor . De 1 1 75 à 1 187,ce prince soumit
Moult an , le Sind et Lahore . Le sultan voulut s ’ engager
dans les riche s provinces de l’
Inde supérieure il fut
d ’ abord vaincu par les Radjpout s hindous , mais en
1 193,s’
empara de Delhi e t de B enarè s, en 1 196,de
Gwalior, en 1203 de Kalanj ar . Ce dernier succès com
plét ait la soumission de l’
Inde supérieure .
Vainqueur, Mohammed de Ghor , qui avait succédé
à son frère en 1203,retourna à Ghazni et tourna ses
armes vers le nord . Il fut vaincu dans le Khwarizm
(Khiv a) ,e t se born a a son empire . Rappelé dans l ’ Inde ,
en 1205 , par la révolte des Khokars, Mohammed noya
l’
insurrection dans le sang,mais fut assassiné au retour
par un fanatique (mars
Avec Mohammed de Ghor, l’
occupation de l’
Inde
par les Musulmans devint eff ective et permanente . Sansdoute le souverain fut touj ours un Afghan aux yeux
aussi bien tournés vers l ’Oxus que vers l’
H indus, mais
il laissa dans l ’ Inde un vice-roi . Ce vice—roi donna nai s
sance à la fameuse dynastie des Rois Esclaves delaquelle part cette longue suite de souverains musul
mans qui,de D e lhi , on t gouverné l
’
Inde j usqu’ à la dé
sast reuse révolte des Hindous contre les Anglai s . C’
est
ainsi que par Mohammed de Ghor se fait la liaison
entre le khalifat islam ique et l’
Inde musulmane .
L es sultans turcs de D elhi Les Rois Esclaves . Le
vice-roi laissé dans l ’ Inde par Mohammed de Ghor fut
le général Malik Kout b cd—din Ibak . Né dans le Turkes
tan , il avait été achet é comme esclave par le prince dé
L ’ INDE MUSULMANE 27 1
funt . Ses victoires éclatantes lui valurent de la part dusultan Ghiyas ed din ,successeur de Mohammed de Ghor,l ’ envoi du titre de sultan , avec Delhi comme capitale .
Il ne faut pas s ’ étonner de voir un esclave parvenir
aux plus hautes dignités . L ’
Islam est égalitaire : l’ es
clave fait partie de la famille à laquelle il est tout dé
voué . Dans l’
empire sedj ou cide les esclaves j ouèrent
un rôle important . La garde m ameluk de l ’ empereur
Malik shah fut une école de gouverneurs capables .
En ces temps- là le prince , faute de fils , désignait
souvent un esclave comme général ou comme gonyer
neur . Avoir été esclave de Malik shah constituait alors
un véritable titre au respect . Les grands vassaux es
claves des Sedj oucides furent aussi loyaux que les Bâ
t ards du Moyen Age . Quand ils assumè rent à leur tour
le pouvoir royal , ils t ransm 1rent à leur lignée les hautes
qualités de leur seigneur e t maître ai nsi que les tradi
tions de la maison princière . Quelqu’un déplorait devant
Mohammed de Ghor que ce prince n’
eû t pas d ’ enfant
mâle : N ’ ai-j e pas des milliers de fils en mes esclaves
turcs ! Aussi,n e trouva-t —ou ri en d
’
ex t raordinaire à
c e qu e Ghi yas ed din envoyât le titre de sultan au
général Kou t b ed din , le plus célèbre des esclaves du
Ghori . D’
ai lleurs il est possible que les Sultans pré
fè rent employer leurs esclaves plutôt que des gens de
grande famille : les grands,surtout les princes , font
touj ours figure de prétendants à un moment donné .
La facilité‘
avec laquelle les Musulmans montèrent
sur le trône de Delhi n ’ a,non plus , rien d
’
ex t raordinaire .
La hi érarchie des castes dans l’
Inde avait préparé les
habitants à se soumettre au pouvoir ex i stant . Il y eut
seulement une caste de plus , cell e des Musulmans . LesHindous reconnaissai ent avec la même résignation le
270 L’
I SLAM 3T LES RACES
Les sultans de Ghor de Ghazn i .
du prince de Ghor fut plcé sur le t rôn
(1 1 73 Il fut appelé ultan Muizz
Mohammed de Ghor . D 1 1 75 à 1 187 ,
Moult an , le Sind et La ] re . Le sultan
dans les riche s province de l’
Inde
d ’ abord vaincu par le sRadjpout s
1 193 ,s ’ empara de Del l et de Be
Gwalior, en 1203 de K anj ar . Ce d
plét ait la soumi ssion d l’
Inde supé
Vainqueur, Mohamm d de Ghor , quià son frère en 1203 . rmurna à Ghazni
armes vers le nord . I l'
ut vaincu dans
(Khiv a) ,e t se born a sn empire . Rappelen 1205 , par la révolte 1€S Khokars,
l’
insurrection dans le sag ,mais fut ass
par un fanatique (mar
Avec Mohammed 111 Gh0 r, l’ occupation
par les Musulmans (le—“it eff ective et permandoute le souverain full ouj ours un Afghan
aussi bien tournés v er: ’ Oxus qu e
i l laissa dans l’
Inde un i ce-roi . Ce
sance à la fameuse dnast i e des
laquelle part cette lonue suite demans qui
,de Delhi . on tgouv erné l
’
Inde
sast reuse révolte des I h dous contre les
ainsi que par Moham re d de Ghor . se
entre le khalifat islanÿ ue et l’
Inde
L es sultans turcs de DM
vice—roi lai ssé dans l’
Iri e p
le général Malik Ke nt
tan , il avai t été achet
272 L’
I SLAM ET LES RACES
souverain quel qu ’ il fût, Radjpout e , Musulman , Mon
gol , sans se laisser , d’ ailleurs , entamer dans leurs mœurs
et dans leurs croyances . Dupleix et ses Françai s , puis
les Anglais furent également acceptés plus tard avec la
même facilité,comme représentant une caste supérieure .
Les sultans musulmans de l’
Inde furent complète
ment indépendants des khalifes , bien qu’
ils aient ré
connu leur suzeraineté . Les rois de Ghor et Ghazni re
çurent le titre de sultan de même , les sultans de Delhi
recevront avec j oie e t vénération l ’ investiture du Com
mandeur des Croyants,mais pratiquement les souverains
de l’
Inde eurent touj ours une politique et une action
indépendantes . Les princes musulmans de l’
Inde régné
rent surtout par la force les armées ne l eur firent pas
défaut ; en effet, ils savaient — pouvoir touj ours trouver
dans le nord des guerriers de leur foi susceptibles de
s ’ engager le cas échéant dans leurs armées . Dès lors
c ommence véri tablement l ’histoire de l’
Inde en tan t
qu’
E t at islamique .
En peu de temps,Sultan Kout b ed-din , aidé par son
général Mohammed Bakhtyar, un Turc encore, assura
s on autorité de l ’Hindus au Bengale . Le fil s du sultan
parut incapable de lui succéder : ce fut un de ses è s
c laves turcs , Ilt ou tm ish, qu i fut placé sur le trône par
les chefs de l ’ armée
Ilt ou tm ish combattit d ’ abord ses frères esclaves ;le Turkes tan , la Perse, l
’
Afghanist an , l’
Inde furent à ce
m oment-là ébranlés par l ’ invasion mongole de Gengis
Khan . Les trônes s ’
écroulaient , les princes et les peu
ples fuyaien t vers l’
Inde . L’
ém ot ion fut pro fonde dans
toute la péninsule, mais le Fléau de Dieu renonça
à sa première idée de revenir en Mongolie par la vallée
d u Gange et l ’Assam . Ilt outm ish sortit de la tempête
plus fort que j amais . Ses rivaux di sparurent .
L ’ INDE MUSULMANE 273
Ilt outmish atteignit l’
apogée de sa puissance en 1 229,quand le khalife de Baghdad le reconnut comme sultan
de l’
Inde . Il mourut dans toute sa gloire en 1236 . D es
princes 1n5 1gnifiant s lui succédèrent . Enfin , en 1246 , Nasired-din Mohammed , roi fainéant, prit comme maire du
palais un Turc esclave,du nom de Balban .
D’
abord ministre, puis sultan à la mor t de son maître,Balban reforma l ’ empire musulman , combattit les
raids incessants des Mongols vers l ’ Inde où se réfu
giaient tous les fugi t ifs de l’
Asie centrale . Balban mou
rut en 1287 .
Les fameux esclaves héritiers d ’
Ay b ek n’ existaient
plus Balban s’
ent oura à son tour d’ esclaves khalj is
d’
Afghanist an . Son fils Kaïkob ad fut déposé par ces
esclaves qui élevèrent au trône un des leurs , D j elal ed
din
L es ro is Khalj ou Khilj i . D j e lal ed-din eut en
core à lutter contre les Mongols . Fort avancé en âge,il laissa la direction de l ’ empire à son neveu et gendre ,Ala ed-din . Ce dernier fut le premier qui porta les ét en
dards de‘
l’
Islam dans l ’ Inde méri dionale Le
butin fait dans ses conquêtes permit à Ala cd-din de
gagner le peuple de Delhi . l l fit assassiner D j elal cd—din
e t monta sur le trône
Sous le règne de ce prince , les Mongols parvinrent
j usqu ’ à Delhi , mais la v igoureuse résistance des Mu
sulmans leur permit de refouler l ’ env ahi sseur. Ala e d
din vainqueur j ugea ne pouvoir se fier aux Mongols
convertis à l ’ Islam ,lesquels habitaient un quartier spé »
cial . Un massacre général eut lieu en 1297 .
De 1302 à 131 1 , un général du sultan , Malik Kafour,
plaça des gouverneurs musulmans dans l ’ Inde du sud18
274 L ’ 1 5 LAM ET LES RACES
j usqu’ au Malabar et su r la côte de Coromandel . D rm
menses trésors furent apport és à D elhi . Ala cd— din mou
rut en 13 16 , maître de l’
Inde entière .
Les intrigues du harem , une réaction hindoue , le s
querelles intestines succédèrent à l’
ordre établi par Al a
cd—din . Aussi en 1320, las de s troubles , les nobles of
frirent-ils le trône à Ghazi-Khan Toughlak, gouverneur
du Pandjab , qui vingt—neuf fois avait mis le s Mongolsen déroute .
La dynastie Toughlak . Ghazi-Khan prit le nom
de Ghiyas ed-din . Lui-même était un esclave de Balb an .
I l semble que , dans toutes ces dynasties , un souverain
énergique épuise toute les facultés d’
une fam ille Les en
fauts sont incapables de recueillir sa succession .Sans doute
le climat meurtrier de l’
Inde , le luxe , les plaisirs sen
suels détruisaient rapidement les qualités héréditaires
d es montagnards ; sans doute les plaines de l’
Hindous
tan étaient fatales aux quali tés physiques et aux fa
cult és morales des guerriers venus du nord-ouest . Peut
être aussi , les Sultans élevaient-ils leurs enfants dans lamollesse et dans l
’
ignorance pour n ’ avoir rien à craindre
d ’ eux . C ’ est en tout cas une constatation qui se vérifie
depuis le début de l’
histoire de l’
Inde .
Ghiyas cd-din fut remplacé en 1325 par son fils ,Mohammed ben Toughlak, l equel , suivant la loi tradi
t ionnelle , porta à son plus haut degré de puissance
l ’ empire des Toughlak , que ses successeurs laissèrent dé
e llner . Le prince , pendant son règne de vingt— six an
nées , aspira à la renommée universelle de conquérant .
Après avoir soumi s à nouveau , les unes après les autres ,toutes les provinces de l’Et at , i l réunit une grande ar
276 L’
1 SLAM ET LES RACES
Sous son règne,commença à prévaloir le système de s
présents annuel s au sultan , système qui devin t plus
tard une taxe onéreuse sous l’
empire mogol . Les v as
saux durent envoyer des esclaves , des chameaux , des
chevaux , de l’ or et de l
’argent : le p rince qui envoyait
les présents les plus considérables é tait naturellement
le plus estimé . La cour de Delhi devint a insi riche et
opulente .
Mais Firoz , homme j uste , comprit que le système
d ’ impôts employé par son prédécesseur ne pouvait être
maintenu . Les paysans étaient soumis aux taxes les
plus dures . Sur l ’ avis du vizir hindou Makhonl , la dettedes agri culteurs fut annulée . Les taxes furent ramenées
au taux fixé par le Coran et les exactions furent sév è
rement punies . Naturellement cette mesure rendit le
prince populaire .
Pour la première fois depuis l ’ arrivée au pouvoir des
Musulmans dans l ’ Inde , le sultan associa des Hindous
au pouvoir . En effet, le recrutement des esclaves turcsdans le nord étai t tari : les souverains de Delhi , en se
civilisant, avaient d’ ailleurs perdu tout contact avec
leurs montagnes natales . C ’ est alors qu’
apparurent les
Hindous dans le gouvernement ; il semble d’ ailleurs que
leur entente avec le s Musulmans ait donné d’ excellents
résulta ts .
L’
Islam n ’ en fu t pas oub l1e pour cela . Firoz resta .
avant tout , un prince musulman . Fervent Sunni , i l fit
brûler des schismatiques e t des idolâtres . En dévot orthodoxe
,i l organisa des prières et des fêtes publiques .
A la prière du vendredi , i l ordonna de prononcer l’
in
vocation à Dieu au nom de ses prédécesseurs les plus
renommés , au nom du khalife qui l’ avai t consacré sul tan ,
et au sien propre . Cette mesure mon tre de quelle ma
L ’ INDE MUSULMANE 277
mere les Musulmans indiens comprenaient leur attache
ment au khalifat : grand respect traditionnel et moral
du khalife im ais compréhension parfaite de leur valeuret de leur autonomie .
Le pro sélyt isme islam ique se dév eloppa sous Firoz .
Les Hindous furent encouragés à embrasser l’
Islam .
En même temps que les brahmanes étaient imposésce qui ne s
’ étai t j amais fait les nouveaux convertisétaient exemptés de la Capitation (Dj izy a) . Naturelle
ment nombre d’
Hindous se convertirent . D’ailleurs
le prince interdisait la construction de nouveaux tem
ples hindous sous prétexte que le peuple ne devait pas
prendre de telles lib ertés dans un pays musulman
Malgré tou t,Firoz fut aimé de tous ses suj ets . Mal
heureusement, à sa mort aucun prince ne fut
capable comme lui de maintenir l’
entente entre Mu
sulmans et Hindous ; une anarchie terrible régna dans
l ’ empire . Tout le monde fut mis d ’ accord par l’
inv a
sion des Mongols de Tamerlan .
Le Terrible Boiteux ravagea la vallée du Gange . Mu
sulman fervent, il n’
épargna pas ses coreligionnaires de
l’
Inde , sous prétex te que leur foi était dégénérée . Maître
de Delhi d ’ où s ’ était enfui le dernier Toughlak , le Khan
mongol , en partant pour l’
Occiden t , laissa le pouvoir
dans l ’ Inde à Khizr-Khan , un Seyy i d ou descendant
du Prophète chef de la famille la plus in fluente de
la capitale .
Vice—roi de Moult an , le Seyyid eut d’ abord a com
battre le dernier Toughlak ,Mahmoud touj ours
de nom sultan de Delhi . Ce dernier mourut en 14 13sans héritiers .
Les dynasties sayy id et pathan . Khizr Khan
278 L’
I SLAM ET LES RACES
mourut en 1421 , après sept ans de guerres continuelles .
Prudemment , i l ne s’ était considéré dans l ’ Ind e que
comme le représentant de Tamerlan . I l conserva ce
rôle même quand il assuma le pouvoir suprême en 1 4 14 .
Se s successeurs,lim it és comme in flence au seul vo i sinage
de Delhi,régnèrent sans gloire . Le derni er, Ala ed—din ,
fit appel , en 145 1 , à un noble afghan ,Bahlol Lodi, lequel
remplit une fois de plus l’
offi ce de maire du palais
Son fils , Sultan Sikandar, agrandit le royaum eMusulman fanatique, il détrui sait tous les. temples
hindous qu ’ il rencon trait . Il mourut en 1 5 17 après
un règne prospère de vingt—huit ans .
L ’ empire avait été trop ébranlé par l m v asion mon
gole . L ’ autorité royale n ’ étai t plus respec t ée . D e con
t inuelle s révoltes dévastaient l ’Et at . A la fin , le gou
v erneur du Pandjab , Daoulat Khan Lodi , appela à son
aide contre le sultan de Delhi , un Mongol ,Bab our, roi
de Kaboul , lequel saisit l’ o ccasion d ’ envahir l
’
H indous
tan . En 1 526 , à Panipat, Bahour fit subir à Ib rahim
le dernier des sultans turcs de De lhi , une cruelle dé
faite qui co ûta à ce dernier le trône e t la v ie .
Les Mon gols arriv a ie nt à leur t our à la souveraineté
dans l ’ Inde . Ils la trouvaient déj à habituée au j ougmusulman . Sans dou te la maj orité de la population re s
tait hindoue , mais les com ersions à l’
Islam étaien t de
plus en plus nombreuses . En outre les conquérants turcset afghans avaient amené très peu de femmes avec eux ,s’
étaient mariés dan s le pays : la conquête des sultansturcs de D elhi avai t ainsi abouti à la création d
’
une
véritable nation musulmane dans l’
Inde . L’
Et at
musulman fut développé par l ’ organisation mongole,qui dans l
’
Inde comme en Asie antérieure et mineure
eut un rôle prépondérant.
280 L’
I S LAM ET LES RACES
Le long règne d’
Akb ar (1506- 1605) marque le début
de la longue période de splendeur qui carac t ér1 se la sou
veraineté des Grands Mogols . Le prince mit vingt an
nées à soumettre l’
H indoust an ; même à sa mort , d’ ail
leurs,la soumission n
’
était pas complète .
Akbar essaya d’
appliquer à l’
Inde l es grands prin
cipe s de tolérance qu’ avaient j adis mis en honneur les
Khans mongo ls , lesquels faisaient offi cier devant eux
de s prêtres de toutes les religi ons . Akbar tenta de réa
liser la fusion entre Musulmans et Hindous . Dans la
neuvième année de son règne, il aboli t même la D j izy a
imposée par la loi de l’
Islam aux non Musulmans , c’
est
à—dîre aux seuls Hindous qu i formaient la maj orité de
la popula t i on . Il épousa une princesse radjpou t e et fit
contracter à ses cousins de semblables mariages .
Akbar supprima les tax es appliquées aux pèlerinages
hi ndous , disant qu’
il ne fallait me ttre aucun obstacle
entre un homme et son Dieu . Cependant, tout en ac
cordant ces faveurs aux Hindou s , le sultan interdit
dans leurs coutumes tout ce qui lui paraissait devoir
offenser l’
humanité . Il interdit le mariage des enfants ,les épreuves du j ugement de Dieu , les sacrifices d
’ ani
1 aux . Il permit aux veuves de se remarier, interdit
formell ement leur holocauste sur le bûcher de l ’ époux
défunt . Le prince insista également pour que le con
sent em ent des fiancés fût requis avant le mariage ;i dée toute nouvelle dans l ’ Inde où les parents mariaient
le urs enfants sans les consulter .
Il semble que,malgré ces restrictions
,les Hindous
répondirent à l’
appel d’
Akb ar . Le souverain eut des
contingents hindous dans ses armées , et même des géné
raux radjpout es, ce qui ne s ’ était pas encore vu . Le
financier le plus renommé de l ’ époque fut un Hindou ,
L ’ INDE MUSULMANE 28 1
Radj a Todal Mal , lequel organisa le budget de l’ empire
en se basant sur les revenus du sol ; toutes les terres
furent imposées,sauf cell es accordées en récompense
de services militaires .
Ces réformes ne plurent naturellement pas aux Ma
sulm ans. L ’ écrivain Badaoui attaqua violemment le
sultan dans ses écrits . Les Orthodox es d’
l slam ne pou
v aient évidemment pas accorder leur confiance à un
souverain qui ne faisait aucune différence entre Croyants
e t Hindous . Les Sunnis reprochaient également à Akbarde ne pas suivre aveuglément l ’ enseignement coranique
et de subir des in fluences étrangères .
En effet, Akbar, très curieux de s problèmes religieuxcomme ses ancêtres m ongols,se fit expliquer leur différen
tes doctrines par desHindous,des Jains et des Musulmans .
Il écouta même les explicati ons des Jésuites , mais ne vou
lut se prononcer pour aucune religion . Les Khans mon
gols avaient j adis fait de la religion un instrument de
domination : i l semble qu’
Akb ar, souverain d’un pays
où les religions diverses se partageaient le peuple, ait
voulu régner impartialement, à la manière des Gengis
Khan , sans se préoccuper des croyances populaires au
t rem ent que pour les connaître .
C ’ est vraisemblablement pour faire admettre dans
l etat cette égali té religieuse, qu’
Akb ar, en 1579 , pro
mulgua que l’
Islam ne disait pas la vérité . Il voulaitsans doute abattre l ’ idée ancrée chez les Musulmans
que l ’ Islam seul était j uste e t donnait tous les droits
dans l ’ état aux seuls croyants . Dans le même ordre
d ’ i dées,en 1579 également, Akbar obligea les t héolo
giens musulmans à affi rmer officiellement que le sultanavait le droit de statuer sur les questions religieuses
e t que nul ne pouvait se soustraire à sa décision reli
282 L’
1 S LAM ET LES RACES
gieuse . Le Sultan devenait ainsi le maître de la foi , unis
sant en fai t le pouvoir spiri tuel et temporel . Il es t pro
bable qu’
Akb ar voulait ainsi renforcer son autorité e t
empêcher toute immix t ion étrangère dans l’ empire .
L’
Islam devenai t ainsi dans l’
Inde une religion localisée .
Comme lors de sa mort, Akbar professa ouvertement la
religion musulm ane , il semble que dans toute cette cam
pagne, il ait voulu agir suivant la raison d’
E t at .
Comme naturellement les Musulmans obéi ssaientdifficilement, le sultan ne mainti nt pas avec eux sa to
lérance primitive envers tous . Des chefs religieux furentexi lés à La Mekke ; l es prières publiques furent in
t erdi tes ainsi que le Ramâdan e t le pèlerinage . Akbar
fit même une déclaration de chy i t e panthéiste : pour
t enter d’
unir l ’ empire dans une mêm e croyance, il vou
lut créer une nouvelle religion basée sur l’unité de Dieu ,
l a Divine Foi (Din-i— l llahi ) , sorte de panthéisme
éclectique où les concep t ions brahmaniques voisinaient
avec les i dées des missionnaires portugais , et dans la
quelle le soleil représentait le créateur . Cette nouvelle
religi on n ’ eut aucun succès .
Akbar, souverai n aux idées larges et généreuses qui
dépassaient son époque, avait voulu politiquement e t
religi eusem ent fusionner l’
Inde . Il échoua car les Mu
sulm ans conquérants ne voulai ent aucune compromis
sion avec: les in fidè le s,e t . ne purent pardonner au sultan
les atte intes portées à la foi qui n ’
adm et t ait aucune
vé rité en dehors d’ elle .
Nous ne suivrons pas les souverains m ogols,qui , après
Akbar , régnèren t sur l’
H indoust an avec des alternatives
de puiSsance : et de déclin . L’
Islam et la lignée issue de
Bab our reprirent tout leur éclat de 1568 à 1707 avec
Aurangzeb .
284 L’
1 SLAM ET LES RACES
Une armée persane désola le Pandj ab et saccagea Delhi .
Dans les champs de Panipat où se j ouent d’
o rdinaire les
destinées de l ’ Inde supérieure , Persans et Afghans réu
nis forcèrent les Mahrattes au combat Mis en
pleine déroute , ces derniers retournèrent en grande hâte
dans le D ekkan ; ils avaient perdu la seule occasion
qu ’ il s eussent eu e de fonder un empire hindou . Quand ,
quelques années plus tard , ils s’
av en turèrent à retourner
dans l ’ Inde du nord , une nouvelle puissance était sur
venue‘
.
Au début de l’ année 1 600 , avec la permission du gou
v ernem ent mogol , les Anglais , à la suite des Portugais
e t des Hollandais , s’ étaient établi s sur différents po ints
de la côte indienne . Dans cet épisode de la croisade
des épices , Portugais et Hollandais se b ornèrent aux
comptoirs côtiers les Français au XVI I I ° siècle s’
ét a
b liren t dans le D ekkan , les Anglais , eux , eurent aff aire
aux Musulmans du Bengale et aux derniers Grands
Mogols de Delhi à la puissance bien déchue . Ce n ’ est
pas le lieu de décrire ici les diff érentes étapes de la lutte
entre Français et Anglais pour la suprématie aux Indes .
Il est à remarquer simplement que le s Français s’
ap
pnyè rent plutôt sur les Hindous et les Anglais sur les
Musulmans . Pourtant Dupleix,avant les Anglais
,eut
affaire au Grand Mogol duquel il reçut le titre de
Soubah souverainLa Compagnie des Indes orientales (East India Com
pany) , association de marchands londoniens , devint
une véritable organisation politique , militaire e t navale
pour développer ses comptoirs contre les indigènes hos
(1 ) Duple ix en t. sa polit iqu e ex t érieur e à l’ Inde . Il fit ain sio c cuper Moka par une garm son e t en v oy a une. m 1ssron à Sanaa
pour s’
a ssurer le comm erc e du ca fé.
L’
1ND E MUSULMAN E 285
tiles et les Européens rivaux . La supériorité maritime
britannique et le résultat des guerres d’
Europe can
sèrent la ruine de la puissance française aux Indes . Envain
,Dupleix , sa femme la Bégum Jeanne , son lieut e
nant de Bussy , furent-ils aimés des princes hindous ,créèrent—il s des armées , des revenus locaux, des conté
dérations de princes , sans secours , sans renforts et qu i
plus est , attaqués à Paris même, ils durent renoncer à
la lutte Les méthodes politiques de Dupleix seraient
intéressantes à comparer avec celles des Galliéni et des
Lyautey , car elles procèdent du même point de départ
la compréhension parfaite des b esoins physiques , poli
tiques e t moraux de l ’ indigène . Quoi qu ’ il en soit , le
désastreux traité de Paris signé par Louis XV ,
nous fit perdre le résultat de tant d’ eff orts . Plus tard ,
Napoléon I e r fit de gros efforts pour secourir l’
Inde
contre les Anglais,en passant par Maurice et la Réu
nion , mais le temps étai t passé, pour la repris e d’
un
empire français en ces régions .La Compagnie anglaise des Indes , en 1756 , fit marcher
ses contingents européens et indigènes contre le nabab
du Bengale qui avait ordonné des massacres . Le nab ab ,
vaincu à Plassey,v i t passer ses Etats sous le contrôle
de la Compagnie . En 1764 , le nabab d’
Oudh , autre vas
sal de la cour de Delhi , fut ba ttu à Buxar ; le Grand
Mogol fugitif , réclama la protection de la Compagnie,
lui accordant en retour l ’ administration du Bengale .
Dès lors , les Anglais tendirent de plus en plus à recueillir
l’
héritage des empereurs de Delhi .
Quelques années après Plassey , la Compagnie soutint
(1 ) Lire Malleson , Les F ra n ça is dans l ’ Inde a u XVI I I e s recle ;G . A . Mar t in e au ,
D uple ix e t l’
I nde fra n ça ise .
286 L’
1 SLAM ET LES RACES
de vives luttes contre les chefs pillards , contre les aven
t uriers, pour la plupart anciens offi ciers de l’
Et at mogol
qui cherchaient à créer des royaumes ou tout simple
ment â piller . Les Anglais eurent surtout à combattre
les Mahrattes . Le danger grandit quand le plus puissant
des princes du Dekkan , Scindia , chargea des offi ciers
français d’
inst r uire e t de commander ses armées ; à lafin du siècl e il possédait une armée supéri eurement or
ganisée . Dans le sud du D ekkan , le roi musulman de
Mv sore , Tippoo Sahib , formait également des troupesso lides à l ’ aide d ’ offi ciers français . Napoléon en
guerre avec l’
Anglet e rre , pensait que la possession de
l’
Orient fai sai t l a fo rc e de l’
Em pire b ritannique ; auss i
rêvait—il l ’ alliance avec le tsar de Russie pour chasserles Anglais d
’
Orien t . Napoléon s’
e ff orça d’ ouvrir la route
des Indes par t erre ; en Perse , en Afghanistan aus s i
bien qu ’ aux Indes , o n suit la trace de ses agents de se s
offi ciers dont le plus célèbre fut Lascaris .
En 1798, alors qu e la guerre faisait rage entre la
France et l ’Angle t erre , le marquis de Wellesley dev int
gouverneur général » de la Compagnie anglaise des
Indes o rientales , avec pleins pouvoirs en H indoust an .
En cinq années,Tippoo Sahib e t ses Musulmans furent
écrasés , les Mahrattes vaincus et obligés d’ abandonner
à la Compagnie un grand nombre de leurs terri toires .
Par une s éri e de traités , les princes indigènes furent
obligés de subir le contrôle britannique , de fou rnir de s
contingen ts auxiliaires et de restreindre leur pol itique
extérieure . Depuis ce temps la Compagnie est
restée le plus fort pouvoir de l’
Hindon st an
Dans cette lu tte acharnée contre les Musu lmans et
(1 ) D’
aprè s Peop les a nd Pro blem s of I ndia , par Sir T . W . Ho l
de rn e ss . London , William s and No rga t e .
288 L’
TSLAM ET LES RACES
mais leur in fluence temporelle ; les Hindous reprirent
le j ong . Cependant ces événements avaient fait du brui tpour en éviter le retour, en 1858, par un acte du Parle
ment anglais, la Compagnie dut céder ses droits dans
l’
Inde à la Couronne britannique .
L’
adm in istration anglaise aux Indes . Dans 1 1m
m euse empire des Indes , les Anglais ont employé diffé
rents systèmes suivant les peuples à administrer . La
politique les forçait à tenir compte de l ’ extrême v a
riét é de religi ons et de races qui divisaient la péninsule .
Suivant qu ’ ils avaient affaire aux Hindous , aux Musul
mans , aux Sikhs etc . , les Britanniques ont appli qué
des méthodes differentes dont l ’ origine se retrouve dans
l ’ étude de l ’histoire . Suivant la forte expression d ’unauteur contemporai n , les Anglais sont devenus les constables de l
’
Hindonst an .
Les radj as hindous , dont le loyali sme n ’ a pu être sus
pect é, ont été maintenus dans un état pratique d’
indé
pendan ce , plus ou moins grand suivant les cas . Ces
princes ont leur armée personnelle, leurs impôts par
t iculiers ; seulement un Commissaire britannique se
trouve auprès du souverai n , théoriquement à titre ho
norifiqne , en réalité dans un but de surveillance . Un
précepteur anglai s est chargé de l’
éducation du prince
héritier .
L’
Angle t erre a imposé le régime de l’
administration
directe aux Etats dans lesquels des mouvements insurre ct ionne ls pourraient être craints . Les Musulmansreprésentent dans l ’ Inde l
’ élément combatif et rév o
lut ionnaire . Avant la grande révolte de 1857, le Grand
Mogol de Delhi avait conservé titre et résidence impé
riale . Après les troubles , les Musulmans perdirent tonte
L ’ INDE MUSULMANE 289
i ndépendance dans l’
Inde supérieure . Cependant,par
u ne politique habile , les Anglais se sont servi des Mu
sulm ans pour tenir les Hindous .
En résumé , les Anglais , au contraire des Français quipratiquent une politique d ’ assimilation pratiqué
rent une politique de fédération Alors que le peu
ple français est avant tout un peuple éducateur, l’
An
glais est dominateur . Avec l’
économie pour eux de forces
et de dépenses la plus grande , ils veulent dominer un
pays pour en tirer le plus grand parti possible au point
de v ue économique . Comme les Anglais connaissent
merveilleusement leurs indigènes , le système de fédé
ration leur permet de satisfaire les aspirations des peuples soumis vers la liberté , en leur dosant leurs libertés
suivant leur'
loy alism e , les nécessités du moment , et les
ressources purement anglaises dont les maîtres pour
raient avoir besoin le cas échéant . De là,dans l ’ Inde
cette mosaïque d’
Et at s, de principautés , de territoires
régi s directement, sans compter encore les provinces
frontières du nord—ouest . Ces dernières régions , transi
tion entre l ’ Inde et les Etats indépendants voisins , ontnécessairement un régime de marche-frontière qui
permet de passer insensiblement de l’
ex térieur à l’
in
t érieur. Dans ces provinces , les chefs indigènes adm i
n ist rent directement sous le contrôle de l’ autorité mi
li t aire britannique .
Un tel système fédératif, aux nuances et aux combi
naisons poli tiques infinies , nécessite un personnel admi
nist rat if de choix . C ’ est ce que représente l ’ Indian Civil
Service . En principe , le concours d’ admission au Servi ce
e st ouvert à tous les candidats, mais les élèves des
Universités d’
Oxford et de Cambri dge j ouissent à l’ exa
men de grands avantages . Les officiers de l’
armée peu49
290 L’
1 SLAM ET LES RACES
vent être autorisés à entrer dans les Services Civ ils,
mais diffi cilement . Les postes où leur expérience mili
taire peut être mise à profit leur son t généralement
confiés . Le Service des Renseignements de l ’ Inde est merv e illeusem ent organisé . Il suffira de li re le roman célèbre
de Rudyard Kipling, Kim (l ) , pour en avoir une idée . Au
sommet de tous les organes administratifs , est le vi ce
roi des Indes lequel part d’
Anglet e rre avec un program
m e fixé par le Conseil des Ministres qui le nomme . Ce
vice—roi a pleins pouvoirs dans l’
Inde .
Le gouvernement indien a sa politique personnelle,
même en dehors de l’
Inde . En étudiant la questionarabe, nous avons vu lord Curzon , vice-roi des Indes ,créer un véritable front arabe , dès avant la guerre mon
diale . Pendant et après la guerre de 19 14- 18, 1e gouverne
ment des Indes , en Mésopotamie , en Turquie cen trale,au Lev an t , en Cilicie , a en ses agents , lesquels , comme
ceux d ’
Egypt e d’ ailleurs , ont pu faire constater parfo is
l’
ant agonism e politique exi stant entre les coloniaux
anglais et les Anglais d’
Angle t e rre . Notamment dansleurs relations avec les Français , les Anglais qui avaient
passé par le front de France se sont touj ours montrés
d ’une correction impeccable, alors que les Coloniaux
ont manqué parfois de mesure . D ’ailleurs , les dissenti
ments étaient chaque fois effacés par le s chefs, mais il
convenait de noter l ’ ex istence de ces faits .
L’
Inde musulman e con tempora in e. Malgré le régime
de surveillance auque l ils sont astreints , les Musulmans
n’
ont pas abdiqué dans l ’ Inde . L’
Islam“
comprend au
jourd’
hui dans la péninsule,soixante-six millions six
(1 ) Lire égalem en t Le Prophè te a u M an tea u Ver t . Collec t i on
Nelson .
292 L’
1SLAM LES RACES
a longtemps désiré une Um ersit é musulmane aux Indes .Le Co llège d
’
Aligahr l‘
n t m dé en réponse à cette ten
dance,il y a enviro n 35 1 11 5 . C
’
était un simple collège,
mais il a pro spè re e t il e s devenu une véritable univer
si t é . Dè s 1 9 1 1 l‘
ae th i le le la Ligne s’
étendait dans
tous les domaines e t pe r e t t ait même la création de
filiales e n Anglete rre .
Les mouvemen t s d’
i d 1 remuées p endant la guerre
de 19 14- 18 on t affec t é le Indes . D e même qu’ en 1789
et en 1848 la Révo lution rançaise avait transformé lestendances intellect uelle l e l
’
Occident , de même la
guerre de 19 14- 18 a éb r:né le s assises fondamentales du
monde,et préc ipit é le d e 10 ppemen t des idées et des
tendances . Le gouv e rn… nt anglais , fidèle à son sys
t èm e de. fédéra t ion . ne pavait ignorer ce mouvement .
Aussi dès le 9 j uillet 19 1e J ournal de Genève pouvait
p ublier l’
ar t icle suivan t
Les p ropo si t io ns pm la réforme constitutionnelledu gouvernement de l
’
l 11é constituent un événement
histo rique de p remie r u n e Le but que vise cette ré
fo rme est d’
éduqne r le cuple hindou aux formes du
gouvernemen t re spo nsa l n Le problème est év idem
ment colo ssal c t d i ffic i l1 , tant données la profonde igno
rance de la 111 aj o ri té de. population et les différences
de cas t es soc iale s et reli 5 , ainsi qu
nelle hos t ilit é Bien que
ac t uelles de l ’ l
cons t itutionnel
et prévenirl’
autonomie .
la cause
touj ours
lutte
232 L ’ 1 5 LAM ET LES RACES
longtemps désiré une Université musulmane aux Indes .
Le Collège d’
Aligahr fut fondé en réponse à cette ten
dance, il y a environ 35 ans . C
’
était un simple collège ,mais il a prospéré et il est devenu une véritable univer
sité . Dès 19 1 1 l’
activité de la Ligue s’
étendait dans
tous les domaines et permettait même la création de
filiales en Angleterre .
Les mouvements d ’ i dées remuées pendant la guerre
de 19 14-18 ont aff ecté les Indes . D e même qu’ en 1 789
et en 1848 la Révolution française avait transformé lestendances intellectuelles de l ’Occident , de même la
guerre de_
19 14— 1 8 a ébranlé les assises fondamentales du
monde,et précipité le développement des i dées e t des
tendances . Le g ouvernement anglais , fidèle à son sys
t èm e de fédération , ne pouvait ignorer ce mouvement .
Aussi dès le 9 j uillet 19 18, 1e J ournal de Gen ève pouvait
p ublier l’
article suivant
Les propositions pour la réforme constitutionnell e
du gouvernement de l’
Inde constituent un événement
historique de premier ordre . Le but que vise cette ré
forme est d ’
éduquer le p euple hindou aux formes du
gouvernemen t responsable . Le problème est év idem
ment colossal e t difficil e , étant données la profonde igno
rance de la maj orité de la population et les différences
de castes sociales et religieuses , ainsi que la tradition
nelle hostilité entre les races . Bien que le s conditions
actuelles de l’
Inde ne rendent pas urgente une réforme
constitutionnelle , l’
Angle t e rre veut prendre le s devants
et prévenir tout mouvement politique en faveur de
l’
autonomie . La fidélité avec laquelle l’
Inde a épousé
la cause anglaise pendant la guerre et la conscience
touj ours plus claire des principes fondamentaux de la
lutte mondiale actuelle ont poussé le gouvernement
294 L ’ 1 5 LAM ET LES RACES
aux Indes . En effet,le s Hindous avaient été atteints
par l ’ évolution des idées consécutive à la guerre mon
diale le s Musulmans depuis 1 9 19 ne furent pas les seuls à
réagir contre le gouvernement les Hindous eux—mêmes
se sont mis en action . Un véritable ascète , M . Gandhi ,a pris la tête d
’un mouvement considérable con tre l’
ét ran
ger il préconise la méthode dite de non coopération
Nulle marchandise de provenance anglaise ne doit être
achetée ; la désob éissance civile est le seul moyen
civilisé et effectif qui puisse remplacer la rébelli on armée
lorsque tous les autres moyens ont échoué de vant le
gouvernement En même temps les frères Ali , LaradjPatrai , conduisaient les Musulmans vers des résistances
plus effectives .
Le résultat de cette campagne unifiée des Musulmans
et des Hindous ne s ’ est pas fait attendre l’
Inde,
d ’ administration directe , à la fin de 1921 , a accueilli le
passage du prince de Galles par des grèves e t par des
manifestations (1 ) en même temps , le 30 décembre 1921
s’
es t ouvert â Ahm edab ad la session annuelle de la Ligu e
musulmane . Il est nécessaire de citer le passage suivant
de l’
E cho de l’
I slam qu i relate les travaux de la Ligue
A la Ligue musulm an e .
La session annuelle de la Ligue musulmane indienne s’
estouverte le 30 décemb re à Ahm edab ad .
Parm i les personnes présentes se trouvaient M . Ghandi e td ’autres personnalités notab les .Le président a préconisé une répub lique indienne qu i seraitdénommée Eta ts-Uni s de l ’ Inde e t qu i serait proclamée le1 er janvier 1922.T0us le s moyens possib les devraient, selon lui ,
(1 ) Au con t rair e , le s souv erains indiens, sen t an t l’
orage m on
t er au ssi c on t re eux , appu i e n t le s Angla i s de t ou t e s leurs force s
e t on t fa 1 t u n acene 1 l en thou sms t e au Pr1nc e de Ga lles .
L’
1ND E MUSULMANE 295
être employés , y compris la guerre de guérillas , dans le cas
où on proclam erai t la 10 1 marti ale .
Le président a en outre inv ité M . Ghandi à étab lir de son
côté,le l e ? j anv ier , un gouvernement parallè le , ayant son
propre Parlement et ses propres armées , b ien que ce gony ernem ent ne puisse pas être maintenu par des moyens pacifiques , attendu que le gouvernement b ritannique de l
’
Inde a
recours lui-mêm e à la v iolence et aux mitrail leuses .Le président a exprimé l
’
avis qu’ il fallait recourir à la v io
lence . Il a déclaré , pour calmer les appréhensions des H indous
, que l’
Inde appartenait égalem ent aux H indous e t auxMahom étans .Il a aj outé que l
’
év acuation de Smyrne par les Grecs et leretour de la Thrace à la Turquie ne satisferont pas les musulmans
,lesquels ne seront contents que lorsque tout leur terri
toire aura ét é soustrait aux influences qu i ne sont pas islam iques . Enfin il a déclaré que le s Musulmans soutiendraient lesHindous jusqu
’
au b out dans la lutte pour l’ indépendance de
l’
Inde .
Le congrè s national indien poursuit ses travaux . Au coursdes séances
,un memb re du congrès ayant suggéré qu
’
il seraitpeut-être utile de prov oquer une c onférence où les représen
tants de l ’ Inde seraient présents en même temps que ceux dugouv ernem ent b rit annique , M . Gandhi
,le leader nationaliste ,
s ’ est nettem ent opposé à cette proposition ; il a donné pourm otifs que l
’
attitude intransigeante du gouvernem ent e t le
fait qu e la dignité du congrès serait atteinte si l’
on s ’adressaitau gouv ernem ent en ayant l ’air de demander une conférenceau m om ent m êm e où le v ice-roi annonce que la politique derépression do it continuer , empêchent que l
’
on fasse cettedém arche . Cependant , a aj outé M. Gandhi , la porte n
’estpoint fermée aux négociations, pour peu que le gouv ernem entse montre disposé à les fav oriser . Je suis un homme de paix ,
mais non de paix à tout prix .
La comm ission spéciale du congrès a approuvé l’
attitude duleader nationaliste .
L’
assem b lée a ensuite voté une motion où on lit entre autres choses Le congrès déclare que le pays a fait de form idahles progrès en ce qui concerne le respect de so i—m êm e etl’esprit de sacrifi ce , que le m ouv em ent de non-c0 0 pérat ion a
sérieusem en t atteint le prestige gouv ernemental , que l’
Inde
év olue rapidem ent v ers un gouv ernem ent autonome, qu
’elleest déterm inée à déployer une v igueur encore plus grandejusqu
’ à ce que soit étab lie cette autonom ie et que le contrôledu gouvernem ent passe aux m ains du peuple . La désob éissancec iv ile est le seul moyen c iv ilisé et effectif qu i puisse remplacerla réb ellion armée, lorsque tous les autres moyens ont échoué
296 L’
I SLAM ET LES RACES
devant le gouvernem ent ; c’est pourquoi tous les efforts du
congrè s doiv ent être concentrés v ers la désob éissance civ ile .
M . Gandhi a prononcé en outre cette parole m enaçanteNous disons au gouv ernement Prenez garde à ce que
v ous faites e t craignez de faire de 320 m illions d’
H indous v osennemis éternels .
E cho de l’
I slam, j anv ier 1 922.
Les Anglais ont beau réprimer dans le sang l ’ insur
rection des Moplah ,comm e ils ont réprimé en 1 92 1 les
émeutes du Pandjab , la situation aux Indes reste sé
rieuse . Pour la première fois , Musulmans e t Hindous se
sont unis pour réclamer l ’ autonomie de l’
Inde sans les
Anglais . Les extrém istes ne se cachent pas de vouloir
rej eter , coûte que coûte , les Britanniques à la m er, fau
drait-il quarante ans pour le faire . Hindous et Musul
mans réclamen t leur indépendance entière,en dehors
de tout Dominion . Ils réclament le droit de pouvoir
fabriquer dans le pays les obj ets manufacturés que les
Anglais leur revendent très cher après les avoir fabri
qués en Angleterre avec les matières premières venues
de l’
Inde . Ils réclament le droit de ne plus payer les
douanes trop fortes qui imposent toutes les entrées dans
l’
Inde . Il semble enfin qu ’ il y ait dans l ’Hindoust an une
volonté unanime de s’
affranchir de la domination an
glaise . Les Hindous réclament déj à des techniciens pour
assurer le fonctionnement de leurs futures usines, car,
disent—ils , nous ne voulons plus des Anglais comme
guides Il est à craindre que l’
Allemagne ne trouve
en ces régions un nouveau moyen de combattre l ’Entente .
Au point de v ue i slamique, les Musulmans reprochentd
’
avoir fait combattre des Musulmans les uns contre
les autres en Turquie , d’ avoir séquestré le sultan khalife,
d’
avoir démembré la Turquie, dernier E ta t lib re de l’ l s
lam . Leurs dirigeants , les frères Ali , ont été emprisonnés .
296 L’
I SLA 1\ET LE S RACES
dev ant le gouvernement pourquoi tous les efforts ducongrès doivent être concet rés vers la désob éissance civile .
M . Gandhi a prononcé n outre cette parole menaçanteNous disons au gouv nement Prenez garde à ce que
vous faites et craignez de ire de 320 millions d’
H indous v os
ennemis éternels .E cho de l
’
I slam, j anv ier 1922.
Les Anglais ont b eat réprimer dans le sang l’
insur
rection des Moplah ,corm e ils o nt réprimé en 1 921 les
émeutes du Pandjab , situation aux Indes reste sérieuse . Pour la prem iè r( o is, Musulmans e t Hindous se
sont unis p our réclame rl’
au t onom ie de l’
Inde sans les
Anglais . Les extrémist e ne se cachent pas de vouloir
rej eter,coûte que coûte es Britanniques à la mer, fau
drait-il quaran t e ans par le faire . Hindous et Musul
mans réclamen t leur idépendan ce entière , en dehors
de tout Dominion . Ils éclam ent le droit de pouvoirfabriquer dans le pays ls obj ets manufacturés que les
Anglais l eur revendent rè s cher après les avoir fabri
ques en Angleterre av e cles matières premières venues
de l’
Inde . Ils réclam eni le droit de ne plus payer les
douanes trop fortes qui nposent toutes les entrées dans
l’
Inde . Il semble enfin q il y ait dans l’
Hindoust an une
volonté unanime de s’
a ranchir de la domination an
glaise . Le s Hindous réclment déj à des techniciens pourassurer le fonc t ionnemat de leurs futures usines, car,disent-ils , nous ne vo lons plus des Anglais comme
guides Il est à crain re que l ’Allemagne ne trouve
en ces régions un nouvau moyen de combattre l’
En
tente .
Au point de vue islam;ue , les Musulmans reprod
’
avoir fait combattre es Musulmans les uns
les autres en Turquie , d voir séquestré le sultan
d’
avoir démembré la Trquie , dernier E ta tIam . Leurs dirigeants
,
L ’ IND E MUS I ! NE 297
Gandhi lui—même a été con nné . Beaucoup de zèles
ont ét é'
refroidis par la répr on anglai se . Depuis que
la politique britannique e ev enue plus sévère , l a
situation s’
est améliorée au ‘ des . E lle reste sérieuse ,car la volonté anglai se s ’ im par la force ; dans les
révoltes précédentes de l’
In la force anglaise a touj ours fini par avoir le dern
'
mot,car la révolte ne
dépassait pas le s l imites de i de . A l’
heure actuelle ,
la question est plus grave ; est devenue mondiale ;
les métropoles peuvent son -r d ’avoir à éparpiller
leurs forces . Dans l’
Inde bo v ersée par la guerre de
1914—19 18,qui
,comme la F olut ion de 1789, pré
cipit é des ferments dans 1 onde,les pri ncipes Wil
soniens ont rappelé aux peu * le droit d’
avoir à dispo
ser d ’eux —mêmes ; or l’
lnd rusulmane a fourni un
terrain tout préparé aux snt s pantouraniensqui
ont su faire vibrer la corc‘
slamique . L’
Islam ,une
fois de plus,sert à une r; ambitieuse de moyen
de combat . Le combat est igé par l’
Allemagne , le
Bolchevisme,l a e la France et l
’
Angle
os terrains de la lutte ;ndra de la coopération
glet erre .
CHAPIT RE XV I I
LA PERSE . L’
AFGHANISTAN
LE BÉLOUCH ISTAN
I . LA PERSE .
La Perse est un des pays les plus anciennement con
quis par les Musulmans , qui défirent la dynastie sassa
nide régnante (642 dans une brève campagne . La
Perse avait été, dans l’ antiquité, le berceau d
’
empires i a
meux et renommés : dans l’
Islam , ce pay s joue encore un
rôle considérable . Les Alides dont nous avons v u l’
his
toire, s’
unirent par mariage à la famill e de Yesguerd le
dernier roi de Perse sassanide, chassé de ses Etats par lapremière épopée arabe i slamique . La Perse constitua
pour les Alides une sorte de fief dans lequel se dév e
loppèrent , mieux que partout ailleurs , leurs théories etpar suite , le chy ism e , surtout après la mort d
’
Ali e t
d’
Hussein , traîtreusement assassinés par les Sunnis .Le gendre et le fils adoptif du prophète Mahome t de
vinrent e n Perse les obj ets d’ un culte spécial dont Ker
bela et Nedj ef furent les lieux saints . Ces deux localités
en ruines sont situées en Mésopotamie, près de
Baghdad . Les Britanniques , profitant de la guerre de l 9 l 4
(1 ) Ou Ye sdeguerd (634 Il fu t sou t enu c on t re le s Arab es
par l’
em pereur chin ois Taï -t song Ie r . \”e 3de gu erd écho ua en co re
sur l’
Oxu s, après se s défait e s précéden t e s, par suit e de la t ra
hison de s Turcs . Il fu t a ssassin é en e ssa y an t de se réfugier prèsde Taï— t song . Le s Arab e s furen t arrê tés à l ’Ox ns e t au Cauca se
par le s Hun s e t le s Turc s .
300 L’
I SLAM ET LES RACES
autorité , mais encore établi t le chy ism e en Perse comme
religion d ’ état . Bien que les dynasties persanes n’ aien t
eu que peu de stabilité , les choses en sont restées ai nsi
j usqu’ à nos j ours .
Il serait fastidieux d enumérer la longue suite de
dynasties qui se succédèrent en Perse . Le plus grand
monarque persan fut Abbas I er (1557 qui monta
sur le trône en 1 586 , bat tit les Ouzb egs à Herat
les Turcs en de nombreuses rencontres (1 601
chassa les Portugais d’
Orm uz en 1622 avec l ’ aide de s
Anglais,et posséda un empire qu i s
’
ét endit du Tigre
à l ’H indus . Sa capitale était I spahan .
La dynastie actuellement régnante des Kaj ars fut
fondée par Agha Mohammed Khan en 1794 . Le début
du x x e siècle a été marqué par une tentative faite pour
intro duire le gouv ernement constitutionnel en c e pays .
Le bab ism e . Le fait qui domine incontestablementl ’hi stoire musulmane de la Perse , qui domine même
l ’ établi ssement du chy ism e en ce pays , et la création
du soufism e , est l’
apparition du b ab isme .
Un nommé Ali Mohammed , né à Chiraz en 18 12,
Seyy i d, c’
e st -à-dire descendan t du Prophète par Hus
sein , fils d’
Ali , avait longuement étudié les Evangiles ,discuté avec les Israélites de Chi raz , étudié les Guèbres ,naturellement poussé à fond les études corani ques e t
visité les lieux saints de l ’ Islam . Il était le continuateur
de la secte dite Cheikhsm e surtout répandue chez
les savants . Or en Perse comme dans le monde entier,la Révolution française de 1789 avait ému les esprits .Devant les ex actions de s princes et des gouverneurs ,et surtout en rai son du caractère conservateur et ré
t rograde des mollahs chy i t es, le m écont ent em ent était
LA PER SE,L’
A FGHAN I STAN,LE BÉLOUCH ISTAN 30 1
g énéral dans le peuple . Ali Mohammed apparut dans
c e monde alid e comme le nouveau mahdi chargé dec onduire les hommes à un nouveau progrès vers Dieu .
S es causeries , ses prêches , son exemple lui donnèrentu ne armée de partisans . Il fut bien tôt appelé le Bâb
la porte par laquelle on arrive à Dieu Nokt eh ,
la pointe , le créateur et la manifestation de la vérité
divine et il reçut enfin la qualification d’
Alt esse Sublime .
La doctr in e du bâbysm e . Le b âb ism e admet ,co mme l ’ Islam , l
’unité e t l ’ éternité de Dieu ; mais son
Dieu n e vit pas séparé du monde , il es t v ivan t et agis
san t ; il y a des rapports inin terrompus entre le créateur
et la créature par l ’ in termédiaire des prophètes ; à la
fin des temps , les bons , les purs se réuniront à Dieu
et vivront en lui , participant à ses perfections e t à
ses féli cités ; les méchants seront anéantis . La morale
du b âb y sme est aimable et douce ; ell e prescrit le dé
v e loppement des sentimen ts d ’ affection , de l’hospitalité ,
de la sociabilité, de la politesse et de la charité ; elle
condamne la polygamie , le divorce , l’usage du voile ;
elle répudie le célibat, resserre les liens de la famille ,relève la condition de la femme dont elle fait l
’
égale
de l’homme, se préoccupe de l
’
éducation et de l’
inst ruc
t ion des enfants , prohibe les punitions corporelles . Le
b âb y sm e n ’ est pas une sec te communiste , i l ne re com
mande point le partage égal des propriétés ; i l glorifie
les arts , l’ industrie, le commerce et n
’ est pas hostile au
luxe, mais il fai t de l’
aum ône un devoir essentiel , et
ordonne aux riches de se considérer comme les préposés
de Dieu pour le soulagemen t des pauvres Quant à la
forme du gouvernement, le Bâb ne la discu te pas , par
(1 ) Lire Cte de Gob in e au , Les Rel ig ions e t le s Philosofl zies
dans l’
As ie cen t ra le , i i i 1865 , chap . V I e t X I I .
300 L’
I SLA : ET LES RACES
autorité,mais encore ét 3 1i t l e chy i sme en Perse comme
r eligion d ’ état . Bien qu les dynasties p ersanes n ’aient
eu que peu de stabilité . ss choses en sont restées ainsi
j usqu ’ à nos j ours .
I l serait fastidieux énumérer la longue suite dedynasties qui se succé rent en Perse . Le plus grand
monarque persan fut Abas I“ (1557 qui monta
sur le trône en 1586 , b . ai t les Ouzb egs à Hérat
les Turcs en de nom euse s rencontres (1601
chassa les Portugais d'
rmuz en 1 622 avec l ’ aide des
Anglais,et posséda un mpire qui s
’
ét endit du Tigre
à l ’H indus . Sa capit ah : tait I spahan .
La dynastie ac t ue llu e nt régnante des Kaj ars fut
fondée par Agha Moha med Khan en 1 794 . Le début
du x x e siècle a été mar ré par une tentative faite pourintro duire le gou v e rnemnt constitutionnel en ce pays .
Le ba b ism e . Le fa . qui domine incontestablementl’
histoire musulmane la Perse,qui domine même
l’
établissement du chyi n e en ce pays , et la créationdu soufism e , est l
’
appz…t ion du b ab isme .
Un nommé Ali Mohmmed , né à Chiraz en 1812,
Sey y id , c’
e st —à-dire de scndan t du Prophète par Hus
sein , fils d’
Ali , avait lc guem ent étudié les Evangiles ,di scuté avec les Israélit c de Chi raz , étudié les Guèbres,
naturellement poussé afoud les études coraniquesvisité le s li eux saints de ’
Islam . Il était le
de la secte dite Cheihsm e su rtout ré
les savants . Or en Pers comme dans
la Révolution française l e 1789 avaitD evant les exactions ds p rince
et surtout en rai son (1 cara
t rograde des mollahs chi t es,
m ents les plus nobles du
a t i on même du despot isme
moins aux princip es de
gueur l’
orgueil et'
sc ucite e t les vi ces des
rfrav és des pm grès.
le faux prophète à
: .mm ed nm t æ t a auprès
mr iiscu t er à Téhéran
n neuple contre tous les
soumettre humb lement
es rois . Le gouvernement
i l li ant clergé, dont il re“t .l d
‘
interdire aux deux“
e cuire s sur les doctrines
u l « le sor ti r de sa mai son.
leurs di s cussions t héo
se s disciples , les Bâb ys,foi nouv elle ,e t allèrent
les pe rsécutions conti
La doctrine se propageait
z ouîe . En 1848 ,ce fut une
i csola la Perse . Bien que
:rmr t e t exécuté, son sup
L'
n nouveau Bâh
Les persécutions con les Bâb ist e s redoublèrent
à la suite d’
une tenta t iv assassinat manquée contre
le souverain . Les plus s pages du christianisme
martyr furen t égalées p manière dont moururent
dans les suppli ces des e rs de Bâb ist e s, hommes ,femmes et enfants .
Depuis 1852 , le b âb is’
a plus causé en Perse de
troubles sérieux . Cependa l’
at rocit é des supplices ne
l ’a pas empêché de faire nouveaux progrès . Le b â
bisme s’
est transformé e nfrérie secrè te . Parmi les
Bâb istes semblen t se cac t ous le s dissidents de l’
Is
lam ; si ce fait se v érifi beauté de la do ctrine du
Bâb , à l’
origi ne très dou très b elle , pourrait servi rde base à des re v e ndica B farouches .
Il serait intére ssant d nnaît re l’
attitude des sec
tat eurs du Bâb pendant erre de 19 14- 18,et surtout
pendant les années qui s rent .
La Perse e t l’
E urope . ) ans la pério de contempo
raine, la Perse a servi d arche entre l’
empire russe
et l’
empire des Indes . Av que l’
expansion moscovite
ait été nettement arrêtée le Japon dans les plaines
mandchoues,le gouverner t des tsars et celui de Lon
dres se sont âprement disput és politiquement les po ints
d’
appui qui pouvaient d’
u : ôté perme t t re aux Russesde descendre le plus loin ible vers le sud , de l
’
autre
côté,aux Bri t annique s , de é t endre l
’
accès des passes
menant aux Indes .Les visées politi ques de Russi e vers l ’Ori ent , et en
particuli er vers les In des lt e rm inè rent , dès l’
ab ord,à
pousser de Merv un emb chemen t du Transcaspien
Ve rs le sud, amorc e d'une ne vers Téhéran . Les An
glai s protestèrent. Les En se, à la recherche de la m er
02 L’
i SLAM ET LES RACES
prudence ; mais la doctrine tou t enti ere , qui repose
sur les aspirations et le s sen t iments le s plus nobles du
cœur humain , est la condamnation même du despotisme
ori ental .
Ali-Mohammed s’
at t aquai t moins aux prin cipes de
l’
Islam qu’
aux formes ex térieures e t à l’ in terprétati on
du culte of ficiel ; i l fl étrissait avec vigueur l’
orgue il et
la corruption des mollahs , la rapacité et les vi ces des
fonctionnaires , le relâchement de s mœurs publiques et
privées . Les prêtres du Farsist an , effrayés des progrès
rapides du b âb y sm e , dénoncèrent le faux prophète à
Téhéran .
—De son côté , Ali-Mohammed protesta auprès
du shah de la pureté de ses intentions , de la nécessité
d’
une réforme morale, offrit de venir discuter à Téhéran
en présence du souverain et du peuple contre tous les
mollahs de l ’Empire , et de se soumettre humblement
ensuite à la volonté du Roi des rois . Le gouvernementcentral , sourdement hostile au haut clergé, dont il ré
doutait l’
influence, se contenta d’ interdire aux deux
partis les conférences contradictoires sur les doctrines
nouvelles , et défendit au Bâb de sor t ir de sa mai son .
Les mollahs irrités continuèrent leurs discussions t héo
l ogiques ; le Bâb obéit, m ais ses disciples , les Babys ,devinrent alors les apôtres de la foi nouv elle ,e t al lèrent
la prêcher partout (1844)Malgré la soumission du Bâb , les persécutions conti
nuèrent contre se s partisans . La doctrine se propageait
d ’ ailleurs avec une rapidité inou1e . En 1848,ce fut une
véritable guerre religi euse qui désola la Perse . Bien que
le Bâb eût été condamné à mort et exécuté , son sup
plice ne fit qu’
augm ent e r sa gloire . Un nouveau Bâb
fut nommé,lequel s
’ établit à Baghdad
(1 ) Lanier, L’
A s ie fra n ça ise , Paris, Belin , 1” Part ie , La Perse ,
pages 544 e t 545 .
304 L’
i SLAM ET LES RACES
libre , pensaient devoir la trouver dans le Golfe Persique
et la mer d’
Oman par les por ts de Bonchir et d’
Ab b as .
La Compagnie de Navigation d’
Odessa avait même
décidé la création de musées commerciaux à Bonchir
et à Bassorah , pendant que ses navires , dès 190 1 , at t e i
gnaien t le sud de la Perse et que par le nord , le com
merce russe se répandait dans le pays . A la cour des
shahs de Perse , les agents diplomatiques de laRussieet de la Grande—Bretagne se sont disputés la suprématie
j usqu’ en 1 9 14 où un nouveau concurrent, pour la pre
mière arrivée au fond du Golfe Persique avec le Berlin
By zance-Baghdad-Bassorah , j eta le poids de son épée
dans la balance .
Pendant la guerre de 19 14-18, la Perse servit de champ
de bataille aux Russes et aux Anglais contre les Turcs .Lorsque les Soviets eurent remplacé le tsarisme , lesAnglai s se crurent d
’
ab ord les maîtres . Mais les temps
avaient changé . Les principes Wilsoniens ont permis
aux petites nationalités de revendiquer hautement leur
patrimoine ; les Soviets aidés par les Turcs ont repris
les i dées impérialistes des tsars . Les Anglai s ont dû
reculer . D’ ailleurs l
’
Angle t erre s’ intéresse surtout à la
Perse côtière , où se trouve du pétrole exploité par
l ’ Anglo—Persian C0 et o ù se trouvent ses troupes
indiennes reli ées par mer à l ’ Inde .
D ’ accord avec Moscou , sans doute aussi avec Berlin ,un Turc, D jémal pacha , qui se distingua en Syrie pendant la guerre , a été nommé commandant du front per
san et caucasien . C ’ est la lutte contre l’
Angle t erre et
contre les Alliés qui continue . Le Shah de Perse aenvoyé en 1922 des étudiants dans les écoles de France
et est venu lui—même à Pari s par Bombay . Il semble que
la Perse,menacée au nord par le Bolchevisme
,ait
LA PER SE,L’
AFGHAN I STAN,LE BÉLOU CH I STAN 305
c ependant cherché à garder son autonomie . En 1 921des traités d ’ alliance ont été conclus entre Téhéran
,
Angora et Mo scou ; mais la Perse manque d’
argent ;elle est en pleine voie de réorganisation . Elle paraît en
tout cas être nette ment influencée par les Soviets , qui ,déj à , au Congrès de Bakou , préc o nisèrent l
’ o ccupation
par les Bolchevistes de s t erri t oires du nord de la Perse .
Cette action est évi demment dirigée contre l ’Angle t erre .
I l . L’
AFGHAN I STAN .
L’
histoire de l’
Afghanist an est intimement unie à
celle de la Perse et à celle de l ’ Inde . Sa position géographique en a fait un lieu de passage continuel entre
les deux pays . Les invasions successives traversèrent
l’
Afghanist an sans que ri en de bien intéressant se soit
passé au point de vue islamique . La vill e de Ghazm ,
d’
où partirent des peuplades turques à la conquête de
l’
Hindoust an , était située dans les montagnes afghanes .
La création d ’une nation afghane n ’ eut lieu que très
tard . L ’ établissement du royaume d ’
Afghanist an est
généralement attribué à Mir Wa ’ iz , qui , en 7 19, fonda
une dynastie indigène dont les princes furent assez forts
p our envahir la Perse,mais furent absorb és par les con
quêtes de Nadir Shah . Ahmad shah , le chef du contin
gent afghan de ce sultan , affirma, après l’
assassinat de
son souverain , l’ indépendance de la contrée Un
de ses descendants Mahmoud shah fut détrôné par la
famille de son vizir , Fathi-Khan Un des fils
d e ce vizir, Dost Mohammed , s’ empara du pouvoir en
1835 et prit le titre d’
Am ir al Moum enin , Commandeur
des Croyants .
Les Afghans sont Sunni s cette différence de secte
avec les Persans a fortement gêné les relations entre20
306 L’
I SLAM ET LES RACES
les d eux peuples , surtout depuis que le chy ism e est
d evenu la religion officielle de la Perse .
Les visées politiques des Russes vers l’
Inde am e
n èrent la Grande—Bretagne à défendre l’
accès des passes
d e Kandahar, porte de l’
Hindoust an . Dès 1838, une
première expéditio n anglai se était di rigée c ontre l’Af
ghanist an . Le but en ét ait de détrôner Dost Mohammed
qui aurait engagé des pourparlers avec les Russes et dele remplacer par un descendant anglophile d
’
Ahm ad
Shah . Par le traité de Gandam ak (26 mai le sou
verain promit d ’ agir touj ours diplomati quement en
liaison av ec la Grande—Bretagne . D e son cô t é,la Grande
Bretagne garantissait l ’ immunité du territoire afghan
contre toute agression étrangère .
Jusqu ’ à la guerre de 19 14—18, l’
Afghanist an est prati
quement resté sous l’
in fluence anglaise ; cependant il
est à remarquer qu e le brigandage n’ a j amais cessé
dans les montagnes , ni aux frontières de l’
Inde . Le
gouvernemen t indien a dû maintenir dans c es régions
des forces de police iinport ant es ,trè s souvent employées .Pendant la guerre , les Afghans enrégimentés dans l
’
ar
m ée britannique ont fait merveille mais après la guerre ,sous la pression des Soviets russes , sous l
’ action éner
giquem ent poussée des Enver, des Dj emal et d’ offi ciers
ottomans continuateurs de la lutte allemande contre
l’
Anglais, les forces indiennes ont dû reculer .
L’
Afghanist an fut ainsi une cause de soucis pendant
toute la guerre . Il fut maintenu dans l ’ alliance anglaise,
ou à peu près , par l’ in fluence personnelle du précédent
Emir, qu i fut assassiné aprè s la défaite allemande , trop
tard heureusement .
Depuis , la princesse régente d’
A fghanist an semble en
1920 avoir voulu reprendre les proj ets ambiti eux de
308 L’
i SLAM ET LES RACES
I I I . LE BÉLOUCH ISTAN .
De même que celle de l’
Afghanist an , l’
histoire d u
Bélouchist an e s t intimement unie aux destinées de
l’
Inde e t de la Perse Le pays fut la proie des conque
rants successifs . Au x v re siècle , la région fut annex ée
par Akbar à l’
empire mogol . En 1 738, Nadir Shahconquit le Bélouchist an
,mais laissa sur le trône le
prince indigène, se contentant de le réduire à la vassa
lité . A la mort du chef , Abdallah Khan se rendit inde
pendant . Eu 1838,l’
expédition d’
Afghanist an mit les
Anglais en contact avec les Bélou chi s . Un traité signé
fut violé par les indigènes : une colonne anglaise en
profita pour occuper Kelat en 1839 . Par le traité d ’ oc
tobre 1841 , le Khan fut déclaré vassal de l’
Am ir d’
Af
ghanist an e t dut suivre les directives données par un
résident b ritannique . En 1854,fut signé un accord , rati
fié en 1876,par lequel le Bélouchi st an acceptai t le con
t rô le britannique sur ses relations diplomatiques avec
l’
étranger (d’ après Margoliouth) .
Pendant la guerre de 19 14—18, les Bélouchis ont fourni
des troupes so lides aux Britanniques . Depuis la guerre,i ls semblent avoir, comme les Afghans , causé de grossesdiffi cultés au gouvernement de s Indes .
Les Bélouchis sont Sunnis . Une bonne partie d’
entre
eux appartiennent aux sectes les plus fanatiques . Au
nombre d’
un demi-million , les B élouchis n e sont guère
civilisés encore et représentent plutôt une population
de sauvages guerriers .
(1 ) L’
his t oire m usulm ane de la Pe rse , de l’
Afghan is tan e t du
Bélou chis t an a ét é résum ée dan s les m ou v em en t s rég ionaux issus
de l’
e xpan sion t urc o —m ongole , c ar si le s prem i ère s in fl uen ce s
islam iqu e s e n ce s régi on s fure n t arab e s , il apper t que leur dév e
loppem en t m oderne e s t plu t ô t t u rco-m ongol .
QUATR IÈME PARTIE
CONCLUSIONS GÉNÉRALES . IMPRESSIONSSUR L
’
ISLAM ET SES TENDANCES ACTUELLES
Nous qu i v ou lons t ou joursgarder ra i son
(Max im e de s Rois de Fran c een poli t i qu e ét rangère . )
L’
Islam apparaît, dès le début de son histoire , comme
une réaction politique des Arabes contre les Perses,les
Byzantins,les Abyssins . Le Prophète Mahomet fit de
l’
Islam une religion qui a sa valeur , mais il semble que
cette empreinte politique première ait à j amais marqué
les destinées de l ’ Islam . Dès la mort du Prophète,nous
avons v u comment les discussions et les rivalités politi ques ont fait de la foi une arme au servi ce des indi
vidus,des clans
,des familles et des races . L ’
Islam s ’est
diversifié suivant les races qui l ’ont embrassé .
Les premiers et extraordinaires succès du prosély
t isme musulman s’expliquent non seulement par l
’état
d’
aff aib lissement des peuples voisins,mais encore par
la supéri o rité relative et la simplicité dogmatique de
ce système , dans sa facilité morale , qui con siste bien
plus le mot d’ordre étant admis dans un ri t ua
lism e tout extérieur que dans l a poursuite intérieure e t
constante du règne de Dieu et enfin dans l ’ardeur
guerri ère des premiers Musulmans attirés vers la guerre
L’
i SLAM ET LES RACES
sainte par l’attrai t du nouveau et l
’
appât du b u t…. Les
schi smes religieux qui ont diversifié l’
Islam su ivant les
races,représentent une réaction des familles contre le
pouvoir central . afin d e s’
emparer du trône,au besoin en
modifiant le monothéisme primitif de l’
Islam,suivan t
les conceptions traditionnelles lo cales . Les discussions
relatives à la transmission de l’
Imamat serv irent ainsi
bien de s amb iti ons personnelles .
L’
Islam recrute actuellement la plupart de se s adeptes
chez le s païens d’
Afrique , gagne sur les religi ons de
l’
Inde,de la Chine et du Japon , mais n
’
atteint pas le
Christianisme . En échange,bien que dans l
’
Aurè s,en
Kabylie,sur le Chéliff il existe quelques villages d
’
arab es
chrétiens,l ’on peu t dire que le Christianisme est ino
pérant contre l’
Islam . S i,phi losophiquement
,on poussait
au fond des choses,il semblerait qu
’
au train dont m ar
chent les événements actuels,le Christianisme et l ’ Isla
m isme devraient à un m oment donné se partager le
monde . Et toutes le s agitations politiques de l ’heureprésente ne sont- elles pas pour un peu ,
toutes choses
é tant égales d ’ailleurs,la résultante du choc de c es deux
grands courants d ’ idées,tous deux actifs
,et agissant
directement ou indirectement sur l’
immensité des peu
ples . Cependant,l’
Islam manque de cohésion , souff re de
l ’absence d ’une direc tion unique ; les schismes p olitico
religieux ont détruit le prestige de l ’ Im amat .
En tant que religion,l’
Islam apporta avec lui une
civilisation qui f souv ent , fut très belle , mais cette civi
lisation né fut pas unique dans ses manifestations elleprocéda touj ours des peuples antérieurs à elle
,et se
développa dans les diff érents pays d ’
lslam suivant les
formules locales . Marquée par l’
hellénisme,cette civi
lisation,d
’
arabe devint bientôt persane,égyptienne
,b e r
312 L’
I SLAM ET LES RACES
re commence à agir,cherche avec ses penseurs
,les textes
et les commentaires qu i peuvent servir de base , non
pas à une évolution religi euse,mai s à l
’
action en rapport
avec les nécessités de l’heure présente . N
’
est—ce pas là,
d ’ailleurs,un semblant
,un commencement d
’
évolution
L’
Islam,comme le monde entier
,subit une crise
trop longtemps,l ’âme islamique a servi de prétexte à
des ambitions politiques . Actuellement,le monde se
transforme politiquement et économiquement ; les Mu
sulm ans ne peuvent échapper au mouvement . Les ten
dances religieuses de l ’ Islam ne pourront être clai rement
soudées que l orsque ses peuples auront retrouvé leur
quiétude ; cependant , si l’on veut bien songer qu ’au
X IV e siècle,paraissai t inébranlable le Christianisme
,lui
qui ne subissai t pas alors le contact d’
une civilisation
agi ssante comme l ’ Islam subit maintenant celui del a civilisation moderne
,si l ’on veut bien songer que
le Christianisme subit alors simplement le retour d’
in
fluence de la vieille civi lisation gréco—latine,un instant
étouffée,il pourra être admis que l
’
Islam ne restera pas
immuable et se transformera,comme tout ce qui existe
sur la terre . L’
Islam,si l ’on date suivant son è re
,est
actuellement en 134 1,en retard sur nous de six ou sept
siècles c ’est sur cette base qu e l’observateur doit rai
sonner e t j uger .
La France a touj ours é té une puiss ance curieuse
d ’expansion politique aussi bien que sci entifique . Ellea touj ours eu dans le monde ori ental ou extrême-orien
tal,des savants
,des consuls
,des officiers
,des agents
,qui
CONCLUS IONS GÉNÉRALES 313
ont su voir et comprendre,1 ame en apparence immobile
,
immuab le,en réalité tenace dans ses buts lointain s et
ses méthodes touj ours les mêmes,de tous ces peuples
,
blancs,j aunes ou noirs qui ont embrassé l ’ Islam . Sans
parler des agents e t des émissaires qu’
eurent les Roisde France
,il est b on de rappeler que Napoléon I e r
s’
intéressa de tous temps au monde musulman,à la
route des Indes dont la possession devai t lui permettre
d’
ab at t re l’
Anglet erre . En 1807,le capitaine Bure] est
auprès du Sultan marocai n ; en Orient , Lascaris réussitdès 18 12 à ouvrir par terre la route des Inde s
,m ais
mourut en 1813 en plein succès (1 ) le capitaine Boutin,
après avoir reconnu en 1808 l a Régence d ’
Al ger , celle
de Tunis,la côte de Tripoli
,finit par être assassin é en
Asie Mineure après avo ir parcouru la Syri e et le Liban .
Mais il semble que la conquête de l ’Algérie ait rétréci
notre champ de vision depuis lors,les Français pa
rai ssen t ne plus connaître que le Musulman turc ou
nord—afri cain ; le dernier sursaut de notre action sur le
monde musulman lointain fut vraisemblablement l ’aban
don de notre droit de pavillon sur les b outres de Mascate
et d ’
Om an Il est certai n que nous ne pouvons dis
perser nos eff orts e t devons concen trer nos ressources
(1 ) Se s papiers renv oy és en Fran c e furen t capt u rés par une
fréga t e anglaise e t n’
on t j am ais reparu . Lascaris eu t à lut t erc on t re Lady S t anhope , sœur de Pit t , qui , in st allée au Lib an ,
s’
é ta it créé u n e si t ua t ion priv ilégi ée dan s le pay s . Lascaris
réussit à réc on c ilier le s Anazeh e t le s Wahab it e s e t à leu r faireconclure un t rai t é fav orab le à Napoléon
(2) Au m om e n t où le s Anglais ét aien t t rès em b arrassés par
la gu erre de s Afridis, le c on sul de Fran c e à Masca t e ét an t
M. Laron ce , le s b arqu e s de Masc a t e e t d’
Om an firen t un e grossec on treb ande de gu erre e t n e po uv aien t ê t re arrêt ée s pu isqu
’
e lle s
b a t t aien t pav illon fran çais . En échan ge de la re con naissan c e
de n os dro i t s sur Madagascar par lÎAngle t erre , la Fran ce ab an
donna c e dro it de pav illon .
3 14 L’
I S LAM ET LES RACES
sur notre empire colonial,mai s il est nécessaire de ne pas
pe rdre de v ue le reste de l ’ Islam qui compose en fai t
la plus grande partie du monde islamique,et dont cha
cune de s manifestations a chez nous ses contrecoups
apparents ou cachés .
La guerre de 19 14— 18 a démontré que l a France était
l a digue continuatrice de Rome en politique coloni ale .
L’
experrence vien t de démontrer que les popula t ions
asiatiques ou afri cai nes françai ses ont ét é plus loya
l istes envers leur métropole que c ell es des coloni es an
glaise s . Rome adoptait toutes les crov ance s de ses administ rés
,et latinisait l ’au t ocht one en même temps qu
’elle
le colonisait par l’admiration que la Ville suscitait
chez lu i . Nos méthodes,dérivées de celles de Rome
,
développées par les Dupleix ,les Montcalm
,les Gallieni
,
les Lyautey,appliquées par tous ces Fran çais obscurs
que les Français ignorent e t dont le s indig ènes gardent
le souveni r,se son t démontrées b on nes
,malgré des
erreurs inévitables et des expériences trop souvent ré
nouv elées qui auraient pu être évitées par la leçon du
passé . Il n ’est pas besoin aux Françai s d’
env ie r à tel
autre pays sa méthode coloniale ; la nôtre a fourni ses
preuves . É tudions l ’étranger pour tirer parti de ce qu’
il
fait,mais ne prenons pas modèle sur lui pour l ’ étude et
la m aî trise de s populations d’
Afrique ou d’
Asie,ne
prenons conseil que de notre cœur Nous intéresser,
aimer,voilà les mei lleures manières d ’ intéresser et d ’être
aimé . L’
ind‘
igène aime qu i Et nous,s i nous
con naisso ns son histoire,si nous respect ons ses mœurs
,
si nous l’
éd‘
uquons , nous nous l’
at t acherons . La France
d oit être avant tout éducatrice et no n dominatrice.
3 1 6 L’
I SLAM ET LES RACES
n ’ont pas épargné l’
Islam . La guerre a tout remué °
hommes et pensées . Le calme reviendra forcément un
j our,mais les êtres et les choses ne seront plus ce qu
’ils
étaient auparavant ; en cinq ans , plusieurs siècles on t
passé . De 19 19 à 1922,profitant de toutes les fautes
,
l’
Islam s ’est ressai si dans ses particularismes locaux
issus de l a sou che arabe et de la greffe turco—mongole .
D ’acco rd avec la tradition de sa race depuis Tamerlan ,
le Turco-Mongol le Touranien cherche à grouper
autour de sa dictature militaire , à peine dissimulée par
le prétexte fall acieux d’une apparente lutte religieuse
,
toutes les aspirations de liberté,d
’
idéologism e,des par
t icularism es musulmans . Loin de nous la pensée d ’
incri
miner le peuple turc lequel , comme ses victimes , est
souvent la victime de se s meneurs toutefois il ne faut
pas cacher que le meneur turco-mongo l , allié des gensde Moscou et de Berlin
,tend à r allie r vers lui toutes les
oppositions au monde chrétien,représenté en l ’occurrence
par la France et par l’
Angle t erre . S i cette tendancetouranienne était acceptée par l
’ensemble du monde
musulman,elle devrait le soulever à nouveau dans une
vague immens e du Croissant contre la Croix . En AsieMineure
,le s luttes religieuses ont conservé une acuité
que ne connaît guère plus l ’Afrique du No rd , plus reli
gieuse sans doute , mais mo ins fanatique . En Afriquedu Nord
,les oppositions de races
,bases des querelles
religi euses,sont mo ins violentes qu ’en Asie où se heur
tent la race j aune,la race blanche
,e t tous leurs métis
sages ; en Afrique du Nord également , l’
instruction pri
maire franco—arabe,l ’activité agri cole et commerciale
ont déterminé une sécurité que ne connaît pas encore
l’
Asie turque,ignorante
,dans laquelle chaque race
conserve sa place de caste e t son rôle social par ticulier .
CONCLUS IONS GENERALES 31 7
Les intérê ts économiques communs lient les peuples ;le fait se vérifie entre Françai s et Arabo-Berbères il ne
se réalise pas encore en Orient entre Musulmans et
Chrétiens,parce que les premiers sont restés des no
mades dans l ’état e t parce que les derniers sont divi sés .
Ce déséquilibre économique et social du monde musul
man cause l a crise e t empêche son union .
De même que les Arabes , la plupart des peuples isla
miques veulent maintenir leur vitalité en dehors de
l ’influence t urque après avoir été un grand unifica
t eur d ’énergies au temps de l a conquête,l’
Islam se
prouve un grand dissociat eur parce que la foi col
le c t iv e des premiers âges créatri ce de fanatisme,s ’est
transformée chez chaque peuple en une série d’
égoïsm es
nationaux . Ces égoïsmes nationaux peuvent se rencon
trer quelque j our dans un intérêt commun , s’allier alors
toutefois l ’alliance durera seulement tant que l’ intérêt
commun subsistera . Il en est de l’
Islam comme du
Christianisme comme ce dernier,l’
Islam doi t peu à peu
céder le pas aux nationalités,puis au pouvo ir laïque ;
il se débat à l’heure actuelle dans cette dernière trans
formation . Eu l a plupart des cas,l’
Islam a dû subir le
pouvoir l arque des Européens parce qu’ il se montrait
incapable de l e t ab lir lui —mêm e ; le s dirigeants musul
mans réagissent à l’heure act uelle
, pour, sans toucher au
Coran,laïciser l ’E t at ; certains ont échoué , d
’autres
ont progressé en affi rmant cependant l ’int angib ili t é de
la loi-dogme ; quoi qu’ il en soit
,l a tendance semb le
s’
amplifier . Ces crises où se débat l ’ Islam,la diversité
des climats et des habitats,empêchent
,malgré la religion
commune,la formation d
’un intérêt commun musulman .
L ’uni on ne peut se fai re que pour un certain temps
contre un ennemi déterminé ;mai s faute de base reli
3 1 6 L’
I SLAM ET LES RACES
n ’ont pas épargné l ’ Islam . La guerre a tout remué °
hommes et pensées . Le calme reviendra forcément un
j our,mais les êtres et les choses ne seront plus ce qu ’ ils
étaient auparavant ; en cinq ans , plusieurs siècles on t
passé . De 19 19 à 1922,profitant de toutes les fautes
,
l’
Islam s ’est ressai si dans ses particularismes lo caux
issus de l a souche arabe e t de l a greffe turco-mongole .
D ’acco rd avec la tradition de sa race depuis Tamerlan ,
le Turco—Mongol le Touranien cherche à grouper
autour de s a dictature militai re , à peine dissimulée par
le prétexte fall acieux d ’une apparente lutte religieuse,
toutes les aspirations de lib erté,d
’
idéologism e,des par
t icularism es musulmans . Loin de nous la pensée d ’
incri
miner le peuple turc lequel , comme ses vi ctimes , est
souvent la victime de ses meneurs toutefois il ne faut
pas cacher que le meneur turco-mongo l , allié des gens
de Moscou et de Berlin,tend à rallie r vers lui toutes les
oppositions au monde chrét i en,représenté en l ’occurrence
par la France et par l’
Angle t erre . S i cette tendancetouranienne était acceptée par l
’ensemble du monde
musulman,elle devrait le soulever à nouveau dans une
vague immense du Croissant contre la Croix . En AsieMi neure
,les luttes religieuses ont conservé une acuité
que ne connaît guère plus l ’Afrique du Nord , plus reli
gieuse sans doute , m ai s moins fanatique . En Afrique
du Nord,les oppositions de races bases des querelles
religi euses , sont moins violentes qu en Asie où se heur
tent la race j aune,l a race blanche
,e t tous leurs métis
sages ; en Afrique du Nord également , l’
instruction pri
maire franco-arabe,l ’activité agricole et commerciale
ont déterminé une sécurité que ne connaît pas encore
l’
Asie turque,ignorante
,dans laquelle chaque race
conserve sa place de caste e t son rôle social particulier .
3 18 L’
I SLAM ET LES RACES
gieuse sol ide , l’alli ance n
’est pas durable des peuples
aussi di vers que ceux de l’
Islam,par leurs origines
,
leurs sectes,leurs schismes
,aussi oppo sés par leur genre
de vie,ne peuvent avoir l ongtemps d ’intérêts communs .
Pour que l’union soit durable
,il serait nécessaire qu
’un
peuple musulman s’
imposât aux autres la Perse,
l’
A fghanist an l’ont tenté l a Turquie de Kemal cherche
à s ’impo ser,en donnant comme pré texte la lutte à
mener contre le Français et l’
Anglais , destructeurs du
Khalifat .
Livrés à eux -mêmes,les Turcs ne parviendraient sans
doute pas à prendre la tête du monde isl amique ainsiunifié
,car le Turc a montré son incapacité à gouverne r
partout où il est passé ; les particularismes nationaux
reprendraient comme autrefois b ien vite leur exi stence
propre . Mais le Kém alist e reçoit l ’ inspiration bo lche
viste et l’
inspiration allemande . I l existe un mouvementislam ique comparab le toutes choses étant égales
d ’ai lleurs à celui du monde catholique à la chute des
Etats de l ’Egli se ; celui— là n’est pas dangereux ; mais
il s ’est formé un mouvement panislamique politique
ant ifrançai s et ant ianglai s , lequel cherche à se faire
confondre avec le premier ;le dernier e st très dangereux ,car il forme bloc avec le pangermanisme et le bol
che v ism e . Ces deux courants n ’ont de commun que les
apparences il ne faut pas le s confondre . Il est à remar
quer d ’ailleurs que les peuples islamiques ralliés au
courant anti—ent e nt ist e sont pour ai nsi dire tous des
islamisés issus de l ’expansion musulmane turco-mon
gole le fait se passe de commentaires . Au lieu de pren
dre Moustafa Kemal pour le chef de l ’ Islam,i l aurai t
été plus conforme à la tradition politique musulmane
françai se de développer l ’i dée du maréchal Lyautey
CONCLUS ION S GÉNÉRALES 319
le khalifat de l ’Afrique du No rd au Maro c ; de suivre
l ’ idée franco—britannique de 19 16,le khalifat arabe de
La Mekke ; e t pour l’
e nsemble du monde islami que ,de reconnaître que le Sultan khalife est touj ours à
Co nstantinople où i l attend qu’on ut ilise son prest ige
touj ours très grand sur les masses .
La plus grande partie des peuples musulmans ralhes
à l’ idée d ’un mouvement panislamique anti—e nt ent ist e
sont des islam isés datant de l ’expansion turco—mongole
Pendant des siècles,Byzance fut le musoir où vinrent
se heurter,se diviser
,s e briser
,les flots montants de la
marée asiatique , à l’
autre bo ut de l a Méditerranée,les
Francs,le s Berbères
,formèrent la digue où vi nrent
s’
user les flots arab es e t Gcs la De i per F
Ainsi,pendant le Moyen Age , la Chrétienté fut sauvée
la Croix et le Croissant eurent dès lors leur dom aine
respectif . Dans la période contemporaine,la Croix
pren ant à son tour l ’o ffensive,a délivré du j oug asi ati que
turc un certai n nombre de peuples chrétiens , a repri s
pie d dans l ’Asie elle—même . Depu is 19 19,les Asiatiques
se sont ressaisis à l’appel de Moscou
, qui , durant toute
son histoire,a hésité entre l ’Europe et l
’
Asie . Le mou
vement turco-mongol reprend vers l ’Ouest ; il peut
(1 ) Je dis exprès la Cro ix pour sy n thét ise r t ou t un e ns em b le
d’
idée s . En réali t é, l’
Eu rope , le Ba ghdadb ahn , c’
e s t la civ ilisa t ion , la rou t e des Inde s, le c omm e rce . Je n e v oudra is pa s
u t iliser l ’ idée chré t ie nn e comm e le pan islam ism e u t ilise l ’ Islamj e dis exprès la Cro ix , car aux y eux de s Musu lm an s, n ous somm e s
t ou j our s le chrét ien , quo i qu e n ou s fassion s . E t le Chrét ien po ureux représen t e sinon l ’ e nn em i, t ou t au m o in s l
’
ê tre in férie ur e t
dan gereux qu i risque de fa ire pe rdre par sa civ ilisa t ion sa qua
li té de b on Croyan t au Musulm an .
320 L’
i S LAM ET LES RACES
réussi r avec les cadres allemands qui font de ce mouve
ment,un mouvement nettement germanique ; il est , en
tout cas,inquiétant . Le nouvel éveil asiatique serait
réellement dangereux si un peuple j eune,moderne
,en
prenait la direction or il est certain que le Japon s’est
intéressé et s ’ intéresse au monde musulman,dont tant
de j aunes font partie .
La France,au cours des âges
,a cherché des alb es à
l’
Orient de ses ennemis parmi c es alliés furent ainsi
les Suédois,les Turcs et les Russes . A mesure que les
communications deviennent plus faciles et plus rapides,
les alliances peuvent être cherchées plus loin . Le Japon
nous a touj ours donné des marques indéniables de sym
pathie . Pourquoi ne pas chercher dans ce peuple guerrier
le contrepoids qui nous est nécessaire à l’ orient de nos
ennemis,et ne serait—cc pas le meilleur moyen d
’ en di
guer un mouvement islamique j aune,touj ours p os
sibl e,b ien plus dangereux
,sans doute , qu e s on avant
garde, l e mouvement pant ouran ien ? Les Musulmans
croien t à leur salut,lequel viendra , disent— ils , d
’
Ex
t rêm e—Orient . Précédons-les dans cette voie . Bien que
l ’ entente franco-anglaise soit une nécessité pour la paix
générale , notamment p our la sécurité du Levant, l’
al
liance j aponaise serait une garantie contre la mainmise
anglo-saxonne sur le monde . Le Japon n’
a rien à
craindre de nous ;nos intérêts sont communs sur b eau
coup de points ; il nous appartient de savoir fai re esti
m er par lui notre force et no tre valeur .
Nous qui voulons touj ours garder raison disaient
les Rois de France,dans une de leurs maximes fav orites
en affaires é t rangères Garder raison . c’est ne pas
TABLE DES MATIERES
TOME I I
LE S RM IEAUX
(MOUVEMENTS RÉGIONAUX ET SECTES )
INTROD U CTION
L IVRE SECOND . PREMIÈRE PART IE
Les Schismes et les Sectes .
CHAP ITRE Ier_ Kharedj isme et Chyisme 5
I . Les div ergen ces arab e s, 5 . I I . Le Kharedp sm e , 6 . I I I.Le s Alide s, 1 1 . IV . Le Chy ism e , 12.
Ca n n e s 1 1 . Le Mysti cisme dans l ’Islam . Soufi sme et
Confréries religi euses 21
I . Le Soufi sm e , 21 . I I . Le s Con frérie s religieuses, 28. I I I .Influ enc e de s c on frérie s religieu ses, 55 . IV . Le Wahab ism e ,
58 .
CHAPITRE I I I . Les transformations mystiques de l’
Islam 63
CHAPITRE IV . Le Fanatisme musulman 73
La gu erre sain t e pendan t la guerre m ondiale , 73 .
LIVRE SECOND . DEUX IÈME PART IE
LesMouvements régionaux issus de l’
expansion arab e .
CHAP ITR E V . La questi on arabe
324 TABLE DES MAT IÈRES
CHAPITRE V I . L’
Egypte et la Tripolitaine
I . L’
Egy pt e , 94 . I I . La Tripolit ain e , 1 00 .
CHAPITRE V I I . L’
Afrique duNord et l’
Islam 105
In t rodu c t ion . L’
Afriqu e , 105 . La n a t ion b erb ère av an t
l’
Islam , 106 . La c on quêt e m u su lm an e v ers l’
Ou est , 1 1 5 .
Lu t t e s pour l’
indépen danc e b erb ère , 1 19 . Le s grande s dyn as t ie s b erb ères, 127 . Les con séqu en c e s de l
’
in v asion m u
sulm an e sur l’
e thn ographi e en Afriqu e du Nord, 1 43. L’
oc
cupa t ion t urqu e en Algérie , 1 50. Con quê t e fran çaise , 1 53 .
CHAPITRE V I I I . L’
Islam chez les noirs 157
In t rodu c t ion , 1 57. A . L’
Afr iqu e n oire fran çaise , 1 60. B .
Le c en t re du Con t inen t n oir, 167. C. L’
ancienn e Afri queorien t al e allem ande , 171 .
CHAPITRE IX . L’
Islam en Abyssinie
CHAPITRE X . Les Sultanats de l’ocean Indien
CHAPITRE X I . Le Sultanat de Zanzibar et Madagascar 1 96
I . Zanzib ar, 196 . I l . Madagascar, 205 .
CHAPITR E X I I . Lutt es commerciales de la Croix et du
Croissant 209
La Cro isade de s Epic es, 209 . Veni se . Le m on opole de s
épice s, 210. Véni t iens e t Port ugai s . La lu t t e pour lem on opole du c omm erc e de s épices, 218. La Croisade de sépice s c on t emporaine , 223.
L IVRE SECOND . TROIS IEME PART IE
Lesmouvements régionaux issus de l’
expansion turco-mongole .
CHAPITR E X I I I . L’
Islam en Extrême-Orient
I . L’
Islam en Chin e , 229 . I I . L’
Islam en ludo -Chin e , 235 .
L’
Islam a u Japon , 236 .
CHAPITRE X IV .— L
’
Islam en Russie et au Caucase
324 TABLE r s MAT IÈRE S
CHAPITRE V I . L’
Egypte et Tripolitaine
I . L’
Egypt e , 94 . I I . La '
] ipoli t ain e , 100.
CHAPITRE V I I . L’
Afrique 0 Nord et l’
Islam 105
In t rodu c t ion . L’
Afriqu e , 05 . La na t ion b erb ère av an t
l’
Islam , 106 . La conque m usu lm an e v ers l’
Ou est , 1 1 5 .
Lu t t e s pour l’
indépendanc b erb ère , 1 19 . Le s grandes dyn ast ie s b e rb ère s, 1 27. I s con séqu en c e s de l
’ inv asion mu
sulm an e sur l’
e thnographie .n Afrique du Nord, 1 43. L’
oc
cupa t ion t urque en Algéri 1 50. Conquêt e fran ç aise , 1 53.
CHAPITRE V I I I . L’
Islam en les noirs 1 57
In t roduc t ion , 1 57. A . L’ fr iqu e n oir e fran çaise , 1 60. B .
Le c en t re du Con t inent n r, 1 67. C. L’
ancienne Afriqu eorien t ale allem ande , 1 71 .
CHAPITR E IX. L’
Islam en .byssinie
CHAPITRE X . Les Sultana de l’
ocean Indien
CHAP ITRE X I . Le Sultanade Zanzibar et Madagascar 196
I . Zanzib ar, 196 . I l . Madgascar, 205 .
CHAP ITR E X I I . Luttes cmmerciales de la Croix e t duCroissant 209
La Cro isade de s Epic e s, 20 Veni se . Le m on opole desépice s , 210 . Véni t iens t Por t ugais . La lu t t e pour lem onopole du comm erc e ds épice s, 218. La Cro isade desépice s c on t emporain e , 223
L IVRE SECOND . TROIS IEME PART IE
Lesmouvements régionaux sus de l’
expansio
CHAPITR E X I I I . L’
Islam Extrême-0
I . L’
Islam en Chin e , 229 .— I I . L’
Islam
L’
Islam a u Japon , 236 .
CHAPITRE X IV . L’
Islam « Russie
TABLE MAT IERES 325
CHAPITRE XV . L’
Islam l’
Insufinde 25 5
I . L’
Islam isat ion , 258 . s Européens en Insulinde , 259 .
I I I . Les Musulm ans Isul inde , 260.
CHAPITRE XV I . L’
Inde !mane
CHAPITRE XV I I . La P L’
M ghanistan . Le Bélou
chistan
I . La Perse , 298. I l . L gan is t an , 305 . I I I . Le Bê nchist an , 308.
L IVRE SECOND . QUATR IÈME PARTIE
Conclu sion s générale s . e ssions sur l’
Islam e t ne:
t endance s ac t u elles