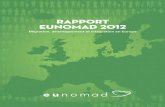Ligues, nationalisme et péronisme en Argentine
-
Upload
conicet-ar -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Ligues, nationalisme et péronisme en Argentine
1
Ligues, nationalisme et péronisme en Argentine
[in Olivier Dard-Nathalie Sévilla (textes réunis par), Le phénomène ligueur en Europe et en
Amérique, Metz, CRULH, 2011]
Humberto Cucchetti1
Introduction
Si l´on s´en réfère au phénomène ligueur à proprement parler, en Argentine sa présence
se circonscrirait à la première moitié du XXe siècle. C´est alors que s´est produite, en
effet, la prolifération de réseaux associatifs qui ont choisi cette expression pour désigner
certaines de leurs activités publiques. Outre la dénomination adoptée par les
protagonistes des faits, la dynamique de ces groupes reflétait certains traits, récemment
mis en lumière par diverses publications, essentiels à la compréhension du phénomène
des ligues tel qu´il s´est développé en France. Il s´agit, par exemple, de la particularité de
leurs rapports avec les partis politiques, ou encore de leur capacité à s´ériger en groupe
de pression, voire de mobilisation2. Dans certains cas, les ligues argentines n´étaient que
le rejeton organisé d´institutions ou de référents culturels de plus ample envergure (les
ligues catholiques, par exemple). Dans d´autres cas, elles résultaient de tentatives
d´association idéologiques et politiques plus étendues, relativement autonomes bien que
traversées de différents liens sociaux et institutionnels.
Les associations publiques et même politiques ligueuses n´ont pas, en tant que telles,
connu de circulation politique au sein de l´Argentine de la seconde moitié du XXème
siècle. L´intervention des Forces Armées – acteur central en Argentine – à travers les
coups d´État qui se sont succédé depuis 1930, a peut-être représenté un obstacle à la
prolifération de certaines représentations ligueuses nationalistes de défense de la patrie.
Cependant, si l´on se situe dans le contexte qui suit l´année 1955 – année au cours de
laquelle le gouvernement du général Juan Perón est renversé, marquant le début de
longues années de proscription et de répression du mouvement péroniste – des groupes
relativement autonomes et à forte vocation activiste commencent à se développer dans les
amples brèches que laissait la proscription de l´activité partidaire, surtout liée au parti
majoritaire, le péronisme.
1 CEIL PIETTE- CONICET
2 Voir Olivier Dard et Nathalie Sevilla, Le phénomène ligueur sous la IIIe République, Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire, 2009. L´analyse reprend la contribution de Serge Berstein, « La Ligue », dans Jean-François Sirinelli, Histoire des droites en France, Tome 2 Cultures, Paris, Gallimard, 2006 (1992) également mise à contribution dans ce travail.
2
L´analyse proposée, centrée dans les rapports entre modalités ligueuses et militantisme
péroniste entre 1955- 1976, requiert de procéder dans un premier temps à une
reconstruction partielle de cas particuliers et historiquement antérieurs qui, en
Argentine, témoignent avec acuité d´une relation explicite avec la problématique des
ligues. Nous présenterons ainsi brièvement un cas typique dans l’histoire des ligues en
Argentine, celui de la Ligue Patriotique argentine. Cet objet particulier nous permet de
saisir des torsions du nationalisme argentin de la première moitié du XXème siècle,
certaines difficultés propres aux organisations nationalistes existantes ainsi que des
itinéraires, caractéristiques « des nationalistes », qui nous aident à saisir les faiblesses
politiques propres à ces espaces de même que le caractère éphémère de certains objectifs
« restaurateurs »3. Dans un deuxième temps, nous nous centrerons, en particulier, sur la
possibilité de problématiser les implications générales du phénomène ligueur à partir de
certaines expériences organisationnelles et de représentations militantes qui naissent au
sein du mouvement péroniste au cours de sa proscription, entre 1955 et 1973. Partant de
la réalité empirique locale, nous chercherons à contribuer aux discussions et débats sur
les ligues, leur portée ainsi que leurs limites en tant qu´option politique stable et
dominante sur le terrain de la construction du pouvoir, à partir de l´analyse de diverses
trames organisationnelles abordées à partir de récits biographiques.
Nous serons peu à peu amenés à admettre que, au-delà de l´originalité de chaque cas
particulier, il nous faut poursuivre la réflexion dans deux directions. La première
concerne les transferts d´acteurs, d´organisations et de représentations qui contribuent au
développement d´un esprit militant que l´on retrouve dans certaines expériences
organisationnelles de type ligueur. La seconde va dans le sens du point de vue comparé
qu´autorise le fait d´analyser des « proto-ligues » ou « ligues factuelles » dans des horizons
nationaux autres que ceux où ils ont vu le jour en tant que tels, mais qui partagent, en
toile de fond, une scène éminemment moderne. La nécessité d´avancer dans cette
direction est reprise dans la conclusion de notre article.
Ligues et nationalisme
Une lecture sur la longue durée de la trajectoire historique d´organisations, de groupes et
d´espaces politiques se situant en dehors des partis politiques, permet de mieux
comprendre un éventail d´évènements de la société argentine susceptibles d´être
analysés à la lumière du phénomène des ligues. Les ligues ont commencé à se développer
3 Expression employée par l´historien Cristian Buchrucker lorsqu´il définit deux grandes “familles” dans le nationalisme argentin: d´un côté, le nationalisme populaire, de l´autre, le nationalisme restaurateur. Christian Buchrucker, Nacionalismo y peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial (1927- 1955), Buenos Aires, Sudamericana, 1987.
3
et à acquérir une présence publique au cours des premières décennies du XXème siècle.
Certaines d´entre elles, issues du travail social alors en plein développement dans le
catholicisme argentin4, cherchaient à consolider le champ associatif, fut-il d´ouvriers ou
de femmes, autour de certains idéaux : la Ligue démocrate chrétienne (1902), la Ligue
Sociale Argentine (1908), ou encore la Ligue des Dames Catholiques (1931). Pour notre
part, nous nous arrêterons sur un cas particulièrement parlant de par son importance
historique et les caractéristiques de sa présence activiste, la Ligue Patriotique Argentine
(LPA).
La LPA surgit au début de l´année 1919 suite à un ensemble de conflits sociaux qui
débouchèrent sur la « semaine tragique ». Cette année-là, sous le premier gouvernement
de Hipólito Yrigoyen – leader politique charismatique, personnaliste, et figure de
l´Union Civique Radicale – une protestation ouvrière pour de meilleures conditions de
vie, née au sein des ateliers métallurgiques de la ville de Buenos Aires, déboucha sur une
cruelle répression contre travailleurs et immigrés5. Cet épisode ne fit qu´illustrer, aux
yeux de certains secteurs de l´élite conservatrice, l´existence d´une menace bolchévique,
exigeant d´organiser de manière extra-légale la répression des organisations ouvrières6.
L´analyse de cette ligue fait apparaître certaines caractéristiques intéressantes. Ses slogans
et ses consignes politiques – « la défense de la patrie et la conservation de l´ordre social »,
en font une ligue nationaliste aux traits spécifiques. Les participants à sa réunion
inaugurale proviennent de l´élite politique, sociale et intellectuelle de l´ordre conservateur7,
et incluent aussi bien des dirigeants du radicalisme d´Yrigoyen que ses opposants. Côté
organisation, apparaissent des groupes locaux d´action de rue, connues sous le nom de
brigades. Les chercheurs spécialistes de ces questions ont souligné l´importance aussi bien
des femmes dans l´organisation, par l´intermédiaire du développement des œuvres de
charité, que du rôle éducatif que la Ligue s´est proposé de mener à bien. De même, le
développement national et le protagonisme dont elle a jouit, en particulier entre 1919 et
1922 lorsqu´elle participait activement de l´affaiblissement des organisations ouvrières
4 Voir à ce sujet Fortunato Mallimaci, El catolicismo integral en la Argentina (1930- 1946), Buenos Aires, Ed. Biblos, 1988; Loris Zanatta, Perón y el mito de la nación católica, Buenos Aires, Sudamericana, 1999; Lila Caimari, Perón y la Iglesia Católica, Buenos Aires, Ariel, 1995; Floreal Forni, “Catolicismo y peronismo I y II”, UNIDOS, nº 14 y 17, 1987; Humberto Cucchetti, “Réflexions sur le phénomène péroniste”, en Natacha Borgeaud-Garciandía, Bruno Lautier y otros, Penser le politique en Amérique Latine, París, Karthala, 2009.
5 Voir Julio Godio, La Semana Trágica de enero de 1919, Buenos Aires, Hyspamérica, 1985.
6 Cf. à ce sujet Sandra McGee Deutsch, Contrarrevolución en la Argentina, 1900- 1932. La Liga Patriótica Argentina, Bernal, Universidad de Quilmes, 2003 (1986); Fernando Devoto, Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina contemporánea. Una historia, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2006 (2002).
7 Devoto, op.cit., p. 144
4
contestataires, lui ont conféré une importance politique nullement négligeable. Avec,
cependant, une particularité.
Pour Sandra Mc Gee Deutsch, la LPA « a acquis la forme d´un parti conservateur
national »8 même si – en dehors de moments exceptionnels – elle n´a pas cherché à se
transformer en parti politique. En ce sens, la LPA pouvait envisager de représenter un
élément d´unité nationale puis, érigée en groupe de pression, encourager la préservation
de l´ordre politique et économique. Son leader historique, Manuel Carlés, avocat de
profession, était un notable sans base politique transférable, plus proche du libéralisme
que de la démocratie9. En 1928, lorsque Yrigoyen est nouvellement élu à la présidence,
Carlés tenta de transformer son groupe en groupe activiste, afin de renverser le président
et de prendre le pouvoir politique. Deux ans plus tard, face un plus grand nombre de
concurrents nationalistes et suite au coup d´Etat de septembre 1930 dirigé par le Général
José Uriburu10, la LPA amorce une phase de déclin progressif.
Nombre d´analyses ont cherché à établir si la LPA constituait une manifestation locale du
fascisme. Mis à part les ouvrages plus généraux sur ce thème qui associent spécifiquement
le phénomène fasciste à l´émergence d´un climat belliqueux ayant conduit à la Seconde
Guerre Mondiale11, empêchant toute filiation antérieure avec le fascisme, dans certains
ouvrages apparaît l´idée de protofascisme12 ainsi que la possibilité d´analyser la LPA en
continuité directe avec le fascisme13. Ce type d´analyse se rapprochait du problème,
abordé de manière quasi obsessive ou fruit d´un comparatisme rapide, des racines
vernaculaires d´un mouvement ou d´un régime fasciste ou des possibilités de son
implantation en Argentine. Si l´on regarde les classifications qui ont été proposées, on
peut suivre un certain nombre de discussions ayant approfondi la réflexion sur les
implications de cette organisation. Certains auteurs, tel Mc Gee, ont repoussé le terme
de nationalisme pour caractériser la LPA, préférant mettre en avant son caractère
contrerévolutionnaire. Pour Fernando Devoto, au contraire, « il s´agit certainement 8 McGee, op.cit., pp. 105- 106.
9 Devoto, op.cit., p. 146.
10 Voir à ce sujet Marianne González-Aleman, « Autour de septembre 1930 en Argentine : quel sens pour la « Révolution » ? », Colloques du MASCIPO : La notion de révolution en Amérique Latine, 19e- 20e siècles, Paris, février 2010 ; « Le 6 septembre 1930 en Argentine : un Coup d’Etat investi de révolutions », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2007, [En ligne], Mise en ligne le 18 mai 2007. URL: http://nuevomundo.revues.org/5385.
11 Voir Cristian Buchrucker, El fascismo en el siglo XX. Una historia comparada, Buenos Aires, Emecé, 2008. Buchrucker interroge certaines interprétations comme celles de Sternhell, centrées sur la consécration d´une méthode révolutionnaire et le passage de la gauche vers la droite dans certains milieux intellectuels français, qui auraient incarné une manifestation précoce du phénomène fasciste.
12 María Inés Barbero, Fernando Devoto, Los nacionalistas, Buenos Aires, CEAL, 1983.
13 McGee, op.cit. p. 236. McGee construit cette approche suivant les arguments développés par Ernst Nolte.
5
d´une organisation nationaliste, surtout apparentée aux formes précédentes de
patriotisme et de nationalisme. Il s´agissait également, c´est certain, d´une organisation
para-policière et de briseurs de grèves » 14. Cependant il existe une différence sensible
avec les groupes fascistes « puisqu´elle ne s´est pas construite comme un groupe politique
aspirant à prendre le pouvoir »15. Ce à quoi, on peut ajouter que « la question
historiquement importante est de savoir pourquoi une organisation comme la Ligue a
évolué non pas vers la participation politique mais dans le sens d´un instrument
transversal, qui opérait soit sur la société, soit comme auxiliaire répressif ou assistentiel
de l´État, sans toutefois chercher à s´en emparer16 ».
Si l´explication réside dans l´idée que le risque révolutionnaire répondait davantage à la
représentation que s´en faisaient de vastes secteurs sociaux qu´à un risque réel et
imminent correspondant à l´accumulation de forces par les secteurs ouvriers radicalisés
en Argentine, la vie interne de la LPA se situe alors en dehors des manifestations
ligueuses européennes. La LPA partageait encore avec d´autres forces un horizon libéral
et parlementaire propre à résoudre les problèmes politiques17.
A cause de ses caractéristiques nationalistes, la LPA s´est vue obligée de partager l´espace
avec d´autres références intellectuelles, religieuses, politiques du nationalisme argentin.
De ce dernier, diverses manifestations firent leur apparition, témoignant dans bien des cas
de leurs racines hispaniques, de l´influence chez certains intellectuels des discours de
l´Action française18, ou encore de la nette offensive de l´Église Catholique.
Un élément d’explication important doit être pris en compte si l´on veut mieux
comprendre le déclin de la LPA et des ligues en général en Argentine. Outre les tissus
14 Devoto, op.cit., p. 152.
15 Idem.
16 Ibid., p. 154.
17 Voir également, Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina I, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986 (1978). Pour une analyse locale du phénomène, voir Virginia Mellado, “La Liga Patriótica Argentina. Una aproximación a las redes asociativas de los elencos políticos y culturales de Mendoza (1919-1930)”, Entrepasados, 2007.
18 On peut citer, par exemple, le journal La Nueva República, qui regroupait une jeune génération d´intellectuels, maurassiens pour nombre d´entre eux, comme les frères Rodolfo et Julio Irazusta, Juan Carulla, Ernesto Palacio. Devoto définit ce projet comme un “maurrassisme bien tempéré” mettant ainsi l´accent sur la distance qui sépare le groupe intellectuel de La Nueva República de l´Action française. Malgré la virulence discursive maurassienne que tentaient d´imiter les nationalistes argentins, ils ne pouvaient être définis comme un groupe contrerévolutionnaire antisystème. Influencé par le nationalisme intégral, le journal n´a d´ailleurs pas disposé d´un bras ligueur censé commettre ses objectifs déstabilisateurs. Une situation politique plus détendue en Argentine et le poids important du catholicisme intégriste dans ce milieu intellectuel auraient tempéré toute possible radicalisation autour de ce maurrassisme vernaculaire – Cf. Devoto, op.cit., p. 219-231. L´historien Enrique Zuleta Alvarez, disciple des frères Irazusta et tributaire de l´oeuvre de charles Maurras, offre une analyse intéressante dans ses ouvrages: El nacionalismo argentino, Tomo I y II, Buenos Aires, La Toma de la Bastilla, 1975 et Introducción a Maurras, Buenos Aires, Editorial Nuevo Orden, 1965.
6
associatifs de pression et de sociabilité de masses (ligues, sections de l´Action
Catholique), outre l´ambiance intellectuelle de l´époque (publications, œuvres et
influence d´auteurs nationalistes), une explication politique s´ajoute, croit-on, aux
explications sociales ou intellectuelles possibles – si ce n´est qu´elles convergèrent de
manière autonome ou conjointe vers la résolution des conflits qui marquaient l´Argentine
de cette époque : les Forces Armées se transformèrent, grâce aux coups d´État, en acteur
direct du pouvoir.
Militantisme et péronisme : une réédition de modalités ligueuses ?
Suivant l´interprétation de Mc Gee, un certain nombre de similitudes rapprocherait la
LPA de l´ expérience péroniste : la lutte contre le marxisme, la défense d´une rhétorique
proche du catholicisme social ou encore la capacité du péronisme « d´insuffler de la
vitalité et de l´égalitarisme à ce qui fut, originellement, une idéologie antirévolutionnaire
de classe aisée, la transformant en appel aux masses »19. Ce qui, selon l´auteur, était
« essentiellement conservateur » semblait « révolutionnaire » du simple fait d´être porté à
la pratique (par le mouvement péroniste). La filiation établie est à ce point rapide qu´elle
permet de soulever des arguments contraires : la composition sociale, majoritairement
ploutocratique de la LPA contrairement aux caractéristiques populaires du péronisme
n´est pas un élément mineur, et la définition que donne l´auteure du péronisme comme
étant un mouvement conservateur ou contrerévolutionnaire mérite pour le moins d´être
nuancée. Il faudrait également ajouter que les caractéristiques anticapitalistes et
industrialistes du péronisme, de même que son attachement à des formes démocratiques à
fortes tendances antilibérales, constituent une différence radicale entre ce mouvement et
l´expérience préalable de la LPA, qui ne fut jamais gouvernementale malgré ses liens
étroits avec les cercles de pouvoir.
Dans les pages qui suivent, nous ne chercherons pas à tracer des passerelles entre la LPA
et le péronisme, mais plutôt à analyser des modalités d´action, développées au sein du
péronisme, qui peuvent être étudiées à la lumière du phénomène ligueur. Nous nous
intéressons à un moment particulier de l´histoire de ce mouvement politique qui, né du
coup d´État de 1955, ouvre une période de dix-huit années au cours desquelles
s´imposèrent diverses formes de proscription – interdisant notamment à son leader Juan
Perón de demeurer dans le pays et au péronisme de présenter son propre candidat aux
élections présidentielles.
19 McGee, op.cit., p. 244.
7
Divers auteurs, penchant pour des explications de type systémique, insistent sur la
manière dont la l´ère de proscriptions initiée en 1955, et qui faisait suite au caractère
autoritaire du gouvernement péroniste des années précédentes (1946-1955), aurait
entraîné une dynamique politique à somme nulle et l´adoption de moyens radicaux
comprenant, aussi bien pour la société que pour le pouvoir militaire, la violence comme
une ressource légitime du jeu20. Pour ces auteurs, le péronisme acquit ainsi les
caractéristiques d´un mouvement à même de fédérer des adhésions éparses, difficilement
contrôlables et spontanément organisées. Le Parti péroniste ne parvenait pas à discipliner
leurs noyaux activistes. Quant aux syndicats, ils n´arrivaient pas davantage à
« internaliser » 21 une certaine action collective ouvrière et populaire tributaire de
l´autorité de Perón et des conflits opposant ce dernier aux leaders syndicaux et
partidaires. Le militantisme péroniste, qui tentait de se réorganiser depuis les années
1960, embrassa peu à peu un mysticisme héroïque éloigné des formes institutionnelles,
sacralisant leur propre loyauté envers le leader exilé22.
Prenons à titre d´exemple un cas concret, connu dans la littérature (surtout
journalistique) sous le nom de Guardia de Hierro (la « Garde de Fer », en partielle
référence au mouvement nationaliste roumain du même nom). La Guardia de Hierro naît
au début des années 1960 en partie suite à la « crise de la résistance péroniste». Celle-ci fait
référence au développement spontané et inorganisé d´actes de sabotage montés par des
adhérents péronistes contre le gouvernement militaire du Général Pedro Aramburu
(1956-1958) et celui, à l´époque où le péronisme était encore proscrit, d’Arturo Frondizi
(1958-1962), personnage issu du Parti radical intransigeant. Dans cette « résistance
péroniste » convergeaient les groupes d´activistes péronistes, les réseaux syndicaux
combatifs, d´anciens dirigeants fidèles à Perón. Les explosifs faits maison, la participation
à des protestations à l´encontre du gouvernement militaire ou à des actions syndicales
critiques à l´égard de la proscription du péronisme sont quelques-unes des actions
auxquelles ils se livrèrent. Ajoutons que l´impossibilité de développer une organisation
20 Voir à ce sujet, Samuel Amaral, “Perón en el exilio: la legitimidad perdida”, en Samuel Amaral y Mariano Plotkin (comp.), Perón del exilio al poder, Buenos Aires, Cántaro, 1993; Claudia Hilb, “La legitimación irrealizable del sistema político y la aparición de la izquierda en los años sesenta”, in Claudia Hilb- Daniel Lutzky, La Nueva Izquierda argentina 1960- 1980. Política y violencia, Buenos Aires, Centro editor de América Latina, 1984; Marcelo Cavarozzi, Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del Estado al mercado en la Argentina. Buenos Aires: Eudeba, 2002 (1983).
21 Cf. Sidney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza 1997 (1994).
22 Voir à ce sujet Daniel James, Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina (1946- 1976), Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
8
politique unifiée s´est traduite par la cristallisation d´aspérités au sein du mouvement
justicialiste23.
Un groupe de jeunes issus de la « résistance péroniste » prit la décision de constituer, fin
1961 début 1962, une organisation autonome baptisée, pour des raisons encore difficiles
à établir, Guardia de Hierro. Elle regroupait de jeunes péronistes, dans certains cas au
passé communiste encore récent, liés aux syndicats durs et à la figure du dirigeant syndical
de la métallurgie Héctor Tristán, lui-même d´origine anarchiste. La chronologie de
Guardia de Hierro témoigne d´un développement rapide dans la capitale autour de
certains réseaux politiques et syndicaux péronistes. Tout au long des années 1960, et dans
un contexte marqué par la Révolution cubaine, les discussions s´orientèrent vers l´idée de
lutte armée, méthode politique prônée par le fondateur de l´organisation, Alejandro
Álvarez, non pas du point de vue guévariste des « focus ruraux » mais du concept maoïste
de « guerre prolongée » - ce qui devait, en Argentine, se poser en milieu urbain. À partir
des années 1964-1965, une fois dépassé « un état généralisé de décadence au sein de la
jeunesse péroniste de la décennie » - pour reprendre les termes d´un acteur de
l´organisation que nous avons interviewé – Guardia de Hierro commence à élargir sa base
sociale de recrutement. La pénétration a d´abord eu lieu dans certains milieux catholiques
et universitaires. L´objectif consistait alors à élargir les possibilités de constituer un bras
armé, enraciné dans la résistance populaire contre les gouvernements en place, et à
obtenir « le retour de Perón au pouvoir ». Pour cela, en 1967, un petit comité de
Gardiens rencontre Perón à Madrid, où il est exilé, afin d´obtenir les contacts nécessaires
pour organiser l´entraînement militaire et mettre en place la fameuse lutte armée. Perón,
si l´on en croit les témoignages de l´époque, aurait exhorté les jeunes à ne pas suivre la
voie de la guérilla mais à travailler plutôt au sein des milieux populaires à l´obtention
d´un climat favorable de soutien au péronisme. Cette rencontre avec Perón permit aux
leaders de Guardia de Hierro d´infléchir l´option subversive. Le travail politique s´est
alors orienté vers l´arrivée et la formation de nouveaux militants en provenance des
milieux catholiques et universitaires et le développement d´une implantation partisane
territoriale.
De son côté, le Front Estudiantin National (FEN) s´est développé au point d´atteindre
une portée nationale. Le FEN naît dans un climat de protestations étudiantes dans
diverses universités du pays. Alors que les sentiments juvéniles anti-impérialistes sont n
plein essor, cette organisation, dont les membres provenaient d´univers sociaux
23 Le Justicialisme, tel que l´on tenta de définir le mouvement dirigé par Perón partant de la centralité idéologique de l´idée de justice sociale, peut être compris comme un synonyme de péronisme.
9
étrangers, voire hostiles au péronisme, entame un processus de nationalisation. La
nationalisation et la péronisation des étudiants témoignait d´un cliché idéologique selon
lequel les jeunes, parce qu´ils provenaient de la classe moyenne, avaient hérité de leurs
parents et de leur milieu social une forte « sensibilité antinationale ». Suivant ce discours,
la classe moyenne devait s´impliquer dans les problèmes du pays et reconnaître la
particularité de ce qui était national. C´est ainsi que se construisait la représentation des
« secteurs de la classe moyenne, antagonistes au peuple » et le « devoir éthique » des
jeunes qui s´attachaient à reconnaître les intérêts nationaux… et populaires. Ce qui les
amenait à une acceptation progressive du péronisme lequel, dans le cas du FEN, se
rapprochait d´une péronisation intensive.
Des jeunes d´origines politiques diverses, issus d´organisations ou à titre individuel, ont
participé de la constitution du FEN. Il s´agissait pour nombre d´entre eux de catholiques
sensibilisés par les réformes conciliaires catholiques. D´autres étaient d´ex-militants
d´organisations de gauche, des libéraux réformistes, etc. voyons, par exemple, la
trajectoire de Roberto Grabois, grand promoteur de cet espace d´étudiants universitaires.
Issu d´une famille d´origine juive, Grabois vivait dans la capitale, dans le quartier de
Constitución. Son père tenait une petite entreprise – une laverie mécanique. La famille
de sa mère comptait quelques dirigeants du Parti socialiste (PS). Côté militantisme,
Grabois témoigna d´une politisation précoce puisqu´il fit ses débuts politiques dans le
socialisme entre 1957 et 1958 alors qu´il n´avait que 14 ans. Il manifeste alors « cette
même précocité en termes intellectuels », sautant des années d´études au Collège
National Bernardino Rivadavia. Puis il poursuit ses activités politiques en tissant des liens
avec les réseaux militants du Parti socialiste et assiste, alors qu´il était encore très jeune,
au processus de scission de ce parti. Cette sociabilité initiale lui permit de rencontrer les
principaux dirigeants socialistes de ces années-là. Sa place était parmi les étudiants du
secondaire socialistes, puis il se rapprocha postérieurement de la revue du PS La
Vanguardia. Selon lui, un évènement ayant marqué sa trajectoire politique fut un voyage
qu´il réalisa en Union Soviétique. Ce fut en 1961, à 19 ans, lorsqu´il représenta la
Jeunesse Socialiste au Forum Mondial de la Jeunesse. Cette expérience fut à l´origine de
sa première crise (« (ce voyage eut) un très grand impact sur moi »). La bureaucratie
communiste heurtait son socialisme libéral, sa conception de l´étique, et il se sentait
indigné par le style de vie embourgeoisé des bureaucrates soviétiques et la perte de
libertés sous le régime communiste. A son retour, en pleine scission du socialisme, il
reste lié au Parti Socialiste argentin qui, de par son inclinaison procubaine, servit de pont
pour qui voulait entrer en contact avec les courants combatifs du péronisme et les
trajectoires de la résistance péroniste. Entre 1962 et 1963, il abandonne ses études de droit
10
et entreprend des études de sociologie, à l´Université Nationale de Buenos Aires. Des
raisons familiales font qu´il maintient alors une « relation périphérique » - pour reprendre
ses propres mots – avec des foyers de guérilla. En 1965, il organise un acte de solidarité
avec la guérilla dans un climat, selon lui, de « de “guérillerisme”, guévarisme, révolution
cubaine, sentiment antimilitaire ». Sa proximité avec les réseaux foquistes guévaristes fut
à l´origine d´une nouveau coup dur. Pour les dirigeants foquistes « seules importaient les
armes, et les pertes humaines étaient simplement des numéros ». Cela l´a amené à
reconnaître et à rejeter « le mécanisme de la lutte armée ». À 22 ans il avait, selon lui,
accumulé toute cette expérience ; une impression de confrontation avec le Che Guevara
qu´il ne pouvait rendre explicite dans le climat guévariste du monde étudiant
universitaire. C´est la raison pour laquelle il dit avoir cherché une « pensée nationale », la
guérilla s´apparentant à quelque-chose de « trompeur et de froid ». Il a ainsi participé à la
création de réseaux d´étudiants qui mettaient en contact et établissaient des échanges
entre maoïstes, trotskistes, péronistes combatifs, catholiques. Il a également tissé des
liens aussi bien avec la Confédération Générale du Travail des Argentins (CGT des
Argentins) qu´avec l´ouvriérisme « anti-impérialiste, anticapitaliste et antidictatorial »
opposé au « participationnisme » de la CGT24. La trajectoire de Grabois nous montre
également la dimension sacrificielle que revêt le compromis politique ainsi qu´une étique
ouvrière-militante de la participation et de l´honnêteté qui faisaient partie du bagage
idéologique. Le Front Estudiantin National est né dans ce contexte, en pleine
prolifération de groupes universitaires que se sont uni et désuni à la recherche d´une
identité politique. La politique universitaire du Général Juan Carlos Onganía, président
de fait entre 1966 et 197025, a largement contribué à son développement26.
Vers la fin de l´année 1971, et suite aux contacts maintenus entre les leaders de Guardia
de Hierro et du FEN, ils créèrent une nouvelle organisation, l´Organisation Unique de
Renouvellement Générationnel (OUTG27). Celle-ci avait pour mission de former de
nouvelles générations « authentiquement loyales au mouvement péroniste », favorisant le
24 En 1968, face au climat de radicalisation politique, les syndicats les plus puissants du pays, avec à leur tête la corporation des métallurgistes, perdirent le contrôle de la centrale ouvrière. En conséquence les syndicats se divisèrent entre, d´un côté, la CGTA – liée aux secteurs combatifs du péronisme – et, de l´autre, la CGT, plus disposée à dialoguer avec les Forces armées.
25 Le 29 juillet 1966 se produisit la “nuit des bâtons longs” (la noche de los bastones largos), au cours de laquelle des étudiants et des enseignants qui avaient occupé l´Université de Buenos Aires pour protester contre le gouvernement de facto furent délogés par la Police fédérale argentine.
26 Entretiens avec Roberto Grabois, 5 juillet et 1 août 2005.
27 Organización Única del Trasvasamiento Generacionl; “trasvasamiento » aurait pu être traduit par “transfert” mais le terme
choisi, “renouvellement”, respecte davantage l´objectif de l´organisation de former et renouveler les futurs cadres politiques du péronisme.
11
militantisme territorial au service du péronisme et remettant en cause toute option
prétendant défier l´autorité de Perón – ce qui explique que les Montoneros, crées en
1970, soient devenus l´ « ennemi principal » des réseaux péronistes ici étudiés, comme
en témoignent les textes militants. L´OUTG fut dissoute en juillet 1974 avec le décès de
Perón, ses membres se dispersèrent dans les réseaux politiques locaux au sein desquels ils
conservèrent les liens qu´ils avaient préalablement tissés.
Sur le plan des récits biographiques, des parcours individuels et des représentations des
acteurs, on peut retracer certaines dynamiques organisationnelles. Malgré les rapports
entretenus avec un parti politique sui generis comme le péronisme, et un contexte de
proscription politique, de gouvernements militaires et de coups d´Etat, les organisations
créées ne deviennent jamais pleinement des partis politiques à proprement parler.
Guardia de Hierro développait une rhétorique par laquelle elle se disait totalement au
service du péronisme. Il s´agissait cependant d´un principe d´adhésion non
institutionnelle – dans bien des cas, l´organisation n´hésitait pas à répudier les partis
politiques, voire même les dirigeants justicialistes qui ne respectaient pas les ordres de
Perón. Son activisme consistait à s´attribuer le rôle de représentante des intérêts
populaires et de médiatrice entre « Perón et le peuple ». Ainsi, au milieu des années
1970, alors que se développaient les positions qui, au sein du péronisme, cherchaient à
s´écarter de l´autorité de Perón exilé, s´imposa la nécessité de radicaliser un certain
nationalisme révolutionnaire :
Parce que seul le Peuple Travailleur de l´Argentine, SUR LE PIED DE GUERRE
ET SOUS UNE DIRECTION LOCALE NATIONALE-SOCIALISTE
REVOLUTIONNAIRE, peut mettre un terme à ce cercle vicieux et atteindre la
plénitude de l´Argentinité [...] Pour cela, GUARDIA DE HIERRO appelle tous
les Argentins – qui, au-delà du confusionnisme « idéologique », veulent être libres
et portent une vocation de destin et d´hommes – à s´organiser en commandos de
3, 5 ou plus de patriotes pour se préparer et attendre ou coordonner des actions
futures, se transformant en unités de GUARDIA DE HIERRO et en diffuseurs de
l´IDEE NATIONALE-SOCIALE-REVOLUTIONNAIRE.
Ce militantisme radical rejetait toute possibilité de solution « démocratico-bourgeoise »
aux « problèmes politiques argentins ». Une telle hostilité au libéralisme – qui, bien que
Guardia de Hierro précisait qu´il ne s´agissait nullement d´un rejet en soi de la forme
parti28, se traduisait dans les faits par une opposition aux espaces institutionnels – se
28 “GH Guardia de Hierro, La Argentina será grande o no será”, nº 5, enero de 1966.
12
trouvait étroitement liée à un cadre anticapitaliste qu´il fallait défendre par des moyens
violents :
Le problème politique argentin ne se résout ni par des « manœuvres », ni par des
urnes et les papiers imprimés que l´on y met, ni avec des parlements qui sont
invariablement au service de qui les adopte et les a créés : le Système Libéral
Capitaliste. Posé sur de solides bases, le problème politique argentin n´a qu´une
sortie dans la mesure où nous serons capables de répondre à la guerre par la
guerre, à la violence économique, politique et militaire du Système par le pouvoir
suprême de l´organisation du Peuple et la violence des armes29.
Même si, avec le temps et l´insistance de Perón, Guardia de Hierro s´est éloignée de la
lutte armée (des années plus tard et une fois adoptée par Montoneros, elle susciterait
chez les Gardiens une profonde aversion), cette organisation avait contribué à la
cristallisation du climat insurrectionnel de l´époque. Que le projet de lutte armée ait
disparu ne modifia en rien le rôle que s´était attribué l´organisation : celui de représenter
la garantie territoriale et formative du mouvement péroniste. Cet objectif s´est traduit
par un intense travail de formation de cadres politiques, travail mené conjointement avec
le FEN dès leur association au sein de l´OUTG. Comme dans nombre d´expériences
militantes, la formation de cadres a supposé la lecture de textes politiques qui offraient,
du point de vue des protagonistes, une forte rationalité à l´activité militante :
J´entre (au FEN) comme membre de l´unité en première année de faculté. D´une
certaine manière, avec une grande discipline et une grande formation. Le thème
de l´autoformation était très fort. Il y avait une grande vocation de lecture. Ce fut
un parapluie nous protégeant de l´émotionnel. On consacrait beaucoup de temps à
la lecture, à la discussion. Tous les jours. C´était bizarre. Je ne sais pas pourquoi
c´était comme ça. Nous étions alors des militants très bien formés et nous avions
de l´amplitude : nous lisions tout, de Primo de Rivera à Karl Marx. De tout, tout
ce que tu veux. Beaucoup de lecture nationale […] C´est là qu´on s´éduquait30.
Dans ce sens, et sans que cela représente à leurs yeux une contradiction, les acteurs
pouvaient combiner des sources aussi bien maoïstes que nationalistes roumaines.
Codreanu31 et Mao étaient aussi indispensables l´un que l´autre à la direction de l´OUTG
pour huiler les mécanismes de cette organisation et son travail de formation de cadres
29 “14 de Marzo: Tumba para los legalistas”, Revista GH Guardia de Hierro, Nº 3, febrero 1965.
30 Entretien avec Antonio, 10 juillet 2005.
31 Corneliu Codreanu, La Garde de Fer (Pour les Légionnaires), Grenoble, Colectia Omul Nou, 1972 (1936).
13
territoriaux. Ainsi, la visite des jeunes universitaires récemment péronisés aux foyers de
vieux adhérents, avec en main un enregistrement des discours de Perón en provenance de
Madrid, accompagnait et renforçait leur fraîche adhésion grâce au contact avec un
péronisme ordinaire présent dans les quartiers et secteurs populaires :
Notre travail était systématique: sonnerie et enregistrement de Perón, sonnerie et
enregistrement de Perón. Alors, que finissait-il par arriver ? Que les vieux
militants nous rendaient nous-mêmes encore plus péronismes. Nous sommes
devenus péronistes à cause d´eux et pas l´inverse32.
L’OUTG en est arrivée à être présente dans les plus importantes villes du pays : Buenos
Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán. L´objectif de l´action impliquait une
logique militaire non belliqueuse. De là le souvenir, manifesté par la totalité de ses ex-
membres, d´avoir représenté une organisation « léniniste ou staliniste » au sein du
péronisme. Entre deux à cinq militants conformaient un Groupe dans le Front Principal
dirigé par un Chef de Groupe : il s´agissait là de l´unité de base de fonctionnement affecté à
une certaine zone. Un Commando était formé de trois à cinq groupes et dirigé par un Chef
de Commando. Chaque commando comptait des Officiers de Liaison qui fournissaient les
éléments nécessaires au fonctionnement des groupes. Ils sont ainsi parvenus
progressivement à couvrir une section ou région, et à mettre en place un commandement
collégial composé de 5 dirigeants (avec à sa tête Alejandro Alvarez).
D´un point de vue opérationnel, le travail se trouvait concentré du côté du Front Principal,
c´est-à-dire du militantisme territorial. Mais il existait également divers encadrements
simultanés avec pour objectif d´élargir les bases de l´implantation politique. L´École de
Formation des Cadres préparait les dirigeants, les Brigades Justicialistes réunissaient des jeunes
non universitaires, l´Arme regroupait les femmes militantes, enfin le Front des Professionnels
se consacrait, au sein de l’école de formation des cadres, à la discussion idéologique et
aux politiques des gouvernements et se regroupait autour de la revue Hechos e Ideas
(1973-1975). Cette revue était dirigée par Amelia Podetti, philosophe et professeur
universitaire appartenant à une vague intellectuelle nationaliste et tiermondiste connue
sous le nom de « Chaires nationales » (Cátedras Nacionales). Trinchera était l´organe de
diffusion pamphlétaire et Hechos e Ideas l´espace d´expression intellectuelle où l´on
trouvait aussi bien des discussions d´auteurs péronistes, des discours de Perón, des
informations sur l´ambiance politique locale, et des articles des intellectuels de la OUTG.
32 Entretien avec Ernesto, 20 décembre 2009.
14
L´idée d´organisation léniniste pointe deux aspects particuliers. Le premier d´entre eux
concerne la teneur hautement sacrificielle, disciplinée et organique de l´adhésion
individuelle. Appartenir à l´organisation signifiait lui consacrer toutes ses forces vitales.
« Il n´y avait ni dimanches ni fériés, tu ne pouvais pas non plus présenter de certificat
médical », raconte un militant. Cependant, l´adhésion au principe de l´organisation –
outre l´apparition de frictions et de divisions internes – supposait le ralliement volontaire
aux sacrifices exigés par le militantisme. Cette prédisposition sacrificielle représentait
d´ailleurs une décision non seulement adoptée mais idéalisée. D´après Adela, faisant
référence à son passé militant, « ça nous a beaucoup servi pour nous former, pour
développer une mystique, c´est très important pour n´importe quelle organisation
politique. Avec l´esprit, avec l´âme, avec les énergies les plus profondes. Moi, par
exemple, j´ai dû, à un moment, réaliser des activités additionnelles et en même temps
j´étais enceinte. J´allais aux réunions nationales avec le bébé dans le ventre et ma fille
sous le bras. Ça je t´en parle (pour illustrer) le degré de dévouement que nous avons eu
et que nous voulions avoir. Ce fut une grande chose de la politique, le dévouement
personnel. C´étaient des voyages très durs, mais même comme ça je crois que les
inconvénients étaient atténués par les objectifs que nous poursuivions » 33. C´est pour cela
que Roberto fait appel à des exemples extraits du monde communiste lorsqu´il tente
d´expliquer la signification de la dissolution de la OUTG après la mort de Perón : « As-tu
lu El día que maté a mi padre ? Le type raconte le jour qu´il a quitté le PC. El camarada
Carlos, c´est pareil34. C´est ce que signifie quitter cette église laïque qu´est le
communisme. C´est un renoncement très fort, très fort. Et pour nous c´est ce que ça a
signifié. Et Perón était mort, lui qui était comme un père pour nous »35.
Le deuxième aspect concerne la relation entre l´organisation et le parti. Comme nous
l´avons déjà signalé, celle-ci n´était pas institutionnalisée. L´OUTG était, en gros, un
ensemble d´individus réunis autour de certains objectifs politiques. Il n´était même pas
indispensable d´être affilié au Parti Justicialiste pour y militer. D´après ses fondateurs,
l´organisation staliniste, de par la discipline que supposait l´adhésion individuelle,
comportait des fondements en contradiction avec le péronisme. Cette contradiction naît
de la tension organisationnelle que suppose la coexistence d´une organisation de cadres au
sein d´une organisation de masse faiblement bureaucratisée. Le risque consistait alors à
devenir un « parti en soi » plutôt qu´un agrégat d´activistes dans un rapport d´obéissance
33 Entretien avec Alma, 21 juin 2005.
34 « El camarada Carlos » (Alicia Dujovne, 2007) et « El día que maté a mi padre » (Jorge Sigal, 2006), témoignent des relations entre biographie militante et Parti communiste.
35 Entretien avec Roberto, 15 décembre 2009.
15
sans faille avec un espace plus ample tel que, ici, le péronisme. La vocation politique d´un
large éventail d´organisations militantes de l´époque – qui va de Montoneros à
l´organisation trosko-guévariste Armée Révolutionnaire du Peuple (ERP) – faisait de la
prise de contrôle du pouvoir par l’organisation même et de l´effondrement du régime des
objectifs étroitement liés. Pour l’OUTG, ces objectifs avaient une solution en apparence
plus simple : pour eux, la Révolution justicialiste demeurait « vivante » grâce à l´arrivée
au pouvoir de Perón en octobre 1973.
L’OUTG était une organisation de cadres: c´était là que se formaient les futurs dirigeants
politiques dont le péronisme pourrait avoir besoin. Le cadre, affirmait-on à l´époque,
était un « homme politico- révolutionnaire », consigne combinant les nécessités réalistes
des tâches de commandement et les idéaux de transformation sociale. Si le sectarisme et
l´autonomie organisationnelle étaient des risques réels, un danger plus important encore
menaçant l´organisation dirigée par Alejandro Álvarez, était incarné par la figure du
politique professionnel pouvant entraîner la désaffectation des militants. Ainsi, avec
l´apparition en 1972-1973 des postes d´élus (en particulier de députés), puis l´occupation
de postes au sein de l´Etat, des conflits virent peu à peu le jour au sein de l´organisation.
L´exemple le plus connu est celui de Julio Bárbaro, ancien militant de Guardia de Hierro,
issu d´une famille modeste et socialiste. Il suivit sa scolarité dans les milieux catholiques
et fut dirigeant universitaire du groupement étudiant Humanisme, également
d´extraction catholique. Fasciné par le travail territorial de Guardia de Hierro, Bárbaro
décide d´y militer et de mettre à profit sa capacité à pénétrer les tissus territoriaux par la
fréquentation de bars et de cafés, sa profonde connaissances des réseaux sociaux,
intellectuels et religieux des quartiers de Buenos Aires, et les visites auprès des militants
auxquels il apportait les enregistrements de Perón (méthode connu sous le nom de
« maison et sonnerie » (« casa y timbreo »)). En 1973, il occupe un poste de député
national, ce qui engendre de fortes tensions entre ses fonctions de député et sa loyauté
envers l´organisation. Il finit par rompre avec l´OUTG et ses leaders, tout en
approfondissant ses liens, tout au long des années et des décennies qui ont suivi, avec
divers espaces de la politique partidaire. L´existence et l´institutionnalisation de charges
publiques pour des militants devenus cadres politiques fit émerger, à diverses reprises,
des situations conflictuelles entre les membres de l´organisation et sa direction. Les
années passant, une querelle factice s´enracine entre anciens confrères ; entre ceux qui
soutiennent que le mépris des charges publiques se traduit par un idéalisme difficile de
soutenir politiquement et démocratiquement, et ceux qui accusent les militants qui se
sont professionnalisés d´avoir abandonné les « idéaux révolutionnaires ».
16
L´OUTG se dissout finalement en juillet 1974. Son héritage postérieur peut être résumé
suivant deux grandes directions. La première concerne effectivement le transfert d´ex-
militants vers la politique incarnée par des partis. Cette intégration s´est produite avec le
retour à la démocratie en 1983, lorsque certains « ex-gardiens », comme les nomme la
presse, occupèrent des fonctions importantes au sein des partis politiques et des
administrations péronistes locales et nationales. La seconde direction est incarnée par la
tentative constante de recréer, parfois avec le péronisme, d´autres fois en rupture avec
lui, un projet organisationnel autonome. Depuis la dernière dictature (1976-1983), ce
projet s´est peu à peu rapproché du catholicisme, au point de fonder en 1988 une
association privée composée de fidèles (qui fut un temps une société secrète) connue sous le
nom d´Ordre de Marie du Rosaire de Saint Nicolas. La conversion et reconversion vers
un catholicisme militant envisagé comme une possibilité de renversement du « Régime »
représenta une option pour nombre d´ex-militants de l´OUTG. Comme le soutient un
texte qui tente de justifier cette conversion catholique (texte écrit par un ancien adhérent
élevé dans un milieu profondément antipéroniste, socialiste et athée), les membres de la
« ligue » se rendirent compte que la « politique pure » ne suffisait pas, pas plus que
l´adhésion à une « religion anodine et intimiste » 36. Les échecs successifs ont marqué la
biographie organisationnelle d´une ancienne congrégation péroniste transformée en une
secte catholique virtuelle37.
La ligue comme problématique large
L´histoire de l´OUTG peut être interprétée à partir de quelques-uns des traits qui
définissent les formes de compromis individuels présents dans d´autres organisations, par
exemple dans le communisme français tel qu´il fut étudié par Marc Lazar. Les distances et
différences sont certes énormes et il est nécessaire d´en souligner quelques-unes. Par
exemple, la brièveté de l´expérience de l´OUTG de même que son extension limitée
contrastent avec la longue histoire et l´amplitude qu´atteint le communisme en France.
D´autres importantes différences se cristallisent autour des relations institutionnelles. Le
groupe péroniste étudié, comme tant d´autres appartenant à ce mouvement, incarne la
volonté de réunir des adhésions en fonction d´une cause, de manière indépendante de
tout parti, tout en finançant l´activité militante grâce à un système de cotisation précaire.
La principale source de financement de la politique était liée au fait de recruter des
personnes appartenant aux secteurs universitaires, suffisamment aisés pour demeurer en
36 Histoire de l´Ordre de Marie du Rosaire de Saint Nicolas, 2009, texte inédit et anonyme.
37 Voir Humberto Cucchetti Combatientes de Perón, Herederos de Cristo. Peronismo, religión secular y organizaciones de cuadros, Buenos Aires, Prometeo, 2010.
17
dehors du marché du travail et jouissant provisoirement d´une certaine disponibilité.
Malgré les crises diverses et les moments de affaiblissement que réservent les décennies
d´existence, un parti politique – et plus encore le communisme inséré dans des réseaux
transnationaux – parvient à stabiliser son appareil politique en fonction des liens
institutionnels nationaux et étrangers. Au final, Maurice Duverger soutenait que le
communisme représentait un « troisième type » de parti au regard de la notion
d´adhérent : un « parti de fidèles, plus ouvert que les partis de cadres, mais plus fermé
que les partis de masses »38. En tant qu´ensemble organisé lié au péronisme, l´OUTG
réglait le thème de sa relation avec les masses en s´y insérant. Cependant, et
contrairement à ce qui était ouvertement admis, certains de ses militants rêvaient de
parvenir à transformer l´organisation en parti autonome.
Malgré ces différences, quelques rapprochements peuvent être faits avec la proposition de
Lazar : l´importance de la manière dont on devient communiste, les dimensions politico-
religieuses du compromis politique (ce qui conduit à l´épineuse question des religions
séculaires), la difficulté de rompre avec le noyau partisan et, en particulier, l´idée que ce
compromis n´est pas réservé à la seule sphère politique mais traverse au contraire la
totalité de la vie humaine et implique un effort constant de réforme et de transformation
personnelle39. Les récits et documents auxquels nous avons eu accès, qu´ils s´agisse
d´anciens militants de l´OUTG ou de documents partisans, nous renvoient à une logique
qualitative et intensive à partir de laquelle penser le compromis politique.
C´est alors que l´on peut introduire la référence au phénomène ligueur. Le cas de
l´OUTG rejoint un ensemble de phénomènes qui, dans une perspective empirique, sont
liés à des ligues déterminées, à certains partis politiques et à des formes particulières de
militantisme. La spécificité de notre exemple se situe du côté de la place constitutive
qu´occupent, dans l´espace politique, l´adhésion du militant et les significations de
l´activité politique. L´OUTG ne peut être comprise, dans ce sens, comme une ligue de
cadres mais comme un ensemble d´individus qualifiés pour réaliser une « activité
transcendante ». Ce type d´objet d´étude a tendance à présenter une tension entre deux
types de ligues tels que définis par Bernstein : la ligue groupe de pression et la ligue
activiste. Dans les faits, l´organisation analysée constituait un mécanisme visant la
politisation et la formation de dirigeants (cadres) au sein du péronisme. Cependant, le
discours construit depuis l´époque de Guardia de Hierro relevait davantage d´une ligue
maximaliste, accompagnée de déclarations virulentes et excessives. L´organisation
38 Maurice Duverger, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, 1981(1951), p. 128.
39 Marc Lazar, « Le parti et le don de soi », Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, Année 1998, Volume 60, Numéro 1.
18
partisane représentait justement l´instrument révolutionnaire ; tout en abandonnant le
cadre de la lutte armée, Guardia de Hierro, le FEN et finalement l´OUTG se
présentèrent comme les auxiliaires d´une révolution justicialiste qui commencerait à
prendre forme avec le retour de « Perón à la Patrie et au Pouvoir » 40.
En se centrant sur une autoreprésentation qui transgresse l´institutionnel et menace de
défier l´ordre en place (quel qu´il soit), le groupe activiste met l´accent sur les prouesses
de ses membres et les « exploits » de l´organisation elle-même41. L´héroïsme des
adhérents – qui s´explique également par une combinaison d´éléments religieux
sacrificiels, d´un esprit aventurier avide de lutte et de bagarre, de manifestations viriles et
d´audace semi-inconsciente – témoigne d´une modalité qualitative d´appartenance à
l´organisation. L´OUTG est passée de méthodes qui l´associaient à un activisme défini
comme étant fanatisé par la violence, « insurrectionnaliste », propre d´une étape anarco-
syndicale42. vers des formes plus rationnelles et habituelles du politique : la pénétration
territoriale, la formation des militants, les contacts (parfois paradoxaux et conflictuels)
avec les structures institutionnelles du parti et des gouvernements justicialistes. Ses
dirigeants n´hésitaient cependant pas à souligner le caractère métaphysique de Perón
haranguant entre 1972 et 1973 que le leader « ne mourrait pas » ou, plus tard, que son
épouse et vice-présidente, Isabel Martinez, incarnait l´« institutionnalisation de la
direction » en faisant appel à toute une panoplie de récits sacrés43.
L´exacerbation des critères d´adhésion suscitèrent une tension source de débats entre les
militants : de la loyauté envers l´OUTG ou envers Perón, de la fidélité envers le
militantisme ou la progressive professionnalisation politique. Déambulant entre ces
alternatives, et à travers les contradictions qui marquaient le péronisme et la politique
argentine des années 1970, les réseaux organisés de l´OUTG perdirent peu à peu la
possibilité de se constituer en groupe activiste à même d´atteindre le pouvoir politique.
L´exemple étudié appartient au phénomène plus ample du militantisme des années 1960
et 1970 en Argentine44. Du point de vue de la problématique d´ordre conceptuel, les
40 Ces consignes étaient partagées par un ample éventail de groupes péronistes de l´époque.
41 Sur les Camelot du Roi et les répercussions de leur activisme de rue, voir Francis Balace, « Les Camelots du Roi. Une jeunesse contestataire et dérangeante dans le roman français:1908- 1914 », dans Olivier Dard- Michel Leymarie- Neil McWilliam, Le maurrassisme et la culture. L’Action française. Culture, société, politique (III), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2010.
42 Ramón Prieto, El Pacto. Ocho años de política argentina, Buenos Aires, En marcha, 1963. Ancien dirigeant sous la Seconde République espagnole, le catalan Ramón Prieto arrive en Argentine et adhère au péronisme. Il critique radicalement les solutions insurrectionnelles qui commencent à pointer vers la fin des années 1950, début des années 1960.
43 “Editorial. La jefatura de Isabel Perón”, Hechos e Ideas, Año 2, n º 7, tercera época, noviembre- diciembre 1974, pp. 4- 5.
44 Les motifs ayant conduit à une telle politisation massive des jeunes de classe moyenne font l´objet de diverses explications.
19
ligues sont ici interprétées comme des modalités politiques particulières qui se débattent
entre la pratique de la pression et la « prise du pouvoir », entre une composition de
notables et la formation de futurs cadres, entre son absorption par des espaces plus
amples et la spécialisation du groupe ; la problématique en tant que telle peut traverser
différentes réalités porteuses d´intéressants points communs45. Nous avons, dans ces
pages, approché une organisation analysée du point de vue de l´adhésion à un espace
militant actif qui, bien que dans les faits il ait représenté une étape vers les partis
politiques, n´a pas abandonné la tentation de se penser comme un instrument autonome
de type léniniste.
De même, les trajectoires sociales présentées peuvent illustrer la manifestation concrète
d´un liguisme nationaliste en Argentine. Bien que différente du groupe nationaliste LPA –
d´une composition sociale plus ouvertement militaire et ploutocratique – l´OUTG
partage certaines de ses caractéristiques articulées à d´autres manifestations politiques
propres à la société argentine des années 1960 et 1970. Ses ennemis, qui prirent le
chemin de la lutte armée, furent comme elle pénétrés d´un esprit révolutionnaire qui,
par la reconnaissance d´un programme socialiste souvent présenté comme un socialisme
national, se définissait par rapport à un nationalisme continental assumant, sans les
remplacer, les fondements d´une entreprise nationale légitime46.
Conclusions
Si l´on se penche sur le sens du phénomène ligueur au regard d´une certaine
représentation du militantisme ?, il est possible de distinguer deux ensembles de
réflexions. L´un d´eux se situe sur le plan des transferts transnationaux. Certaines
expériences péronistes sont liées à des projets idéologiques ainsi qu´à des types de
45 Nathalie Sevilla, « Les ligues, état de lieux historiographiques », dans Olivier Dard et Nathalie Sevilla, Le phénomène ligueur sous la IIIe République, Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire, 2009. Le cas de la ligue de la Jeunesse Patriotique témoigne de différentes approches possibles : son mimétisme à l´égard des organisations communistes (ce qui renouvelle l´intérêt de rendre compte des rivalités spéculaires), et la coexistence, au sein d´une même histoire organisationnelle, de divers principes associatifs dont les frontières peuvent sembler diffuses : par exemple entre les ligues, les milices et les partis. Cf. Jean Philippet, « Les Jeunesses Patriotiques : ligue, milice ou parti ? », Nathalie Sevilla, « Les ligues, état de lieux historiographiques », dans Olivier Dard et Nathalie Sevilla, Le phénomène ligueur sous la IIIe République. Il est également possible d´analyser les relations entre contexte de crise et activité ligueuse. Dans ce sens, les reconversions que subissent les ligues dans les cas de dissolution du groupement (que ce soit suite à une décision forcée ou volontaire) aident à mieux saisir les limites des projets ligueurs. Cf. Aude Chamouard et Gilles Morin, « Les effets de la dissolution des ligues en 1936 : le cas de l’Action française », dans Nathalie Sevilla, « Les ligues, état de lieux historiographiques », dans Olivier Dard et Nathalie Sevilla, Le phénomène ligueur sous la IIIe République. En relation au phénomène organisationnel, voir l’analyse déjà esquissée par Jacques Maître en 1961 sur les dynamiques propagandistes du communisme et sa récupération par le catholicisme d’extrême droite : Jacques Maître, « Catholicisme d’extrême droite et croisade anti-subversive », in Revue française de sociologie, 1961, 2-2, p. 112.
46 À ce sujet, nous trouvons très intéressantes la compilation de textes et l´analyse de Raoul Girardet dans l´ouvrage Nationalismes et nation, Bruxelles, Editions Complexe, 1996.
20
militance qui proviennent de l´extérieur, d´autres pays. Cette affinité peut être expliquée
par l´histoire des idées mais elle peut également être approchée en tant que sensibilité
dont l´étude devrait être approfondie par la sociologie historique et par l’histoire des
organisations activistes (y compris des ligues) dans la perspective de l´étude du compromis.
Cet extrait d´entretien d´Alain de Benoist, cherchant à définir l´influence de ses idées sur
le « tiercérisme » péroniste, conjugue croyons-nous attirance doctrinaire et une
dimension militante plus enfouie, moins immédiatement visible :
« Oui, d’une certaine manière. Il y a des choses que j’aime beaucoup dans le
péronisme, il y en a d’autres que j’aime moins. Mais quand même c’est un
phénomène sud-américain, il y a une dimension un peu de démagogie populiste
(…), il y a le personnage de Perón, etc. Mais c’est vrai que, il y a eu une partie du
péronisme dans laquelle je pourrais me reconnaître. Et si je voulais affiner je
dirais, parce que l’expression est employée, [dans] le péronisme de gauche. Je [ne]
dis pas les Montoneros forcément mais oui, c’est vrai, je suis sensible
affectivement à la légende d’Evita Perón, mais je ne suis pas péroniste. Mais il y a
des choses intéressantes dans le péronisme. Et des limites également »47.
La question des transferts transnationaux a supposé un va-et-vient constant de trajectoires
partisanes et intellectuelles d´un continent à l´autre. Dans un début, et c´est là un thème
à approfondir, il s´agissait de nationalistes espagnols, français, italiens, basques, etc. qui
rejoignaient les milieux activistes des années 1960 et 1970. Plus tard, ce sont les
trajectoires péronistes qui construisirent des liens avec les membres de la Nouvelle droite
française.48
Un autre ensemble de réflexion se dégage de l´approche comparative. Prenons, par
exemple, certaines significations entourant l´histoire contemporaine de l´Action
française. Suivant l´interprétation qui assigne à la ligue une importance toute relative dans
cette organisation49, la mémoire construite par une grande partie de ses militants actuels
est marquée par le caractère radical assigné au « compromis royaliste ». Cela implique de
trouver dans différentes biographies de jeunes militants nullement issus de familles ayant
47 Entretien avec Alain de Benoist, 27 mai 2009.
48 On peut rappeler les relations entre Alberto Buela, intellectuel péroniste, et la Nouvelle École; ou encore le récent numéro que la revue Krisis consacre au “Populisme?” (nº29, février 2008) et la présence dans ses pages de Luis María Bandieri et de Jorge Raventos. Si ces liens ne constituent que des “indices” dont l´analyse doit être approfondie, et les transferts ne supposent pas d´assimiler des phénomènes ayant lieu dans différents contextes et sociétés, les influences qui parcourent et marquent différentes trajectoires politico-intellectuelles représentent des éléments très enrichissants pour l´analyse.
49 Olivier Dard, « La part de la ligue dans l’identité et le rayonnement de l’Action française », Olivier Dard et Nathalie Sevilla, Le phénomène ligueur sous la IIIe République, Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire, 2009.
21
été préalablement socialisées dans l´Action française une raison d´ordre contestataire à
même d´expliquer leur adhésion à un projet monarchique : leur compromis est lié à une
forme de transgression d´un conformisme progressiste50. Au cours des réunions, les
militants prêchent la révolte contre le régime politique dominant en France ; ils
renouvellent, dans ce sens, le serment d´action et de fidélité qui implique une forme de
renoncement de soi. La révolte mène à l´insurrection, c´est aussi un état d´esprit, un maquis
spirituel qui implique de faire montre de responsabilité individuelle « lorsque je contemple
les orages qui s’annoncent dans le ciel de France »51.
Cet esprit ligueur survit au fort penchant intellectuel du royalisme français ainsi qu´à la
toute aussi menaçante professionnalisation politique. Une militante, qui appartient à cette
organisation de même qu´à un parti politique (CNI), témoigne de la nature radicalement
hétérogène de l´appartenance à l´une et l´autre de ces organisations : « Être adhérent
c’est voter, c’est donner de l’argent. À l’Action française c’est gratuit, c’est bénévole.
Un militant de l’UMP, du CNI n’a pas la même vision de l’engagement et le don de soi
qu’un militant de l’Action française. Ça c’est sûr. Jamais »52. Même Bertrand Renouvin,
qui, au moment de la définir, revendique l’inclinaison intellectuelle de la Nouvelle
Action Royaliste, n´en souligne pas moins l´esprit militant, toujours latent, qui peut à
tout moment transformer une école de pensée en ligue éventuelle qu´il qualifie de
« mouvement » :
« Alors, société de pensée à vocation révolutionnaire. Dans l’ordinaire des jours
on ne fonctionne pas comme un parti politique parce que c’est lourd, coûteux,
etc. Mais on est capable de se transformer du jour au lendemain en mouvement
militant très organisé, très discipliné. C’est qu’on a fait en 2002 ; on a rejoint
Chevènement et on participe à la direction de sa campagne, là la société de pensée
est redevenu un mouvement […]. On est capable de faire ça et on est toujours
capable de le faire. Demain quelqu’un se présente à la présidentielle et on peut
accepter son programme politique, et bien oui, on deviendra à nouveau, avec
quelques années de plus et avec quelques militants jeunes en plus et de
sympathisants beaucoup plus nombreux qu’avant, on deviendra les cadres de cette
campagne à venir. On peut proposer une très grosse expérience militante »53.
50 Entretien avec Aurélie, 30 mars 2009 ; entretien avec Arnaud, 22 mai 2009.
51 Propos du Responsable de la Jeunesse d’AF, Meeting à Jeanne d’Arc, 9 mai 2005.
52 Entretien avec Marie, 15 mai 2009.
53 Entretien avec Bertrand Renouvin, 16 mars 2009.
22
L´une des approches du phénomène des ligues peut se centrer sur certaines des
caractéristiques que partagent celles qui considèrent, ne serait-ce que tangentiellement,
le thème du pouvoir et la déstabilisation d´un système politique donné, ainsi que d´autres
formes de militantisme radical. L´analyse de type comparatif permet de détecter
comment, dans différents contextes, se sont développées certaines sociabilités politiques
intensives et nationalistes. Les expériences individuelles et les significations que revêt
l´organisation mettent en relief un aspect subjectif essentiel à analyser. Il n´est ainsi pas
rare d´être confronté à la manière dont cette association politique, qu´elle porte ou non
le nom de ligue, souscrit à une représentation propre et à un type d´activisme qui se
détourne des partis politiques, établissant avec ces derniers une concurrence partisane. La
professionnalisation politique et la transformation des organisations en partis apparaissent
comme un destin de reconversion individuelle et organisationnelle. Les efforts liés à une
forte dose de volontarisme, à un certain militantisme ligueur, et qui vont de pairs avec
des objectifs maximalistes, entrent en phase de décadence suivant des dynamiques
endogènes et exogènes. L´observation de type comparative du problème permettrait de
construire une approche originale qui consisterait à rechercher des études synthétiques
afin de consolider un apport typologique, voire cartographique, du problème en question54.
54 Nathalie Sevilla, « Les ligues, état de lieux historiographiques », dans Olivier Dard et Nathalie Sevilla, Le phénomène ligueur sous la IIIe République.






















![Spécificateurs engendrés par les traits [±ANIMÉ], [±HUMAIN], [±CONCRET] et structures d’arguments en arabe et en français](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63196bfebc8291e22e0f184b/specificateurs-engendres-par-les-traits-anime-humain-concret-et.jpg)