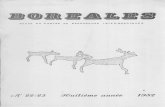Recherches algériennes en sociolinguistique et en littérature
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Recherches algériennes en sociolinguistique et en littérature
Multilinguales
15 | 2021Recherches algériennes en sociolinguistique et enlittérature : discours scientifique/discours militant,quelles frontières ?
Édition électroniqueURL : https://journals.openedition.org/multilinguales/5968DOI : 10.4000/multilinguales.5968ISSN : 2335-1853
ÉditeurUniversité Abderrahmane Mira - Bejaia
Référence électroniqueMultilinguales, 15 | 2021, « Recherches algériennes en sociolinguistique et en littérature : discoursscientifique/discours militant, quelles frontières ? » [En ligne], mis en ligne le 15 juin 2021, consulté le14 février 2022. URL : https://journals.openedition.org/multilinguales/5968 ; DOI : https://doi.org/10.4000/multilinguales.5968
Ce document a été généré automatiquement le 14 février 2022.
Multilinguales est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution -Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International
SOMMAIRE
Avant-proposMourad Bektache
Esquisse d’une sociolinguistique de la littérature dans le contexte algérien : enjeuxthéoriques et positionnements épistémologiques
Mokhtar Boughanem et Hassiba Benaldi
Recherche en littérature écrite d’expression amazighe : état des lieux et typologie desdiscours critiquesSalim Ayad
Une lecture de la reception du roman de langue kabyle (ou l’ungal)Nabila Sadi
Tajeṛṛumt n tmaziγt de Mouloud Mammeri : terminologie grammaticale et métalangage Mahmoud Amaoui
Autour de l’acte humoristique en Algérie : le français au service de l’impliciteRadia Touati
Une analyse discursive de l’acte humoristique à travers les créations lexicales dans la pressefrancophone algérienneSamira Allam Iddou
Varia
La lecture/déchiffrement en Algérie et la méthode syllabiqueAfaf Salhi et Mourad Bektache
Les insultes « mots-doux » dans les échanges conversationnels dans l’espace public en Côted’IvoireKouakou Kouman Fodjo
L’identité nationale à travers les manuels scolaires de langue française en Algérie. Cas dumanuel de première année moyenne Adila Sahraoui Idriss et Fatima Zohra Chiali Lalaoui
« La nuit de noce sur la natte » : l’expression liminaire d’une initiation ratéeZahir Sidane
Deux romans de Kamel Daoud, entre militantisme satirique et symbiose interculturelleSmail Mahfouf
Multilinguales, 15 | 2021
1
Avant-proposMourad Bektache
Recherches algériennes en sociolinguistique et enlittérature : discours scientifique/discours militant,quelles frontières ?
1 Depuis plusieurs années les études dans les domaines des sciences du langage et de la
littérature en Algérie prolifèrent. L'ouverture de ce pays maghrébin dans différents
niveaux (sociopolitique, économique, culturel) depuis les années 1990 a libéré
ostensiblement la recherche scientifique. Rappelons qu’après l'indépendance, la
recherche dans le domaine des sciences sociales était bridée et très peu encouragée. Si
elle existait elle se faisait à l'étranger par quelques chercheurs algériens exilés ou,
souvent, par des universitaires étrangers (Tristan Leperlier, 2018). L'étude de terrain
était très peu développée. Les quelques travaux produits étaient davantage
institutionnels et étatiques. Ceux-ci constituaient un moyen de légitimation des
pouvoirs publics de l'époque (Tristan Leperlier, idem). Les travaux sur les langues
n'étaient pas en reste puisqu'ils constituaient l'un des éléments les plus contrôlés dans
la politique nationale du pays. Les seuls travaux tolérés sont ceux qui sont limités au
cadre descriptif des langues. Du fait d’une politique d’arabisation, les études traitant de
la langue arabe institutionnelle ont été encouragées. La libération du champ politique
en Algérie dès 1990 a favorisé la multiplication des travaux universitaires dans le
domaine des sciences du langage et de la littérature. En sociolinguistique, par exemple,
plusieurs études sont menées sur les langues autrefois interdites (l’amazight et l’arabe
dialectal). Même dynamique est observée dans le domaine de la recherche littéraire :
plusieurs travaux ont été publiés sur des œuvres littéraires interdites auparavant. Cette
nouvelle donne a favorisé l’apparition de mouvements d’universitaires défenseurs des
langues minorées (l’amazigh et l’arabe dialectal) et de la liberté d’expression (théâtre,
cafés littéraires, presse écrite, art et cinéma…). Comme leurs pairs occitanistes
(universitaires-militants défenseurs de la langue occitane ; R. Lafont, Ph. Martel, H.
Boyer, P. Sauzet, par exemple), plusieurs universitaires algériens prônent un discours
Multilinguales, 15 | 2021
2
plutôt militant vis-à-vis des langues algériennes, des questions identitaires, culturelles
et religieuses.
2 Notre intérêt dans cet appel à contribution est porté sur les discours universitaires
(Dominique Maingueneau, 2010) produits dans les domaines de la recherche en sciences
du langage et en littérature depuis l’indépendance en Algérie. Il s’agit pour nous de
recueillir des travaux sur le positionnement dans le discours (Christian Le Bart, 1998) de
chercheurs sur des questions linguistiques et littéraires. Un bilan de tous les travaux
menés dans ces disciplines permettrait de comprendre l’évolution de la recherche dans
ces domaines, d’en comparer les différentes étapes et, surtout, de tracer une typologie
des discours propres aux chercheurs algériens.
3 Dans le domaine des sciences du langage nous pouvons citer le travail mené par Dalila
Morsly (2012) qui retrace les travaux sociolinguistiques menés en Algérie. Elle évoque
les positions des uns et des autres à l'égard de l'objet d'étude. L’article de Chachou
Ibtissem et Bensekat Malika (2016), intitulé "Le traitement de la variation linguistique dans
les travaux universitaires sur les langues pratiquées en Algérie : Cas de quelques positions de
recherche », tente une étude sur les postures de recherche d'universitaires algériens sur
la variation linguistique. L'étude met en avant, à travers un corpus limité, quelques
postions épistémologiques de chercheurs vis-à-vis de l'objet d'étude de leur recherche.
D'autres études (Abderazak Dourari, Khaoula Taleb Ibrahimi, Foudil Cheriguen) tentent
tant bien que mal de démonter la complexité de l'objet langue en Algérie.
4 Ce numéro se propose de répondre à deux questionnements : la complexité du rapport
au terrain algérien (Attika-Yasmine Abbes-Kara) et le statut des connaissances
produites par des chercheurs algériens. Le premier soulève des questions d’ordre
méthodologique (quelle posture adopte le chercheur de terrain [Philipe Blanchet, 2012]
dans un contexte généralement tendu, conflictuel et souvent en mouvement continu
?) ; le deuxième renvoie aux positions épistémologiques des chercheurs [Françoise
Demaizière, Jean-Paul Narcy-Combes, 2007] (quels sont les statuts respectifs des
connaissances et des discours scientifiques et militants produits en Algérie ?). Il s'agit,
en effet, de savoir quelles postures discursives (Aude Bretegnier, 2009) caractérisent les
connaissances produites par des chercheurs algériens. Quels sont les mécanismes
discursifs mis en place par les universitaires algériens quand un lien direct existe entre
le chercheur (impliqué/distancié) et l’objet d’étude analysé ? Et quels discours sont
produits (représentations) sur ces connaissances scientifiques ? Les universitaires-
militants en sociolinguistique (Tirvassen Rada, 2019 ; Philippe Blanchet, 2014)
produisent quel discours sur les langues en Algérie ? Quelles sont les frontières entre le
chercheur algérien dans ces disciplines et son objet d’étude ?
5 Ces questionnements pourront trouver des réponses à travers les axes suivants :
Axe 1 : Quels bilans peut-on faire des productions scientifiques dans les domaines des
sciences du langage et de la littérature en Algérie ? Quelle typologie peut-on en dégager
? Quel type de discours est produit sur les questions linguistiques et littéraires en
Algérie ? Quelles positions discursives adoptent les chercheurs algériens dans leur acte de
production des connaissances face à l’ordre du discours (Aïcha Kassoul, 2008) mis en
place par les institutions ?
Axe 2 : Les universitaires algériens en sciences du langage s’inscrivent-ils dans un cadre
épistémologique imposé par la nature/particularité de leur objet d’étude ? Comment
gèrent-ils (des marqueurs discursifs le font apparaitre) les pressions sociales et
institutionnelles dans leur recherche ? Quel discours produisent-ils sur les langues
Multilinguales, 15 | 2021
3
minorées et les langues institutionnelles ? Comment se construit le discours produit
par l’universitaire-militant ? Quel impact a-t-il sur la recherche et le devenir des
langues en Algérie ?
AUTEUR
MOURAD BEKTACHE
Directeur de publication, memebre du comité scientifique et de lecture de Multilinguales,
Université de Bejaia
Multilinguales, 15 | 2021
4
Esquisse d’une sociolinguistique dela littérature dans le contexte
algérien : enjeux théoriques etpositionnements épistémologiques
Outlining sociolinguistics of literature in the Algerian context: theorical issues
and epistemological
positions
Mokhtar Boughanem et Hassiba Benaldi
1 La présente réflexion part de l’idée selon laquelle la fragmentation institutionnelle des
champs disciplinaires rend problématique l’appréhension des objets complexes (Morin,
1990) qui, à l’instar de la langue et de la littérature, requièrent des approches plurielles.
En Algérie, les études linguistiques et les études littéraires ont tendance à évoluer de
manière autonome les unes des autres. Pourtant, leurs objets respectifs sont appelés à
interagir en permanence.
2 La question qui se pose dès lors est de savoir s’il est possible, en l’état actuel des
connaissances, de faire dialoguer leurs objets d’étude sans se heurter à de sérieux
obstacles épistémologiques. Ainsi que le note Lise Gauvin, « la question des interactions
entre langue et littérature, si elle parait au départ affectée d’un caractère d’évidence, se
complique dès qu’on y regarde de plus près » (2004 : 7). D’une part, la langue génère de
la littérature sur la base d’une construction discursive rendue possible grâce au
processus d’écriture. D’autre part, la littérature procède, au cours de son élaboration,
de la déconstruction puis de la reconstruction de la langue. D’où notre objectif de
rassembler dans ce travail les présupposés épistémologiques1 et théoriques à la lumière
desquels l’opposition paradigmatique entre langue et littérature cesse de tourner le dos
à la recherche interdisciplinaire. L’intérêt du décloisonnement scientifique ainsi prôné
réside dans le fait qu’il offre la possibilité d’explorer les zones d’ombre créées sous
l’effet du retranchement disciplinaire.
Multilinguales, 15 | 2021
5
3 Le point de vue que nous adoptons ici est celui d’une sociolinguistique de la littérature
qui se veut en construction. Si dans cette perspective la langue peut immédiatement
être définie comme un objet social dont les contours sont forgés par les pratiques ainsi
que par les représentations des locuteurs, qu’en est-il de la littérature ? Quelle réalité
socio-langagière recouvre-t-elle ? En quoi peut-elle constituer un terrain de recherche
pour la sociolinguistique ?
Ces questions sont bien sûr à mettre en relation avec le contexte académique algérien.
Pour y répondre, nous comptons établir un état des lieux concernant les recherches qui
interrogent conjointement les notions de langue et de littérature. A partir de cet état
des lieux, il sera question de relever les positionnements épistémologiques adoptés par
différents chercheurs algériens.
1. Une prédisposition à travailler sur des terrainsdispersés
4 La sociolinguistique se donne pour tâche d’explorer les langues dans et à travers leurs
contextes d’emploi. Dans cette optique, l’accent est davantage mis sur l’aspect
dynamique des faits langagiers à l’œuvre que sur leur aspect statique. Ainsi,
conformément à sa vocation, la sociolinguistique est susceptible d’intervenir partout
où la langue est employée, partout où des locuteurs se mettent à produire du discours.
C’est ainsi qu’à partir de ce fil conducteur, nous avons pu assister progressivement à la
multiplication des terrains de la sociolinguistique. Il peut s’agir de terrains physiques
dont la délimitation effective est possible à vue d’œil ou de terrains symboliques au sein
desquels se déploie une phénoménologie socio-langagière mouvante. En voici quelques
exemples :la ville, à travers ses versants linguistique et langagier, constitue l’objet d’étude de la
sociolinguistique urbaine (Calvet, 1994) ;
l’école est, en ce qu’elle est le siège institutionnel de l’enseignement-apprentissage des
langues, le champ d’investigation de la sociolinguistique scolaire (Dabène, 1994) ;
le monde du travail, avec ses problématiques de socialisation, d’insertion et de domination,
figure au cœur des préoccupations de la sociolinguistique des situations de travail (Boutet,
2008) ;
la variation linguistique, en tant que phénomène majeur indissociable de l’activité
langagière, est prise en charge par la sociolinguistique variationniste (Gadet, 2007) ;
la communication interpersonnelle sous toutes ses formes (interlocution, conversation,
échanges, etc.) mobilise autour d’elle la sociolinguistique interactionnelle (Gumperz, 1989) ;
les phénomènes liés au métissage linguistique dans les situations bi-plurilingues sont
étudiés par la sociolinguistique des contacts de langues (Simonin et Wharton, 2013).
Bien évidemment, cette énumération n’a pas la prétention d’être ni linéaire ni
exhaustive. Elle ne fait que mettre en évidence le caractère entropique de la
sociolinguistique et sa prédisposition épistémologique à investir, pour peu que la
question de la langue soit posée dans un cadre impliquant la dimension sociale, des
terrains peu conventionnels.
5 Partant de cette configuration, nous tenterons le long de cet article d’identifier les
ressorts favorables à l’attraction heuristique entre sociolinguistique et littérature.
Etant à l’opposé de toute vision disjonctive cloisonnée dans la stricte disciplinarité, la
sociolinguistique adopte un mode de construction des connaissances de type
•
•
•
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
6
« hologrammique » (Blanchet, 2015 : 66), lequel consiste à considérer les phénomènes
langagiers comme étant irréductibles à la somme des parties qui les constituent.
Conformément à ce postulat, les interactions qui peuvent être observées entre les
parties en question sont à l’origine d’une dynamique d’ensemble qui requiert une
démarche constructiviste. Cela suppose pour ce qui nous concerne ici que, une fois mis
en contact, les complexes langue et littérature laissent entrevoir des phénomènes
émergents qui ne demandent qu’à être explorés en dehors de l’opposition classique
dans laquelle ils ont longtemps été confinés. En d’autres termes, la relation entre
langue et littérature est à rechercher non pas dans ce qu’est l’une ou l’autre, de
manière séparée, mais dans ce qu’implique l’une pour l’autre.
2. Exploitation des données bibliométriques via laplateforme ASJP
6 Les données de la plateforme ASJP2 nous ont servi d’indicateurs bibliométriques afin de
situer la production scientifique ayant comme objet de réflexion le couple langue-
littérature. Etant donné que cette plateforme est continuellement alimentée par de
nouveaux articles, nous nous sommes contentés de vérifier les données disponibles
jusqu’au 31 décembre 2020.
Etant dotée d’un moteur de recherche intégré, la plateforme ASJP nous a permis
d’accéder, en un clic, à tous les contenus dans lesquels langue et littérature figurent
comme mots-clés3. Lors de cette opération de sélection automatique des contenus, nous
avons recensé 1065 publications. Après avoir survolé tous les contenus identifiés, nous
nous sommes résolus à la nécessité d’effectuer un autre tri manuel, forcément plus
rigoureux, de sorte à ne garder que les propositions pertinentes et exploitables. Nous
avons ainsi éliminé tous les articles dans lesquels la relation entre langue et littérature
n’est pas explicitement abordée ainsi que tous ceux qui ne sont pas rédigés par des
chercheurs algériens. A l’issue de cette étape, nous nous sommes retrouvés en présence
de 103 articles. Une grille de lecture nous a ensuite permis de repérer, en priorité, la
problématique ainsi que l’ancrage théorique de chacun de ces articles.
7 La représentation graphique ci-dessous montre, en termes de pourcentages, la
répartition disciplinaire des articles retenus. Il en ressort que, rien que dans le contexte
algérien, quatre champs de recherche4 s’interrogent sur les spécificités de la relation
entre langue et littérature. Ceci témoigne non seulement de l’intérêt scientifique que
suscite cette relation, mais aussi des interrogations qu’elle soulève chez de nombreux
chercheurs.
Multilinguales, 15 | 2021
7
Graphique 1 : Répartition par discipline des recherches traitant de la relation entre langue etlittérature
Les chiffres ainsi obtenus5 révèlent que, malgré leur grande diversité, les études
littéraires n’ont pas la prétention de monopoliser la réflexion sur cette question. Les
problématiques développées dans ce sillage portent, entre autres, sur les spécificités
linguistiques de l’écriture littéraire, sur les retombées stylistiques liées à l’usage de la
langue dans le cadre de la fiction ainsi que sur les modalités d’expression véhiculées
par le texte littéraire. Toutes ces orientations sont importantes à prendre en
considération dès lors qu’elles sont révélatrices d’un type d’analyse critique à caractère
linguistico-interprétatif. Nous y reviendrons plus loin.
8 La didactique des langues est un autre champ de recherche au sein duquel le texte
littéraire est étudié à la lumière de son potentiel didactique en classe. Dans cette
optique, le littéraire est, au regard des ressources lexicales, grammaticales et
sémantiques qu’il recèle, considéré comme le point de départ pour l’enseignement-
apprentissage du linguistique. Même s’il n’est représenté que par un taux de 12.62 %
dans cette étude statistique, le champ de la traduction n’est pas du tout étranger au
débat scientifique engagé autour de la relation entre langue et littérature. La prise en
charge de l’opacité culturelle qui sous-tend les écrits littéraires et la gestion des effets
de sens lors du passage de la langue source à la langue cible relèvent de ses principales
préoccupations.
9 Aux sciences du langage est associé le taux le plus faible (9.71 %) des publications
portant sur la relation entre langue et littérature. De notre point de vue, ceci n’est pas
le signe d’un désintérêt pour le littéraire, mais d’une méfiance cultivée par une
organisation en vase clos des domaines de recherche au sein de l’université algérienne.
Ainsi l’étanchéité des frontières disciplinaires favorise-t-elle l’insécurité
épistémologique et, par voie de conséquence, le repli sur soi. Les données consultées
sur la plateforme ASJP révèlent, néanmoins, qu’au sein des sciences du langage, la
Multilinguales, 15 | 2021
8
sociolinguistique et l’analyse du discours sont à l’avant-garde de l’exploration du
littéraire.
Dans les paragraphes qui suivent, nous tâcherons d’exposer plus particulièrement les
leviers épistémologiques dont se sert la sociolinguistique afin de se frayer un chemin
dans le littéraire. Les chiffres maigres enregistrés dans ce cadre témoignent d’une
tendance de recherche qui n’en est qu’à ses débuts. D’où notre désir, à travers cette
contribution, de documenter quelques aspects saillants inhérents à la genèse d’une
réflexion ouverte au dialogue interdisciplinaire. Cependant, avant d’aller plus loin, il
est utile de souligner en quoi les études sociolinguistiques se démarquent des études
littéraires, notamment à travers les apports et les limites de la glottocritique.
3. La glottocritique : apports et limites
10 Dans les études littéraires, la glottocritique apparait comme l’aboutissement de la
réflexion sur la relation entre langue et littérature. Selon Jean Bernabé, cette approche
« définit son projet et sa pratique par référence exclusive à la nature ontologiquement
langagière des textes » (1982 : 85). De plus, celle-ci « intègr[e] dans son propre
mouvement l’analyse d’éléments pertinents de la psychogenèse et de la sociogenèse des
textes » (p. 86). La saisie de la matérialité langagière des textes littéraires permet ainsi
de retracer le processus d’écriture à travers des éléments de repérage d’ordre discursif
qui, dans une certaine mesure, reflètent les intentions du sujet écrivant ainsi que les
conditions dans lesquelles s’exerce l’activité de production littéraire. La finalité de
cette approche n’est ni la description de la langue ni l’essentialisation de celle-ci à
travers le texte littéraire. Au contraire, son objectif est la mise en perspective de
l’œuvre littéraire à travers la langue dans laquelle elle a été élaborée.
11 Même si beaucoup de travaux algériens s’en inspirent, peu d’entre eux se revendiquent
explicitement de son héritage. Encore une fois, il est légitime de supposer que le souci
de rester fidèle à la discipline de référence fait que toute tentative d’interdisciplinarité
peut d’emblée être assimilée à une entreprise vouée à l’ambiguïté théorique. Les
quelques travaux que nous avons consultés proposent des analyses qui n’abordent la
question linguistique que dans un métadiscours métaphorique, construit en termes de
rupture existentielle, de déchirement linguistique, de quête identitaire et
d’engagement intellectuel. Sans être révélateurs de la tendance générale, ces travaux
prennent le plus souvent la forme d’études de cas, consacrées à des œuvres ou à des
auteurs en particulier. Dans l’une de ses publications, Amira Souames (2015) interroge
l’identité du sujet écrivant dans l’œuvre d’Assia Djebar, où la langue française est
utilisée pour dire un monde profondément façonné par l’oralité de l’arabe et du
berbère. Le français ainsi déployé porte donc, en filigrane, les traces de ces deux
langues, sans pour autant renoncer à sa syntaxe ni à sa grammaire. Même s’il
n’intervient que dans cette langue, le sujet écrivant est bel et bien conscient de sa
dimension plurilingue constitutive de son identité. Toujours en relation avec l’œuvre
d’Assia Djebar, Houria Bensalem (2013) met en perspective la dimension linguistique
par rapport à l’acte d’écriture, lui-même envisagé comme étant un investissement dans
la mémoire et l’histoire, notamment celles des femmes de son pays de naissance qui
n’ont accès qu’au code oral pour s’exprimer. Beaucoup d’écrivains algériens ont
également fait l’objet de ce type d’approches. Citons le cas de Malek Haddad qui illustre
bien l’idée selon laquelle la relation entre l’auteur et la langue d’écriture n’est pas
Multilinguales, 15 | 2021
9
toujours évidente. Ce dernier a connu, selon les études qui lui ont été consacrées, tout
autant la fortune que l’infortune dans sa langue d’écriture, le français. D’après Goucem
Nadira Khodja (2013), l’héritage colonial lié à la langue française a conduit cet auteur à
se méfier de la culture que celle-ci véhicule, laquelle est considérée comme une culture
de domination et d’aliénation, et c’est pourquoi elle est souvent contrecarrée par le
recours à la langue des origines dans le processus d’écriture, donnant à l’occasion
naissance à une langue dite « double » (Larbi, 2013).
Des exemples de ce type d’analyses sont multiples. Leur point commun est qu’ils se
donnent davantage la peine d’étudier le prétexte linguistique que le contexte
linguistique. Le prétexte se justifie par des considérations liées à l’intériorisation et à
l’extériorisation de l’expérience langagière par le biais de l’écrit. Par contre, le contexte
se démontre par l’analyse des faits qui gravitent autour de la praxis linguistique telle
qu’elle est mise en œuvre dans et par le texte.
4. Vers un tournant sociolinguistique
12 Ce que nous appelons ici « tournant sociolinguistique » désigne la tendance qui consiste
à rendre compte de la covariance entre langue et société à travers toutes les
manifestations aussi bien formelles que symboliques de la création littéraire. Pendant
longtemps, la langue a été considérée, dans son interaction avec la littérature, soit
comme un système codifié ayant ses propres exigences lexicales et syntaxiques, soit
comme un outil d’expression mis au service de la création. Cette conception binaire
nous renvoie à deux écoles fondamentales, l’école structuraliste et l’école
fonctionnaliste, qui, toutes deux, au-delà de leurs affinités épistémologiques
manifestes, proposent des pistes de réflexion oscillant entre l’étude du bon usage et
l’étude de l’usage tout court. C’est pourquoi, dans de nombreuses situations, la relation
entre langue et littérature est posée uniquement en termes de construction,
d’agencement scriptural, de grammaire textuelle et de style. La part socio-langagière
inhérente à la production littéraire n’a été abordée que tardivement, notamment grâce
à la mise en place d’un nouvel arsenal conceptuel issu de la sociolinguistique. A partir
de là, un changement de paradigme est opéré, donnant lieu à des pratiques de
recherche de plus en plus émancipées. Un article programmatique, co-signé par Aicha
Kassoul et Mohamed-Lakhdar Maougal, est paru dans la revue Insaniyat, comme pour
insister, une bonne fois pour toutes, sur le fait que « c’est au développement de la
sociolinguistique que la critique littéraire […] se doit d’avoir été déchargée d’un
bavardage pseudo scientifique […] auquel rares auront échappé les chercheurs les plus
ou moins avertis » (2002 : 74). Les questions inhérentes à l’usage littéraire de la langue
ont dès lors le mérite d’être abordées loin de tout jugement esthétique et loin de tout
préjugé idéologique.
13 Afin de mieux cerner les orientations de cette sociolinguistique de la littérature, rien ne
nous semble plus approprié, du point de vue méthodologique, que de travailler sur un
corpus qui donne accès aux discours produits par les chercheurs concernés par cette
dynamique. Au cours de notre recherche documentaire, nous avons constaté deux
événements éditoriaux en faveur de la recherche sociolinguistique orientée vers la
littérature. Dans l’une de ses livraisons, la revue Cahiers de linguistique. Revue de
sociolinguistique et de sociologie de la langue française (Blanchet et Taleb-Ibrahimi, 2009) a
consacré toute une section, composée de trois articles, à la dimension sociolinguistique
Multilinguales, 15 | 2021
10
de la littérature algérienne. Un peu plus de trois ans plus tard, c’est au tour de la revue
Socles de consacrer un numéro entier à l’interaction de la littérature avec les milieux
plurilingues (Oucherif et Coste, 2013). Sur la base d’une sélection d’articles publiés dans
ces revues, auxquels nous avons rajouté d’autres articles parus en varia dans d’autres
revues, nous avons constitué un corpus destiné à être soumis à une analyse de contenu.
Ce corpus se compose de neuf articles qui ont en commun le même ancrage théorique
de référence, celui de la sociolinguistique.
14 L’analyse de contenu que nous proposons pour traiter notre corpus vise à dégager les
axes de réflexion sur lesquels s’appuient les chercheurs dans leur démarche explicative
ou compréhensive des faits de langue associés à la pratique littéraire. L’avantage de ce
type d’analyse réside dans le fait qu’il guide l’exploration, l’organisation, la
classification et la catégorisation des thèmes qui traversent le discours scientifique que
nous avons sous les yeux. Patrick Chardenet explique que « [l]’analyse de contenu
focalise sur la notion de thème qui constitue une affirmation sur un sujet […] sous
lequel un vaste réseau de formulations singulières peuvent être affectées » (2011 : 82).
Cette technique consiste en effet à rendre compte de ce que disent les productions
discursives organisées en corpus, en mettant en exergue la trame significative à
l’œuvre. Une grille d’analyse a été conçue pour aiguiller notre travail, celle-ci ayant
pour objectif de faire ressortir à partir de notre corpus les éléments suivants :
l’approche adoptée en matière d’analyse ;
les notions et les concepts théoriques mobilisés ;
les références théoriques sollicitées ;
la nature du corpus analysé ;
et, le cas échéant, la conception du terrain.
Le tableau ci-dessous reprend les informations les plus pertinentes issues de
l’exploration du contenu thématique de notre corpus :
Tableau 1 : Grille d’analyse appliquée au contenu des articles traitant de la relation entre langue etlittérature dans une perspective sociolinguistique
Eléments
d’identification
Approche
analytiqueNotions et concepts
Références
théoriquesCorpus Terrain
Abbes-Kara
(2006)
Approche
praxématique
Diglossie,
pluriglossie,
discours sur la
langue,
minoration,
représentations
R. Lafont
Œuvre
romanesque de
Mouloud
Mammeri
Non
spécifié
Abbes-Kara
(2009)
Analyse lexico-
statistique
Hybridation,
néologisme, bi-
langue
Non
spécifiées
Œuvre
romanesque de
Mohamed Dib
Non
spécifié
Abbes-Kara et
Kebbas (2013)
Analyse
linguistique et
discursive
Ecriture bilingue,
diglossie, discours
épilinguistique,
xénisme, emprunt,
calque, métissage
C. Lagarde
Œuvres de
Mouloud
Mammeri, Assia
Djebar et
Mohamed Dib
Non
spécifié
•
•
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
11
Benbachir
(2012)
Analyse
séquentielle de
la biographie
langagière
Bilinguisme,
répertoire verbal,
diglossie
Ch.
Perrégaux,
Ch. Deprez, J.
Gumperz
Récit
autobiographique
de Soumya
Ammar-Khodja
Non
spécifié
Benbachir
(2017)
Analyse
thématique de
la biographie
langagière
Plurilinguisme,
mobilité
linguistique
A. Gohard-
Radenkovic,
E. Murphy-
Lejeune
Entretiens
biographiques
Non
spécifié
Chiraz et
Temim (2018)Argotologie
Argot, verlan,
pratiques
langagières,
fracture
linguistique
J.-P.
Goudailler
Le roman
Boumkœur de
Rachid Djaidani
Allusion
au
terrain
urbain
Hamadache
(2019)
Grille d’analyse
notionnelle
Contact de langues,
bilinguisme,
diglossie,
alternance codique,
mélange de codes,
interférence
linguistique
M. L.
Clément, Ch.
Kossogorova
Contes populaires
écrits en français
Non
spécifié
Kebbas (2009)Grille d’analyse
thématique
Ecriture bilingue,
diglossieC. Lagarde
Œuvre
romanesque de
Mouloud
Mammeri
Non
spécifié
Taleb-
Ibrahimi
(2009)
Analyse
thématique
Métissage,
bilinguisme
Non
spécifiées
Entretiens
journalistiques
Non
spécifié
Les informations exposées dans ce tableau nous serviront à étayer notre analyse,
notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles se présente la
sociolinguistique de la littérature dans le contexte universitaire algérien. Seront ainsi
explicités les enjeux théoriques et les positionnements épistémologiques relatifs à son
objet d’étude, à son corpus de prédilection et à son terrain d’investigation.
5. Une conception sociolinguistique de la littérature
15 Il y a lieu de noter que, dans leur majorité, les articles consultés jusque-là ne se
risquent pas à donner une définition toute faite de la littérature, celle-ci n’étant bien
évidemment pas leur objet d’étude de base. Le vague plane encore sur ce qu’est la
littérature en sociolinguistique. Et pourtant, sur l’ensemble des textes étudiés, le mot
« littérature » revient 48 fois6. Quand il ne se présente pas seul, ce mot est associé soit à
un qualificatif d’ordre géographique (littérature algérienne, littérature maghrébine),
soit à un qualificatif d’ordre linguistique (littérature francophone, arabophone, etc.). Ce
Multilinguales, 15 | 2021
12
qui témoigne, de manière assez évidente, de la territorialisation de la littérature par le
biais de la langue et, en même temps, de l’appropriation de la langue par la littérature.
16 Selon les propos de Khaoula Taleb-Ibrahimi, la littérature, du moins dans le contexte
algérien, va de pair avec « la publication d’un nombre non négligeable de recueils
poétiques, de nouvelles et de romans » (2009 : 239). Il s’agit donc d’un acte de création
qui prend des formes multiples, où la prose côtoie les vers, et dont l’existence propre
dépend de l’implication des instances éditoriales. Cette conception nous éloigne de
l’univers du texte pour nous rapprocher un peu plus de celui de l’œuvre. Si le texte
résulte de la somme des signes qui le composent et des procédés par lesquels il est
construit, l’œuvre, par contre, nous renvoie à l’environnement dans lequel s’exerce
l’acte d’écriture.
17 Attika-Yasmine Abbes-Kara en propose une autre définition formulée ainsi : « [L]a
littérature est une pratique langagière qui s’investit d’un contenu social, qu’elle est
également dialogique du fait qu’il n’y a pas de message tout à fait transmis par l’un et
l’autre mais une interaction verbale » (2006 : 27). A partir de là, l’accent est mis sur le
fait que la littérature fait interagir des formes linguistiques avec un contenu social. En
tant que pratique, elle implique une instance auctoriale, une assise textuelle, un
ancrage contextuel et, au bout de la chaine, une instance réceptrice. Tous ces éléments
sont appelés à entrer dans une relation dialogique les uns avec les autres. Le texte
devient ainsi indissociable du contexte dans lequel il a été conçu ainsi que du contexte
qu’il conçoit. Il en va de même pour l’auteur et le lecteur qui se laissent, l’un comme
l’autre, entrainer dans une forme de communication interactive qui n’est pas
forcément traçable.
18 Alors, contrairement à la glottocritique qui s’intéresse à la littérature à travers la
langue, la sociolinguistique emprunte le chemin inverse, en ce sens qu’elle s’intéresse à
la langue à travers la littérature. Et là encore, il faut préciser qu’elle ne s’intéresse pas à
la langue dans sa forme et encore moins à travers ses mécanismes de déploiement au fil
de la plume. Elle s’y intéresse à travers la dimension sociale et factuelle que son usage
en littérature laisse entrevoir.
6. Caractéristiques sociolinguistiques des corpuslittéraires
19 Indépendamment de sa nature générique, tout texte littéraire recèle, aussi bien en
dedans qu’en dehors, des phénomènes langagiers susceptibles d’être examinés à la
lumière des apports théoriques de la sociolinguistique. Dans une certaine mesure, les
corpus littéraires véhiculent un potentiel documentaire qui renseigne sur des pratiques
linguistiques visibles et lisibles dans et/ou à travers le texte. Dans le texte sont
repérables les procédés liés à l’usage de la langue à des fins littéraires. A travers le texte
sont repérables les normes et les attitudes qui sous-tendent l’usage en question.
20 Il est à remarquer que, dans les travaux que nous avons consultés, le débat ne tourne
plus autour de ce qu’est la langue en littérature ni de ce qu’est la langue pour la
littérature. Il se trouve que ces questions, comme nous l’avons déjà mentionné plus
haut, ont largement été abordées dans des recherches antérieures d’inspiration
glottocritique. C’est désormais la nature discursive des corpus littéraires qui interpelle
les chercheurs versés en sociolinguistique, et c’est aussi le contexte des œuvres
Multilinguales, 15 | 2021
13
littéraires qui leur donne à réfléchir, notamment sur la relation entretenue, en amont
et en aval, par le sujet écrivant avec sa langue d’écriture ainsi qu’avec les éventuelles
langues de son répertoire verbal (Benbachir, 2012 ; 2017). La production littéraire a
comme point de départ la position à partir de laquelle l’instance auctoriale signe ses
écrits et comme point d’arrivée la position occupée par l’instance réceptrice. Cela
explique la tendance de certains chercheurs à intégrer dans leurs travaux les discours
tenus en dehors du texte, mais qui sont dialogiquement reliés au texte. Ainsi, les
déclarations publiques et les interventions médiatiques des auteurs sont, comme le
démontre Khaoula Taleb-Ibrahimi (2009), porteuses de renseignements d’ordre
sociolinguistique qui expliquent les choix littéraires effectués par les uns et les autres.
21 Afin de vérifier l’hypothèse selon laquelle les multiples écrits d’un seul auteur ou les
écrits d’un collectif d’auteurs appartenant à la même génération se télescopent et se
recoupent par endroits, certains chercheurs, à l’instar de Attika-Yasmine Abbes-Kara et
Malika Kebbas (2013) privilégient d’interroger plusieurs œuvres à la fois dans l’espoir
de dégager des pratiques linguistiques en rapport avec un mode de socialisation
langagière influencé par le contexte tant social que littéraire. Qu’il s’agisse du contexte
colonial ou du contexte postcolonial, les usages linguistiques dans la littérature
algérienne portent les traces d’une pluralité linguistique différemment mise en texte.
22 La mise en texte de la pluralité linguistique donne à voir des phénomènes qui
s’inscrivent dans le registre du contact des langues (Hamadache, 2019), de la mobilité
linguistique (Benbachir, 2017) ou de la créativité langagière (Chiraz et Temim, 2018).
Les concepts de bilinguisme, de diglossie et d’alternance codique ont ceci d’original
qu’ils mettent l’accent sur les rapports instaurés entre les langues dans et par la
littérature. Dans le même ordre d’idées, l’analyse des discours épilinguistiques (Abbes-
Kara, 2006 ; Kebbas, 2009), c’est-à-dire ceux tenus sur les langues au sein même des
écrits littéraires, permet de mettre en évidence la spécificité des rapports entretenus à
l’égard des langues par le biais de la composition littéraire.
7. La littérature comme terrain d’investigation
23 La sociolinguistique a pour vocation de se saisir de la langue en acte, et c’est la raison
pour laquelle elle a longtemps été conçue comme une « linguistique de terrain »
(Blanchet, 2012). Une chose est sûre est que la littérature n’est pas directement l’objet
d’étude de la sociolinguistique ; elle n’en est qu’un terrain d’investigation. Cette
affirmation nous invite à reconsidérer la notion de terrain et à en expliquer les
particularités heuristiques.
24 Des neuf articles que nous avons analysés, aucun d’eux ne fait explicitement référence
à la notion de terrain. Par contre, la notion de contexte y est fréquemment évoquée. Ce
n’est qu’au prix d’un effort de déduction qu’il est possible d’apercevoir entre les lignes
le reflet d’un terrain à peine circonscriptible. Se voulant assez illustratif à ce sujet,
l’article de Hakim Chiraz et Dalida Temim (2018) met en relation, à travers l’analyse du
roman Boumkœur de Rachid Djaidani, les pratiques langagières dites argotiques avec le
terrain urbain au sein duquel elles surgissent.
A vrai dire, ce n’est pas le terrain en lui-même qui est complètement aboli dans ces
études, mais c’est plutôt l’enquête de terrain, au sens ethnographique du terme, qui est
délaissée au profit d’une investigation de type documentaire. Aux corpus
traditionnellement sollicités se sont succédé des corpus prêts à l’emploi, ceux-ci étant
Multilinguales, 15 | 2021
14
directement puisés dans des œuvres littéraires de divers genres ou dans des entretiens
accordés par des auteurs à la presse.
25 Dans l’absolu, il n’est pas exclu que la « sociolinguistique [soit] appliquée à un objet
pour lequel un terrain n’est guère envisageable, ou bien change complètement de sens »
(Gasquet-Cyrus, 2015 : 20). Nous sommes exactement dans ce cas de figure avec la
sociolinguistique de la littérature, dans la mesure où le terrain ne correspond plus ici à
un espace géographique susceptible d’être parcouru à l’aide d’une méthodologie
artisanale. Dans cette perspective, la littérature représente à elle seule un espace de
création multiforme impliquant une série d’interactions entre divers acteurs situés à
des niveaux différents sur la chaine de production, de diffusion et de consommation. En
tant que telle, la littérature est aussi le siège de libertés et de contraintes, observables
dans le texte et en dehors du texte. Et c’est à ce titre, justement, qu’elle se prête au jeu
de l’exploration et de l’investigation sociolinguistique.
26 Au terme de cette réflexion, il convient de souligner qu’en réponse aux questions que
nous nous sommes posées au tout début, nous avons de fil en aiguille abouti à ces
conclusions :
la littérature est envisagée en sociolinguistique comme une pratique étroitement liée à un
contexte de production et de circulation, et surtout comme une pratique qui fait interagir
des formes linguistiques fluctuantes avec un contenu socialement marqué ;
la littérature est le siège de phénomènes sociolinguistiques qui se déploient sur deux
principaux axes, celui des rapports instaurés entre les langues et celui des rapports
entretenus à l’égard des langues ;
la littérature n’est pas à proprement parler un objet d’étude pour la sociolinguistique mais
un terrain d’investigation à entrée textuelle.
27 Ces trois conclusions sont révélatrices des présupposés épistémologiques qui guident
les travaux effectués dans le cadre de la sociolinguistique de la littérature. L’intérêt
d’une telle approche réside dans le fait que celle-ci contribue, par-delà les frontières
disciplinaires traditionnelles, à une meilleure compréhension des relations complexes
entre langue et littérature.
BIBLIOGRAPHIE
ABBES-KARA, Attika-Yasmine, « Le roman algérien en situation de pluriglossie », buḥuṯ simyaʾiya,
1/2, 2006, pp. 27-37. Disponible sur [https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26108] (consulté le
24/12/2020)
ABBES-KARA, Attika-Yasmine, « Du métissage littéraire au métissage culturel et linguistique. Le
cas de Mohamed Dib », Cahiers de linguistique. Revue de sociolinguistique et de sociologie de la langue
française, 34/1, 2009, pp. 217-226.
ABBES-KARA, Attika-Yasmine, KEBBAS, Malika, « Pour une problématisation des "écritures
bilingues" dans la littérature francophone algérienne », Socles, 2, 2013, pp. 21-36. Disponible sur
[https://www.asjp.cerist.dz/en/article/2636] (consulté le 19/07/2020)
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
15
BENBACHIR, Naziha, « Le bilinguisme dans le récit autobiographique de Soumya Ammar-
Khodja », Revue Annales du patrimoine, 12, 2012, pp. 7-17. Disponible sur [https://
www.asjp.cerist.dz/en/article/39193] (consulté le 03/01/2021)
BENBACHIR, Naziha, « L’expérience plurilingue chez les écrivains du bassin méditerranéen : une
cartographie des langues et des mobilités », Insaniyat, 77-78, 2017, pp. 123-140. Disponible sur
[https://www.asjp.cerist.dz/en/article/87572] (consulté le 25/07/2020)
BENSALEM, Houria, « La problématique de la langue et de l’écriture chez Assia Djebar », El-khitab,
16, 2013, pp. 271-276. Disponible sur [https://www.asjp.cerist.dz/en/article/21682] (consulté le
13/03/2020)
BERNABE, Jean, « Contribution à une approche glottocritique de l’espace littéraire antillais », La
Linguistique, 18/1, 1982, pp. 85-109.
BLANCHET, Philippe, La linguistique de terrain, méthode et théorie. Une approche ethnosociolinguistique
de la complexité, PUR, Rennes, 2012.
BLANCHET Philippe, « Pensée complexe ou objet complexe ? Sur les enjeux épistémologiques de
la complexité en linguistique et sociolinguistique », Cahiers internationaux de sociolinguistique n° 7,
2015, pp. 57-74.
BLANCHET, Philippe & TALEB-IBRAHIMI, Khaoula (dir.), « Le plurilinguisme maghrébin :
comparaison de pratiques sociales ordinaires, techniques, didactiques et littéraires en Algérie, au
Maroc et en Tunisie », Cahiers de linguistique. Revue de sociolinguistique et de sociologie de la langue
française, 34/1, 2009.
BOUTET, Josiane, La vie verbale au travail. Des manufactures aux centres d’appels, Octares, Toulouse,
2008.
CALVET, Louis-Jean, Les voix de la ville, introduction à la sociolinguistique urbaine, Payot, Paris, 1994.
CHARDENET, Patrick, « Les principales méthodes et leurs techniques de construction des
observables. L’échange avec les acteur comme méthode de production des données [entretiens et
groupes de discussion] », dans BLANCHET, Philippe, CHARDENET, Patrick (dir.), Guide pour la
recherche en didactique des langues et des cultures. Approches contextualisées, AUF/Editions des
archives contemporaines, Paris, 2011, pp. 77-91.
CHIRAZ, Hakim & TEMIM, Dalida, « L’argot des jeunes des cités dans le roman Boumkœur de
Rachid Djaidani », Revue algérienne des sciences du langage, 3/1, 2018, pp. 101-113. Disponible sur
[https://www.asjp.cerist.dz/en/article/59478] (consulté le 05/01/2021)
DABENE, Louise, Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues. Les situations plurilingues,
Hachette, Paris, 1994.
GADET, Françoise, La variation sociale en français, Editions Ophrys, Paris, 2007.
GASQUET-CYRUS, Médéric, « "Je vais et je viens entre terrains" Réflexions sur le terrain dans la
théorisation sociolinguistique », Langage et Société, 154, 2015, pp. 17-32.
GAUVIN, Lise, La fabrique de la langue. De François Rabelais à Réjean Ducharme, Editions du Seuil,
Paris, 2004.
GUMPERZ, John, Engager la conversation. Introduction à la sociolinguistique interactionnelle, Minuit,
Paris, 1989.
HAMADACHE, Tahar, « Contacts de langues et/ou de cultures dans les contes populaires écrits en
langue française », Multilinguales, 7/2, 2019, pp. 166-189. Disponible sur [https://
www.asjp.cerist.dz/en/article/109956] (consulté le 26/12/2020)
Multilinguales, 15 | 2021
16
KASSOUL, Aicha & MAOUGAL, Mohamed-Lakhdar, « Actancialiser ou déconstruire », Insaniyat,
17-18, 2002, pp. 71-77.
KEBBAS, Malika, « Sociolinguistique et littérature algérienne francophone. L’écriture bilingue
dans l’œuvre romanesque de Mouloud Mammeri », Cahiers de linguistique. Revue de sociolinguistique
et de sociologie de la langue française, 34/1, 2009, pp. 227-238.
KHODJA, Goucem Nadira, « Une écriture entre deux langues. Contraintes et enjeux de l’entre-
deux chez Malek Haddad », Socles, 2, 2013, pp. 97-108. Disponible sur [https://www.asjp.cerist.dz/
en/article/2641] (consulté le 19/07/2020)
LARBI, Chérifa, « La langue "double" chez Malek Haddad », Socles, 2, 2013, pp. 109-119. Disponible
sur [https://www.asjp.cerist.dz/en/article/2642] (consulté le 19/07/2020)
MORIN, Edgar, Introduction à la Pensée Complexe, Paris, ESF, 1990.
OUCHERIF, Lamia & COSTE, Claude (dir.), « L’invention d’une langue littéraire dans un milieu
plurilingue », Socles, 2, 2013.
PIAGET, Jean, Logique et connaissance scientifique, Gallimard, Paris, 1967.
SIMONIN, Jacky & WHARTON, Sylvie, « Sociolinguistique des contacts de langues. Un domaine en
plein essor », dans SIMONIN Jacky & WHARTON Sylvie (dir.), Sociolinguistique du contact.
Dictionnaire des termes et concepts, ENS Editions, Lyon, 2013, pp. 13-18.
SOUAMES, Amira, « Identité du sujet écrivant au carrefour des langues dans l’œuvre d’Assia
Djebar », Al-bâhith, 14, 2015, pp. 12-25. Disponible sur [https://www.asjp.cerist.dz/en/article/
25266] (consulté le 19/07/2020)
TALEB-IBRAHIMI, Khaoula, « Ecrire dans la langue de l’autre, écrire entre les langues. Plaidoyer
pour le métissage littéraire », Cahiers de linguistique. Revue de sociolinguistique et de sociologie de la
langue française, 34/1, 2009, pp. 239-246.
NOTES
1. Il faut entendre ici par épistémologie ce que Jean Piaget décrit comme étant « l’étude de la
constitution des connaissances valables » (1967 : 6). Alors que le savoir en tant qu’ensemble de
propositions à valeur synthétique ou analytique, organisées en notions et en concepts, nous
renvoie à la théorie, le savoir tel qu’il est pensé et élaboré nous renvoie à l’épistémologie.
2. L’ASJP (Algerian Scientific Journal Platform) est un portail électronique destiné à la mise en
ligne du contenu des revues scientifiques affiliées à des établissements universitaires algériens.
Placé sous la responsabilité du Centre de recherche sur l’information scientifique et technique
(CERIST), ce portail est en libre accès via le lien : [https://www.asjp.cerist.dz]. Les données qu’il
permet d’explorer témoignent de la dynamique scientifique ayant cours, notamment en matière
production, dans le contexte algérien.
3. La recherche par mots-clés a été effectuée en français. Cette manière de procéder ne présente
aucun risque quant à la fiabilité des résultats obtenus, puisque, indépendamment de la langue de
rédaction utilisée dans le corps du texte, la plupart des revues algériennes exigent que les
résumés et les mots-clés associés aux articles publiés soient notés en français.
4. L’identification de ces champs de recherche repose ici sur leur dénomination institutionnelle.
5. Pour plus de détails sur ces chiffres, voir Annexes.
6. Le calcul des occurrences a été effectué par l’intermédiaire du logiciel Tropes (version 8.4.4).
Précisons encore que l’adjectif « littéraire » est, pour sa part, mentionné dans 49 endroits
différents dans le corpus, en référence à une activité de production à caractère scriptural.
Multilinguales, 15 | 2021
17
RÉSUMÉS
L’objectif de cet article est de reconstituer, à partir de quelques travaux scientifiques algériens,
les fondements épistémologiques d’une sociolinguistique de la littérature qui se veut en pleine
émergence. Dans un premier temps, nous avons tenu à souligner la prédisposition de la
sociolinguistique à travailler sur des terrains hétérogènes, juste parce que la question de l’usage
de la langue y est posée. Nous avons ensuite, à l’aide d’une étude quantitative basée sur des
données bibliométriques, fait en sorte de situer les travaux sociolinguistiques orientés vers la
littérature par rapport à l’ensemble de la production scientifique qui traite de la relation entre
langue et littérature. Enfin, nous avons approfondi notre analyse par une étude qualitative
portant sur le contenu des publications qui s’inscrivent dans le cadre de la sociolinguistique de la
littérature.
On the basis of Algerian research studies, this article aims to reconstitute the epistemological
underpinnings of the sociolinguistics of literature, whose emergency is in full swing. First, the
researcher highlights the tendency of sociolinguistics to cover heterogeneous fields, given that it
raises the question of language usage. Furthermore, a quantitative approach, based on
bibliometric data, was adopted to examine literature-oriented sociolinguistics in relation to
academic publications that study the nexus between language and literature. Finally, the
researcher broadened the analysis through a qualitative study of the content of academic work
which fall under which fall within the framework of the sociolinguisitcs literature.
INDEX
Mots-clés : épistémologie, glottocritique, langue, littérature, sociolinguistique
Keywords : epistemology, glottocriticism, language, literature, sociolinguistics
AUTEURS
MOKHTAR BOUGHANEM
Université d’Alger 2, Laboratoire LISODIL, Algérie
HASSIBA BENALDI
Université d’Alger 2, Laboratoire LISODIL, Algérie
Multilinguales, 15 | 2021
18
Recherche en littérature écrited’expression amazighe : état deslieux et typologie des discourscritiquesResearch in written literature of Amazigh expression: state of the art and
typology of critical discourses
Salim Ayad
1 Depuis les premiers travaux inaugurés à l’étranger, notamment en France, la recherche
dans le domaine de la littérature écrite en tamazight ne cesse de se développer. Les
travaux de Chaker (1987,1992, 2006) et, ensuite, ceux d’Abrous (1989) ont posé les jalons
d’un discours nouveau jusqu’ici inexistant dans le camp des études berbères.
2 Ce discours tel qu’il est formulé à ces débuts se veut, essentiellement, un regard sur
l’ensemble des facteurs socio-historiques ayant contribué à l’émergence d’une
littérature écrite, considérée comme l’aboutissement d’une dynamique culturelle
enclenchée depuis le début du vingtième siècle par les instituteurs kabyles (la chaîne
dite des culturalistes), qui ont donné à la langue, à la littérature, et à la culture berbère
un nouvel essor (Chaker, 1987 :14). Il se veut également un regard sur les propriétés
linguistiques des textes produits dans cette littérature, caractérisées par les calques
lexicaux et sémantiques. Mais aussi par des néologismes (Abrous, 1989 : 81), ainsi que
des problèmes de la transcription de cette littérature, puisque le berbère manquait d’un
système d’écriture.
3 Quelques temps après, toujours en France, d’autres travaux viennent consolider cette
tradition « naissante ». Le mémoire de Maitrise d’Ibrahim (1997) portant sur la vie et
l’œuvre de Belaid At Ali1, s’inscrivent dans la ligne droite des réflexions amorcées par
ces prédécesseurs, mais ce discours critique s’est confirmé avec les DEA de Belgasmia
(2001) et celui d’Ameziane (2002). A partir de là, les études sur la littérature écrite ont
pris un nouvel essor. Elles se sont détachées d’une manière remarquable des premières
réflexions. Car, même si l’esprit de leurs prédécesseurs est présent dans leurs travaux,
Multilinguales, 15 | 2021
19
étant leurs réflexions s’inscrivent dans la perspective du processus du « passage à
l’écrit » (Chaker, 1992 :2), ces deux études ont eu le mérite d’aborder le contenu des
œuvres écrites en kabyle. En effet, les deux auteurs se sont attelés à montrer les
propriétés internes des œuvres en décrivant les procédés d’écriture, le redéploiement
des genres oraux dans des textes modernes et les différences de styles entre les textes
oraux et les textes écrits.
4 Ces mêmes réflexions ont été approfondies par Ameziane (2004,2006) et, ensuite, dans
sa thèse de doctorat (2008), dans laquelle il a examiné un corpus plus vaste en adoptant
des méthodes de la critique littéraire telles que l’intertextualité et la mythocritique.
Ainsi, ce discours prend enfin forme et explore des horizons jusqu’ici ignorés par le
discours critique ayant pour objet la littérature écrite.
5 Ce regard furtif que nous venons de jeter sur les prémices de ce discours n’est, en
réalité, que d’ordre indicatif. Car ces travaux nécessitent à eux seuls, tenant compte des
conditions dans lesquelles ont vu le jour et leur intérêt dans la constitution d’un champ
d’études nouveau, une étude particulière. Cependant, en Algérie, avec les changements
qui se sont produits concernant la condition du tamazight dès le début des années 1990
jusqu’aux évolutions récentes, les choses ont beaucoup évolué dans les aspects
touchant à la création écrite et aux études littéraires.
6 Dès lors, la relative effervescence qu’a connu la production littéraire écrite2 a constitué
un véritable champ d’investissement pour les chercheurs, et il suffit de jeter un coup
d’œil sur les travaux réalisés dans ce domaine pour constater l’engouement de la
recherche à ce nouveau champ d’étude. Désormais, des recherches de tous types ont
abordé cette littérature : mémoires de magistère, articles scientifiques, thèses de
doctorat. Soulignons de passage que des dizaines de mémoires de fin d’études de
licence ancien régime et master, qui instituent à une critique littéraire universitaire,
ont été réalisés dans les différents départements de Langue et Culture Amazighes.
Tandis que le discours critique se consolide, au fur et à mesure que cette veine littéraire
évolue, ses orientations se sont diversifiées en multipliant les méthodes et les corpus
étudiés. Mais la question qui nous préoccupe ici est la suivante : Qu’on est-il de ce
discours et de ses orientations ? Quelles lectures peut-on en tirer de ces recherches ?
7 Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce discours se constitue, en partie, par le recours aux
différentes méthodes de la critique littéraire, ce qui a permis d’inscrire les
problématiques des recherches dans des cadres théoriques stricts. Les unes
s’intéressent au contexte des œuvres et le cheminement historique de leur réception,
d’autres s’attaquent aux contenus des œuvres, à leurs structures narratives, et d’autres
inscrivent cette littérature dans sa relation à la littérature orale. Comme il y a d’autres
qui portent sur les thèmes et l’imaginaire ou encore sur la classification générique des
œuvres que cette littérature a produites.
8 Mais avant d’aller plus loin dans notre propos, des précisions concernant cette notion
de discours critique s’imposent. Dans notre cas, ici considéré, par discours critique
nous entendons l’ensemble des discours théoriques ayant pour objet l’œuvre littéraire
et plus généralement la littérature. À cet égard, les réflexions esquissées par Todorov
(2002) et Compagnon (2002), semblent répondre suffisamment à nos besoins dans cette
étude. En effet, dans leurs tentatives de circonscrire les grandes orientations du
discours sur la littérature Todorov et Compagnon, chacun de son côté, ont proposé des
typologies des grandes tendances qu’ont connu les études littéraires au 20em siècle.
Todorov emploie le terme de poétique pour désigner les discours sur la littérature et les
Multilinguales, 15 | 2021
20
œuvres, au sein duquel il distingue deux grands discours, bien qu’ils soient
complémentaires, l’un porte sur les ouvres et l’autre porte sur l’objet littérature. C’est ce
que nous pouvons lire dans ce commentaire :
Dès sa naissance, ce discours n’est pas un, quant à sa finalité et ses formes, maisprend deux directions différentes : ce sont l’exégèse et la théorie. […]Le discoursexégétique emprunte depuis les origines deux chemins séparés : d’une part,l’exégèse littérale, qui consiste à élucider le sens de tel mot incompréhensible, defournir des références à telle allusion, d’expliquer une telle constructionsyntaxique ; de l’autre, l’exégèse allégorique, qui cherche un sens autre à un texte(ou à un segment de texte) qui en a déjà un. […]L’objet de la théorie littéraire, enrevanche, change radicalement d’une époque à une autre […]. (Todorov, 2001 : 601).
9 Chez Compagnon, on trouve une autre catégorisation de ce discours. D’ailleurs, lui, à la
place de poétique il emploie l’expression critique littéraire pour désigner l’ensemble des
méthodes des études littéraires. A ce propos, il écrit :
L’expression « critique littéraire » recouvre aujourd’hui deux activités relativementautonomes. Elle désigne d’une part les comptes rendus de livres dans la presse, à laradio, à la télévision : parlons ici de « critique journalistique ». Elle renvoie d’autrepart au savoir sur la littérature, aux études littéraires : parlons cette fois de« critique universitaire » ou « didactique ». (Compagnon, 2001 : 430).
10 De notre côté, c’est à la critique dite universitaire que nous nous intéressons ici, en
commençant d’abord par délimiter son objet. La critique universitaire se veut une
critique scientifique et érudite, à l’université, disait Compagnon
« on fait de la recherche sur la littérature, on décrit, on analyse, on interprète, etl’on dépend des jugements littéraires des autres, ou de soi-même comme autre ».(op, cit : 431).
11 Dans cette dernière, les études littéraires sont regroupées en cinq grands modèles que
nous résumons comme suit :
Les modèles contextuels ou explicatifs : dans ce modèle sont classées la sociologie
littéraire, la philologie, l’histoire littéraire, la sociologie et la psychanalyse de la
littérature, la psychocritique ;
Les modèles profonds ou interprétatifs : où sont rangées la critique biographique, la
critique créatrice, la critique des thèmes, de la conscience et des profondeurs ;
Le modèle existentialiste : La critique existentialiste a préservé les notions d’individu et
de subjectivité promues par les écrivains eux-mêmes ;
Les modèles textuels ou analytiques : où sont classées la linguistique saussurienne, le
formalisme russe, le New Criticism, le structuralisme, la sémiotique, la poétique et la
narratologie, la stylistique et la tropologie ;
Les modèles « gnostiques » ou indéterminés : l’esthétique de la réception (lecture), la
déconstruction (pluralité des sens), le dialogisme et l’intertextualité, le féminisme, le
matérialisme culturel ;
12 En réalité, des répartitions comme celles proposées par Todorov et Compagnon fusent
de partout. Beaucoup d’ouvrages traitent de cette classification, dans le but de baliser
les grandes orientations des études littéraires, sans pour autant réussir à dessiner des
frontières nettes entre les unes et les autres. Ce qu’il y a à retenir de cette aporie est
que des consensus autour d’une classification sont loin d’être trouvés, et tant que les
études littéraires évoluent on trouvera davantage de désaccords, mais aussi de points
communs. Mais pour des raisons méthodologiques et dans le but de cerner les grandes
orientations prises par les études sur la littérature écrite amazighe, nous retiendrons la
Multilinguales, 15 | 2021
21
classification de Compagnon, et nous comptons nous en inspirer afin de dégager notre
propre typologie.
13 Il n’est certes pas de mon propos d’examiner l’ensemble des paramètres qui font de ce
texte un prisme de l’entière condition socio-historique ayant pris part à l’émergence de
ce discours. Les principaux d’entre eux ont été mis au jour par la critique : rapport à la
langue, impact culturel, revendication identitaire. Autant de traits constitutifs qui,
incontournables dans une recherche comme la nôtre, ne me retiendront pas ici.
Néanmoins, cette contribution s’attachera à passer en revue l’ensemble des études
ayant pour objet la littérature écrite d’expression amazighe. Cet examen tel qu’il se
décline aujourd’hui s’appuie, principalement, sur les intitulés et les problématiques
traitées dans chaque travail. Une fois décrites et commentées, ces critiques seront
regroupées en catégories.
1. La littérature écrite en tamazight et sa critique
14 Dans ce qui suivra, nous nous consacrerons à exposer l’essentiel de ce que la critique a
produit comme discours dans le domaine de la littérature écrite d’expression amazighe.
À cet effet, on notera que certains travaux, par souci purement méthodologique, seront
exclus, par contre nous comptons les inclure dans la bibliographie de cette étude afin
de donner une meilleure visibilité sur l’ensemble des travaux réalisés dans ce domaine.
Pour une meilleure lecture, nous avons préféré procéder par domaine d’études afin de
pouvoir inscrire chacune d’entre elles selon le cadre théorique dans lequel elle s’inscrit.
1.1. Critique sociologique et histoire littéraire
15 Sous cette appellation sont regroupés les travaux ayant pour problématique la
littérature écrite dans sa relation à la société. La préoccupation majeure des auteurs de
ces travaux est les conditions d’existence de cette littérature telles que les problèmes
d’édition et de diffusion, le problème de la nomenclature du nouveau système
générique, ainsi que l’effet de la situation sociolinguistique sur la littérature kabyle et
le profil des écrivains de cette veine littéraire. Cette orientation de la recherche a été
amorcée par Salhi (2006, 2008, 2014).
16 Le regard de Salhi porte sur les problèmes que rencontre l’édition du roman amazigh et
le problème de l’appellation Ungal (« Roman ») et l’impact de la situation
sociolinguistique et de l’espace littéraire algérien sur les œuvres écrites en kabyle, en
revanche l’intérêt de Chemakh (2010) s’oriente vers les conditions dans lesquelles les
auteurs de la nouvelle veine littéraire produisent leurs œuvres. Il a cherché, plus
précisément, à comprendre comment des écrivains qui n’ont reçu aucune scolarisation
dans leur langue maternelle ont acquis les compétences linguistiques et littéraires
nécessaires à toute création littéraire. Il confirme que certains écrivains ont appris à
écrire en dehors de l’institution scolaire, par des apprentissages individuels et d’autres
auteurs tels A. Mezdad, S. Sadi ont suivi les cours que donnait M. Mammeri à
l’Université d’Alger jusqu’à ce que ces derniers soient interdits en 1973. En dehors de
ces cours un bon nombre d’auteurs, selon les propos de Chemakh, ont appris à écrire le
kabyle en caractères latins sans suivre le moindre enseignement du kabyle.
17 Salhi et Sadi (2016) ont présenté un état des lieux du roman d’expression berbère. Ils
ont examiné des romans écrits aussi bien en berbère marocain (chleuh et rifain) qu’en
Multilinguales, 15 | 2021
22
berbère algérien (kabyle). Ils ont dressé ce panorama sous trois angles différents. Le
premier aborde les conditions d’émergence de l’écriture romanesque en berbère en
l’incluant dans le grand « champ littéraire maghrébin » et « par rapport aux romans
d’expression arabe et d’expression française et en caractérisant les motivations qui
l’ont favorisé ». Dans cet axe, il a été question des conditions sociopolitiques et
culturelles dans lesquelles évolue le roman d’expression berbère. Le second est
consacré au traitement du corpus qui compose le genre romanesque en berbère en
tentant de situer ses conditions éditoriales. La troisième et dernière partie expose les
grandes tendances thématiques.
18 Ce regard sociologique sur la littérature écrite, on aura remarqué, a beaucoup évolué
dans le temps. Au cours des dernières années, il a pris une autre direction, qui est celle
de l’histoire littéraire. C’est dans cette perspective que s’inscrit la thèse de Bellal (2020)
qui a essayé par le biais de l’étude des caractéristiques de l’écriture de Belaid At Ali de
retracer l’histoire de sa réception.
1.2. Critique sémiotico-narrative
19 Les travaux de recherches qu’on peut ranger dans cette catégorie se sont intéressés,
particulièrement, à la description des différentes techniques narratives employées par
les auteurs des œuvres écrites. Le point commun de ces travaux c’est qu’ils s’inscrivent
tous dans le même cadre théorique à savoir la narratologie et la sémiotique du récit
développées, notamment, par Genette et Greimas. C’est ce qu’on peut constater chez
Berdous (2001), Achili (2002, 2015), Hacid (2007) et Bourai (2007).
20 D’autres études s’inspirant des approches narratologiques et sémiotiques du texte
littéraire, mettent l’accent sur des aspects non traités jusque-là. C’est ce que nous
constatons dans l’étude de Boudia (2012), de deux nouvelles de Mezdad extraites du
recueil Tuɣalin ( =« le retour »). L’objet de cette étude a porté sur la narration dans les
deux récits, l’espace et le temps ainsi que les personnages. Il a aussi abordé la
thématique des deux nouvelles dans leurs liens à la réalité vécue par l’auteur et sa
société. Bellal dans son magistère (2012) a étudié trois romans de Amer Mezdad : Iḍ d
wass ( = « Le jour et la nuit »), Tagrest urɣu ( =« Hiver brûlant »), et Ass-nni ( = “ce jour-
là). C’est une recherche qui porte, à la fois, sur le rapport entre les personnages le
contenu textuel des trois romans, ainsi que la signification que procure chaque
personnage à chaque texte. Il a aussi abordé les personnages des trois romans dans
leurs liens à la réalité vécue par l’auteur et sa société.
21 Une tentative d’analyse sémiotique des trois romans de Mezdad, Achili (2013), a montré
les différentes situations conflictuelles dans lesquelles se trouvent les personnages. Par
cette approche, elle a essayé de dégager la signification de chaque situation en
confrontant les personnages aux objets. À travers cette analyse, l’auteur explique la
relation des œuvres à leur ancrage sociopolitique et culturel.
1.3. Critique intertextuelle
22 L’étude de la filiation qu’il y a entre les œuvres littéraires relevant de celle de la veine
écrite et celles de l’oralité a fait l’objet d’étude d’un certain nombre de travaux
universitaires qui ont été menés au cours des deux dernières décennies. La
problématique qui a été posée par ces travaux consiste à décrire la manière dont ces
Multilinguales, 15 | 2021
23
auteurs ont repris et retravaillé des textes traditionnels pour en faire de nouvelles
œuvres écrites.
23 À ce titre, l’étude de Titouche (2002) est inaugurale. Partant d’un point de vue
stylistique, il a montré les différents procédés d’écriture entrepris par Belaid At Ali sur
des textes traditionnels. Il a dégagé les aspects stylistiques sur lesquels s’est axé le
travail de l’auteur. Pour adapter ces récits à l’écrit, Belaid At Ali opère des digressions
internes, où il s’étale sur des détails, qui servent à expliquer des épisodes peu explicites
dans le texte d’origine. Les récits de Belaid At Ali font aussi recours aux proverbes et
aux structures syntaxiques du français ainsi qu’aux emprunts lexicaux à l’arabe et au
français.
24 Pour désigner les textes transférés de l’oralité à l’écrit, dans le processus qu’on appelle
« passage à l’écrit », Salhi (2002, 2004), utilise le terme de « délocalisation » afin
d’appréhender la relation entre la littérature écrite et la littérature orale. Il distingue
cinq types de délocalisation : graphique, linguistique, stylistique, générique et
architextuelle. Suivant ces types de délocalisation, établis par Salhi, les textes
traditionnels retravaillés par les auteurs de la littérature écrite peuvent faire l’objet de
ces cinq types de délocalisation, mais les plus importantes en sont la délocalisation
stylistique et générique.
Salhi parle, ailleurs, de la présence de la poésie de Si Mohand chez les poètes
contemporains, il écrit à ce propos : Évoquer, citer et rendre hommage à Si Mohand ou Mohand ici, nombrables sont lesévocations dans la poésie écrite et (chantée). Dans les poèmes on évoque lepersonnage de Si Mohand, soit comme caution de réussite poétique soit commeforce langagière capable d’élucider les situations inextricables (Salhi, 2007 :274).
25 Dans une étude de magistère, Ayad (2008), sur deux textes de Bouamara, en partant du
point de vue intertextuel, a dégagé certaines récurrences dans l’appropriation des
œuvres de l’oralité dans les nouvelles de Bouamara tirgara et taqsiṭ n Ɛziz d Ɛzuzu. En
plus de ces deux textes, qui constituent l’ossature des versions recrées par Bouamara, il
a énuméré une multitude d’éléments de l’oralité qui appartiennent à des registres et à
des catégories diverses du répertoire littéraire orale kabyle.
26 L’étude de Mohand-Saidi (2011), s’est proposé de comparer les niveaux narratif,
descriptif et discursif dans trois variantes du conte tafunast igujilen (« la vache des
orphelins ») avec celle écrite par Belaid At Ali. L’objectif est de tirer au clair l’apport de
Belaid At Ali dans la réappropriation d’un conte traditionnel et de vérifier les différents
niveaux sur lesquels se manifeste sa touche. Ceci est dans le but de situer le
renouvellement littéraire dans le texte et son impact sur la catégorie générique du
texte.
27 Une autre étude, qu’on peut regrouper sous cette perspective, est celle de Medjadi
Djejjiga. Dans son magistère (2012), elle a abordé le lien qu’entretient un conte
contemporain avec le conte kabyle traditionnel, en étudiant Imeṭṭi n Bab idurar d’Akli
Kebaili. L’objet principal de ce travail est de déterminer les aspects du renouvellement
dans le conte contemporain et de mesurer le degré de fidélité au conte traditionnel.
28 Dans cette même orientation Ayad et Aissou (2020), ont abordé la poétique du proverbe
dans le roman Iḥulfan (« les sentiments ») de Kaysa Khalifi. Il a été question de
commenter le traitement que réserve l’écriture romanesque au proverbe et de montrer
son importance dans la constitution du sens globale de l’œuvre. Les réflexions autour
de l’intertextualité et son apport dans l’émergence d’une littérature écrite en
Multilinguales, 15 | 2021
24
tamazight a été l’œuvre de Ayad (2020). En effet, dans sa thèse il a tenté de montrer le
lien entre le recours à l’intertextualité dans l’élaboration des œuvres écrites et les
conditions dans lesquelles ces mêmes œuvres ont vu le jour. Il a constaté que
l’intertextualité dans ce cas est adoptée, par les auteurs de cette veine littéraire,
comme une stratégie d’émergence.
1.4. Critique thématique
29 Les études qui s’inscrivent dans cette orientation, comparativement aux autres, sont
moins nombreuses. En effet, Hamane (1999), dans son étude sur Merwas deg lberǧ n yiṭij( = « Merwas au château du soleil »), en partant d’un double postulat : structuraliste et
thématique, a traité la problématique du déracinement. Celui de la parole et celui
relatif à l’espace à travers l’analyse des personnages et de leurs discours.
30 Abrous (2006), en s’appuyant sur ses recherches précédentes, en tire une conclusion
intéressante. Elle remarque que sur quatre romans, bien qu’ils aient des structures
spécifiques, leur écriture présente des ressemblances profondes : deux traits d’écriture
les unissent. Le premier est d’ordre thématique qui se manifeste dans la question
identitaire, déboires de l’émigration, et l’amour d’une terre ingrate. Le second trait est
leur ancrage profond dans la symbolique berbère, qui a alimenté l’imaginaire des
écrivains et a constitué un socle pour leur écriture. À partir de l’analyse de ces
différents éléments certaines conclusions sont dégagées dont : le thème de
l’éclatement, qui prend des formes différentes, est central dans Asfel (« le sacrifice »),
car il mène à la mort. Par contre, dans les trois autres romans, l’éclatement n’est pas
synonyme de la mort. Ils sont construits sur la logique de la lutte.
31 Concernant cette orientation de la critique littéraire, nous citerons l’étude de Sadi
(2012). Le point de départ de cette étude est la récurrence du thème de l’identité dans
les productions romanesques d’expression kabyle. Dans ce cas de figure, le roman
Tafrara (« l’aurore ») présente un cas typique. L’auteur a tenté de répondre à des
questions non abordées jusqu’ici, comme la relation de la poétique au thème de
l’identité, et sa répercutions sur les éléments du récit ou encore l’impact de la
signification de l’identité sur la structure du récit. C’est aussi dans ce type de critique
qu’on inscrit sa thèse de doctorat (2019). Dans cette dernière elle a abordé la
problématique de l’écriture romanesque en kabyle sous l’angle de la sociopoétique afin
d’interroger l’identité même d’une écriture jusqu’ici méconnue de cette littérature.
1.5. Études des genres
32 Cette autre orientation qu’ont prise les études sur la littérature écrite est inaugurée par
Rachid Titouche et Zerar Sabrina (2009), les deux auteurs ont essayé une classification
du texte Lwali n wedrar (« le saint homme de la montagne ») de Belaid At Ali. Ils jugent
que ce récit est innovant, car il se distingue nettement de tout récit connu jusqu’alors.
Et en recourant aux grilles d’analyse « universelles », disaient-ils, et nonobstant la
polémique inhérente à la classification des récits en genres, ils ont tenté dans cet
article d’apporter la preuve que ce récit se classait dans la catégorie littéraire
« nouvelle » à travers l’étude de l’espace, les personnages et les actions. Notons, sous
cette appellation, l’étude de Benallaoua (2012) qui a tenté de dégager une typologie du
roman d’expression amazighe. Pour se faire, elle a examiné les éléments du paratexte,
Multilinguales, 15 | 2021
25
notamment les titres des romans qui expriment le souci des auteurs de ce genre
littéraire à présenter non seulement l’œuvre en elle-même, mais aussi à présenter son
genre.
33 La même problématique est posée autrement, par Ameziane et Salhi (2014), dans une
étude consacrée entièrement au genre dénommé tullist (« nouvelle »), considéré comme
un genre en « construction », en discutant le corpus qui le compose. La préoccupation
principale est de répondre à la question suivante : qu’est-ce qui compose donc le corpus
de cette catégorie de textes appelée tullist ? L’importance de cette question,
affirmaient-ils est qu’elle se pose comme une condition méthodologique essentielle de
la suite et de l’orientation qu’ils veulent donner à l’étude de tullist. Elle est
déterminante, aussi bien, de l’évolution de ce qu’on pourrait considérer comme « le
genre de la nouvelle » en kabyle, des types de textes qui s’y insèrent que des tendances
poétiques que l’analyse est appelée à y définir.
34 Quelles conclusions tirer de cet exposé ? Si l’on se réfère aux orientations qu’a pris la
critique de la littérature écrite en tamazight et à la classification des méthodes de la
critique littéraire dressée par Compagnon, une certaine typologie se dégage, et nous la
décrivons comme suit :
un point de vue sociologique inscrit cette littérature dans sa relation à la société et aux
conditions dans lesquelles elle est née.
un point de vue sémiotico-narratif tente de la saisir dans sa structure, son organisation
narrative, et les significations qu’entretient une structure d’un texte avec son contenu.
un point de vue thématique qui tente de traiter des aspects relatifs à l’imaginaire ou aux
contenus idéologiques traités par certains auteurs.
un point de vue intertextuel qui tente de la cerner dans sa relation à la littérature
traditionnelle orale et/ou transcrite.
5.étude des genres, un point de vue selon lequel on a tenté de décrire et/ou de commenter
les caractéristiques de quelques genres écrits ainsi que des tentatives de classement.
35 Voilà en gros comment s’est construit autour de la littérature écrite tout un discours
critique qui tente de la circonscrire dans ses différents aspects. Mais quelle lecture
pouvons-nous faire à ce parti pris de la recherche dans ce domaine ? Qu’y a-t-il
d’important à retenir dans notre cas précis ? Ce sont des questions qui seront traitées
dans la suite de cette contribution et auxquelles nous tenterons d’apporter quelques
éléments de réponse.
2. Regard sur le discours critique
36 S’il y a des lectures qui se dégagent à partir de l’examen de l’état de la recherche sur la
littérature écrite d’expression amazighe, exposé plus haut, nous retiendrons, en
premier lieu, l’intérêt grandissant de la part des chercheurs à cette littérature : elle est
lue, commentée et étudiée. Bien que des objections peuvent être formulées à l’égard
d’un tel ou tel point de vue, quoi qu’il en soit, cette recherche a donné naissance à un
corps critique qui institue, selon les termes de Compagnon, une critique universitaire
qui ne cesse de s’affirmer et de s’autonomiser des à priori idéologiques.
37 Inscrire cette littérature, longtemps minorée ou tout simplement marginalisée, dans les
études universitaires revient à lui accorder une légitimité. Dans ce sens, le discours
critique joue un rôle déterminant dans sa reconnaissance et par le large public et par la
•
•
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
26
communauté scientifique. Dans ce cas précis, le corps critique, en l’absence d’organes
officiels, joue, selon Bourdieu (1991), un rôle d’instances de consécration et de
légitimation. Puisqu’elle n’est pas seulement étudiée, mais, aussi, elle est enseignée. Et
ainsi, elle a conquis de nouveaux territoires, et a acquis un statut qui ne cesse de
s’affirmer.
38 Un deuxième trait qui se dégage de cet état des lieux est que cette littérature est
réfléchie comme une interaction entre elle et son ainée, la traditionnelle : bon nombre
de travaux ont inscrit leurs réflexions dans cette problématique qui a tendance à
montrer le lien indéfectible que tissent les œuvres écrites avec les genres relevant de la
tradition orale. Cependant, ces œuvres ne sont pas perçues comme de simples
créations, mais on leur fait jouer le rôle de réservoir des savoirs ancestraux, retravaillés
par la poétique moderne et présenter sous de nouvelles formes à un public-récepteur
soucieux de redécouvrir sa filiation littéraire, linguistique et esthétique. De ce point de
vue, cette littérature, du moins d’après notre recherche bibliographique, est
essentiellement intertextuelle. À cela, on peut ajouter les points de vue qui tentent de
saisir la valeur esthétique, mais surtout symbolique, des créations écrites en kabyle. La
présence d’éléments relevant de la culture, de la mythologie est vue comme étant une
tentative d’ancrer cette littérature dans sa dimension identitaire berbère. Il est de
même pour certaines analyses qui n’ont pas manqué de soulever l’aspect revendicatif
de cette littérature. Cette revendication, tissée comme une toile de fond, est une
caractéristique majeure des premières œuvres. Aujourd’hui, nul ne peut nier la
situation défavorable dans laquelle s’est retrouvé le tamazight au lendemain de
l’indépendance de l’Algérie en 1962. Si au départ la revendication pour la
reconnaissance du tamazight a pris une dimension purement linguistique, les choses
ont évolué avec le temps pour gagner d’autres domaines, et la littérature écrite était
l’une des facettes de cette revendication, où elle a joué un rôle déterminant dans la
survie de la langue et de la culture amazighes.
39 Une troisième lecture possible de cet état des lieux est que la réflexion sur les genres
nouveaux a constitué un point nodal de ces études. Les tentatives de classement des
productions écrites dans des grilles génériques imposent inéluctablement une
réflexion, d’une manière particulière, sur la nouvelle configuration de la littérature
d’expression kabyle et, d’une manière générale, sur la configuration de la littérature
d’expression amazighe. Qu’y a-t-il à ajouter au terme de cette étude ? Pour ne pas
conclure commençons par rappeler les grands moments de cette contribution.
L’objectif que nous nous sommes assigné dans cette réflexion est de rendre compte, un
tant soit peu, de la situation de la recherche, en Algérie, dans le domaine de la
littérature écrite d’expression amazighe. Pour ce faire, nous avons réuni ici l’essentiel
des travaux ayant produit des discours critiques sur cette littérature, tout en tentant,
dans le but de dégager une typologie, de les classer selon les grandes tendances que ces
discours ont pris. Mais avant, nous avons jugé utile de retracer, à titre indicatif,
l’historique de ce discours critique afin de mieux nous situer par rapport à notre
problématique.
40 Ensuite, nous avons tenté une lecture globale de l’ensemble des critiques exposées dans
cette étude. Cette lecture, a permis une vue d’ensemble de ce qui a été fait, mais aussi
d’en saisir les grandes tendances de ce discours. Mais cela ne s’est pas fait sans
difficulté, car nous avons dû, en cours de route, nous séparer de quelques travaux pour
éviter de reproduire les mêmes constats. Une autre difficulté à laquelle nous avions dû
Multilinguales, 15 | 2021
27
faire face est de dresser un état des lieux des plus fidèles possible. Avouons-nous que
cela comporte des risques : les lectures que nous avons proposées restent, tout de
même, lacunaires, car nous étions contraints d’opérer des choix sur le contenu à
retenir de telle ou telle étude. Nous avons délibérément évacué certaines études : Les
cahiers de Belaid, regard sur une œuvre pionnière (2016), les écrits de Belaid At Ali 1909-1950,
un auteur et une œuvre à [r]elire(2016), car nous estimons que Bellal (2019) en a déjà fait
un état des lieux des plus détaillés. Nous sommes conscients du fait qu’il est impossible
de décrire ce processus dans sa totalité : conditions de l’émergence des discours
critiques, leurs tendances et leurs limites, ainsi que les représentations qu’on en fait de
ce discours. Autant de questions qui restent en suspend qui nécessiteraient, dans le
futur, une meilleure prise en charge de la part des chercheurs afin de déterminer d’une
façon détaillée tous les postulats de ce discours et d’en débattre des contenus qu’il
véhicule avec plus de précisions.
BIBLIOGRAPHIE
ABROUS D., La production romanesque kabyle : une expérience de passage à l’écrit, D.E.A, SALEM
CHAKER (dir(s)), Aix-en-Provence, Marseille, France, 1989.
ABROUS D., « Eclatement et enracinement dans la production romanesque kabyle », Etudes
littéraires africaines : Littérature berbère, no 21, l’Harmattan, Paris, France, 2006, pp 29-39.
ACHILI F., « L’intertextualité dans le discours romanesque Kabyle à travers le roman d’Amar
Mezdad « Iḍ d wass », Iles d Imesli no 3, Tizi Ouzou, 2011, pp 81-94.
ACHILI F., « Dualité de la révolutionnarisation et du changement dans le discours romanesque
kabyle A travers la trilogie d’Amar MEZDAD », Iles d Imesli no 6, Tizi Ouzou, 2014, pp 266-278.
AIT OUALI N., L’écriture romanesque kabyle d’expression berbère de 1946 à 2014, L’Odyssée, Tizi
Ouzou, 2015.
AMEZIANE A., Les formes littéraires traditionnelles dans le roman kabyle : du genre aux procédés,
D.E.A, ABDELLAH BOUNFOUR (dir(s)), Inalco, Paris, France, 2002.
AMEZIANE A., « La néo-littérature kabyle et ses rapports à la littérature traditionnelle », Etudes
littéraires africaines : Littérature berbère, no 21, l’Harmattan, Paris, France, 2006, pp 20-28.
AMEZIANE A., Tradition et renouvellement dans la littérature kabyle, Thèse de Doctorat, ABDELLAH
BOUNFOUR (dir (s.)), Inalco, Paris, 2008.
AMEZIANE, A., SALHI, M A., Tullist kabyle : réflexions préliminaires sur le corpus, dans 3eme Colloque
international, Université de Bouira, 2013. Disponible sur : [http://hdl.handle.net/
123456789/2057], Consulté le 03/03/2021.
AYAD S., Intertextualité et littérature kabyle contemporaine : le cas de Nekni d weyiḍ de Kamal
Bouamara, Mémoire de Magistère, CLAUDE FINTZ (dir (s.)), Université de Bejaia, 2008.
AYAD S., AISSOU O., Timmedyezt n yinzi deg wungal Iḥulfan n Kaysa Xalifi, Aleph [En ligne], 7 (2) |
2020. Disponible sur : [https://aleph-alger2.edinum.org/2690], Consulté le 22 décembre 2020
Multilinguales, 15 | 2021
28
AYAD S., Littérature écrite d’expression kabyle : stratégies et conditions d’émergence, Thèse de
Doctorat, KAMEL BOUAMARA (dir (s.)), Université de Tizi Ouzou, 2020.
BELGASMIA E., Tradition orale, oralité et écriture dans les romans de Rachid Aliche, D.E.A, ABDELLAH
BOUNFOUR (dir (s.)), Inalco, Paris, 2001.
BELLAL H., Les écrits de Belaid At Ali face à la tradition littéraire kabyle, Thèse de Doctorat, MOHAND
AKLI SALI (dir (s.)), Université de Tizi Ouzou, 2020.
BELLAL N., Etude du personnage, en tant que catégorie textuelle, dans les romans kabyles d’Amer
Mezdad, Mémoire de Magistère, KAMEL BOUAMARA (dir (s.)), Université de Béjaïa, 2012.
BENALLAOUA A., Contribution à l’étude typologique du roman d’expression kabyle, Mémoire de
Magistère, KAMEL BOUAMARA (dir (s.)), Université de Béjaïa, 2012.
BOUDIA A., Contribution à l’analyse textuelle d’un corpus de nouvelles d’expression kabyle,
Mémoire de Magistère KAMEL BOUAMARA (dir (s.)), Université de Béjaïa, 2012. BOURAI O., Asfel : étude
narrative et discursive, Mémoire de Magistère, RABAH KAHLOUCHE (dir (s.)), Université de Tizi-
Ouzou, 2007.
BOURDIEU P. « Le champ littéraire », In Actes de la recherche en sciences sociales. vol. 89,
septembre 1991, pp. 3-46.
Cahiers de Belaid, regard sur une œuvre pionnière, AMEZIANE AMER (dir (s.)), Tira, Béjaia, 2016.
CHAKER S. « L’affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constantes et mutations (Kabylie) »,
Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, n° 44. Berbères, une identité en
construction, 1987, pp. 13-34. Disponible sur : [https://doi.org/10.3406/remmm.1987.2152],
Consulté le 21/04/2018.
CHAKER S., « La naissance d’une littérature écrite : le cas berbère (Kabylie) », in Bulletin des Etudes
Africaines : IX (17/18), Inalco, Paris, 1992, pp 1-7.
CHEMAKH S., « Les conditions de production de la néo-littérature kabyle », Asinag n0 4-5, Rabat,
Maroc, 2010, pp 163-168.
COMPAGNON A., « Littéraire, critique », dans Dictionnaire des genres et des notions littéraires,
Encyclopeadia Universalis et Albin Michel, 2001, pp 430-448.
Ecrits de Belaid At Ali 1909-1950, un auteur et une œuvre à [r]elire. Actes du colloque
international, MOHAND-AKLI SALHI (dir (s).), ENAG, Alger, 2016.
HAMANE F., l’ubiquité du déracinement et son apport dans la rémanence de la littérature
algérienne dans Merwas au château du soleil d’Abdellah Hamane, Mémoire de Magistère, FAOUZIA
SARI (dir(s).), Université d’Oran, 1999.
IBRAHIM M., Vie et œuvre de Belaïd At-Ali, l’auteur des Cahiers de Belaïd ou la Kabylie d’antan,
Mémoire de Maîtrise, ABDELLAH BOUNFOUR et SALEM CHAKER (dir (s.)), Inalco, 1997.
MEDJADI J., Le renouvellement du conte kabyle : le cas d’Imeṭṭi n Bab idurar d’Akli Kbaili,
Mémoire de Magistère, MOHAND-AKLI SALHI (dir (s).), Université de Tizi Ouzou, 2012.
MOHAND SAIDI S., Le récit Tafunast igujilen de Bélaïd Aït Ali : du conte à la nouvelle, Mémoire de
Magistère, DJELLALOUI MHEMMED (dir (s).), Université de Tizi-Ouzou, 2011.
SADI N., L’expression de l’identité dans le roman tafrara de Salem Zenia, Mémoire de Magistère,
DJELLALOUI MHEMMED (dir (s).), Université de Tizi Ouzou, 2012.
Multilinguales, 15 | 2021
29
SADI N., Problématique de l’écriture romanesque en kabyle, Thèse de Doctorat, MOHAND-AKLI SALHI
(dir (s).), Université de Tizi Ouzou, 2019.
SALHI M.A., « La délocalisation des textes oraux. Le cas de deux textes kabyles : Aheddad l-lqalus et
taqsit n Aziz d Âzuzu , dans Echanges et mutations des modèles littéraires entre Europe et
Algérie, Tome 2, CHARLES BONN (dir (s).), Paris, L’Harmattan, 2004, pp 205-211.
SALHI M.A., « La nouvelle littérature kabyle et ses rapports à l’oralité traditionnelle », dans La
Littérature Amazighe : oralité et écriture, spécificités et perspectives. Actes du colloque
international, KICH AZIZ (dir (s.)), Rabat, 2004, pp 103-121.
SALHI M.A., « Regard sur les conditions d’existence du roman kabyle », Studi Magrebini, nuova
serie, volume IV, Napoli, 2006, pp 121-127.
SALHI M.A., « Quelques effets de la situation sociolinguistique algérienne sur la littérature kabyle,
le berbère en contact », Berber studies, volume 22, 2008, pp 165-173.
SALHI M.A., « l’esprit du poète Si Mohand ou Mhand et la poésie kabyle d’aujourd’hui », in Etudes et
Documents Berbères, N0 25-26, 2007, pp 273-283.
SALHI M.A., « Quelle grille d’analyse pour le (sous) champ littéraire Kabyle ? » dans Champs
littéraire et stratégies d’écrivains, Les ouvrages du CRASC, 2014, pp 145-154.
SALHI M.A., SADI N, « Le Roman Maghrébin En Berbère », Contemporary French and Francophone
Studies, 20 :1, 2016, pp 27-36. DOI : 10.1080/17409292.2016.1120548.
TITOUCHE R., Les Cahiers de Belaid At Ali : du conte à la nouvelle, Mémoire de Magistère RICHE B
(dir(s)) la direction), Université de Tizi-Ouzou, 2002.
TITOUCHE R., ZERAR S, « Naissance du genre ‘nouvelle’ en tamazight (kabyle) », El-Tawassol n° 23
Janvier 2009, pp 65-65.
TODOROV T., « poétique », dans Dictionnaire des genres et des notions littéraires, Encyclopeadia
Universalis et Albin Michel, 2001, pp 601-605.
،( ( فارشإ وياروب ديمحلا دبع ،دادزم رمعل راهنلا و ليللا ةياور يف يدرسلا باطخلا ليلحت ، ف يليشأ . . 2002 ،وزو يزيت يرمعم دولوم ةعماج ،ريتسجام ةلاسر
ةيبعشلا ةياكحلا يف درسلا نيب ةنراقم ةسارد . يلئابقلا يصصقلا رثنلا يف درسلا ، – ن سودربلع ثا ديعلب تافلؤم و ةيوفشلا ي ،وزو يزيت ةعماج ، فارشا ) ) وياروب ديمحلا دبع ،ةيلئابقلا ةياورلا و
2001.
Iḍ d wass ديسح . 2008 وزو يزيت ةعماج ،ريتسجام ةلاسر ، ( ( فارشإ وياروب ديمحلا دبع ،دادزم رمعل ،ف. ةياور يف ةيصنلا ةينبلا
NOTES
1. L’œuvre de Belaid At Ali, Les cahiers de Belaid ou la Kabylie d’antan, marque le début effectif de
l’écrit littéraire en kabyle. Elle a été écrite au milieu des années 1940, mais elle n’a été publiée, à
titre posthume, par les Pères Dallet et Degezelle dans le Fichier de Documentation Berbère qu’en
1963.
2. En dépit des changements institutionnels et constitutionnels dont la littérature écrite a su en
tirer profit, sa condition socio-politique est restée, d’une manière générale, défavorable à plus
d’un égard : problèmes d’éditions et de diffusion, le manque de soutien financier, et surtout un
Multilinguales, 15 | 2021
30
manque cruel en lectorat. À l’heure actuelle, les choses sur certains plans vont, tout de même,
beaucoup mieux, et cette littérature commence à avoir une assise plus solide.
RÉSUMÉS
Cette contribution essaie de répondre à la question : où on est la recherche dans le domaine de la
littérature écrite d’expression amazighe en Algérie ? Les réflexions qui seront développées ici, en
nous appuyant sur des propositions théoriques, cherchent à rendre compte de ses orientations et
à proposer une typologie des discours critiques produits par la recherche littéraire.
This contribution tries to answer the question: What is the state of the art concerning the
research in the field of written literature of Amazigh expression in Algeria? The reflections that
will be developed here, based on theoretical proposals, seek to account for its orientations and to
propose a typology of the critical discourses produced by literary research.
INDEX
Keywords : written literature, literary criticism, speeches, typology, literary legitimation
Mots-clés : littérature écrite, critique littéraire, discours, typologie, légitimation littéraire
AUTEUR
SALIM AYAD
Département de Langue et Culture Amazighes, Bejaia, CRLCA, Bejaia, Algérie
Multilinguales, 15 | 2021
31
Une lecture de la reception duroman de langue kabyle (ou l’ungal)A lecture on the reception of the berber (kabyle) novel
Nabila Sadi
1 La réception est une dimension inhérente à la nature même d’un genre littéraire. Elle,
qui se définit comme « l’activité de lecture et d’interprétation des textes » (Kherdouci H.,
2017 : 14), n’accueille pas l’œuvre de manière passive puisque c’est par la réception que
cette dernière prend son plein sens. Le lecteur ne saurait être qu’un élément de la
triade (auteur-œuvre-lecteur) comme le signale H. R. Jauss (2010), mais bien « une
énergie qui contribue à faire l’histoire » (49), participant, de ce fait, pleinement à
l’expérience littéraire et à la mouvance de l’horizon d’attente. Et formuler un discours
autour du discours critique, c’est procéder à rebours de la pratique courante pour
proposer une sorte de métadiscours dans lequel le discours critique est lui-même
transformé en objet d’étude. Il s’agit, ici, de proposer une lecture de la réception de
l’ungal qui se décline au niveau de la critique universitaire, des comptes rendus de
lecture et quelques « mentions rapides dans les émissions de la radio kabyle » (Salhi M. A.,
2011 : 94). Mais il est surtout question d’historiciser les différentes positions des
critiques, de les corréler à l’état du champ littéraire kabyle, à différents moments de
son histoire pour observer la manière dont il a impacté les différentes lectures de
l’ungal, et comment celles-ci, par ricochet, ont contribué au processus de légitimation
et d’institutionnalisation de ce genre. Car comme le note P. Bourdieu (1998), le discours
autour d’une œuvre
« n’est pas un simple adjuvent, destiné à en favoriser l’appréhension etl’appréciation, mais un moment de la production de l’œuvre, de son sens et de savaleur » (285).
L’accueil d’un genre littéraire emergent : l’ungal
2 La naissance officielle1 de l’ungal, au début des années 1980, n’a pas tardé à susciter
l’intérêt de la critique universitaire puisque la première étude en date, celle de D.
Abrous, s’aligne au rang des approches anthropo-littéraires en appréhendant ce genre
Multilinguales, 15 | 2021
32
dans une dynamique de passage de l’oralité à l’écriture (D. Abrous, 1989). Elle s’appuie
sur les trois seuls textes romanesques attestés comme tels à cette époque-là (Asfel,
Askuti et Faffa2) pour énumérer les points de continuité et de rupture que marque
l’ungal par rapport à la tradition littéraire orale. Ceux-ci sont particulièrement discutés
à partir du contexte socio-politique des années 1980 concomittant avec la montée des
revedications identitaires en Kabylie dont l’ungal n’est que l’expression de ces
mutations socio-culturelles, explique la même auteure. C’est pourquoi, la question de
l’identité et de son impact sur ces trois ungal investit une large part de ce travail.
L’usage des néologismes pour pallier à la suppression des emprunts à la langue arabe
est, à ce propos, représenté comme un choix motivé de ces trois romanciers,
témoignant ainsi d’un réel positionnement idéologique3. Ce contexte historique déteint,
aussi, sur la thématique de ces trois romans qui reprennent, sous des formes variables,
la question identitaire.
3 Le choix d’une approche anthropo-littéraire s’explique, à la fois, par la tendance
« anthropologisante » des études portant sur la littérature kabyle jusque-là,
notamment celles consacrées à la littérature orale mais aussi, par la nature et la
vocation même de l’ungal dont la naissance officielle coïncide avec le contexte
revendicatif des années 1980. C’est pourquoi, la tendance des premières études portant
sur l’ungal gravitait autour du contexte 4 ayant vu émergé ce genre et de ses
répercussions sur les reconfigurations génériques. L’ungal est, alors, amené à ne pas
être interrogé dans sa singularité, mais au sein de la structure vaste de la littérature
kabyle écrite comme il est notable dans une étude de D. Abrous (D. Abrous, 2004). Il est,
plutôt, replacé dans une dynamique évolutive de cette dernière (intégrant d’autres
genres comme tullist/nouvelle et amezgun/théâtre), contribuant, ainsi, à la production
d’un champ notionnel visant à rendre compte de ces nouvelles réalités littéraires, à
l’image de « néo-littérature/nouvelle littérature », « littérature écrite » (Chaker S.,
1992) ou encore « littérature émergente » (A. Ameziane, 2008 : 131-137). Elles
représentent autant d’appellations dont le but est de rendre compte du nouveau
paysage littéraire kabyle et des inspirations et motivations (modernisme, quête
identitaire, etc.) ayant pu impulser son émergence. Ces premières études donnent,
ainsi, forme à un discours « sur » l’ungal correspondant -pour reprendre les termes
de C. Moisan (1987)- à la « phase d’admission » d’un genre, qui est une sorte
d’« introduction, d’un discours d’entrée, qui donne un droit d’entrer » (220). La prise en
compte de ce contexte d’émergence est un préalable indispensable auquel M. A Salhi
dédie d’innombrables textes dans lesquels il y traite l’ensemble des éléments
déterminant l’existence de l’expression romanesque kabyle en interrogeant, entre
autres, les conditions éditoriales et institutionnelles, le statut de la langue amazighe, la
situation sociolinguistique, etc. (Salhi M. A., 2006, Salhi M. A., 2011). S. Chemakh (2010)
y observe, également, une étape décisive :
« avant de mener des études thématiques ou d’entamer des analyses littéraires duroman, de la nouvelle ou de la poésie kabyle écrite, il semble nécessaire de décrireles conditions d’existence de cette néo-littérature » (163).
C’est du côté de l’écrivain qu’il place cette problématique en décrivant les conditions de
production des différents genres constituant la littérature kabyle écrite en insistant sur
la compétence linguistique, littéraire et la motivation sociale des auteurs de langue
kabyle (Chemakh S., 2010).
4 La question de l’édition se taille une place de choix au sein de ce discours d’entrée. Le
romancier A. Mezdad, en incluant sa propre expérience dans l’écriture romanesque,
Multilinguales, 15 | 2021
33
initie le débat en posant le problème de l’écrivain de langue kabyle (A. Mezdad, 2001).
Les difficultés liées à la production (publications à compte d’auteur) et à la réception
(lectorat réduit) sont posées comme deux grands obstacles à la prospérité de l’ungal. De
manière un peu plus ciblée, c’est l’expérience éditoriale du haut commissariat de
l’amazighité et de son degré d’impact sur le champ littéraire algérien en tant
qu’instance de légitimation de la production amazighe qui se retrouve interrogée dans
une étude de A. Ameziane (Ameziane A., 2011). Bien que cette institution offre une
opportunité aux auteurs de se faire publier en langue amazighe, cet auteur souligne
« l’impact négatif » de sa politique éditoriale qui affiche parfois un manque de suivi par
rapport aux ouvrages qu’elle publie. Il cite le cas de Bu-tqulhatin dont la réédition à
compte d’auteur présente plusieurs anomalies qui le poussent à supposer que la
commission de lecture « ne semble pas agir sur le contenu des ouvrages que le HCA
édite » (Ameziane A., 2011 : 374). Ce discours d’entrée ouvre, ainsi, les portes à l’ungal
par le biais d’un discours attestant des transformations littéraires ayant amené
l’introduction de genres inédits, mais il se consacre, tout particulièrement, à son
fonctionnement institutionnel au sein du champ littéraire algérien.
5
La pratique des comptes rendus de lecture entre, également, en résonnance avec la
critique universitaire dans la mesure où elle intègre, à son tour, cette phase
d’admission de l’
ungal
, bien que par des stratégies divergentes. En effet, paradoxalement aux autres travaux
de recherche sur l’
ungal
, la pratique des comptes rendus de lecture est, souvent, réalisée en langue kabyle. Une
stratégie qui identifie, non seulement, le lectorat visé par cette pratique, mais qui
exprime, par la même occasion, la capacité de cette langue à produire non seulement
une littérature écrite mais, aussi, à porter un discours sur cette même littérature. La
question linguistique occupe, d’ailleurs, une place de choix au niveau de ces comptes
rendus qui insistent, pratiquement tous, sur la facilité de lecture des
ungal
abordés. C’est à cette occasion que K. Naït Zerrad évoque la fluidité de la langue usitée
par D. Benaouf dans
Timlilit ntɣermiwin
malgré les quelques néologismes qui la traversent (K. Nait Zerrad, 2001). Les auteurs de
ces comptes rendus mettent, souvent, l’accent sur le degré de recours des romanciers
aux néologismes dont l’usage démesuré peut être très contraignant au moment de la
lecture. Toutefois, l’entreprise de certains romanciers est, parfois, saluée au regard du
travail effectué sur la langue romanesque. En parlant de
Faffa, N. Abrous énumère les mérites de R. Aliche qui «
n’a cessé de triturer et d’essorer la langue, la nouer et la pétrir pour rendre un univers
sémantique intarissable
» (N. Abrous, 2008). Le talent d’A. Mezdad, selon A. Hamidouche, réside dans la
simplicité de la langue du roman
Tagrest Urɣu
, marquée par un retour constant aux archaïsmes de la langue kabyle (A. Hamidouche,
2000). Malgré cela, les difficultés que pose cette même langue pour ces romanciers qui
n’ont eu l’occasion de la pratiquer que dans son usage oral, ne sont pas passées sous
silence. C’est dans ce sens que M. A. Salhi reconnaît que la langue d’
Multilinguales, 15 | 2021
34
Iɣil d Wefrude S. Zenia « est par moment un peu forcée
» (M. A. Salhi, 2003). Une conséquence presque naturelle d’une langue évoluant dans
un milieu marqué par le plurilinguisme, ajoute le même auteur. Néanmoins, l’accent est
majoritairement porté sur la lisibilité et l’accessibilité de certains
ungal
à la lecture, chose qu’affirment, par exemple, S. Chemakh et T. Ould Amar à propos de
Salas d Nujade B. Tazaghart (Chemakh S., 2005, Ould Amar T., 2006).
6
A leurs premières manifestations, ces comptes rendus se consacrent rarement à la
présentation seule des textes dont ils proposent une lecture mais se livrent aussi à des
présentations générales de l’
ungal. En effet, en raison du problème de diffusion que connaissent les productions
romanesques en langue kabyle (notamment à leurs débuts) et vu la publication de
nombreux textes à l’extérieur du territoire national, il fallait, donc, pour l’essor de ce
genre, attester de l’existence de ces textes en les replaçant dans leur « lieu naturel » (P.
Bourdieu, 1998 : 276) dans lequel ils sont censés prendre place et être consommés, vu
qu’aucune prise en charge institutionnelle n’œuvrait à leur promotion. En parlant des
ungal publiés en France, M. A. Salhi (2006) écrit qu’il fut un temps où
« leurs auteurs ne sont reconnus comme romanciers que par l’information et lacritique journalistiques ou l’information militante » (125).
C’est là que se mesure tout l’intérêt de la critique car comme le note P. Bourdieu
(1998) : « Le travail de fabrication matérielle n’est rien sans le travail de production de lavaleur de l’objet fabriqué » (287).
7 C’est l’une des raisons qui font de ces lectures un lieu mobilisant plusieurs stratégies de
valorisation par lesquelles certains auteurs vont jusqu’à niveler les romanciers kabyles
à des écrivains de renommée internationale (tels M. Proust, W. Faulkner, A. Camus)
comme il est possible de le noter dans certains textes consacrés à R. Aliche (N.
Abrous, 2012) ou à B. Tazaghart (T. Ould Amar, 2006). Le critique participe, ainsi,
« à faire la valeur de l’auteur qu’il défend par le seul fait de le porter à l’existenceconnue et reconnue, d’en assurer la publication […] en lui offrant en garantie tout lecapital symbolique qu’il a accumulé »5 (Bourdieu P., 1998 : 287).
8 Visant à asseoir une certaine autorité à l’ungal
, cette pratique s’insère au sein de cette phase d’admission de l’ungal
. Ces stratégies de valorisation ainsi que la constante mise en relief de l’accessibilité de
la langue de l’
ungal
rend palpable certains aspects contraignants du champ littéraire dans lequel évoluait le
genre. Prôner certains textes de l’
Multilinguales, 15 | 2021
35
ungal
comme très faciles et agréables à la lecture se dresse en réponse au problème accru de
lectorat que connaissait ce genre. Une réalité que ne manque pas de noter D. Merrola
qui observe que le problème de communication entre les auteurs de romans kabyles et
leur public est beaucoup plus accru qu’il ne l’est pour le romancier de langue arabe ou
française dans le milieu maghrébin, dont le lectorat est déjà assez réduit ( Merolla
D., 2006 : 183). En effet, avec le passage à l’écrit, il fallait créer une habitude de lecture
en langue kabyle qui n’est pas une pratique qui suit de manière « naturelle » le cours
des choses mais bien une disposition qui, pour s’accomplir, nécessite la mobilisation
d’un ensemble de facteurs comme la promotion et la médiatisation du livre amazighe,
la prédisposition à la lecture en langue amazighe grâce à l’enseignement de cette
langue, etc.
9 La réception de l’ungal diffère, ainsi, selon le type d’institution d’où elle émane. Les
premières appréciations de cette nouvelle prise de position des auteurs (autrement dit,
l’écriture d’ungal) ont été largement structurées en fonction des données du champ
littéraire kabyle en rapport avec sa position au sein du champ littéraire dominant. Les
premiers « réflexes » observés au niveau de la critique universitaire ainsi que dans la
pratique des comptes rendus de lecture élaborent davantage un discours « sur » l’ungal.
Ces derniers, s’adressant à un public plus élargi, concourent à offrir une visibilité à
cette forme d’expression dont la majeure partie de ses productions était, pendant
longtemps, assurée par des maisons d’édition internationales. Ce type de réception
répondait plus directement aux exigences qu’imposait ce même champ littéraire qui
était démuni de toutes les composantes nécessaires pour assurer la visibilité et la
promotion de l’ungal (et de la littérature kabyle de manière générale). C’est pourquoi, à
cette situation défavorable et contraignante, la réception (au niveau des comptes
rendus) avait réagi positivement en louant les vertus des écritures de certains auteurs,
optant par moments pour une stratégie de surenchère de certaines œuvres en les
nivelant à celles d’auteurs de notoriété internationale, pour stimuler un lectorat qui
était dépourvu de toute prédisposition à la consommation (lecture) en langue kabyle
(statut non institutionnalisé de la langue amazighe, indisponibilité des ouvrages, etc).
Pareillement dans la critique universitaire, de nature plus ésotérique puisque
s’adressant davantage à ses pairs, elle affiche également, à ses débuts, un discours qui
servait d’introduction à cette nouvelle forme d’expression dans l’espace culturel en
insistant sur les conditions de son existence.
10 Par ailleurs, l’aspect et le contenu des comptes rendus ces dernières années, plus
tournés vers la description de la poétique des ungal6 sont, d’ailleurs, une indication de
nouvelles données en matière de lectorat. Dans un entretien réalisé il y a maintenant
quelques années avec M. Kezzar, M. Zimu et S. Zenia, ce dernier observe le regain d’élan
qu’a connu l’édition en berbère. Il affirme que :
« Si l’édition a pris plus d’essor, cela veut dire qu’il y a un lectorat, même relatif,mais il existe. Avant, les éditeurs réfléchissaient deux fois avant d’éditer unquelconque ouvrage, non seulement en tamazight mais aussi dans les autreslangues » (S. Zenia et al., 2011).
En effet, nous assistons, présentement, à une vague de réédition d’ouvrages de
littérature kabyle (dont plusieurs
ungal7) notamment avec le concours des éditionsTira
Multilinguales, 15 | 2021
36
. L’épuisement de certains stocks de réédition (M. A. Salhi et A. Ameziane, 2017 : 326)
nous invite à réévaluer la question du lectorat, notamment, depuis que l’enseignement
de la langue amazighe s’est généralisé en Kabylie avec l’implantation de trois
départements au niveau de cette dernière (
Tizi Ouzou,BejaïaetBouira
) et un autre département à Batna, formant, ainsi, des centaines de diplômés tous les
ans, autrement dit, une prédisposition à la consommation (la lecture) du livre écrit en
kabyle (tamazight).
La problématique du renouvellement littéraire
11 Certaines positions de la critique manifestent le souci de recherche d’une voie propre
dans l’étude de l’ungal. Ainsi peut-on dire des nombreuses études insérant ce genre
dans une dynamique évolutive de la littérature kabyle, misant sur le rapport de l’ungal
à l’oralité traditionnelle pour pouvoir déceler les procédés du renouveau littéraire.
L’objectif étant de déceler quelques mécanismes de la création littéraire qui passent par
l’appropriation et la subversion du fond kabyle oral. Ce qui est souvent mis en exergue,
sont les passerelles qui s’établissent entre ces deux pans de la littérature amazighe (la
littérature écrite et la littérature orale) même lorsque la première s’en désolidarise
totalement pour manifester une nette rupture vis-à-vis de la tradition orale. C’est dans
le sillage de ces études que M. A. Salhi discute, à titre d’exemple, le recours constant
des auteurs aux ressources de la littérature orale pour leur usage comme matrice
essentielle à la composition de nouveaux textes (Salhi M. A, 2004). Ces narrations orales
(le conte plus particulièrement) deviennent, par moments, le point de départ par lequel
est discuté l’ungal par rapport au renouvellement qu’il opère d’un point de vue narratif
et thématique (Berdous N., 2001).
12 Cette tendance n’est pas stérile et ne se résume pas à une simple recension des motifs
de la littérature orale dans l’ungal. A. Ameziane va se consacrer longtemps à cette
problématique. D’abord, dans Les formes littéraires traditionnelles dans le roman kabyle où il
repère, non seulement, la présence de textes oraux dans l’ungal mais formule une
réflexion sur la manière dont ils sont transformés en contexte d’écriture (Ameziane A.,
2002). Intéressé fortement par cette question, il élargit, ensuite, sa problématique dans
sa thèse de doctorat (Ameziane A., 2008) en se penchant sur la mise en texte de ces
formes traditionnelles et les différentes fonctions et significations « nouvelles » dont
elles se dotent une fois transposées dans d’autres genres relevant de l’écrit. L’auteur
parvient à rendre compte de quelques aspects du renouvellement de la littérature
kabyle s’élaborant sur la base de la réactualisation de motifs traditionnels, de la parodie
ou de la transformation totale d’un genre littéraire oral.
13 Le rapport ungal/oralité jouit, ainsi, d’un grand intérêt au niveau de la critique
littéraire kabyle. Cette tendance est conditionnée par la représentation qu’a été faite de
ce genre, considéré comme « une forme de passage à l’écrit ». Au moment où certains
chercheurs clament l’essoufflement des genres oraux8, et que parallèlement, le champ
littéraire kabyle accueille d’autres formes littéraires qui se construisent et y prennent
place, étudier le lien qu’entretient l’ungal avec ses prédécesseurs constitue un passage
presque obligatoire dans le parcours de la critique romanesque kabyle. Cette dernière
ne faisant, ainsi, que suivre l’élan de l’évolution de la littérature kabyle mais en
saisissant cette problématique comme moyen permettant de comprendre l’un des
Multilinguales, 15 | 2021
37
mécanismes de la création et du renouvellement littéraires. Cette approche, traduit,
toutefois -ne serait-ce que de manière tacite- une manière de concevoir les genres
littéraires « nouveaux » et plus précisément les genres écrits dans un processus et une
dynamique intra-littéraires. De surcroit, démontrer comment les genres oraux sont
transformés et réhabilités dans l’ungal dessine un nouveau rapport à ces genres et à
leur traitement, hors de leur contexte naturel d’existence et projette, par la même
occasion, une conception de l’ungal dans une perspective intra-générique et intra-
culturelle.
L’impact des approches immanentistes
14 À partir des années 2000, le discours critique s’engage dans une nouvelle voie avec une
tendance immanente très prononcée au niveau des études consacrées à l’ungal. Celles-ci
s’attèlent à la description de la forme et du discours « de » l’ungal par l’exposition de
plusieurs caractéristiques de sa poétique, répondant ainsi à des exigences d’ordre
interne. Cette orientation est réalisée, presque exclusivement, par les trois
départements de langue et culture amazighes (Tizi Ouzou, Bejaïa, et plus récemment
Bouira)9. Pendant longtemps, la tendance générale fut à l’approche sémiotique. Elle se
lit dans l’étude de F. Achili qui, en prenant pour objet la triologie de A. Mezdad (Iḍ d
wass, Tagrest urɣu et Ass-nni) tente d’y mettre en relief la structure narrative et
discursive (Achili, 2015). Dans la même lignée, O. Bourai, en faisant appel au même type
d’approche (dite sémiotique), se propose d’exposer l’organisation du discours du roman
Asfel sur le plan actoriel, spatial et temporel tout en s’attachant à relever les principales
oppositions sémantiques mises en place par le texte (Bourai O., 2007). N. Berdous
interroge, également, le volet narratif (techniques des points de vue, rapport
narrateur/narrataire) en relation avec la transition opérée de l’oral vers l’écrit. Elle
envisage la thématique de ces ungal comme l’un des plus grands aspects du renouveau
littéraire et affirme que les auteurs se sont beaucoup plus préoccupés de celui-ci,
négligeant le côté narratif, qu’elle juge très proche du style oral. Les techniques
narratives sont également explorées dans l’étude de F. Hacid (Hacid F., 2008) qui aborde
la problématique de la création littéraire kabyle à travers l’étude de la structure et de la
temporalité narratives dans le roman Iḍ d wass d’A. Mezdad. Dans la perspective d’une
combinatoire, celle de la sémio-anthropologie, nous avons consacré une étude à la
question de l’expression de l’identité dans le roman Tafrara de S. Zenia (Sadi N., 2011).
L’identité n’y est plus envisagée comme simple contenu mais en tant que procédé de
création littéraire intervenant à différents niveaux de la poétique de l’ungal,
notamment au niveau du narrateur, du personnage et de l’espace.
15 Il est d’ores et déjà possible d’observer que les textes de R. Aliche, d’A. Mezdad et de S.
Zenia occupent le pôle position en matière de corpus soumis à l’étude, ce qui contribue
non seulement à appuyer l’autorité de ces auteurs mais sert, également, à mettre en
lumière quelques caractéristiques de leur poétique. Ainsi en est-t-il de la première
étude entièrement consacrée au personnage, à savoir celle de N. Bellal qui part du
postulat que les personnages mis en scènes par A. Mezdad constituent des archétypes.
En joignant l’analyse sémiologique à l’approche sociologique, il explicite les différents
procédés usités par le romancier dans la constitution de ses personnages et tente d’en
fructifier la valeur idéologique en présentant la vision du monde de ce romancier
(Bellal N., 2012). Un autre texte du même romancier s’adonne, aussi, à une étude de
Multilinguales, 15 | 2021
38
type stylistique. K. Hireche aborde le discours féminin dans le roman Ass-nni d’A.
Mezdad en prêtant attention à la manière dont l’auteur fait parler les personnages
féminins en fonction de leur profil, de leur espace d’énonciation et des contenus
qu’investissent leurs propos (discours sur les droits de la femme, croyances, conditions
de vie, etc.) (Hireche K., 2017).
16 Bien qu’ils aient mis en avant l’insertion de l’ungal au sein d’un champ littéraire en
transformation, et l’ont représenté comme le véhicule de questionnements
idéologiques majeurs (l’identité principalement), la critique émanant des institutions
universitaires investit, notamment à partir des années 2000, la problématique de la
création littéraire (en se consacrant à la question du renouveau littéraire). Mais ceux-ci
dessinent, également, quelques grandes lignes de la poétique de ce genre en optant
pour des approches immanentistes bien que certaines d’entre-elles réduisent un temps
soit peu l’ungal à un « simple corpus d’application » (Salhi M. A. et Sadi N., 2016 : 31). En
effet, l’application de ces grilles d’analyse déjà toutes préconçues - quoique prises
comme un ensemble, elles esquissent quelques lignes de la poétique de l’ungal - régente
toutefois les dimensions de l’œuvre, désamorce sa charge symbolique et la détache de
son contexte qui façonne grandement les textualités et les conceptions qu’engendre ce
genre. Néanmoins, ce revirement de la critique, en basculant d’un discours « sur »
l’ungal vers un discours « de » l’ungal, n’est dû, en grande partie, qu’à l’entrée en jeu de
nouveaux paramètres comme l’institutionnalisation de la langue amazighe, son
intégration dans l’enseignement scolaire, la formation des premiers diplômés en langue
et culture amazighes, etc.
La codification de l’ungal
17 Comme il a été noté plus haut, les années 2000 représentent un marquage important
dans l’étude de la réception de l’ungal. Elles inaugurent les prémisses des
interrogations autour de la codification de ce dernier dont l’institutionnalisation ne
s’achemine pas de façon aisée. Cette phase de codification consiste à déconstruire
l’ungal en un ensemble de codes, de règles, de lois, permettant d’identifier les textes se
rattachant à cette même catégorie. Le soucis premier a été de délimiter le corpus
représentatif de ce genre, ce à quoi s’est consacré M. A. Salhi qui place l’élément
linguistique, en l’occurrence la langue kabyle, et l’attribution de la mention d’« ungal/
roman » que ce soit par l’auteur lui-même, l’éditeur ou le critique, comme premiers
éléments distinctifs de ce genre (Salhi M. A., 2011 : 82). Après avoir marqué cette
identité linguistique, le même auteur procède à la mise en comparaison des genres dits
« nouveaux » face à leurs prédécesseurs, à savoir la littérature kabyle traditionnelle. En
effet, l’identité de l’ungal s’élabore souvent en comparaison à la tradition orale, qui
n’admettait pas plusieurs des caractéristiques de ce genre. M. A. Salhi (2000) note, à ce
propos, que ces nouveaux genres
« se distinguent fortement des textes traditionnels par leur langue, leurthématique, leurs styles et leurs structures » (249).
18 A la même période (début des années 2000) le même type de réflexion s’entend chez A.
Mezdad10, mais à propos d’un texte bien particulier, Lwali n udrar de B. At Ali. Il voit
dans l’implication de B. At Ali dans ses écrits et la nomination des personnages des
signes de « pré-roman » (Mezdad A., 2000). La définition de l’ungal commence, alors, à
prendre place, engendrant des réflexions sur sa généricité11. En faisant reposer l’ungal
Multilinguales, 15 | 2021
39
sur trois dimensions essentielles (les actions, les personnages et l’intrigue), sans
lesquelles il n’y aurait de roman, A. Mezdad définit ce genre comme :
Une œuvre en prose généralement assez longue, dont l’intérêt est dans la narrationd’aventures, l’étude de mœurs ou de caractères, l’analyse de sentiments ou depassions, la représentation objective ou subjective du réel. C’est une œuvre qui doitcomporter une action et une intrigue, des personnages et quelques connaissancesgénérales ou spécifiques pour le côté documentaire. (Mezdad A., 2000).
Le roman s’érige, ainsi, en une sorte de passerelle entre la réalité et la fiction, en une
forme intermédiaire entre le réel et cette activité créatrice qui puise du premier en le
« symbolisant »12. Une idée que reprend, également, A. Ameziane : « écrire un roman est plus exigeant qu’écrire un simple récit car alors que le secondse contente de focaliser sur les événements, le premier exige de rendre compte dela complexité du monde » (Ameziane A., 2016).
19 L’ungal commençait, ainsi, à être de plus en plus pensé en tant que catégorie générique.
Et l’une des conséquences de l’émergence de ce débat s’est manifesté en termes
d’assignation générique. Celle-ci s’est observée notamment dans la chaîne de réception
qui s’est constituée autour de l’œuvre de B. At Ali dont la plupart des textes ne
véhiculaient nulle indication générique13. Et le texte Lwali n udrar, tout
particulièrement, a été sans cesse recontextualisé en vue de nouvelles relectures ayant
eu un impact direct sur sa reconfiguration générique, le faisant basculer de la catégorie
de conte, à nouvelle et enfin, au roman (Mohand Saidi S., Sadi N., 2016). Ces
classifications génériques variables ayant accompagné ces relectures successives sont
autant d’indications patentes de l’évolution de la réception et de l’horizon d’attente.
Sous l’effet de ces nouvelle données, de la croissance des publications romanesques en
langue kabyle et de la familiarisation de la critique avec l’ungal qui était, désormais, une
formulation générique « attendue », les critères ayant été usités pour la réception de ce
texte en tant que « conte » ont eux-même été sous l’emprise de cette mouvance.
N’ayant plus la même connotation générique d’antan14(Sadi N., 2019 : 108), ils sont,
dorénavant, représentés comme des éléments puisés de la tradition orale mais dont le
caractère subversif les engage au service de nouvelles esthétiques, dont l’ungal
(Ameziane A., 2008 : 100).
20 Mais en dépit de la variété de la production de B. At Ali et de sa profusion, cette
réception phénoménale n’a été rendue possible que dans la mesure où son œuvre
représentait en soi un enjeu. La période à laquelle elle fut produite (entre1945-1946) est
l’un des facteurs décisifs. Recontextualiser l’œuvre de B. At Ali dans le champ du
présent pour d’innombrables relectures sert, non seulement, à élaborer un marquage
temporel inaugurant une mutation au sein du système littéraire kabyle (naissance de la
littérature kabyle écrite) mais il représente, aussi, un enjeu symbolique consistant à
« faire date » (Bourdieu P., 1998 : 261) dans le champ littéraire algérien en attestant
d’une prise de position anciennement établie, plus ou moins concomitantes des
premières prises de position des littératures écrites dominantes (d’expression arabe et
française) au sein du champ littéraire algérien. En effet, « l’ancienneté est un élément
déterminant du capital littéraire » (Casanova P.,2008 : 33). Et au regard de l’évolution du
champ littéraire kabyle à la périphérie du champ littéraire algérien dominant
(détenteur du capital économique et politique), l’exhibition du capital littéraire et
culturel par la répertoriation d’un texte ancien qui s’est canonisé au fil des réceptions,
est, aussi, une stratégie d’acquésition du capital symbolique, une manière de rejoindre
ces luttes symboliques qui marquent les champs littéraires.
Multilinguales, 15 | 2021
40
La légitimation de l’ungal
21 Par discours de légitimation, il faut entendre tout processus de validation, de
reconnaissance d’une œuvre ( un texte, une catégorie de textes, un genre) émanant
d’une institution (université, prix littéraire, etc.) détentrice d’un capital symbolique lui
permettant de faire autorité et de consacrer la valeur littéraire, esthétique, générique
de cette œuvre qu’elle se propose de discuter. Le processus de légitimation peut être,
alors, entendu comme
« le discours des institutions qui concernent les sélections faites en vertu d’accord(ou de désaccord) aux règles, aux coutumes, aux normes établies » (Moisan C., 1987 :220).
De manière plus schématique, le discours de légitimation représente tout discours
critique qui consacre l’œuvre comme étant « sérieuse ». Par ricochet, le procédé de ce
même discours peut se manifester par un processus de « dé-légitimation » qui se
matérialise par la reconsidération de cette même valeur littéraire, esthétique ou
générique propre à une œuvre singulière.
22 C’est autour de la question des contiguités génériques -de plus en plus prégnante ces
dernières années- que s’énonce ce discours de légitimation autour de l’ungal. Cette
interrogation est une problématique de toutes les littératures. Le débat qui l’anime
émane, souvent, d’une opposition entre le discours des critiques, de nature plus
normatif, ne trouvant pas toujours échos dans les réalisations des auteurs qui ne voient
pas forcément dans la rigidité des critères que propose ce discours un rouage
essentielle à leurs productions. Pour le cas de la littérature kabyle, la dénomination
générique d’ungal est largement employée dans la désignation des productions
littéraires écrites en langue kabyle, mais elle réunit parfois des écritures d’apparence
dissemblables. Alors qu’une première constante reprend des critères largement
partagés par le roman occidental, la seconde entraîne des perspectives esthétiques
autres en empruntant à d’autres genres (comme tullist/nouvelle, tamacahut/conte) leurs
techniques. La production romanesque en langue kabyle ne présente, donc, pas un
corpus homogène en matière de généricité. Et de ce fait, la définition de l’ungal engage
deux voies divergentes au niveau de la critique. La première, plus normative, mobilise
des références cadrant avec la conception occidentale du roman, autant sur le plan
formel que du point de vue de l’élaboration de l’histoire. Ainsi, N. Aït Ouali (2015)
stipule que :
Le roman ou la nouvelle sont des produits d’une écriture créative qui sollicitel’imaginaire et le rêve. Refuser le monde dans lequel on vit et/ou dénoncer ce quis’y passe ne suffisent pas pour faire une œuvre littéraire. Il faut rêver et imaginerun autre monde, différent, possible ou utopique. C’est l’universalité de l’écriture quipermettra au lecteur de partager ce rêve, ne serait-ce que le temps de la lecture.(08)15.
23 Cette conception de l’histoire non exemplifiée par certains ungal, conjuguée à la
longueur de certains textes jugés trop courts, sont interprétés comme un facteur ayant
engendré « une véritable confusion des genres dans la littérature kabyle d’expression
amazighe » (Ait Ouali N., 2015 : 08). Mais cette « universalité de l’écriture » qu’évoque
N. Aït Ouali, n’est en fait que la manifestation des catégories littéraires occidentales
(voire françaises) s’étant imposées sur le monde littéraire par la forte domination de
l’espace auquel elles appartiennent (Casanova P., 2008 : XV). La globalisation du modèle
Multilinguales, 15 | 2021
41
romanesque comme modèle théorique ne peut se faire que par la relativisation de
certains « réflexes spontanés » et quelques « habitudes littéraires » qui verraient dans
certaines « déviations » génériques une hérésie ( Casanova P., 2008 : XIV). Il faudrait
plutôt songer -comme le note P. Casanova à propos de l’élaboration de son modèle
explicatif du fonctionnement de la république mondiale des lettres- à mettre en place
des outils qui puissent reconnaître une légitimité à d’autres littératures qui ne
fonctionnent souvent pas selon la même logique de cet espace dominant. L’esprit de
cette réflexion se lit chez M. A. Salhi (seconde orientation de la critique) où une nette
évolution se dessine dans son traitement de cette problématique. Après avoir affiché
des interrogations à l’égard de l’identité générique de quelques textes et de leur
éventuelle lecture en tant que nouvelles/tullisin (Salhi M. A., 2011 : 92-93)16, il tranche
sur la question dans une étude inédite, notamment en matière d’orientation théorique
dans le traitement de ce type de manifestations.
24 Il affirme que ces contiguïtés génériques ne représentent « ni une confusion des genres, ni
une anomalie éditoriale » mais bien une conséquence naturelle des cultures en
transformation (Salhi M. A., texte inédit). Des questionnements s’entendent, également,
chez Z. Meksem à propos de la variation des identifications génériques, vacillant entre
ungal et tullist, qu’on lui avait proposé pour son texte Tabrat n uẓekka. Bien que la
première de couverture indique clairement son identité d’ungal, Z. Meksem (2015)
choisit dans son mot d’auteur au début du texte, de laisser une ouverture à son
éventuelle lecture en tant que tullist : « aḍris-a nezmer, ahat, ad t-nwali d ungal acku deg
waṭas n tulmisin-is yeffel i tullist ; nezmer ad t-nwali d tullist acku wezzil ibedd s tuget ɣef
umazrar n tedyanin17 » (06). La présence de ce type d’interrogation indique au moins un
élément : Si l’on connait énormément de choses sur le roman, on en sait encore très
peu sur l’identité de l’ungal.
25 Cette difficulté de se départir de l’influence de l’école étrangère a irrémédiablement
marqué les appréciations de certains critiques en matière de légitimation du corpus
représentatif de l’ungal. Comme celui-ci ne s’engage pas dans une voie homogène,
notamment du point de vue de sa conception, les spécificités de ce corpus, fortement
imprégné de l’actualité géo-politique de l’espace auquel il appartient, ont parfois été
interprétées comme des insuffisances. La naissance d’un système littéraire écrit en
langue kabyle dont les genres le composant y ont, plus ou moins, pris place à la même
période, a fait que les frontières ont parfois été traversées pour emprunter certains
aspects propres à un genre ou à un autre (Sadi N., 2019). Si les tullisin/nouvelles18 ayant
adopté une conception se rapprochant de l’ungal, manifestant une poétique du
romanesque, n’ont pas été confrontées au discrédit de la réception, les « promiscuités »
de l’ungal avec d’autres genres comme tullist ou tamacahut/conte ont mis un point
d’orgue au niveau de la critique. À croire que le roman s’enferme dans une servilité
telle qu’il en devient fortement canonisé, que tout dépassement esthétique, poétique,
est interprété comme une défaillance. Or, le choix de ces conceptions « disparates »,
puisant de la prose orale, de tullist, etc., renseigne sur les significations de l’acte
d’écrire un ungal dont la valeur symbolique était, entre autres, de porter une langue
orale dans un genre « écrit », amenant les propriétés significatives de la mention
« ungal » à s’élargir dans une extension de sens qui l’assimile dans certaines de ses
réalisations à un « livre » écrit en langue kabyle, à un projet d’écriture dans une langue
qui était jusque-là orale (Sadi N., 2019 : 173). Et toute la difficulté de penser ces
« promiscuités » tient dans la position méthodologique à adopter. Repenser ces
Multilinguales, 15 | 2021
42
productions selon la logique du champ littéraire dans lequel elles sont réalisées, comme
le suggère P. Bourdieu dans sa théorie des champs, est une voie féconde dans l’étude
des genres littéraires.
26 Et dans cette perspective, la prise en compte de la singularité de ces conceptions en
tant que « contiguïtés génériques », pour reprendre la dénomination de M. A. Salhi,
représente en soi une position infiniment singulière au sein de la critique car elle
s’attache à rendre explicite le fonctionnement d’une littérature émergente en
élaborant de nouveaux codes de lecture et d’évaluation d’un système littéraire en
transformation dont ces contiguïtés génériques en sont la conséquence directe, selon le
même auteur. Et comme tout champ littéraire est un champ de lutte (Bourdieu
P., 1998 : 263), ces productions non canonisées exprimant ces contiguïtés ne sont en fait
qu’une réponse –parmi d’autres - que l’on avait oublié d’interroger par rapport à la
problématique à laquelle elle réagissait, à savoir la production d’une littérature écrite
en langue kabyle (Sadi N., 2019 : 316).
27 La réception intéragit, donc, bel et bien avec le champ littéraire et l’espace social dans
lequel celui-ci évolue. Les conditions défavorables qui ont longtemps couvé sur les
productions littéraires écrites en langue kabyle (absence de prise en charge éditoriale
des textes, publication à compte d’auteurs, invisibilité des textes, etc.) ont amené la
réception à s’organiser pour pallier ces conditions contraignantes. Elle a, ainsi,
contribué à faire émerger cette forme d’expression en lui consacrant études et comptes
rendus, contribuant à attester de son existence et à décrire les conditions dans
lesquelles elle évolue. Ces conditions ont amené la réception de l’ungal à s’adapter à ces
contraintes « externes » en déployant plusieurs stratégies de valorisation (notamment
au niveau des comptes rendus de lecture) visant à asseoir une certaine autorité à l’ungal
et à œuvrer à l’amélioration des conditions de son lectorat. Et dès lors que le champ
littéraire s’est vu attribué de nouvelles données (ouvertures des départements de
langue et culture amazighes, enseignement et institutionnalisation de la langue
amazighe), une nouvelle orientation de la critique de l’ungal prend place pour répondre
à des interrogations plus « internes » aux textes. C’est ainsi qu’à partir des années 2000,
s’élève tout un discours de légitimation de cette forme générique (centré autour de la
poétique des textes) s’accompagnant, également, d’une orientation à caractère plus
prescriptif, s’interrogeant à propos de la codification de l’ungal et de l’ambigüité de
certaines assignations génériques, perçues par certains critiques comme aberrantes.
Entre prescription et réflexions sur le corpus de l’ungal, ces discours dépendent
grandement des positionnements méthodologiques de ces critiques et du système de
références (souvent imprégnés des canons de la littérature occidentale) à partir duquel
ils discutent les textualités de ce nouveau genre, encore en construction.
BIBLIOGRAPHIE
ABROUS, Dahbia, La production romanesque kabyle : une expérience de passage à l’écrit, Chaker, Salem
(dir.), DEA, Université de Provence, 1989.
Multilinguales, 15 | 2021
43
ABROUS, Dahbia, « La littérature kabyle », Chaker, Salem (dir.), Encyclopédie berbère, n° XXVI,
Edisud, Aix en Provence, 2004, pp. 4067-4074.
ABROUS, Nacira, « Pensée pour Rachid Aliche, Auteur romancier d’expression kabyle. Encore un
rempart qui tombe », Mars 2008. Disponible sur : [URL] : http:// www.kabyle.net/ Pensée-pour-
Rachid-Alliche-Auteur, 3811.
ABROUS, Nacira, « Rachid Aliche : Ṣṣaba teğğa-d tayeḍ », La Dépêche de Kabylie, mars 2012,
Disponible sur : [URL] : http://www.depechedekabylie.com/ddk-tamazight/106630-rachid-aliche-
aba-tea-d-taye.html.
AIT OUALI, Nasserdine, L’écriture romanesque kabyle d’expression berbère, l’Odyssée, Tizi Ouzou,
2015.
AMEZIANE, Amar, Les formes traditionnelles dans le roman kabyle : du genre au procédé, Bounfour,
Abdellah (dir.), DEA, Inalco, 2002.
AMEZIANE, Amar, Tradition et renouvellement dans la littérature kabyle, Bounfour, Abdellah (dir.),
thèse de Doctorat, Inalco, 2008.
AMEZIANE, Amar, « La littérature kabyle dans l’expérience éditoriale du HCA. Quelques notes
exploratoires », Studi Africanistici, Naples, 2011, pp. 369-375.
AMEZIANE, Amar, « Une lecture de Yiwen wass deg tefsut, roman d’Amar Mezdad ». Disponible
sur : [URL] http://www.ayamun.com/Janvier2016.htm#Etude.
BELLAL, Hakima, « La question du genre entre le manuscrit de Belaïd At-Ali et son édition.
Regard sur trois textes Tafunast igujilen, Lexḍubegga et Sut taddart », Salhi, Mohand Akli (dir.),
Iles d imesli, n° 8, Tizi Ouzou, 2016, pp. 34-42.
BELLAL, Noureddine, Étude du personnage en tant que catégorie textuelle, dans les romans kabyles d’Amer
Mezdad, Bouamara, Kamel (dir.), mémoire de magister, université Abderrahmane Mira de Bejaïa,
2011/2012.
BOURAI, Ourdia, Asfel, étude narrative et discursive, Dourari, Abderrezak (dir.), mémoire de
magister, Ummto, 2007.
BOURDIEU, Pierre, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, Paris, 1998.
Casanova, Pascale, La République mondiale des lettres, Seuil, Paris, 2008.
CHAKER, Salem, « La naissance d’une littérature écrite. Le cas berbère (Kabylie) », Bulletin des
Études Africaines de l’INALCO, n° 17-18, 1992, pp. 7-21.
CHEMAKH, Saïd, « Salas d Nuja ou l’amour possible », Mars 2005. Disponible sur : [URL]:http://
www. tamazgha/fr//Salas-et-Nuja-ou-l-amour-possible, 1267, html.
CHEMAKH, Saïd, « Les conditions de production de la néo-littérature kabyle », Asinag, n° 4-5,
Ircam, Rabat, 2010, pp. 163-168.
HACID, Farida, « Amar Mezdad, tettḍilli-d ur d-tkeččem : ungal [roman], Ayamun, Bgayet, 2014,
210p. », Di Tolla, Anna Maria (dir.), Langues et Littératures berbères : Développement et standardisatio.
Quaderni di Studi Berberi e Libico-berberi, Naples, 2014, pp. 171-173.
HADDADOU, Mohand Akli, Dictionnaire des racines berbères communes, Alger, HCA, 2006/2007.
HAMIDOUCHE, Abdelkrim, « Tagrest urghu (hivers brûlant), un grand roman en Tamazight",
l’Hebdo n Tmurt, n° 23, Août 2000. Disponible sur : [URL] http://www.ayamun.com/
Novembre2000.htm#article.
Multilinguales, 15 | 2021
44
HIRECHE, Kahina, Tiɣunba n yinaw n tlawin deg wungal « Ass-nni » n Ʃmer Mezdad, Haddadou,
Mohand Akli (dir.), mémoire de magister, Ummto, 2017.
JAUSS, Hans Robert, Esthétique de la réception, Gallimard, Paris, 2010.
KHERDOUCI, Hassina, La chanteuse kabyle, une voix et une voie, La pensée, Tizi Ouzou, 2017.
LOIKKANEN, Sinikka, Vocabulaire du roman kabyle (étude lexico-statistique), Chaker, Salem (dir.),
DEA, 1998.
MEKSEM, Zahir, Tabrat n uẓekka, Tira, Béjaia, 2015.
MEROLLA, Daniella, De l’art de la narration tamazight (berbère), état des lieux et perspectives, Peeters,
Paris/Louvain, 2006.
MEZDAD, Amar « Vie et œuvre de Belaid At-Aâli, écrivain de Kabylie », 2000. Disponible sur :
[URL] :http://www.ayamun.com/Mai2000.htm.
MEZDAD, Amar, « Perspectives dans l’édition du roman berbère », Ayamun, n° 9, Novembre 2001.
Disponible sur : [URL] . URL : www.ayamun.com/Novembre2001.htm..
MOHAND SAIDI, Saïda et SADI Nabila, « Histoire de la réception des textes de Belaïd Ait Ali »,
SALHI Mohand Akli (dir.), Iles d imesli, n° 8, Ummto, Tizi Ouzou, 2016, pp. 51-59. Disponible sur :
[URL] : file :///C :/Users/DELL/Downloads/1474-5349-1-PB %20(3).pdf.
MOISAN, Clément, Qu’est-ce que l’histoire littéraire ?, Paris, PUF, 1987.
NAIT ZERRAD, Kamel, « Timlilit n t$ermiwin, s$ur Djamel Benaouf », Ayamun, 2001. Disponible
sur : [URL] : http://www.ayamun.com/Librairie.htm.
SADI, Nabila, L’expression de l’identité dans le roman Tafrara de Salem Zenia, Djellaoui, Mohamed
(dir.), mémoire de magister, Ummto, 2011.
SADI, Nabila, « Brahim Tazaghart, Inig Aneggaru : ungal [roman] », Di Tolla, Anna Maria (dir.),
Langues et Littérature berbères : Développement et standardisatio, Quaderni di Studi Berberi e Libico-
berberi, Naples, 2014, pp. 175-178.
SADI, Nabila, Problématique de l’écriture romanesque en « kabyle », thèse de doctorat, Salhi, Mohand
Akli (dir.), Ummto, 2019.
SALHI, Mohand Akli, « Les voies de modernisation de la prose kabyle », Actes du colloque
international. Tamazight face aux défis de la modernité, Boumerdès, 2000, pp. 244-251.
SALHI, Mohand Akli, « Iɣil d Wefru : Un grain dans la meule », Mensuel Iẓuran/Racines, n° 42, Mai
2003.
SALHI, Mohand Akli, « La nouvelle littérature kabyle et ses rapports à l’oralité traditionnelle »,
Kich, Aziz (dir.), La littérature amazighe : oralité et écriture, spécificités et perspectives, Actes du colloque
international, 2004, pp. 103-121.
SALHI, Mohand Akli, « Regard sur les conditions d’existence du roman kabyle », Studi Magrebini,
Naples, vol. IV, 2006, pp. 121-127
SALHI, Mohand Akli, Études de littérature kabyle, Enag, Alger, 2011.
SALHI, Mohand Akli et Sadi, Nabila, « Le Roman Maghrébin En Berbère », Contemporary French and
Francophone Studies, Irlande, vol. 20, 2016, pp. 27-36.
SALHI, Mohand Akli, Asegzawal ameẓẓyan n tsekla, l’Odyssée, Tizi Ouzou, 2017.
Multilinguales, 15 | 2021
45
SALHI, Mohand Akli et Ameziane, Amar, « Le livre littéraire kabyle : édition et éditeurs »,
Littératures en langues africaines. Production et diffusion, Karthala, Paris, 2017, pp. 315-330.
SALHI, Mohand Akli, « Texte inédit », à paraître.
SCHAEFFER, Jean-Marie, « Du texte au genre. Notes sur la problématique générique », Genette,
Gérard et Todorov, Tzvetan (dir.), Théorie des genres, Seuil, Paris, 1986, pp. 179-205.
OULD AMAR, Taher, « Quand les mots simples parlent de la vie », La dépêche de Kabylie, [en ligne].
URL : http:// www.bgayet.net/Salas-d-Nuja.html.
ZENIA, Salem, Zimu, Mourad et Kezzar, Meziane, « Écrire en kabyle aujourd’hui pour exister
demain », propos recueillis par LATEB Azzedine, La Tribune, 2011. Disponible sur : [URL] http://
www.djazairess.com/fr/latribune/50459.
أ ةليضف يليش ةيئاورلا دادزم رمعا ةيثالث يف يدرسلا باطخلا ،هاروتكد ةحورطأ ، وياروب ديمحلا دبع فارشإ، ،.2015 ،وزو يزيتب يرمعم دولوم ةعماج
،ةيدان سودربتافلؤم و ةيوفشلا ةيبعشلا ةياكحلا يف درسلا نيب ةنراقم ةسارد يلئابقلا يصصقلا رثنلا يف درسلا –
ةيلئابقلا ةياورلا و يلع ثآ ديعلب،.2001-2000 ،وزو يزيتب يرمعم دولوم ةعماج ،ريتسجام ةلاسر ،وياروب ديمحلا دبع فارشإ
دادزم رمعل ةياور يف ةيصنلا ةينبلا ،ةديرف ديسح ةعماج ،ريتسجام ةلاسر ،وياروب ديمحلا دبع فارشإ ،. 2008 ،وزو يزيتب يرمعم دولوم
NOTES
1. Le premier texte portant la mention paratextuelle de « ungal » en première page de
couverture est le roman Asfel de Rachid Aliche, publié en 1981. Néanmoins, la critique atteste,
présentement, le texte Lwali n udrar de Bélaid At Ali, écrit entre 1945-1946, comme le premier
ungal/roman de langue kabyle.
2. Faffa (1986) de R. Aliche et Askuti (1983) de S. Sadi.
3. L’analyse du lexique de six ungal dans une étude de S. Loikkanen, soutenue à l’institut des
langues et cultures orientales (INALCO), corrobore les résultats présentés par D. Abrous à propos
de la prédominance des néologismes et de la suppression des emprunts à l’arabe au sein des
premiers textes romanesques kabyles (Loikkanen S., 1998).
4. Des études plus récentes continuent encore à interroger cet aspect de la littérature kabyle
écrite. Cela peut s’appliquer à l’étude de la narration en berbère de D. Merrola où elle interroge
l’ungal, entre autres, en corrélation avec le contexte socio-historique des premières publications
romanesques (D. Merolla, 2006).
5. L’impact de ce capital symbolique en termes de valorisation et de légitimation est variable
selon le profil et la notoriété des auteurs de cette critique. L’étude de leur profil -qui serait sans
aucun doute intéressante- gagnerait davantage à intégrer parmi ses interrogations la question de
l’activité préfacielle. À titre d’exemple, les préfaces de deux textes (Asfel et Askuti), parmi les
premiers ungal, ont été assurées par M. Mammeri dont la notoriété contribue naturellement à
faire autorité.
6. Nous pensons, notamment, aux comptes rendus de M. A. Salhi (2003), de N. Sadi (2014), de F.
Hacid (2014), d’A. Ameziane (2016), etc.
7. C’est le cas des ungal d’A. Mezdad, de Tafrara et Iɣil d Wefru de S. Zenia, de Timlilit n tɣermiwin
de D. Benaouf, de Askuti de S. Sadi, etc.
Multilinguales, 15 | 2021
46
8. C’est le cas d’A. Ameziane qui insiste sur l’essoufflement progressif de la littérature kabyle
orale au profit d’une littérature écrite s’exprimant par le biais de nouvelles voies (Ameziane A.,
2008).
9. Il s’agit, notamment, de mémoires de magister au niveau des départements de Bejaïa et de Tizi
Ouzou, et de mémoires de master au niveau du département de Bouira.
10. A. Mezdad est l’auteur de plusieurs romans, d’un recueil de nouvelles et d’un recueil de
poésie.
11. J.-M. Schaeffer propose de distinguer entre « genre » et « généricité ». Alors que le premier
est une catégorie de lecture, dotée d’une composante prescriptive, agissant selon une fonction de
classification, la généricité traduit une relation d’appartenance dans toute sa dynamique et est,
par définition « une composante textuelle » susceptible d’être transformée et modulée (Schaeffer
J.-M., 1986).
12. La racine « NGL », du mot « ungal », est pan-berbère. Elle engage deux significations
divergentes. La première est relative à la « noirceur » (Haddadou M. A., 2006/2007 : 142). La
seconde, quant à elle, reprend la sigification de « symbole », de « paroles symboliques », de
« paroles à sens caché ». ( Salhi M. A., 2012 : 98)
13. Voir à propos de la question du genre dans l’œuvre de B. At Ali, l’étude de H. Bellal ( Bellal H.,
2016)
14. Parmi ces éléments, l’intitulé du premier chapitre de ce roman « sebba n tmacahut/l’argument
du conte », ainsi que le motif traditionnel de l’homme ordinaire devenant saint par un concours
extraordinaire des circonstances.
15. Cet ouvrage de N. Ait Ouali sur l’écriture romanesque en kabyle est le premier en son genre. Il
est, à la fois, introductif et descriptif de quelques aspects du corpus romanesque kabyle. L’auteur
y apporte son appréciation sur la qualité des ungal publiés (mais aussi sur des nouvelles) en
s’intéressant à leur dimension romanesque à travers l’analyse de plusieurs niveaux tels la
narration, les thématiques, le rapport à l’histoire, etc. Des études plus récentes proposent des
visions d’ensemble de l’ungal en exposant, de manière générale, la question du roman amazigh
(kabyle, rifain et chleuh). M. A. Salhi et N. Sadi interrogent le roman berbère dans le champ
littéraire maghrébin en abordant à la fois son corpus (d’un point de vue thématique) et son
contexte d’apparition et d’évolution (conditions de production et de réception) (Salhi M. A. et
Sadi N., 2016).
16. Il s’agit de Salas d Nuja de Brahim Tazaghart, de Bu-tqulhatin de Omar Dahmoune, de Ccna n
yibẓaẓ de Laifa Ait Bodaoud, etc.
17. « Nous pouvons envisager ce texte comme un roman car dans plusieurs de ses caractéristiques, il
dépasse la nouvelle. Nous pouvons l’envisager comme une nouvelle car de facture courte, il repose sur une
succession d’évènements ». C’est nous qui traduisons.
18. Il est possible de citer le cas des recueils de nouvelles Ameddakkel d tullisin niḍen et Ṭaṭabaṭaṭa,
respectivement de Mourad Zimu et de Mohand Arab Ait Kaci, qui arborent une généricité se
rapprochant davantage du romanesque.
RÉSUMÉS
Cette étude se propose de suivre le discours critique ayant accompagné l’ungal/roman de langue
kabyle et d’observer les jalons de son évolution au gré des enjeux du champ littéraire dans lequel
Multilinguales, 15 | 2021
47
il est produit. Il est question de voir la manière dont ces enjeux ont contribué à façonner les
lectures qu’elles soient de l’ordre de la recherche universitaire ou s’inscrivant dans un cadre plus
« informel » comme le cas des comptes rendus de lecture. L’objectif est de décrire la manière
dont la réception s’est organisée pour répondre à certaines problématiques de l’espace social, à
certains aspects contraignants du champ littéraire kabyle, et comment celle-ci s’est vue
transformée une fois que ce même champ s’était doté de nouvelles données.
This study is devoted to the analyse of the critical discourse that accompanied L’ungal/the berber
novel. It also observes the milestones of its evolution according to the challenges of the literary
field in which it is produced. This study aims to find out how these issues have contributed to
shape readings, whether they are of the order of the university research or part of a more
"informal" setting such as the case of reading reports. The objective is to describe the way in
which the reception was organized to respond to certain problems of the social space, to certain
constraining aspects of the Kabyle literary field, and how it was transformed once the same field
had new data.
INDEX
Mots-clés : Horizon d’attente, champ littéraire, positions, institutionnalisation, légitimation
Keywords : Horizon of expectation, literary field, positions, institutionalization, legitimation
AUTEUR
NABILA SADI
Département de langue et culture amazighes, Université M. Mammeri. Tizi Ouzou
Multilinguales, 15 | 2021
48
Tajeṛṛumt n tmaziγt de MouloudMammeri : terminologiegrammaticale et métalangage Tajeṛṛumt n tmaziγt by Mouloud Mammeri : grammatical terminology and
metalanguage
Mahmoud Amaoui
1 La publication de Tajeṛṛumt n tmaziγt1 de Mouloud Mammeri en 1976 marque une étape
importante à la fois dans le processus de grammatisation de la langue kabyle et dans la
constitution du métalangage scientifique dans les langues berbères. Pour être
historiquement le premier texte grammatical kabyle (et berbère) entièrement rédigé en
kabyle2, ce manuel met en œuvre une terminologie grammaticale, des techniques
discursives et des procédés morphosyntaxiques qui sont jusque là inconnus dans les
écrits berbères.
Le vocabulaire dit « technique » de Tajeṛṛumt a déjà fait l’objet d’une étude
systématique par R. Achab (1996 : 103-131). Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la néologie
lexicale comme le sont les autres vocabulaires analysés dans le même ouvrage de R.
Achab (Amawal, Mathématiques, Éducation…). Mais, comme on le verra plus loin, aborder
un tel vocabulaire dans le cadre de la terminologie grammaticale et plus généralement
de l’élaboration du métalangage en berbère conduit à des conclusions très différentes
de celles de l’étude des néologismes.
2 En nous inscrivant dans l’approche théorique des études linguistiques du métalangage
(notamment Rey-Debove, 1997), nous tenterons dans un premier temps d’inventorier le
lexique métalinguistique contenu dans le manuel de Mammeri avant de déboucher sur
l’étude de sa terminologie grammaticale3. Cette étude lexicale sera complétée par
quelques remarques d’ordre général sur les caractéristiques du métalangage berbère. A
partir d’un échantillon d’énoncés métalinguistiques extraits de Tajeṛṛumt, nous
examinerons deux aspects de cette question :
l’incidence des lacunes en terminologie grammaticale sur la constitution du discours
métalinguistique ;
•
Multilinguales, 15 | 2021
49
l’autonymie et ses caractéristiques morphosyntaxiques.
I- Tajeṛṛumt, son glossaire et son index
I.1. Le manuel
3 Le contenu et la structuration du texte de Tajeṛṛumt étant déjà décrits dans quelques
études (Achab, 1996 ; Elmedlaoui, 1998 ; Amaoui, 2013 et 2017), il n’y a pas lieu de
revenir ici sur ce point. Nous rappelons seulement que le texte de ce manuel
[pp. 13-109] comprend cinq parties de dimensions inégales couvrant les domaines
suivants : a) la phonétique ; b) le nom ; c) le verbe ; d) la particule ; e) les modalités de la
phrase (assertion, négation, interrogation). Ce texte proprement dit est :
précédé d’un glossaire bilingue (berbère-français) des « termes de la grammaire » (9-11) ;
suivi d’un index qui mêle terminologie et morphèmes grammaticaux (111-114).
C’est ce glossaire qui a le plus retenu l’attention de quelques auteurs qui ont abordé le
vocabulaire grammatical mis en circulation par Tajeṛṛumt. Mais comme on le verra ci-
dessous, le texte du manuel se révèle beaucoup plus riche en termes qui, de surcroît, ne
se réduisent pas à des unités isolées et monosémiques.
I.2. Le glossaire
4 Sous le titre de Amawal n tjeṛṛumt [vocabulaire grammatical], Mammeri dresse une liste
bilingue (berbère-français) de 148 vocables (dérivés et locutions compris). Mais
plusieurs indices montrent que ce titre est trompeur et qu’en réalité il ne s’agit là que
d’un glossaire de termes difficiles. D’une part, on peut constater qu’un tiers des termes
ne relève pas du domaine de la grammaire ni même plus généralement du lexique
métalinguistique. C’est le cas notamment des morphèmes grammaticaux acku « parce
que », maca « mais », war « sans » … et des mots mondains ou ordinaires tels que
amezruy « histoire » ou uṭṭun « numéro ». D’autre part, la liste ne contient aucun terme
complexe (composé ou syntagme) alors que le texte en contient des dizaines. Ainsi, on y
trouve par exemple les mots tanila « direction » et timmarewt « parenté » qui n’acquiert
le statut de termes grammaticaux qu’une fois combinés à de véritables mots
métalinguistiques : tazelγa n tnila « particule de direction », ismawen n timmarewt « noms
de parenté ».
5 Bien qu’il soit composé en partie de mots métalinguistiques (termes de grammaire), ce
glossaire contient aussi de nombreux mots qui, à la suite J. Rey-Debove (1997 : 26-27),
sont à ranger dans les catégories des mots mondains ou des mots neutres. Le tableau
suivant en donne un aperçu :
Mots métalinguistiques Mots mondains Mots neutres
amernu « adverbe »
amqim « pronom »
amyag « verbe
izri « passé (le) »
…
amezruy « histoire »
ifeḍ « infini (l’) »
tamrawt « dizaine »
uṭṭun « numéro »
…
aferdis « unité »
asmil « classe »
maca « mais »
war « sans »
…
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
50
I.3. L’index
6 L’index (uniquement en kabyle) rassemble les morphèmes grammaticaux ayant fait
l’objet d’une description et quelques termes métalinguistiques dont une dizaine
environ ne figurent pas dans le glossaire : ajemmal « collectif », amyaγ wwesswaγ« réciproque du factitif », asswaγ wwemyaγ « factitif du réciproque », attwaγ wwesswaγ« passif du factitif », aẓemẓi « diminutif », azgenaggaγ « affriquée », isem amyag « nom
verbal », tannumi « habitude ».
II- Code graphique et typographique
II.1. La langue-objet et le métalangage
7 En plus de la concision dans la structuration de l’ensemble du texte de Tajeṛṛumt bien
décrite par M. Elmedlaoui (1998 : 116-118), M. Mammeri a utilisé un code graphique et
typographique assez rigoureux4. Pour distinguer entre la langue-objet et la métalangue,
qui relèvent ici toutes les deux de la même langue (le kabyle), l’auteur a utilisé
systématiquement le caractère romain dans le premier cas et l’italique dans le
second (i.e. la représentation des exemples) :
amyag d awal ifettin almend wwudem :
zemreγ, tzemṛeḍ, izmer… (61)« le verbe est un mot qui se conjugue selon la personne (grammaticale) :
zemreγ, tzemṛeḍ, izmer… »
II.2. Les autonymes
8 S’agissant des séquences autonymes, l’auteur recourt, selon les cas, à deux conventions
différentes :
les guillemets doubles et le caractère italique dans le cas des mots libres : noms, verbes,
adverbes :
« tibṣelt » d asuf unti am « tiskert » (23)« « tibṣelt » est un singulier féminin tout comme « tiskert » »
Dans quelques cas néanmoins, les séquences autonymes sont introduites par le deux-
points et représentées en caractère italique sans les guillemets :« k » inṭeq d aggaγ di : akken, d azenzaγ di : akal (17)« « k » se prononce occlusif dans akken et spirant dans akal »
avant de rétablir juste après les guillemets pour les mêmes mots sans qu’on sache
pourquoi :maca ur izmir ara wawal « akal » neγ « akken » ad isâu sin inumak, yiwen s « k »
aggaγ, wayeḍ s « k » azenzaγ (17)« mais le mot « akal » ou « akken » ne peut pas avoir deux sens, l’un avec un « k »occlusif, l’autre avec un « k » spirant »
- les guillemets et le caractère romain dans le cas des lettres5 et de certains morphèmes
comme les particules : ttama n « γ » d « q » imesli dayem d ufay (p. 17)
« devant « γ » d « q » un son est toujours emphatique »
talγa yyimal t-tin wwurmir iwimi yezwar « ad » (p. 64)« la forme du futur est constitué de l’aoriste précède par « ad » »
•
Multilinguales, 15 | 2021
51
II.3. Les conventions ici adoptées
9 Pour notre part, nous avons utilisé dans les énoncés extraits de la grammaire la même
orthographe et les mêmes conventions graphiques et typographiques que celles
utilisées par l’auteur, sauf dans le cas des guillemets. Nous avons en effet substitué
systématiquement les guillemets en chevron simple (‹ ›) aux guillemets doubles (« »),
pour réserver l’usage de ces derniers à la traduction des exemples en français.
En dehors de ces extraits d’énoncés, nous avons adopté les conventions suivantes :le caractère italique sans les guillemets pour les termes métalinguistiques berbères non
autonymes ;
le caractère italique et les guillemets en chevron simple pour les autonymes ;
le caractère romain et les guillemets doubles pour les traductions en français.
III- Lexique métalinguistique et terminologiegrammaticale
III.1. Le vocabulaire métalinguistique
10 En nous fixant ici comme objectif l’étude du vocabulaire métalinguistique, défini
comme l’ensemble des mots destinés à parler du langage ou des mots polysémiques
dont un de leurs sens parle du langage (Rey-Debove, 1997 : p. 29), nous avons établi un
premier inventaire de 299 termes. Celui-ci contient aussi des termes, tels que les noms
de langues et de dialectes (12 termes), les noms de lettres (37 termes), certains mots
appartenant à la langue usuelle comme les verbes ini « dire », γer « lire », etc. Malgré
leur statut métalinguistique indéniable, ces termes ne font pas partie de ce qu’il
convient d’appeler traditionnellement la terminologie grammaticale ou linguistique.
D’ailleurs, exception faite de tamaceγt « langue touarègue », aucun des termes dont il a
été question ne figure dans le glossaire et l’index susmentionnés.
11 Cet inventaire fait apparaitre l’extrême rareté des verbes métalinguistiques. Pour
traduire les valeurs métalinguistiques les plus communes comme, « qualifier »,
« signifier », « préfixer »,… l’auteur de Tajeṛṛumt utilise des verbes ordinaires comme
mmel « indiquer », rnu « ajouter », sken « montrer ». Aussi de nombreuses formes
nominales traduisant des notions de grammaire des plus fondamentales n’ont-elles pas
de formes verbales correspondantes. Les néologismes asemmad « complément », ibaw/
tibawt « négation/négatif », ilaw « affirmatif » n’ont pas donné lieu à la création des
verbes « compléter », « nier », « affirmer ».
III.2. La terminologie grammaticale
12 Après l’élimination des termes évoqués ci-dessus, nous avons obtenu 239 termes [§
Annexe]. Comme tous les termes métalinguistiques (à l’exclusion des autonymes), leur
spécificité par rapport aux termes des autres domaines est d’ordre sémantique. Aussi,
n’y a-t-il pas de procédés morphologiques usités dans la formation de ces termes ni de
comportements syntaxiques qui leur sont propres. Il faut juste signaler qu’en berbère
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
52
les termes spécialisés (les domaines scientifiques et techniques notamment) sont en
majorité :
des néologismes obtenus par dérivation, composition ou glissement de sens ;
des traductions des termes usités en français.
Cette seconde caractéristique compte parmi les critères qui nous ont servi à attribuer le
statut de « terme de grammaire » à quelques mots et syntagmes pour lesquels il y a une
certaine hésitation. C’est le cas, entre autres, de tannumi « habitude », tiγri ineṭṭqen
« littéralement : voyelle prononcée »,... qu’on rencontre dans de nombreuses études
linguistiques et grammaires berbères6 composées en français respectivement sous les
dénominations de « forme d’habitude » et « voyelle pleine ».
13 Nous présentons brièvement ci-dessous les caractéristiques morphosyntaxiques de ce
vocabulaire grammatical. Des indications sur l’origine dialectale de quelques termes
(emprunt interne) nous sont fournies par des travaux antérieurs (Achab, 1997 :
103-131 ; Elmedlaoui, 1998 : 115-131).
Un premier type est constitué de termes métalinguistiques usités dans les différentes
langues et parlers berbères (emprunts internes). Il y a au total une vingtaine de termes
de ce genre : agemmay « alphabet » (chleuh), asekkil « lettre » (touareg), tutlayt
« langue » (chaouïa), awal « mot », isem « nom », tira « écriture » (divers parlers et
langues berbères), etc. Fait tout à fait remarquable, l’auteur de Tajeṛṛumt n’a pas eu
recours à l’emprunt externe (langues étrangères) pour constituer son vocabulaire
grammatical. Quelques termes seulement, souvent sous une forme berbérisée, sont
d’origine arabe : lmenṭeq « prononciation », taxtimt « désinence » et tunṭiqt « syllabe ».
Un second type regroupe les termes obtenus par différents procédés néologiques. La
néologie sémantique qui consiste à attribuer un sens grammatical à des mots ordinaires
est relativement bien représentée (plus de 40 termes) : afeggag « ensouple du métier à
tisser » : « radical (un) », tazelγa « particule » (« pièce » en chleuh), tiγri « voyelle »
(« appel » en kabyle), udem « personne grammaticale » (« visage » en kabyle et en
plusieurs langues et parlers berbères).
14 L’autre procédé néologique, de loin le plus usité, est la création de nouveaux termes à
partir de racines attestées dans les langues berbères. A quelques exceptions près, les
termes crées résultent de l’application des mêmes procédés que ceux qui ont court dans
d’autres domaines :
la composition (lexème + lexème) : asemmad n yisem « complément du nom », azgenaggaγ« affriquée », azgenaγri « semi-voyelle » isem n timarrewt « nom de parenté », tazelγa n tnila
« particule de direction ».
la dérivation (lexème + morphème) : amernu « adverbe » ( am + rnu « ajouter »), ameskan
« démonstratif » (am + sken « montrer »), arawsan « neutre » (ar + tawsit « genre »), armeskil
« invariable » (ar + ameskil « variable »).
15 Cependant, les termes forgés pour dénommer les trois principales formes dérivées du
verbe berbère, amyaγ « réciproque », asswaγ « causatif » et attwaγ « passif », présentent
une particularité quant à leur mode de formation. Les études qui ont abordé la
terminologie grammaticale de Tajeṛṛumt (Achab, 1997 ; Elmedlaoui, 1998 ; Berkai, 2002)
ne se sont pas arrêtées sur cette particularité. Si Elmedlaoui (son article n’aborde que
brièvement les procédés de formation) ne mentionne même pas les termes en question,
les analyses de Berkai et de Achab n’ont pas tenu compte de l’utilisation autonymique
des morphèmes qui rentrent dans la dérivation des trois termes. Ce sont en effet les
mêmes morphèmes my-, ss- et ttw-, qui servent à former des dérivés verbaux qui sont
•
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
53
utilisés (en les préfixant au verbe aγ « prendre, subir ») dans la formation des termes
qui les désignent :
aγ + my « morphème dérivationnel du réciproque » : amyaγ « réciproque »
aγ + ss « morphème dérivationnel du causatif » : asswaγ « causatif »
aγ + ttw « morphème dérivationnel du passif » : attwaγ « passif »
Relèvent aussi de cette catégorie deux composés construits sur le modèle morphème
grammatical autonyme + n + nom : d n tilawt « d de prédication » et d n tγara « d de
qualification ».
16 A ces deux principales catégories, s’ajoutent de nombreux termes de forme complexes
(essentiellement des syntagmes) de type : nom + adjectif : addad ilelli « état libre »,
amqim udmawan « pronom personnel » ; nom + participe : tiγri ineṭṭqen « voyelle pleine ».
Deux termes appartenant à cette catégorie « complexe » formés par la juxtaposition
deux de noms (apposition ou composition ?) sont à signaler : isem amyag « nom verbal »,
ismawen imḍanen « noms de nombre ».
Sur le plan sémantique, ces termes qui constituent le domaine de la grammaire
n’apparaissent pas comme un ensemble d’unités monosémiques sans liens entres elles
(ou, suivant le glossaire, une liste bilingue de termes biunivoques). Il y a lieu de relever,
d’une part, des relations de synonymie entre termes et des termes polysémiques :
synonymie : amagrad = tiγri n zdat « voyelle initiale » ; afeggag = tafekka « radical (le) ;
amaγun = amyag amaγun « participe (le) » ; ussid = tannumi « intensif (aoriste) » ; ussid =
aγezzfan « tendu (son) », etc.
polysémie : amagrad « voyelle initiale » et « article » ; ameskan « démonstratif » et
« présentatif » ; amḍan « nombre (grammatical) » et « nom de nombre » ; ussid « tendu
(son) » et « intensif (aoriste) » ; awṣil « affixe » et « indice de personne », mlelli « alterner » et
« se décliner ».
17 D’autre part, de nombreuses notions de grammaire sont rendues par des noms
composés de type nom + n + nom ou des syntagmes de type nom + adjectif (ou participe)
dont le sens est compositionnel, c’est-à-dire que le sens global résulte de l’association
du sens de chacun des constituants. Ces unités complexes sont en majorité formées en
ajoutant des déterminants aux noms présentateurs d’unités comme amernu « adverbe »,
amyag « verbe », tasγunt « conjonction », etc. :
amyag aḥerfi « verbe simple » ; amyag amagnu « verbe ordinaire » ; amyag n
tγara « verbe de qualité »amernu n tesmekta « adverbe de quantité » ; amernu n tibawt « adverbe de négation » ;amernu ukud « adverbe de temps »
IV- Quelques observations sur le métalangage et sonusage
18 Les observations sur les caractéristiques du métalangage kabyle que nous présentons
ici sont forcément partielles. Le corpus limité provenant d’un seul manuel de
grammaire kabyle ne nous permet ni d’explorer tous les aspects ni d’en généraliser les
caractéristiques à l’ensemble du berbère. Cette esquisse demande donc à être
complétée et approfondie en élargissant le corpus des grammaires unilingues et autres
textes métalinguistiques.
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
54
IV.1. Déficit terminologique et contournement du métalangage
19 Malgré le nombre relativement élevé de termes de grammaire identifiés, il reste que
cette terminologie est loin de couvrir l’ensemble des notions nécessaires à la
description morphosyntaxique de la langue, aussi sommaire soit-elle. Des termes
communs que sont syntaxe, fonction, morphologie n’y figurent pas. Certains y voient, à
juste titre, « le souci [de l’auteur] de préserver la transparence du texte, en évitant le
recours abusif aux néologismes » (Achab, 1997 : 119). M. Mammeri lui-même exprime
clairement cette volonté d’en faciliter l’usage à ses lecteurs dans l’Avertissement. Mais il
n’en demeure pas moins qu’il est difficile de faire l’économie d’une terminologie de
spécialité comme celle de la grammaire sans déboucher du même coup sur des énoncés
banals et imprécis, voire même insensés.
Une première conséquence de ce déficit en terminologie (surtout dans le discours
définitionnel) est de produire des définitions tautologiques. En voici quelques
exemples : sskanen medden kra s imeskanen (42)« on montre quelque chose à l’aide des démonstratifs »
amaţţar d awal iyes teţţren medden taγawsa (49)« l’interrogatif est un mot avec lequel on interroge à propos de quelque chose »
imassaγen teggen assaγ ger yisem d wemyag (p. 52)« les relatifs établissent un rapport entre le nom et le verbe »
On remarquera dans les trois exemples ci-dessus les définitions tautologiques résultant
des liens morphosémantiques entre le nom du terme défini et le verbe qui sert à le
définir : sken « montrer » / imeskanen « démonstratifs » ; amaţţar « interrogatif » / ţţer
« interroger » ; imassaγen « relatif » / eg assaγ « établir une relation ».
20 Dans d’autres cas, faute d’un terme métalinguistique approprié, l’auteur a recourt à des
périphrases ou tournures d’une banalité déconcertante :
anaḍ d maa d as tiniḍ i lbaaḍ ad ixdem kra :
aγ abrid-a (67)« l’impératif sert à demander à quelqu’un de faire quelque chose. [Littéralement :l’impératif c’est quand tu dis à quelqu’un de faire quelque chose] :
aγ abrid-a [prends ce chemin !] »
Si l’on se base sur la définition du dictionnaire de la linguistique, les deux termes mode
et ordre (ou injonction) sont nécessaires pour définir l’impératif (Dubois et al., 1973 :
251).zdat wurmir izmer ad yili ‹ awer › maa idaa bnadem s tigawt ur teţţili yara (104)« devant l’aoriste on peut utiliser ‹ awer › pour souhaiter qu’une action n’adviennepas ».[Littéralement : devant l’aoriste il peut y avoir ‹ awer › quand quelqu’un fait le vœuqu’une action ne soit pas] »
Le terme qui fait défaut dans ce second exemple (et qui aurait pu éviter à l’auteur le
recours à la périphrase) est l’optatif-négatif. C’est ce terme en tout cas ou son équivalent,
souhait négatif, qui est utilisé dans les descriptions et grammaires berbères rédigées en
français.
21 Les exemples de ce genre ne manquent pas dans le manuel de M. Mammeri. Il s’agit à
l’évidence d’un manque de termes métalinguistiques, qui trahit l’état des premiers
balbutiements du métalangage scientifique en berbère. Ce déficit ne concerne pas
seulement les noms métalinguistiques de noms d’unités (morphème, lexème, terme, etc.) ;
il se fait sentir dans les catégories de termes les plus diverses, comme l’absence de
Multilinguales, 15 | 2021
55
certains verbes à la fréquence très élevée dans le discours métalinguistique : définir,
dénoter, déterminer, signifier, traduire, etc. C’est aussi le recours à la périphrase ou encore
à des verbes ordinaires qui est utilisé pour pallier l’absence de termes exprimant des
valeurs sémantiques. Ainsi, dans les deux énoncés qui vont suivre, il s’agit
respectivement des équivalents en berbère des termes péjoratif et unité qui font défaut :
amalay yyisem illan d unti di lasel is iččemmit (p.25)« l’usage de la forme masculine pour les noms féminins exprime la valeur péjorative[littéralement : le masculin d’un nom, qui est féminin à la base, rend laid] »
llan yismawen immalen ajemmal n tγawsiwin. Talγa nnsen t-tamalayt. Talγa tuntit
d yiwet tγawsa seg-wjemmal (25)« il y a des noms dont la forme masculine indique le collectif quand la formeféminine indique l’unité. [Littéralement : … la forme féminine c’est une chose dansl’ensemble (collectif) »
IV.2. L’autonyme et ses caractéristiques morphosyntaxiques
22 Nous terminons ce survol en livrant les premières observations sur le fonctionnement
de l’autonymie en berbère. Comme dans toutes les langues du monde qui possède la
catégorie de nom, l’autonyme en berbère est un nom :
Le signe autonyme, quel que soit son signifiant, est un nom (noun). Il ne saurait enêtre autrement, car parler d’un signe c’est le prendre comme sujet du discours, et lesujet du discours possède, dans toutes les langues qui ont des noms, la fonctionnominale. Pour parler d’un verbe, d’un adverbe, il faut les nominaliser. (Rey-Debove, 1997 : 64).
C’est pour cette raison que les verbes aγ « prendre » et azzel « courir », dans l’énoncé
qui va suivre, fonctionnent comme de véritables noms : ‹ aγ › d ‹ azzel › ţţekkin deg-gwesmil-a [asmil 11], maca d iwḥiden (76)
« ‹ aγ › et ‹ azzel › font partie de cette classe [classe 11] mais ils sont les seuls en leurgenre »
23 La fonction nominale des deux « verbes » dans cet énoncé qui nous a servi d’exemple
est assuré par :
la position en tête d’énoncé en fonction d’indicateur de thème (antéposition au syntagme
prédicatifs verbal ţţekkin « ils font partie ») ;
l’intercalation du subordonnant d « et, avec ».
Peuvent être employés comme autonymes tout types de séquences (significatives ou
non significatives) : des syllabes, des morphèmes (libres ou liés) des particules, des
verbes, des noms, des phrases, etc. le genre masculin
24 Mais quelle que soit sa catégorie d’origine (verbe, nom, particule, etc.) en kabyle
l’autonyme est toujours un nom de genre masculin. Voici quelques exemples d’énoncés
où le sujet du verbe (représenté ici par l’indice de personne) est au masculin :
‹ am › issertay amagrad ‹ a › : am-maman (si : am waman) (93)« ‹ am › assimile la voyelle initiale ‹ a › :am-maman (de : am waman) »
‹ ddeqs › izmer daγ ad isselkem awṣil udmawan (90)« ‹ ddeqs › peut aussi être suivi d’un pronom affixe du nom »
l’état libre
•
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
56
Tous les noms, adjectifs et adverbes qui connaissent la forme d’état d’annexion dans
certaines conditions syntaxiques demeurent, dans les mêmes conditions syntaxiques, à
l’état libre quand ils sont autonymes.‹ tibṣelt › d asuf unti am ‹ tiskert › (23)« ‹ tibṣelt › est un singulier féminin tout comme ‹ tiskert »
‹ ara › d ‹ acemma › γursen amaruz (103)« ‹ ara › et ‹ acemma › ont la forme d’état annexion »7
Dans les deux derniers exemples ci-dessus, du fait de leur emploi autonymique, le nom
tiskert et l’adverbe acemma ne sont pas à l’état d’annexion même s’ils sont reliés aux
morphèmes antécédents respectivement par la préposition am et le subordonnant d. En
l’absence de présentateur métalinguistique, la forme d’état libre (ou plutôt absence de
l’état d’annexion), caractéristique des autonymes, participe à la levée de l’ambiguïté qui
peut exister dans certains énoncés entre mots autonymes et mots ordinaires.les fonctions syntaxiques
25 Dans un énoncé métalinguistique, les séquences autonymes peuvent normalement
assumer toutes les fonctions qu’assume un nominal dans un énoncé non
métalinguistique : indicateur de thème, complément explicatif, expansion objet directe,
expansion objet indirecte. Mais il semble que la fonction de complément explicatif soit
rare ou improbable dans certains cas et impossible dans d’autres. De toute manière,
comme il apparait dans la plupart des exemples ci-dessus, il y a une nette préférence
pour la mise en tête d’énoncé des autonymes (indicateur de thème). Sans doute à cause
de la forme d’état libre caractéristique des autonymes, certains autonymes ne peuvent
apparaitre sans le nom présentateur métalinguistique après le syntagme verbal en
fonction de complément explicatif. Ainsi dans énoncé :
‹ annar, inurar › s-teqbaylit iban-d amzun t-tasureft. Di tilawt ur isuref ara, acku dilaṣel-is asuf d ‹anrar › (30). « ‹ annar, inurar › en kabyle semble être une exception. En réalité, il ne l’est pasparce que à l’origine son singulier c’est ‹ anrar › »
le déplacement de la séquence autonymes ‹ annar, inurar › après syntagme verbale (tout
à fait envisageable dans un énoncé ordinaire) est peu probable, sinon impossible8 :* s-teqbaylit iban-d ‹ annar, inurar › amzun t-tasureft […]
l’apposition
La présence d’un présentateur d’autonyme (généralement un nom métalinguistique
comme awal « mot », isem « nom », amernu « adverbe », etc.) qui signale l’autonyme,
forme en même temps avec le mot qu’il présente une construction qui n’existe en
kabyle que dans la phrase métalinguistique : l’apposition. Ainsi, dans l’exempleisem ‹ argaz › γures 3 talγiwin (31)« le nom ‹ argaz › possède 3 formes »
26 Les deux noms isem et argaz sont en apposition puisque, en plus d’être à l’état libre, ils
sont juxtaposés. En berbère, une telle construction est impossible dans un énoncé
ordinaire sans une préposition qui reliera les deux noms. Cependant, cette forme de
l’état libre, comme on peut le constater dans l’exemple qui va suivre, ne concerne que
l’autonyme ; le présentateur métalinguistique peut prendre la forme d’état d’annexion :
ur izmir ara wawal ‹ akal › neγ ‹ akken › ad isâu sin inumak, yiwen s ‹ k › aggaγ,
wayeḍ s ‹ k › azenzaγ (17)« le mot ‹ akal› ou ‹ akken › ne peut pas avoir deux sens (différents), l’un avec un ‹ k ›occlusif et l’autre avec un ‹ k › spirant »
27 A l’oral, en l’absence d’études des marques phoniques de l’autonymie en kabyle (et en
berbère de manière générale), il est encore difficile de déterminer avec certitude les
•
• ◦
Multilinguales, 15 | 2021
57
phénomènes prosodiques qui la caractérisent. Mais nous pensons qu’il existe des
moyens prosodiques (accentuation ? pause ?) dont la finalité est d’individualiser ou de
mettre en évidence en quelque sorte la séquence autonyme dans l’ensemble de l’énoncé
pour éviter une éventuelle ambiguïté. Il est vrai que l’apposition (juxtaposition de deux
termes dont le premier est un nom présentateur métalinguistique) permet de
désambiguïser l’énoncé. Cependant, même dans les cas où ce risque d’ambiguïté est
totalement absent, il existe une certaine manière de réaliser l’autonyme.
Notre étude a révélé que la terminologie grammaticale employée dans le texte de
Tajeṛṛumt est beaucoup plus riche que ne laisse apparaitre le glossaire au début de
l’ouvrage. Mais malgré tout, un déficit énorme en la matière est nettement perceptible
dans le discours métalinguistique. Cette situation a bien évidemment un coût : il se
traduit dans le discours métalinguistique quelquefois par des définitions tautologiques
et un contournement du métalangage.
28 En attendant l’analyse d’autres documents pour approfondir notre connaissance du
métalangage berbère, cette grammaire, au demeurant bien rédigée et respectant les
conventions graphiques et typographiques du métalangage scientifique, donne à voir
les principales caractéristiques de l’autonymie en kabyle : un nom masculin à l’état
libre qui, précédé d’un morphème présentateur, forme le second terme d’une
apposition.
BIBLIOGRAPHIE
ACHAB, Ramdane, La néologie lexicale berbère (1945-1995), Peeters, Paris-Louvain, 1996.
AMAOUI, Mahmoud, « Grammaires berbères : Tajeṛṛumt n tmaziɣt de Mouloud Mammeri », in
Corpus des Textes Linguistiques fondamentaux (CTLF), [Disponible sur : http://ctlf.ens-lyon.fr/
n_fiche.asp?n=567 ], 2013.
AMAOUI, Mahmoud, 2015, « La terminologie berbère de linguistique dans la grammaire de Saïd
Hanouz » in Études et recherches en linguistique et littératures amazighes, Université Saïs-Fes, pp.
175-185.
AMAOUI, Mahmoud, Le processus de grammatisation du kabyle, Thèse de Doctorat, Université
Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, 2017.
BERKAI, Abdelaziz, Essai d’élaboration d’une terminologie de la linguistique en tamazight, Mémoire de
Magistère, Université de Bejaïa, 2002.
Dubois, Jean et al., Dictionnaire de linguistique, Librairie Larousse, Paris, 1973.
ELMEDLAOUI, Mohamed, « Tajerrumt de Mouloud Mammeri : lecture analytique », Awal, 18, 1998,
pp. 115-131.
MAMMERI, Mouloud, Tajeṛṛumt n tmaziγt (tantala taqbaylit). Grammaire berbère (kabyle), Maspero,
Paris, 1976.
Multilinguales, 15 | 2021
58
REY-DEBOVE, Josette, Le métalangage. Étude linguistique du discours sur le langage, Armand Colin, Paris,
1997.
NOTES
1. Le titre complet (bilingue) est : Tajeṛṛumt n tmaziγt (tantala taqbaylit). Grammaire berbère
(kabyle).
2. Il existe cependant une grammaire berbère bilingue (textes en kabyle et en français) publiée
en 1968 par Saïd Hanouz sous le titre de Grammaire berbère. La langue. Les origines du peuple
berbère. Mais pour des raisons qui tiennent à la fois à l’analyse grammaticale adoptée et à la
terminologie qui l’exprime, cette grammaire ne s’inscrit pas dans la tradition grammaticale
berbère inaugurée par les savants européen vers la fin du XVIIIe siècle (Amaoui, 2015).
3. La notion de Terminologie grammaticale est utilisée ici au sens large incluant des termes de la
linguistique descriptive : phonétique, écriture, morphologie, syntaxe, sémantique.
4. Malgré l’intérêt porté à la forme et à la structuration du texte de Tajeṛṛumt, M. Elmedlaoui n’a
pas fait mention dans son article de ce code graphique et typographique.
5. Il faut préciser qu’à strictement parler les noms de lettres, de sons ou de phonèmes n’ont pas
d’autonymes (Rey-Debove, 1997 : p. 116).
6. Dans cette perspective, il y a lieu de citer : Essai de grammaire kabyle (1858) d’Adolphe
Hanoteau, La langue berbère. Morphologie. Le verbe - Étude de thèmes (1929) d’André Basset et
Éléments de grammaire berbère, Kabylie (Irjen) (1948) d’André Basset et André Picard.
7. Cet exemple présente un des types de paradoxes bien connus en philosophie du langage : en
même temps qu’il est affirmé que ‹ ara › et ‹ acemma › ont la forme d’état annexion, l’adverbe
acemma n’est pas à l’état d’annexion.
8. Un tel déplacement entrainerait nécessairement la forme d’état d’annexion (exclue dans le cas
des autonymes), seule marque qui distingue entre le complément explicatif et l’expansion objet
directe.
RÉSUMÉS
Premier manuel de grammaire kabyle (et berbère) rédigé entièrement en kabyle, Tajeṛṛumt n
tmaziγt de Mouloud Mammeri est, par là même, la première tentative de construire un discours
métalinguistique en cette langue. Aussi, cette contribution se penche-t-elle sur l’analyse de
quelques aspects du métalangage scientifique usité dans ce manuel : le lexique métalinguistique
et les caractères linguistiques de l’autonymie, plus particulièrement.
Being the first Kabyle (and Berber) grammar manual entirely written in Kabyle, Mouloud
Mammeri’s Tajerrumt n tmaziγt is also the first attempt to build a metalinguistic discourse in this
language. This contribution focuses on the analysis of some aspects of scientific metalanguage
used in this manual : the metalinguistic lexicon and more particularly, the linguistic characters
of autonymy.
Multilinguales, 15 | 2021
59
INDEX
Keywords : autonymy, grammar, Kabyle, metalanguage, terminology
Mots-clés : autonymie, grammaire, kabyle, métalangage, terminologie
AUTEUR
MAHMOUD AMAOUI
Université Abderrahmane Mira – Bejaia
Multilinguales, 15 | 2021
60
Autour de l’acte humoristique enAlgérie : le français au service del’impliciteAround the humoristic act in Algeria : the french language at the service of the
implicit
Radia Touati
1 L’humour a, de tout temps, accompagné les révolutions algériennes en offrant un
espace matriciel de développement d’une pensée critique, et ce, en s’interrogeant et
interrogeant les valeurs qui unissent les sociétés. Dans son expression spontanée, le
rire a tendance à délier les langues et les pensées. La période du Hirak1 algérien est
marquée par une lourde censure, qu’elle soit journalistique ou non, qui porte préjudice
à la réflexion. En effet, les nombreuses arrestations connues durant cette période
tendent à réprimer la créativité. El Manchar fait partie de ces médias qui ont bravé
l’interdit et a multiplié les publications comme « arme redoutable.2 » (Dahak. B, 2018 :
15)
De ce fait, l’engagement de l’auteur apparait à travers une dénonciation par la dérision
tissée dans un discours souvent implicite. En effet, face à la situation politique « tellement critiquée » du pays et le « ras le bol » exprimé par le peuple, El Manchar a
su désamorcer la pression sociale offrant ainsi au peuple un moment de récréation
alliant la réflexion sérieuse et le rire salutaire.
2 Par ailleurs, la problématique de l’humour nous amène à nous interroger à propos du
concept lui-même et de l’effet susceptible qu’il engendre. L’humour ne fait pas
forcément rire, à ce titre, l’humour peut déplaire, « L’humour, c’est le droit d’être
imprudent, d’avoir le courage de déplaire, la permission absolue d’être imprudent3 ». C’est
cette imprudence que s’autorise l’auteur d’El Manchar qui fait de son journal le premier
en Algérie rédigé dans une tendance satirique. À cela s’ajoute le recours à du
vocabulaire faisant partie de la culture algérienne (le nôtre4) que le chroniqueur
communique à travers la langue française. Ce qui nous interpelle et nous amène à nous
intéresser à la question du Même et de l’Autre dans le discours humoristique du journal
Multilinguales, 15 | 2021
61
et le rôle de la langue française dans la mise en relief de la culture algérienne et le
comportement sociétal et individuel.
Ainsi, nous proposons une analyse du discours humoristique qui vise à démontrer
comment l’énonciateur (El Manchar) exploite la langue française (l’Autre) afin de faire
rire l’Algérien (le Même, le nôtre). Pour ce faire, nous proposons de cerner notre étude
autour des questions de recherche suivantes :Quelles sont les caractéristiques propres au discours humoristique d’El Manchar ?
Dans quelle mesure la langue française impacte l’expression de la culture algérienne ?
3 Afin de répondre à ces questions, nous proposons ces hypothèses de réponses qui nous
aideront à orienter et à organiser notre travail de recherche. Ainsi, nous posons comme
première supposition que le contexte socio-politique algérien représente un
environnement qui se prête aux différentes dérisions qu’exploiterait El Manchar
comme « arme pacifique » pour dénoncer les pratiques du régime en place. Dans un
second temps, nous supposons que l’exploitation de compétences linguistiques et
encyclopédiques en langue française pourrait aboutir à une structure humoristique à
même de faire réagir tant le peuple, destinataire des textes, que le régime en place ciblé
par le discours. Dans un troisième temps, les éléments culturels du Même et de l’Autre
auxquels recourt l’auteur pourraient fournir une structure linguistique et
interculturelle qui, fusionnée dans un discours humoristique, fait la particularité des
textes d’El Manchar.
4 Aussi, pour vérifier nos hypothèses et répondre à nos questions de recherche, nous
proposons de nous référer aux orientations théoriques de Catherine Kerbrat
Orecchionni et de Patrick Charaudeau, ainsi que d’Abdallah Pretceille Martine dont les
différentes définitions nous servent de balise à notre étude. Notons également que la
collecte de notre corpus s’est effectuée à partir de la page Facebook ainsi que le site
officiel du journal5 En tout, cinq articles ont été sélectionnés et en partie exploités dans
la présente étude. Notre corpus s’est enrichi par un entretien accordé par l’auteur du
journal, en l’occurrence, Nazim Baya.
1. Quelques particularités du discours humoristiqued’El manchar
5 Afin de cerner les caractéristiques qui définissent les textes du journal, nous proposons
un bref descriptif des acteurs d’un acte humoristique, des effets attendus et des
catégories de discours humoristiques. Ces éléments descriptifs que nous empruntons à
Patrick Charaudeau nous permettent de situer les écrits d’El Manchar.
1.1. Les protagonistes de l’acte humoristique
6 L’acte humoristique6 est une situation de communication qui met en interaction trois
acteurs que Patrick Charaudeau nomme : le locuteur (chroniqueur), le destinataire et la
cible.
a. Le locuteur
7 Concernant notre étude, le locuteur produit des articles dans le cadre d’un journal, de
ce fait, il est considéré comme étant un chroniqueur. Ce dernier puise la légitimité de
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
62
ses productions dans le rapport qui les lie au public cible, à savoir, un lectorat algérien
âgé entre 20 et 40 ans qui comprend et lit la langue française.
Le chroniqueur d’El Manchar commente l’actualité algérienne et mondiale en ornant
les textes de traits humoristiques. « Le journal a vu le jour en 2013 sous forme d’une page Facebook avant de se doterde son propre site web en 2015 (https://el-manchar.com/). C’est un site dontl’organisation déroge aux règles traditionnelles de la presse qu’on connait jusque-là. Le fondateur du site est un jeune pharmacien algérois, Nazim Baya. À 31 ans, cejeune développeur web a réussi à réunir des collaborateurs afin de lancer la pageFacebook du journal (lancée en 2013) avant de passer à la vitesse supérieure enlançant le site web. » (Guettaf. F, Reggad Malki. F, 2017 : 3)
8 Ainsi, d’une page Facebook qui partage quelques blagues à un site internet (crée en mai
2014), le fondateur d’El Manchar, Nazim Baya, a su imposer le discours humoristique
définissant son journal comme étant « un site de fausses informations et complètement
saugrenues ». En plus de s’adresser à un public spécifique7, le chroniqueur recourt
presque exclusivement à la langue française pour la rédaction de ses articles, et justifie
ce choix par l’aisance qu’il éprouve à rédiger en langue française plutôt qu’en langue
arabe.
b. Le Destinataire
9 Les articles publiés par les collaborateurs du journal satirique El Manchar trouvent
chez le public algérien un large écho. Ce dernier se vérifie à travers le nombre
d’abonnés aux différentes pages sur les réseaux sociaux. Pour ne parler que du réseau
social Facebook, la page El Manchar compte 514 776 abonnés. Par ailleurs, le réseau
social Facebook nous permet de remarquer que le public algérien n’est pas le
destinataire exclusif. En effet, les articles s’adressent à tout algérien vivant ou non en
Algérie, mais également, à tout citoyen du monde qui se reconnait à travers le discours
de l’auteur.
10 Charaudeau évoque le public qu’il définit comme étant le « complice » du locuteur.
Ainsi, le peuple « est appelée à partager la vision décalée du monde que propose
l’énonciateur, ainsi que le jugement que celui-ci porte sur la cible. » (2006 : 23).
Ajoutons à cela le lien qui relie l’auteur du journal à ses lecteurs. Selon Patrick
Charaudeau « [...] ne produit pas un acte humoristique qui veut, sans tenir compte de
la nature de son interlocuteur, de la relation qui s’est instaurée entre eux, des
circonstances dans lesquelles il est produit. » (2006 : 22)
c. La cible
11 Le régime politique algérien trouve également « une place de choix » de destinataire
dans les écrits d’El Manchar. En plus d’être la cible des différentes fausses informations,
les dirigeants politiques algériens se voient destinataires d’un discours teinté de
dérision. En effet, que ce soit pendant la période du soulèvement populaire (le Hirak)
dont le déclenchement remonte au 22 février 2019, ou l’apparition de la pandémie de la
COVID-19, le régime politique algérien a contribué dans une large mesure à
l’inspiration du chroniqueur et a motivé la plupart des textes publiés.
Multilinguales, 15 | 2021
63
1.2. Les portées contingentes de l’humour
12 La connivence ludique permet de transformer la fatalité de la situation socio-politique
algérienne en un discours ludique. Elle représente
« un enjouement pour lui-même dans une fusion émotionnelle de l’auteur et dudestinataire, libre de tout esprit critique, produite et consommée dans une gratuitédu jugement comme si tout était possible » (Charaudeau, 1996 : 36).
L’algérien, destinataire et récepteur du texte d’Al Manchar suivant : « Insolite : il prend
une année sabbatique pour retirer de l’argent dans un bureau de poste »8, conçoit comme
possible la situation décrite par l’auteur et qui met en scène un personnage fictif « Salim » qui décide de prendre un congé afin d’effectuer un retrait d’argent au bureau
de poste. Cette « fausse information » est produite pour souligner la gestion des
services de la poste algérienne. Cette dernière fait des files d’attente dans les bureaux
de poste, un chainon interminable.
13 La connivence critique correspond pleinement aux écrits du journal dans la mesure où
il propose au lecteur une dénonciation du régime en place. Par cette dernière, l’auteur
« cherche à faire partager l’attaque d’un ordre établi en dénonçant de faussesvaleurs » (Charaudeau, 1996 : 36).
Nous retrouvons cet effet de sens dans l’exemple suivant : « De retour au pays, Tebboune
estime que l’Algérie devrait se doter d’hôpitaux » (El Manchar, 2020). L’auteur, dans cet
exemple, attribue à l’actuel président de la République une préoccupation qu’il ne
semble pas avoir. El Manchar suppose que Tebboune ne connait pas les hôpitaux, car
inexistants en Algérie. C’est après son retour d’Allemagne, où il a effectué un
déplacement, pour des soins médicaux, qu’il a eu l’idée d’en avoir dans son propre
pays : « Pour son excellence, le voyage en Allemagne était à la fois médical et spirituel.Entre deux intubations trachéales, le président a beaucoup pensé, murementréfléchi et n’a pas hésité à s’inspirer du mode de vie allemand. “Ce qui m’a frappé,ce n’est pas les routes, ni les écoles, ça on y travaille et on les aura bientôt. Mais j’aidécouvert une chose toute particulière : Un établissement charitable où les citoyensreçoivent des soins. On y trouve un personnel soignant qui prend en charge despersonnes malades. Ils appellent ça Krankenhaus, et en français c’est hôpital.L’Algérie devra en avoir un, ça vous évitera de mourir” a estimé le président. » (ElManchar, 2020)
Les appellations « Notre père » et « Son excellence » désignent toutes deux Abdelmadjid
Tebboune, également nommé « Le président ». Nous nous sommes interrogés sur la
raison de ces dénominations et leurs significations.
14 Concernant l’expression « notre père », il nous semble qu’elle comporte une charge
sémantique importante. En effet, le père joue un rôle primordial dans la culture
magrébine, car, selon Le Camus cité par Kettani Myriam :
« l’identité paternelle comporte trois dimensions, liées au rôle du père : la présenceen termes d’investissement et de stabilité [...] » (2015 : 60).
Le père est, de ce fait, le garant de la stabilité du foyer et le pourvoyeur de la
protection. En s’en allant en Allemagne, le « père » auquel fait référence l’auteur d’El
Manchar, laisse les citoyens qu’il sert, de ce fait, il n’assure pas sa place de père de la
nation. C’est là que réside la « fausse valeur ». Aussi, pour l’appellation « Son excellence », Monsieur Tebboune, dès le début de son mandat, a déclaré publiquement :
« Lors de sa prestation de serment en décembre dernier, le président avait déjàsouhaité ne plus voir le terme “Son excellence” précédé son nom et prénom “Si je
Multilinguales, 15 | 2021
64
réussi, aidez-moi et encouragez-moi, et si j’ai failli, corrigez-moi. Le culte de lapersonnalité est révolu dans l’Algérie nouvelle”, avait déclaré le chef de l’état. » .
15 Le président ne veut plus qu’on l’appelle par « Son excellence », il veut se mettre sur le
même plan que ses concitoyens. Néanmoins, en allant dans un pays étranger pour
recevoir des soins, il montre également une autre « fausse valeur ». Il ne s’aligne pas
sur le même plan que son peuple. Le journal, en l’appelant par « Son excellence » met
l’accent sur cela. La connivence de dérision vise, pour effet, la dévalorisation de la cible
du discours humoristique, et ce, en cherchant « à faire partager cette insignifiance de
la cible lorsque celle-ci se croit importante (ou lorsqu’on croit qu’elle se croit
importante) » (Charaudeau, 1996 : 36). C’est ainsi que l’ancienne députée algérienne se
voit tournée en dérision dans l’article intitulé : « Le shour9dément : je n’y suis pour rien.
Naïma Salhi est juste idiote »10. Cette ex-députée jouissait d’une immunité parlementaire
due à son statut politique, ce qui lui confère une importance sur la scène politique. Ses
discours, qualifiés de haineux, lui ont valu une plainte déposée à son encontre le 09 juin
2019 par des militants opposants ainsi que des avocats lui reprochant une « incitation à
la haine raciale et appel au meurtre » (El Watan, 2021).
16 El Manchar, quant à lui, tourne le discours de l’ex-députée en dérision faisant parler « Shour » : « Outré par les propos de la députée, le shour a régi en déniant toute
responsabilité quant à l’indigence politique de Naïma Salhi […] qu’il qualifie de
délirantes et de diffamatoires. ». Ce faisant, l’auteur rétablit la responsabilité des
propos et désigne Naïma Salhi comme seule responsable. C’est ainsi que dans son texte,
El Manchar dévalorise la députée en la qualifiant « d’idiote » dès le titre par les
expressions « délirante », « diffamatoire » et « indigence politique ».
1.3. Le triangle humoristique
17 À l’image du triangle didactique de Jean Houssaye, nous constatons que le discours
humoristique d’El Manchar implique, tel que le stipule Patrick Charaudeau, trois
protagonistes. Nous suggérons que les interactions entre ces acteurs, souvent ornées
d’éléments culturels partagés par les différents acteurs, participent à la structuration
du discours humoristique.
Nous proposons le schéma suivant qui représente le processus interactif entre les
protagonistes. Ceci nous amène à constater l’importance de la langue et de la culture
dans la transmission du discours humoristique d’El Manchar exprimé dans la langue de
l’Autre.
Multilinguales, 15 | 2021
65
Figure : Le triangle humoristique
18 Comme nous pouvons le constater, le locuteur, également nommé chroniqueur d’El
Manchar, s’adresse à un destinataire déterminé (un public algérien) et au régime
politique algérien. Pour des raisons d’aisance, l’auteur use de la langue française qui
véhicule sa propre culture et dont il puise ses références culturelles adaptées à la
situation d’énonciation algérienne. Ainsi, le discours humoristique issu de ces rapports
nommés engendre des effets différents selon que le message s’adresse au destinataire
(peuple algérien) ou à la cible (également destinataire du discours).
19 S’agissant du peuple algérien, la réaction attendue s’exprime par une appréciation (ou
pas) témoignée par le nombre d’abonnés que comptent les différentes pages sur les
réseaux sociaux. Quant à la cible, qui n’adhère pas de façon systématique à la ligne
éditoriale du journal, manifeste ses positions par l’instauration d’un climat de
répression et de peur amenant le chroniqueur à suspendre temporairement ses
publications justifiant ainsi son choix :
« [...] Cette décision a été prise par l’équipe de rédaction. Le climat de répressiondes libertés, les incarcérations de citoyens à la suite de leurs activités sur lesréseaux sociaux nous ont conduits à réfléchir sur les risques que nousencourons11[...] ».
2. La situation d’énonciation : autour de l’implicite
20 Ce qui fait la particularité des écrits d’El Manchar, c’est la correspondance des thèmes
traités à l’actualité dominante. Dans cette perspective, Charaudeau met l’accent sur
l’importance de la description du contexte d’énonciation afin de mettre en évidence
l’acte humoristique. En effet, pour l’auteur,
« L’acte humoristique ne se réduit pas non plus aux seuls jeux de mots comme biendes études semblent le suggérer. Les jeux de mots, s’ils relèvent en soi d’une activitéludique, ne produisent pas nécessairement un effet humoristique. Aussi est-onamené, pour étudier l’acte humoristique, à décrire la situation d’énonciation danslaquelle il apparait, la thématique sur laquelle il porte, les procédés langagiers qui
Multilinguales, 15 | 2021
66
le mettent en œuvre et les effets qu’il est susceptible de produire sur l’auditoire. »(2006 : 21).
Partant de ce point de vue, Guettaf Fares et Reggad Malki Fouzia mettent en évidence la
restriction du terrain d’expression en Algérie qui a vu naitre le journal satirique. En
effet : « Malgré une certaine abondance des médias arabophones et francophones dans lascène médiatique algérienne, il n’en demeure pas moins qu’elle manque de ce qu’onappelle “la presse satirique”. Dès lors, force est de constater que la scènemédiatique algérienne manque sévèrement d’une presse satirique proprement dite,c’est-à-dire d’une presse dotée de moyens financiers et humains considérables telsque le cas en France où ce type de presse est apparu dès l’aube de la Révolutionfrançaise (1789) et représente, de ce fait, une vraie institution avec tout que celaengendre pour son image. Contrairement à la presse satirique dans d’autres paysoccidentaux ou africains où plusieurs titres peuvent se disputer la scène. En Algérie,la scène de la presse satirique proprement dite est exclusivement occupée par lesite El-Manchar » (Guettaf, Reggad Malki, 2017 : 3).
Ainsi, les articles publiés dans le journal traitent, principalement, de la thématique
relative à la situation socio politico culturelle algérienne dont le Hirak, le soulèvement
populaire est une situation des plus conjoncturelles. À ce mouvement populaire marqué
par la libération de la parole tant populaire que médiatique, s’ajoute la situation
sanitaire causée par la pandémie de la COVID 19.
21 La situation d’énonciation se traduit également par divers procédés langagiers qui se
déploient par le recours de l’auteur à des stratégies dont : l’ironie, la dérision, le
sarcasme, le non-dit. À ce sujet, Catherine Kerbrat-Orecchioni insiste sur le fait que
tout implicite contient des éléments permettant d’expliciter le non-dit,
« Toute unité de contenu possède, directement ou indirectement, un supportsignifiant quelconque ; et même lorsqu’ils n’ont d’autre ancrage qu’indirect, lescontenus implicites sont en quelque sorte “entés” sur les contenus explicites, detelle sorte que la reconnaissance des premiers présuppose l’identification desseconds » (1986 : 161-162).
Dans l’exemple qui suit, le chroniqueur annonce une (fausse) information relative à
l’arrestation de fleuristes à Alger, « Trois fleuristes arrêtés à Alger pour complot contre la
sûreté de l’État » (El Manchar, 2019). Nous pouvons lire dans l’article qui accompagne ce
titre les raisons qui justifient cette arrestation :« Trois fleuristes ont été arrêtés par l’armée lors de l’opération menée à Algerdepuis hier mercredi, a-t-on appris ce jeudi 28 février de sources sécuritaires. Cette opération a été déclenchée sur la base de renseignements faisant état de laprésence de marchands de fleurs qui étaient en train de fomenter - une guerre dansle but manifeste de détruire l’Algérie- selon nos sources.Les terro-fleuristes avaient en leur possession “des roses assez semblables à cellesqui avaient servi à déclencher la guerre en Syrie”, parait-il. L’opération se poursuitsous le haut commandement du Premier ministre Ahmed Ouyahia. Le Premierministre a mis en garde les Algériens ce matin contre les roses avec lesquelles tout acommencé en Syrie. Vous êtes prévenus, la troisième guerre mondiale aura lieu lejour de la Saint-Valentin. »
22 Cet extrait nous permet de relever des informations sous-entendues12et dont le sens
prend forme dès lors qu’ils sont mis en relation avec le contexte socio-politique
algérien. En effet, « Il ne s’agit pas seulement de faire croire, il s’agit de dire sans avoir dit ».
(Ducrot, 1972 : 15). De ce fait, recourir à des indices explicites permet d’identifier le
sous-entendu de l’énonciation :
Multilinguales, 15 | 2021
67
« On peut tirer d’un énoncé des contenus qui ne constituent pas en principe l’objetprincipal de l’énonciation, mais qui apparaissent à travers les contenus explicites.C’est le domaine de l’implicite. » (Maingueneau,1996 : 47)
Concernant notre exemple, l’énonciation du nom de l’ancien premier ministre algérien
représente en soi l’indice qui permet de comprendre le sous-entendu. Ce dernier ayant
fait le parallèle entre les évènements qui se passent en Algérie (le Hirak) avec ceux en
Syrie pendant la guerre civile de 2011. Ces propos ont été recueillis par la journaliste
Nabila Amir dans son article pour le journal El Watan en date du 02 mars 2019.
23 Par ailleurs, interpréter des énoncés implicites requière, selon Catherine Kerbrat-
Orecchioni l’application, aux signifiants inscrits dans l’énoncé, de diverses
compétences afin d’arriver à extraire le signifié. Pour les besoins de notre étude, nous
nous limiterons à quelques-unes de ces compétences, à savoir : linguistiques,
encyclopédiques et rhétorico-pragmatique. La compétence réthorico-pragmatique
représente, selon l’auteur, la loi de la pertinence, autrement dit, plus le texte est court
mieux cela fait rire. C’est ainsi que les publications d’El Manchar, sur les réseaux
sociaux Facebook et Instagram, se limitent à des énoncés d’une longueur proportionnée
qui se limitent à une phrase telle que : « Des échauffourées éclatent au moment de la
distribution des sandwiches cachir » (Facebook 09 février 2019), ou encore « De retour au
pays, Tebboune estime que l’Algérie devrait se doter d’hôpitaux » (El Manchar 2020) . Ce
faisant, le contexte d’énonciation représente l’élément pertinent pour la
compréhension et la transmission du message.
3. Langue-cultures : le rire en français
24 Dans l’exercice rédactionnel à visée humoristique, l’auteur relève plusieurs défis, dont
celui de faire rire en utilisant une langue étrangère. El Manchar fait de l’humour avec
une langue qui est Autre. La langue française est utilisée pour faire rire et devient,
ainsi, un élément d’altérité, un élément partagé entre deux cultures et qui fait rire la
culture qui l’emprunte :
« Une fois perçue l’originalité de l’auteur, le texte nous apparaitra égalementcomme l’expression et la mise en forme esthétique de représentations partagéespar les membres d’une même communauté. En d’autres termes, de telles œuvrespeuvent constituer une voie d’accès à des codes sociaux et à des modèles culturelsdans la mesure où elles représentent des expressions langagières particulières deces différents systèmes. » (Collès, 1994 : 17)
Faisant le parallèle avec le contexte pédagogique, Alain Cazade13 (2009) affirme que :« Le professeur qui s’essaye à faire passer en classe une plaisanterie en langue 2connait bien cette problématique déroutante. L’humour supporte mal d’êtreexpliqué. Si l’on s’y hasarde, l’expérience est décevante, l’effet voulu se trouve vidédu charme fragile de ses ressorts humoristiques. Ces ressorts reposent souventessentiellement sur un effet d’instantanéité, confrontant, mélangeant habilementet discrètement divers registres de langue, de situations, etc. »
25 La réception du message humoristique suppose le partage de certains traits culturels
entre le locuteur et le destinataire pour assurer la transmission du message visé
intrinsèquement. Les textes d’El Manchar regorgent d’un capital culturel à travers
lequel l’auteur démontre un niveau de maitrise de la différenciation culturelle. En effet,
« Plus on est cultivé, plus nombreuses sont les distinctions qu’on est capablesd’instaurer ; ou, réciproquement, plus fines sont les distinctions qu’on est capablesde repérer, plus on accède à un rang culturel élevé » (Cuq, 2003 : 63)
Multilinguales, 15 | 2021
68
3.1. Les éléments culturels de(s) l’Autre(s)
26 L’entretien accordé par Nazim Baya nous a permis de relever les références qui
motivent et nourrissent le modèle type du discours humoristique d’El Manchar. En
effet, l’auteur trouve chez l’humoriste Pierre Desproges14 un archétype d’humour noir
au discours anticonformiste et au sens de l’absurde. Desproges est également célèbre
pour sa singulière aisance littéraire, ce qui, à notre sens, procure au chroniqueur d’El
Manchar une source intarissable de compétence encyclopédique et culturelle.
Cette capacité se traduit par le fait que l’auteur exploite avec finesse des éléments
culturels solubles dans la formulation de ses blagues. À ce sujet, Catherine Kerbrat-
Orechionni ajoute :« [...] la compétence encyclopédique se présente comme un vaste réservoird’informations extra-énonciative portant sur le contexte ; ensemble de savoirs etde croyances, système de représentations, interprétations et évaluation de l’universréférentiel [...] » (1982 : 162)
Ce bagage cognitif est mobilisé dans un ensemble d’informations injectées dans le texte
de l’auteur, et trouve tout leur sens lors des opérations de décodage. C’est ainsi que le
07 avril 2020, El Manchar écrit : « Face à la pénurie des masques, la France autorise le port
du niqab. ».
27 La pandémie de la COVID-19, thème qui a inspiré au journal satirique une multitude de
publications, offre un contexte de mélange de culture dans la mesure où chaque pays
dans le monde opte pour des solutions visant à réduire la propagation du virus.
L’auteur d’El Manchar puise dans cette diversité (solution-culture) afin de construire
son discours humoristique. Ainsi, l’élément culturel français, représenté à travers le
principe de laïcité, est repris dans l’article comme suit :
« [...]Une vraie catastrophe qui a conduit certains pays à renoncer à leurs principespour endiguer le problème.- Avec le Covid-19, il n’y a ni laïcité… niqab -L’un des premiers pays à avoir tout osé pour trouver une solution à la pénurie desmasques est la France. En effet, par la voix de son Premier ministre, l’Hexagone, quia loupé le coche à plusieurs reprises dans la politique d’achat et de distribution desmasques, a décidé de faire fi d’un principe qui lui est cher : la laïcité. »
28 Plus loin, Nazim Baya fait référence aux idéologies du parti politique français le Front
National, connu pour son rejet pour les cultures étrangères fondamentalistes
susceptibles d’endiguer leur propre culture, à savoir, la culture française. À l’exemple
du niqab (voile intégrale) perçu comme une menace. Comme nous pouvons le constater
dans le propos suivant :
« Une source hospitalière nous a confirmé qu’en apprenant cette décision, MarineLe Pen a été admise aux urgences suite à un malaise politico-idéologique. »(El Manchar. 2020)
Cet exemple met en relief un va-et-vient entre deux cultures, à savoir, celle du Moyen
Orient exprimée à travers le voile intégral, et la politique française de l’extrême droite.
Cette ligne de conduite a été détournée pour dénoncer une idéologie extrémiste basée
sur un discours qui implique l’exclusion de l’Autre15.
29 En somme, pour faire rire, El Manchar convoque non seulement des aspects de la
culture algérienne qu’il tourne en dérision, mais aussi des aspects de la culture de
l’Autre (des autres cultures) qu’il adapte à l’actualité algérienne. Notons l’exemple de
l’article publié le 25 septembre 2020, intitulé : « oui-oui16 rejoint l’assemblée populaire
Multilinguales, 15 | 2021
69
nationale » où l’auteur associe oui-oui, personnage fictif de dessins animés français, aux
membres de l’APN algérienne afin de dénigrer ces derniers, réputés pour leurs votes
oui, provoquant ainsi un processus en miroir17qui transmet la culture du Même à
travers l’élément culturel de l’Autre représenté.
3.2. Les éléments culturels du Même
30 Le croisement entre la forme, qui est la langue française, et le fond, qui est la culture
algérienne, constitue un réservoir interculturel qui offre un champ d’expression et de
questionnement portant non seulement sur la culture de l’Autre, mais amène aussi à
réfléchir à propos de la culture du Même. Abdallah Pretceille précise à ce sujet :
« Le discours interculturel induit un questionnement autant sur les autres cultures,sur autrui, que sur sa propre culture. C’est ce processus en miroir qui fonde laproblématique interculturelle » (1999 : 28).
Ainsi, ce serait la langue de l’Autre, en tant qu’élément culturel, qui donnerait de la
distance afin d’appréhender une réalité (nôtre réalité) de façon à lui impulser une note
humoristique.
31 Parmi les personnages politiques algériens ayant multiplié des déclarations burlesques,
une ex-députée algérienne se distingue à travers ses publications, considérées par
plusieurs Algériens cuisantes et criardes provoquant ainsi une agitation populaire. En
réponse à l’absurdité de la situation, El Manchar publie le 06 septembre 2020 : « Le
Shour dément : je n’y suis pour rien. Naïma Salhi est juste idiote. ». Le chroniqueur se lance
sur les pas de La Fontaine, et ce, en faisant parler « la sorcellerie » pour tourner en
dérision les dernières déclarations de la députée. La personnification de ce schème
culturel enclenche la problématique du double sens et installe une ambigüité d’ordre
métalinguistique. Ainsi, l’auteur dénonce le fait que la députée se réfugie dans la
sorcellerie pour justifier ses dérapages sur la scène politique en jetant la pierre sur un
élément culturel relatif aux croyances populaires, à savoir, la religion.
32 Par ailleurs, le recours aux jeux de mots et à l’implicite est constamment présent dans
les articles humoristiques d’El Manchar. En effet, dans un autre exemple qui date du
14 novembre 2020, l’auteur s’exprime à propos du manque de liquidité (financière) dans
les bureaux de poste ainsi que les banques algériennes. C’est ainsi que dans l’article
intitulé « Insolite : il prend une année sabbatique pour retirer de l’argent dans un bureau de
poste », l’Algérien reconnait implicitement, de prime abord, l’aspect inscrit dans la
culture nationale qui consiste à subir des chaines interminables pour le retrait d’agent.
Ce phénomène est d’autant plus marqué par l’interculturel dans la mesure où l’auteur
fait appel à un jeu de mots exprimé dans la langue de l’Autre, soit le français, afin de
tourner en dérision cette situation. Ce jeu de mots consiste à comparer les liquidités
financières au liquide (substance qui tend à couler).
« C’est la dernière goutte de liquidités qui a fait déborder le vase. Salim, 35 ans,cadre dans une entreprise publique est aujourd’hui à sec. Il n’a pas pu retirer sonargent depuis juillet dernier. Aujourd’hui, il décide de jouer sa dernière carte pourpas crever de faim : Prendre une année sabbatique.“Vous n’allez pas me croire, mais il me reste 45 dinars en tout et pour tout. Il y aplus de liquidités dans la poche urinaire de Boutef que dans les poches de monpantalon. Je ne pensais pas que l’on pouvait en arriver là, mais je n’ai pas trop lechoix, je prends un congé pour retirer enfin mes 3 derniers salaires” lâche-t-il endétresse. » (El Manchar, 2020)
Multilinguales, 15 | 2021
70
Le message intrinsèque, dans cet exemple, fait référence de manière implicite au
manque de liquidités dans les banques, causé par le détournement d’argent par le
régime politique algérien, celui du Président de la République déchu notamment.
33 Enfin, par le choix du récit de l’aventure de Salim, personnage fictif, l’auteur met en
place la métaphore du mémoire, reprise par le terme de « reflet » de toute une société
qui se voit confrontée à son propre parcours en se représentant la réalité quotidienne
propre à la culture algérienne. Une stratégie pédagogiquement humoristique qui invite
le destinataire, à savoir le peuple, à une révolte douce et à un éveil salvateur. L’objectif
de notre étude visait à démontrer comment l’énonciateur (El Manchar) exploite la
langue française (l’Autre) pour faire rire l’Algérien (le Même, le nôtre), et ce, à travers
une analyse du discours qui met l’accent sur la façon dont la langue française fait
ressortir des traits de la culture algérienne et des comportements spécifiques aux
Algériens.
34 Au terme de notre étude, nous pouvons confirmer que le discours humoristique est une
écriture créative. D’une part, elle fait appel à des compétences linguistiques qui se
manifestent dans la tribune d’El Manchar à travers l’expression implicite des messages
ainsi que les divers jeux de mots que nous avons relevés au cours de notre analyse.
D’autre part, la compétence encyclopédique se traduit par le recours aux éléments
culturels tant algériens (le Même) que français (l’Autre). Ces compétences ont permis
aux chroniqueurs de tisser des textes résultants d’une polyphonie culturelle qui offre
un espace de cohabitation pour créer une association d’éléments culturels appartenant
à l’un et l’autre dans une symbiose créative. Le corpus analysé, constitué de certains
écrits d’articles issus du journal El Manchar, nous a permis de mettre en avant une
image « sommaire » d’une sorte d’inclusion de la langue de l’Autre. Avec sa dimension
culturelle, le français a permis d’exprimer et de distinguer la culture du Même par la
voie de procédés linguistiques tels que les jeux de mots, véhiculant l’implicite et la
dérision, dont le rapport signifiant-signifié a engendré un humour adopté par le
destinataire.
BIBLIOGRAPHIE
abdallah pretceille, Martine, L’Éducation interculturelle, PUF, Paris, 1999.
ait ouarabi, Mokrane, « Plainte contre Naïma Salhi : L’instruction relancée », El Watan, 2021,
Disponible sur [https://www.elwatan.com/edition/actualite/plainte-contre-naima-salhi-
linstruction-relancee-11-03-2021] Consulté 10-09-2020.
amir, Nabila, « Les manifestants répondent à Ahmed Ouyahia : L’Algérie n’est pas la Syrie », El
Watan, 2019. Disponible sur [https://www.elwatan.com/edition/actualite/lalgerie-nest-pas-la-
syrie-02-03-2019.] Consulté le 09-12-2020.
cazade, Alain, « L’interculturel est-il soluble dans l’humour ? », Cahiers de l’APLIUT,
vol. XXVIII N° 2, 24-39, 2009. Disponible sur [https://journals.openedition.org/apliut/1067]
consulté le 01-12-2020.
Multilinguales, 15 | 2021
71
charaudeau, Patrick, « Des catégories pour l’humour ? », Revue Questions de communication,
n° 10, Presses Universitaires de Nancy, Nancy, 2006. URL : http://www.patrick-charaudeau.com/
Des-categories-pour-l-humour,93.html] consulté le 08-12-2020.
cuq, Jean Pierre, Dictionnaire de didactique de langue étrangère et seconde, CLE International, Paris,
2003.
dahak, Bachir, Les Algériens, le rire et la politique de 1962 à nos jours, Éditions Frantz Fanon, Tizi
Ouzou, 2018.
collès, Luc, Littérature comparée et reconnaissance interculturelle, De Boeck-Duculot, Bruxelles,
1994.
ducrot, Oswald, Dire et ne pas dire : Principes de sémantique linguistique, Paris : Hermann, Coll. « Savoir », 1972.
El Manchar, « Insolite : il prend une année sabbatique pour retirer de l’argent dans un bureau de
poste », 14 novembre 2020. Disponible sur [https://el-manchar.com/2020/11/un-algerien-prend-
une-annee-sabbatique-pour-retirer-de-largent-dans-un-bureau-de-poste/], consulté le
15/12/2021.
El Manchar, « Le Shour dément “Je n’y suis pour rien. Naïma Salhi est juste idiote” », 06
septembre 2020, [https://el-manchar.com/2020/09/le-shour-dement-je-ne-suis-pour-rien-
naima-salhi-est-juste-idiote/] Consulté le 01-12-2020.
El Manchar, « Oui-oui rejoint l’assemblée populaire nationale », 25 septembre 2020 [https://el-
manchar.com/2020/09/oui-oui-rejoint-lassemblee-populaire-nationale/ ] Consulté le 20-11-2020.
El Manchar, « De retour au pays, Tebboune estime que l’Algérie devrait se doter d’hôpitaux. », 12
novembre 2020 [ https://el-manchar.com/2020/11/de-retour-au-pays-tebboune-estime-que-
lalgerie-devrait-se-doter-d’hopitaux/ ] Consulté le 10-12-2020.
El Manchar, « Face à la pénurie des masques, la France autorise le port du niqab. », 07 avril 2020, [
https://el-manchar.com/2020/04/face-a-la-penurie-des-masques-la-france-autorise-le-port-du-
niqab/ ] Consulté le 13-10-2020.
filali, Zeineb, « Algérie : le président Tebboune met fin à une expression aussi vieille que
l’indépendance. », Financial Afrik, 23 avril 2020. Disponible sur [https://www.financialafrik.com/
2020/04/23/algerie-le-president-tebboune-met-fin-a-une-expression-aussi-vieille-que-
lindependance/] Consulté le 22-09-2020.
guettaf, Fares, reggad Malki, Fouzia, « Approche polyphonique de l’ironie dans la presse satirique
algérienne : cas du journal d’information satirique El-Manchar », International Journal of
Innovative Research in Human Sciences, VOL1. ISSUE1, 2017 001–016. Disponible sur [https://
oasesvox.com/journals/index.php/ijirhs/article/view/3/3], consulté le 15/05/2021.
kerbrat-orecchioni, Catherine, L’implicite, Paris : Armand Colin, 1986.
kettani, Myriam, « Identité paternelle en contexte d’immigration magrébine en France : des
pères immigrés aux pères issus de l’immigration », Alterstice, 2015. 5(1), 57-68. Disponible sur
[https://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/article/viewFile/
Kettani_Alterstice5 %281 %29/129# :~ :text =Selon %20Le %20Camus %20 (2005) %
2C, %C3 %A0 %20celui %20de %20la %20m %C3 %A8re.] Consulté le 15-12-2020.
maingueneau, Dominique, Les termes clés de l’analyse du discours, Paris : Ed Seuil, Coll. « Mémo :
Lettres », 1996.
Multilinguales, 15 | 2021
72
NOTES
1. Terme employé pour désigner le mouvement de protestation populaire qui a débuté en Algérie
le 22 février 2019.
2. Boualem Sensal fait référence ici à l’humour politique qu’il considère comme dérangeant vis-à-
vis des gouvernants tant qu’ils sont à l’afflux des éléments susceptibles d’éveiller la conscience
populaire et déstabiliser le régime en place.
3. Pierre Desproges, l’Évènement du jeudi 2 octobre 1986. Citation disponible sur le lien : https://
www.mon-poeme.fr/citations-pierre-desproges/
4. Exprime mon appartenance à cette culture.
5. https://el-manchar.com/, La page Facebook est disponible à l’adresse suivante : https://
web.facebook.com/dz.manchar/ ?_rdc =1&_rdr
6. Expression empruntée à P. Charaudeau, Des catégories pour l’humour ? questions de
communication, 2006, 10, 19-41
7. Nazim Baya nous a accordé un entretien le 27 décembre 2020 au cours duquel il précise que ses
articles s’adressent à un public qui lit et comprend la langue française.
8. https://el-manchar.com/2020/11/un-algerien-prend-une-annee-sabbatique-pour-retirer-de-
largent-dans-un-bureau-de-poste/14 Novembre 2020
9. Terme issu de l’arabe dialectale qui signifie « sorcellerie ».
10. El Manchar, Le Shour dément « Je n’y suis pour rien. Naïma Salhi est juste idiote », 2020, https://el-
manchar.com/2020/09/le-shour-dement-je-ne-suis-pour-rien-naima-salhi-est-juste-idiote/
11. Propos recueillis à partir de la page officielle Facebook du journal El Manchar qui date du 14
mai 2020. Le poste est consultable à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/dz.manchar/
posts/1358694924320507/
12. À savoir, le recours des manifestants algériens à la distribution de fleurs aux éléments de la
police. Ces fleurs sont associées par l’auteur d’El Manchar à la fête de l’amour (La Saint-Valentin).
13. Adresse URL : https://journals.openedition.org/apliut/1067
14. Pierre Desproges est un journaliste humoriste français né le 9 ai 1939, décédé le 18 avril 1988,
connu pour son humour chicanier.
15. L’Autre ici étant identifié comme celui émanant de la culture française.
16. Oui oui est un personnage fictif de livre et dessins animés pour les enfants, créé par le
romancier britannique Enid Blyton. Le dessin animé est adapté en langue française, pour la
première fois, en 1962.
17. Concept emprunté à Abdellah Pretceille
RÉSUMÉS
Cet article suggère une analyse du discours humoristique du journal satirique algérien « El
Manchar ». Notre étude est principalement basée sur deux compétences, linguistique et
encyclopédique en langue française qui permettent de mettre en relief l’impact d’une interaction
culturelle qui allie la langue de l’Autre (la langue française) destinée à provoquer l’humour chez
le public algérien (le Même, le nôtre, le mien) en période de Hirak et de la COVID-19.
This article suggests an analysis of the humorous discourse of the Algerian satirical newspaper
"El Manchar". Our study is principally based on two skills, linguistic and encyclopedic in the
Multilinguales, 15 | 2021
73
French language which allow us to highlight the impact of a cultural interaction combining the
language of the Other (the French language) intending to create humor in the Algerian public
audience (the Same, ours, mine) in the period of Hirak and COVID-19.
INDEX
Mots-clés : discours, El Manchar, humour, implicite, interculturalité
Keywords : speech, El Manchar, humor, implicit, interculturality
AUTEUR
RADIA TOUATI
Faculté des Lettres et des Langues, Université A. Mira, Bejaia. Algérie
Multilinguales, 15 | 2021
74
Une analyse discursive de l’actehumoristique à travers les créationslexicales dans la presse francophonealgérienneA discursive analysis of the humorous act through lexical creations in the
francophone Algerian press
Samira Allam Iddou
1 Cet article s’inscrit dans la réflexion sur l’acte humoristique dans le discours
journalistique francophone à travers les créations lexicales. Cette étude a pour but de
mettre l’accent sur les procédés de création lexicale (dérivation, composition,
inversion, synapsie, troncation ou siglaison, métaphore, emprunt,…) pour véhiculer
l’humour. Si l’innovation lexicale a fait l’objet de beaucoup d’études, nous ne recensons
pas de recherches consacrées à la création lexicale à effet humoristique de la presse
francophone algérienne. Ce constat nous amène à poser la question suivante :
Quels sont les procédés de création lexicale pour véhiculer l’humour dans le discours
journalistique d’expression française ?
2 A cet effet, nous nous permettons de mettre à jour une analyse discursive de l’humour
par le biais des créations lexicales manifestées dans le discours journalistique. Dans le
cadre de cette étude, nous proposons d’abord de relever toutes les créations pouvant
servir de base à des effets humoristiques afin de les analyser ensuite, nous mettons en
lumière la mise en œuvre du processus néologique. Cette étude entreprend d’illustrer
dans cette perspective la typologie des néologismes proposée par Sablayrolles
(2000) par des exemples tirés des chroniques journalistiques1. Ces lexies reposent sur
différents procédés linguistiques (suffixation : bouteflikisme2 ; amalgame :démocrachie3 ;
synapsies :pauvres de Bill Gates4 , transcatégorisation : castinguent5 (n>v, etc.). Des
métaphores comme le Lénine du Funk6 semblent aussi propres au contexte7 de la presse
algérienne.
•
Multilinguales, 15 | 2021
75
1. Quelques caractéristiques générales de la presseécrite
1.1 La typologie des genres journalistiques
3 La presse écrite a pour principale fonction l’Information, c’est-à-dire, la transmission
de la grande et petite actualité, mais aussi l’expression des jugements, des idées et des
opinions. J. De Brouker (1995 : p. 207) distingue deux grandes familles de genres
rédactionnels : les genres de l’information et les genres du commentaire. Les genres de
l’information comprennent la brève, le reportage, la dépêche, etc. Tandis que les genres
du commentaire comprennent la tribune, le billet, l’éditorial, la chronique, etc. Selon
M. Voirol (1995 : p. 18), l’article d’information a pour principal objectif « de relater des
évènements, de livrer des faits, de montrer les personnages », l’article de commentaire
a pour objet « de développer des idées, de livrer une opinion, d’affirmer une position. A
cette catégorie appartiennent le billet, la critique, l’éditorial, la chronique, etc.
4 Au sujet des typologies des genres journalistiques, J-M. Adam (1997 : p. 3-18) les résume
selon deux positions énonciatives polaires. La première concerne l’engagement du
journaliste, nommé aussi la « distance ». C’est le cas de l’article d’information (la brève,
la dépêche, tec). L’autre pôle, on trouve l’implication, et l’article de commentaire dont
la chronique, notre objet d’étude, fait partie.
1.2 L’acte d’énonciation dans la chronique
5 La chronique, à partir de laquelle nous avons relevé les créations lexicales à effet
humoristiques, se présente comme étant
L’article dans lequel une « signature » rapporte ses observations, impressions et pasréflexions au fil du temps passé. […] C’est en quelque sorte un journal d’auteur àl’intérieur d’un journal de journalistes. L’auteur en question, qui d’ailleurs peut êtreou ne pas être un journaliste, a ses propres critères de sélection et d’appréciationdu ou des sujets dont il désire s’entretenir selon son humeur. (J. De Broucker, 1995 :207).
6 Selon le G-Blas8, la chronique est un des genres journalistiques qui « doit être courte et
hachée, fantaisiste, sautant d’une chose à l’autre et d’une idée à la suivante sans la
moindre transition. » Elle est un article écrit au jour le jour. Elle se présente comme un
reflet de la vie quotidienne. Mais, qui selon M. Voirol, brasse plutôt les idées. La
chronique en tant que genre journalistique a pour objet de dénoncer les travers de la
société « de développer des idées, de livrer une opinion, d’affirmer une opposition. »
(Voirol, 1995 : 18) C’est un article de commentaire qui a pour objet de livrer une
opinion, d’affirmer une position. C’est donc une lecture personnelle de l’actualité par
son auteur et une façon de la raconter dans la plus grande liberté avec la bonne humeur
et avec la légèreté de l’esprit. L’auteur précise que tout article de commentaire dont la
chronique fait partie, est forcément « subjectif ».
7 Cette subjectivité se traduit par le fait que l’énonciateur ou le chroniqueur manifeste sa
propre opinion ou ses propres appréciations dans l’analyse qu’il propose. Ce caractère
subjectif se désigne aussi par l’ensemble des moyens linguistiques dont dispose le
chroniqueur pour marquer sa présence dans l’énoncé. La présence de l’auteur se
ressent non seulement dans les mots et les phrases qu’il utilise, mais même au niveau
Multilinguales, 15 | 2021
76
des phonèmes, et dans la ponctuation. Pour cela le chroniqueur utilise, selon D. Banks
(2005 : 260), la sublocution, néologisme, qui peut se diviser en : - modalisation, ou
domaine de jugement (appréciatifs), (judicatifs) ou (contradictifs). – modulation, ou
domaine de l’expressivité des divers sentiments du locuteur. Ces termes axiologiques
sont utilisés pour pouvoir persuader le lectorat.
1.3 Caractéristiques linguistiques de la chronique Tranche de vie
8 Sur le plan linguistique, la chronique en tant que genre journalistique est également un
genre littéraire car elle doit, selon J. Mouriquand (1997 : 19), ses « caractéristiques à
l’écriture, au talent de littéraire de l’auteur ». Production journalistique qui entretient
des liens étroits avec la littérature, l’écriture de la chronique est souvent remarquable
par la maîtrise de la langue. Rédigée souvent par des sociologues, des ethnologues, des
anthropologues, la chronique est l’espace journalistique où écrivains peuvent
s’introduire. Ceci dit que le chroniqueur n’est pas forcément un journaliste ou une
personne qui a reçu une formation dans le domaine journalistique. C’est d’ailleurs le
cas de l’auteur de la chronique Tranche de vie qui était avant tout un homme de théâtre9.
9 Pour ce qui est de la dimension linguistique et du style d’écriture adopté, le
chroniqueur interpelle ses lecteurs dans une langue simple non spécialisée. Le
chroniqueur traite des sujets dont il dévoile le contenu de chaque fait d’actualité, en
s’intéressant à la fois à des thèmes variés pour en faire une critique dans une langue le
plus souvent dérisoire et satirique, acquise avant toute chose à l’humour. L’auteur
emploie également plusieurs tournures populaires et plusieurs parlers porteurs de sens
et transformateurs du message voulu. Ainsi, le registre familier et le code oral ne sont
pas épargnés dans ses chroniques où l’on assiste non seulement à l’utilisation de
l’alternance codique comme dans le petit paragraphe suivant :
« …Pendant le Ramadhan, il y a beaucoup de baraka10. Fi11 l’entreprise même leplanton devient charika gadra12. Et comment... c’est lui qui est devant la pointeuse...si tu veux pointer à ta guise, il te faut pointer chez le monsieur de la pointeuse... etkoulchi yemchi13. » (22/08/2009).
10 Mais nous assistons également à la naissance d’un autre phénomène linguistique,
phénomène de la création d’unités lexicales nouvelles hybrides formées de deux
composants, l’un relevant de la langue française, l’autre des langues en présence dans
l’univers algérien comme le montre bien le petit passage suivant :
…Au fait, les samedhan, dimandhan, lundhan, mardhan, mercredhan14, les jours duRamadhan, on devient moderne, la technologie est utilisée à fond. On n’a pas besoinde se déplacer pour donner un ordre ou lancer une opération. Faire un suivi ousuivre une directive. Il suffit d’une connexion ADSL15 payée par la charika16, unepuce, un bon téléphone mobile, et du champ et du champ. Sur le champ tout serègle…
1.4 L’humour à travers les créations lexicales dans Tranche de vie
11 Considérée comme le principal vecteur du changement linguistique, la presse écrite
algérienne, en l’occurrence la chronique journalistique, est perçue comme une
institution de la liberté d’information et d’expression dans le sens où elle constitue un
lieu privilégié d’apparition et de création de mots nouveaux17. Les exemples cités plus
haut illustrent parfaitement ce nouveau phénomène linguistique. Ceci symbolise sans
doute cette capacité de la presse écrite à inventer la langue en créant des mots et des
Multilinguales, 15 | 2021
77
expressions. Manipuler la langue est donc une tâche aisée pour les chroniqueurs du
moment qu’ils jouissent de cette qualité qui leur est attribuée en agissant surtout sur le
lexique.
12 La création lexicale se fait naturellement pour dénommer des concepts et des nouvelles
réalités (J. Pruvot, J-F Sablayrolles, 2003 : 17). Ayant une fonction pratique, ces
créations sont aussi utilisées pour augmenter l’expressivité du discours, pour inciter à
la lecture et établir une certaine connivence et entretenir des rapports de familiarité
avec le lecteur. Dans le cas des contextes médiatiques, le néologisme finit, par fois, par
être utilisé comme une unité lexicale ordinaire. Une certaine complicité naît alors entre
le quotidien et ses lecteurs. (L Sader Feghali, 2005 : p. 532). Cette connivence repose
principalement sur la langue qui pourrait favoriser l’émergence des créations lexicales
à effet humoristique. A l’égard de F. Evrard (1996 : 144) :
« l’écriture humoristique tend à manipuler le langage comme le lieu d’une activitéludique et poétique au sens de création, recréation et récréation ». Il s’agit donc de« créations délibérées » (J-F Sablayrolles, 2017 : 37-50).
13 Créations instantanées et individuelles qui servent également à faire de l’humour.
Construction de l’humour par des procédés de création lexicale, c’est donc l’une des
stratégies discursives adoptée par les chroniqueurs qui consiste selon Charaudeau à :
S’affronter au langage, se libérer de ses contraintes, qu’il s’agisse des règleslinguistiques (morphologie ou syntaxe) ou des normes d’usage (emplois réglés pardes conventions sociales en situation), ce qui donne lieu au jeu de mots [...]. Et enfinelles demandent à un certain interlocuteur (individu ou auditoire) de partager cejeu sur le langage et le monde, d’entrer dans cette connivence de « jouer ensemble », mais un jouer qui engage l’individu à devenir un autre, l’instant de l’actehumoristique, ce qui permet de dire que l’acte humoristique n’est jamais gratuit. Autotal, l’humour correspond toujours à une visée ludique, mais à celle-ci peuvents’adjoindre d’autres visées plus critiques, voire agressive... (P. Charaudeau, 2011 :9-43)
Cet humour, nous le verrons, sous toutes ses formes (ironie, dérision et satire) serait
donc un des moyens privilégiés du chroniqueur pour capter l’attention de ses lecteurs.
C’est une façon humoristique de raconter le quotidien et refléter une image caricaturée
des divers domaines de la réalité sociale. Celle-ci constitue pour la créativité
langagière18 la source première de sa dynamique.
2. Le corpus d’étude
14 Notre corpus est constitué d’un ensemble d’exemples de créations lexicales recueillies
par la méthode de dépouillement systématique de plusieurs chroniques
journalistiques19. Pour pouvoir comprendre le phénomène de la créativité lexicale
comme vecteur de l’humour que l’on entreprend de présenter d’abord et d’analyser par
la suite dans la presse journalistique algérienne d’expression française, nous avons
choisi comme corpus un échantillon des chroniques tirées de la presse non spécialiste
mais généraliste telle que la chronique Tranche de vie du journal Le Quotidien d’Oran.
Cette chronique bien connue, jouit d’une grande notoriété et est marquée par sa façon
typique d’aborder des sujets variés qui reflètent la vérité et la réalité de notre société.
Cette dimension a motivé une part, subjective, du choix de notre corpus. Nous avons
aussi limité notre étude à cette rubrique dans la mesure où la chronique Tranche de vie,
Multilinguales, 15 | 2021
78
compte à elle seule un nombre important de créativités lexicales dont le versant
linguistique est pris en ligne de compte.
Nous avons ainsi recensé un nombre assez considérable des créations lexicales. Notre
source des créations lexicales s’est limitée aux années 2007-2016. Nous tenons à
préciser que le choix de la période de la collecte des néologismes n’est pas pris au
hasard, mais il s’agit bien d’un choix qui peut être qualifié de stratégique dans la
mesure où la période détermine les conditions de création des mots. Nous relevons
donc une relation entre l’emploi des néologismes et le contexte de la période.
15 J-F Sablayrolles précise que « le processus néologique n’est pas activé avec une
intensité constante et régulière : certaines époques voient l’apparition de nombreux
néologismes d’autre n’en voient apparaître que très peu. » (J-F Sablayrolles, 2000 : 133)
En effet, la période détermine les conditions de création des mots. Nous relevons donc
une relation entre l’emploi des néologismes et le contexte de la période. Ainsi Z. Xu
(2001 : p. 55) affirme que
« l’analyse quantitative d’un corpus peut souvent servir à dégager une certainetendance linguistique reliée au contexte d’une époque particulière dans une sociétédonnée. ».
Les conditions particulièrement extralinguistiques qui ont favorisé l’émergence des
créations lexicales à effet humoristique peuvent être liées aux évènements nationaux
(sociaux, économiques, culturels) et internationaux (politiques, économiques,
médicaux,...). Tous ces évènements qui ont marqué cette époque et ont fait d’elle une
période propice à l’activité de création de nouveaux mots dans le domaine
journalistique.
3. Quels axes d’analyse ?
16 J-F Sablayrolles (2000 : 72) établit une typologie des typologies en s’inspirant largement
des travaux de Tournier (1985 et 1991) qui pour sa part hiérarchise les néologismes
selon deux matrices, une matrice externe et une matrice interne. J-F Sablayrolles
(2000 : 245) propose d’enrichir la classification de Tournier avec une typologie axée sur
une sous-typologisation des matrices lexicogéniques. Cette typologie distingue la
matrice externe (emprunt) des matrices internes en sous-catégorisant cette dernière
selon quatre matrices : morphosémantiques, syntactico-sémantiques, morphologiques
et phraséologiques. Pour notre étude, nous entreprenons l’analyse du corpus par
l’application du dernier état du tableau des matrices lexicogéniques de l’année 2011
présenté en annexe à la page 09.
17 Nous partons donc de cette grille d’analyse qui gouverne le processus de formation des
mots nouveaux. Par le biais de cette grille, nous entreprenons l’analyse de nouvelles
unités lexicales produisant un effet humoristique. Subséquemment, il est important de
rappeler que l’objectif assigné à cette étude est de mettre en lumière les procédés de
création lexicale les plus privilégiés ( les procédés de dérivation, de composition,
d’inversion, la synapsie, la troncation ou la siglaison, la métaphore, l’emprunt,…) pour
véhiculer l’humour, et ce, en établissant le classement des innovations lexicales que
nous avons relevées d’après leurs domaines d’utilisation ou le champ notionnel où
s’applique avec humour la créativité lexicale. Ceci nous conduit aussi à nous rendre
compte du domaine le plus accru aux créations lexicales comme vecteurs d’humour par
rapport aux autres domaines.
Multilinguales, 15 | 2021
79
4. Analyse lexicale et discursive des énoncéshumoristiques
18 L’examen du corpus20 a révélé que l’emploi des matrices internes21semble intéressant
en matière de création lexicale humoristiques dans les différents domaines. L’activité
sociale avec ses divers domaines constitue pour la créativité langagière la source
première de sa dynamique. A cet effet, il nous a semblé intéressant d’établir le
classement des innovations lexicales que nous avons relevées dans notre corpus d’après
leurs domaines d’utilisation ou le champ notionnel où la lexie néologique à effet
humoristique apparaît.
19 Ainsi, la répartition des créations lexicales par domaines nous a permis de rendre
compte de la domination du domaine faits et comportements sociaux. Plus que tous les
autres domaines, le domaine social se prête à l’ironie. Notre corpus atteste que le
discours attaché à la société est souvent ironique et l’ironie n’y est que partiellement
cachée. Les constructions ironiques sont assez fréquentes. Etat de buvresse22, cette lexie
inventoriée par le chroniqueur, illustre l’état d’une personne qui boit jusqu’à l’ivresse.
Peut-on la considérer aussi comme une lexie appartenant aux matrices
phraséologiques23 ou lexie créée par détournement Sablayrolles J-F, (2009 : 17-28.) de
l’état d’ivresse ? Le composé relié par l’interfixe-o-, mobiliotite24, otiteur ou encore
otitophone25 créés par le chroniqueur, ne sont pas aussi sans une certaine charge
ironique. C’est une manière de se moquer des personnes qui ont tout le temps leurs
oreilles collées contre leurs téléphones portables. Ils ont été créés pour désigner
ironiquement un phénomène social très répandu chez les jeunes. La juxtaposition de
deux mots constitue un oxymore tel que mendicité new-look. Ce composé hybride a été
inventé pour désigner les jeunes joliment habillés et qui demandent l’aumône. Un autre
néologisme à effet humoristique, pneumanie, a été formé par analogie à pneumonie
indiquant les citoyens qui brûlent des pneus pour exprimer leur colère et leur
mécontentement.
20 Le domaine de la culture, avec toutes ses variétés, étant donné sa nature très large et
l’apport personnel du chroniqueur, se trouve plus au moins accru par rapport aux
autres domaines. L’émergence de ce phénomène dans les chroniques journalistiques
peut se rattacher également à un grand évènement culturel qui s’est produit à Alger. Le
Panaf26, l’une des plus grandes manifestations culturelles d’Afrique où intellectuels et
artistes africains se sont réunis en juillet 2009. En effet, la synapsie panne à fric a été
créée pour dénoncer les dépenses onéreuses consenties à ce festival. Des néologismes à
effet humoristique liés à ce domaine ont aussi été trouvés tels que téléaste27, skechistes28,
écriveurs29ou encore cultureurs30 pour ridiculiser ceux qui manquent de culture civique.
21 Il est également important de dire que la langue n’existe pas séparément de la culture.
En effet, la langue n’est qu’un aspect d’une culture. Notre corpus confirme ce constat.
La majorité des emprunts est faite à l’arabe, qui est omniprésent dans le domaine
culturel. Ce dernier a enregistré un nombre considérable de lexies néologiques dont la
majorité est empruntée à la langue arabe notamment l’arabe dialectal. De ce fait, nous
nous rendons aisément compte de la domination de l’arabe comme première source
d’emprunts. Le chroniqueur les utilise pour décrire un évènement culturel spécifique à
la réalité algérienne. Ainsi, la chronique journalistique semble se caractériser par un
certain effort d’employer des emprunts hybrides. Notre corpus atteste ce procédé de
Multilinguales, 15 | 2021
80
création par hybridation faisant recours surtout à l’emprunt. Des hybrides comme hard-
rai,31 jazz karkabou32 ont été recensées dans notre corpus. La création lexicale, comme
phénomène linguistique au service du rire et d’amusement, paraît réussie dans ce cas
mais la nouveauté n’est pas portée par les mots dans leur isolement, mais bien dans
leur association.
22 Le domaine politique est susceptible d’avoir recours aux créations lexicales à effet
humoristique. La lexie foot politique a été créée pour refléter les relations entre l’Algérie
et l’Egypte qui, depuis le match qui s’est déroulé dans le cadre des éliminations de la
coupe du monde 2010, sont devenues tendues. Au sujet de la politique extérieure, la
lexie doigtalisme33 a été créée par le chroniqueur. Pour lui, c’est un concept qui est né
avec le printemps arabe 2010. « C’est grâce à cette méthode de vote (le doigtalisme) que des
pays, démocratiquement, ont élu ceux qui les mènent en bateau, aujourd’hui. » (5/07/2014). La
politique intérieure est très évoquée. Ainsi l’amalgame dictarchie combine les fragments
des mots « dictature » et « anarchie », le chroniqueur l’a crée pour désigner, d’une
manière satirique, deux systèmes sociopolitiques en principe antagonistes qu’il associe
pour décrire sa vision de l’Algérie. Parlons du même domaine, des composés reliés par
l’interfixe-o ont été créées pour décrire par manière de dérision le système politique en
Algérie. A titre d’exemple, nous citons ces quelques compositions plus moins
exagérées : Politicopolitiques34, historicopoliticotactique, tecnicotacticofootbalisticopolitique.
23 Attachées au domaine économique, des lexies à effet humoristique ont été créées telles
que dinariste35, se milliardérisé, se dolarisant ou encore grippe financière36. Cette dernière
création a été obtenue par altération phonétique, ne renvoie pas à grippe mais à la crise
financière qui a touché le système économique de tous les pays en particulier l’Algérie.
Par comparaison avec les autres domaines, la technologie n’intervient toutefois que
très peu dans la néologie journalistique. Car la terminologie, selon J-C Corbeil (1974), ne
semble pénétrer que lentement dans la presse générale. Il est à remarquer que dans le
cas des innovations lexicales à caractère scientifique ou technique, la presse recourt
surtout à la vulgarisation. Nous pouvons citer l’exemple suivant : « La NASA, encore elle, a
déjà commencé à étudier le concept d’un recyclage. L’idée consistait à développer une PaCM (pile
à combustible microbienne ultra-compacte)… ». Néanmoins, des innovations ont été
inventées pour dénommer par manière de dérision. Parlons de nouvelles technologies,
le chroniqueur s’amuse à créer des lexies telles que otitophone ou encore mobiliotite.
Selon le chroniqueur, il s’agit d’une otite qu’on peut avoir à cause du téléphone
portable.
24 En ce qui concerne le domaine religieux, les créations lexicales à effet humoristique
n’ont pas été recensées. Ce domaine n’est pas propice à la créativité. Cette abstinence à
la création est due, pensons-nous, à la nature même du domaine. En d’autres termes, le
domaine religieux, où ne s’applique pas avec humour la créativité lexicale, est un
domaine traditionnellement sacré et donc n’est pas favorable à la création. Le
chroniqueur préfère s’abstenir de faire des créations dans ce domaine. L’analyse
discursive de la presse écrite francophone, en l’occurrence la chronique Tranche de vie
du journal Le quotidien d’Oran, a essentiellement porté sur le processus de la création des
lexies comme vecteur de l’humour. Ces lexies, volontairement créées, sont insérées
dans un contexte à caractère humoristique afin d’établir avec le lecteur une certaine
familiarité et connivence. Ces dernières se manifestent par l’usage de la langue sous
toutes ses formes : alternance des langues, emprunt à l’arabe dialectal, en particulier,
jeux de mots et création lexicale qui, contribuent en grande partie à l’effet
Multilinguales, 15 | 2021
81
humoristique. Parmi les procédés de création lexicale, certains, comme la dérivation, la
composition, la synapsie, la métaphore..., sont privilégiés pour véhiculer l’humour.
25 Ainsi, en lisant ces créations, on voit bien que le genre de la chronique est plutôt
ironique. L’humour dans toutes ses formes (ironie, dérision et satire) est donc une des
stratégies que le chroniqueur adopte pour révéler le quotidien. Le chroniqueur se
présente ainsi comme un facilitateur de lecture des réalités sociales. C’est une façon
donc humoristique et satirique de dévoiler le quotidien et refléter une image
caricaturée de la réalité sociale. L’activité sociale avec ses divers domaines constitue
pour la créativité langagière la source première de sa dynamique.
26 La répartition des créations lexicales à effet humoristique par domaines nous a permis
de rendre compte de la domination du domaine social. Le domaine culturel se trouve
plus au moins néologène par rapport aux autres domaines. Fait confirmé par le nombre
considérable des emprunts. Ainsi des lexies telles que cultureur ou encore sketchistes ont
été recensées. Il est à noter ensuite que le domaine politique vient en troisième
position. Or, des créations lexicales attachées à la politique intérieure sont plus
nombreuses que celles qui appartiennent à la politique extérieure. Des lexies
néologiques ont été également recensées dans le domaine économique. En effet, ces
innovations lexicales à effet humoristique ont été créées suite à la crise économique qui
a touché le système économique de tous les pays du monde. Le domaine scientifique et
de la technologie vient en dernière position. Cela s’explique par le fait que nous avons
affaire à un journal non spécialisé.
27 Cette étude qui s’est intéressée à l’analyse de l’acte humoristique par le biais des
procédés de création lexicale dans les chroniques journalistiques, ne prétend pas
l’exhaustivité. Bien certainement, tous les résultats ainsi que les remarques ne sont
valables que pour notre corpus d’étude. Bien qu’ayant recherché, dans cette étude, à
examiner le mieux possible notre corpus, il peut néanmoins contribuer à approfondir
d’autres pistes de recherche : une analyse approfondie qui permet de voir comment
s’applique avec humour la création lexicale dans le discours journalistique en
constituant des corpus plus larges et plus diversifiés.
BIBLIOGRAPHIE
ADAM J-M., (1997), « Unités rédactionnelles et genres discursifs : cadre général pour une
approche de la presse écrite », In Pratiques, no 94, p. 3-18.
ALLAM-IDDOU S. & BOUTMGHARINE N., (2016), « Le français d’Algérie et du Maroc : une étude
comparative des interférences comme source de créativité lexicale ». Université de Paris Diderot.
. Colloque International Langues, Cultures et Médias en Méditerranée : formes, sens et
développemen. <hal-01370321>.
BANKS D., (2005), Les Marqueurs Linguistiques De La Présence De L’auteur, L’Harmattan. p. 260.
Multilinguales, 15 | 2021
82
CATARING A-T., (2011), « Néologismes d’auteurs »dans la presse écrite généraliste. http://
www.contrastiva.it /…/ Deroy, % 20Tipologie %20general %20neologis. Site consulté le
20/11/2011.
CHARAUDEAU P., (2011), « des catégories pour l’humour. Précisions, rectifications,
compléments. », In Vivero Ma.D. (dir.), Humour et crises sociales. Regards croisés France-Espagne,
(pp. 9-43), L’Harmattan, Paris, Article disponible sur URL : http:// www. Patrick Charaudeau.
com/Des-categories-pour-l-humour, 274.html, Consulté le 02/05/2013.
CHARAUDEAU P., (1997), Le discours d’information médiatique, la construction du miroir social, coll.
Médias-Recherches, Nathan, Paris.
CORBEIL J-C., (1974), « Analyse des fonctions constructives d’un réseau de néologie,
l’aménagement de la néologie », actes du colloque international de terminologie, office de la
langue française, Québec, mai 1975.
CORBIN D., (ed. 1991), La formation des mots : structures et interprétations, (Lexique, 10.) Lille :
Presses universitaires de Lille, 294 pp. 2 907170 04 X.
DE BROUCKER J., (1995), Pratique de l’information et écritures journalistiques, p. 207,CFPJ, Paris.
EVRARD F., (1996), L’humour, « Contours Littéraires », Hachette
MOURIQUAND J., (1997), L’écriture journalistique, p. 19, PUF, Paris.
PICARD J.-C., (1999), « La chronique dans les quotidiens québécois : un genre journalistique de
plus en plus populaire », in Les Cahiers du journalisme, n° 6, 1999, pp. 36-49. Disponible sur le site :
http://www.cahiersdujournalisme.net/cdj/pdf/06/06_Picard.pdf.
PRUVOST J., SABLAYROLLES J-F., (2003), Les néologismes, n° 3674, p. 17, Paris, « Que sais-je ? »,
PUF, 128 pages.
SABLAYROLLES J-F., (2000), La néologie en français contemporain. Examen du concept et analyse de
productions néologiques récentes, p.p72-133, Honoré Champion
SABLAYROLLES J-F., (2009), « Des néologismes par détournement ? ou Plaidoyer pour la
reconnaissance du détournement parmi les matrices lexicogéniques », Recherches, didactiques,
politiques linguistiques : perspectives pour l’enseignement du français en Italie, Oct 2009, Milan,
France. pp. 17-28. ffhalshs00735933f https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00735933
Consulté le [12/5/2013].
SABLAYROLLES J.-F., (2017), « Créativité lexicale en discours liée à l’existence de paradigmes », in
Signata, Annales des sémiotiques/ Annals of semiotics, Article disponible en ligne à l’adresse :
https://journals.openedition.org/signata/1345
SADER FEGHALI L., (2005), « La presse vue à travers Néoscope : Quand les contextes médiatiques
sont mis au service de la néologie », In Mots, Termes et Contextes, Actes des septièmes Journées
scientifiques du réseau de chercheurs, Lexicologie Terminologie Traduction, Bruxelles,
Belgique-8, 9 et 10 septembre, p. 532.
VOIROL M., (1995), Guide de la rédaction, p. 18, CFPJ, Paris.
Xu Z., (2001), Le néologisme et ses implications sociales, p. 55, L’Harmattan.
Multilinguales, 15 | 2021
83
NOTES
1. Pour comprendre comment le phénomène de l’innovation lexicale humoristique que l’on
entreprend de présenter d’abord et d’analyser par la suite, nous avons choisi comme corpus un
échantillon des chroniques publiées dans le journal quotidien généraliste algérien en langue
française Le Quotidien et le journal.
2. Issu d’un nom d’un homme politique, le président Bouteflika, création par analogie (à
marxisme), cette lexie indique une attitude politique. Construction hybride, cet exemple illustre
aussi la tendance à l’association de la lexie arabe (nom d’un patronyme) à un morphème de la
langue française.
3. Cette création combine les fragments de mots « démocratie » et « anarchie » désignant deux
systèmes sociopolitiques en principe antagonistes. Il s’agit sans doute de la démocratie pratiquée
d’une façon anarchique.
4. Cette lexie est construite sur un nom propre Bill Gates. Elle a été créée à l’occasion de l’Aïd, fête
religieuse musulmane, fête du sacrifice pour désigner les vendeurs de troupeaux qui font fortune
en cette occasion et il les compare alors à Bill Gates.
5. Il s’agit d’une une conversion N->V sur un nom emprunté. Il a été créé pour désigner le
comportement des femmes qui changent de tenue dans un mariage, le chroniqueur les compare
aux artistes.
6. Le processus sémantique néologique est créé essentiellement à partir de métaphores comme le
Lénine du Funk. La star américaine du genre musical « funk », Mikael Jackson, est assimilée à une
figure politique russe, Lénine, associée à la révolution russe d’octobre 1917.
7. Pour pouvoir analyser les lexies néologiques, il est nécessaire de ne pas s’arrêter seulement à
la création lexicale mais de prendre en considération « l’ensemble de la situation de production et
extra-linguistique » Chr Marcellesi (1974 :95-96), des néologismes, qui sont à saisir et à étudier dans
leur contexte (le texte dans lequel ils apparaissent) et l’environnement général. On relève donc
une relation entre l’emploi des néologismes et le contexte de la période.
8. Un quotidien de la presse écrite française (1879-1938/1940) dans lequel Maupassant écrit
Messieurs de la chronique, novembre 1889.
9. Dans la chronique journalistique Tranche de vie apparaît le pseudonyme de l’auteur soussigné
EL Guellil, dont le vrai nom est Baba Hamed Fodil. A treize ans, il était déjà au théâtre amateur.
Plus tard, il se transporte à Alger pour poursuivre des études de théâtre à l'Institut nationale des
Arts dramatique. Ensuite, il passe un bref séjour de quelques années à l'école des arts et métiers
de Paris. Puis, il retourne travailler en Algérie dans l'entreprise Nationale de Cinéma. Dans les
années 1990, la libération du champ médiatique, avec la création de la presse privée, il a été un
des pionniers de la presse privée à Oran avec la création d'un journal du soir puis l’Espoir et enfin
le journal Le Quotidien d'Oran où il occupe le poste de directeur technique en plus de l'animation
quotidienne de la rubrique Tranche de vie. En 2006, ses chroniques ont été rassemblées dans un
recueil de 293 pages, sous le titre Tranche de vie par el-Guellil, publié par la maison d’Edition Dar el
Gharb d’Oran.
10. La bénédiction est la traduction en français.
11. Dans est la traduction en français.
12. Cela veut dire une grande entreprise en français mais dans ce passage, cette expression veut
dire un homme riche.
13. Tout est en marche.
14. Cette lexie et les autres sont complexes car elles sont fabriquées à partir de la lexie dimanche,
lundi, mardi, mercredi et la lexie arabe Ramdhan, le mois du jeûne pour les musulmans. Ces
néologisme ont été crées sur le modèle de formation apocope (diman, lund, mard, mercred) et
aphérèse (dhan) en utilisant le procédé de compocation. Ils désignent les jours du Ramadhan.
15. Protocole de transmission numérique à haut débit qui utilise le réseau téléphonique.
Multilinguales, 15 | 2021
84
16. Entreprise.
17. Ce phénomène de la création lexicale de la presse témoigne de l’évolution de la société
algérienne depuis le début des années 1980. Après la décennie noire, les libertés d’opinion et
d’expression ont fait de la période transitoire (1988-1990) une période propice à l’émergence de
nouveaux mots dans les médias indépendants. Cette mutation médiatique a eu une incidence
directe sur la dynamique et l’évolution des pratiques linguistiques des journalistes. Certaines
chroniques journalistiques des années 2007-2016 ont suscité l’intérêt que nous portons à la
création lexicale.
18. Nous avons également pris en considération le cotexte qui indique le groupe de termes dans
lequel se trouve la création lexicale, pour aussi déterminer la catégorie grammaticale du
néologisme.
19. Corpus recueilli dans le cadre d’une recherche menée en 2009-2015, qui s’inscrit dans la thèse
de doctorat qui s’intéresse à la néologie journalistique et en particulier l’innovation lexicale et la
productivité des procédés de nouvelles créations lexicales dans la presse francophone algérienne,
soutenue et mise ligne, en 2017, sur le site : http://e-biblio.univ-mosta.dz dirigée par J-F
Sabalyrolles.
20. La liste des créations, présente ici, n’est pas exhaustive.
21. Nous développerons ultérieurement l’analyse détaillée des créations appartenant à ces
matrices morphosémantiques, syntaxico-sémantiques, morphologiques pragmatico-sémantique
ainsi que la matrice externe. Celle-ci est principalement constituée de procédés relevant de
l’interférence tels que l’emprunt.
22. Cette lexie est issue du participe passé bu du verbe boire et ivresse, état d’une personne ivre.
23. Se référer au tableau intitulé annexe, p. 12.
24. Pour créer ce mot composé, le chroniqueur a pu relier par l’interfixe-o- deux mots mobile et
otite.
25. Ce nom d’agent est construit sur la base otite et le suffixe –eur. Ce néologisme a été crée pour
désigner ceux qui ont le téléphone portable collé à l’oreille : « Comme tous les « otiteurs »
(otiteur, c'est celui qui, la journée durant, a son portable collé à l'oreille) […] »
26. Festival Panafricain d’Alger.
27. Par analogie à cinéaste
28. Cette lexie a été créée par analogie à humoriste.
29. C’est un dérivé du verbe écrire qui laisse supposer une connotation sémantique péjorative de
ce mots dérivé désignant l’écrivain pauvre : [non, il ne s’agit pas du trou du journal que l’infortuné
écriveur, que je suis […]
30. cultureur constitue pertinemment une lexie néologique par affixation. La comparaison de
cultureur et cultivé ou culturel permet de relever la valeur péjorative de ce suffixe dans la
formation de ces dérivés.
31. Lexie néologique par analogie à Hard Rock.
32. Des composés hybrides où les deux éléments constitutifs appartiennent à deux langues
différentes, anglais/arabe.
33. Doigtalisme vs au vote informatisé.
34. politico-politique s’assimile plutôt à un pléonasme même si le composant politico ajoute une
détermination supplémentaire à politique puisqu’il en spécifie, pensons-nous, le type de système
politique établi en Algérie.
35. Cette lexie et la suivante ont été inventées d’une manière ironique pour décrire la situation
économique d’une minorité d’Algériens ont pu faire de l’argent au détriment de certains d’autres
qui ne peuvent même pas subvenir aux besoins les plus élémentaires de leur famille. : « Depuis
qu'une minorité de superalgériens, en se « dinarisant » à outrance et en se « dollarisant » avec aisance, s'est
« milliardisée » au détriment des « ah j'ai rien ! »
Multilinguales, 15 | 2021
85
36. Il s’agit de la déformation volontaire du signifiant par jeu de mots. Cette lexie est créée
ironiquement : « Moi, je vous le dis, quitte à vous paraître ridicule, que la crise porcine et la
grippe financière qui affectent toute la planète ne peuvent pas faire de dégâts chez nous car on
est immunisés […] »
RÉSUMÉS
Notre contribution vise à mettre en valeur l’acte humoristique dans le discours journalistique
francophone à travers des créations lexicales. Si l’innovation lexicale a fait l’objet de nombreuses
études, nous ne recensons aucune étude consacrée à la création lexicale à effet humoristique de
la presse algérienne francophone. Pour cela, nous nous permettons d’actualiser une analyse
discursive de l’humour à travers les créations lexicales manifestées dans le discours
journalistique. Dans le cadre de cette étude, nous proposons tout d’abord d’identifier toutes les
créations pouvant servir de base à des effets humoristiques afin de les analyser puis nous
mettons en évidence la mise en œuvre du processus de la création lexicale.
Our contribution aims to highlight the humorous act in French-speaking journalistic discourse
through lexical creations. While lexical innovation has been the subject of much study, we
haven’t found any studies devoted to the humorous neology of the French-speaking Algerian
press. To this end, we allow ourselves to update a discursive analysis of humor through the
lexical creations manifest in journalistic discourse. In the framework of this study, we first
propose to identify all the creations that can serve as a basis for humorous effects in order to
analyze them, then we highlight the implementation of the lexical creation process.
INDEX
Mots-clés : Créativité lexicale, acte humoristique, processus de formation de mots, presse écrite
algérienne, processus de création lexicale
Keywords : Lexical creativity, humorous act, word formation processes, Algerian written press,
lexical creation processes
AUTEUR
SAMIRA ALLAM IDDOU
Laboratoire de rattachement ELILAF : Université de Mostaganem, Algérie
Multilinguales, 15 | 2021
86
La lecture/déchiffrement enAlgérie et la méthode syllabiqueReading/deciphering in Algeria : proposal of the syllabic method
Afaf Salhi et Mourad Bektache
1 La lecture au sens du déchiffrage est une activité clé qui nécessite sans doute une
maitrise totale de la part de l’apprenant. Pour cela, son enseignement constitue l’une
des premières priorités à l’école primaire.
« La lecture est la première des trois connaissances de base dont l’école primairedoit munir les élèves » (Giollito, 1984 :8).
Au-delà de son usage fréquent au quotidien, la maîtrise de la lecture est une condition
fondamentale de l’intégration socio- professionnelle de toute personne. « Il faut bien admettre que la lecture conditionne la réussite scolaire au mêmetemps que l’individu » écrit Philibert (2006 :14).
2 En fonction de leurs principes didactiques, les méthodes d’enseignement de cette
activité sont élaborées essentiellement selon deux conceptions différentes : l’une,
synthétique, basée sur le principe alphabétique c’est-à-dire aller de l’élément simple
qu’est la lettre vers le texte en passant par le mot. L’autre, analytique qui va du texte
vers la lettre. Elles visent chacune l’efficacité. Malgré les nombreux travaux de
recherche qui ont traité de ce sujet, la question de rentabilité reste « relative » ouvrant
ainsi le débat entre chercheurs et praticiens particulièrement les enseignants du cycle
primaire. Ceux-ci leur revient de penser minutieusement au choix des méthodes
adéquates du moment que les apprentissages ultérieurs dépendent de la maitrise de
cette activité pendant cette étape de la scolarité.
3 En Algérie, l’apprentissage de la lecture débute en troisième année primaire (première
année d’apprentissage du français langue étrangère) et se fait selon la méthode semi
globale. Celle-ci étant une combinaison des deux méthodes syllabique et globale. Les
instructions officielles de 2003 et celles de 2016 justifient le choix de cette méthode par
le fait que son but est d’
« arriver à une lecture qui ne soit pas mécanique, qui saisisse les unités de sens ens’appuyant sur chacune des articulations : lettre, syllabe, mot » (Document
Multilinguales, 15 | 2021
88
d’accompagnement décembre 2003 : 6) (document d’accompagnement duprogramme 216 :7).
Contrairement à cela, la méthode syllabique est, selon les mêmes documents, « basée sur la présentation de phonèmes dépourvus de signification et vides de senstelle la syllabe » (Ibid. : p. 25).
4 Une première étude menée sur ce thème dans le cadre de notre mémoire de magister,
nous a permis de relever un échec quant à l’appropriation de cette activité chez nos
apprenants de troisième année primaire. Les résultats avaient révélé en effet, un taux
de déficit considérable estimé à 66 % de difficultés au niveau de la maitrise phonie/
graphie. Au niveau du déchiffrage, l’évaluation des apprenants a montré qu’il se limite
nettement à une bonne prononciation des lettres suivant les étapes d’une leçon de
lecture présentée selon la méthode semi-globale. Nous lions cet échec d’un côté, à la
complexité de l’activité elle-même, la méthode semi-globale adoptée en plus de son
apprentissage dans le cadre d’une langue étrangère.
5 Notre intérêt s’est suite à cela, retourné vers la proposition pour des apprenants
algériens, d’une autre méthode d’enseignement qui pourrait les aider à maitriser cette
activité et faire d’eux de bons lecteurs déchiffreurs, autonomes. Une méthode qui serait
convergente avec les conditions d’apprentissage dont entre autres le milieu
socioculturel et les capacités cognitives. La question fondamentale que nous soulevons
est donc la suivante : serait-il plus efficace et plus bénéfique d’enseigner le
déchiffrement selon la méthode syllabique à des élèves de troisième année primaire ?
Une question fondamentale de laquelle découlent d’autres : cette méthode sera-t-elle la
bonne solution aux préoccupations des enseignants qui se plaignent du niveau de
déchiffrage faible malgré les efforts fournis ? Est-ce qu’un élève de troisième année
primaire qui apprend selon la méthode synthétique peut être autonome dans son
apprentissage et plus tard dans ses lectures ?
Cadrage théorique
Qu’est-ce que lire ?
6 L’acte de lire est défini selon plusieurs paramètres. C’est d’abord attribuer du sens aux
signes graphiques en ce sens que l’on lie chaque lettre et /ou groupe de lettres à une
sonorité particulière. « Lire » serait également en lien avec les capacités intellectuelles
selon Muckensturm (2012 :30). Ce dernier écrit que « c’est un travail de l’esprit » par
lequel le lecteur parvient à « solliciter modestement mais réellement des facultés
intellectuelles, la capacité d’invention »(P.8). Après quoi, l’auteur évoque la dimension
du sens dans sa définition en écrivant que lire c’est : « créer du sens à l’aide des images
visuelles que sont les mots » (Ibid.). Conjuguant les deux aspects décodage et
compréhension, Chauveau (2004) enrichit cette idée en disant qu’il conçoit la lecture
comme étant une « activité à la fois culturelle et langagière ». Elle est selon lui culturelle
parce qu’on lit pour « s’informer, se divertir, agir, imaginer, apprendre… » .
7 Pour définir l’acte de lire, G. Chauveau et E. Chauveau (1990) rappellent des modèles
théoriques dont essentiellement les modèles « de bas en haut » qui reposent sur une
logique de passage des « éléments primaires » dont acquisition des lettres et syllabes
vers des « processus cognitifs supérieurs » en relation avec la production du sens. Les
modèles de « haut en haut » qui proposent une démarche contraire qui repose sur la
Multilinguales, 15 | 2021
89
reconnaissance des mots avec « anticipation des formes écrites » (Ibid). Bokstoel (2007)
quant à elle, fait intervenir les indices syntaxiques, sémantiques et graphiques. Dans
son travail, elle évoque la réflexion de Giasson qui pense que les connaissances sur la
grammaire permettent à l’apprenant de faire la différence entre les mots qui se
ressemblent. En effet, l’enfant arrive à lire convenablement des mots qui ont la même
terminaison dès qu’il comprend qu’il s’agit d’un verbe dont le sujet est au pluriel, un
nom ou un adverbe par exemple. L’enfant qui s’appuie sur le sens de la phrase arrive de
ce fait à lire d’une façon automatique et spontanée les mots qui la composent. Enfin,
concernant l’implication des signes graphiques dans la maitrise de la lecture, Bokstoel
exige en plus de la connaissance des graphèmes, la maitrise de la forme des lettres
script et cursive surtout pour les lettres dont la forme change complètement.
Qu’est-ce qu’apprendre à lire ?
8 C’est l’expérience qui sert à « recenser les savoir-faire » essentiels que fournit la maitrise
du code et dont la finalité serait de réussir le décodage, explique Muckensturm (2012 :
30). D’après le même auteur, apprendre à lire c’est passer par les niveaux de la lecture
« hiérarchiques » dont la maitrise de l’un dépend de la maitrise de l’autre et qui sont :
déchiffrage, lecture courante à haute voix, lecture silencieuse et enfin, lecture rapide
(Ibid. : 30). De son côté, Giasson (2014) propose un canevas pour « l’évolution du jeune
lecteur ». Il s’agit d’une somme de capacités qui commencent par l’habileté de
déchiffrement à travers la maitrise du code graphique aussi bien à l’oral qu’ à l’écrit
jusqu’à la capacité de choisir ses propres lectures en passant par plusieurs attitudes
qu’un lecteur développe par rapport à un écrit dont l’anticipation, l’élaboration et
l’exploitation qui ne sont autre que des aspects de la compréhension.
9 Afin de réaliser l’acte de lire, le processus commence par « une exploitation visuelle »
(Gombert, 2014) qui consiste en une fixation d’une chaine de mots au même temps,
suivie d’une identification des mots écrits (Ibid.). Celle-ci serait le résultat d’une
compréhension du principe alphabétique se basant sur la correspondance graphie/
phonie. Après quoi, le lecteur entame l’identification des graphèmes dont lettres et
groupes de lettres (l, r, ch, in, eau…) suivie par un apprentissage explicite de ces
derniers. C’est une acquisition importante au début de l’enseignement car elle prépare
à l’auto-apprentissage (Ibid.). Le principe alphabétique constitue également une étape
importante dans l’apprentissage de la lecture selon Gombert(2014). L’apprenant ne doit
pas se contenter d’identifier les lettres mais il doit comprendre qu’elles entrent dans la
formation d’autres mots (Ibid.). Ces acquisitions constituent un dispositif indispensable
au déchiffrement. Ce dernier étant « l’étape clé de la lecture » (Dehaen, 2007 :291).
Spécificité de la lecture en français
10 Des études telles que celle de Peerman et al. (2013) ont montré que la spécificité de la
lecture en langue française réside dans « la consistance » des correspondances
graphèmes /phonèmes du moment qu’à plusieurs graphèmes correspond un phonème.
Les apprenants doivent de ce fait, adopter une démarche phonologique en début
d’apprentissage de la lecture car la réussite dans l’appropriation de l’habileté de lire en
dépendrait. Les études de Charolles menées entre 2003 et 2016 ont prouvé que des
apprentis lecteurs favorisent la voie phonologique pour lire aussi bien des mots
réguliers que des mots irréguliers même si des erreurs de régularisation sont à
Multilinguales, 15 | 2021
90
mentionner. Les enfants ont tendance en effet, à prononcer des lettres muettes comme
le p de sept.
Malgré ces insuffisances recensées, les recherches de Sprenger Charolles ont confirmé
que les apprenants qui ont le plus recours au décodage c’est-à-dire qui maitrisent
l’assemblage et la prononciation correcte des syllabes sont ceux qui progressent le plus
dans l’apprentissage de la lecture/déchiffrement. En effet, le choix de cette stratégie
favorise des connexions entre graphèmes et phonèmes.
Apprendre à lire en langue étrangère
11 Gaonach (2005), affirme que des mécanismes en interaction qui entreraient dans la
réalisation de l’acte de lire, seraient déjà placés en langue maternelle. De ce fait, la
lecture dans une autre langue n’aurait pas un début (ibid.). Cet appui sur la langue
maternelle afin de lire dans une autre langue, se réaliserait de la même façon qu’il soit
sous la forme d’une prise d’informations à partir d’hypothèses ou une prise
d’informations à partir de lettres ou de mots (Goodman et Slith in Gaonac’h : 2005). Un
avis qui n’est pas partagé par Riquois (2010) qui pense qu’il s’agit en fait de « deux
situations de lecture différentes » dont chacune présente « des particularités et des objectifs
singuliers » (Ibid). La différence réside également au niveau du comportement adopté
par l’apprenant vis-à-vis le texte. Ainsi, un apprenant en français langue étrangère ou
seconde, est considéré comme un « sujet lecteur » dans sa langue maternelle et
« lecteur apprenant » quand il lit un texte en français.
12 Lors de l’appropriation du système de l’écrit durant la phase préparatoire, les
apprenants aussi bien natifs que non francophones rencontrent des difficultés qui
entravent leur apprentissage à cette étape (Rafoni : 2014). Les principales contraintes
que rencontrent des apprenants non francophones se situent essentiellement au niveau
de la distinction des unités non significatives qu’ils ont tendance à acquérir un peu tard
par rapport aux natifs. D’autre part, l’identification du mot écrit à partir des lettres et
des syllabes écrites est entravée à cause du stock lexical limité chez les enfants non
francophones. Le dernier point soulevé par Rafoni quant aux difficultés rencontrées
par les apprenants dont le français n’est pas une langue maternelle, concerne « les
différences » dans le « rythme d’acquisition (Ibid.). Ce problème s’explique selon l’auteur
par un déficit dans la manipulation des unités linguistiques par les allophones dépassés
en cela largement par leurs pairs francophones (Ibid.).
Débat des méthodes d’enseignement de la lecture
13 De par leurs principes méthodologiques, les méthodes d’enseignement de la lecture se
divisent en dépit de plusieurs désignations (phonétiques, alphabétiques, globales, semi
globales) en deux grands ensembles : les méthodes analytiques qui favorisent la
décomposition d’un tout dont un texte ou une phrase pour aller vers la syllabe puis la
lettre. D’autres dites synthétiques qui, au contraire, s’appuient sur la composition à
partir de la plus petite unité (la lettre) pour aller vers des éléments plus complexes
dont la syllabe, le mot, la phrase et enfin le texte.
14 Pour enseigner la lecture au sens du déchiffrement, deux grands axes font l’unanimité,
le décodage des signes graphiques et l’accès au sens. Cependant, un grand débat qui
retourne parfois en « querelle » fait que les chercheurs polémiquent sur le
Multilinguales, 15 | 2021
91
cheminement qu’il faut adopter pour y parvenir. Condamnée à l’échec par les
chercheurs, la méthode dite « idéo visuelle » est la seule qui semble « bonne à écarter »
car, à en croire Boulanger (2010 :143), elle :
refuse le travail systématique sur la correspondance graphème/phonème. Elle n’estplus utilisée et personne ne pense sérieusement aujourd’hui qu’un enfant puisseapprendre de textes (…).
Un point de vue partagé par Peiron (2015) qui, lui aussi, appelle à délaisser cette
méthode car elle « consiste à photographier les mots, à les reconnaitre grâce à leur forme ».
15 Une étude américaine menée par l’organisme de recherche « national Reading panel »
entre 1988 et 1999 a conclu également que les méthodes purement globales qui
excluent complètement l’enseignement des correspondances graphies/phonies, sont
démunies de la moindre efficacité. Elles reposent sur la mémorisation de la graphie des
mots sinon sur la reconnaissance des mots à travers le sens de la phrase. D’autant plus
que cette stratégie qui conviendrait plus aux écritures idéographiques ne peut convenir
à une langue alphabétique.
16 Dans une conception différente, Charmeux (2016) écarte toute entrée par la
correspondance graphème/phonème la considérant comme une « erreur pédagogique »
qui risque de mettre en difficulté tous les élèves. Elle explique son point de vue comme
suit : les enfants entrent à l’école avec des représentations graphiques sur les objets
qu’ils possèdent et qu’ils voient. Il serait donc préférable de leur enseigner la lecture à
partir de ce qu’ils savent. Aborder l’apprentissage de la lecture à partir d’éléments
abstraits, veut dire selon Charmeux, « casser dès l’entrée » pour l’élève « toute possibilité de
comprendre »et prévoir des répercussions négatives sur l’habileté de lire (Ibid.).
L’évaluation scientifique des méthodes d’enseignement de la lecture
17 Devant ce débat « acharné » sur les différentes méthodes d’enseignement de la lecture,
la neuroscience intervient afin de fournir un avis aussi bien objectif que rigoureux.
Ainsi, Stanislas Dehaen affirme que
« les données de l’imagerie et de la psychologie ne sont pas neutres vis-à-vis desgrands débats sur la lecture à l’école » (2007 :290).
Afin de justifier le recours à l’imagerie médicale dans le domaine, il affirme que « quand il faut apprendre à lire, tous les enfants ont le même cerveau qui impose lesmêmes contraintes et la même séquence d’apprentissage » (Ibid.).
Cet avis serait de ce fait, suffisant pour retracer les différentes étapes par lesquelles
passe le parcours de déchiffrage des mots « notre cerveau ne passe pas directement de l’image des mots à leur sens. A notreinsu, toute une série d’opérations cérébrales et mentales s’enchainent avant qu’unmot ne soit décodé » (Ibid.).
18 Pour justifier le choix de la méthode synthétique, il affirme que
« l’imagerie médicale met en évidence l’effet le plus spectaculaire : l’hémisphèredroit s’active pour la lecture globale, alors que l’attention portée aux lettres activela région classique de la lecture l’aire occipito-temporale ventrale gauche.Autrement dit, l’apprentissage par la méthode globale mobilise un circuitinapproprié » (Ibid.).
Une idée soutenue par Thérèse Cuche et Michelle Sommer (2016) qui, s’appuyant sur
leur expérience d’orthophoniste et psychothérapeute, confirment qu’il faut apprendre
à l’enfant le code pour qu’il devienne lecteur déchiffreur. Lui apprendre un texte par
Multilinguales, 15 | 2021
92
cœur, lui donne juste l’impression qu’il lit (Ibid.).Pire encore, opter pour une démarche
globale mènerait une catégorie d’apprenants à l’abandon de cet apprentissage (Ibid.).
19 Les adeptes de cet avis n’ont pas négligé de proposer quelques recommandations
didactiques pour la préparation et la présentation d’une leçon de lecture selon la
méthode syllabique dont :
Préparer l’enfant à travers l’entrainement à la conscience phonétique en focalisant sur une
bonne perception de la forme des lettres
Aborder la correspondance graphème/phonème au début du processus enseignement/
apprentissage d’une façon explicite
Procéder dans l’enseignement des lettres selon les critères du degré de complexité et de la
fréquence
Expliquer qu’à chaque son correspondent plusieurs transcriptions
Proposer aux apprenants des mots et des phrases qui contiennent uniquement les lettres
étudiées.
Choix méthodologique
20 Pour mener notre étude, nous avons proposé une progression conçue selon les
principes de la méthode syllabique. Nous l’appliquons dans des classes de troisième
année primaire qui constitue la première année d’apprentissage du français langue
étrangère en Algérie. Grâce aux neuf évaluations programmées le long du processus
enseignement/apprentissage qui dure une année scolaire, nous aurons des indices sur
l’apport des principes méthodologiques de cette démarche par rapport à l’acquisition
de l’acte de lire pour des apprentis –lecteurs. Nous serons également renseignés sur
l’adéquation de cette méthode avec les conditions d’apprentissage de cette activité.
Conditions du déroulement de l’enquête
21 L’étude est menée dans dix écoles de la circonscription f2 de la wilaya de Constantine.
L’échantillon comporte 377 élèves répartis sur 15 classes. Le choix dans sa délimitation
est basé sur les paramètres du milieu social, le nombre d’élèves dans chaque classe et
l’expérience professionnelle des enseignants relative au nombre d’années de service.
Notre choix n’a pas pu être complètement satisfait à cause de quelques obstacles liés
essentiellement à la réticence de certains enseignants qui ont refusé de participer à
l’étude sinon le départ de certaines d’entre elles travaillant dans des régions qui
répondent à nos critères, en congés. Nous avons quand même réussi à diversifier notre
choix qui s’est fixé sur les écoles suivantes :
Dans la région urbaine
L’école Aboubakr Essedik dans la région Djebel Alouahche
L’école Mouloud Feraoun dans la cité Emir Abdelkader
L’école Loucif Fatima dans la cité Loucif au centre-ville.
Dans la région semi-urbaine
L’école Goumida Ali à 45 kilomètres de Constantine
L’école Hanache Rabah dans la cité Sarkina dans la banlieue
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
93
L’école Boughrara Rabah à 45 Kilomètres de Constantine
Dans la région rurale
L’école Houcine Chaaraoui dans la région Tafrente
L’école Seradj Mostapha dans la zone rurale de Djebel Aouahch
Dans la région semi-rurale
L’école Aouane Rabah à 45 kilomètres de Constantine.
L’instrumentation
22 Nous avons procédé avec une progression de notre conception qui contient le
programme à enseigner en plus d’une fiche d’évaluation qui sert à la quantification du
rendement des apprenants concernant la qualité et le rythme de l’appropriation de
l’habileté de lire durant une année scolaire. Nous avons conçu la progression dans une
logique qui
« (…) suppose avant tout tenir compte des besoins et des souhaits de la classe »(Courtillon, 2003 :10).
Nous la présentons en deux volets. A travers le premier, nous décrivons le principe
synthétique de la méthode qui consiste en un départ de l’élément le plus petit qu’est la
lettre. La distinction voyelle /consonne nous mène vers le montage syllabique qui entre
dans la construction du mot, puis la phrase et enfin le texte.
23 Concernant la compétence qu’on tend à installer chez l’apprenant à la fin de son
parcours d’apprentissage, c’est le rendre capable d’effectuer une lecture spontanée
dans toutes les situations de l’apprentissage et qu’il soit surtout autonome dans ses
lectures. Au terme de chaque séance d’enseignement/apprentissage de la lecture, nous
aspirons à ce que l’apprenant arrive à identifier le ou les graphèmes sujet (s) d’étude
sur le plan audio-visuel, et qu’il arrive à comprendre la logique d’assemblage (montage
syllabique) du plus simple vers le plus complexe (consonne/voyelle- consonne/semi-
voyelle, consonne/sons plus complexes : voyelles nasales par exemple).
24 Dans le même volet, nous avons inclus la démarche qu’un enseignant adopte dans la
présentation d’une leçon de lecture/déchiffrement selon la méthode syllabique. Ainsi,
le cheminement rejoint les principes de la méthode en ce sens que l’enseignant
commence par une présentation du ou des graphèmes à étudier, après quoi, il passe au
montage syllabique suivi d’un montage d’une série de mots avec la participation des
apprenants. Afin de s’assurer que ces derniers ont compris la logique de leur
apprentissage et afin de vérifier l’atteinte des objectifs délimités au préalable,
l’enseignant leur demande de lire les mots proposés. La constitution progressive d’un
stock lexical, permet le passage à la rédaction par l’enseignant de petites phrases et
plus loin de petits paragraphes à partir de mots qui contiennent uniquement les lettres
étudiées.
25 Dans ce volet, nous avons également intégré les directives et les consignes destinées
aux enseignants pour les aider dans leur pratique de classe. En effet, même si nous
tenons au respect strict des principes méthodologiques de la méthode dont le passage
progressif des éléments simples vers ceux plus complexes, nous optons pour une
autonomie de l’enseignant concernant la modification des étapes d’une leçon en
fonction du rythme d’apprentissage par exemple. Il revient également au praticien de
•
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
94
travailler à partir des exemples de la progression proposée, les enrichir ou de choisir
d’autres. Nous avons également recommandé le traitement des difficultés relatives au
système graphique de la langue française dont présence de lettres muettes, la liaison
ainsi que les exceptions telles le « er » qui se prononce parfois [e] et parfois [ère]. Quant
au paramètre compréhension, nous avons rappelé la nécessité de lui réserver tout
l’intérêt en pensant à des stratégies et des moyens qui le facilitent dont illustrations,
objets concrets, dessins et dramatisation des scènes dans la mesure du possible.
26 Nous exposons et décrivons à travers le deuxième volet, les différents paramètres de la
progression proposée. Nous nous sommes efforcée à établir un enchainement
« rationnel » qui tend à un maximum d’efficacité et de rentabilité. Ainsi, il est question
dans un premier temps, d’initier les apprenants à l’apprentissage de la lecture /
déchiffrement en commençant par une mémorisation des lettres de l’alphabet afin de
fournir une entrée « fluide » dans le processus d’acquisition de la lecture et préparer à
des apprentissages plus complexes. Il est également question durant cette phase, de
décrire le système vocalique français en faisant d’abord la distinction voyelle/consonne
ensuite en expliquant la logique du montage syllabique. En effet, l’apprenant novice
doit comprendre à ce stade, que c’est la voyelle qui donne la résonnance à la consonne.
Dans le même volet, nous présentons la progression des apprentissages en commençant
par l’étude des voyelles suivie par celle des semi-voyelles ou et oi. Cet apprentissage st
justifié à ce stade par l’identification auparavant des différentes voyelles ce qui permet
ce type de combinaisons. D’autre part, les semi-voyelles permettront le montage d’un
maximum de syllabes ce qui donnera une diversité de mots isolés et de phrases et à lire.
27 Après acquisition des voyelles et des semi-voyelles ou et oi, nous passons à l’étude des
consonnes. Celle-ci est une phase complexe durant laquelle l’apprenant reçoit deux
types d’apprentissage : il continue l’identification des lettres et entame la combinaison
et la production des mots et des phrases. Nous terminons par l’étude des sons. Il s’agit
de combinaisons de graphèmes qui produisent des sonorités : digrammes1 et/ou
trigrammes2. Nous les proposons après l’étude de toutes les lettres pour que
l’apprenant progresse dans le processus d’apprentissage en enrichissant les
combinaisons allant du plus simple vers le plus complexe (passer de syllabes de deux
lettres à des syllabes de trois lettres et plus). Cela lui permet d’aborder le déchiffrement
de paragraphes de plus en plus longs.
28 Pour élaborer le programme à enseigner, nous nous sommes appuyée sur les principes
de jumelage de certaines lettres pour une meilleure opposition phonologique telles :
m/n- t/d-f /v. Nous avons procédé également selon la ressemblance grapho/
phonétique pour jumeler certains sons. C’est le cas des transcriptions des sons [o], [e],
[ɛ],[ ɛː] [ə], [oe],[ø],des voyelles nasales an/am- on/om – en/em- un/um – in/ain /
ein)ainsi quedes sons ail/aille- eil/eille- euil/euille- ouil/ouille. Enfin des suites de
voyelles et voyelles/consonnes : (ia/io/iel –ier/iére- ien/iènne). Par rapport à leur
singularité phonétique, nous avons proposé l’étude de certaines lettres séparément.
C’est le cas du l, j et r. Nous basant sur le même critère, nous avons procédé de la
même façon avec certains sons.
29 Enfin, concernant la progression des apprentissages, nous avons procédé
essentiellement selon les critères du taux de fréquence des lettres et des sons dans la
langue, par rapport au nombre de mots qui contiennent telle lettre et qu’un enfant
algérien peut comprendre en français. Enfin, par rapport à la dépendance des sons les
uns par rapport aux autres dans la constitution des mots lisibles. La fiche d’évaluation
Multilinguales, 15 | 2021
95
ou fiche de suivi réservée au contrôle de l’évolution de l’apprentissage contient les
éléments suivants : le numéro de l’épreuve, son contenu, un tableau avec une première
case réservée à la liste nominative des apprenants et une autre qui informe sur le
niveau de déchiffrement. Celle-ci est subdivisée en colonnes dont chacune fournit des
informations de plus en plus affinées sur le niveau de lecture, ensuite sur la nature des
lacunes décelées chez l’apprenant. Nous y trouvons les indices suivants : niveau de
lecture très bon (TB)- niveau bon (B) - moyen avec déficit au niveau de l’acquisition de
la lettre (M.A.L)- moyen avec déficit au niveau de la combinaison (M.A.C)- très faible au
niveau de l’acquisition de la lettre (T.F.A.L) – très faible au niveau de l’acquisition de la
combinaison (T.F.A.C).
Les modalités d’évaluation
30 Pour la première épreuve, nous avons opté pour une dictée afin de contrôler
l’acquisition des lettres et des syllabes, éléments indispensables à l’apprentissage de la
lecture. Nous estimons que contrairement à la distinction auditive, la reconnaissance
visuelle de ces petites unités n’est pas suffisante pour le contrôle de leur acquisition. A
partir de la deuxième épreuve, nous optons pour des épreuves de lecture car
l’apprenant aurait développé à ce stade de l’apprentissage une conscience
phonologique (discrimination des différents phonèmes d’un mot) qui lui permettrait de
découvrir l’unité mot aussi bien oralement qu’à l’écrit. Plus l’apprenant progresse dans
son apprentissage, on lui propose des listes plus élaborées de mots ainsi que quelques
phrases et/ ou des paragraphes.
Présentation et interprétation des résultats
31 Pour interpréter les résultats, nous procédons à une catégorisation des épreuves selon
les étapes du processus enseignement/apprentissage. Ainsi, nous divisons ce procédé
en trois étapes : celle de l’acquisition des lettres régulières et des syllabes simples, elle
est constituée des quatre premières épreuves, ensuite, l’étape de l’appropriation des
lettres à irrégularité phonétique qui ont une double voire une triple prononciation.
Celle-ci englobe les deux épreuves cinq et six. La troisième étape est celle de
l’acquisition des sons complexes. Elle est constituée des épreuves sept, huit et neuf.
32 Afin de pouvoir cerner les différents éléments qui concernent l’objectif de l’étude, nous
prenons en considération les paramètres suivants : le contenu des épreuves, le nombre
d’apprenants par classe, l’expérience des enseignants de l’échantillon relative au
nombre d’années de service et enfin l’emplacement de chaque école. Les scores que
nous présentons représentent une moyenne des scores de chaque étape pour chaque
indice.
Première étape
Fig1 : la qualité de rendement des apprenants durant la première étape de l’enseignement/apprentissage
Indices Moyenne du score réalisé
Multilinguales, 15 | 2021
96
B
TB
T.F.A.L
M.A .C
M.A .L
T.F.A.C
26, 43
23, 09
16, 92
14 ,59
13, 11
08 ,16
33 Commentaire : Précisons d’abord que nous classons les résultats du rendement des
apprenants en deux catégories : celle des acquis ou la réussite représentée par les
indices « très bon » et bon » ; celle des « déficits » représentée par les indices : « moyen
au niveau de l’acquisition de la lettre », « moyen au niveau de la combinaison », « très
faible au niveau de l’acquisition de la lettre », « très faible au niveau de la
combinaison ». Les résultats des premières épreuves montrent clairement un niveau de
rendement positif à cette étape de l’apprentissage du moment que les deux indices
« bon » et « très bon » s’affichent clairement à travers des pourcentages importants
avec une prédominance de l’indice « bon ». Les apprenants ont en effet, « pu
surmonter » beaucoup de difficultés pendant les premières épreuves de déchiffrage en
ce sens qu’ils ont pu identifier les lettres étudiées à cette étape, effectuer
convenablement des combinaisons et décoder de ce fait les mots qui leurs sont
proposés.
34 Notons également que les meilleurs résultats pour le niveau « bon », sont enregistrés
dans les classes où le nombre d’apprenants atteint une moyenne de 21 élèves et la
moyenne de l’expérience professionnelle des enseignantes atteint une moyenne de 10
ans de service ; et ce, par rapport à l’ensemble des classes où la moyenne des élèves est
estimée à 24 élèves et l’expérience professionnelle des enseignantes est estimée à 5 ans.
Par rapport au milieu socio culturel, le niveau « bon » est mentionné avec différentes
échelles dans les écoles de toutes les régions concernées par notre étude ; notamment
dans les zones : urbaine, semi urbaine, rurale et semi rurale.
35 L’analyse des déficits durant cette étape de l’enseignement/ apprentissage, révèle que
le taux de faiblesse le plus important est mentionné pour l’indice « très faible au niveau
de l’acquisition de la lettre » suivi d’un niveau « moyen dans l’acquisition du système
combinatoire ». La faiblesse dans l’acquisition de l’unité lettre se justifierait à cette
étape de l’apprentissage par l’implication des apprenants dans l’appropriation d’une
langue étrangère. Les lettres proposées à cette étape, sont au nombre de dix : six
voyelles et quatre consonnes ; alors que l’évaluation est programmée après à peu près
trois semaines d’enseignement /apprentissage. Même si nous avons tenu à entamer
l’enseignement avec des phonèmes qui sont « familiers » aux apprenants tels que [m],
[n] et [d], les « images » proposées restent nouvelles et certaines d’entre elles
pourraient entrainer des confusions visuelles.
36 Concernant le déficit dans l’appropriation du principe combinatoire, le résultat
mentionné trouverait une explication par rapport aux contenus qui ont consisté au
départ en un déchiffrement de lettres, de syllabes voire de mots avec des combinaisons
simples constituées de syllabes du type consonne + voyelle. Durant la deuxième
épreuve, ont été proposés des mots et des phrases avec des syllabes complexes à savoir,
consonne + semi-voyelle. Le passage d’un niveau de lecture à un autre aurait entrainé
des difficultés au niveau de l’assemblage des syllabes. Après deux épreuves qui ont
Multilinguales, 15 | 2021
97
proposé des contenus de niveaux différents, une diminution du taux de déficit est
constatée au cours de la troisième épreuve. Cela témoignerait d’un passage vers la
« maitrise » des contenus enseignés au niveau de l’identification ainsi qu’au niveau des
mécanismes de déchiffrage.
37 Les taux les plus élevés de « faiblesse » dans l’acquisition de la lettre sont mentionnés
pour l’ensemble des classes où la moyenne de l’effectif est égale à 24 élèves et la
moyenne de l’expérience professionnelle des enseignantes est estimée à 6 ans
d’exercice ; et ce, par rapport aux classes où la moyenne des élèves est estimée à 25 et la
moyenne des années de service des enseignantes est estimée à 9 ans de service. Le
niveau d’acquisition moyen dans l’appropriation du système combinatoire, est
mentionné avec des taux élevés dans les classes où la moyenne de l’effectif atteint
26 élèves et l’expérience professionnelle des enseignantes atteint 8 ans de service ; par
rapport à celles où la moyenne de l’effectif est estimée à 17 élèves et la moyenne de
l’expérience professionnelle des enseignantes atteint 3 ans.
38 Un « déficit » important représenté par les deux indices « très faible au niveau de
l’acquisition de la lettre » et « moyen au niveau de l’acquisition du système
combinatoire », est mentionné dans les écoles des quatre régions : urbaine, semi
urbaine, rurale et semi rurale. La prédominance est pour les écoles de la région semi
urbaine qui ont connu le plus grand taux de carence.
Nous récapitulons à travers l’histogramme suivant, la qualité du niveau de rendement
au cours de cette première étape de l’enseignement / apprentissage.
Fig2 : la qualité de rendement des apprenants durant la première étape de l’enseignement/apprentissage
Deuxième étape
Fig3 : la qualité de rendement des apprenants durant la deuxième étape de l’enseignement/apprentissage
Indices Moyenne du score réalisé
Multilinguales, 15 | 2021
98
TB
B
M.A.C
T.F.A.L
M.A.L
T.F.A.C
30,37 %
23,88 %
12,80 %
12,29 %
11,49 %
08 ,02 %
39 Commentaire : Les résultats de cette deuxième étape d’enseignement/ apprentissage
révèlent par rapport au paramètre « réussite » une nette amélioration du niveau de
déchiffrement du moment que l’indice « très bon » s’affiche en tête des résultats avec le
pourcentage le plus élevé. Au cours du deuxième trimestre, un nombre « important »
d’apprenants a de ce fait, pu maitriser les éléments que nous jugeons « indispensables »
au déchiffrement à savoir l’identification de l’unité lettre ainsi que le principe
d’assemblage c’est-à-dire la combinaison des syllabes au niveau de la fusion : consonne/
voyelle puis l’assemblage des syllabes afin de prononcer les mots. La maitrise des
premières unités et la lecture de mots au cours de la première étape semble « faciliter »
le déchiffrement d’une unité plus complexe qui est la phrase. Signalons également, que
cet indice a connu une hausse entre la cinquième et la sixième évaluation en passant de
29,73 % à 31,01 %. Concernant le paramètre « déficit », un score presque à égalité est
enregistré pour les deux indices « moyen dans l’acquisition du principe combinatoire »
suivi de celui « très faible dans l’acquisition de la lettre ».
40 Basée sur le principe d’assemblage, l’inculcation de ce principe pour un élève qui
apprend à lire avec la méthode syllabique, revient pendant les séances d’apprentissage ;
son contrôle se fait régulièrement à travers les différentes évaluations ce qui développe
chez le lecteur débutant un « automatisme » qui l’aide à déchiffrer au fur et à mesure le
long de sa formation. L’apprentissage des lettres par contre, confronte l’apprenant
dans chaque séance d’apprentissage à la découverte de nouveaux signes qui différent
les uns des autres de par leur forme et/ou leur correspondance phonétique. Au cours de
cette deuxième étape réservée à l’apprentissage des lettres à irrégularité phonétique, le
niveau de rendement « bas » enregistré pendant l’épreuve 6 est relatif à l’enseignement
des lettres x et y. Ces deux graphèmes n’ont pas de règles « précises » de prononciation.
La lettre x est prononcée ks ou gz entre deux voyelles dans « exercice » et « taxi » et
entre une voyelle et une consonne comme « mixte » par exemple. Il en est de même
pour la lettre y. Même si elle a la valeur de ii, celle-ci apparait comme une consonne
dans les mots où elle précède une voyelle tels que « voyage » et « rayures » , et elle est
exclusivement une voyelle qui produit [i] dans « stylo » et « pyjama » par exemple. En
l’absence d’une « règle de prononciation », l’apprenant se confronte à une situation de
« doute » et de « tâtonnement » afin d’effectuer la bonne combinaison surtout qu’à ce
stade, il ne dispose pas d’un stock lexical « riche » qui pourrait l’aider à déchiffrer en
reconnaissant le mot.
41 Contrairement à cela, et même si les lettres s, c et g (programmées avant x et y), sont à
irrégularité phonétique, leur valeur reste quand même systématique par rapport aux
voyelles auxquelles elles sont associées. Ainsi, le s est toujours prononcé [z] entre deux
voyelles, le c est toujours prononcé [k] devant a, o, u et prononcé [s] devant i, e, é. Le
g est toujours doux [j]devant i, e, é et dur [g] devant a, o et u. Les meilleurs scores
réalisés pour le niveau « très bon » dans la réalisation de l’acte de lire sont indiqués
Multilinguales, 15 | 2021
99
pour l’ensemble des classes, où la moyenne de l’effectif est égale à 19 élèves et la
moyenne de l’expérience professionnelle des enseignantes est estimée à 10 ans de
service ; et ce, par rapport à l’ensemble des classes où la moyenne de l’effectif est
estimée à 32 élèves et l’expérience professionnelle des enseignants est estimée à 4ans
de service.
42 Les résultats supérieurs à la moyenne pour l’indice « moyen au niveau de la
combinaison » sont indiqués dans l’ensemble des classes où la moyenne de l’effectif est
égale à 30 élèves et la moyenne de l’expérience professionnelle des enseignantes est
égale à 8 ans de service et ce ; par rapport aux classes où la moyenne de l’effectif est
estimée à 25 élèves et l’expérience professionnelle des enseignantes est estimée à 3 ans
de service. Concernant le troisième indice « très faible dans l’acquisition de la lettre »,
un déficit important est mentionné dans l’ensemble des classes où la moyenne de
l’effectif est égale à 28 élèves et la moyenne de l’expérience professionnelle des
enseignantes est égale à 6 ans de service ; et ce, par rapport à l’ensemble des classes où
la moyenne de l’effectif est égale à 24 élèves et la moyenne de l’expérience
professionnelle des enseignantes est égale à 6 ans de service.
43 Un niveau de réussite important (supérieur à la moyenne) concernant cette étape
d’enseignement /apprentissage est mentionné à égalité dans les quatre zones : urbaine,
rurale semi urbaine et semi rurale. Par ailleurs, un niveau inférieur à la moyenne est
mentionné à égalité dans les trois régions : urbaine, semi urbaine et semi rurale.
Concernant le paramètre « déficit », des niveaux supérieurs à la moyenne sont signalés
dans les quatre régions concernées par notre étude avec une prédominance dans la
région semi urbaine. Des niveaux « moins importants » (inférieurs à la moyenne) sont
indiqués également dans les quatre régions avec une prédominance des écoles de la
région semi rurale.
Nous récapitulons à travers l’histogramme suivant, la qualité du niveau de rendement
au cours de cette deuxième étape de l’enseignement/ apprentissage.
Fig4 : la qualité de rendement des apprenants durant la deuxième étape de l’enseignement/apprentissage.
Multilinguales, 15 | 2021
100
Troisième étape
44 A ce niveau, nous avons remplacé les abréviations ( M.A.L) et (T.F.A.L) par (M.A.S) et
(T.F.A.S) c’est-à-dire moyen au niveau de l’acquisition des sons et très faible au niveau
de l’acquisition des sons.
Fig5 : la qualité de rendement des apprenants durant la troisième étape de l’enseignement/apprentissage
Indices Moyenne du score réalisé
B 29,45 %
TB 21,30 %
M.A.C 16,25 %
T.F.A.S 15,83 %
M.A.S 15,61 %
T.F.A.C 07,04 %
45 Commentaire : l est très important de noter que les classes ne sont pas toutes
parvenues à atteindre cette étape et donc à terminer le processus enseignement/
apprentissage selon le programme que nous avons conçu. Les résultats révèlent tout de
même, une confirmation de la prédominance du paramètre « réussite », du moment
que l’indice « bon » s’affiche à travers le plus haut pourcentage. Il est en écart « assez
étroit » par rapport à l’indice « très bon » qui s’affiche en deuxième position. A la fin de
ce parcours d’acquisition de l’habileté de lire à travers la méthode syllabique, les
résultats de la troisième étape reflètent un parcours d’apprentissage « stable » par
rapport aux résultats requis. Cette « stabilité » est maintenue malgré le principe de la
graduation des difficultés adopté dans la conception des contenus proposés à ce niveau
et qui ont consisté en des syllabes complexes constituées de quatre voire de cinq et de
six lettres (travail, fenouil, conseille) ainsi que des passages sous forme de phrases et
de paragraphes constitués de quatre, vingt, voire même de trente-six mots. Précisons
que le paramètre « réussite » est représenté à travers l’indice « bon » durant cette
dernière étape de l’enseignement/apprentissage et ce, par rapport à l’étape précédente
où les résultats ont témoigné d’un niveau « très bon ».
46 Concernant le paramètre « déficit », le plus haut niveau de « carence » est signalé dans
l’acquisition du principe d’assemblage à travers l’indice « moyen dans l’acquisition de
la combinaison ».Cette « lacune » pourrait s’expliquer par la « double » complexité du
principe d’assemblage à ce niveau du processus d’apprentissage sur le plan
graphophonétique. L’apprenant s’approprie des syllabes constituées de quatre jusqu’à
sept lettres en plus de la gestion de leur prononciation : pour le même son, on peut
avoir deux émissions de voix différentes en fonction de la consonne à laquelle il est
associé. Prenons l’exemple de [ɛ] qui donne [sɛ] avec la lettre c quand il prend la
forme in ou la forme ein dans : « ceinture » et « cinquante ». Il est par contre
prononcé [kɛ] quand il prend la forme ain/aim dans « africain » par exemple. Notons
Multilinguales, 15 | 2021
101
que les apprenants ont « plus ou moins » pu traiter ces difficultés ce qui a fait que les
résultats se sont stabilisés dans un niveau « moyen » et non pas « faible ». Ils se seraient
appuyés sur les combinaisons déjà étudiées : ci, ce et ca.
47 Au niveau de l’acquisition des sons, une qualité « très faible » dont témoigne un
pourcentage de 15,83 %, est enregistrée au cours de cette dernière étape du processus
enseignement/apprentissage. Nous avons en effet, commencé la troisième étape par
deux séances d’apprentissage durant lesquelles, nous avons proposé des digrammes et
des trigrammes c’est-à-dire des graphèmes constitués de deux, voire trois lettres
auxquels correspond un seul phonème. Il s’agit des différentes transcriptions des
voyelles é, e et o ainsi que les six voyelles nasales an, en, on, et in. La double difficulté
pour l’apprenant résiderait de ce fait, à cette étape, dans la multiplicité graphique. Les
différentes transcriptions des voyelles étant au nombre de onze et celle des voyelles
nasales au nombre de treize. Les meilleurs scores pour le paramètre « réussite » sont
réalisés dans l’ensemble de classes où le nombre d’élèves atteint une moyenne de 21. Et
ce, par rapport aux classes où la moyenne des élèves atteint 24.
48 Pour l’expérience professionnelle, les meilleurs résultats concernant ce paramètre sont
mentionnés dans les classes des enseignantes qui ont travaillé en moyenne 9 ans ; et ce,
par rapport aux enseignantes qui ont travaillé en moyenne 3 ans. En ce qui concerne
l’emplacement des écoles, les meilleurs scores de réussite sont mentionnés dans toutes
les régions concernées par l’étude avec une prédominance des écoles de la région semi
urbaine suivie de la région urbaine. Pour le paramètre « déficit », qui comporte
rappelons- le, les deux indices : « moyen au niveau de l’acquisition de la combinaison »
(MAC) et « très faible dans l’acquisition des sons » (TFAS), les résultats qui témoignent
d’un haut niveau de carence tout comme ceux qui témoignent d’un niveau moins
important de faiblesse sont indiqués dans les classes où la moyenne des élèves est
estimée à 23.
49 En ce qui est de l’expérience professionnelle des enseignantes, le niveau haut de
déficience est signalé chez les enseignantes dont la moyenne des années de service
atteint 5 ans. Un niveau de déficience moins important est signalé par contre dans les
classes des enseignantes dont la moyenne de l’expérience professionnelle atteint 6 ans
de service. L’analyse de l’impact du milieu socio culturel révèle que les écoles des
quatre régions concernées par notre étude ont connu un niveau important de
déficience (supérieur à la moyenne) dans l’acquisition de l’acte de lire à ce stade de
l’apprentissage avec une prédominance dans la région semi urbaine. Un niveau moins
important (inférieur à la moyenne) est signalé à égalité dans les régions : semi urbaine,
rurale et semi rurale avec une prédominance des écoles de la région urbaine.
Nous récapitulons à travers l’histogramme suivant, la qualité du niveau de rendement
au cours de cette deuxième étape de l’enseignement/ apprentissage.
Multilinguales, 15 | 2021
102
Fig6 : la qualité de rendement des apprenants durant la troisième étape de l’apprentissage
50 Au terme de cette étude, nous concluons que l’évolution des résultats témoigne d’une
rentabilité dès le début de l’apprentissage, de la démarche synthétique. Les premières
unités « indispensables » au déchiffrement à savoir lettres, sons ainsi que le principe de
combinaison paraissent de ce fait, acquis pour un bon nombre d’apprenants. Nous
récapitulons à travers le graphe suivant l’évolution du paramètre « réussite » au cours
du parcours enseignement/apprentissage.
Fig7 : évolution de la réussite au cours des trois étapes du processus enseignement/apprentissage.
51 En parallèle, un niveau de déficit est signalé tout le long de ce parcours d’apprentissage
de la lecture aussi bien au niveau de l’appropriation de la lettre que dans
l’appropriation du principe de combinaison. Le paramètre déficit apparait tout le long
de l’étude à travers les deux indices « moyen au niveau de l’acquisition de la
combinaison » (MAC) et « très faible dans l’acquisition de la lettre/du son » (T.F.A.L/S).
Il est à noter que les deux indices ont connu le même parcours d’évolution au cours des
trois étapes du processus enseignement/apprentissage. En effet, ils paraissent à travers
des scores qui baissent lors de la deuxième étape pour retrouver une certaine hausse
vers la troisième.
52 Encore une fois, le principe « facilitateur » basé sur l’inculcation progressive des
éléments impliqués directement dans le décodage parait « efficace » du moment que le
déficit connait une régression dans la deuxième étape après que l’apprenant s’habitue à
son enseignement et s’entraine à lire ; Après quoi, l’insuffisance fléchit quand
l’apprenant s’implique dans une étape plus « compliquée » celle de l’acquisition des
Multilinguales, 15 | 2021
103
sons complexes avec les difficultés qu’ils présentent aussi bien au niveau de
l’identification qu’au niveau de la combinaison. Notons quand même que l’acquisition
de la syllabe a été tout le long de ce parcours moyenne mais jamais faible.
Nous récapitulons à présent l’évolution du paramètre « déficit » au cours du parcours
enseignement/apprentissage.
Fig7 : évolution du déficit au cours des trois étapes du processus enseignement/apprentissage
53 L’aptitude à lire appelle des capacités intellectuelles qui induisent une certaine
« invention », des activités langagières et même des connaissances grammaticales et
syntaxiques. Malgré la diversité des éléments qui composent l’acte de lire, ce dernier
reste en étroite relation avec l’appropriation des graphèmes qui facilitent le décodage
ainsi que la compréhension qui constitue la finalité de toute lecture. Apprendre à lire à
un enfant à l’école primaire privilégie de ce fait, des pratiques enseignantes « fiables »
qui conduiraient l’apprenant au statut du « bon lecteur » surtout que l’appropriation
des autres activités dépend de la maitrise de cette activité.
54 Rappelons que notre étude prend la forme d’une expérimentation menée dans un
nombre d’écoles de la wilaya de Constantine et qu’elle tend à prouver à quel point la
méthode syllabique basée sur le principe synthétique, serait efficace dans l’inculcation
de l’acte de lire à des enfants de troisième année primaire. Nous aspirons à un statut de
lecteur autonome en dehors de toute dépendance familiale. Il nous intéresse également
de les libérer de la technique de mémorisation des textes condamnés le plus souvent à
l’oubli. Les résultats ont prouvé qu’effectivement la méthode syllabique serait adéquate
pour enseigner la lecture/ déchiffrement dans nos écoles grâce à ses principes
didactiques « facilitateurs » car ils s’organisent autour d’une logique d’apprentissage
progressif qui va du plus simple qu’est la lettre vers le plus complexe dont le mot, la
phrase et enfin le texte. Les insuffisances décelées n’ont pas eu un impact trop négatif
sur ce choix du moment que les indices positifs sont restés prédominants le long de
l’évaluation continue.
55 Malgré cela, nous infirmons relativement le facteur de l’adéquation avec l’effectif quel
que soit son importance et le milieu socio culturel de l’enfant avec cette méthode du
moment que des classes avec un effectif réduit ont montré les mêmes carences que
celles à effectif élevé. Il en est de même pour l’emplacement des écoles où nous avons
enregistré la même qualité de rendement positive ou négative aussi bien dans des zones
rurales que dans des zones urbaines. Parler de l’efficacité d’une telle ou telle méthode
n’exclut en aucun cas l’importance de l’apport de l’enseignant. Bien au contraire, nous
Multilinguales, 15 | 2021
104
pensons que la touche du pratiquant à travers des gestes professionnels comme la
régulation des insuffisances méthodologiques, l’ajustement de la pratique selon les
conditions de l’apprentissage, restent indispensables. Même si l’application de cette
méthode dans nos classes s’avère en adéquation avec l’expérience professionnelle des
enseignants aussi bien anciens que novices, ceci ne peut exclure la nécessité d’une
formation bien ciblée et surtout continue de ces praticiens.
BIBLIOGRAPHIE
BOULANGER Françoise, A la découverte de la lecture : premiers apprentissages. Pratiques et
théories, Ed, sciences humaines 2010.
COURTILLON Janine, Elaborer un cours de FLE, Ed. Hachette, 2003
GIOLLITO Pierre, Histoire de l’enseignement primaire au XIX siècle, Ed. Fernand Nathan, 1984.
Ministère de l’Education nationale, -Document d’accompagnement du programme de français de
la 2ème année primaire 2003.
Ministère de l’Education nationale, -Document d’accompagnement du programme de français
cycle primaire2016
MUCKENSTURM Pierre, Il faut apprendre à lire comment ? Pourquoi ? Ed. paradigme, Orléans,
2012.
Articles en ligne
BOCKSTAEL Anne, « Qu’est-ce que lire ? Les pistes théoriques », Revue la filoche [on line], mai,
juin, juillet 2007pp 123-132. URL :www.ffedd.be/Cms_files/ffedd/files/filoche/2007_318-13.pdf
CHARMEUX Evelyne, « Mais enfin pourquoi revenir sur l’apprentissage de la
lecture ? »,Education, Ecole et Pédagogie[On line],septembre 2016 connection on
27/01/2020URL :charmeux.fr/blog/ index. Php ?2016/09/11/302-mais-enfin-pourquoi- revenir-
toujours-sur-l-apprentissage-de-la-lecture
CHAUVEAU Gérard, « Apprendre à lire ou apprendre l’écrit », Revue les cahiers pédagogiques [On
line],n° 479 connection on 07mars 2020
URL :https://www.cahiers-pedagogiques.com/Apprendre-a-lire-ou-apprendre-l-ecrit
CHAUVEAU Gérard, Eliane Rogovas Chauveau 1990, « Les processus interactifs dans le savoir lire
de base »,Revue française de la pédagogie [On line], 1990 pp 23-30,connection on 23 décembre
2019
URL :ife.ens-lyon.fr › revue-francaise-de-pedagogie › INRP_RF090_3
CUCH Thérèse, Sommer Michelle, « Halte au départ global », collection Léo et Léa [On line], 2016,
connection on 28 décembre 2020
URL :www.leolea.org/halte-au-depart-global.par.therese-cuche-et-michell sommer.html
DEHAEN Stanislas, « Les mécanismes cérébraux de la lecture », enregistrement de cours au
collège de Franceet au collège de Belgique [On line], 2007, 2011
Multilinguales, 15 | 2021
105
URL :https://www.collge-france-.fr/site/stanislas-dehaen/course.2006-2007.htm
GAONAC’H Daniel, « La lecture en langue étrangère : un tour d’horizon d’une problématique de
psychologie cognitive » aile revue [online],13ǀ2000, n° 13,pp 5-14
URL :aile.revues.org>Numeros>13
GIASSON Jocelyne, « La lecture : apprentissage et difficultés » adapté par G. Vandercasteel »,
graine de lire[Online], novembre2014,connection on 15 décembre 2019
URL :www.grainedelire.fr9wp-content›uploads›sites›2014/11›la lecture.
GOMBERT Jean Emile, « Compétences et processus mobilisés par l’apprentissage de la lecture »,
Document envoyé au PIREF en vue de la conférence de consensus sur l’enseignement de la lecture
à l’école primaire [Online],4-5 décembre 2003 connection on 11 décembre 2019.
URL :http://www.bienlire.education.fr> 2003
PEEREMAN, R., SPRENGER-CHAROLLES, L. & MESSAOUD-GALUSI, S, « l’apport de la morphologie à la
cohérence des relations orthographe-son :uneanalyse quantitative baséesur les lecteurs du
primairefrançais ».L’Annéepsychologique[Online]2013113(1),p.3-33.
DOI : 10.4074/S0003503313001012
URL : https://www.cairn.info/revue-l-annee-psychologique1-2013-1-page-3.htm ?
contenu =resume
PEIRON Denis, « Apprentissage de la lecture : les méthodes qui marchent »la croix actualité
[Online], septembre 2015
URL :www. La-croix.com>actualite>France
RAFONI Jean-Charles, « Apprentissage de la lecture en français langue seconde », organisation
des CASNAV[Online], mars 2014
URL :acgrenoble.fr/casnavac/accueil/jcRafoni2014/index.php ?post/2014/06
RIQUOIS Estelle, « Acquérir une compétence lectoriale en français langue étrangère », collection
des congrès mondiaux [Online] ,2010,since 12 juillet 2010,connection on 15 février 2020
URL :https://www.linguistiquefrancaise.org/articles/cmlf/abs/2010/01/cmlf2010_000236/
cmlf2010_000236.html
SprengercharollesLilliane, « L’apprentissage de la lecture (du comportement aux corrélats
neuronaux), Revuepratiques : linguistique, littérature, didactique [Online],169ǀ170 2016,
connection on 01 janvier 2020
URL : https://journals.openedition.org/pratiques/2969
NOTES
1. 1 Un son constitué de deux lettres comme au- ei…
2. 2 Un son constitué de trois lettres comme eau- œu…
Multilinguales, 15 | 2021
106
RÉSUMÉS
A travers cette étude, nous soulevons la problématique de la répercussion de l’application de la
méthode syllabique sur le rendement des apprenants algériens de troisième année primaire
quant à l’appropriation de l’habileté de la lecture/déchiffrement. A travers une progression de
notre conception, nous menons une expérimentation dans quinze classes de troisième année
primaire appartenant à neuf écoles de la circonscription f2 de la wilaya de Constantine. Les
résultats nous indiqueront à quel point l’apport de l’application d’une telle démarche serait en
faveur d’une bonne maitrise de cette activité. Le questionnaire destiné aux enseignants,
permettra d’apprécier l’adéquation des principes méthodologiques de cette méthode avec
différentes conditions de travail.
Through this study, we raise the problem of the impact of the syllabic method on the
performance of Algerian third-year primary-school learners in terms of reading/deciphering
skills. Our research design is based on an experiment conducted with fifteen third-year classes in
nine primary schools situated in the f2 district of the wilaya of Constantine. The results will
indicate to what extent the contribution of the application of such an approach would be in favor
of a good mastery of the reading activity. A questionnaire intended for teachers would allow us
to evaluate the adequacy of the methodological principles of this method with in different
working conditions.
INDEX
Mots-clés : Méthode syllabique, enseignement/apprentissage, lecture/déchiffrement, troisième
année primaire, français langue étrangère
Keywords : syllabic method, teaching/learning, reading/deciphering, third year of primary
school, French as a foreign language
AUTEURS
AFAF SALHI
Laboratoire LESMS, faculté des lettres et langues, université de Bejaia
MOURAD BEKTACHE
Laboratoire LESMS, faculté des lettres et langues, université de Bejaia
Multilinguales, 15 | 2021
107
Les insultes « mots-doux » dans leséchanges conversationnels dansl’espace public en Côte d’Ivoire"Gentle- words" insults in Ivorian public conversation talk
Kouakou Kouman Fodjo
1 L’appellation « violence verbale » fédère un ensemble de termes qui se rapportent à la
violence exprimée par des mots, des expressions des cris acrimonieux, irrévérencieux
et « infériorisants » à travers divers faits et actes de langage. Ainsi, non seulement ces
faits et actes affectent la personne ou les groupes qui les subissent mais ils peuvent
porter atteinte à leur intégrité psychologique. Au nombre de ces termes figure
l’ « insulte » qui est inhérente à nos pratiques sociales ainsi qu’à nos rituels
conversationnels ou communicationnels. Pour cela même, l’insulte englobe divers faits
et actes vu qu’elle porte sur « toute parole, toute attitude ou allusion à contenu
symbolique » (J. Dubois et al., 2012 : 250) perçues comme dévalorisantes et blessantes.
2 Toutefois, loin d’être placée au cœur des « conflits » langagiers et donc d’être toujours
envisagée dans sa dimension vexatoire, l’insulte, du fait de son importance dans la
dynamique sociale des échanges conversationnels, peut s’entrevoir sous les angles de
concorde et d’harmonie. Suivant ce qui précède, l’on se demande comment des mots
et / ou expressions, reconnus comme « insultes » à bien des égards et qui, dans bien de
circonstances, ont donné leur preuve de charge vexatoire, ne déclenchent pas
systématiquement le processus d’humiliation ou de réclusion dans une posture peu
gratifiante. Mieux, pourquoi le résultat débouche sur le contraire, avec des insultes qui
se font « mots-doux » ? Nous nous proposons d’étudier cet état de fait suivant la
méthode d’analyse du discours, notamment la praxématique qui est centrée sur
l’analyse de la production du sens en langage.
3 Nous nous appuyons sur un corpus composite constitué de conversations, promouvant
des insultes qui fonctionnent comme des « mots-doux », entre deux catégories de
personnes. La première catégorie concerne des personnes qu’unissent globalement
quelque lien d’amitié, de camaraderie ou de proximité du fait de la communauté
Multilinguales, 15 | 2021
108
professionnelle ou de lieu de travail. Dans cette catégorie, l’on relève majoritairement
des jeunes, conducteurs et apprentis de véhicules de transport en commun, élèves du
secondaire et étudiants. L’on y note également, mais très rarement, des personnes
âgées ou très âgées, peut-être par exigence sociale. En effet, fors les cas de pacte
d’autorisation « d’insultes non épigrammatiques » dans le cadre des alliances
interethniques, il est rare que des personnes adultes se distribuent des
insultes « affectives » publiquement. Le respect et la courtoisie régulent les rapports
publics entre eux et avec les autres. La seconde catégorie ressortit naturellement à des
alliés1 interethniques sans distinction d’âge.
4 En termes de subdivision, notre analyse comporte trois parties. La première, « de
l’insulte à l’insulte "mot-doux" », évacue les questions théoriques en présentant les
concepts d’ « insulte » et d’ « insulte mot-doux ». La seconde partie, « catégorisation
des insultes-mots doux », relève les différentes propriétés des « insultes mots-doux ».
La dernière partie, « valeurs des insultes mots-doux » aborde la question de la portée
des « fausses insultes ».
1. De l’insulte à l’insulte « mot-doux »
5 Il s’agira ici de présenter au moins succinctement les notions de « insulte » et de
« insulte mot-doux » en les définissant brièvement. Par ailleurs, nous relèverons
comment et à quel moment l’« insulte » devient « insulte mot-doux ».
1.1. De l’insulte
6 L’ « insulte » désigne l’action d’offenser, de blesser, à l’oral et de manière accidentelle
ou intentionnelle. Elle garde son sens primitif d’« attaque », puisqu’elle est « une
attaque verbale ». Elle s’applique aussi bien à toute parole qu’à tout acte qui sont des
outrages ou dont le but poursuivi est d’outrager, de blesser la dignité ou l’honneur de
leur destinataire. Reposant sur l’interaction verbale, son domaine d’application est
vaste. S’il fallait en administrer la preuve, la prodigalité des termes et expressions qui
la désignent et /ou avec lesquels ce mot entretient quelque relation de synonymie y
suffirait assurément. En effet, l’insulte est connexe à des notions qui désignent aussi
bien des actes que des comportements verbaux usuellement distincts. Ces notions sont
l’ « injure », l’ « offense », le « blasphème », le « sacrilège », l’ « invective » auxquelles
on peut ajouter les « sacres » du québécois parlé ainsi que la « joute lexicale »,
l’ « imprécation », la « mise en boite ». Il existe bien entendu une distinction d’intensité
entre l’insulte et certaines de ces notions. Par ailleurs, les valeurs en contexte des unes
et des autres ainsi que leurs caractéristiques pragmatiques ne sont pas à dépriser.
7 L’insulte relève par conséquent et avant tout de la violence verbale, étant elle-même
une de ses multiples formes. Elle est un acte menaçant pour la face de celui qui la subit
puisqu’elle induit un jugement de valeur dépréciatif. Autrement dit, l’insulte laisse des
traces « psychologiques » souvent profondes et indélébiles. Elle fait intervenir a
minima un objet et deux acteurs ou groupes d’acteurs. L’objet représente le terme dont
fait usage l’être qui insulte. Ce terme, selon Laforest et Vincent, associe souvent
« la personne visée à des animaux connotés négativement ou à des objets ou substancesperçus comme dégoûtants » (Laforest et Vincent, 2004 : 60),
à travers une comparaison, une métaphore, une métonymie ou bien une hyperbole.
Multilinguales, 15 | 2021
109
8 Les acteurs, nous le désignons par « insulteur », « insultaire » et « insulté », tel que
proposé par Lezou (Lezou, 2012) et suivant le modèle de Larguèche à propos de
l’« injure » (Larguèche, 1983 : 1). Sur cette base, l’insulteur est celui qui insulte ;
l’insultaire celui qui subit l’insulte « interpellative », notamment dans les interactions ;
l’insulté désigne l’être à qui s’adresse l’insulte mais dans une relation triangulaire.
Somme toute, l’insulte est un phénomène social, acte ou parole par lesquels un
insulteur adjuge au(x) récipiendaire(s) des propriétés nouvelles mais négatives et
dévalorisantes. Elle intervient dans un contexte de conflit, de frustration, de
mécontentement. L’insulteur y a recours pour non seulement manifester son état
psychologique rembruni, mais aussi et surtout pour abâtardir l’insultaire ou l’insulté.
De ce point de vue, l’insulte fonctionne comme un instrument de brimade et de torture
attentatoire à la dignité et au moral de l’insultaire ou de l’insulté. Le but ultime d’un tel
acte réside dans la volonté de l’insulteur de les rabaisser ou de les blesser. L’insulte,
telle que présentée jusqu’ici, a besoin de la validation de l’insulté ou de l’insultaire qui
l’acceptent et encaissent le coup qu’elle porte. Si ces derniers ne la valident pas,
l’insulte devient vaine, stérile puisqu’elle n’aura pas atteint son but. De là l’importance
du concept « insulte mot-doux ».
1.2. De l’insulte « mot-doux »
9 Le groupe nominal écrit en deux mots « mot » et « doux » sans le trait d’union,
permettra de spécifier ce que l’on devra entendre par « mot » et « doux » dans un
premier temps avant de l’entrevoir comme concept. En effet, après avoir défini et
présenté l’insulte, il parait évident de dire un mot sur la seconde composante du
groupe « insulte mot-doux » pour faire ressortir l’opposition qui les caractérise et qui,
en même temps, donne toute son importance et son originalité à notre étude. Suivant
cela, le lexème mot est à considérer ici aux divers sens de « unité lexicale ou vocable »
ou comme une litote signifiant « petit nombre de paroles, de phrases ou propos ».
Quant à l’adjectif « doux », il signifie selon le contexte, « affectueux, non violent ».
Ainsi, par le groupe nominal « mot doux », il faut entendre, « parole ou propos non
violents, non agressifs » ou « parole, propos affectueux ».
10 Le mot composé, « mot-doux », permet de marquer qu’il existe un lien lexical étroit
entre ces deux termes et en fait un concept. Ainsi, le désormais concept « mot-doux » a
un sens spécifique certes, mais dont le rapport avec les sens individuels de chaque mot
qui le compose reste alambiqué. Ce sens « spécial » est « affectueux, factice » et leurs
synonymes respectifs en contexte. La définition même de « mot-doux » ne s’affranchit
pas de la définition de l’ « insulte » qu’il faut prendre à rebours. Avec cette
orthographe, les groupes nominaux « insulte » et « mot-doux » forment un oxymore
car leur rapprochement crée un contraste. L’« insulte mot-doux » signifie « une insulte,
et donc en réalité attentatoire à la dignité et reconnue comme vexatoire mais, qui,
paradoxalement, produit l’effet inverse ». Tout bien considéré, l’ « insulte mot-doux »
est une « fausse insulte », « un simulacre d’insulte » ou mieux une « moquerie
aimante ».
11 Dans sa forme, elle ne diffère pas de l’insulte de manière générale, mais dans son
fonctionnement, en contexte, elle s’oppose radicalement à celui de l’insulte. L’insulte
mot-doux est une insulte détournée en une adresse affectueuse aux frontières
nébuleuses avec l’insulte. La tension entre la signification ratifiée en langue, et qui est
Multilinguales, 15 | 2021
110
bien évidemment dépréciative, de l’insulte et celle actualisée et « valorisante » du mot
doux reste latente. Par voie de conséquence, la menace de basculer de l’insulte mot-
doux à l’insulte est réelle. Tout est lié à l’état d’esprit ou à la prédisposition des acteurs
de la conversation et surtout au contexte dans sa diversité (le cotexte, situation
d’énonciation et les participants à la conversation) qui compte énormément dans le
calcul sémantique de l’insulte mot-doux. L’insulte mot-doux, quoique mot ou
expression infériorisants et turpides, procède d’une resémantisation à polarité positive
et, contrairement à l’insulte, n’outrage pas, dans le contexte où elle s’utilise. C’est dire
que hors de ce contexte, singulièrement dans un environnement propice à l’insulte,
l’insulte mot-doux redevient outrageante et donc explicitement une insulte.
2. Catégorisation des insultes « mots- doux »
12 Par catégorisation des insultes « mots doux », il sera question de relever les
constituants insultes mots-doux, d’analyser leurs propriétés linguistiques mais aussi
discursives. Le corpus recueilli auprès du public provient de conversations. Les énoncés
sont par conséquent oraux à l’origine. Nous les avons donc transcrits pour les besoins
de l’analyse.
2.1. Description grammaticale et énonciative des constituants
« insultes mots-doux »
13 Cette description porte sur les unités lexicales les plus utilisées pour adresser des
insultes. Ce sont l’adjectif qualificatif, le nom et le groupe nominal. Les adjectifs
qualificatifs constituent l’une des unités lexicales les plus sollicitées comme insultes
mots-doux. Ce sont en général des adjectifs descriptifs à polarité négative ou péjorative
ou dont le sens est dévalorisant, dépréciatif. Ils qualifient un nom ou un groupe
nominal qui désignent une partie ou un aspect du corps humain. Les énoncés suivants
l’illustrent.
Tes fesses dures avec ton petit nez et ton vilain visage.
C’est cela que mon mari aime. Toi, regarde ta vilaine barbe !
Tu es un faux type, un vrai faux type !
14 Les adjectifs « vilain » ainsi que sa forme féminine « vilaine » et « faux » employés en (1,
2 et 3) appartiennent au vocabulaire dépréciatif. Quant à « dures » et « petit » en (1a),
ils ne sont en réalité pas nécessairement négatifs ou dévalorisants, mais leur emploi en
contexte leur confère ces valeurs. Syntaxiquement, ils sont antéposés ou postposés aux
noms qu’ils qualifient et sont alors épithètes :
nom + adjectif (fesses dures en (1)) ;
adjectif + Nom (petit nez, vilain visage, vilain visage, faux type en (1, 2 et 3)).
15 Ces adjectifs donnent une image « négative » et subjective des portraits physiques ainsi
faits, a priori. Toutefois, ils n’outragent effectivement pas leurs destinataires. Ici, même
si la qualification avilissante, bien que subjective, est avérée, elle reste inoffensive, non
méchante. Elle s’accepte comme telle. Celui / celle qui la profère n’y a pas mis une
méchante intention, celle de blesser ou de choquer par exemple. De cette manière celui
/ celle à qui elle s’adresse ne se sent nullement insulté, rabaissé. A contrario, il /elle
plaisante même avec ce qui est supposé offensant, infamant. L’ambiance et le contexte
•
•
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
111
conviviaux d’une gare de transport en commun ou d’un environnement professionnel
ou d’un lieu de conversation entre jeunes apprentis ou étudiants y conduisent.
L’on rencontre également des adjectifs insultes mots-doux adressées ou auto-
adressées :
4. Il / elle ne sait pas que tu es bête ! Montre lui que tu es bête !
5. Laisse-la, je vais lui montrer que je suis très bête, très sauvage !
6. Les autorités savent que nous sommes bêtes…
7. Vous êtes sauvages, vous-là.
8. Tu es trop fou, tu es bête hein !
16 Sans aucun doute, les adjectifs « bête(s) », « sauvage(s) » « fou » ont généralement un
sens avilissant. Cependant, l’avilissement est désactivé ici au profit d’une
resémantisation, d’une « recharge » positive et affectueuse de ces adjectifs. Il n’est
nullement question du sens dénoté des adjectifs « bête(s) », « sauvage(s) » ou « fou »,
affublés ou non d’adverbes d’intensité « très » ou « trop », dans ces conversations entre
étudiants. Ces mêmes adjectifs se rencontrent dans des conversations entre les autres
catégories sociales ou professionnelles ciblées par notre étude. Ils qualifient le moral, le
comportement, l’état ou l’être. Selon le contexte, ils signifient « pouvoir faire mieux
ou pire… » (4, 5, 6 et 7) et « être drôle » (8).
17 Du point de vue syntaxique, ils apparaissent dans des constructions où ils sont attributs
du sujet. Le sujet est généralement un pronom de la première et/ou de la deuxième
personne, puisque nous avons des énoncés conversationnels, le dialogue est toujours
latent. L’usage de la première personne, « je » (5) et « nous » (6), prévaut justement
lorsque le locuteur semble se « flageller ». Quant à la deuxième personne, elle s’utilise
pour les insultes mots-doux directement adressées à un allocutaire apostrophé ou
représenté (4 et 7). Ils s’accompagnent souvent d’adverbes d’intensité. L’auxiliaire
« être » utilisé de manière presqu’exclusive est au présent simple de l’indicatif, suivant
la syntaxe :
Je / nous + être (présent de l’indicatif) + adjectif ;
Tu / vous + être (présent de l’indicatif) + adjectif.
Cette structure est modifiée par l’adverbe d’intensité qui se place après « être ».
18 Il arrive que lors de la conversation, l’allocutaire, quoique présent est désigné par la
troisième personne. Le pronom personnel est ainsi décalé ou substitué.
9. Ces mecs, ils sont malades hein !
10. Lui, il n’est vraiment pas normal !
11. Les Guérés (Gouros) sont sauvages ou les Yacouba (Sénoufo) sont bêtes…
19 Ainsi, le groupe nominal « ces mecs » désigne en réalité « vous » (9) alors que « il »
renvoie à « tu ». Sans le changement du pronom, on aurait « vous êtes malades hein ! »
ou « tu n’es pas normal ». Les énoncés (9, 10 et 11) ainsi que leurs formes en structure
profonde sont des insultes mots-doux. Deux d’entre eux ont le sens de « Ces mecs, ils sont
(très) intelligents, habiles ! » pour en vérité dire « Vous êtes très intelligents, habiles ! » (9),
« Lui, il est (très) intelligent, habile ! » pour dire « Tu es (très) intelligent, habile ! » (10).
Quant à (11), il est le prototype même de l’insulte mot-doux entre alliés interethniques.
« Guéré » et « Gouro », « Yacouba » et « Sénoufo » sont des groupes ethniques ivoiriens
alliés. Il n’y a rien de méchant ou de frustrant dans les adjectifs utilisés. C’est juste une
manière de plaisanter, pour montrer la solidité de l’alliance, l’impossibilité de violence,
quelle qu’elle soit, entre les individus appartenant à ces groupes.
•
•
•
•
•
• ◦
◦
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
112
20 Lorsque l’adjectif qualificatif utilisé a un sens valorisant ou « positif », il est affecté d’un
adverbe de négation pour lui conférer un sens dépréciatif, disqualificatif. La structure
syntaxique s’adapte avec l’inclusion des nouveaux constituants et l’exclusion de ceux
qui n’y figurent plus :
GN / ils / il + être (présent de l’indicatif) + adjectif ;
GN / ils / il + adverbe de négation+ être (présent de l’indicatif) + adjectif (valorisant).
Enfin, l’adjectif peut être employé seul dans des énoncés du genre : « Sauvage !
Bête !… ».
21 Hormis l’adjectif, le nom, déterminé ou non, motivé ou non, est également utilisé
comme insulte mot-doux. Il désigne une condition de vie ou un lien (esclave, sujet), des
animaux (chien, cochon, cafard…), un état (sauvage, bête), des êtres humains (père, mère,
pygmée…), des personnages (Kirikou), et la liste ne semble pas close. Les noms
négativement connotés s’accompagnent de déterminants possessifs, définis ou indéfinis
suivant diverses structures syntaxiques :
adj. possessif (ou article défini, indéfini) + nom (péjoratif ou dépréciatif) (12, 13) ;
GN + être (présent de l’indicatif) + adj. possessif (ou article défini, indéfini) + nom
(péjoratif ou dépréciatif).
12. Mon esclave adoré ! Mon esclave !
13. L’esclave, que fais-tu ici ? Un esclave, tu as fini ton boulot ?
14. Les baoulés (Agni, Abron) sont (des, mes, nos) esclaves, sujets.
15. Les Guérés (Gouro) sont des sauvages.
16. Yacouba ce n’est pas l’homme, ce sont des animaux.
22 Nous avons ici des exemples d’insultes mots-doux entre alliés interethniques. Ils ne se
disent qu’en présence de celui à qui l’insulte mot-doux s’adresse ou d’un
« représentant » du groupe auquel il appartient. Les noms, bien que « agressifs » se
déchargent de leur « agressivité » et se perçoivent comme mots non violents. Il y a ici
une déconsidération de la charge dévalorisante qui se transforme en un lien d’union
sacrée qui transcende n’importe quelle violence. Généralement, le destinataire en rit et
y répond avec les mêmes insultes mots-doux, puis l’échange se poursuit dans une
bonne ambiance. La liste n’est pas exhaustive et l’on rencontre également des noms à
valeur toujours rabaissante désignant des parties d’animaux (gueule, pattes…) ou des
noms d’animaux comme en (17 et 18), avec le même fonctionnement.
17. Chien ! Cafard ! Cochon !...
18. Quand je vois la gueule de mon voisin... ta gueule là je sais que tu vas manger poulet.
23 Dans cette catégorie d’insultes mots-doux, on observe le déterminant zéro pour les
noms d’animaux (17). De plus, l’insulte mot-doux peut être constituée d’un seul nom
d’animal ou d’une succession souvent rapide de noms d’animaux. La structure de (17)
n’est pas pour autant figée car ces noms se rencontrent dans des structures du genre
« Tu es un chien, un cafard, un cochon ! ». L’article défini ou l’adjectif possessif de la
deuxième personne s’emploient pour « gueule » et par ricochet les insultes mots-doux
similaires. (18) contient une métaphore avilissante certes, mais elle n’est pas méchante
encore moins motivée, qui renvoie à la « bouche ».
24 Les noms se rapportant aux parents ne sont pas en marge des insultes mots-doux. L’on
rencontre des énoncés du genre « Ta mère, ton père, ta grand-mère, ton grand-
père » (19), qui visitent toute la généalogie, ou presque, avec un accent sur les grands-
parents. L’intonation reste essentielle car le destinateur insiste sur les voyelles
• ◦
◦
• ◦
◦
•
•
•
•
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
113
accentuées finales en tirant également sur le « r ». Sur cette même base, les parties du
corps humain ne sont pas oubliées. Elles s’utilisent également comme insultes mots-
doux. Cela donne « Ta tête, ton ventre, tes fesses… » (20). Parfois, elles visitent même les
parties intimes pour donner des insultes mots-doux grossières comme « Ta pine, ton
con, mon con » (21) à la fois gênantes et choquantes pour les non habitués. Des sous-
entendus se rattachent à ces désignations vulgaires des sexes masculin et féminin qui
s’adressent indistinctement, dans de nombreux cas, aux hommes comme aux dames.
Dans de tels usages, elles fonctionnent comme des mots vides, de simples plaisanteries.
La structure se présente comme suit :
Déterminant possessif (2è personne) + nom (de généalogie ou partie du corps humain).
25 Comme on peut le constater, contrairement à bien d’insultes mots-doux rencontrées
jusqu’ici, qui sont en réalité de vraies insultes du fait de leur sens péjoratif, infamant,
vexatoire, celles qui précèdent n’ont de coloration « méprisante » que dans la prosodie
et dans le processus d’énonciation. Mais le principe étant le même, elles demeurent
« inoffensives ». Bien des insultes mots-doux se forment par usage concomitant du
nom, de l’adjectif dans un mélange dont le modèle est « Toi-même imbécile, vaurien,
enfoiré, bête, cornard … ! » (22).
2.2. Registre de langue des insultes mots-doux
26 Le type de corpus choisi, c’est-à-dire la conversation entre catégories sociales ou
professionnelles, même s’il n’exclut pas les registres soutenu ou courant, il impose déjà
tacitement un registre de langue, celui de la conversation. En effet, la conversation
impose moins de contraintes aussi bien lexicales que grammaticales. Par ailleurs,
certains des auteurs des énoncés du corpus sont peu ou pas lettrés. Sur cette base, on
ne s’étonne pas que la grande majorité des insultes mots-doux empruntent un style oral
qui promeut les niveaux de langue courant et, à un degré moindre, familier, voire
relâché. L’adverbe « là », dans « Maudit-la ! Salaud-là ! » (23), ainsi que dans certains
énoncés du corpus, termine certaines insultes mots-doux. Au demeurant, le vocabulaire
reste essentiellement familier, souvent vulgaire. Ainsi, les adjectifs, les noms ou
groupes nominaux n’appartiennent pas au vocabulaire châtié. Le nouchi achève de
convaincre du registre relâché. De nombreuses insultes mots-doux foisonnent en
nouchi, sorte d’argot crypté ivoirien qui est un mélange de français et de plusieurs
langues du pays. La structure syntaxique ainsi que le fonctionnement énonciatif
respectant ce qui est décrit jusqu’ici, nous nous contenterons de donner le sens de
l’expression nouchi entre parenthèses.
24. Malo-là ! (Malhonnête).
25. Djandjou-là tu fais quoi ici ? (Coureur de jupons, prostitué(e)).
26. Espèce de djaouli ! kpakpato ! (badaud, indiscret, importun).
27. Apprenti vogo-là ! (vagabond).
28. Blakoro-là ! (très bizarre).
29. Espèce de côcô ! (tapeur, parasite).
30. Imbécile, "ibièkissè"2, idjou ! (injure grossière qui désigne le sexe de la femme).
Le registre familier, voire relâché utilisé dans les insultes mots-doux fait perdre la
virulence et la rigidité des propos. Ainsi, il participe du « désarmement » des
constituants naturellement ou contextuellement violents.
• ◦
•
•
•
•
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
114
2.3. Quelques procédés stylistiques des insultes mots-doux
27 L’insulte mot-doux innove dans le processus de sa mise en œuvre. Elle exploite des
procédés tels la comparaison, la métaphore, à l’instar de l’insulte. Elle joue également
sur les sonorités. La comparaison consiste à rapprocher un terme ou un ensemble de
termes, d’un terme ou d’un ensemble de termes. Dans les insultes mots-doux, elle
procède du rapprochement de deux objets ou réalités antagonistes. Ce rapprochement
crée une sorte de hiatus. La comparaison débouche sur quelque chose d’abject,
d’inconcevable ou d’inacceptable. L’énoncé « Regardez-le on dirait "la" » (31) est une
comparaison ignominieuse. Ici, entendons qu’un être de sexe masculin, représenté ici
par « le », se comporte comme une femme, représentée par « la ». Ainsi, elle fonctionne
comme une insulte et, prise à rebours, elle est insulte mot-doux. Sur ce modèle, on peut
avoir plusieurs insultes mots-doux qui procèdent de la comparaison des parties ou
aspects du corps humain, du comportement…, qui procèdent à des comparants de sorte
que le résultat soit avilissant.
28 De même, la métaphore, avec laquelle elle partage certains traits de fonctionnement,
assimile un comparé à un comparant. Les insultes mots-doux résultent également de
cette figure d’analogie. La métaphore est la figure essentielle des insultes mots-doux.
Elle est in praesentia dans les énoncés (4 à 8, 11,12, 14 à 16) où elle assimile des êtres
humains à des « sauvages » et in absentia dans (17 et 18) où les humains sont désignés
du nom d’animaux. On assiste à une « dépersonnification » de la personne. Quelle
qu’elle soit la métaphore est dégradante. Enfin, les insultes mots-doux exploitent des
procédés novateurs. L’on exploite la proximité des sonorités pour créer quelque chose
de « négatif ou dégradant ». En voici quelques exemples.
32. Le faux djo ou le faux des djos.
33. Arbron (petit arbre).
34. C’est nous les faux.
29 Il s’agit en réalité dans ces énoncés de noms de personnes et de groupes ethniques. Les
noms sont « Fodjo » (32) et « Abron » (33), « Sénoufo » (34). « Fodjo » est un nom de
l’ethnie « Abron ou Brong ou Bron », peuple du nord-est de la Côte d’Ivoire allié du
peuple « Sénoufo » du nord. Dans les insultes mots-doux qu’ils se distribuent du fait de
leur alliance, certains en arrivent à exploiter les sons des noms pour donner (32, 33 et
34). Il faut plutôt entendre « Fodjo », en (32) ; « Abron », en (« 33) ; « Sénoufo » en (34).
Le résultat fait donc de « Fodjo » le faux (fo-) des « djo » ou le faux (fo-) « djo », de
« Abron » arbron, entendu « arbuste » et sur le modèle de « Fodjo » on aura c’est (sé-)
nous (nou-) les faux (fo). L’objectif de « rabaisser » amicalement l’allié est atteint dans
tous les cas et l’on savoure ces insultes mots-doux.
2.4. Typologies des insultes mots-doux
30 Telles qu’elles définies, et suivant la typologie des insultes, les insultes mots doux se
classent en ethnotype ou tribale, en personnelle et en sexotype. L’ethnotype ou encore
tribale tient à ce que l’insulte mot-doux porte sur l’origine de provenance de la
personne à qui elle s’adresse. C’est le cas dans (11, 14 à 16). Ici, la dimension de
l’appartenance géographique ou de la race n’apparait pas. Tout se passe entre groupes
ethniques alliés, chaque groupe se « croyant » supérieur à l’autre. Dans les exemples
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
115
supra, le destinateur de l’insulte mot-doux confirme son appartenance au « bon »
groupe en mettant à distance le groupe de l’autre, perçu comme « sauvage, inférieur ».
31 Personnelle, l’insulte mot-doux porte sur l’identité du destinataire, son estime de soi
ainsi que son physique. Les énoncés 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29 en sont des illustrations.
L’insulte mot-doux porte sur les traits physiques ou des traits de comportement ainsi
que sa fierté, sa dignité. Le sexotype est le type d’insulte mot-doux qui visite les parties
intimes et porte sur l’orientation sexuelle du destinataire. Les exemples foisonnent
avec des désignations ubuesques aussi bien en français que dans des langues
ivoiriennes. On peut relever (21 et 30).
32 En définitive, avec les insultes mots-doux, les constituants, le registre ainsi que les
procédés stylistiques utilisés visent à créer quelque chose de dévalorisant pour le
destinataire de l’insulte mot-doux que ce dernier devra en retour recevoir en inversant
le sens ou en le valorisant. Face à ce qu’on pourrait appeler « escalade de la violence »
qui, en réalité, n’en est pas une, le spectateur non averti des réalités ivoiriennes et
notamment des affinités entre les destinateurs et les destinataires des insultes mots-
doux, adopte une posture de surprise.
3. Valeur des insultes « mots doux »
33 Par valeur, il faut entendre le sens ou la signification profonde, la portée des insultes
mot-doux dans les milieux cibles et par ricochet dans la société de manière générale.
L’existence même d’un phénomène aussi abstrus et alambiqué que l’insulte mot-doux
suffit pour ne pas dépriser ses valeurs qui sont culturelle, sociale et à la fois ludique et
affective.
3.1. Valeur culturelle
34 Le culturel est en rapport avec la culture et s’oppose au « naturel ». Ainsi, les insultes
mots-doux fonctionnent comme des acquis culturels hérités de nos ancêtres, et que
nous devons préserver. Elles constituent une des meilleures manifestations des
alliances et pactes multiséculaires tissés par nos aïeuls entre différents groupes
ethniques. Ces pactes, dits de « non-agression », autorisent les groupes ethniques alliés,
notamment leurs membres, à plaisanter entre eux. Cette plaisanterie outrepasse les
limites de la plaisanterie ordinaire. Elle va au-delà, jusqu’à l’offense. Mais, l’offense
résultant d’une telle plaisanterie ne devrait pas être prise comme un outrage. C’est
justement ce qu’exploitent des insultes mots-doux, comme nous avons pu le montrer
dans l’analyse dans (12 à 16) et (32 à 34).
35 Considérer l’offense faite dans le cadre de la plaisanterie de ce type est jugé
attentatoire au pacte et doit être en principe sanctionné. Le caractère sacro-saint de ces
pactes permet de consolider l’amour, la tolérance, la fraternité entre les groupes. Ces
pactes constituent aussi un facteur de cohésion et de prévention de conflits. La preuve
est donnée par l’exemple des insultes mots-doux qui, plutôt que de susciter la colère, le
hérissement de leurs destinataires, au contraire les font sourire, parfois même au
détriment de leur mauvaise humeur de l’instant. C’est pourquoi face aux insultes mots-
doux, la réaction est plutôt calme, emprunte de convivialité.
Multilinguales, 15 | 2021
116
3.2. Valeur ludique
36 Les insultes mots-doux s’insèrent dans la lignée des insultes ludiques à l’instar du
« gâtte-gâtte » dont elles s’inspirent du modèle de fonctionnement. Le « gâtte-gâtte » se
présente comme un rituel de propos dévalorisants que des jeunes, organisés en deux
équipes, échangent entre eux sous forme de joutes ludiques. Il fonctionne sur la base
des règles à l’instar de tout jeu. La règle première consiste à proférer des insultes
arbitraires qui n’ont aucun lien avec un quelconque « défaut » physique du
destinataire. Ce qui importe dans ce jeu c’est l’escalade verbale.
37 Cependant, contrairement au jeu, les insultes mots-doux ne cherchent pas un
vainqueur et un vaincu. Elles sont souvent motivées mais s’inscrivent dans une
approche à la fois ludique et affective, généralement amusante, récréative, attachante
ou divertissante. Elles s’échangent entre les jeunes, élèves, étudiants, apprentis, mais
de manière générale entre jeunes ou promotionnaires d’âges. Le caractère ludique des
insultes mots-doux réside dans le fait qu’elles n’agressent pas en réalité.
3.3. Valeur sociale
38 L’homme est naturellement un être social. Cette nature intrinsèque se ressent dans
nombre de ses faits et gestes. L’insulte mot-doux en est une manifestation. En dépit des
nombreux drames issus de la cohabitation malheureuse entre les hommes, l’humain
recherche sempiternellement la compagnie de ses semblables, avec qui mieux vivre. Or
mieux vivre ne se limite pas uniquement à l’acquisition de biens, il suppose aussi
partager, échanger, rire, s’épanouir… L’homme est fait pour vivre en communauté et en
interaction avec ses semblables. Par ailleurs avec le développement de la société, la
nécessité de vie en société s’accentue. Or justement cela n’est pas sans conséquences,
du fait des antagonismes toujours latents. Les insultes mots-doux se présentent comme
une solution pour prévenir la survenue d’antagonismes. Elles permettent de briser les
barrières et de créer une ambiance emprunte de convivialité entre les hommes. Ce type
de plaisanterie fonctionne comme un antidote du stress. Les insultes mots-doux en
brisant les barrières, favorisent le rapprochement d’individus d’horizons divers non
unis par quelque lien.
39 Au total, cette étude sur les « insultes mots-doux » a permis de montrer la connexité
entre « insulte » et « insulte mot-doux » à travers une approche définitionnelle de
chaque notion. Il s’agit de deux phénomènes qui sont très étroitement liés par nombre
de leurs mécanismes de mise en œuvre. Toutefois, le fonctionnement de l’insulte qui
consiste à vexer s’oppose à celui de l’insulte mot-doux qui produit l’effet inverse. Ainsi,
des mots et expressions, généralement des adjectifs qualificatifs et des noms ou
groupes nominaux, naturellement ou contextuellement violents, sont les constituants
de l’insulte mot-doux avec une réception positive. Au demeurant le registre
préférentiel de l’insulte mot-doux est familier voire relâché avec un mélange du nouchi
et de langues du pays. L’insulte mot-doux se range en insulte mot-doux sexotype,
tribale et personnelle. Loin d’être un phénomène banal, elle participe du
rapprochement des populations et joue un rôle éminemment important sur les plans
culturel et social.
Multilinguales, 15 | 2021
117
BIBLIOGRAPHIE
BUTLER, Judith, « Le pouvoir des mots. Politique du performatif », Paris, Éditions Amsterdam,
(2004).
DERIVE, Jean, DERIVE, Marie Jo, « Processus de création et valeur d’emploi des insultes en français
populaire de Côte-d’Ivoire », dans « Les insultes : approches sémantiques et pragmatiques »,
Langue française, n° 144, Paris, Larousse, (2004), pp. 13-34.
DUBOIS, Jean etal., « Le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage », Paris, Larousse,
2012.
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine, « La Conversation », Paris, Éditions du Seuil, (1996).
KOFFI-LEZOU, Aimée-Danielle, « La violence verbale comme un exutoire. De la fonction sociale de
l’insulte », Signes, Discours et Sociétés [en ligne], 8, La force des mots : valeurs et violence dans
les interactions verbales, 30 janvier 2012, Disponible sur Internet : http://www.revue-
signes.info/document.php?id=2614. ISSN 1308-8378.
LAFOREST, Marty et VINCENT, Diane, « La qualification péjorative dans tous ses états », Langue
française, 144, (2004), pp. 59-81.
LAGORGETTE, Dominique, et LARRIVEE, Pierre, « Interprétation des insultes et relations de
solidarité », Langue française 144 : (2004a), pp. 83-103.
LARGUÈCHE Evelyne, « L’effet injure, De la pragmatique à la psychanalyse », Collection Voix
nouvelles en psychanalyse, Paris, PUF, (1983).
MOISE Claudine, « Espace public et fonction de l’insulte dans la violence
verbale », dans Dominique Lagorgette (éd.), « Les insultes en français : de la recherche
fondamentale à ses applications (linguistique, littérature, histoire, droit) », Chambéry, Université
de Savoie, (2009), pp. 201-219.
NOTES
1. 1 Ce sont des personnes unies par des alliances interethniques. En Côte d’Ivoire, ce sont des
pactes ancestraux de non-agression entre différentes ethnies qui permettent le maintien de la
paix et de la cohésion sociale. Toutefois, ces pactes autorisent des « invectives » ou « offenses » à
ne pas considérer comme agressives.
2. 2 Insulte célèbre, puisque prononcée publiquement par une dame députée, et grossière en
langue malinké, qui désigne le sexe féminin.
RÉSUMÉS
Les insultes sont des faits et des actes qui rythment la vie communautaire. Elles surgissent
généralement dans un environnement « confligène ». Toutefois, l’on rencontre des cas
Multilinguales, 15 | 2021
118
« insolites » de leur manifestation, notamment dans des conversations entre des catégories ou
classes sociales, professionnelles qui partagent une certaine connexité, où, loin d’offenser le
destinataire et provoquer son hérissement, les insultes se font « mots-doux ».
Insults are speech acts that punctuate social life. They arise mostly in a conflicting environment.
However, an anusual case of insult can occur especially in conversations between some socio-
professional categories that share a certain connection. These types of insult do not cause any
offence that may provoke the addressee’s anger, because it is done through "gentle words".
INDEX
Mots-clés : conversation, espace public, insultes, insultes mots-doux, mots-doux
Keywords : conversation, public places, insult, gentle-words insults, gentle-words
AUTEUR
KOUAKOU KOUMAN FODJO
École Normale Supérieure Abidjan, Côte d’Ivoire
Multilinguales, 15 | 2021
119
L’identité nationale à travers lesmanuels scolaires de languefrançaise en Algérie. Cas du manuelde première année moyenne The national identity through the French language textbooks in Algeria. Case of
the textbook of first year middle school
Adila Sahraoui Idriss et Fatima Zohra Chiali Lalaoui
1 Dans la plupart des pays, notamment en Algérie, la communauté scolaire peut
constituer un lieu privilégié pour forger l’identité nationale de l’apprenant comme le
souligne (Outaleb, 2011 :13-23). La communauté éducative dans l’ensemble de ses
constituants, en l’occurrence : les enseignants, les moyens pédagogiques, les aides
didactiques et même les élèves entre eux, participent de près ou de loin au
renforcement de l’identité. Il existe dans le processus d’enseignement/apprentissage
une multitude « d’outils pédagogiques et supports didactiques1 », néanmoins le manuel
constitue par excellence l’outil pédagogique le plus usité au sein de la classe, à défaut
de supports élaborés par l’enseignement. Il se caractérise par un ensemble varié de
textes, d’images et d’activités ayant une visée didactique et pédagogique.
2 Le manuel scolaire représente le terrain où s’expriment les objectifs du système
éducatif, qui tente de s’adapter aux besoins impératifs du développement et aux
réalités du monde moderne. En conséquence, le statut du manuel l’expose à des
changements constants dus aux réformes, qui tentent de rendre plus efficace
l’enseignement/apprentissage des apprenants en tant que futurs citoyens et leur
permettre d’accéder à des connaissances mais aussi à des valeurs culturelles, morales et
idéologiques2. Á cet effet, la loi n° 08-04 proclame que « l’école algérienne a pour
vocation de former un citoyen doté de repères nationaux incontestables, profondément
attaché aux valeurs du peuple algérien […] et en mesure de s’ouvrir sur la civilisation
universelle »3.
Multilinguales, 15 | 2021
120
3 Conformément à cette directive, le cahier des charges pédagogique précise que
l’identité algérienne doit être présente dans les manuels des différentes disciplines.
Sur le plan pédagogique […] il faut accorder une proportion significative auxcomposantes du patrimoine culturel algérien, à concurrence de 80 % […] dans lessciences sociales et humaines (littérature, histoire, éducation islamique, éducationcivique, histoire, géographie, …), dans divers supports (textes, illustrations, carteset documents cartographiques…). Le reste est puisé du patrimoine universel4.
4 Nous pouvons déduire que l’objectif du système éducatif aspire à mettre en évidence
l’identité nationale, conformément aux principes idéologiques de l’État algérien et aux
textes y afférents. Or, une question essentielle s’impose ici : Á quel degré la dimension
de l’identité algérienne est omniprésente dans le manuel scolaire de langue française
de première année moyenne (2éme génération) ? Autrement dit, le manuel en question
contribue-t-il à la construction et au renforcement de l’identité nationale de
l’apprenant algérien en conformité avec ce qui est stipulé dans le cahier des charges
pédagogique ?
En réponse à nos questionnements, nous proposons l’hypothèse suivante :Étant conçu pour apporter des améliorations et des complémentarités par rapport au
précédent, le manuel de FLE de 1ère AM (2 ème génération) reflète l’identité nationale de
l’apprenant algérien conformément aux recommandations du cahier des charges
pédagogique.
5 Le présent article est axé sur les directives du cahier des charges pédagogique et leur
mise en application dans le manuel en question. Pour ce faire, nous avons opté pour
une approche qualitative se basant sur l’analyse de contenu permettant d’explorer trois
composantes pédagogiques essentielles : les thématiques des textes, la nationalité des
auteurs, les sources bibliographiques sélectionnées et les images choisies. Nous nous
sommes intéressées au cycle moyen car il représente un nouveau stade pour
l’apprenant, après un cursus de cinq années au primaire suivies par une période de
trois années au secondaire. Il est donc la phase liant deux cycles différents et
complémentaires. En outre, l’esprit critique et imaginatif de l’apprenant peut être
sollicité davantage à ce niveau, dans le sens où à cet âge5, il est plus facile de lui
inculquer des valeurs nationales et universelles.
Manuel scolaire : outil pédagogique pour apprendre
6 Dans le processus d’enseignement/apprentissage, le manuel scolaire est considéré
comme un outil didactique indispensable qui offre à l’apprenant un recueil de
connaissances lui permettant de découvrir, apprendre, comprendre et acquérir des
savoirs. Il représente aussi pour l’enseignant une référence de base telle une feuille de
route pour la gestion des cours,
et permet aux parents l’accompagnement et le suivi de leurs enfants dans
l’apprentissage (Gérard et Roegiers, 2009 : 83-106). Notons aussi, que le curriculum
scolaire6 est reflété dans le manuel sous forme de textes et d’images : le message
iconique accompagne le message linguistique utilisé à des fins pédagogiques. Dans ce
sens, (Lebrun, 2007 : 14) note que
le manuel est un objet culturel en soi, qui nous renseigne sur la société globale dontil est issu […] Analyser les divers manuels d’une société donnée, c’est donc tracer unportrait de cette société elle-même et du type d’élève qu’elle entend former.
•
Multilinguales, 15 | 2021
121
Dans ce contexte, il s’agit pour nous de déterminer la place octroyée aux référents
identitaires dans le manuel du FLE de 1èreAM (année 2016 – 2017).
Principes du système éducatif algérien
7 Il convient de souligner qu’à la lecture de la loi n° 08-04 du 15 Moharram1429
correspondant au 23 janvier 2008, portant loi d’orientation sur l’éducation nationale,
les principes sont édictés comme suit :
renforcer l’identité des élèves en harmonie avec les valeurs et traditions sociales,spirituelles et éthiques issues de l’héritage culturel commun ; s’imprégner desvaleurs de la citoyenneté et des exigences de la vie en société ; apprendre àobserver, analyser, raisonner, résoudre des problèmes, développer[…] leurcuriosité, leur imagination, leur créativité et leur esprit critique ; avoir uneouverture sur les civilisations et les cultures étrangères... (Chapitre III. Art. 45).
8 Il est bien entendu que ces objectifs sont favorablement recommandées en insistant sur
la préservation des composantes principales de l’identité nationale qui peuvent être
définies comme étant l’ensemble des mœurs, traditions, rites, langues, croyances et
l’histoire qui jalonne la mémoire d’une société :
« l’identité est à la fois personnelle et sociale ; elle exprime en même temps la
singularité individuelle et l’appartenance à des "catégories sociales" (familiales, locales,
ethniques, sociales, idéologiques, religieuses…) » (Costalat-Founeau & Lipiansky, 2008 :
3). Á cet égard, le Ministère de l’Éducation a adopté une réforme apportant des
remaniements au niveau des programmes et manuels scolaires, pour réaliser
concrètement les objectifs généraux visés. En effet, la loi du 23 janvier 2008 n° 08-04,
portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, s’inscrit dans une perspective visant
une ouverture sur le monde extérieur en vue du développement des échanges entre les
civilisations, l’intégration de l’interdisciplinarité et du savoir-faire, l’éducation à la
citoyenneté et la valorisation de l’identité nationale (articles 4, 5 et 6).
9 Ces intentions, sont traduites dans les finalités du cahier des charges pédagogique
ministériel et doivent être appliqués dans les supports didactiques (curriculums et
manuels scolaires) de toutes les disciplines, touchant en grande partie ceux des langues
étrangères, du fait qu’elles peuvent véhiculer une culture autre que celle de
l’apprenant.
Les langues étrangères sont enseignées en tant qu’outil de communicationpermettant l’accès direct à la pensée universelle en suscitant des interactionsfécondes avec les langues et cultures nationales. Elles contribuent à la formationintellectuelle, culturelle et technique et permettent d’élever le niveau decompétitivité dans le monde économique7.
Cahier des charges pédagogique ministériel
10 Il s’agit d’un document pédagogique contractuel qui trace les directives à respecter par
les concepteurs de manuels. Il décrit précisément les besoins auxquels le
soumissionnaire doit répondre. Ce document est promulgué par le Ministère de
l’éducation nationale en partenariat avec l’Institut national de recherche en éducation -
INRE- et la Commission d’agrément
et d’homologation. Il est édité en 2016 et comprend vingt-deux pages incluant quatre
parties : les moyens didactiques ; les conditions d’admissibilité à l’agrément et à
Multilinguales, 15 | 2021
122
l’homologation ; les critères d’évaluation et enfin le barème de notation du matériel
didactique pour une évaluation concurrentielle.
11 Dans son ensemble, le cahier des charges pédagogique algérien met l’accent sur
l’importance d’introduire l’identité algérienne dans le contenu pédagogique du manuel
scolaire. Conformément à la loi d’orientation 08-04 du 23 janvier 2008, les critères
d’évaluation retenus dans ce cahier des charges pédagogique s’inspirent :
des fondements de l’École algérienne, article 2 chapitre 1 ;
des missions de l’École algérienne, article 4 chapitre 28.
12 En relation avec les autres disciplines, l’enseignement du français, « contribue à la
concrétisation des objectifs de transmission et d’intégration des valeurs républicaines
et démocratiques, identitaires, sociales et universelles »9. Cette présente étude
s’intéresse particulièrement au manuel de langue française de première année
moyenne (deuxième génération), ayant subi des modifications suite à la réforme, et à
travers lequel nous allons décrypter la dimension de l’identité nationale de l’apprenant
algérien véhiculée via ses espaces textuels et graphiques. Dans cette perspective, nous
allons adopter une approche analytique qui « consiste à décomposer l’objet d’étude en
allant du plus complexe au plus simple. Cette méthode recherche le plus petit
composant possible, l’unité de base des phénomènes » (Aktouf, 1992 : 23), ce qui
donnera lieu à une distinction des thématiques favorisés dans le manuel ;
l’identification de la nationalité dominante des auteurs et le choix des illustrations
ayant un rapport avec l’identité algérienne.
Identité nationale
13 Nous rappelons que des travaux existent sur la question
de l’identité nationale10 dans les manuels scolaires en tant
que
« principaux transporteurs de valeurs culturelles et idéologiques » (Abadi, 2013 : 137-141).
Les manuels d’histoire soulignent que le « référent arabo-islamique a besoin d’être articulé à des contextes et cadres socio-historiques au sein desquels les apprenants sont directement intégrés dans leur viequotidienne » (Remaoun, 1993 : 57-64).
Ainsi, les manuels d’histoire peuvent façonner « une image homogène de l’identité à travers la multiplicité des catégories, desclasses sociales, des régions et des ethnies ». (Ait Saadi Bouras, 2015 : 445-453).
14 Entre autres, dans les manuels des sciences islamiques, dits facteurs de l’identité
nationale, l’école algérienne se voit imposer une dichotomie entre une formation de
« citoyens d’une société démocratique et des individus religieux pour unecommunauté religieuse ». (El-Mestari, 2011 : 70-80).
S’agissant des manuels du FLE, il est signalé « qu’exclure complètement la culture étrangère ne peut aider les élèves àconstruire leur identité communautaire et nationale ». (Khadir, 2016 : 1-16) ;(Bouari, 2011 :127-132).
La relation langue/culture est étroitement liée partant du principe que « la classe de langue est définie comme un des lieux où la culture du pays de l’élèveet la culture étrangère enseignée entrent en relation » (Zarate, 1995 :11).
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
123
Ainsi, l’enseignement du FLE n’échappe pas à la dimension culturelle de la langue en
question.
15 En effet, la langue ne constitue pas uniquement un vecteur de communication, mais
également une dimension qui relève de la culture d’un groupe social (Hamidou, 2007 :
29-40). En tant que substance sociale et culturelle, la langue constitue l’identité d’une
société. Dans les sciences humaines et sociales, la définition de l’identité demeure
équivoque. De ce fait, il n’est pas si évident d’en donner une définition simple et
précise. Toutefois, les paradigmes identificatoires comme la langue, la religion,
l’histoire, la culture, les traditions et les coutumes sont des liens symboliques
permettant de créer d’une part, un socle commun dans une société donnée, et d’autre
part assurer des distinctions anthropologiques.
16 Nous relevons dans le cahier des charges pédagogique
général les mêmes composantes fondamentales de l’identité algérienne signalées dans
le préambule de la révision constitutionnelle de la République algérienne démocratique
et populaire (2016 : 3). En termes de constantes nationales, l’école algérienne a pour
missions d’« affirmer la personnalité algérienne et consolider l’unité de la nation par la
promotion
et la préservation des valeurs en rapport avec l’Islamité, l’Arabité et l’Amazighité
[…] »11. Ainsi notre étude se focalise sur l’approche de l’identité algérienne, comme
ensemble constitué de repères nationaux : religion (l’islam), arabité, amazighité,
histoire, nationalité
et patrimoine algérien (traditions, coutumes, habillement, cuisine algérienne, prénoms
arabes, etc.).
Présentation du corpus
17 Le manuel scolaire sélectionné pour notre étude se compose de 174 pages, il est édité et
mis en circulation en 2016, conçu par une inspectrice de l’éducation et de
l’enseignement moyen12 avec la participation de deux professeurs de français13. Ce livre
se constitue de 3 projets dont chacun comporte une brève présentation et une situation
de départ. Ces projets sont divisés à leur tour en séquences présentées comme suit :
Projet 1 : présente l’introduction suivante : « afin de célébrer les journées mondiales de la
propreté et de l’alimentation qui se déroulent les 15 et 16 octobre de chaque année, mes
camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment vivre sainement »14. Il
comprend trois séquences définit chacune par un intitulé :
Séquence 1 : j’explique l’importance de se laver correctement.
Séquence 2 : j’explique l’importance de manger convenablement.
Séquence 3 : j’explique l’importance de bouger régulièrement.
Projet 2 : est introduit par l’intermédiaire de l’énoncé suivant : « je réalise avec mes
camarades un dossier documentaire pour expliquer les progrès de la science et leurs
conséquences » (Idem., :73). Il se subdivise pareillement en trois séquences :
Séquence 1 : j’explique les progrès de la science.
Séquence 2 : j’explique les différentes pollutions.
Séquence 3 : j’explique le dérèglement du climat.
Projet 3 : comprend une brève introduction : sous le slogan
« pour une vie meilleure », je réalise avec mes camarades un recueil de cosignes pour se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
124
comporter en éco-citoyen. (Ibid., :135). Contrairement aux deux premiers projets, ce dernier
ne comporte que deux séquences intitulées comme suit :
Séquence 1 : j’incite à l’utilisation des énergies propres.
Séquence 2 : j’agis pour un comportement éco-citoyen.
Méthodologie adoptée
18 En nous appuyant sur une étude analytique descriptive de notre corpus, nous avons
adopté une démarche nécessitant une lecture attentive, suivie d’une analyse et
interprétation de son contenu. Cette démarche « permet de retracer, de quantifier,
voire d’évaluer, les idées ou les sujets présents dans un ensemble de documents :
corpus » (Leray, 2008 :5). Cette opération nous permettra de repérer les différentes
thématiques abordées, les auteurs et les sources bibliographiques sélectionnés, ainsi
que les illustrations fournies dans le but de vérifier la présence d’indices des référents
identitaires algériens. Il est à noter que l’identité en tant que catégorie générale
complexe se décline à travers les pratiques langagières, les croyances, le sentiment
national, la culture, les coutumes et traditions, etc.
Analyse thématique
19 Partant du principe que l’analyse thématique est partie intégrante de l’approche
qualitative qui s’insère dans les techniques d’analyse de contenu permettant
d’identifier les thèmes des textes (ce dont parle le texte), il nous a semblé pertinent
d’opter pour cette démarche. Cette analyse consiste à
« transposer d’un corpus donné en un certain nombre de thèmes représentatifs du
contenu analysé ». (Mucchielli, 2012 : 238) Cela dit, notre corpus comprend soixante-
treize textes qui sont principalement de type informatif, explicatif et prescriptif dont
nous allons identifier les thématiques sous format de graphes en secteur.
Commentaire : Le projet 1 comprend vingt-neuf textes répartis comme suit : huit qui
évoquent le thème de la santé, une égalité de cinq textes pour chacune des deux
thématiques, celle de l’alimentation saine et du sport, s’en suit celle de l’hygiène (4).
20 Nous citons ici à titre d’exemple quelques intitulés : « problème de santé et
information » (p.18) ; « une alimentation saine » (p.44) ; « l’utilité du sport scolaire » (p.
64) ; « des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle » (p.14) ; etc. Cependant
les sept textes restants dont trois conçus pour
une lecture récréative sont porteurs de thématiques variées
•
•
Multilinguales, 15 | 2021
125
entre histoire et culture algérienne, écocitoyenneté et animaux :
« Bleu, blanc, vert » (p. 70) ; « Si Bachir » (p. 28),
« Le fennec » (p.56), etc. En somme, nous pouvons retenir que le thème principal
dominant dans cette partie est celui de la « santé » dans le sens où il englobe les
thématiques de l’hygiène, l’alimentation saine et le sport. En ce qui concerne la
question de l’identité nationale, elle est très peu évoquée même si nous pouvons y
référer de manière superficielle dans les textes suivants :
« Le tabac tue » : ce texte rapporte particulièrement les statistiques faites en Algérie sur
les personnes qui décèdent au quotidien à cause du tabac, et ce, lors d’une journée de
sensibilisation organisée au profit de 120 lycéens de la wilaya d’Oran. Toutefois, le thème
choisi relève d’un sujet d’ordre universel sur la nocivité du tabac.
« À quoi servent les UDS » : le texte parle de l’unité de dépistage et de suivi du Ministère
de la santé qui contrôle l’hygiène des établissements scolaires en Algérie.
« Problèmes de santé et information » : un docteur algérien explique le rôle des médecins,
des journalistes et des écoles dans la diffusion de l’information concernant les problèmes
de santé. Dans ce texte, l’identité algérienne n’est référée que par rapport à la nationalité
du docteur.
« La journée mondiale de l’hygiène des mains » : il s’agit de la participation de l’Algérie à
la célébration de cette journée mondiale pour l’amélioration de l’hygiène des mains dans
les hôpitaux. Il faut noter ici que la célébration de cette journée est d’ordre mondial
(universel), et l’Algérie en fait partie (membre participant).
« Le terfès » : présente un plat populaire du sud algérien (Sahara).
« Surpoids et obésité chez les enfants algériens » : étude effectuée sur le surpoids et
l’obésité chez les enfants scolarisés à Tébessa (Algérie).
« Le fennec » : animal adapté à la vie du désert et vit dans le Sahara. Nous signalons ici que
cet animal vit aussi au sud algérien (Sahara) et que c’est en rapport à cela qu’on
surnomme les joueurs de football algériens « les Fennecs ».
« La longue marche » : texte rhétorique abordant l’exil qui peut-être référé à la Guerre de
libération nationale.
« Coupe du monde » : présente un résumé sur un match joué par l’Algérie lors de la coupe
du monde de 2014.
« Noureddine Morceli » : relate les exploits d’un athlète algérien.
21 Résultat (s) : Pour cette partie, nous constatons que sur les vingt-neuf textes du
premier projet, nous relevons uniquement dix textes incluant des indices relatifs à
l’identité algérienne, à savoir : la nationalité, l’histoire, les personnalités, les noms
arabes (Halliche, Djabou, Morceli…) et la cuisine algérienne (terfès).
• ◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Multilinguales, 15 | 2021
126
Commentaire : Le projet 2 comporte vingt-sept textes dont douze traitent le thème de
l’environnement, sept textes d’ordre technologique, tandis que les sept autres restants
dont trois destinés pour une lecture récréative portent des thèmes diversifiés, à savoir,
l’éthique (3), l’histoire et culture algérienne (3), ainsi que la santé (1). Nous citons ici
quelques exemples : « La couche d’ozone va-t-elle disparaître » (p.106) ; « Pourquoi
Internet a-t-il modifié notre vie ? » (p. 86) ; « Ali le pêcheur » (p.92) ; « La patrie » (p.
112), etc.
22 Les données recueillies permettent donc d’identifier deux thématiques prédominantes
dans le second projet, celles de l’environnement et de la technologie. Toutefois, nous
relevons des symboles de l’identité algérienne dans les textes suivants :
« Ali le pêcheur » : relate l’histoire d’un pêcheur doté de valeurs humaines te morales,
telles, la naïveté, la générosité et l’honnêteté. De ce fait, le fond de l’histoire présentée
dans le manuel évoque principalement des valeurs humaines (universelles). Néanmoins, le
personnage principal choisi dans le texte porte un prénom arabe (Ali).
« Ils vont dans la légende » : ce poème exprime le deuil et la tristesse face à la perte des
êtres chers lors de la Guerre de libération algérienne.
« La patrie » : extrait d’un roman évoquant la période coloniale en Algérie.
« Mon oncle » : l’indice pouvant marquer l’identité algérienne dans cet extrait de roman,
est le terme « gandoura », vêtement souvent porté en Algérie,
« Qu’est-ce qu’une foggara ? » : dans ce texte, l’auteur emploie les termes arabes « oued »
et « foggara » et mentionne la région du sud algérien « Sahara ».
« La sécheresse en Algérie » : cet extrait traite la question de la sècheresse en Algérie.
« Algérie » : ce poème reflète l’identité algérienne par la mention de plusieurs régions de
l’Algérie souffrant de la violence de la guerre.
23 Résultat (s) : Nous constatons qu’il n’existe que sept textes dans le projet 2 portant des
symboles de l’identité algérienne, à savoir : l’histoire, l’habillement, les régions
d’Algérie, les termes et prénoms arabes.
• ◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Multilinguales, 15 | 2021
127
Commentaire : Le projet 3 comprend dix-sept textes dont neuf traitent le sujet des
énergies renouvelables, cinq autres, celui de l’écocitoyenneté et les trois restants
évoquent l’histoire et la culture algérienne. Á titre d’exemple, voici quelques intitulés :
« Pourquoi devrions-nous utiliser des énergies renouvelables ? » (p.142) ; « Les bons
réflexes pour devenir un éco-citoyen » (p.160) ; « Boussoulem » (p. 140), etc. En somme,
le projet 3 adopte le thème des énergies renouvelables et de l’écocitoyenneté. Toutefois,
l’identité algérienne ne figure superficiellement que dans les textes suivants :« Boussoulem » : cet extrait porte sur le patrimoine culturel algérien dans lequel l’auteur
relate la beauté de son pays natal la Kabylie et la cuisine traditionnelle connue dans cette
région
« couscous, huile d’olive… ».
« L’Algérie et le développement des énergies propres » : ce texte traite la question des
énergies propres dans un contexte algérien. Néanmoins, la thématique ici est d’ordre
technologique et non pas identitaire.
« Les énergies vertes » : cet extrait expose un entretien avec un professeur-chercheur
algérien (Mme Benhamou) de l’université de Boumerdés en rapport avec les énergies
renouvelables.
« Les meringues » : cet extrait de roman croise deux civilisations différentes (algérienne et
française) reflétées dans les prénoms arabes et français des personnages (Nfissa, Lalla
Aïcha, Si Othmane et Jacqueline), ainsi que dans l’ambigüité à comprendre deux termes :
« marraine » : femme désignée par les parents dans le but d’accompagner et de soutenir
leur enfant, particulièrement en leur absence, culture qui n’est pas accoutumée en
Algérie ; et « meringue » : pâtisserie d’origine européenne très connue en France.
« La citronnade » : ce texte présente une recette algérienne15 d’une boisson.
« Pour une facture d’eau moins salée » : texte portant sur les directives pour la
consommation rationnelle de l’eau dans la wilaya d’Oran.
« De l’électricité pour 20 villages isolés du Sud algérien » : texte informatif sur
l’introduction de la filière solaire en vue du développement des énergies renouvelables
dans 20 villages du Sud algérien.
« L’Algérie, 1er pays dans le monde arabe en matière de protection de l’environnement » :
extrait tiré du journal El Moudjahid sur une journée d’étude, concernant la protection de
l’environnement dirigée par Soumia Abdel Sadok, présidente du Conseil d’Etat algérien.
Résultat (s) : Nous relevons dans le projet 3, huit textes porteurs d’indices de l’identité
algérienne tels : des éléments de l’histoire, des prénoms arabes, des régions, cuisine et
personnalités algériennes.
• ◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Multilinguales, 15 | 2021
128
Analyse des résultats de l’approche thématique destrois projets
24 Nous constatons que sur un total de soixante-treize textes dans le manuel de FLE de
1èreAM (2ème génération), nous relevons vingt-cinq textes, équivaut à 34.25 % incluant
des facteurs reflétant l’identité nationale. Il faut noter ici, que certains extraits choisis
dans le manuel appartenant à de grands auteurs algériens comme Yasmina Khadra,
Assia Djebar, Tahar Ouettar, Mouloud Féraoun, etc. qui traitent souvent du thème de la
Guerre de libération algérienne n’abordent pas explicitement les éléments de l’identité
algérienne. L’analyse thématique du manuel en question, nous amène à déduire que la
majorité des thèmes abordés s’imprègnent principalement du contexte d’actualité qui
relève d’une politique universelle (santé, hygiène, environnement, technologie,
écocitoyenneté, etc.). Cependant, le facteur identitaire national est négligé dans les
thématiques proposées dans notre corpus.
25 Notre recherche montre, en conséquence, que le corpus étudié ne reflète pas les
recommandations du cahier des charges pédagogique, qui favorise la prise en charge
des valeurs identitaires et nationales, dans « le fait de comprendre/dire des énoncés
relatifs à un événement national historique, religieux, sportif ou culturel ; de lire/
écrire des textes dont les thèmes sont porteurs de ces valeurs évoquant le patrimoine,
les symboles, les traditions, etc. »16.
Nationalité des auteurs et références bibliographiques
26 Les auteurs sont généralement des témoins de leur époque, tributaires de leur société,
faisant référence à leur espace de vie et de pensées. Ils « dressent des tableaux de leur
propre société tout en valorisant leur identité et appartenance culturelle »
(Boutaghane, 2015 : 27). Dans l’intention d’identifier la nationalité culminante des
auteurs ainsi que l’origine des sources bibliographiques choisies dans notre corpus,
nous allons dresser un tableau pour la constatation des chiffres obtenus.
Multilinguales, 15 | 2021
129
Analyse des résultats relatifs aux auteurs et sourcesbibliographiques dans le manuel
27 Á l’issu des résultats obtenus, nous pouvons conclure que sur une totalité de soixante-
treize textes inclus dans notre corpus, un nombre significatif de quarante-trois textes
ne fournit pas d’informations sur l’auteur. Néanmoins, ceux dont les auteurs sont
mentionnés, se répartissent équitablement entre auteurs de nationalité algérienne (17)
tels Assia Djebar, Mohamed Dib, Mouloud Feraoun, Abdelhamid Benhadouga, etc. et
ceux de nationalité étrangère (17), notamment française comme Marc Dufumier,
Philipe Corentin, Cathy Franco, etc.
28 Á propos des textes qui ne mentionnent pas d’auteurs, ils sont tirés de différentes
sources (site internet, journal, encyclopédie, etc.). Cependant, il faut noter que les
sources étrangères (40) sont dominantes par rapport à celles algériennes (30). Ceci nous
laisse dire que les directives adressées aux auteurs-concepteurs de manuels scolaires ne
concordent pas avec les données recueillis à travers notre analyse. En effet, en matière
de représentation des valeurs nationales et universelles, le matériel didactique doit
selon le cahier des charges :
- […] intégrer des textes authentiques, extraits d’œuvres littéraires d’auteursalgériens, tous genres confondus (roman, nouvelles, poèmes, pièces de théâtre, etc.)et du patrimoine culturel national (contes, légendes, mythes, etc.), à concurrencede 80 % ;- intégrer des textes littéraires du patrimoine universel, à concurrence de 20 %.Pour les autres langues étrangères (Langue étrangère 2), intégrer des textesd’auteurs algériens, autant que possible17.
Les illustrations du manuel et leurs corrélations avecl’identité algérienne
29 Les documents iconographiques qui désignent l’ensemble des images représentant un
dessin, une carte, un graphe, une photographie, etc. servent à expliquer, décrire et
donner une idée plus claire. À ce propos, (Biron, 2006 :196) signale la
« nécessité d’introduire l’image pour rendre concret ce qui est abstrait ». L’image
permet donc d’illustrer et d’expliquer le code linguistique. Notre corpus présente une
abondance d’illustrations regroupant en grande partie des photographies et des dessins
de bonne résolution. Bien entendu, environ 80 images occupent une surface très
importante dans les pages du manuel.
30 Par ailleurs, les illustrations sélectionnées sont d’ordre universel, mettant en scène des
photos et des dessins reflétant l’hygiène, la nourriture, le sport, la technologie,
l’environnement, etc. Une autre minorité (13 images) représente principalement des
personnalités algériennes et des lieux appartenant au territoire national :
la place de l’Emir Abdelkader (Alger, Algérie) ; un village au sud algérien (Sahara) et un
village en Kabylie (Algérie) ;
auteurs algériens : Abdelhamid Benhadouga, Mouloud Mammeri, Maïssa Bey, Tahar
Ouettar, Mohamed Dib et Assia Djebar ;
athlètes algériens : Noureddine Morceli et Hassiba Boulmerka.
• ◦
◦
◦
Multilinguales, 15 | 2021
130
La dominance des images d’ordre scientifique et universel laisse à supposer que les éditeurs
du manuel tentent de concilier avec les objectifs de la politique éducative avec la volonté de
s’intégrer à un monde en constante progression.
31 Par l’entremise de notre étude, nous cherchions à déterminer si l’école algérienne
véhicule via ses manuels une représentation assez large de l’identité algérienne, ou
uniquement une image imprécise de celle-ci. Cependant, à travers la lecture du manuel
scolaire du FLE de 1èreAM, édition (2016-2017) comme espace réservé pour forger
l’identité algérienne, nous pouvons constater que les référents qui se rapportent à cette
identité sont négligés dans l’ensemble. En effet, comme nous l’avons pu remarquer via
l’analyse effectuée, nous retenons que :
les thématiques reflétant l’identité algérienne ne représentent que 34 % de la totalité des
textes (73) proposés dans notre corpus. Nous pouvons relever le thème de la guerre de
libération nationale ainsi que la présence de quelques indices pouvant refléter l’identité
nationale, tels : les termes et noms arabes, cuisine traditionnelle algérienne, régions de
l’Algérie, etc.
les auteurs sont sélectionnés de manière équitable entre nationalité algérienne et
étrangère, notamment française avec un pourcentage significatif de 50 %.
l’iconographie occupe une grande place dans les pages du manuel à raison de 80 images.
Toutefois, celles qui ont proprement représenté l’Algérie sont à proportion de 16 %, et ce,
à travers la référence des personnalités et régions algériennes.
32 Il est concevable que le contenu didactique et pédagogique couronne l’action de
modernisation et la formation identitaire du citoyen. Attitude clairement constatée
dans le manuel en question qui s’appuie de manière globale sur une sélection de textes
d’ordre universel qui coïncide probablement avec l’intention politique éducative du
pays désirant répondre aux besoins impératifs de la mondialisation. Toutefois, on
soulève une certaine marginalisation vis-à-vis des indices pouvant renvoyer à l’identité
algérienne comme il est censé être établi selon les directives du cahier des charges
pédagogique relative à la langue française pour le cycle moyen.
BIBLIOGRAPHIE
ABADI, D. (2013). « L’image de l’identité nationale en contexte didactique algérien. Cas des
manuels scolaires du FLE », Al Athar, 18, vol. 12, 11-14.
AIT SAADI BOURAS, L. (2015). L’histoire nationale algérienne à travers ses manuels scolaires
d’histoire, 445-453. Disponible sur :
[https://books.openedition.org/enseditions/2417 ?lang =fr] (consulté le 10/09/2019).
AKTOUF, O. (1987). Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations.
Québec : PUQ.
•
• ◦
◦
◦
Multilinguales, 15 | 2021
131
BIRON Diane, « Fonctions de l’image dans les manuels scolaires de mathématiques au primaire »,
dans Lebrun Monique (dir.), (2006). Le manuel scolaire : un outil à multiples facettes. Québec :
Presses de l’Université du Québec.
BOUARI, H. (2011). Le manuel de français de 5AP : Quels traits identitaires et quelles
représentations culturelles y véhiculés ? In Actes du Séminaire national : Enseignement/
apprentissage y-sont français en Algérie : Enjeux culturels et représentations identitaires,
127-132.
Bulletin officiel de de l’éducation nationale (2008). Loi d’orientation sur l’éducation nationale
n° 08-04 du 23 janvier 2008, article 45.
CALABRE, I. (1988). « Le rôle de l’iconographie », Revue des livres pour enfants, 122-123,
Bibliothèque nationale de France, 1988, 84-91.
CALINDERE, O-C. (2010). L’identité nationale et l’enseignement de l’histoire. Analyse comparée
des contributions scolaires à la construction de l’identité nationale en France et Roumanie
(1950-2005), Thèse pour le Doctorat en Science politique, Université de Bucarest, Bucarest,
Roumanie.
Conseil national des programmes (2009). Référentiel général des programmes.
COSTALAT-FOUNEAU, A-M. & LIPIANSKY, E-M. (2008/1). Éditorial. « Le sujet retrouvé ». In
Connexions, Cairn. info, 89, Belgique, 2008/1, 7-12.
DEMOUGIN, F. & SAUVAGE, J., « Construction identitaire à l’école », Tréma, 33-34, Faculté
d’éducation de l’université de Montpelier, 2010, 1-8.
DJABI, N. & BOUKROUH, N., (2015) Nabni. Débats Algérie rêvée sur l’identité et les langues :
comment renouveler le récit national ? Disponible sur : [https://www.youtube.com/watch ?
v =e1_ICp2H-vg&t =2978s] (consulté le 03/08/2019).
EL-MESTARI, D., « Le discours religieux des manuels scolaires algériens de l’éducation islamique
dans le cycle secondaire », Tréma, 35-36, Faculté d’éducation de l’université de Montpelier, 2011,
70-80.
GERARD, F-M. & ROEGIERS, X., (2009/2). Des manuels scolaires pour apprendre : concevoir,
évaluer, utiliser. Bruxelles : De Boeck supérieur. (83-106)
HAMIDOU, N. « La langue et la culture : une relation dyadique », Synergies Algérie, 1, France :
Gerflint, 2007, 29 – 40.
KHADIR, S. (2016). « Étude socioculturelle du manuel scolaire de FLE en Algérie. Cas du manuel de
première année moyenne », Dirassat & Abhath, 24, 1-16.
LERAY, Ch. (2008). L’analyse de contenu : de la théorie à la pratique. Québec : Presses de
l’Université du Québec.
LOUBET, J.L, (2000). Initiation aux méthodes des sciences sociales. Paris : L’Harmattan.
MERAGA, C., BOUZELBOUDJEN, H. & MADAGH, A., (Eds.), Mon livre de langue française, 1ère année
moyenne, (2017-2018). Réghaïa, Alger : ENAG Éditions.
Ministère de l’Éducation nationale, Institut nationale de recherche en éducation & Commission
d’agrément et d’homologation, Cahier des charges pédagogique général, Discipline : Français,
palier du cycle moyen, 2016,
Multilinguales, 15 | 2021
132
Ministère de l’éducation nationale, Commission nationale des programmes, Groupe spécialisé
disciplinaire du français (2016). Document d’accompagnement du programme de français -cycle
moyen-.
OUTALEB, A., (2011). « Les connaissances culturelles au service de la compétence communicative.
L’enseignement du FLE en Algérie ». In Actes du séminaire national : enseignement/
apprentissage du français en Algérie : enjeux culturels et représentations identitaires, 13-23.
PAILLE, P. & MUCCHIELLI, A., (2012). L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales,
Paris : Armand Colin.
Présidence de la République & secrétariat général du gouvernement (2016). Constitution de la
République algérienne démocratique et populaire. Loi n° 16-01 du 6 mars 2016, Journal officiel
n° 14 du 7 mars 2016.
REMAOUN, H., (1993/2). « Sur l’enseignement de l’histoire en Algérie ou de la crise identitaire à
travers (et par) l’école », NAQD, 5, 57 – 64.
ZARATE, G., (1995), Représentations de l’étranger et didactique des langues, Paris : Didier.
NOTES
1. Autrement dit : tout dispositif matériel accompagnant une situation d'enseignement /
apprentissage, tel que, le manuel scolaire, l’ordinateur, le tableau, le CD, le vidéoprojecteur, etc.
Un support devient un outil pédagogique lorsqu’il est élaboré pour aider un public à atteindre un
objectif dans un contexte donné ; il sert en quelque sorte de médiateur, de facilitateur pour
apprendre.
2. La loi d’orientation sur l’Éducation Nationale n° 08-04 du 23 janvier 2008 précise dans son
préambule, notamment dans les chapitres I et II du titre premier et dans les chapitres II, III et IV
du titre trois, les missions de l’école en matière de valeurs spirituelles et citoyennes.
3. La loi n° 08-04 du 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'Éducation Nationale, chapitre I,
article 2.
4. Ministère de l’Éducation Nationale, l’Institut National de Recherche en Éducation & la
Commission d’Agrément et d’Homologation (2016). Cahier des charges pédagogique général
algérien, p. 4.
5. L’OMS considère que l’adolescence est la période de croissance et de développement humain. Il
s’agit de l’acquisition de compétences,
la construction et l’exploration identitaire, le choix de valeurs, la création
de l’estime de soi ainsi que la capacité de raisonnement. https://www.who.int/
maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/fr/
6. Le curriculum est entendu comme le programme scolaire dans son sens le plus large ;
autrement dit, les objectifs d’enseignement, les objectifs d’apprentissage, les méthodes et
démarches, les supports ainsi que l’évaluation.
7. Commission Nationale des Programmes (2009). Référentiel général des programmes, mise en
conformité avec la loi n° 08-04 du 23 janvier 2008 p.p.65-66.
8. Ministère de l’Éducation Nationale ; l’Institut National de Recherche en Éducation & la
Commission d’Agrément et d’Homologation (2016). Cahier des charges pédagogique général
algérien, p. 14.
9. Ministère de l’Éducation Nationale (2016). Document d’accompagnement du programme de
français pour le cycle moyen, p. 2.
Multilinguales, 15 | 2021
133
10. La notion de l’identité nationale est complexe et polysémique, elle est sujette à des tensions
et discussions idéologiques et politiques, mais comme notre recherche ne s’insère pas
directement dans cela, nous nous sommes contentées de donner les grandes lignes de l’identité
nationale.
11. Ministère de l’Éducation Nationale, l’Institut National de Recherche en Éducation & la
Commission d’Agrément et d’Homologation (2016). Cahier des charges pédagogique général
algérien, p. 3.
12. Anissa Madagh.
13. Chafik Meraga & Halim Bouzelboudjen.
14. Meraga, C., Bouzelboudjen, H., Madagh, A. (2017-2018). Mon livre de langue française, 1 ère
année moyenne, Réghaïa, Alger : ENAG Éditions, p. 8.
15. Dans le contenu du texte, il est précisé qu’il s’agit d’une recette algérienne : « pour obtenir
une bonne citronnade algérienne, il faut […] ».
16. Ministère de l’Éducation Nationale (2016). Document d’accompagnement du programme de
français pour le cycle moyen, p. 5.
17. Ministère de l’Éducation Nationale ; l’Institut National de Recherche en Éducation & la
Commission d’Agrément et d’Homologation (2016). Cahier des charges pédagogique général
algérien, p. 15.
RÉSUMÉS
Par le biais de ses textes, ses illustrations et ses activités variées, le manuel scolaire est
susceptible de contribuer au renforcement de l’identité algérienne des apprenants. La question
est de savoir comment ? Notre contribution vise l’analyse des finalités actuelles du système
éducatif algérien, traduites en objectifs de formation, via le manuel. Notre corpus est basé sur le
manuel de langue française de première année moyenne (édition 2016-2017), dont nous avons
fait l’analyse de contenu. À l’issue de notre recherche, il s’avère que ce support pédagogique ne
semble pas interférer dans l’identité « nationale » algérienne.
Through its texts, illustrations and varied activities, the textbook can contribute to the
strengthening of the Algerian identity within learners. Yet, the question to be asked is “how”.
This paper aims to analyse the current purposes of the Algerian education system ; i.e. the
educational objectives stated in the textbook. The corpus of this study is based on the French
language textbook of the first year in middle school (2016-2017 edition), whose content is the
core of the analysis. From this research, it can be revealed that this pedagogical support does not
seem to interfere in the "national" Algerian identity.
INDEX
Keywords : textbook, French language, national identity, Algerian education system, middle
school
Mots-clés : manuel scolaire, langue française, identité algérienne, système éducatif algérien,
cycle du moyen
Multilinguales, 15 | 2021
134
AUTEURS
ADILA SAHRAOUI IDRISS
Université Oran 2, Mohamed Ben Ahmed, Algérie
FATIMA ZOHRA CHIALI LALAOUI
Université Oran 2, Mohamed Ben Ahmed, Algérie
Multilinguales, 15 | 2021
135
« La nuit de noce sur la natte » :l’expression liminaire d’uneinitiation ratée“La nuit de noce sur la natte ”: the liminal expression of a failed initiation
Zahir Sidane
1 La littérature maghrébine de graphie française née dans l’année quarante est une
réalité mouvante qui s’est affirmée dans le panorama culturel nord-africain. Celle-ci ne
cesse d’actualiser de concert le processus d’esthétisation et de création littéraire. Bien
que l’avènement de cette dernière soit salué par certains, la considérant comme une
valeur certaine au développement culturel pour entrer résolument dans la modernité ;
ou comme un « butin de guerre », pour reprendre les propos méditatifs de Kateb
Yacine ; d’autres l’ont condamné pour cause qu’elle véhicule une culture hostile ; celle
du colonisateur.
2 Le panorama de la littérature maghrébine d’expression française, par-delà son
hétérogénéité et ses différences est devenue matière intarissable qui rend compte des
parcours historique, idéologique et esthétique et s’arrime à cet ensemble qui est la
patrie maghrébine. A l’image de sa culture, celle-ci reste ouverte aux influences
étrangères et creuse, sans complexe, ses sillons favorisant ainsi l’émergence
d’intellectuels et de nouvelles plumes littéraires qui ont porté résolument le flambeau
de la création pour une écriture qui s’affirme et s’enrichit avec le temps. Comme le dit
Charles Bonn :
La littérature maghrébine de langue française est en grande partie cette danse dedésir mortel devant un miroir fabriqué par l’Occident, qu’on ne cesse de briser et dereconstituer, pour mieux souligner le simulacre d’un projet de meurtre qui seretourne le plus souvent en quête d’amour et revendication d’une reconnaissanceéperdue, et toujours contrite. (Bonn, 1985 : 5)
3 Face à cette méditerranée en ébullition, force est de constater l’entreprise de dé-
construction de sens qui sollicite des manœuvres textuelles ostentatoires attestant
d’une volonté d’affirmer la différence et de re-construire une identité propre au
Maghreb. Ce Maghreb des cultures constitue en effet, un espace d’échange matriciel
Multilinguales, 15 | 2021
136
regroupant des réalités littéraires et culturelles diverses. Il est aussi et surtout, un défi
pour les écrivains de rendre compte des réalités coloniales, postcoloniales ou celles
essentiellement caractérisées par les migrations. De nombreux écrivains, tels que Kateb
Yacine, Abdelkébir Khatibi, Nabile Farès et bien d’autres, ont inscrit dans leurs œuvres
la problématique d’exprimer le dire1 ; d’écrire le Maghreb. Ces derniers trouvent dans
les motifs de l’oralité et de la tradition, des éléments de jeux et d’enjeux concurrentiels
mettant ainsi en évidence cet héritage qu’ils tentent de perpétuer dans leurs créations
littéraires.
4 Assia Djebar, enfant terrible de la littérature algérienne d’expression française, fait
partie de ces écrivains qui ont participé au renouvellement de cette littérature ainsi
que sa vitalité en apportant un sang neuf à cette dernière qui reste souvent rattachée à
certaines règles et dogmes. Ses textes, ouverts et pluriels, mêlent à la fois des images
aussi agressives et inquiétantes qu’humaines et généreuses, témoignent de cette
fécondité génératrice.
5 Nous nous intéressons dans notre présente analyse à l’univers ethnoculturel dans son
roman intitulé « Ombre Sultane ». Nous proposons une lecture ethnocritique de « La
nuit de noce sur la natte »2 où nous nous pencherons sur la question des pratiques et
des coutumes relatant un rite fondateur parmi d’autres, celui du mariage. Cela nous
amène à nous poser la question suivante : Comment le rite du passage, celui du mariage
et les symboles qui lui sont associés, problématise la sociabilité des jeunes filles et le
redressement de la sexualité des femmes en l’inscrivant dans l’économie narrative de
l’œuvre ? Ces ressources axiologiques étant prises comme des signes ethnographiques,
pourraient modaliser leurs intégrations dans le tissu romanesque et témoigner d’une
articulation symbolisée.
6 Les rites peuvent apparaitre, dans une certaine mesure, comme une mise en
perspective qui unit la société autours de valeurs communes tout autant qu’elle révèle
les travers. C’est ainsi que le fait remarquer Sébastien Pesce dans sa réflexion au sujet
du rite de passage :
Les rites assurent la pérennité d’un idéal social nécessaire a la survie du groupe, enconvoquant des symboles expressifs de sa culture.si c’est a l’individu que le riteparle, c’est aussi au groupe, et du groupe lui-même, de ses valeurs et de sescroyances (Pesce, 2008 : 221-222)
7 Notre propos est de démontrer que le texte d’Assia Djebar dessine une focalisation
polyphonique autour des imaginaires folkloriques. Une hybridation et une pluralité
culturelle qui convoquent un imaginaire caractérisé par un ensemble de croyances
traditionnelles sur les relations problématiques, le tout dans un jeu subversif et
poétique de belligérance culturelle. Il devient dès lors possible d’y dessiner dans le
texte djebarien des zones et des points de localisations et de passage ou transitent des
phénomènes d’interculturalité, de transculturalité, d’hybridité et de collage/bricolage
culturel dans le système de signifiance du texte.
8 Le populaire est représenté dans l’œuvre d’Assia Djebar comme un immense réservoir
d’énergie pour la narration qu’elle essaie de mettre au service de leur cause. Nous
faisons alors l’hypothèse que la nuit de noce est la suite funeste, mais logique, d’une
série de passages et rituels ratés suscitant un désordre généralisé. Nous verrons dans
un premier temps l’importance du rite initiatique fondé sur l’expérientiel dans la
transmission des valeurs sociétales à travers l’investissement symbolique du rite de
mariage et ce, d’un point de vue ethnologique. Dans un second temps, nous nous
Multilinguales, 15 | 2021
137
intéresserons aux épreuves vécues par le personnage d’Isma et les différentes manières
dont l’œuvre retraduit dans son système les cosmologies plurielles de ces chronotopes
rituels afin de conceptualiser ce rite d’initiation du point de vue de la socialisation.
Le rite initiatique et la transmission des valeurs
9 Pour les spécialistes des sociétés traditionnelles, le rite est un schème culturel d’une
importance considérable. Il occupe une position fondatrice puisqu’il assure une chaîne
de transmission de sens et de valeurs, et donne une cohésion au groupe social.
S’agissant des conceptions du monde et des croyances métaphysiques, Daniel Fabre
perçoit bien la pléthore d’acceptions du rite3qui concourent à définir cette notion :
Le rite, nous l’avons vu, est une des plus communes cibles du soupçon : notionvague, importation exotique, étiquette illusoire, on n’hésite pas à voir dans l’usagedu mot une façon naïve qu’aurait l’ethnologie de s’annexer les territoires de l’actuelet du moderne. […] Dans sa complexité, le rite est un élément du prisme qui permetd’accommoder notre regard et de construire notre savoir (Fabre. 2007)
10 Un détour donc par l’anthropologie révèle en effet que la plupart des rites - et
particulièrement les rites de passages - articulent un scénario qui repose
essentiellement sur une structure tripartie. Selon une séquence constante en trois
temps, Arnold Van Gennep (1873-1957) dans son ouvrage intitulé « Les rites de passage.
Etude systématique » (Van Gennep, 2016), fait la distinction entre les trois phases du rite
de passage qui se dessine comme ceci : Le « rite de séparation » ou « rites
préliminaires », « rite de marge » appelé aussi « rites liminaires », et enfin le « rite
d’agrégation » ou « post-liminaire ». Il faudrait donc envisager ces rites de passages
comme un processus de construction sociale pour comprendre ainsi la fonction de
séparation que Robert Herouet dresse dans son étude consacrée au « Rites et rituels
funéraires » :
La première fonction d’un rituel est de provoquer une rupture, de nous faire sortirde notre quotidien, de ses habitudes. Ces ruptures impliquent non seulement de seretrouver hors de l’espace et du temps habituel, de se sentir ailleurs, mais aussi dese retrouver hors de l’ordinaire, de faire autre chose, de faire autrement (Herouet,2013)
11 Dans ce sens, les rites du mariage sont placés sous le signe de la dualité et de la rupture,
puisque cela implique la séparation du jeune homme et de la jeune fille d’une situation
initiale caractérisée par leurs célibats, et leur intégration à une nouvelle catégorie ;
celle des adultes mariés. Ce n’est donc pas un hasard si la question des rites de passage
est posée aujourd’hui avec acuité. Si besoin était, la thèse selon laquelle les rites de
passages participent de l’identité culturelle des sociétés maghrébines. C’est ce qui
justifie que nous le qualifiions de « culturème » ou « désignateur de référent
culturel », au sens de Michel Ballard4 (Ballard, 2003) :
Les formes signifiantes sont constituées par des signes de plusieurs sortes (lexèmes,grammèmes, etc.) et les relations qui les unissent. Celles auxquelles nous allonsnous intéresser ici sont les désignateurs de référents culturels (DRC), c’est-à-diredes signes renvoyant à des éléments ou traits dont l’ensemble constitue unecivilisation ou une culture. La plupart des DRC sont des signes à désignationexplicite, ce sont les culturèmes, qui peuvent être des noms propres(The Wild West) ou des noms communs (porridge) mais il faut être conscient que ladésignation peut être effectuée de façon plus implicite, donc plus opaque, à l’aide depronoms ou de substituts et même de l’ellipse. (Ballard, 2003)
Multilinguales, 15 | 2021
138
12 Mais, si le statut de culturème ou DRC au sein des sociétés maghrébines peut être
aisément concevable, dans grand nombre d’œuvres littéraires, celles que nous citons ici
et bien d’autres fonctionnent comme un marqueur identitaire. Car, n’en doutons pas,
ils lèvent le voile sur une complexité relative à la condition féminine et l’usage de tout
un héritage séculaire de l’Algérie pour faire entendre des voix de femmes qui se terrent
derrière un voile de silence imposé par le poids des coutumes et traditions. On devrait
alors s’interroger sur ce qu’implique un tel questionnement non seulement pour cerner
les modalités de manifestation de ces pratiques culturelles qui entourent le rite de
passage, en l’occurrence le rite du mariage dans notre corpus, mais aussi et surtout de
comprendre la rupture avec cette « socialité heureuse » pour reprendre les propos de
Michel Contat.
13 A l’instar des autres textes maghrébins, ceux d’Assia Djebar se construisent sur une
mise en situation fictionnelle pour qualifier le processus d’orchestration à l’œuvre.
L’initiation de la jeune fille vécue à travers les yeux de Isma, emprunte au symbolique
de la tradition du mariage. Dans son roman « Ombre Sultane », Assia Djebar fait
alterner la narration pour dérouler le récit de deux femmes algériennes au cœur d’un
mariage polygame. Il s’agit de Isma ainsi que sa coépouse Hadjila, unies dans une sorte
de relation sororale. Ce récit est aussi une vision réaliste qui nous invite à réfléchir plus
avant sur le poids de la parole féminine, de la femme, de son corps et son rôle dans la
société, et surtout, de son conditionnement par la tradition. Le roman s’ouvre sur cette
performativité :
Ombre et sultane ; ombre derrière la sultane. Deux femmes : Hajila et Isma. Le récitque j’esquisse cerne un duo étrange : deux femmes qui ne sont point sœurs, etmême pas rivales, bien que, l’une le sachant et l’autre l’ignorant, elles se soientretrouvées épouses du même homme – l’« Homme » pour reprendre en écho ledialecte arabe qui se murmure dans la chambre… Cet homme ne les sépare pas, neles rend pas pour autant complices (Djebar, 2006 : 9)
14 Ces quelques mots esquissent déjà une sorte de préambule poétique d’un cri de cœur
d’une femme qui voit son destin sellé. C’est la voix d’une femme qui passe de l’enfance à
la vie d’esclave par un mariage imposé, de l’innocence des non-dits à la tragédie
muette, de la rébellion étouffée à la recherche de son moi enfoui sous le poids des
contraintes et des traditions. Ainsi, dans le chapitre « La nuit de noce sur la natte »,
l’auteur dresse le portrait d’une jeune fille synchrétisant les deux cultures occidentales
et orientales. Elle apparait sous les traits d’une jeune fille à l’âme romantique qui,
depuis son plus jeune âge, s’adonnait avidement à la lecture :
Dès l’âge de douze ans, lorsqu’elle fut retirée de l’école pour être recluse jusqu’à sonmariage, elle lisait avidement les feuilletons de tous les magazines. Elle avait mêmeréussi à se procurer plusieurs romans de Colette, la série des Claudines ainsi queChéri. Baissant la voix, elle ne rêvait plus, elle s’absentait plutôt… (Djebar, 2006 :160)
15 Ces références à la culture française préparent la jeune fille à s’ouvrir au monde
occidental et commence déjà à s’imaginer un avenir différent que celui réservé à ses
cousines qui ont eu droit à des mariages arrangés. Elle pouvait donc « espérer pour elle-
même ce qu’elle appelait un mariage d’amour » (Djebar, 2006 : p. 160) . Ce processus
préparatoire d’Isma est enrichi par une éducation de base qui est assurée par le réseau
social de la jeune fille. Celle-ci nous est présentée comme une brodeuse, couturière,
dentelière, dont la réputation parmi les familles voisines est sans égal. La beauté de
Isma ainsi que sa douceur font d’elle une future mariée modèle très prisée et enviée :
Multilinguales, 15 | 2021
139
« elle rougissait au moindre mot prononcé, elle ne parvenait même pas à hausser son filet de
voix dans les réunions nombreuses » (Djebar, 2006 : 160), et font d’elle une jeune fille dont
le profil est très recherché. Ajoutant à cela son trousseau qu’elle a pris le soin de
collectionner durant toute la période de son « initiation ». Ce dernier « cumulait deux
traditions : celle de la ville, qui se voulait de culture andalouse, celle du rêve européen que
décrivaient les publications françaises » (Djebar, 2006 : 160). Et ce mélange de culture qui
caractérise le trousseau de la future mariée reflète cette symbiose culturelle qui
constitue un terrain d’élection pour faire dialoguer les savoirs, les rêves et les
fantasmes de la jeune fille qui s’apprête à passer le seuil vers le monde des adultes.
16 La jeune Isma avait donc tout pour réussir ces nouvelles noces ; chose qui a accentué la
convoitise des familles bourgeoises qui continuent à caresser le rêve de l’avoir comme
épouse à leurs enfants. Mais « Comment oser demander cette vierge, la plus belle, la plus
douce, pour l’un ou l’autre des fils ? » (Djebar, 2006 : 161). Tel fut le grand défi pour Isma
qui, elle ne rêve que de vivre une belle histoire d’amour. Ainsi, par une lecture plus
attentive des motifs culturels et des pratiques symboliques que véhiculent le texte, on
remarque cette mise en texte du passage du personnage Isma du statut de petite fille
rêveuse à l’état de jeune fille prête à se marier qui met en évidence un processus
d’initiation la préparant à sa future vie d’adulte mariée. Autrement-dit, marquer une
transition, en insistant sur un temps et un espace de coupure pour ainsi souligner la
différence d’un état antérieur à un état postérieur ; un itinéraire initiatique que la
jeune fille doit parcourir avant de pouvoir accéder au mariage et intégrer donc le
monde des adultes.
Le processus d’individuation et l’expérience del’altérité
17 C’est au croisement d’une poétique des textes littéraires et d’une anthropologie du
symbolique que nous tenterons de re-lire ces schèmes culturels périphériques à la
cérémonie du mariage pour mettre en évidence l’hétérogénéité culturelle qui se trouve
souvent dissimulée dans la structure du texte djebarien. Si la nuit de noces n’a pas fait
l’objet d’un véritable questionnement particulier5, force est d’admettre tout le système
de conditionnement auxquels se livrent les protagonistes, souvent de façon
inconsciente pour honorer une morale se trouvant au principe même de toutes les
actions. Ce rite de passage implique nécessairement l’exclusion de ceux qui ne passent
pas par cet impératif culturel pour ainsi confirmer l’identité de ceux et celles qui en
sont dignes, surtout pour la femme dont le corps est « socialement constitué en objet
sacré » (Bourdieu, 1994 : 2). Et que les pratiques qui participent à la légitimation de cet
examen de passage où tout le monde est mis à l’épreuve rendent acceptable la
profanation de ce corps/objet sacré. Autrement-dit, ce rite d’institution, pour reprendre
les propos de Bourdieu, légitime cet arbitraire culturel.
18 Il est vrai que dans les sociétés modernes occidentales actuelles, le mariage ne marque
plus vraiment comme avant un passage transitoire qui donne accès à la sexualité, à la
fécondité ou même au droit à l’installation en ménage. Il va de soi, qu’en fonction des
cultures et des récits, la littérature ne cesse d’actualiser ces pratiques, car c’est un
« temps d’épreuve [qui] impose la rencontre de l’altérité, du contraire : du détourpar la sauvagerie et la marge non cultivée ; du détour par l’autre sexe » (Vidal-Naquet, 1981 : 15).
Multilinguales, 15 | 2021
140
Et c’est justement le rôle des rites de passage que de concrétiser cette chaine de
transition en transmettant les valeurs inhérentes à chaque société, chaque culture pour
assurer une cohésion dans le groupe social, comme le souligne Fabrice Hervieu-Wane
dans son étude consacrée aux « Nouveaux rites de passage » :Les rites de passage ont toujours été, dans les sociétés du sud, comme d’ailleursdans les sociétés occidentales, un mode de transmission pour faire grandir lajeunesse et la faire passer a l’âge adulte. A côté de l’éducation offerte par lesfamilles et de l’instruction donnée par l’école, le rite de passage représente unmode de transmission originale fonde sur l’expérientiel, sur la traversée d’uneexpérience. (Hervieu-Wane, 2012)
19 Le passage, qui est tout à la fois une action et un lieu, prend des formes multiples et
complexes du fait que les différentes acceptions du terme créent des configurations
espace-temps chaque fois particulières. Le passage, chemin que l’on se fraie, peut en
effet être une « sortie du sillon », un « écart de route ». En conséquence, dans sa
dimension éphémère et contingente, le passage ne constituerait-il pas une forme de
transgression ? Si la notion de passage parcourt et mobilise diverses disciplines, son
rapport à la transgression reste encore à approfondir. De son côté, Arnold Van Gennep
met en évidence la fonction organisatrice du rite qui conditionne la vie sous la forme
d’une succession de passages :
La vie individuelle consiste en une succession d’étapes dont les fins etcommencements forment des ensembles de même ordre : naissance, pubertésociale, mariage, paternité, progression de classe, spécialisation d’occupation, mort.Et à chacun de ces ensembles se rapportent des cérémonies dont l’objet estidentique : faire passer l’individu d’une situation déterminée à une autre situationtout aussi déterminée (Van Gennep, 1909 : 4)
20 La progression de la vie individuelle passe donc selon l’auteur par des phases
d’oscillations dont les rites codifient et facilitent le franchissement de ces seuils. Si on
investit le texte d’Assia Djebar, en tenant compte de la première phase d’initiation,
comme toute jeune fille, Isma était donc prête pour ces nouvelles noces, sauf le
prétendant. Elle s’apprêtait donc à quitter le monde de la jeunesse dont la cérémonie
du mariage constitue une scène de transition importante pour le couple.
L’investissement total des jeunes prétendants dans l’organisation de leurs mariage
apparaît dès lors à la mesure de l’engagement matrimonial qu’ils souhaitent ou
espèrent ainsi révéler. La cérémonie de mariage est un espace de performation du
couple que les époux aspirent à concrétiser l’union sacrée. Seulement la déception de la
jeune fille fut la révélation d’une pratique qu’on croyait obsolète. En effet, dans le
village ou était originaire le promis « l’homme n’était pas originaire de la ville, ni même
d’une autre ville ; tout bonnement il venait d’un village proche » (Djebar, 2006 : 162). Le
mariage devait se pratiquer selon un rituel de pauvreté que le saint patron de la région
avait codifié des siècles auparavant : on disait qu’on se mariait selon le « rameau de sidi
Maamar » :
Ce saint personnage avait jadis prêché contre le luxe ostentatoire des bourgeois deces cités, autrefois opulente. Aussi, avait-il prévu, dans ses moindres détails, lacérémonie des épousailles. Quand l’un des descendants prétendait s’exclure de lachaine, les enfants issus de l’union, avait-on constaté naissaient immanquablementinfirmes ou sujets à la folie, à moins qu’on les retrouvât vauriens ou sujet gibiers depotence. Se manifestait ainsi la malédiction du saint Sidi Maamar. (Djebar, 2006 :162)
21 Les pratiques culturelles ainsi que les croyances inhérentes qui entourent la cérémonie
du mariage sont une mosaïque de rites qui sont souvent très variés selon les régions.
Multilinguales, 15 | 2021
141
Cette notable variation est la conséquence du cloisonnement des communautés entre
elles. Et l’hétérogénéité de ces pratiques font de cette cérémonie un temps
d’expériences sociales et de pratiques exclusives dont la légitimité générationnelle,
bien qu’elle soit basée sur le même système de représentation, dynamise un rapport de
force et créent des situations plus ou moins conflictuelles. Il faudrait comprendre aussi
que l’hypervariabilité des détails de ces pratiques rituelles est l’expression d’une
volonté de différenciation et d’autonomie qui s’inscrit dans des alternatives de conflits
et d’alliances. C’est le cas avec ces croyances ancestrales de la famille du mari qui
continuent à croire en une vieille malédiction ; celle du saint de Sidi Maamar. Les
détails de « l’étrange protocole » (Djebar, 2006 : 162) sont annonciateurs de perdition. A
l’évidence, les pratiques rituelles sont perpétuées dans le but d’assurer une cohésion au
sein d’une communauté tant qu’elles demeurent fonctionnelles ; si bien qu’elles
deviennent dysfonctionnelles dans la transmission des savoirs et des savoir-faire, ou
même dans la codification des relations sociales et symboles qu’elles véhiculent.
22 Mais cette pratique rituelle sensée être au service de la religion est vivement contestée
par la famille de la jeune fille et voit dans l’attachement à ces superstitions ancestrales
une tradition désuète qui ne correspond pas aux principes de leur religion, l’islam. Il
est vrai que la cérémonie des noces de mariage demeure une affaire publique dans la
mesure où cette dernière concerne et affecte toute la communauté et non pas
seulement les deux futurs époux. Ces derniers sont exposés durant la nuit de noces aux
exigences sociales qui sont bien codifiées que ce soit sur le plan de la virilité, virginité,
contrôle public etc. C’est à travers la légitimation du pouvoir de l’acte charnel que M.
E. Combs-Schilling battit sa réflexion sur les représentations qui entourent les rituels
matrimoniaux :
L’acte charnel qui constitue l’apogée du rite n’est pas seulement un acte personnel :c’est un acte communautaire et religieux. Au travers de l’acte charnel et de lanaissance d’une postérité , la famille et la communauté des croyants sera élargie etrenouvelée (Combs-Schilling, 1996 : 76)
23 Cet acte charnel, la jeune Isma, à l’image de toutes les jeunes filles qui, durant leur
jeune âge rêvait d’une nuit de noce qui serait le prélude à une vie conjugale épanouie.
Cette dernière devrait donc légitimer cet acte fondateur de l’intimité du futur couple.
Elle l’avait donc préparé durant toute sa jeunesse et dans les moindres détails, car dans
le parcours initiatique des coutumes matrimoniales, toute jeune fille exemplaire :
[…] Devait arriver dans sa nouvelle maison avec tout ce qui parerait la chambreconjugale : multiples matelas de laine blonde lavée dans les ruisseaux d’alentour,les couvre-lits, les draps ajourés les coussins pailletés, et le nécessaire brodé mainpour les bains hebdomadaires. Elle se préparait une lingerie abondante, deschemisiers de soie ajourée (selon les modes tunisoise, algéroise et fassie) (Djebar,2006 : 160)
24 Cette séquencialisation structurée met l’accent sur certains traits culturels qui
surdéterminent les logiques initiatiques de la socialisation. Celles-ci se traduisent par
une quête permanente d’un redressement stable de situation pour assurer une place de
choix au sein du groupe social. Une vie à l’envers6 donc pour reprendre l’expression de
Mikhaïl Bakhtine, semble coïncider avec un temps iconisant les passages sociaux et
tendent à modifier les trajectoires et les passages des individus. Le rite ainsi formalisé,
amène le personnage principal à faire l’expérience de l’altérité en accomplissant cette
traversée :
Multilinguales, 15 | 2021
142
Le matin où l’on viendrait la chercher – une escorte de parentes emmitouflées quedes calèches et des automobiles transporteraient du hameau à notre rue – il nedevait s’élever nulle clameur, aucun you-you, pas la moindre musique ; à la rigueurdes litanies coraniques égrenées par une vieille, un cierge à la main, à l’instantprécis où les marieuses franchiraient le seuil. Celles-ci refuseraient de boire lacitronnade ou le lait de bienvenue, elles ne mangeraient pas la moindre datte ni leplus petit gâteau aux amandes. Elles ne viendraient que pour la vierge àaccompagner. Cette dernière, visage entièrement masqué, le corps vêtu d’une laineou d’une toile ne portant aucune couture, ne devait ni voir ni être vue dequiconque, jusqu’à ce que son nouveau maître, seul dans la nuit avec elle, dévoilâtsa face dans la gravité et la piété : ainsi l’avait voulu le saint Maamar, quatre sièclesauparavant. (Djebar, 2006 : 146)
25 Assia Djebar opère dans son texte un renversement de la situation hégémonique. En
effet, en tenant compte de l’aspect coutumier de ces pratiques, ce processus
d’intégration que devait assurer ce rituel initiatique s’est avéré inopérant en raison des
croyances de la famille du mari qui sont aux antipodes de celle de la famille de la jeune
fille. Ce mariage ainsi consommé aura un impact des plus déterminants sur la suite
logique du parcours de la jeune Isma :
L’union avait été consommé – ainsi l’avait voulu le code du saint - sur une simplepeau de mouton ou sur une natte : deux corps s’accouplant sous une couverture.Etait-ce à cause de cette rudesse que la mariée sanglotait dans cette aube à peineéclaircie ? Elle dut apparaitre l’après-midi, dressée dans ses atours, le front ceint dudiadème, mais les paupières gonflées, le visage bouffi de la déception virginale.(Djebar, 2006 : 168)
26 Cette ouverture aux influences étrangères et l’adoption des pratiques cérémonielles de
la famille de l’époux ne sera pas sans conséquences. En effet, cette sérialisation
« premières fois » met en évidence le décalage entre ces deux cultures et va jusqu’à
engendrer des déséquilibres et un choc culturel difficile à appréhender. Ce constat
d’échec se manifeste par des anecdotes ironiques légitimant le « viol » dans le mariage
tel qu’il est coutume de se pratiquer : « Qu’est-ce que la tendresse chez un homme ?Ricana une voix mauvaise » (Djebar, 2006 : 182). Dans de telles conditions, et face aux
différences de normes, de codes et de valeurs entre les deux familles, les parents d’Isma
ont tendance à cliver entre ces pratiques et croyances de l’Autre qu’ils ont jugé
obsolètes et porte atteinte aux principes religieux de l’Islam en lesquels ils croient :
« L’islam est un, l’islam est nu et pur ! Il te laisse le loisir de te réjouir ! Sa loi nepeut changer, elle est semblable de notre ville jusqu’à Médine, je n’ai besoind’aucun fakih ou docteur de la zitouna pour me l’expliquer ! » (Djebar, 2006 : 164).
Ainsi, le mariage s’annonçait enfler des prémices du deuil. Les diseuses s’étonnaient et
protestaient « Elles ne donneraient jamais leurs filles à un parti similaire, autant sacrifier lapucelle dans l’étau d’un célibat volontaire ». (Djebar, 2006 : 165).
L’union avait été consommé, comme l’avait voulu le code du saint Sidi Maamar, sur une
simple peau de mouton. Le chapitre se termine ainsi : Je retins de cette fête ces détails épars, l’accouplement sur une natte, un marié sanstendresse et les pleurs de l’épousée au visage bouffi, mais aussi l’amertume dupréambule, une dévastation que certaines jugèrent puérile. Comme si, dans notreville comme partout ailleurs, avec la bénédiction d’un saint d’autrefois ou sous lesyou-yous nasillards des citadines passives, nul espoir ne devait s’ouvrir après lanoce (Djebar, 2006 : 169)
Multilinguales, 15 | 2021
143
27 Et c’est dans la conscience de cette blessure enfouie que se creuse ces séparations
performatives et qui font de l’écriture un exercice de liberté, voire un exutoire pour les
souffrances qui la condamne dans son devenir-femme. Et comme l’écrit Marie Scarpa,
« le personnage liminaire, spécialiste du cumul des décumuls, est en quelque sorteun personnage-témoin, placé simplement sur le degré ultime d’une échelle, celle duratage initiatique, qu’emprunte à des degrés divers l’ensemble du personnelromanesque » (Scarpa, 2015 : 34).
Et le texte d’Assia Djebar témoigne de cette impossible agrégation à la communauté à
voir les effets de ces défaillances rituelles sur le parcours narratif du personnage :L’enfance, ô Hajila ! Te déterrer hors de ce terreau commun qui embourbe. […]Isma, l’impossible rivale tressant au hasard une histoire pour libérer la concubine,tente de retrouver le passé consumé et ses cendres. […] quelle ombre en moi seglisse, les sandales à la main et à la bouche bâillonnée ? Eveilleuse pour queldésenchantement… (Djebar, 2006 : 149)
28 L’histoire de l’échec d’une femme émancipée, au corps diaphane, face aux poids de la
tradition est ainsi un appel à la vigilance pour les autres femmes qui sont condamnées à
perpétuité à vivre les affres des exigences coutumières. Ce temps d’une révolution
silencieuse constitue une des problématiques fondamentales du roman moderne qui
tend à problématiser à sa manière les désordres dans la sphère du symbolique en
investissant les brisures du destin dans la marge rituelle sur les frontières et les seuils.
29 En somme, le rite du mariage tel qu’il figure au seuil du texte a narrativement une
fonction prédictive. La nuit de noce, au lendemain d’une nuit consommée comme dans
un rapt, est vécue avec la brutalité d’un viol « sur la natte » ; un passage socialement
consenti et normalisé par la collectivité. Organisé selon une éthno-logique inversée, il
constitue symboliquement un « mauvais » passage. Les noces sont donc ici le temps
d’une initiation ratée si toutefois on tient compte d’un parcours préparatoire à la
socialisation par l’apprentissage qui a abouti à l’emprisonnement de la jeune fille dans
un chronotope de crise. Et c’est au moyen des schèmes culturels qui, dans leurs
progressions parallèles, rendent compte de la spécificité endogène de ces pratiques,
que l’auteur nous livre une mixture, où les hiérarchies d’ordre linguistiques, culturelles
et autres, sont plus ou moins fluctuantes. L’espace scriptural se dessine donc à travers
des combinaisons complexes définies par des logiques multiples, et devient alors un
lieu d’interrogations sur les univers symboliques ; un espace à la fois saisissable et
fuyant, ouvert à tous les possibles.
BIBLIOGRAPHIE
BAKTINE, Mikhaïl, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire du Moyen Âge et sous la
Renaissance, Gallimard, « Tel », 1970.
BONN, Charles ; Le roman algérien de langue française. Vers un espace de communication
littéraire décolonisé, Paris, L’Harmattan, 1985.
Multilinguales, 15 | 2021
144
BOURDIEU. Pierre, Le corps et le sacre, Actes de la recherche en sciences sociales - n° 104, Sept.
1994.
COMBS-SCHILLING, M. E., « La légitimation rituelle du pouvoir au Maroc » in : COLLECTIF, Femmes,
culture et société au Maghreb, vol. 1, Culture, femmes et famille, Casablanca : Afrique Orient,
1996.
DJEBAR, Assia, Ombre Sultane, [Première Edition J.-Lattès, 1987], Albin Michel, 2006.
FABRE, Daniel, « Le rite et ses raisons », Terrain [En ligne], 8 | avril 1987, mis en ligne le 19 juillet
2007, disponible sur : [https://doi.org/10.4000/terrain.3148], consulté le 25 septembre 2020.
HEROUET, Robert, Rites et rituels funéraires : Fonctions, Objectifs, Bénéfices. Généasens [en ligne],
Mars 2013. Disponible sur : [http://www.geneasens.com/dictionnaire/
rites_et_rituels_funéraires.htm], Consulté le 02/11/ 2020.
HERVIEU-WANE, Fabrice., Les nouveaux rites de passage, une transmission expérientielle. Biennale
internationale de l’éducation, de la formation et des pratiques professionnelles., 2012, Paris,
France.
PESCE, Sébastien ; « Le rite de passage comme forme d’autorisation mutuelle : analyse d’un rituel
produit sur un mode de coopératif », in R. Casanova et A. Vulbeau (dirs.), Adolescences, entre
défiance et confiance, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2008.
SCARPA, Marie, « Figures du Sauvage », dans LAVILLE B. et PELLEGRINI F. (dirs.), La Fortune des
Rougon. Lectures croisées, Bordeaux, Presses universitaires, 2015.
VAN GENNEP, Arnold, Les rites de passage. Etude systématique, Picard, Paris, 2016.
NOTES
1. Cette problématique a déjà été traitée dans nos travaux antérieurs, voir la thèse de doctorat
intitulée : « L’écriture du silence dans quatre textes de Nabile Farès ; L’Etat perdu, La mort de Salah
Baye, Le Miroir de Cordoue et Il était une fois l’Algérie » sous la direction du Pr. BOUALIT Farida, en 2015
2. « La nuit de noce sur la natte » est un chapitre constitutif du roman « Ombre Sultane »d’Assia Djebar
3. Selon les contextes dans lesquels il est utilisé, la définition peut prendre des acceptions bien
différentes.
4. BALLARD Michel, Versus : la version réfléchie : anglais-français. vol. 1. Repérages et
Paramètres, Gap, Paris, Ophrys, 2003. La définition des « culturèmes/DRC » est reprise par
l’auteur dans un article intitulé « La lecture des désignateurs de référents culturels ».
Consultable sur le site : [https://revistas.ulusofona.pt/index.php/babilonia/article/viewFile/
1721/1377, consulté le : 14/11/2020].
5. Selon Faouzi Adel, dans son article intitulé « La nuit de noces ou la virilité piégée », les
réflexions investies autour du rite de la nuit de noces ont surtout mis en évidence le caractère du
rituel et les codifications opérées par la tradition d’un point de vue anthropologique et ont
négligé les effets sur la suite des évènements. Consultable sur le site : [https://
journals.openedition.org/insaniyat/11635 ?lang =ar consulté le : 14/11/2020]
6. Cette expression est utilisée par Mikhael Bakhtine dans son ouvrage intitulé : « L’Œuvre de
François Rabelais et la culture populaire du Moyen Âge et sous la Renaissance », Gallimard,
« Tel », 1970, p. 180, pour définir cet espace-temps vécu par un groupe social en situation de
carnaval pour ainsi faire pleinement l’expérience de l’altérité par l’accomplissement d’une série
Multilinguales, 15 | 2021
145
d’actes carnavalesques. Ce « monde à l’envers » temporaire donc, est réglé et codifié par le rite,
et s’achève sur une remise en ordre du désordre provoqué par les rites de passage.
RÉSUMÉS
Cet article propose une lecture ethnocritique du texte d’Assia Djebar « Ombre Sultane », en
exposant l’apport de cette théorie à l’étude des chronotopes rituels et les logiques culturelles qui
architecturent son roman. Ces logiques ritiques ainsi que les métissages anthropologiques
articulés autour du rite du mariage, et les symboles qui lui sont associés, sont retraduit par
l’œuvre en dé-nouant les difficiles traversées des frontières, mobiles et labiles, du personnage
liminaire d’Isma et constitue le point nodal du procès narratif.
This article proposes an ethnocritical reading of Assia Djebar’s novel "Ombre Sultane", through
exposing the contribution of this theory to the study of ritual chronotopes and cultural logics,
which shape her novel. These ritual logics as well as the anthropological mixtures articulated
around the rite of marriage, and the symbols associated with it are mirrored and reflected in the
novel by unveiling the difficult border crossings faced by the liminal character of Isma, and they
constitute the nodal point of the narrative process.
INDEX
Mots-clés : Ethnocritique, ethnologie, personnage liminaire, rite, seuil
Keywords : Ethnocritic, ethnology, liminal character, rite, threshold
AUTEUR
ZAHIR SIDANE
Faculté des Lettres et des Langues, Université A. Mira – Bejaia, Algérie
Multilinguales, 15 | 2021
146
Deux romans de Kamel Daoud, entremilitantisme satirique et symbiose
interculturelleTwo novels by Kamel Daoud, between satirical activism and intercultural
symbiosis
Smail Mahfouf
1 Notre choix du corpusZabor ou les Psaumes(2017) etLe peintre dévorant la femme
(2018) est motivé par la thématique du sacré qui en constitue la toile de fond. De ce
sacré à l’œuvre découle notre démarche analytique. Nous considérons, en effet, qu’à
l’arrière-plan de ces romans se profile une forme de dialogue interculturel, qui
implique dans une large mesure le religieux. Cette dynamique interculturelle, qui est
amorcée et limitée dans le premier roman,
Meursault, contre-enquête
(2013) à l’histoire coloniale franco-algérienne se trouve étendue dans
Zabor ou Les PsaumesetLe peintre dévorant la femme
aux imaginaires oriental et occidental grâce à une forte inscription du mythe, de l’art et
du religieux. Ce dernier étant essentiellement constitué de récits bibliques, de versets
coraniques et de hadiths1.
Multilinguales, 15 | 2021
147
2
Plus qu’un contenu commun aux deux romans, ce sacré détermine la méthodologie
même à mener, à savoir que cette thématique est à l’origine du caractère ambigu de
l’écriture romanesque de Kamel Daoud. En effet, à ses balbutiements, cette écriture se
fait expression politique, un militantisme dirigé contre le religieux jugé être derrière
l’anachronisme culturel, particulièrement dans le monde arabe. Cet énoncé politique
du projet romanesque, apparent, de Kamel Daoud est assumé par l’écrivain, grâce
notamment à ses intrusions fréquentes, qui relèguent au second plan la fiction
narrative. En même temps, ce projet créateur se révèle être une contre-expression du
militantisme entrepris, c’est-à-dire que la spiritualité, qui est par ailleurs érigée en une
cible privilégiée du discours satirique fortement à l’œuvre, devient vecteur d’une
symbiose interculturelle pluridimensionnelle. Ce devenir interculturel du sacré
s’accomplit grâce au dialogue que cette spiritualité entretient avec les composantes
essentielles de l’art, du mythe et de l’écriture.
3
L’analyse de cette ambiguïté romanesque qui spécifie l’écriture des deux romans se fera
en deux parties successives et complémentaires. La première concerne l’énoncé
politique de cette écriture, ce discours idéologique impliquant la moralité de l’écrivain
et sa visée de la refonte culturelle dans le monde arabe. D’où la formule « Le sacré, cible
d’un rabaissement satirique » qui résume cette dimension politique de l’écriture
daoudienne. La seconde partie de l’analyse consistera à démontrer que ce même sacré
s’offre comme une esthétique interculturelle en mouvement. C’est cette transmutation
interculturelle du sacré que résume la formule : « Le sacré, facteur d’une symbiose
interculturelle ». Dans ce qui suit, nous allons d’abord examiner l’allure discursive de
cette écriture puis ses contours esthétiques.
1.Le sacré, cible d’un rabaissement satirique
4
Le volet politique de l’écriture de Kamel Daoud concorde avec la présence massivedes
références religieuses dans
Zabor ou les PsaumesetLe peintre dévorant la femme
. Ce discours s’en tient à ces références religieuses en les rabaissant. Il se trouve, de ce
fait, en grande partie soustrait au voile de la fiction, si bien que l’instance narratrice
cède devant les implications manifestes de l’écrivain-orateur. En rhétorique, cette
stratégie discursive est désignée par le concept de
l’éthos,
c’est-à-dire : « Les traits que l’orateur doit montrer à l’auditoire pour faire bonne
impression ; ce sont ses airs » (Barthes, 1985 : 146). Kamel Daoud agit en orateur dans
son œuvre, il exerce une influence persuasive sur ses lecteurs, en multipliant dans ce
sens ses attaques à l’encontre de l’héritage spirituel en présence. Dans
Zabor ou les PsaumesetLe peintre dévorant la femme
la satire prend sens de cette attitude extrêmement critique.
Multilinguales, 15 | 2021
148
5
Il convient, pour mieux vérifier l’emploi de la satire dans les deux romans de Kamel
Daoud, d’interroger cette notion, d’en préciser l’étymologie. Le mot satire est latin, «
Satira »,
selon Le Petit Robert de la langue française, ce mot renvoie à « Un ouvrage libre de la
littérature latine où les genres, les formes, les matières étaient mêlées et qui censurait
les mœurs publiques » (Le petit Robert de la langue française, 2015 : 2312). La satire
cible une norme axiologique, c’est-à-dire (tout système de valeurs religieuses,
politiques, morales ou sociales). La satire se définit également par sa finalité
pragmatique, en d’autres termes, la stratégie rhétorique, dont elle se sert, vise à
rabaisser la valeur sociale, ciblée, dans l’esprit du public.
6 DansZabor ou Les psaumesetLe peintre dévorant la femme
de Kamel Daoud, c’est sur la norme axiologique du sacré que porte l’expression
satirique de rabaissement. Et cette présence du sacré est signalée dès l’ouverture des
deux romans,
Zabor ou les Psaumes
commençant par un verset coranique « Noun ! Et le calame et ce qu’ils écrivent »
(Daoud, 2017 : 13) ;
Le peintre dévorant la femme
inscrit l’élément religieux de « la pierre noire » qui se trouve à la Mecque « Paris est
une pierre sacrée blanche » (Daoud, 2018 : 9). Les deux récits multiplient au fur et à
mesure de leurs évolutions ces références religieuses en les soumettant à deux
principales formes d’expressions satiriques complémentaires, celle d’une rhétorique
offensante, et celle d’une parodie à la tonalité fortement ironique. Dans ce qui suit,
nous examinerons deux formes principales de cette rhétorique injurieuse, à savoir le
sarcasme et le mépris, ce dernier souvent introduit par des allégories.
1.1. Une rhétorique offensante
7
La rhétorique injurieuse est la principale forme d’expression satirique, militante, chez
Kamel Daoud. Elle est essentiellement sarcastique, et le mot sarcasme étant dit en grec,
son sens étymologique,
sarcasmus
en latin, qui signifie, selon le Petit Robert de la langue française (2015), « Mordre la
chair ». Appuyée sur cette étymologie, l’analyse du ton sarcastique dans l’œuvre de
Kamel Daoud s’associe à un autre concept de la rhétorique, celui de
l’éthos
en ses deux aspects de moralité, ou de vérité que l’auteur prétend détenir, et de mépris
soutenu par un puissant esprit critique. Le premier met en avant le profil moderniste
de Kamel Daoud, ses idées progressistes par lesquelles il exerce davantage d’influence
sur ses lecteurs, à les faire adhérer à sa vision de la culture. C’est pourquoi ce discours
intellectualiste est entaché d’un certain moralisme que trahissent les formules : « Je
m’égare » (Daoud, 2017 : 22)), « Je me perds » (Daoud, 2017 : 17), « J’en suis sûr »
(Daoud, 2018 : p. 83), « J’en ai honte » (Daoud, 2017 : 217).
Multilinguales, 15 | 2021
149
8 L’investissement de l’éthos
moral de l’écrivain est lié au paradigme de la création opposé à celui du sacré tout le
temps vilipendé. Cette création est évoquée par le biais des thèmes sensibles d’une
écriture libre de toute censure morale, de l’art du corps, du cannibalisme, de l’érotisme,
autant de thèmes qui sont mis au service du projet politique, daoudien, de la refonte
culturelle. La visée est toujours celle de chercher des stratégies de mobilisation de
l’auditoire, de stimuler son
pathos,
c’est-à-dire « Les affects de celui qui écoute, tels que du moins l’orateur les imagine »
(Barthes, 1985 : 146). À cet effet, l’entremêlement de l’érotisme et de la culture
constitue l’une de ces stratégies discursives mobilisatrices. En effet, la citation suivante
exprime, selon le point de vue de Kamel Daoud, l’impact que pourrait avoir l’érotisme
sur la culture, et l’écrivain se fait encore plus explicite en assimilant cet érotisme à sa
vision du monde :
L’érotisme est une clef dans ma vision du monde, et de ma culture. Les religionssont l’autodafé des corps et j’aime, dans ce mouvement obscur de la dévoration
érotique, la preuve absolue que l’on peut se passer des cieux, des livres et destemples. L’érotisme est la permanence de l’homme, la preuve que l’au-delà est un
corps que l’on a sous la main et dans le ventre ici et pas ‘’après’’ (Daoud, 2018 : 16).
La jonction établie entre la personne de l’énonciateur et l’érotisme est fortement
marquée. Cette manœuvre procède d’un parti-pris idéologique, à savoir une plaidoirie
en faveur d’une émancipation culturelle en totale rupture avec l’éthique religieuse.
L’érotisme, comme issue possible à l’enfermement culturel, se fait aussi stratégie
carnavalesque, dont parle Mikhaïl Bakhtine, c’est-à-dire l’association du culturel au bas
matériel, au physiologique, au scatologique, au sexuel.
9 L’autreéthos
qui participe à la structuration de l’expression sarcastique, satirique, dans l’œuvre de
Kamel Daoud est celui du mépris. Dans cette autre forme de satire, le référentiel prime
toujours sur le fictionnel, par conséquent la norme axiologique, religieuse, demeure la
cible du discours méprisant à l’œuvre. Doublement représentée, cette norme
axiologique revêt deux formes principales : l’une, explicite par l’évocation directe de la
spiritualité et l’autre, implicite présentée sous la forme d’allégories.
Les entités de Dieu, du destin, du Livre sacré, de la prière et du paradis composent cette
dimension explicite du sacré. Le propos, tenu à l’égard de ces valeurs religieuses, est
fréquent et ouvertement moqueur. Quatre exemples de propos, que nous allons
consécutivement citer, convergent vers un même sens, celui des formules : « Dans le
Livre sacré l’histoire des frères jaloux finit bien pour la victime, mais dans la vie c’est
différent. Dieu manque parfois d’inspiration » (Daoud, 2017 : 41). « Le destin est un
cahier comportant des fautes que l’on peut corriger » (Daoud, 2017 : 112). « Le jugement
n’est pas dernier, il est permanent » (Daoud, 2018 : 10). « Le paradis fait partie de la vie
pas de la mort ! » (Daoud, 2018 : 30). Et le dernier exemple est : « Quand le livre est
sacré l’homme ne l’est plus » (Daoud, 2018 : 32). Ces formules de mépris, qui sont émises
à l’encontre du religieux, se caractérisent par un style lapidaire. En effet, la forme en
slogan de ces énoncés favorise la mobilisation attendue. Par ailleurs, ce mépris se
révèle sous une autre forme, celle de l’allégorisation du sacré qui intègre de nombreux
et divers éléments matériels de la nature.
Multilinguales, 15 | 2021
150
10
L’allégorisation du sacré s’illustre dans les figures matérielles du Sahara, du vent, de la
pierre tombale ou du cimetière, du mouton, du couscous, une diversité d’éléments
hétérogènes qui atteste la place centrale qu’occupe cette thématique dans l’œuvre de
Kamel Daoud. Dans les passages suivants cette matérialité est à la foisgéographique,
atmosphérique, zoologique, pharmaceutique et culinaire : « L’odeur du couscous qui est
une odeur de mort s’infiltre et s’ajoute à celle de l’acide agonie, des médicaments et des
élevages rances des moutons » (Daoud, 2017 : 29). « L’odeur du couscous grasse et
lourde, on le prépare toujours en même temps que le cercueil et la noce » (Daoud, 2017 :
47). « Les cimetières c’est de la friperie. Un débarras d’habits. De l’éternité mal cousue »
(Daoud, 2017 : 48). « Le Sahara avait quatre-vingt-dix-neuf noms lui aussi, et lui aussi
était invisible et colérique » (Daoud, 2017 : p. 68). « Je me suis mis à penser aux vents
que j’ai toujours détestés (le Prophète demande à ce qu’on n’insulte pas le vent, car
c’est un signe de l’esprit » (Daoud, 2017 : 43).
Ce qui n’est pas explicitement dit dans les premières catégories sacrales l’est dans ces
allégories, à savoir l’identification du sacré à la mort. Dans le projet de Kamel Daoud,
cette mort est essentiellement culturelle, et l’orateur en fait un argument mobilisateur.
Du renforcement de son
éthos
moral, en vue de convaincre et de mobiliser, au mépris exprimé, Kamel Daoud pousse à
son paroxysme le discours satirique à l’encontre du sacré. Ce discours se prolonge dans
une autre forme satirique, celle d’un jeu intertextuel.
1.2. Les retournements intertextuels
11
La stratégie intertextuelle adoptée dans l’œuvre de Kamel Daoud est de forme subtile,
atténuée. Les deux romans acquièrent le statut d’hypertexte où se poursuit la
dégradation du corpus coranique, biblique, en tant qu’hypotexte. Dans ce contexte,
Julia Krestiva, se référant au principe dialogique de Mikhaïl Bakhtine, explique ce
phénomène de transformation intertextuelle. Ainsi : « Tout texte se construit comme
une mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d’un autre
texte » (Kristeva, 1969 : 45).
Zabor ou Les PsaumesetLe peintre dévorant la femme
transforment triplement le monothéisme religieux : par la citation aux accents
ironiques, par la transposition thématique et par le travestissement burlesque.
La citation, forme emblématique de l’intertextualité, se manifeste par « La présence
effective d’un texte dans un autre, sous sa forme la plus explicite et la plus littérale
(avec guillemets avec ou sans référence précise » (Genette, 1982 : 8). Si par son
évidence, cette inscription n’exige pas une quelconque perspicacité du lecteur, elle est,
néanmoins, de nature à inciter à s’interroger sur la fonction qu’elle est censée remplir
dans le texte.
Multilinguales, 15 | 2021
151
12
Dans les deux romans précités de Kamel Daoud, qui sont soumis à l’étude, la fonction
assumée par les nombreuses citations religieuses est celle de l’ironie, les citations
imbriquées dans les deux récits est déjà une manière de tourner leur contenu spirituel
en dérision. Vladimir Jankélévitch précise cet usage de la citation en parlant d’ « Une
circonvolution du sérieux » (Jankélévitch, 1964 : p. 58), ou un sérieux tu. Cette
évacuation du sérieux est, par exemple, illustrée dans les versets coraniques suivants :
« Tandis que les poètes sont suivis par les égarés / Ne les vois-tu pas errer dans chaque
vallée…/… et disent ce qu’ils ne font pas ? » (Daoud, 2017 : 24). « Donnez vie à vos
images si vous en êtes capables ! » (Daoud, 2018 : 159). La reprise ironique - par Kamel
Daoud - de ces versets consiste à sous-entendre leurs sens contraires, latents, celui de
l’encensement de l’égarement et de l’errance des poètes dans le premier verset et celui
d’une création artistique libre, aussi scandaleuse soit-elle, dans le second.
13
L’autre procédé de l’altération du sacré est celui de la transposition thématique– celle-
ci étant d’une grande amplitude textuelle, car pouvant s’étendre à tout un texte –qui
touche la signification même de l’hypotexte. Selon Gérard Genette, cette transposition
relève de deux ordres : le premier ordre est diégétique, c’est-à-dire spatio-temporelle,
alors que le deuxième ordre est pragmatique (
de pragmma
qui signifie, selon le petit Robert de la langue française, (2015) « Evénement, action »,
dans ce dernier cas, l’hypertexte modifie l’intrigue ou le cours des événements, de
l’action. Dans les récits de Kamel Daoud, ce déplacement de l’espace, du temps et de
l’action concerne, à titre d’exemple,l’histoire du Prophète Moïse, qui se trouve
transposée dans l’époque contemporaine du terrorisme international. Le propos qui
suit illustre ce cas de figure :
J’imagine donc un autre personnage qui serait né en Occident, ou pas, enfant sanspère ni mère, né du zénith et de la nuit, ou enfant presque illégitime confié aux
courants d’eau, comme Moïse, mais cette fois noyant son peuple. […] Traduire : unenfant de l’histoire immédiate ou un orphelin qui rêve de détruire les généalogies
du monde pour se sentir réparé (Daoud, 2018 : 51).
L’intégration de ce récit médiéval dans l’actualité terroriste et la substitution de l’acte
prophétique de sauvetage – Moïse franchissant la mer par son bâton - par celui profane
de la noyade se double d’une autre défiguration avilissant encore davantage le
religieux, celle de la réincarnation de Moïse dans le personnage « illégitime » cité.
Ainsi, l’amplitude de ces catégories narratives est à la mesure de celle de la
transformation introduite dans ce récit prophétique.
14
Enfin, le travestissement burlesque sert également de biais à l’expression satirique de la
dégradation du religieux chez Kamel Daoud. Ce travestissement s’opère par une
transformation stylistique du texte noble en maintenant intact le sujet de celui-ci. Ce
cas de figure se présente, entre autres, dans la réécriture d’une autre histoire sacrée du
Prophète Abraham, dénommé aussi Hadj Brahim dans le récit
Zabor ou Les Psaumes.
Le rabaissement stylistique réalisé est relatif au sujet noble du sacrifice. En effet, la
citation suivante est une caricature de l’événement sacré en question :
Le mouton avait levé les yeux d’une douceur poignante, avait interrompu sonéternité et s’était éparpillé en mille bêtes destinées à détourner le regard de Hadj
Brahim de ma personne. Pour m’épargner, il s’était donné au patriarche, et m’avaitoffert la puissance de l’écrivain capable de contrer la mort (Daoud, 2017 : 83).
Multilinguales, 15 | 2021
152
En effet, le mouton céleste venu sauver le fils d’Abraham est resté sans modification au
niveau de l’hypertexte. Cependant, le style, dans lequel est relatée cette histoire, est
tout autre que celui du Coran ou de la Bible. Cette trivialisation stylistique du religieux
consiste à personnifier le mouton, ce dernier compatit avec le triste sort d’Ismaël et il
octroie au narrateurle don de l’écriturecréatrice.
15
L’œuvre de Kamel Daoud se fait – du moins à ce stade – discours satirique en vue de
rabaisser le sacré. L’omniprésence de la norme axiologique, religieuse, plaide en faveur
de cette hypothèse de l’essence polémique de l’écriture de Kamel Daoud. Cependant,
limiter cette œuvre romanesque à un simple discours militant, c’est faire passer
promptement sous silence son expression fictionnelle, implicite, brefévacuer
injustement la force créatrice de cette écriture. Saisir donc cette œuvre dans sa
complexité, implique de s’attarder sur sa poétique secrète, de tenter d’appréhender le
devenir fictionneldu sacré. À ce titre, la nouvelle question qui se pose est celle : Qu’en
est-il de la poétique du sacré comme contre-expression du projet militant précédent ?
Cette poétique est un processus textuel où le sacré devient une symbiose
interculturelle.
2. Le sacré, facteur d’une symbiose interculturelle
16
Souvent présenté sous la forme de biographies de prophètes, le sacré se trouve associé
au mythedu salut, présenté comme une exaltation d’actes de délivrance. Ce récit
fondateur de la foi religieuse correspond à ce que le mythologue roumain, Mercia
Eliade, appelle le mythe de l’origine qu’il définit en ces termes : « Une histoire sacrée,
un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des
commencements » (Eliade, 1963 : 15). Dans les deux romans de Kamel Daoud, le temps
primordial est celui des Prophètes, et les récits sont tous ceux du salut.
17
Dans les religions monothéistes, ces histoires sont nombreuses : histoire du prophète
joseph tiré du puits où l’ont mis ses frères jaloux « Le loup l’a mangé, ont dit les frères
au patriarche aveugle et éploré » (Daoud, 2017 : 290) ; histoire du mouton céleste grâce
auquel fut sauvé le Prophète Ismaël, fils d’Abraham ; histoire du Prophète Nouh, ou
Noé, sauvé lui et ses compagnons du déluge ; histoire du Prophète Jonas, ou Younes,
allant à la rencontre de Dieu « Qui s’est manifesté à lui sous la forme d’un navire
ancien, d’une tempête haineuse, de marins, puis d’une baleine, puis d’un arbre qui
donne son ombre au corps nu du naufragé » (Daoud, 2017 : 248), etc. Tissé sur la toile de
fond du mythe salvateur élargissant le dialogue entre contes, arts et écritures, le projet
esthétique de
Zabor ou Les PsaumesetLe peintre dévorant la femme
recrée ce substrat sacral du salut en une symbiose interculturelle. Les contes
Mille et Une NuitsetRobinson Crusoé,
qui constituent la première section du deuxième axe de notre article, participent à
cette dynamique interculturelle. C’est cette autre dimension dialogique qui sera
examinée.
Multilinguales, 15 | 2021
153
2.1. Robinson Crusoé et Mille et Une Nuits
18 La relation dialogique entre lesMille et Une NuitsetRobinson Crusoé
de Daniel Defoe paraît dans le triomphe de l’imagination créatrice sur la mort qui
spécifie ces deux contes. Les
Mille et Une Nuits
mettent en scène un antagonisme entre deux forces, celle d’une parole conteuse
s’ingéniant à inventer toujours mieux, pour mieux « Justifier la méfiance du roi cocufié
[Shahrayar] envers les femmes » (Bencheikh, 1988 : 29) et celle d’une exécution
menaçant de s’effectuer au moindre tarissement de la parole en exercice. Shahrazade
vainc la mort, elle humanise le roi et devient, au terme de cette périlleuse aventure, son
épouse. Elle se sauve donc, sauve d’autres femmes, et c’est, en définitive, en un modèle
féminin sacré aux pouvoirs créatifs, illimités, que cette héroïne s’érige dans
l’imaginaire oriental.
Robinson Crusoé
est l’histoire d’un naufragé, un Robinson se trouvant sur une île sans trace humaine ni
repère culturel, sauf la bible lui servant à la fois de consolation et de source
d’improvisation de quelque forme de vie sur l’île. À l’instar de Shahrazade, Robinson
doit vaincre la mort, mettre à rude épreuve son imagination à même d’apprivoiser cet
univers sauvage et inhospitalier de l’île, d’y faire naître la vie.
19
De ces contes, où la vie mime constamment la mort, Kamel Daoud en fait une
métaphore interculturelle. En effet, l’enjeu dépasse les deux contes (dans l’un, sauver
une femme face à un roi féminicide et un homme perdu sur l’île dans l’autre), il s’agit
de sauver la culture, lui trouver d’autres attaches plus flexibles avec le religieux ; d’où
le biais du conte qui n’est, à ce titre, qu’une stratégie qui vise la réparation culturelle
envisagée. Dans cette veine, toutes les citations du récit
Zabor ou Les Psaumes,associées auxMille et Une Nuits,
mettent en avant la culture arabesymbolisée parle village fictionnel d’« Aboukir »,
« Centre du monde situé entre mon nombril et mon cœur » (Daoud, 2017 : 15).
20
La langue arabe occupe aussi une place privilégiée dans ce projet culturel ; elle est
décrite dans toute son inertie, tout à l’opposé de la parole vivifiante des
Mille et Une Nuits
. Dans le récit de Kamel Daoud, cette parole est assumée par le personnage de Hadjer, la
tente du narrateur : « Elle repousse ta décapitation par ses Mille et Une Nuits
improvisées, sa verve et sa ruse » (Daoud, 2017 : 144). Or si telle est la langue fertile du
conte, la langue arabe, telle que pratiqué dans le village précité, « Il [lui] manquait le
rêve, le mystère du conte comme je le comprenais plus tard. Nous étions un pays
récemment libéré de la colonisation et les mots se faisaient soldats » (Daoud, 2017 :
144). La formule« les mots se faisaient soldats » résument le figement de la langue et de
la culture arabes. Inspiré des
Mille et Une Nuits,
le besoin de créer une langue vivante est exprimé par une métaphore interculturelle,
vive, celle d’un livre à écrire par une combinaison aléatoire de tous les autres. Cette
réalisation inclut tout le sens du rêve et du mystère qui font la force du conte. La
biographie du narrateur est quasi-identique à ce livre en devenir. En voici un
fragment :
Multilinguales, 15 | 2021
154
Il y a quelques années après mon passage par l’école coranique, j’en ai accentué ledésordre en décollant les couvertures de certains pour les coller sur d’autres, créant
ainsi un brouhaha insonore, un amalgame qui augmente la combinaison possibledes textes et de leur sens. Une sorte d’autodafé inédit, démiurge. Comme si je jetaisles romans en l’air et qu’ils retombaient riches de nouvelles pistes, par le hasard de
rencontres et de collisions entre titres vierges et récits orphelins (Daoud, 2017 :196).
L’improvisation ingénieuse desMille et Une Nuits
devient la démarche créatrice par laquelle s’accomplirait le livre à venir, de son sens
tout neuf issu d’autres livres se recombinant. En filigrane de ce procédé créateur,
interculturel, se profile la démarche surréaliste de jeux collectifs, dit « cadavre
exquis », ou d’écriture automatique qu’André Breton définit comme « Le
fonctionnement réel de la pensée » (Breton, 1920 : 42) Cette méthode tiendrait lieu
d’instrument de reconstruction interculturelle, à la manière du surréalisme et des
Mille et Une Nuits.
21 DansRobinson Crusoé,
ce projet interculturel, qu’incarne la mosaïque de livres en perpétuelle recomposition,
contraste avec la phrase répétitive du perroquet Poll, celle « Pauvre Robinson où es-
tu ? ». À la différence de la dynamique interculturelle de livres s’entremêlant,
cettephrase statiqueserait synonyme d’une stagnation culturelle. Dans la citation
suivante, un lien est établi entre cette phrase de Poll et les textes sacrés qui sont
également immuables et répétitifs :
Peut-être que nos langues n’avaient aux yeux du dieu déserteur que le sens d’uneseule phrase réitérée sans cesse depuis des millénaires, recomposée à l’infini ? Peut-
être que le village où je vivais n’était qu’une île renfermée et sourde que j’étaischargé de libérer par de longs récits et l’apprentissage d’une langue plus vaste, plusvigoureuse, plus proche du naufragé que de ses perroquets qui tournaient en rond.
(Daoud, 2017 : 156).
À l’enfermement culturel s’oppose l’urgence interculturelle de faire « L’apprentissage
d’une langue plus vigoureuse », d’écrire-libérer de longs récits, comme projet
interculturel salvateur qui fait écho au mystère et au rêve propre à la parole conteuse,
toute aussi salvatrice des
Mille et Une Nuits
. Cette langue essentiellement créatrice est celle, par exemple, qui mêle dans les deux
romans de Kamel Daoud les écritures romanesque et ésotérique. C’est ce que nous
allons analyser dans la seconde section du deuxième axe
.
Multilinguales, 15 | 2021
155
2.2. Ecriture romanesque et écriture ésotérique
22
L’hybridité de l’écriture de Kamel Daoud est l’aboutissement d’une forme
interculturelle particulière, qui est générée par la fiction du salut. L’intrigue de
Zabor ou Les Psaumes
s’offre elle-même en exemple de ce type de fiction. En effet, de bout en bout du récit,
l’acte de narration se confond avecl’acte de sauvetage salvateur, et le narrateur
s’adossant tour à tour la mission de l’écriture pour faire reculer la mort dans son
village : « Quand j’utilise les bons mots, la mort redevient aveugle et tourne en rond »
(Daoud, 2017 : 19). Mais pour être pleinement salutaire, cette écriture doit se déployer
en dehors, voire à contrecourant du Livre sacré. À cet égard, le propos du narrateur est
sans équivoque : « Je pouvais sauver une vie et congédier la mort en écrivant autre
chose que leurs versets et les quatre-vingt-dix-neuf noms de Dieu » (Daoud, 2017 : 31).
Improviser des formes d’écritures à l’écart du cadre légitimiste du Livre sacré aboutit à
une prolifération d’écrits libres grâce auxquels bien des vies furent arrachées à la mort,
dont celle de Hadj Brahim, le père du narrateur, le plus longuement assisté par une
telle thérapie scripturaire.
23
La fusion des écritures romanesque et ésotérique, qui contribue au renforcement du
processus interculturel dans les deux romans de Kamel Daoud, s’effectue sur le fond de
l’autobiographique. En effet, le narrateur évoque son enfance et son expérience de
l’apprentissage coranique. Le narrateur-adulte qui raconte cette phase sensible de sa
vie y demeure encore fortement attaché, ce qui serait une manière à lui de revendiquer
cette Tradition. La citation suivante illustre clairement cet attachement :
J’adorais humer l’odeur de l’argile qui nous servait à enduire le bois pour leblanchir et accueillir les nouveaux versets. […]L’odeur moisie du sansal, l’argile,
sont des laines brûlées sont restées pour moi comme le parfum d’un mystère. Et sile Livre sacré était parfois ennuyeux pour l’enfant que j’étais, avec des mots
impossibles à comprendre, des hurlements et des récits trop épars pour accrocherl’imagination, j’aimais méditer longuement sur les premiers mystères. (Daoud,
2017 : 223).
Comme l’atteste clairement la dernière formule « comme l’écriture sous mes yeux cela
devrait avoir un sens », l’ésotérisme est la matrice sur laquelle s’élaborent les contours
de l’écriture romanesque. La perméabilité du romanesque, sa disposition à intégrer
d’autres genres en les remodelant, c’est la définition même qu’en donne Marthe Robert,
lorsqu’elle souligne la capacité du genre romanesque à « S’emparer de secteurs de plus
en plus vastes de l’expérience humaine » (Robert, 1972 : 15). Dans le cas de
Zabor ou Les Psaumes,
cette expérience humaine est celle de l’expérience enfantine aux fortes prises avec
l’ésotérisme que le romanesque s’associe. En réinventant l’ésotérisme par le
romanesque, Kamel Daoud élargit son esthétique interculturelle, celle-
cicommereconfiguration permanente du mythe du salut.
24
Cette esthétique interculturelle salvatrice, qui fait figure d’un ésotérisme romancé,
prend l’allure d’undésordre scripturaire. Celui-ci est à l’image du mystère qui fonde la
syntaxe ésotérique. Le passage suivant met l’accent sur le caractère irréductiblement
énigmatique de cette écriture :
Multilinguales, 15 | 2021
156
Noun ! Et le calame et ce qu’ils écrivent, dit le Livre sacré. Le roseau taillé commeun stylet, plongé dans l’encre du plus vieil océan. […] Je voulais juste déplier ce livre
d’une seule page […] Et tout ce que je pus y lire, ce fut une écriture folle,désordonnée, dense comme une toison secrète, emmêlé de signes, de chiffres et
d’exclamations, ponctuée d’astres et d’étoiles sommaires, incompréhensible commeun ciel constellé (Daoud, 2017 : 189).
Ainsi décrit, l’ésotérisme favorise la création par le biais de laquelle se renouvelle le
processus interculturel dans l’œuvre de Kamel Daoud. Cette écriture ésotérique ne se
présente pas dans un ordre syntaxique fixe et rigoureusement codifié, mais comme une
recombinaison de signes hétérogènes, qui en rendent insaisissable le sens. C’est cette
opacité, à la fois lexicale et sémantique, qui est derrière la transposition de l’ésotérisme
dans le genre romanesque. Enfin, nous parachevons ce processus textuel de la
transmutation interculturelle du sacré, en analysant, à présent, deux autres formes
artistiques, en symbiose, celles du nu pictural et de la calligraphie arabe. Ces dernières
constituent la troisième section du deuxième axe de notre étude.
2.3. Nu pictural et calligraphie
25
Le nu de Picasso et la calligraphiearabefont de la représentation du corps, celui féminin
en particulier, une issue au figement culturel dans le monde arabe. À l’instar des
Mille et Une Nuitset de la « Robinsonnade »2,
ces arts se trouvent dans la même relation mimétique avec la mort, car faisant face au
triomphe de l’Invisible, à la résistance d’un imaginaire collectif, hostile. De ce fait, ces
arts s’inscrivent en droite « Des icônes de l’ancien ordre païen », dit en transposition de
l’arabe au français «
Timthal »,
(Daoud, 2018 : 159), et donc perçues comme une « Hérésie ou idolâtrie » (Daoud, 2018 :
159). Il en résulte que ces œuvres d’art sont à détruire, comme ce fut le cas de « La
statue de Sétif de Francis de Saint-Vidal datant de 1898 […], dynamitée en 1997 par les
groupes islamistes » (Daoud, 2018 : p. 156).
26
Une fois de plus, Kamel Daoud fait de cet art du nu une autre métaphore interculturelle
en fusionnant deux corps féminins, celui sacré de Houri, « Cette femme promise après
la mort » (Daoud, 2018 : 10) et celui profane de Marie Thérèse, « Une jeune femme de
dix-huit ans que Picasso rencontre au hasard à Paris en janvier 1932 » (Daoud, 2018 :
33). Inscrit encore dans la dialectique de la vie et de la mort, le nu artistique étend la
quête du salut interculturel à l’acte primordial de la création divine souvent évoquée
sous la formule « L’atelier argileux » (Daoud, 2018 : 22). Le corps pictural composite de
« Marie-Houri » met en vis-à-vis deux visions du monde manifestement divergentes,
l’Au-delà et l’Ici-bas respectivement incarnés par chacune de ces deux figures
féminines. La fusion de celles-ci, dans un seul portrait artistique, signifie aussi
concordance des deux imaginaires, celui de la mort (Au-delà) et de la vie (Ici-bas), un
jumelage que résume le propos de « Marie Thérèse est peinte comme une houri, mais
avant la mort » (Daoud, 2018 : 149).
27
Cette peinture consacre ainsi le rapprochement entre deux cultures d’orientations
différentes, un dialogue interculturel atténuant par une telle démarche artistique la
projection de l’imaginaire musulman dans la vie
post-mortem
Multilinguales, 15 | 2021
157
, et la projection de l’imaginaire occidental dans la vie Ici-bas. L’allégorie du corps
féminin n’est pas la seule manière, indirecte, de faire dialoguer les deux imaginaires
évoqués. L’introduction decedialogue se fait également sans détour, en mettant côte à
côte le religieux et l’art de la peinture, une symbiose interculturelle métonymiquement
indiquée par « le verset » et « le pinceau » dans la citation suivante : « Cette “tradition
” me fascine. Elle mêle sans le savoir la peinture au verset, le coup de pinceau à la
mort » (Daoud, 2018 : 154). L’interaction verset / peinture, pinceau / mort révèle, selon
les termes de cette citation, l’inscription de l’interculturel dans l’acte créateur, divin,
primordial.
28
Le mixage des cultures orientale et occidentale s’accentue par le biais de la calligraphie
arabe décrite dans l’œuvre de Kamel Daoud comme une pratique biaisée du nu
artistique. Une identité artistique, commune, confirmée par Picasso lui-même en
qualifiant la calligraphie en question d’ « Art érotique sublimé » (Daoud, 2018 : 162).
Née dans la culture musulmane, la calligraphie se fait art qui ruse en permanence avec
l’interdit religieux, une expression travestie de ce que cette culture encore rattachée au
religieux empêcherait d’être. Cette souplesse culturelle est défendue par Fatima
Mernissi, la sociologue marocaine spécialiste de la pensée islamique, en affirmant que
« Contrairement à l’idée reçue, l’Islam possède une riche tradition de peintures
profanes, et qu’il ne condamne les images figuratives que dans le domaine religieux »
(Mernissi, 2001 : 21). Poussée à son expression extrême chez Kamel Daoud, puisque
directement reliée au nu de Picasso, cette calligraphie prend la forme d’une expression
alambiquée de la chair, que par ailleurs l’art du nu représente plus directement. La
citation qui suit illustre ce cas de figure :
La calligraphie a lentement au fil des siècles pris les traits du nu désincarné etréincarné, la langueur, l’allongement, l’exposition de la toison et de l’érection, du
sein et de la courbe, du pubis et du point. Elle se fait clandestinité publique,exposition aveuglante, ruse du corps dans le demi-mot (Daoud, 2018 : 163).
La définition de la calligraphie comme expression déformée du nu artistique atteste le
point culminant d’harmonisation des civilisations occidentale et orientale, cette
dernière demeure encore sous l’influence de l’Islam. La stratégie inter-artistique ainsi
mise en œuvre à l’œuvre renforce significativement l’esthétique interculturelle,
multiforme, dans les deux romans de Kamel Daoud.
29 En guise de conclusion, il nous semble avoir mis au jour la complexité de l’écriture de
Zabor ou Les PsaumesetLe peintre dévorant la femme
de Kamel Daoud.Nous y avons décelé deux formes d’expressions, contradictoires,
cellemilitante, satirique, qui rabaisse en permanence le sacré, et celle créatrice, qui
transforme ce sacré en une symbiose interculturelle. Dans ce sens, le rapprochement
des imaginaires oriental et occidental par le biais du dialogue inauguré entre les arts,
les contes et les écritures imprègne le projet interculturel de Kamel Daoud. Ce projet
interculturel, salvateur, ainsi investi, inscrit dans la durée la réflexion de Mouloud
Mammeri, celle relative au sort réservé - à l’ère contemporaine particulièrement
marquée par l’uniformisation et l’hégémonisme - aux anciennes cultures. En effet,
Mouloud Mammerise demande si : « Dans la culture barbare, que nous exécutons d’une
giclée de canon dédaigneuse, n’y avait-il pas une formule de notre salut » (Mammeri,
1973 : 16). En définitive, ce débat culturel se poursuit avec encore plus de
détermination dans les écrits récents d’Amine Zaoui, un autre écrivain algérien
d’expression arabe et française. Ses deux essais intitulés :
La boîte noire de l’islam. Le sacré et la discorde contemporaine(2018) et
Multilinguales, 15 | 2021
158
Dieu n’habite pas la Mecque. Pour une déconstruction du sacré
(2019) inscrivent résolument la thématique du sacré dans la dynamique interculturelle
en cours.
BIBLIOGRAPHIE
BARTHES, R., « L’ancienne rhétorique : aide-mémoire », inL’aventure sémiologique,
Paris, Seuil, 1985.
BENCHEIKH, J.,Les Mille et Une Nuits ou la parole prisonnière,Paris, Gallimard, 1988.
BRETON, A.,Manifeste du surréalisme,Paris, Gallimard, 1970.
DAOUD, K.,Le peintre dévorant la femme,Alger, Barzakh, 2018.
DAOUD, K.,Zabor ou Les Psaumes,Alger, Barzakh, 2017.
ELIADE, M.,Aspects du mythe,Paris, Gallimard, 1963.
GENETTE, G.,Palimpsestes. La littérature au second degré.Paris, Seuil, 1982.
JANKELEVITCH, V,L’ironie,Paris, Flammarion « Champs », 1964.
Le petit Robert de la langue française, Edition 2015.
MAMMERI, M.,La mort absurde des Aztèques,Paris, Librairie Académique Perrin, 1973.
MERNISSI, F,Le Harem et l’Occident,Paris, Albin Michel, 2001.
ZAOUI, A.,Allah n’habite pas la Mecque. Pour la déconstruction du sacré,Alger, Tafat, 2019.
ZAOUI, A.,La boîte noire de l’Islam. Le sacré et la discorde contemporaine,Alger, Tafat, 2018.
NOTES
1. Le hadith est « un recueil des actes et paroles du prophète Mohammed. Dans le courant sunnite
les hadiths complètent le Coran », Le petit Robert de la langue française, Edition 2015, p. 1209.
2. « La Robinsonnade est un genre littéraire, mais aussi cinématographique, qui tient son nom de
Robinson Crusoé, roman de Daniel Defoe publié en 1719. La Robinsonnade est parfois considérée
comme un sous-genre du roman d’aventures (ou du film d’aventure). Le terme a été créé et utilisé
pour la première fois en 1731 Par l’écrivain allemand Johann Gottfried Schnabel », https://
fr.m.wikipedia.org/wiki/l
Multilinguales, 15 | 2021
159
RÉSUMÉS
L’écriture des romansZabor ou Les PsaumesetLe peintre dévorant la femme
de Kamel Daoud revêt un caractère équivoque, un projet créateur écartelé entre une expression
militante amplement satirique et une orientation interculturelle esthétiquement travaillée. En
apparence, cette écriture se présente sous la forme d’un discours satirique qui cible le sacré, soit
en tenant un discours offensant, sarcastique, soit en se livrant à un jeu intertextuel marqué par le
travestissement burlesque, la transposition thématique et la citation ironique. En filigrane, cette
écriture est également une esthétique dans laquelle le sacré se transmue en un dialogue
interculturel, qui vise à harmoniser les imaginaires oriental et occidental. Ce dialogue des
cultures est sous-tendu par la fusion des arts du nu pictural et de la calligraphie arabe, de la
robinsonnade et des
Mille et Une Nuits,du genre romanesque et de l’ésotérisme de la mystique musulmane.
The writing of the novels Zabor or The Psalms and The Painter Devouring the Woman by Kamel Daoud
takes on an equivocal character, a creative project torn between an amply satirical militant
expression and an aesthetically crafted intercultural orientation. Apparently, this writing takes
the form of a satirical discourse that targets the sacred, either by either by holding an offensive,
sarcastic discourse, or by engaging in an intertextual game marked by the burlesque disguise, the
thematic transposition and the ironic quote. Implicitly, this writing is also an aesthetic in which
the sacred is transmuted into an intercultural dialogue which aims to harmonize the Eastern and
Western imaginations. This dialogue of cultures is underpinned by the fusion of the arts of the
pictorial nude and Arabic calligraphy, of the robinsonnade and One Thousand and One Nights,
the novelistic genre and the esotericism of Muslim mysticism.
INDEX
Keywords : sacre, satire, creation, intercultural, Kamel Daoud
Mots-clés : sacré, satire, création, interculturel, Kamel Daoud
AUTEUR
SMAIL MAHFOUF
Université de Bejaia
Multilinguales, 15 | 2021
160