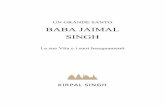Baba Yaga en chair et en os - OpenEdition Journals
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Baba Yaga en chair et en os - OpenEdition Journals
Revue Sciences/Lettres
4 | 2016Baba Yaga en chair et en osDes contes slaves aux incarnations contemporaines
Juliette Drigny et Sandra Pellet (dir.)
Édition électroniqueURL : http://journals.openedition.org/rsl/906DOI : 10.4000/rsl.906ISSN : 2271-6246
ÉditeurÉditions Rue d'Ulm
Référence électroniqueJuliette Drigny et Sandra Pellet (dir.), Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016, « Baba Yaga en chair et en os »[En ligne], mis en ligne le 16 janvier 2016, consulté le 09 mars 2020. URL : http://journals.openedition.org/rsl/906 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rsl.906
Ce document a été généré automatiquement le 9 mars 2020.
© Revue Sciences/Lettres
SOMMAIRE
ÉditorialJuliette Drigny et Sandra Pellet
Théories et concepts
La Baba Yaga sur la route vers l’autre monde : une rencontre cruciale pour le héros du conteNatacha Rimasson-Fertin
La Baba Yaga et les autres personnages surnaturelsdu conte merveilleux. Forment-ils unsystème ?Lise Gruel-Apert
Une consommation marchandée : le cannibalisme comme dispositif d’échange et detransformationchez Baba YagaJane Sinnett-Smith
Baba Yaga pourra-t-elle jamais être belle et bonne ?Magdalena Cabaj
Sorcière ou nourricière : la Baba Yaga à l’épreuvede la pensée psychanalytiqueCécile Rousselet
Baba Yaga, les sorcières et les démons ambigusde l’Europe orientaleStamatis Zochios
Portrait d’une Baba Yaga polonaiseKatia Vandenborre
Baba Cloantza, la Yaga édentée du folklore roumainSimona Ferent
Pratique de la recherche
Baba Yaga dans les louboksGalina Kabakova
Baba Yaga sur l’écran soviétiqueMasha Shpolberg
Le double jeu de la Baba Yaga : effets psychiqueset socioculturels d’une performancethéâtrale contemporaineSibylle Lesourd
Baba Yaga contée : la voix en acteEntretien avec la conteuse Ariel Thiébaut, mené par Raísa França BastosRaísa França Bastos et Ariel Thiébaut
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
1
ÉditorialJuliette Drigny et Sandra Pellet
1 « Pouah, pouah, pouah ! ça sent la chair russe ! » À l’approche du héros ou de l’héroïne,la Yaga-jambe-d’os, sorcière des contes populaires slaves, hume son odeur de vivant. Lepassage par son isba correspond toujours à un moment décisif de la quête du héros,celui où il quitte le village et la nature apprivoisée des champs avant d’entrer dans la« forêt profonde » ou « le monde du Tchoudo-Youdo » tapissé d’ossements. L’isbareprésenterait, d’après la célèbre analyse qu’en a faite Vladimir Propp dans Les Racineshistoriques du conte merveilleux, un passage, une frontière entre le monde des vivants etle mystérieux monde des morts. Mi-objet, mi-animal, l’isba montée sur pattes de poulese déplace lorsque le héros prononce la formule magique. Elle-même figure liminaire,Baba Yaga possède, en haut, un buste de chair et de sang et, en bas, une unique jambed’os.
2 Cette frontière entre vie et mort a été le point de départ de nombreuses recherchesdepuis Propp, ainsi que celui du colloque interdisciplinaire « Baba Yaga et son isba,analyse pluridisciplinaire du personnage mythique des contes populaires russes »,organisé par l’association LETAP avec l’appui de l’ENS et de Paris Sciences et Lettres les16 et 17 janvier 2015. Ce colloque s’est inscrit dans le cheminement intellectuel etartistique mené par l’association LETAP sur le thème des contes russes revisités1.
3 Le numéro que nous présentons ici poursuit les questionnements du workshop BabaYaga (2013-2014) et ouvre à d’autres réflexions grâce à de nouvelles perspectivesgéographiques (l’archétype de la Yaga se retrouve en Roumanie, en Pologne et jusqu’enSerbie) et grâce à de nouvelles sources et de nouveaux matériaux (incantations,poèmes, films, gravures, pièces de théâtre). On le voit, l’influence de Baba Yaga dépasselargement les frontières du conte russe, tant son symbolisme est universel.
4 Natacha Rimasson-Fertin nous attire la première à l’orée du bois et mène une quêterigoureuse d’indices spatiaux en vue de comprendre la « géographie » des contes russeset la particularité de l’espace propre aux babas Yaga. À travers ce voyage, c’est lafonction de garde-frontière entre monde des vivants et monde des morts qui se dessine.
5 La baba Yaga n’est pas seulement plurielle, voire « plurifonctionnelle », elle est aussi unpersonnage parmi les autres archétypes dans la pièce que joue presque à chaque fois le
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
2
conte. Elle n’est jamais l’héroïne, elle est rarement l’adversaire. Elle prend place dansun système, une structure, où, malgré les nombreuses variantes, chacun joue un rôle etentretient des relations relativement stables, prédéfinies. Lise Gruel, grande spécialistedes contes populaires et plus généralement du folklore russe, décrit et analyse cesrelations entre les personnages surnaturels récurrents.
6 Revenons à la Yaga elle-même, vieille, aigrie et vilaine. Mais en a-t-il toujours étéainsi ? Magdalena Cabaj interroge ces trois caractères en explorant la piste de Proppselon laquelle la vieille sorcière des contes serait l’héritière de la déesse-mère d’unereligion ancestrale, dans le cadre d’une société encore matriarcale. Un avatar de cettedéesse « dégradée » apparaîtrait sous une forme ridiculisée, détournée, dans latradition orale, une fois les croyances auxquelles elle appartient rendues obsolètes parl’instauration d’un nouvel ordre patriarcal. La Yaga, réinterprétée au prisme du« mouvement de la déesse » aux États-Unis, pourrait ainsi faire figure de proue d’unféminisme renouvelé.
7 Jane Sinnett-Smith s’attelle à la compréhension profonde du statut de la Yaga cannibaledans les contes : ce point de non-humanité permet, par contraste, à la société quiraconte le conte de se définir comme société humaine. De la même façon, le systèmed’appropriation propre à la Yaga situe la « communauté humaine » du côté del’échange réciproque, qu’il soit sous la forme du don/contre-don, du troc ou del’échange marchand.
8 Si la Yaga est un personnage incontestablement investi de tous les fantasmes dedévoration et de castration des lecteurs, enfants et adultes, mis en évidence par lapsychanalyse des contes, elle est aussi, selon Cécile Rousselet, un personnage « troué »,incomplet et mystérieux qui permet à l’imaginaire personnel créatif de s’y infiltrerlibrement. La menace mortifère de dévoration qu’elle représente, par effet de miroirdéformant, est là pour mieux pointer du doigt la véritable menace orale, celle de lamère qui retient son enfant, dans un lien fusionnel, malsain pour son développement.La Yaga, agent de l’autonomisation de l’adolescent ?
9 Après ces premières interprétations qui s’aventurent pour ainsi dire en profondeurdans la structure du conte, les articles suivants explorent l’étendue spatiale de laYaga et de ses différentes facettes.
10 Stamatis Zochios se livre à un relevé comparatiste des différents motifs et personnagessurnaturels des folklores centre-européens (au-delà des contes, ceux des incantations,légendes, superstitions). Certains se retrouvent dans toutes les cultures sous différentesformes et montrent une proximité avec la Yaga slave : la vieille, la femme qui file, lastrige, la femme-serpent, les esprits de la forêt et leur pouvoir sur les éléments de lanature.
11 Personnage aux origines lointaines et probablement issu de la mythologie slave, la Yagase retrouve dans les contes polonais. Katia Vandenborre nous narre cette Baba Jędza ettente d’expliquer sa présence et son succès en Pologne, à une époque de subordinationà l’Empire russe. Ne témoigne-t-elle pas de la nécessité de reconstruire l’identiténationale par un « retour aux sources » et peut-être de la slavophilie ambiante, ducollecteur et des lecteurs ?
12 Simona Ferent nous emmène quant à elle dans l’univers folklorique et littéraireroumain. Elle étudie la Yaga roumaine, Baba Cloantza, et ses nombreux avatarssymboliques (projections symboliques, identités, significations, rôles, figurations,
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
3
représentations symboliques) non seulement dans les contes mais dans lessuperstitions et croyances des paysans roumains et dans de longs poèmes et ballades duXIXe siècle. Cette formidable baba roumaine est elle aussi investie de rôles et defantasmes aussi variés que celui, pragmatique, de guérisseuse du village, de sorcièrediabolique, d’ensorceleuse, et jusqu’à la représentation de la mort elle-même.
13 Ainsi, la Yaga d’un point de vue historique, symbolique, psychologique,anthropologique, a attiré et attire toujours l’intérêt de nombreux chercheurs, tant safigure liminaire donne à penser. Dans une seconde partie du numéro nous donnons lamain à des chercheurs et praticiens du conte afin d’appliquer ces clés de lecture et dedécoder des supports variés, gravures, films, pièces, de différentes périodes historiquesoù apparaissent la Yaga.
14 Les gravures russes du XVIIIe siècle, les louboks, donnent à Galina Kabakova l’occasiond’une réflexion nouvelle sur les origines diaboliques attribuées à la Yaga, à partir d’unmatériau original qui change des contes collectés par Afanassiev.
15 En s’appuyant sur quatre films soviétiques des années 1930-1970, Masha Shpolbergexplique la réémergence du conte, après son bannissement dans les années 1920, et soninstrumentalisation politique à but nationaliste. Elle analyse l’évolution du personnagede Baba Yaga au cours des films, en fonction des changements politiques et sociétaux.De source du mal, diabolisée, elle perd sa puissance et n’inspire plus la peur, jusqu’àdevenir la sympathique marraine du héros.
16 Une représentation théâtrale de Vassilissa-la-très-belle très innovante, comparable auxexpériences d’immersive Theater, est analysée par Sibylle Lesourd. La compagnie desBriciole prend au pied de la lettre le rôle initiatique du conte et « capture » une fillettedu public pour jouer la Vassilissa.
17 Enfin, après ces détours théoriques et esthétiques, nous redonnons la parole aux conteseux-mêmes et à leur « praticien », le conteur. Raísa França Bastos interroge la conteuseAriel Thiébaut sur sa pratique du conte, son lien au public, et sur la façon dont sonchemin a croisé celui de la Yaga.
18 Nous espérons que ce tour d’horizon interdisciplinaire vous aura permis de découvrirles mille facettes du personnage de Baba Yaga et la richesse des contes populairesrusses. Leur fécondité artistique, leur intérêt littéraire et même social ne se démententpas à travers les lieux et les âges.
NOTES1. Page du colloque : http://www.fabula.org/actualites/baba-yaga-et-son-isba-analyse-pluridisciplinaire-du-personnage-mythique-des-contes-populaires_63801.php. Site du workshopBaba Yaga: http://workshopbabayaga.wix.com/bbyg#!projet/c10fk.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
4
AUTEURS
JULIETTE DRIGNY
Juliette Drigny, agrégée de lettres modernes, doctorante à l’université Paris-Sorbonne enlittérature française, est l’auteur de « Le sens de la parole dans les contes russes de la BabaYaga », article de l’ouvrage collectif Baba Yaga. Workshop (LETAP), publié par les Éditionsl’Imprimante (2014).
SANDRA PELLET
Sandra Pellet, doctorante et enseignante à l’université Paris-Dauphine en sciences économiqueset sociales, est à l’initiative du Workshop Baba Yaga (2013) et est l’auteur de « Baba Yaga : témoinou gardienne des “institutions” pré-chrétiennes en Russie occidentale et orientale ? », article del’ouvrage collectif Baba Yaga. Workshop (LETAP), publié par les Éditions l’Imprimante (2014).
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
5
La Baba Yaga sur la route versl’autre monde : une rencontrecruciale pour le héros du conteNatacha Rimasson-Fertin
Introduction
1 Si tout lecteur familier des contes russes a parfaitement présent à l’esprit l’apparencede la fameuse petite isba sur pattes de poule qui sert de domicile à la Baba Yaga, lalocalisation précise de celle-ci semble moins aisée au premier abord, ne serait-ce queparce qu’elle varie selon les récits.
2 En nous appuyant sur le corpus des contes d’Afanassiev, nous partirons des lieuxpropres au conte merveilleux1 pour y situer plus précisément la demeure de cepersonnage aussi emblématique qu’énigmatique qu’est la Baba Yaga. Le but sera detenter de mieux cerner sa fonction et son identité véritables, à la fois pour le hérosvoyageur et pour l’auditeur-lecteur de ces contes. C’est ainsi qu’Anna-NatalyaMalakhovskaya, auteur de l’une des dernières monographies consacrées à la Baba Yaga,s’interroge : « Mais qui la Baba Yaga était-elle vraiment2 […] ? »
3 Une première étape de notre cheminement s’attachera à resituer la Baba Yaga et sademeure dans l’univers du conte en accordant une attention particulière aux lieuxtraversés par le héros. Car même si le genre du conte est caractérisé par son « refus dedécrire le trajet3 », son « refus de donner [de l’espace] une description épique4 […] », onparvient tout de même à relever, d’un récit à l’autre, des détails qui, une fois associés,finissent par composer une certaine image de cet univers imaginaire. La question peutdonc être posée de la manière suivante : quelle place revient à la Baba Yaga dans lareprésentation du monde propre au conte ? Nous examinerons ensuite cette isba et cequi s’y passe, avant de nous interroger sur le sens à donner à ces événements, et, plusgénéralement, sur la portée de ces récits.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
7
1. Le lieu de la rencontre avec la Baba Yaga : lafrontière avec l’autre monde
4 Avant d’aborder les textes mettant en scène des héros voyageurs, disons deux mots desrécits faisant allusion à l’intrusion de la Baba Yaga dans le monde des hommeslorsqu’elle vient enlever un enfant. À la différence des contes bâtis sur un voyage, lesrécits comme « Ivachka » (NRS 108-111) ou « Les oies sauvages » (NRS 113) ne situentpas l’habitat de la Baba Yaga dans un autre monde, mais « tout près de l’habitat deshommes : au bord de la rivière, dans la forêt proche où les héros vont simplementchercher des champignons5. » Sa maison n’a d’ailleurs pas l’allure qu’on lui connaîthabituellement et s’apparente davantage à une simple isba.
1.1 Le voyage : un état d’exception
5 Les motivations de la quête des héros (ce terme était pris au sens large) voyageurs sontmultiples6 et mériteraient une étude à part. Les grandes tendances en sont lessuivantes : dans le cas des héroïnes, il s’agit toujours d’une délivrance et, pour les hérosmasculins, de la délivrance ou de la quête d’une fiancée, à parts égales.
6 Voyons plutôt quelle est la perception de l’espace propre à ces récits populaires. Dans leconte, l’espace et sa perception s’organisent en fonction des oppositions suivantes :connu/inconnu, familier/étranger. Dans ce contexte, le voyage7, dont Propp a montré àquel point il était un élément structurant du conte – « la composition du conte est bâtiesur le déplacement du héros dans l’espace8 » – équivaut à une rupture de l’ordre deschoses et est d’emblée placé sous le signe de l’extraordinaire9. Un coup d’œil auxtermes utilisés dans quelques langues européennes pour désigner le voyage révèle uneprédominance de l’idée de rupture, d’effort10, de danger aussi, celui-ci étant accentuépar la lenteur – et donc la longue durée – des trajets. Dans son étude de lareprésentation de l’espace au Moyen Âge, Paul Zumthor montre que les durées dedéplacement restent à peu près les mêmes au fil des siècles, ce qu’il commente de lamanière suivante : « La vitesse relève du merveilleux ; elle ne peut être l’effet que dumiracle ou de la magie11. » Les contes en donnent des exemples en abondance.
7 En ce qui concerne les traditions russes, l’ethnologue Tatiana Ščepanskaja décrit lestatut du voyageur de la façon suivante :
La route est en-dehors de l’ordre divin [...] et, même, s’y oppose... Dans lesconceptions traditionnelles, la route est le monde du non-être, où la coutume nejoue pas. Prenant la route, l’individu se retrouve hors de la communauté, il échappeà la zone où pourraient l’atteindre les leviers habituels du tissu social, comme lapunition, la pression de l’opinion publique, le prestige, l’encouragement, etc. Enroute, il est seul, et, donc libre : à la fois en dehors de la communauté et de sesnormes12.
8 En d’autres termes, « l’homme voyageant perd tout statut : il n’appartient plus à lasociété humaine mais à “l’autre monde13” », et les normes habituelles (vestimentaires,comportementales etc.) n’ont plus cours. De telles représentations, qui peuventsembler provenir d’un autre temps, ont été recueillies par des anthropologuesjusqu’aux années 1980, signe qu’elles sont profondément ancrées dans les mentalités.
9 Prendre la route, c’est aussi quitter la sphère des ancêtres protecteurs14 et s’exposer àtoutes sortes de dangers, contre lesquels de nombreuses pratiques avaient pour but de
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
8
se prémunir, à commencer par le fait de se placer sous la bénédiction parentale, commele font tous les héros des contes russes15. L’ensemble de ces pratiques montre que cetemps du voyage était vécu comme un moment hors du temps quotidien.
10 Cet état d’exception et la situation du voyageur se trouvent synthétisés, au sein duconte, dans le motif de la route, espace ouvert par excellence et lieu de tous lespossibles. Dans la dernière version donnée par Afanassiev du conte « Va je ne sais où,rapporte je ne sais quoi » (NRS 212-215), le héros fait allusion lui-même à son statut devoyageur lorsqu’il apostrophe la Baba Yaga qui lui fait part de son intention de ledévorer :
[…] Comment, vieille diablesse ! Comment veux-tu manger un voyageur ? Unvoyageur, c’est osseux et tout noir ; commence par faire chauffer l’étuve, lave-moiet fais-moi prendre un bain de vapeur, et ensuite, tu me mangeras à ta guise16.
11 Avant le fameux repas – qui reste heureusement toujours à l’état de menace –, le bainconstitue donc lui aussi un rite de passage, même s’il n’y a pas là, à proprement parler,de réintégration dans la communauté des sédentaires, comme c’était le cas dans la viequotidienne.
1.2. La frontière avec l’autre monde
12 La frontière avec l’autre monde est d’épaisseur variable et diversement matérialiséeselon les récits17. Elle est le plus souvent doublée d’une clairière, l’ensemble constituantune zone de marge, ou pour citer Nicole Belmont, un « territoire liminaire18 ». La BabaYaga entretient une relation particulière avec la forêt, et sa maison se trouvegénéralement au cœur de celle-ci, qui l’isole du monde des hommes :
Vassilissa se signa et entra dans la profonde forêt […]. [Elle] marcha toute la nuit ettoute la journée, et c’est seulement le soir qu’elle arriva dans la clairière où setrouvait la maison de la Baba Yaga19.Et comme si l’épaisseur de la forêt ne suffisait pas, la peur semble avoir tracé uncercle autour d’elle : « La Baba Yaga ne laissait personne s’approcher et mangeaitles gens comme des poulets20. »
13 La forêt se combine parfois avec d’autres obstacles naturels qui contribuent à donnerune épaisseur à cette frontière : tantôt il est question d’un profond fossé, tantôt d’unemontagne.
14 Dans « Ilia de Mourom et le dragon » (NRS 310), l’accent est moins mis sur la forêt quesur la localisation de l’isba de la Baba Yaga au sommet d’une montagne, qui prendl’allure d’un vaste plateau. Ainsi, pour se rendre chez le tsar dont la fille est visitée parun dragon, le héros doit gravir une « montagne haute et extrêmement raide etentièrement faite de sable21 ». Une fois là-haut, le héros rencontre non pas une, maisdeux Baba Yaga qui lui indiquent comment se rendre chez leur sœur aînée, puis leBrigand-Rossignol, dont le sifflement est si assourdissant qu’il tue tous les voyageurs.Après qu’Ilia a triomphé de ce dernier, la suite de l’action semble se dérouler sur lemême plateau, et c’est sans doute là que se trouve aussi le royaume où se rend le héros.C’est du moins une hypothèse, car la descente n’est pas évoquée. Cette vaste zonemontagneuse s’apparente donc elle aussi à un monde intermédiaire. Notons quelorsqu’il est dit, plus tôt dans le conte, que le souverain d’Ilia se rend chez le même tsar,le récit passe sous silence les étapes que sont la montagne puis la forêt avec les deuxBaba Yaga et le Brigand-Rossignol. Voilà pourquoi : la mention de ces obstacles à cemoment-là ne présente pas d’intérêt pour le récit. Ils ne jouent de rôle que comme
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
9
épreuves pour le héros et non comme lieux en tant que tels : le paysage du conte n’estpas toujours décrit de manière identique et les lieux ne sont évoqués que lorsqu’ils ontune importance pour la progression de l’action.
15 Par ailleurs, nous avons affaire ici à un triplement du personnage de la Baba Yaga,puisque le héros rencontre successivement trois sœurs, dont l’âge et les pouvoirs vontcroissant. La démultiplication de ce personnage, à laquelle s’ajoute le très intimidantBrigand Rossignol, incarnation du mal absolu et de l’ennemi de la terre russe, contribueà dilater la zone de marge, ce qui en fait un véritable no man’s land22.
16 Un procédé similaire destiné à figurer l’épaisseur de la frontière se rencontre dans laseconde version de « La plume de Finist, clair faucon » (NRS 235), où le récit s’emploie àaccentuer l’effet de l’hyperbole :
Elle marche à travers la sombre forêt, elle marche par-delà des souches et desarbres abattus, tant que ses souliers de fer s’usent, que son bonnet de fer s’élime,que le pain est rongé, mais la belle jeune fille marche encore et encore, et la forêtest de plus en plus noire, de plus en plus dense. Soudain elle voit devant elle unemaisonnette de plomb, sur des pattes de poules, qui tourne sans cesse23.
17 Parfois, la maison se situe elle-même « par-delà trois fois neuf pays, dans le trois-fois-dixième royaume, de l’autre côté de la rivière de feu », comme dans « Maria Morevna24
» (NRS 159). Comme dans le conte précédent, la rivière de feu est traitée différemmentselon les besoins de l’action, et elle joue pleinement son rôle d’ultime frontière entre lemonde des hommes et l’autre monde au moment du retour d’Ivan : privée de sonfoulard magique, la Baba Yaga périt dans les flammes.
1.3. La maisonnette sur pattes de poule : constantes et variables
18 Les nombreuses occurrences de l’isba de la Baba Yaga font de celle-ci un exempleparticulièrement éloquent du fonctionnement du conte, au point que V. Propp s’en estservi dans son essai intitulé Les Transformations du conte merveilleux pour illustrer leprincipe de l’amplification et de la réduction, où « la forme fondamentale est agrandieet complétée par des détails25. » Les invariants sont la situation en marge de la forêt etle détail zoomorphe des pattes de poule. Notons que celles-ci sont parfois remplacéesou accompagnées d’autres éléments tout aussi insolites, comme des « cornes de bouc26 »dans « Ivan-taurillon ».
19 Dans la seconde version de « La plume de Finist, clair faucon » (NRS 235), l’héroïne setrouve soudain, après avoir longuement cheminé dans la forêt, face à « unemaisonnette de plomb, sur des pattes de poules, qui tourne sans cesse27 ». Propp amontré qu’en réalité la maisonnette ne tourne pas sans cesse, mais seulement lorsqu’onle lui demande – c’est une déformation du motif où le sens initial s’est perdu : « seretourner » est devenu « tourner quand il faut » puis « tourner28 ».
20 Dans l’une des sept versions du conte « Le tsar des mers et Vassilissa-la-très-sage »(NRS 224), seule la forêt est évoquée. Cet élément, associé à la formulette prononcée parle héros est ce qui permet d’identifier cette maison comme celle de la Baba Yaga, mêmeen l’absence du détail zoomorphe caractéristique.
Il marche sur la route, la large route, il passe par de vastes prairies, par de riantesplaines et arrive à une sombre forêt. Tout est désert alentour, il n’y a pas âme qui vive.Il n’y a qu’une petite isba, toute seule, l’entrée tournée vers la forêt et le dos versIvan-fils de marchand. « Maisonnette, maisonnette ! lui dit-il, tourne-toi dos à laforêt, et ton entrée face à moi. » La maisonnette lui obéit et se tourna, dos à la forêt,
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
10
et face à lui. Ivan-fils de marchand entra – la Baba Yaga à la jambe d’os y étaitétendue d’un coin à l’autre, les tétons pendant de l’autre côté de la plate-bande29.
21 Arrêtons-nous sur un cas particulier. Dans « Les preux Ours, Moustache, Colline etDuchêne » (NRS 141-142), la Baba Yaga et ses filles interviennent comme antagonistesdu héros, mais dans un monde souterrain et sans qu’il soit fait mention de la fameusemaisonnette. La désignation du personnage antagoniste comme « Baba Yaga » jouedonc sur le complexe d’associations que ce nom éveille dans la mémoire du lecteur,laissant son imagination faire le reste.
2. L’isba sur pattes de poule : un lieude mise à l’épreuve du héros
22 Voyons à présent ce qui se déroule à l’intérieur de la maison.
2.1. Un poste-frontière menant dans le monde des morts
23 Face à cette isba sur pattes de poule, élément familier du lecteur de contes russes maisnéanmoins insolite, l’interrogation de Propp est légitime :
Que se passe-t-il donc ici ? Pourquoi faut-il faire tourner la petite maisonnette ?Pourquoi n’est-il pas possible d’y entrer, tout simplement ? Souvent, Ivan a face àlui un mur lisse – « sans fenêtres ni porte » – et l’entrée se trouve du côté opposé.[...] Mais pourquoi ne pas faire le tour de la maisonnette et entrer par l’autre côté ?Manifestement, cela est interdit. De toute évidence, la maisonnette se trouve surune frontière, visible ou invisible, qu’Ivan ne peut franchir d’aucune manière. On nepeut arriver à cette frontière qu’en passant par la maisonnette, à travers elle, etpour cela, il faut la faire tourner30 [...].
24 L’examen de différents contes russes et la comparaison avec un mythe amérindienpermettent à Propp de conclure que la maison de la Baba Yaga
est tournée, par son côté ouvert, vers le trois-fois-dixième royaume, et, par son côtéfermé, vers le royaume accessible à Ivan. Voilà pourquoi Ivan ne peut pascontourner la maisonnette et est obligé de la faire tourner. Cette maisonnette estun poste-frontière31.
25 Un peu plus loin, il complète sa définition de la frontière en rapprochant « l’étrangedisposition » de la porte de la maison de la Baba Yaga d’une part avec la coutumescandinave de ne jamais orienter la porte des maisons vers le nord, et, d’autre part avecle fait que, dans l’Edda, la porte de la demeure de la mort (Nastrand32) est justementtournée vers le nord. Par recoupement, V. Propp conclut que la maison de la Baba Yagaconstitue une frontière avec le monde des morts33. Il s’agit donc, en quelque sorte, defaire le tri parmi les candidats au passage dans l’autre monde. Cette sélection s’effectuede la manière suivante : la rencontre avec la Baba Yaga constitue en elle-même uneépreuve pour le héros.
26 Si Propp voit dans le motif des pattes de poule un vestige des poteaux zoomorphes quisupportaient la cabane où avait lieu l’initiation34, ce détail peut également nousconfirmer le lien qui unit le personnage de la Baba Yaga à la mort. Dans son ouvrage surle paganisme des anciens Slaves, Boris Rybakov évoque en effet une certaine catégoriede morts malfaisants, appelés les nav’i (sing. nav’), qui sont des morts sans baptême, et àqui l’on faisait des offrandes. Il précise qu’ils ont « l’aspect d’énormes oiseaux ou decoqs déplumés35 » de la taille d’un aigle, qu’ils laissent sur le sol des traces de poule et
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
11
qu’ils « s’en prennent aux femmes enceintes et aux enfants36 », dont ils sucent le sang.Ces éléments, dont la similitude avec le symbolisme ornithologique de la maison de laBaba Yaga et avec l’hostilité de cette dernière à l’égard des humains est frappante,pourraient fournir une clé pour une meilleure compréhension de ce personnage. LaBaba Yaga serait-elle, à l’origine, un de ces mauvais morts ?
27 Un autre détail nous renseigne sur l’appartenance de la Baba Yaga au monde desmorts : la fameuse exclamation par laquelle elle accueille le héros. Comme l’a montréGalina Kabakova, le terme dux dans l’expression russkim duxom paxnet – qui correspondà l’expression française « ça sent la chair fraîche » – désigne l’« odeur, autrement dit cequi fait reconnaître la nature de l’être et qui est véhiculé par le souffle37 ». Cettehypersensibilité à l’odeur humaine est une caractéristique commune à tous les êtres del’autre monde38. 2.2. Des épreuves différentes selon le sexe du héros
28 Pour mieux comprendre en quoi consiste cette épreuve, relisons l’échange qui a lieuentre la Baba Yaga et le héros ou l’héroïne. Ivan-taurillon, dans le conte russe du mêmetitre (« Ivan Bykovič », NRS 137), pénètre avec ses compagnons dans la maisonnette« sur pattes de poule, sur cornes de mouton39 » :
[...] sur le poêle était allongée la Baba Yaga à la jambe d’os, étendue d’un coin àl’autre, le nez dans le plafond. « Pouah, pouah, pouah ! jusqu’au jour d’aujourd’huije n’avais jamais flairé, jamais vu de mes yeux d’être russe. Mais voici qu’au jourd’aujourd’hui, il en est un pour venir se poser sur ma cuiller, pour rouler tout droitdans ma gueule. – Eh, la vieille, ne te fâche pas, descends donc de ton poêle etassieds-toi sur le banc. Demande-nous où nous allons. Et moi, je te répondraigentiment40. »
29 La Baba Yaga tient peu ou prou le même discours lorsqu’elle a face à elle une héroïne,comme dans la seconde version de « La plume de Finist, clair faucon » (NRS 234-235).Elle est cependant moins agressive, sans doute parce que la jeune fille s’adresse à elleen l’appelant tendrement « petite grand-mère41 » [babusja], ce à quoi elle répond, toutaussi affectueusement : « Eh bien, tu as une longue route à faire, ma petite [maljutka] ».
30 Ces exemples nous le montrent : les héros et héroïnes savent trouver les mots pourintimider et amadouer la Baba Yaga, afin de s’en faire une auxiliaire. On reconnaît làune épreuve comportementale implicite visant à tester le courage dans le cas du hérosmasculin, et la politesse lorsqu’il s’agit d’une héroïne.
31 Cette épreuve revêt diverses formes et peut être plus ou moins intentionnelle selon lestextes. Elle aboutit toujours à un changement de fonction de la Baba Yaga qui, degardienne et d’adversaire, se fait guide et auxiliaire du héros.
32 Dans certains récits, la Baba Yaga, bien moins agressive qu’à son habitude, endossed’emblée un rôle de guide, et n’est pas dépourvue de tendresse. Dans la premièreversion du conte « Le tsar des mers et Vassilissa la très-sage » (NRS 219-226), voici cequ’elle dit au héros une fois que celui-ci lui a appris l’objet de sa quête :
Va, mon enfant [ditjatko], au bord de la mer. Douze cigognes voleront jusque-là ;elles se changeront en belles filles et se baigneront. Approche-toi tout doucement etprends à l’aînée sa chemise42.
33 Cette fonction d’auxiliaire et de guide se rencontre notamment dans les contes où lavieille femme est la maîtresse des animaux ou des vents. Ainsi, dans « La princesseensorcelée » (NRS 271-272, version no 272), le héros, un soldat, part en tapis volant à la
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
12
recherche du royaume où se trouve sa fiancée magique, et se rend successivement cheztrois Baba Yaga, trois sœurs, dont la dernière habite « au bout du monde » :
Il y avait là une maisonnette, et au-delà, il n’y avait que de l’obscurité [t’makromešnaja], on ne voyait rien ! « Eh bien ! se dit-il, si je n’obtiens pas de réponse ici,ensuite, je peux plus aller nulle part ! [bolše letet’ nekuda43] »
34 Au bout du monde, il n’y a donc, en somme, que l’obscurité, le néant. Cette dernièreBaba Yaga est la maîtresse des vents et offre son aide au soldat. C’est le vent du sud, ledernier arrivé, qui apprend au soldat où trouver son épouse en racontant qu’il revientd’un nouveau royaume. Voici sa description du temps nécessaire pour s’y rendre :
À pied, on mettrait trente ans, un oiseau mettrait dix ans, mais si je me mets àsouffler, nous y serons en trois heures44.
2.3. Une rencontre à valeur initiatique
35 Parfois, le séjour chez la Baba Yaga se prolonge et l’épreuve comportementale estremplacée par une autre, qui a pour enjeu la vie du héros : dans « Maria Morevna »(NRS 159), le héros se rend chez la Baba Yaga pour obtenir un cheval magique capablede battre à la course celui de Kochtcheï-l’Immortel, afin de délivrer son épousesurnaturelle.
« Je viens mériter chez toi un cheval de preux. – Très bien, tsarévitch ! Mais chezmoi, le service ne dure pas un an, mais seulement trois jours ; si tu réussis à gardermes cavales, je te donnerai un cheval de preux, mais si tu n’y arrives pas, ne tefâche pas, mais ta tête ira coiffer le dernier poteau. » Le tsarévitch Ivan acquiesça ;la Baba Yaga lui donna à manger et à boire, puis elle lui ordonna de se mettre autravail45.
36 Le héros viendra à bout de cette épreuve grâce à des animaux reconnaissants qu’il aépargnés auparavant.
37 Un autre exemple d’épreuve particulièrement intéressant se rencontre dans le célèbreconte « Vassilissa-la-très-belle » (NRS 104), qui est aussi celui où la maison de la BabaYaga est décrite avec le plus de précision, avec notamment le détail particulièrementmorbide des poteaux coiffés de crânes humains, que l’on distingue nettement dansl’illustration de ce conte par Ivan Bilibine (1899). Le peintre a également fait le choix dereprésenter l’isba juchée sur des pattes de poule, alors que ce détail n’est pasmentionné dans la description citée plus haut, parce qu’il est indissociable dupersonnage dans l’imaginaire collectif.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
13
Figure 1 – Ivan Bilibine, Vassilissa la très Belle sortant de la maison de Baba Yaga. Illustration pourle conte « Vassilissa la très Belle », 1899.
O. Semënov, Ivan Bilibin. Rasskaz o xudožnike-skazočnike [Ivan Bilibine. Histoire d’un peintre-conteur],Moscou, éditions Detskaja Literatura, 1996, p. 23.
38 Après avoir volontairement laissé s’éteindre le feu de la maison, la marâtre envoiel’héroïne chercher du feu chez la Baba Yaga, dans l’espoir de se débarrasser d’elle. Aulieu d’être dévorée, l’héroïne rentre saine et sauve, mais en plus, ce voyage dans l’autremonde remplit une fonction réparatrice, puisqu’il rétablit la justice en infligeant à lamarâtre le châtiment qu’elle mérite : le feu rapporté par Vassilissa réduit cette dernièreet ses filles en cendres.
39 Notons que dans ce récit, l’héroïne ne pénètre pas dans l’isba de la Baba Yaga en lafaisant tourner. Après avoir traversé la forêt pendant un jour et demi, et vu passer lestrois cavaliers, elle attend la maîtresse des lieux près du portail.
40 En plus de devoir surmonter sa peur, la jeune fille est soumise à des épreuves bien pluscomplexes. La première consiste à s’acquitter des tâches domestiques imposées par laBaba Yaga, qui s’apparentent par leur ampleur à des tâches impossibles, mais dontVassilissa vient à bout avec l’aide de sa poupée magique et de la bénédictionmaternelle, la première étant en quelque sorte l’incarnation de la seconde.
41 La seconde épreuve a lieu pendant l’échange qui clôt son séjour chez la Baba Yaga.Celle-ci encourage la jeune fille à lui poser des questions, tout en la mettant en gardecontre la question de trop, car « toute question n’est pas bonne à poser46 ». Cette mise àl’épreuve est implicite et consiste à ne pas violer le tabou47 – tacite – en interrogeant lavieille sur ce qui se passe à l’intérieur de la maison.
42 Cette fois, Vassilissa sort victorieuse de l’épreuve parce qu’elle sait se contenterd’observer : elle se garde bien d’interroger la Baba Yaga sur les trois mystérieusespaires de mains qu’elle a vues à l’intérieur de l’isba, ce pourquoi celle-ci la félicite. Mais
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
14
surtout, comme le souligne A.-N. Malakhovskaya, parce qu’elle s’en sort sans l’aide desa poupée, qu’elle ne peut consulter au moment où elle parle avec la Baba Yaga48.
43 En ayant vu ce qu’elle a vu et en ayant triomphé de sa peur, Vassilissa a été initiée auxtâches typiquement féminines propres à cette société patriarcale, et relevant de latroisième fonction dumézilienne de fertilité/fécondité : non seulement à celles relevantdu ménage et de la préparation des repas, mais aussi et surtout à celles qui la mènerontvers l’accomplissement du destin annoncé par son nom (« Vassilissa » est dérivé dugrec basileus, le roi), grâce au filage et au tissage. On se souvient que dans le secondépisode du conte, Vassilissa est recueillie par une vieille femme chez qui elle tisse deschemises ; la finesse de celles-ci lui vaudra d’être appelée chez le tsar qui l’épousera.
44 Le fait que le héros ou l’héroïne parviennent à s’acquitter de l’épreuve qui leur estimposée contribue à les identifier comme tels. Il s’agit donc là d’épreuves« qualifiantes », pour reprendre les termes de Nicole Belmont49.
45 Les contes russes comportent également d’autres personnages féminins qui ne sontdésignés que comme des « vieilles femmes », mais que plusieurs éléments permettentd’assimiler à la Baba Yaga et à sa fonction d’initiatrice : leur grand âge, le fait qu’ellesont un habitat similaire (une maisonnette à la lisière ou au cœur de la forêt, avecparfois la même description), et, surtout, leur manière de s’adresser au héros. Onrencontre même, dans « Ivan-de-la-chienne et le Sylvain Blanc » (NRS 139), unéquivalent masculin de la Baba Yaga : « un vieillard âgé dans un mortier, qui se pousseavec un pilon50 ». Cependant, son comportement évoque davantage celui du petithomme grand d’un pouce, évoqué plus haut. Cet exemple illustre parfaitement lecaractère interchangeable et polymorphe de ces êtres surnaturels, qui remplissent lamême fonction, celle de figures du destin, de passeur entre les mondes et d’initiateur.
46 L’analyse de tous ces exemples permet donc de pointer une nouvelle fois l’ambivalenceprofonde du personnage de la Baba Yaga, à laquelle les chercheurs ont tenté d’apporterdifférentes explications, bien souvent sans parvenir à surmonter réellement lescontradictions qui la caractérisent. L’interprétation la plus pertinente semble être celled’Anna-Natalya Malakhovskaya, qui voit dans la Baba Yaga non plus simplement ladéesse-mère archaïque caractérisée par la dichotomie bien/mal51, mais plutôt unedivinité dont les différents rôles correspondent aux trois fonctions duméziliennes, quisont respectivement la sagesse et le lien au sacré (et aux divinités magiques), lafonction guerrière, et la fonction de fertilité/fécondité qui est aussi liée à la mort52.
3. Des récits porteurs d’un « sens latent53 »
47 Quel sens faut-il donc donner à ces récits relatant un voyage dans l’autre monde, c’est-à-dire dans l’au-delà, le monde des morts ? Par-delà leur fonction compensatrice etcelle de divertissement, propres au genre du conte, ces récits-là seraient-ils eux-mêmesporteurs d’une fonction initiatique et étiologique ?
48 On se souvient que Vassilissa-la-très-belle, dans le conte éponyme (NRS 104), estchassée par la Baba Yaga une fois qu’elle lui a révélé la nature de son auxiliairemagique :
« [...] À présent, c’est moi qui vais te poser une question : comment fais-tu pourréussir à faire le travail que je te donne ? – C’est la bénédiction de ma mère qui m’aide,répondit Vassilissa. – Voilà donc ce qu’il en est ! Puisqu’il en est ainsi, va-t-en d’ici,fille bénie que tu es ! Je n’ai pas besoin de ceux qui sont bénis54 ! »
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
15
49 Au delà de sa fonction compensatrice, ce récit est donc porteur d’une dimensiondidactique. Cette seconde fonction transparaît dans les vertus incarnées par lepersonnage de Vassilissa, qui réunit à la fois piété – au sens traditionnel de ce terme –et piété filiale (à travers sa fidélité à la dernière recommandation de sa mère), maisaussi la docilité, la serviabilité, ainsi que le courage ou plutôt la confiance, forte qu’elleest de la bénédiction maternelle. Car contre celle-ci, la Baba Yaga, toute puissantequ’elle est, ne peut rien55.
50 Ce dernier motif, dont le conte de Vassilissa donne une illustration particulièrementprégnante, met en évidence à quel point le personnage de la Baba Yaga renvoie à desreprésentations archaïques et préchrétiennes, puisque c’est finalement le lien auxancêtres protecteurs, par le biais de la bénédiction maternelle, qui assure le salut del’héroïne. Ainsi, ce conte illustre-t-il à merveille la notion de « double foi » utilisée pourcaractériser le christianisme populaire propre à la Russie56.
51 Revenons enfin, pour clore notre réflexion, aux contes évoqués à l’orée de cet article,qui avaient pour motif central l’enlèvement d’enfants, afin de tenter d’élucider leurfonction. Comment expliquer, en effet, cette intrusion de la Baba Yaga dans le mondedes hommes, qu’elle soit directe, ou qu’elle se fasse par le biais d’intermédiaires commeles oies sauvages ? Si nous avons vu, à propos du conte « Les oies sauvages » (NRS 113),que loin d’être en danger chez la Baba Yaga57, le petit frère y jouait avec des pommesd’or, c’est davantage son enlèvement qui fait l’objet d’une crainte que son sort. La peurporte donc bien plus sur le trouble de l’ordre des choses que représente ce rapt –d’autant que le conte met également l’accent sur la peur de la fillette, qui craint d’êtrepunie par ses parents pour son défaut de surveillance.
52 Ce récit serait donc porteur, comme d’autres, d’une fonction étiologique, l’intrusion dupersonnage inquiétant de la Baba Yaga ou de ses émissaires ailés, les oies sauvages,étant destinée à apporter une réponse à des phénomènes que l’entendement se refusaità expliquer, tels que la mortalité infantile58 – on se souvient qu’il est dit, au début duconte « Les oies sauvages », que ces-dernières « enlevaient les petits enfants59 ».
Conclusion
53 La Baba Yaga nous est donc apparue à la fois comme gardienne de la frontière avecl’autre monde, mais aussi comme passeuse vers celui-ci et comme guide, comme être àla frontière des mondes, mi-vivant, mi-mort, mais aussi des règnes, mi-animal, mi-humain.
54 Comme l’a noté N. Novikov, « dans la figure de la Baba Yaga, sans doute comme dansaucun autre personnage de contes, se sont déposées, d’une manière bizarre etparticulière, des strates culturelles séculaires, et les démêler n’est pas une tâchefacile60... ». On peut donc voir en elle un personnage-palimpseste, une divinité alliantles dimensions à la fois chthonienne et spirituelle, et présidant à la destinée deshommes.
55 Quant à la représentation de l’univers, la Weltanschauung qui se dégage des contes, ausein de laquelle la frontière, si étroitement liée à la Baba Yaga, joue une place centrale,on peut parler d’une géographie à trois pôles qui sont ce monde-ci, l’autre monde etl’entre-deux-mondes ; entre ces lieux, le passage est possible dans un sens comme dansl’autre.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
16
56 Ce passage, géographique en apparence, si l’on considère le voyage accompli par leshéros et héroïnes, est en réalité un passage à une « altérité ontologique61 »,conformément à un procédé cher au genre du conte, celui de l’extériorisation62. Eneffet, sous l’apparence de simples histoires visant le divertissement, ces récits narrentde manière imagée les changements qui s’opèrent lors du passage à l’âge adulte, tant àl’échelle individuelle que du point de vue du statut social, et sont donc eux-mêmesinvestis d’une fonction initiatrice.
BIBLIOGRAPHIE
Afanassiev, Alexandre Nikolaiévitch, Narodnyje Russkije Skazki, (3 t.), édition établie, préfacée etannotée par V. Propp, Moscou, Gosudarstvennoe Izdatel’stvo Xudožestvennoj Literatury, 1957.
Becker, Richarda, Die weibliche Initiation im ostslawischen Zaubermärchen, Wiesbaden, OttoHarrassowitz, 1990.
Belmont, Nicole, « Les seuils de l’autre monde dans les contes populaires français », Cahiers delittérature orale, no 39-40, 1997, p. 61-79.
—, Poétique du conte. Essai sur le conte de tradition orale, Paris, Gallimard, 1999.
—, « Manipulation et falsification des contes traditionnels par les cultures lettrées »,ethnographiques.org, numéro 26, 2013, Sur les chemins du conte : http://www.ethnographiques.org/2013/Belmont
Čistov, Kirill, « Baba-Jaga », Märchenspiegel, no 7, 1996, p. 38-42.
Conte, Francis, L’Héritage païen de la Russie, Paris, Albin Michel, 1997.
Dumézil, Georges, Mythe et épopée, Paris, Gallimard, 1968.
—, Les Dieux souverains des indo-européens, Paris, Gallimard, 1977.
Hetmann, Frederik, « Die keltische Anderswelt als Reich der Wunscherfüllung und Phantasie », inLox, Harlinda, Volkmann, Helga et Bücksteeg, Thomas (éd.), Homo faber – Handwerkskünste inMärchen und Sagen/Verlorene Paradiese – Gewonnene Königreiche. Forschungsbeiträge aus derWelt der Märchen, Krummwisch, Königsfurt, 2005, p. 164-193.
Horn, Katalin, « Der Weg », in J. Janning et alii (éd.), Die Welt im Märchen, Kassel, Erich RöthVerlag, 1984, p. 22-37.
Kabakova, Galina, « Les représentations des odeurs dans la culture populaire slave », Cahiersslaves, no 1, 1997, p. 205-216.
Lecouteux, Claude, La Maison et ses génies, Paris, Imago, 2000.
—, Dictionnaire de mythologie germanique, Paris, Imago, 2005.
Malakhovskaya, Anna-Natalya, Nasledie baby-yagi. Religioznye predstavleniya, otražennye vvolšebnoj skazke, i ix sledy v russkoj literature XIX-XX vv., Saint-Pétersbourg, Aleteia, 2006. (enrusse)
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
17
Novikov, Nikolaï, Obrazy vostočnoslavjanskoj volšebnoj skazki [Les figures du conte merveilleuxdes Slaves orientaux], Moscou, Nauka, 1974. (en russe)
Propp, Vladimir, Morphologie du conte, suivi de Les transformations du conte merveilleux, et deE. Mélétinski, L’Étude structurale et typologique du conte, traductions de Marguerite Derrida,Tzvetan Todorov et Claude Kahn, Paris, Le Seuil, coll. « Poétique », 1970.
—, Les Racines historiques du conte merveilleux, trad. fr. Lise Gruel-Apert, Paris, Gallimard, coll.« NRF », 1983.
Rimasson-Fertin, Natacha, L’Autre monde et ses figures dans les Kinder – und Hausmärchen desfrères Grimm et les Contes populaires russes d’A. N. Afanassiev, université Stendhal-Grenoble 3,thèse de doctorat, 2008.
– , « Putešestvie v inoe carstvo kak osnova struktury skazki : sravnitel’nyj analiz skazok brat’evGrimm i A. N. Afanas’eva » [Le voyage dans l’autre monde comme élément structurant du conte :étude comparée des contes des frères Grimm et d’A. N. Afanassiev] in Tradicionnaya kultura [Laculture traditionnelle, almanach scientifique], no 58, 2015 (2), p. 104-119. (voir : http://www.folkcentr.ru/izdaniya/zhurnal-tradicionnaya-kultura/) (en russe)
Rybakov, Boris, Le Paganisme des anciens Slaves, Paris, PUF, 1994 (Moscou 1981), coll.« Ethnologies », trad. fr. Lise Gruel-Apert.
Ščepanskaja, Tatiana, « La culture de la route dans la Russie du Nord », Ethnologie française,XXVI, 4, 1996, p. 677-690.
Zumthor, Paul, La Mesure du monde. Représentation de l’espace au Moyen Âge, Paris, Seuil, coll.« Poétique », 1993.
NOTES1. Cet article s’inscrit dans la continuité de nos précédents travaux sur l’autre monde dans lesrecueils de contes d’Afanassiev et des frères Grimm. Voir N. Rimasson-Fertin, L’Autre monde et sesfigures dans les Kinder – und Hausmärchen des frères Grimm et les Contes populaires russes d’A. N.Afanassiev.2. « А кем же была Баба-Яга на самом деле […]? », in A.-N. Malakhovskaya, Nasledie baby-yagi.Religioznye predstavleniya, otražennye v volšebnoj skazke, i ix sledy v russkoj literature XIX-XX vv., p. 5.3. V. Propp, Les Racines historiques du conte merveilleux, p. 57.4. Ibid.5. N. Novikov, Obrazy vostočnoslavjanskoj volšebnoj skazki, p. 74.6. N. Rimasson-Fertin, L’Autre monde et ses figures…, p. 390-396.7. Sur le voyage chez Afanassiev et Grimm, voir N. Rimasson-Fertin, « Putešestvie v inoe carstvo kakosnova struktury skazki », p. 104-119.8. V. Propp, Les Racines historiques…, op. cit., p. 56.9. Voir également K. Horn, « Der Weg », p. 23.10. P. Zumthor, La Mesure du monde. Représentation de l’espace au Moyen Âge, p. 167.11. Ibid., p. 172.12. T. Ščepanskaja, « La culture de la route dans la Russie du Nord », p. 678.13. Ibid., p. 677.14. Voir C. Lecouteux, La Maison et ses génies.15. Cette coutume existe aussi dans le monde germanophone, mais elle ne transparaît pas dansles contes.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
18
16. A. N. Afanassiev, Narodnye russkie skazki (cité NRS infra), p. 156-157. En l’absence d’indicationcontraire, tous les soulignements sont le fait de l’auteur de l’article.17. Voir N. Rimasson-Fertin, L’Autre monde et ses figures…, op. cit., p. 75-126.18. N. Belmont, « Les seuils de l’autre monde dans les contes populaires français », p. 64.19. NRS, t. 1, p. 161.20. NRS, t. 1, p. 160.21. NRS, t. 3, p. 11.22. Le même effet de dilatation de la frontière est parfois obtenu grâce à un doublement ou à untriplement du personnage du gardien. Le « Conte du jeune preux, des pommes de jouvence et del’Eau de la Vie » (NRS 171-178) en offre plusieurs exemples. Dans la version no 176, Elena-la-très-belle, qui s’élance à la poursuite du héros qui a pénétré chez elle, reproche à ses sœurs de l’avoirlaissé passer, par une phrase qui rend manifeste leur fonction de gardiennes : « Pourquoi doncvous a-t-on placées ici ? » Dans la version no 178, trois Baba Yaga jouent le même rôle.23. NRS, t. 2, p. 243.24. NRS, t. 1, p. 379.25. V. Propp, Morphologie du conte, p. 185.26. NRS, t. 1, p. 279.27. NRS, t. 2, p. 243.28. V. Propp, Morphologie du conte, op. cit., p. 186.29. NRS, t. 2, p. 199-200.30. V. Propp, Les Racines historiques du conte merveilleux, op. cit., p. 72.31. Ibid., p. 73.32. Ce nom, qui signifie « Rivage des cadavres », désigne une des demeures de Hel, la déesse desenfers. Voir C. Lecouteux, Dictionnaire de mythologie germanique, p. 119-120 et p. 173.33. Voir V. Propp, Les Racines historiques…, op. cit., p. 154.34. Ibid., p. 158-159.35. B. Rybakov, Le Paganisme des anciens Slaves, p. 35.36. Ibid.37. G. Kabakova, « Les représentations des odeurs dans la culture populaire slave », p. 206.L’auteur rappelle notamment les différents sens du terme dux : « Dux est, selon les contextes,souffle, souffle de vent, air (vozdux), alcool, vapeur, respiration, inspiration, esprit en tant quesubstance incorporelle opposée à la chair, être immatériel, démon, souffle créateur de Dieu,essence, force principale, univers spirituel, confession. »38. Ibid., p. 212-213.39. NRS, t. 1, p. 279.40. V. Propp, Les Racines historiques..., op. cit., p. 78.41. NRS, t. 2, p. 244. Comme le note très justement R. Becker, le terme baba a, à lui seul, lasignification de « grand-mère » dans toutes les langues slaves, même s’il a tendance, depuistoujours, à élargir son sens pour désigner les femmes mariées. Voir R. Becker, Die weiblicheInitiation im ostslawischen Zaubermärchen, p. 114.42. NRS, t. 2, p. 174.43. NRS, t. 2, p. 351.44. NRS, t. 2, p. 352.45. NRS, t. 1, p. 380-381.46. NRS, t. 1, p. 163.47. A.-N. Malakhovskaya, Nasledie Baby Yagi, op. cit., p. 32.48. Ibid., p. 34.49. N. Belmont, Poétique du conte. Essai sur le conte de tradition orale, p. 185.50. NRS, t. 1, p. 293.51. Cet aspect a notamment été souligné par R. Becker, voir R. Becker, op. cit., p. 162.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
19
52. A.-N. Malakhovskaya, op. cit., p. 10-13 et G. Dumézil, Mythe et épopée 1, et, du même, Les Dieuxsouverains des indo-européens.53. N. Belmont, « Manipulation et falsification des contes traditionnels par les cultures lettrées ».54. NRS, t. 1, p. 163.55. Dans son ouvrage, A.-N. Malakhovskaya propose une lecture très intéressante de la question-clé de la Baba Yaga. Celle-ci serait, semble-t-il, en quête d’une héritière digne de prendre sasuccession, comme le laissent entendre les mots avec lesquels elle chasse Vassilissa une foisqu’elle sait que sa force réside en la bénédiction de sa mère : « Je n’ai pas besoin de ceux qui sontbénis » – ce qui sous-entend bien qu’elle a besoin de quelqu’un, dans un but qui n’est pas dévoilé.Pour l’auteur, le prénom même de Vassilissa la place au même rang que toutes les héroïnes qui setrouvent être des filles ou des nièces de la Baba Yaga. Voir A.-N. Malakhovskaya, op. cit., p. 34-35.Ceci vient renforcer le choix de traduction fait par L. Gruel-Apert pour le nom de cette héroïne,qu’elle appelle « Vassilissa la Magique ».56. F. Conte, L’Héritage païen de la Russie, p. 23-24.57. Nous tenons à remercier ici Evelyne Cevin pour son interprétation très éclairante de ce récit.58. Voir F. Hetmann, « Die keltische Anderswelt als Reich der Wunscherfüllung und Phantasie »,p. 174.59. NRS, t. 1, p. 185.60. N. Novikov, op. cit., p. 180. Voir aussi, K. Čistov, « Baba-Jaga », p. 38-42.61. Concernant cette différence ontologique entre les deux mondes, voir N. Belmont, « Les seuilsde l’autre monde dans les contes populaires français », op. cit., et N. Rimasson-Fertin, L’Autremonde et ses figures…, op. cit., p. 460.62. N. Rimasson-Fertin, L’Autre monde et ses figures…, op. cit., p. 460-461.
RÉSUMÉSCet article s’appuie sur une étude du recueil d’Afanassiev dans sa langue d’origine et vise à situerprécisément la demeure de la Baba Yaga dans l’espace du conte pour définir son identitévéritable et sa fonction. La rencontre avec cet être a lieu à la frontière avec l’autre monde. La BabaYaga apparaît, quant à elle, comme un personnage ambivalent, gardienne de la frontière, maisaussi donatrice et initiatrice du héros. Quel sens donner à ces récits relatant un voyage dansl’autre monde ? Loin d’être un simple divertissement, ils sont eux-mêmes investis d’une fonctioninitiatique et étiologique.
This article, based on a study of Afanassiev’s tales collection, aims at locating accurately BabaYaga’s hut in the space of the fairy tale, in order to define her real identity and her function. Thehero always meets her at the border of the Otherworld, and she appears as an ambivalentcharacter, which is a guardian of the border, as well as a donator and an initiator of the hero.What is the meaning of these tales about a journey to the Otherworld? Far from being a simpleentertainment, they also have an initiating and an etiological dimension.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
20
INDEX
Mots-clés : Baba Yaga, autre monde, géographie mythique, Weltanschauung, voyage, frontière,initiation, au-delà, épreuve, destin, mortKeywords : Baba Yaga, otherworld, mythical geography, Weltanschauung, travel, boundary,initiation, world beyond, destiny, death
AUTEUR
NATACHA RIMASSON-FERTIN
Maître de conférences en langue et littérature allemandes à l’Université Grenoble-Alpes etchercheur à l’ILCEA4 (Institut des langues et des cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie etAustralie) depuis 2009, Natacha Rimasson-Fertin est une ancienne élève de l’École normalesupérieure de Fontenay-Saint-Cloud. D’origine russe et agrégée d’allemand, elle est titulaire d’undoctorat d’études germaniques, consacré au motif de l’autre monde dans les contes de Grimm etd’Afanassiev (2008). Auteur de la nouvelle traduction et édition critique des Contes pour les enfantset la maison des frères Grimm (José Corti, 2009), qui a obtenu le prix Halpérine-KaminskyDécouverte, de la Société des gens de lettres, et un prix de l’Académie française en 2010, sesrecherches portent sur les contes populaires allemands et russes : croyances et traditionspopulaires, folklore et identité nationale, contes et imaginaire, adaptations littéraires,iconographiques et cinématographiques.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
21
La Baba Yaga et les autrespersonnages surnaturelsdu conte merveilleux. Forment-ilsun système ?Lise Gruel-Apert
1 Baba Yaga ou vieille, princesse ou belle fille, dragon, serpent ou diable, les personnagessurnaturels du conte merveilleux sont ceux que le héros / l’héroïne rencontre au coursde sa quête. J’ai traité peu ou prou de ces personnages dans les ouvrages cités enbibliographie1. Vladimir Propp en avait largement parlé dans Les Racines historiques duconte merveilleux2.
2 Nous laisserons ici de côté la démarche psychanalytique qui ne prend pas suffisammenten compte le contexte économique et socio-culturel dans lequel le conte merveilleux etles personnages qu’il met en scène évoluent. Pour nous, il s’agit de replonger la figurede la baba Yaga dans un contexte environnemental et socio-culturel qu’il faut lui-mêmeen partie dégager, avec tous les risques d’erreur que cela comporte. Car cela comportedes risques.
3 En effet, toutes les interprétations que l’on peut ou que l’on a pu donner du contemerveilleux ont de façon inhérente un aspect flou, indéterminé, parce que le matériaumême du conte est flou et indéterminé (voir les formules d’ouverture : « Il était unefois… », « En un certain État, en un certain royaume… »). Les interprétations n’ont pasmanqué depuis le XIXe siècle, elles ont suivi les modes (moralisante, « christianisante »,« mythologisante », « météorologisante », « psychanalysante », etc.). L’erreur est,probablement, comme le signalait déjà Luzel3, de vouloir s’en tenir à une théoriedonnée et de réduire le matériau si divers du conte à cette théorie. Aussi, sachant à quelpoint le terrain est miné, nous prendrons une méthode inductive plutôt que déductive,c’est-à-dire que nous partirons du matériau lui-même et essaierons d’aller vers unethéorie (ce que Propp s’efforça de faire en son temps).
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
22
1. Les caractéristiques des principales figuressurnaturelles
4 Dans le conte merveilleux, les figures surnaturelles appartiennent à l’autre monde.Comme Propp l’a dit à maintes reprises, l’existence de deux mondes avec traversée d’unmonde – le nôtre – vers l’autre – l’autre monde, l’au-delà – fait partie de la composition,de la structure même du conte merveilleux. Une des figures emblématiques de cet autremonde est la baba Yaga, personnage des plus énigmatiques et fascinants.
1.1. La baba Yaga
5 Faut-il mettre un article ? Faut-il dire « Baba Yaga » ou la baba Yaga ? Dans la mesureoù les langues slaves n’ont pas d’article, l’une et l’autre dénomination sont recevables.Cependant le terme russe baba n’est pas un prénom, mais un nom commun signifiant« la femme du peuple, la paysanne ». L’étymologie, de son côté, pourrait faire remonterl’appellation à la femme Serpent4. Quels sont ses principaux aspects ?
6 1. La baba Yaga ravisseuse. Survenant brusquement, elle ravit un petit garçon pour lefaire rôtir. Mais, abusée par le garçonnet (c’est-à-dire le héros), elle mange sa fille à laplace (contes Tomassounet, Filiouchka5, etc.). Elle se présente comme une chasseresse,elle se déplace dans un mortier, elle se met à l’affût, elle se précipite sur sa proie (proiequi « sent le Russe », c‘est-à-dire le vivant). Son cannibalisme est hors de doute. Lepersonnage est révélateur d’une société basée sur la chasse mais qui connaît aussil’agriculture primitive, comme le montre le motif du mortier.
7 2. La baba Yaga combattante. Dans le conte Petit Bout6, à nouveau trompée par le héros,elle tue ses quarante-et-une filles au lieu des quarante-et-un frères, dont Petit Bout, quil’affrontent. L’environnement est un lac. Elle est amazone, à cheval, elle a un bouclierde feu et projette des flammes. On note encore l’opposition et la différence detraitement entre filles et garçons.
8 Dans le conte Ivachko-Ourseau7, la baba Yaga bat les compagnons du héros, leur découpeà chacun une lanière dans le dos. Le héros renverse la situation, il découpe à la babaYaga trois lanières dans le dos. La baba Yaga lui échappe, elle retourne sous terre, oùelle vit avec sa fille. La fille, adulte, trahit sa mère pour partir avec Ivachko-Ourseau. Ona une opposition baba Yaga / héros, mais aussi fille / mère.
9 3. La baba Yaga donatrice. Le héros ou l’héroïne parvient dans la petite isba de la forêt,est soumis (e) à des épreuves, reçoit des cadeaux lui permettant d’effectuer la traverséevers l’autre royaume et de parvenir à ses fins, qui sont la quête de la personne désirée.La petite isba, d’après Propp, est un poste frontière entre les deux mondes.
10 4. La baba Yaga gardienne du royaume des morts. D’après l’analyse de Propp, la petite isbaest équivalente à un cercueil : la baba Yaga en occupe tous les coins, elle est allongée detout son long sur le poêle et a le nez fiché dans le plafond8. Elle a une jambe d’os, elledéteste l’odeur du vivant. Propp interprète le séjour dans la petite isba de la forêtcomme un écho, un souvenir du rite d’initiation des sociétés primitives, lequel supposeune mort temporaire. La baba Yaga est pour lui le chef travesti de ce rite9.
11 5. La baba Yaga (la Vieille) maîtresse de la forêt et des animaux sauvages. « Toutes lescréatures du monde lui sont soumises » (conte La Belle des Belles10). Ces créatures sont les
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
23
bêtes de la forêt, les poissons, les oiseaux. Dans l’univers sylvestre, la femme / la mère/ la vieille est souveraine.
12 6. La sexualité et les relations familiales de la baba Yaga. On ne peut ici accepter l’analyse dePropp qui reste à mi-chemin de sa déduction : tout en reconnaissant qu’elle est mère etmaîtresse des animaux, il ne lui voit pas d’enfant humain11. En fait, si elle n’a ni mari nifils, elle a des filles (soit une, soit trois, soit de très nombreuses). En ce qui concerne sesattributs sexuels, le conte insiste plus sur ses mamelles que sur son sexe proprementdit : elle a « les tétons enroulés à un crochet12 », ce qui peut prouver que la maternité dela baba Yaga intéresse plus le conteur (et le conte en général) que sa sexualitéproprement dite.
13 7. Le côté solaire de la baba Yaga. Dans deux contes célèbres (Vassilissa la Belle et MariaMarievna13), elle commande aux phénomènes célestes. Cet aspect reste limité.
14 Ainsi, si la baba Yaga a pu être comprise comme le chef d’un rite initiatique, commeune grande déesse aux attributions multiples, elle est avant tout un esprit lié à la forêtet à la chasse. Elle a des filles plutôt que des garçons et son attitude est différente vis-à-vis des unes et des autres : elle défend les unes et s’en prend aux autres, un clanmaternel se dessine. Comme la plupart des esprits de la nature, elle a à la fois un aspectbénéfique et maléfique, ce qui apparaît dans sa façon de mettre à l’épreuve le héros.Pour Propp, son aspect repoussant, sa vieillesse sont liés au fait que déjà à l’époque oùle conte a été élaboré, elle incarnait une religion morte, dépassée14. Elle est, suivant sestermes : « incroyablement archaïque15 ». 1.2. La princesse
15 La figure de la princesse correspond aussi aux appellations de : la Fille-Roi, la princessegrenouille, la fille de la baba Yaga, Vassilissa la Magique, la Belle Fille, etc.
16 Elle est d’une beauté que nul ne saurait décrire, et ceci n’est pas une simple facilité destyle car l’éclat de cette beauté est équivalent à celui du soleil, il marque son rapportavec l’or et l’astre du jour. La princesse est aussi liée à l’eau vivifiante des sources : « deses mains et de ses pieds coule l’eau de jeunesse et de vie » (conte L’Eau de jeunesse et laBelle Fille16).
17 On peut distinguer trois sous-types. Premièrement, elle est certes la belle fille enlevée,mais, curieusement, on la retrouve dans l’autre royaume en tant que souveraine et nonen tant que prisonnière (et vice versa, de prisonnière, elle se meut rapidement endonneuse d’ordres) : cette contradiction n’a pas été suffisamment prise en compte.Ensuite, elle est la Fille-Roi, amazone d’une force inouïe et commandant une troupe defilles guerrières ; quand le héros la découvre endormie, « son souffle est semblable àcelui de la feuille du chêne » (conte L’Eau de jeunesse et la Belle Fille) ; dans une version ducollecteur Khoudiakov17, elle a « des pommiers qui lui poussent sous les aisselles ». Elleest le symbole de la terre endormie. Enfin, Vassilissa la Magique, la princessegrenouille, sont, elles, créatrices de la nature civilisée, inventrices de l’agriculture, dumariage, elles sont des héroïnes de culture18.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
24
1.3. Le serpent ou l’adversaire
18 Le serpent est la forme principale prise par l’Adversaire. Mais on peut trouver cedernier sous d’autres noms : la serpente, le dragon ou la dragonne, Tchoudo-Youdo, lediable, l’Ouragan, Kachtchéï l’Immortel.
19 Le mot signifiant le serpent dans les langues slaves est zmeja, mot à déclinaison en – a,accordé au féminin, provenant de zemlja, la terre : c’est l’animal qui sort de terre, qui aun lien étroit avec elle19. Ceci explique l’importance à la fois mythologique et cultuellede cette figure.
20 Dans les légendes slaves, le serpent a des côtés bénéfiques : il a un pouvoir de guérison,il est détenteur de richesses, gardien du foyer20. Dans quelques contes également, ilpeut servir au héros d’auxiliaire magique (conte Hélène la Magicienne21).
21 D’une façon générale cependant, dans le conte merveilleux, le dragon cherche à vivreavec la jeune fille ou la femme enlevée (contes Roule-petit-pois22), mais surtout à ladévorer (conte La Pomme de jeunesse et le Royaume d’en bas23). Cette deuxième fonctions’applique aussi au héros (contes Le Dragon et le tsigane, Les Deux Ivan-fils de soldat24) : « Jevais te manger, os compris ». D’où l’importance de son combat avec le dragon : il s’agitde lui couper les têtes, chose difficile, non seulement parce qu’il en a plusieurs, maisparce qu’elles repoussent. Un autre combat, plus dangereux encore, est le combat à lamassue : dans ce cas, il faut enfoncer le serpent ou le dragon dans la terre (ou êtreenfoncé par lui). C’est une forme de combat archaïque qui souligne le rapport avec laterre. La fonction d’engloutissement par la terre est une façon de dévorer, d’anéantirl’adversaire, et elle est pratiquée aussi bien par le dragon que par le héros (contebiélorusse Roule-Petit-Pois25). Le troisième combat, le plus risqué, est celui qui intervientquand les dragons ont été tués et que leurs femmes et mère entrent en lice : la mère-dragonne ouvre une gueule depuis la terre jusqu’au ciel et, tel un aspirateursurpuissant, avale tout sur son passage. Le héros, paniqué, n’est sauvé quemiraculeusement et jamais par ses propres moyens (par son cheval ailé, par desforgerons). Ce dernier combat est le fait d’une femelle et il s’agit de dévoration. Sousson aspect femelle, le dragon est donc particulièrement imprévisible et dangereux.
22 Ainsi, le côté maléfique l’emporte sur le côté bénéfique, existant malgré tout.
23 Une autre fonction du dragon consiste à vouloir marier le héros. Il a un entourageféminin tellement présent qu’il peut dire au héros avant que le combat ne s’engage :« Viens-tu pour te fiancer à mes sœurs ou à mes filles ? » Et, sur la réponse outrée duhéros : « Je ne suis pas venu pour entrer dans ta famille, mais pour te battre dans laplaine ! » (conte Ouragan le Valeureux26), le combat commence. Mais cette fonction demarieur du dragon reste peu appuyée, elle est plus apparente chez le Tsar de l’Onde oule diable.
24 Le Tsar de l’Onde, Tchoudo-Youdo, le diable (Tchort), appartiennent aussi à la catégoriede l’Adversaire. Très entourés de femmes et de filles, ils sont liés au motif archaïque dela vente à l’avance : « Donne ce que tu as à la maison sans le savoir ». Personnagesdémoniaques, ils enlèvent à un père son fils dans le but de le marier. Ils sont dévoreurset marieurs. Nous allons revenir sur cette double fonction, étrange dans notre contextesocio-culturel.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
25
2. Les liens entre ces figures
25 Nous sommes passés un peu vite sur les caractéristiques de ces personnages27,l’essentiel est pour nous de déterminer les liens qui les unissent.
2.1. La relation entre la baba Yaga et sa fille(la princesse), entre la Vieille et la Jeune
26 Il arrive que la baba Yaga soit simplement mentionnée comme la gardienne duroyaume de la Belle Fille à qui elle est soumise (variantes des contes sur l’eau dejeunesse28). Néanmoins, ces deux personnages, de génération – mais peut-être aussi deculture – différente, ont souvent des liens de parenté : mère / fille (« C’est donc que tuas épousé ma fille », dit la Yaga au héros, dans le conte Va je ne sais où, rapporte je ne saisquoi29), mais aussi tante / nièce (conte Tchoudo-Youdo et Vassilissa la Magique30), etégalement grand-mère / petite-fille (contes sur l’oiseau Finiste31). Les jeunes femmes oufilles sont en quelque sorte la lignée utérine de la baba Yaga, laquelle baba Yaga a aussides sœurs. Par contre, la baba Yaga n’est jamais de la famille du héros, elle est de cellede l’épouse, la fiancée, la femme recherchée, comme l’avait déjà noté Propp32.
27 Ceci n’empêche pas une opposition entre ces personnages féminins de générationdifférente. Cette opposition peut être frontale : c’est le cas de la fille de la baba Yagaqui, désireuse de quitter le monde de sa mère, indique au héros la façon de tuer cettedernière (conte Ivachko-Ourseau). Il n’y a pas d’élaboration du personnage de la fille : oubien elle est tuée, petite, par mégarde par sa mère ou bien, adulte, elle fait tuer sa mère.
28 Les personnages de Vassilissa la Magique, la princesse-grenouille, etc., sont plusélaborés. Elles instaurent un monde différent de celui de leur mère, leur tante, ou leurgrand-mère, un monde qui n’est plus basé sur la forêt et la chasse, mais sur les champset l’agriculture, elles accomplissent des tâches agricoles et ménagères, ce qui n’est pasbanal dans le monde sylvestre sauvage d’où elles sont issues, elles dressent des bêtessauvages, elles construisent des ponts ou des palais, elles créent par leur danse unenature civilisée, elles établissent le mariage. Elles ne s’en prennent pas directement à lababa Yaga, mais, créatrices d’un monde nouveau, elles cherchent à quitter son mondearchaïque, et ceci les amène à affronter d’autres représentants de ce même monde.
29 On peut déceler cependant beaucoup de traits communs entre la Vieille et la Jeune.Voici comment la princesse du royaume d’argent accueille le héros, venu soi-disantpour la délivrer :
Jusqu’aujourd’hui, je n’avais jamais perçu, jamais flairé de carcasse russe, mais voiciqu’aujourd’hui il en est une pour venir jusqu’à moi ! Eh bien, Ivan-tsarévitch,l’épreuve, tu la cherches ou tu la fuis ? — Je suis à la recherche …33
30 Mais ce sont les paroles mêmes de la baba Yaga, on croirait entendre cette dernière ! Labelle fille du conte Les Deux Ivan-fils de soldat se transforme soudain en lionne qui enfleterriblement et avale les deux héros, mettant ainsi fin au conte. La dévoration a doncbien lieu ici de façon non fictive et elle est l’œuvre de la belle fille.
31 Dans une variante du conte La Princesse-grenouille34, si l’héroïne est bien la princesse-grenouille qui, « d’un geste de la main, fait apparaître jardins et prairies », soncannibalisme n’en est pas moins menaçant : ainsi, d’après le texte, la grenouille arrivechez sa mère où est caché le héros, et elle s’exclame : « Pouah ! Cela sent comme une
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
26
odeur russe ! Si Ivan-tsarévitch me tombait sous la main, je le mettrais en pièces ! »Dans ce conte, curieusement, c’est la mère qui sert de modérateur et qui donne desconseils au héros pour retourner la situation. Les rôles mère / fille sont inversés, la filletenant le rôle primitif de l’ogresse, la mère étant, elle, relativement civilisée. À vraidire, le héros finit malgré tout par être englouti, dans la mesure où la grenouille,redevenue amoureuse de lui, l’emporte définitivement vers son septième royaume35.
32 Dans le conte L’Eau de jeunesse et la Belle Fille, la Belle Fille, abusée pendant son sommeilpar le héros, tue ce dernier, puis, se reprenant et le trouvant beau garçon, revient surson acte, applique sur la blessure qu’elle vient de faire la paume de sa main d’où coulel’eau de jeunesse et de vie : le jeune homme revient à la vie et une promesse de mariageentre eux est échangée.
33 Entre les deux générations, on a donc les traits communs suivants : pouvoir à la foisbénéfique et maléfique, cannibalisme (beaucoup plus que de simples traces), lien avecla nature, sauvage ou civilisée, mise à l’épreuve du héros, conseils, qui sont plutôt desinjonctions et ont pour but le mariage. 2.2. Le rapport avec le monstre masculin
34 Nous avons vu que le monstre masculin (dragon, Tchoudo-Youdo, le Tsar de l’Onde, lediable, etc.) était à la fois dévoreur et marieur. Cette deuxième fonction, celle demarieur, reste, en ce qui concerne le dragon, énigmatique bien que présente. Il faut setourner vers les autres représentants masculins de l’au-delà pour s’efforcer d’y voirplus clair.
35 Le monstre de l’onde, le diable, Tchoudo-Youdo ont un aspect physique mal défini, maisleurs surnoms révèlent une appartenance à un monde hérétique. Ils s’appellent le Tsarmécréant, Tchoudo-Youdo le Hors la loi, le Tsar au front non baptisé, Satan, le diable etmême, « l’Enfer36 ». Leur entourage familial est féminin : ils n’ont que des filles,quelquefois une sœur. La fille est une figure essentielle qui peut faire partie du titremême du conte (voir Le Diable et la fille maligne37), mais la baba Yaga se situe elle aussidans ce cadre. Voici comment elle accueille le héros qui arrive : « Mon frère, Tchoudo-Youdo, est bien las de t’attendre ! » (conte Tchoudo-Youdo et Vassilissa la Magique38). Lababa Yaga peut aussi avoir des sœurs (conte Finiste-Clair-Faucon39) et en a mêmefréquemment40. Nous savons par ailleurs que la fille de Tchoudo Youdo, Vassilissa laMagique, est fille, nièce ou petite-fille de la baba Yaga (ou de la Vieille de la forêt). Nousrevoilà donc en famille. Mais de quel groupe familial s’agit-il ? Les choses peuvent êtreprécisées car, cette fois intervient le « père » et, même, deux pères. Notons tout de suiteque l’analyse qui va suivre concerne moins la baba Yaga que les membres de son groupefamilial, mais c’est le but que nous nous sommes fixés au départ, déterminer la naturede cet entourage familial, en approcher le contexte socio-culturel.
36 Le sujet de conte Le Tsar de l’Onde et Vassilissa la Magique, alias Le Diable et la fille maligne,est très révélateur. Il est aussi ancien que célèbre, même s’il a peu donné lieu à desélaborations littéraires. C’est le A.T. 313 de l’index international des sujets de conte (oucontes-types). On trouve ce sujet un peu partout en Europe, il y en a des traces àBabylone, et un passage significatif figure dans L’Océan des contes de Somadéva 41. Lemythe grec Jason et Médée est bâti sur ce thème. On le trouve aussi, bien représenté,dans la tradition du conte populaire français. Les versions russes sont particulièrementriches et archaïques.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
27
37 La scène de départ, assez stable dans les contes russes, est la suivante (en résumé). Untsar, voyageant, a soif. Il s’approche d’un lac, se penche pour boire. Un monstre sortantde l’onde l’attrape par la barbe et lui dit : « Je ne te relâcherai que quand tu m’aurasdonné ce que tu as chez toi sans le savoir ». Croyant tout savoir, le tsar acquiesce, sansse douter qu’il vient de donner son fils nouveau-né. Le fils ne sera cependant donnéqu’à la puberté.
38 C’est ce qu’on appelle le motif de la vente à l’avance.
39 Or, le monstre sortant de l’onde (alias le Tsar de l’Onde) s’avère être le père deVassilissa la Magique (« Mon père est bien las de t’attendre ! », dit celle-ci). Ainsi, cesujet de conte met en scène deux pères, celui du héros, Ivan-tsarévitch, et celui del’épouse quêtée, Vassilissa, qui va aussi jouer le rôle de l’héroïne. Pour en revenir à cesdeux pères, on est confronté à l’anomalie suivante : le premier père, père d’Ivan-tsarévitch, lors de la naissance de ce dernier, ne savait pas qu’il allait avoir un enfantalors que le deuxième père, père de Vassilissa, savait que le premier allait avoir unenfant. On peut établir que le premier ne fréquente pas sa compagne en permanence,ne forme pas un couple avec elle, est donc un homme d’un groupe clanique différent,alors que le deuxième, père de Vassilissa, est du même clan que la mère d’Ivan, ce quilui permet de savoir ce qui lui arrive, à elle, c’est-à-dire qu’elle est enceinte. Le premierpère est un père de type nouveau, ordinaire, biologique, à la puissance limitée sur sonfils qu’il ne peut marier, alors que le deuxième est un puissant magicien, doué, nousallons voir, pour marier ses filles. En effet, ce deuxième père, père de Vassilissa, estaussi père de filles, plus ou moins nombreuses, les « sœurs » de Vassilissa. Étant donnéle nombre élevé que cela peut atteindre (trois, douze, mais soixante-dix-sept dans leconte no 172 d’Afanassiev, cent dans la version de Somadéva) et que rien n’est dit surles mères, ne seraient-elles pas plutôt cousines que sœurs, et le tsar de l’onde ne serait-il pas plus oncle que père ? Ceci est d’autant plus vrai que, encore en russe moderne, lesmots brat et sestra signifient aussi souvent « cousin » et « cousine » que « frère » et« sœur ». Le père de Vassilissa serait alors le père-oncle et nous aurions ici une formedéguisée d’avunculat archaïque (de nombreux articles ont été écrits sur ce sujet deconte, dont deux personnels où je développe cette thèse42). Le père-oncle est le chefmasculin d’une organisation familiale où seules les filles et femmes sont prises encompte dans le calcul des lignées. La baba Yaga qui, elle aussi, est définie par une lignéeutérine, appartient à ce clan et, par sa position de gardienne, par ses ordres etinjonctions, elle le dirige à sa façon. C’est donc le clan de la mère d’Ivan qui organise lemariage de celui-ci, le père d’Ivan étant exclu des démarches. Ceci avait été entrevu parPropp, mais sans précisions43.
40 Ainsi, dans le conte russe apparaît très clairement une organisation clanique de typematernel avec une vieille, gardienne de l’ordre, un chef masculin, père-oncle, denombreuses filles ou sœurs, formant la lignée utérine. Dans d’autres traditions decontes, on a des échos de la même organisation. Le conte tiré de L’Océan des contesoppose un père ayant cent fils (ce que le conteur explique « rationnellement » par lapolygamie) et un père surnaturel ayant cent filles (ce qu’il n’explique pas). On trouve defaibles échos de ceci dans les contes de Perrault44.
41 Est-ce-que le chant épique russe, beaucoup plus misogyne que le conte et de factureplus récente, pourrait nous fournir un début de solution ?
42 Voyons le chant épique novgorodien Sadko45 : après un naufrage, Sadko se retrouvechez le roi de la mer. Le roi de la mer veut le marier avec une de ses trois cent filles.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
28
Mais Saint-Nicolas apparaît et dit en substance à Sadko : « Choisis la dernière qui seprésentera, mais ne fais pas l’amour avec elle. Tu pourras ainsi revenir à Novgorod ».Ainsi fait Sadko et, grâce à cette abstinence, il se retrouve le lendemain matin, seulmais libre, dans sa ville natale. Sinon, il aurait été absorbé (englouti) par le clanmaternel du roi de la mer. Nous retrouvons ici l’idée de l’engloutissement : pour lehéros champion du patriarcat, se marier dans un clan maternel signifie disparaître,être absorbé, englouti par lui. Une réaction s’impose donc et comporte à son tour unedose de sadisme non négligeable.
43 Le conte russe, archaïque et bien conservé, garde des traces encore très apparentesd’une organisation familiale largement dépassée, y compris en Russie même, et qui atoutes les apparences d’un clan maternel. Davantage d’exemples pourraient étayercette constatation. Ceci a des implications d’ordre historique et sociologique, mais aussimythologique. En effet, si les figures dont nous avons traité sont surnaturelles, quelsens faut-il attribuer à l’épithète « surnaturelles » ? Ces figures seraient-elles le simpleproduit d’une imagination individuelle ou le souvenir lointain et transforméd’organisations sociales et culturelles depuis longtemps oubliées et qui ont cependantsubsisté dans la mémoire collective de paysans analphabètes ?
BIBLIOGRAPHIE
Afanassiev, Alexandre Nikolaiévitch, Contes populaires russes, 3 t., trad. et présent. Lise Gruel-Apert, Paris, Imago, 2009, 2010, rééd. 2014.
Delarue, Paul, Le Conte populaire français, 3 t., Paris, G.P. Maisonneuve et Larose, 1976, t. I,p. 234-239.
Gruel-Apert, Lise, La Tradition orale russe, Paris, PUF, 1995.
—, De la paysanne à la tsarine. La Russie traditionnelle côté femmes, Paris, Imago, 2007.
—, Le Monde mythologique russe, Paris, Imago, 2014.
Propp, Vladimir, Les Racines historiques du conte merveilleux, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèquedes sciences humaines », 1983 (trad. fr. L. Gruel-Apert).
Vasmer, Max, Dictionnaire étymologique de la langue russe, Moscou, Progress, 1986 (traduction russede l’allemand).
NOTES1. L. Gruel-Apert, La Tradition orale russe, chap. « Les contes » ; De la paysanne à la tsarine. La Russietraditionnelle côté femmes, p. 131-139 ; Le Monde mythologique russe, chap. « L’Au-delà et les figuressurnaturelles du conte merveilleux ». Voir aussi www.gruel-apert.com.2. V. Propp, Les Racines historiques du conte merveilleux, chap. : « La Forêt mystérieuse », « Le TroisFois Neuvième Royaume », « Près de la rivière de feu ».3. Les Contes de Luzel, Rennes, PUR, Terre de Brume, 1996 en 3 tomes ; t. I, Préface.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
29
4. Dans mes commentaires aux Contes d’Afanassiev, je me suis expliquée à ce sujet (voir A.N. Afanassiev, Contes…, t. II, p. 395).5. A. N. Afanassiev, Contes…, t. I, no 78, 80.6. A. N. Afanassiev, Contes…, t. I, no 76.7. A. N. Afanassiev, Contes…, t. I, no 105, 106.8. A. N. Afanassiev, Contes…, t. III, no 208.9. V. Propp, Les Racines …, p. 139-141.10. A. N. Afanassiev, Contes …, t. II, no 119.11. Propp V. Ya., Les Racines …, p. 94.12. A. N. Afanassiev, Contes …, t. III, no 208.13. A. N. Afanassiev, Contes …, t. I, no 75, et t. II, no 121.14. V. Propp, Les Racines …, p. 142.15. V. Propp, Les Racines…, p. 141.16. A. N. Afanassiev, Contes…, t. II, no 135.17. Ivan А. Khoudiakov, Contes grands-russes, Saint-Pétersbourg, no 41, 2001, p. 139 (1re éditionMoscou 1860-1862) [Velikorusskie Skazki]. Comme Afanassiev a travaillé sur des contes d’archives,Khoudiakov, qui fut son contemporain, doit être considéré comme le premier véritable collecteurde contes russes.18. L. Gruel-Apert, « Vassilissa la Magique, héroïne de culture », Slovo, no 30/31, Inalco, 2004 ;article développé dans L. Gruel-Apert, « Héroïne de culture », Le Folklore russe, Saint Pétersbourg,Naouka, 2011 [Kul’turnaja gerojnja].19. M. Vasmer, Dictionnaire étymologique de la langue russe.20. L. Gruel-Apert, Le Monde mythologique russe, p. 218-222.21. A. N. Afanassiev, Contes …, t. II, no 182.22. A. N. Afanassiev, Contes…, t. I, no 96-98.23. A. N. Afanassiev, Contes …, t. II, no 133.24. A. N. Afanassiev, Contes …, t. I, no 111, no 117.25. A. N. Afanassiev, Contes …, t. I, no 97.26. A. N. Afanassiev, Contes …, t. I, no 100, p. 255.27. Ainsi, dans un conte d’Afanassiev souvent illustré en France (conte La baba Yaga II, t. I, no 74),la baba Yaga est sœur de la marâtre de l’héroïne et joue à ce titre un rôle entièrement négatif. Cecas, qui met en jeu la nouvelle épouse du père, est unique et totalement différent de ceuxenvisagés.28. Afanassiev, Contes …, t. II, no 134, 136-138, 140.29. Afanassiev, Contes …, t. II, no 164.30. Afanassiev, Contes …, t. II, no 172.31. Afanassiev, Contes …, t. II, no 179, 180.32. V. Propp, Les Racines…, p. 137.33. Dans le conte Les Trois Royaumes, A. N. Afanassiev, Contes …, t. I, no 93.34. A. N. Afanassiev, Contes …, t. III, no 207.35. Voir fin d’article p. 11.36. Khoudiakov, Contes grand-russes, op. cit., no 18.37. Afanassiev, Contes…, t. II, no 173.38. Afanassiev, Contes …, t. II, no 172.39. Afanassiev,Contes…, t. II, no 180.40. Une raison de plus pour contester la traduction par : Baba Yaga41. Recueil indien de contes, XIe siècle. Voir à ce sujet P. Delarue, Le Conte populaire français,p. 234-239. Une traduction complète en français de L’Océan des contes est disponible chezGallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1996. Une traduction complète en russe a été faiteen 1976 à Moscou (rééditée en 2008).
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
30
42. Voir note 17, p. 5.43. V. Propp, Les Racines…, p. 137-138.44. Dans le conte Le Petit Poucet, on a une situation familiale semblable à celle du conte russe PetitBout : tandis que le héros et ses frères sont sept, l’ogre a, de son côté, sept filles. Comme la babaYaga, il tue par méprise ses sept filles au lieu des sept garçons. L’ogre (l’ogresse ?) a une lignéeutérine qui est anéantie par le héros à la suite d’un subterfuge.45. L. Gruel-Apert, La Tradition orale russe, p. 208, 227 ; Le Monde mythologique russe, p. 199.
RÉSUMÉSÀ partir d’une étude attentive des contes d’Afanassiev, on peut dégager les traits principauxsuivants : la Baba Yaga est un esprit de la forêt, avec cannibalisme et entourage familial féminin ;la princesse est liée à l’or, au soleil ; le dragon est dévoreur et marieur. Ces trois figures ont desliens familiaux suggérant un clan maternel. Une analyse des rapports entre les pères du contepermet d’affiner ces relations.
A careful analysis of Afanasyev’s fairy tales allows us to bring out the following main features:Baba Yaga is a spirit of the forest, characterized by cannibalism and a female family circle; theprincess is related to gold and the sun; the dragon behaves as a devourer and a match-maker.These three figures suggest a maternal clan. A study of the links between the fathers of the fairytale allows us to better define this relationship.
INDEX
Mots-clés : Afanassiev, Propp, baba Yaga, princesse, dragon, clan maternel.Keywords : Afanasyev, Propp, Baba Yaga, princess, dragon, maternal clan
AUTEUR
LISE GRUEL-APERT
Lise Gruel-Apert, traductrice des Contes populaires russes d’Afanassiev, est maître de conférencesde civilisation et linguistique russes en retraite, après avoir exercé à l’université de Rennes II. Ellea également publié plusieurs ouvrages : La Tradition orale russe (PUF, 1995), De la paysanne à latsarine. La Russie traditionnelle côté femmes (Imago, 2007), Le Monde mythologique russe (Imago, 2014)et de nombreux articles (voir la bibliographie donnée en fin d’article). Elle prépare unetraduction complète des ouvrages de Vladimir Propp consacrés au conte.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
31
Une consommation marchandée : lecannibalisme comme dispositifd’échange et de transformationchez Baba YagaJane Sinnett-Smith
1 Au même titre que son mortier bondissant et son isba à pattes de poule, le cannibalismefait partie intégrante de l’image typique de Baba Yaga : elle apparaît dans l’imaginationdu public comme une sorcière féroce, qui dévore les enfants qui errent trop près de sondomaine. Les contes cannibales de Baba Yaga se révèlent être un lieuexceptionnellement significatif pour les actes de transformation. Si la rencontre avecBaba Yaga est souvent considérée comme un moment d’initiation, une transformationdu protagoniste d’enfant en adulte, le cannibalisme lui-même effectue destransformations complexes qui dérangent la frontière entre sujet et objet, humain etanimal, intérieur et extérieur. Cet article met en question le rapport entre lecannibalisme et la transformation du héros, qu’il s’agisse d’une transformation denature, de statut ou même d’un changement de forme par intervention magique. Noussoutenons que ce rapport se formule dans le contexte des échanges, des marchandiseset des dons. Nous considérerons la manière dont un réseau complexe de rapports etd’échanges s’organise dans chaque conte entre Baba Yaga et le protagoniste, entre leprotagoniste et la société, entre deux mondes distincts. Nous soutenons que le contactavec le cannibalisme laisse des traces importantes sur le protagoniste, ébranlant lesdistinctions que les contes s’efforcent d’établir.
2 À grands traits, les textes étudiés se rassemblent autour de deux motifs : celui de lafuite hors du four de la Baba Yaga, qui cherche à faire cuire et dévorer le héros, et celuide la gentille petite fille qui assure sa fuite en participant à une série d’échanges avecdes créatures rencontrées pendant son aventure, ou avec la Baba Yaga elle-même.
3 Le premier groupe se compose de quatre variantes très proches : La Baba Yaga etDégourdi, La Baba Yaga et Filiouchka, Ivachko et la sorcière, Tomassounet, et une versiondivergente Prince Daniel, mots de miel1. En substance, l’histoire raconte comment Baba
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
32
Yaga enlève un petit garçon à sa famille pour le manger, et comment le héros la vaincet rentre sain et sauf au foyer. La clé de sa fuite est la ruse qu’il emploie : quand lacomplice de Baba Yaga, sa fille, essaie de le faire monter dans le four pour être cuit, ilfait semblant de ne pas comprendre comment on y entre. Bien sûr, aussitôt que la fille yentre elle-même pour lui montrer comment faire, il ferme la porte et la laisse cuire. LaBaba Yaga, à son insu, finit par manger sa propre fille, et le garçon s’échappe. Parfois, lehéros réussit à duper et faire brûler Baba Yaga elle-même. On trouve aussi le motif dufour dans Prince Daniel, mots de miel, encore qu’il soit très déformé : c’est la seule versionde ce motif dans le recueil d’Afanassiev où le protagoniste est une fille. Le récit est unesorte de texte hybride, qui mélange plusieurs éléments de contes différents. L’héroïne,une princesse, en tentant d’échapper à son frère qui veut se marier avec elle, seretrouve dans la hutte de Baba Yaga. La fille de Baba Yaga, au lieu d’essayer de la fairecuire, l’aide à s’échapper, les deux filles conspirent pour tromper la Baba Yaga, et lesdeux prennent la fuite ensemble pendant que la Yaga est piégée dans son four.
4 Le deuxième groupe de contes inclut Les Oies Sauvages, La Baba Yaga et Vassilissa la Belle.La générosité de la protagoniste, voire son empressement à aider les étrangers qu’ellerencontre, est récompensée, car ces derniers l’aident en retour : dans les contes quinous intéressent, ces rencontres l’aident à échapper à Baba Yaga. Dans Les Oies Sauvages,l’héroïne cherche à secourir son petit frère, qui a été enlevé par Baba Yaga à cause de sanégligence. En allant chez Baba Yaga elle rencontre une série d’objets animés, un four àpain, un pommier, une rivière de lait, qui la cachent de la fureur de Baba Yaga après luiavoir imposé certaines conditions. Dans le conte intitulé simplement La Baba Yaga, c’estla fille, envoyée dans l’isba de Baba Yaga par sa méchante marâtre, qui doit offrir desservices aux serviteurs de Baba Yaga pour que ceux-ci la laissent fuir. Vassilissa la Bellen’entre pas facilement dans l’une ou l’autre des catégories de conte que nous avonsétablies2, bien qu’il partage plusieurs éléments avec La Baba Yaga : Vassilissa estenvoyée par sa marâtre, qui veut se débarrasser d’elle, chercher du feu chez la sorcière.Baba Yaga promet de l’aider si elle parvient à réaliser des tâches impossibles, tâchesque Vassilissa accomplit avec l’aide d’une poupée magique, un don de sa défunte mère.Baba Yaga lui permet de partir avec du feu, feu qui, une fois porté chez Vassilissa,consume la méchante marâtre et les belles-sœurs. Vassilissa se marie avec un prince etvit heureuse.
1. Les transformations
5 La consommation est par sa nature même un acte qui donne lieu à des transformationsde matière et de sens : la nourriture mangée est convertie de substance externe enélément interne, elle devient partie du corps du mangeur, intégrée à un systèmecorporel plus large qu’elle3. La transformation subie est donc multiple : de l’extérieurvers l’intérieur, et d’un objet isolé en une composante d’un corps plus large. Lorsquecette consommation transformatrice devient aussi une consommation cannibale (avectoutes les connotations de transgression de tabou liées à l’anthropophagie), lestransformations qu’elle effectue se multiplient de nouveau, et deviennent plusinquiétantes. En particulier, chez Baba Yaga, le cannibalisme menace la stabilité desfrontières entre l’humanité et l’animalité, l’animé et l’inanimé. Ainsi, en plus des motifsde transfert extérieur-intérieur, isolement-communauté, nous identifions plusieurstypes de transformation subis par les victimes du cannibalisme de Baba Yaga.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
33
1.1. Humain-animal
6 Le conte Vassilissa la Belle décrit comment la sorcière mange des humains « comme despoulets4 ». L’acte de manger une personne réévalue le statut de cette personne. Un desprivilèges tacites de l’humanité est d’occuper uniquement la position de mangeur, deprédateur, et jamais celle de mangé, de proie. En refusant ce privilège à sa victime, lecannibale effectue un glissement troublant de catégorie et déstabilise le statutprivilégié de l’humanité5. Le conte de Vassilissa suggère que la consommation del’humain, sa transformation en proie, est incompréhensible sans le recours à unemétaphore d’animalité. Si un élément essentiel de l’humanité est le fait de ne pas êtremangé, le seul moyen de comprendre ce changement de statut est d’imaginer la victimehumaine comme un animal. Le cannibalisme de Baba Yaga initie donc unetransformation à deux niveaux, de statut et de nature : la victime est transforméed’être privilégié en créature vulnérable et d’être humain en animal. Cette animalisationde la victime rappelle de manière inquiétante que l’humanité n’est qu’une catégoriesupérieure d’animal. Mais elle est loin d’être la transformation la plus dramatique dansles contes cannibales.
1.2. Sujet-objet
7 Plusieurs contes narrent comment le désir cannibale de Baba Yaga transforme savictime d’actant, de sujet conscient, en objet inanimé. Dans le conte La Baba Yaga, celle-ci proclame à propos du protagoniste qu’elle veut « en faire [son] déjeuner6 ». Demanière similaire, dans Prince Daniel, mots de miel, la fille de Baba Yaga lui expliquequ’elle n’a pas retenu un groupe de passantes pour les manger parce que celles-ciétaient trop « vieilles », et donc pas au goût de sa mère, « trop dures pour [ses] dents ».De la même manière, dans le conte de Vassilissa, on perçoit la victime comme un animalcar on n’arrive pas à concevoir l’acte de dévorer un être humain : ici Baba Yaga nereconnaît pas la subjectivité de ses victimes désignées. Elle les perçoit seulement dupoint de vue gastronomique, comme des repas ou de la nourriture. On trouve l’exemplele plus dramatique de procédés selon lequel le cannibalisme transforme la victime enobjet inanimé dans La Baba Yaga et Filiouchka. Cela vaut la peine d’examiner l’épisodeentier où la fille de Baba Yaga pénètre dans le four et y est rôtie7.
Pas comme cela, Filiouchka ! dit la fille de la Yaga brune. — Et comment alors ? J’saispas, moi ! — Attends, je vais te montrer ! », et elle s’allongea comme il faut sur lapelle. Filiouchka, […] la saisit en un tournemain et la lança dans le poêle […] [il]ouvrit la porte et sortit sa victime, rôtie. Il l’enduisit de graisse, la posa sur un platqu’il recouvrit d’un linge, et rangea le tout dans le coffre […] la Yaga brune arrive,fouille le coffre, en retire le rôti8.
8 Ce passage raconte un processus de transformation linguistique extraordinaire. Audébut la fille participe au conte comme un sujet parlant, capable d’action et de pensée.Si elle n’est pas nommée dans cette version du conte (elle l’est dans des variantes), elleest au moins identifiée clairement comme une personne (« la fille… »). Satransformation en victime est aussi une transformation en objet. Il y a un glissement devocabulaire, de « fille » en « victime » puis simplement en « rôti ». Elle devient unsimple ingrédient dans une recette, objet inerte qui sert au plaisir d’un autre.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
34
1.3. Mangé-Mangeur
9 Il est intéressant de noter que si l’on considère des représentations du cannibalismeplus larges, surtout les rites rapportés par des anthropologues, ou même l’acte decannibalisme symbolique qu’est l’Eucharistie9, on découvre que le cannibalisme asouvent pour effet de transformer le cannibale lui-même, qu’il s’agisse d’une sorted’initiation à la maturité ou de l’incorporation dans une communauté. Mais malgré lestransformations éprouvées par ses victimes, Baba Yaga elle-même ne semble paschanger de nature au fil de son cannibalisme, elle n’est pas sujette aux transformationseffectuées. Nous suggérons que le cannibalisme est si constitutif du personnage de BabaYaga, à la fois changeant et immuable10, que les contes ne peuvent concevoir unemétamorphose ni de son caractère ni de sa nature. Qu’elle soit menaçante oubienveillante, elle est toujours Baba Yaga, et impossible à transformer. Cela ne signifiepas que Baba Yaga n’est pas du tout touchée par les transformations impliquées par laconsommation. En dévorant la victime, elle l’incorpore dans son propre corps : soncorps est constitué par ceux de ses victimes. Sa consommation trouble la frontièreentre le corps qui mange et le corps qui est mangé. En effet, la section suivante de cetarticle revient plus précisément sur l’idée que, au cours du conte, les identités de BabaYaga et de sa victime semblent se brouiller et se ressembler.
2. Les échanges
10 Il est important de noter que malgré les multiples références au cannibalisme de BabaYaga, les contes ne racontent la réalisation de ses appétits cannibales que peufréquemment11. En général, la menace cannibale de Baba Yaga demeure à l’état demenace : elle constitue un défi que doit vaincre le protagoniste. La victoire contre lasorcière et son cannibalisme est assurée par la participation du héros aux processusd’échange – en fait, chaque conte dans le recueil d’Afanassiev qui montrent lecannibalisme de Baba Yaga contient une sorte d’échange, qu’il s’agisse demercantilisme pur ou d’un échange plutôt symbolique. Le motif de l’échange n’est paspropre aux contes du cannibalisme, mais son omniprésence dans ces contes le rendparticulièrement remarquable.
11 La nature transformatrice du cannibalisme est seulement exacerbée par sonimplication dans les processus d’échange. La forme de la transformation effectuée estbien sûr différente et ne vise plus seulement la victime (ou disons la victime désignée),mais s’étend au monde qui l’entoure. Le « type » de transformation le plus basiqueeffectué dans ces contes – voire peut-être dans tous contes de fées – est ledéveloppement du protagoniste d’enfant en adulte12. Cette section examine la manièredont la menace du cannibalisme stimule cette transformation fondamentale, etcomment l’engagement des protagonistes dans des réseaux d’échanges peut à la fois lesdistinguer de Baba Yaga et aggraver leur ressemblance à la sorcière. 2.1. Le cannibalisme comme punition : échanges avec Baba Yaga
12 La Baba Yaga semble rarement déclencher l’échange d’elle-même. Dans Vassilissa la Belleet Ivachko et la sorcière, elle utilise son cannibalisme comme une menace afin d’assurerque l’on respecte les termes des échanges qu’elle propose. Elle déclare à Vassilissa : « Tu
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
35
vas travailler chez moi quelque temps : si je suis contente, je te donnerai du feu, sinon,je te mangerai13 ! ». L’issue de l’échange détermine la position que Vassilissa occupe : sielle arrive à accomplir les tâches que Baba Yaga lui a assignées, elle peut participer àl’échange comme celle qui rend un service et qui reçoit le don de feu. Si elle échoue,elle devient simplement l’objet échangé, ou plutôt pris, par Baba Yaga. Cet échange estclairement déséquilibré : les conditions de Baba Yaga (de séparer le froment du son, lesgraines de pavot de la terre) sont impossibles. Baba Yaga perturbe la logique del’échange réciproque en instaurant un rapport injuste qui ne favorise qu’elle : elleessaie de s’établir comme double bénéficiaire du travail de Vassilissa, et de son corps,sans rien donner.
13 Cet échange déséquilibré est encore plus marqué dans Ivachko et la sorcière. Baba Yagadéclare au forgeron qu’elle le mangera s’il ne lui donne une voix douce qui luipermettra d’attirer le petit garçon qu’elle veut manger, et des dents de fer pour lechasser : « Forgeron, forgeron ! Forge-moi une voix aussi douce que celle de la mèred’Ivachko, sinon je vais te manger ! », « Forgeron, forgeron ! Forge-moi des dents de fer,sinon je te mange !14 ». Le cannibalisme fonctionne donc comme une punition à laquellela réalisation de l’échange permettra d’échapper. Le forgeron est payé pour le servicequ’il rend à Baba Yaga non par un bénéfice, un profit concret, mais par un manque (lefait que Baba Yaga s’abstienne de le dévorer). En fait, il faut interroger la possibilité dequalifier cet épisode de vrai échange : Baba Yaga reçoit quelque chose du forgeron,mais elle ne donne rien. Bien qu’ailleurs dans les contes Baba Yaga fonctionne trèssouvent comme donneuse de conseils ou de cadeaux magiques, sous son aspectcannibale elle reste en dehors des systèmes d’échanges, elle refuse d’y participer, dedonner autant que de recevoir. Au lieu de l’échange réciproque, elle se meut dans unsystème d’exigence et de prise. Elle reste à part des structures d’échange qui unissent lasociété, elle ne participe pas à une communauté15. 2.2. Les dons récompensés : échangesavec la société
14 Si ces deux contes mettent l’accent sur le caractère isolé et fermé de Baba Yaga et deson monde, les contes mettant en scène la gentille petite fille et ses échanges au gré desrencontres contrastent fortement avec les contes évoqués ci-dessus. Le type d’échangeréalisé dans ces contes est au contraire explicitement réciproque : la fille donne, et sondon est rémunéré par l’aide du bénéficiaire. Les Oies Sauvages, un conte hanté par lamenace cannibale de Baba Yaga, illustre l’importance de ce partage mutuel du rôle dedonateur et de récepteur. La première fois que l’héroïne, en route vers l’isba de BabaYaga pour récupérer son frère, rencontre les autres participants à l’échange, elle refusede coopérer. Chaque fois l’être rencontré dit qu’il lui révélera où les oies emportent sonfrère si elle remplit les termes de l’échange qu’il propose : le four à pain demandequ’elle mange son pain, le pommier une de ses pommes, la rivière de lait un peu dusirop qui forme ses rives16. Elle exige qu’ils lui fournissent les informations qu’ellecherche gratuitement, rejetant leurs conditions et ainsi refusant le contre-don. Elle secomporte, autrement dit, comme la Baba Yaga elle-même. Ce n’est qu’au cours de ladeuxième rencontre, de retour de la hutte et fuyant Baba Yaga, que la fillette accèdeaux requêtes de ses interlocuteurs et, ce faisant, garantit sa survie.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
36
15 Le conte relate donc comment la fille apprend à participer aux systèmes d’échange.L’œuvre fondamentale de Marcel Mauss, Essai sur le don (1925), met en valeurl’importance de l’échange mutuel pour lier et unir une communauté17. Mauss décrit leréseau complexe d’obligation mis en place par l’échange des dons : l’obligationsimultanée qu’ont les participants de donner, recevoir, et rendre18. Ce conte sembledramatiser la centralité de cet échange réciproque et commun. La rencontre de laprotagoniste avec des objets anthropomorphes variés incarne les trois pôlesd’obligation de Mauss dans un seul moment d’échange. La fille reconnaît son devoir derecevoir du four, du pommier, de la rivière, le don qu’ils veulent lui donner. Saconsommation est donc à la fois un don de leur part (elle reçoit de la nourriture) et desa part (elle remplit leur demande). Chaque partie utilise la notion de la dette, c’est-à-dire l’obligation de rendre après avoir reçu un don, pour aboutir à leurs fins. La menacedu cannibalisme transforme l’héroïne d’actant égoïste, qui veut prendre sans donner etsans recevoir, en participant actif qui comprend les dettes qu’elle doit à la sociétéautour d’elle.
16 Nous suggérons donc que ce récit enseigne la manière d’appartenir à la société. Lafillette apprend comment rejeter le mode de consommation égoïste incarnée par BabaYaga, comment éliminer une ressemblance entre elle et la sorcière. En revanche, elle seconçoit comme membre d’un groupe social auquel elle contribue et duquel elle reçoitdans un système d’obligations, mais aussi, pour nous éloigner un peu des termes deMauss, de profit mutuel. Finalement la fille et ceux qu’elle rencontre exploitent leréseau d’obligation pour obtenir ce dont ils ont envie. Il est important de noter que cequi la sauve est l’acte de manger, de partager de la nourriture, un geste puissantd’unification qui forge la communauté19. L’acte d’échanger de la nourriture, un service,de l’aide, crée des liens qui unissent la fille et les créatures rencontrées au sein d’unemême communauté.
17 Si le conte décrit la transformation d’un individu en membre d’une communautésoudée par des échanges mutuels, il déclare aussi la supériorité des valeurs de ce modede vie. Il établit deux modèles rivaux de comportement, l’égoïsme de la prise et lepartage des dons mutuels. Ce n’est que l’initiation réussie du protagoniste au systèmed’échanges mutuels qui assure sa survie, une légitimation claire de ce mode de viecommun. Le texte déclare que ce ne sont pas seulement les échanges qui construisent lasociété, mais que seule la participation à ces échanges permet l’accès à cette société.Toutefois, le fait de ne pas adhérer à ces valeurs implique une absorption dans lemonde de Baba Yaga – non seulement à travers une incorporation littérale par laconsommation, mais aussi à travers un système d’appropriation qui ne serait pasgouverné par les obligations mutuelles de l’échange. 2.3. Un échange de système
18 La rencontre de Baba Yaga et du protagoniste est donc une rencontre entre le mondede la victime et le monde de Baba Yaga. Dans Vassilissa la Belle cette rencontre demondes met en scène une confrontation non seulement des deux systèmes (de partageou de prise) mais de deux types de consommation. La consommation est au centre dutexte : Vassilissa s’assure de n’être pas dévorée par Baba Yaga en donnant de lanourriture à sa poupée magique, qui l’aide à remplir les termes de l’échange de BabaYaga. Vassilissa substitue à un type de dévoration – le risque d’être dévorée par Baba
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
37
Yaga – une autre dévoration – celle des repas par sa poupée. Fait significatif, ellechange la nature de la consommation effectuée. Baba Yaga se livre à une consommationessentiellement solitaire, égoïste : Vassilissa lui sert une nourriture suffisante pour dixpersonnes, qu’elle mange en totalité, ne laissant à Vassilissa que quelques miettes20. Enrevanche, l’alimentation de la poupée fait partie d’un échange réciproque : Vassilissadonne de la nourriture pour recevoir quelque chose de retour. La dévoration égoïsteperpétrée par Baba Yaga est remplacée par un système de réciprocité, le mangeurtransformé de simple profiteur en acteur participant à l’échange de dons/contre-dons.
19 Ce qui est particulièrement intéressant est le fait que Vassilissa se prive souvent desrepas pour alimenter sa poupée21. Bien qu’elle évite le cannibalisme littéral de BabaYaga, elle semble s’engager dans une forme de cannibalisme sublimé, voiresymbolique : elle donne à la poupée la nourriture qui aurait dû la nourrir, qui aurait dûêtre incorporée dans son propre corps, un don symbolique de sa propre chair22. Ce donsuggère peut-être une part de sacrifice dans la notion de l’échange, mais il faut noterqu’il est loin d’être sans intérêt personnel. Vassilissa ne se sacrifie pas sans attendreune récompense concrète de celui qui reçoit. En fait, Mauss note que dans les systèmesd’échange de dons, bien qu’un objet puisse être donné sous l’apparence d’un cadeau, ledon porte toujours des implications d’obligations et d’exigences de remboursement23.
20 Le conte La Baba Yaga confirme l’aspect intéressé des échanges entamés par leprotagoniste. Comme le suppose le topos de la gentille petite fille, la participation del’héroïne aux échanges avec la communauté assure le succès de sa fuite. Cependant,c’est l’héroïne elle-même qui propose ces échanges aux serviteurs de Baba Yaga : elledonne un foulard à la servante pour mouiller les bûches du feu sur lequel elle devraitêtre cuisinée, du jambon au chat pour qu’il ne lui arrache pas les yeux, du pain auxchiens pour qu’ils ne la mettent pas en pièces, de l’huile au portail pour la laisser passersans grincer, un ruban au bouleau pour qu’il ne l’égratigne pas24. Le don de lanourriture, ou d’un autre type de ressource essentielle, occupe le devant de la scène :comme Vassilissa, l’héroïne de ce conte change le système égoïste de consommation deBaba Yaga pour son propre système de consommation partagée. Lorsque Baba Yagainterroge ses serviteurs pour découvrir pourquoi ils l’ont trahie, ils se plaignent qu’ellene leur a jamais payé leurs services, tandis que la fillette était prête à établir unsystème de contrepartie.
21 Cette plainte met l’accent sur le besoin de réciprocité pour gérer une société, mais aussisur les attentes des participants à cette société. Si Les Oies Sauvages enseigne que l’on nepeut pas recevoir sans donner, La Baba Yaga suggère que personne ne donne sansattendre une récompense. Même la générosité de l’héroïne n’existe pas sansobligations : dans la même phrase où elle donne un foulard à la bonne comme un« cadeau », elle lui présente la contrepartie de ce don (empêcher le progrès du feu pourla cuisiner). Elle ne donne pas simplement par pure bonté de cœur, mais dans l’attenteque ses cadeaux soient rémunérés. C’est-à-dire que les échanges dans lesquels elles’engage ressemblent moins à un partage commun égal qu’à un acte marchand, unevente et un achat de services. Le système d’échanges qui gouverne la société est unsystème qui cache des traces de mercantilisme : la rencontre avec le cannibalisme deBaba Yaga enseigne au protagoniste, et aux autres membres de sa communauté, lavaleur commercialisable de leurs services.
22 En gérant les marchandises avec les serviteurs de Baba Yaga, la fille effectue unetransformation non seulement de la nature du système de l’échange, mais aussi de son
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
38
propre statut dans ce système. Elle se convertit de victime de cannibalisme et objetd’échange (elle a été envoyée par sa belle-mère à Baba Yaga pour être dévorée) envainqueur de Baba Yaga et actrice de l’échange, donatrice et receveuse. En changeantsa position dans le schéma objet-donneur-bénéficiant, elle échappe à la menaceimmédiate du cannibalisme. Cependant, à travers les obligations qu’elle impose auxcréatures qui l’entourent25, à travers l’aisance avec laquelle les serviteurs de Baba Yagala servent elle à la place de leur maîtresse originelle, le texte semble entretenir l’idéed’une ressemblance entre Baba Yaga et sa victime d’autrefois. 2.4. Une transformation de victime : ressemblance victime-BabaYaga
23 Les récits qui mettent en scène le motif du four examinent cette possible similaritéentre Baba Yaga et sa victime plus en détail. La substitution de la victime nous présenteun des cas rares où le conte narre la réalisation du cannibalisme de Baba Yaga :ignorante de la ruse du héros, Baba Yaga mange sa propre fille. En transformant lavictime, le conte arrive à transformer la nature de la consommation racontée. Si ladévoration du héros violait les exigences de la morale du conte où le Bien doit vaincrele Mal, la dévoration de la fille complice maintient le cannibalisme dans ce systèmemoral26.
24 Qui plus est, le fait que Baba Yaga ne mange que sa propre fille renferme saconsommation transgressive dans sa propre communauté familiale, et assure qu’elle necorrompt pas le reste de la société humaine. Dans les exemples les plus extrêmes duconte, La Baba Yaga et Dégourdi, Prince Daniel, c’est la Baba Yaga elle-même qui estenfermée et qui périt dans le four : sa menace est radicalement éliminée, elle ne troubleplus la société27.
25 Elle effectue donc un échange de place avec sa victime, qui est elle-mêmemétamorphosée de victime en vainqueur, d’enfant innocent en protagoniste habile.Cette progression de position vulnérable en position de pouvoir affirme l’intégration duhéros dans la société. Elle confirme l’idée de la rencontre avec Baba Yaga comme d’unesorte d’acte d’initiation. La plupart des protagonistes sont des petits garçons, etAndreas Johns considère le refus du héros d’entrer dans le four comme une ruptureavec la mère (Baba Yaga), un refus de rentrer dans son ventre (le four)28. Nous ajoutonsque le héros quitte son statut d’objet de prise en participant à l’échange, l’aventureraconte donc l’entrée du protagoniste dans la société adulte, sa prise de consciencequ’il peut participer à des systèmes d’échange qui gouvernent cette société. Néanmoins,le fait qu’il rôtit Baba Yaga et ses filles avec une telle jubilation suggère qu’il peut agircomme l’analogue de Baba Yaga : il adopte le rôle de Baba Yaga avec une alacrité quidément la séparation des mondes de Baba Yaga et du protagoniste et l’effort d’affirmerles valeurs de la société à laquelle le protagoniste appartient en éliminant lecannibalisme de Baba Yaga ou en l’enfermant dans un système familial clos.
26 En effet, le conte de Prince Daniel suggère que l’exclusion des traits indésirables incarnéspar Baba Yaga est loin d’être sans ambiguïté. Au lieu de duper et brûler la fille de BabaYaga, l’héroïne forge une communauté avec elle – la fille dérobe l’héroïne aux yeux deBaba Yaga en la transformant en aiguille, elles enferment Baba Yaga dans le fourensemble, et la fille finit par épouser le frère de l’héroïne29. Ce parent proche de BabaYaga, même si elle aide le héros, ne parvient pas à se purifier des indices inquiétants du
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
39
cannibalisme de sa mère : en transformant l’héroïne en aiguille elle lui fait subir lamême métamorphose en objet inanimé que la Baba Yaga cannibale voulait effectuer.L’intégration de cet enfant de Baba Yaga dans la société par le mariage suggère doncque la frontière claire que les contes essayent de construire entre le système égoïste,antisocial et hors la société de la cannibale Baba Yaga et le système réciproqued’échange et de communauté du protagoniste n’est pas sûre et infranchissable. Lesystème social de partage communautaire abrite toujours la possibilité de l’égoïsme ducannibalisme. Encore plus inquiétant : la fille de Baba Yaga ressemble à la sœur siparfaitement qu’elles sont indistinctes, ce qui suggère le manque essentiel dedifférence entre la souillure de Baba Yaga que le conte essaie d’exclure et les valeursqu’il soutient.
Conclusions
27 Le cannibalisme de Baba Yaga peut être une force très utile pour forger la société. Leséchanges auxquels les protagonistes doivent participer pour y échapper leurpermettent l’entrée dans une communauté et définissent les limites de cettecommunauté. Une démarcation claire est construite entre le monde de Baba Yaga, oùl’on prend sans payer et où l’on ne partage pas, et le monde du héros, où les échangessont réciproques et produisent un profit mutuel. La construction de ce systèmed’échanges suggère à la fois l’idéalisme et le mercantilisme : il enseigne laresponsabilité envers la communauté (l’obligation de recevoir et de rendre) et aussi unsentiment de droit (l’attente qu’à tour de rôle on sera récompensé). Cependant lecannibalisme est essentiellement un acte qui transgresse des frontières, entrel’humanité et l’animalité, l’animé et l’inanimé, le comportement acceptable et ce quidoit être exclu. Nous soutenons que malgré leurs efforts, les contes ne réussissent pas àse purger complètement des implications du cannibalisme de Baba Yaga, neparviennent pas à ériger une frontière définitive entre le monde de Baba Yaga et lenôtre. L’ambiguïté qui en résulte rappelle que cela peut toujours resurgir dansl’individu et dans la communauté et appelle à une nécessaire vigilance. En effet, aucours des échanges dans lesquels les protagonistes s’engagent pour échapper auxgriffes de Baba Yaga, ils peuvent finir par lui ressembler plutôt que se différencier deson mode de vie. Au bout du compte, l’échange entre ces mondes qui est le sens de larencontre entre Baba Yaga et le protagoniste déstabilise toujours la tentative de lesséparer.
BIBLIOGRAPHIE
Afanassiev, Alexandre Nikolaiévitch, Contes populaires russes, t. I, trad. Lise Gruel-Apert, Paris,Imago, 2009.
Arens, W., The Man-eating Myth : Anthropology and Anthropophagy, New York, OxfordUniversity Press, 1979.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
40
Avramescu, Catalin, An Intellectual History of Cannibalism, Princeton, Princeton UniversityPress, 2011.
Balina, Marina, Goscilo, Helena, et Lipovetsky, Mark, (dir.), Politicising Magic : An Anthology ofRussian and Soviet Fairy Tales, Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 2005.
Guest, Kristen (dir.), Eating Their Words : Cannibalism and the Boundaries of Cultural Identity,Albany, State University of New York Press, 2001.
Johns, Andreas, Baba Yaga : The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folktale, New York,Peter Lang, 2004.
Kilgour, Maggie, From Communion to Cannibalism : An Anatomy of Metaphors of Incorporation,Princeton, Princeton University Press, 1990.
Mauss, Marcel, The Gift : The form and reason for exchange in archaic societies, trad. W. D. Halls,Londres, Routledge Classics, 2002.
Propp, Vladimir, Les Racines historiques du conte merveilleux, Paris, Gallimard, 1983.
Reeves Sanday, Peggy, Divine Hunger : Cannibalism as a Cultural System, Cambridge, CambridgeUniversity Press, 1986.
Singer, Eliot A., « The narrative functions of food in Afanas’ev’s fairy tales », Semiotica, 57, 1985,p. 339-368.
Sinnett-Smith, Jane, « Dents d’acier et enfants rôtis : Baba Yaga et le cannibalisme », in LETAP(collectif), Baba Yaga. Workshop., Paris, Éditions l’Imprimante, 2014, p. 48-59.
Steel, Karl, How to Make a Human : Animals and Violence in the Middle Ages, Columbus, OhioState University Press, 2011.
NOTES1. Tous les textes étudiés se trouvent dans A. N. Afanassiev, Contes populaires russes (cité CPR infra),Tome I.2. On a identifié ce conte exceptionnellement long et détaillé comme une création plutôtlittéraire que folklorique. Voir A. Johns, Baba Yaga: The Ambiguous Mother and Witch of the RussianFolktale, p. 117.3. M. Kilgour, From Communion to Cannibalism: An Anatomy of Metaphors of Incorporation, p. 4.4. A. N. Afanassiev, CPR, p. 141.5. Karl Steel, How to Make a Human: Animals and Violence in the Middle Ages, p. 124.6. A. N. Afanassiev, CPR, p. 137.7. Nous examinons cet épisode également dans J. Sinnett-Smith, « Dents d’acier et enfants rôtis :Baba Yaga et le cannibalisme », p. 49-50.8. A. N. Afanassiev, CPR, p. 153.9. Pour une discussion du rapport entre la communion et le cannibalisme, voir M. Kilgour, op. cit.,p. 15-18 ou W. Arens, The Man-eating Myth : Anthropology and Anthropophagy, p. 16, p. 160.10. M. Balina, H. Goscilo et M. Lipovetsky, (dir.), Politicising Magic: An Anthology of Russian andSoviet Fairy Tales, p. 13.11. J. Sinnett-Smith, op. cit., p. 49.12. V. Propp, a notamment étudié Baba Yaga comme un personnage central dans le « rited’initiation » subi par le protagoniste, voir Les Racines historiques du conte merveilleux, p. 142.13. A. N. Afanassiev, CPR, p. 142.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
41
14. Ibid., p. 156—157.15. J. Sinnett-Smith, op. cit., p. 57.16. A. N. Afanassiev, CPR, p. 161.17. M. Mauss, traduit par W. D. Halls, The Gift: The form and reason for exchange in archaic societies,p. 6.18. Ibid., p. 50.19. E. Singer, « The narrative functions of food in Afanas’ev’s fairy tales », p. 362.20. « Vassilissa […] se mit à retirer du four plats et rôtis : il y en avait bien là pour dix personnes[…] La vielle but et mangea tout. » A. N. Afanassiev, CPR, p. 143.21. « Écoute-moi, Vassilissa [dit la mère] […] Je meurs et, avec ma bénédiction, je te laisse cettepoupée […] Chaque fois que tu seras en peine, offre-lui de la nourriture et demande-lui conseil. »Ibid., p. 140.22. Nous étudions le rapport entre le cannibalisme de Baba Yaga et les consommationsalternatives proposées par ses victimes d’un autre point de vue dans J. Sinnett-Smith, op. cit.,p. 53-54.23. M. Mauss, op. cit., p. 3-4.24. A. N. Afanassiev, CPR, p. 136—137.25. Ainsi que celles qu’ils lui imposent dans Les Oies Sauvages et Vassilissa la Belle.26. J. Sinnett-Smith, op. cit., p. 50.27. A. N. Afanassiev, CPR, p. 152 et p. 166.28. A. Johns, op. cit., p. 99.29. A. N. Afanassiev, CPR, p. 165-167.
RÉSUMÉSCet article examine la manière dont la consommation cannibale de Baba Yaga fonctionne au seindes rapports divers établis entre la sorcière et ses victimes. Il suggère que le cannibalisme est lefoyer d’un réseau d’échanges entre Baba Yaga et la victime, entre la victime et les autresmembres de la société, entre les mondes différents. Ces échanges provoquent une série detransformations qui établissent les limites de ce qui peut être incorporé à la société, et de ce quidoit être exclu.
This article examines the ways in which Baba Yaga’s cannibal consumption works within acontext of the various relationships established between the witch and her victims. It argues thatcannibalism is home to a network of exchanges between Baba Yaga and her victim, between hervictim and the other members of their society, between different worlds. These exchangesprovoke a series of transformations that establish the limits of what can be incorporated intosociety, and what must be excluded.
INDEX
Mots-clés : cannibalisme, échange, donKeywords : cannibalism, exchange, gift
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
42
AUTEUR
JANE SINNETT-SMITH
Jane Sinnett-Smith est étudiante à University College London. Elle se spécialise dans la littératurefrançaise médiévale et prépare une thèse sur l’utilisation des reliques comme objets de foi, demerveille ou de préoccupation dans la littérature sé[email protected]
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
43
Baba Yaga pourra-t-elle jamais êtrebelle et bonne ?1
Magdalena Cabaj
1 Il était une fois un vieil homme et une vieille femme qui avaient un fils, VladimirPropp. Propp, poussé par le désir de trouver l’explication et la signification du contepopulaire, est parti en voyage dans un autre royaume à la recherche de la« grammaire » du conte et de ses racines. À mi-chemin il a vu la petite isba et la BabaYaga à l’intérieur.
2 L’enjeu de cet article sera, par l’analyse de l’ambiguïté de la Baba Yaga, de montrer saprovenance divine, qui implique l’hypothèse d’un matriarcat. Propp est à l’origine de laprincipale explication de la signification de la Yaga. Le personnage de la sorcièreapparaît dans ses trois ouvrages : Morphologie du conte, Les Racines du conte et dans LesTransformations des contes merveilleux. De cette façon il propose deux approchesdifférentes : synchronique-analytique et diachronique-comparative, qui ensemblecomposent une analyse complexe et cohérente de la vieille habitante de la cabane surpattes de poule. Nous nous concentrerons sur les recherches dans lesquelles il faitremonter la Baba Yaga à d’anciennes religions (un hymne du Rig-Véda) et sur le rôle dela Baba Yaga dans le rite de passage, inscrit surtout dans la forme fondamentale de lavariante masculine du conte.
3 Ensuite, la question figurant dans le titre « Baba Yaga pourra-t-elle jamais être belle etbonne ? » nous encourage à percevoir l’histoire de la sorcière russe comme inachevée.L’origine historique de la sorcière vue comme une déesse dégradée ressemble à la thèsesoutenue par des féministes engagées dans le « mouvement de la déesse » (GoddessMovement). Nous essayerons de voir le parallèle entre la situation de ce personnage descontes populaires russes et la motivation de l’activité politique de certaines féministes.Sous cet angle, nous espérons que la Baba Yaga pourra être perçue comme unemétaphore heuristique de ce mouvement.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
44
1. La Baba Yaga hier et aujourd’hui
4 Qui a peur de la Baba Yaga ? Aujourd’hui la Baba Yaga n’effraie que les plus jeunes.Dans les pays slaves les parents n’hésitent pas à recourir aux contes qui mettent enscène cette sorcière cruelle pour discipliner leurs enfants. La vieille et laide habitantede l’isba située à l’orée de la forêt a toujours envie de rôtir les enfants désobéissantsdans son four. Cependant cela n’a pas toujours été le cas. À une époque lointaine notrehéroïne semblait beaucoup plus dangereuse et faisait sérieusement peur même auxadultes. Nous pensons ici à son incarnation la plus ancienne, la Grande Déesse quiprobablement régnait sur le monde préhistorique.
1.1. La Baba Yaga et la religion
5 Dans Les Transformations des contes merveilleux, Propp met en relief des interconnexionsentre les religions et les contes. Il donne plusieurs exemples pour illustrer l’hypothèseselon laquelle « tout élément des religions disparues aujourd’hui est toujourspréexistant à son utilisation dans un conte2 ». Il écrit aussi que les formes du contedéfinies comme fondamentales « sont visiblement liées aux anciennes représentationsreligieuses3 ». C’est le cas de la Baba Yaga, dont Propp reconnaît certains traitssignificatifs dans un hymne du Rig-Véda4 :
Maîtresse des forêts, maîtresse des forêts, où disparais-tu ? Pourquoi ne poses-tupas de questions sur le village ? N’as-tu pas peur ?Quand les grands cris et le gazouillement des oiseaux retentissent, la maîtresse desforêts se sent comme un prince qui voyage au son des cymbales.Il te semble alors que des vaches paissent. Tu penses alors apercevoir, là-bas, unechaumière. On entend un cri le soir, comme si une charrette passait. C’est lamaîtresse des forêts. Quelqu’un appelle la vache là-bas. Quelqu’un abat des arbreslà-bas. Quelqu’un crie là-bas. Ainsi pense celui qui passe la nuit chez la maitressedes forêts.La maîtresse des forêts ne te fait pas mal, si toi tu ne l’attaques pas. Tu goûtes à desfruits doux et tu t’étends pour le repos selon ton plaisir.Je glorifie celle dont émane un parfum d’herbe, celle qui ne sème pas, mais quitrouve toujours sa nourriture, la mère des bêtes sauvages, la maîtresse des forêts5.
6 Propp remarque que l’on peut trouver dans cet hymne plusieurs éléments du contecomme :
la chaumière dans la forêt, le reproche lié aux questions (il est donné dans un ordreinverse), l’hospitalité (elle l’a nourri, lui a donné à boire, lui a offert le gîte),l’indication de l’hostilité possible de la maîtresse des forêts, l’indication de cequ’elle est la mère des bêtes sauvages6.
7 et même un morceau de bois à la charrette. Il souligne aussi qu’ « on ne peut pasconsidérer ce parallèle comme une preuve que notre Baba Yaga remonte au Rig-Véda7 »,néanmoins cela atteste que « d’une façon générale, c’est de la religion8 au conte que sedessine le mouvement et non pas l’inverse9 ».
8 Le nœud du problème réside dans ce qu’on peut faire avec une telle observationaffirmant l’existence d’un parallèle entre la poésie épique religieuse et les contes. SelonPropp, le folkloriste doit se confronter à deux possibilités. D’après la première il estfavorable à « la genèse indépendante des espèces », donc il traite ces deux phénomènescomme indépendants. Par conséquent, un parallèle entre eux nous apparaît commeaccidentel. D’après cette optique nous examinons les contes et leurs variantes en les
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
45
traitant comme un tout, et de telles recherches « […] mènent à une comparaison soiterronée soit impossible ». Conformément à la deuxième possibilité, on demeure plutôtdu côté de l’évolutionnisme, en admettant que « cette morphologie est interprétéecomme la conséquence d’un certain lien génétique, et c’est la théorie de l’origine parmétamorphoses ou transformation remontant à une certaine cause ». Celle-ci est lapiste de Propp10. 1.2. La place de Baba Yaga dans la Morphologiedu conte
9 En essayant de remonter à la genèse des contes, Propp examine leurs liens avec lemonde extérieur (religions, mythes, coutumes, anciennes organisations sociales). Dansle même but il mène aussi des recherches sur les convergences entre les contes eux-mêmes.
10 Précédemment, les contes merveilleux se distinguaient en raison de la présence dansl’intrigue d’un élément merveilleux11. Propp pense qu’une telle typologie n’aide pas àexpliquer la signification des contes. Il traite les contes comme une langue qui possèdesa propre sémantique. Il est impossible de la comprendre sans connaître les règles debase de la syntaxe, soit la grammaire du conte. Par conséquent, l’enjeu de LaMorphologie du conte est d’analyser des convergences entre les différentes intrigues descontes populaires russes pour découvrir la structure interne du conte12. Propp observequ’une répétition spécifique caractérise ce type de narration. Il existe des élémentsstables comme certaines actions (interdiction, départ du héros) et des éléments quivarient, comme les attributs des héros. Ceci signifie que l’action est un facteur quigarantit aux fables leur cohérence. Propp qualifie de « fonction » l’action particulièrequi est nécessaire au développement de l’intrigue. Le schéma sélectionné comprend31 fonctions, la première étant « l’éloignement ou l’absence » et la dernière « le hérosépouse la princesse / monte sur le trône ». La quantité de fonctions présentées dans unconte est variable, mais en même temps leur ordre d’apparition et leur distributionparmi les types de personnage demeurent stables pour toujours. Le schéma defonctions établit un critère qui permet d’isoler les contes merveilleux des autres13.
11 Du point de vue morphologique, les rôles des personnages de conte y sont réduits auxfonctions qu’ils peuvent remplir. Ayant établi le schéma des contes, Propp distinguesept sphères d’action correspondant aux sept types de personnages qui peuventremplir certaines fonctions (la sphère d’action de l’agresseur, du donateur, del’auxiliaire, de la princesse, du mandateur, du héros, du faux-héros). Dans ce système laBaba Yaga revêt parfois un rôle d’auxiliaire involontaire, par exemple quand, en fuyant,elle montre par hasard à Ivan le chemin vers l’autre royaume. Cependant, elle demeuresurtout dans la sphère d’action du donateur dont elle est la forme la plus ancienne. Lasorcière donne l’objet magique ou des conseils aux héros. Propp dit que « L’étude dudonateur nous montre que celui-ci unit des qualités hostiles et hospitalières14. »L’ambiguïté de la Baba Yaga s’expose à travers les contes. Elle est tantôt amicale ethostile, tantôt elle a des penchants cannibales. Cette diversité au niveau formel estdéterminée par des éléments qui précèdent son apparition dans la narration. Lasorcière peut occuper la place du donateur de deux façons : bienfaisante – elle régale lehéros de nourritures aux propriétés magiques ; hostile – elle essaie de dévorer lesenfants. Son comportement diffère également en fonction du sexe du héros, entre les
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
46
contes « féminins » (par exemple Vassilissa la Belle) et « masculins » (Ivan Taurillon)15.Nous pouvons essayer de trouver la cause de cette double nature de la Yaga dans sapréhistoire. 1.3. Les Racines historiques du conte merveilleux
12 Ensuite, grâce à l’étape morphologique, Propp aborde la sémantique du conte dans sondeuxième grand ouvrage, Les Racines historiques… Il cherche la genèse des contes (bienqu’il soit conscient qu’il n’existe pas d’explication absolument certaine). Le chercheurrusse montre que la composition du conte est enracinée dans la réalité historique.
13 Selon Propp, pour dater la genèse du conte, il faut faire attention aux rapports deproduction qui y sont présents et penser au système social qui leur correspond. Il voitdans les contes certains réflexes d’un système plus ancien que le capitalisme et mêmeque le féodalisme. Dans le monde du conte la chasse est beaucoup plus fréquente quel’agriculture. Les institutions du mariage appliquent la règle de l’exogamie. Lemécanisme de transmission du trône ne procède pas en ligne droite. De tels facteurspeuvent révéler un peu le monde caché dans les contes. Sans doute, ils nous évoquentun monde très ancien. 1.3.1. Le rite de passage
14 Propp propose une hypothèse selon laquelle la structure spécifique de narration duconte merveilleux est le résultat de l’ordre interne des rites de passage et de la visioneschatologique de la communauté ancestrale. Dans « La forêt mystérieuse », le chapitredans Les Racines… il explique que la Baba Yaga jouait probablement un rôle importantdans ces deux évènements. Nous pensons avec Propp que la Yaga est liée à la visioneschatologique de la société ancestrale et au rite d’initiation. Elle présidaitprobablement ce rite. Dans ce schéma, elle remplit une place particulièrementimportante : elle est la gardienne de la frontière entre le monde des vivants et celui desmorts16. En même temps, ses attributs (la jambe d’os) sont aussi liés au royaume de lamort. Ces deux aspects de la vie, la mort et l’initiation, demeurent très proches. Lesgens qui viennent dans l’isba de la Baba Yaga veulent aller au-delà. Ils peuvent nejamais revenir, mais s’ils reviennent, ils se révèlent comme autres, comme despersonnes mûres17. La maturation est le but du rite de passage. Le garçon qui le réussitdevient membre de plein droit de sa société.
15 Dans toutes les cultures étudiées, ces rites ont toujours lieu dans la forêt ou dans unespace géographique équivalent, au milieu des faune et flore sauvages et effrayantes.Voilà pourquoi dans la plupart des contes un héros pénètre la forêt et la quitte après laconfrontation avec la Baba Yaga. Cela explique pourquoi la maison de la sorcière setrouve au milieu des arbres. La route à travers la forêt conduit également vers leroyaume des morts qui est fortement associé à ce rituel. Il se caractérise par unebrutalité particulière : les adeptes sont brûlés et torturés. Ce motif est présent dans leconte quand la sorcière veut brûler et manger les enfants. De plus, dans ce rite il existel’étape importante de mort temporaire. Pendant le rite le garçon est tué afin quel’homme puisse naître. Il faut dire que les enfants, en entrant dans la forêt, sonttoujours confrontés avec une sorte de mort.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
47
16 Sachant qu’une fonction fondamentale de ce rite est surtout la préparation du garçonau mariage, ce n’est pas une surprise que la plupart des contes traitent d’un jeunehomme qui quitte la maison familiale pour trouver sa future femme dans un payslointain. (Il semble que cet aspect incarne la règle de l’exogamie). Dans les contes, laBaba Yaga n’a jamais de lien avec le héros, au contraire elle peut être la cousine d’unemarâtre d’une héroïne. C’est-à-dire qu’elle vient d’une communauté avec laquelle lacommunauté d’une personne initiée a l’habitude de célébrer des mariages. Ensuite,Propp rappelle les rites de passage marqués par une sorte de travestissement (parexemple en Océanie). Là-bas, pour la durée du rituel les responsables de la cérémonie sedéguisent en femmes.18 Il est probable que ce fût aussi une vieille femme dans cetteautre société qui menait le rite. On peut se demander pourquoi une femme mène unrite où ne peuvent participer que des hommes. Il est difficile de donner une réponseexacte, mais Propp partage quelques intuitions à ce sujet. Il pense que le rôle d’unefemme ne peut pas être aussi important dans un système patriarcal, et que la présencede la Baba Yaga dans ce rite est le signe d’une société matriarcale. 1.3.2. Disparition du rite et naissance du conte
17 D’après Propp, pendant le rite de passage, on narrait au garçon initié ce qui se passait.De la même façon, pendant le rite funéraire, le président de cérémonie narrait étapepar étape l’histoire de l’âme errante dans l’au-delà. D’amples recherches montrent quel’intrigue du conte merveilleux partage la même chronologie que celle de la narrationancestrale. D’où l’hypothèse selon laquelle le conte est né au moment du changementou de la disparition des rites et que son intrigue est plus ancienne que le genre du conteen soi. Les rites commencent en effet à disparaître à l’époque où les divinités de la forêtsont détrônées par les divinités agraires et la chasse par l’agriculture. Sous cet angle,un conte est vu comme un mythe désacralisé, et la Baba Yaga semble être une déessedégradée, une ancienne maîtresse de la forêt.
1.4. Le conte comme carnaval : la physiologiede la Baba Yaga
18 Nous développerons les idées de Propp selon lesquelles la disparition des rites depassage et les changements du système social sont illustrés dans les contes par lesmécanismes d’inversion du pouvoir de la Yaga contre elle-même. Le premier exempled’inversion est celui des yeux de la sorcière. Pendant le rite c’était un candidat qui avaitles yeux bandés ou collés. Dans le conte c’est la Baba Yaga qui est malvoyante. Aucontraire, selon les croyances anciennes, la Déesse mère était extralucide.Deuxièmement, on observe la même chose avec le feu : c’est la sorcière qui est brûlée,pas les enfants passant par le rite. Le conte semble un monde à l’envers, la protestationcarnavalesque et tardive contre la religion qui a disparu. Le conte se moque de l’ordrepassé.
19 Le changement du système social et religieux affectait probablement l’apparencephysique de la Yaga. D’après l’observation d’Andreas Johns19, la physiologie de la BabaYaga est toujours plus soulignée dans les variantes masculines des contes20. Dans ce cas-là, ses traits féminins sont fortement marqués et exagérés : « […] des seins énormes, lesmamelles posées sur l’étagère, de l’isba bondit la baba Yaga, le cul noueux21 […] ».
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
48
20 Si on voulait aller plus loin dans l’analyse des déformations successives probables de laYaga, on pourrait même imaginer que la Yaga était jolie dans sa jeunesse… Mais la Yagadans les contes est toujours vieille. De plus Propp remarque que :
L’hypertrophie de ses organes de reproduction ne correspond à aucune fonctionconjugale. Peut-être est-elle pour cela toujours vieille. Symbole de son sexe, elle n’apas de vie sexuelle. Elle est mère, mais elle n’épouse ni dans le présent ni dans lepassé22.
21 Elle est une vieille femme sans mari… Elle est soit seule, soit elle a des sœurs cadettesou des filles. Dans sa famille il n’y a jamais de garçons. Cela pourra nous rappeler lesAmazones. Autrement dit, la Yaga avec sa famille remonte à un stade où la féconditéétait considérée comme une œuvre féminine, indépendante de la participationmasculine.
2. Matriarcat
22 Comme le rôle de l’homme dans la procréation était plutôt mystérieux à la préhistoire,la croyance commune était que la femme seule était capable de ce qu’on appelleaujourd’hui la parthénogenèse. Pour cette raison, selon Johann Jakob Bachofen, lafemme a été marquée par la créativité naturelle, et deviendra l’objet d’une permanentejalousie masculine.
23 Bachofen était le premier à s’intéresser au système non patriarcal. C’est lui qui a mis encause la conviction selon laquelle l’ordre patriarcal est absolu et constant. Dans sonouvrage Le Droit maternel, recherche sur la gynécocratie de l’Antiquité dans sa naturereligieuse et juridique, en examinant la culture antique, il essaie de trouver des preuvesdu fait qu’à une époque lointaine le système gynocratique domine. Ce chercheur suissequalifie un tel ordre de « droit maternel », car il se construit autour de la famillematrilinéaire. Selon lui, le matriarcat précédait le patriarcat et la relation entre eux estdialectique.
24 Les chercheurs n’ont pas pu trouver de preuves historiques de l’hypothèse de Bachofen.Au contraire, elle a été profondément critiquée23. Néanmoins, la perspectivecontroversée de Bachofen continue d’inspirer24. Malgré le rejet de celle-ci, c’est lui qui apris le risque de dire que la structure patriarcale est relative. Sans doute, cettesupposition ouvre la discussion…
25 Même si Bachofen attribue à la femme une force unique et positive, cela ne lui vaut pasl’adhésion des féministes, puisqu’il traite l’époque de domination des femmes commeun temps non seulement plus primaire mais aussi plus primitif que le patriarcat.
26 C’est Marija Gimbutas qui dans ses recherches archéologiques reprend l’hypothèse dumatriarcat privée d’une valeur péjorative25. Elle présente dans son travail la « culturepréhistorique de la déesse » née à la période paléolithique. Ses recherches demeurentune source d’inspiration pour certaines féministes. Quant aux recherches sur la BabaYaga, le concept de Gimbutas inspire Michael Shapiro pour écrire une interprétation dela Baba Yaga comme déesse-oiseau paléolithique qui au Néolithique prend une formeplus humaine26. Pareillement Stella Richards fonde sur les recherches de Gimbutas savision de la sorcière russe comme déesse androgyne27. Nous avons déjà dit que selon lesrecherches de Propp, la maîtresse de la forêt est la plus vieille forme de la Yaga. Sespouvoirs sur les animaux et son isba sur pattes de poule confirment une phase de
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
49
transition de l’animal vers l’homme. Une telle hybridation semble caractéristique duchamanisme, du totémisme et surtout du culte de la Déesse mère (ou Grande Déesse),qui souvent était imaginée comme une hybride d’une femme et d’un oiseau (lapatronne des bêtes des bois).
3. Le féminisme et la Yaga – l’avenir commun ?
27 Jusqu’ici nous avons vu que l’idée de matriarcat est importante pour la compréhensionde la Baba Yaga. Y a-t-il une fin à cette histoire ? Au niveau des recherches sur lescontes malheureusement oui. Cependant il est encore possible que la Baba Yaga soitlibérée de son rôle ingrat et donne son témoignage de l’oppression masculine qu’elleéprouve. Le « mouvement de déesse » se développe en nourrissant des biographiescomme celle de la Baba Yaga. Nous le regarderons un peu pour voir commentl’hypothèse du matriarcat et une figure de sorcière peut gagner de la visibilitépolitique.
3.1. « Mouvement de déesse »
28 L’hypothèse du matriarcat a vécu sa renaissance (plutôt politique que historique) dansles années 70 aux États-Unis, par le lancement d’un « mouvement de déesse » (GoddessMovement) qui malgré plusieurs critiques continue à se développer jusqu’à maintenant.L’enjeu de ce mouvement est de nier le patriarcat en tant que système permanent. Lespartisans cherchent de l’inspiration surtout chez des chercheurs comme MarijaGimbutas. Une conviction ou plutôt une hypothèse selon laquelle la religion de laGrande Déesse est plus ancienne que les autres est caractéristique de ce mouvement28.
29 Bien que, pour les féministes, une telle croyance soit un facteur essentiel, on peut aussiobserver qu’elles ne cherchent pas des motivations strictement historiques. Il estimportant que, même si le matriarcat n’a jamais existé, une telle idée resteparticulièrement séduisante pour les femmes qui désirent imaginer elles-mêmes unsystème en dehors du patriarcat, pour les femmes qui veulent se renforcer et quiluttent pour établir une définition positive de la féminité. L’idée du matriarcat permetalors de repenser la femme comme sujet indépendant.
30 Ainsi Kathryn Rountree dans son article « The Politics of the Goddess : FeministSpirituality and the Essentialism Debate » présente en bref l’histoire du mouvementdont nous parlons. Cet article commence avec les débuts du mouvement aux États-Uniset, grâce aux recherches pertinentes menées par l’auteur, continue avec sa réceptioncontemporaine en Nouvelle Zélande. Ensuite, elle approche leurs philosophies oùdomine l’unique vision d’une femme restée très proche de la divinité ancienne. Enfin,elle essaie de repousser le reproche selon lequel le mouvement de déesse retourne àl’essentialisme29. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que l’auteur de cetarticle interprète favorablement les idées du mouvement, qui ne semblent pas être trèsprécises, et qui probablement n’ont pas besoin de plus de précision. Il y a surtout deuxchoses qui nous intéressent ici. Premièrement, l’effort du mouvement orienté contre ladichotomie largement comprise. Deuxièmement, l’utilité de la figure de la sorcière dansle mouvement féministe, qui nous fait penser à la Baba Yaga.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
50
3.2. Sorcières féministes
31 WITCH (Internationale Terroriste Conspirancy from Hell) a été établi dans les années 1960aux États-Unis pour réunir plusieurs féministes socialistes. L’acronyme a rapidementgagné en popularité grâce à sa sonorité charismatique. La sorcière a commencé à servirde métaphore de l’effrayante féminité « déviante » (« frightening and “deviant”womanhood30 »). Pendant la fête d’Halloween 1968 les activistes de WITCH ont donnéleur première performance. Elles se sont déguisées en sorcières et ont présenté leurspostulats en public à New York. Puis, le groupe, au cours de son activité, a continuéd’organiser des rites pour conserver une visibilité sociale. Ces rites, contrairement auxrites de passage auxquels participe la jeune Baba Yaga, n’avaient qu’une valeurthéâtrale, et étaient privés de spiritualité. De cette façon, ce qui jusque-là était perçucomme des contes pour enfants devient la réalité. Les rites répétés comme desperformances permettent de voir dans le spiritualisme une signification politique.
32 Dans l’étape suivante, les activistes s’intéressent à la chasse aux sorcières lancée parl’Église catholique au Moyen Âge. La religion a été réduite par elles, dans ce cas-là, auhomocentrique. Elles interprètent l’activité de la persécution des sorcières comme lapeur d’un secret pouvoir féminin. Ensuite, dans les années 1970, le « mouvement dedéesse » est inspiré surtout par la théorie de l’archétype de Jung31. L’archétype de ladéesse aide les femmes à penser et parler d’elles-mêmes « hors de la “dichotomierestrictive”32 ». Le mouvement continue en même temps d’évoquer la déesse commeprincipe et les sorcières comme activistes. Les militants font attention à explorer lapotentialité métaphorique d’une telle contradiction illusoire.
33 Le but du mouvement est l’accentuation des relations entre les images positive etnégative de la femme. La première, soit la déesse, évoque le temps perdu du matriarcat.La deuxième, soit la sorcière, est le résultat d’une perspective homocentriquedéfigurante. Dans cette explication nous voyons le parallèle avec la genèse del’ambiguïté de la Baba Yaga. La déesse et la sorcière disposent pareillement de forcesuniques. Selon les féministes, les deux présentent la même idée de la femmeindépendante et forte. Elles unifient Hécate et Athéna, la Baba Yaga et Déméter, ladame de la vie et la reine de la mort. La déesse/sorcière est la figure liminaire quiembrasse le monde entier33. La séparation des deux aspects, positif et négatif, est laconséquence de la tentative d’affaiblissement du rôle des femmes dans la société.
34 Pour cette raison, la Baba Yaga, la vieille maitresse de la forêt, est devenue une vieillefemme cannibale, maladroite, caricaturale. Au niveau superficiel on pourra même direqu’elle incarne le stéréotype de la féministe laide. Voici la Baba Yaga, privée de sa forcemagique, vieille comme la plus ancienne religion du monde et si faible que même ungarçon est capable de la tuer.
35 La Baba Yaga comme personnage de contes russes a une connotation très négative. Elleeffraie les enfants, elle a des penchants pour le cannibalisme. Cependant elle remplit lafonction de donatrice dans le système de Propp. C’est elle qui donne à boire et à mangerau héros. Grâce à elle le héros pourra obtenir l’objet magique, un cheval qui l’emmènedans l’autre royaume et lui permet de finaliser sa mission. Nous voyons la Yaga commedonatrice dépendant des règles de transformation et du schéma téléologique du conte.Mais elle aide si elle peut. Elle montre le chemin à Ivan, mais on dirait que c’est parhasard. Elle tient ses promesses, alors elle est fiable34.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
51
36 La triste histoire de la Baba Yaga, reconstruite par Vladimir Propp, introduit plusieursfacettes inspirantes. C’est la figure liminaire et chamanique, située entre denombreuses dichotomies : la vie et la mort, le bien et le mal, et même entre les genresmasculin et féminin. Propp met en relief sa provenance divine, son rôle important dansles rites de passage et au bout du compte sa dégradation douloureuse.
37 Dans la partie finale de cet article nous avons montré que certaines féministes voientl’absurdité dans les histoires comme celle de la sorcière russe. Elles essaient deréutiliser leurs schémas dans le discours politique. Nous pouvons ajouter que les contesmerveilleux et les féministes jouent avec l’absence du rite qui n’existe pas ou quin’existe plus. Les contes sont établis sur le schéma narratif du rite et les féministesimitent les rites pour capter l’attention du public.
38 Enfin on pourra conclure avec un peu d’humour : est-ce que la Baba Yaga pourrait nousservir de figure féministe ? Imaginons-nous la féministe militante défigurée, exiléedans la forêt. Il est facile de devenir fou quand auparavant on était la Grande Déesse,alors que maintenant il ne reste plus que la vie avec les bêtes de la forêt. Peut-être qu’ilfaut apprivoiser la Baba Yaga et comprendre que cette vieille femme, toute seule,limitée par l’histoire et les lois du conte, n’a pas eu la vie facile.
BIBLIOGRAPHIE
Afanassiev, Alexandre Nikolaiévitch, Contes populaires russes, trad. introd. et notes par Lise Gruel-Apert, Paris, Maisonneuve et Latose, 1988 – 1992.
Bachofen, Johann Jakob, Le Droit maternel, recherche sur la gynécocratie de l’Antiquité dans sa naturereligieuse et juridique, trad. Étienne Barilier, Lausanne, Éditions L’Âge d’Homme, 1996.
Eller, Cynthia, Myth of Matriarchal Prehistory : Why An Invented Past Will Not Give Women a Future,Boston, Beacon Press, 2000.
Fromm, Erich, Miłość, płeć i matriarchat, [L’amour, le sexe et le matriarcat] trad. Beata Radomska,Grzegorz Sowinski, Poznań, Rebis, 1999.
Johns, Andreas, « Baba Iaga and the Russian Mother », The Slavic and East European Journal, vol. 42,no 1, 1998, p. 21-36.
Johns, Andreas, Baba Yaga : The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folktale, New York, PeterLang, coll. « International Folkloristics », vol. 3, 2004.
Pellet, Sandra, « Baba Yaga : témoin ou gardienne des” institutions” pré-chrétiennes en Russieoccidentale et orientale ? » in Sandra Pellet (dir.), Baba Yaga Workshop, Paris, Éditionsl’Imprimante, 2015, p. 88-108.
Propp, Vladimir, Morphologie du conte, suivi de Les Transformations des contes merveilleux et Evguéni,Mélétinski, L’Étude structurale et typologique du conte, trad. Marguerite Derrida, Tzvetan Todorov etClaude Khan, Paris, Le Seuil, coll. « Points / Essais », 1970.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
52
Propp, Vladimir, Les Racines historiques du conte merveilleux, trad. Lise Gruel-Apert, Paris,Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 1983.
Rountree, Kathryn « The Politics of the Goddess : Feminist Spirituality and the EssentialismDebate », Social Analysis : The International Journal of Social and Cultural Practice, vol. 43, no 2, Backwaters Run Deep : Locating New Zealand Social Anthropology, 1999, p. 138-165.
Spiteri, Aurore, « Le Genre restitué. Une lecture psychanalytique de la question du genre chezBaba Yaga, in Sandra Pellet (dir.), Baba Yaga Workshop, Paris, Éditions l’Imprimante, 2015,p. 128-140.
Skotnicki, Wanda, « Baba Yaga, ou les survivances d’un maternel archaïque », in Sandra Pellet(dir.), Baba Yaga Workshop, Paris, Éditions l’Imprimante, 2015, p. 114-124.
NOTES1. Je remercie beaucoup Margaret Bilu pour son aide inestimable dans la réalisation de cetarticle.2. V. Propp, Les Transformations des contes merveilleux, p. 176.3. Propp donne des critères pour distinguer des variantes plus récentes des contes de celles quisont plus anciennes, ou « fondamentales » : l’interprétation merveilleuse d’une partie du conteest antérieure à l’interprétation rationnelle (la version avec la Baba Yaga précède celle avec unevieille femme). La version héroïque est plus ancienne que la version humoristique. La versioninternationale précède une version nationale. Cette méthode, décrite précisément dans LesTransformations… permet de distinguer aussi des variantes plus jeunes de la Baba Yaga(déterminées surtout par des facteurs géographiques) des plus anciennes représentations de lasorcière motivées par des croyances païennes. Voir V. Propp, op. cit., p. 176-184.4. Le Rig-Véda est un texte sacré, essentiel pour l’hindouisme. Il est le plus ancien des livres deVéda et il demeure même un de plus vieux textes écrits en langues indo-aryennes (certainesparties ont été créées au XVe siècle av. J.-C.). Le Rig-Véda est un recueil d’hymnes religieux« chantés à l’origine de la société indienne, accumulés par la suite des temps, et conservés dans lamémoire des races sacerdotales », voir : Alexandre Langlois, Rig-Véda ou Livre des hymnes,Maisonneuve et Cie, 1872, réédité par la Librairie d’Amérique et d’Orient Jean Maisonneuve,Paris, 1984, Introduction, p. iii.5. V. Propp, Les Transformations…, p. 178 sq.6. Ibid., p. 179.7. Ibid. p. 179.8. Propp montre que « l’étude des formes fondamentales amène le chercheur à comparer le conteaux religions. Au contraire, l’étude des formes dérivées dans le conte merveilleux est liée à laréalité. De nombreuses transformations s’expliquent par l’introduction de celle-ci dans leconte. ». V. Propp, Les Transformations…, p. 181. Comme résultat, si nous avons la même formedans un document religieux et dans un conte, la forme religieuse est primaire, la forme du contesecondaire. Cette supposition concerne surtout une religion archaïque qui est morte ou qui vientde la préhistoire. Les relations entre une religion « vivante » et le conte sont différentes.9. V. Propp, op. cit., p. 172.10. Une telle hypothèse est inspirée par le darwinisme et le marxisme (l’importance de ce derniersemble discutable, étant donné que Propp a publié ses recherches à une époque où les scienceshumaines en Russie contenaient systématiquement une telle inspiration). Nous pouvonsmentionner l’approche d’Andreas Johns, selon laquelle la théorie des contes merveilleux de
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
53
Propp est uniquement valable si toutes les sociétés s’étaient développées de la même façon. VoirA. Johns, Baba Yaga: The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folktale, p. 21-31.11. L’unité morphologique chez Propp est une partie encore plus petite qu’un « motif » chezVeselovski. Voir Alexander Nikolayevich Veselovski, Poetika sjuzhetov [Poétique des sujets]Sobranie Sochinenij, ser. 1, Poetika, t. II, vyp. 1, Saint-Pétersbourg, 1913, p. 1-133, après V. Propp,Morphologie…, p. 21-25.12. Propp examine 100 contes du recueil d’Alexandre Afanassiev numérotés de 50 à 151.13. Grâce à la connaissance de la grammaire et du vocabulaire nous sommes en mesure deproduire un discours : de même, la connaissance du schéma du conte nous permet de lecomprendre et de créer une quantité infinie de contes du même type.14. V. Propp, Les Transformations…, p. 186.15. Néanmoins, dans les deux variantes, la sorcière joue un rôle important pour le processus dematuration.16. Sur ce sujet voir aussi l’article de S. Pellet « Baba Yaga : témoin ou gardienne des« institutions » préchrétiennes de Russie occidentale et orientale ? » in Baba Yaga Workshop.17. Dans le cas du conte féminin, si la fille achève toutes les tâches, elle revient au monde desvivants sage, responsable et prête au mariage.18. Voir également l’article de A. Spiteri, « Le genre restitué. Une lecture psychanalytique de laquestion du féminin dans Vassilissa la très belle », p. 128-132.19. A. Johns, « Baba Iaga and the Russian Mother », p. 28.20. Nous pouvons interpréter cela en termes psychanalytiques : le sexe masculin dans leprocessus d’identification peut se définir par négation du sexe féminin, ou plus spécifiquementpar le fait de tuer l’image négative de la mère. Sur la réception psychanalytique de la Baba Yagavoir « Psychological Approaches » in A. Johns, Baba Yaga : The Ambiguous Mother and Witch of theRussian Folktale, p. 34-38. Sur les fantasmes de dévoration d’une mère voir W. Skotnicki, « BabaYaga, ou les survivances d’un maternel archaïque », p. 115 – 117.21. V. Propp, Les Racines du conte merveilleux, p. 94.22. Ibid.23. Voir C. Eller, Myth of Matriarchal Prehistory: Why An Invented Past Will Not Give Women a Future.24. Erich Fromm dans les années 1970 affirme que même si Bachofen s’est trompé, les recherchesanthropologiques contemporaines pourraient confirmer le mérite de ses vues. E. Fromm,« Matriarchat a męskie stworzenie świata » in Miłość, płeć i matriarchat, p. 15-50.25. Marija Gimbutas, auteur des ouvrages: The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000-3500 B.C. Myths,Legends, Cult Images, London, Thames and Hudson, 1974; The Language of the Goddess, San Francisco,Harper and Row, 1989 et The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe, San Francisco,Harper San Francisco, 1991.26. Michael Shapiro, « Baba Yaga: A Search for Mythopeic Origins and Affinities » InternationalJournal Of Slavic Linguistics And Poetics, no 28, 1983, p. 109-135.27. Stella Richards, « Baba Iaga and the Great Phallic Goddess », in The San Francisco Jung InstituteLibrary Journal, vol. 23, no 1, 2004, p. 54-66.28. « Goddess feminists claim that Goddess religion is the oldest religion of all, dating back to thePaleolithic and long pre-dating such world religions as Christianity, Judaism, Islam, Buddhismand Hinduism, […] having closer associations with shamanism and other so-called” primal”religions. […] However here I am dealing with the relatively recent phenomenon of Goddessfeminism, which, while tracing an ancient genealogy derived from a creative mix of prehistoryand mythology and expressed in a blend of political and romantic rhetoric, emerged as adistinctive movement in the Unites States during the late 1960s along with, and informed by, agreat number of other counter-cultural expressions ». K. Rountree, « The Politics of the Goddess:Feminist Spirituality and the Essentialism Debate », p. 140.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
54
29. Au début « le mouvement de déesse » était considéré comme apolitique. Néanmoins, l’auteurdonne plusieurs exemples sociologiques pour rendre visible le fait que les militantes du« mouvement de déesse », pareillement aux autres féministes, restent aussi politiquementactives. Il faut ajouter que les principes de ce mouvement sont facilement critiquables nonseulement par les féministes chrétiennes, qui ne peuvent pas accepter sérieusement un culte dela déesse mère, mais aussi par des féministes constructivistes qui voient dans ce mouvement unetrace nette d’essentialisme.30. K. Rountree, op. cit. p. 140.31. Ibid., op. cit. p. 141. Le personnage de la Baba Yaga, aperçue comme archétype de Carl GustavJung, pourrait être très adjuvant dans le processus de la différenciation de sexe, voir A. Johns,« Baba Iaga and the Russian Mother », p. 26.32. K. Rountree, op. cit. p. 141.33. Ibid., op. cit. p. 156.34. De plus, la Baba Yaga est juste, parce qu’elle récompense une fille responsable et travailleuse,mais elle punit fatalement une fille gâtée avec laquelle on ne s’identifie jamais.
RÉSUMÉSLa Baba Yaga comme personnage de contes russes a une connotation très négative. L’enjeu de cetarticle est, par l’analyse des aspects positifs de la sorcière, de montrer leur provenance divine,qui implique l’hypothèse d’un matriarcat. Nous développons les idées de Vladimir Propp selonlesquelles les traces de changements sociaux, comme la disparition des rites de passage, sontprésentes dans les contes. Grâce aux recherches présentées dans Les Racines historiques du contemerveilleux et aussi dans Les Transformations du conte merveilleux, nous voyons la Yaga comme unedonatrice ambivalente et très particulière, dotée d’attributs merveilleux, quoiqu’elle demeuredépendante du schéma téléologique du conte merveilleux.
Baba Yaga, as a character from Russian folk tales, has very negative connotations. The aim of thispaper is, in analyzing the positive aspects of her persona, to demonstrate their divineprovenance, from which stems the matriarchy hypothesis. We develop Vladimir Propp’s ideaaccording to which changes in social structure, such as the vanishing of the rites of passage, areencoded in folk tales (e. g. by an inversion of Baba Yaga’s power against herself). Building onresearch presented in Historical Roots of the Wonder Tale and Transformations of the Wonder Tale, wepropose a vision of Baba Yaga as a very peculiar and ambivalent donor endowed with magicattributes, albeit she remains dependent on the teleologic structure of the folktale.
INDEX
Mots-clés : donatrice, matriarcat, transformations du conte, Vladimir ProppKeywords : donor, matriarchy, transformations of the wonder tale, Vladimir Propp
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
55
AUTEUR
MAGDALENA CABAJ
Magdalena Cabaj est doctorante au laboratoire Les Archives Husserl à l’École normale supérieurede Paris en cotutelle avec l’Université de Varsovie auprès du laboratoire La théorie de lalittérature et de la poétique. Elle prépare une thèse sur les notions d’intersexualité et d’écriturehermaphrodite.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
56
Sorcière ou nourricière : la BabaYaga à l’épreuvede la pensée psychanalytiqueCécile Rousselet
1 « Mère nourricière – mère sorcière ». Ces deux expressions peuvent semblerantagonistes mais révèlent en réalité, dans leur conjonction, l’essence même de lareprésentation maternelle dans les contes russes. À première lecture, la mèrenourricière apparaît comme une femme totalement bonne envers son enfant, lamarâtre ou la Baba Yaga, son prolongement, comme des personnages cruels et parfoismême cannibales, dévorant les enfants comme des « poulets1 ». Pourtant, les Baba Yagaapparaissent rapidement comme des personnages véritablement ambigus, distribuantleurs pouvoirs destructeurs ou bienfaiteurs au gré des contes et des sentiers. C’est danscette vision complexe et plurielle des pouvoirs des sorcières que l’approchepsychanalytique trouve sa place dans le champ d’études des contes d’Afanassiev. Unetelle approche se fonde d’emblée sur la question du fantasme : toute analysepsychanalytique des contes en est une analyse « pragmatique ». Les Baba Yaga sont dessupports de fantasmes d’agressivité et de destructivité, au sein d’un mécanismeinconscient collectif2. Elles ne peuvent dès lors tenir un rôle unique, puisqu’ellesendossent tour à tour ceux que les interlocuteurs de ces contes veulent leur faireporter. Nous appelons ces interlocuteurs les « acteurs pragmatiques » du conte, en cesens qu’ils participent, en les écrivant, lisant et racontant, à faire vivre la composantefantasmatique des textes. Ces sorcières, que l’on pouvait considérer comme despersonnages stéréotypés, se manifestent ici dans toute leur complexité. Nous mettronsdeux contes issus du recueil d’Afanassiev, « Vassilissa la Belle3 » et « Tomassounet4 » àl’épreuve de théories psychanalytiques, celles de Sigmund Freud (sur la transpositionpulsionnelle et l’étayage des pulsions dans la libido infantile), Melanie Klein (dans sonanalyse des imagos maternelles et de la position schizo-paranoïde du jeune enfant),mais aussi les analyses proposées par Jean Bellemin-Noël, Marthe Robert, ou NicoleBelmont sur les contes et leurs fantasmes.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
57
2 Néanmoins, une telle approche psychanalytique est elle-même mise à l’épreuve par lacomplexité du matériau sur lequel elle se penche. Tout d’abord, les contes sont desstructures narratives établies5. Le conte a ses codes, et un pôle agressif inévitable dansl’économie narrative, économie que l’analyse pragmatique des Baba Yaga ne peutignorer. En outre, les contes d’Afanassiev sont des textes littéraires : il ne faut pastomber dans le piège d’un certain essentialisme, qu’une lecture psychanalytique, d’unecertaine manière, encourage. Une analyse pragmatique psychanalytique des contesrusses s’inscrit dès lors davantage dans l’étude des processus inconscients qui sous-tendent la narration – le genre féminin de la Baba Yaga dans des contes réécrits par unauteur masculin qu’est Afanassiev, fait de ce personnage par exemple un lieud’investissement fantasmatique sexuel – que dans une démarche illustrative deconceptualisations psychanalytiques figées. Le conte littéraire fait sien lesinvestissements pulsionnels qui structurent les textes et la Baba Yaga se place au cœurd’une circulation fantasmatique et poétique, dans une négociation permanente entreprocessus imaginaire et réécriture littéraire.
1. La Baba Yaga : un chaudron pulsionnel. Troisentrées par la psychanalyse
3 L’analyse psychanalytique des personnages de Baba Yaga dans les contes populairesrusses peut se faire selon trois voies. Une première entrée par la psychanalyse consisteen l’analyse du motif de l’avalement. Dans la dynamique fantasmatique du conte, avalerreprésente un retour à la fois rassurant ou menaçant au sein maternel, une symbiose laplupart du temps mortifère. Jean Bellemin-Noël, dans Les Contes et leurs fantasmes, écrit :
Créer une dépendance jusqu’à vouloir dévorer, jusqu’à vouloir récupérer l’autreintégralement. Nourrir pour avoir de quoi se nourrir. Dévorer pour ne pas risquerde perdre, de voir l’autre nous échapper6.
4 Avaler ses enfants, c’est donc les réintégrer, pendant négatif et thanatique de l’acteérotique qu’est de donner naissance. Si l’on reprend cette théorie, il s’agit donc ici,dans la dévoration par la Baba Yaga, de l’agressivité maternelle que l’enfant ressentiraitet fantasmerait dans le conte. Néanmoins, les manifestations pulsionnelles à l’œuvredans la formation de l’objet conte sont complexes, et il est impossible alors deconsidérer « la sorcière cannibale » de manière essentielle, ou même de pouvoirinterpréter de manière univoque le comportement d’une sorcière précise dans un conteprécis. La pluralité de significations que chaque acte cannibale peut offrir nous invite ànous demander si la thèse selon laquelle chaque sorcière transpose, sur le planimaginaire, le comportement hostile d’une mère envers son enfant dans la réalité, puissa transformation inconsciente, est la seule donnée explicative à l’analyse ducomportement cannibale dans nos contes. Nicole Belmont présente à plusieurs reprisesles textes comme des lieux d’inversion fantasmatique : l’enfant qui souhaite plus quetout réintégrer sa mère, établir une fusion avec elle, qu’aucune frustration ne pourraitternir, est un enfant « cannibale » lui-même. La sorcière, menaçant de le dévorer, n’estdonc que le pendant de son agressivité. Géza Roheim, dans son introduction àPsychoanalysis and anthropology, décrit le phénomène suivant :
Freud has interpreted the phantasy of the father as an animal that bites (wolf) andof being eaten by the father as the manifestation of the negative Oedipus complexof passivity in relationship to the father. But this phantasy is also a sequel to the
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
58
tale of the cannibal mother who, in turn, as we saw above, is the “cannibal” child inreverse7.
5 La position dévorante de la sorcière semble donc davantage être l’impressionfantasmatique de l’agressivité de l’enfant lui-même envers sa mère, recyclée dans leconte par un déplacement sur le personnage de la sorcière, ce déplacement opérantainsi une épargne psychique pour l’enfant : il s’agit là d’une deuxième entrée dans leconte par la psychanalyse. Celui-ci est traversé de tensions infantiles, fixé à la fois à unstade narcissique – il projette donc sa libido sexuelle sur lui-même, ou ses substitutsidentificatoires – et satisfaisant ses pulsions sexuelles partielles. Il manifeste alorsenvers lui-même une grande agressivité sexuelle orale, qu’il réinvestit dansl’imaginaire, en la déplaçant donc sur le personnage de la sorcière. Comme l’écritNicole Belmont, l’imaginaire fantasmatique des contes se forme par régression à unstade antérieur de la libido, fixé aux pulsions partielles, et notamment, ici, orales8.Ainsi, les sorcières deviennent les manifestations, sur le mode imaginaire, de pulsionsinconscientes archaïques, infantiles, fixées au stade oral. Refoulées, les angoisses dedévoration sont recyclées dans la vie fantasmatique, et donc dans l’imaginaire descontes. La formation des Baba Yaga relève dès lors de la constitution d’une imagomaternelle destructrice, au sens kleinien. Selon Melanie Klein9, l’enfant vit, au début desa vie, une position schizo-paranoïde dans laquelle il n’y a pas d’ambivalence. Le jeuneenfant introjecte son environnement, selon deux modalités : amour et haine. De là, il secrée des imagos, qui sont des représentations psychisées de ce qu’il éprouve face aumonde : il y a donc des imagos positives et des imagos négatives. Melanie Klein ajouteque ces imagos sont étroitement liées au vécu que l’enfant éprouve par rapport à samère : le sein qui comble et qui nourrit devient le « bon sein », imago positive ; tandisque le sein qui frustre, qui se refuse, qui se sépare, est le « mauvais sein », imagodétestable. La création des Baba Yaga relève de la formation fantasmatique d’unereprésentation du « mauvais sein » dans le conte. La sorcière est donc un fantasmecompensatoire, toute l’activité sexuelle orale que l’enfant éprouve envers sa mère étantrecyclée dans l’imaginaire selon un scénario qui serait : « Je veux te manger, donc tu memanges. »
6 Une troisième voie d’accès psychanalytique au personnage de la Baba Yaga concerne ladifficile sexualisation de la mère par l’enfant, notamment au moment de l’Œdipe, qui seretrouve alors condensée, tout comme le rêve condense les pulsions refoulées en lesvoilant, dans le personnage de la Baba Yaga. Selon Marthe Robert, ce sont avant tout lespersonnages masculins idéalisés, dans les œuvres qu’elle étudie, qui sont des avatars dupère tout puissant et fantasmé de l’Œdipe et du roman familial que l’enfant se construitau cours de sa petite enfance10. Mais les personnages féminins des contes de fées, etnotamment les sorcières, sont tout autant des avatars de ce « roman familial ». Aucours de celui-ci, selon Marthe Robert, l’enfant ne cesse de manifester une certaineagressivité envers ses parents puisqu’ils lui mentent, selon son fantasme. Figurefantasmatique, la sorcière prend en charge, donc, cette agressivité, au nom d’uneépargne psychique. D’autre part, Sigmund Freud, dans « Le roman familial desnévrosés11 » insiste sur le fait que, selon lui, le stade de l’enfant bâtard est un stadesexuel, contrairement au premier stade de l’enfant trouvé, puisque l’enfant sexualise samère en lui prêtant des amants, dont le plus illustre est son géniteur. Cettesexualisation de la mère peut être vécue, par l’enfant, comme une violence, carnouvelle ; elle est une tension qui vient bouleverser son équilibre psychique.L’agressivité qu’il ressent alors est à la fois dirigée contre sa mère, sexualisée trop
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
59
brutalement, et envers lui-même, ce lui-même sexualisant sa propre mère. L’enfant,inconsciemment, est dédoublé, et soumis aux affres de la découverte de la sexualité. Salibido se fixe peu à peu à sa mère – avant le stade œdipien, déjà – et génère alors desangoisses infantiles. En effet, pour l’enfant, si sa mère est sexualisée, elle est aussidétentrice des pouvoirs de la sexualité, et par là, elle est en mesure de castrer sonenfant. Ce sont ces angoisses que l’enfant ressent qui peuvent être relayées, sur le planimaginaire, par la création de femmes violentes aux pouvoirs oraux – donc sexuels –forts.
7 L’appareil théorique psychanalytique a ainsi une réelle pertinence dans l’interprétationdes contes et du personnage de la Baba Yaga. Mais en tant que personnage littéraire desContes d’Afanassiev, la Baba Yaga est un personnage produit dans une certaine mesurepar un imaginaire collectif, mais, doté de spécificités esthétiques et poétiques, dépassele cadre d’interprétation psychanalytique, ou du moins le nuance.
2. Les théories psychanalytiquesà l’épreuve du personnage littérairede la Baba Yaga
8 La littérarisation de la Baba Yaga met d’emblée en valeur la dimension fantasmatiquemortifère de la sorcière. Vladimir Propp soulignait la cécité de la Yaga, comme lien àl’invisible et à la mort, cette mort que l’on retrouve dans la description de l’isba de BabaYaga dans « Vassilissa la Belle ». C’est aussi dans l’outrance de la description despouvoirs oraux qu’Afanassiev surcharge le pôle mortifère et oriente la narration autourdu personnage de la sorcière. Dans « Vassilissa la Belle », l’auteur théâtralise la BabaYaga, tant dans son agressivité — celle-ci s’écrie « Pouah, pouah, cela sent la chairrusse12 ! » —, que dans la description même qu’il fait de sa maison :
Toute la nuit et tout le jour étaient passés, ce n’est qu’au soir qu’elle atteignit laclairière où était l’isba de la baba Yaga : elle était entourée d’une palissade faited’ossements humains, plantés de crânes humains dont les yeux luisaient ; auportail, des jambes étaient placés en guise de traverse, des bras servaient deverrous ; une bouche aux dents aiguës tenait lieu de serrure13.
9 Afanassiev insiste aussi sur l’outrance de son personnage en mettant en scène demanière euphorique la satisfaction libidinale sexuelle que lui apporte la dévorationorale, comme dans le conte « Tomassounet » :
Avale-tout accourut, d’un bond elle entra dans l’isba, s’empiffra, ressortit et se mit àse rouler dans l’herbe en chantant : « Je me couche, je me roule, bien gavée deTomassounet ! »14
10 Et pourtant, tout en étant un personnage « plein », presque saturé esthétiquement, laBaba Yaga est aussi, par certains aspects, un personnage troué, aux béances explicites.Les descriptions physiques sont incomplètes, et la narration est soumise à des videsdiégétiques. Le texte ne dit pas, par exemple, ce que la Yaga fait de ses journées dans« Vassilissa la Belle » : c’est par ces trous que le texte offre un espace d’investissementfantasmatique. Ces brèches sont lieux de création, d’élaboration imaginairepersonnelle. La Baba Yaga s’impose comme présence charnelle forte et puissante, maisse dérobe, laissant place alors à un vide diégétique qu’il incombe à chacun de combleret de poétiser.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
60
11 La Baba Yaga est tendue entre incarnation, souvent comique, et tension vers uneexistence plus immémoriale. Elle ronfle dans « Vassilissa la Belle », et dévore le troncde l’arbre sur lequel s’est réfugié Tomassounet dans le conte du même nom, dents enavant ; mais en même temps elle est un gouffre qui semble toujours laisser imaginer desprofondeurs que le texte ne décrit pas. La Baba Yaga se trouve dès lors, dans le texte, aucentre d’un processus dialogique : personnage effrayant mais dont l’effroi est distanciédans le texte par ses traits comiques et grotesques, elle s’inscrit dans un écart entrel’investissement fantasmatique qu’elle organise et la trivialité de sa textualisation.
12 En outre, c’est aussi un personnage familier – avatar maternel – qui est inquiété par soncannibalisme, donc sa capacité à devenir l’envers d’elle-même, à nier son rôle maternel,dans un effet poétique d’ « inquiétante étrangeté ». Il y a double distance au sein dupersonnage, et par ce double mouvement distantiel, la Baba Yaga s’inscrittextuellement comme ambivalente. Elle est dans un entre-deux, entre incarnationcomique et tension vers un ailleurs, entre personnage avatar d’une mère réelle etfantasme d’une imago agressive toute puissante. C’est à cause de cet entre-deux qu’ilsemble nécessaire de relativiser l’approche kleinienne de la Baba Yaga.
13 La Baba Yaga est dans un entre-deux dans le sens où elle semble menacer de dévorerpour mieux ne pas dévorer. La sorcière représente, dans le conte, un pôle mortifèrepour mieux pointer du doigt la véritable menace orale, qui est celle du personnage quel’on considérait comme la « bonne mère ». La Baba Yaga devient alors une mère« suffisamment bonne » au sens de Winnicott15, dans l’économie narrative du conte :elle présente la menace orale opérée par la vraie mère, pour mieux permettre au hérosde s’en détacher.
14 À cet égard, le conte « Vassilissa la Belle » est particulièrement significatif puisque lesrôles de bonne mère et figure maternelle dévorante sont inversés. La poupéereprésente la permanence du lien qui unit Vassilissa à sa véritable mère, présentéecomme bienfaitrice. Néanmoins, si cette poupée aide la jeune fille à accomplir lestâches que lui imposent sa marâtre et ses sœurs, c’est en échange de nourriture. Lapoupée, en mangeant pour secourir la jeune fille, est une image de la menace orale dontVassilissa pourrait être victime si elle ne rompt pas le lien fusionnel à sa mère morte.Au contraire, la Baba Yaga, ne mangera la jeune fille que si elle ne travaille pas assez :« Tu vas travailler chez moi quelque temps ; si je suis contente, je te donnerai du feu,sinon je te mangerai16. » La sorcière répète la menace orale que la poupée exprime, etpropose à Vassilissa de s’en dégager : son ambiguïté réside dans le fait que tout enmenaçant de dévorer la jeune fille, elle est aussi agent de son développement et de sonautonomisation. Au fur et à mesure de son séjour chez la Baba Yaga, Vassilissa doittravailler, de plus en plus : elle prépare le repas, puis elle doit tisser elle-même le filgrâce au métier à tisser que lui a confectionné sa poupée – et lors de cette dernièreétape, la poupée ne mange pas –, avant d’aider la jeune fille. Enfin, au moment decoudre les douze chemises, Vassilissa opère seule : elle est autonome. La poupée restedans la poche de la jeune fille et n’en sort plus : intégrée à la personnalité de sapropriétaire, elle laisse celle-ci réussir par ses propres moyens.
15 Dans « Tomassounet », ce rôle initiatique de la Baba Yaga quant à la question orale estégalement explicite. Au début du conte, le garçon va régulièrement pêcher seul, et lesymbolisme de ces voyages semble indiquer son besoin d’émancipation. Néanmoins, samère le rappelle à la rive pour lui donner du lait et du fromage blanc, deux aliments quisymbolisent le lien fusionnel procuré par l’allaitement. Ainsi, de la mère nourricière à
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
61
la mère qui gave son enfant, le pas est vite franchi : la mère de Tomassounet donne sonlait autant qu’elle semble l’imposer au garçon — en obéissant à ses demandeslibidinales, mais en l’empêchant de voguer au loin et de s’autonomiser. Il estremarquable de constater que lorsque « Avale-tout » tente d’attirer le garçon sur larive, elle se fait faire une douce voix « toute pareille à celle de la mère » : on voit doncdans cette confusion l’ambiguïté de chacun des pôles maternels. On remarque aussi que« Avale-tout » est associée à un personnage masculin, le forgeron : les deux hommes duconte (le père qui construit à Tomassounet sa barque et le forgeron associé à la Yaga)sont des agents de la castration — ces personnages renvoient au père castrateur de lathéorie freudienne du complexe d’Œdipe, ce père qui, parce qu’il pose l’interdit del’inceste, dénoue la fusion entre la mère et l’enfant ; ces deux figures permettent ainsiau jeune garçon de s’autonomiser en se détachant de la sphère maternelle et oralearchaïque. L’évolution du rapport à la nourriture que vit le garçon est d’ailleursexplicite dans la mention des crêpes que Tomassounet mange en revenant chez lui : cen’est plus du lait brut mais un mets cuisiné. Les contes sont alors un hymne au plaisirde manger, mais de manger bien.
16 Le personnage littéraire de la Baba Yaga, par sa condensation poétique, peut d’unecertaine manière mettre en scène les investissements fantasmatiques qui semblentavoir présidé à son élaboration populaire. Mais le texte littéraire lui donne une plusgrande ambivalence, ce qui permet de relativiser les positions psychanalytiques faisantde la sorcière l’incarnation des pulsions archaïques orales et mortifères de l’enfant,tout en les enrichissant.
3. L’apport de la théorie littérairepour la compréhension fantasmatiqueet pragmatique du conte
17 Dans la dynamique même de la narration, qui suit le cheminement du héros, la BabaYaga dérange, vient faire un écart. Son déploiement textuel est tout entier dans cetécart. Il s’agit pour le héros, et pour la trame même du récit, de rétablir l’ordre narratif,et de supprimer la sorcière. L’ambivalence même de ce personnage, sa faculté àtoujours se distancier comiquement ou de manière inquiétante, produit déjà un espacede mise à mort potentiel : son incarnation comique ou mortifère est sapée par lanarration, et donc possiblement anéantissable. La Baba Yaga s’inscrit dès lors dans unprocessus carnavalesque17 : son outrance est subversive, et la dimension régressive – etpar là angoissante – de ses agissements est liquidée à la fin du texte, ce dénouementpermettant le retour à un certain ordre (narratif et affectif).
18 Dans la dynamique du conte, le héros nécessite donc un face-à-face avec la sorcière.Dans ce face-à-face, la destruction de cette mère dévorante est fondamentale : ellesouligne l’évacuation du pôle mortifère dans le conte et, à un niveau plus pragmatiquede lecture, la liquidation des schèmes archaïques qui organisaient fantasmatiquementle personnage de la Baba Yaga. Les morts des sorcières et marâtres fascinent. Dans« Vassilissa la Belle », on peut lire :
On apporte le feu dans la chambre. Les yeux des crânes se mettent à fixer la marâtreet ses filles et à les brûler vives. Elles se jettent de-ci de-là, mais où qu’elles sefourrent, partout les yeux les suivent. Au matin, il ne restait d’elles qu’un petit tasde cendres dans un coin. Seule, Vassilissa avait été épargnée18.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
62
19 Il est un autre cas remarquable : il s’agit du cas où la Baba Yaga meurt de la mortréservée au héros. Dans « Tomassounet », nous considérons que la fille d’Avale-tout estun avatar diégétique de la Yaga elle-même : faire rôtir la fille, c’est une manière de tuerAvale-tout, représentation maternelle, tout en déplaçant le meurtre. Mais sur le planfantasmatique aussi, au nom d’une épargne psychique, il est plus aisé de tuer la fille dela sorcière, puisque tuer véritablement la mère (ou sa représentation directe dans leconte) serait désorganisant psychiquement. La sorcière, donc, en dévorantimpunément sa propre fille se dévore elle-même. La sorcière est renvoyée à sespulsions archaïques, à sa menace orale, et en dégage le héros. Le spectacle del’anthropophagie maternelle, réintégrant sa propre progéniture, est ainsi salutairepour l’enfant : s’il manifeste la violence d’une relation fusionnelle de l’enfant à sa mère,il est aussi le vecteur d’une connaissance sur le monde. L’enfant, héros du conte etsoumis aux menaces cannibales d’une sorcière, devient alors, par la destruction de samauvaise mère, la dynamique fondamentale de la sublimation des déficiencesparentales.
20 Dans un carnaval jouissif, la Baba Yaga est aussi sacrifiée par la narration, et sonexécution, racontée de manière complaisante, permet tant au héros qu’aux « acteurspragmatiques » des contes, d’accéder à un stade supérieur de maturité. En ladétruisant, ceux-ci réduisent la personnification de leur fantasme dans le conte à unvague souvenir dont on ne garde guère de traces, sinon celle d’une épreuve, traverséeavec succès. La Baba Yaga efface les traces de son passage à l’aide de son balai, le balaitenant alors lieu d’image poétique du refoulement. Nicole Belmont, à propos du « Contedu genévrier » des frères Grimm, indique :
La violence narrative avait un effet cathartique dans la mesure où elle donnait unstatut externe à des pulsions inconscientes intenses désireuses de se faire jour. Lamise en récit, la narrativisation, permettait en outre une désintrication de cespulsions, qui s’exprimaient dès lors en une séquence libératrice, depuis l’oralité etle cannibalisme jusqu’à l’acquisition d’une identité sexuée19.
21 La plasticité du conte est sans doute ce qui le rend à la fois si riche et si complexe,adaptant les fantasmes à la narration, et influençant par la narration les fantasmes. Dèslors, incarnant les pulsions de mort, invitant au dépassement de ces pulsionsarchaïques, les sorcières sont fondamentalement ambivalentes, par leur seule présencedans la diégèse. Elles sont le lieu, pour les acteurs pragmatiques des contes, d’un« transfert » de pulsions infantiles et partielles liées à Thanatos, et elles offrent, enacceptant ce transfert puis en étant sacrifiées, la possibilité d’atteindre Eros.Profondément métapoétiques, nos contes mettent en abyme leur fonctionnementpragmatique.
Conclusion
22 Nous avons pu dégager l’apport que représente la théorie psychanalytique dansl’approche des contes populaires et notamment de l’étude de la Baba Yaga. Néanmoins,il faut souligner l’importance de faire jouer les théories les unes avec et contre lesautres, et surtout de les heurter aux textes. « Nourricière ou sorcière : la Baba Yaga àl’épreuve de la pensée psychanalytique » : il s’agit bien là d’une épreuve, carpersonnage littéraire, la Baba Yaga a la spécificité d’être un haut lieu fantasmatique descontes, eux-mêmes produits, indéniablement, dans une certaine mesure, par des
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
63
mouvements collectifs. L’écoute attentive des mécanismes inconscients a permis dedégager l’ambivalence de la Baba Yaga, dans cet entre-deux, entre la sorcière et labonne nourricière. Mais c’est au cœur du texte que se déploie toute la saveur de cetteambivalence, qui fait encore aujourd’hui de la Baba Yaga un personnage si haut encouleurs.
BIBLIOGRAPHIE
Afanassiev, Alexandre Nikolaïevitch, Contes populaires russes, trad. fr. Lise Gruel-Apert, Paris,Imago, 2014.
Bakhtine, Mikhaïl, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous laRenaissance, trad. Andrée Robel, Paris, Gallimard, 1982.
Bellemin-Noël, Jean, Les Contes et leurs fantasmes, Paris, PUF, 1983, p. 27‑29.
Belmont, Nicole, Mythe, conte et enfance : les écritures d’Orphée et de Cendrillon, Paris, L’Harmattan,2010.
Freud, Sigmund, Le Roman familial du névrosé et autres textes, trad. Danièle Voldman et OlivierMannoni, Paris, Payot, 2014.
Klein, Melanie, « Le développement précoce de la conscience chez l’enfant », in Essais depsychanalyse, trad. fr. Marguerite Derrida, Paris, Payot, 1968.
Propp, Vladimir Iakovlevich, Morphologie du conte, trad. Claude Ligny, Paris, Gallimard, 1970.
Robert, Marthe, Roman des origines et origines du roman, Paris, Grasset, 1988.
Róheim, Géza, Psychanalyse et anthropologie : Culture – Personnalité – Inconscient, trad. MarieMoscovici, Paris, Gallimard, 1967.
Winnicott, Donald W., The Maturational Processes and the Facilitating Environment, Londres, KarnacBooks, New Ed edition, 1990.
NOTES1. A. N. Afanassiev, Contes populaires russes, p. 141.2. Nous nous référons ici aux idées de Carl Jung, reprises par Marie-Louise von Franz dans sonanalyse des contes de fées.3. A. N. Afanassiev, « Vassilissa la belle », in op. cit., p. 140‑146.4. A. N. Afanassiev, « Tomassounet », in op. cit., p. 158-160.5. V. I. Propp, Morphologie du conte, Paris, Gallimard, 1970.6. J. Bellemin-Noël, Les Contes et leurs fantasmes, p. 27‑29. Le plan de cet ouvrage est d’ailleursconstruit sous la forme d’un menu, mettant en valeur la dimension orale des contes qu’il analyse.7. G. Róheim, Psychoanalysis and anthropology: culture, personality and the unconscious, InternationalUniversities Press, 1968, p. 8. « Freud a interprété le fantasme du père comme animal qui mord(loup) et celui d’être mangé par son père comme la manifestation du complexe d’Oedipe négatif
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
64
de passivité en relation avec le père. Mais ce fantasme est aussi une séquelle du conte de la mèrecannibale qui, à son tour, nous l’avons vu, est l’enfant “cannibale” inversé. » (trad. M. Moscovici,in G. Róheim, Psychanalyse et anthropologie : Culture – Personnalité – Inconscient).8. N. Belmont, Mythe, conte et enfance : les écritures d’Orphée et de Cendrillon, p. 133.9. M. Klein, « Le développement précoce de la conscience chez l’enfant », p. 296‑306.10. Robert, Marthe, Roman des origines et origines du roman, Paris, Grasset, 1988.11. Freud, Sigmund, Le roman familial du névrosé et autres textes, trad. Danièle Voldman et OlivierMannoni, Paris, Payot, 2014.12. A. N. Afanassiev, « Vassilissa la belle », in op. cit., p. 142.13. Ibid.14. A. N. Afanassiev, « Tomassounet », in op. cit., p. 159.15. À cet égard, cf. D. W. Winnicott, The Maturational Processes and the Facilitating Environment.16. A. N. Afanassiev, « Vassilissa la belle », in op. cit., p. 142.17. À cet égard, nous renvoyons à : M. Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaireau Moyen Âge et sous la Renaissance.18. A. N. Afanassiev, « Vassilissa la belle », in op. cit., p. 145.19. N. Belmont, op. cit., p. 136.
RÉSUMÉSLa Baba Yaga est une figure complexe, appelant une démarche herméneutique plurielle.L’analyse de la problématique de la dévoration chez la sorcière dans les deux contes d’AlexandreNikolaïevitch Afanassiev « Vassilissa la Belle » et « Tomassounet » nous amène à interroger lesplaces que psychanalyse et littérature peuvent tenir dans l’interprétation des contes, et en quoices deux positions se complètent et s’enrichissent mutuellement lorsqu’il s’agit d’approcher laquestion de l’ambivalence de la Baba Yaga, tour à tour nourricière et sorcière.
Baba Yaga is a complex figure, and as such demands a pluralistic and open-ended hermeneuticapproach. This article interrogates Baba Yaga’s wish to devour as it is presented in two ofAfanassiev’s tales, « Vassilissa the Beautiful » and « Terechetchka ». Along the way, weinterrogate the role of literature and psychoanalysis in the interpretation of folk tales. These twoapproaches, we argue, are complementary and mutually enriching, especially when we considerthe ambivalence of Baba Yaga as both a nurturing and devouring figure.
INDEX
Mots-clés : Baba Yaga, psychanalyse, littérature, ambivalenceKeywords : Baba Yaga, psychoanalysis, literature, ambivalence
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
65
AUTEUR
CÉCILE ROUSSELET
Cécile Rousselet est étudiante à l’UFR d’Études psychanalytiques de l’université Paris 7 Paris-Diderot et doctorante en littérature comparée, russe et yiddish, à l’université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle. Elle prépare actuellement une thèse sous la direction de Carole Ksiazenicer-Matheron(Paris 3 Sorbonne-Nouvelle) et Luba Jurgenson (Paris 4 Paris-Sorbonne) : « Les personnagesféminins face à l’histoire et à la mémoire dans les romans yiddish et russe après 1930 (I.J. Singer,I.B. Singer, M. Kulbak, A. Platonov, V. Grossman) ».
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
66
Baba Yaga, les sorcières et lesdémons ambigusde l’Europe orientaleStamatis Zochios
1. Être surnaturel des contes ou/etdes croyances populaires
1 Publié en 1863, le Dictionnaire raisonné du russe vivant n’est pas seulement le magnumopus du grand savant, lexicographe et folkloriste Vladimir Dahl mais aussi un despremiers essais systématiques de recensement des trésors linguistiques russes.L’œuvre, en incluant plus de trente mille dictons et proverbes, et en insistant sur lecôté populaire et oral de la langue, ne pourrait exclure l’interprétation des termes dufolklore russe (on trouve ici par exemple les noms domovoi, rusalka ou leshii). Ainsi, BabaYaga est nommée сказочное страшилищ (skazochnoe strashilishh)1, vocable signifiant« monstre des contes ». Une première interrogation porte sur la nature de la catégoriede littérature orale dont fait partie Baba Yaga : à laquelle le personnage appartient-il ?
2 Selon Bogatyrev, Baba Yaga, tout comme d’autres personnages principaux des contesRusses (Kochtcheï, Zmey Gorynych et autres), ne joue aucun rôle dans la démonologiepopulaire2. Par conséquent, est-elle seulement un personnage d’un récit d’aventuresmerveilleuses-mensongères, ayant une fonction spécifique – principalement celled’agresseur ou de donateur, pour utiliser la terminologie proppienne – ou la retrouve-t-on dans d’autres genres folkloriques ? Est-elle présente dans des genres plus« crédibles » (d’après la mentalité du croyant) tels que les légendes, les croyancespopulaires3 et les incantations ? Appartient-elle donc au système de la religionpopulaire et de ses rites agraires ? A-t-elle finalement, par le biais de ces genres moins,peu ou guère fictifs, une hypostase témoignée et crédible ?
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
67
2. Baba Yaga dans le folklore slave
3 Cherepanova dans son ouvrage La Mémoire culturelle dans l’ancien et le nouveau mot4
cite une incantation dont la source se trouve déjà dans l’ouvrage du XIXe siècleMatériaux pour l’ethnographie de la population russe de la province d’Arkhangelsk dePiotr Efimenko5. Ici, un homme voulant séduire une femme et la faire tomberamoureuse de lui demande l’aide des démons Sava, Koldun et Asaul, ayant tous servi leroi Hérode. L’incantation continue en mentionnant qu’en plein champ, sous le chênesarrasin, il y a trois fois neuf filles que Baba Yaga, postée sous le chêne, vient éclairer.Comme le bois brûle, la femme (dont le nom est mentionné dans l’incantation) brûleraà son tour. Dans le même ouvrage, Efimenko cite encore une incantation qui estnommée « vieux sort pour l’amour » [starinnoe zaklinanie na ljubov]6 :
En plein champ, il y a 77 poêles en cuivre rouge et sur chacune d’elles il y a 77 Egi-Babas. Ces 77 Egi-Babas ont 77 filles chacune dotée de 77 bâtons et de 77 balais. Moi,le serviteur de Dieu (nom de l’homme) supplie ces filles d’Egi-Babas. Salut à vous,filles d’Egi-Babas, fait la servante de Dieu (nom de la femme) tomber amoureuse etl’amener au serviteur de Dieu (nom de l’homme) etc.7
4 La réapparition de Baba Yaga dans les incantations témoigne du fait qu’elle n’existaitpas seulement en tant que personnage des contes mais qu’elle faisait en outre partie dela religion populaire aux côtés des leshii, rusalka, kikimora et domovoi. Il est cependantnécessaire d’insister sur deux points du texte précédent. La première précision portesur la version du nom Baba Yaga, Egi-babas au pluriel.
5 En effet, le nom apparaît dans différentes langues : russe et ukrainien Баба-Язя, Язя,Язі-баба, Гадра ; polonais jędza, babojędza ; tchèque jezinka, Ježibaba, « sorcière, femmede forêt » ; serbe баба jега ; slovène jaga baba, ježi baba. Baba ne pose aucun problème ;il dérive du vieux slave баба [baba] et constitue un diminutif de бабушка [babyshka],grand-mère, signifiant à la fois la paysanne, la bonne femme, mais aussi la sage-femme(accoucheuse), la maîtresse, une statue de pierre – statue d’une divinité païenne ou,dans la langue courante, simplement la femme, jeune ou vieille8. Chez Baba Yaga, lenom signifie davantage la vieille femme, sans pour autant être isolé des autressignifications. Le deuxième étymon, Yaga, Egi, Jedzi, Jedza et ainsi de suite, est bien plusproblématique.
6 Fasmer, dans son dictionnaire étymologique de la langue russe, fait remonter le nom auproto-slave * (j) egа, « colère », « horreur »9. La majorité des dictionnaires reprend cetteperspective étymologique en considérant le nom comme une fusion du terme baba,старуха (staruha), vieille, et de яга, злая (zlaia), « mal, douleur, tourment,importunité », pour signifier finalement la злая женщина (zlaja zhenshhina), « lafemme du mal, la femme-bourreau10 ». L’interprétation de Yaga selon le terme de« douleur » est néanmoins restrictive.
3. Baba Yaga, la femme serpent
7 Dans son ouvrage les Conceptions poétiques des Slaves sur la nature, le folkloriste éminentAleksandr Afanassiev considère que le deuxième étymon est lié au sanskrit ahi, à savoir« serpent », désignant ainsi à l’origine une femme serpent ressemblant aux lamia11 etdrangua des contes (et croyances populaires) néohelléniques et albanais 12. Le folkloreslave le justifie par ailleurs. Baba Yaga est parfois la mère de trois filles démoniaques
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
68
(pouvant, dans certains cas, être des princesses dont l’une finira par épouser le héros)et d’un fils-serpent, finalement exterminé par le héros13.
8 Les contes slovaques reprennent le motif de cette parenté de serpents et désignent lesfils de Jezi-Baba en tant que serpents démoniaques. De plus, une incantation du XVIIIe
siècle contre ces mêmes serpents évoque Iaga Zmeia Bura (Yaga le serpent brun) :« J’enverrai Yaga le serpent brun après toi. Yaga le serpent brun couvrira ta blessureavec de la laine14. » Selon Polivka, la forme jaza apparaît dans les parlers petit-russes deGalicie : c’est une sorte de serpent mythique (rodzaj zmii mitycznej, d’après Karłowicz,słownik gwar polskich) que les humains n’ont jamais vu ; il se transforme tous les sept ansen serpent ailé à sept têtes15.
9 Il devient alors évident qu’une des versions de Yaga est la drakaina, un dragon femelleaux caractéristiques humaines. Ces entités ont des têtes et des torses de femmes, maisla partie basse de leurs corps est sous forme de serpent. Elles constituent une catégoriemythologique très importante au sein de l’imaginaire eurasiatique, surtout connuegrâce à Mélusine16, reine mi-femme mi-serpent, immortalisée à la fin du XIVe siècle et audébut du XVe siècle, en prose par Jean d’Arras (La Noble Histoire de Lusignan), et en poésiepar Couldrette (Roman de Mélusine). Pour certains savants, ces femmes-hybrides,originaires de la Déesse mère, manifestent un profond dualisme en tant qu’êtresbénéfiques-maléfiques, agresseurs-donateurs.
4. Baba Yaga, la sorcière
10 Revenons maintenant à l’incantation d’Efimenko, starinnoe zaklinanie na ljubov. Nousconstatons que les 77 (le chiffre a évidemment une valeur arithmologique-symbolique)filles de Baba Yaga possèdent quelques метелы (metly), qui signifient « balais ». Cetobjet ne correspond pas seulement aux balais de Baba Yaga, qui, avec le mortier et lepilon composent son équipement et son moyen de transport, mais il est aussi l’objetprincipal des voyages des sorcières, motif qui revient à plusieurs reprises dans lestextes occidentaux des XV-XVIe siècles17. Deux exemples connus de la littératuremédiévale peuvent être trouvés dans le Perceforest18 et le Champion des dames19, où lesvieilles sorcières voyagent sur des bâtons-balais, en tant qu’oiseaux, pour manger depetits enfants ou aller aux Sabbats.
11 Baba Yaga réalise des voyages similaires. Afanassiev témoigne qu’elle vole auxrassemblements des sorcières, montée sur son mortier avec son pilon et son balai20, etFederowsky, en 1897, indique que Baba Yaga est la tante ou la maîtresse des sorcières21.Ainsi, Baba Yaga a été décrite comme une vieille sorcière – de nombreux dictionnairesexpliquent son nom en tant que старуха-колдунья (staruha-koldun’ja), à savoir vieille-sorcière22 – et plus précisément vieille sorcière qui saisit des enfants, dévore leur chair,suce leur sang. On trouve souvent cette sorcière aux tendances cannibales,croquemitaine et grande menace pour les enfants, surtout les nourrissons, et leursmères, sous le nom de strix23, non seulement en Europe occidentale24 mais aussi enEurope orientale.
12 Selon Polivka et son article important de 1922, « Du surnaturel dans les contesslovaques », « c’est à peu près le même être que la ježibaba qui se présente sous le nomde striga, c’est-à-dire “strige” […]. Nous le trouvons assez souvent dans les plusanciennes notations manuscrites, depuis les années 1910, et dans des notations se
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
69
rapportant à différentes régions du pays slovaque. La ježibaba et la striga sont aussiproches que possible l’une de l’autre. » Et il continue : « À côté de la ježibaba et de lastriga, la tradition populaire slovaque offre encore la bosorka. Ce nom, hors de laSlovaquie, se rencontre aussi dans des régions de la Moravie orientale, chez lesSlovaques et les Valaques » pour préciser que « la bosorka, dont le nom avaitoriginellement le sens de “sorcière” (čarodejnice) ou de “magicienne” (kuželnice), prendsouvent dans la tradition populaire le rôle de la ježibaba et de la striga25” ».
13 Vinogradova26 signale que la bosorka est une sorcière carpato-ukrainienne qui nuit auxgens de plusieurs façons27. Elle vole, entre autres, le lait des vaches, motif récurrentdans les textes occidentaux contre les sorcières, aussi mentionné par Luther dans sonSermon sur l’Exode, soutenant que « la loi selon laquelle les sorcières doivent mourir estjuste parce qu’elles font beaucoup de choses maudites comme par exemple voler le laitde la vache28 ». La Baba Yaga qui suce le lait des seins d’une jeune fille (AT 519 – TheStrong Woman as Bride)29 est probablement liée avec cette sorcière voleuse de lait. Enconclusion, nous pouvons schématiser et délivrer une identification entre striga-bosorkaet la version slovaque de Baba-Yaga30, Ježibaba31. Le nom Ježibaba, qui définit une figuredu folklore slave occidental, apparaît sous plusieurs variations locales : Jenzibaba,Jendzibaba, Endzibaba, Jazibaba et en Pologne jedza-baba, « femme très méchante », etjedzona, jedza-baba, jagababa, « espèce de sorcière ». Cependant, elle n’est pas toujoursméchante. Dans au moins trois contes slovaques, Ježibaba est donatrice, apparaissantsous la forme de trois sœurs (caractéristique qui nous rappelle les trois fatae, moirae etfées des contes) qui aident le héros à échapper à l’ogre qui le pourchasse, lui donnentde la nourriture, et lui prêtent leurs chiens magiques. Dans un autre conte, « troisježibaby prêtent aide à une fileuse paresseuse32 ».
5. Baba Yaga et le filage
14 Dans ce dernier cas, Ježibaba est mystérieusement liée au filage. Ce rapport ne noussurprend pas. Baba Yaga file elle-même de la laine ou d’autres matériaux sur son métierà tisser33. Dans un autre cas des jeunes filles arrivent chez elle et la trouvent en train defiler. Dans une troisième acception, elle demande à ces jeunes filles de filer à soncompte (AT 480 – The Spinning-Women by the Spring). De plus, son isba se trouve parfoissur une quenouille34.
15 Cette liaison entre le filage et une figure surnaturelle féminine (fée ou sorcière) n’estguère rare dans le folklore européen. Dans les traditions populaires slaves orientalesParaskeva-Piatnitsa (ou Pyatnitsa-Prascovia), sainte importante, personnification devendredi et protectrice des récoltes – souvent rapprochée de Baba Yaga –, punit lesfemmes qui filent le cinquième jour de la semaine35. Parfois la punition est très sévère :Piatnitsa déforme les doigts des femmes qui filent le vendredi36, motif qui nous rappellela naroua (naroue, narova, narove etc.), fée nocturne qui se manifeste principalement enIsère et en Savoie pendant les Douze Jours de Noël, relative, selon Joisten, au cycleCarnaval-Carême. L’ethnologue la considère comme un croquemitaine de type« cérémoniel »37 qui se manifeste à une date précise de l’année et, selon les récitspopulaires, elle pénètre dans les maisons pour punir ceux qui travaillent à minuit ou lesjours fériés et en particulier les dentellières et les fileuses. Voici ce que raconte un récitpopulaire de Savoie :
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
70
Elle bat les dentellières (elle irait même jusqu’à tuer), leur tape sur les doigts avecsa baguette, assène un coup de pied de bœuf aux veilleurs, les bâtonne avec un nerfde bœuf, enlève les enfants et les frappe avec la jambe de vache et la jambe de bœufqu’elle brandit à chaque main.38
16 Les même interdictions concernent la version grecque de Piatnitsa, Agia (sainte)Paraskevi, qui punit les fileuses continuant leur travail le jeudi soir, le vendredi ou lejour de la fête de la Sainte (26 juillet). La punition infligée aux fileuses est de manger dela chair d’un mort39.
17 Un tel rapport entre la femme démoniaque, sorcière ou fée et le filage se trouve dans lefolklore roumain où Baba Cloanța, parent lointain de Yaga, explique qu’elle est laideparce qu’elle a trop filé au cours de sa vie40. Les sources de l’Europe occidentale etcentrale contenant ce motif du filage sont aussi abondantes. En revenant au passage dePerceforest cité dessous, nous voyons que les vieilles matrones barbues et échevelées setransportent non seulement sur des bâtons et des petits sièges de bois, mais aussi surdes dévidoirs et des quenouilles.
6. Baba Yaga, Perchta et Pechtrababajaga
18 Un autre exemple très typique de femme démoniaque souvent rapproché de Baba Yagas’illustre en la personne de Perchta selon la version alpine germanique, Baba Pehtraselon la version slovène, ou Pechtrababajaga d’après un néologisme russe. Le nomPerchta, Berchta, Percht, Bercht, etc. dérive du vieux haut allemand beraht, du vieuxallemand behrt et, plus tôt, du germanique commun *berhto-, parents étymologiques del’anglais brilliant et du français brillant. Par conséquent, le nom Berchta ou Perchtasignifie « la brillante », à savoir une porteuse de lumière. Mais pourquoi un nom ausens positif est-il attribué à un être maléfique ?
6.1. Perchta et les tables ornées
19 En 1468, le Thesaurus pauperum, probablement écrit de toute évidence par Jean XXI,compare Satia et dame Abonde, fées vénérées en France médiévale, à une autre femmeet à sa troupe. Cette femme est Perchta :
Le second type de superstition, une sorte d’idolâtrie, est celle de ceux qui, la nuit,exposent ouverts des récipients remplis de nourriture et de boisson destinées auxdames qui doivent venir, dame Abonde et Satia, que le vulgaire désignecommunément et couramment du nom de dame Percht ou Perchtum, cette damevenant avec sa troupe. Ceci, pour qu’elles trouvent ouverts tous objets tenant à lanourriture et à la boisson, afin que, par la suite, elle les remplissent et les accordentrichement et en plus grande abondance. Beaucoup croient que c’est pendant lesnuits saintes, entre la naissance de Jésus et la nuit de l’Épiphanie, que ces dames, àla tête desquelles est dame Perchta, visitent leurs demeures. Nombreux sont ceuxqui, au cours de ces nuits, exposent sur les tables pain, fromage, lait, viandes, œufs,vin, eau et denrées de cette sorte, de même que cuillers, plats, coupes, couteaux etautres objets semblables, en vue de la visite de dame Perchta et de sa troupe, pourqu’elles y trouvent agrément et que, par conséquent, elles soient propices à laprospérité de la demeure et à la conduite des affaires temporelles41.
20 Le texte est explicite. Les superstitieux préparent des tables en exposant desnourritures et couverts pour satisfaire dame Perchta. La coutume est celle de mensasornare42. Il s’agit de la pratique de préparation de tables en l’honneur d’une dame qui
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
71
visite les maisons pendant la nuit, souvent accompagnée de sa troupe. Si elle trouve desoffrandes (nourritures, surtout sucrées, boissons, couverts), elle récompense en offrantdes richesses. Dans le cas contraire, elle punit les habitants de la maison.
6.2. Perchta et le filage
21 La « solution » de la punition n’était pas employée par Perchta uniquement pour cetteraison. Plusieurs récits décrivent la visite de Perchta dans des maisons, où elle fouillel’intérieur de fond en comble pour découvrir des irrégularités. Parmi elles, la plus graveest liée au filage : la femme de la maison est obligée d’arrêter son travail avant minuitou de ne pas travailler un jour férié, un jour important pendant les Douze Jours, parexemple à Noël et surtout lors de l’Épiphanie, jour sacré de la déesse. Dans le casinverse, en cas de désordre, ou lorsque le lin n’était pas filé, la déesse punit la femme.Cette action lui a attribué le nom Spinnstubenfrau, la femme de la salle de filage. CarolRose signale que Spinnstubenfrau est une épithète de l’esprit Berchta dans le folklore del’Allemagne. En tant que Spinnstubenfrau, elle prend la forme d’une vieille sorcière quipeut apparaître sur la propriété de l’homme pendant les longs mois d’hiver. Sous cetteforme, elle est l’esprit gardien des granges et de la salle du filage pour surveiller lerespect des normes du travail43.
22 La punition était très particulière : elle ouvrait le ventre de la victime et remplaçait sesentrailles par des ordures. Thomas Hill, dans son article « Perchta the Belly Slitter andÁn hrísmagi : “Laxdoela saga” cap. 48-49 », voit derrière cette punition de typegastrotomique (ainsi que derrière un passage similaire tiré par la Laxdoela saga) uneaction dualiste, finalement salutaire, d’origine extatique-chamanique-initiatrice44. Uneopinion similaire a été exprimée par Andrey Toporkov par rapport au motif de lacuisson de l’enfant du type AT 327 C, F : un garçon (Ivashka, Zhikharko, Filyushka, etc.)se rend à l’isba de Baba Yaga, et cette dernière demande à sa fille de le cuire. Le garçonprend une mauvaise position dans le four, Baba Yaga veut lui expliquer comment il fautse poser, elle se met dans le four et le garçon ferme la porte en y piégeant de cettefaçon Baba Yaga. Selon Toporkov, derrière ce motif, un rituel, selon lequel on pose unbébé dans le four trois fois pour le fortifier, est bien caché45. Nous constatons donc quederrière l’action maléfique, il y a un rite de passage, une initiation, ou une actionmagique à vocation bénéfique46. Le caractère initiateur des actes de Baba Yaga a été parailleurs souligné par le grand folkloriste Vladimir Propp, pour lequel la sorcière était lechef travesti du rite de passage des sociétés primitives47. Enfin, dans un conte de laYakoutie, une Ega-Baba est décrite en tant que chamane (stala shamanist’ ona) qui estconvoquée pour ramener à la vie une personne tuée48.
23 Par conséquent, l’affinité entre Yaga et Perchta, liées aux sorcières en tant que déessesou protectrices, commence par leur aspect démoniaque-punitif, pour aboutir à unaspect bénéfique et initiateur. Cette vive ambivalence ne s’arrête pas là. 6.3. Perchta, le carnaval et la malformation
24 La période des Douze Jours de célébrations en l’honneur de Perchta est pratiquée enAllemagne, en Autriche et en Suisse. « Aujourd’hui encore, l’appellation “Percht”désigne des personnages masqués qui, la nuit, hantent les villages de Haute-Styrie oudu Pays de Salzbourg. Porteurs de masques, vêtus de hardes, munis de balais, ils
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
72
visitent les maisons49 ». Les jeunes gens sont déguisés soit en belles filles aux costumestraditionnels – les schöne Perchten, soit en vieilles femmes laides – die schiache Perchten50.Ces dernières sont inspirées de l’ « iconographie » de Perchta en tant que vieillefemme51, parfois hybride, portant de traits abominables parmi lesquels on trouve,premièrement, des palmes d’oie, qui pourraient expliquer l’existence en Serbie d’uneBaba Jaga ou Jega portant un pied de poule, ou même les pattes de poule sur lesquellesl’isba est montée. Par ailleurs, cette malformation rappelle la fameuse Tante Arie,figure surnaturelle des Douze jours et du filage52. On trouve, deuxièmement, un nez defer. Déjà au XIVe siècle, le théologien Martin d’Amberg, fait référence dans son Miroir desconsciences, à « Percht au nez de fer » (Percht mit der eisnen nasen)53. Yaga porte parfoisun tel nez de fer et pour cette raison elle est assimilée par les folkloristes à une autrefigure démoniaque de la région des Carpates de l’Ukraine occidentale, Zalizna baba ouZaliznonosa baba54, la vieille femme de fer, qui habite dans un palais placé sur despattes de canard, ainsi qu’à la Vasorru Baba, la femme au nez de fer du folklorehongrois55, et enfin Huld56.
25 Cette dernière, étant une Spinnstubenfrau, et identifiée souvent à Perchta, revêtplusieurs caractéristiques funestes. Luther signale qu’elle a un énorme nez57 et Grimmqu’elle apparaît parfois en tant que sorcière avec une longue dent58. Cettecaractéristique est aussi un motif récurent dans la mythologie de l’Europe orientale. EnSerbie, Gvozdenzuba (Dent en fer) brûle les mauvaises fileuses et Baba Yaga est parfoisdécrite avec une ou plusieurs longues dents, souvent en fer. C’est cependant un autremotif des mythes de Huld (Holda ou Frau Holle) qui a amené l’éminent Potebnja àidentifier Perchta et Holda à Baba Yaga59.
7. Baba Yaga, génie de la nature
26 D’après les croyances populaires germaniques, Huld (ou souvent Perchta) secoue sestaies d’oreillers pleines de plumes, provoquant de cette façon la neige ou le givre, et destonnerres se font entendre quand elle fait bouger sa bobine de lin. On dit que la voielactée a été filée avec son rouet60. Elle contrôle de cette manière les changementsclimatiques. Dans une fonction similaire, Baba Jaudocha (Baba Dochia, Odochia,Eudochia, Dochiţa, Baba Odotia, nom qui dérive du grec Eudokia), dans l’Ukraineoccidentale, très souvent identifiée à Baba Yaga, produit aussi de la neige en bougeantses douze oreillers ou son manteau de fourrure61. Selon Afanassiev, les Biélorussesimaginent derrière les nuages d’orages Baba Yaga avec son balais, son mortier, sontapis magique, ses chevaux volants, ses bottes de sept lieues etc. Pour les Slovaques,Yaga peut déclencher le mauvais et le beau temps. En Russe, elle s’appelle parfois ярою,бурою, дикою (jaroju, buroju, dikoju), mots qui révèlent sa connexion à l’orage62. ParfoisYaga et ses filles apparaissent comme des serpents et volent ; leur vol (полет змея –polet smeja – vol du serpent) provoque tempêtes, tonnerres, tremblements de terre 63.Dans une chanson populaire, Yaga est appelée sorcière de l’hiver : « Soleil, tu as vu lavieille Yaga, Baba Yaga, la sorcière de l’hiver, cette féroce, elle a échappé au printemps,elle s’est enfuie du juste, elle a porté le froid dans un sac, secoué le froid sur la terre,trébuché et dévalé la colline64. »
27 Enfin, pour Potebnia, le dualisme et l’ambiguïté de Baba Yaga (à la fois ravisseuse etdonatrice), peuvent être rapprochés du dualisme du nuage qui fertilise la terre en été etamène la pluie en hiver. Baba Yaga est autant une déesse solaire qu’une déesse
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
73
chtonienne. Conjointement psychopompe et cause de la mort, et protectrice desnaissances.
28 Par ces exemples, il est évident que Baba Yaga peut être une déesse, ou plusrigoureusement, un génie de la nature. Elle est parfois leshachikha, la femme de leshii65,esprit de la forêt, et elle-même un esprit des bois en vivant dans son isba isolée dans lesforêts denses. Ainsi, elle est aussi rapprochée de Muma Pădurii, la Mère de la Forêt dufolklore roumain, habitant dans une hutte posée sur des pattes de coq, entourée parune clôture semée de crânes, et voleuse d’enfants (AT 327A –Hansel et Gretel66).
29 Cet aspect de génie de forêt, et plus généralement du lieu (genius loci), nous indique uneautre dimension de Baba Yaga l’identifiant à une autre figure très importante dufolklore slave, Полудница (Południca), la « femme de midi ». Elle est vieille, trèschevelue, vêtue de haillons, habitant dans les roseaux et les orties, ou c’est au contraireune très belle jeune fille vêtue de blanc, punissant ceux qui travaillent à midi67. Elleapparaît surtout dans les champs de seigle et protège la récolte. Dans d’autres lectures,elle absorbe la force vitale des champs, motif souvent lié à Baba Yaga68 qui court atravers les champs de seigle avec les cheveux dénoués ou en portant un foulard69. Parailleurs, Południca peut ressembler à Baya Yaga. Roger Caillois dans son article« Spectres de midi dans la démonologie slave : les faits », explique qu’elle est unedivinité des limites des champs, pour laquelle on chante : полудница во ржи,покажи рубежи, куда хошь побѣжи ! (« Południca dans le seigle — indique leslimites — et va-t-en où tu veux70. »).
30 Ce caractère limitrophe présente un autre aspect de Baba Yaga, en tant que genius loci,attaché à un lieu spécifique, défini et protégé par le génie lui-même sous les versions deBaba Yaga, Baba Gorbata, Polydnitsa et Pozhinalka71. Baba Yaga, soit, en tant que géniebénéfique, protège le lieu et la récolte, soit, et plus souvent, en tant que géniemaléfique, absorbe la force vitale de la récolte et la détruit. Ainsi, elle doit être chassée,action qui explique la chanson slovène ci-dessous, chantée par le peuple pendant la fêtede Saint-George (Jurij), le 23 avril, fête purement agraire visant à la renaissance de lanature : « George Vert (Zelenega Jurja) nous conduisons, beurre et œufs nousdemandons, la Baba Yaga nous chassons, le Printemps nous dispersons72 ! »
31 La chanson devait être accompagnée par un sacrifice rituel : le mannequin d’une vieillefemme devait être brûlé. Par conséquent, Baba Yaga (et ses avatars) est le génie devantêtre chassé, coutume commune à travers toute l’Europe et en particulier la partie slaveoù, à la fin de la récolte, certaines formules étaient employées et répétées pour éloignerou couper la vieille femme (Бабу резать)73. Cette coutume nous rappelle les indicationsde Frazer à propos de la Hag (vieille femme mais aussi esprit démoniaque74) quimanifeste elle aussi un dualisme remarquable. Dans un village de Styrie, la Mère du blé,sous la forme d’un mannequin, issu de la dernière botte de blé et vêtu de blanc, peutêtre vue à minuit dans les champs de blé qu’elle fertilise en les traversant ; mais si elleest en colère contre un agriculteur, elle dessèche tout son blé75. Ensuite la vieillefemme, comme dans le cas de la fête de Jurij, doit être sacrifiée.
Conclusion
32 Le côté folklorique de Baba Yaga reste relativement inconnu dans le monde occidentalet non-russophone. Le travail le plus élaboré jusqu’à aujourd’hui est le livre d’Andreas
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
74
Johns, titré Baba Yaga mais avec le sous-titre explicite : The Ambiguous Mother and Witchof the Russian Folktale. À travers les multiples catégories examinées plus haut, il estprouvé tout d’abord que Baba Yaga n’est pas un personnage sans dimensions etprofondeur. Au contraire : sorcière ravisseuse, psychopompe, cannibale, protectrice desnaissances, du lieu, de la nature et de la récolte, Baba Yaga est, comme Johns l’indique,ambigüe. Elle est inscrite par ailleurs dans un ensemble de figures fémininesdémoniaques qui créent un réseau de motifs mythologiques aux caractéristiques trèscommunes, non seulement dans la région est-européenne mais plus largementeuropéenne, caractéristiques qui doivent être comparativement relevées pour« décrypter » les mystères du folklore européen.
BIBLIOGRAPHIE
Abry, Christian et Abry-Deffayet, Dominique, « Des Parques aux fées et autres êtres sauvages :naroues, naroves et naroua savoyardes », Le Monde alpin et rhodanien, revue régionale d’ethnologie, no
1-4, Grenoble, 1982, p. 252.
Afanassiev, Alexandre Nicolaiévitch, Poeticheskija vozzrenija slavjan na prirodu [Conceptionspoétiques des Slaves sur la nature], 3 vol. , Moscou, Soldatenkov, 1869.
Alvarez-Pereyre, Frank, Contes et tradition orale en Roumanie, Paris, Société d’études linguistiqueset anthropologiques de France, 1976, p. 260-262.
Barret, John, An alvearie, or, Triple dictionarie in Englishe, Latin, and French, Londres, Henry Denham,1574.
Bleiweis, Janez, Novice gospodarske, obertnijske in národske [Économie, métiers et nouvellesnationales], Lubiana, Blaznik, p. 90.
Bogatyrev, Petr, Actes magiques, rites et croyances en Russie subcarpathique, Paris, Champion, 1929.
Boriak, Olena, « The Anthropology of Birth in Russia and Ukraine : The Midwife in TraditionalUkrainian Culture. Ritual, Folklore, and Mythology », SEEFA Journal 7, no 2, 2002, p. 29-49.
Caillois, Roger, « Les spectres de midi dans la démonologie slave : les faits », Revue des étudesslaves, t. 16, fasc. 1-2, 1936, p. 18-37.
Cherepanova, Ol’ga, Kul’turnaja pamjat’v drevnem i novom slove : issledovanija i ocherki [La mémoireculturelle dans l’ancien et le nouveau mot : études et essais], Saint-Pétersbourg, université d’Étatde Saint-Pétersbourg, 2005.
Chubinskij, Pavel, Trudy jetnografichesko-statisticheskoj jekspedicii v Zapadno-Russkij kraj [Actes del’expédition ethnographique statistique dans la région de l’Ouest de Russie], vol. 1, Saint-Pétersbourg, Société impériale russe de géographie, 1872.
Copeland, Fanny, « Slovene Folklore », Folklore, no 42, 1931, p. 405-446.
Dalh, Vladimir, Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo jazyka [Dictionnaire explicatif de la languerusse], vol. 1, Moscou, Olma Press, 2002, p. 75.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
75
Du Cange, Charles Du Fresne, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, vol. 6, Paris, Instituti RegiiFranciae Typographi, 1846, p. 390.
Efimenko, Piotr, Materialy po jetnografii russkogo naselenija Arhangel’skoj gubernii. Chast’2. Narodnajaslovesnost’ [Matériaux pour l’ethnographie de la population russe de la province d’Arkhangelsk.Partie 2 : Littérature populaire], Moscou, S. P. Arhipova, 1878.
Efremova, Tat’jana, Novyj slovar’russkogo jazyka. Tolkovo slovoobrazovatel’nyj [Nouveau dictionnairede langue russe], Moscou, Russkij jazyk, 2000.
Federowski, Michał, Lud bialoruski [peuple biélorusse], vol. 1, Cracovie, Académie des sciences,1897.
Frazer, James, The Golden Bough : A Study in Magic and Religion, vol. 1 (éd. abr.), New York,Macmillan Company, 1925, p. 399.
Grimm, Jakob, Teutonic Mythology, vol. 1, New York, Dover, 1966.
Hill, Thomas, « Perchta the Belly Slitter and Án hrísmagi : “Laxdoela saga» cap. 48-49 », Journal ofEnglish and Germanic Philology, vol. 106, no 4 (oct. 2007), p. 516-523.
Hoferer, Sebastian, Frau Holle & Baba-Jaga– Zwei ambivalente Frauenfiguren aus Mythos, Sage undMärchen im Vergleich, Diplomarbeit, Vienne, Université de Vienne, 2009.
Johns, Andreas, « Baba Iaga and the Russian Mother », The Slavic and East European Journal, vol. 42,no 1, 1998, p. 21-36.
—, Baba Yaga, The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folklore, New York, Washington, Bern,Peter Lang, 2004.
Joisten, Charles, Récits et contes populaires de Savoie, Paris, Gallimard, 1980, p. 85.
Khudiakov, Ivan, Velikorusskie skazki v zapisiakh [Enregistrements de contes de la Grande Russie],Moscou, Academia, 1964.
Korinfskii, Apolon, Narodnaia Rus’. Kruglyi god skazanii… [Les gens de la Russie. L’année deshistoires…], Moscou, Kliukin, 1901.
Lăzărescu, George, Dicţionar de mitologie, Bucarest, Dicţionarele Editurii Ion Creangă, 1979.
Lecouteux, Claude, Chasses infernales et Cohortes de la nuit au Moyen Âge, Paris, Imago, 1999.
Le Franc, Martin, Le Champion des dames, vol. IV, éd. R. Deschaux, Paris, Honoré Champion, 1999,p. 113
Lobkova, Galina, Drevnosti Pskovskoi zemli [Antiquités de la région de Pskov], Saint-Pétersbourg,ministère de la Culture de la Fédération de Russie, 2000.
Meletinskij, Eleazar, Mifologicheskij slovar’ [Dictionnaire mythologique], Moscou, Encyclopédiesoviétique, 1990.
Motz, Lotte, « The Winter Goddess : Percht, Holda, and Related Figures », Folklore 95, 1984,p. 151-166.
Nikitina, Alla, Russkaja tradicionnaja kul’tura [Culture traditionnelle russe], Saint-Pétersbourg,université d’État de Saint-Pétersbourg, 2002.
—, Russkaja demonologija [Démonologie russe], Saint-Pétersbourg, université d’État de Saint-Pétersbourg, 2006.
Novichkova, Tatiana, Russkii demonologicheskii slovar [Dictionnaire de démonologie russe], Saint-Pétersbourg, Peterburgskii pisatel’, 1995.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
76
Petruhin, Vladimir, Slavjanskie drevnosti : Jetnolingvisticheskij slovar’ [Antiquités slaves :dictionnaire ethnologique], Moscou, Relations internationales, 2012.
Planté, Christine (dir.), Sorcières et sorcelleries, Lyon, PUL, 2002.
Pócs, Éva, Fairies and Witches at the Boundary of South-Eastern and Central Europe, Helsinki, AcademiaScientiarum Fennic, 1989.
Politis, Nikolaos, Melete peri tou viou kai tis glossis tou ellinikou laou : Paradoseis [Études sur la vie etla langue néohelléniques : traditions], vol. I, Athènes, Sakelariou, 1904, p. 508-509.
Polívka, Jiří, « Du surnaturel dans les contes slovaques : les êtres doués de pouvoirs surnaturels »,Revue des études slaves, t. 2, fasc. 3-4, 1922, p. 256-271.
Potebja, Aleksandr, « O mificheskom znachenii nekotorykh obriadov i poverii. II. Baba-Iaga » [Àpropos de la signification des certains rituels et croyances mythiques. II. Baba-Yaga], Chteniia vimperatorskom obshchestve istorii i drevnostei rossiiskikh pri moskovskom universitete [Lecture de laSociété impériale de l’histoire et des antiquités russes à l’Université de Moscou], Moscou,Typographie universitaire, 1865.
Propp, Vladimir, Les Racines historiques du conte merveilleux, trad. Lise Gruel-Apert, Paris,Gallimard, 1983.
Proppovskiĭ tsentr, Morfologija prazdnika [Morphologie des fêtes], Saint-Pétersbourg, Universitéde Saint-Pétersbourg, 2006.
Revelard, Michel et Kostadinova, Guergana, Le Livre des masques : masques et costumes dans les fêteset carnavals traditionnels en Europe : collections du musée international du Carnaval et du Masque, Paris,La Renaissance du Livre , 1998, p. 35.
Rose, Carol, Spirits, Fairies, Leprechauns, and Goblins : An Encyclopedia, New York, Londres, Nortonand Company, 1996, p. 297.
Roussineau, Gilles (éd.), Perceforest, vol. 2, Genève, Droz, 1999, p. 77
Rumpf, Marianne, Perchten : populäre Glaubensgestalten zwischen Mythos und Katechese, Würzburg,Königshausen & Neumann, 1991.
Ryan, William Francis, The Bathhouse at Midnight : An Historical Survey of Magic and Divination inRussia, Pennsylvanie, Pennsylvania State University Press, 1999.
Shanskij, Nikolai et Bobrova, Tat’jana, Jetimologicheskij slovar’russkogo jazyka [Dictionnaireétymologique de la langue russe], Moscou, Prosveshhenie, 1994.
Simpson, John et Weiner, Edmund, The Oxford Eglish Dictionary, vol. VI, Oxford, Clarendon Press,1989, p. 1011.
Smith, John, « Perchta the Belly-Slitter and Her Kin : A View of Some Traditional ThreateningFigures, Threats and Punishments », Folklore 115 (2), août 2004, p. 167-186.
Sokolov, Mihail, Starorusskie solnechnye Bogi i Bogini [Dieux et des déesses vieux-russes du soleil],Simbirsk, Tipografija A. T. Tokareva, 1887.
Toporkov, Andrey, « “Rebaking” of Childrend in Eastern Slavic Ritual and Fairy-Tales », ThePetersburg Journal of Culture, vol. 1, no 3, 1993, p. 15-21.
Vinogradova, Ljudmila, « Obshchee i spetsificheskoe v slavianskikh poveriiakh o ved’me »[Études générales et spécifiques des croyances slaves sur la sorcière], Obraz mira v slove i rituale.Balkanskie chteniia [L’image du monde dans le mot et le rituel, Lecture des Balkans], Moscou,Institut des études slaves de l’Académie des sciences de Russie, 1992, p. 58-73.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
77
Walter, Philippe, La Fée Mélusine, Paris, Imago, 2008.
Zavoiko, Genadii, « Verovaniia, obriady i obychai velikorossov Vladimirskoi gubernii »[Croyances, rites et coutumes de la province de la Grande-Russie Vladimir], EthnograficheskoeObozrenie [Critique ethnographique], vol. 3-4, 1914, p. 81-178.
Zochios, Stamatis, « Lamia : a Sorceress, a Fairy or a Revenant ? », in Tric Trac. Journal of WorldMythology and Folklore, vol. 4, University of South Africa Press, 2013, p. 96-112.
NOTES1. V. Dalh, Tolkovyj slovar’zhivogo velikorusskogo jazyka [Dictionnaire explicatif de la langue russe],p. 75.2. P. Bogatyrev, Actes magiques, rites et croyances en Russie subcarpathique, p. 142-144.3. Quelques traits du récit-croyance populaire sont : temps et espace défini ; caractère detémoignage, réel, documentaire, souvent fonctionnel qui interprète des faits ; texte bref, moinsorné que le conte ; narration simple ; moins fabuleuse.4. O. Cherepanova, Kul’turnaja pamjat’v drevnem i novom slove : issledovanija i ocherki [La mémoireculturelle dans l’ancien et le nouveau mot : études et essais], p. 120.5. P. Efimenko, Materialy po jetnografii russkogo naselenija, [Matériaux pour l’ethnographie de lapopulation russe de la province d’Arkhangelsk. Partie 2 : Littérature populaire], p. 142-143.6. Pour une incantation similaire, incluant une convocation de Baba Yaga, voir M. Sokolov,Starorusskie solnechnye Bogi i Bogini [Dieux et des déesses vieux-russes du soleil], p. 25.7. P. Efimenko, op. cit., p. 140. Texte traduit par nos soins.8. Voir N. Leskov, « Zhitie odnoj baby » [la vie d’une femme], http://rvb.ru/leskov/01text/vol_01/007.htm/9. Disponible sur http://starling.rinet.ru/10. Voir N. Shanskij et T. Bobrova, Jetimologicheskij slovar’russkogo jazyka [Dictionnaireétymologique de la langue russe].11. Voir S. Zochios, « Lamia : a Sorceress, a Fairy or a Revenant ? », p. 96-112.12. A. N. Afanassiev, Poeticheskija vozzrenija slavjan [Conceptions poétiques des Slaves sur laNature], p. 588.13. V. Petruhin, Slavjanskie drevnosti : Jetnolingvisticheskij slovar’ [Antiquités slaves : dictionnaireethnologique], p. 614.14. P. Efimenko, op. cit., p. 106.15. J. Polívka, « Du surnaturel dans les contes slovaques : les êtres doués de pouvoirssurnaturels », p. 264.16. Voir Ph. Walter, La Fée Mélusine.17. Voir C. Planté (dir.), Sorcières et sorcelleries.18. G. Roussineau (éd.), Perceforest, p. 77 : « Lors regarde en l’air et voit que c’estoient toutesvielles matrosnes barbues et eschevellees qui menoient le plus lait deduit (affreux vacarme) quel’on porroit oïr et tenoient en leurs mains selletes (petites sièges de bois) et bourdons (bâtons),hasplez (dévidoirs) ou cyneules (quenouilles) et aloient escremissant (combattant) en l’air lesunes aux aultres ainsi que toutes esragees (enragées). »19. M. Le Franc, Le Champion des dames, p. 113 : « Hélas, tu n’as parlé des masques : Je te pry quenous en contons, Dist l’adversaire, et de leurs frasques, Se ce sont varous ou luitons, Se vont à piéou sur bastons, Se volent en l’air comme oysiaux, Se menguent les valetons. »20. A. N. Afanassiev, op. cit., vol. 1, p. 291.21. M. Federowski, Lud bialoruski [peuple biélorusse], p. 80.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
78
22. Voir T. Efremova, Novyj slovar’russkogo jazyka. Tolkovo slovoobrazovatel’nyj [Nouveaudictionnaire de langue russe].23. L’aspect cannibale de la strige est noté par Du Cange dans l’entrée Striga : « Striga,λαιστρυγών, ϰαι γυνὴ φαρμαϰίς ». Λαιστρυγών, Laestrygon, signifie le cannibale et γυνὴφαρμαϰίς, la femme sorcière. Cf. Ch. Du Fresne Du Cange, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis,p. 390.24. Prenons un exemple : dans l’Alvearie or Triple Dictionarie in Englishe, Latin, and French, ouvragede 1574, l’auteur John Barret fait référence à une hag, synonyme de strix : « a hag, a fairie, a witchthay changeth the fauour of children, strix ». Selon Littré la strige est un vampire, un géniemalfaisant et nocturne, une sorcière, et elle est issue du latin striga, oiseau de nuit qui passaitpour déchirer les enfants.25. J. Polívka, op. cit., p. 256-262.26. L. Vinogradova, « Obshchee i spetsificheskoe v slavianskikh poveriiakh o ved’me » [Étudesgénérales et spécifiques des croyances slaves sur la sorcière], Obraz mira v slove i rituale. Balkanskiechteniia [L’image du monde dans le mot et le rituel, Lecture des Balkans], p. 64.27. Les traditions disent que la septième fille d’une famille devient bosorka. Voir L. Vinogradova,op. cit., p. 65.La croyance selon laquelle l’enfant qui est né pendant certains moments – tabous, ou dans uneligne de succession particulière – par exemple le septième fils ou la septième fille d’une famille,peut devenir un être surnaturel est répandue en Europe. En France, la croyance mentionne qu’ilest fort possible qu’un fils (souvent le septième) de la famille devienne un loup-garou et que lafille (également la septième) devienne un cauchemar. On retrouve cette croyance dans lesfameux Évangiles des Quenouilles (CIV, 12) : « Se un homme a tele destinee d’estre leu warou, c’estfort se son filz n’en tient. Et ses filles a et nulz filz, volontiers sont quauquemaires. » On retrouvela tradition en Grèce moderne, mais cette fois-ci le fils devient kalikantzaros et la fille, gello. Pourune analyse de cette tradition, ainsi que le rapport entre mora, cauchemar et kikimora, voir S.Zochios, Le Cauchemar mythique : étude morphologique de l’oppression nocturne dans les textesmédiévaux et les croyances populaires, thèse, Université de Grenoble, soutenue en 2012.28. Martin Luther, Sermon sur Exode, WA XVI, 1526, p. 551.29. O. Cherepanova, op. cit., p. 118.30. Selon le Jetimologicheskij slovar’russkogo jazyka de Shanskij et Bobrova, le nom Baba Yaga est unsynonyme de ведьма (ved’ma), sorcière ; pour une analyse en anglais des termes volkhv, koldun,ved’ma, znakhar’ et vorozhei qui signifient tous le sorcier-la sorcière, voir le travail important de W.F. Ryan, The Bathhouse at Midnight : An Historical Survey of Magic and Divination in Russia, p. 68-86.31. Le mot correspond au vieux tchèque jëzë, lamia (évoquant à la version de Baba Yaga femme-serpent), et bien sur au russe яга, d’après le proto-slave * (j) egа ou, selon Polívka, le slavecommun * ęga (J. Polívka, op. cit., p. 257).32. J. Polívka, op. cit., p. 261.33. G. Zavoiko, « Verovaniia, obriady i obychai velikorossov Vladimirskoi gubernii » [Croyances,rites et coutumes de la province de la Grande-Russie Vladimir], p. 111.34. A. Johns, Baba Yaga, The Ambiguous…, p. 58.35. T. Novichkova, Russkii demonologicheskii slovar [Dictionnaire de démonologie russe], p. 471-477.36. P. Chubinskij, Trudy jetnografichesko-statisticheskoj jekspedicii v Zapadno-Russkij kraj [Actes del’expédition ethnographique statistique dans la région de l’Ouest de Russie], p. 217.37. Ch. Joisten, Récits et contes populaires de Savoie, p. 85.38. C. Abry, et D. Abry-Deffayet, « Des Parques aux fées et autres êtres sauvages : naroues,naroves et naroua savoyardes », p. 252.39. N. Politis, Melete peri tou viou kai tis glossis tou ellinikou laou : Paradoseis [Études sur la vie et lalangue néohelléniques : traditions], p. 508-509.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
79
40. Voir le conte Cu Baba Cloanța [Avec la Mère Mégère] – de type AT 501 : F. Alvarez-Pereyre,Contes et tradition orale en Roumanie, p. 260-262.41. Ms. Clm. 1438, fol. 203v o de la Bibliothèque nationale de Munich. Cité par Cl. Lecouteux,Chasses infernales et Cohortes de la nuit au Moyen Âge, p. 20.42. Cl. Lecouteux, op. cit., p. 21.43. C. Rose, Spirits, Fairies, Leprechauns, and Goblins: An Encyclopedia, p. 297.44. Th. Hill, « Perchta the Belly Slitter and Án hrísmagi: “Laxdoela saga» cap. 48-49 », p. 516-523.45. A. Toporkov, « “Rebaking” of Childrend in Eastern Slavic Ritual and Fairy-Tales », ThePetersburg Journal of Culture, vol. 1, no 3, 1993, p. 15-21.46. Cette coutume violente est aussi mentionnée dans le De Graecorum Hodie Quorundamopinationibus (Sur certaines opinions modernes chez les Grecs) de Leo Allatius (1645). Les Grecspassaient le nouveau-né au dessus du feu pour qu’il ne se transforme pas en kalikantzaros.47. Voir V. Propp, Les Racines historiques du conte merveilleux.48. I. Khudiakov, Velikorusskie skazki v zapisiakh [Enregistrements de contes de la Grande Russie],p. 269-270.49. M. Revelard et G. Kostadinova, Le Livre des masques : masques et costumes dans les fêtes etcarnavals traditionnels en Europe : collections du musée international du Carnaval et du Masque, p. 35.50. Pour plus d’informations sur Perchta, voir M. Rumpf, Perchten: populäre Glaubensgestaltenzwischen Mythos und Katechese; J. Smith, « Perchta the Belly-Slitter and Her Kin: A View of SomeTraditional Threatening Figures, Threats and Punishments », p. 167-186.51. En Serbie orientale Baba Jega peut être une figure masquée de la période Pascale. VoirJ. Andreas, Baba Yaga, The Ambiguous…, op. cit., p. 70.52. F. Péroz, La Campagne franc-comtoise : Vie et traditions d’autrefois, p. 55.53. Martin von Amberg, Gewissensspiegel, Hoffm., p. 335-336.54. O. Boriak, « The Anthropology of Birth in Russia and Ukraine: The Midwife in TraditionalUkrainian Culture. Ritual, Folklore, and Mythology », p. 29-49.55. G. Illyés, Once Upon a Time: Forty Hungarian Folk-Tales, p. 271.56. Pour le rapport entre Huld et Baba Yaga, voir S. Hoferer, Frau Holle & Baba-Jaga– Zweiambivalente Frauenfiguren aus Mythos, Sage und Märchen im Vergleich.57. Martin Luther, Auslegungder Episteln, Basel, 1622, p. 69.58. J. Grimm, Teutonic Mythology, p. 269.59. A. Potebja, « O mificheskom znachenii nekotorykh obriadov i poverii. II. Baba-Iaga » [Àpropos de la signification des certains rituels et croyances mythiques. II. Baba-Yaga], p. 88-90.60. Voir L. Motz, « The Winter Goddess: Percht, Holda, and Related Figures », p. 151-166.61. E. Meletinskij, Mifologicheskij slovar’ [Dictionnaire mythologique], p. 85.62. A. N. Afanassiev, op. cit., III, p. 591.63. V. Petruhin, op. cit., p. 614. Il serait fort intéressant de comparer cet aspect de Yaga à ala, ouhala créature féminine du folklore bulgare, macédonien et serbe, personnification du mauvaistemps.64. A. Korinfskii, Narodnaia Rus’. Kruglyi god skazanii… [Les gens de la Russie. L’année deshistoires…], p. 146-147.65. O. Cherepanova, op. cit., p. 104.66. Voir G. Lăzărescu, Dicţionar de mitologie.67. R. Caillois, « Les spectres de midi dans la démonologie slave : les faits », p. 20-22.68. G. Lobkova, Drevnosti Pskovskoi zemli [Antiquités de la région de Pskov], p. 27-28.69. Ibid.70. R. Caillois, op. cit., p. 20-22.71. G. Lobkova, op. cit., p. 27-28.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
80
72. « Zelenega Jurja vodimo, Maslo in jajca prosimo, Ježi-babo zganjamo, Mladoletje trošimo ! ».Voir J. Bleiweis, Novice gospodarske, obertnijske in národske [Économie, métiers et nouvellesnationales], p. 90.73. Proppovskiĭ tsentr, Morfologija prazdnika [Morphologie des fêtes], p. 133-137.74. Pour l’interprétation du terme hag voir J. Simpson et E. Weiner, The Oxford Eglish Dictionary,p. 1011.75. J. Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, p. 399.
RÉSUMÉSBaba Yaga est une figure du conte russe s’inscrivant dans le panthéon des êtres surnaturels dufolklore slave, comme le prouvent les recherches des folkloristes et ethnologues. Elle peutapparaître en tant que figure démoniaque, liée aux motifs des femmes surnaturelles descroyances populaires de l’Europe – le filage, l’apparence monstrueuse, le contrôle desphénomènes naturels, le royaume des morts – ainsi qu’à un ensemble d’êtres apparentés : laslovaque jezibaba (jenzibaba, endzibaba, jazibaba), la carpato-ukrainienne izhuzhbaba, indzhibaba, lapolonaise jedsi baba ou baba jaga, les sorabes wjerbava, wurlavu (ou worawy), pripolnica (prezpolnicaou poludnitsa), les serbes sumska maika, baba korizma et gvozdenzuba, et ainsi de suite.
Baba Yaga, a character of Russian fairy tales, is an integral part of the pantheon of supernaturalbeings of Slavic folklore, as evidenced by folklorists and anthropologists. She can appear as ademonic figure, characterized by certain motifs shared with supernatural women of Europeanfolk beliefs – the spinning, the monstrous appearance, the control of natural phenomena, accessto the Kingdom of the Dead – as well as to a set of related beings: the Slovak jezibaba (jenzibaba,endzibaba, jazibaba), the Carpatho-Ukrainian izhuzhbaba, indzhibaba, the Polish jedsi baba ou babajaga, the Sorbian wjerbava, wurlavu (ou worawy), pripolnica (prezpolnica ou poludnitsa), the Serbiansumska maika, baba korizma et gvozdenzuba, and so on.
INDEX
Mots-clés : croyances populaires, sorcellerie, filage, génie du lieu, dualismeKeywords : folk beliefs, witchcraft, spinning, genius loci, dualism
AUTEUR
STAMATIS ZOCHIOS
Stamatis Zochios est docteur en littérature comparée de l’université de Grenoble III, il a étérattaché au Centre de recherche sur l’imaginaire (CRI) et au Centre d’études byzantines néo-helléniques et sud-est européennes (EHESS), en tant que chercheur doctoral et postdoctoral.Actuellement il est attaché temporaire d’enseignement et de recherches (ATER) au Départementd’études néo-helléniques de l’Université de Strasbourg, ainsi que membre scientifique du GEO
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
81
(Groupe d’études orientales, slaves et néo-helléniques) de l’Université de Strasbourg. Sondomaine de spécialisation est le folklore grec moderne et européen.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
82
Portrait d’une Baba Yaga polonaise1
Katia Vandenborre
1 L’idée de dresser le portrait d’une Baba Yaga polonaise peut paraître surprenantequand on sait qu’elle est un des personnages les plus représentatifs de la culture russe2.Même si des figures similaires ont pu être relevées en Ukraine, en Biélorussie, enSlovaquie et en République Tchèque3, sa présence en Pologne est loin d’être évidente.Dans l’esprit des folkloristes polonais, elle relève de la tradition russe et ne figure parconséquent pas dans Le Dictionnaire du folklore polonais [Słownik folkloru polskiego, 1965].Pourtant, elle fait partie du panthéon féerique de la compilation de contes polonais laplus populaire dans la deuxième moitié du XIXe siècle : Le Conteur polonais. Recueil decontes, nouvelles et récits populaires [Bajarz polski. Zbiór baśni, powieści i gawęd ludowych]d’Antoni Józef Gliński. Au moment de sa sortie en 1853, cela faisait déjà plusieursdécennies que la Pologne avait perdu son indépendance au profit de la Russie, la Prusseet l’Autriche, faisant du folklore un refuge de culture nationale. Dans ce contexte, laprésence de Baba Yaga dans trois des quatre tomes de Gliński pose de multiplesquestions. Afin d’apporter un premier éclairage sur cette figure de la littératureféerique polonaise, le présent article se propose d’esquisser son portrait sur la base dessept contes dans lesquels elle apparaît. Il sera ainsi possible de mieux la cerner parrapport à son homologue russe et d’établir des liens avec l’époque de Gliński, tout enrendant compte des différents niveaux de son ambiguïté.
1. Les deux visages de Baba Yaga
2 Les deux visages que Gliński attribue à Baba Yaga reflètent les deux natures positives etnégatives de la sorcière qui tantôt s’entremêlent, tantôt s’opposent. Dans Le Conteurpolonais, elle exerce en effet des fonctions contradictoires qu’il serait difficile deconcilier dans un portrait figé ou unilatéral.
1.1 Un visage d’ange
3 Dans Le Conteur polonais, le premier visage que le lecteur entrevoit de Baba Yaga estcelui d’une précieuse auxiliaire sans laquelle le héros ne peut retrouver sa fiancée et
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
83
reformer le couple heureux qu’il a détruit en jetant la peau de grenouille de sa bien-aimée au feu. Appelé à succéder à son père pour avoir trouvé un meilleur parti que sesfrères, le prince de « La Princesse transformée en grenouille » [O królewnie zaklętej wżabę] arrive chez Baba Yaga au tout début de sa quête. La fiancée qui lui avait étédésignée par sa flèche tombée dans le marais vient à peine de disparaître, alors qu’elleavait prouvé au roi qu’elle était la belle-fille parfaite. Transformée en grenouille par lesennemis de sa mère magicienne, la princesse devait néanmoins attendre que sa mère sedébarrasse de ses adversaires pour retrouver définitivement sa forme humaine. En luidérobant sa peau de grenouille, le héros ne s’est pas rendu compte qu’il risquait de toutgâcher. Changée en canard, la princesse se volatilise soudainement avant que le princen’ait eu le temps de l’épouser. Il se lance alors à sa recherche.
4 Ayant sillonné la terre pendant des semaines, le héros s’approche enfin d’une maisonsur pattes de poule. Il prononce la formule suivante :
Maisonnette, maisonnette ! Remue-toiSur pattes de poule par le bas ;Le dos vers la forêt tourne-toi,Et fais face à moi.4
5 Sur ce, la maison commence à craquer, à bouger et ouvre ses portes au prince. Il entreet trouve Baba Yaga qui « file la quenouille, fredonne une chansonnette et prépare unprojet dans sa tête5 ». À sa vue, Baba Yaga lui demande ce qui l’amène et il racontetoutes ses mésaventures. Désireuse de l’aider, elle l’invite à tenter d’attraper le canardqui lui rend visite chaque jour. Toutefois, le canard lui échappe en prenant l’apparenced’un pigeon, d’un faucon, puis d’un serpent. Baba Yaga le sermonne car, par sa faute, lecanard ne reviendra plus jamais chez elle. Elle lui donne néanmoins une pelote de filqui le mènera chez sa sœur où il pourra retenter sa chance. La scène du prince quiprononce la formule magique devant la maison sur pattes de poule se répète àl’identique quand il arrive chez la deuxième Baba Yaga. Elle invite le prince à se cacherpour attraper le canard. Cette fois-ci, l’oiseau échappe au prince en se transformant endinde, en chien, en chat et finalement en anguille. Ce n’est que dans la troisièmemaison sur pattes de poule, chez la troisième Baba Yaga et aînée des deux premières,que le héros finit par s’en saisir. Libérée de son sort, la princesse peut enfin épouserl’héritier de la couronne.
6 Dans le conte qui succède à « La Princesse transformée en grenouille » dans le premiervolume du Conteur polonais, Gliński attribue une fonction similaire à Baba Yaga. Toutcomme dans le précédent texte, la sorcière de « La Princesse Vierge-Miracle, le princeYunak et l’invisible massue auto-frappante » [O królewnie Cud-dziewicy, królewiczu Junaku,i o maczudze niewidce samobijce] apparaît dans la deuxième partie pour aider à dénouer lenœud qui s’est noué dans la première. Bien qu’elle ne soit plus accompagnée de sesdeux sœurs, elle prodigue de précieux conseils qui permettent de libérer à termes laprincesse des mains de Koščej. C’est le soleil qui recommande au chevalier Yunak de serendre chez Baba Yaga plutôt que de s’opposer de manière frontale au magicien qui aemprisonné la princesse Vierge-Miracle dans son château. Yunak va d’abord chercherla massue invisible auto-frappante et le cheval capable de le conduire chez Baba Yaga.Le prince arrive ainsi « devant la forêt vierge ensommeillée dans laquelle vit Baba Yaga6
». Étonné par « la vieillesse des immenses chênes, pins et sapins », Yunak constate qu’il« y règne un silence de mort », que « tous les arbres sont comme endormis » et « quel’on ne voit aucune créature vivante dans les profondeurs antiques de la forêt7 ». Yunaket sa monture traversent la forêt morbide et atteignent la maison sur pattes de poule.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
84
Yunak y prononce la même formule que le héros de « La Princesse transformée engrenouille », la maison s’ouvre et le prince entre dans la demeure de Baba Yaga.
7 Surprise de le voir, Baba Yaga lui demande : « Comment es-tu arrivé ici, prince Yunak,alors qu’aucune âme vivante n’est jamais parvenue jusqu’ici8 ? » Peu désireux derépondre, il lui demande l’hospitalité, ce que Baba Yaga s’empresse de faire en luidonnant à boire, à manger et de quoi se reposer. Le surlendemain, le prince explique àson hôte les raisons de sa venue. Impressionnée par « la grande et belle œuvre9 » qu’il aentreprise, Baba Yaga lui apprend comment débusquer la mort de Koščej sans laquelleil ne pourra le vaincre. Il doit se rendre sur une île située dans l’océan et déterrer sousun chêne un coffre qui contient un lièvre dans lequel il y a le canard qui renferme l’œufoù se trouve sa mort. Ayant déniché la mort de Koščej, Yunak élimine Koščej et dissipeainsi tous les sorts que le magicien avait jetés. Le chevalier et la princesse se marient.La fin heureuse confirme ainsi le rôle positif joué par Baba Yaga en tant que donatrice. 1.2 Un visage bifrons
8 Même si l’action positive de Baba Yaga est attestée dans les deux contes que nousvenons d’évoquer, elle reste entourée d’une aura négative qui rend sa classificationincertaine. « Vieille et grisonnante10 », son apparence est peu engageante à l’image detout l’environnement qui l’entoure. Elle vit dans une maison qui est d’emblée fermée auhéros, puisqu’elle ne s’ouvre qu’après l’énonciation de la formule magique adéquate etqu’elle est située dans une forêt obscure inspirant la mort par son âge et son silence.Cet habitat morbide égratigne quelque peu l’image de Baba Yaga qui semble avoir demystérieux liens avec la mort. Par ailleurs, son côté dissimulateur est amplifié par lefait qu’elle élabore des plans dans sa tête sans en toucher un seul mot au héros, commesi elle tramait quelque chose derrière son dos, tout en prétendant l’aider.
9 La gratuité de son aide cesse en tout cas d’être en vigueur dans « Le Prince à lamoustache d’or au poing d’or, la princesse aux cheveux en or, la casquette auto-chauffante et la flasque auto-refroidissantes » [O królewiczu złotowąsym ze złotą pieścią,królewnie złotowłosej, czapce samogrzejce i o flaszy samochłodce]. Justifiée par la beauté et lagrandeur de l’entreprise du héros dans « La Princesse Vierge-Miracle », l’interventionde Baba Yaga est parfaitement désintéressée dans « La Princesse transformée engrenouille ». Le fait qu’elle devienne nettement plus exigeante dans « Le Prince à lamoustache d’or au poing d’or » suggère dès lors une ambiguïté plus grande de sa natureprofonde. Dans ce conte issu du troisième volume du Conteur polonais, Baba Yagaaccepte d’aider le prince à la moustache d’or au poing d’or à condition qu’il lui apportede l’eau de jouvence qui s’écoule sur la montagne où sa quête est censée aboutir. Eneffet, ses deux frères aînés y ont perdu la vie alors qu’ils tentaient d’atteindre lesommet sur lequel la princesse aux cheveux d’or avait été emprisonnée par l’ouraganqui l’avait enlevée le jour de ses dix-huit ans. Ayant pris en pitié le couple royal affligépar la perte de ses deux fils, Dieu leur fait cadeau d’un troisième fils aux capacitéssurnaturelles afin de retrouver les aînés.
10 Ayant rapidement atteint l’âge adulte, ce prince fabuleux entame une quête qui le faittraverser d’immenses espaces. Il arrive finalement dans une forêt sombre où il aperçoitune maison sur pattes de poule : « La chaumière noircit au loin et le champ alentour estparsemé de coquelicots en pleine floraison11. » Pris de somnolence au fur et à mesurequ’il approche, le héros s’accroche à sa monture, arrache des têtes de coquelicot et finit
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
85
par l’atteindre. Il y entre après avoir prononcé la formule consacrée et y trouve BabaYaga « grisonnante, décrépie, plein de rides et de boutons12 ». L’apparence de ce« véritable démon13 » qui est plongé dans ses pensées contraste avec celle de ses deuxfilles « jeunes et avenantes14 » qui sont assises à côté d’elle à la table. Voyant arriver leprince à la moustache d’or au poing d’or, Baba Yaga l’interroge sur son dessein et, aprèsavoir entendu son histoire, lui explique comment et où ses frères sont morts. Sur ce, lehéros la questionne sur les moyens d’atteindre le vent kidnappeur, mais elle le prévientque celui-ci risque de l’enlever à son tour. Le prince reste cependant confiant, sesentant protégé par son poing en or.
11 Comme le prince ne craint rien, Baba Yaga accepte de l’aider en échange de l’eau dejouvence. Remplissant sa fonction de donatrice, elle met entre ses mains troisauxiliaires magiques : une pelote qui indique le chemin, une casquette auto-chauffanteet une flasque auto-refroidissante. Les trois objets permettent au jeune hommed’atteindre la montagne sous les nuages, de l’escalader en résistant aux changementsde températures, de retrouver le corps de ses frères et d’arriver au palais où estenfermée la princesse aux cheveux d’or. Il la libère, vainc la tempête, ressuscite sesfrères et apporte l’eau de jouvence à Baba Yaga. À peine en prend-elle quelques gouttesque « tout ce qui en elle était vieux et vilain devient jeune et beau15 ». « Rajeunie enpucelle16 », elle éprouve une joie réelle, comme si cette nouvelle apparencecorrespondait mieux à sa nature intérieure. Reconnaissante, elle donne ses deux fillesen mariage aux frères ressuscités. Le prince à la moustache d’or au poing d’or, quant àlui, épouse la princesse aux cheveux d’or.
12 Tout en incarnant un personnage favorable au héros, Baba Yaga semble néanmoinsavoir une part de responsabilité dans l’enlèvement de la princesse aux cheveux d’or.Bien que l’identité du vent qui la kidnappe ne soit pas révélée, le lecteur ne peut qu’êtresurpris par la configuration du palais dans lequel elle est emprisonnée. Tout comme lachaumière de Baba Yaga, celui-ci tient sur des pattes de poule et le prince doit énoncerune formule similaire pour qu’il s’ouvre :
Palais, palais ! Remue-toiSur pattes de poule par le bas ;Le dos vers l’abîme tourne-toi,Et fais face à moi.17
13 La ressemblance entre le palais et la chaumière laisse supposer que Baba Yaga est enréalité le vent violent qui a enlevé l’héroïne. Quoique surprenante, l’hypothèse est loind’être improbable. Elle est corroborée par des recherches qui ont établi des parallèlesentre Baba Yaga et un nuage de tempête18, confirmant dès lors l’identité cachée del’ouragan kidnappeur et maître du palais sur pattes de poule. Cela signifie que BabaYaga joue simultanément les rôles de méchant et de donateur.
14 Cette ambiguïté est également perceptible dans un texte issu du deuxième volume quis’intitule « Le Prince transformé en écrevisse » [O królewiczu zaklętym w raka]. Dans cettetrame proche de « La Princesse transformée en grenouille », Baba Yaga n’est pasprésentée comme un personnage à part entière, mais son absence est soulignée quandle héros entre dans la maison sur pattes de poule : « À la place de la Baba Yaga que l’ons’attend habituellement à voir dans ce type de maison, le prince voit devant lui unejeune pucelle d’une beauté jamais vue et jamais entendue19 ! » À la vue de la joliesilhouette, le narrateur suggère qu’il ne peut s’agir de Baba Yaga, étant donné qu’elleest normalement vieille et repoussante. Bien que le conte précédent nous ait montré
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
86
qu’il lui arrive d’être transformée en belle jeune fille, le développement ultérieur de latrame confirme l’affirmation du narrateur : la jeune pucelle dans la maison sur pattesde poule se révèle être la fille d’un couple royal qui a été enlevée par le « maître desmagiciens », une « vipère-esprit volant » [żmij-latawiec20]. Rien ne laisse supposer que cemagicien ait un quelconque lien avec Baba Yaga, mais il semble y avoir une parentécachée. Des recherches ont en effet démontré que la sorcière avait une origine reptilequi la rattache à la famille des serpents21. Par ailleurs, le terme latawiec est le masculinde latawica qui, bien qu’il désigne un esprit volant, est souvent utilisé comme unsynonyme de sorcière en polonais22. Il est dès lors légitime de supposer que Baba Yagaest le principal méchant du récit, ayant non seulement enlevé la princesse, mais aussitransformé le héros en écrevisse. Il n’en demeure pas moins que la maison de BabaYaga constitue le principal lieu de résolution de l’intrigue. Le héros y trouve la réponseà plusieurs problèmes qu’il a promis de résoudre dans sa quête ainsi que l’opportunitéde tuer le magicien qui l’a ensorcelé, lui permettant finalement de rejoindre son épousedans leur palais et de vivre heureux éternellement. Quoiqu’elle demeure absente, BabaYaga joue donc un double rôle dans l’action, à la fois positif et négatif. 1.3 Un visage de démon
15 Cette duplicité est encore plus marquée dans « Le Tapis volant, la casquette invisible, labague qui donne de l’or et le bâton auto-battant » [O dywanie samolocie, czapce niewidce,pierścieniu złotodajnym, i o kiju samobiju] qui précède « Le Prince à la moustache d’or aupoing d’or » dans le troisième volume du Conteur polonais. Bien qu’elle ne fasse paspartie intégrante de l’action, l’ombre de Baba Yaga se devine derrière l’action duméchant. À chaque fois que ce dernier assaille le royaume il est repoussé par le héros,un pauvre pêcheur aidé par la bague merveilleuse qu’il a reçue d’un poisson en or. Afind’éviter un troisième échec, l’ennemi du roi va finalement trouver Koščej pour luidemander de kidnapper la princesse à sa place. Même si l’issue est finalement heureuse– le pêcheur parvient à éliminer l’ennemi et reçoit la main de la princesse enrécompense –, cet épisode ralentit drastiquement son action. Or, le narrateur souligneque cette idée de faire intervenir Koščej a été soufflée au méchant par Baba Yaga enpersonne23. Sans être fatale, l’action de Baba Yaga est donc malveillante.
16 De manière encore plus limpide, la lumière est jetée sur l’action négative de Baba Yagadans « Le Diable et la Bonne Femme » [O diable i o babie]. Ce célèbre conte est lié à unproverbe paysan déjà répertorié par Kazimierz Władysław Wójcicki dans ses Contes,légendes antiques et récits du peuple polonais et de Rus [Klechdy, starożytne podania i powieściludu polskiego i Rusi, 1837] : Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle24, c’est-à-dire « Quand lediable ne peut pas, c’est la commère qu’il envoie ». Le diable énonce le proverbe à la finde l’histoire, reconnaissant que la femme est parfois plus douée que lui pour commettrele mal. Ne supportant pas qu’un couple vive en harmonie, le diable s’efforce en vain desemer le trouble entre les deux amoureux. Voyant le diable désespéré, une baba quipasse par là propose de s’en charger en échange de souliers neufs. Décrite par Glińskicomme « sèche, ridée et carbonisée comme un tisonnier25 », cette femme est en véritéBaba Yaga : « C’était la célèbre Yaga [Jędza], elle avait été qualifiée de sorcière et,plongée plusieurs fois dans l’étang, elle n’avait jamais coulé26. » Le marché est concluavec le diable, Baba Yaga réussit à créer un quiproquo entre les époux et le diablesatisfait lui offre des souliers.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
87
17 Toutefois, c’est dans « Le chevalier Niezginek, l’épée auto-coupante et les gousli auto-joueuses » [O rycerzu Niezginku, mieczu samosieczu, i o gęslach samograjach] que Baba Yagaagit véritablement comme un être maléfique, incarnant le principal ennemi du héros.Niezginek est le douzième des fils offerts par Dieu à un vieux couple pour lesrécompenser de leur bonté. Quand les garçons arrivent à l’âge adulte, les parents leurconseillent de se rendre chez Baba Yaga pour demander la main de ses douze filles :
– Voilà que dans ce pays-ci et ce pays-là, dans cette région-ci et cette région-là vit lacélèbre sorcière Baba Yaga à la jambe osseuse qui se déplace dans un mortier enchêne, s’appuie sur des pilons en fer et efface les traces derrière elle avec un balai.Chez cette Baba Yaga, il y a justement douze filles, toutes belles et bien dotées, justebonnes à marier. Allez de ce pas de ce côté-là et, sans épouses, ne revenez pas27.
18 Les douze frères prennent la direction de la maison de Baba Yaga sur leurs douzemontures. Białoszek, le cheval de piètre apparence dont a hérité le cadet, le met engarde au sujet de la sorcière : « souviens-toi qu’il est difficile de l’atteindre, mais il estencore plus difficile de lui échapper, car elle en a déjà dévoré des milliers comme vous28
». Białoszek prévient le héros à juste titre car Baba Yaga est une créature maléfique :C’était un démon, une cruelle sorcière vieille comme le monde ; et bien qu’elle eûtl’air d’un homme, elle se nourrissait de corps humain ; en conséquence de quoi lemalheureux qui se faisait embobiner par elle était condamné à mourir dans lamisère29.
19 Baba Yaga accueille les douze frères en faisant montre d’hospitalité. Elle leur sert duvin et de l’hydromel, leur offre à manger et leur prépare douze lits en face des douzelits de ses filles. À minuit, elle ordonne à ses gousli de jouer de la musique et à son épéede couper les têtes des garçons. Niezginek réussit cependant à déjouer son plan. Quandle matin Baba Yaga découvre que l’épée a coupé les têtes de ses filles à la place de cellesdes garçons, « elle hurle, gémit, s’arrache une touffe de cheveux de la tête, saute dansson mortier en chêne et, s’appuyant sur ses pilons en fer, file à leur poursuite30. » Avecl’aide des auxiliaires magiques fournis par Białoszek, Niezginek parvient à la freiner enfaisant apparaître une rivière, un lac et puis une forêt. Furieuse de les voir s’échapper,elle fait demi-tour, mais ses yeux injectés de sang se reflètent jusque dans le cieltraversé par une lueur rougeâtre.
20 Tandis que Baba Yaga paraît définitivement maîtrisée, les frères jaloux du succès deleur cadet dans le royaume où ils arrivent au terme de leur fuite poussent Niezginekdans de nouvelles confrontations avec la sorcière. Pour ce faire, ils informent le roi del’existence des gousli qui jouent toutes seules de manière à lui donner envie d’enposséder et donc d’envoyer Niezginek chez Baba Yaga. Avec l’aide de Białoszek qui luidonne une herbe spéciale pour endormir Baba Yaga, le héros revient victorieux, ce quiaccroît la jalousie de ses aînés. Pour se venger, ils parlent au roi de l’épée auto-coupante. Niezginek retourne une nouvelle fois chez la sorcière sur ordre du roi et,après avoir neutralisé l’épée avec une craie bénite, il rapporte l’objet magique. Déçus,les frères parlent alors de la princesse Vierge-Miracle de façon à instiller dans le roi ledésir de l’épouser. Białoszek emmène son maître devant la mer :
– Voici devant nous l’océan-mer. Un vaisseau en argent avec un mât en or ynavigue. Et dans ce vaisseau grillagé et fermé de partout se trouve Vierge-Miracle,la plus jeune fille de Baba Yaga qui, après avoir perdu ses douze filles aînées, sesgousli auto-joueuses et son épée auto-coupante, a eu peur d’être privée de sadernière fille. C’est pour cette raison qu’elle l’a enfermée dans ce navire, la laissantvoguer au gré des vagues, et a jeté la clé dans la mer. Baba Yaga, quant à elle, nage
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
88
dans son mortier en chêne, avec ses pilons en fer, et noie les bateaux étrangers enles attaquant avec son vent31.
21 Le fait que Baba Yaga utilise le vent pour écarter les bateaux qui s’approchent du naviredans lequel elle a enfermé sa fille Vierge-Miracle confirme la comparaison suggéréedans « Le Prince à la moustache d’or au poing d’or » et donc l’ambiguïté du personnage.En revanche, le héros du « Chevalier Niezginek » réussit à éviter cette tempête. Aidépar les conseils de Białoszek, il obtient la clé en diamant du roi des écrevisses, libèreVierge-Miracle et la ramène au roi. Trompé par la princesse qui préfère avoir un jeunemari, le vieux roi meurt et le trône revient au héros qui épouse la fille cadette de BabaYaga. Malgré ses pouvoirs maléfiques, cette dernière est ainsi la grande perdante del’histoire.
2. Une sorcière à la double nationalité ?
22 Le caractère insaisissable de Baba Yaga ne se limite pas à la nature morale de sonaction. Gliński entretient aussi le mystère autour de sa sphère culturelle dont lesdifférentes facettes peuvent se traduire en plusieurs hypothèses.
2.1 Une sorcière russe
23 Bien que protéiforme, le profil de Baba Yaga tel qu’il ressort des contes de Gliński estsemblable à celui qui traverse le folklore russe. Oscillant – tout comme son homologuerusse – entre les rôles de donateur, de méchant ou de personnage ambigu32, la BabaYaga polonaise partage en outre avec celle-ci un ensemble de traits caractéristiques.
24 Des recoupements peuvent être effectués au niveau du physique, du statut, desrelations de filiation, de l’habitat, des comportements, des pouvoirs, des activités, descollaborations, des objets possédés ainsi que de la sphère symbolique. Baba Yaga vitseule ou avec ses filles. Il lui arrive d’avoir deux sœurs du même nom et d’apparencesimilaire. Extrêmement vieille, elle a les cheveux gris, plein de rides, des boutons et unejambe osseuse. Elle a une allure décrépie, sèche, voire carbonisée, sauf quand elle estmétamorphosée en belle pucelle par l’eau de jouvence. Elle « se déplace dans unmortier en chêne, s’appuie sur des pilons en fer et efface les traces derrière elle avec unbalai33 ». Elle vit dans une maison sur pattes de poules qui se trouve au cœur d’une forêtsombre et morbide. L’ayant atteinte avec l’aide de sa monture, le héros connaît laformule magique pour y entrer. À l’intérieur, Baba Yaga y file la quenouille, chante ouréfléchit à ses projets. Surprise de voir le héros, elle l’interroge sur ses desseins et luioffre l’hospitalité. Ensuite, soit elle l’aide, soit elle tente de le tuer afin de satisfaire sasoif de chair fraîche. Pour ce faire, elle a différents auxiliaires magiques à sa portée. Encontrepartie de son aide, elle peut exiger des souliers neufs ou de l’eau de jouvence.Quand, en revanche, elle poursuit le héros, elle ne peut être freinée qu’au moyend’autres auxiliaires magiques. Sur le plan plus symbolique, la sorcière estprincipalement associée à la mort, à un vent violent capable de capturer les humains,voire à un esprit volant apparenté au serpent.
25 Tous ces traits propres à la Baba Yaga de Gliński ont des corrélats dans l’un ou l’autreconte russe. L’hypothèse la plus évidente est que l’auteur a emprunté le personnage aufolklore russe, sans même se donner la peine de le maquiller. La probabilité est grande,puisque ce fin connaisseur de la littérature russe et traducteur des fables d’Ivan Krylov
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
89
a réécrit plusieurs contes d’Aleksander Puškin, Vasilij Žukovskij et Piotr Eršov dans LeConteur polonais. Alors qu’il a pendant longtemps été considéré comme un dignecollecteur de contes populaires, il a ainsi suscité l’indignation chez les folkloristespolonais, à commencer par Julian Krzyżanowski. Parmi les contes que nous avonsmentionnés plus haut, deux illustrent en effet ce que certains ont pu qualifier deplagiat. Gliński s’est, semble-t-il, inspiré d’ « Ivan Tsarévitch et le Loup gris » [Skazka oIvane-Careviče i o serom volke] de Žukovskij pour composer la deuxième partie de « LaPrincesse Vierge-Miracle » et il a trouvé dans « Le Petit Cheval bossu » [Konëk-Gorbunok]d’Eršov la trame centrale du « Chevalier Niezginek ».
26 « La Princesse transformée en grenouille » tend à confirmer ce transfert de la sphèrerusse à la sphère polonaise, puisqu’il s’agit d’un conte courant en Russie, dont laversion la plus connue a été mise par écrit par Aleksandr Afanassiev sous le titre « LaPrincesse-grenouille » [Carevna-ljaguška]. Ceci dit, Gliński n’a logiquement pas pu seservir des Contes populaires russes [Narodnye russkie skazki] dont Afanassiev n’envisage lapublication qu’au moment où paraît Le Conteur polonais. Dans la mesure où l’histoire dela princesse-grenouille est un « conte très populaire dans la tradition slave de l’est34 »,Gliński ne l’a peut-être pas tant emprunté au folklore russe qu’au folklore biélorusse ouukrainien, particulièrement vivaces dans la région dont il est originaire. Celaexpliquerait les différences, notamment dans la représentation de Baba Yaga qui a deuxsœurs chez Gliński. 2.2 Une sorcière slave des Confins
27 Bien que les origines littéraires russes de plusieurs contes soient attestées, elles neconcernent qu’environ un quart du recueil de Gliński. Une analyse plus approfondie decertains d’entre eux laisse en outre supposer que d’autres sources interviennent.L’exemple de « La Princesse Vierge-Miracle » est évocateur à ce titre, puisque toute latrame liée à Baba Yaga n’apparaît pas dans l’original d’Eršov. « Le Petit Cheval bossu » aprobablement été combiné à un autre conte du type « Baba Yaga et Petit Bout » [Baba-jaga i Zamoryšek]. Il reste à déterminer si Gliński l’a emprunté au folklore russe,confirmant la provenance de Baba Yaga envisagée ci-dessus, ou s’il a été raconté souscette forme par un conteur de sa région, ouvrant la piste d’une généalogie locale. Unmariage similaire de trames féeriques se retrouve par exemple dans un contebiélorusse intitulé « Ivan l’Idiot et le Petit Cheval bossu » [Ivanuška-Duračok i Kanëk-Garbunok], semblant confirmer les observations de Jirzi Polívka au sujet des inspirationsbiélorusses de Gliński35.
28 Même si Baba Yaga ne figure pas dans « Ivan l’Idiot et le Petit Cheval bossu », il estlégitime de se demander si, au lieu d’être un produit importé de Russie, elle est unpersonnage propre au folklore des Confins orientaux de la Pologne. Originaire de larégion de Nowogródek (Navahrudak) qui, bien qu’ayant fait longtemps partie de laRépublique des Deux Nations, se trouve aujourd’hui en Biélorussie, Gliński affirme queles contes de son recueil sont des réminiscences de ceux qu’il a entendus dans sonenfance36. Nous pouvons en déduire que Le Conteur polonais reflète partiellement lestraditions féeriques vivaces dans les environs de Nowogródek dans la première moitiédu XIXe siècle. Cela pourrait signifier que Baba Yaga faisait partie du folklore local, lui-même imprégné des traditions polonaises, biélorusses, ukrainiennes, lituaniennes ainsique russes. Conscient de l’imbrication des différentes cultures, Gliński ne voit d’ailleurs
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
90
pas l’intérêt de distinguer les contes polonais des contes « étrangers37 », comme s’ilsformaient un tout dont les composants ne peuvent être différenciés.
29 Pour Gliński, ce folklore local des Confins traduit l’unité slave précédant les divisionsnationales et remontant à un lointain passé païen. Justifiant son refus de distinguer lescontes polonais des contes étrangers, il explique qu’il est
convaincu […] que presque tous les conte circulant en Pologne, en Lituanie et danstoutes la Rus sont communs à toutes les tribus slaves qui, n’ayant que peu empruntéaux peuples voisins, les ont nationalisés au point de les rendre méconnaissables38.
30 Cette vision idéalisée de la culture slave primitive fait échos aux conceptions de JohannGottfried von Herder qui ont été relayées par Zorian Dołęga Chodakowski et KazimierzBrodziński dans leurs fameux essais appelant les intellectuels à fonder une littératurenationale sur des bases populaires slaves. Dans la mesure où le nom de Brodziński était« cher à son cœur39 », Gliński avait incontestablement cette ambition de fonder unelittérature féerique polonaise à partir du patrimoine slave des Confins. Baba Yaga estdonc partie prenante de ce projet, étant vue par certains comme un vestige de lacommunauté slave préchrétienne.
31 Cette idée est en effet défendue par Wójcicki dans son essai « Sur les sorcières » [Oczarownicach, 1842]. Celui qui a reçu le titre de « Grimm polonais » pour avoir été lepremier à publier une compilation de contes en Pologne estime en effet que lessorcières russes et polonaises ont de nombreux points communs, notamment au niveauphysique. Des deux côtés de la frontière, il remarque notamment qu’elles sontreprésentées sous la forme de « vieille femme au visage ridé et desséché, aux yeuxenfoncés et rougis, en un mot une silhouette abominable et répugnante40 ». Les traitscommuns qu’il met en évidence le poussent à présupposer une origine commune41.
32 L’hypothèse d’une généalogie slave peut être appuyée par plusieurs faits linguistiqueset culturels. Comme l’évoque Ryszard Berwiński dans son Étude des envoûtements, sorts,superstitions et croyances populaires [ Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądachludowych, 1862], des recherches ont démontré que Baba Yaga résulte de la dégradationd’une divinité slave qui aurait été la femme de Perkunas et la mère du monde42, lachrétienté ayant ultérieurement fait d’elle une « méchante sorcière43 ». Toujoursd’actualité44, cette association paraît cohérente d’un point de vue linguistique, dans lamesure où toutes les langues slaves ont en commun le terme baba qui signale laféminité du personnage45. Quoique plus ambiguë, on fait souvent remonter la deuxièmepartie « Yaga » au proto-slave46. Pour sa part, Gliński choisit d’utiliser « Jędza » – lavariante la plus répandue en Polésie47 – dans la plupart de ses contes, réservant laforme russe « Jaga » au seul « Chevalier Niezginek ». Il confirme ainsi l’ancrage slave desa sorcière, tout en la situant géographiquement dans les Confins polonais. 2.3 Une sorcière polonisée
33 Malgré l’imbroglio généalogique du personnage, l’utilisation privilégiée du termepolonais « Jędza » suggère néanmoins que la polonité reste une préoccupation centralede l’auteur du Conteur polonais. Nous pouvons, à cet égard, voir un lien supplémentaireavec l’essai susmentionné de Wójcicki qui, tout en faisant allusion à une lointainesource slave commune, décrit les ramifications nationales qui ont ultérieurementpermis l’émergence d’une sorcière typiquement polonaise. Ainsi, même si l’attributiondu statut de sorcière à Baba Yaga reste discutable48, il est intéressant de la mettre en
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
91
parallèle avec la mythologie populaire de cette sorcière polonaise. Dans le folklorepolonais, les sorcières sont liées au diable et elles se rendent certaines nuits à un« sabbat » sur le Mont Chauve [Łysa Góra]49. Bien qu’il existe un Mont Chauve parmi lesmontagnes de la Sainte-Croix [Góry Świętokrzyskie], l’expression désignait de façon plusgénérale un endroit éventuellement en hauteur situé en dehors de la ville ou duvillage50. Déjà présent dans la littérature médiévale, le personnage de la sorcièredevient de plus en plus fréquent dans la littérature polonaise à partir du XVIIe siècle,parallèlement à la multiplication des procès pour sorcellerie qui culminent en Pologneau tournant des XVIIe et XVIIIe siècles51.
34 Dans Nouvelle comédie de ménestrel [ Komedia rybałtowska nowa, 1615], la sorcière estappelée baba52, mais elle est plus couramment désignée sous le nom de czarownica,comme en témoigne le titre de l’essai de Wójcicki. Proche du russe ved’ma qui fait échosaux savoirs de la sorcière, l’expression wiedźma est d’usage presque aussi courant. Celadit, le terme wiedma existe aussi en polonais et mądra – qui veut dire sage – confirme lefait qu’elle possède une certaine forme de connaissance53. À côté de cela, il y a toute unepanoplie de noms qui évoquent sa forme surnaturelle et son caractère démoniaque :lamia, latawica, południca, przepołudnica, nocnica, jędza, strzyga, etc.54 Parmi ces créatures,Berwiński s’est surtout intéressé à la strige [strzyga] avec laquelle « les sorcières ont étéconfondues55 » dans l’imaginaire polonais. D’après lui, cette sorte de vampire fémininest apparentée non seulement à la Lamia romaine, mais aussi à ladite jędza qui estoriginellement « un démon féminin de la forêt à la forme humaine dont l’origineremonte au Moyen Âge et qui constitue la personnification d’une âme de femme morteen couche56 ». Comme l’indique son étymologie liée à l’acte de manger [jedzenie]57, lajędza est, elle aussi, friande de chair humaine. Le rapprochement entre ces démonsd’origine païenne et la sorcière se serait produit au moment de son importationoccidentale dans la culture polonaise et, tout en prenant le pas sur les créaturespréchrétiennes, la sorcière en aurait gardé les noms, bien que vidés de leur senspremier58.
35 Parmi tous ces termes qui traduisent l’ambiguïté de la représentation de la sorcièredans la culture polonaise59, Gliński prend soin de n’en choisir qu’un nombre restreint etde ne les utiliser que dans de rares cas. Si l’on inclut latawiec qui ne désignequ’hypothétiquement Baba Yaga, l’auteur se limite à l’usage de trois appellations. Ilparle de czarownica dans « Le Diable et la Bonne Femme » et de jędza dans « Le chevalierNiezginek ». Dans les autres contes, Gliński ne mentionne pas la profession de BabaYaga. Cela signifie qu’il ne la catégorise comme sorcière que quand elle joue un rôleplus ou moins négatif dans l’histoire. Ce détail est assez significatif car il révèle lepenchant catholique de Gliński et donc son éloignement par rapport au paganismeslave vers lequel il essaye pourtant de tendre au travers de la figure de Baba Yaga. Enassociant la sorcière au mal, l’auteur se montre fondamentalement plus en phase avecsa diabolisation chrétienne qu’avec sa participation dans la communauté slavepréchrétienne. Il fait d’ailleurs allusion aux châtiments infligés aux sorcières que l’onplongeait dans l’eau pour démontrer leurs accointances avec le diable. Les deux contesdans lesquels il qualifie Baba Yaga de sorcière laissent pourtant supposer qu’il lui tientmalgré tout à cœur de concilier paganisme slave et catholicisme polonais. Dans « LeDiable et la Bonne Femme », Gliński donne le nom de Baba Yaga à la baba qui est décritecomme une czarownica60. La version de Wójcicki montre qu’habituellement cettesorcière est simplement appelée baba, sans être comparée à Baba Yaga. En opérant ce
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
92
rapprochement, Gliński a donc l’apparente volonté de faire fusionner la sorcière dufolklore catholique polonais avec Baba Yaga. Dans « Le Chevalier Niezginek », il fait lamême chose, puisqu’il qualifie de jędza61 et de czarownica62 celle qu’il appelle à la russeBaba Jaga, alors qu’elle n’a en principe pas de lien avec la sorcière polonaise.
36 Envisagés dans le cadre plus large de la polonisation de contes russes par Gliński63, cesexemples suggèrent que l’auteur du Conteur polonais ait souhaité intégrer Baba Yaga aufolklore polonais ou plus exactement l’utiliser pour fonder une littérature féeriquenationale.
Conclusion
37 À l’image de la pointe de l’iceberg, la figure ambigüe de Baba Yaga est révélatrice descontradictions que cache le projet de Gliński et dont elle fait partie intégrante en mêmetemps. Au prix d’une périlleuse gymnastique, le natif des Confins polonais cherche àfaire jaillir des contes polonais de la source slave préchrétienne qu’il voit matérialiséeautour de lui dans le folklore de sa région multiculturelle de l’Empire russe. Il n’est dèslors pas étonnant de trouver cette sorcière supposée remonter au noyau culturelcommun des Slaves de l’est dans Le Conteur polonais, ni de lui reconnaître desressemblances manifestes avec son pendant russe. Cette manière de raviver la culturepolonaise au travers de la culture slave, voire spécifiquement russe, peut êtreinterprétée comme une démonstration de slavophilie de la part Gliński et donc unepreuve de son rattachement au mouvement des Polonais qui, déçus par l’Occident et sesvaleurs au lendemain du Printemps des Peuples, se tournent vers la Russie dans l’espoird’y trouver le salut de la Pologne. Compte tenu de ce contexte, la présence d’une BabaYaga aux traits russes dans Le Conteur polonais est loin d’être anodine, mais le francsuccès des contes de Gliński en Pologne l’est encore moins. Il démontre que les lecteursse sont reconnus dans cette polonité slavophile, favorisant l’intégration durable dupersonnage de Baba Yaga dans la culture polonaise.
BIBLIOGRAPHIE
Afanassiev, Alexandre Nicolaiévitch, Les Contes populaires russes, t. 1-3, trad. Lise Gruel-Apert,Paris, Éditions Maisonneuve & Larose, 1988-1992.
—, Narodnye russkie skazki, t. 1-5, Moscou, Terra, 1999.
Bandarčyk, Vasilij K., Belaruskaja narodnaja tvorčasc’. Kazki pra žyvël i čaradzejnyja kazki, Minsk,Navuka i Tehnika, 1971.
Berwiński, Ryszard, Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych, t. 1-2, Poznań,Ludwik Merżbach, 1862.
Biggs, Maude Ashurst, « Tales From Poland », in Antoni Józef Gliński, Polish Fairy Tales, trad.Maude Ashurst Biggs, Londres-New York, John Lane Company, 1920, p. ix.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
93
Brodziński, Kazimierz, Pisma estetyczno-krytyczne, t. 1, Wrocław, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1964.
Chodakowski, Zorian Dołęga, « O sławiańszczyźnie przed chrześciaństwem » oraz inne pisma i listy,Varsovie, PWN, 1967.
Gliński, Antoni Józef, « Do czytelnika », in Antoni Józef Gliński, Bajarz polski. Zbiór baśni, powieści igawęd ludowych, t. 3, Vilnius, Drukarnia Gubernialnej, 1853, p. VII-XIII.
—, Bajarz polski. Baśnie, powieści i gawędy ludowe, t. 1-4, Vilnius, W. Makowski, 1899.
Johns, Andreas, Baba Yaga. The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folktale, New York-Washington, D.C. /Baltimore-Bern, Peter Lange, 2010.
Krzak, Zygmunt, Od matriarchatu do patriarchatu, Varsovie, Wydawnictwo TRIO, 2007.
Krzyżanowski, Julian, Słownik folkloru polskiego, Varsovie, Wiedza Powszechna, 1965.
—, « Bajarz polski Glińskiego i jego źródła literackie », in Krzyżanowski, Julian, Paralele. Studiaporównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Varsovie, PIW, 1977, p. 760-772.
Malinowski, Michał et Pellowski, Anne, Polish Folktales and Folklore, Westport (Connecticut)-Londres, Libraries Unlimited, 2009.
Ostling, Michael, Between the Devil and the Host. Imagining Witchcraft in Early Modern Poland, Oxford,Oxford University Press, 2011.
Pełka, Leonard J., Polska demonologia ludowa, Varsovie, Iskry, 1987.
Potebnja, Aleksandr A., O mifičeskom značenii nekotoryh poverij i obrjadov, t. 2, Moscou, ObščestvoIstorij i Drevnostej Rossijskih pri Moskovskom Universitete, 1865.
Podgórscy, Barbara et Adam, Wielka księga demonów polskich. Leksykon i antologia demonologiiludowej, Katowice, Wydawnictwo KOS, 2005.
Simonides, Dorota, « Z recepcji Bajarza polskiego A. J. Glińskiego », in Julian Krzyżanowski etRyszard Górski (éd.), Ludowość dawniej i dziś, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973,p. 91-108.
Tazbir, Janusz, « Fałszerstwa historyczno-literackie » in Janusz Tazbir, Od sasa do lasa, Varsovie,Iskry, 2011, p. 11-32
Wołkow, Anatolij, « “Bajka o carze Sałtanie” A. Puszkina i baśń “O królewiczu z księżycem naczole, z gwiazdami po głowie” A. J. Glińskiego », in Julian Krzyżanowski et Ryszard Górski (éd.), Ludowość dawniej i dziś, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973, p. 79-89.
Wójcicki, Kazimierz Władysław, « O czarownicach », in Kazimierz Władysław Wójcicki, Zarysydomowe, t. 3, M. Chmielewski, Varsovie, 1842, p. 131-173.
—, Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, Varsovie, PIW, 1972.
Wróblewska, Violetta, « Baba Jaga w folklorze i w literaturze dla najmłodszych », in ViolettaWróblewska, Od potworów do znaków pustych. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci, Toruń,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, p. 51-101.
Wyporska, Wanda, Witchcraft in Early Modern Poland, 1500-1800, New York, Palgrave Macmillan,2013.
Zipes, Jack, « Foreword. Unfathomable Baba Yagas », in Sibelan Forrester, Helena Goscilo, MartinSkoro et Jack Zipes (éd.), Baba Yaga. The Wild Witch of the East in Russian Fairy Tales, Jackson,University Press of Mississippi, 2013, p. VII-XII.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
94
NOTES1. Le présent article a été publié grâce au soutien de la Belgian American Educational Foundation.2. J. Zipes, « Foreword. Unfathomable Baba Yagas », p. VIII-X.3. A. Johns, Baba Yaga. The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folktale, p. 8-9.4. A. J. Gliński, Bajarz polski, t. 1-2, p. 50. Sauf là où un traducteur est mentionné, j’ai traduit tousles extraits du polonais cités dans cet article.5. Ibid.6. Ibid., p. 63.7. Ibid.8. Ibid., p. 64.9. Ibid.10. Ibid., p. 5211. A. J. Gliński, Bajarz polski, t. 3-4, p. 30.12. Ibid.13. Ibid.14. Ibid.15. Ibid., p. 37.16. Ibid.17. Ibid., p. 33.18. A. Potebnja, O mifičeskom značenii nekotoryh poverij i obrjadov [De la signification mythique decertains rites et croyances], p. 197.19. A. J. Gliński, Bajarz polski, t. 1-2, p. 198.20. Ibid., p. 198-199.21. A. Johns, op. cit., p. 28.22. B. et A. Podgórscy, Wielka księga demonów polskich, p. 84.23. A. J. Gliński, Bajarz polski, t. 3-4, p. 17.24. K. Wł. Wójcicki, Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, p. 260.25. A. J. Gliński, Bajarz polski, t. 3-4, p. 146.26. Ibidem.27. A. J. Gliński, Bajarz polski, t. 1-2, p. 150.28. Ibid., p. 152.29. Ibid., p. 153.30. Ibid., p. 154.31. Ibid., p. 163-164.32. A. Johns, op. cit., p. 137.33. A. J. Gliński, Bajarz polski, t. 1-2, p. 151.34. A. Johns, op. cit., p. 149.35. Cité dans J. Krzyżanowski, « Bajarz polski Glińskiego i jego źródła literackie », p. 761.36. A. J. Gliński, « Do czytelnika », p. XV.37. Ibid., p. XIII.38. Ibid., p. XIV.
39. Ibid., p. IX.40. K. Wł. Wójcicki, « O czarownicach », p. 153.41. Ibid., p. 133-134.42. R. Berwiński, Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych, t. 1, p. 149.43. B. et A. Podgórscy, op. cit., p. 218.44. Z. Krzak, Od matriarchatu do patriarchatu, p. 371-373; W. Wyporska, Witchcraft in Early ModernPoland, 1500-1800, p. 101.45. A. Johns, op. cit., p. 9
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
95
46. B. et A. Podgórscy, op. cit., p. 218.47. Ibid.48. A. Johns, op. cit., p. 55.49. M. Malinowski et A. Pellowski, Polish Folktales and Folklore, p. 192.50. W. Wyporska, op. cit., p. 38.51. M. Ostling, Between the Devil and the Host. Imagining Witchcraft in Early Modern Poland, p. 20.52. W. Wyporska, op. cit., p. 137.53. B. et A. Podgórscy, op. cit., p. 85.54. Ibid., p. 85; M. Ostling, op. cit., p. 25-26; Stamatis Zochios, ce volume.55. R. Berwiński, Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych, t. 2, p. 13.56. B. et A. Podgórscy, op. cit., p. 264.57. R. Berwiński, op. cit., t. 2, p. 13.58. Ibid., p. 180-183; L. Pełka, Polska demonologia ludowa, p. 192-193.59. M. Ostling Michael, op. cit., p. 27.60. A. J. Gliński, Bajarz polski, t. 3-4, p. 146.61. A. J. Gliński, Bajarz polski, t. 1-2, p. 153.62. Ibid., p. 151.63. A. Wołkow, « “Bajka o carze Sałtanie” A. Puszkina i baśń “O królewiczu z księżycem na czole,z gwiazdami po głowie” A. J. Glińskiego », p. 89.
RÉSUMÉSLe présent article a pour objet de dresser le portrait de Baba Yaga telle qu’elle apparaît dans LeConteur polonais (1853) d’A. J. Gliński. Étant donné que la Russie a participé au démantèlement dela Pologne à la fin du XVIIIe siècle, il est étonnant de trouver la sorcière la plus représentative decette culture « ennemie » dans un recueil de contes populaires polonais. Tout en tentant de lasituer par rapport à son homologue russe, je vais essayer de comprendre sa présence et sasignification dans sept contes de Gliński, en me reportant à la question de la culture nationaledans la Pologne du XIXe siècle ainsi qu’au contexte slavophile qui succède au Printemps despeuples.
In my paper I seek to draw the portrait of Baba Yaga as she appears in A.J. Gliński’s The Polish TaleTeller (1853). Insofar Russia contributed to the dismantling of Poland at the end of the 18 th
century, it is surprising to find the most representative witch of this “enemy” culture in a Polishcollection of folktales. I will first compare her to her Russian counterpart. Then I will try tounderstand her presence and meaning in seven of Gliński’s fairy tales by referring to theintricate question of national culture in 19th-century Poland and the Slavophilia that came afterthe Spring of Nations.
INDEX
Mots-clés : folklore polonais, identité nationale, littérature populaireKeywords : polish folklore, national identity, folk literature
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
96
AUTEUR
KATIA VANDENBORRE
En tant que « BAEF Fellow », Katia Vandenborre bénéficie d’une bourse de la Belgian AmericanEducational Foundation pour mener des recherches à un niveau postdoctoral sur la réception descontes russes dans la culture et la littérature polonaises. Pour l’année académique 2014-2015, elleest donc détachée de l’Université libre de Bruxelles où elle jouit d’un mandat de chargée derecherches FNRS et travaille en tant que chercheur-visiteur dans le Département d’études russeset slaves de la New York University.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
97
Baba Cloantza, la Yaga édentée dufolklore roumainSimona Ferent
1 Tout en intégrant la réflexion initiée par l’association LETAP en janvier 2015 intitulée« Baba Yaga et son isba, analyse pluridisciplinaire du personnage mythique des contespopulaires russes » nous vous proposons l’exploration d’une autre baba, Baba Cloanţapersonnage central des contes roumains. Pour une traduction phonétique la plus fidèlepossible, nous avons opté pour la forme « Cloantza ». Puisant dans le folklore desCarpates les contes, vieux ou récents, mettent en scène le personnage d’une vieillesorcière facilement reconnaissable grâce à certains traits particuliers. Avant deprocéder à une analyse des séquences livresques, notons que l’invocation du nom deBaba Cloantza suggère pour tout lecteur roumain une représentation corporellesingulière, dont le symbole qui se détache est l’absence de dents. Le terme de cloanţaprononcé [kloantza] signifie « une femme vieille, laide et sans dents1 ». Dans l’universdes contes, il résume le syntagme de méchante sorcière. Par ailleurs, le même mot estemployé dans le langage familier pour désigner de manière péjorative « la bouche2 »,comme organe d’expression (qu’on pourrait traduire vulgairement comme « la babagrande gueule »). L’appellation populaire insiste sur sa vieillesse (marque d’une sagesseinquiétante), mais aussi sur sa fonction de vecteur d’une parole. Cette parole estd’autant plus puissante que la baba serait impuissante à mordre.
2 À cette symbolique particulière, l’imaginaire populaire superpose un deuxième sens quiest celui d’une vieille femme vivant en périphérie du village, souvent dans la forêt,d’une apparence effrayante et pratiquant des rituels magiques. Le terme « baba »exprime, de manière plus générale, la vieille sage, ou plus particulièrement la sorcière àlaquelle le village attribue tous les pouvoirs traditionnels allant du sort d’amour, à ladivination, la maîtrise des éléments météorologiques et jusqu’aux pouvoirs de guérison.
3 À partir de l’étude de cas représentatifs, notre réflexion insistera sur deux dimensionsdu personnage : d’un côté, l’ambiguïté de la figure de la baba, à la fois créaturedémoniaque (image d’une altérité archaïque) et guide spirituel (la sorcière dont lespouvoirs magiques aident le voyageur, la jeune femme en mal d’amour ou le héros dansson combat avec des forces surnaturelles) ; de l’autre côté, la richesse et la diversité des
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
98
figures artistiques de la baba Cloantza et ses avatars. Notre analyse propose ainsi unetypologie des différentes représentations de la baba Cloantza qui espère susciterl’intérêt du lecteur français pour la mythologie populaire roumaine qui abrite d’autrescréatures tout aussi ensorcelantes que les bien connus vampires.
4 Le corpus que nous avons choisi de présenter ici comporte un ensemble varié de textesappartenant à des auteurs roumains ayant puisé dans la matière folklorique afin dedonner une seconde vie aux mythes. Pour Vasile Alecsandri (1821-1890), immensepersonnalité littéraire dont les poèmes et les pièces de théâtre constituent desclassiques pour les élèves roumains, la collecte des ballades et autres productions oralestraditionnelles n’est pas uniquement un travail de mémoire nécessaire mais surtout,dans le contexte historique, l’affirmation d’une identité culturelle roumaine. Dans lesballades populaires qu’il nous a léguées mais aussi dans ses réécritures poétiques (dontla plus réussie porte le nom de « Baba Cloantza »), la sorcière occupe souvent le devantde la scène pour jouer son rôle de prophète, de guérisseuse ou de démon. Si le bardeamoureux du folklore de la Transylvanie, George Coşbuc (1866-1918) reprend l’imagede la baba réinvestissant le mythe d’un éternel féminin aux origines daces, d’autrespoètes comme Tudor Arghezi (1880-1967) au siècle dernier et Gelu Vlaşin (1966-) en2000 nous proposent des versions modernes et une baba Cloantza réduite à unpersonnage caricatural. Sa bouffonnerie théâtrale se retrouve déjà représentée dans lapremière opérette roumaine composée en 1848 intitulée « Baba Hârca ». Mais puisqueBaba Cloantza puise ses sources dans l’univers des contes, nous examinerons sesmanifestations dans plusieurs histoires célèbres du grand folkloriste Petre Ispirescu(1830-1887) et du mémorialiste du monde rural Ion Creanga (1837-1889). Baba Cloantzay surgira comme une composante incontournable du parcours initiatique du héroslégendaire.
1. Baba Cloantza, oracle du village
5 Dans la mythologie populaire roumaine le Sburător incarne la séduction maléfique parune créature fantastique qui hante la nuit le sommeil des femmes. Lorsqu’en 1843Vasile Alecsandri met en vers ce mythe du vampire dans un poème d’inspirationfolklorique intitulé « Kraiu-Nou3 », l’apparition du personnage de Baba Cloantza estplacée dans le cadre d’une nature paysanne idyllique dominée par le symbole lunaire.La temporalité spécifique du calendrier populaire associe la manifestation de l’astrenocturne (le Kraiu-Nou correspondant à la première phase de la lune) à un momentpropice pour exprimer des vœux (d’amour pour la plupart) : « À cette heure du soir, oùl’oiseau vole à son nid en jetant un cri plaintif comme un soupir ; / […] Zamfira, triste etpensive, sortait de sa tente et fixait des regards humides de larmes sur la lune quirépandait sa blanche lumière sur le front de la jeune fille.4 »
6 Parmi les jeunes qui adressent leur invocation magique à la lune, le poète évoqueZamfira, prototype romantique de la beauté virginale de la paysanne roumaine, quisous l’emprise de ses premières pulsions érotiques choisit d’ignorer la mise en garde deBaba Cloantza : après un acte divinatoire propre à la baba (qui consulte ses quarante etun grains de maïs), celle-ci lui conseille avec effroi de fuir « le bel étranger à la voixcaressante5 ». La baba est représentée assise sur un monticule et le lecteur comprendrapar la suite qu’il s’agit en fait de la tombe d’un être vampirique. Dans le poème lamention faite à Baba Cloantza suit la strophe décrivant les vieux sages du village qui
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
99
prévoyaient un avenir heureux à la jeune fille. Mais Zamfira succombe aux charmesd’un mystérieux amant qui descend des ombres nocturnes et dévore peu à peu sa forcevitale.
Trois jours après, le croissant s’effaça du ciel, et, comme lui, le bel étrangerdisparut. La pauvre fille s’assit au bord du chemin, et le regretta beaucoup et pleurabeaucoup après lui.Trois jours après, là-bas dans la vallée, il ne restait plus que son tombeau, et bienlongtemps on entendait une voix plaintive passer dans le vent de la nuit et répéteravec douleur :« Toi, qui vas gaiement sur la colline pour confier les secrets de ton âme aucroissant de la lune, ô pauvre jeune fille, fuis à la tombée de la nuit, fuis le belétranger à la voix caressante. »6
7 Placée en marge de la communauté, la baba Cloantza joue ici entièrement son doublerôle dans le sens où elle prévient et provoque le danger. Sa fonction d’oracle met enplace les conditions d’une prophétie auto-réalisatrice. Ses paroles détiennent laformule à la fois de la peur et de la séduction qu’elle résume dans l’image d’une altéritétotale (l’étranger est celui qui vient d’un autre monde, céleste et maléfique, un êtredémoniaque). Le personnage de la baba permet autant la mise en scène d’une voixrappelant une croyance populaire (celle qui associe les apparitions fantomatiquespendant le premier croissant de lune aux êtres maléfiques) que l’expression d’unemorale archaïque de mise en garde sur la sexualité. Ce sont les manifestations magiquesqui assurent la dimension pédagogique du conte.
2. La baba guérisseuse
8 La baba est également invoquée par l’homme désespéré par un amour qu’il en vient àmaudire. La poésie populaire « Burueana de leac7 » (à traduire « la mauvaise herbe quisoigne8 », titre révélateur) est une illustration des prières qui peuvent être adresséespar un paysan à la baba du village. Sous l’emprise d’une passion qui ressemblefortement à une possession maléfique (à travers surtout les symboles du soleil quis’éteint et du tombeau qui l’appelle), il déclame ses vers afin de solliciter les pouvoirsmagiques de la mama Ileana, seuls capables d’éteindre le feu du cœur. Comme une noteexplicative du folkloriste V. Alecsandri le souligne, la mère Ileana n’est qu’un desavatars de la baba. Celle-ci remplit un statut de guérisseuse dans les villages roumains.Elle soigne à l’aide de plantes et de paroles magiques en fonction de chaque période ducalendrier populaire, véritable croisement de fêtes religieuses et païennes. Au cœur decette ambiguïté de l’imaginaire populaire, la baba en fait ressortir la dimensionparadoxale en invoquant à la fois des objets religieux (des icônes), des lieux sacrés(l’église du village), des personnages bibliques (un chant faisant référence à la SainteMarie mère de Jésus ainsi qu’à Dieu), au sein d’une effervescence de rituels païens(fleurs, mauvaises herbes, une eau investie de pouvoirs magiques, trois baguettes decoudrier, des paroles qualifiées de sorcellerie).
3. Baba Cloantza et ses caricatures
9 Puisant dans le réservoir mythique, les poètes roumains réinvestissent cette image dela guérisseuse. Dans un recueil de vers pour enfants paru en 1948, Tudor Argheziimagine une baba9 qui fait des miracles dans le village : elle connaît tous les sorts
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
100
d’amour, elle peut unir ou séparer les amants, elle détient les remèdes à toutes lesdouleurs (du mal des dents au mal du cœur). Le poète crayonne une caricature desorcière bossue qui, à l’aide de « deux charbons et trois mensonges », peut soigner toutle monde sauf les pauvres, car pentru om sàrac / n-are leac10 (à traduire « pour le pauvre/ elle n’a pas de remède ». En roumain la distance ironique est renforcée grâce à la rimequi s’appuie sur deux termes clés : minuni / minciuni c’est-à-dire, « miracles /mensonges ».
10 La figure de la baba Cloantza surgit dans les vers du poète contemporain Gelu Vlaşincomme matérialisation d’un fantasme. Entre l’ivresse et le délire, le poète erre dans lesrues de la ville en quête d’un sort de fortune à dépenser dans le premier bordel. Laréférence à la Cloantza revêt ici le sens d’une réminiscence de l’inconscient collectif quivient s’immiscer dans le réel « dilaté » déjà par Dionysos et investi par un ensemble desymboles à ample connotation psychologique (le nain, le cirque, « le bar à putes », desaraignées, etc.) : « comme dans un conte pour les cons / je cherche la baba cloantza /pour qu’elle me jette des sorts / d’argent » (notre traduction des vers ca-ntr-o poveste cuprosti / caut baba cloanţa / să-mi descânte vrăji / cu bani mulţi11).
11 Un autre avatar de la Cloantza, Baba Hârca, apparaît quant à elle dans les contes sous laforme d’une vieille sorcière vivant recluse dans les grottes au fond des bois (par peurdes humains) et qui utilise des crânes humains ou d’animaux dans ses rituels magiques.Epithète dépréciatif qualifiant une « vieille femme, laide et méchante », en roumain, leterme de hârca12 signifie aussi « crâne ». Dans les contes retranscrits ou composés, parles écrivains et folkloristes roumains nous observons une souplesse dans ladénomination du personnage. Les appellations Baba Cloantza et Baba Hârca deviennentsynonymes au sein d’une même histoire ou alternent en fonction des variantes dumême conte.
12 C’est sous le nom de Baba Hârca que la sorcière joue son rôle magistral, dans lapremière opérette roumaine, composée par Matei Millo et Alexandru Flechtenmacheren 1848 et transposée par le musicien slovène Davorin Jenko sur des territoires serbes.« Baba Hârca » affiche le sous-titre « opérette-sorcellerie en deux actes et troistableaux13 ». Matei Millo y interprète lui-même le rôle de la Hârca, en campant unpersonnage de gitane traité de façon comique.
4. La sorcière et la magie du rituel
13 Nous recomposons aujourd’hui les traits de celle qui ne représente qu’un personnagelégendaire quelque part entre la nostalgie de l’enfance et le souvenir livresque d’unespace pastoral résolument disparu. Son altérité nous paraît radicale. Elle ne constituepour nous qu’un être de fiction. Mais lorsque l’écrivain et folkloriste V. Alecsandri,enregistre des productions populaires, comme Cucul si Turturica14 [Le Coucou et laTourterelle], il insiste dans les notes explicatives sur la description soignée dessuperstitions populaires. Pour nombre de paysans roumains, le pouvoir de la baba estbien réel. Ainsi, à travers le dialogue entre la tourterelle (symbole de l’amourangélique) et le coucou (oiseau mystérieux, voire dangereux car fils d’une méchantesorcière), l’allégorie transcrit une réalité qui est celle de la sorcellerie rurale. Conservéedans la langue parlée par une somme de proverbes associant la sorcière audémoniaque, la baba incarne au sein du village une entité surnaturelle. Baba Cloantzaest ainsi un être dont la différence est acceptée et intégrée par la communauté. Placée
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
101
en intermédiaire entre le monde des vivants et un au-delà fantastique, la sorcière agitcomme un élément catalyseur indispensable au sein du rituel magique. Guérisseuseexercée, la baba « prend sur elle le mal », devient une véritable bouche qui aspire lesangoisses de l’autre qu’elle expulse ensuite en leur donnant une forme symbolique. Lerituel est une mise en acte d’une projection fantasmagorique et il faut insister sur ladimension performative de la parole de la baba. Rappelant que le mot « cloantza »abrite la métaphore de la bouche édentée, il nous semble pertinent d’envisager le rituelmagique de la sorcière comme un acte de digestion : les angoisses des paysans enfournissent l’aliment et les paroles de Baba Cloantza la substance magique.
14 Sur le fond d’un hédonisme et d’un animisme profonds, le rituel et les paroles de lababa inspirent autant la peur qu’un certain fatalisme. Personnification d’un espritjoueur et bon vivant, le coucou chante son désir et sa détermination à user des moyenspeu orthodoxes auxquels il aurait accès grâce à sa génitrice pour séduire et consommersa passion. L’influence maléfique de la baba Cloantza dans la conquête amoureuse est àenvisager sous le signe du jeu. Ainsi pour figurer le danger gisant dans les jeux deséduction, le choix des objets magiques que les babas manient dans leurs sorts révèleune dimension burlesque : pour leurs rituels d’ensorcellement des jeunes hommes unpeu « distraits », les sorcières utilisent des os de chauve-souris attrapées la veille deNoël et enterrées vivantes dans une fourmilière. Ce qui reste du squelette de la chauve-souris prendra la forme d’un crochet et d’une petite pelle. La Cloantza se sert dupremier objet pour accrocher l’être qu’on désire, alors que le deuxième éloigne tousceux qu’on n’aime pas.
15 L’imaginaire paysan témoigne d’une impressionnante richesse quant aux pouvoirs desbabas, dont l’une des constantes majeures semble être l’élément aquatique. Sous lesformes les plus variées, l’eau acquiert des pouvoirs surnaturels : la sorcière se sert del’eau des rivières, elle arrive à maîtriser la pluie, jette des sorts à l’aide de l’eau béniteou au contraire à l’aide d’une eau enchantée dite « vierge » ; ainsi l’un des sortsclassiques est celui de la cruche, l’ulcica, dont un proverbe roumain dit i-a fàcut cu ulcicasignifiant « il/elle a subi le sort de la cruche15 ». D’autres éléments souvent mentionnés– comme la baguette de coudrier, les grains de maïs, le batic traditionnel (le fichutraditionnel des paysannes) – renvoient à cet univers paysan au sein duquel l’objet duquotidien s’anime ou, sous l’emprise d’une formule magique, devient un instrumentenchanté.
16 La communion avec la nature est totale, une nature animée. Le paysan chante sa doïna(une oraison populaire à forte tonalité mélancolique) à son esprit-frère (ceci peut êtreun arbre, une fleur, un oiseau, un animal sauvage ou domestique ou souvent la forêtentière). Des créatures fabuleuses comme les ielele (les sirènes des bois) peuplent lesmontagnes et les collines. La croyance populaire veut que, sous l’influence d’unmaléfice, un jeune homme puisse se retrouver à errer dans les plaines sur un bâtonensorcelé suivant la voix d’une Cloantza. Le folkloriste enregistre le témoignage depaysans convaincus d’avoir vus ces malheureux voyageurs transpercer le ciel commedes flèches. On apprendra aussi que seul un couteau planté dans la terre peut arrêterleur errance.
17 Il nous paraît important d’insister sur le poids de la récitation au sein de la formulemagique. La baba accompagne ses gestes d’une invocation que le roumain appelledescântec, terme qui possède un double sens, celui d’une parole, chantée ou récitée, quipeut soit ensorceler et soit désensorceler. Ces invocations sont très nombreuses et
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
102
répondent à une panoplie de situations, allant de la morsure d’un serpent jusqu’à unecertaine peur de la solitude. Celle-ci est exprimée en roumain par la crainte du urât ; leterme de urât se traduit à la fois par l’adjectif « laid » mais il résume également uneangoisse difficilement traduisible qui concentre le sentiment de l’abandon et la peur del’autre – si nous devions transposer cela au lecteur français nous utiliserions l’imaged’une personne se retrouvant seule dans une maison hantée16. Baba Cloantza,personnage des fictions pour enfants, reprend donc l’ensemble des caractéristiques dela vieille sorcière du village dont le rôle principal consiste à offrir une somme desolutions magiques en réponse aux besoins réels des paysans. Il s’agit bien évidemmentici d’un village roumain archaïque baignant dans une réalité mythique que l’onretrouve dans les contes.
5. Un archétype féminin protéiforme
18 À partir de la matrice de la vieille prêtresse, initiée aux secrets de la nature, quiconcentre une énergie originaire (la sorcière investissant des figures mythologiquescomme Gaïa, Maya, Circé, Déméter, Isis, Lilith), la baba propose aussi l’imagearchétypale de la Mère-Terrible Sorcière. Le principe de l’éternel féminin prend alorsune dimension inquiétante. Sa capacité à engendrer des humains dotés de capacitésphysiques hors du commun est un élément constant de la mythologie populaire. Dansune évocation apologétique intitulée Atque nos !17, le poète George Cosbuc n’oublie pasde mentionner le personnage de la baba sous cet aspect de génitrice du courageuxjeune homme qui selon la formule roumaine consacrée « pousse en un an commed’autres en dix ». Il fait l’éloge de cette alchimie magico-religieuse qui a donnénaissance à une riche galerie de figures de l’universel féminin : la baba Dochia auxorigines daces, la Mama-Noptii (la Mère de la Nuit) entourée de créatures vampiriques,ou les Saintes Mardi, Vendredi, Mercredi et Jeudi comme des fantaisies païennes,véritables métamorphoses des déités du panthéon grec (Mars, Zeus, Venus ouMercure).
19 La critique souligne la présence de la baba dans les contes comme manifestation d’uneforce élémentaire incontrôlable. Ainsi, dans un de ses célèbres contes intitulé « LeConte du cochon » [Povestea porcului18], l’écrivain Ion Creangă, met en scène la figure dela baba sous trois formes : premièrement, la très vieille paysanne qui, désespérant de sastérilité, adopte un cochon qu’elle élève comme son fils (celui qui se révélera être lePrince charmant en proie à un sort) ; deuxièmement, les Trois Saintes – Mercredi,Vendredi et Dimanche – les sorcières qui guident l’héroïne dans son voyage initiatiqueà la recherche de son mari (c’est-à-dire à la fois le cochon et Prince charmant ensorceléqu’elle avait épousé et qu’elle avait perdu en jetant au feu sa peau / son habit decochon) ; et troisièmement, « l’Édentée-baba-Cloantza » qui garde le Prince charmantsous son emprise à l’aide de ses pouvoirs maléfiques. En déjouant les plans de laCloantza et retrouvant sa bien-aimée, le héros délivre celle-ci du sort qui l’empêchaitd’accoucher depuis quatre ans.
20 Sur la toile de fond d’une nature inquiétante, le conte du cochon semble hanté parl’idée d’une procréation maudite illustrée à travers trois manifestations : la stérilité, lesort qui empêche l’accouchement et le fait d’accoucher d’un démon. L’héroïne, enceinted’un enfant qui ne peut naître, traverse un cadre fantastique peuplé par des dragons,des loutres à vingt-quatre têtes et d’autres créatures terrifiantes, mais surtout un
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
103
monde défini comme le règne de la cupidité, de la ruse et de la méchanceté. L’image dela vilaine sorcière est ici construite en antithèse avec la jeune princesse naïve. Le contel’identifie comme la Hârca (insistant ainsi sur sa vieillesse, sa fourberie, et sa laideur)mais surtout par le nom de Talpa Iadului (« La Taupe du Diable », n. t.). Ce personnageconstitue l’un des êtres les plus maléfiques de la mythologie populaire roumaine car ilest considéré comme la mère des démons. Elle se distingue par son intelligence et satraîtrise. La punition finale de celle-ci attachée à la queue d’un cheval réétablitl’élément comique qui ouvre d’ailleurs l’histoire, empêchant le conte de sombrer dansune morale qui se prête peu à l’ambiance fabuleuse créée.
21 Ce schéma initiatique de la fille cadette du roi se retrouve dans de nombreux contes. Legrand passionné de folklore roumain, Petre Ispirescu publie en 1876 « Le CochonEnsorcelé » [Porcul cel Fermecat19] une histoire racontée par sa mère et qui reprendl’image antithétique mentionnée : Baba Cloantza (mère de dragons) et la jeune femmequi découvre à ses dépens les pouvoirs magiques et surtout les ruses de la méchantesorcière. Ici la baba personnifie une épreuve du Destin que l’héroïne doit surmonterpour parvenir au bonheur (symbolisé par le mariage d’amour). L’histoire décrit lesaventures de la fille cadette d’un roi qui, suivant ses deux sœurs, entre dans la seulechambre du château à laquelle le père leur avait interdit l’accès. Les princesses yretrouvent un livre-oracle qui prédit des mariages princiers aux grandes sœurs, lacadette devra quant à elle épouser un cochon. Lisant le malheur sur le visage de sa fille,le vieux roi comprend la transgression. La prophétie se réalise et la princesse quitte lademeure paternelle pour suivre un cochon à la voix si humainement belle que le pèresoupçonne un terrible maléfice. La princesse apprend à aimer son étrange époux qui,tous les soirs, enlève la peau de cochon pour redevenir un homme. Mais lorsque lajeune mariée commence à s’habituer à ce train de vie peu commun (au point de tomberenceinte), la sorcière baba Cloantza « croise son chemin » et lui explique commentprocéder pour chasser le sort. Sans se méfier de la sorcière, la jeune femme essaied’utiliser la corde ensorcelée donnée par la baba pour attacher le pied gauche de sonmari au lit. Mais la corde se casse et son époux se réveille pour lui apprendre que sansce geste irréfléchi et précipité il aurait été délivré du sortilège trois jours plus tard. Leprince ensorcelé disparaît et sa jeune épouse part à sa recherche, son enfant dans lesbras. Traversant des contrées hostiles, la princesse roumaine trouve abri, conseil etobjets magiques dans la maison de la Lune et de ses sœurs, la mère du Soleil et la mèredu Vent. Arrivée devant l’étrange maison du prince ensorcelé, la jeune femme faitpreuve d’intelligence et d’une extrême détermination : elle s’improvise une échelleavec les objets enchantés reçus (rien que des os de poulets) et va jusqu’à se couper lepetit doigt pour s’en servir en guise de dernière marche. Les retrouvailles avec son maripermettent d’éclaircir les zones d’ombre de l’histoire, notamment le maléfice jeté par laCloantza, mère d’un dragon tué par le prince lors d’une guerre. Avant le banquet finalet la fin heureuse, la traversée du désert s’est imposée à la jeune femme qui a voyagéau-delà des frontières du monde réel. La transgression de la loi du père constitue lemoteur déclencheur du parcours initiatique, alors que la baba Cloantza personnifie,dans ce contexte, l’agent du Mal à expier.
22 La même idée de la faute envers le père constitue le déclencheur du célèbre conte russerecueilli par Alexandre Afanassiev, La Plume de Finist-Fier-Faucon, qui donne son titre àun volume traduit en roumain Pana lui Finist Soimanul20. On y suit le même parcours dela jeune cadette qui cache à son père l’existence d’un amoureux qui lui rend visitemagiquement chaque nuit. Par la jalousie de ses sœurs, cette romance sera
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
104
tragiquement interrompue et la jeune fille devra quitter le foyer paternel pourtraverser nombre d’épreuves afin de retrouver son amant. Lors de son périple, ellerencontrera la baba Cloantza21 à trois reprises sous trois formes différentes, laquelle luiservira à chaque fois de guide et d’alliée en lui fournissant les artefacts nécessaires àl’accomplissement de sa quête. Ces derniers, offerts par la petite, la moyenne, puis lagrande baba, évoquent à la fois les Parques et le fil d’Ariane.
23 Le folkloriste Petre Ispirescu nous donne l’occasion de découvrir la baba Cloantzaégalement comme mère d’un dragon que le jeune prince doit vaincre afin de délivrerune princesse esclave. Dans le conte intitulé « Histoire paysanne » [Poveste Tărănească22]le personnage de la Cloantza est placé au milieu d’un monde démoniaque dont le signele plus manifeste consiste en une rangée de têtes empalées tout autour de sa cour.Plongé dans le monde du conte établi par le dispositif mythique du « Il était une fois »,le lecteur retrouvera chez cette Cloantza une caractéristique similaire à celle du sorciervaudou car elle puise sa force et son immortalité en avalant des esprits qu’elle gardeprisonniers dans un tonneau. La menace principale qui plane d’ailleurs sur le royaumeest celle des créatures vampiriques cherchant à s’emparer de l’âme du vieux roi.
6. Baba Cloantza, une sorcière diabolique
24 Baba-i calul dracului, (en traduction littérale « la Baba est le cheval du diable »,traduction littéraire « Vieille sorcière, coursier de Satan23 »), dit un ancien dictonroumain cité par V. Alecsandri en exergue d’un poème qu’il intitule Baba Cloanţa (écriten 1842), travail d’inspiration folklorique qu’il qualifie lui-même comme une des sesmeilleures improvisations24. La formule poétique reprend l’oralité du style populaire. Lelexique spécifique surchargé d’argot déplace la figure ambiguë de la baba vers uneconstruction de sorcière shakespearienne. Ici c’est Cloantza elle-même qui semblepossédée par un désir incontrôlé pour « le plus beau des jeunes garçons », désir quis’empare d’elle dans une convulsion viscérale et résonnante : « Elle file, la vieilleédentée ; elle file en faisant claquer ses mâchoires et ses doigts ; le fuseau de saquenouille tourne rapidement en bourdonnant dans l’air25. »
25 À travers une progression hyperbolique, le lecteur est transporté dans un cadre certesrural mais plongé entièrement dans une nuit infernale : dans le ciel nocturne desfantômes maléfiques peuplent les nuages, l’étang semble ensorcelé alors que desserpents rampent parmi les fleurs et « sur la branche élevée d’un arbre reluisentsoudain deux yeux ennemis26 ». Dans cet éden dévoyé, sous le signe de la « lune pâle etblonde », la Cloantza invoque divers démons (Fiară-Verde, Sânge-Rosu, Hraconit), tout enproférant des menaces à l’encontre du jeune homme qui résisterait à ses charmes.
Que ses yeux tournent dans leurs orbites ; que sa langue soit prise et que Satan,armé d’un fer brûlant, lui arrache le cœur de la poitrine pour le jeter dans lesflammes éternelles. Que le monstre vert le poursuive (poursuit la Baba de plus enplus enragée, hystérique) tant qu’il y aura devant lui de la terre pour courir et de lalumière pour voir ! Que les terribles esprits de la nuit, Hraconit et Sang-Rouge,viennent le torturer à leur tour jusqu’à l’aurore27.
26 Lorsque les démons invoqués (dont un vârcolac, un être vampirique qui, selon lescroyances populaires, « mange le soleil et la lune ») échouent, la sorcière « gémit etpleure, elle a fini de filer, hélas ! et son bien-aimé n’est pas venu28 ». La vieille Cloantzanomme alors Satan lui-même en lui proposant le pacte ultime « sans plus songer aupéché mortel » : « viens accomplir mon vœu au prix de mon âme, que je te cède pour
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
105
l’éternité29 ». Le pacte avec le diable déclenche un tourbillon de manifestationsrappelant la démence et/ou la possession : elle court « follement30 », saute, vole, ellecrie des exorcismes. Décrite comme une « vieille échevelée31 », la « folle Kloantza »entourée de « milliers d’esprits infernaux » n’entend pas le « long éclat de rire32 »retentissant dans la forêt auquel un autre rire répond en écho. À deux pas de son« bien-aimé », la Cloantza voit son rêve basculer dans le cauchemar : le chant du coqréveille le village et les fantômes de la nuit se dissipent. Le tableau final se concentre iciencore sur l’élément aquatique : Satan se jette dans les profondeurs de l’étang aspirantégalement sa proie, la baba. La nature retrouve le calme et la sérénité mais le danger nedisparaît pas car les chuchotements d’une voix mélancolique appellent encore levoyageur « attardé [qui] passe en sifflant pendant la nuit au bord de cet étang » :« Viens à moi, mon brave chéri ; viens, je te chanterai pour toi la nuit de douceschansons, et je te soignerai comme une fleur, et je te préserverai par mes exorcismes dumauvais œil, des destinées cruelles et de la morsure des serpents33 ».
27 Comme la critique le souligne, l’œuvre permet deux pistes interprétatives : l’une quiexamine cette ballade d’inspiration populaire comme une construction épique figurantl’amour malsain, inapproprié de la femme âgée pour le jeune homme ou, dans lelangage du conte, le désir de la méchante sorcière pour le Prince charmant34 ; unedeuxième perspective insiste sur la dimension humoristique au sens de « chicane »(donc, « chamaillerie, bagarre, querelle de mauvaise foi sur des détails de peud’importance ») terme qui en roumain signifie « agacer, embêter quelqu’un avec desdemandes infondées35 ». Il est important de rappeler alors la dualité de la baba à la foispersonnage diabolique et esprit joueur. Opter pour une seule approche signifieraitperdre une partie essentielle de son potentiel signifiant.
7. La Cloantza, avatar de la Mort
28 Dans un très ancien chant populaire, Holera36 (« Le Choléra », recueilli par V. Alecsandrien 1853) la Cloantza est figurée au prisme de la mythologie romaine des « Furies del’enfer » représentées avec des serpents dans les cheveux. La métaphore de la sorcière(les cheveux ébouriffés, la peau asséchée sur son corps « envenimée ») révèle à nouveaule syncrétisme entre christianisme et paganisme : maniant des armes humaines etdiaboliques, la Cloantza rappelle ainsi les représentations propres à la mythologieromaine des anges tenant dans la main droite un sabre de feu, signe d’une calamiténaturelle à venir. Ici la Cloantza n’est autre que la mort (la maladie mortelle du choléra)qui surgit sur le chemin de l’insoucieux et bon vivant jeune Vâlcu. Cette fois aucunenégociation n’est possible37. La Cloantza incarne la Faucheuse et il ne semble pas anodinqu’elle soit identifiée dans le chant par le terme « cloantza » employé seul. Ladisparition du nom « baba » enlève au personnage toute dimension humaine.
29 Partant à l’aventure dans l’univers du conte roumain nous avons pris pour guide BabaCloantza qui s’est révélée porteuse de multiples visages et le médium de nombreusesvoix. Et ces voix qui traversent la baba, ces voix qui soignent ou qui mutilent, qui fontrire ou pleurer, qui jouent à l’oracle quand c’est la baba elle-même qui intriguera pourréaliser ses prophéties, se joignent à celle du conteur comme dans un chant choral etdévoilent à ceux qui les écoutent les pouvoirs de la mise en fiction. Lorsque le conteurnarre les aventures de cette vieille femme édentée dont les pouvoirs pourraient serésumer à savoir mettre en récit les angoisses de ceux qui la consultent pour les diriger
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
106
vers un avenir, c’est à lui-même et à son rôle qu’il fait référence. Privé d’un pouvoirréel, édenté lui aussi, le conteur dispose néanmoins de la magie des illusions quinourrissent ou qui empoisonnent. Ainsi, lorsqu’il conte les histoires de la baba, c’est lui– même qui se raconte et l’on peut voir dans l’évolution de la figuration de la baba,l’évolution du rôle que peut se prêter le conteur : du rôle quasi mystique etthérapeutique de l’ancien temps au rôle subversif mais ironiquement inoffensif ducontemporain.
BIBLIOGRAPHIE
Afanassiev, Alexandre, Pana lui Finist Soimanul : Basme fantastice rusesti [La plume de Finist-Fier-Faucon : contes fantastiques russes], trad. en roumain P. Stoicescu et A. Ivanov, Bucarest, éd. IonCreanga, 1986.
Alecsandri, Vasile, Poésie roumane. Les Doïnas : poésies moldaves, trad. J. E. Voïnesco, Paris,Imprimerie de De Soye et Bouchet, 1853.
—, Poezii populare ale românilor, Bucarest, Éditions Minerva, notes Em. Gârleanu, coll. « BibliotecaScriitorilor Români », 1908.
Arghezi, Tudor, Prisaca, Bucarest, éd. Ion Creanga, 1990.
Creangă, Ion, Povesti, Povestiri, Amintiri, Bucarest, éd. Eminescu, 1987.
Coteanu, Ion, Seche, Luiza et Seche, Mircea (dir.), DEX Dicţionarul explicativ al limbii române,Bucarest, Univers enciclopedic, 1996.
Ispirescu, Petre, Basmele românilor, Bucarest, Éditions eLiteratura, 2013.
—, Poveste tărănească, Povesti pentru Copii, 2015, http : //www.povesti-pentru-copii.com/petre-ispirescu/poveste-taraneasca.html, consulté en ligne le 15/05/2015.
Prisaca, Bucarest, éd. Ion Creanga, 1990, p. 40.
Millo, D.M., Baba Hârca : operetă vrajitorie în doua acte si trei tablouri, Bucarest, Tipografia C.A.Rosetti, 1851.
Nicolescu, Carmen, Daimonii in literatura românà, Craiova, éd. Universitaria, 2012.
Vlasin, Gelu, Atac de panică, Bucarest, éd. Soc. Culturala Noesis (édition en ligne, www.noesis.ro),2000 / éd. Muzeul Literaturii Române, 2002.
NOTES
1. I. Coteanu et al. (dir.), DEX Dicţionarul explicativ al limbii române, p. 187.2. Ibid., p. 187.3. V. Alecsandri, « Kraiu-Nou ou la nouvelle lune », Les Doïnas : poésies moldaves, p. 34-37.4. Ibid., p. 34.5. Ibid., p. 36.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
107
6. Ibid., p. 37.7. V. Alecsandri, « Burueana de leac », Poezii populare ale românilor, p. 174-175.8. Nom commun roumain composé de buruiana qui signifie « mauvaise herbe » et leac étant unsynonyme populaire pour « remède ». Le sens du syntagme renvoie à toute « plante sauvagemédicinale ». DEX Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucarest, op. cit., p. 120.9. Nous faisons référence au poème « Baba-n sat » (« La Baba dans le village », notre traduction)publié dans le recueil Prisaca, p. 40.10. T. Arghezi, Prisaca, op. cit., p. 4011. Nous citons en traduisant du poème « 15 : 28 », paru dans le recueil Atac de panică [Attaque depanique].12. Le dictionnaire roumain renvoie à l’étymologie ukrainienne de hyrka. DEX Dicţionarulexplicativ al limbii române, op. cit., 1996, p. 447.13. D.M. Millo, Baba Hârca : operetă vrajitorie în doua acte si trei tablouri, [Baba Hârca : opérette-sorcellerie en deux actes et trois tableaux].14. V. Alecsandri, « Cucul si turturica », Poezii populare ale românilor, op. cit., p. 9-11.15. En roumain le terme utilisé est « neîncepută » qui signifie « à laquelle on a pas encoregoûté », par extension, « à laquelle on a pas encore touché ». Voir les notes de V. Alecsandri,op. cit., p. 10.16. Voir également le poème populaire « Urâtul » publié par V. Alecsandri dans Poezii populare aleromânilor, op. cit., p. 152.17. Le poème sera publié pour la première fois en 1886 dans La Tribuna, le principal journal deCluj, Roumanie. Poème consulté en ligne http : //www.povesti-pentru-copii.com/poezii-pentru-copii/george-cosbuc/atque-nos.html, le 14/05/2015.18. I. Creangă, « Povestea porcului », p. 38-52.19. P. Ispirescu, « Porcul cel Fermecat », Basmele românilor, p. 66-81.20. Pana lui Finist Soimanul : Basme fantastice rusesti [La plume de Finist-Fier-Faucon : contesfantastiques russes], p. 3-14.21. Notons que dans cette version roumaine du conte d’Afanassiev, le terme de « Baba Yaga » esttraduit par celui de « Baba Cloantza », une adaptation lexicale qui semble s’imposer devant unlecteur roumain moins sensible aux sonorités russes du nom de la sorcière.22. Petre Ispirescu, Poveste tărănească.23. La traduction appartient à J.E. Voinescu, in Poésie roumane. Les Doïnas : Poésies moldaves, deV. Alexandri, p. 19. La version française du poème s’intitule « La Vieille Kloantza » ; le terme« baba » étant traduit soit par l’adjectif « vieille » soit par la formule « vieille sorcière » enfonction du contexte.24. Les mots du poète sont cités par Carmen Nicolescu, dans sont travail sur le mondedaïmonique dans la littérature roumaine, qui propose une analyse approfondie du poème.Daimonii in literatura românà, p. 75.25. V. Alecsandri, « La Vieille Kloantza », in Poésie roumane. Les Doïnas : Poésies moldaves, op. cit.,p. 20.26. Ibid., p. 22.27. Ibid., p. 20.28. Ibid., p. 21.29. Ibid., p. 22.30. Ibid., p. 23.31. Ibid., p. 22.32. Ibid., p. 23.33. Ibid., p. 24.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
108
34. Dans son étude Carmen Nicolescu cite l’analyse de Serban Cioculescu, en l’opposant àl’interprétation de Alexandru Macedonski qui voit dans ce poème des situations de « chicane ».Daimonii in literatura românà, op. cit., p. 75, p. 79.35. DEX Dicţionarul explicativ al limbii române, op. cit., p. 1055.36. V. Alecsandri, « Holera », Poezii populare ale românilor, op. cit., p. 27-28.37. Nous rappelons qu’en échange d’avantages matériels, comme nous l’avons signalé dansd’autres contextes, la Baba Cloantza se mettait au service de celui ou celle qui faisait appel à elleet à ses pouvoirs.
RÉSUMÉSPresque toute histoire inspirée du folklore des Carpates met en scène le personnage d’une vieillesorcière, d’une femme âgée vivant en périphérie du village, Baba Cloanţa [Kloantza]. Pour toutlecteur roumain bercé par les contes, ce nom suggère une représentation corporelle singulière,dont le symbole qui se détache, riche en termes d’analyse littéraire et mythique, est l’absence dedents. Notre réflexion s’attache à explorer l’ambiguïté de la figure de la Baba (guérisseuse, oracle,guide, démon, ou simple caricature) à travers un ensemble de textes représentatifs (contes,poèmes et opérette).
Nearly all the stories inspired by the Carpathian folklore feature the character of an old witch, anelderly woman living on the outskirts of the village, named Baba Cloanţa. For the Romanianreader, cradled by the ancient tales, this name suggests a singular (and symbolically charged)appearance marked by the absence of teeth. Our article examines the ambiguous nature of theBaba (as healer, oracle, spiritual guide, demon, or caricature) as presented in a number ofedifying texts (tales, poems and an operetta).
INDEX
Mots-clés : réécriture du conte, folklore roumain, sorcellerieKeywords : rewriting tales, Romanian folklore, witchcraft
AUTEUR
SIMONA FERENT
Simona Ferent, docteur ès lettres de l’Université de Limoges, est chercheuse indépendante etexerce le métier de professeur d’anglais à l'IFPM de Nanterre. Après un parcours littéraire, ellesoutient en 2010 un mémoire de thèse intitulé Le JE et l’AUTRE, ou comment l’altérité répond àl’identité : questionnements chez Marthe Bibesco. Ses articles scientifiques portent un intérêtparticulier à l’écriture de la mémoire et aux expressions de l’altérité dans les littératuresfrançaise et francophone roumaine des XIXe et XXe siè[email protected]
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
109
Baba Yaga dans les louboksGalina Kabakova
1 Le personnage de Baba Yaga attire l’attention des chercheurs depuis les premièrespublications de contes. Plusieurs hypothèses ont été formulées quant à l’origine dupersonnage et de son symbolisme. Une autre question qui a été longuement débattueconcerne les fonctions du personnage. Est-il en rapport avec l’initiation, comme lepensait Vladimir Propp, avec la mort ou avec la naissance ? Symbolise-t-il la terre ou lafertilité ? Ces réflexions s’appuient toutes sur l’analyse de contes de tradition orale.Mais que nous apprend donc l’iconographie populaire de Baba Yaga ? L’étude d’imagesqui suit se propose de découvrir de nouvelles pistes de réflexion sur les origines dupersonnage, à partir d’un matériau visuel très original, celui des louboks russes du XVIIIe
et du XIXe siècle.
1. Baba Yaga et ses compagnons
2 Deux planches représentant Baba Yaga figurent dans toutes les études consacrées àl’imagerie populaire. La première s’intitule « Yaga-baba part combattre le crocodile » etla deuxième « Yaga Baba avec un moujik, un vieux chauve, sautent en dansant ». Lesdeux datent des années 1760 et apparaissent dans le catalogue de Dimitri Rovinski quifait référence en la matière1.
3 La première image est connue dans deux versions, qui diffèrent légèrement par lesmotifs et par la légende. La légende complète de la première version explique : « Yaga-Baba part combattre le crocodile à dos de cochon avec un pilon. Ils ont une fiole de vinsous le buisson ».
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
111
Image 1 – Yaga-Baba part combattre le crocodile à dos de cochon avec un pilon. Ils ont une fiole devin sous le buisson (1760 environ).
4 La deuxième version a une légende différente : « Baba Yaga jambe de bois partcombattre à dos de cochon le karkadil avec son pilon. Il y a du vin ».
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
112
Image 2 – Baba Yaga jambe de bois part combattre à dos de cochon le karkadil avec son pilon. Il ya du vin (1760 environ).
5 Les images sont intéressantes parce qu’elles représentent un personnage inconnu dufolklore : le crocodile.
6 L’ouvrage récent de Konstantine Bogdanov, Crocodiles en Russie2, traite de la place de cetanimal dans l’imaginaire russe en insistant sur ses connotations exotiques. Ce korkodilou karkodil apparaît dans les bestiaires médiévaux et symbolise soit le diable, soit unhomme hypocrite, d’où l’expression les « larmes de crocodile ». En même temps,l’iconographie des bestiaires est plus proche du crocodile réel. Dans les louboks, nousavons affaire à un animal fantastique composé de plusieurs bêtes avec des pattes et unecrinière de lion, une queue de loup, des griffes et une barbe qui fait plutôt penser à lareprésentation du diable dans les livres manuscrits.
7 Outre ces deux versions de la première représentation célèbre de la Yaga avec lecrocodile, on trouve une seconde image dans l’iconographie populaire, celle avec leMoujik.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
113
Image 3 – Baba Yaga et le moujik (1760 environ).
8 Cet autre compagnon de Baba Yaga, le moujik avec la cornemuse de la deuxièmereprésentation, est habillé comme un vrai paysan avec ses chaussures russes tressées,lapti. La calvitie doit indiquer son âge avancé. La représentation de Baba Yaga varied’une image à l’autre et fait montre de contradictions assez spectaculaires. Dans tousles cas, elle ressemble assez peu aux portraits de la sorcière brossés dans les contes. Lafameuse unique jambe d’os n’apparaît pas. Elle a l’air d’une femme mais munie de traitshypertrophiés. Ainsi, son nez « en patate » dans les louboks 1 et 3, est recourbé vers lehaut, et en même temps busqué (3). Les trois images mettent en évidence son énormelangue qui sort de la bouche. Et pour compléter ce portrait effrayant, la Baba Yagadansante est bossue.
9 Dans cette série de gravures, elle est habillée comme les femmes russes aisées aux XVIe
et XVIIe siècle. L’habit qu’elle porte peut être identifié au letnik dont les manches et laceinture sont peut-être brodées. Elle porte également une boucle et un collier, ce quidoit signaler son haut statut. Le bonnet dont elle est coiffée (no 3) est celui d’une femmemariée ou d’une veuve. L’image no 2 au contraire la présente les cheveux défaits, ce quià l’époque était considéré comme indécent.
10 La Baba Yaga des images 2 et 3 porte des lapti comme le moujik paysan, ce qui crée unecertaine dissonance par rapport à son habit, celui d’une femme noble ou, du moins,riche. L’habit de la première Baba Yaga est différent car il ressemble beaucoup à l’habitd’une femme finnoise avec son bonnet caractéristique.
11 Tout aussi intéressants sont les attributs de ces Babas Yaga. Le mortier ou le balai quilui servent de moyen de locomotion dans les contes sont absents et elle avancefièrement perchée sur un cochon ou un sanglier. Dans les deux premières images elleest munie à la fois d’ustensiles féminins, comme le peigne, et d’ustensiles masculins
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
114
comme la hache. On reconnaît également les rênes et le pilon dont elle aiguillonne lecochon.
12 D’ailleurs, le pilon en tant qu’arme se retrouve dans d’autres louboks. Il sert à la fois àBaba Yaga dans les contes – dans son mortier, elle s’approche d’un vieux et le frappeavec son pilon (« Fedor Vodovitch et Ivan Vodovitch3 ») – et à la femme méchante dansle loubok. Ainsi, dans une version de livre manuscrit du XVIIIe siècle on trouve une imagepopulaire qui représente l’épouse méchante qui chasse son mari de la maison en tenantdans une main une cruche et dans l’autre un pilon4.
13 Le couple énigmatique composé du crocodile et de Baba Yaga dispose d’autres attributsintéressants : ce sont la bouteille de vin posée devant le crocodile ainsi que le petitbateau qu’on reconnaît dans l’eau en-dessous du crocodile (1). Le paysage symboliqueest composé également de fleurs et de branches pour signaler que la nature est enfleurs.
14 Cette présentation intrigue les universitaires depuis plus d’un siècle. En effet, si BabaYaga ressemble si peu à son prototype merveilleux, ne s’agit-il pas d’un tout autrepersonnage qui se cache derrière le nom de la célèbre sorcière ?
15 Dimitri Rovinski a été le premier à supposer qu’il s’agissait d’une satire politique visantle premier empereur russe Pierre le Grand et son épouse5. En effet, le bateau pourraitsymboliser la passion du tsar pour la marine qui l’avait amené à construire unenouvelle capitale maritime, Saint-Pétersbourg. Le bonnet et le costume finnois de lafemme seraient alors la référence à l’origine balte de sa deuxième épouse qui deviendral’impératrice Catherine Ire. Le vin indiquerait leur penchant commun pour l’alcool et laposture martiale de la femme évoquerait les relations tumultueuses du couple. Mais quipourrait donc ironiser ainsi sur le couple impérial ? Rovinski a supposé que les gravuresétaient produites par des vieux-croyants qui nourrissaient une haine tenace pour leurennemi juré et l’affublaient de sobriquets comme « chat » et « crocodile ». D’autresimages populaires pourraient également être interprétées comme une satire contrePierre le Grand, comme par exemple celle où il est représenté comme le chat : « Le Chatde Kazan ou Les obsèques du chat par les souris ».
16 Cette interprétation a été systématiquement répétée par plusieurs chercheurs jusqu’ànos jours. Mais elle suscite également des interrogations. Que signifie notamment lalongue barbe du crocodile si on prend en compte le fait que Pierre avait déclaré laguerre aux barbes6 ? De plus les gravures dont on dispose datent des années 1760 et onn’a pas de preuves que les originaux aient été réalisés un demi-siècle plus tôt. DianeFarrell dans sa thèse Popular prints in the cultural history of eighteenth-century Russia aémis des doutes quant au contexte politique de ces images. La chercheuse américainesuppose notamment qu’il s’agit plutôt de personnages carnavalesques7. Le dernier endate, Konstantin Bogdanov, insiste sur le caractère purement divertissant de ces imagesqui s’inscrivent bien dans la lignée d’autres scènes comiques représentant des ivrogneset des bagarreurs8. On pourrait ajouter que ces trois gravures s’insèrent également dansla thématique des images antiféministes, voire misogynes, où les femmes, surtout lesjeunes épouses, cherchent à humilier et à malmener leurs maris. Parfois cette satirevise plus précisément les femmes étrangères.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
115
2. En quête des origines de Baba Yaga
17 En préparant l’anthologie de contes étiologiques russes publiée en 2005 sous le titreContes et légendes de Russie, j’ai trouvé un récit assez court enregistré dans l’est de laRussie, dans la vallée de Kama, région qui se singularise par la très forte présence desvieux-croyants.
Un diable eut envie de fabriquer Baba Yaga. Il rassembla les douze bonnes femmesles plus méchantes et les mit à cuire dans un chaudron. Il goûta, puis fit cuireencore un jour. Il goûta de nouveau et éternua si fort que les portes s’ouvrirent. Ilmangea une cuillerée de la préparation et cracha. Du chaudron sortit alors BabaYaga9.
18 Malgré le fait que le texte figure dans l’Index des contes-types du conte des Slaves orientauxsous le numéro SUS 1169*, il reste isolé car aucune autre version n’a été enregistrée nien Russie, ni en Ukraine, ni en Biélorussie. C’est après avoir publié ce texte que j’aidécouvert une planche de loubok composée de huit images, huit séquences quiracontent la création de Baba Yaga. Le conte cité ci-dessus représente la versionabrégée du début du récit figurant sur le loubok en huit planches.
Image 4 – les origines de Baba Yaga.
19 C’est un loubok assez rare qui ne figure pas dans le catalogue de l’image populaire deDimitri Rovinski. Un exemplaire est conservé au Musée d’histoire de la religion à Saint-Pétersbourg, un autre à la Bibliothèque nationale à Saint-Pétersbourg, enfin untroisième à la Bibliothèque nationale de France. C’est ce dernier qui a été reproduitdans la monographie de Catherine Claudon-Adhémar, Imagerie populaire russe (Milan,1977). Voici donc le texte complet de la légende.
Origine et formation de Baba YagaLe diable en chef ou le chef de tous les diables, tout en étant grand chimiste, eut
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
116
envie d’inventer le mal qui le dépasserait par sa puissance. Dans ce but, il cuisitdouze femmes méchantes, car la physique lui avait apprit que c’était la meilleure etla plus profitable des matières. Et d’après les calculs mathématiques chaque femmeméchante contient du mauvais alcool en considérant un diable normal dans laproportion de sept contre douze et contre lui en personne une septième. En faisantcuire ces particules du mauvais alcool qui se dégageaient avec la vapeur enl’absence de la cornue il les attrapait avec la bouche et les avalait. En fin de cuissonil ne restait dans le chaudron que la matière brûlée ; il cracha dans le chaudron etl’alcool du mal de femmes mêlé à la salive du diable tombée sur les cendres, enfusionnant, forma Baba Yaga. Le diable la considéra comme le mal absolu et la plaçadans un bocal dans l’idée de fabriquer par la suite une dizaine de Baba Yaga commecelle-ci et en fabriquer ensuite le mal encore plus parfait. Mais en pesant le malqu’elle contenait et le comparant au mal propre aux femmes du monde, il constata,désappointé, que ces dames même sans cuisson ne lui cèdent pas une once. Cela lefâcha au point que, par dépit, il jeta le bocal par terre qui se brisa en millemorceaux, comme les jambes de Baba Yaga qui, arrachées, s’étaient cassées. Celadégrisa le diable qui, conscient qu’il libérerait ainsi le monde du grand mal, donna àBaba Yaga des jambes en os, lui inspira la connaissance de la sorcellerie et pourqu’elle quitte l’enfer lui offrit en guise de voiture un vieux mortier en fer quitraînait dans son laboratoire et un pilon en fer pour aiguillonner le mortier qui luisert toujours à parcourir le monde en faisant le mal.
20 C’est un texte assurément satirique qui insiste sur le caractère « scientifique » de lafabrication de Baba Yaga qui fait appel à la fois aux mathématiques, à la chimie et à laphysique. Mais il est clair que le message de cette planche satirique vise avant tout laméchanceté des femmes. Pour une fois la satire ne vise pas toutes les femmesméchantes, comme ça se faisait depuis le Moyen Âge, mais les femmes de la hautesociété.
21 Cette satire peut se nourrir des modèles occidentaux : rappelons la célèbre sériefrançaise de Lustucru où ce forgeron cherche à remodeler les femmes précieuses etmême l’alambic miraculeux qui permet de refaire les femmes. Le thème de lafabrication n’est pas sans rappeler le motif de l’homoncule créé par un alchimistemoyenâgeux. Le motif de la pesée de Baba Yaga et d’une mondaine fait référence à unthème traité par les icônes : « Saint Michel et Satan qui pèsent les âmes de pécheurs ».
22 En même temps, on reconnaît quelques motifs propres aux récits étiologiques, commela salive qui aide à fabriquer un personnage humain (en général, c’est la salive divinequi permet de fabriquer des figurines en argile qui deviendront les premiers hommes).Dans la tradition orale, on trouve également des récits qui présentent le diable en tantque créateur : par exemple, il arrive à fabriquer les différentes nations. Il s’agit d’unconte ukrainien et le mode opératoire n’est pas sans rappeler notre planche : le diablemet dans un chaudron des herbes et de la poix et les fait cuire. Selon le temps decuisson, il en sort d’abord un Ukrainien, un Allemand, un Tatar et un Juif, le dernier estconsidéré par le diable comme le plus réussi10. Même si ce récit est prétendumentétiologique, on y trouve quand même la caractéristique permanente du diable : c’est uncréateur malheureux ; il essaie de créer l’homme mais il échoue, dans d’autres cas ilcherche à imiter l’œuvre divine et il crée tout autre chose. Et dans notre cas, il essaie defabriquer quelque chose d’inédit qui dépasserait par sa nuisance tous les êtres existantset finalement il ne fait que reproduire les méchantes femmes du monde.
23 La naïveté du dessin fait penser que l’auteur n’a pas copié une gravure occidentale(contrairement à d’autres louboks consacrés à cette problématique, comme parexemple celui qui représente un couple en train de s’affronter pour savoir qui va porter
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
117
la culotte). Le graveur est assez malhabile dans le traitement des personnages. Le diableressemble à un homme, mais muni des détails obligatoires pour un diable russe : unequeue, des cornes et une barbichette de bouc, des ergots de coq, des griffes mais aussides ailes pour rappeler ses origines célestes (d’ailleurs, ce dernier détail n’est passystématique dans la représentation de Satan). La grande similitude entre le portrait dudiable, des femmes et de Baba Yaga, produit final, serait-elle voulue (comme parexemple dans la gravure française illustrant la vraie nature de la gent féminine, « Lavraye femme ») ? Je pense qu’elle résulte plutôt de la maladresse du graveur que de sondessein. Il est aussi intéressant de souligner la représentation banalisée de Baba Yaga etdes femmes mondaines qui ne portent aucun signe distinctif de leur statut, aucunetrace de la coquetterie. En fait, les seuls détails qui constituent le portrait de laméchante sorcière sont ses deux jambes (au lieu d’une dans le folklore) en os et sonmortier avec le pilon qui lui servent de moyen de locomotion.
24 Les recherches de la source de cette planche si mystérieuse m’ont conduite à lalittérature du colportage qui a fait la part belle aux adaptations et à la réécriture descontes traditionnels. Cette littérature « du loubok » a précédé la publication« scientifique » de contes au XIXe siècle ; Alexandre Afanassiev a en partie puisé dans ceséditions de la deuxième moitié du XVIIIe siècle lorsqu’il considérait les contes proches deleur source populaire.
25 C’est ainsi que j’ai retrouvé le texte du loubok dans le « Conte du gentilhommeZaolechanine, preux au service de prince Vladimir » qui fait partie des « Contes russes »en 10 volumes de Vassili Levchine (1780). Ce texte, à la différence de celui du loubok,cite le terme alchimique caput mortuum [le brun momie] qui permet de créer la pire descréatures, Baba Yaga :
De l’origine de Baba YagaLe diable en chef ou le diable au-dessus de tous les diables, tout en étant grandchimiste, cuisit douze femmes méchantes, en espérant d’en extraire l’essence dumal qui le dépasserait par sa qualité. La physique lui avait appris que c’était lameilleure et la plus profitable des matières, et d’après les calculs mathématiqueschaque femme méchante contient du mauvais alcool en considérant un diablenormal dans la proportion de 7 contre 22 et contre lui en personne une 11e, c’estpourquoi il en cuisait 12. Mais comme la cornue n’était pas encore inventée, ilattrapait avec la bouche les particules de l’alcool qui se dégageaient avec la vapeur.En fin de cuisson il ne restait dans le chaudron que du caput mortuum ; dissipé, ilcracha dans le chaudron ; l’alcool mêlé à la salive du diable tomba sur ce caputmortuum, et le diable, dépassé dans ses attentes, découvrit Baba Yaga qui en sortit.
26 Dans le conte de Levchine, ce texte légende un portrait dessiné sur un mur du châteauensorcelé. Et il débouche sur la mise en garde :
Cette nouvelle t’est communiquée, ô lecteur curieux, de la part d’une personne quiprotège ton sauveur. Mais comme il est convenu que le mystère dévoilé contre legré d’une femme soit puni, sois métamorphosé pour ta désobéissance à Baba Yaga.
27 Et en effet, le personnage qui raconte la découverte est transformé en un clin d’œil endragon11.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
118
3. Baba Yaga dans la littérature« de loubok »
28 On y retrouve les mêmes motifs que dans la littérature orale, mais certains sontmodifiés, et d’autres sont ajoutés. Voyons par exemple le motif du cannibalisme etprenons l’exemple du conte-type ATU 327C, « Le diable apporte chez lui l’enfant dans lesac ». Dans la version russe, il s’agit toujours de la sorcière Baba Yaga qui attrape unenfant et essaie de le cuire au four. Dans les versions populaires du conte russe, commedans « Hansel et Gretel » des frères Grimm, c’est la sorcière ou sa fille ou bien les deuxqui périssent dans le feu enfournées par l’enfant rusé. Il en va autrement dans lalittérature du loubok. Ainsi dans le « Conte du gentilhomme Zaolechanine », la sorcièreréussit à capturer un enfant de six ans, à le rôtir et le manger12.
29 La jonction entre Baba Yaga et le dragon, qui est l’antagoniste attitré du héros, peutprendre une tournure différente de la tradition orale : dans le « Deuxième conte d’Ivanle Tsarévitch » du recueil Contes russes de Piotr Timofeev (1787) le roi dragon Erakskiqui avait capturé l’héroïne Maria Morevna part au combat contre Baba Yaga, ce quipermet à Ivan le Tsarévitch de la libérer sans problème. Rappelons qu’en règlegénérale, c’est au héros qu’incombe la tache d’affronter et d’occire le méchant dragon.
30 De même, dans « Le conte de Léviane le preux » du recueil anonyme Le Narrateur decontes russes (1787) ce n’est pas le héros qui est mandaté pour garder les poulichesfabuleuses de Baba Yaga, comme c’est le cas dans les contes populaires « Le chevalmagique » (ATU 302C), mais Kachtchej l’Immortel, un autre antagoniste redoutable.
31 Dans le « Conte du gentilhomme Zaolechanine », on découvre également des thèmes« romanesques » inventés par l’auteur : Baba Yaga adopte l’héroïne, elle éprouve del’amour pour le dragon ailé, qui ne le partage pas. Néanmoins « elle lui rend visite tousles jours et rentre parfois en larmes et parfois en grande colère qui se solde toujourspar des soupirs ». Et pour finir, quand Baba Yaga décède, « son âme mesquine quitteson siège misérable et chute en enfer13 ».
32 Mais c’est surtout dans les descriptions que l’on découvre des détails absents desversions orales. Ainsi, dans le « Deuxième conte d’Ivan le Tsarévitch », la sorcière vitdans un palais protégé par une barrière en fer et non plus dans une cabane perchée surdes pattes de poulet.
33 Dans une version anonyme de « L’oiseau de feu et le cheval à la crinière d’or » publiée àMoscou en 1860, on fournit une image composite de notre sorcière. Elle a « une tête deporc, une queue de corbeau ou une queue en os » ou bien « elle a deux cornes, une têtede chien, un nez d’oie, une queue d’étain ». Ou encore on évoque « l’affreuse Baba Yagaà longues dents, jambe d’os, tête de fonte, queue d’argile14 ».
34 Rappelons à ce propos que le personnage folklorique de Baba Yaga est décrit demanière assez succincte et ce ne sont pas les mêmes caractéristiques physiques qui sontmises en avant. On insiste sur les traits qui la rapprochent du monde des morts ou desreptiles : elle ne dispose que d’une jambe et celle-ci est en os, autrement dit, décharnée.Et son nez est parfois si long qu’il atteint le plafond. Parfois on mentionne des traits quisuggèrent sa féminité hypertrophiée : des seins si énormes qu’ils ne tiennent pas dansla pièce et débordent par-dessus du seuil. Et on évoque aussi les détails compositescomme le nez de fer ou la face d’argile15.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
119
35 Pour conclure cette étude iconographique des images et légendes gravées sur bois, onpeut constater que le loubok se saisit du personnage des contes, de grande notoriétédans la tradition orale, non pour en raconter l’histoire, mais essentiellement dans lebut de dénigrer les faiblesses de la gent féminine en général, en se focalisant soit sur lesfemmes du monde, à la réputation d’être méchantes, soit sur les femmes étrangères.L’imagerie populaire montre ainsi les préjugés à la fois sociaux, de genre et de raceayant cours à l’époque.
NOTES1. Dm. Rovinskij, Russkie narodnye kartinki, vol. 1, Saint-Pétersbourg, 1900, p. 273-274.2. K. Bogdanov, O krokodilax v Rossii, Moscou, NLO, 2006.3. Severnye skazki v sobranii N.E. Ončukova, Saint-Pétersbourg, Mir, 2008, p. 84-89.4. F. I. Buslaev, « Ženščina v narodnyx knigax », Moi dosugi, part. 2, Moscou, 1886, p. 44-45.5. Dm. Rovinskij, op. cit., p. 273-274.6. Pierre le Grand, lors des grands projets de modernisation de la Russie, avec notamment laconstruction de Saint-Pétersbourg, avait instauré de nombreux impôts et notamment un impôtsur le port de barbe. Cela était vu comme une persécution supplémentaire des vieux-croyants quiportaient la barbe.7. D. Farrell, Popular prints in the cultural history of eighteenth-century Russia, thèse de doctorat,Madison, Université du Wisconsin, 1980, p. 96.8. K. Bogdanov, op. cit., p. 184-187.9. G. Kabakova, Contes et légendes de Russie, trad. A. Stroeva, Paris, Flies France, 2005, p. 188.10. G. Kabakova, « La figure de l’étranger dans les contes étiologiques », in A. Stroev (dir.),L’Image de l’étranger, Paris, Institut d’études slaves, 2010, p. 347.11. V. Levšin, Russkie skazki, livre 1, Saint-Pétersbourg, Tropa Trojanova, 2008, p. 363.12. Ibid, p. 330.13. Ibid, p. 330-333.14. A. Orlova, Obraz Baby-Yagi v russkix volšebnyx skazočnyx povestjax XVIII veka (http : //msu-research06.ru/index.php/filology/165-russustn/1140-2011-03-17-12-07-27 ?tmpl =component&print =1&page =) ; K. Korepova, Russkaja lubočnaja skazka, Moscou, Forum,2012, р. 141.15. V. Dobrovol’skaja, « Baba Yaga : k voprosu ob iskonnoj prirode », Obraznyj mir tradicionnojkul’tury, Moscou, GRCKF, 2010, р. 30.
RÉSUMÉSL’iconographie populaire de Baba Yaga n’est pas très abondante. Une image de loubok a attirétout particulièrement mon attention. Il s’agit d’une planche peu connue, qui raconte la création
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
120
de Baba Yaga. C’est un loubok assurément satirique qui vise avant tout la méchanceté desfemmes. Nous procédons à l’analyse de différentes hypothèses émises quant à la significationd’autres images, plus célèbres : « Yaga-baba part combattre le crocodile », connue en deuxversions, et « Yaga Baba avec un moujik ».
The popular iconography of Baba Yaga is not very abundant. An image from the Lubok traditionhas particularly caught my attention. This is a little-known print that tells of the creation of BabaYaga. This is certainly a satirical Lubok aimed primarily at the wickedness of women. I proceed tothe analysis of different hypotheses about the meaning of other, more famous prints: « Baba Yagarides off to fight the crocodile », printed in two versions, and « Yaga Baba with mujik », BabaYaga with peasant.
INDEX
Mots-clés : contes populaires, légendes étiologiques, loubokKeywords : folk and fairy tales, etiological legends
AUTEUR
GALINA KABAKOVA
Maître de conférences en civilisation russe, UFR d’études slaves, université [email protected] les publications : Anthropologie du corps féminin dans le monde slave, Paris, Montréal,L’Harmattan, 2000 ; Le Corps dans la culture russe, Moscou, Novoe literaturnoe obozrenie, 2005 (enrusse) ; L’Hospitalité, le repas, le mangeur dans la civilisation russe, Paris, L’Harmattan, 2013 ; Contes etlégendes étiologiques dans l’espace européen, Paris, Pippa/Flies France, 2013 ; Les Traditions russesd’hospitalité et de convivialité, Moscou, Forum-Neolit, 2015 (en russe) ; ainsi que la publication desept anthologies de contes et légendes étiologiques, dont Contes et légendes de Russie, Paris, FliesFrance, 2005 et Aux origines du monde : contes et légendes étiologiques russes, Moscou, Forum – Neolit,2014 (en russe).
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
121
Baba Yaga sur l’écran soviétiqueMasha Shpolberg
Introduction
1 En 1979, le studio soviétique Soïuzmultfilm produit un dessin animé en trois parties envue des jeux olympiques de l’année suivante. Le premier épisode s’ouvre avec un chœurde journalistes proclamant dans toutes les langues de la terre que « l’ourson Michavient d’être élu la mascotte des jeux olympiques de Moscou » tandis que Baba Yagaécoute dans sa cabane, de plus en plus enragée. « Pourquoi lui ? Pourquoi lui et pasmoi ? » se demande-t-elle. « Tout le monde est pour, » conclut l’un des journalistes. « EtBaba Yaga est contre ! » s’exclame-t-elle, avant d’attaquer l’image télévisée de Micha àcoups de balai.
2 Au fil de ces trois courts épisodes, Baba Yaga est contre ! raconte les tentativesinfructueuses de Baba Yaga et ses assistants, Zmeï Gorynytch et Kachtcheï l’Immortel,d’empêcher Micha de participer aux jeux. L’intrigue repose sur l’ubiquité de Baba Yagadans l’imaginaire soviétique et son importance en tant que symbole de la culturepopulaire. Pourtant, Baba Yaga n’a pas toujours bénéficié d’un tel statut. La sorcière, etle conte de ses aventures, furent bannis de l’union soviétique dans les années quisuivirent son établissement. À partir de 1918, année de la création de l’union desjeunesses léninistes communistes (ou komsomol), le Parti se mît à progressivement ré-organiser le système éducatif : il fut alors décidé que le conte ne pouvait pas y avoir deplace. Ses racines rurales et païennes posaient nécessairement problème à un État quivisait à construire un nouveau monde industrialisé et rationnel. « D’une part »,explique Galina Kabakova, le conte « ne véhicule pas les valeurs de la nouvelle sociétéet d’autre part, le merveilleux est jugé nocif pour la conscience des jeunes bâtisseurs dusocialisme1 ».
3 La campagne contre le conte connût son apogée en 1924 lorsque Nadejda Krupskaïa,compagne de Lénine et présidente du Glavpolitprosvet, le comité centrale chargé del’éducation politique, exigea que les bibliothèques publiques se débarrassent de tous leslivres à « mauvaise influence émotionnelle ou idéologique » ainsi que des livres ne seconformant pas aux « nouvelles approches pédagogiques » – y compris les recueils de
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
122
contes d’Afanasiev2. « Au début des années vingt, » explique l’historien culturel Félix J.Oinas « certains critiques soviétiques ont argumenté que le folklore exprimaitl’idéologie des classes dominantes, une proposition qui a mené les organisationslittéraires prolétaires à une réception négative du conte populaire »3. Une sectionspéciale du Proletkult pour enfants attaqua même les contes pour leur « glorificationdes tsars et tsarévitchs », proclamant qu’ils « renforçaient les idéaux bourgeois » et« provoquaient des fantaisies malsaines » chez les enfants4.
4 Lorsque le conte réapparut au milieu des années trente, ce fut au sein d’unerécupération plus générale de folklore russe par la politique culturelle soviétique.Comme les nationalismes romantiques de l’époque prérévolutionnaire, ce tournantidéologique visait la dissolution de l’identité personnelle dans l’identité collective. Et oùce processus pouvait-il se dérouler plus efficacement qu’au cinéma ? « Lesadministrateurs culturels staliniens changèrent de ligne officielle sur la culturepopulaire, et le conte merveilleux devint un genre cinématographique légitimepuisqu’il aida à visualiser l’esprit de la réalité miraculeuse promulguée par la culturestalinienne », écrit Alexander Prokhorov dans sa « brève histoire du cinéma soviétiquepour enfants et adolescents5 ». La fin de la NEP en 1928 mit fin à l’importation de filmsétrangers, libérant le cinéma soviétique de toute compétition – et donc de touteconsidération commerciale6.
5 En 1934, lors du premier congrès des écrivains soviétiques, Samouil Marchak et MaximeGorki insistèrent sur l’importance de la littérature pour enfants dans la création dunouvel homme soviétique, et en 1936, le Sovnarkom, la plus haute autoritégouvernementale, établit deux nouveaux studios sur la base de l’ancien Mejrabpomfilm :Soïuzdetfilm, pour les films pour enfants, et Soïuzmultfilm, pour les dessins animés. C’estdans ce contexte politique et institutionnel que le jeune réalisateur Alexandre Ro’oudécida, pour son premier film en 1937, d’adapter pour le cinéma une fable connue, Parl’ordre du brochet. La réussite de ce film lui permit de produire un conte plus compliquéde point de vue idéologique, Vassilissa la très belle, en 1939, et de devenir en quelquesorte le « père fondateur » du genre du conte cinématographique7. C’est dans ce dernierfilm que Baba Yaga fit son début au cinéma, jouée par un homme – Guéorgui Milliar. Aucours des trente années suivantes, Milliar incarna Baba Yaga dans trois autres films deRo’ou – dans Morozko (1964), Par feu et par flammes (1968) et Cornes d’or (1972).
6 Dans cet article, j’analyse l’évolution du personnage de Baba Yaga dans ces quatre filmsen fonction des changements sociaux et politiques. Quoique conçue par le mêmeréalisateur et incarnée par le même comédien, Baba Yaga n’est pourtant jamais lamême. Elle subit, au fil des années, un processus de domestication progressive : d’uneforce de la nature macabre et intimidante, elle évolue en une vielle coquette, pluscapricieuse que malveillante ; d’une relique du passé, elle devient la mascotte modernede Baba Yaga est contre ! En analysant les choix narratifs et esthétiques responsables decette transformation, nous tâcherons d’analyser le contenu allégorique de chaque filmet de les replacer au sein de leur contexte historique.
1. Baba Yaga à l’époque stalinienne : Vassilissa la Belle(1939)
7 Une adaptation filmique de « La Princesse-grenouille », Vassilissa la Belle [ВасилисаПрекрасная] fut conçue à la fois comme spectacle et comme outil pédagogique. Dans la
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
123
version de Ro’ou, Vassilissa n’est plus princesse et Ivanouchka n’est plus idiot. Les deuxsont travailleurs : diligents, intelligents et honnêtes. Les frères d’Ivanouchka et lesépouses qu’ils se trouvent – une aristocrate farfelue et une fille de négociant gloutonne– leur servent de faire-valoir. Toute la première partie du film met en scène uneallégorie de la lutte des classes. Pendant que les frères attendent d’être servis,Ivanouchka part à la chasse chercher leur dîner. Pendant que les épouses flânent à lamaison, Vassilissa fait sa part du travail, préparant les meules de foin. Lorsque leshommes reviennent, les épouses mentent, évidemment, et s’approprient le travail deVassilissa.
8 Baba Yaga n’apparaît que dans la deuxième partie du film, lorsque les épouses brûlentla peau de grenouille de Vassilissa, et la jeune fille est à nouveau enlevée par ZmeïGorynytch. « Dans le pays du Zmeï, Vassilissa la très belle fut gardée par Baba Yaga »annonce un titre8. Traditionnellement, ce rôle de ravisseur dans les contes est joué parKachtcheï l’Immortel, qui n’apparaît pas dans le film. Néanmoins, comme les deux sontdéfinis ici uniquement par leur fonction dans le schéma narratif du conte, ilss’équivalent. « Kachtcheï est toujours le rival du héros masculin pour la main d’unefemme » explique Andreas Johns, « le plus souvent la fiancée du héros ou sa femme ; àl’occasion, sa mère. Il correspond ainsi à Baba Yaga dans son rôle d’usurpatrice9 ». Dansles deux cas, chez soi ainsi que dans le royaume magique, Ivanouchka et Vassilissadoivent se libérer d’oppresseurs qui usurpent leurs biens et exploitent leur travail.
9 Une lecture marxiste des contes, écrit Jack Zipes, favoriserait une interprétation deBaba Yaga « comme symbolisant le système féodal tout entier, où l’avarice et labrutalité de l’aristocratie sont responsables des conditions de vie difficiles. Le meurtrede la sorcière est la réalisation symbolique de la haine ressentie par les paysans contrel’aristocratie en tant qu’accumulateurs et oppresseurs10 ». Pourtant, dans la Vassilissa deRo’ou, Baba Yaga joue un rôle plus ambiguë. Sa figure maigre et nerveuse et lesguenilles qu’elle porte lui permettent de se camoufler facilement dans la nature. Lacourbure de sa bosse, sa manière de déployer ses bras et jambes imitent les branchesdes arbres et les rochers. Se fondant ainsi dans le paysage, elle peut attaquerIvanouchka sans jamais être vue par lui. Souvent, Ro’ou emploie des superpositionspour permettre à Baba Yaga d’apparaître et de disparaître subitement. Par conséquent,elle paraît souvent à moitié transparente, ce qui suggère qu’elle est une force de lanature voire une personnification de la forêt.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
124
10 La partie « magique » du film joue sur le contraste entre le domaine de Baba Yaga – laforêt, et le domaine du Zmeï – la montagne. Bien que les deux décors soient fortementinfluencés par le cinéma expressionniste allemand (et surtout par les décors du Cabinetdu docteur Caligari, sorti en 1920), les univers qu’il représentent ne pourraient pas êtreplus différents. Le monde de la Yaga est celui de la forêt noire, confuse et menaçante,mais profondément organique et donc humaine. Celui du Zmeï, en revanche, est unmonde industrialisé, géométrique, et aseptisé. Un monde, en quelque sorte post-humain ou dépourvu d’humanité. Un monde fasciste. En effet, le contexte historiquedans lequel Vassilissa fut produit invite à une lecture allégorique. Le pacte germano-soviétique a été signé le 23 août 1939 et le film est sorti le 13 mai 1940, un an avantl’invasion nazie de l’URSS le 22 juin 1941. À l’époque, donc, l’Allemagne n’était pasencore un pays ennemi et il est difficile d’imaginer que le choix de conte de Ro’ou étaitpolitiquement motivé. Le film ne laisse néanmoins planer aucun doute surl’atmosphère tendue de l’époque. Baba Yaga rôde perpétuellement autour de Vassilissa,telle la Mort autour de la Jeune Fille dans les tableaux occidentaux. Ce n’est passimplement la virginité de la Russie – l’intégrité de ses frontières – qui est menacée,c’est sa vie.
11 Vassilissa, fille sage et modeste lorsqu’elle est en liberté se montre fière et insoumise encaptivité. Elle devient ainsi un modèle de résistance qui préfigure les vraies héroïnes dela Seconde Guerre mondiale, telle Zoïa Kosmodemianskaïa, canonisée par LeoArnchtam dans le film éponyme de 1944. Tout comme Zoïa, Vassilissa se montre prête àse sacrifier pour le bien des autres et pour ses principes. « Où se cache-t-il ? » demandeBaba Yaga à Vassilissa lorsqu’elle découvre le chapeau d’Ivanouchka à l’intérieur del’isba. « Tu ne dis rien ? Si tu ne le dis pas, je trouverai une manière de te faire parler. Sice n’est pas moi, peut être le feu te déliera la langue11 ». Vassilissa n’est sauvée de latorture que par l’arrivée de Zmeï Gorynytch à la dernière minute.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
125
12 L’analogie entre le monstre et l’envahisseur étranger est renforcée par le troisièmeciné-conte réalisé par Ro’ou, Kachtcheï. Filmé dans l’Altaï et au Tadjikistan en 1944 etsorti le jour de la victoire le 9 mai 1945, le film raconte « comment Kachtcheïl’Immortel tomba sur la Russie comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, brûlanos maisons et notre pain, dévasta la population et enleva des milliers de femmes12 ».Même si les faits historiques ne nous permettent pas de lire Vassilissa comme unesimple allégorie de la guerre à venir, la possibilité d’un conflit imminent planeindubitablement sur les images. Il est lisible dans la présentation de Vassilissa commeun modèle de résistance ainsi que dans l’exaltation des éléments de la culture populaire– et donc essentiellement russe. Le film est encadré par un prologue dans lequel troisbardes introduisent le conte à la musique des gousli, instrument traditionnel. LorsqueIvanouchka part à la recherche de Vassilissa, le texte souligne qu’il « erra longtempsdans sa terre natale13 » (italiques d’auteur). Même la typographie utilisée pour le titragerappelle celle des livres médiévaux.
13 Tous ces éléments contribuent à forger un nouveau vocabulaire nationaliste – et donc àunir le peuple menacé par une force extérieure. Comme l’explique Prokhorov, « Lesfilms de Ro’ou, tout comme les comédies musicales de kolkhoz d’Ivan Pyr’ev, répondaientà la demande officielle d’art inspiré par narodnost’ [l’esprit populaire] », un art qui« permettait à la communauté soviétique entière de rester en contact avec l’espritpopulaire en tant que source métaphysique de la force communautaire14 ».L’internationalisme des premières années de l’URSS cédait devant cette visionromantique et profondément essentialiste de la nation.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
126
2. Baba Yaga à l’époque du dégel : Morozko (1964), Parfeu et par flammes (1968) et Cornes d’or (1972)
14 La période qui suivit la guerre fut à nouveau une période difficile pour le conte et pourceux qui étudiaient la culture populaire. « Après la guerre, les folkloristes russesdevaient passer par une nouvelle période de tribulations, peut-être la plus difficile àsubir », écrit Félix Oinas. « L’époque de la dictature idéologique de Jdanov, surnomméeJdanovchtchina, qui commença en 1946, devint vite une chasse aux sorcières anti-occidentale à grande échelle15 ». Vladimir Propp, qui venait de publier Les Racineshistoriques du conte merveilleux, fut critiqué pour ses nombreuses citations de folkloristesoccidentaux et ses idées comparativistes voire cosmopolites. En 1947, Soïuzdetfilm futréorganisé et devint le studio Gorki : le studio n’a alors pas de mandat particulierl’incitant à produire des films pour enfants16. En 1952, la situation amène ConstantinSimonov et Fedor Parfenov à publier une lettre ouverte dans La Gazette littéraire[Literaturnaïa gazeta] sous le titre « Ressusciter le cinématographe pour enfant ».Pourtant, ce n’est qu’en 1957, après la mort de Staline et la succession deKhrouchtchev, que le ministère de la culture commande enfin une augmentation de laproduction de films pour enfant. En 1961 le studio Gorki fut ainsi renommé « Studiocentral Gorki de cinéma pour enfants et jeunes »17.
15 Lorsque Ro’ou produisit Morozko [Морозко] en 1964, ce fut donc dans des conditions à lafois très différentes et paradoxalement similaires à celles dans lesquelles Vassilissa laBelle fut produit. La première nouveauté marquante est l’usage de la couleur. L’actiondramatique de la deuxième partie du conte se déroule en hiver, ce qui donne unepalette assez restreinte, ponctuée partout, même dans le maquillage et les costumes desprotagonistes, par le rouge et le bleu pâle de la peinture russe traditionnelle.L’apparition de la couleur rajeunit Baba Yaga et la rend plus visible dans le paysage –sans pour autant la rendre plus énergique. Lorsqu’Ivan découvre l’isba en plein milieude la forêt – et que celle-ci obéit à l’injonction qu’il a sans doute apprise enfant de semettre face à lui, dos à la forêt, Ivan paraît sincèrement surpris. Baba Yaga, pour sapart, émerge en bâillant et demande, grincheuse : « Qu’est-ce que tu veux ? Pourquoi,inattendu, inappelé, tu as osé tourner la cabane, réveiller la vieillarde18 ? ».
16 Il apparaît alors comme si chacun se trouvait plongé dans le conte contre son gré. Si laYaga de Vassilissa sautait d’arbre en arbre, la Yaga de Morozko se plaint d’un lumbagoqui l’empêche de se déplacer et prie Ivanouchka de partir. Elle ne pratique sa magie quelorsque l’insistance d’Ivanouchka l’y force et son discours est parsemé des diminutifsaffectifs se terminant en – tchik [голубчик/ супчик/ тулупчик]. Ivanouchka en fin decompte n’a plus tant besoin de vaincre Baba Yaga que de la con-vaincre de l’aider.L’équivalent masculin de Baba Yaga, Morozko (le Général Hiver) s’avère en réalité êtreaussi inoffensif qu’elle. Lorsqu’il voit Nasten’ka, abandonnée par sa famille sur le pointde mourir de froid dans la forêt, son premier instinct est de lui venir en aide. Le rôlejoué par les deux personnages magiques – Morozko et Baba Yaga – dans la vie des deuxjeunes protagonistes s’apparente ainsi à celui d’un parrain ou d’une marraine.L’équivalence de ces deux relations est soulignée par une séquence au montageparallèle qui montre Morozko et Baba Yaga habillant Nasten’ka et Ivanouchka envêtements chauds. Elle est aussi indiquée linguistiquement par les noms employés parNasten’ka et Ivanouchka en parlant à leurs bienfaiteurs. Baba Yaga devient, pourIvanouchka, Yagusia ou Babulia-yagulia, tandis que Nastenka appelle Morozko avec
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
127
beaucoup d’affection Morozouchka-batiouchka. De vilains, Morozko et Baba Yaga sontdonc transformés en Donateurs d’après le schéma proposé par Vladimir Propp (1970).
17 La plus importante conséquence de cette transformation est le déplacement de lasource du Mal. Il ne provient plus de ce qui est surnaturel, mais plutôt de ce qui est tropnaturel : les défauts des êtres humains ordinaires. Ce sont la jalousie de la belle-mère deNasten’ka et la vantardise d’Ivanouchka qui sont responsables de leur séparationinitiale et du déséquilibre auquel Baba Yaga et Morozko cherchent à remédier. Lesqualités prêchées par Morozko ne sont pas très différentes de celles glorifiées parVassilissa la Belle : l’industrie, la modestie, l’intelligence. Ce qui est différent, ce sont lesenjeux. La gravité de Vassilissa la Belle n’est plus là dans Morozko. Les personnagespeuvent se permettre d’être drôles, légers. Les tentatives de Ro’ou dans Vassilissad’animer la culture visuelle populaire, héritée du loubok et des livres illustrés,deviennent dans Morozko un grand spectacle, une surface lisse sans profondeur.Lorsqu’Ivanouchka quitte sa maison natale pour aller chercher sa fortune il passedevant nombre de jeunes filles qui se mettent à danser et à chanter en le voyant. Lesdanses et les chants sont traditionnels, mais l’esthétique est plus proche de celle d’unecomédie musicale en technicolor que d’une fantaisie médiévaliste.
18 Par feu et par flammes [Огонь, вода и медные трубы], tourné par Ro’ou quatre ans plustard en 1968, va encore plus dans la direction du spectacle que le film précédent.Caractérisé par des couleurs saturées et des explosions spontanées de musique et dedanse, le film vise plus la variété audiovisuelle que la cohérence stylistique. Cettevoracité se manifeste également au niveau narratif : tandis que Morozko réunissait deuxcontes distincts – « Morozko » et « Ivan à la tête d’ours », Par feu et par flammes présenteau spectateur un remix d’éléments issus des contes, mythes et légendes de plusieurscultures. Le squelette de l’intrigue reste le même : comme d’habitude, Kachtcheï enlèvela bien-aimée d’Ivanouchka, qui doit passer par plusieurs épreuves avant de laretrouver. Ces épreuves – symbolisées par le feu, l’eau, et le cuivre du titre – présententautant d’occasions d’introduire les éléments hétérogènes tels les philosophes grecs oule dieu Neptune.
19 Dans ce film, Ro’ou modifie la structure traditionnelle de ses ciné-contes d’une autremanière : au lieu de commencer avec le drame humain qui met en action le récit, ilcommence par une présentation des êtres magiques. C’est dans ce « prologue » quel’humanisation de Baba Yaga est achevée : elle devient mère et donc un être capabled’éprouver de l’empathie et du chagrin. Le film s’ouvre avec Baba Yaga en plein ciel, seprécipitant aux noces de sa fille et de Kachtcheï l’Immortel (joué également parMilliar). Au moment de son arrivée, elle subit deux humiliations. D’abord, elle n’arrivepas à bien atterrir, ce qui implique que sa motricité n’est plus ce qu’elle était autrefois.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
128
Ensuite, elle n’est reconnue par personne à la cour à part par sa fille et par Kachtcheï. Ilest révélateur qu’elle choisisse dans ce contexte de s’introduire non pas en tant queBaba Yaga mais en tant que parente du couple heureux : « Je suis la mère de la fiancée,Kachtcheï l’Immortel est mon beau-fils », proclame-t-elle joyeusement dans uneformule qui rime en russe19.
20 Cet image de Baba Yaga en tant que mère n’est pas sans précédent : dans « Baba Yaga etgringalet » Afanassiev raconte le malheur de quarante et une filles de Baba Yaga,mortes de sa propre main. Dans le film de Ro’ou l’incapacité physique de Baba Yaga(elle manie mal son mortier, tombe chaque fois qu’elle danse), ainsi que sa maternité,prennent une nouvelle importance : elles suggèrent que la vie de la sorcière peut avoirune dimension temporelle différenciée. En d’autres termes, elles impliquent que BabaYaga n’ait pas toujours été la même ; qu’elle aussi a vécu une période de jeunesse et unepériode de vieillissement – et donc que sa vie peut avoir un début et un fin, comme lavie de tout être mortel.
21 Le prologue qui met en scène la maternité de Baba Yaga sert également un butparticulier dans l’économie narrative du film : il fournit des éléments d’explication à labonne volonté dont elle témoignera envers Vasia (le nouveau nom d’Ivanouchka) plustard. Rajeuni par une pomme magique offerte par Zmeï Gorynytch comme cadeau denoces, Kachtcheï renvoie sa fiancée, maintenant plus vieille, l’humiliant devant toute sacour. En aidant Vasia à vaincre Kachtcheï et à libérer sa bien-aimée, Alionouchka, BabaYaga réussit donc à venger sa propre fille. Elle a autant besoin de Vasia que Vasia abesoin d’elle.
22 Cornes d’or [Золотые рога], réalisé en 1972 – trente-trois ans après Vassilissa la Belle, futle dernier film de Ro’ou à prendre pour motif le mythe de Baba Yaga. Reléguée auxrôles secondaires dans Morozko et Par feu et par flammes, elle y assume à nouveau la placed’honneur. Reine de la forêt, elle n’a pas de rival – à part le cerf à cornes d’or, qui, seplaint-elle à quelques chasseurs, défait tous ses pièges et ruine tous ses projets. Sonlumbago ne la trouble plus, et elle se trouve en assez bonne santé pour chanter etdanser.
23 En effet, au cours du film elle insiste à plusieurs reprises sur le fait qu’elle est toujoursjeune. Le début du conte la présente en train de jouer aux cartes avec son ami Duraleï.Lorsqu’il l’accuse de tricher en l’appelant une « vieille peau », elle le chasse de l’isba20.« Et il ose encore m’appeler “vieille peau” – moi, de qui tout le monde dit que j’ai uneâme jeune ! » se plaint-elle. La Baba Yaga de Cornes d’or n’est pas donc tant méchanteque vaniteuse : une vieille coquette qui passe des heures devant sa glace. Les troisjeunes lechiï qui la servent flirtent constamment avec elle et l’appellent en chantant parle diminutif Babou-yagusen’ka. Et elle flirte à son tour avec le groupe des chasseurs-
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
129
bandits qui poursuivent Cornes d’or. Baba Yaga a même un numéro musical au coursduquel elle transforme son miroir à main en guitare et chante « Je ne peux pas la voirassez, Yaga la Belle / Ô mon amour – moi, moi, moi21 ! »
24 Au delà des changements apportés à l’image même de Baba Yaga, Cornes d’or diffère desfilms précédents par deux aspects importants. Le premier est lié à la question durapport des sexes. Dans Cornes d’or, ce n’est plus un jeune homme qui part sauver sabien-aimée des mains de Baba Yaga ou de Kachtcheï : c’est une mère, Evdokia, qui partsauver ses enfants. Le conflit final est donc un conflit entre deux femmes – l’une mèreet l’autre, la Yaga, vieille fille. Par conséquent, les valeurs véhiculées par le film sontdes valeurs plus conservatrices que dans les trois films précédents. Le chant des jeunesfilles dans le prologue du film, avant les titres, compare la Russie à une mère.« Toujours joyeuse et un peu triste / Telle est la Russie, ma mère », chantent-elles.« Comme le conte, intemporel et gentil / Telle est la Russie, ma mère22 ». C’est aussi laterre russe au sens propre qui protège Evdokia dans son combat final avec Baba Yaga.Voyant cette dernière s’armer, Evdokia se souvient du petit sac de terre qu’une voisinelui avait offert à son départ. « Terre natale, protège-moi ! » crie-t-elle en lançant lecontenu du sac dans la direction de Baba Yaga23. Ces deux séquences insistent sur lecaractère sacré de la terre russe, « mère » du peuple, et de la maternité en tant quetelle. Le film laisse indubitablement l’impression que c’est sa maternité qui rendEvdokia invincible, et sa coquetterie (le mauvais usage du sexe) qui condamne BabaYaga.
25 L’absence mystérieuse du père de famille contribue au glissement politique du film versdes valeurs plus conservatrices. Il est possible de lire Evdokia comme une figureféministe. Elle est indépendante, et part à la recherche de ses deux filles sans crainte.Elle est intelligente et forte : elle n’est même pas choquée lorsqu’elle découvre qu’elledevra combattre Baba Yaga dans un duel à l’épée. Pourtant, elle est continuellementguidée et assistée par des figures masculines en position d’autorité : le Soleil, le Vent,et, finalement, Cornes d’or. Ainsi, Cornes d’or fournit l’exemple parfait à la théoriearticulée par Evgueni Margolit et résumée par Prokhorov : « Le cinéma soviétiquearticulait la communauté idéale de l’avenir comme un pays d’enfants avec legouvernement dans le rôle du père autoritaire du peuple24 ». Mère par excellence,Evdokia se trouve donc elle-même infantilisée par ces remplaçants du Père.
26 En définitive, le film propose une définition originale de l’action politique. Comme laplupart des contes, le film s’ouvre avec une transgression : les filles jumelles d’Evdokia,Machen’ka et Dachen’ka, désobéissent aux instructions de leur mère et partent troploin dans la forêt. Ce qu’elles ne peuvent pas savoir, c’est que les deux esprits malinsqui les piègent se servent d’elles pour mettre feu à une révolte populaire contre ladomination de Baba Yaga. Le film se clôt avec un tribunal des petits enfants-espritsforestiers avec l’ancien ami de Baba Yaga, Duraleï, à la barre. Par un vote populaire, ilsdécident de punir Baba Yaga en la séquestrant dans le marais. Les évènements du récitse déroulent donc dans un cadre beaucoup plus grand que celui que l’on peutapercevoir au début du film : ils représentent une renégociation des rapports dupouvoir au sein de la forêt, et le triomphe du peuple simple sur la monarchie.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
130
Conclusion
27 Dans Vassilissa la Belle (1939), réalisé avant la guerre, Ro’ou tente pour la première foisde donner une forme cinématographique au monde du conte populaire. Tirant sur lefond iconographique du loubok, du livre illustré, et de l’expressionisme allemand, il créeun univers clair-obscur avec des personnages explicitement connotés comme étant« bons » ou « mauvais ». Baba Yaga, dans cet univers, comme dans celui des contes,selon l’interprétation de Propp, devient un personnage liminal, la gardienne de lafrontière entre le connu et l’inconnu. Souvent indiscernable de la forêt et des rochersqui entourent son isba, elle personnifie le côté sombre de la nature. Dans un film dontle but est d’enrichir le vocabulaire nationaliste d’un pays menacé par une forceextérieure, Baba Yaga devient une figure problématique, connotée à la fois commel’une des « nôtres » puisqu’issue du folklore slave, et non l’une des « nôtres »puisqu’imprévisible et hostile.
28 Les trois films réalisés par Ro’ou en succession rapide pendant la période dite du« Dégel » œuvrent à domestiquer la Baba Yaga de Vassilissa en en faisant une satire, àlui enlever ses crocs en la faisant rire. Quoiqu’ils continuent à nourrir le fond d’imagesdu nationalisme russe et à maintenir l’autorité de l’État, ils visent plus le spectacle quela communion mystique avec l’âme du peuple. En dotant Baba Yaga d’une biographie –d’enfants, d’intérêts romantiques, de désirs pour les vêtements et autres produits deconsommation – ces films l’arrachent au monde mythologique pour lui accorder uneplace dans notre contemporanéité. C’est ainsi qu’elle devient, à l’époque des Jeuxolympiques de 1980, une figure culte, concurrente légitime de l’ourson Micha pour letitre de mascotte de l’URSS.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
131
BIBLIOGRAPHIE
Balina, Marina et Rudova, Larissa (éd.), Russian Children’s Literature and Culture, New York etLondres, Routledge, 2008.
Dobrenko, Evgenii et Savage, Jesse, The Making of the State Reader, Social and Aesthetic Contexts of theReception of Soviet Literature, Stanford, Stanford University Press, 1997.
Johns, Andreas, Baba Yaga, The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folktale, New York, PeterLang, 2004.
Kabakova, Galina, « Les contes vus par le cinéma soviétique (années 1930-1950) », ILCEA, Revue del’Institut des langues et cultures d’Europe et d’Amérique, http : //ilcea.revues.org/2725
Kenez, Peter, Cinema and Soviet Society, From the Revolution to the Death of Stalin, Londres, I.B. Tauris,2001.
Margolit, Evgenii, « Prizrak svobody : strana detei », Isskustvo kino, no 8, 2002, http : //www.kinoart.ru/magazine/08-2002/review/margolit
Miloserdova, Natalia, « Detskoe kino » in Lioudmila M. Budiak (éd.), Istorïa otechestvennogo kino,vol. 2, Moscou, Materik, 2006, p. 6-133.
Nusinova, Natalia, « Teper’ ty nasha. Rebenok v sovetskom kino. 20-30ye gody », Isskustvo kino, no 12,2003, http : //www.kinoart.ru/magazine/122003/analysis0312/nusinova0312/
Oinas, Felix J., « Folklore and Politics in the Soviet Union », Slavic Review, vol. 32, no 1, mars 1973,p. 45-58.
—, « The Political Uses and Themes of Folklore in the Soviet Union », in Felix J. Oinas (éd.), Folklore, Nationalism, and Politics, Columbus, Slavica Publishers, Inc., 1978, p. 77-79.
Prokhorov, Alexandre, « Arresting Development : A Brief History of Soviet Cinema for Childrenand Adolescents » in M. Balina, et L. Rudova (éd.), Russian Children’s Literature and Culture.
Zipes, Jack, Breaking the Magic Spell, Radical Theories of Folk & Fairy Tales, Lexington, UniversityPress of Kentucky, 1979.
—, The Enchanted Screen, The Unknown History of Fairy-Tale Films, New York et Londres, Routledge,2011.
NOTES1. G. Kabakova, « Les contes vus par le cinéma soviétique (années 1930-1950) ».2. M. Balina et L. Rudova (éd.), Russian Children’s Literature and Culture, p. 7; E. Dobrenko etJ. Savage, The Making of the State Reader, Social and Aesthetic Contexts of the Reception of SovietLiterature, p. 173. Original en anglais : « In 1924, she prepared an influential manual that requiredthe reevaluation of all books kept in public libraries, especially children’s sections. Shedemanded the removal of books with “wrong emotional” and ideological influences’ as well as ofbooks “that do not satisfy new pedagogical approaches” ». Dorénavant, toutes les traductions del’anglais et du russe sont les traductions de l’auteur, sauf si autrement signalé.3. F. J. Oinas, « The Political Uses and Themes of Folklore in the Soviet Union », p. 97.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
132
4. Ibid., p. 77. Il faut noter que lorsque Krupskaïa attaqua les contes littéraires de KorneïTchuikovski dans la Pravda en 1929, c’était aussi en les qualifiant de « désordre bourgeois »[bourjouaznaïa mut’] (M. Balina, op. cit., p. 7).5. A. Prokhorov, « Arresting Development: A Brief History of Soviet Cinema for Children andAdolescents », p. 153. Original en anglais: « Stalinist cultural administrators changed the officialline on folk culture, and the fairy tale became the legitimate film genre because it helped tovisualize Stanilinist culture’s spirit of miraculous reality. »6. N. Nusinova, « Teper’ ty nasha. Rebenok v sovetskom kino. 20-30ye gody » et N. Miloserdova, « Detskoe kino ».7. Ro’ou n’était pas, bien sûr, le seul à travailler ce genre. Son plus grand « compétiteur » étaitAlexandre Ptouchko, qui fît son début deux ans plus tôt en 1935, avec Le Nouveau Gulliver, uneadaptation soviétique du livre de Jonathan Swift. Au cours de sa longue carrière, Ptouchkocontinua à produire des contes dits « littéraires » tandis que Ro’ou se concentra principalementsur les contes populaires.8. Original en russe : « В царстве Змея, стерегла Василису Прекрасную Баба-Яга ».9. A. Johns, Baba Yaga, The Ambiguous Mother and Witch of the Russian Folktale, p. 231. Original enanglais: « Koshchei is consistenly the male hero’s rival for a woman, most often the hero’s fiancéeor wife, sometimes his mother. He corresponds to Baba Yaga in her role of usurper ».10. J. Zipes, Breaking the Magic Spell,…, p. 32. Original en anglais : « witch {as parasite} could beinterpreted here to symbolize the entire feudal system or the greed and brutality of thearistocracy, responsible for the difficult conditions. The killing of the witch is symbolically therealization of the hatred which the peasantry felt for the aristocracy as hoarders andoppressors ».11. Original en russe : « Где он прячется ? Молчишь ? Не скажешь, выпытаю ! Не я так огонь языкразвяжет ».12. Original en russe : « Kак гром с ясного неба упал на Русь Кощей Бессмертный, поджег нашидома и хлеба, людей повырубил и жен живыми угнал многие тысячи », traduction libre de labande-annonce du film.13. Original en russe : « Долго шёл Иван по родной земле… ».14. A. Prokhorov, op. cit., p. 137. Original en anglais: « Rou’s pictures, together with Ivan Py’ev’skolkhoz musicals, provided the essential artistic output in response to the official demand for art inspiredby narodnost’ (popular spirit),” an art that “allowed the entire Soviet community to keep in touch with thepopular spirit as the metaphysical source of communal strength. »15. F. Oinas, « Folklore and Politics in the Soviet Union », p. 56. Original en anglais: « After the warRussian folklorists had to go through another period of tribulation, perhaps the hardest one to endure. Theera of the ideological dictatorship of Zhdanov, the so-called Zhdanovshchina, which began in 1946, soondeveloped into a full-scale anti-West witch hunt. »16. A. Prokhorov, op. cit., p. 140.17. Ibid., p. 131.18. Original en russe : « Чего надо ? Чего, не ждан, не зван, повернул избушку, разбудилстарушку ? »19. Original en russe : « Я невестина мать, мне кощей-бессмертный – зять ».20. Original en russe : « старая карга ».21. Original en russe : « На красавицу-Ягу, наглядеться не могу / Ох любимая моя – я, я, я ! »22. Original en russe : « Всегда весёлая и чуть печальная / Россия, матушка моя [..] И словносказка, вечная и добрая / Россия матушка моя »23. Original en russe : « Земля родная, защити ! »24. A..Prokhorov, op. cit., p. 129. Original en anglais: « Soviet children’s cinema articulated the idealcommunity of the future as a land of children with the government as the people’s authoritatian father. »
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
133
Résumé d’argument articulé par Evgenii Margolit dans « Prizrak svobody : strana detei ». Isskustvokino, no 8, 2002.
RÉSUMÉSDe facto banni de l’URSS dès sa création, le conte réapparaît à la fin des années trente avec leresurgissement du nationalisme russe face à la menace nazie. C’est dans ce cadre politique que lejeune réalisateur Alexandre Ro’ou fait de Baba Yaga un personnage cinématographique dansVassilissa la très belle (1939) . Cet article analyse l’évolution de ce personnage en fonction deschangements sociaux et politiques à travers quatre films de Ro’ou : Vassilissa (1939), Morozko(1964), Par feu et par flammes (1968) et Cornes d’or (1972). Prenant en compte les différentscontextes de production, l’article vise à cerner le contenu allégorique de chaque film et à lemettre en rapport avec les dynamiques historiques.
Banished from the Soviet Union since its creation, the folk tale reappeared at the end of the1930s in the wave of Russian nationalism engendered by the Nazi menace. In 1939, the youngfilmmaker Alexandre Rou (Rowe) transformed the Baba Yaga of children’s stories into acinematic character in Vassilissa the Beautiful. This article analyzes the evolution of Baba Yaga’sportrayal in relation to social and political changes across four films by Rou: the aforementionedVassilissa the Beautiful (1939), Jack Frost (1964), Fire, Water, and Brass Pipes (1968), and Golden Horns(1972). Taking into account the different production contexts, the article attempts to unpack theallegorical content of each film and define its relation to broader historical dynamics.
INDEX
Mots-clés : cinéma soviétique, film pour enfants, Soyuzdetfilm/studio Gorki, nationalisme etconte de fées, Baba YagaKeywords : soviet cinema, children’s cinema, Gorki studio/ Soyuzdetfilm, fairy tales andnationalism, Baba Yaga
AUTEUR
MASHA SHPOLBERG
Doctorante en cotutelle à l’École normale supérieure (laboratoire THALIM) et Yale University,Masha Shpolberg se spécialise dans les cinémas d’Europe de l’Est ainsi que dans l’évolution destechnologies et conventions sonores dans le cinéma documentaire. [email protected] ses publications:« The din of gunfire: Rethinking the role of sound in World War II newsreels », NECSUS, EuropeanJournal of Media Studies [En ligne], Amsterdam University Press, Automne 2014. URL stable: < http://www.necsus-ejms.org/din-gunfire-rethinking-role-sound-world-war-ii-newsreels/>
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
134
Le double jeu de la Baba Yaga : effetspsychiqueset socioculturels d’une performancethéâtrale contemporaineSibylle Lesourd
1 En 1994, la compagnie des Briciole de Parme, une troupe majeure du théâtre italienpour le jeune public, a créé le spectacle La Poupée dans la poche d’après le conte russeVassilissa la Belle. Or le désir de communication avec l’enfant spectateur, au cœur de larecherche artistique des Briciole, a conduit à faire du conte le lieu d’une expérienceactive : la Baba Yaga, incarnée par une comédienne seule en scène, choisit une enfantparmi le public pour qu’elle joue le rôle de Vassilissa. Ce phénomène, dépassantlargement le cadre de la participation traditionnelle, est une véritable capturescénique. En faisant éprouver aux jeunes spectateurs l’ambivalence de la Yaga, lacomédienne va permettre à l’enfant capturée de vivre sous nos yeux une expérienceinitiatique.
2 La dramaturgie du spectacle repose tout entière sur la technique théâtrale de lacomédienne, exigeante et atypique, dans la mesure où elle comporte une dimensionaléatoire et néanmoins maîtrisée. Flavia Armenzoni, créatrice du rôle de la Baba Yaga,l’a joué plusieurs centaines de fois puisque La Poupée dans la poche voyage depuis vingtans à travers l’Europe et le monde. Cette artiste pionnière du théâtre pour l’enfancenous a fait part de son expérience en novembre 2011, au Teatro al Parco de Parme.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
135
Illustration 1 – La Poupée dans la poche (affiche du spectacle).
Entretien avec Flavia Armenzoni
3 Comment est née l’idée de ce spectacle ?
4 À cette époque, j’avais envie de monter une « petite forme1 » et de la jouer seulementdans les environs, sans envisager de tournée à l’étranger. En effet je revenais tout justed’une tournée très éprouvante en France où j’avais emmené mon enfant tout petit.Avec la metteuse en scène Letizia Quintavalla, nous avons eu l’idée d’aller dans lesécoles maternelles pour nous adresser aux très jeunes enfants. Nous voulions travaillersur le petit, dans une recherche de simplicité absolue. En ce qui concerne le contenu duspectacle, nous recherchions une matière narrative car depuis quelques années lacompagnie des Briciole avait pris l’habitude de monter des spectacles de narration2 quiavaient beaucoup de succès. Un jour, Letizia a découvert un livre qui faisait beaucoupparler de lui en Italie : Femmes qui courent avec les loups, de Clarissa Pinkola Estés3.C’est un livre de psychologie très simple, qui ne recevrait pas une grande considérationdes puristes, mais qui à nos yeux est de grande valeur. L’auteure y reprend les contesdans leur structure archaïque ; ce sont des contes qui concernent les femmes. Ainsil’histoire de Vassilissa que je raconte n’est pas celle d’Afanassiev, elle est différente :par exemple il n’y a pas la fin heureuse, Vassilissa ne se marie pas. À l’époqued’Afanassiev, les contes devaient nécessairement finir bien, avec le mariage et lesenfants. Nous avons préféré prendre l’histoire du livre de Pinkola Estés, sans nouspriver de confronter les deux versions.
5 D’où est venue l’idée de faire intervenir une enfant du public ?
6 Cette idée est née un peu par hasard, ou plutôt par nécessité. Vois-tu, nous étions deuxà travailler sur le spectacle, Letizia Quintavalla et moi. Or la protagoniste du conte était
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
136
une enfant. Et nous détestons mettre en scène des protagonistes enfants. Les adultesqui jouent des enfants… ce n’est pas que nous ne l’ayons jamais fait, mais… c’esttoujours quelque chose d’un peu étrange. Il nous fallait donc raconter l’histoire d’uneprotagoniste que nous ne pouvions pas incarner nous-mêmes : elle pouvait être prisedans le public ! Et du coup, la fonction de mon personnage serait de l’inciter à l’action.C’est sur cette base qu’on a commencé à travailler. Le plus difficile était qu’il me fallaitrépéter sans la protagoniste de l’histoire ! Parce que quand une enfant a joué une foisavec moi, elle ne peut plus le refaire, puisqu’il faut nécessairement qu’elle découvre leschoses au fur et à mesure. Alors il fallait à chaque fois répéter avec quelqu’un dedifférent.
7 Vous n’avez jamais pensé à faire intervenir une enfant comédienne ?
8 Non, jamais. L’idée fondamentale était que l’enfant est la Vie, et que moi je suis leThéâtre. Si on fait intervenir une enfant comédienne, on perd cette idée. Nous nousappuyions à la fois sur ce présupposé théorique et sur notre connaissance des enfants.Nous savons bien qu’un enfant qui joue la comédie peut être la chose la moins théâtralequi soit. Au contraire nous voulions utiliser la spontanéité, la surprise, la vie au pleinsens du terme.
9 Quelles ont été les étapes de création du spectacle ?
10 En fait nous avons commencé à jouer presque tout de suite, après un très petit nombrede répétitions. Il n’y avait pas encore de texte, j’étais dans l’improvisation. J’avaisseulement la poupée, dont je ne savais pas encore très bien quoi faire. Avant d’arriver àsavoir comment mener ce spectacle, nous avons fait de nombreuses tentatives, mêmeerronées. Une fois on est allées dans une école et j’ai joué la sorcière d’une façonhorriblement méchante ; ensuite, je changeais de ton et je faisais la poupée4. La petitefille ne comprenait plus rien du tout. Elle n’était pas en mesure de comprendre undegré de fiction aussi avancé, surtout dans une école où il n’y avait aucun dispositif deson, de lumière… La pauvre enfant, je pense que je l’ai traumatisée pour toute sa vie.Maintenant, les choses sont pensées dans les moindres détails. Les lumières ne doiventêtre ni trop faibles, ni trop fortes. Il y a un jeu sur trois couleurs – le blanc, le rouge, lenoir – et il faut que ce soit toujours ces couleurs-là. La taille des objets est aussi trèsétudiée. Tout cela est essentiel pour pouvoir créer une fiction qui ne fasse pas trop peurmais qui ne donne pas non plus trop confiance. C’est un savant équilibre qui doit êtremaintenu pendant toute la représentation.
11 Comment es-tu parvenue, peu à peu, à maîtriser ce spectacle ?
12 Je dois dire que je n’avais pas du tout conscience de l’importance que prendrait cespectacle. Au tout début, on était beaucoup plus proches de l’animation que du théâtre :on recherchait surtout un rapport direct avec les enfants. Mais aujourd’hui, ce n’estplus de l’animation, c’est vraiment du théâtre : le public – parmi lequel se trouve laprotagoniste – est emporté dans une fiction théâtrale très forte. Et puis maintenantnous sommes très pointilleux sur le nombre de spectateurs, et nous écrivons une lettreaux enseignants pour expliquer qu’il faut au moins une classe d’enfants de cinq ans(parmi lesquels on choisit Vassilissa), il y a tout un règlement pour accueillir lespectacle. Parce que s’il n’y a que des enfants de trois ans, il est impossible de jouer !Nous sommes devenus terribles sur le plan contractuel. Au début on ne prenait pastoutes ces précautions. Elles sont le fruit de toutes mes expériences…
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
137
13 Lorsque tu partages la scène avec une enfant du public, est-ce que ton jeu est différent del’habitude ?
14 Quand le brouillard s’est estompé dans ma tête, j’ai compris que le plus difficile seraitde comprendre l’équilibre de la Baba Yaga. En effet, si elle est trop méchante, cela nemarche pas. C’est pour cela que doit s’établir un rapport subtil entre elle et la poupée :quand la figure du Bien apparaît, il est nécessaire que la figure du Mal disparaissecomplètement. Mais si elle est trop gentille, cela crée d’autres difficultés. Pendant unecertaine période, on a tenté une chose : je devais faire le clown, avec des chutes et desdrôleries diverses. Mais comme cela faisait rire, cela ne faisait plus peur. Alors çan’allait pas. Le danger d’un tel spectacle, c’est que le public peut décider de te manger.Il faut gérer le public, parce qu’il faut que ce soit du théâtre, que ce soit sacré, d’unecertaine façon. Quand le public est si proche de toi, en plus, ça fonctionne un peucomme le squash : la balle te revient avec la même intensité que celle que tu as misedans la frappe. Si tu parles trop fort, ils parlent trop fort. Je ne devais pas êtreseulement actrice, mais aussi éducatrice d’un comportement et d’un rituel.
15 J’ai compris peu à peu que pour être bonne, il faut se faire oublier. Toute taconcentration doit être mobilisée pour guider la petite fille, pour lui faire vivre cetteexpérience. Si ton regard abandonne la petite fille, elle ne devient plus rien. Ça, c’estune règle théâtrale : la petite fille n’est pas une actrice. Un acteur est capable demaintenir l’attention même s’il n’est pas protagoniste ; une petite fille, non. C’est pourcela que tous les mouvements de Vassilissa sont chorégraphiques, dans le spectacle. Ilfallait trouver une astuce pour la faire évoluer en permanence devant le public. Illustration 2 – La pantomime de Vassilissa.
16 Pour pouvoir la maintenir active, théâtrale. Pour qu’elle puisse inventer et pour que lepublic puisse s’apercevoir que c’est elle qui invente. J’ai été impitoyable avec Laura5,l’actrice qui m’a remplacée pour faire le spectacle. Quand elle faisait la danse du feu,elle se laissait aller, les yeux fermés. Je lui ai dit : non ! Ce n’est pas comme cela qu’ilfaut le faire, parce que si tu fermes les yeux, la petite disparaît. Si au contraire tu fixes
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
138
intensément la petite fille, alors il peut arriver qu’elle danse avec toi. Tu dois être unecomplice. Évidemment, les actrices ont la tentation de jouer. Alors que tu es meilleuresi tu ne joues pas trop : tu es actrice, éducatrice et aussi metteuse en scène de ce quiarrive.
17 Comment choisis-tu, à chaque fois, la fillette qui va jouer Vassilissa ?
18 L’expérience que nous avons faite au début a été de demander aux institutrices. Maisaprès quelques représentations, j’ai vu que ce procédé ne marchait pas bien. Moninstinct m’aurait poussé vers d’autres petites filles. J’ai vite compris que les maîtressesindiquaient toujours les premières de la classe, alors que ce ne sont pas forcémentcelles qui ont besoin de cette expérience, qui ont quelque chose à l’intérieur qu’elles neparviennent pas à faire sortir… Et donc ce ne sont pas forcément celles qui se prêtentau jeu de la façon la plus émouvante. J’ai donc changé de méthode. Je me suis ditqu’après tout c’était un spectacle fondé sur l’intuition féminine ; c’est en tout cas ce quedit l’auteure du livre qui nous a inspirées. Alors je me suis dit : je dois me fier à mapoupée dans la poche, me laisser guider par ma propre intuition. Et à partir de là, j’ai eudes expériences grandioses. En fait, toute la première partie du spectacle est prévuepour comprendre qui, dans le public, peut être Vassilissa. Ce n’est pas nécessairementla moins timide, la plus exubérante. Peut-être justement ce sera la plus timide detoutes. L’intuition peut naître d’un geste, d’une question, d’un regard.
19 Nous entrons ici dans la première phase du spectacle… En guise de préambule, tu poses auxenfants rassemblés toute une série de questions.
20 Oui, cette première phase est conçue pour observer les enfants. D’abord je leurdemande un mouchoir. Il faut que je fasse croire à un besoin véritable. C’est une façonde leur dire : j’ai besoin de vous, je suis faible. Les questions, elles, permettent d’étudierle public ; mais elles sont aussi prévues pour faire comprendre aux enfants que ce sonteux, les protagonistes ; et que ce qu’ils font, ce qu’ils disent, est bien, et qu’il n’y aaucun jugement porté sur eux. Il faut entrer dans une relation complètement à égalité.Et puis je ne pose pas des questions normales, celles qu’on poserait habituellement à unenfant de quatre ans. Ce sont même des questions difficiles, philosophiques6, auxquellesils peuvent répondre de manière créative. Dans cette première partie, au moindresourire de la part d’un spectateur adulte, il faut réagir. La plupart du temps il suffitd’un regard et l’adulte, s’il est intelligent, se souvient de nos consignes7 et les respecteparce qu’il comprend quel projet il y a derrière.
21 Pourquoi ensuite racontes-tu en entier l’histoire de Vassilissa ?
22 Parce que si tu sais comment ça va finir, peut-être que tu vas oser monter sur le tapisrouge. Mais si tu te demandes si la sorcière va te manger – et les enfants croientvraiment qu’ils peuvent être mangés – tu n’y vas pas. Donc nous avons fait un travail derésumé pour ne garder que les éléments principaux du conte, en sacrifiant même debeaux passages. L’idée essentielle était de créer un langage commun. Un seul geste doitpouvoir te rappeler un moment précis du conte. C’est pourquoi je raconte l’histoiretrois fois. La première fois avec beaucoup de mots, et en associant des gestes à certainsmots. La deuxième fois il y a moins de mots et je m’appuie sur la gestuelle, enm’assurant que le public a compris les parties essentielles. Et la troisième fois, il nereste que les gestes. En particulier, le geste fondamental. (Elle mime ce geste quiconsiste à nourrir la poupée, de la bouche à la bouche. Un geste primordial etfascinant.)
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
139
23 Lorsqu’arrive la troisième phase du spectacle, celle où intervient la petite fille, comment te sens-tu ?
24 C’est un moment de panique absolue, comme personne ne peut se le représenter.Surtout les premières fois, bien sûr, car même après plusieurs dizaines dereprésentations tu ne peux pas savoir à l’avance si tu vas pouvoir finir le spectacle oupas. Ensuite je suis devenue plus sûre de moi parce que j’étais plus sûre du spectacle :les gestes et les mots sont extrêmement calibrés, c’est une véritable chorégraphie, toutest calculé dans les moindres détails. La musique aussi joue un rôle très important.
25 Comment peux-tu gérer les émotions des petites filles, y compris celles qui ne veulent pas resteravec toi sur la scène ?
26 Au tout début, je prends l’enfant sur mes genoux (ce geste me semblait tout naturelquand j’ai créé le spectacle car j’avais un enfant du même âge) et je lui parle tout bascomme si j’étais sa maman. Le public ne m’entend pas. Je lui dis : « Elle te plaît, mapoupée ? Tu sais qu’elle est magique ? Mais elle est magique pour de vrai. Elle t’aideratoujours. » Et puis encore : « Faisons un jeu. Moi je vais me déguiser en sorcière. » Je luidis de m’attendre et je sors. Ces mots sont très importants parce qu’ensuite elle doit s’yfier complètement. À ce moment il peut toujours arriver qu’une enfant refuse. Alors larègle est de ne pas insister – il faut seulement bien s’assurer qu’elle ne veut vraimentpas le faire. Alors, tout ce que je fais doit être théâtral. Si une petite fille pleure, ou sielle fait pipi (car tout cela arrive !), je redeviens narratrice, j’enlève mes éléments decostume et je dis : « Cette Vassilissa est très fatiguée et retourne à la maison. Arrive uneautre Vassilissa. » On peut changer de petite fille à tout moment du spectacle. Mais il ya des moments où c’est vraiment rude, techniquement. Par exemple, lorsqu’arrive laBaba Yaga. C’est un moment de peur : pour la première fois, on baisse la lumière ;j’entre en scène avec la maison qui tourne sur la tête… Illustration 3 – Baba Yaga, avec louche et couvercle.
27 Dans certains cas, j’ai vu l’enfant s’enfuir à ce moment-là ! Tu es effrayante avec ton visagedéformé… Il est difficile de reconnaître en toi la conteuse ou la maman.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
140
28 C’est vrai, d’autant que quand j’arrive on ne peut même pas voir mon visage. Un jourune enfant m’a dit : « Je savais que c’était toi parce que je t’ai reconnue à teschaussettes. » Mais tu sais, le fait que la petite fille accepte de rester pour toute la duréedu spectacle ne veut pas dire que tout se déroule au mieux. Quand je dois changer, cen’est pas forcément une mauvaise chose. Parfois c’est plus beau. Symboliquement, çapeut être plus fort, puisque celui qui vient en scène est un représentant du public. Siune deuxième personne est sollicitée, cela signifie que n’importe qui peut y aller, et passeulement « l’élue ». Évidemment, si je dois faire venir cinq petites filles, c’est trop.
29 Pendant les deux tiers du spectacle, l’enfant est capturée à l’intérieur d’une dramaturgiepréétablie où elle doit jouer son rôle. Quelle est sa liberté ?
30 De faire les choses elle-même. Elle peut inventer complètement. Plus elle invente, etplus tu peux la faire inventer. Il y a des jours où les petites filles imaginent des tas dechoses, des façons étonnantes de faire la cuisine… et d’autres jours où elles ne trouventrien parce qu’elles ont peur. Le public, quand il voit ce spectacle, est toujours conquis,mais nous actrices savons bien que certaines représentations sont de qualité biensupérieure. Cela dépend de la qualité du rapport entre réalité et fiction. La petite doitcomprendre que tu fais la méchante pour son bien. Que plus les travaux sont difficiles,plus elle se montre vaillante. Que plus ils sont impossibles, plus tu l’aideras. Ce qui estmerveilleux, c’est le degré de complicité d’actrices qui se met à exister entre une petitefille qui n’a pas conscience de ce qu’elle fait, et toi qui as étudié aussi intensément cettechose que vous faites ensemble. J’adore quand elles me mentent et me cachentl’existence de la poupée, parce que cela montre qu’elles ont compris toute la fiction…ou qu’elles pensent que la poupée est vraiment magique. Illustration 4 – La sorcière cachée.
31 Certaines ne savent donc pas qu’il s’agit d’un jeu ?
32 À cet âge, les enfants sont, comme on dit, « au seuil de la porte d’Alice ». Il est difficilepour nous d’établir une différence stricte entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Lamagie de la poupée ou la magie du théâtre, au fond, c’est un peu la même chose. Lethéâtre apparaît comme le lieu du sacré.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
141
33 Finalement tu as emmené ce spectacle en tournée en Europe et dans le monde. As-tu constaté desdifférences culturelles dans la réception du spectacle ?
34 Pour jouer ce spectacle, en Italie et ailleurs, il est important d’être à l’écoute du lieu oùtu vis. Chaque groupe est différent, il faut jouer d’une façon différente pour chaquepublic. Lorsque tu as beaucoup d’expérience, tu te mets à avoir des préjugés, à te dire :ce type de public-là, je l’ai déjà vu. Quand j’étais à Paris, par exemple, j’ai vite remarquéque jouer à Chaillot, ce n’est pas comme jouer à Saint-Denis. Les enfants de Chaillotlavaient beaucoup moins bien les culottes ! Déjà, rien que dans leur façon de les tenir…Alors qu’à Naples ! (Elle mime avec expressivité, et tour à tour, les réactions dégoûtéesdes enfants de Chaillot et l’enthousiasme des gamines de Naples qui prenaient lesculottes à pleines mains pour les plonger dans l’eau.) Ce n’est pas une critique, bien sûr.Mais ce spectacle met en scène le social. Avec Letizia, on avait cherché des tâchesfaciles à réaliser pour une enfant de quatre ans. Moi j’appartiens à une génération où lapetite fille aidait la maman, et une des premières choses qu’on apprenait à faire, c’étaitlaver à la main. Peut-être pas les culottes, d’accord, et c’est vrai que ça peut semblerrépugnant de laver cet accessoire intime de la Baba Yaga. Mais par exemple, étendre lelinge me semblait quelque chose de très évident. Maintenant, il arrive que les enfantsne sachent plus du tout comment faire ! Au Canada, par exemple, c’était impossible. Onaurait dit que les enfants n’avaient jamais vu un séchoir. Bien sûr, chez eux, tout lemonde a le sèche-linge automatique ! Et pourtant ce geste culturel était important pourle spectacle.
35 Était-il difficile de jouer ce spectacle dans une langue étrangère que tu maîtrisaisimparfaitement, comme le français ?
36 J’avais déjà joué quelques spectacles en français mais il s’agissait simplementd’apprendre un texte. Avec La Poupée dans la poche, c’était autre chose : il me fallaitcomprendre ce que disait la petite fille, être capable d’improviser par rapport à sesrépliques… Le plus difficile était de jouer dans les quartiers de forte immigration. Lesenfants, en effet, y apprennent la langue au cours de leur scolarité. Les enseignants medisaient qu’ils connaissaient le français mais en vérité ils savaient peut-être dire « uncahier », ils connaissaient le français de la vie scolaire, mais pas le français duquotidien. Du coup, ils ne comprenaient pas l’histoire. Pour me faire comprendre, j’aidû parler toutes les langues ; parfois j’aimais autant faire des gestes et revenir àl’italien. J’ai eu toutefois une très belle expérience à Mulhouse : j’avais face à moi desenfants en majorité africains, je ne savais pas de qui je pourrais me faire comprendre.J’ai choisi une petite Chinoise de quatre ans, mais mal m’en a pris car elle necomprenait pas du tout cette actrice italienne qui parlait français avec un accent… Parchance, les autres enfants, eux, me comprenaient très bien ! Alors ils se sont mis àguider la petite Vassilissa par gestes, en se cachant de la sorcière ! Comme c’était beau,ce jour-là. Cette complicité de tous les enfants a permis à la petite, bien que necomprenant pas la langue, de triompher de la Baba Yaga. Pour sa plus grande joie !
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
142
Illustration 5 – Baba Yaga assise.
Analyse
37 Dans cette performance théâtrale, l’expérience vécue par l’enfant capturée est larencontre avec la figure mythique de la Baba Yaga. Celle-ci est ressaisie par lapsychanalyse : pour Clarissa Pinkola Estés, dans Vassilissa la Belle, la Baba Yaga incarnela « mère sauvage » avec qui l’enfant doit trouver une affinité pour nouer un rapportplus intuitif à la vie, en se séparant progressivement de l’archétype de la mère douce etbonne. Pour que ce trajet initiatique puisse se réaliser, la comédienne met en place undouble jeu où, sous l’apparence du manichéisme, la figure maternelle laisse entrevoirson ambivalence et aide ainsi l’enfant à grandir.
38 Ce double jeu ne peut s’établir immédiatement et requiert un temps de préparation.C’est pourquoi dans la première partie du spectacle, la comédienne ne joue pas etraconte aux enfants l’histoire de Vassilissa la Belle. Ce faisant, elle met en place lesgrands repères structurants du conte en les ritualisant progressivement. Face à laméchante sorcière, la ressource essentielle de l’héroïne est la poupée que lui a confiéesa mère avant de mourir et qui lui porte conseil dès qu’elle la nourrit. Le gestesymbolique exprimant l’acte de nourrir la poupée est riche pour l’interprétationpsychanalytique : la main va de la bouche de l’enfant à celle supposée de la poupée,installée dans une poche au niveau de son ventre. L’accomplissement de ce geste « de labouche à la bouche » met l’accent sur l’oralité et traduit le rapport fusionnel avec lamère nourricière, qui s’oppose bien sûr à la mère dévoratrice, la Baba Yaga.
39 Lorsqu’arrive le moment de la capture, la comédienne prend soin d’établir avec l’enfantun rapport maternel : l’ayant entraînée sur la scène et dotée des accessoires de
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
143
l’héroïne du conte (un capuchon, la poupée dans la poche), elle la prend sur ses genouxet la berce, Illustration 6 – L’enfant sur les genoux.
40 lui murmurant des choses dans le creux de l’oreille. À ce stade du spectacle, elle doitapparaître aux yeux de l’enfant capturée – et à ceux des jeunes spectateurs – sous lestraits d’une figure maternelle incarnant la douceur et la bonté. Au moment de l’entréeterrible de la Baba Yaga et de son isba, il est essentiel que l’enfant éprouve de la peur.Certes, il ne faut pas qu’elle ait trop peur, sinon elle sera incapable de faire quoi que cesoit. Mais il s’agit de susciter une peur suffisante pour que la dimension initiatiqueopère et pour que le jeune public entre sérieusement dans la fiction théâtrale. D’oùl’importance de susciter une première apparition impressionnante, avec d’abord lamaison tournante sur la tête de la sorcière, puis la découverte du visage métamorphoséde la comédienne (un œuf déformant sa joue), soudain agressive dans son adresse àl’enfant. Celle-ci, très jeune, peut hésiter à reconnaître la figure maternelle complicequi vient de la quitter. Si l’enfant reste face à la sorcière (ce qui est déjà en soi unedémonstration de courage), le double jeu va pouvoir se mettre en place.
41 Pour la comédienne, il s’agit d’incarner à la fois l’archétype de la Méchante (celle quidonne à l’enfant des tâches difficiles, voire impossibles à réaliser et menace de ladévorer en cas d’échec) et la figure aidante et gentille, celle de la Poupée qui fait ensorte que l’enfant parvienne à réaliser les tâches en question. Or face à ce personnageambigu et contradictoire, l’enfant risque de ne pas trouver sa place dans le spectacle. Lasolution théâtrale est que les deux figures doivent s’exclure radicalement l’une l’autrepour établir la dichotomie avec clarté. Il y aura d’une part la sorcière infligeant lesépreuves, debout face à l’enfant ; lorsqu’elle se retire, c’est une voix off, extrêmementdouce, qui prend en charge le discours suggestif et tendre de la Poupée – « Regarde à telendroit, essaie de faire tel geste, c’est bien mon trésor, c’est bien mon cœur. » Ainsi,lorsque l’enfant exécute l’épreuve, elle est seule sur le plateau. Cachée en fond descène, la comédienne ne perd pas de vue sa pantomime et encourage son initiative, la
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
144
guide quand c’est nécessaire, pallie les éventuelles difficultés, adapte enfin l’exigenceen fonction de ce qu’elle se révèle capable de réaliser.
42 Dans le conte populaire, l’expérience initiatique de Vassilissa passe par la réalisation detâches ménagères – faire la lessive, accrocher le linge, plier un drap, balayer le sol – quilui permettent, symboliquement, de sortir de l’enfance et de devenir une femme, initiéepar une figure maternelle oppressante. La transposition théâtrale du conte, qui en faitune expérience active, soumet également l’enfant capturée à une contrainte forte : eneffet elle ne peut pas se soustraire à la dramaturgie préétablie, qui lui a été répétéemaintes fois, tant et si bien qu’elle doit y jouer son rôle. Mais elle est libre d’inventer lafaçon dont elle s’acquittera de chacune des épreuves – comment elle nettoiera les effetspersonnels de la Baba Yaga, comment elle séparera les grains de riz blancs et noirs… Lerôle de la Poupée est de l’aider à trouver en elle-même des ressources qu’elle ignoraitposséder jusqu’alors.
43 Dans ses représentations archaïques, la Yaga incarne le passage entre le monde desvivants et le monde des morts. La réappropriation de cette figure mythique par lesBriciole vise plutôt à réaliser sur la scène une rencontre authentique entre la Vie et leThéâtre. La Yaga permet le passage d’une dimension à l’autre : en initiant l’enfant à lafiction théâtrale, elle lui indique un chemin pour grandir. L’effet quasi thérapeutiquede ce spectacle, qui dans certains cas évoque le psychodrame8, relève en tout cas d’unecatharsis9 de l’acteur. En effet, dans La Poupée dans la poche, les conflits latents autour dela figure maternelle peuvent être appréhendés symboliquement et surmontés réellementpar l’enfant. En ce sens, l’expérience théâtrale est initiatique. Le double aspectapparemment irréconciliable de la mère nourricière et de la mère dévoratrice est perçupar l’enfant selon le schéma manichéen du conte, ce qui lui permet d’entrer en action,faisant confiance à l’une et résistant à l’autre. Mais ce faisant, elle prend consciencequ’en réalité il n’y a pas deux mères distinctes mais une seule figure maternelleambiguë. L’ambivalence constitutive de la Baba Yaga s’inscrit progressivement dansson psychisme. En choisissant de jouer avec elle et en s’appuyant sur elle pour affirmerson identité propre, l’enfant est amenée à perdre ses illusions au sujet d’une mère quiserait toute bonté mais ne renonce pas pour autant à lui faire confiance et à voir en elleune alliée dans son chemin vers l’indépendance. À la fin de l’histoire, c’est bien lasorcière qui lui remet le feu et l’incite à brûler la maison de sa marâtre pour se rendrelibre.
44 Les effets psychiques du spectacle ne concernent pas seulement l’enfant capturée. Lephénomène de l’identification, décrit par Aristote, fonctionne parfaitement dans lamesure où les jeunes spectateurs ont conscience que Vassilissa a été choisie parmi euxet qu’il aurait pu s’agir de n’importe qui parmi l’assistance. Dès lors, les longuespantomimes de Vassilissa, livrée à elle-même sur le plateau, sont suivies par uneassistance fascinée qui retient son souffle. En vérité, la mise en valeur de l’enfantcapturée repose beaucoup sur le jeu de la comédienne : celui-ci ne doit pas être tropappuyé afin qu’un équilibre se crée entre le Théâtre et la Vie. L’objectif est de rendrel’enfant aussi théâtrale que possible, et donc de la mettre en action, car c’est en lavoyant active et expressive que le public sera saisi de vertige et partagera pleinementl’expérience initiatique.
45 Au-delà de son impact psychique, le spectacle La Poupée dans la poche révèle souvent lesproblématiques sociales et culturelles des groupes auxquels il se confronte. Dèsl’instant où un membre du public a l’opportunité d’agir sur scène et d’y imposer sa
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
145
propre gestuelle, le théâtre met facilement en scène les réalités sociales. De plus, il estarrivé parfois que le spectacle apporte, même sans le rechercher consciemment, uneréponse à une problématique culturelle locale vis-à-vis de laquelle la Baba Yaga a pufaire figure de catalyseur. C’est ce que révèle l’anecdote de la petite Chinoise deMulhouse : la solidarité inattendue de tous les jeunes spectateurs, ligués contre unefigure oppressante, a permis au spectacle de se tenir mais surtout a contribuéfortement à l’intégration d’une fillette d’une autre culture au sein de la communautéenfantine.
46 La réappropriation contemporaine de la Baba Yaga par la compagnie des Briciole estdonc intéressante à la fois par ses effets psychiques et socioculturels. Mais que reste-t-il, en définitive, de la figure mythique des contes populaires dans cette performancethéâtrale ? Esquissons quelques hypothèses pour finir :
À un premier niveau, la Baba Yaga est l’archétype du Mal absolu. Elle semble alors seconfondre avec la sorcière des contes occidentaux, celle qui fait obstacle au héros. Pourincarner ce personnage redoutable, la comédienne doit trouver un équilibre dans son jeuafin de ne pas déclencher l’inhibition de l’enfant et d’être au contraire instrument derévélation.À un deuxième niveau, la Baba Yaga est une figure maternelle complexe et ambiguë. Grâceau double jeu de la comédienne, la performance théâtrale rend justice à l’interprétationpsychanalytique de Pinkola Estés et prépare subtilement l’enfant à faire la transition de lamère douce à la mère sauvage.À un troisième niveau, enfin, la Yaga est une figure liminaire : elle incite à franchir unefrontière symbolique, celle qui existe entre la Vie et le Théâtre, ou celle qui sépare certainsgroupes humains. Elle pousse ainsi à retrouver des communautés instinctives, primaires, en-deçà des clivages culturels.
NOTES1. Un spectacle de courte durée, avec peu d’éléments de décor.2. La narration théâtrale est un genre apparu en Italie dans les années 1980, sous l’impulsion ducréateur Marco Baliani. À l’origine, elle se caractérise par l’absence de décor et la présence enscène d’un narrateur-acteur qui livre un récit à son public.3. Clarissa Pinkola Estés est une psychanalyste jungienne. Dans son ouvrage Femmes qui courentavec les loups, paru en 1992, elle choisit des contes centrés sur des figures féminines et elle met aujour les processus d’individuation et de connaissance de soi dont ils sont porteurs. Ainsi, sonanalyse du conte Vassilissa la Belle est axée sur l’histoire de la transmission, de la mère à la fille, del’intuition féminine. (Voir Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent avec les loups, Paris, Grasset,1996).4. Dans Vassilissa la Belle, l’héroïne a été envoyée dans la forêt par sa belle-mère et ses belles-sœurs pour y récupérer le feu auprès de la Baba Yaga. Elle est aidée par la poupée que lui aconfiée sa vraie mère avant de mourir : lorsqu’elle la nourrit, la poupée lui donne de bonsconseils.5. Il s’agit de Laura Magni.
•
•
•
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
146
6. La comédienne demande par exemple aux enfants : « C’est quoi le temps ? C’est quoi lamémoire ? » Les enfants répondent spontanément et toutes les réponses sont acceptées avecbeaucoup de sérieux.7. Avant l’entrée dans la salle, les adultes se voient remettre un petit papier qui leur demande decontenir leurs réactions pendant le spectacle afin de laisser les enfants le vivre intensément.8. Il s’agit d’une forme de thérapie inventée par le psychiatre américain Jacob Levy Moreno. Cedernier récuse la psychanalyse selon Freud : au lieu de demander au patient de raconter, ilpréfère lui suggérer de s’exprimer par des actions et des gestes pour montrer les événementstraumatiques qu’il a vécus et s’en délivrer. Voir Anne Ancelin Schützenberger, Le Psychodrame,Paris, Éditions Payot et Rivages, 2008.9. La catharsis est une notion aristotélicienne : elle vise l’épuration des passions par lareprésentation théâtrale. Dans son acception originelle, la catharsis se produit chez le spectateur.
RÉSUMÉSLe désir de communication avec le jeune public, au cœur de la recherche artistique des Briciole,conduit cette compagnie italienne à faire du conte Vassilissa la Belle le lieu d’une expérienceactive : la Baba Yaga, incarnée par une comédienne seule en scène, choisit une petite fille parmil’assistance pour qu’elle joue le rôle de Vassilissa. Ce phénomène, dépassant largement le cadrede la participation traditionnelle, est une véritable capture scénique : par son ambivalence, laBaba Yaga permet à l’enfant d’effectuer sous nos yeux un parcours initiatique.
The wish to communicate with young audiences, which is the central preoccupation of theBriciole (an Italian theatre company), leads them to turn the tale Vassilissa the Beautiful into anactive experience: Baba Yaga, performed by an actress who is alone on stage, picks a little girlfrom the audience to play the part of Vassilissa. Widely exceeding traditional participation, thisphenomenon can be described as a form of stage capture: Baba Yaga’s ambivalent nature enablesthe child to undergo an initiation rite before our very eyes.
INDEX
Mots-clés : théâtre, jeunesse, Italie, psychanalyseKeywords : theatre, youth, Italy, psychoanalysis
AUTEUR
SIBYLLE LESOURD
Sibylle Lesourd, normalienne et agrégée de lettres modernes, doctorante en littérature comparéeà l’université de Paris-Sorbonne. Professeur de français, rédactrice et responsable de la rubriquethéâtre dans la Revue des livres pour enfants. Thèse en cours : « L’enfant protagoniste : naissance,mouvances et paradoxes d’une figure clé du théâtre contemporain pour la jeunesse en France eten Italie des années 1960 à nos jours. » [email protected]
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
147
Baba Yaga contée : la voix en acteEntretien avec la conteuse Ariel Thiébaut, mené par Raísa França Bastos
Raísa França Bastos et Ariel Thiébaut
1. Donner de la chair aux mots
1 Raísa França Bastos : Je suis heureuse que Sandra Pellet et Juliette Drigny m’aient invitéeà venir mener cet entretien avec Ariel Thiébaut, conteuse ; je les en remercie. BonjourAriel. Tout d’abord, pourriez-vous nous parler un peu de vous, de votre parcours deconteuse ? Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer le conte ?
2 Ariel Thiébaut : Bonjour, je tiens tout d’abord à remercier nos deux « Vassilissa », Sandraet Juliette qui ont voulu pénétrer dans cette forêt des contes russes et qui m’y ontconviée. Pour moi aussi, c’est de l’ordre de l’initiation. Mon parcours de conteuse acommencé il y a plus d’une dizaine d’années. Je pourrais dessiner deux voies parallèlesqui ont finalement fusionné : il y a eu d’une part un cheminement purementintellectuel, des travaux universitaires sur le conte avec Bernadette Bricout àl’Université Denis Diderot, et d’autre part les rencontres qui m’ont permis de donner dela chair aux mots.
3 Il m’a semblé qu’on pouvait mettre plus de chair et de vérité en empruntant lesdéguisements de différents personnages ; déguisements comme autant de manières d’êtrepour changer de point de vue, tout en restant sur son axe de conteuse. Pour moi, leshistoires mises en voix sont les parcours d’entités psychiques qui font miroiter lesdifférentes facettes d’un prisme. Chacun d’entre nous peut emprunter une propositiond’itinéraire comme un bel habit laissé à disposition sur un cintre. Libre à chacun del’endosser soit par la parole, soit par l’écoute. Alors s’étoffe le costume en mouvementet en vibration1.
4 Dans les deux cas, nous sommes au travail pour donner de l’épaisseur.
5 Je voulais rendre hommage aux conteurs et conteuses que j’ai croisés dans cecheminement et qui m’ont amenée à raconter. Je citerais principalement CatherineZarcate, porteuse d’une lumière, qui m’a éclairée sur une route parfois tortueuse. Parmi
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
148
ses nombreux enseignements, je retiendrais le grand respect de l’héritage immatérielde la tradition orale qui est parvenue jusqu’à nos oreilles.
2. Suivre un chemin d’écoute
6 Raísa França Bastos : Comment avez-vous découvert que vous aviez un talent particulierpour le conte ?
7 Ariel Thiébaut : Ce sont les oreilles des autres qui me l’ont révélé. Dès l’enfance, uneparole fictionnelle était pour moi plus simple qu’une prise de parole explicative ourationnelle. Raconter des histoires et me lancer dans le récit imaginaire est restélongtemps occulté avant d’émerger dans la maturité. J’emprunterai l’image du bambou2
– bien connue des scientifiques – qui reste souterrain avant d’émerger. Et en ayantécouté moi-même, ce sont les oreilles qui m’ont menée au conte, j’ai suivi un chemind’écoute. C’est le conte qui est venu à moi, venu comme une évidence fulgurante. Enécoutant énormément moi-même, j’ai pu engranger, sédimenter tout ce qui m’est passéentre les oreilles. J’ai attendu longtemps, accumulé en strates successives, avant demoi-même conter.
3. Accueillir l’opportunité
8 Raísa França Bastos : Comment en êtes-vous venue à la tradition du conte russe, etnotamment à la Baba Yaga ? Est-ce un cycle d’histoires que vous avez étudiées ?Comment en avez-vous eu connaissance, et qu’est-ce qui vous a semblé séduisant danscet univers ?
9 Ariel Thiébaut : Je ne l’ai pas étudié dans le cadre universitaire mais je l’ai approfondiavec une découverte personnelle du monde slave et des expériences en Russie et enCrimée. C’est d’abord par l’image que j’en suis venue à la collecte d’Afanassiev avec maformation initiale en arts plastiques puis plus tard lors d’un module sur l’éducation àl’image à l’Université Paris Descartes. L’exposition au musée d’Orsay L’Art russe dans laseconde moitié du XIXe siècle : en quête d’identité, il y a une dizaine d’années a réactivé lesouvenir des œuvres que j’avais déjà vues à la Galerie Trétiakov avec en particulier destoiles de Vasnetsov dont Ivan Tsarévitch et le loup gris. Les illustrations originales deBilibine relayées par les reproductions dans les albums de jeunesse ont également servide tremplin.
10 Le hasard de la vie est parfois la capacité à accueillir l’opportunité, en l’occurrence icicelle de la découverte du monde slave et de ses histoires populaires, car je ne peux pasme définir comme conteuse territoriale.
11 Le conte, je l’ai pris dans toute sa complexité. C’est un espace déterritorialisé – enempruntant au concept de déterritorialisation de Deleuze et Guattari – qui permet devoyager et de se transporter instantanément d’un lieu à un autre. Cette instantanéitém’a le plus remplie dans ma pratique de conteuse par son aspect performatif avec desformules orales telles que à l’instant même, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire trèssouvent utilisées par les conteurs.
12 Nous avons entendu parler tout au long du colloque de voyage et de vitesse. C’est vraique l’utilisation de Skype pour pallier l’absence inopinée d’une des intervenantes ducolloque, ce côté magique de Skype, on le retrouve déjà dans les contes. Cela existe déjà
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
149
dans les contes. Notre période permet de voir que ce qui était déjà inscrit dans latradition populaire, on la retrouve maintenant dans notre monde scientifique,technique et informatique qui essaye d’être à la hauteur des contes.
13 Mais revenons à la Baba Yaga et ce qui m’a fait venir à elle. Mon travail universitaires’était beaucoup penché sur l’éducation des filles3 et j’avais croisé Cendrillon4, passageobligé quand on veut approfondir l’éducation des filles dans le conte.
14 Quelle jeune fille ne s’est pas identifiée à Cendrillon, figure de proue5 ? Surtout lorsqu’ils’agit d’aller danser ! Je suis passée par la littérature écrite de Perrault puis Cosquin,collecteur de contes de Lorraine – je suis originaire de l’Est de la France –, puis je mesuis tournée vers les frères Grimm et leur version allemande et j’ai poussé plus loinencore jusqu’à l’Est de l’Europe6. D’Est en Est.
15 Raísa França Bastos : Et comment êtes-vous passée de Cendrillon à Vassilissa ?
16 Ariel Thiébaut : Avec Cendrillon, figure centrale du conte, la transmission se fait par lamère défunte sous forme non humaine, dans énormément de versions différentes. AvecVassilissa – la Cendrillon russe – celle qui transmet, la passeuse, c’est Baba Yagaincarnée pleinement, présente et palpable dans tous ses excès. Cette figure correspondégalement à une femme plus avancée en âge comme je le suis moi-même. Cetteévolution de mes centres d’intérêt dans le temps, somme toute logique, suit lachronologie biologique du cycle de la vie.
4. La peur : un bonbon au goût acidulé
17 Raísa França Bastos : Dans vos performances, à quel public vous adressez-vous ?
18 Ariel Thiébaut : Dans les premiers temps de ma pratique de conteuse, j’ai expérimenté lepublic des trois à six ans dans le cadre scolaire et dans des bibliothèques. Ce sont lesjeunes enfants qui ont été mes premières oreilles. J’ai longtemps attendu avant dem’autoriser les oreilles du public adulte. Quand je me suis tournée vers les adultes, jeme suis toujours dit qu’il fallait que je m’adresse à l’enfant qui était dans les oreillesadultes qui m’écoutaient. En essayant de faire résonner tout ce qu’ils avaient dans leurconstruction d’enfant qui pouvait affleurer avec le conte.
19 Raísa França Bastos : Est-ce qu’il est difficile d’incarner une sorcière devant des enfants,une sorcière qui dévore et qui entretient un lien très fort à la mort ?
20 Ariel Thiébaut : Au contraire, c’est extrêmement jouissif. C’est extrêmement libérateurvoire libératoire puisqu’on s’affranchit d’une esthétique convenue, on peut se déformerà souhait, le visage devient très plastique. Il devient même à certains moments masque.
21 En cela la commedia dell’arte et le clown m’ont été très utiles avec les ateliers proposéspar Sophie Hutin de la Compagnie de l’Homme qui marche. Bien que j’aie toujours prissoin de ne pas me laisser envahir par le masque en sachant le reposer à temps...
22 Rentrer dans la figure de la sorcière échevelée et sauvage avec la facette guerrière donta parlé Natacha Rimasson-Fertin est aussi exaltant que d’enfourcher un cheval partantau combat mais il ne faut pas laisser s’emballer la monture.
23 Raísa França Bastos : Faites-vous parfois peur aux enfants ?
24 Ariel Thiébaut : Ils adorent ça. Ils sont même en demande, en attente7. Ils savent que celava advenir. Une préparation à la peur s’impose toutefois, en crescendo, comme unepente à escalader en paliers successifs, pour ne pas prendre les enfants en traître
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
150
comme dans certains films d’Hitchcock dans lesquels, même s’il y a une musique qui vavous mettre en tension, l’effet de surprise peut être utilisé comme effet de mise enscène.
25 Les adultes peuvent l’absorber. Cela est beaucoup plus délicat à recevoir pour les plusjeunes. J’ai essayé de maîtriser la peur que je pouvais inspirer parce que c’est vrai qu’endébutant on ne dose pas toujours l’intensité que l’on peut mettre à enfiler ledéguisement. Il faut absolument mettre les enfants en sécurité. Ce point a été abordétout particulièrement lors de la communication de Sibylle Lesourd concernant ledispositif théâtral du Teatro delle Briciole dans sa mise en scène de Vassilissa8.
26 Emailler donc suffisamment le conte de peur, mais ne pas aller jusqu’à ce qu’elletétanise9. J’aurais envie de parler de bonbons. Vous savez, quand il y a un petit côtéacidulé, cela pique et cela fait du bien ce petit moment tant attendu. Et les enfantssavent que cela va piquer. Et quand ils y sont enfin, c’est jouissif, ils en sont ravis. Celapétille dans les yeux. Comme le piquant du bonbon qui envahit l’intérieur du palais. Jevois qu’ils sont envahis par le bonheur d’avoir eu peur.
27 Au début, quand on ne maîtrise pas, on y va trop à fond, et du coup, on se dit, là j’y suisallée trop fort. La prochaine fois, je freinerai un peu plus l’intensité du pilon de la Yaga.
28 J’ai emmagasiné une dizaine d’années d’expérience de peur avec toutes les gradationsque vous pouvez imaginer. Plus on en parle, plus je me dis que la première effrayée,c’était déjà moi-même. Quand on essaie de retranscrire l’émotion que l’on peut susciteren racontant ces histoires, évidemment qu’on a travaillé sur ses propres peurs. Lescontes russes, je les ai beaucoup expérimentés avec les enfants de la maternelle. C’estvraiment la tranche d’âge avec laquelle j’ai beaucoup mis en acte cette peur.
5. Recréer un esprit de veillée en restant ancrée
29 Raísa França Bastos : Avez-vous recours à une scénographie, ou bien est-ce par la seuleparole que vous créez l’univers des contes ? Quels sont les accessoires que vous utilisezpour raconter la Baba Yaga ? La parole seule ? La musique ?
30 Ariel Thiébaut : J’essaie de recréer à ma manière, d’installer même en plein jour, unesprit de veillée puisque initialement le conte était la lumière des foyers. On en a uneautre à présent cathodique et plus récemment numérique. Allumer des bougies, tirerles volets, les rideaux pour établir ce passage entre le jour et la nuit, entre le réel etl’imaginaire ; juste à la lisière. D’ailleurs, dans certaines traditions populaires, on attendla tombée de la nuit pour commencer les racontées sous peine de devenir chauve !
31 Cette mise en condition permet de rentrer plus facilement dans le conte en floutant cequi peut parasiter l’écoute car cela demande un effort réel pour le jeune auditoire. Lasemi-pénombre estompe les contours et les détails de l’environnement immédiat. Lebut est de permettre une concentration focalisée sur l’histoire. L’absence desollicitation visuelle extérieure privilégie une neutralité de décor faisant écran pourque l’imaginaire puisse s’y projeter. Donc n’avoir que la voix et la présence de laconteuse, effacer tout ce qui ne permet pas de projeter son imaginaire10.
32 Le costume de la conteuse permet aussi de rentrer dans une autre temporalité. Le faitde l’enfiler établit ce glissement du quotidien au merveilleux, pour soi-même et pour lepublic.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
151
33 En ce qui concerne les accessoires, je peux faire usage de petites percussions telles quedes clochettes de cheville qu’une amie m’a ramenées d’Inde. Elles me permettent derythmer mon récit en tapant du pied. D’où la nécessité absolue d’être ancrée dans lesol. Effectivement, on puise l’énergie de la terre et elle se transmet dans le corps enpassant d’abord par les pieds.
34 J’ai mis beaucoup de temps à redescendre dans mes pieds pour faire circuler l’énergie.La pratique du taï-chi m’y a aidée. J’étais trop dans la tête, il a fallu que je mereconnecte. J’ai eu tout un travail personnel de reconnexion.
35 Lorsque que l’on doit partir pour un long voyage, il faut savoir où on met les pieds.
6. Improviser : être ici et maintenant,à l’écoute, et filtrer
36 Raísa França Bastos : Quelle est la part d’improvisation dans votre travail ? Est-ce que, àla manière d’un comédien, vous apprenez un texte par cœur, texte que vous modifiezdurant votre performance de conteuse, ou bien avez-vous seulement l’intrigue en tête,des jalons ?
37 Ariel Thiébaut : Ces questions, je me les suis posées en adaptant pour le théâtre un demes travaux universitaires « Y’a du monde au balcon ! » en collaboration avec FabienneRetailleau, comédienne metteuse en scène. C’est à l’issue de cette expérience que j’airéalisé que c’est vraiment le conte qui me correspondait. Parce que le quatrième mursaute avec le conte et qu’il y a une interaction avec le public. On a un chemin, une quêteinitiatique. Et ce chemin, on est à l’écoute de soi-même pour le faire vivre. Donc, cen’est absolument pas le même travail que le comédien qui a son texte, va le faire vivrebien sûr, mais par le biais de mots déjà prédéfinis. Le conte a cette liberté de laisser laparole s’exprimer. Il y a une part effective d’improvisation et énormément de ressenti.L’énergie et l’humeur du conteur ici et maintenant ne seront jamais exactementidentiques. Il en va de même pour le public. La part de l’improvisation tient égalementau lieu, à la complicité qui se tisse ou non avec le public.
38 Je parlerai de deux moteurs pour raconter : être à l’écoute et filtrer. On estextrêmement poreux à tout ce qui se passe. La peau du conteur est un outil de filtrage11.
39 Nathalie Léone, également conteuse, membre actif de l’APAC12, fait partie desrencontres plus récentes qui m’ont permis de travailler spécifiquement l’improvisation,d’apporter des éléments de l’ordre de la surprise, d’intégrer au récit les perceptionssensorielles de l’instant sans passer par l’intellect.
40 La plupart des conteurs13 vous diront qu’ils ne racontent jamais de la même façon parceque vous lancez quelque chose et vous recevez. Et ce que les gens vous rendent, vousleur renvoyez. Donc forcément le public n’est pas le même, les oreilles ne sont pas lesmêmes, ainsi que vous-même. Une racontée participe de tout cela.
7. Une parole authentique, actede création à symboles ouverts
41 Raísa França Bastos : Est-ce possible de créer du nouveau au sein d’une tradition, de sefaire porte-parole d’un contenu traditionnel tout en préservant sa liberté créatrice ?
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
152
42 Ariel Thiébaut : Bien sûr que oui. Mais c’est vrai que l’on pourrait empoussiérer ourigidifier en l’amidonnant ce contenu traditionnel pour le rendre suranné voire vieillot.J’ai le parti pris de vouloir le réactualiser en essayant de ne pas le dénaturer. En cela, jene suis qu’une héritière, non pas au sens de Bourdieu bien sûr. Il y a eu en France toutun renouveau du conte qui date de plus de quarante ans, je ne suis vraiment qu’une desnombreuses ramifications de cet arbre qui a relancé ses racines. Je suis bénéficiaire detout ce qui a été essaimé.
43 Raísa França Bastos : Est-ce que cela vous pose des difficultés en France aujourd’hui depratiquer un art qui n’est plus traditionnel mais encadré par des institutions qui font lapromotion du conte ?
44 Ariel Thiébaut : Je ne sais pas s’il y a vraiment une promotion du conte. Ce genre decolloque tendrait à prouver que oui. Mais bien souvent le conte reste confiné dans lesbibliothèques et les festivals à destination du jeune public alors que c’est un contre-sens et qu’il doit retrouver les oreilles d’un public élargi aux adultes. Comme le conten’est pas de l’ordre du spectaculaire mais de la sobriété en terme de moyens,s’adressant quasiment de personne à personne, il faut trouver les lieux de confidence –sans rester confidentiel – des endroits permettant de toucher à l’intime. Il fautchercher des espaces adaptés.
45 En ce qui me concerne, je privilégie pour l’instant un rapport direct sans être sonorisée,ou surélevée sur un plateau. Peut-être qu’il faut aller le chercher dans des lieux où onne l’attend pas forcement. J’ai déjà conté dans des cafés où on doit demander le silenceau percolateur, où les gens sont obligés de s’arrêter de parler, alors qu’un café est unlieu de discussion, de retrouvailles et d’échange. Ce n’est pas toujours évident. Il fautpeut-être trouver de nouveaux lieux pour se renouveler. Je pense que justement il y aplein de choses qui sont à créer, des liens pouvant se tisser avec la musique, la danse,les arts visuels.
46 Toutes ces questions autour des néo-conteurs, je suis loin d’être la seule à me les êtreposées et ces pistes de réflexion ont été approfondies par d’autres praticiens du conte14.
47 C’est peut être aussi le caractère du workshop Baba Yaga15 à l’origine de ce colloque quim’a intéressée. Ce qui m’avait vraiment interpellée, c’était le côté transdisciplinaire,même si ce mot ne sonne pas de façon tellement plaisante, écornant quelque peul’oreille.
48 Raísa França Bastos : Est-ce que vous vous sentez comme quelqu’un qui pratique uneactivité engagée, donc importante au sein de la société ?
49 Ariel Thiébaut : Certainement, dans la mesure où il s’agit de parole authentique16.
50 Alors que la plupart du temps, on pratique le bavardage ou le « jargonnage »17. Et quandon s’aventure sur ce terreau des contes, il faut se sentir légitime dans sa parole.
51 Cette légitimité, j’ai mis du temps à la forger car elle ne faisait pas partie de ma culturefamiliale plutôt du côté des taiseux.
52 Raísa França Bastos : Quel pourrait être le message, si l’on peut dire, qu’un conteur peutfaire passer par la pratique du conte, notamment par la Baba Yaga ? Y aurait-il unedimension didactique ?
53 Ariel Thiébaut : Forcément, à plusieurs lectures. Tout ce qui s’est dit dans le colloque adémontré à quel point il fallait absolument ouvrir les symboles et ne pas fermer lesquestionnements. Sinon, cela devient de la propagande.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
153
54 C’est vraiment un cheminement intérieur, un parcours initiatique que nous propose icila Baba Yaga. C’est tellement ouvert que cela répond en chacun d’entre nous. Desréponses entrent en résonance, réponses à des questions qu’on se posait depuislongtemps. Parfois de façon épidermique. Cela peut renvoyer à des points de sa proprevie intérieure. Cela n’arrive pas forcément au même moment, au même endroit puisquechaque personne est différente. La conteuse vient toucher des points sensibles.
55 Raísa França Bastos : Donc non seulement par le contenu de l’histoire, mais aussi par lapratique en tant que telle du conte ?
56 Ariel Thiébaut : Tout à fait.
57 Sites à consulter– Association mouveLOReille– Catherine Zarcate (association À claire-voix)– Nathalie Leone (association La Huppe Galante)– Revue spécialisée La Grande Oreille
58 Lieux pour écouter des contes à ParisMensuellement : Un samedi pour conter, Espace Jemmapes 10e
Contes à croquer, Le Petit Ney 18e
Festival d’hiver : « Le tour du monde en 80 contes », Centre Mandapa 13e
BIBLIOGRAPHIE
Belmont, Nicole (dir.), Cahiers de littérature orale, no 25 « Cendrillons », Paris, Éditions MSH, 1989.
—, Comment on fait peur aux enfants, Paris, Mercure de France, 1999.
—, et Lemirre, Élisabeth, Sous la cendre : figures de Cendrillon, Paris, José Corti, coll. « Merveilleux »,2007.
Bricout, Bernadette, « Les rois mages », in G. Calame-Griaule (dir.), Le Renouveau du conte (Therevival of storytelling), Paris, Édition du CNRS, 1991.
—, La Clé des contes, Paris, Seuil, 2005.
Clerc, Olivier, La Grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite, Paris, JC Lattès, 2005.
Calame-Griaule, Geneviève (dir.), Le Renouveau du conte (The revival of storytelling), Paris, Édition duCNRS, 1991.
Gruel-Apert, Lise, « L’Intérêt pour les contes populaires en Russie au début du XIXe siècle etl’aspect novateur du recueil d’Afanassiev », Du côté des Frères Grimm et d’Alexandre Afanassiev, Paris,actes du colloque publiés par le Centre national de la littérature pour la jeunesse – La Joie par leslivres et l’Oiselle de feu, 2013.
—, Le Monde mythologique russe, Paris, Imago, 2014.
Hindenoch, Michel, Conter, un art ?, Sermamagny, Le Jardin des Mots, 2012.
Maillie, Myriam, Conter, Noville-sur-Mehaigne Belgique, Esperluète Éditions, 2013, p. 27.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
154
Noury-Mazel, Karine, « Le Nouveau Conte », La Grande Oreille, no double Cendrillon de l’ombre à lalumière, Malakoff, automne 2014 – Hiver 2015.
Patrini Maria, Les Conteurs se racontent, Genève, Éditions Slatkine, 2001.
Rimasson-Fertin, Natacha, « Des contes populaires allemands ? Les frères Grimm et leursprédécesseurs », in Du côté des Frères Grimm et d’Alexandre Afanassiev, Paris, actes du colloquepubliés par le Centre national de la littérature pour la jeunesse – La Joie par les livres et l’Oisellede feu, 2013.
Verdier, Yvonne, Façons de dire, façons de faire, Paris Gallimard, 1979.
NOTES1. Bernadette Bricout a utilisé la métaphore d’un jeu de cartes-personnages plates prenant del’épaisseur dans les contes lors de sa conférence à la BNF, dans le cadre des matinées dupatrimoine « Cendrillon, d’un monde à l’autre », juin 2015.2. O. Clerc, La Grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite, chap. 2.3. Je citerai, parmi les auteurs de référence utilisés, Yvonne Verdier qui développe le cycle de lafemme agissant dans le cadre domestique au travers de trois figures de rôle traditionnellementféminins dans la société rurale ; la laveuse, la couturière et la cuisinière in Façons de dire, façons defaire.4. Principalement avec Nicole Belmont. Collecte de contes : Sous la cendre : figures de Cendrillon,anthologie établie et postfacée par Nicole Belmont et Élisabeth Lemirre. Articles de référence en1989, Cahiers de littérature orale, no 25 sous sa direction, « Cendrillons. Éditorial », p. 7-9, et « DeHestia à Peau d’Âne : le destin de Cendrillon », p. 11-31.5. « Avant d’aller user ses souliers rouges à la danse, quelles chaussures choisir pour son premierbal ? », Mémoire de DEA sous la direction de Bernadette Bricout.6. 1 Ne faisons pas l’économie d’évoquer également pour les fondements théoriques le colloque de2011 à la BNF « Du côté des Frères Grimm et d’Alexandre Afanassiev » avec déjà les intervenantesLise Gruel-Apert et Natacha Rimasson-Fertin. Les actes ont été publiés par le Centre national dela littérature pour la jeunesse – La Joie par les livres et l’Oiselle de feu.7. « Il faut trembler pour grandir » René Char in En trente-trois morceaux et autres poèmes, Paris,Gallimard, coll. « Poésie/Gallimard », 1983.8. Voir dans ce même volume : Sibylle Lesourd, « Le double jeu de la Baba Yaga : effets psychiqueset socioculturels d’une performance théâtrale contemporaine », 2015.9. Voir vertus éducatives de la peur : N. Belmont, Comment on fait peur aux enfants.10. Au sujet de conter dans l’ombre, le bel ouvrage plein de poésie du conteur Michel Hindenoch,Conter, un art ?, p. 35-37 ; p. 44-46.11. M. Hindenoch, p. 21.12. Association professionnelle des artistes conteurs.13. Lire les témoignages dans l’ouvrage inspiré de la thèse de Maria Patrini, Les Conteurs seracontent.14. En particulier récemment l’article de fond : K. Noury-Mazel, « Le Nouveau Conte », La GrandeOreille, no 59-60, p. 188-195.15. Pour une description détaillée, voir le site du Workshop Baba Yaga : http://workshopbabayaga.wix.com/bbyg#!projet/c10fk16. « La parole, ça n’existe pas. Ce qui existe, ce sont les paroles. Il y en a de toutes sortes. Laparole conteuse est une voix confidentielle, une ligne de fond sous la surface. Une parole à bas-
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
155
bruit. Il faut avoir l’oreille fine pour l’entendre sous le fracas quotidien des paroles dominantes. »écrit Myriam Maillié dans son recueil entre journal de bord et récit de vie Conter, p. 27.17. « Dans un monde qui fait un usage abusif et détérioré de la parole et une consommationsurabondante et désordonnée de l’image, l’émerveillement suscité par la parole juste, habitéed’images signifiantes comme des présences aimantes, est un plaisir rare et précieux. » in MyriamMaillié, p. 27.
RÉSUMÉSCet entretien met en rapport deux voix, l’une théorique, l’autre artistique, pour questionner lavoix en acte dans une « racontée » (racontée : terme de conteur utilisé pour évoquer l’espace-temps du conte donné devant public). Raísa França Bastos, jeune chercheuse, interroge laconteuse Ariel Thiébaut sur sa formation et sa pratique du conte, dans son rapport au public et àl’improvisation. La manière dont la conteuse restitue la tradition de la Baba Yaga en la faisantvivre différemment à chaque performance est particulièrement mise en valeur.
This interview connects two voices: a theoretical voice and an artistic one, in order to speakabout the voice in action, the voice in actuality. The young researcher Raísa França Bastos asksthe storyteller Ariel Thiébaut about her practice of storytelling, about her relationship with theaudience, her practice of improvisation, and eventually about her way of reproducing thetraditional ambiguous Baba Yaga, every time the same, every time different.
AUTEURS
RAÍSA FRANÇA BASTOS
Normalienne, Raísa França Bastos débute un doctorat à l’université de Nanterre Paris Ouest LaDéfense. Elle travaille sous la double direction d’Idelette Muzart – Fonseca dos Santos (étudeslusophones) et Camille Dumoulié (littérature comparée) sur le parcours textuel et oral de lalégende carolingienne, de l’Europe médiévale au Brésil contemporain.
ARIEL THIÉBAUT
Le parcours de conteuse d’Ariel Thiébaut a commencé il y a plus d’une dizaine d’années inspiré etéclairé par Catherine Zarcate, figure emblématique du renouveau du conte en France (Lerenouveau du conte = The revival of storytelling, colloque international, des 21-24 février 1989organisé par la DRAC d’Ile-de-France, le Musée des arts et des traditions populaires, l’Associationl’Âge d’or de France, sous la direction de Geneviève Calame-Griaule. Les actes sont publiés auxÉditions du CNRS, 1991). Ariel Thiébaut tisse, en bibliothèque et en milieu scolaire, le fil deshistoires traditionnelles dont celles d’Afanassiev. Leur mise en voix s’appuie sur la textureuniversitaire d’une maîtrise de sciences de l’éducation (université Paris Descartes), et d’un DEAen littérature orale (université Paris Diderot), sous la direction de Bernadette Bricout. À l’originede l’association mouveLOReille, elle souhaite élargir l’audience du conte auprès d’un publicadulte, au carrefour de champs disciplinaires théoriques et de pratiques artistiques.
Revue Sciences/Lettres, 4 | 2016
156