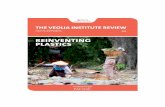GLAD!, 04 - OpenEdition Journals
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of GLAD!, 04 - OpenEdition Journals
GLAD!Revue sur le langage, le genre, les sexualités
04 | 2018Rhétoriques antiféministes
Édition électroniqueURL : http://journals.openedition.org/glad/916DOI : 10.4000/glad.916ISSN : 2551-0819
ÉditeurAssociation GSL
Référence électroniqueGLAD!, 04 | 2018, « Rhétoriques antiféministes » [En ligne], mis en ligne le 17 juin 2018, consulté le 22décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/glad/916 ; DOI : https://doi.org/10.4000/glad.916
Ce document a été généré automatiquement le 22 décembre 2020.
La revue GLAD! est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution -Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
Fruit d’une collaboration entre les membres du collectif Arpège-EFiGiES Toulouse et le
comité de rédaction de GLAD!, ce numéro, à travers un dossier consacré aux rhétoriques
antiféministes, contribue à la fois à documenter les antiféminismes en s’intéressant à
plusieurs types de rhétoriques antiféministes (masculiniste, féminine...), à inscrire ces
rhétoriques dans le temps long grâce à une approche diachronique, et à fournir des
outils critiques pour déconstruire ces rhétoriques. Le numéro comprend également une
partie varia, ainsi que des contributions dans la rubrique Actualités.
The result of a collaboration between the members of Arpège-EFiGiES Toulouse and
GLAD! editorial committee, this issue, by focusing on antifeminist rhetorics, contributes
to document antifeminist trends, to inscribe these trends in History through a
diachronic perspective, and to offer critical tools in order to deconstruct these
rhetorics. The issue also includes a varia section and contributions in the News section.
GLAD!, 04 | 2018
1
SOMMAIRE
Rhétoriques antiféministes
Rhétoriques antiféministes : entre recherche et pratiquesAuréline Cardoso et Charlotte Thevenet
Recherches
Des féministes qui ne sont pas féministes ? Écrivaines et lutte des femmes en France des années 1970 aux années 1980Audrey Lasserre
Sémiotique de l’enterrement prématuré : le féminisme à l’ère du postféminismeMary Hawkesworth
Modalités de diffusion et rhétoriques des discours misogynes et misogames imprimés à laRenaissanceTatiana Clavier
Construire les hommes comme des victimes irresponsables Les stratégies discursives des associations masculinistes françaisesÉtienne Lefort
L’antiféminisme d’ÉtatUne analyse rhétorique du mouvement des pères séparés au QuébecAurélie Fillod-Chabaud
Explorations
Retour sur un siècle et demi de rhétorique anti-égalitaire et antiféministe Entretien avec Juliette RennesJuliette Rennes et Revue GLAD!
Antiféminisme sur papier glacéLa rhétorique réactionnaire des magazines fémininsAuréline Cardoso
Le traitement médiatique des violences faites aux femmes : entre instrumentalisation etinvisibilisationAssociation Faire Face
Des corps « monstres ». Historique du stigmate féministeCaroline Fayolle
Les femmes en philo, qu’est-ce que ça mange en hiver ?Sarah Arnaud et Cloé Gratton
GLAD!, 04 | 2018
2
Varia
Recherches
Une chambre à soi : genres et corps en artLuc Schicharin et Anne-Laure Vernet
Explorations
L’agitation du quotidien Une conversation sur la réflexion Ⓐnarchiste face au sexisme dans la langueMariel Acosta et Ernesto Cuba
Chroniques
Les genres décrits n°2Le genre exemplaire. Bestiaire des exemples et contre-exemples du genre dans les grammairesJulie Abbou
Les genres récrits n° 3Au-delà de la binarité : le trouble entre les genresDaniel Elmiger
Actualités
Notes de lecture
Sara Garbagnoli & Massimo Prearo. 2017. La croisade « anti-genre ». Du Vatican auManif pour Tous Julie Abbou
Elsa Dorlin. 2017. Se défendre. Une philosophie de la violence Vers une phénoménologie de la violence défensiveMickaëlle Provost
He-Yin Zhen. 2018. La Revanche des femmes et autres textes Agathe Senna
GLAD!, 04 | 2018
3
Rhétoriques antiféministes : entrerecherche et pratiquesAntifeminist Rhetorics: Research and Practice
Auréline Cardoso et Charlotte Thevenet
Femme sans teste, tout en est bon. (Proverbe
misogyne)
Femme sans teste tout en est bon [estampe]
Recueil des plus illustres proverbes divisés en trois livres. Le second livre ou est despaint lesproverbes joyeux (impr. à Paris par I. Lagnet, 1657)
Crédits : Gallica (BNF)
GLAD!, 04 | 2018
5
1 En mai 2016, à l’Université de Toulouse II Jean Jaurès, se tenaient deux journées
d’études intitulées « Rhétoriques antiféministes : entre recherche et pratiques »,
organisées par le collectif de jeunes chercheuses féministes Arpège-EFiGiES Toulouse1,
et qui mettaient en dialogue les savoirs issus d’universitaires, de militantes et/ou de
professionnelles d’organisations féministes. Deux ans plus tard, alors que les médias
saluent d’une main la « libération de la parole » symbolisée par le hashtag #MeToo, et
publient de l’autre articles et pièces d’opinion qui condamnent cette supposée
libération, il semble plus urgent que jamais de mettre les discours antiféministes sur la
table de dissection critique. Non seulement l’actualité de ces derniers mois a-t-elle
rappelé, s’il en était besoin, combien les discours réactionnaires et antiféministes
étaient prompts à la riposte, mais également combien ils étaient nombreux et divers :
venus d’hommes de droite comme de gauche, bien sûr, mais aussi de femmes comme l’a
montré en fanfare la tribune réclamant « la liberté d’importuner » parue dans Le Monde
en janvier, voire, pourquoi pas, de femmes se réclamant du féminisme2. Face au
foisonnement et au succès de ces discours aujourd’hui, face aussi à leur constance dans
l’histoire, ce numéro thématique fruit de la collaboration des membres du collectif
Arpège-EFiGiES Toulouse et de l’équipe éditoriale de GLAD!, vise à offrir une anatomie
critique des discours antiféministes aujourd’hui et dans l’histoire, qui rende compte de
leur permanence autant que de la diversité de leurs rhétoriques.
2 Il s’agit en effet de penser ensemble les diverses réalités que recouvrent les
antiféminismes aujourd’hui, « nébuleuse aux manifestations tangibles » (Devreux &
Lamoureux 2012) certes, mais dont les contours restent néanmoins flous. Des pères
divorcés aux magazines féminins, en passant par le milieu universitaire aujourd’hui, les
contributions illustrent toute une palette de sphères d’actuation des discours
antiféministes. La perspective historique adoptée dans certains articles permet quant à
elle de saisir les (dis)continuités de ces rhétoriques, et les perpétuels renouvellements
de discours dont le fond et la forme varient, mais pas l’objectif, puisqu’il s’agit, in fine,
de s’opposer aux avancées sociales en faveur de l’égalité de genre et de perpétuer la
domination d’un genre sur l’autre. La richesse de ces matériaux empiriques permet une
compréhension fine de la reproduction des discours antiféministes, et des manières
dont ils s’entrecroisent avec d’autres rhétoriques réactionnaires (Hirschman 1991),
telles que les rhétoriques racistes, transphobes et néo-libérales. Ce dossier entend donc
participer à la construction des savoirs sur les antifeminismes, qui, s’ils font l’objet d’un
nombre croissant de recherches en France3, ne cessent de se renouveler et demandent
ainsi une attention et une vigilance féministes accrues.
Une multitude d’antiféminismes
3 La manière de définir l’antiféminisme varie selon l’angle sous lequel il est appréhendé.
Ainsi, en écrivant que l’antiféminisme est une réaction d’hostilité et de rejet à l’égard
du féminisme, Christine Bard met l’accent sur le caractère défensif de l’antiféminisme
et sur la dynamique relationnelle entre mouvement féministe et contre-mouvement
antiféministe (Bard 1999). D’autres conceptualisations plus larges de l’antiféminisme
mettent en exergue sa dimension « ordinaire », en définissant l’antiféminisme comme
« une expression directe de la misogynie » et « l’argumentaire politique de la haine des
femmes » (Dworkin 2012 : 195), ou comme « un continuum allant de l’indifférence à la
violence en passant par la non-reconnaissance des femmes comme égales, le mépris et
GLAD!, 04 | 2018
6
l’hostilité déclarée » (Descarries 2015 : 75). Pour Diane Lamoureux et Francis Dupuis-
Déri, si l’antiféminisme peut avoir des effets pour l’ensemble des femmes, il relève
toutefois d’une logique distincte de la misogynie et vise prioritairement les féministes
(Lamoureux & Dupuis-Déri 2015).
4 Tout comme le mouvement féministe, la nébuleuse antiféministe (Devreux &
Lamoureux 2012) présente une grande pluralité d’objectifs, de répertoires d’actions ou
de principes idéologiques. On peut tout d’abord distinguer l’antifeminisme ordinaire,
renvoyant aux discours de sens commun qui s’opposent, plus ou moins frontalement,
aux revendications féministes ; ensuite, l’antifeminisme religieux ou conservateur et
s’attaquant plus directement aux droits sexuels et reproductifs et visant les féministes ;
enfin, le masculinisme, qui au moyen d’actions plus ou moins virulentes revendique de
« nouveaux droits » pour les hommes et notamment les pères (Blais 2012). On peut
également mentionner l’antife minisme d’État ou plutôt l’antifeminisme dans l’État, qui
désigne et permet d’exposer la façon dont des agents de l’État ou acteurs et actrices
politiques, font barrage aux revendications féministes ou au travail d’associations et
institutions œuvrant pour l’égalité (Dupuis-Déri 2013).
5 En France, l’antiféminisme est représenté d’abord par des groupes comme SOS Papa ou
le groupe anti-IVG Les Survivants, qui, bien que minoritaires, parviennent à occuper un
espace médiatique certain. Mais les idées antiféministes imprègnent en fait les discours
de nombreux et nombreuses intellectuel-le-s, politiciennes et politiciens
(Andriamandroso 2017 ; Dauphin 2010) ; l’antiféminisme fonctionne comme un vecteur
d’union sacrée de tout le spectre politique, comme l’anti-suffragisme mettait d’accord
l’Action française et le Parti Radical au début du XXe siècle 4. Certaines formes
d’antiféminisme peuvent également influencer les pratiques professionnelles, par
exemple dans le champ du travail social lorsque la lecture féministe des violences
conjugales est évacuée au profit d’une approche psychologisante et inter-individuelle
qui minimise les rapports de pouvoir liés au genre (Casas Vila 2006 ; Côté & Lapierre
2017). Pour autant la plupart de ces personnes « relais » d’idées hostiles aux féminismes
ne se pensent pas nécessairement comme antiféministes, et c’est peut-être dans ce
paradoxe que réside toute la difficulté d’étudier l’antiféminisme : il est à la fois la toile
de fond d’une multitude de discours et de pratiques, tout en étant dilué dans d’autres
logiques notamment néo-libérales (Blais 2017) et en avançant masqué derrière des
valeurs égalitaires (Lefort 2017). Le paradoxe est poussé à son comble quand c’est au
nom du féminisme que s’articule une rhétorique antiféministe, comme c’est le cas dans
ce qu’on peut appeler les nouveaux (anti)féminismes de droite, représentés par le
« féminisme intégral » de Marianne Durano et de la revue Limite. Il y a quelques années,
un mouvement comme celui des « Antigones », groupe de jeunes femmes toujours
habillées d’un blanc virginal et prônant « la féminité pour les femmes », posait déjà la
question des rhétoriques antiféministes venues des femmes au nom de valeurs
supposément « féminines ».
Déconstruire les discours antiféministes
6 Si ce dossier propose de se pencher sur les discours antiféministes, c’est notamment
parce que c’est bien par le langage, les discours (écrits ou oraux, médiatiques,
scientifiques, religieux…) que se diffuse l’antiféminisme. La palette argumentative est
large, allant d’une dénonciation des supposés privilèges féminins à la valorisation de la
GLAD!, 04 | 2018
7
« complémentarité entre les femmes et les hommes », en passant par la revendication
de l’égalité parentale. Pour autant, malgré cette diversité de stratégies, on peut repérer
un certain nombre de récurrences dans les rhétoriques antifeministes.
7 Francine Descarries distingue trois registres argumentatifs de l’antiféminisme
ordinaire : la distorsion (distorsion des faits comme lorsqu’il est affirmé que l’égalité
est atteinte), la simplification abusive (lorsque l’égalité est considérée comme une
affaire privée et que le féminisme est vidé de son contenu politique et transformateur),
et la victimisation (lorsque l’Histoire est réinterprétée pour faire des hommes les
principales victimes des changements sociaux récents) (Descarries 2005). Les
interprétations fallacieuses de statistiques, voire leur négation ou leur lecture
sommaire, contribuent également à légitimer l’idée selon laquelle les luttes féministes
auraient été menées au-delà du nécessaire et auraient abouti à l’avènement d’un
« matriarcat » où les hommes n’auraient plus leur place (Bard 1999 ; Blais & Dupuis-
Déri 2012). On peut également mentionner le recours fréquent à la mise en exergue de
l’exemple marginal d’une femme ayant accédé à un poste de pouvoir (une femme
présidente, cheffe d’entreprise) pour « prouver » qu’il y aurait bien une féminisation de
la société et que les femmes voire les féministes seraient désormais aux commandes
(Blais 2012 ; Rabenoro 2012). Quant aux discours plus spécifiquement masculinistes, en
plus de la distorsion et de la victimisation, ils mobilisent souvent le témoignage
individuel d’un homme en souffrance construit comme une « victime impuissante » qui
serait représentatif d’une condition masculine en déclin, comme le montre Étienne
Lefort dans son article « Construire les hommes comme des victimes irresponsables. Les
stratégies discursives des associations masculinistes françaises ». Les thèmes privilégiés
par les rhétoriques masculinistes, largement diffusés par les magazines féminins
(Cardoso 2018 dans ce numéro), s’articulent autour de la « crise de la masculinité », de
l’inégalité face à la justice des familles qui favoriserait les femmes, du suicide des
hommes et de l’échec scolaire des garçons (Lamoureux 2008).
8 D’autres discours, sans être explicitement antiféministes, viennent délégitimer les
revendications féministes et surtout le recours à l’action collective. C’est le cas des
rhétoriques sur le « post-féminisme », notion aux contours flous qui est souvent
associée à la proclamation de la mort du féminisme (Cossy et al. 2009 ; Aronson 2015) et
au rejet de celui-ci par les jeunes femmes (Braithwaite 2004), et dont l’article de Mary
Hawkesworth « Sémiotique de l’enterrement prématuré : le féminisme à l’ère du
postféminisme » traduit dans ce numéro par Aude Ferrachat fait la généalogie et la
critique. Le post-féminisme, topos des antiféminismes depuis les années 1970 comme le
montre Audrey Lasserre dans son article « Des féministes qui ne sont pas féministes ?
Écrivaines et lutte des femmes dans la France des années 1970 », est considéré comme
une nouvelle phase du mouvement des femmes, qui s’inscrirait dans une vision néo-
libérale des inégalités et proposerait de se concentrer sur des solutions individuelles
(Aronson 2015 ; Genz 2006). En cela les rhétoriques post-féministes se rapprochent du
« féminisme élitiste », dont les discours et propositions, sur l’accès des femmes aux
postes de pouvoir, concernent surtout la fraction diplômée et aisée des femmes (Klaus
2010).
9 La valorisation d’un mouvement « post-féministe » a également souvent pour effet de
délégitimer le féminisme dit de la « deuxième vague », dont la radicalité et l’agressivité
― largement exagérées ― sont décriées, et dont la richesse politique et tactique est
réduite à la visibilité des manifestations de rue (Hawkesworth 2004 traduit dans ce
GLAD!, 04 | 2018
8
numéro). Là encore, cette stratégie s’inscrit dans une tradition au long cours de
discours qui transforment volontiers les féministes en monstres, qu’il s’agisse de furies
mettant des soutiens-gorge au bucher (Bard 2012), des « tricoteuses » de la Révolution
si bien inscrites dans la mémoire misogyne par Dickens (A Tale of Two Cities), ou des
« sorcières androphobes » qui persistent jusqu’au XXe siècle5. Les discours sur le post-
féminisme alimentent stratégiquement l’idée d’une rupture générationnelle, faisant
des « jeunes femmes d’aujourd’hui » un bloc homogène qui ne se reconnaitrait pas dans
le féminisme, sans définir ce qu’est le féminisme ni s’intéresser à ce qu’en perçoivent
ces femmes nées après les mouvements politiques de libération des femmes (Aronson
2015 ; Hall & Rodriguez 2003). Ainsi le post-féminisme serait une sorte de « nouveau »
féminisme, plus joyeux, indépendant et non politique qui valoriserait la réussite
individuelle et la compétition entre individu-e-s perçu-e-s comme également doté-e-s
en opportunités (Blais & Dupuis-Déri 2014 ; Braithwaite 2004 ; Lamoureux 2008), plutôt
que la solidarité et la lutte collective (Dupuis-Déri 2015).
Critique des discours antiféministes
L’argument de la nature
10 À la lecture des différents articles, la récurrence de certains arguments et notamment
d’une forme de « naturalisme différentialiste » se dégage d’emblée, comme l’explique
Juliette Rennes dans l’entretien « Retour sur un siècle et demi de rhétorique anti-
égalitaire et antiféministe ». Il s’agit là toujours selon Juliette Rennes d’une « matrice
idéologique commune à tous les discours qui s’opposent aux réclamations féministes »,
construisant les femmes et les hommes comme incommensurablement différents et dès
lors, voué-e-s à occuper des fonctions distinctes, au sein de la famille comme du couple
et du travail. « La différence est la façon dont […] on justifie l’inégalité entre les
groupes […] » écrit Christine Delphy dans « Penser le genre » (2001 : 8).
Particulièrement paradigmatiques de cette stratégie, le mouvement de la « Manif Pour
Tous » et plus largement l’offensive vaticane contre la dite « théorie du genre » sont
auscultées dans ce numéro à travers la recension par Julie Abbou de l’ouvrage de Sara
Garbagnoli et Massimo Prearo, La croisade « anti-genre » paru en 2017. On pourrait
ajouter que la pensée de la différence vient justifier les mesures renforçant et/ou
légitimant les politiques inégalitaires, comme lorsque les militants des groupes de
pères séparés, étudiés par Aurélie Fillod-Chabaud dans l’article « L’antiféminisme
d’État. Une analyse rhétorique du mouvement des pères séparés au Québec »,
revendiquent le retour à une éducation non mixte afin de mieux respecter les
différences naturelles entre hommes et femmes. De façon autrement plus masquée,
certains articles de magazines féminins s’emploient également à justifier des inégalités
sociales (comme les inégalités liées au partage des tâches ménagères) en invoquant une
différence ontologique et indépassable entre hommes et femmes ; c’est ce que montre
dans ce numéro Auréline Cardoso dans un article intitulé « Antiféminisme sur papier
glacé. La rhétorique réactionnaire des magazines féminins ». Contrepartie de cette
naturalisation du genre, les femmes qui refusent d’y souscrire (qu’il s’agisse de
féministes révolutionnaires ou de femmes philosophes comme chez Arnaud & Gratton
dans ce numéro) sont construites comme des aberrations de la nature ; c’est le stigmate
que représente le mot même de "féministe" à travers l’histoire que retrace Caroline
Fayolle dans son article « Des corps “monstres”. Historique du stigmate féministe ».
GLAD!, 04 | 2018
9
Pauvres hommes…
11 Bon nombre d’articles explorent la stratégie d’inversion des rôles, opérée plus
particulièrement par les masculinistes, représentés dans ce dossier au travers des
militants des organisations de défense des droits des pères (articles d’Aurélie Fillod-
Chabaud et d’Étienne Lefort). Si ces groupes sont, pour l’heure, beaucoup moins
audibles en France qu’outre-Atlantique, ils constituent cependant « la composante la
plus active du mouvement masculiniste en France » (Lefort dans ce numéro). Au moyen
notamment d’un usage fallacieux de statistiques, les membres de ces groupes cherchent
à faire de ce qui est présenté comme un inexorable déclin de la condition masculine, un
problème public d’ampleur que l’on ne saurait négliger. Les discours sur la résidence
alternée qui serait presque systématiquement refusée, sur les violences conjugales qui
toucheraient autant, sinon plus, les hommes que les femmes, ou sur les suicides
masculins, participent d’une « stratégie victimaire » (Fillod-Chabaud dans ce numéro).
12 Le supposé acharnement des féministes à l’égard des hommes est lui aussi multi-
séculaire : dès la fin du XIXe siècle, le combat féministe est présenté comme une lutte
« anti-hommes » par ses détracteurs, alors même que des hommes le soutenaient déjà
(et le soutiennent encore), comme nous le rappelle Juliette Rennes.
Maquiller les discours antiféministes sous une apparence égalitaire
ou progressiste
13 Si l’on a parfois tant de peine à identifier les discours antiféministes, c’est aussi parce
que leurs auteurs, bien conscients de la (relative) diffusion d’une norme égalitaire,
prennent soin de ne pas s’opposer ouvertement aux droits des femmes et à l’égalité. Dès
le Moyen-Âge tardif et la Renaissance, les auteurs antiféminins prenant position dans la
Querelle des femmes sont ainsi contraints d’inclure dans leurs argumentaires
polémiques certains des arguments qu’ils combattent ; dans son article intitulé
« Modalités de diffusion et rhétoriques des discours misogynes et misogames imprimés
à la Renaissance », Tatiana Clavier montre ainsi la circulation voire la réversibilité des
discours misogynes à cette époque. Aussi ne s’agit-il pas forcément pour les
antiféministes de nier la légitimité de la lutte pour l’égalité, mais d’affirmer que celle-ci
est déjà advenue : Julienne Rennes rappelle la prégnance de la rhétorique de « l’égalité
déjà là » identifiée par Christine Delphy (Delphy 2010) au XIXe siècle, alors même que
contrairement à aujourd’hui l’égalité femmes-hommes était loin d’être inscrite dans la
loi. À cette contre-vérité s’en articule une autre : les discours proclamant « la mort du
féminisme » (Hawkesworth dans ce numéro, traduit par Aude Ferrachat), dès les années
soixante-dix, sont portés par des femmes, parfois même identifiées par d’autres comme
féministes (c’est le cas d’Hélène Cixous), qui s’efforcent pourtant de rendre le terme
caduc (Lasserre dans ce numéro). Que ce soit au nom d’une égalité débarrassée des
rapports de domination telle qu’analysée par Hawkesworth, ou d’une radicalité plus
radicale que la révolution comme chez certaines antiféministes des années 1970
(Lasserre dans ce numéro), le féminisme semble destiné à être stratégiquement
conjugué au passé, renvoyé à Mathusalem et ainsi commodément privé de voix à la
table du progrès.
GLAD!, 04 | 2018
10
L’antiféminisme au croisement des rapports sociaux
14 Le retentissement et les suites de ce qui a vite été qualifié d’« affaire Weinstein6 »
viennent illustrer à quel point différents rapports sociaux, et notamment de classe et
de race, s’imbriquent perpétuellement aux rapports sociaux de sexe et se renforcent
mutuellement. Comme l’ont souligné plusieurs commentatrices7, si les dénonciations —
légitimes — de violences sexistes et sexuelles commises par un homme à l’encontre de
dizaines de femmes ont pu trouver un tel écho et une telle écoute, c’est notamment
parce que les victimes sont incarnées par des femmes riches, célèbres et
majoritairement blanches. Se remémorer la réception des accusations de Nafissatou
Diallo à l’encontre de Dominique Strauss-Khan suffit à se convaincre qu’en matière de
dénonciation des violences, toutes les paroles sont loin de se valoir. De même, si ces
différentes affaires permettent de pointer du doigt des auteurs issus de milieux
favorisés, les politiques cherchant à répondre à la colère — elle aussi, toujours légitime
— suscitée par ces révélations, en se focalisant sur ce que l’on nomme désormais le
« harcèlement de rue », ciblent toujours les mêmes coupables : des hommes plutôt issus
des classes populaires et racisés, comme le souligne la tribune « Contre la pénalisation
du harcèlement de rue » signée par des militantes et chercheuses engagées dans la lutte
contre les violences envers les femmes8. Dans cette perspective, certains textes du
numéro fournissent réflexion et outils pour penser ces articulations et surtout pour
élaborer des stratégies de défense tenant compte de l’imbrication des rapports sociaux.
D’abord, l’analyse fournie dans l’article « Le traitement médiatique des violences faites
aux femmes : entre instrumentalisation et invisibilisation » par les membres de
l’association Faire Face, qui propose des stages d’auto-défense féministes, est salutaire
en ce qu’elle permet de réfléchir à des stratégies féministes pour dénoncer et
combattre les violences faites aux femmes, sans pour autant alimenter d’autres formes
de violences (de classe et raciste en particulier). Comme en écho à ces réflexions, la
recension par Mickaëlle Provost du livre d’Elsa Dorlin paru en 2017, Se défendre, propose
de concevoir l’auto-défense des personnes minorisées à travers une lentille
phénoménologique (Provost dans ce numéro). Dans un tout autre espace, celui de
l’université, Sarah Arnaud et Cloé Gratton nous offrent un guide de survie pour femmes
philosophes en milieu misogyne et antiféministe, dans un article intitulé « Les femmes
en philo, qu’est-ce que ça mange en hiver ? ». Enfin, le compte-rendu par Agathe Senna
de la première édition en français d’essais rédigés en 1907 par He-Yin Zhen, féministe
et anarchiste chinoise (rassemblés sous le titre La Revanche des femmes et autres textes
aux éditions de l’Asymétrie en 2018, traduction de Pascale Vacher), propose un contre-
point radical et bienvenu à tous ces discours antiféministes, sous la forme d’une pensée
décisivement émancipatrice et révolutionnaire.
GLAD!, 04 | 2018
11
Opérateur Céphalique
Opérateur Céphalique Céans maitre Lustucru a un secret admirable qu'il a apporté de Managascarpour reforger et repolir sans faire mal ni douleur les testes des femmes acariatres, criardes...[estampe] (publication à Paris chez Daumont, 1720)
Crédits : Gallica (BNF)
15 En plus de son dossier thématique, ce numéro #4 poursuit le travail entrepris dans les
numéros précédents. Travail d’exploration de formats de recherche inédits, d’abord :
ainsi de la recherche filmée et montée d’Anne-Laure Vernet et de Luc Schicharin (« Une
chambre à soi : genres et corps en art »). Partis de journées d’études consacrées au
corps dans les arts queer et féministes, le montage vidéo et le texte qui l’accompagnent
inscrivent le travail et les rencontres effectuées à ce moment-là dans une archive
académique féministe, et invitent à la poursuivre. Travail de traduction, ensuite : Sara
Martinez a traduit pour GLAD! un entretien de Mariel Acosta avec Ernesto Cuba,
entretien inédit en français, et dans lequel iels explorent « L’agitation au quotidien » à
travers l’émergence d’une profusion de formes linguistiques « anarchistes ». Travail de
diversification des temporalités, enfin, avec la troisième livraison de la chronique « Les
genres récrits » (Daniel Elmiger), et la seconde des « Genres décrits » (Julie Abbou).
Qu’il s’agisse des varia ou des dossiers thématiques, GLAD! protège ainsi précieusement
sa tête des attaques des Lustucru en tout genre qui voudraient la lui reformater, et
poursuit avec acharnement son travail d’édition féministe et politique !
Auréline Cardoso
et le collectif Arpège-EFiGiES Toulouse (Émilie
Blanc, Aude Ferrachat, Leslie Fonquerne, Bruna
Martins-Coelho, Héloïse Prévost, Agathe Roby-
Sapin, Marine Rouch, Marie Walin, Justine Zeller)
Charlotte Thevenet
et le comité de rédaction de la revue GLAD! (Julie
GLAD!, 04 | 2018
12
Abbou, Aron Arnold, Maria Candea, Alice Coutant,
Mona Gérardin-Laverge, Magali Guaresi,
Stavroula Katsiki, Noémie Marignier, Lucy
Michel, Émilie Née)
Nous remercions encore une fois les membres du comité de rédaction pour avoir
ouvert ses pages à la publication des journées d’étude Arpège-EFiGiES Toulouse
permettant ainsi la plus grande diffusion des savoirs coproduits par des
universitaires et des militantes féministes. Nous espérons que ce dossier pourra
donner quelques pistes d’action, à l’heure où les revendications féministes sont
encore loin d’être satisfaites et où les régressions en termes d’acquis sociaux sont
plus que probables.
Le collectif Arpège EFiGiES Toulouse
BIBLIOGRAPHIE
ANDRIAMANDROSO, Hanitra. 2017. « Déni de la “violence conjugale” et de la “violencia de género” :
une clef de voûte des stratégies des groupes masculinistes en France et en Espagne. »,
Communication au colloque Antiféminismes et masculinismes d’hier et d’aujourd’hui, Université
d’Angers, 4 mars 2017.
ARONSON, Pamela. 2015. « Féministes ou postféministes ?, Feminists or “Postfeminists” ? » Politix
109 : 135‑158.
BARD, Christine. 1999. Un siècle d’antiféminisme. Paris : Fayard.
BARD, Christine. 2012. Le féminisme au-delà des idées reçues. Paris : Le Cavalier Bleu.
BLAIS, Mélissa. 2012. « Y a-t-il un “cycle de la violence antiféministe” ? Les effets de
l’antiféminisme selon les féministes québécoises » Cahiers du Genre 52(1) : 167-195.
BLAIS, Mélissa. 2017. « Penser les effets de l’antiféminisme comme facteur de transformation du
mouvement féministe : le cas du Québec », Communication au colloque Antiféminismes et
masculinismes d’hier et d’aujourd’hui, Université d’Angers, 4 mars 2017.
BLAIS, Mélissa & DUPUIS-DÉRI, Francis. 2012. « Masculinism and the Antifeminist Countermovement »
Social Movement Studies 11(1) : 21‑39.
BLAIS, Mélissa & DUPUIS-DÉRI, Francis. 2014. « Antiféminisme : pas d’exception française » Travail,
genre et sociétés 32(2) : 151‑156.
CASAS VILA, Gloria. 2009. « Médiation familiale : quelle place pour les violences conjugales ? »
Empan 2 (73) : 70-75
COSSY, Valérie, MALBOIS, Fabienne, PARINI, Lorena & LEMPEN, Silvia. 2009. « Édito : Imaginaires
collectifs et reconfiguration du féminisme » Nouvelles Questions Féministes 28(1) : 4‑13.
GLAD!, 04 | 2018
13
CÔTÉ, Isabelle & LAPIERRE, Simon. 2017. « La récupération de l’“aliénation parentale” au tribunal de
la famille, par les antiféministes, au Québec », Communication au colloque Antiféminismes et
masculinismes d’hier et d’aujourd’hui, Université d’Angers, 4 mars 2017.
DAUPHIN, Sandrine. 2010. L’État et les droits des femmes. Rennes : Presses universitaires de Rennes.
DELPHY, Christine. 2001. L’ennemi principal. Penser le Genre. Paris : Éditions Syllepses.
DELPHY, Christine. 2010. « Retrouver l’élan du féminisme », in Un universalisme si particulier,
DELPHY, Christine. Paris : Éditions Syllepses, 69‑75.
DESCARRIES, Francine. 2005. « L’antiféminisme “ordinaire” » Recherches féministes 18(2) : 137‑151.
DEVREUX, Anne-Marie & LAMOUREUX, Diane. 2012. « Les antiféminismes : une nébuleuse aux
manifestations tangibles » Cahiers du Genre 52(1) : 7-22.
DUPUIS-DÉRI, Francis. 2013. « L’antiféminisme d’État » Lien social et Politiques 69 : 163-180.
DUPUIS-DÉRI, Francis. 2015. « Postféminisme et antiféminisme », in Les antiféminismes. Analyse d’un
discours réactionnaire, DUPUIS-DERI, Francis. Les Éditions du Remue ménage : Montréal, 129‑148.
FILLOD-CHABAUD, Aurélie. 2014. Au nom du père. Une sociologie comparative du militantisme paternel en
France et au Québec. Thèse de doctorat, Florence, European University Institute.
GENZ, Stéphanie. 2006. « Third way/ve: The politics of postfeminism » Feminist Theory 7(3) :
333-353.
GOURARIER, Mélanie. 2017. Alpha mâle. Séduire les femmes pour s’apprécier entre hommes. Paris : Seuil.
HALL, Elaine J. & RODRIGUEZ, Marnie S. 2003. « The myth of postfeminism » Gender & Society 17(6) :
878-902.
HAWKESWORTH, Mary. 2004. « The Semiotics of Premature Burial: Feminism in a Postfeminist Age »
Signs 29(4): 961-985.
HIRSCHMAN, Albert. 1991. Deux siècles de rhétorique réactionnaire. Paris : Fayard.
KLAUS, Elisabeth. 2010. « Antiféminisme et féminisme élitiste en Allemagne : les termes du débat »
Travail, genre et sociétés 24(2) : 151-165.
LAMOUREUX, Diane. 2008. « Un terreau antiféministe », in Le mouvement masculiniste au Québec,
l’antiféminisme démasqué, LAMOUREUX, Diane. Montréal : Les Éditions du Remue ménage, Montréal,
55-73.
LEFORT, Étienne. 2017. « Qui parle, et de quoi, dans les groupes de paroles des associations pour le
“droit des pères” ? », Communication au colloque Antiféminismes et masculinismes d’hier et
d’aujourd’hui, Université d’Angers, 4 mars 2017.
RABENORO, Mireille. 2012. « Le mythe des femmes au pouvoir, arme de l’antiféminisme à
Madagascar » Cahiers du Genre 52(1) : 75-95.
NOTES
1. L’atelier Arpège-EFiGiES Toulouse est animé par de jeunes chercheuses en études genre issues
de diverses disciplines (histoire, sociologie, anthropologie). Pour plus d’information sur l’atelier :
https://efigies-ateliers.hypotheses.org/category/efigies-toulouse
GLAD!, 04 | 2018
14
2. Dans un article paru en avril dans Libération, Martine Storti dénonce cet antiféminisme qui se
dit « féministe » venu de femmes publiant dans la revue d’extrême-droite Limite, et qui prônent
un « féminisme intégral » contre la « médicalisation » du corps des femmes, par exemple. Il
s’agit, en fait, d’un exemple typique d’écoblanchiment (greenwashing) des pires idées
réactionnaires. « Attention, détournements de féminismes », Libération, 25 avril 2018 2018
http://www.liberation.fr/debats/2018/04/25/attention-detournements-de-feminismes_1645862,
consulté le 9 juin 2018.
3. Pour des recherches déjà achevées voir par exemple Fillod-Chabaud (2014) ou Gourarier (2017),
et pour des recherches en cours voir outre celles présentées dans ce dossier Andriamandroso
(2017) ou Lefort (2017).
4. Voir l’exposition virtuelle de Christine Bard et Valérie Neveu « Visages du suffragisme
français », en particulier la section « Les évolutions de l’argumentaire antiféministe », sur le site
Muséa http://musea.univ-angers.fr, consulté le 09 juin 2018
5. Voir l’exposition de Bard et Neveu citée précédemment.
6. Nous faisons référence aux prises de parole publiques d’actrices qui ont dénoncé au cours de
l’été 2017 les violences sexuelles exercées par le producteur américain Harvey Weinstein.
7. Notamment Lola Lafon dans l’émission « Harcèlement sexuel : le grand déballage », Le nouveau
rendez-vous, France Inter, 23 octobre 2017. https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-
rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-23-octobre-2017-0
8. « Contre la pénalisation du harcèlement de rue », Libération, 26 septembre 2017. http://
www.liberation.fr/debats/2017/09/26/contre-la-penalisation-du-harcelement-de-rue_1599121
INDEX
Thèmes : Recherches
Mots-clés : argumentation, misogynie, masculinisme, rhétorique, antiféminisme
Keywords : argumentation, misogyny, masculinism, rhetoric, antifeminism
AUTEURS
AURÉLINE CARDOSO
Auréline Cardoso est doctorante en sociologie à l'Université Toulouse II Jean Jaurès, au CERTOP.
Sa thèse porte sur l'usure au travail dans les associations féministes. Elle est co-fondatrice du
collectif Arpège-EFiGiES-Toulouse, créé en septembre 2015. Ce collectif vise à proposer des
espaces d'échange de savoirs autour du genre en tentant de placer savoirs professionnels,
militants, pratiques et académiques sur un pied d'égalité.
CHARLOTTE THEVENET
Doctorante en littérature française à University College London (SELCS, French), Charlotte
Thevenet prépare une thèse sur la rhétorique du commentaire chez Jacques Derrida.
GLAD!, 04 | 2018
15
Des féministes qui ne sont pasféministes ? Écrivaines et lutte des femmes en France des années 1970 auxannées 1980
Feminists Who Are Not Feminists? Women Writers and Women's Struggle in
France from the 1970s to the 1980s
Audrey Lasserre
1 En 1978, lorsque Jean-François Lyotard signe pour la revue américaine SubStance « One
of the Things at Stake in Women’s Struggles », il choisit de désigner Luce Irigaray
comme féministe en escortant le terme de guillemets 1. L’usage d’une ponctuation
d’escorte, loin d’être isolé2, signale que qualifier de féministe une écrivaine et/ou une
théoricienne liée au Mouvement de libération des femmes en France ne va pas de soi.
Décrivant son expérience du Mouvement des femmes aux États-Unis, l’écrivaine et
philosophe Françoise Collin prévient ainsi dès 1972 : « on hésite parfois à utiliser le
terme de “féministe” qui est attaché à une certaine tradition et à une certaine forme de
lutte, le terme de mouvement des femmes, Women’s Movement, est plus juste.3 »
2 Pourtant, en France, c’est bien la lutte féministe de la première vague des suffragettes
qui est revendiquée par certaines femmes du moins, dès l’origine du Mouvement.
Christine Delphy et Monique Wittig se regroupent avec d’autres sous l’appellation des
Féministes révolutionnaires, qui, plus qu’un groupe, devient rapidement une tendance
du Mouvement des femmes. Leur féminisme est résolument matérialiste4. Un second
groupe guidé par Antoinette Fouque, Psychanalyse et Politique, et les femmes qui en
sont proches (Luce Irigaray ou Hélène Cixous notamment) se définissent alors, en
réaction, résolument non féministes et antiféministes. De cette tendance que l’on dira
par la suite différentialiste5 procèdent du point de vue éditorial, les Éditions Des
femmes, et du point de vue littéraire, l’écriture féminine.
3 Le travail de Psychanalyse et Politique consiste, dans la lignée de la rupture inaugurée
par mai 1968, et non dans la continuité des mouvements de femmes du siècle passé et
de la pensée du Deuxième Sexe, à « déconstruire le féminisme comme idéologie et à faire
émerger un sujet femme.6 » Or pour celles qui se revendiquent féministes le travail
GLAD!, 04 | 2018
17
consiste, dans la lignée de la rupture consacrée par mai 1968, et dans la continuité des
mouvements de femmes du siècle passé et de la pensée du Deuxième Sexe, à déconstruire
la femme comme idéologie et à faire émerger un sujet dépris du féminin.
4 On trouvera donc ici l’histoire apparemment paradoxale des écrivaines de France
luttant en tant que femmes pour la libération des femmes mais refusant pour la
plupart, de façon motivée, de se désigner comme féministes. La littérature et les
autrices qui sont ci-dessous mentionnées ont certes joué un rôle essentiel dans un
mouvement des femmes que l’on sait social, politique et culturel7. Mais surtout,
l’écriture — pour reprendre la terminologie de l’époque — et le travail sur le langage
sont devenus, à partir d’un certain moment et d’autant plus vues de l’étranger, le lieu
du Mouvement des femmes lui-même8. Retracer les prises de position des écrivaines
« féministes », positions qui vont jusqu’à l’antiféminisme, en passant par le refus du
féminisme et le post-féminisme, contribue donc à une histoire littéraire autant qu’à
une histoire des idées : l’une des caractéristiques premières de la plupart des
« féministes » de France serait ainsi de ne savoir se désigner comme telles, moins par
méconnaissance de la longue histoire du féminisme et de ses complexités que par la
conviction de l’inadéquation idéologique et pragmatique du féminisme aux nécessités
de la libération des femmes. Ce refus témoigne du lien que le féminisme entretient à
cette époque avec l’avant-garde littéraire, laquelle s’accommode mal de la domination
du seul principe politique sur des textes littéraires qui entendent proposer une autre
révolution.
Le féminisme : « une idéologie réactionnaire »
5 En 1978, Carolyn Greenstein Burke9, qui rend compte aux États-Unis et pour la revue
Signs de la crise qui divise le Mouvement de libération des femmes en France, attribue
cette tension au clivage entre celles qui se définissent comme féministes et celles qui,
différentialistes, s’opposent à un féminisme jugé réformiste ou réactionnaire. Si la
divergence entre féministes révolutionnaires et participantes au groupe Psychanalyse
et Politique existe depuis les origines du Mouvement, c’est en effet depuis le début de
l’année 1977 que la divergence s’est muée en véritable différend. Le numéro de la Revue
des sciences humaines, « Écriture, féminité, féminisme », mis en œuvre par Françoise van
Rossum-Guyon, entérine la condamnation sans appel du féminisme, par Hélène Cixous
comme par Julia Kristeva qui y sont interrogées toutes deux.
6 C’est dans cet entretien entre « Hélène » et « Françoise », la mention des seuls prénoms
reprenant les codes de présentation d’un mouvement où l’on refuse le patronyme
patriarcal10, que, en négatif de l’affirmation beauvoirienne de 197211, Hélène Cixous
refuse de se dire féministe pour se déclarer dans un même élan résolument
antiféministe. « Pour moi, de façon extrêmement précise », explique Hélène Cixous, « le
féminisme aujourd’hui est une idéologie, qui à la limite, est réactionnaire.12 » Si le
procédé rhétorique de qualification révolutionnaire par la disqualification
réactionnaire n’est pas neuf13 au sein du Mouvement, l’attaque du féminisme par une
écrivaine qui, aux yeux du public, notamment de celui de la Revue des sciences humaines,
représente le Mouvement des femmes, et donc le féminisme14 (en littérature), est bien
plus significative. Faire du féminisme une idéologie revient également à occulter que le
féminisme est depuis les débuts du MLF une idée revendiquée et défendue par un
groupe (les Féministes révolutionnaires) dont les membres ont été parmi les pionnières
GLAD!, 04 | 2018
18
de la lutte des femmes en France et les plus actives du point de vue des actions
publiques entreprises.
7 La position d’Hélène Cixous à l’égard du féminisme se comprend dans le contexte de
cette divergence devenue querelle entre deux tendances du Mouvement. Mais loin de
rester dans un dialogue certes conflictuel avec une tendance politique et littéraire qui
n’est pas la sienne, l’écrivaine déplace stratégiquement le débat, opposant le
féminisme, comme idéologie, au Mouvement des femmes (défini comme un collectif),
en précisant que le premier entrave littéralement le second :
Avant l’existence de ce qu’on appelle le « Mouvement des femmes », cela [leféminisme] renvoyait à quelque chose, dont l’histoire faisait d’ailleurs assez peu decas, et qui était la tentative ponctuelle ou régionale de la part des femmes, àl’intérieur d’un certain système culturel et politique, d’appeler l’attention sur « lacondition » des femmes. À notre époque, se dire féministe signifie quelque chose detout à fait autre. C’est un certain comportement, encore une fois pris dans unecertaine idéologie, dont les effets sont des effets d’arrêt du mouvement (je veuxdire le « mouvement des femmes »).15
8 Du point de vue diachronique, en distinguant le premier féminisme du deuxième,
Hélène Cixous refuse la filiation d’un mouvement politique (le Mouvement de
libération des femmes) à un mouvement politique qui l’a précédé (le mouvement des
suffragettes). Cette distinction est le préalable nécessaire à la réduction du féminisme à
un ensemble d’idées par opposition à un ensemble d’actions pourtant déjà réalisées par
certaines des femmes du MLF au nom du même féminisme. Du point de vue
synchronique, son interprétation sort de la dispute, pourtant signifiante, entre deux
options politiques et littéraires pour procéder à l’identification du Mouvement des
femmes au seul courant différentialiste, au détriment de la tendance et du groupe des
Féministes révolutionnaires, comme des idées qu’elles défendent. Rappelons qu’Hélène
Cixous figure à l’époque dans la liste des six « ami-e-s politiques, précieux parce que
sûrs16 » de Psychanalyse et Politique.
9 Ainsi lorsque Françoise van Rossum-Guyon propose de voir malgré tout dans la position
d’Hélène Cixous « un certain type de “féminisme”17 », l’autrice répond sans ambiguïté
par la négative. Face au « déferlement du mot de tous les côtés18 », c’est-à-dire à un
usage démultiplié du terme, elle se dit contrainte de refuser le féminisme qui relève, de
son point de vue, soit d’une phase pré-politique que le Mouvement des femmes a
dépassée, soit d’un parti politique qui ne vise que l’acquisition d’un pouvoir social, soit
encore de l’adéquation systématique et irréfléchie entre femme et féministe. Ces trois
positions sont bien éloignées de l’objectif révolutionnaire qu’Hélène Cixous fixe au
Mouvement, mûri au sein des « lieux où s’élaborent une réflexion politique sur la
femme, l’histoire et l’idéologie » qu’elle mentionne explicitement : « je pense à
l’avancée ouvrante, opérée par la pensée et la pratique radicalement transformatrices
des femmes du groupe Politique et Psychanalyse19 ». Les féministes relèvent, quant à elles,
des lieux qui se situent « dans l’en-deça » (sic).
10 C’est dans ce même numéro coordonné par Françoise van Rossum-Guyon que Julia
Kristeva se livre également à une critique du féminisme, mais pour des motifs, nous
semble-t-il, bien différents de ceux d’Hélène Cixous. Ce n’est en effet pas au nom du
Mouvement des femmes, réduit au seul différentialisme, que Julia Kristeva nourrit ses
observations contre le féminisme, mais bien contre le Mouvement des femmes, dans
son ensemble, toutes tendances confondues. Elle dénonce ainsi la « bouderie
esclavagiste20 » qui le caractérise au motif que la reconnaissance sociopolitique des
GLAD!, 04 | 2018
19
femmes est sur le point de se réaliser en France, laissant de côté le fait que si réalisation
il y a, c’est grâce à l’action des femmes, notamment des féministes, qui y est menée
depuis presque dix ans à l’époque.
11 Dans cet entretien, la théoricienne critique aussi bien les féministes matérialistes que
les différentialistes prônant la féminitude car elle reste « persuadée que celles qui vont
à la problématique féminine non pas par recherche de leur singularité mais pour se
retrouver en communauté avec “toutes les femmes”, le font d’abord pour éviter de se
voir particulière et finissent en dernière instance par la déception ou l’adhésion
dogmatique.21 » Opposant la réalisation de l’individu dans sa singularité à la logique du
groupe qui anime le Mouvement des femmes, elle met en garde contre « le devenir-
secte des groupes féminins22 », la même année où Nadja Ringart, nous y reviendrons,
publie un témoignage accablant sur les pratiques sectaires du groupe d’Antoinette
Fouque dans Libération23. Julia Kristeva assimile à cette occasion le discours de la
féminitude à celui de l’antisémitisme des « penseurs de l’Allemagne nazie », concluant
que « personne n’est à l’abri du totalitarisme, les femmes pas plus que les hommes24 ».
L’attaque est sévère et clairement dirigée contre l’ensemble du Mouvement des
femmes, dont la génération démocratique et spontanée est ici oubliée. Cette prise de
position n’est certainement pas étrangère au conflit 25— dont on peut lire le récit
transposé dans son roman Les Samouraïs (1990)26 — qui l’a opposée au groupe Éditions
des femmes et plus particulièrement à Antoinette Fouque lors de la remise du
manuscrit des Chinoises en 1975. Cet épisode aurait ainsi signé « la fin de son
militantisme féministe, chinois ou autre27 ».
12 Or la pensée de Julia Kristeva est, dans cet entretien, extrêmement proche de celle que
donne à lire la poète et essayiste Annie Le Brun la même année dans son pamphlet,
Lâchez tout. Ne distinguant pas le féminisme matérialiste du différentialisme, Annie Le
Brun dénonce en effet ce qu’elle appelle le « néo-féminisme » comme un totalitarisme.
Elle y pointe le fonctionnement et les effets de ce qu’elle considère comme une
propagande idéologique fondée sur l’éloge de la différence sexuelle féminine et qu’elle
appelle « le terrorisme idéologique de la femellitude28 », reprenant le néologisme forgé
par Xavière Gauthier dans Surréalisme et Sexualité29. Le patriarcat, ou plus précisément
l’homme, à l’origine des maux des femmes, devient, dans Lâchez tout, l’ennemi commun
qui fonde et justifie le rassemblement des femmes, dans une logique « grégaire »,
logique de masse à laquelle on fournit un bouc émissaire, ce qui n’est pas sans rappeler,
fait remarquer Annie Le Brun, les analyses d’Hannah Arendt dans Le Système totalitaire.
La démonstration, quoique plus détaillée, est donc similaire à celle de Julia Kristeva,
seul l’exemple donné à titre de comparaison varie : le nazisme pour Julia Kristeva, le
communisme pour Annie Le Brun.
13 L’année 1977 voit ainsi le début d’une critique appuyée du féminisme, soit par les
intellectuelles et écrivaines qui dénoncent le Mouvement des femmes comme un
nouveau totalitarisme, soit par des écrivaines différentialistes, qui, défendant la
différence, choisissent non seulement de prendre position contre le féminisme mais
encore de superposer le Mouvement des femmes à leur seule position révolutionnaire,
faisant du féminisme un réformisme passéiste.
14 La même année, les Éditions Des femmes publient Histoire du féminisme français du
Moyen-âge à nos jours. Psychanalyse et Politique refuse — tout à fait logiquement — de
figurer dans le chapitre consacré au Mouvement de libération des femmes. Une note
éditoriale est placée à la fin de l’ouvrage en « hors-texte » par « celles des éditions des
GLAD!, 04 | 2018
20
femmes / groupe psychanalyse et politique / mouvement de libération des femmes30 ».
Les signataires revendiquent le choix de ne pas figurer dans cette Histoire du féminisme
français comme « un geste politique délibéré », geste d’opposition au féminisme
puisque, précisent-elles, « nos pratiques dans ce mouvement, sociales-politiques,
théoriques ne reviendront jamais au même (quoique tant veuillent s’y méprendre et
coûte que coûte ces malentendus)31 ». Ce refus permet aux femmes de Psychanalyse et
Politique de s’inscrire dans le présent de la lutte et non dans le passé, certes proche,
d’un combat qui a été, et qui est d’ailleurs présenté dans l’ambiguïté sémantique du
terme comme un « passif ».
15 C’est également dans Libération, le 1er juin 1977, que Nadja Ringart, militante féministe
du Mouvement, ayant participé au groupe Psychanalyse et Politique à ses débuts,
raconte « La naissance d’une secte ». « L’anathème, à l’initiative d’une femme et d’une
seule, Antoinette, est venu frapper… les féministes » explique-t-elle alors, « nous avons
été nombreuses à trébucher dans le piège.32 » Car si l’expression d’une virulente
critique du féminisme trouve à se formuler en fin de décennie, c’est bien dès 1970,
qu’Antoinette Fouque refuse le terme de féminisme, après la lecture du manifeste de
FMA33 par Anne Zelensky, au motif que « sous couvert de luttes des femmes, [celui-ci]
ne fai[t] que reconduire l’ordre masculin et l’idéologie dominante34 ». Elle n’aura de
cesse d’affirmer ce refus au sein du groupe Psychanalyse et Politique.
« Les voiles flasques du féminisme » : détour par lepost-féminisme
16 En 1977 toujours, Annie Le Brun donne de façon tout à fait provocante un entretien à la
presse sous l’égide d’un « Le féminisme, c’est fini35 » ; l’initiative reste cependant isolée,
contribuant d’ailleurs à l’effet de provocation. Deux ans plus tard, le discours du « post-
féminisme » prend en revanche son essor et s’appuie sur des plumes non seulement
différentialistes mais encore de femmes politiques extérieures au Mouvement des
femmes. Ce discours trouve sa voix pour la première fois au début de l’année 1979,
lorsque Maria Antonietta Macciocchi préface Les Femmes et leurs Maîtres. Sous le titre
« Le post-féminisme », l’universitaire, telquelienne et maoïste, y annonce la mort des
« féministes historiques » : « Nous naviguons déjà dans l’estuaire du Post-Féminisme,
les voiles flasques.36 » La métaphore de l’allure maritime signifie sans ambiguïté que
l’heure n’est plus au mouvement (des femmes) mais à la transition vers un ailleurs : le
post-féminisme augure l’après d’un engagement alors que l’estuaire matérialise tout à la
fois, parce qu’il est entre fleuve et mer, l’entre-deux et la transition.
17 « À quoi une préface sert-elle ? Presque à rien, à condition qu’on prenne la peine de la
lire » : ces premiers mots de Maria Antonietta Macciocchi ont été lus et entendus.
Françoise Giroud, ancienne secrétaire d’État chargée de la Condition féminine, rend
élogieusement compte de l’ouvrage dans Le Monde du 7 avril 1979, sous le titre « Les
voiles flasques du féminisme », reprenant l’image liminaire convoquée par Maria
Antonietta Macciocchi. Ce soutien offre une caisse de résonance aux propos de la
sociologue. Plusieurs femmes du Mouvement de libération des femmes souhaitent
également exercer collectivement leur droit de réponse ; le quotidien leur en promet la
publication qui reste néanmoins lettre morte. « Des hystériques aux historiques, ou de
la caricature à l’enterrement », est ainsi publié à l’automne 1979 dans Questions
féministes et La Revue d’en face, par une douzaine de militantes qui dénoncent ces
GLAD!, 04 | 2018
21
« quelques intellectuelles en mal de sujet » qui « viennent […] jouer les mères
poignards, dans le dos, toujours dans le dos d’une cause où on ne les a jamais vues venir
de face.37 » Le texte est signé par des féministes du « Collectif contre le viol », d’« Elles
voient rouge », de la revue Histoires d’elles, du Planning Familial, de la Ligue du droit des
femmes, du Centre Flora Tristan, de la revue Questions féministes, de La Revue d’en face,
du MLAC, des Féministes révolutionnaires du groupe Amiens-Beauvais, de la revue
Remue menage, de SOS femmes alternatives, ainsi que par des féministes hors groupe.
C’est presque tout le Mouvement des femmes qui se trouve réuni par ces signatures, à
l’exception, cohérente, du groupe Psychanalyse et Politique et des Éditions Des femmes.
18 Car le discours du post-féminisme trouve à alimenter dans le même temps
l’antiféminisme qu’Antoinette Fouque formule depuis les origines du Mouvement. Dans
« La révolution est un travail » qui paraît dans Libération en juin 1974, les membres du
groupe Politique et Psychanalyse affirment ainsi, annonçant les propos tenus par
Hélène Cixous trois ans plus tard, que « [l]e féminisme n’est pas la lutte des femmes, la
lutte des femmes passe par une lutte contre le féminisme. Le féminisme, comme
idéologie (de l’avant-garde bourgeoise au réformisme), maintient le pouvoir en place
dans un processus répétitif, oppositionnel, provocatoire.38 » Dans Le Quotidien des
femmes, presse de Psychanalyse et Politique et de la maison d’édition Des femmes, en
mars 1975, le féminisme devient « la dernière forme historique du patriarcat39 ».
L’année suivante, en mars 1976, Le Quotidien des femmes publie « Féminismes ou lutte de
femmes40 », intervention de Benoîte Groult le 6 décembre 1975 à la maison pour tous et
retransmis par France culture au cours duquel « une femme », dont le discours
l’apparente au groupe Psychanalyse et Politique, explique à l’autrice d’Ainsi soit elle que
toutes les femmes du Mouvement ne sont pas féministes.
19 La remarque alors formulée publiquement à Benoîte Groult, qui restait extérieure au
MLF tout en lui apportant son soutien et en se disant féministe, va plus loin qu’une
simple prise en compte de la diversité des positions au sein du Mouvement des femmes.
L’intervenante explique en effet que, pour sa part, elle n’est jamais devenue féministe,
percevant le féminisme comme une « idéologie41 », vectrice d’oppression pour les
femmes. Elle se définit ainsi au cours du débat comme « une femme en lutte […]
radicalement anti-féministe42 ». Le féminisme devient alors, par cette voix anonyme,
écho d’Antoinette Fouque elle-même, le risque pris par le combat pour l’égalité entre
hommes et femmes, celui d’une société où la distinction « sexuelle » serait à terme
abolie. Cette femme dit au contraire œuvrer contre « l’effacement définitif des femmes,
des femmes en tant que lieu d’une différence qui n’a jamais eu lieu, en tant que non
lieu43 ». Cette dernière précision polarise le travail sur la différence du côté de la
subversion d’une avant-garde auquel le féminisme, conservateur et réformisme, ne
saurait donc prétendre.
20 S’il existe des signes d’une opposition constante d’Antoinette Fouque et du groupe
Psychanalyse et Politique au féminisme, l’année 1979 voit les attaques redoubler et
s’accentuer, toujours par voie de presse spécialisée. Des femmes en mouvement, journal de
Psychanalyse et Politique et de la maison d’édition Des femmes qui a pris la succession
du Quotidien des femmes, permet d’établir un florilège. Dès le premier numéro qui paraît
en novembre 1979, un compte rendu du colloque « The Second Sex : Thirty Years later »
qui a eu lieu en septembre aux États-Unis, et sur lequel nous reviendrons, interroge « la
quasi nullité de la “pensée” dite “féministe” qui entraînait la forme creuse de cette
Conférence de Sourdes44 » et critique tout autant le féminisme américain en général
GLAD!, 04 | 2018
22
que Simone de Beauvoir ou Monique Wittig qui y donnait en manière de conférence
« On ne naît pas femme ».
21 L’année suivante, lors d’une discussion avec le sociologue Alain Touraine, reproduite
dans l’hebdomadaire du 29 février au 7 mars, Marie-Claude [Grumbach] rappelle la
spécificité du Mouvement des femmes, qui est, de son point de vue, la qualité d’analyste
et d’agente des militantes, pour expliquer que « c’est à partir de cette position qu’a pu
être faite la critique du féminisme comme idéologie impérialisante des luttes des
femmes45 ». L’année 1980 prolonge les critiques par deux entretiens, l’un avec
l’écrivaine féministe américaine Kate Millett, à nouveau publié en mai dans Des femmes
en mouvement hebdo et l’autre avec Catherine Clément en juillet dans Le Matin de Paris.
22 Dans cet entretien réalisé deux ans plus tôt et intitulé en référence aux propos
d’Antoinette Fouque « Le féminisme de la non-différence — sexuelle, économique,
politique — est l’atout maître du gynocide46 », les textes comme la personne de Kate
Millett mettent en valeur une autre parole, celle de l’intervieweuse Antoinette Fouque.
Le titre n’est pas le seul élément textuel qui est emprunté aux propos de la cheffe de file
du groupe Psychanalyse et Politique et de la maison d’édition Des femmes, c’est la
majorité des citations d’accroche qui le sont.
23 Antoinette Fouque formule, grâce à cet entretien, trois critiques majeures contre le
féminisme. Comme le titre l’indique, le féminisme (matérialiste) est perçu comme un
levier essentiel du gynocide qui caractériserait la « phallocratie ». Dans la mesure où le
féminisme (matérialiste) espère l’abolition des classes de sexe, il procède donc, au
même titre que le système qu’il entend combattre, au meurtre de la femme (ou du
féminin). Le féminisme est en conséquence défini comme « l’adversaire du Mouvement
de Libération des femmes », ainsi qu’Hélène Cixous l’avait déjà formulé en 1977. Enfin,
en cette période d’élections législatives en France, Antoinette Fouque constate que le
féminisme ne cherche qu’à prendre le pouvoir (masculin) ; il est donc réformiste et non
révolutionnaire.
24 C’est à partir de cette triple critique du féminisme que, se solidarisant pour l’occasion
avec celles qui sont toujours dans l’erreur (féministe), Antoinette Fouque conclut
l’entretien sur un appel à la désertion de la phallocratie, et donc de son « atout
maître », le féminisme. « Nous avons toutes été, nous sommes probablement encore
toutes, au titre de mères — épouses – filles… féminines — féministes, des prostituées de
l’Histoire. Notre honneur de femmes en luttes de libérations aujourd’hui, est de dire
non aux Prostitutions47 » exhorte-t-elle. Les féministes se définissent donc, comme la
mère, l’épouse et la fille, par rapport à l’homme ou plus exactement au père, selon
Antoinette Fouque. On entrevoit ici l’influence de la psychanalyse, notamment
lacanienne, sur sa conception du politique. Prétendre à l’égalité, notamment politique,
avec les hommes, revient donc, de son point de vue, à se prostituer pour obtenir un
pouvoir qui est par définition ici phallique.
25 À Catherine Clément, qui a publié avec Hélène Cixous La Jeune née en 1977 et qui dirige
également avec elle la collection « Féminin futur », Antoinette Fouque précise, une fois
encore dans la continuité de la déclaration d’Hélène Cixous en 1977, « nous tenions à
affirmer que nous ne sommes pas féministes. Ce qui voulait dire, ce qui veut dire : le
féminisme n’est pas le point d’arrivée de notre révolution. Nous ne sommes ni anté, ni
anti, mais “post-féministes”48 ». Antoinette Fouque répond ici implicitement à « Proto-
féminisme et anti-féminisme49 » de Christine Delphy, texte paru dans Les Temps
modernes et également diffusé comme une brochure des Féministes révolutionnaires50.
GLAD!, 04 | 2018
23
Christine Delphy était la première à s’inquiéter publiquement en 1975 de l’affirmation
littéraire, à travers Parole de femme, d’un différentialisme51, alors politiquement discuté
au sein du groupe Psychanalyse et Politique. Son texte cherchait à démontrer que
l’ouvrage d’Annie Leclerc, comme le différentialisme lui-même, part du proto-
féminisme, c’est-à-dire d’une phase pensée comme antérieure au féminisme, pour
aboutir à l’antiféminisme. En fin de décennie, au moment où Psychanalyse et Politique
se choisit pour nouveau slogan « nous nous sommes libérées de l’oppression »,
Antoinette Fouque appuie ainsi le discours général qui consacre l’après du féminisme
pour transformer un antiféminisme assumé en post-féminisme.
« Nous en France » ou l’invention du « FrenchFeminism »
26 Du 27 au 29 septembre 1979, devant presque un millier de femmes, un colloque est
organisé par le New York Institute for the Humanities autour du Deuxième Sexe sous le
titre « The Second Sex : Thirty Years later, a commemorative conference on feminist
theory ». Loin d’être célébrée comme un monument vivant, l’œuvre de Beauvoir y est,
au choix, renvoyée au passé ou jugée dépassée, ce dont témoigne d’ailleurs le peu de
contributions de la rencontre centrées sur Beauvoir elle-même. Le geste de femmage
que constitue le colloque est ainsi paradoxal, tout comme les articles signés dans la
presse en cette année 1979. Ceux-ci disent aussi bien l’avancée que représentait l’essai
de Simone de Beauvoir en 1949 que le dépassement dont il fait l’objet en 1979.
27 Deux phénomènes se révèlent alors au moment de ce colloque : l’affirmation du
différentialisme, devenu sous l’appellation américaine le « French Feminism », comme
la seule option littéraire et politique du mouvement français, et celle du lesbianisme
politique, comme avenir du féminisme. Tous deux se définissent comme des post-
féminismes et sont liés par le différend de la différence qui les oppose pourtant. Le
premier est porté par Hélène Cixous, le second par Monique Wittig : leur altercation
publique52 au cours du colloque consacré au Deuxième Sexe est en ce sens tout aussi
signifiante que leurs communications qui pour l’occasion sont respectivement
intitulées « Poésie e(s)t politique53 » et « On ne naît pas femme54 ».
28 Voici comment l’histoire nous est contée : le 27 septembre, à la suite de la session au
cours de laquelle interviennent Christine Delphy, Monique Wittig et Michèle Le Dœuff,
le premier jour du congrès, Hélène Cixous aurait souhaité discuter chacune des
interventions précédentes lors de sa propre communication. C’est dans ce contexte
qu’elle aurait affirmé « nous en France nous ne nous appelons plus féministes parce que
nous avons abandonné ce point de vue négatif […] nous en France nous ne nous
appelons plus lesbiennes, parce que c’est un mot négatif et péjoratif55 ». « [Q]ui ça, “nous
en France”, qui ça ? » lui aurait rétorqué Monique Wittig, s’insurgeant de ce qu’elle
estimait une contrefaçon de la position « française ». L’anecdote, attestée par plusieurs
participantes56, intéresse en ce qu’elle incarne la lutte d’une histoire politique et
littéraire en train de se faire, autour de l’objectif et de la définition d’un mouvement
révolutionnaire.
29 S’il est vrai que Monique Wittig a quitté le sol français depuis 1976 pour vivre et
enseigner aux États-Unis, Christine Delphy et Michèle Le Dœuff vivent bel et bien en
France, y mènent leur recherche et y enseignent. Caïmane à l’ENS Fontenay-sous-Bois,
GLAD!, 04 | 2018
24
Michèle Le Dœuff présente pour l’occasion une communication sur les relations entre
féminisme et existentialisme dans l’œuvre de Simone de Beauvoir ; elle milite par
ailleurs au MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception)
depuis 1973. Christine Delphy comme Monique Wittig représentent de surcroît la
tendance des Féministes révolutionnaires à laquelle s’oppose Psychanalyse et Politique,
et le féminisme matérialiste dont on vient de voir qu’Hélène Cixous le considère comme
une idéologie réactionnaire qui entrave le Mouvement des femmes.
30 Il n’est pas inutile d’anticiper ici la question des crises que traverse le Mouvement des
femmes en cette fin de décennie pour préciser qu’Antoinette Fouque vient de créer
quelques semaines plus tôt l’association loi 1901 « Mouvement de Libération des
Femmes – Psychanalyse et Politique », et s’apprête à déposer la marque commerciale
« Mouvement de Libération des Femmes – MLF » à l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI). L’affirmation du différentialisme de France comme seule option
révolutionnaire portée par le Mouvement des femmes, en dépassement d’un féminisme
passéiste, se produit donc dans le même temps que la tentative d’appropriation
(revendiquée comme une sauvegarde) de tout le Mouvement de libération des femmes
par un seul de ses groupes devenu tendance, Psychanalyse et Politique.
31 Faisant retour, de façon générale, sur les conflits qui ont marqué le Mouvement des
femmes à la fin des années 1970, Françoise Collin a mis en avant l’usage comme la
réalité problématiques du « nous » collectif : « Les dérives et règlements de compte
entre femmes qu’a connus le premier féminisme », expliquait-elle à Nadine Plateau en
2011, « tenaient sans doute principalement à la projection d’un “nous” fusionnel que
chacune pouvait annexer à son profit et qui ne prenait pas en considération la
persistance légitime et indispensable des “je” dans tout “nous”57 ». En 1979, Hélène
Cixous, et derrière elle le différentialisme du groupe Psychanalyse et Politique,
« annexent » à proprement parler le « nous » de la lutte des femmes en France pour en
exclure, d’une part, les féministes et, d’autre part, les lesbiennes, dont certaines, à
l’instar de Monique Wittig, revendiquent à cette époque leur position politique comme
seule issue porteuse d’avenir pour le féminisme en France.
32 « Nous en France » permet donc de subsumer Psychanalyse et Politique et le
différentialisme sous le Mouvement des femmes en France. Mais si l’opération est à ce
moment possible, c’est aussi parce que le principe a déjà en France et surtout aux États-
Unis quelque fondement. La réduction du féminisme à une idéologie comme le passage
d’une critique antiféministe à une critique post-féministe l’autorise certes. Mais à
travers cette « annexion », on perçoit en amont le travail effectué et la surface de
reconnaissance acquise par les périodiques spécialisés et la maison des Éditions Des
femmes emmenés par Antoinette Fouque, par certaines membres du pôle universitaire
de l’Université Paris 8, centre universitaire expérimental, qui s’est doté, grâce à Hélène
Cixous, d’un centre d’études féminines depuis 1974. À Vincennes, par exemple,
enseignent ou ont animé des séminaires Antoinette Fouque, Serge Leclerc, Michèle
Montrelay et Luce Irigaray.
33 Cette production tout comme l’aura intellectuelle qui l’accompagne s’inscrit dans le
contexte d’un import de la pensée française aux États-Unis, désignée à l’époque sous le
vocable de « French Theory58 ». Il n’est d’ailleurs pas étonnant que ce soit les États-Unis
qui accueillent le colloque consacré au trentenaire du Deuxième Sexe, colloque où
s’affirment deux discours post-féministes « français », et où s’affrontent deux
écrivaines de France les plus représentatives de la décennie : Hélène Cixous et Monique
GLAD!, 04 | 2018
25
Wittig. Cette importation de la pensée française se matérialise non par la reproduction
mais bien dans la « translation » et l’« appropriation59 », comme l’ont montré Christine
Planté et Eleni Varikas à propos du « French Feminism » dans leurs contributions
respectives au collectif Féminismes au présent60. Tout comme la pensée française devient
la « French Theory », l’une ne recoupant que partiellement l’autre, le féminisme
français devient le « French Feminism », dont Hélène Cixous, Julia Kristeva et Luce
Irigaray, toutes trois opposées au féminisme, sont les seules représentantes.
34 Ainsi, dans l’anthologie préparée par Elaine Marks61 et Isabelle de Courtivron qui
devient rapidement une référence aux États-Unis, New French Feminisms : an Anthology,
publié l’année suivante, il n’est pas encore question de « French Feminism » mais déjà
de « French Feminisms » alors que les deux chevilles ouvrières du volume, spécialistes
de littérature française, retranscrivent, dans leur introduction, l’attaque vigoureuse
(« vigorous attack62 ») contre le féminisme menée par Psychanalyse et Politique et
Hélène Cixous. Elles s’en justifient en ces termes : « Nous avons néanmoins décidé de
mettre “Féminismes” dans notre titre parce qu’il n’y a pas encore de meilleur mot pour
rendre compte du phénomène que nous présentons.63 » Pour diffuser aux États-Unis les
textes produits dans le sillage du Mouvement des femmes, dans la complexité de
l’opposition entre l’avant-garde féministe et l’avant-garde de la néo-féminité, les
éditrices font donc le choix de voir dans leur dénominateur commun, « la conscience de
l’oppression-répression des femmes64 », un équivalent du féminisme.
35 Or sous la plume d’Elaine Marks, on trouvait, deux ans plus tôt, une autre définition du
féminisme. Celle-ci, quoique antérieure, semble tout aussi bien rendre compte des
choix opérés pour la constitution de l’anthologie. À l’été 1978, Elaine Marks présentait
en effet « Women and Literature in France » pour la revue Signs dans la section
« Review : French Literary Criticism ». Se référant à l’article de Carolyn Greenstein
Burke retraçant, dans le même numéro, les dernières avancées du Mouvement de
libération des femmes en France, Elaine Marks écrivait en note de bas de page de son
propre texte : « Les mots “féministe” et “féminisme” ont été attaqués par le groupe
Psychanalyse et Politique et par Hélène Cixous […]. J’utiliserai le mot “féministe”, entre
guillemets, pour désigner les femmes qui explorent les liens entre femmes et langage.65 » La
précision a de quoi surprendre tant elle laisse de côté la question du politique, et
notamment du rapport homme/femme, de l’aspiration à l’égalité ou à la libération,
pour définir le féminisme comme le travail, linguistique ou littéraire, d’avant-garde ou
expérimental (« explorent »), d’une femme sur la ou les femmes.
36 Les textes sélectionnés pour l’anthologie sont en ce sens révélateurs de la
reconnaissance aux États-Unis du différentialisme, au détriment du matérialisme et de
l’universalisme. Alors que le discours d’accompagnement de l’anthologie retrace le rôle
fondateur de Monique Wittig au sein du Mouvement des femmes en France, on ne
trouve d’elle qu’un seul de ses textes, Les Guérillères, fiction de 1969 sans difficulté
interprétable dans la logique de la définition du féminisme donnée en introduction de
l’anthologie ou de celle donnée par Elaine Marks en 1978. Par comparaison, Julia
Kristeva est convoquée à quatre reprises, Luce Irigaray et Hélène Cixous chacune à
deux reprises. Les écrivaines féministes représentées sont celles de la génération
précédente – Simone de Beauvoir à six reprises, Françoise d’Eaubonne à deux reprises,
et Christiane Rochefort pour une seule apparition. La section “Creations”, qui est la
plus révélatrice de la réception américaine de ce qui s’apprête à devenir le “French
Feminism”, comporte huit textes : sept relèvent de la tendance différentialiste (Xavière
GLAD!, 04 | 2018
26
Gauthier, Julia Kristeva66, Claudine Hermann, Marguerite Duras, Chantal Chawaf,
Madeleine Gagnon, Viviane Forrester) et un seul de la tendance matérialiste /
universaliste (Christiane Rochefort).
37 En 1981, Signs, dont Elaine Marks est une collaboratrice régulière, consacre le passage
des « French Feminisms » à la « French Feminist Theory67 », nom du dossier central qui
constitue son septième volume. L’éditorial explique la nécessité d’un numéro spécial
consacré à la « théorie féministe française » par la fortune que connaît la pensée
française en général aux États-Unis : « L’influence de la pensée française sur la théorie
féministe aux États-Unis, forte depuis la parution du Deuxième Sexe de Simone de
Beauvoir, semble maintenant devenir encore plus forte, et les opportunités
d’apprendre des penseurs/euses français-es se multiplient68 » commente le collectif de
Signs. C’est en fonction de cet intérêt grandissant du public américain qu’est donné à
lire dans cette livraison « le travail de quatre écrivains [sic] français [Julia Kristeva,
Hélène Cixous, Luce Irigaray, Christine Fauré] […] represent[ant] un échantillon des idées
qui s’échangent actuellement en France69. » Parmi les quatre écrivaines censées
représenter la théorie féministe française, trois refusent explicitement l’appellation
féministe, alors que la quatrième (Christine Fauré), sociologue et historienne, vient de
signer deux articles dans Les Temps modernes pour interroger la pratique, à l’époque
naissante, de l’histoire des femmes.
38 En cette même année 1981, Diane Griffin Crowder, Professor of French and Women
Studies à Cornell College, se souvient qu’« on parlait beaucoup de l’écriture féminine et,
aux États Unis, dans les cercles féministes académiques, les noms de Cixous, Irigaray, et
Kristeva faisaient fétiche. […] Cixous, Kristeva, et Irigaray à elles seules étaient vues
comme LE féminisme français70 ». Excluant de l’échantillon de théorie « féministe »
française celles qui, stricto sensu, l’ont véritablement écrites, le collectif éditorial de
Signs précise ainsi qu’il prévoit dans l’avenir de porter son attention sur d’autres
écrivain.es tel.les que Monique Wittig et Christine Delphy. L’intention reste
globalement lettre morte, car le collectif ne traduira aucun texte71 par la suite de ces
deux représentantes du féminisme matérialiste en France. Cette absence confirme
l’exclusion des théoriciennes féministes françaises de la « French Feminist Theory ».
39 Si Christine Delphy a pu qualifier de « démarche essentielle72 » l’invention du « French
Feminism », soutenant qu’il n’y a pas métonymie mais « invention pure et simple » de ce
féminisme à la française, si dès 1980 lors de la contestation collective du dépôt du MLF
comme marque par le groupe Psychanalyse et Politique, Simone de Beauvoir a pu
dénoncer, dans le texte liminaire à Chroniques d’une imposture, le fait que « [d]epuis
longtemps, cette petite secte [Psychanalyse et Politique] s’affirmait à l’étranger comme
l’unique incarnation valable du MLF73 », des chercheuses américaines ont elles aussi
analysé le phénomène de translation des courants français du MLF en un « French
feminism » réduit aux seuls noms Julia Kristeva, Hélène Cixous, et Luce Irigaray. C’est
notamment le cas de Claire Moses qui a interrogé à plusieurs reprises les raisons de
cette appropriation déformante.
40 Claire Moses74 a ainsi imputé l’émergence du « French Feminism » aux priorités
scientifiques des départements féministes américains qui privilégient à la fin des
années 1970 « le discours purement théorique75 » : cette « course à la théorie76 » est
également l’une des clés de compréhension données par Eleni Varikas dans
« Féminisme, modernité, postmodernisme : pour un dialogue des deux côté de
l’océan ». C’est en ce sens que Claire Moses voit dans le « French Feminism » une
GLAD!, 04 | 2018
27
preuve de l’impérialisme du monde universitaire américain qui a « exproprié un aspect
de la culture française, l’a appliqué [aux] objectifs américains, au mépris des Françaises
et du contexte français.77 »
41 Or, expliquant l’invention du « French Feminism » par le privilège accordé à la
littérature et aux écrivaines au détriment du social et des sociologues et historiennes,
dans des revues américaines et des anthologies faites par des spécialistes de littérature,
il nous semble que Claire Moses délaisse un phénomène d’histoire littéraire qui
privilégie tout autant une littérature et certaines écrivaines par rapport à d’autres. En
privilégiant, par leur sélection, l’avant-garde littéraire de la néo-féminité, les
spécialistes de littérature française aux États-Unis ne donnent pas seulement une vision
du féminisme, en particulier du féminisme de France, elles privilégient également une
certaine définition de la littérature, en particulier de la littérature française qui
s’irrigue à la source de la féminitude et non à ses tentatives de dépassement.
« Les Questions Féministes ne sont pas des QuestionsLesbiennes »
42 Mais le refus, ou le dépassement, du féminisme ne concerne pas que les écrivaines
différentialistes. À partir du Brouillon pour un dictionnaire des amantes, la catégorie
utilisée par Monique Wittig pour désigner une position de résistance au système
oppressif n’est plus féministe mais amante ou lesbienne. En 1979, dans le texte que
Monique Wittig donne Homosexuality in French Literature78, une tension est très
nettement perceptible entre les catégories et les objectifs du lesbianisme d’une part et
du féminisme d’autre part, au point que Wittig consacre à ce rapport une section
entière de l’article sous le titre « Lesbiennes », laissant ainsi présager que le
lesbianisme est devenu sous sa plume le futur du féminisme.
43 Le lesbianisme y est en effet présenté comme une culture et une société antérieures au
féminisme, et envisagé dans son intersection, et donc dans sa coïncidence comme dans
sa non-coïncidence avec le féminisme : « Politiquement, le féminisme en tant que
phénomène théorique et pratique inclut le lesbianisme tout en étant dépassé par lui79 »,
écrit-elle. Si le lesbianisme excède le féminisme, les deux phénomènes entretiennent
cependant un rapport de complémentarité :
Sur le plan théorique, le lesbianisme et le féminisme articulent leur position de tellemanière que l’un interroge toujours l’autre. Le féminisme rappelle au lesbianismequ’il doit compter avec son inclusion dans la classe des femmes. Le lesbianismealerte le féminisme sur sa tendance à traiter de simples catégories physiquescomme des essences immuables et déterminantes.80
44 Le lesbianisme est donc l’équivalent d’une position de résistance au système oppressif.
Plus encore, Monique Wittig fait du seul lesbianisme un équivalent du matérialisme.
C’est enfin grâce au, ou à cause du, féminisme que le lesbianisme doit se souvenir que
les lesbiennes sont considérées comme faisant partie de la classe des femmes, alors que
« Paradigm » reprend l’affirmation formulée dès 1978 dans « La pensée straight », à
savoir que les lesbiennes ne sont pas des femmes, parce qu’elles ne sont pas
appropriées par quiconque.
45 C’est durant cette même année 1979 que Monique Wittig présente « On ne naît pas
femme » lors du colloque de New York consacré au Deuxième Sexe. Le texte paraît en mai
1980 dans la revue Questions féministes, avec pour toile de fond le débat séparatiste qui
GLAD!, 04 | 2018
28
agite le collectif de la revue depuis la parution dans le numéro de février de « La pensée
straight ». La revue, comme le mouvement français, s’interroge avec plus ou moins de
heurts sur la ligne à suivre désormais, alors que le partage est effectif entre celles qui
voient dans le lesbianisme une position politique plus radicale que le féminisme, et
celles pour qui le féminisme est le moyen d’une lutte des femmes qui ne se veut pas
moins révolutionnaire.
46 « On ne naît pas femme », référence à la phrase célèbre, mais ici tronquée, du Deuxième
Sexe, témoigne du dépassement qui vient de s’opérer. Si Beauvoir insistait sur la
construction sociale du sujet femme, Wittig ouvre de façon neuve d’autres possibles :
on ne naît ni on ne devient nécessairement femme. Comme le remarque Teresa de
Lauretis81, Wittig déplace l’accent initial beauvoirien de naître femme à devenir femme.
C’est à partir de cette réflexion que Wittig s’oppose à celles qui, même parmi les
lesbiennes, revendiquent la féminitude. Or, alors que sous sa plume féminitude et
féminisme avaient été présentés comme deux options opposées l’une à l’autre, Monique
Wittig glisse de la féminitude au féminisme pour affirmer :
L’ambiguïté du terme « féministe » résume toute la situation. Que veut dire« féministe » ? Féministe est formé avec le mot « femme » et veut dire « quelqu’unqui lutte pour les femmes ». Pour beaucoup d’entre nous, cela veut dire « quelqu’unqui lutte pour les femmes en tant que classe et pour la disparition de cette classe ».Pour de nombreuses autres, cela veut dire « quelqu’un qui lutte pour la femme etpour sa défense » - pour le mythe donc et son renforcement.82
47 Par là même, elle entérine l’existence du différentialisme non seulement comme option
de la lutte des femmes (option qui lui est radicalement étrangère), mais encore comme
un type de féminisme, ce qui témoigne de l’influence du contexte américain qui est
alors le sien et qui la pousse également en ce sens au dépassement du féminisme lui-
même. Elle rappelle d’ailleurs ensuite l’échec de la première vague féministe française,
échec qu’elle impute à l’absence de dépassement des catégories de sexe et au principe
d’un combat souhaitant l’égalité dans la différence.
48 Ainsi, « ne jamais oublier à quel point être “femme” était […] “contre nature”,
contraignant, totalement opprimant et destructeur dans le bon vieux temps d’avant le
mouvement de libération des femmes83 », c’est « avoir une conscience lesbienne », et
non plus une conscience féministe. Elle poursuit alors en faisant de son programme
théorique et politique, le projet même du Mouvement de libération des femmes en
France depuis son apparition en 1970 : « il y a trente ans Simone de Beauvoir détruisait
le mythe de la femme. Il y a dix ans, nous nous mettions debout pour nous battre pour
une société sans sexe.84 » Selon Namascar Shaktini, c’est à partir de cette période que
Wittig ne se désigne plus ni comme femme, ni comme féministe85. C’est aussi à cette
période que le débat au sein de Questions féministes, comme parmi les féministes
radicales françaises, se mue en violente querelle.
49 Au début de l’année 1981, La Revue d’en face consacre un dossier à la polémique sous le
titre « Hétérosexualité et lesbianisme86 ». Plusieurs contributions significatives
trouvent place dans cette livraison qui prolonge le numéro à l’origine87 de la polémique
de Questions féministes répondent au texte initialement reproduit. C’est surtout la
contribution de Catherine Deudon, figurant en deuxième place dans le dossier sous le
titre de « Radicale-ment, Nature-elle-ment88 », qui retiendra ici notre intérêt tant elle
nous semble diachroniquement et synchroniquement révélatrice.
GLAD!, 04 | 2018
29
50 Reprenant le titre du troisième numéro de Questions féministes publié en 1978 sous le
titre « Natur-elle-ment », qui se donnait pour tâche de démontrer que la nature et le
naturel ne sont que des constructions idéologiques, le texte de Catherine Deudon
constitue en effet la première réfutation de « La pensée straight » et de ses implications
séparatistes par une lesbienne radicale. Avant tout féministe, Catherine Deudon défend
ainsi le potentiel subversif des pratiques sexuelles mais sans les résumer à une identité.
Ce refus de la catégorie ou de l’étiquette la mène notamment à infirmer l’opposition
entre hétérosexuelle et homosexuelle et à défendre la cohérence du groupe des femmes
réunies par l’action féministe : « N’en perdons pas notre latin féministe et restons (sans
honte) homosexuelle féministe (et non pas lesbianiste) c’est-à-dire située dans la classe
des femmes et luttant avec elles contre leur oppression à laquelle s’ajoute (et non
retranche) mon oppression spécifique d’homosexuelle.89 » Cette position unitaire était
d’ailleurs celle de Monique Wittig cinq ans plus tôt lorsqu’elle affirmait que les
catégories hétérosexuelle et homosexuelle appartenaient à une stratégie de division de
la classe des femmes.
51 Et avec Éliane V. [Viennot] dans le même numéro, Catherine Deudon est l’une des
premières à voir dans cette évolution de la pensée wittigienne un rapprochement
inattendu mais manifeste avec les positions de Psychanalyse et Politique : « Je n’ai nulle
envie de voir cette Nation lesbienne chauvine, sexiste et avatar de cet ailleurs de secte
sectaire (déjà vue à Psyképol [Psychanalyse et Politique]) faisant dans la “révolution
symbolique” et “l’indépendance érotique” sur le dos… des femmes90 ». Le risque bien
mesuré ici est de vider le féminisme de ces actrices, si d’un côté les hétérosexuelles ne
sauraient être féministes sans collaborer à l’oppression, et que de l’autre « les
lesbiennes ne sont pas des femmes », alors que Psychanalyse et Politique, sous la
conduite d’Antoinette Fouque, se dit ouvertement et depuis ses débuts antiféministe, et
tout récemment post-féministe. Le parallèle témoigne aussi de visées différentes et
concurrentes pour le Mouvement de libération des femmes que les lesbiennes radicales
souhaitent voir évoluer en Front lesbien international dans le même temps où
Psychanalyse et Politique tente d’en obtenir la propriété symbolique et concrète par le
dépôt du sigle MLF.
52 C’est dans cette trajectoire de pensée politique qui la mène du féminisme au
lesbianisme radical que, faisant référence à la polémique et à la scission du collectif de
Questions féministes, Monique Wittig en viendra à déclarer en 1983 que « [l]es questions
féministes ne sont pas des questions lesbiennes91 ». Dans ce texte, elle affirme sans
ambiguïté la séparation politique entre lesbiennes et féministes — « le lesbianisme n’a
rien à voir avec le féminisme92 », écrit-elle — et redit sa gêne face au terme comme au
concept de féminisme, « non pas à cause des suffragettes (non) mais à cause de “la
femme” autour duquel il est bâti93 ». Sa démonstration est d’ailleurs identique sur ce
point à celle de « On ne naît pas femme » : la lutte des femmes n’est pas la défense de la
femme mais bien le combat pour la suppression des catégories de sexes.
Conclusion
53 Au début des années 1980, l’heure n’est donc plus au féminisme. Les points communs
entre le différentialisme, littérairement incarné par Hélène Cixous et Antoinette
Fouque, et le lesbianisme comme choix politique, emmené par Monique Wittig, attirent
l’attention. Au-delà d’Hélène Cixous et de Monique Wittig, deux écrivaines dont les
GLAD!, 04 | 2018
30
positions traduisent à cette période une opposition catégorique au féminisme, pour des
motifs pourtant bien différents, le différentialisme et le lesbianisme politique, se
retrouvent sur le constat commun d’une sortie affirmée de l’oppression qui rend le
féminisme dépassé et obsolète : là où Psychanalyse et Politique scande « nous avons
vaincu l’oppression94 », Wittig conclut que « les lesbiennes ne sont pas des femmes »,
leur conférant un statut de marronnes, c’est-à-dire d’esclaves en fuite. Dans cette
convergence entre deux tendances pourtant distinctes du Mouvement des femmes au
tournant des années 1980, dans ce point de rencontre entre des intellectuelles —
écrivaines et éditrices — que tout oppose (et opposera d’ailleurs jusqu’à la fin de leur
vie pour Fouque et Wittig) se trouve, nous en faisons la proposition exploratoire, l’un
des principes définitoires et régulateurs du féminisme radical de France, voire de
l’Europe francophone, depuis le XIXe siècle, un féminisme qui s’affirme dans et par sa
négation même.
BIBLIOGRAPHIE
ALBISTUR, Maïté et ARMOGATHE, Daniel. 1977. Histoire du féminisme français : du Moyen âge à nos jours.
Paris : des Femmes.
BEAUVOIR, Simone (de) et SCHWARZER, Alice. 2008 [1972]. « Je suis féministe », in Entretiens avec
Simone de Beauvoir, traduit par Léa MARCOU et Daniel MIRSKY, Paris, Mercure de France, 2008.
CIXOUS, Hélène. 1977. « Entretien avec Françoise van Rossum-Guyon », Revue des sciences
Humaines 168 : 479-493.
COLLECTIF. 1981. Dossier «French Feminist Theory», Signs, The University of Chicago Press 7(1).
COLLIN, Françoise. 2011. « De la création littéraire, philosophique et féministe : un entretien avec
Françoise Collin », Nadine PLATEAU, Transmission(s) féministe(s) — Penser/agir la différence des sexe :
Avec et autour de Françoise Collin, Sofia, Réseau belge des études de genre, n˚ 1, 2011, 45-57.
CROWDER, Diane Griffin. 2003. « Lire Wittig : Un souvenir personnel », Labrys, études féministes [En
ligne], numéro spécial, consulté le 30 juin 2018. URL : https://www.labrys.net.br/special/special/
diane.htm
CUSSET, François. 2005 [2003]. French Theory : Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie
intellectuelle aux Etats-Unis. Paris : La Découverte.
DELPHY, Christine. 1996. « L’invention du "French Feminism" : une démarche essentielle »
Nouvelles Questions féministes, France, Amérique : regards croisés sur le féminisme, Paris, IRESCO, 17
(1) : 15-58.
DELPHY, Christine. 1998 [1975]. « Pour un féminisme matérialiste » [L’Arc, Simone de Beauvoir et la
lutte des femmes], in L’Ennemi principal, 1. Économie politique du patriarcat. Paris : Syllepse, 259-269.
DELPHY, Christine. 1998 [1975]. « Proto-féminisme et anti-féminisme » [Les Temps modernes 346], in
L’Ennemi principal, 1. Économie politique du patriarcat. Paris : Syllepse, 207-243.
GLAD!, 04 | 2018
31
DEUDON, Catherine. 1980. « Radicale-ment, Nature-elle-ment », Questions féministes, Du mouvement
de libération des femmes, février, 7 : 81-84.
FOREST, Philippe. 1995. Histoire de « Tel quel » : 1960-1982. Paris : Seuil.
FRONT D’ACTION RÉVOLUTIONNAIRE. 1971. « Quelques réflexions sur le lesbianisme comme position
révolutionnaire », Rapport contre la normalité.
GAUTHIER, Xavière. 1971. Surréalisme et Sexualité. Paris : Gallimard.
GREENSTEIN BURKE, Carolyn. 1978. « Report from Paris: Women’s Writing and the Women’s
Movement », Signs, The University of Chicago Press 3(4) : 843-855.
HIRATA Héléna, LABORIE Françoise, LE DOARÉ Héléne, & SÉNOTIER Danièle (dir.). 2000. Dictionnaire
critique du féminisme, Paris : Presses Universitaires de France.
KRISTEVA, Julia. 1977. « Questions à Julia Kristeva : à partir de Polylogue », Revue des Sciences
Humaines 168 : 495-501.
KRISTEVA, Julia. 1990. Les Samouraïs. Paris : Fayard.
LASSERRE, Audrey. 2014. Histoire d’une littérature en mouvement : textes, écrivaines et collectifs
éditoriaux du Mouvement de libération des femmes en France (1970-1981). Th. de doctorat en Littérature
et civilisation françaises. Paris : Université de la Sorbonne nouvelle — Paris 3 [En ligne]. URL :
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01635187.
LASSERRE, Audrey. 2016. « Quand la littérature se mit en mouvement : écriture et Mouvement de
libération des femmes en France », Les Temps modernes, 689 : 119-141.
LASSERRE, Audrey. 2018. « La signature au sein du Mouvement de libération des femmes : une
tentative de révolution de l’autorité et de l’auctorialité », in Genre et signature, REGARD, Frédéric et
TOMICHE, Anne (éd.), Paris : Classiques Garnier, 233-246.
LAURETIS, Teresa (de). 2002. « Quand les lesbiennes n’étaient pas des femmes », in Marie-Hélène
BOURCIER et Suzette ROBICHON (éds.), Parce que les lesbiennes ne sont pas des femmes : autour de l’œuvre
politique, théorique et littéraire de Monique Wittig, Paris : Éd. Gaies et lesbiennes, 35-53.
LE BRUN, Annie. 1990. Vagit-prop ; Lâchez tout et autres textes. Paris : Ramsay J.-J. Pauvert.
LE DŒUFF, Michèle. 1980. « Colloque féministe à New York : Le Deuxième Sexe trente ans après »,
Questions féministes, Du mouvement de libération des femmes 7 : 103-109.
LYOTARD, Jean-François. 1978. « One of the Things at Stake in Women’s Struggles », trad. par
Deborah J. Clarke SubStance, Focus on the Margins, University of Wisconsin Press 6/7 (20) : 9-17.
MACCIOCCHI, Maria Antonietta (éd.). 1979. Les Femmes et leurs Maîtres. Paris : C. Bourgeois.
MARKS, Elaine. 1978. « Women and Literature in France », Signs, The University of Chicago Press 3
(4) : 832-842.
MOSES, Claire Goldberg. 1996. « La construction du “French Feminism” dans le discours
universitaire américain », Nouvelles Questions féministes, France, Amérique : regards croisés sur le
féminisme, Paris, IRESCO, 17 (1) : 3-14.
MOSES, Claire Goldberg. 2002. « Made-in-America : le “French Feminism” dans l’université
américaine », in DELPHY, Christine et CHAPERON, Sylvie (éds.), Cinquantenaire du Deuxième Sexe, avec
la collab. de Kata et Edward Fullbrook, Paris : Syllepse : 277-284.
GLAD!, 04 | 2018
32
NAUDIER, Delphine. 2000. La Cause littéraire des femmes : Modes d’accès et modalités de consécration des
femmes dans le champ littéraire (1970-1998). Th. de doctorat en sociologie, Paris : EHESS.
PLANTÉ, Christine. 1993. « Questions de différence », in Féminismes au présent, RIOT-SARCEY, Michèle,
PLANTÉ Christine et VARIKAS Eleni (dir.), Paris, Montréal : L’Harmattan, 1993, 111-131.
Shaktini, Namascar (éd.). 2005. On Monique Wittig: theoretical, political and literary essays. Urbana :
University of Illinois Press.
SHAKTINI, Namascar. 1982. « Displacing the Phallic Subject: Wittig’s Lesbian Writing », Signs, The
University of Chicago Press 8(1) : 29-44.
TOMICHE, Anne et ZOBERMAN, Pierre. 2007. « Introduction » à Littérature et identités sexuelles, Paris,
Société Française de Littérature Générale et Comparée : 3-28.
VARIKAS, Eleni. 1993. « Féminisme, modernité, postmodernisme : pour un dialogue des deux côté
de l’océan », in Féminismes au présent, RIOT-SARCEY, Michèle, PLANTÉ Christine et VARIKAS Eleni (dir.),
Paris, Montréal : L’Harmattan, 59-84.
WITTIG, Monique. 2007 [2001]. La Pensée straight. Paris : Éditions Amsterdam [Balland].
NOTES
1. Jean-François LYOTARD, “One of the Things at Stake in Women’s Struggles”, trad. par Deborah J.
Clarke, in “Focus on the Margins”, SubStance, University of Wisconsin Press, vol. 6/7, n° 20,
Automne 1978, p. 15.
2. Elaine Marks qui signe « Women and Literature In France » à l’été 1978 pour la revue Signs
opère le même choix (Elaine MARKS, « Women and Literature in France », Signs, The University of
Chicago Press, vol. 3, n° 4, Été 1978, p. 833).
3. Françoise COLLIN, « New York des femmes », La Revue nouvelle, 1972, p. 25.
4. Affirmé par Christine Delphy dans « Pour un féminisme matérialiste » (L’Arc, n° 61, « Simone
de Beauvoir et la lutte des femmes », 1975) désigne un courant du féminisme qui s’inspire du
matérialisme historique de Marx pour penser et combattre l’oppression des femmes. En
supplément de Christine Delphy, ses penseuses connues sont Colette Guillaumin, Nicole-Claude
Mathieu et Monique Wittig.
5. Terme non employé à l’époque, désigne le courant de la néo-féminité ou de la différence ;
partant du principe qu’il y a deux sexes distincts, souhaite dans une optique révolutionnaire,
garantir leur existence et le maintien de leur différence. Également orthographié
différencialisme (voir not. Françoise Collin, « Différence des sexes (Théorie de la) », Dictionnaire
critique du féminisme, Héléna HIRATA, Françoise LABORIE, Hélène LE DOARÉ, Danièle SÉNOTIER (dir),
Paris, Presses Universitaires de France, 2000, p. 26-35). On trouve parmi les différentialistes
Xavière Gauthier, Annie Leclerc ou (de façon plus problématique au regard de son œuvre) Hélène
Cixous.
6. Antoinette FOUQUE, « Droit de réponse », Libération, 26/12/2008 et « Une lettre d’Antoinette
Fouque », Le Monde, 14 et 15 décembre 2008.
7. Sur ce point voir la thèse de Delphine NAUDIER La Cause littéraire des femmes : Modes d’accès et
modalités de consécration des femmes dans le champ littéraire (1970-1998), Th. de doctorat en
sociologie, EHESS, 2000.
8. Voir la thèse d’Audrey LASSERRE, Histoire d’une littérature en mouvement : textes, écrivaines et
collectifs éditoriaux du Mouvement de libération des femmes en France (1970-1981), Th. de doctorat en
Littérature et civilisation françaises, Université de la Sorbonne nouvelle - Paris 3, 2014 (https://
GLAD!, 04 | 2018
33
tel.archives-ouvertes.fr/tel-01635187 ) dont on lira une synthèse dans « Quand la littérature se
mit en mouvement : écriture et Mouvement de libération des femmes en France », Les Temps
modernes, mai-juillet 2016, n°689, p. 119-141.
9. Carolyn GREENSTEIN BURKE, « Report from Paris: Women’s Writing and the Women’s
Movement », Signs, The University of Chicago Press, vol. 3, n° 4, Été 1978, p. 846.
10. Cf. Audrey LASSERRE, « La signature au sein du Mouvement de libération des femmes : une
tentative de révolution de l’autorité et de l’auctorialité », Genre et signature, sous la dir. de
Frédéric Regard et Anne Tomiche, Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 233-246.
11. Voir « Je suis féministe » [1972], Simone de BEAUVOIR et Alice SCHWARZER, Entretiens avec Simone
de Beauvoir, traduit par Léa MARCOU et Daniel MIRSKY, Paris, Mercure de France, 2008.
12. Hélène CIXOUS, « Entretien avec Françoise van Rossum-Guyon », Revue des sciences humaines,
« Écriture, féminité, féminisme », 1977, no 168, p. 481.
13. On en trouve un exemple, en début de décennie, dans les « Quelques réflexions sur le
lesbianisme comme position révolutionnaire » publiées dans le Rapport contre la normalité
(Symptôme, n° 3, Champ libre, 1971).
14. Ainsi dans un article de 1978 consacré à « La littérature au féminin pluriel » où sont
présentées une dizaine d’écrivaines qui « prennent la littérature d’assaut », aucune référence
n’est faite à Monique Wittig ou à son œuvre, alors qu’Hélène Cixous est dépeinte comme « le chef
de file » des révolutionnaires « qui brandissent la bannière du féminisme » (Noëlle LORIOT, « La
littérature au féminin pluriel », L’Express, 17 au 23 juillet 1978, p. 21).
15. Hélène CIXOUS, « Entretien avec Françoise van Rossum-Guyon », op. cit., p. 481, en italiques
dans le texte.
16. Des Femmes en Mouvement Hebdomadaire, n°3, p. 1.
17. Hélène CIXOUS, « Entretien avec Françoise van Rossum-Guyon », op. cit., p. 481.
18. Ibid., p. 482.
19. Ibid. en italiques dans le texte.
20. Julia KRISTEVA, « Questions à Julia Kristeva : à partir de Polylogue », « Écriture, féminité,
féminisme », Revue des Sciences Humaines, op. cit., p. 499.
21. Ibid.
22. Ibid., p. 501.
23. Nadja RINGART, « La naissance d’une secte », Libération, 1er juin 1977, p. 7.
24. Julia KRISTEVA, « Questions à Julia Kristeva : à partir de Polylogue », op. cit., p. 501.
25. Voir Philippe FOREST, Histoire de « Tel quel »: 1960-1982, Paris, Seuil, 1995, p. 516.
26. Julia KRISTEVA, Les Samouraïs, Paris, Fayard, 1990, p. 241‑244.
27. Ibid., p. 244.
28. Annie LE BRUN, Vagit-prop ; Lâchez tout et autres textes, Paris, Ramsay J.-J. Pauvert, 1990, p. 116.
29. Xavière GAUTHIER, Surréalisme et Sexualité, Paris, Gallimard, 1971.
30. Maïté ALBISTUR et Daniel ARMOGATHE, Histoire du féminisme français: du Moyen âge à nos jours,
Paris, des Femmes, 1977, p. 477.
31. Ibid.
32. Nadja RINGART, « La naissance d’une secte », art. cit.
33. Les initiales se déplient en un Féminin Masculin Avenir devenu par la suite Féminisme
Marxisme Actions.
34. Nadja RINGART, « La naissance d’une secte », art. cit.
35. Entretien donné par Annie Le Brun, le 10 décembre 1977, au Matin et reproduit dans Annie LE
BRUN, Vagit-prop ; Lâchez tout et autres textes, op. cit., p. 213.
36. Maria Antonietta MACCIOCCHI (dir.), Les Femmes et leurs Maîtres, Paris, C. Bourgeois, p. I.
37. « Des hystériques aux historiques, ou de la caricature à l’enterrement », Questions féministes,
n°6, septembre 1979, p. 103.
GLAD!, 04 | 2018
34
38. « La révolution est un travail », Libération, 9 et 10 juin 1974.
39. Des femmes, « La situation et notre politique », Le Quotidien des femmes, lundi 3 mars 1975, p. 5.
40. « Féminisme ou lutte de femmes », débat d’une femme avec Benoîte Groult, Le Quotidien des
femmes, samedi 6 mars 1976, p. 7-10.
41. Ibid., p. 7.
42. Ibid., p. 8.
43. Ibid., p. 10.
44. « Un colloque féministe à New York, “Le second sexe trente ans après” », Des femmes en
mouvements – hebdo, n° 1, 9 au 16 novembre 1979, p. 11.
45. « Mouvements sociaux ou / et mouvements de libération », Alain Touraine, Zsuzsa Hegedus,
Brice Lalonde, Emmanuel de Severac, Georges Buis, Antoinette [Fouque] et Marie-Claude
[Grumbach], Des femmes en mouvements – hebdo, n° 17, 29 février au 7 mars 1980, p. 27.
46. « Le féminisme de la non-différence – sexuelle, économique, politique – est l’atout maître du
gynocide », entretien de Kate Millett et d’Antoinette Fouque, Des femmes en mouvement – hebdo,
n°28, du 16 au 23 mai 1980, p. 12-15.
47. Ibid., p. 15.
48. Antoinette FOUQUE, « Notre ennemi n’est pas l’homme mais l’impérialisme du phallus »,
entretien avec Catherine Clément, Le Matin de Paris, 16/07/1980, p. 13.
49. Christine DELPHY, « Proto-féminisme et anti-féminisme », Les Temps modernes, n° 346, mai 1975,
p. 1469-1500.
50. C. D., FÉMINISTES RÉVOLUTIONNAIRES, « L’exploitation patriarcale, 3 : Les idéologies de la
différences naturelle des sexes, Proto-féminisme et anti-féminisme », 32 p., Bibliothèque
Marguerite Durand, Cote : BROC MF 799.
51. Le terme n’est cependant jamais employé par Christine Delphy.
52. Voir Michèle LE DŒUFF, « Colloque féministe à New York : Le Deuxième Sexe trente ans après »,
Questions féministes, Du mouvement de libération des femmes, n°7, février 1980, p. 103-109.
53. Le texte d’Hélène Cixous a été publié dans Des femmes en Mouvement Hebdo, n°4, 30 novembre
au 7 décembre 1979, p. 29-32.
54. On en trouvera la version publiée dans Questions féministes, Du mouvement de libération des
femmes, n°8, mai 1980, p. 75-84.
55. Voir Michèle LE DŒUFF, « Colloque féministe à New York : Le Deuxième Sexe trente ans après »,
art. cit., p. 106, nous soulignons.
56. Cette altercation est également narrée, avec une variante importante, dans « Wittig-la-
politique », introduction de Marie-Hélène Bourcier à la première traduction française de La
Pensée straight (voir Monique WITTIG, La Pensée straight, Paris, Balland, 2001, p. 27, note 5).
57. « De la création littéraire, philosophique et féministe : un entretien avec Françoise Collin »,
Nadine PLATEAU, Transmission(s) féministe(s) - Penser/agir la différence des sexe: Avec et autour de
Françoise Collin, Sofia, Réseau belge des études de genre, n˚ 1, 2011, p. 51.
58. Voir François CUSSET, French Theory : Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie
intellectuelle aux États-Unis, Paris, La Découverte, 2005 [2003], voir en particulier la seconde partie
« Les usages de la théorie », p. 141 sqq.
59. Anne TOMICHE et Pierre ZOBERMAN, « Introduction » à Littérature et identités sexuelles, Paris,
Société Française de Littérature Générale et Comparée, p. 11.
60. Christine PLANTÉ , « Questions de différence », p. 111-131 et Eleni VARIKAS, « Féminisme,
modernité, postmodernisme : pour un dialogue des deux côté de l’océan », p. 59-84, in RIOT-
SARCEY, Michèle, PLANTÉ Christine et VARIKAS Eleni (dir.), Féminismes au présent , Paris, Montréal,
L’Harmattan, 1993.
61. Elaine Marks était présente au colloque de New York. Psychanalyse et Politique / Des femmes
fait un compte-rendu élogieux de sa communication dans « Un colloque féministe à New York,
GLAD!, 04 | 2018
35
“Le second sexe trente ans après” », Des femmes en mouvements – hebdo, n° 1, 9 au 16 novembre
1979, p. 11-12.
62. New French Feminisms: an Anthology, New York London Toronto, Harvester Wheatsheaf, 1980.
63. Notre traduction de « We have nonetheless decided to place “Feminisms” in our title because
there is as yet no better word to account for the phenomenon we are presenting. » (Ibid).
64. « Nous définissons le féminisme comme une prise de conscience de l’oppression-répression
des femmes qui inaugure tout à la fois des analyses de la dimension de cette oppression-
répression et des stratégies de libération », notre traduction de « We define feminism as an
awareness of women’s oppression-repression that initiates both analyses of the dimension of this
oppression-repression, and strategies for liberation. » (Ibid).
65. Elaine MARKS, « Women and Literature in France », art. cit., p. 833, nous soulignons. Notre
traduction de : « The words “feminist” and “feminism” have come under attack by the group
Politics and Psychoanalysis and by Hélène Cixous […]. I shall use the word “feminist,” in
quotation marks, to refer to women who are exploring the connections between women and
language. »
66. Julia Kristeva est assimilée à la tendance différentialiste alors qu’il s’agit, nous semble-t-il,
d’une lecture inadéquate de son œuvre.
67. Dossier “French Feminist Theory”, Signs, The University of Chicago Press, vol. 7, n°1, automne
1981.
68. Notre traduction de « The influence of French thought among feminist theory in the United
States, strong since Simone de Beauvoir’s The Second Sex first appeared, would seem now to be
growing even stronger, and opportunities to learn about French thinkers are increasing. » (Ibid.,
p. 1).
69. Nous soulignons. Notre traduction de « The work of the four French Writers appearing in this
issue of Signs represents a sampling of the ideas now exchanging in France. » (Ibid., p. 2).
70. Diane GRIFFIN CROWDER, « Lire Wittig : Un souvenir personnel », Labrys, études féministes,
numéro spécial, septembre 2003, https://www.labrys.net.br/special/special/diane.htm
71. On trouve en revanche à l’automne 1982 un texte de Namascar Shaktini, plus connue en
France sous le nom de Margaret Stephenson, ancienne du groupe des Perverses Polymorphes et
du cercle militant de Wittig, ayant défilé à ses côtés sous l’Arc de Triomphe (Namascar SHAKTINI,
« Displacing the Phallic Subject: Wittig’s Lesbian Writing », Signs, The University of Chicago Press,
vol. 8, no. 1, Autumn, 1982, p. 29-44).
72. Christine DELPHY, « L’invention du "French Feminism" : une démarche essentielle », in
Nouvelles Questions féministes, « France, Amérique : regards croisés sur le féminisme », Paris,
IRESCO, volume 17, n°1, février 1996, p. 15-58. Repris dans L’Ennemi principal, 2. Penser le genre,
Paris, Syllepse, 2001, p. 319-358.
73. Les pages de cette « brochure » ne sont pas numérotées, voir la deuxième page du texte de
Simone de Beauvoir.
74. Claire Goldberg MOSES, « La construction du “French Feminism” dans le discours universitaire
américain », dans « France, Amérique : regards croisés sur le féminisme », Nouvelles Questions
féministes, Paris, IRESCO, vol. 17, n° 1, février 1996, p. 3-14 et Claire Goldberg MOSES, « Made-in-
America : le “French Feminism” dans l’université américaine », in DELPHY, Christine et CHAPERON,
Sylvie (dir.), Cinquantenaire du Deuxième Sexe, avec la collab. de Kata et Edward Fullbrook, Paris,
Syllepse, 2002, p. 277-284.
75. Claire Goldberg MOSES, « La construction du “French Feminism” dans le discours universitaire
américain », art. cit., p. 10.
76. Eleni VARIKAS, « Féminisme, modernité, postmodernisme : pour un dialogue des deux côté de
l’océan », art. cit., p. 62.
GLAD!, 04 | 2018
36
77. Claire Goldberg MOSES, « La construction du “French Feminism” dans le discours universitaire
américain », art. cit., p. 11.
78. Monique WITTIG, « Paradigm », », in Homosexuality in French Literature, Elaine MARKS and George
STAMBOLIAN (éds.), Ithaca, Cornell University Press, 1979, p. 114-121. Les textes de Monique Wittig
ayant fait l’objet de corrections lors de leur réédition en recueil, nous citons systématiquement le
texte et l’édition d’origine suivie de la référence du passage correspondant au sein de la dernière
édition parue en France (2007).
79. Monique WITTIG, La Pensée straight, op. cit., p. 85.
80. Ibid.
81. Teresa de LAURETIS, « Quand les lesbiennes n’étaient pas des femmes », in Marie-Hélène
BOURCIER et Suzette ROBICHON (dirs.), Parce que les lesbiennes ne sont pas des femmes: autour de l’œuvre
politique, théorique et littéraire de Monique Wittig, Paris, Éd. Gaies et lesbiennes, 2002, p. 39.
82. Monique WITTIG, « On ne naît pas femme », Questions féministes, Du mouvement de libération des
femmes, mai 1980, vol. 8, p. 79 ; Monique WITTIG, La Pensée straight, op. cit., p. 47‑48.
83. Monique WITTIG, « On ne naît pas femme », op. cit., p. 78 ; Monique WITTIG, La Pensée straight,
op. cit., p. 46.
84. Monique WITTIG, « On ne naît pas femme », op. cit., p. 79 ; Monique WITTIG, La Pensée straight,
op. cit., p. 47.
85. Namascar SHAKTINI (dir.), On Monique Wittig: theoretical, political and literary essays , Urbana,
University of Illinois Press, 2005, p. 4.
86. Dossier « Hétérosexualité et lesbianisme », La Revue d’en face, Paris, Éditions Tierce, n° 9-10, 1er
trimestre 1981, p. 66-109.
87. Questions féministes, Du mouvement de libération des femmes, février 1980, n° 7.
88. Catherine DEUDON, « Radicale-ment, Nature-elle-ment », ibid., p. 81-84.
89. Ibid., p. 83.
90. Ibid.
91. « Les Questions Féministes ne sont pas des Questions Lesbiennes », Amazones d’hier et
Lesbiennes d’aujourd’hui, n° 2.1, Montréal, juillet 1983, p. 10-14. Plus tardivement lors d’un
entretien avec Catherine Ecarnot en 1996, l’autrice revient sur cette distinction qui marqua
également une scission politique pour la contester : « Le lesbianisme est une rupture avec un
système économique : l’hétérosexualité, certainement pas avec le mouvement féministe, c’est
une rupture de contrat avec ce régime politique qu’est l’hétérosexualité. Je crois qu’il n’y a pas de
femmes “hétérosexuelles”. » (« Rencontre avec Monique Wittig », propos recueillis par Catherine
Rognon-Écarnot, Lesbia, op. cit., p. 30).
92. « Les Questions Féministes ne sont pas des Questions Lesbiennes », art. cit., p. 10.
93. Ibid., p. 11.
94. La formule émaille les pages de Des femmes en mouvements – hebdo.
RÉSUMÉS
Issue de travaux d’histoire littéraire consacrés au Mouvement de libération des femmes en
France, la présente contribution retrace un moment qui est aussi une particularité des
littératrices radicales de France de cette époque : leur refus, pour certaines dès le début des
années 1970, pour d’autres au tournant des années 1980, de se désigner comme féministes. Cette
GLAD!, 04 | 2018
37
contestation se manifeste différemment chez les écrivaines proches de Psychanalyse et Politique
dont le projet est de « déconstruire le féminisme comme idéologie et de faire émerger un sujet
femme » et chez celles, matérialistes, qui cherchent à déconstruire la femme comme idéologie et
à faire émerger un sujet dépris du féminin. La palette de leurs positions — le rejet du terme et de
ce qu’il est supposé recouvrir augmentant au fil de la décennie — témoigne d’un véritable enjeu
pour l’histoire du féminisme comme pour l’histoire littéraire. Ce tableau illustre en effet les
objectifs que peut se donner le féminisme radical tout comme il permet de mieux comprendre la
manière dont celles qui écrivent proposent de transformer le monde et de changer la vie.
Drawing from research in literary history dedicated to the Women's Liberation Movement in
France, this contribution tells a story that is specific to radical women writers in France at this
time: the story of their refusal, for some in the early 1970s, for others at the turn of the 1980s, to
designate themselves as feminists. This refusal is mapped out differently for the writers close to
Psychoanalysis and Politics, whose project it was to "deconstruct feminism as an ideology and to
bring out a female subject", and for the materialist writers who sought to deconstruct “woman”
as an ideology and to bring out a subject rid of the feminine. The range of their positions—as the
term “feminist” and what it supposedly refers to elicits more and more rejection over the years—
reveals how much is at stake for the history of feminism as well as literary history. This overview
both illustrates the goals of radical feminism and gives a better understanding of the ways in
which women writers propose to transform the world and “change the life”.
INDEX
Thèmes : Recherches
Mots-clés : féminisme, littérature, écrivaines
Keywords : feminism, literature, women writers
AUTEUR
AUDREY LASSERRE
UCLouvain (Louvain-la-Neuve)
Historienne du littéraire, Audrey Lasserre est spécialiste des rapports entre littérature, genre et
féminisme aux XXe et XXIe siècles. Ses recherches doctorales, consacrées à une histoire littéraire
du mouvement des femmes en France, ont été primées par le GIS Institut du Genre (France). Elle a
dirigé plusieurs collectifs, dont le dernier s’intitule « Le concept de genre a-t-il changé les études
littéraires ? », numéro de la revue Francofonia préparé avec Christine Planté (n° 74,
printemps 2018). Actuellement boursière postdoctorale à l’UCL (Louvain-la-Neuve, Belgique), elle
travaille à une histoire transnationale de la littérature francophone et « féministe » en Europe.
GLAD!, 04 | 2018
38
Sémiotique de l’enterrementprématuré : le féminisme à l’ère dupostféminismeThe Semiotics of Premature Burial: Feminism in a Postfeminist Age
Mary Hawkesworth
Traduction : Aude Ferrachat
NOTE DE L’ÉDITEUR
Cet article est une traduction de HAWKESWORTH, Mary. 2004. « The Semiotics of
Premature Burial » Signs 29(4) : 961-985.
La mort-récit prête à conjecture. (Loraux 1985 :
13)1
Si l’audace le pousse à défier l’ordre établi,
Qu’il n’ait plus place aucune à mon foyer.
(Sophocle 2011 : 17)2
1 Au cours des quatre dernières décennies, le féminisme a connu un essor sans
précédent. Selon Sonia Alvarez, « les lieux où les femmes qui se déclarent féministes
agissent ou peuvent agir se sont multipliés. Il ne s’agit plus seulement des rues, des
groupes autonomes ou de sensibilisation, des ateliers d’éducation populaire, etc. Bien
que les féministes occupent toujours ces espaces aujourd’hui, elles et ils sont également
présent·e·s3 dans de nombreuses autres arènes culturelles, sociales et politiques : dans
les couloirs des Nations unies, à l’université, dans les instances étatiques, les médias et
les organisations non-gouvernementales (ONG), entre autres » (Alvarez 1988 : 4)4. Par le
travail bien trop invisible des militant·e·s féministes à travers le monde, le féminisme a
fait surface au cœur de multiples luttes qui ne retiennent que rarement l’attention de la
presse.
GLAD!, 04 | 2018
39
2 Au sein des institutions gouvernementales d’Afrique, d’Asie, d’Australie, d’Europe,
d’Amérique Latine et d’Amérique du Nord, des projets féministes sont à l’œuvre pour la
parité femmes-hommes et l’élaboration de « mécanismes nationaux » pour les femmes
tels que des ministères, des bureaux et des commissions pour l’égalité femmes-
hommes. La branche féministe des Nations unies, le Fonds de développement des
Nations unies pour la femme (UNIFEM), travaille en collaboration avec des
organisations de femmes indigènes sur tous les continents pour défendre et protéger
leurs moyens de subsistance et d’existence et pour garantir leurs droits économiques,
politiques et civiques. Dans plusieurs États, comme la Suède et les Pays-Bas, les projets
pour l’égalité femmes-hommes figurent parmi les initiatives principales en termes de
politique étrangère. Des fémocrates œuvrent au sein des agences nationales de tous les
pays, à l’exception d’une ou deux, pour structurer les initiatives politiques qui traitent
des besoins, des préoccupations et des intérêts des femmes, aussi contestés que ces
concepts puissent être (Eisenstein 1991). Suite aux quatre conférences mondiales sur
les femmes parrainées par l’ONU, 162 nations ont ratifié la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et, dans tous ces
pays, des militant·e·s pour les droits des femmes s’emploient à faire pression sur leurs
gouvernements pour changer les constitutions, les lois et les pratiques traditionnelles
conformément aux clauses de la CEDAW. Ces nations ont adopté par consensus quasi-
universel le Programme d’action de Beijing et les militant·e·s féministes travaillent
localement et par le biais des processus de suivi de l’ONU pour en imposer la mise en
œuvre.
3 Les ONG féministes se sont multipliées, créant une société civile féministe dynamique.
Des sites web tels que « Electrapages » et « Euronet » fournissent des informations sur
des dizaines de milliers d’organisations dans le monde créées par et pour des femmes,
qui aspirent à développer leurs agendas politiques, à réaliser des audits de genre et des
analyses de l’impact des politiques gouvernementales, à construire des alliances
progressistes entre femmes, à renforcer la signification des notions de démocratie et de
démocratisation, à offrir aux femmes les services dont elles ont le plus besoin et à faire
pression sur les secteurs publics et privés pour qu’ils incluent davantage de femmes et
répondent mieux à leurs préoccupations5. La portée d’un travail féministe de cette
ampleur recouvre les luttes pour l’existence, les politiques concernant les vivres, le
carburant et le bois de chauffage, la santé des femmes et leur liberté reproductive,
l’éducation des femmes et des filles, les opportunités d’emploi, l’égalité salariale, les
conditions de travail sécurisées et la protection contre le harcèlement sexuel, le viol et
les violences domestiques, le trafic sexuel, les droits des femmes comme droits
humains, la militarisation, le rétablissement et le maintien de la paix,
l’environnementalisme, le développement durable, la démocratisation, les droits et
bénéfices sociaux, le SIDA, la parité dans la fonction publique, les informations
numériques par et pour les femmes, les journaux et la presse féministe, et la réforme
des programmes scolaires, la pédagogie féministe et la recherche féministe.
4 Un phénomène étrange a accompagné cet essor sans précédent du militantisme
féministe dans le monde : la déclaration récurrente de la mort du féminisme. Depuis les
années 1970 jusqu’au nouveau millénaire, des journalistes, des universitaires et même
certaines chercheuses féministes ont annoncé la fin du féminisme et salué l’avènement
de l’ère postféministe. Entre 1989 et 2001 par exemple, lors d’une période qui a vu le
nombre d’organisations féministes augmenter de manière exponentielle, une enquête
GLAD!, 04 | 2018
40
menée par Lexis-Nexis parmi des journaux en langue anglaise recense quatre-vingt-six
articles mentionnant la mort du féminisme et soixante-quatorze articles
supplémentaires faisant référence à l’ère postféministe6. Que signifient de telles
proclamations ? Au vu du dynamisme et de la diversité des formes de théories et de
pratiques féministes, et de leur prolifération, comment expliquer l’enterrement
prématuré du féminisme ?
5 Sarah Webster Goodwin et Elisabeth Bronfen ont défini les écrits funéraires comme des
modes d’appréhension particulièrement propices à l’analyse sémiotique, car « toute
représentation de la mort est une déformation » (1993 : 20). Dans les cas où la mort est
réelle, les mots cherchent à rendre présent ce que la mort a rendu irrévocablement
absent et, par conséquent, déforment leur sujet. Mais les annonces de la mort du
féminisme supposent une déformation d’un type bien différent. Ces récits de mort
écrits font office de symboles allégoriques pour quelque chose d’autre, un moyen
d’identifier un danger perçu et qui doit être éliminé, une façon pour un collectif de se
définir au travers de celles et ceux qu’il choisit de tuer symboliquement. L’enterrement
prématuré du féminisme nécessite donc une analyse plus poussée.
6 Dans cet article, j’explore la façon dont la mort du féminisme est représentée afin
d’examiner le sens plus général des déclarations de ce décès symbolique. Je
commencerai en examinant deux mécanismes discursifs producteurs de la mort du
féminisme, la « nécrologie » et les récits d’« extinction par évolution », pour mettre en
lumière les valeurs tacites des embaumeur·se·s du féminisme. J’étudierai ensuite des
récits divergents au sujet des « signes de la mort » afin d’explorer comment certains
postulats sur l’ontologie du féminisme sont liés à des formes spécifiques de mort
métaphorique. Étant donné le type particulier de déformations en jeu dans
l’enterrement prématuré d’un féminisme global et prospère, la dernière partie de mon
article replace la mise à mort du féminisme contemporain dans le contexte historique
genré d’une pratique spécifique : celle de l’enterrement d’un·e individu·e vivant·e. En
exhumant et en analysant ces pratiques archaïques, j’établirai un lien entre
l’enterrement rhétorique du féminisme contemporain et un effort continu pour
discréditer les luttes féministes pour la justice sociale.
Mécaniques de mort
La nécrologie
7 En novembre 1976, Harper’s consacrait sa une à un article intitulé « Requiem pour le
Mouvement des Femmes » (Geng 1976), la première d’une longue série de déclarations
médiatiques annonçant que le féminisme « de la deuxième vague » était mort. Il ne
s’était pourtant rien passé de particulier, en novembre 1976, qui aurait permis de
conclure à la mort du féminisme : pas d’événement cataclysmique, pas d’accident
tragique, ni de drame ménager, aucun signe d’agonie, seulement un messager porteur
de la nouvelle. Conformément aux conventions de la tragédie grecque dans l’Antiquité
classique, la mort du féminisme « passe par les mots. […] Rien [ne] se voit d’abord, car
tout a commencé par être dit, par être entendu, par être imaginé. » (Loraux 1985 : 9)7.
8 L’essai publié dans Harper’s par Veronica Geng a posé un cadre pour les nécrologies à
venir, relatant l’essor du mouvement, rapportant la naissance d’une maladie
incapacitante, et certifiant à la lectrice ou au lecteur qu’il n’y avait pas de crime, pas
GLAD!, 04 | 2018
41
d’intervention extérieure, simplement la mort due à des causes naturelles, ou peut-être
à des blessures volontaires. Selon le récit de Geng, les causes de la mort étaient
nombreuses et diverses. Le mouvement des femmes avait perdu ses repères, s’était
coupé des femmes états-uniennes et avait délaissé son but premier : la sensibilisation,
la confrontation politique et le fait de rassembler les femmes en vertu de « la
conviction que le changement ne peut être obtenu que si les personnes s’allient et
déclarent le vouloir » (Geng 1976 : 52). Plutôt que d’agir de concert pour produire du
changement social, le mouvement féministe s’était divisé, se décentralisant pour
former « des individues et des cliques hautement spécialisées, chacune cultivant
obstinément son petit coin de terre obscur, au point de désorienter et repousser
n’importe quel·le intellectuel·le à la recherche d’un moyen de soutenir les vastes
objectifs de la libération des femmes. » (Geng 1976 : 53). Le factionnalisme avait fait
place à des guerres sororicides. La faction de la National Organization for Women
(NOW) était devenue obnubilée par son image, militant pour un mouvement des
femmes unifié tout en évinçant les lesbiennes et les radicales dont l’existence-même
paraissait incompatible avec les politiques de respectabilité auxquelles NOW adhérait.
Pour Geng, en défendant « un séparatisme pseudo-lesbien, pas seulement par rapport
aux hommes mais par rapport à la “culture patriarcale”, les radicales
s’autodétruisaient, abandonnant par là même la majeure partie du terrain sur lequel le
pouvoir masculin pouvait être combattu. Elles ont stoppé l’afflux d’idées et de vérité
émotionnelle qui avaient donné vie à leurs organisations » (Geng 1976 : 55). La clique
« réaliste » née des politiques des partis démocrates et républicains revendiquait
initialement une représentation égale dans les tribunes, dont les conventions
nationales, mais elle s’était progressivement compromise jusqu’à disparaitre, modérant
ses demandes sous prétexte de réalisme politique jusqu’à ce qu’elle n’affiche plus aucun
lien identifiable avec le féminisme, pendant que la clique « de la justice sociale »
dilapidait son énergie dans un éventail de luttes bien trop large (le racisme, les
discriminations envers les gays et les lesbiennes, la pauvreté, la guerre et
l’impéralisme), jusqu’à manquer de temps, de force et de ressources pour défendre et
imposer « l’intérêt du féminisme » (Geng 1976 : 64).
9 L’autopsie à laquelle procède Geng présente un discours de dissolution qui peut
paraitre extrêmement familier, peut-être parce qu’il a été si souvent répété (pour les
rediffusions les plus récentes, voir Hymowitz 2002). Ces discours nous invitent non
seulement à penser le féminisme comme mort mais également à bien saisir que son
décès est dû à des processus internes au féminisme. Les expressions utilisées pour
décrire la mort du féminisme sont entièrement autoréférentielles, mobilisant des
métaphores du suicide (« mort de ses propres mains ») ou de la vieillesse (« son temps
était venu »). Ce qui est peut-être le plus intéressant dans le chant funèbre de Geng est
l’invocation d’un féminisme univoque idéalisé, promouvant une « émancipation
féminine » abstraite alors qu’il nie la légitimité de féminismes plurivoques et condamne
les stratégies concrètes pour l’instauration du changement social. Ce que les
chercheu·r·se·s en sciences sociales décrivent comme la répartition des tâches et la
spécialisation essentielles à la croissance à long terme des organisations, Geng le
dépeint comme une fragmentation et une dissolution. Ce que les féministes perçoivent
comme une leçon durement apprise (que le fait d’opérer un décentrement par rapport
aux femmes occidentales blanches de classe moyenne, de reconnaitre la multiplicité
des voix au sein du mouvement, de soutenir les priorités des femmes de couleur et des
femmes des pays du Sud, et de combattre le racisme, l’homophobie,
GLAD!, 04 | 2018
42
l’hétéronormativité, et l’impérialisme culturel était crucial pour le développement d’un
féminisme international inclusif), Geng le transforme en une dose mortelle de
différence. Cette trame familière qui encadre la mort du féminisme véhicule alors une
morale claire. Les modalités du militantisme féministe qui contestent les limites fixées
par la culture dominante aux États-Unis doivent être bannies du monde des vivant·e·s.
L’extinction par évolution
10 Certains récits du décès du féminisme évoquent de vagues processus évolutifs grâce
auxquels le féminisme aurait accédé à une phase d’existence plus avancée. Selon Ann
Brooks, le « postféminisme » est « l’expression d’un stade dans la progression évolutive
constante du féminisme » (Brooks 1997 : 1)8. Mais comme l’indiquent clairement les
histoires problématiques du darwinisme social et de la sociobiologie, les métaphores
évolutives de la « sélection naturelle » et de la « survie du plus apte » jouent rarement
en faveur du féminisme.
11 Alors que la nature exacte du postféminisme a fait l’objet de controverses considérables,
certains usages du terme reflètent une forte conviction que le féminisme a ou aura
bientôt disparu. En 1988, Nicholas Davidson saluait l’avènement du postféminisme qu’il
décrivait comme un « nouveau consensus sur le genre » impliquant le rétablissement
de la masculinité et de la féminité traditionnel·le·s, le recul de la politisation de la vie
personnelle, la reconquête et la sauvegarde des « droits des femmes en tant que
ménagère » et le rétablissement du modèle domestique où l’homme est le pourvoyeur
de la famille (1988 : 335-40). Selon Davidson, l’ère postféministe est une révolte contre
les féministes « alors qu’elles luttent pour maintenir l’emprise du passé » (1988 : 336).
En effet, d’après Davidson, le postféminisme nécessite une importante coalition
unifiant des groupes variés :
L’Ère Postféministe mobilisera également des millions de jeunes femmescélibataires qui s’insurgent contre les attentes unisexistes auxquelles elles sontconfrontées. Mais à la différence de l’Ère Féministe, cela nécessitera la participationcollaborative de tous les groupes sociaux. En effet, il est difficile d’imaginer ungroupe principal unique dont les intérêts ne le placent pas en opposition avecl’orthodoxie féministe : les femmes féminines dénigrées par la dévalorisation duféminin ; les femmes ambitieuses freinées par la politisation féministe de la réussitepersonnelle ; tous les hommes ; les enfants — en somme, la vaste majorité despersonnes ; si bien que la disparition prématurée de la vision féministe commeforce sociale significative apparait dès lors non seulement possible maisvraisemblable. (1988 : 337)9
12 Bien que son « nouveau consensus » semble indissociable d’appels au retour aux
valeurs de la famille traditionnelle qui circulent dans les milieux fondamentalistes
chrétiens, Davidson maintient que « les femmes états-uniennes ne sont pas en train de
régresser mais au contraire de progresser par delà le féminisme. Elles dépassent le
féminisme et avancent vers un monde où leurs espoirs, leurs peurs, leurs désirs et leurs
instincts n’inspirent plus ni méfiance ni rejet, en tant que débris destructifs d’un
“conditionnement” mais sont au contraire appréciés et acceptés comme les
caractéristiques féminines positives et fertiles fondamentales qu’elles sont » (1988 :
339-40).
13 Contrairement à Davidson qui établit les instincts naturels et les relations de genre
traditionnelles comme fondement du postféminisme, Tania Modleski, dans Feminism
without Women (1991), attribue l’émergence du postféminisme aux travaux d’un certain
GLAD!, 04 | 2018
43
nombre de féministes autoproclamé·e·s (le plus souvent des hommes) à l’université.
Tout en s’appropriant le lexique de l’analyse féministe, ces universitaires « nient les
critiques et discréditent les objectifs du féminisme — nous renvoyant de fait à un
monde préféministe » (Modleski 1991 : 3). Sous couvert d’étudier les relations de genre,
ces universitaires replacent subtilement les hommes au cœur de l’analyse et laissent
entendre que les femmes ne constituent un objet d’intérêt scientifique qu’en regard de
ces derniers. Dans de tels discours, les lesbiennes et les hommes gays sont une fois de
plus invisibilisé·e·s, puisque des présupposés hétérosexistes structurent les cadres
d’enquête. De plus, ces textes mobilisent tacitement des conceptions libérales des
politiques qui posent l’égalité devant la loi comme limite du projet féministe, éludant
ainsi les questions de l’asymétrie de pouvoir qui imprègnent les relations sociales.
Qualifiant ces universitaires de « féministes gynocidaires », Modlesky affirme qu’ils et
elles utilisent le féminisme comme une « entrée dans le champ plus global des études
de genre [qui ne sont] plus considérées […] comme elles devraient l’être, c’est-à-dire
selon ce qu’elles peuvent apporter au projet féministe et l’appui qu’elles peuvent
fournir par l’analyse des causes, des effets, de la portée et des limites de la domination
masculine » (1991 : 5). Selon Modleski, donc, le postféminisme consiste en un mode
d’analyse ou de critique intellectuelle qui subvertit le féminisme et devrait donc être
considéré comme résolument antiféministe. Elle suggère ainsi que malgré
l’appropriation de termes féministes, ce mode d’analyse académique est empreint
d’implications profondément conservatrices.
14 Pour ce qui est des modes de conscience, Judith Stacey définit le postféminisme comme
« l’incorporation, la révision et la dépolitisation simultanées d’un grand nombre des
objectifs centraux du féminisme de la seconde vague » (1992 : 322). Stacey décrit le
postféminisme comme « la conscience et les stratégies qu’un nombre croissant de
femmes ont développées en réponse aux nouvelles difficultés et opportunités de la
société postindustrielle » (1992 : 323). Stacey, en accord avec Davidson, convient que le
postféminisme bénéficie d’un soutien considérable, notamment parmi les femmes, mais
elle défend que les facteurs contribuant au développement du postféminisme sont bien
distincts de l’antiféminisme, du sexisme et du conservatisme. Stacey propose une
analyse matérialiste qui met l’accent sur les changements systémiques induits par « la
vie professionnelle et familiale postindustrielle » (1992 : 323). Au cours des vingt-cinq
dernières années, alors que la valeur réelle des salaires a chuté, la population active
comprend de plus en plus de femmes. Le taux de divorce s’est accru, tout comme le
nombre de naissances hors mariage, conduisant à une augmentation du nombre de
femmes célibataires cheffes de famille. Ces relations matérielles changeantes, bien plus
que les revendications féministes pour l’égalité, ont transformé les conditions de vie
des femmes, poussant un grand nombre d’entre elles à rechercher une idéologie qui les
aiderait à surmonter cette situation. Stacey interprète le postféministe comme un
mécanisme d’adaptation de ce type, un mécanisme qui dépolitise le féminisme,
éliminant ses politiques publiques et le plaçant pleinement dans la sphère domestique.
Selon Stacey, les femmes postféministes aspirent à une vie domestique égalitaire où des
hommes solidaires et impliqués assument de plein gré leur part des tâches ménagères
et de l’éducation des enfants.
15 Frances Mascia-Lees et Patricia Sharpe (2000) déplacent le point d’ancrage du
postféminisme de la conscience et des désirs des femmes contemporaines au champ de
la culture contemporaine. Elles mobilisent le postféminisme pour décrire notre
contexte culturel actuel, « un contexte dans lequel le féminisme des années 1970 est
GLAD!, 04 | 2018
44
problématisé, scindé, considéré comme suspect » (Mascia-Lees et Sharpe 2000 : 3).
Selon Mascia-Lees et Sharpe, les dynamiques au sein du féminisme, des études de
genre, des discours postmodernes et de la culture populaire ont contribué à
l’émergence du postféminisme. Alors que le féminisme permettait à des femmes plus
nombreuses et aux expériences plus variées d’exprimer leurs craintes, « il a perdu son
identité singulière distincte, bien que peut-être illusoire » (Mascia-Lees et Sharpe 2000 :
5). Alors que les féminismes foisonnent et que les féministes commencent à occuper des
espaces de plus en plus divers et contradictoires, il n’était plus possible de désigner une
posture en particulier comme féministe. En effet, selon Mascia-Lees et Sharpe,
« adopter une posture féministe n’est plus facile, amusant, source d’empowerment, ni
même une possibilité » (2000 : 3). À mesure que des « débats internes », coupés des
mobilisations féministes extra-universitaires, accaparaient de plus en plus les
chercheu·r·se·s en études de genre, la théorie féministe a commencé à mettre l’accent
sur « la nature paradoxale » de l’entreprise féministe. Pour citer Joanne Frye, « le
féminisme vise les libertés individuelles en mobilisant une solidarité de sexe. Le
féminisme reconnait la diversité des femmes tout en postulant que les femmes
admettent leur unité. Le féminisme requiert, comme socle, une prise de conscience des
questions de genre et pourtant, il appelle à l’élimination des rôles prescrits des genres »
(1987 : 2). Parce qu’il n’a « que des paradoxes à offrir » (Scott 1996), le féminisme
n’apparait pas comme suffisamment intéressant pour que son caractère novateur et
prometteur suscite des ovations publiques. Alors que les discours postmodernes ont
gagné du terrain à l’université, les contestations des conceptualisations d’identité(s) et
de différence(s) « questionnent profondément le droit à prendre la parole […] [Par
conséquent], dans l’arène actuelle des idées, personne n’est concrètement en position
de formuler des revendications » (Mascia-Lees et Sharpe 2000 : 9). La prévalence de
« l’idéologie du self-help » dans la culture populaire, qui amène le politique à se fondre
dans le thérapeutique, complique encore davantage, selon Mascia-Lees et Sharpe,
« l’allégorie synthétisante » postmoderne de la fragmentation et de l’impuissance
(2000 : 93). Ces féministes qui tentent de nager contre le courant postmoderne, et qui
expriment avec insistance leurs critiques du pouvoir masculin, sont « quasiment
noyées par les discours de self-help qui ne cessent de se multiplier » (Mascia-Lees et
Sharpe 2000 : 95). Au sein du cadre élaboré par le mouvement des hommes, ce que les
féministes dénoncent comme la domination masculine est reformulé et exposé comme
un « mauvais comportement » qui résulte lui-même de la victimisation de l’homme
dépeint comme un enfant sans défense. Les propositions féministes pour la
restructuration des sphères publiques et privées sont alors supplantées par des
interventions thérapeutiques élaborées pour se réapproprier et soigner ce pauvre
enfant. Indéfendable intellectuellement, irréalisable politiquement et surpassé
thérapeutiquement, le féminisme dépérit. Toute tentative malavisée pour le rétablir
doit être reconnue comme « nostalgique et naïve, le vestige d’un désir ardent pour un
Éden perdu » (Mascia-Lees et Sharpe 2000 : 59).
16 Qu’il se situe dans des révoltes populaires présumées contre le féminisme, dans la
critique académique, dans la conscience féminine de la société postindustrielle ou dans
la culture contemporaine, le postféminisme induit une cartographie de l’espace social
destituant le féminisme de son point d’ancrage. Les limites du viable sont redessinées
pour en exclure toute présence féministe. Au sein du cadre narratif de l’extinction par
évolution, le postféminisme est un marqueur de temps mais aussi d’espace, impliquant
une séquence temporelle dans laquelle le féminisme a été transcendé, oblitéré, vaincu.
GLAD!, 04 | 2018
45
Les revendications du postféminisme peuvent alors être lues comme des
bannissements, nous enjoignant à imaginer les relations de genre, l’enseignement
supérieur, les psychismes individuels et la culture contemporaine en général comme
des zones spatiales et temporelles desquelles le féminisme a été éclipsé. Tout comme les
nécrologies dans la presse, les déclarations portant sur le postféminisme proclament
que le féminisme s’en est allé, nous a quitté·e·s, est décédé.·
Représentations de la dépouille du féminisme
17 Comme Nicole Loraux l’a si justement remarqué, « la mort-récit prête à conjecture »
(1985 : 13)10. Les proclamations concernant la mort du féminisme stimulent
indéniablement l’imagination. Comment la dépouille du féminisme peut-elle être
représentée ? Quelles formes de vie sont attribuées au féminisme et comment leur
associe-t-on des agonies spécifiques ? Le féminisme a été conçu comme une idée, un
ensemble de convictions, une idéologie, un mouvement social et une praxis. Comment
pouvons-nous conceptualiser la mort de phénomènes aussi divers que les
représentations mentales, les principes moraux, les modes d’existence et les formations
sociales ?
18 Dans Three Guineas (1938) 11, Virginia Woolf propose une généalogie du féminisme.
Attribuant l’origine du terme à des journalistes français de la fin du XIXe siècle, Woolf
remarque qu’il a été inventé dans le but de caricaturer et de dénigrer les femmes
activement impliquées dans la lutte pour « la Justice, l’Égalité et la Liberté. » Bien que
quelques suffragettes en Angleterre et aux États-Unis aient choisi de s’approprier ce
terme pour leurs propres projets, Woolf avance que des résidus de la caricature
originale ont continué à hanter le féminisme, déformant sa nature et ses objectifs. En
effet, Woolf remarque que pour beaucoup, le féminisme a été associé à un combat pour
les droits des femmes interprété trop étroitement — le droit de gagner sa vie, de
recevoir son propre salaire, d’être éduquée, d’exercer un métier et de voter. Comme ces
droits avaient été acquis par les femmes blanches en Nouvelle-Zélande, en Australie, en
Grande-Bretagne et aux États-Unis grâce à des campagnes historiques aux XIXe et début
du XXe siècles, le terme féminisme semblait tout particulièrement démodé, dépourvu
d’intérêt et inutile. Celles qui persistaient et continuaient à défendre les revendications
féministes pouvaient alors être écartées et qualifiées de ridicules, d’anachroniques,
d’excessivement bruyantes.
19 Pour marquer l’importance de l’obtention de ces droits par les femmes et pour libérer
la lutte continue contre la tyrannie et l’oppression masculines de l’idée que la bataille a
déjà été gagnée, Woolf imagine un bucher funéraire sur lequel les femmes
expurgeraient le mot féministe. Elles bruleraient le mot pour libérer le projet en cours.
Le scénario incendiaire de Woolf, un des premiers rituels funéraires symboliques
associé au terme féminisme, célèbre une mort étroitement associée à la résurrection. Car
selon elle, purger les connotations négatives associées à un terme injurieux constituait
un mécanisme qui pouvait ressusciter l’idée plus générale que femmes et hommes
continueraient à lutter ensemble contre les oppressions de genre, affranchi·e·s de la
dégradation causée par les déformations et les fausses représentations. En forte
opposition avec les notions de mort comme décomposition et disparition d’une entité
organique spécifique, Woolf décrit un bucher funéraire avec pour but l’élucidation
intellectuelle. Elle propose que, dans le champ des représentations mentales,
GLAD!, 04 | 2018
46
l’extinction du terme féministe pourrait faire avancer les causes que les féministes
défendent.
20 En imaginant une extinction rituelle du terme au nom de la cause, Woolf présageait un
débat récurrent au sein du féminisme et qui fait encore écho chez les femmes d’Europe
de l’Est, de Chine et d’Afrique ainsi que chez les jeunes femmes en Europe de l’Ouest et
aux États-Unis : que faire de cette injure ? Quelques femmes utilisent la tactique de
mise à mort lexicale de Woolf, faisant le choix d’enterrer l’étiquette féministe
lourdement caricaturée au nom de la poursuite de leur action. Dans ces cas-là, le
sacrifice rituel du féminisme est empreint d’ambigüité car le projet doit continuer.
21 Au lendemain des attaques contre le Pentagone et le World Trade Center le 11
septembre 2001, Jerry Falwell a d’abord qualifié l’enfer qui suivit d’exemple de la colère
de Dieu s’abattant sur l’humanité pour châtier les aberrations des idéologies féministes
(et d’autres idéologies progressistes). Interpréter le féminisme comme une idéologie —
plutôt que comme une idée ou un ensemble de convictions morales sur l’importance de
la liberté, de l’égalité et de la justice pour les femmes et les hommes — revient à
mobiliser une kyrielle d’associations politisées qui ont une longue histoire dans la
pensée politique. Examinez, par exemple, la définition d’idéologie du Cambridge
Dictionary of Philosophy : « un terme désobligeant communément utilisé pour décrire les
opinions politiques d’autrui perçues comme discutables »12 (Audi 1999 : 416). Les usages
contemporains d’idéologie ont tendance à s’inspirer autant de Napoléon Bonaparte que
de Karl Marx. Napoléon dénonçait l’idéologie comme des opinions abstraites, irréalistes
et fanatiques de révolutionnaires déterminés à détruire les fondements de la société
civilisée. Les traditionnalistes contemporains comme Falwell, qui accusent le féminisme
d’être une idéologie menaçant le caractère sacré du foyer, de la famille et de la
communauté morale, peuvent être considérés comme les héritiers contemporains de
Napoléon. Les châtiments bibliques imaginés par Falwell dans sa vision funeste
représentent la dépouille du féminisme, frappée par la condamnation divine. Dans cette
démonstration de vengeance tant attendue, Dieu aide « l’Homme » à purger la
communauté du corps féministe dangereux qui corrompt le corps politique. Le
féminisme est englouti par les flammes que Falwell invoque pour la purification rituelle
de la communauté dans son ensemble.
22 Marx associe l’idéologie aux idées d’une classe dirigeante bien établie. De ce point de
vue, une idéologie est une expression idéalisée et intrinsèquement déformée des
intérêts matériels de la classe dominante, qui imprègne de ce fait la conscience et
structure les perceptions de la plupart des membres d’une société. Du fait de sa relation
d’opposition aux idées dominantes dans la société contemporaine, le féminisme ne
correspond pas à la conception marxiste de l’idéologie. Mais avec le temps, les relations
de pouvoir que le marxisme a cherché à révéler grâce au concept d’idéologie ont été
occultées. Par conséquent, nombreu·x·ses sont celles et ceux qui définissent l’idéologie
de manière plus flottante, comme un ensemble d’idées qui défendent les intérêts d’une
classe ou d’un groupe spécifique. Défini ainsi, le féminisme peut être interprété comme
un ensemble de convictions et de valeurs qui profitent aux femmes. Défini ainsi, le
féminisme en tant qu’idéologie semble indissociable des connotations négatives du
féminisme que Woolf a cherché à détruire avec son bucher funéraire en 1938.
23 Mais cette dépouille féministe apparait dans des contextes inattendus. En effet, le
besoin d’exterminer le corps du féminisme « de l’égalité » est une caractéristique
dominante dans certains scénarios funèbres qui circulent dans les rangs féministes
GLAD!, 04 | 2018
47
ainsi que dans les milieux conservateurs. Voyez, par exemple, combien définir le
« postféminisme comme l’état actuel de la pensée féministe » (Brooks 1997 : 7) élimine
unilatéralement la diversité des féminismes. Tout en faisant l’éloge des approches
postmodernes et poststructuralistes de la théorie féministe qu’elle définit comme
« l’avènement du féminisme, sa maturation et son insertion dans les corps solides de la
théorie et de la politique, représentant le pluralisme et la différence » (1997 : 1), Brooks
donne à croire que tous les féminismes ont évolué et se sont transformés en
postféminisme. Plutôt que de reconnaitre que toutes les versions du féminisme font
face à une tâche inachevée et continuent de lutter pour atteindre des objectifs de plus
en plus insaisissables, certaines féministes éliminent rhétoriquement des modes
alternatifs de faire et de penser le féminisme. L’ironie dans le fait de confondre la
théorie féministe postmoderne avec toutes les formes de pratiques féministes —
éliminant ainsi le féminisme libéral, le féminisme radical, le féminisme culturel, le
féminisme lesbien et le féminisme socialiste au nom du pluralisme et de la diversité du
postféminisme — n’échappera pas aux militant·e·s et théoricien·ne·s ainsi réduit·e·s à
l’état de cadavres.
24 Pendant les campagnes pour les droits des femmes aux XIXe et XX e siècles, des
centaines de milliers de femmes sont descendues dans les rues, ont occupé les églises,
les synagogues, les locaux syndicaux et les salles de conférences afin de promouvoir
leurs causes, éduquer le grand public, récolter des signatures, faire pression sur les
élu·e·s pour transformer la législation et mobiliser pour le changement social et la
justice sociale. Le féminisme est souvent décrit comme un mouvement social afin de
rendre compte du caractère créatif, indépendant et innovant de l’action collective
incarnée par le militantisme de tant de femmes. Pourtant, en décrivant les multiples
formes et acquis du militantisme féministe comme un mouvement unique, de
nombreux récits emploient des métaphores de la durée de vie qui confèrent au
féminisme un commencement défini et une fin précise, une naissance et une mort.
Alors que ce cadre narratif tend à réduire le féminisme à un ensemble spécifique
d’objectifs (droits à la propriété, droits politiques, droit de vote, opportunités
professionnelles et d’éducation, législation pour l’égalité salariale ou droit à
l’avortement) et met l’accent sur les victoires historiques, il condamne
involontairement le féminisme à une espérance de vie assez limitée. On accorde
généralement au « mouvement des femmes » du XIXe siècle aux États-Unis, par
exemple, une durée de vie de soixante-douze ans, dont la naissance se situe à Seneca
Falls en 1848 et la mort en 1920 avec la ratification du 19e Amendement. La « seconde
vague », en revanche, est morte très jeune, ayant vu le jour, selon le récit de Sara Evan,
au début des années 1960 avec le Student Non-Violence Coordination Committee
(SNCC) et s’étant éteinte avant 1976 selon le récit de Veronica Geng13.
25 Bien qu’il ne fasse aucun doute que la conceptualisation du féminisme comme
mouvement social soit particulièrement pertinente dans certaines circonstances, se
reposer de manière excessive sur ce cadre analytique présente plusieurs inconvénients.
Interpréter le féminisme uniquement en termes de mouvement social attise la
fascination des médias pour le spectacle. Mais malheureusement, cela engendre aussi
des déclarations de mort une fois que les femmes n’occupent plus la rue. Associer le
féminisme à des formes de contestation et de manifestations massives entretient une
représentation du féminisme comme éternellement marginal. Puisqu’un statut de
marginal est fondamentalement incompatible avec le fait d’agir au cœur du système, le
féminisme est condamné à des manifestations temporaires et fugaces, car
GLAD!, 04 | 2018
48
l’institutionnalisation des principes féministes et la mobilisation au sein des
institutions restent à jamais hors d’atteinte. Le cadre analytique du mouvement social a
également tendance à réduire les objectifs féministes à ceux visant uniquement des
solutions légales. Une fois la législation passée, le féminisme devient obsolète. Par
conséquent, bien que la conceptualisation du féminisme comme mouvement social
mette en lumière une forme de militantisme féministe présente à des époques données,
elle a pour effet, ironiquement, de déclarer le féminisme comme mort bien avant que
les féministes aient obtenu les transformations sociales auxquelles elles et ils aspirent.
La mort du mouvement est déclarée alors que les féministes poursuivent la lutte pour
mener à bien un programme qui reste encore à accomplir.
26 Patricia Misciagno (1997) a défendu l’idée qu’on comprend mieux le féminisme quand
on le considère comme une praxis plutôt que comme un mouvement social. Par
contraste avec la conceptualisation de la mobilisation féministe comme mouvement
social qui postule la présence de leaders qui sensibilisent et motivent les individues à
agir, la notion de praxis implique que le féminisme émerge de manière autonome chez
des individues confrontées aux contradictions de leur existence. Selon Misciagno,
l’identité féministe n’est pas causée par des conditions matérielles ni par l’acceptation
d’une idéologie formulée par d’autres. Il s’agit d’un impératif existentiel qui se
développe chez une femme, à l’échelle individuelle, alors qu’elle lutte pour surmonter
les injustices et les contradictions émanant de situations d’oppression (Misciagno 1997 :
48). Par exemple, les injustices rencontrées dans l’atelier de Johnson Control peuvent
inspirer un sentiment féministe à des femmes de la classe ouvrière qui souhaitent
accéder à des postes mieux payés ; une décision judiciaire, selon laquelle des femmes
afro-américaines ne sont pas autorisées à saisir la justice pour des discriminations à la
fois sexistes et raciales car les doctrines juridiques régulant ces deux formes de
discriminations divergent, peut susciter un féminisme résolu, sensible aux complexités
de l’intersectionnalité chez les femmes noires ; l’homophobie concrétisée par le
Defense of Mariage Act (la loi de Défense du Mariage), qui limite les façons dont l’amour
peut être exprimé publiquement, peut éveiller une conscience féministe chez des
lesbiennes engagées dans des relations durables.
27 Conceptualiser le féminisme comme praxis aide à faire sens de la pluralité et de la
plurivocalité du militantisme féministe. Selon le cadre analytique de la praxis, il
pourrait y avoir autant de modalités de féminismes qu’il y a d’expériences vécues
d’injustices raciales et de genre. Le concept de praxis distancie le militantisme
féministe du spectacle des manifestations massives élaborées pour capter l’attention
des médias vers les politiques du quotidien et met ainsi en lumière la multitude de
luttes féministes comprises dans les efforts des femmes pour subsister, pour vivre dans
la dignité et le respect, pour affronter la violence et pour construire des communautés
équitables et durables. La conceptualisation du féminisme comme praxis souligne
également que devenir un·e féministe est un processus complexe qui se développe au fil
du temps et qui implique des changements tant dans la connaissance de soi, les
comportements, les façons de se vêtir et de se tenir, les relations avec les ami·e·s et les
partenaires amoureu·x·ses, que dans les environnements artéfactuels et sociaux. Le
modèle praxique du féminisme insiste sur le fait que le féminisme n’est jamais fixe ni
statique. En ce sens, le féminisme n’est jamais un projet accompli ; il se développe et
s’adapte aux circonstances changeantes de l’oppression des femmes.
GLAD!, 04 | 2018
49
28 Le féminisme comme praxis permet à la mort de s’insérer dans ce cadre par analogie
avec la durée de vie d’un·e individu·e. Dans la mesure où la praxis individualise le
féminisme, associant son émergence à la prise de conscience, la résistance et
l’opposition aux injustices raciales et de genre dans les expériences de vie individuelles
des femmes, on pourrait dire que des modalités spécifiques de féminismes disparaissent
avec la mort de féministes spécifiques. Bien qu’une telle analogie de la durée de vie
permette de faire sens du recours à la métaphore de la mort en référence au féminisme,
une disparité significative demeure entre les affirmations concernant la mort du
féminisme et la disparition d’instanciations singulières du féminisme due à la mort des
femmes qui y sont associées. La conception praxique du féminisme donne un sens aux
déclarations de mort mais il s’agit d’un sens qui reste bien éloigné de l’intention de
celles et ceux qui font ces déclarations et qui sous-entendent l’éradication totale de
toutes les formes de féminismes et pas uniquement du décès d’une féministe en
particulier. Conçue pour expliquer le processus par lequel la conscience féministe
émerge chez certaines femmes, l’individualisation centrale à la thèse de la praxis n’a
jamais eu pour ambition d’expliquer l’élimination du féminisme comme force sociale.
29 La dépouille du féminisme est une figure remarquablement versatile, qui hante les
tracts féministes comme antiféministes. Dans les textes féministes, les représentations
de la dépouille du féminisme miment la mère morte en couches, permettant à l’autre de
vivre. Le sacrifice rituel du terme féminisme permet aux divers projets transformateurs
des femmes de perdurer. Les conceptions naissantes des intérêts des femmes associées
à la lutte évolutionniste de diverses espèces de féminismes libéral, radical, lesbien et
socialiste sont supplantées via un processus de sélection naturelle par une pluralité
postféministe qui fait avancer le patrimoine génétique féministe purifié. Les vagues
successives des mouvements féministes meurent pour que les générations suivantes
puissent bénéficier des progrès que le militantisme féministe a rendus possibles. Les
féministes, à l’échelle individuelle, meurent en ayant donné un sens à leur praxis
féministe, nous léguant un monde devenu meilleur grâce à leurs multiples luttes.
Placées dans un tel cadre utilitariste, les représentations féministes de la dépouille du
féminisme peuvent être perçues comme bénignes, car elles symbolisent une disparition
pour le bien collectif féministe.
30 Les représentations antiféministes de la dépouille du féminisme revendiquent
également des fins bénéfiques, mais pas pour les féministes. Selon Falwell, le féminisme
est une abomination idéologique sur laquelle s’abat la colère de Dieu, signifiant aux
fidèles qu’il leur faut purger leurs rangs des éléments corrupteurs. Selon Davidson,
l’extinction du féminisme est productrice d’harmonie sociale et permet le
rétablissement des valeurs traditionnelles, afin que tou·te·s les membres de la
communauté puissent s’épanouir en conformité avec leurs inclinations « naturelles ».
31 La dépouille féministe peut fonctionner comme signifiant dans des systèmes de
signification radicalement différents. Cependant, étant données les preuves accablantes
de la vitalité persistante du féminisme à travers le monde, il serait pertinent
d’examiner la signification non pas de la mort proprement dite mais plutôt de
l’enterrement prématuré du féminisme.
GLAD!, 04 | 2018
50
Les sémiotiques de l’enterrement prématuré
32 La pratique de « l’enterrement vivant » a une histoire — et une histoire genrée. Une
exhumation de cette histoire pourrait apporter quelques indices quant aux sens
possibles de l’enterrement prématuré du féminisme. La pratique d’enterrer des femmes
vivantes a été documentée dans un certain nombre de cultures : l’Égypte ancienne, la
Rome républicaine et l’Europe médiévale. Je souhaite explorer quelques-unes de ces
pratiques afin d’apporter un éclairage à la sémiotique de l’enterrement prématuré du
féminisme.
33 Dans l’Égypte ancienne, les hommes de biens et de pouvoirs étaient traditionnellement
enterrés avec leur entourage afin que leurs besoins soient satisfaits de manière
adéquate dans « l’au-delà ». Les archéologues ont nommé cette pratique « inhumation
avec sacrifice humain ». Joseph Campbell montre que la mise en terre des épouses
vivantes, « et dans les tombeaux les plus opulents, du harem entier » (1962 : 60) doit
être comprise comme une extension des rôles sociaux joués par les femmes de leur
vivant. Ainsi, l’économie genrée du care qui structure les devoirs des femmes demeure
constante dans la vie et, en les enterrant vivantes, dans la mort. Dans ce cadre
explicatif, les femmes existaient pour satisfaire aux besoins de leur mari-maitre. Être
enterrées vivantes leur permettait de remplir dans tous les mondes possibles la
fonction qui leur était assignée. Leurs morts prématurées étaient insignifiantes dans un
cosmos qui les considérait comme moins qu’humaines. En effet, remarque Campbell,
« ces sacrifices n’étaient, en fait, pas du tout proprement individuels ; autrement dit,
elles n’étaient pas des individues, distinctes d’une classe ou d’un groupe en vertu du
sens ou de la réalisation d’une destinée ou d’une responsabilité individuelle
personnelle » (1962 : 65). La mécanique de cet argument est édifiante. Un système social
attribue aux femmes des rôles et des obligations spécifiques qui subordonnent leur
humanité en les considérant comme des outils au service des besoins des autres. Aucun
sacrifice donc, aux yeux du système qui a défini leur existence comme instrumentale,
puisque leurs morts sont prescrites par les besoins qu’elles sont destinées à satisfaire.
Cette logique instrumentaliste peut-elle permettre d’appréhender la mort du
féminisme ? Peut-on imaginer un objectif plus large que le féminisme et sa mort
seraient destinés à servir ?
34 À première vue, l’essence du militantisme féministe semble profondément
incompatible avec une économie genrée du care qui privilégie les besoins des hommes,
car au cœur du féminisme réside une lutte pour la liberté des femmes. Mais beaucoup
parmi celles et ceux qui conçoivent le féminisme, temporellement, comme une étape
transitoire entre un monde préféministe et un monde postféministe instrumentalisent
le projet féministe. Ils et elles le présentent comme une expérience ratée mais qui a
permis de réitérer une vérité plus large : la vérité quant au « rôle naturel » des femmes,
la vérité quant à « la masculinité et la féminité traditionnelles ». La fonction du
féminisme est alors de démontrer l’impossibilité d’une véritable égalité entre hommes
et femmes, une fonction remplie par l’avènement du postféminisme. En ce sens,
l’invitation à imaginer le féminisme comme mort est une invitation à répudier l’égalité
sexuelle et la justice en matière de genre, à admettre comme naturelles des relations de
pouvoir asymétriques entre hommes et femmes et à accepter l’existence d’un fossé
infranchissable entre nos prétendus idéaux et la réalité vécue.
GLAD!, 04 | 2018
51
35 Peut-être n’est-ce pas un hasard si la nécrologie du féminisme a d’abord été publiée aux
États-Unis, une démocratie libérale qui affirme considérer l’égalité comme un de ses
« idéaux les plus chers ». La mort du féminisme confirme combien sont évidentes les
vérités inscrites par les fondateurs de la République américaine dans la Déclaration
d’Indépendance, « que tous les hommes naissent égaux et […] dotés par leur créateur de
droits inaliénables » (mes italiques). Maintenant comme alors, l’idéal existe bien loin
des expériences vécues des femmes et des personnes de couleur. Pourtant, quand les
féministes tentent de mettre en œuvre l’égalité promise, le projet est décrété non
viable. Enterrer le féminisme vivant sert alors simultanément à « déréaliser » les
ambitions des femmes pour l’égalité et à les rendre impuissantes tout en réaffirmant le
bon sens du statu quo.
36 Enterrer des individues vivantes a également été pratiqué dans des contextes
sensiblement différents de l’économie genrée du care de l’Égypte ancienne. Dix cas
« d’emmurement vivant » de Vestales ont été documentés sous la République romaine
(Balsdon 1963 : 240). Porteuses d’une mission sacrée, les Vestales avaient la
responsabilité de faire en sorte que le feu sacré dans le temple de la déesse Vesta ne
s’éteigne jamais. Selon W. Warde Fowler, protéger le feu sacré était d’une importance
politique et religieuse cruciale : « Dans toutes les fonctions publiques qu’elles
remplissaient, nous pouvons discerner une idée principale — que la nourriture et
l’alimentation de l’État, dont le feu sacré était le symbole, dépendent pour la
préservation de celui-ci de la réalisation rigoureuse de leurs missions » (1899 : 114). La
pureté, l’innocence, la chasteté et la virginité étaient pensées comme des prérequis
pour cette réalisation rigoureuse des missions des Vestales envers l’État. En effet, « la
pureté des Vestales était le gage et la garantie de la bonne santé et du salut de Rome
elle-même » (Balsdon 1963 : 238).
37 Les enterrer vivantes était la sentence infligée aux Vestales déclarées coupables
d’impureté ou d’immoralité sexuelle. Selon Plutarque, les Vestales qui mettaient en
danger la sécurité de Rome par leur propre « corruption » sexuelle étaient emmurées
vivantes dans « une petite chambre souterraine construite avec un accès par le haut via
une échelle. S’y trouvaient un lit, une lampe allumée et des petites portions du
nécessaire minimum pour vivre — du pain, une cruche d’eau, du lait et de l’huile, afin
que les Romains aient la conscience tranquille et que personne ne puisse les accuser
d’avoir affamé et tué une femme consacrée au plus sacré des rituels » (cité dans Balsdon
1963 : 240). Dans ce cas, il semble qu’enterrer les Vestales vivantes constitue une
sentence de mort sans bourreau, un moyen de délivrer le gouvernement d’un fléau
politique sans qu’un cadavre n’oblige quiconque à en assumer la responsabilité.
38 Si, en ayant des rapports sexuels, les Vestales avaient mis l’empire en péril, pourquoi
les Romains auraient-ils craint d’avoir recours à une peine capitale bien méritée ? J. P.
V. D. Balsdon remarque que l’emmurement des Vestales vivantes était une pratique
rare, beaucoup plus rare que les cas d’activité sexuelle de la part des femmes auxquelles
était attribuée cette fonction sacrée. Des accusations étaient proférées et des sentences
exécutées uniquement lorsqu’un drame national ou un complot politique créaient une
situation propice à l’apaisement des dieux ou à la réforme des morales publiques en
infligeant la sentence à une Vestale. La culpabilité réelle de la Vestale accusée n’avait
alors aucune importance (Balsdon 1963 : 239-42). Compte tenu du statut problématique
de l’accusée, la sentence était élaborée consciencieusement afin d’écarter toute
responsabilité et tout reproche. Au moment de sa réalisation, l’enterrement, vivante,
GLAD!, 04 | 2018
52
de la femme condamnée ne la plaçait ni parmi les vivant·e·s ni parmi les mort·e·s.
Installée dans un espace hors de celui des vivant·e·s mais pas encore morte, la Vestale
sacrifiée était confinée de manière à empêcher son retour. En terre, elle était effacée
des perceptions sensorielles des vivant·e·s. Elle ne pouvait leur faire aucune demande.
Mais pas encore morte, elle n’avait pas droit aux rituels de deuil, à la commémoration
de sa vie et aux dons. Elle était effacée.
39 Le cas de l’enterrement de Vestales vivantes offre de nouvelles possibilités
d’interprétation pour comprendre l’enterrement prématuré du féminisme. Dans le cas
romain, enterrer des individues vivantes exige une imputation de la culpabilité absente
des pratiques traditionnelles de l’inhumation qui ont ôté la vie aux épouses-concubines
égyptiennes. Interprétés littéralement, les enterrements de Vestales vivantes
représentent une sentence pour manquement à leur devoir politique voire pour
sédition14. Les références au soin et à l’alimentation de l’État mobilisent les notions de
loyauté et de soutien envers le régime en place et les définissent comme des missions
politiques de premier ordre anéanties par des Vestales prétendument lubriques. Existe-
t-il des manquements au devoir similaires envers le régime politique actuel dont le
féminisme pourrait être accusé ? Le féminisme pourrait-il être interprété comme un
mode de sédition justifiant un sacrifice rituel destiné à purger le système de ce fléau
politique ?
40 L’émergence du féminisme comme phénomène global a coïncidé avec la fin de la Guerre
Froide et la recrudescence du capitalisme sous le signe de la globalisation. Alors que
l’Ouest proclamait sa victoire contre le système soviétique et faisait rimer
démocratisation avec réformes économiques néolibérales et politiques libérales
démocratiques, les féminismes révélaient les inégalités croissantes et généralisées au
sein des états capitalistes et entre le Nord et le Sud. La « féminisation de la pauvreté »,
que les féministes ont identifiée comme un phénomène global en expansion, atteste de
manière éloquente des limites des propositions néolibérales quant au développement
durable15. Le militantisme dynamique des féministes des pays du Sud contre les
politiques d’ajustement structurel et autour des politiques de subsistance tourne en
dérision les déclarations selon lesquelles le capitalisme remédie à la pauvreté. La lutte
continue des féministes pour l’égalité de genre dans la gouvernance et pour la
participation à niveau égal des femmes dans les processus décisionnels publics et privés
représente un challenge considérable pour les régimes démocratiques libéraux où les
femmes sont terriblement sous-représentées, occupant moins de 20 % des sièges dans
les instances décisionnelles nationales. De telles contestations féministes pourraient-
elles être interprétées comme des trahisons politiques, comme des efforts militants
pour subvertir les systèmes politiques et économiques dominants, s’exposant alors à
être condamnées à être enterrées vivantes ?
41 Le fait que la culpabilité ou l’innocence de certaines Vestales en particulier n’ait aucun
lien avec leur condamnation à être enterrées vivantes lorsque les machinations de
l’élite politique jugent un sacrifice rituel nécessaire est un élément central de ce cadre
d’interprétation. Car il nous aide à comprendre comment l’enterrement rituel du
féminisme peut être ordonné par le biais d’une déclaration politique même si les
féministes ne sont pas, en toute objectivité, coupables de sédition. Les affirmations
récurrentes de la mort du féminisme extraient le féminisme de la perception
sensorielle des vivant·e·s. Transformant avec subtilité l’actif en inerte dans l’esprit
public, les déclarations de la mort du féminisme effacent les actions militantes de
GLAD!, 04 | 2018
53
millions de femmes à travers le monde qui continuent de se battre pour la justice
sociale. Cette suppression contrôle toute menace que le militantisme féministe
représente pour le système dominant tout en contribuant l’entretien d’un mythe de
soutien universel pour le programme néolibéral. Elle réaffirme la notion hégémonique
selon laquelle le modèle américain est le meilleur modèle pour le reste du monde. Il
relègue à un silence de mort les voix de celles et ceux qui s’opposent aux efforts des
États-Unis pour remodeler le monde à son image. Mobilisant une telle dialectique de la
trahison et de la sentence, l’enterrement du féminisme vivant apparait comme mérité,
même si une réelle culpabilité est loin d’être prouvée. Le retrait du féminisme global de
la conscience des vivant·e·s via les déclarations de mort fait également office de baume
protecteur. Une menace envers les valeurs du régime dominant est éliminée sans
bourreau ni corps. Comme cela fut le cas pour les Romains de Plutarque, il n’y a pas de
remords quand la cause du décès du féminisme est la mort par déclaration.
42 Il semble que le cas le plus connu d’une femme condamnée à être enterrée vivante ne
nous vienne pas de sources historiques mais plutôt du théâtre grec. Antigone, de
Sophocle, fait le récit de l’enterrement d’une individue vivante comme châtiment
politique. Les interprétations classiques de cette tragédie mettent généralement en
avant des confrontations mémorables entre de grands principes irréconciliables — la
liberté versus le destin, la conscience personnelle versus le bien-être public, les
responsabilités familiales versus les obligations civiques, la loi humaine versus la « loi
divine », les instincts premiers versus la raison politique, les demandes des vivant·e·s
versus les demandes des mort·e·s et les exigences de la guerre versus les impératifs pour
le maintien de la paix (Steiner 1986) — mais ces interprétations s’attardent rarement
sur des descriptions de subversion de genre et ses liens à l’ordre politique que Sophocle
expose dans sa pièce de théâtre. Une lecture féministe d’Antigone pourrait alors nous
éclairer sur le symbolisme genré de l’enterrement d’individues vivantes et nous aider à
faire sens de l’enterrement prématuré du féminisme.
43 Dans Antigone, Créon, roi de Thèbes, enterre, vivante, la fille endeuillée d’Œdipe car elle
enfreint ses lois : elle inhume son frère assassiné malgré l’interdiction formelle du roi.
Le crime d’Antigone est alors également un acte de sédition. Mais comme Créon
l’explicite dans son accusation envers Antigone, sa trahison représente bien plus que la
transgression de l’édit du roi contre les inhumations. La décision et l’action d’Antigone
défient l’ordre genré sur lequel repose la cité de Créon. En choisissant d’agir selon sa
conscience et sa propre interprétation de la loi de Zeus, Antigone usurpe une
prérogative masculine : le droit d’agir librement. L’analyse de l’acte d’Antigone
formulée par Créon est très claire à ce sujet :
Voilà que cette fille, non contente d’avoir déjà montré son orgueil démesuréen transgressant les lois promulguées, réitère, redouble d’arrogance en sevantant de ce qu’elle a fait et se riant de nous. De nous deux, ce n’est plus moil’homme, mais elle, si elle l’emporte et demeure impunie. (Sophocle 2011 : 20 ;mes italiques)16
44 Créon perçoit dans le fait qu’Antigone se soit approprié une liberté réservée aux
hommes une menace envers sa masculinité et sa fonction royale. Si elle se comporte
comme un homme, alors il perd sa qualité d’homme. En construisant la liberté comme
un jeu à somme nulle genré, Créon définit les enjeux de sa confrontation avec Antigone.
Il associe son émasculation à l’expression de son agentivité à elle. Alors qu’Antigone
décrit son action en termes de responsabilité envers son frère défunt et d’adhésion à
GLAD!, 04 | 2018
54
une loi supérieure à la volonté de Créon, celui-ci maintient que cet acte doit être
interprété comme une subversion de genre aux effets dé-genrants. De son point de vue,
en affirmant son agentivité, Antigone endosse non seulement le rôle attribué
rituellement aux hommes dans l’Antiquité grecque, mais elle le féminise également lui-
même.
45 Dans son Antigone, Sophocle dépeint une culture qui non seulement a genré l’espace
physique, consignant les femmes aux tréfonds de l’espace domestique tout en
accordant aux hommes l’espace public, mais qui a également genré la vertu. Parmi les
critères d’excellence associés à chaque sexe et dont Aristote fait l’inventaire, l’analyse
du courage comme performance genrée aide à faire sens de l’interprétation formulée
par Créon quant à l’infraction d’Antigone. Dans Les Politiques, Aristote stipule que « chez
l’homme il y a un courage de chef, chez la femme un courage de subordonné » (2009 :
54)17. Si Créon permet aux actions d’Antigone de rester impunies, il se soumet alors à
son commandement. En obéissant docilement, il serait féminisé. En l’autorisant à le
gouverner, il lui accorderait la souveraineté que la nature accorde aux hommes18. En
tant qu’homme et en tant que roi, Créon se sent obligé d’écarter cette possibilité. Ainsi,
il dit au chœur : « Moi vivant, aucune femme ne me dictera sa loi » (Sophocle 2011 :
21)19. Et il agit rapidement pour réaffirmer son commandement, ordonnant
l’arrestation et la mise à mort d’Antigone et restaurant ainsi l’ordre « naturel » du
genre. En décidant qu’enterrer Antigone vivante est la peine adéquate, Créon cherche à
rétablir immanence, passivité et sujétion ainsi que sa domination, avisant le chœur que
cet enterrement la forcera à être une femme et à rester à sa place (Sophocle 2011 : 24).
46 La tombe comme espace approprié pour une femme rebelle et comme agent ultime de
la socialisation de genre peut faire l’objet de multiples interprétations20. Cloitrer
Antigone sous terre, loin du regard des vivant·e·s et privée de toute possibilité d’agir
librement, revient à la soumettre aux processus duels de privation-privatisation qui
imitent la condition des femmes athéniennes respectables enfermées dans leurs foyers.
Pour remplir la mission ordonnée par Créon, la tombe est conçue pour faire office non
seulement de mandataire de la mort d’Antigone mais également de représentante d’un
re-genrement cruel. Privée de toute possibilité d’agir librement, Antigone s’en trouve
réduite à un corps inerte, renvoyée au besoin d’immanence que les philosophes
classiques qualifiaient d’essence de la féminité. Ce symbolisme n’échappe pas à
Antigone. Alors qu’elle pénètre dans sa chambre mortuaire, elle parle d’un retour dans
la sphère des femmes. « O tombeau qui seras ma chambre nuptiale, demeure
souterraine qui seras la mienne à jamais ! en m’en allant vers toi, je rentre auprès des
miens. »21
47 Le sort d’Antigone représente bien plus que la normalisation de genre comme
châtiment pour la transgression de genre car l’enterrer vivante ne rétablit l’ordre
genré que si elle disparait. L’emmurer constitue l’ultime exclusion grâce à laquelle la
communauté peut redessiner ses frontières. Le chœur, la voix des valeurs
communautaires dans cette tragédie, affirme la pertinence de mesures extrêmes pour
celles et ceux qui défient les valeurs fondamentales de la cité :
Si l’audace le pousse à défier l’ordre établi,Qu’il n’ait plus place aucune à mon foyerNon plus que dans mes pensées.(Sophocle 2011 : 17)22
GLAD!, 04 | 2018
55
48 Enterrée vivante, Antigone est exilée au-delà des frontières du foyer et au-delà des
frontières de la cité. Selon les clauses édictées par la société patriarcale dans laquelle
elle vit, il ne pouvait y avoir de place dans la conscience de ses contemporain·e·s, ni
même parmi les vivant·e·s, pour une femme qui agit pour une cause illégitime. Antigone
incarne cette cause illégitime. Née d’un père qui était son frère, elle ne peut être
reconnue comme une enfant légitime. En faisant le choix de vivre selon sa propre
conscience au mépris du décret du roi, elle se déclare elle-même hors-la-loi. Par ses
mots et par ses actes, elle se déclare elle-même l’initiatrice et l’agente de ces propres
actions. Elle ne demande aucune autorisation à aucun homme vivant. Elle est alors le
prototype des femmes indisciplinées des vagues successives de militantisme féministe
qui défient l’ordre en vigueur.
49 En se déclarant « identifiées-femmes », en élaborant des méthodes d’analyse du genre
qui placent les femmes en leur centre, en développant des programmes d’action
politique qui reflètent l’articulation des besoins et des intérêts des femmes dans des
contextes spécifiques et en insistant sur le fait que la subordination des femmes est une
injustice intolérable, les féministes promeuvent de nombreuses causes illégitimes — des
causes qui ne portent pas le nom du(des) père(s) ni ne jouissent de leur bénédiction.
Comme Antigone, les féministes semblent « nées pour contester » le pouvoir patriarcal.
L’enterrement prématuré du féminisme contemporain peut alors être lu en écho au
destin d’Antigone. L’enterrement apparait comme un sort particulièrement odieux
pour le féminisme encore vivant, conçu pour infliger une souffrance maximale aux
femmes qui entreprennent de vivre leur liberté. La tombe représente la privatisation
ultime pour des stratégies politiques féministes destinées à rendre publiques des
expériences jusqu’ici privées, des expériences de domesticité, d’intimité, de sexualité et
de conscience. Enterrer le féminisme encore vivant correspond alors véritablement aux
démarches néolibérales de restriction des programmes politiques, de réduction des
espaces publics, de restauration de l’espace privé dissimulé. En limitant le champ
d’action des féministes ainsi que la compréhension publique des possibilités d’action
politique, l’emmurement du féminisme vivant par le néolibéralisme re-genre les
féministes et leurs projets, les renvoyant à un état d’inertie forcée tout en réaffirmant
le caractère sacré des relations personnelles à l’abri du regard public et de l’action
politique.
50 Les nécrologies récurrentes du militantisme féministe peuvent également être
interprétées comme une redéfinition des frontières communautaires afin d’obtenir
bien plus que l’exil du féminisme, afin, en fait, de l’annihiler. La distanciation est un
outil rhétorique conçu pour séparer un « nous » d’un « elles et eux ». Pour les
mortel·le·s, il n’existe pas de distance plus grande que celle entre les vivant·e·s et les
mort·e·s. Déclarer le féminisme comme mort revient alors à qualifier le militantisme des
femmes autonomes de complètement étranger aux vivant·e·s, de le décrire comme un
mode d’existence si dissemblable qu’il ne peut être toléré au sein de « nos »
communautés. En marquant rituellement la mort du féminisme à chaque invocation du
postféminisme, celles et ceux qui souhaitent voir le féminisme expulsé du monde
contemporain y portent préjudice tout en dissimulant leur propre culpabilité. Jean-
François Lyotard a défini le préjudice comme un tort accompagné d’un manque de
moyens pour prouver les dommages (1990 : 5). L’enterrement prématuré du féminisme
constitue un tel préjudice. Sans corps, sans preuve de décès, avec seulement quelques
vagues soupçons de blessures auto-infligées et des causes naturelles, la mort du
GLAD!, 04 | 2018
56
féminisme par déclaration élimine le militantisme pour la justice sociale des femmes du
monde entier tout en effaçant les traces de cette élimination. Les proclamations de la
mort du féminisme invitent le public à prendre part à ce préjudice, à enterrer
rituellement celles et ceux dont la cause est la justice raciale et de genre tout en
déclarant l’injustice irrémédiable. Il reste à voir si le public acceptera cette invitation
ou rejettera la supercherie.
51 Jean Franco (2002) a souligné que des constellations de sens s’agglomèrent autour de
cadavres puissants. La dépouille féministe est à l’évidence compatible avec des
constellations de sens multiples. Mais si j’ai raison en affirmant que la publication
systématique de la nécrologie du féminisme et la construction soignée du monde
contemporain comme zone spatiale et temporelle du postféminisme constitue un
préjudice, alors les féministes devraient faire de ce terrain culturel la cible d’actions
intensives.
Je remercie Joan Tronto dont l’article provocateur, « Time’s Place », a stimulé ma
réflexion sur les déclarations récurrentes de la « mort » du féminisme. J’aimerais
également remercier Tim Kaufman-Osborne, John Nelson, Anna Lorien Nelson,
Philip Alperson et les deux relecteurs ou relectrices anonymes pour leurs
remarques constructives sur une version antérieure de cet article.
BIBLIOGRAPHIE
ALVAREZ, Sonia. 1998. « Feminismos latinamericanos : Reflexiones teóricas y perspectivas
comparativas. » in Reflexiones teóricas y comparativas sobre los feminismos en Chile y America Latina,
RÍOS TOBAR Marcela (éd.). Santiago : Nostas del Conversatorio, 4-22.
ARISTOTE. 2009. Politiques. Livre I. PELLEGRIN, Pierre (trad.). Paris : Nathan.
ARISTOTLE. 1946. The Politics. BARKER, Ernest (éd. et trad.). Oxford : Oxford University Press.
AUDI, Robert (éd.). 1999. The Cambridge Dictionary of Philosophy. 2de éd. Cambridge : Cambridge
University Press.
BALSDON, J. P. V. D. 1963. Roman Women : Their History and Habits. New York : Day.
BHABA, Homi. 1986. « The Other Question: Difference, Discrimination and the Discourse of
Colonialism. » in Literature, Politics, Theory, BARKER Francis Barker, HULME Peter, IVERSEN
Margaret, LOXLEY Diana (éds.). London : Methuen, 165-88.
BROOKS, Ann. 1997. Postfeminisms: Feminism, Cultural Theory, and Cultural Forms. London :
Routledge.
CAMPBELL, Joseph. 1962. The Masks of God : Oriental Mythology. New York : Viking. DAVIDSON,
Nicholas. 1988. The Failure of Feminism. Buffalo, New York : Prometheus
Books.
EISENSTEIN, Hester. 1991. Gender Shock : Practicing Feminism on Two Continents. Boston : Beacon.
GLAD!, 04 | 2018
57
EVANS, Sara. 1979. Personal Politics. New York : Vintage Books.
EVANS, Sara. 1989. Born for Liberty. New York : Free Press.
FOWLER, W. Warde. 1899. The Roman Festivals. New York : Macmillan.
FRANCO, Jean. 2002. The Decline and Fall of the Lettered City. Cambridge, Mass. : Harvard University
Press.
FRYE, Joanne. 1987. « The Politics of Reading Feminism : The Novel and the Coercions of
“Truth.” » Article présenté à la Midwest Modern Language Association Meeting, novembre,
Columbus, Ohio.
GENG, Veronica. 1976. « Requiem for the Women’s Movement. » Harper’s, novembre : 49–56, 61–
68.
GOODWIN, Sarah Webster & BRONFEN, Elisabeth. 1993. Death and Representation. Baltimore : Johns
Hopkins University Press.
HOWELL, Jude & MULLIGAN, Diane (éds.). 2003. « Gender and Civil Society : Challenges for
International Feminism » numéro spécial de International Feminist Journal of Politics, 5 (2).
HYMOWITZ, Kay. 2002. « The End of Herstory. » City Journal 12 (3) :1-9.
IRIGARAY, Luce. 1974. Speculum. De l’autre femme. Paris : Les Éditions de Minuit.
IRIGARAY, Luce. 1985. Speculum of the Other Woman. Ithaca, N.Y. : Cornell University Press.
LORAUX, Nicole. 1985. Façons tragiques de tuer une femme. Paris : Hachette.
LORAUX, Nicole. 1987. Tragic Ways of Killing a Woman. FORSTER, Anthony (trad.). Cambridge,
Mass. : Harvard University Press.
LYOTARD, Jean-François. 1990. Heidegger and « The Jews. » MICHEL, Andreas (trad.) ROBERTS, Mark
S. Minneapolis : University of Minnesota Press.
MASCIA-LEES, Frances & SHARPE, Patricia. 2000. Taking a Stand in a Postfeminist World : Toward an
Engaged Cultural Criticism. Albany, N.Y. : SUNY Press.
MISCIAGNO, Patricia. 1997. Rethinking Feminist Identification : The Case for De Facto Feminism.
Westport, Conn. : Praeger.
MODLESKI, Tania. 1991. Feminism without Women : Culture and Criticism in a « Postfeminist » Age. New
York : Routledge.
SCOTT, Joan. 1996. Only Paradoxes to Offer : French Feminists and the Rights of Man. Cambridge, Mass. :
Harvard University Press.
SOPHOCLE. 2011. Antigone. DAVREU, Robert (trad.) Arles : Actes Sud-Papiers.
SOPHOCLES. 1973. Antigone. BRAUN, Richard Emil (trad.). Oxford : Oxford University Press.
STACEY, Judith. 1992. « Sexism by a Subtler Name : Postindustrial Conditions and Postfeminist
Consciousness in Silicon Valley. » in Gendered Domains : Rethinking Public and Private in Women’s
History, HELLY, Dorothy et REVERBY, Susan (éds.). Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 322-38.
STEINER, George. 1986. Antigones. Oxford : Clarendon.
UNIFEM (United Nations Development Fund for Women). 2002. « Progress of the World’s Women,
2002. » URL : http://www.unifem.org.
WOOLF, Virginia. 1938. Three Guineas. New York : Harcourt, Brace & World.
GLAD!, 04 | 2018
58
WOOLF, Virginia. 2016. Trois Guinées : Se Refuser à l’Impassibilité et Lutter, Ô Dictateurs, pour
l’Avènement de la Société des Outsiders. COTTÉ, Jean-Yves (trad.). Toulouse : Gwen Català Éditeur.
NOTES
1. Ndlt : pour la version française originale : Loraux, Nicole. 1985. Façons tragiques de tuer une
femme. Paris : Hachette. Pour la traduction anglaise utilisée par l’auteure, voir bibliographie.
2. Ndlt : pour la traduction française tirée de : Sophocle. 2011. Antigone. Davreu, Robert (trad.)
Arles : Actes Sud-Papiers. Pour la traduction anglaise utilisée par l’auteure, voir bibliographie.
3. Ndlt : pour la traduction française, l’utilisation, ou non, de l’écriture inclusive à travers le texte
relève des choix de l’auteure.
4. Ndlt : sauf indication contraire, les traductions des extraits cités par l’auteure sont réalisées
par la traductrice, les informations bibliographiques (année, pages) sont celles de l’auteure et
font référence aux ouvrages et articles listés dans la bibliographie.
5. Le site web de l’annuaire d’Electrapages est http://electrapages.org. Le site web d’Euronet, une
base de données regroupant les organisations féministes à travers le monde, est http://
www.euronet.nl/~fullmoon/womlist/womlist.html.
6. Pour un panorama de l’expansion du féminisme pendant cette période, voir Howell et Mulligan
2003.
7. Ndlt : version originale française : Loraux, Nicolas. Op. cit.
8. Bien que Brooks reconnaisse que, dans les discours communs, le postféminisme a été associé
aux politiques du backlash, elle soutient que le terme postféminisme prend un sens bien différent
dans la théorie féministe et ne suppose en aucun cas de l’antiféminisme, une approche que je
contesterai ci-après.
9. Contrairement à de nombreux récits traitant de la mort du féminisme et qui postulent un fait
accompli, Davidson laisse entendre qu’une « bataille » finale pourra s’avérer nécessaire pour
cloitrer le féminisme dans sa tombe : « Mais le féminisme ne pliera pas de son propre chef.
Enraciné dans les foyers d’influence les plus puissants de notre culture, de l’université et du
journalisme jusqu’à Hollywood et au secteur de l’édition, les féministes sont aujourd’hui en
position d’exercer une influence majeure et à long terme sur notre culture, quel que soit leur
taux de réussite ou d’échec sur le marché des idées ou dans les bureaux de vote. Elles doivent être
combattues sans relâche, des partis politiques aux soirées mondaines, afin qu’elles ne triomphent
pas grâce au simple manque de résistance qui a toujours été leur plus grande ressource » (1988 :
337).
10. Ndlt : version originale française : Loraux, Nicolas. Op. cit.
11. Ndlt : il existe plusieurs traductions françaises de cet ouvrage. On peut citer l’une des plus
récente : WOOLF, Virginia. 2016. Trois Guinées : Se Refuser à l’Impassibilité et Lutter, Ô Dictateurs, pour
l’Avènement de la Société des Outsiders. COTTÉ, Jean-Yves (trad.). Toulouse : Gwen Català Éditeur. Il
s’agit du texte original avec traduction française en regard.
12. Ndlt : « generally a disparaging term used to describe someone else’s political views which
one regards as unsound » (Audi 1999 : 416) pour la définition en version originale proposée par le
Cambridge Dictionary of Philosophy.
13. Bien que l’ouvrage d’Evan Personal Politics (1979) offre un récit extrêmement biaisé des
origines du féminisme de la deuxième vague qui valorise les expériences d’un petit groupe de
féministes blanches impliquées dans le SNCC et dans la Students for a Democratic Society, il est
souvent présenté par des personnes n’étant pas historien·ne·s comme un « exposé exhaustif. » Les
historiennes féministes, dont Evans fait partie, ont critiqué le biais racial et l’étroitesse
idéologique de ce récit. Dans Born for Liberty (1989), Evans propose une histoire du féminisme bien
plus complexe et pluriculturelle.
GLAD!, 04 | 2018
59
14. Balsdon (1963 : 240) remarque que lorsque des accusations étaient formulées à l’encontre des
Vestales, les Pontifes se fiaient généralement aux témoignages des esclaves. Aux yeux de la loi
romaine, les preuves présentées par les esclaves contre leur maitre n’étaient acceptées qu’en cas
« d’inceste » (impureté) et de haute trahison.
15. Selon l’UNIFEM (2002), les femmes comptent pour presque 70% des 1.3 milliards de pauvres
dans le monde. Les 564 millions de femmes rurales vivant dans la pauvreté en 1990 révélaient une
augmentation de 47% du nombre de femmes pauvres en 1970. Le quintile le plus pauvre de la
population mondiale (1 milliard de personnes) gagne seulement 1,4% de la richesse mondiale.
Autrement dit, les travailleuses les plus pauvres dans les pays du Sud gagnent moins de $1 par
jour.
16. Ndlt : trad. de Davreu, Robert. Op. cit..
17. Ndlt : pour la traduction française tirée de : Aristote. 2009. Politiques. Livre I. Pellegrin, Pierre
(trad.). Paris : Nathan. Pour la traduction anglaise utilisée par l’auteure, voir bibliographie.
18. D’après Aristote : « si bien que c’est par nature qu’il y a, la plupart du temps, un commandant
et un commandé. L’homme libre, en effet, commande à l’esclave d’une manière différente de celle
dont le mari commande à sa femme et l’adulte à l’enfant. […] l’esclave est totalement dépourvu
de la faculté de délibérer, la femme la possède mais sans autorité, l’enfant la possède mais non
encore développée. » (2009 : 54). [Ndlt : trad. de Pellegrin, Pierre. Op. Cit.]
19. Ce passage est parfois traduit [Ndlt : dans les versions anglaises] : « I will not yield to a woman
[Je ne cèderai devant aucune femme] » ou « I will not be bested by a woman [Je ne serai vaincu
par aucune femme]. »
20. Dans Speculum. De l’autre femme, Luce Irigaray (1974) joue avec les quasi-homonymes français,
antre et ventre, dans sa lecture critique de l’allégorie de la caverne de Platon. Pour Irigaray,
l’antre est un espace où l’homme s’approprie les symboles du féminin-maternel et les incorpore
dans un désir de symétrie. Par le biais de comparaisons, d’analogies et de métaphores qui
prétendent la rendre présente, les hommes occultent la femme. En transformant la différence en
similitude, les hommes reconnaissent la présence de la femme sous le signe du même.
Puisqu’Antigone est enterrée dans un antre, on pourrait extrapoler une interprétation
Irigarayienne de cette façon punitive de genrer. La tombe pourrait être l’espace dans lequel les
féministes sont réduites à n’être que l’image des hommes, leurs projets muselés pour refléter les
désirs et les intérêts masculins. Homi Bhaba propose une autre ligne d’interprétation. Dans « The
Other Question », Bhaba souligne que l’obscurité équivaut à la féminité et la féminité à
l’obscurité : « L’obscurité représente à la fois la naissance et la mort ; il s’agit dans tous les cas
d’un désir de revenir à la mère, le besoin d’une origine et d’une projection linéaire ininterrompue
et indifférenciée » (1986 : 170). Selon ce cadre interprétatif, consigner le féminisme à l’obscurité
de la tombe serait une stratégie pour transformer des femmes autonomes en un fantasme
masculin du maternel bienveillant.
21. Sophocle 2011, 35. [Ndlt : trad. de Davreu, Robert. Op. cit.] Le décret de mort de Créon est
conçu pour garantir que l’assentiment passif auquel s’oppose Antigone de son vivant structurera
sa relation à la mort. Cependant, Antigone rejette un tel assentiment. Dans la mort comme dans
la vie, elle choisit l’action. Plutôt que d’attendre passivement la suffocation, elle fait un nœud
coulant avec son voile virginal et se pend. Ainsi, Sophocle met en lumière la liberté très limitée
dont disposent les femmes dans la tragédie grecque. Comme le remarque Loraux, [évoquant] « le
cadre étroit de l’autonomie que la tragédie consent aux femmes. Toujours assez libres pour se
tuer, elles ne le sont pas d’échapper à leur enracinement spatial » (1985 : 51). [Ndlt : version
originale française : Loraux, Nicolas. Op. cit.]
22. Ndlt : trad. de Davreu, Robert. Op. cit.
GLAD!, 04 | 2018
60
RÉSUMÉS
Cet essai examine l’étrange concomitance entre l’essor sans précédent d’un féminisme global au
cours des quatre dernières décennies et les proclamations récurrentes de la mort du féminisme.
Considérant les écrits traitant de la mort du féminisme comme des modes d’appréhension
particulièrement propices à l’analyse sémiotique, cet article explore les mécanismes rhétoriques
en jeu dans la production de la mort du féminisme et les façons dont différentes représentations
de la dépouille du féminisme sont associées à des propositions spécifiques quant à la nature du
féminisme. En replaçant l’enterrement prématuré d’un féminisme global et prospère dans le
contexte historique genré de pratiques de l’enterrement d’individu·e·s vivant·e·s, cet article
propose d’interpréter les annonces récurrentes de la mort du féminisme comme une forme de
préjudice, une tentative pour discréditer et éliminer les luttes féministes pour la justice sociale
tout en effaçant les traces de cette élimination.
This essay investigates the strange coincidence of the unprecedented growth of global feminism
over the past four decades with recurrent proclamations of feminism’s death. Treating the texts
of feminism’s death as forms of meaning-making ripe for semiotic analysis, the paper explores
the rhetorical mechanisms by which feminism’s death is produced and the means by which
alternative representations of the corpse of feminism are linked to particular assumptions about
the nature of feminism. Situating the premature burial of a thriving global feminism in the
context of a gendered history of live burial practices, the paper suggests that recurrent
pronouncements of the death of feminism should be interpreted as a form of damage, an effort to
undermine and erase feminist struggles for social justice while covering the traces of the erasure.
INDEX
Thèmes : Recherches
Mots-clés : féminisme, postféminisme, sémiotique, enterrement, mouvements sociaux
Keywords : feminism, postfeminism, semiotics, burial, social movements
AUTEURS
MARY HAWKESWORTH
Mary Hawkesworth est professeure émérite en sciences politiques et en études de genre à la
Rutgers University. Ses thématiques de recherche et les objets de ses enseignements incluent la
théorie féministe, les femmes et la politique, le genre et la mondialisation, la philosophie
politique contemporaine, la philosophie des sciences, et les politiques sociales. Parmi ses
principaux écrits, l’on retrouve : Embodied Power : Demystifying Disembodied Politics (Routledge
2016), The Oxford Handbook of Feminist Theory (Oxford University Press 2016), Gender and Power :
Towards Equality and Democratic Governance (Palgrave Macmillan 2015), Political Worlds of Women :
Activism, Advocacy, and Governance in the 21st Century (Perseus 2012), War & Terror : Feminist
Perspectives (University of Chicago Press 2008), Globalization and Feminist Activism (Rowman and
Littlefield 2006), Feminist Inquiry : From Political Conviction to Methodological Innovation (Rutgers
University Press 2006), The Encyclopedia of Government and Politics (Routledge 1992 ; 2de Édition
2004), Beyond Oppression : Feminist Theory and Political Strategy (Continuum Press 1990), and
Theoretical Issues in Policy Analysis (SUNY Press 1988).
GLAD!, 04 | 2018
61
Modalités de diffusion etrhétoriques des discours misogyneset misogames imprimés à laRenaissanceMisogynistic and Misogamistic Discourses in Printed Texts during the
Renaissance: Modes of Circulation and Rhetoric
Tatiana Clavier
1 L’aube des temps modernes est riche d’enseignements pour qui étudie les discours
opposant les ennemis des femmes à leurs défenseurs au regard des mutations sociales
et politiques de la période. L’état des lieux des premiers textes imprimés sur la question
indique en effet que celle-ci est fondatrice en matière de définition des rôles sexués et
de moyens mis en œuvre pour inciter les élites à l’adoption des normes produites.
Grâce à l’imprimerie, les dernières décennies du XVe siècle et le siècle suivant ont été le
théâtre d’une production intense de textes visant à « vitupérer » ou à défendre les
femmes, qu’il s’agisse de vieux textes compulsivement édités et réédités, traduits et
retraduits, ou de textes nouvellement produits. Les imprimeurs ont alimenté la
controverse des sexes en publiant toutes les positions présentes. Ils ont fait de quelques
œuvres de véritables best-sellers, en ont voué d’autres à l’oubli, et ont réorienté la
lecture de certaines dans les imprimés qui les livraient au public.
2 Les nombreux textes des adversaires de l’égalité des sexes publiés à la Renaissance
témoignent du durcissement de l’ordre de genre qui s’est progressivement imposé au
détriment des femmes à la fin du Moyen Âge, mais aussi des vives réactions qu’il a
suscitées. Pour comprendre cet apparent paradoxe, il sera d’abord utile de revenir sur
le contexte de production des discours misogynes et misogames, avant d’aborder leurs
modalités de diffusion par les premières presses. Quelques analyses des stratégies
rhétoriques mises en œuvre dans les textes les plus diffusés montreront enfin comment
l’argumentaire féministe1 a pu s’introduire dans des œuvres les moins pensées pour lui
faire de la place, et quelles sont les implications de ces ambiguïtés textuelles.
GLAD!, 04 | 2018
62
Origines et explosion de la Querelle des femmes2 (XIIIe-XVIe siècles)
Montée en puissance de la clergie et dégradation de la situation des
femmes
3 Les études les plus récentes sur les femmes au Moyen Âge ont montré qu’après une
période de relative mixité du pouvoir et du corps social dans son ensemble, leur
situation s’était progressivement dégradée à partir du XIIIe siècle, parallèlement à la
progression de l’idéal de la séparation des sphères dans les milieux lettrés (Lett 2013).
On sait aujourd’hui que la clergie, groupe social identifié dans la société française dès la
fin du XIIe siècle, a joué un rôle central dans cette transformation (Viennot 2006 :
206-294). Ces « hommes nouveaux » sortis des universités, venus de toutes les classes
sociales excepté la grande noblesse, ont rapidement investi la haute administration, la
justice, l’entourage des rois et l’enseignement supérieur. Tous domaines d’où ils ont
piloté la création des nouvelles instances de gestion et de centralisation de l’État.
Soudés par leurs années de formation, par leurs activités professionnelles et les intérêts
qu’ils défendaient, ces clercs l’étaient aussi par la misogynie apprise dans les textes
dont ils avaient été nourris (les Pères de l’Église, Aristote), qu’ils avaient pratiquée dans
leurs longues années de célibat, et qui justifiait leur monopole dans l’accès aux
diplômes et aux professions prestigieuses.
4 D’où la floraison, dès le XIIIe siècle, de discours misogynes virulents, non plus seulement
destinés aux moines ou aux prêtres qu’il fallait convaincre de rester célibataires, mais à
l’adresse des clercs laïcs de plus en plus nombreux et surtout, à partir du milieu du XIVe
siècle, de plus en plus tentés par le mariage, afin de dénigrer le respect des femmes, qui
fondait souvent les stratégies matrimoniales et la vie de couple, mais aussi de participer
à la lutte contre la bigamie des clercs3. Il s’agissait aussi de miner l’influence de la
culture des nobles, cette « courtoisie » affichant haut et fort le respect dû aux grandes
dames4. Le moralisme anti-matrimonial qui s’exprime dans la littérature de la fin du
siècle illustre ainsi « l’avènement d’un nouvel ordre de valeurs » (Payen 1977 : 426). Les
railleries innombrables qu’on y lit révèlent la dimension politique et militante de cette
littérature dont le Roman de la Rose de Jean de Meun est l’exemple le plus célèbre.
5 Du milieu du XIVe siècle au milieu du siècle suivant, le développement des villes et de
l’État rend possible des carrières entièrement laïques pour les diplômés des universités
qui progressent de façon spectaculaire dans leur course aux postes de pouvoir et
accèdent au mariage. Les places stratégiques qu’ils investissent — le Parlement, la
haute fonction publique, les tribunaux, les universités… — leur donnent les moyens de
piloter le recul des droits des femmes dans différents domaines où le droit est
opérationnel (famille, marché du travail…). La période est celle de l’explosion de la
prostitution féminine (Rossiaud 1986), des débuts de la chasse aux « sorcières » (Le Bras
Chopard 2006), tandis que les théologiens reprennent en main le monde monastique
féminin (Dalarun 2008) et que la loi salique est inventée pour justifier l’arrivée des
Valois sur le trône de France (Viennot 2006 : 347-390). La situation des femmes se
dégrade donc considérablement pendant cette période et l’idéal de séparation des
sphères commence à s’imposer, ce qui est repéré et dénoncé…
GLAD!, 04 | 2018
63
Premières manifestations de la Querelle des femmes
6 La dégradation de la situation des femmes et les discours qui l’accompagnent
provoquent des phénomènes de résistance et des contestations dans le milieu de
l’aristocratie, où certaines femmes commencent à se plaindre (comme en témoigne
l’ouverture du Livre de Leesce de Jean Le Fèvre de Ressons) et à mettre sur pied des
stratégies de riposte, notamment en commandant des textes propres à mettre en valeur
les capacités féminines déniées (comme en témoigne le De claris mulieribus de Boccace,
produit à la demande d’une proche de Jeanne Ire de Naples).
7 Une partie de l’œuvre de Christine de Pizan est liée à ce contexte. L’écrivaine déclenche
d’abord la querelle du Roman de la Rose (1401-1402) en s’attaquant à la misogynie
exprimée par Jean de Meun dans le livre qui jouit alors de la plus grande autorité,
comme Christine le rappellera elle-même un peu plus tard, dans La Cité des dames
(1404). Dès cette controverse, elle démontre sa compétence de lettrée en forçant le
dialogue avec les clercs et en publiant leurs échanges. Puis, reprenant l’ensemble du
dossier, elle analyse les raisons de la misogynie de certains hommes et fait l’éloge des
femmes célèbres, dont plusieurs de ses contemporaines. Outre la reine Isabeau, qu’elle
prend à témoin dans cette joute pour l’honneur des femmes en lui offrant un manuscrit
des lettres du débat (Valentini 2014), outre les femmes de la cour et la haute noblesse
pour laquelle Christine travaillait, les femmes de l’aristocratie princière allaient
longtemps se transmettre ses analyses, puisque la plupart des dirigeantes de la
Renaissance possédaient des manuscrits de La Cité des dames (Beaune et Lequain 2000 :
125 et 134 ; L’Estrange 2007 : 173).
8 La deuxième querelle socio-littéraire de l’époque est déclenchée par La Belle Dame sans
mercy d’Alain Chartier en 1424. Le poète dit retranscrire un dialogue entre une femme
et un homme, le deuxième faisant une cour stéréotypée et insistante à la première, qui
reste inflexible et déconstruit froidement l’argumentaire de celui qui estime qu’elle lui
doit récompense. Devant le danger que représente cette voix féminine critique et
autonome, plusieurs auteurs traînent l’héroïne de Chartier devant des cours d’amour
de plus en plus éloignées du modèle noble et de plus en plus proches des cours de
justice familières à la clergie (Hult 2006). Les textes de cette querelle révèlent, comme
ceux du débat sur le Roman de la Rose, la violence de la « guerre des sexes » qui
caractérise cette période.
9 D’autres réactions très vives à l’idéologie des clercs sont observées dès le milieu du
XVe siècle dans les grands centres de pouvoir féminin où une littérature consacrée à la
défense des femmes commence à se développer. La cour de Bourgogne, notamment,
devient l’un des grands foyers de la Querelle des femmes. Vers 1440-1442, Martin Le
Franc fait l’éloge de la duchesse Isabelle de Portugal dans sa dédicace du Champion des
Dames au duc Philippe le Bon. Fernand de Lucène traduit pour elle Le Triumphe des dames
(v. 1459-60) de Juan Rodriguez de La Camara (av. 1445). Les écrivains et artistes attachés
aux cours prestigieuses de plusieurs princesses multiplient les représentations de leur
pouvoir et les ripostes aux attaques auxquelles elles continuent à faire face.
GLAD!, 04 | 2018
64
La radicalisation des positions
10 La puissance maritale ne cesse de se renforcer et l’incapacité juridique des femmes
mariées s’aggrave de manière sensible au XVIe siècle (Gaudemet 1987). Les juristes
s’inspirent du droit romain et font du pater familias le souverain absolu dans sa famille à
l’instar du roi dans son royaume. Le « complexe État-famille » (Hanley 1995) dit bien
l’interpénétration de l’espace politique et de l’espace familial dans cette progression de
l’ordre monarchique qui consolide en même temps l’ordre masculin. Contre les pères
du Concile de Trente, pour qui le libre consentement est le fondement du mariage, les
élites masculines laïques cherchent à protéger leurs patrimoines et leurs lignages pour
asseoir leur pouvoir au cœur de l’État (Châtelain 2008). Sous leur influence, les édits
royaux se multiplient. Celui de 1556 interdit, sous peine d’exhérédation, les mariages
clandestins contractés sans l’autorisation des parents. En 1579, l’ordonnance de Blois
les assimile au rapt de séduction, puni de mort ou du bannissement, et étend
l’interdiction aux veuves de moins de 25 ans. Les affaires matrimoniales sont reprises
par des tribunaux civils beaucoup moins compréhensifs que les tribunaux
ecclésiastiques à l’égard des femmes et des enfants.
11 Dans le même temps, les autorités laïques et religieuses intensifient leur répression de
la sorcellerie, considérée comme dangereuse pour les fondements de la société qu’elles
cherchent à mettre en place. Entre 1480 et 1700, plus de femmes sont exécutées pour
sorcellerie que pour tout autre crime (King 1991 : 146), et le pic de la « chasse aux
sorcières » se situe vers 1560 (Wiesner 1993 : 220). C’est une des plus profondes
différences de genre de la période. Le Malleus maleficarum (Marteau des sorcières) de
Kramer et Sprenger, publié 24 fois entre 1486 et 1598, accuse les femmes d’être
charnelles, crédules, curieuses, méchantes, imparfaites… Les arguments des
inquisiteurs rejoignent ainsi les thèses aristotéliciennes défendues par les clercs, dont
le médecin Rondibilis se fait l’écho dans le Tiers Livre de Rabelais en 1546 5, et qui leur
servent de justification pour persécuter celles qui refusent de rentrer dans le rang.
12 Mais la codification des rapports femmes-hommes voit encore s’affronter la clergie et
la noblesse, chacun des deux camps cherchant d’autant plus à imposer ses idéaux en la
matière que « les pratiques de la différence des sexes sont au cœur de l’identité des
différents groupes sociaux » (Viennot 2003 : 155 ; Viennot 2013). Pour les clercs, la
mixité et le respect des femmes sont la marque de la perversion des nobles, qu’ils
accusent de manquer de virilité, et de se complaire aux loisirs comme à la lecture
d’ouvrages licencieux et irréalistes — référence à la littérature héroïco-sentimentale
alors très en vogue. Les aristocrates considèrent comme une marque de grandeur et
d’héroïsme la capacité des hommes à nouer des relations avec de grandes dames et
envisagent au contraire le mépris des femmes et la ségrégation des sexes comme la
marque des classes inférieures, notamment la clergie qui lui fait de plus en plus
d’ombre. On retrouve du reste cette opposition sociale dans les controverses mises en
scène à la Renaissance, comme le Blason des faulses amours rédigé par Guillaume Alexis
entre 1450 et 1486.
13 C’est donc le plus souvent avec l’assentiment de leur milieu que, dès la fin du XVe siècle,
les reines et les grandes dames imposent leur pouvoir à la cour de France. Plusieurs
gouvernent ou co-gouvernent d’ailleurs entre la mort de Louis XI (1483) et celle
d’Henri III (1589), comme sœurs de roi (Anne de France, Marguerite de Navarre,
Marguerite de France), comme mères (Catherine de Médicis, Louise de Savoie), comme
GLAD!, 04 | 2018
65
maîtresses (Anne de Pisseleu, Diane de Poitiers), et même comme « reines régnantes »
(Anne de Bretagne), attestant la volonté (et le besoin) des souverains de s’appuyer sur
les femmes de leur entourage. Et la « grand’cour des femmes » chantée par les
contemporains participe de la même politique. Souvent grandes mécènes, les plus
puissantes animent des cercles ou des cours, ont leurs écrivains attitrés, commandent
et se font offrir de nombreux ouvrages (Wilson-Chevalier 2007), dont plusieurs
défendent la légitimité des femmes à jouer un rôle dirigeant.
14 De nombreuses Vies de femmes célèbres sont dédiées aux grandes dames ou
commandées par elles, dont les stratégies narratives et/ou illustratives placent leurs
dédicataires au rang des illustres (Clavier, 2010). De même, plusieurs auteurs
s’inscrivant fermement dans la Querelle des femmes du côté de leurs défenseurs
dédicacent et offrent leurs textes aux grandes dirigeantes de la période. C’est le cas des
plus engagés comme Jean Marot et Agrippa de Nettesheim : le premier écrit La Vraye
disant advocate des dames pour Anne de Bretagne vers 1500, le deuxième la Declamatio de
nobilitate et preaecellentia fœminei sexus pour Marguerite d’Autriche vers 1509 – texte
dont François Habert dédiera l’adaptation rimée à Anne de Pisseleu en 1541. Ces textes
sont partie prenante de la « guerre des idées » menée par les dirigeantes pour affirmer
leur légitimité politique, dans un contexte où l’exercice du pouvoir féminin devient
paradoxal, quand il n’est pas ouvertement condamné dans les textes popularisant la loi
salique.
15 La légende mise au point pendant la première partie du XVe siècle devient en effet une
arme de guerre contre ces femmes, dès l’arrivée au pouvoir de la première, puisque le
premier livre imprimé à la faire connaître est La loi salique, première loi des Français,
publiée en 1488, au temps où Anne de France triomphe de la « guerre folle » (Viennot
2006 : 570-599). L’empêchement français est agité par tous les opposants aux régentes,
et il l’est encore en 1593 lorsque les États généraux doivent désigner un nouveau roi.
L’arrivée au pouvoir d’Henri IV semble l’entériner, marquant la fin de la période des
grandes dirigeantes, mais la contestation reprendra avec le règne de sa veuve.
16 Cette présence de nombreuses femmes aux avant-postes de la scène publique, l’entrée
en lice des plus influentes dans l’opposition à l’ordre masculin, le positionnement de
grands humanistes à leurs côtés, mais aussi le nombre croissant d’autrices (Marguerite
de Navarre, Hélisenne de Crenne, Pernette du Guillet, Louise Labé, les Dames Des
Roches, Marie de Romieu…) et d’éditrices (Jeanne de Marnef, Charlotte Guillard,
Antoinette Perronet…) favorisent le développement de la Querelle des femmes. Entre la
fin du XVe et celle du XVIe siècle, ces tensions ne font que se renforcer, chaque camp
cherchant à diffuser les argumentaires et les figures qui lui permettent de s’opposer à
l’autre. La période des premiers imprimés est donc aussi celle de l’explosion des
discours sur ce que devraient être les femmes et les hommes, dans la société rêvée par
les partisans de l’égalité entre les sexes et leurs adversaires.
Louanges et vitupération des femmes et du mariage :un filon éditorial6 ?
Présence des discours misogynes dans les premiers imprimés
17 Entrée dans les mœurs depuis la fin du XIVe siècle, l’habitude d’attaquer et de défendre
les femmes provoque, dès que l’imprimerie est disponible, la mise sur le marché de
GLAD!, 04 | 2018
66
nombreux textes relevant de cette veine. La féminisation de la vie politique semble
avoir assuré, durant plusieurs décennies, la domination du versant féministe de cette
production. Les ouvrages misogynes ne le cèdent pourtant en rien. Même s’ils peinent à
réunir de grands noms, au-delà de Boccace avec le Corbaccio — traduit par François de
Belleforest sous le titre Le Laberinthe d’amour de M. Jean Boccace, autrement Invective contre
une mauvaise femme7 (1571 et 1573) —, ils raillent lourdement la production philogyne et
diffusent à bas prix les lieux communs de la misogynie.
18 Constatons d’abord que les discours misogynes se trouvent paradoxalement dans les
textes de défense des femmes, qui prennent souvent la forme du débat et rappellent
ainsi les arguments de leurs adversaires pour mieux les réfuter. C’est le choix qu’avait
fait Martin Le Franc dans son Champion des dames, publié vers 1485 et reimprimé en
1530, en mesurant ledit Champion à d’autres personnages allégoriques, dont plusieurs
issus du Roman de la Rose. De nombreux textes suivent le modèle du Champion8. Le Roman
de la Rose connaît un grand succès d’imprimerie9 et génère en effet de très nombreuses
prises de position, signe que la querelle qu’il avait suscitée se démultiplie avec
l’imprimerie10.
19 Certains auteurs précisent dans leurs titres qu’ils adoptent la forme du débat11. D’autres
choisissent — sous une forme ou une autre — de présenter les arguments pour et contre
sans noter leur préférence dans leur titre. Tels se présentent Le Débat de l’omme et de la
femme de Guillaume Alexis (v. 1490, 7 éd. jusqu’en 1530) ; le célèbre De la bonté et
mauvaistié des femmes de Jean de Marconville (1563, 9 éd. jusqu’en 1586) ; et encore La
Guerre des masles contre les femelles : representant en trois dialogues les prerogatives & dignitez
tant de l’un que de l’autre sexe de Nicolas de Cholières (1588) 12. C’est encore le cas des
Controverses des sexes Masculin et Femenin de Gratien Du Pont, sieur de Drusac (1534).
Toutefois ce titre apparemment neutre cache une misogynie virulente, d’où les
critiques violentes qu’il suscite et auxquelles il répond aussitôt, avec une Requeste du
Sexe Masculin contre le Sexe Femenin. A cause de ceulx et de celles qui mesdisent de L’auteur du
Livre intitulé les Controverses des sexes Masculin et Femenin... Le succès du premier ouvrage,
qui connaît au moins neuf éditions jusqu’en 1541, entretient les polémiques, dont
témoigne encore l’Anti-Drusac de La Borie en 156413.
20 Les études réalisées sur cette littérature permettent aussi de repérer nombre de textes
qui affichent un titre proféminin par antiphrase14. Ainsi La Louenge des femmes (1551),
paraphrase des propos de Rondibilis dans le Tiers Livre de Rabelais, est signée du
pseudonyme « André Misogyne » et imputable à un collectif de poètes comprenant
Clément Marot, Mellin de Saint-Gelais et Olivier de Magny (Alonso, 2008). Le procédé du
titre antiphrastique montre aujourd’hui encore son efficacité. Ce texte est en effet
confondu dans (au moins) trois notices du catalogue de la BNF avec La Louange des
dames, imprimé vers 1482 et retitré La Louenge et beaute des dames dans les dernières des
huit éditions répertoriées, texte qu’elles attribuent à l’auteur comique parisien Jean de
l’Espine du Pont-Alais15. Or il s’agit d’un extrait du texte proféminin rédigé vers 1470
par un auteur surnommé « le Dolent Fortuné », qui ne sera imprimé que vers 151616.
21 Tout un pan de cette littérature prend aussi la forme d’échanges entre habitantes de
plusieurs grandes villes, ou de critiques des unes par les autres, occasion de dérouler les
lieux communs de la satire misogyne. Les entrées de Louis XII dans plusieurs villes au
début de son règne donnent ainsi naissance à de petites œuvres publiées ou republiées
vers 1512 par des auteurs qui ventriloquent la parole des femmes17. Certaines de ces
plaquettes connaissent plusieurs rééditions jusque dans les années 1550 – d’où peut-
GLAD!, 04 | 2018
67
être la déclinaison hyperbolique donnée par un auteur anonyme18. Le procédé des
propos féminins fictivement transcrits par un homme se retrouve encore dans Les
Évangiles des quenouilles où un clerc se présente comme le secrétaire d’une assemblée de
fileuses (entre 1479 et 1484, au moins 11 éd. jusqu’en 1530)19.
Contre le mariage, instrument du malheur des hommes
22 Si les partisans du mariage sont particulièrement actifs dès la fin du XVe siècle, la
tradition misogame — et misogyne — se maintient néanmoins, quoique nettement
moins bien représentée car essentiellement portée par des auteurs décédés depuis des
lustres, ou des hommes qui n’inscrivent pas leur nom sur les plaquettes diffusant leurs
idées, ou encore qui se contentent de faire rire avec les déboires des mariés.
23 Le succès des Lamentations de Mathéolus (rédigé en latin à la fin du XIIIe siècle), montre à
lui seul que le camp des misogames est toujours bien représenté : le texte paraît neuf
fois entre vers 1497-98 et le milieu du XVIe siècle. Malgré sa célébrité depuis sa
traduction à la fin du XIVe siècle, les éditeurs ont cru nécessaire de lui donner un titre
mentionnant explicitement dans la plupart des imprimés la matière traitée et le propos
de l’ouvrage :
Le livre de Mathéolus/Qui nous monstre sans varier/ Les biens et aussi lesvertus/ Qui viennent pour soy marier/ Et a tous faitz considerer/ Il dit quelomme nest pas saige/ Sy se tourne remarier/ Quant prins a este au passaige.
24 Il est ensuite diffusé sous forme d’abrégés titrés La (Grand) Malice des femmes dont on
trouve au moins cinq éditions au cours du siècle, mais qui sont données sans nom
d’auteur.
25 Beaucoup d’autres sont des textes anonymes diffusés dans des plaquettes de huit
feuillets non datées qui donnent la parole à des hommes se plaignant du mariage, à
l’image de La Complainte du nouveau marié (v. 1488)20. Certaines sont republiées plusieurs
fois. Une plaquette plus tardive, les Ténèbres de mariage (entre 1512 et 1519) atteint sans
doute les huit éditions au cours du XVIe siècle. Une autre, datant de la seconde moitié du
siècle, avertit encore les lecteurs des dangers du mariage21.
26 À cette veine semble se rattacher la « mise au point » que constitue L’Enfer des mauvaises
femmes, publié dans deux éditions du XVIe siècle avec le texte qui l’a inspiré, le Purgatoire
des mauvais marys à la louenge des honnestes dames & damoiselles (entre 1479 et 1484). Dans
le prologue de cette œuvre vraisemblablement issue de la cour de Bourgogne dans les
années 1460, l’auteur conspuait les misogynes, le Roman de la Rose et le Livre de
Mathéolus, avant d’être guidé par Dame Raison dans le « purgatoire des mauvais maris
et de leurs complices » dont il décrivait les tourments. Sa réponse en reprend la
structure et renchérit sur son titre, tandis qu’un nouveau prologue met en scène le
nouvel auteur, guidé cette fois par dame Vengeance, vers un lieu où les femmes
purgent pour leur part des peines éternelles.
27 Un autre bel accueil est fait aux Quinzes joies du mariage. Ce texte au titre antiphrastique
rédigé vers 1400 est conservé dans six incunables, trois éditions du début du XVIe siècle
(avant 1521), et une édition de 1596 qui prouve que ces moqueries continuaient à
trouver des lecteurs à la fin du siècle (Arnould 2009). Le procédé de l’antiphrase est
également choisi par Jean d’Ivry (dont le nom ne se déchiffre que dans des acrostiches à
GLAD!, 04 | 2018
68
l’intérieur du livre) dans Les secretz et loix de mariage composez par le secretaire des dames
(v. 1500).
28 Le recours à des paroles de femmes pour les caricaturer et démontrer ainsi la nocivité
du mariage s’affiche enfin dans nombre d’autres textes, comme dans les deux petites
œuvres qui, suite à l’ordonnance de 1556 sur la fréquentation des tavernes,
caricaturent la volonté des femmes de renverser les rapports de pouvoir entre les
sexes22.
Rhétoriques ou failles des discours misogynes ?
L’impératif de la défense des femmes et la dénégation de la
misogynie
29 Aussi grandes que soient les certitudes des auteurs qui défendent la suprématie
masculine comme une nécessité, leurs discours sont loin d’être univoques.
L’argumentaire philogyne et féministe martelé depuis la fin du XIVe siècle s’invite
jusque dans les textes des plus ardents partisans de l’ordre du genre — qu’il s’agisse
d’un traducteur désignant l’auteur qu’il traduit comme allant trop loin, ou d’un auteur
déniant les implications idéologiques de son texte.
La trahison du traducteur : le cas Jean Le Fèvre versus Mathéolus
30 Le fameux Liber de infortunio suo, rédigé en latin entre 1295 et 1301 par Mathieu (ou
Mahieu), originaire de Boulogne-sur-Mer, a connu le succès éditorial à travers sa
traduction en rimes françaises par Jean Le Fèvre de Ressons entre 1371 et 1380. Il s’agit
d’une longue plainte d’un clerc « bigame », exclu des ordres car marié avec une veuve23.
Sur quatre livres, il s’étend sur les tourments qu’il a connus en mariage et dit écrire
pour éviter aux autres de faire la même erreur que lui. À cet effet, il déverse son
ressentiment, faisant des Lamentations de Mathéolus le prototype même du florilège de
lieux communs sur la mauvaiseté du sexe féminin.
31 D’entrée de jeu, l’œuvre s’adresse aux hommes, ou plus exactement aux célibataires,
qu’il s’agit de convaincre de ne pas se marier. C’est à leur intention que le traducteur,
qui prend la parole en premier, apporte sa caution au texte qu’ils vont lire. Et c’est à
eux que s’adressent à sa suite les avertissements de l’auteur sur les malheurs qui
proviennent de cet état, et les conseils pour bien vivre hors de lui :
Fay publier par toute FranceQue nul, s’il n’a ou corps la rage,Plus ne se mette en mariage.Et mesmement [surtout] en bigamie !Mieulx vaut que chascun ait s’amie Qu’il se mariast pour plourer. (I, v. 100-10524)
32 Dans les premières pages toujours, Mathieu le Bigame continue d’interpeler cet
auditoire particulier : « Venés, vous, jouvenceaus, venés/ Et de marier vous tenés ! »
(v. 231-232). Ce public n’est jamais perdu de vue et la solidarité masculine est
revendiquée :
GLAD!, 04 | 2018
69
Freres tous d’une confrerieEt membres de Jhesucrist sommes.Si est raison entre nous, hommes,Que l’un doit l’autre conseillerEt pour son profit traveiller. (I, v. 798-802)
33 Pourtant le traducteur se dissocie clairement du Bigame. Bien qu’il ait déclaré dans son
préambule que les Lamentations lui ont plu, parce qu’il est lui aussi malheureux en
mariage, il insère dans sa traduction des excuses relatives au contenu du texte,
affirmant par exemple qu’il n’a pas l’intention de médire des femmes :
Excuser me vueil en mes disQue des bonnes point ne mesdisNe n’ay voulenté de mesdire.J’ameroye mieulx moy desdireQu’estre haï pour fol langage (II, v. 1541-5)
34 Jean Le Fèvre de Ressons revient plus loin sur les médisances du Bigame. On peut le
contester, dit-il, « Quar, s’aucunes femmes sont males,/ Et perverses et ennormales,/
Ne s’en suit pas pour ce, que toutes/ Soient si crueuses et gloutes [cruelles et
dévergondées],/ Ne que toutes soyent comprises/ Generalment en leurs reprises
[critiques]./ L’oroison est trop mal sartie [le discours est très mal composé],/ Quant on
conclut tout pour partie » (II, v. 2593-2600). Pourtant, il concède que l’œuvre qu’il
traduit le pousse à blâmer toutes les femmes : « Ceste euvre presente,/ Qui douleur en
mon cuer presente,/ Ne veult souffrir que rien exclue [ne me permet de rien exclure],/
Mais commande que je conclue/ Tout oultre [sans restriction], jusques a la borne/Qu’il
ne soit nulle femme bonne » (II, v. 2604-2609).
35 On comprend mieux que Jean Le Fèvre ait entrepris de renier cette œuvre en écrivant
son contraire, le Livre de Leesce entre 1380 et 1387, où il retournera tous les arguments
du Bigame, non sans expliquer les raisons de sa misogynie : son impuissance. Le texte
connut six éditions au XVIe siècle. D’abord intitulé Le Resolu en mariage dans les deux
éditions qu’on suppose être les premières (v. 1505), il est par la suite doté d’un titre
sans doute plus vendeur, Le Rebours de Mathéolus, qui indique le succès du nom sinon de
l’œuvre du clerc misogyne. Les ripostes dont les textes violemment misogames sont
l’objet semblent donc témoigner, comme celle-ci, de la mobilisation des féministes sur
ce terrain et sans doute de la conscience des éditeurs qu’il y a là un filon porteur.
Les dénégations de Drusac dans Les Controverses des sexes Masculin et Femenin
36 L’existence d’un fort courant de contestation de l’ordre du genre dans la société du
XVe siècle et du suivant se manifeste aussi par l’attitude défensive d’auteurs soutenant
cet ordre, comme le lieutenant général de la maréchaussée à Toulouse : Gratien Du
Pont, sieur de Drusac, qui s’applique à rendre son œuvre irréfutable. Les Controverses des
sexes Masculin et Femenin sont publiées au moins neuf fois entre 1534 et 1541. Cette
somme misogyne en trois livres presque exclusivement rédigés en vers est insérée dans
un cadre allégorique qui met en scène Sexe Masculin demandant à l’auteur de prendre
sa défense. L’hybridité du texte tient au mélange d’une solide argumentation de type
juridique, s’appuyant sur de multiples autorités, avec d’autres traditions littéraires,
comme les Vies de femmes illustres (ici décriées pour leurs vices), la poésie d’invective
et la poésie satirique médiévale.
GLAD!, 04 | 2018
70
37 Dans sa dédicace à Pierre Du Faur, Drusac cible son lectorat en indiquant que son œuvre
peut « se presenter aux yeulx des hommes vertueulx » (1er cahier non chiffré, 425), et les
pièces liminaires confirment l’entre-soi masculin de la magistrature toulousaine.
Plusieurs fois il affirmera qu’il défend le sexe masculin « Comme ung martire,
soubstenant verité » (E4v°) et s’inclura dans le groupe auquel il s’adresse, non sans
rappeler la position « naturelle » des hommes vis-à-vis de l’autre sexe : « Chef,
desdictes femmes sommes » (F2r°). Pourtant, dans l’« Epistre aulx Lecteurs » où il dit
être conscient de la teneur misogyne de son œuvre, il déclare que ce n’est pas pour lui
affaire de convictions profondes ni signe d’un engagement personnel dans la Querelle,
seulement un prétexte à exercice rhétorique :
Plus pour la Rythme, ce livre commencéJ’ay, et de sorte, (que voyez) advancéQue pour le sens, ny des femmes mesdire. (3ème cahier non chiffré, 5 v°)
38 Au seuil de l’ouvrage, les vingt-quatre vers intitulés dans la table « La declaration
dudict tiltre, et la Cause pourquoy l’Autheur a composé ce livre, et en quel temps » le
présentent également comme un modèle de composition poétique, et Drusac répète
plus loin qu’il « servira par une maniere de rethoricque aulx apprantis de tel art »
(H3 v°).
39 Mieux : dans l’« Epistre aulx dames » qui suit celle « aulx Lecteurs », il se présente
comme le serviteur de « toutes honnestes femmes, de quelque estat et condition
qu’elles soyent ». Ce sont évidemment les autres qu’il critique, et cela ne peut que leur
être favorable : « En mesdisant de telle deshonnestes/ C’est hault louer, à vous qui estes
honnestes » (3ème cahier non chiffré, 7 v°). Il promet même de dire un jour le contraire
de ce qu’il écrit dans ses Controverses — c’est dire s’il ne tient pas au fond du propos,
quel qu’il soit :
Car vous promectz, qu’avant qu’il soyt long tempsS’il plaist à Dieu, absouldre je pretendzMon argument, en telle mode, et sorteQue vrayement, ains que du propoz sorteDe mes escriptz, ne serez mal contentes
40 Loin de s’offusquer, les dames doivent donc admettre qu’« Ung serviteur, meilleur que
moy n’avez » (3ème cahier non chiffré, 8).
41 Drusac reprend à quelques reprises dans son texte la distinction entre les « folles » et
les « mauvaises », qui voisine avec des affirmations les mettant toutes dans le même
sac. Ainsi voit-on écrit sur un feuillet « Aulcunne femme, n’est bonne par nature »
(P4 v°), et sur le suivant : « Et par ainsy, (quant à moy) il me semble/ Qu’il n’est
honneste, de frequenter ensemble/ Les bonnes femmes, ny les filles honnestes / Avec
ces folles, perdues deshonnestes ». Conscient de la charge de son livre, il nie encore ses
intentions misogynes : il ne parle « Que des meschantes, malheureuses infames »
(Q6 v°). L’absence quasi complète de propos sur les « bonnes » dans le livre pourrait
donc — c’est ce qu’il défend — ne refléter que leur rareté. Cependant, en fin de course,
il veut encore montrer que l’exercice de la rime l’intéresse plus que le fond, dans trois
ballades à double sens à l’interprétation réversible, selon qu’on lit le texte
verticalement ou horizontalement :
GLAD!, 04 | 2018
71
Femmes aymerC’est tresbien faictPour les blasmerL’on est infaictDe dict et faictC’est ung gros bienPoinct ne meffaictCyl qu’en dit bien
Jamays ne m’adviendraDe mesdire de femmeTout loz en parviendraLouer leur bruyct et fameLa chose est fort infameNe leur faire serviceQui les blasme et diffameIl est remply de vice (Q7 v°)
42 « Par ainsy, glose-t-il, les honnestes femmes ne fault que blasment l’Autheur de la
composition de ce livre aulmoins quant au sens ». Réversiblement philogyne et
misogyne, son discours ainsi complètement verrouillé devient inattaquable.
43 On ne peut guère suivre les critiques qui adhèrent à l’éventualité réelle de la
« réversibilité du dispositif rhétorique » de Drusac (Marcy 2008 : 121), ni les travaux qui
envisagent plus largement les textes de la Querelle comme des « escarmouches
intellectuelles » au « caractère conventionnel et ludique » (Lazard, 2001 : 31)26. Ces
positions sont contestées depuis les travaux de Joan Kelly, qui soulignait déjà en 1982
les implications idéologiques et politiques de ce flot de discours en étroite relation avec
le contexte esquissé plus haut27. Drusac instruit exclusivement à charge le dossier de
l’incapacité et de l’infériorité des femmes, et cherche ici à fonder son discours en
rejetant toute protestation, conscient qu’il s’y expose. Ainsi, le déni de la vitupération
des femmes semble être une posture inévitable, comme si leur dénigrement ne pouvait
pas s’affirmer comme tel dans ce contexte de vives controverses, ni assurer le succès
d’un livre. Cela expliquerait l’insertion, dans les ouvrages misogynes les plus appréciés,
d’une captatio benevolentiae qui affirme à tout le moins que la vitupération ne cible que
les femmes vicieuses.
Mises en scène du conflit et traitements distanciés
44 D’autres auteurs relativisent les impératifs de la suprématie masculine et du
renforcement de l’ordre du genre en mettant à distance l’argumentaire masculiniste,
qu’ils réduisent le conflit des sexes à une dispute finalement plus drôle qu’autre chose,
ou qu’ils montrent qu’on peut dire tout et son contraire.
Une matière à rire : le cas des Évangiles des quenouilles
45 Les Évangiles des quenouilles sont un texte comique à composante misogyne et obscène,
rédigé entre 1466 et 1474 selon l’éditrice du texte28 par un anonyme issu des milieux de
la cour de Bourgogne qui s’amuse à ventriloquer le discours féminin29. Pendant six
soirées consécutives, six femmes, tournées en ridicule par le narrateur qui dit
retranscrire leurs propos, évoquent les croyances et superstitions concernant
l’enfantement, les relations sexuelles, conjugales et familiales, la santé, la prospérité du
foyer. Chaque veillée est encadrée par un prologue et une transition. Les chapitres qui
les composent, conçus en diptyques texte/glose, réunissent environ 230 croyances
populaires sous forme d’aphorismes, de présages, de recettes, de prescriptions ou
d’interdits.
GLAD!, 04 | 2018
72
46 Le texte a connu un grand succès d’imprimerie : onze éditions en ont été relevées entre
1479 et les environs de 1530. Son titre, comme le complément d’information donné par
ses rallonges dans bien des imprimés (« faittes a l’onneur et exaucement des dames »),
indique d’emblée son ancrage dans la Querelle des femmes. Dans les premières pages, le
scripteur souligne à la fois « la grande noblesse des dames et les grans biens qui d’elles
procedent » (77) et les railleries dont elles font l’objet : il écrit « pour obvier a teles
injures et teles moqueries mettre a neant, et par contraire exauchier [honorer] les
dames » (77-78). La louange cède toutefois vite le pas à la satire. À la fin de ce prologue,
Ysengrine du Glay s’élève contre les « libelles diffamatoires et livres contagieux
poingnans l’onneur de nostre sexe » (80), mais assure le clerc qu’il sera remercié
physiquement « par aucunes d’elles des plus jones et a [s]on chois » (81). Cette satire ne
fait ensuite que s’approfondir, à travers la mise en scène des « doctoresses » et à chaque
reprise de parole par le clerc, qui dit son mépris pour elles. À la fin du texte, il les
regarde fixement pour qu’elles aient « honte de leur affaire qui certes estoit moult
desriglé comme d’une bataille faillie et vaincue » (116). Les derniers mots qu’il adresse à
son lectorat annulent entièrement la position proféminine adoptée dans le prologue : le
texte produit n’est que fadaises :
n’ayez regart a aucune chose qui dedens y soit escripte quant à aucun fruitou substance de verité, ne d’aucune bonne introduction. Mais prenez le toutestre dit et escript pour demonstrer la fragilité de celles qui ainsi se devisentquant ensemble se treuvent. (117)
47 Si l’auteur des Évangiles des quenouilles présente d’abord son texte comme celui d’un
champion des dames, c’est que la posture est déjà à la mode dans le grand monde où la
querelle de la Belle Dame sans mercy se poursuit. De fait, la mise en cause de la
domination masculine par les fileuses est particulièrement forte. Les cinq premiers
chapitres énoncent et revendiquent les droits des femmes dans leur ménage, face à des
maris dépensiers, brutaux, cachottiers, infidèles et qui n’écoutent pas les conseils de
leurs épouses — comportements présentés comme des abus de pouvoir. L’attribution
aux hommes de qualités qui leur reviendraient par nature est également mise à mal.
Une assistante dénonce par exemple la couardise de son mari qui, chevauchant de nuit,
« ne sceut onques tirer son espee » (99) mais prit la fuite devant un épouvantail.
Perrine Bleu Levre se moque du sien, « si doulz qu’on le eust lyé au droit neu » (107),
référence au « nouement d’aiguillette », maléfice alors fort connu qui provoque
l’impuissance.
48 Enfin, l’insistance sur la transmission du savoir entre femmes, la reconnaissance
qu’elles se vouent les unes les autres pour ces enseignements ont beau être tournées en
ridicule par le contenu desdits savoirs, elles mettent en évidence l’injustice dont
souffrent les femmes dans ce domaine. Leur savoir pourrait servir à d’autres et, s’il était
révélé, mettre leur sexe en valeur. C’est le sens de leur appel à l’aide d’un clerc. Le
banquet présidé par Sibylle des Mares est l’occasion de célébrer les « bonnes et sages
doctoresses qui jusques icy nous ont instruit et ammonesté la noble doctrine » et
d’émettre l’espoir que « cy après sans aucune doubte serons ameez, priseez et
honnoureez et par aventure parvendrons a avoir domination par dessus les hommes »
(105). Si le rédacteur du texte fait ainsi dire aux femmes ce dont ses semblables les
accusent, accréditant par là même l’accusation, il signale implicitement que les femmes
connaissent — comme lui — les liens entre le savoir et la domination.
GLAD!, 04 | 2018
73
49 Il est indéniable que ces « facéties » relèvent de la satire antiféministe et que les enjeux
du pouvoir sont identifiés, mais le texte invite donc à la distance. La raillerie — envers
les fileuses comme envers le transcripteur lui-même — désamorce en permanence les
propos tenus, qu’ils soient grotesques ou sérieux. L’homme qui a accepté de coucher
sur le papier les discussions des femmes est aussi ridicule qu’elles. Les remarques
désobligeantes dont il ponctue son récit vont dans le même sens : les femmes sont
grotesques, bruyantes, futiles, mais il reste attablé à son pupitre. Le texte est en outre
truffé d’allusions qui détournent l’attention des lecteurs ou auditeurs, les empêchant
de voir le moindre sérieux dans l’ouvrage. La devisante type des Évangiles est une vieille
femme laide au goût prononcé pour la bonne chère, le vin ou l’amour. Ysengrine du
Glay, par exemple, est remariée avec un jeune et « cinq maris avoir eu sans les acointes
de coste [sans compter les amants] » (82). Abonde du Four « avoit estudié a paris par
l’espace de sept ans ou [au] colliege de Glatigny dont elle avoit rapporté mainte parfond
science » (95) : or la rue de Glatigny était un haut lieu de la prostitution dans l’île de la
Cité.
50 Que le rédacteur des Évangiles ne se moque pas que des femmes est certain. Il le fait
néanmoins, et avec d’autant plus d’ardeur que la charge lui permet aussi de se moquer
de certains hommes — notamment ceux qui frayent avec les femmes, le temps de
quelques soirées ou dans la vie courante. Masquée, la dénonciation est bien réelle, et
peut-être rendue possible par le biais de l’ironie et de l’humour, et dans la bouche de
femmes situées en dehors de la norme. Les Évangiles sont donc à replacer dans le
contexte de la montée en puissance du mariage, dont la critique s’avère ici d’autant
plus forte qu’il est vu « de l’intérieur ». En tout état de cause, le texte mine la puissance
maritale autant que les prétentions des femmes à l’égalité, en faisant rire de tout cela et
douter de l’urgence qu’il y avait à faire régner l’ordre du genre. Les imprimeurs qui ont
misé sur la valeur financière potentielle d’un tel ouvrage ne s’y sont pas trompés : cette
appropriation de voix féminines a séduit un vaste public.
Une affaire d’opinion : le cas Marconville
51 Tout en se plaçant sérieusement sur le terrain de la Querelle, nul ne pousse plus loin
que le gentilhomme percheron Jean de Marconville la mise à distance des deux
argumentaires. Dans De la bonté et mauvaistié des femmes rédigé en 1563, il effectue un
important travail de compilation et de recomposition au sein des deux grandes parties
antithétiques qu’il fait se suivre, chacune construite sur le modèle des listes de femmes
célèbres. La première contient 134 exemples répartis en douze chapitres thématiques,
le premier répondant aux misogynes en montrant l’excellence des femmes, certains
traitant de figures particulières, d’autres regroupant les femmes par capacités ou
vertus reconnues comme spécifiquement « féminines ». La deuxième réunit 111
exemples répartis sur onze chapitres consacrés aux vices dont le sexe féminin était
généralement accusé.
52 Philogyne fervent dans la Bonté des femmes, misogyne confirmé dans la Mauvaistié,
Marconville semble avoir cultivé avec le même enthousiasme l’éloge et le blâme. Était-il
partisan de la declamatio médiévale qui « emprunte à la dispute son apparence de
vérité, mais obéit en réalité aux règles d’un jeu rhétorique (et non dialectique) dans
lequel les deux parties sont les deux faces d’un sujet » (Périgot 2005 : 334) ? Marconville
tricote-t-il d’un côté ce qu’il détricote de l’autre ? L’œuvre a laissé plus d’un critique
perplexe. Pour son dernier éditeur, son dessein est de faire un recueil d’histoires
GLAD!, 04 | 2018
74
prodigieuses suscitant l’admiration et l’horreur, et cette préoccupation esthétique fait
que « la condamnation traditionnelle n’a plus de place, la querelle des femmes devient
donc un non-sens » (Carr 2000 : 21) — argument rhétorique bien connu qui permet de
contourner la question de son engagement. Pour Jean Vignes, sa conviction est
« essentiellement misogyne, mais d’une misogynie qui ne se perçoit pas comme telle »
(2001 : 38). Pour Gabriel-André Pérouse, il était « parmi les misogynes les plus décidés.
Mais la question est-elle là, et a-t-elle même un sens ? » ajoute-t-il, mettant lui aussi en
doute l’engagement de l’auteur dans la Querelle (2000 : 296). Perplexité, donc.
53 Il faut d’abord savoir que Marconville offre son traité à l’une des trois filles de Jacques
Courtin, conseiller du roi, bailli de Perche et seigneur de Cissé. Dans la dédicace datée
du 25 décembre 1563, qu’on retrouve dans la plupart des éditions, il dit avoir « emploié
le labeur de quelques jours à faire un recueil des vertus et vices des dames » (3030) pour
lui offrir en étrennes. Ce miroir lui servira (comme à d’autres) à imiter les bons
exemples et à fuir les mauvais. Marconville loue les qualités de quatre dames de
l’aristocratie provinciale qui constitue son cercle31, et en profite pour se positionner
comme un défenseur de l’honneur des femmes : elles forment selon lui « un plat bien
fourny de toutes les excellences qui se peuvent retrouver au sexe foeminin, que plust il
à Dieu que j’eusse louanges assez dignes pour les exalter » (31).
54 On doit aussi remarquer que l’argumentaire proféminin qui ouvre le volume s’attache à
fournir des exemples servant à contredire l’argumentaire masculiniste, quand le
suivant ne fait qu’abonder dans le sens des misogynes, sans entamer l’argumentaire
féministe — qui n’est pas l’inverse de l’autre car il n’attaque pas les hommes mais
atteste de la valeur des femmes. Ainsi, là où les misogynes défendent l’idée que les
femmes sont mauvaises, Marconville donne des exemples de mauvaises femmes. Mais
les champions des dames défendent l’idée que toutes ne le sont pas, et que certaines
font même preuve d’excellence. Ses louanges des femmes savantes, notamment, non
seulement rappellent les cas anciens parfois bien connus, mais allèguent des
contemporaines comme Marguerite de Navarre, Hélisenne de Crenne ou « Christine de
Pise Italienne » qui « tient le premier lieu entre toutes les sçavantes femmes qui aient
jamais esté » (93). Autant d’exemples qui ne sont pas contestés dans le traité suivant.
Marconville précise en revanche dans la Bonté des femmes qu’il veut renverser les
arguments des « Mysogines et ennemys du sexe foeminin » (38) et « clorre la bouche à
tous medisans et detracteurs du sexe foeminin » (41), voire les convertir à l’issue de sa
démonstration :
Si ceux qui prennent tout plaisir et se delectent à mesdire et detracter desfemmes pour abbaisser leur perfection consideroient les vertuz desquelleselles sont enrichies, et non moins admirables en icelles qu’ès hommes, jepense qu’ils changeroient d’opinion […] aussi je croy qu’[ils…] convertiroientleur detraction et mesdisance à la louange de ce sexe. (109)
55 Sans doute ses contemporains ont-ils reçu ce texte avec la même gêne que celle des
critiques d’aujourd’hui, puisque certains l’ont rangé dans le camp des misogynes,
d’autres parmi les champions des dames32. Ils l’ont pourtant plébiscité, puisque neuf
éditions en ont été répertoriées entre 1563 et 1586. Il faut croire qu’ils le trouvaient
pratique, car résumant en un seul volume les arguments de l’un et l’autre bords. En
tout état de cause, Marconville rend manifeste que chaque position était défendable,
affaire de goût, d’opinion ; que les arguments pouvaient se retourner comme des gants.
Mais on peut aussi soupçonner un choix éditorial, destiné à viser à la fois le public
GLAD!, 04 | 2018
75
féministe et le public misogyne. Sans doute espère-t-il encore vendre son ouvrage aux
deux camps lorsqu’il fait paraître quelques mois plus tard De l’heur et malheur de
mariage. La réitération de l’opération apporterait la preuve de son succès33.
Conclusion
56 Tout concourt donc à montrer que la simple vitupération des femmes n’était plus
possible au temps des premiers imprimés. Non seulement les argumentaires
proféminins étaient lus par les misogynes, qui se voyaient contraints de les contester,
mais même les plus virulents d’entre eux, d’une manière ou d’une autre, à un moment
ou à un autre, soit s’affirmaient du côté des femmes, soit se justifiaient de prendre la
plume pour les dénigrer. En cherchant à rendre leurs discours inattaquables, ils ont
paradoxalement fait des concessions au camp adverse. Certains textes ont aussi apporté
indirectement de l’eau au moulin des féministes par des mises à distance délibérées, en
s’amusant à ventriloquer la parole des femmes pour montrer qu’elles étaient loin d’être
convaincues par les discours prônant leur sujétion et que les hommes n’étaient pas au
bout de leurs peines, ou en portant plus sérieusement auprès d’un vaste public une
partie des arguments élaborés par leur courant — notamment les exemples de femmes
dont les performances ruinent la thèse de la supériorité masculine. Si la prolifération
des discours misogynes témoigne des résistances à une présence de plus en plus
importante des femmes dans les sphères du pouvoir politique et culturel, le succès des
textes de cette controverse promettant en outre des gains substantiels aux imprimeurs,
l’extraordinaire énergie déployée par les partisans de l’ordre du genre à la Renaissance
semble finalement n’avoir guère débouché que sur l’exacerbation de la Querelle.
BIBLIOGRAPHIE
ALONSO, Béatrice. 2008. « Louise Labé, Olivier de Magny : Dialogue poétique, dialogue politique »,
in L’Émergence littéraire des femmes à Lyon à la Renaissance. 1520-1560, CLÉMENT, Michèle & INCARDONA,
Janine (éds.), Actes du colloque de Lyon, 8-9 juin 2006. Saint-Étienne : Publications de l’Université
de Saint-Étienne, 107-121.
ARNOULD, Jean-Claude. 2009. « L’irréception des .XV. Joies de mariage », in Les Quinze Joies du mariage.
Édition et traduction du manuscrit Y. 20 de la bibliothèque municipale de Rouen suivies d’un dossier,
GUÉRET-LAFERTÉ, Michèle, LOUIS, Sylvain, MIRA, Carmelle, BÉTEMPS, Isabelle et al. (éds.). Mont-Saint-
Aignan : Publications des Universités de Rouen et du Havre, 241-255.
BEAUNE, Colette & LEQUAIN, Élodie. 2000. « Femmes et histoire en France au XVe siècle : Gabrielle de
La Tour et ses contemporaines » Médiévales 38 : 111-136.
BERRIOT-SALVADORE, Évelyne. 1990. Les Femmes dans la société française de la Renaissance. Genève :
Droz.
BILLON, François de. 1555. Le Fort inexpugnable de l’honneur du sexe Femenin. Paris : Jean Dallier.
GLAD!, 04 | 2018
76
BLETON-RUGET, Annie, PACAUT, Marcel & RUBELLIN, Michel (éds.). 2000. Georges Duby, regards croisés sur
l’œuvre, Femmes et féodalité. Lyon : Presses Universitaires de Lyon.
BLOCH, Howard R. 1991. Medieval Misogyny and the Invention of Western Romantic Love. Chicago/
London: University of Chicago Press.
BOULENGER, Jacques (éd). 1955. Tiers Livre, in Œuvres complètes de François Rabelais. Paris : Gallimard.
BRUNET, Jean-Charles. 1862. Manuel du libraire et de l’amateur de livres. t. III. Paris : Firmin Didot
Frères.
CARR, Richard A. (éd.). 2000. Jean de Marconville, De la bonté et mauvaistié des femmes. Paris :
Honoré Champion.
CHÂTELAIN, Claire. 2008. Chronique d’une ascension sociale. Exercice de la parenté chez les grands officiers
(XVIe-XVIIe siècles). Paris : Éditions de l’EHESS.
CLASSEN, Albrecht (éd.). 2004. Discourses on Love, Marriage, and Transgression in Medieval and Early
Modern Literature. Tempe: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, vol. 278.
CLAVIER, Tatiana. 2010. « Normativité et polémique dans les Vies de femmes illustres à la
Renaissance », in Femmes, culture et pouvoir. Relectures de l’histoire au féminin. XVe-XXe siècles, FERLAND
Catherine & GRENIER Benoît (éds), Actes du colloque de Sherbrooke (Québec), 20-22 mai 2009.
Laval : Presses Universitaires de Laval, 223-243.
CLAVIER, Tatiana. 2013. « Fortune de La Belle Dame sans mercy. Les mises en scène du débat entre
les sexes dans les premiers imprimés (env. 1475-1535) », in Revisiter la « querelle des femmes ».
Discours sur l’égalité/inégalité des sexes. Vol. 3, de 1400 à 1600, DUBOIS-NAYT, Armel, DUFOURNAUD, Nicole
& PAUPERT, Anne (éds.), Actes du colloque de la SIEFAR, Paris, Université de Columbia, 19-20
nov. 2010. Saint-Étienne : Publications de l’Université de Saint-Étienne, 93-120.
CLAVIER, Tatiana. 2016. La construction des identités de genre à travers les discours didactiques, édifiants
et polémiques imprimés à la Renaissance (1483-1594). Thèse de doctorat en littérature française. Saint-
Étienne : Université Jean Monnet et Université de Lyon. En ligne : https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-01541586/
DALARUN, Jacques. 2008. « Dieu changea de sexe, pour ainsi dire » : la religion faite femme (XIe-XVe siècle).
Paris : Fayard.
DESROSIERS, Diane & ROY, Roxanne (éds.). Sous presse. Ventriloquie. Quand on fait parler les femmes
(XVe- XVIIIe siècles), Actes du 85e congrès de l’ACFAS, Montréal, Université Mc Gill, 10-11 mai 2017.
Paris : Hermann.
DUBY, Georges. 1988. Mâle Moyen Âge. De l’amour et autres essais. Paris : Flammarion.
GAUDEMET, Jean. 1987. Le Mariage en Occident. Les mœurs et le droit. Paris : Cerf.
GRAY, Floyd. 2000. Gender, Rhetoric and Print Culture in French Renaissance Writing. Cambridge:
Cambridge University Press.
HANLEY, Sarah. 1995 [1989]. « Engendrer l’État. Formation familiale et construction de l’État dans
la France du début de l’époque moderne » (trad. par HEURTIN, Jean-Philippe), in Le Pouvoir des
légistes, COLLOVALD, Annie & FRANÇOIS, Bastien (éds). Politix. Revue des sciences sociales du politique 32 :
45-65.
HULT, David F. 2006. « Lecture et relecture d’une affaire amoureuse : les réponses à la Belle Dame
sans mercy », in Le Goût du lecteur à la fin du Moyen Âge, BOHLER, Danielle (éd.). Paris : Éditions du
Léopard d’or, 157-169.
GLAD!, 04 | 2018
77
JEAY, Madeleine (éd.). 1985. Les Évangiles des quenouilles. Montréal : Presses de l’Université de
Montréal, Paris : Vrin.
JORDAN, Constance. 1990. Renaissance Feminism. Literary Texts and Political Models. Ithaca & London:
Cornell University Press.
KELLY, Joan. 1982. « Early feminist theory and the “Querelle des Femmes” » Signs 8 (1): 4-28.
KING, Margarete. 1991. Women of the Renaissance. Chicago/London: Chicago University Press.
LAZARD, Madeleine. 2001. Les Avenues de fémynie. Paris : Fayard.
LE BRAS CHOPARD, Armelle. 2006. Les Putains du diable. Le procès en sorcellerie des femmes. Paris : Plon.
L’ESTRANGE, Elizabeth. 2007. « Le mécénat d’Anne de Bretagne », in Patronnes et mécènes en France à
la Renaissance, WILSON-CHEVALIER, Kathleen (éd.). Saint-Étienne : Publications de l’Université de
Saint-Étienne, 169-193.
LETT, Didier. 2013. Hommes et femmes au Moyen Âge, Histoire du genre. XIIe-XVe siècle. Paris : Armand
Colin.
MALENFANT, Marie-Claude. 2003. Argumentaires de l’une et l’autre espèce de femme. Le statut de
l’exemplum dans les discours littéraires sur la femme (1500-1550). Québec : Presses Universitaires de
Laval.
MARCY, Céline. 2008. Les Controverses des sexes masculin et femenin de Gratien Du Pont de Drusac :
édition et étude critique. Thèse de doctorat en littérature française. Toulouse : Université Toulouse
II — Le Mirail.
PAUPERT, Anne. 1990. Les Fileuses et le clerc. Une étude des Évangiles des Quenouilles. Paris : Honoré
Champion.
PAYEN, Jean-Charles. 1977. « La Crise du mariage à la fin du XIIIe siècle d’après la littérature
française du temps », in Famille et parenté dans l’Occident médiéval, DUBY, Georges & LE GOFF, Jacques
(éds), Actes du colloque de Paris, 6-8 juin 1974. Rome : École française de Rome, 413-426.
PÉRIGOT, Béatrice. 2005. Dialectique et littérature : les avatars de la dispute entre Moyen Âge et
Renaissance. Paris : Honoré Champion.
PÉROUSE, Gabriel-André. 2000. « Note de lecture : Jean de Marconville, De la bonté et mauvaiseté des
femmes, éd. critique établie et annotée par Richard A. Carr » Bulletin de l’Association d’étude sur
l’humanisme, la réforme et la renaissance 51(1) : 295-296.
PIONCHON, Pauline. 2008. « Le Corbaccio en France » Cahiers d’études italiennes, Boccace à la
Renaissance 8 : 209-223.
ROSSIAUD, Jacques. 1986. « Les métamorphoses de la prostitution au XVe siècle. Essai d’histoire
culturelle », in La Condición de la mujer en la Edad Media, FONQUERNE, Yves-René (éd.), Actes du
colloque de la Casa de Velásquez, 5-7 nov. 1984. Madrid : Universidad Complutense, 155-186.
VALENTINI, Andrea. 2014. Le Livre des epistres du debat sus le Rommant de la Rose. Édition critique.
Paris : Classiques Garnier.
VAN HAMEL, Anton Gerard (éd.). 1892-1905. Les Lamentations de Mathéolus et le Livre de Leesce de Jehan
Le Fèvre de Ressons. Paris : É. Bouillon.
VIENNOT, Éliane. 2003. « Le genre, cet inconnu. Le mot et la chose dans l’étude de l’Ancien
Régime », in Le Genre comme catégorie d’analyse : sociologie, histoire, littérature, FOUGEYROLLAS-
GLAD!, 04 | 2018
78
SCHWEBEL, Dominique, PLANTÉ, Christine, RIOT-SARCEY, Michèle & ZAIDMAN, Claude (éds.). Actes du
colloque du RING, Paris, 24-25 mai 2002. Paris : L’Harmattan, 153-166.
VIENNOT, Éliane. 2006. La France, les femmes et le pouvoir. L’invention de la loi salique (Ve-XVIe siècle).
Paris : Perrin.
VIENNOT, Éliane. 2012. « Revisiter la “querelle des femmes” : mais de quoi parle-t-on ? », in
Revisiter la « querelle des femmes ». Discours sur l’égalité/inégalité des sexes. Vol. 1, de 1750 aux
lendemains de la Révolution, in VIENNOT, Éliane (éd.). Actes du colloque de la SIEFAR, Paris,
Université de Columbia, 8 nov. 2008. Saint-Étienne : Publications de l’Université de Saint-Étienne,
7-29.
VIENNOT, Éliane. 2013. « Champions des dames et misogynes : les enjeux d’un combat frontal, à
l’aube des temps modernes (France, 1380-1530) », in L’Engagement des hommes pour l’égalité des
sexes, XIVe-XXIe siècle, ROCHEFORT, Florence & VIENNOT, Éliane (éds.), Actes du colloque de Paris,
Institut Émilie du Châtelet, 11-13 février 2010. Saint-Étienne : Publications de l’Université de
Saint-Étienne, 21-36.
VIGNES, Jean. 2001. Compte-rendu de l’édition de De la bonté et mauvaistié des femmes de Jean de
Marconville par Richard A. Carr. « À travers les livres » L’information littéraire 53 (1) : 36-38.
WIESNER, Mary E. 1993. Women and Gender in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University
Press.
WILSON-CHEVALIER, Kathleen (éd.). 2007. Patronnes et mécènes en France à la Renaissance. Saint-
Étienne : Publications de l’Université de Saint-Étienne.
ZIMMERMANN, Margarete. 2003. « The Old Quarrel: More Than Just Rhetoric? », in The Querelle des
Femmes in the Romania. Studies in Honour of Friederike Hassauer, AICHINGER, Wolfgang, BIDWELL-STEINER,
Marion, BÖSCH, Judith & CESCUTTI, Eva (éds.). Vienne : Turia & Kant, 27-42.
NOTES
1. J’utilise à dessein le terme féministe dans le sens où, dès Christine de Pizan, une pensée de
l’égalité des sexes et des droits afférents (d’étudier, de gouverner, de combattre, de juger, de
prêcher…) existe et se développe dans l’ouest de l’Europe et notamment en France, pensée
accompagnée d’actes concrets destinés à améliorer le sort des femmes et à combattre leurs
adversaires.
2. Voir Kelly (1982), Jordan (1990), Zimmermann (2003) et, pour une mise au point plus récente
de la question, Viennot (2012).
3. En 1274, le concile de Lyon décida de déchoir de la cléricature les clercs « bigames », qui
étaient mariés à une veuve ou remariés eux-mêmes.
4. La thèse selon laquelle l’amour courtois n’aurait été qu’un modèle littéraire et imaginaire dans
un « mâle Moyen Âge » (Duby 1988) où misogynie et idéalisation courtoise concouraient au même
effet d’usurpation sexuelle (Bloch 1991) a été contestée par des travaux plus récents qui ont mis
en évidence le lien entre la courtoisie et la présence des femmes dans la vie politique, culturelle
et affective de l’époque (voir Bleton-Ruget et al. 2000 ; Classen 2004).
5. « Quand je diz femme, je diz un sexe tant fragil, tant variable, tant muable, tant inconstant, et
imperfeict […] Nature leurs a dedans le corps posé en lieu secret et intestin un animal, un
membre [… dont] tout le corps est en elles esbranlé, tous les sens raviz, toutes affections
intérinées, tous pensemens confonduz » (Boulanger 1955 : 455).
GLAD!, 04 | 2018
79
6. J’indiquerai entre parenthèses, après les titres des textes, les dates de leur première (ou seule)
impression et le nombre d’éditions répertoriées (Clavier 2016).
7. Imprimée en italien à Paris en 1569, l’œuvre était déjà connue au début du siècle (Pionchon
2008).
8. C’est le cas du Giroufflier aux dames, conservé dans trois plaquettes gothiques non datées (vers
1508), qui met en scène des personnages réfutant, eux aussi, le Roman de la Rose ; comme Le Rousier
des dames de Bertrand Desmarins de Masan (v. 1530), où le Pelerin d’amours dialogue avec
plusieurs allégories qui louent les femmes ou déroulent les poncifs misogynes.
9. L’ouvrage de Guillaume de Lorris et Jean de Meun connaît 21 éditions des environs de 1481 à
1538, en comptant la traduction en prose de Clément Marot et la version moralisée de Molinet.
10. C’est aussi le cas de la querelle de La Belle Dame sans mercy (Clavier 2013).
11. Dialogue apologetique excusant ou defendant le devot sexe femenin : introduict par deulx personnages :
lun a nom Bouche maldisant : lautre Femme deffendant… (1516) ; Cuyder et Contrepenser des hommes et
des femmes […] avec les louanges des Dames (entre 1525 et 1547).
12. Mentionnons aussi l’anonyme Monologue fort joyeulx auquel sont introduyctz deux advocatz et ung
juge devant lequel est playdoye le bien et le mal des dames (v. 1530).
13. Anti-Drusac, ou livret contre Drusac, faict à l’honneur des femmes nobles, bonnes & honnestes ; par
manière de dialogue, de François Arnault de La Borie.
14. Par exemple La Leaulte des femmes (v. 1500), et La Grande Loyaulté des femmes (v. 1525), qui est
une adaptation du vieux Blasme des femmes (XIIIe s.).
15. La confusion semble provenir de Brunet (1862, col. 1152) qui aurait mal lu Le Fort inexpugnable
de l’honneur du sexe Femenin : « La louenge des Femmes composé, comme se peult croire, de quelque
bon Pantagrueliste, dans lequel l’Esprit de Maistre Jan du Pontalais a voulu tenir les assises, pour
en gergonnant [jargonnant] des Femmes, faire rire tout gaudisseur Varlet de boutique » (Billon
1555 : f. 17).
16. Ses différents titres confirment son positionnement : Cy est le chevalier aux dames/ De grant
leaultez et prudence/ Qui pour les garder de tous blames/Fait grant prouesse et grant vaillance ; et Le
Garant des Dames contre le Calomniateur de la Noblesse feminine.
17. Le Debat des dames de Paris et de Rouen sur l’entree du Roy et La Rescription des dames de Millan a
celles de Paris et de Rouen, attribués à Maximien ; La Rescripcion des femmes de Paris aux femmes de
Lyon et La Replicque faicte par les dames de Paris contre celles de Lyon, de Guillaume Crétin ; La
Reformation sur les Dames de Paris faicte par les Lyonnoises, attribuée à André de La Vigne.
18. La Grant triumphe et honneur des dames et bourgeoises de Paris et de tout le royaulme de France,
1531.
19. Voir aussi le Débat de la damoiselle et de la bourgeoise attribué à Jean de Saint-Mard, vicomte de
Blosseville (v. 1500).
20. Citons encore La Complainte du trop tost marié (v. 1500) ; La Complaincte du nouveau marié, avec le
Dit de chascun, lequel marié se complainct des extenciles qui luy fault avoir à son mesnaige, et est en
manière de chanson, [publié] avec La Loyaulté des hommes (v. 1500) ; le Sermon nouveau et fort joyeulx
auquel est contenu tous les maulx que l’homme a en mariage (v. 1500)…
21. Le Danger de se marier, par lequel on peut cognoistre les périls quy en peuvent advenir, tesmoings ceux
qui ont esté les premiers trompez, s.d.
22. La Vengence des femmes contre leurs maris à cause de l’abolition des tavernes et Le Plaisant quaquet et
resjouyssance des femmes pour ce que leurs maris n’yvrongnent plus en la taverne (1557). On retrouve
encore le procédé de la ventriloquie dans l’Apologie des chamberières qui ont perdu leur mariage à la
blancque [loterie], auquel répond L’Heur et guain d’une chambrière qui a mis à la blanque pour soy
marier, repliquant à celles qui y ont le leur perdu (v. 1540).
23. Voir note 3.
24. Les références des citations renvoient à la numérotation des vers dans l’édition Van Hamel
(1892-1905).
GLAD!, 04 | 2018
80
25. Les références des citations renvoient à la numérotation des feuillets par Céline Marcy (2008)
à partir de l’édition princeps numérisée sur Gallica.
26. Leurs arguments traduiraient « “moins une pensée intime” que “le respect des règles” de ce
jeu » pour s’exercer à l’éloquence (Malenfant, 2003 : 219). Voir aussi « The Querelle des femmes :
rhetoric or reality ? » (Gray 2000 : 11-20), qui s’appuie sur le cadre rhétorique pour affirmer qu’on
ne peut conclure à la misogynie des auteurs.
27. Voir note 2.
28. Les références des citations renverront à la pagination de son édition (Jeay 1985). Mes
analyses s’appuient aussi sur la riche étude d’Anne Paupert (1990).
29. Sur ce procédé de travestissement textuel, voir Desrosiers et Roy, à paraître.
30. Les références des citations suivront la pagination de l’édition Carr (2000).
31. On y trouve Anne Brisart, dame de la Bretonnière, à qui il offrira De l’heur et malheur de
mariage.
32. En 1584, Jean des Caurres reprend son chapitre sur les femmes savantes dans ses Œuvres
morales et diversifiées en histoires… (Berriot-Salvadore 1990 : 361), mais en 1593 René Courtin
évoque son « beau traité de l’abus et mauvaisté des femmes » dans son Histoire du Perche (Vignes
2001).
33. Le volume connut cinq éditions entre 1564 et 1583.
RÉSUMÉS
De la fin du XVe siècle à la fin du suivant, les premières presses d’imprimerie permettent la
publication de nombreux discours visant à attaquer ou à défendre les femmes. Le contexte est
celui de l’accélération de la dégradation de la situation et des droits des femmes qui sévit depuis
la fin du XIIIe siècle, parallèlement à la montée en puissance de la clergie. Mais c’est aussi la
période des grandes dirigeantes françaises au sommet de l’État qui défendent leurs intérêts
comme celles des grands duchés l’avaient fait au XVe siècle, soutenant les premières
manifestations de la Querelle des femmes. L’état des lieux de la production imprimée montre que
les discours misogynes et misogames confiés aux premières presses le sont parfois sous des titres
qui masquent leur positionnement, ou accompagnés de discours qui les contredisent. Il montre
aussi que ces discours suscitent de nombreuses ripostes. Les rhétoriques mises en œuvre dans les
plus divulgués indiquent que les argumentaires proféminins étaient assez diffusés pour qu’ils se
retrouvent jusque dans les discours des partisans de l’ordre du genre. Non seulement les auteurs
misogynes les rappellent pour les contester ou s’en moquer, mais même les plus virulents d’entre
eux se doivent, d’une manière ou d’une autre, à un moment ou un autre, de s’affirmer du côté des
femmes ou bien de se justifier de prendre la plume pour les dénigrer. Ces interférences dans
leurs discours confirment la force de l’argumentaire féministe en cette période des premiers
imprimés qui est aussi celle de l’exacerbation de la Querelle des femmes.
From the end of the fifteenth until the end of the sixteenth centuries, the first printing press
allowed for the publication of various discourses aiming at attacking or defending. Women’s
situation and rights was strongly worsening since the end of the thirteenth century with the
clergy getting greater power. Meanwhile, women leaders at the head of the State defended their
cause, as women of the Grand Duchies had done before them, by supporting the first outbursts of
the Quarrel about Women. The first misogynistic and misogamistic printed discourses were
GLAD!, 04 | 2018
81
sometimes published under misleading titles or together with inconsistent speeches, always
triggering numerous retaliations. Rhetorics in favour of women were sufficiently widespread to
appear in advocates of the gender order’s discourses. Not only misogynistic writers contested or
scoffed at arguments in favour of women, but the most virulent among them also pretended to be
alongside women or found excuses to disparage them. These inconsistencies in misogynistic
speeches attest to the power of the feminist arguments at the time of the first printing press,
concomitant with the intensification of the Quarrel about Women.
INDEX
Thèmes : Recherches
Mots-clés : misogames, misogynes, Querelle des femmes, Renaissance, textes imprimés
Keywords : misogamistic, misogynistic, printed texts, Quarrel about Women, Renaissance
AUTEUR
TATIANA CLAVIER
Tatiana Clavier est docteure en langue et littérature françaises. Elle exerce comme enseignante
(PRCE) à l’Université de La Rochelle : Expression-Communication (IUT), langue et littérature du
Moyen Âge et de la Renaissance (FLASH, département Lettres). Ses travaux portent sur la
Querelle des femmes et la construction du genre à travers les premiers textes imprimés en langue
française (fin XVe et XVIe siècles).
GLAD!, 04 | 2018
82
Construire les hommes comme desvictimes irresponsables Les stratégies discursives des associations masculinistes françaises
Constructing Men as Unaccountable Victims. Rhetorical Strategies of French
Masculinists Associations
Étienne Lefort
1 Les associations pour la « cause des pères », la « coparentalité » ou contre « l’aliénation
parentale » sont présentes en France depuis les années 1980 et continuent à être actives
aujourd’hui. Si le nombre de militant⋅e⋅s est très réduit, les modes d’actions et
l’utilisation des réseaux sociaux donnent parfois à ces groupes une certaine visibilité
médiatique et permettent une diffusion à un public assez large de leurs argumentaires1.
Par ailleurs, l’activité de lobbying que ces groupes mènent leur donne un écho jusque
dans les sphères parlementaires, par le biais d’auditions en commissions
parlementaires ou de questions au gouvernement transmises par des député⋅e⋅sréceptifs à leur cause.
2 La littérature sociologique sur ces associations pour le « droit des pères » permet
d’établir qu’elle est la composante la plus active du mouvement masculiniste en France.
Ce mouvement se caractérise par son antiféminisme, que l’historienne Christine Bard
définit ainsi : « Au sens strict, il s’agit de l’opposition aux mouvements féministes, mais
il relève plus généralement de l’hostilité à l’émancipation des femmes2 ». La sociologue
Mélissa Blais et le chercheur en science politique, Francis Dupuis-Déri, affirment que
« [l]e masculinisme est avant tout une forme particulière d’antiféminisme3 ». Mais, en
tant que mouvement social, « [l]e masculinisme englobe un ensemble d’individus et de
groupes qui œuvrent à la fois pour contrer le féminisme et pour promouvoir le pouvoir
des hommes4 ». Ces auteurs précisent que si ce mouvement fournit souvent beaucoup
d’efforts pour se présenter comme n’étant pas antiféministe
[a]u final, et quel que soit son discours, le mouvement masculiniste a pour effet defreiner l’émancipation des femmes. En ce sens, le masculinisme pourrait êtreconsidéré comme un « contre-mouvement », pour reprendre une notion propre auchamp d’études des mouvements sociaux en sociologie et en science politique. Cettenotion de « contre-mouvement » renvoie à l’idée de « contre-révolution » : chaque
GLAD!, 04 | 2018
83
fois qu’il y a un vaste mouvement d’émancipation, les dominants se mobilisent pourcontre-attaquer.5
3 Pour sa part, le sociologue Léo Thiers-Vidal explique que « le masculinisme consiste à
produire ou reproduire des pratiques d’oppression envers les femmes — quel que soit le
domaine d’action — et ce à partir de la masculinité, la position vécue de domination
selon l’axe de genre6 ».
4 Ainsi, si les deux notions sont liées, il apparaît que le masculinisme relève d’une
opposition à un groupe social, celui des femmes, et d’une attitude volontariste de
défense ou d’extension des privilèges du groupe des hommes, quand l’antiféminisme
s’oppose à un mouvement politique et à ses effets en cherchant à entraver son action.
L’antiféminisme sous-tend l’analyse masculiniste qui s’articule avec la croyance en une
crise de la masculinité tenue pour responsable de la presque totalité des maux de la
société actuelle, mais surtout du supposé déclin de la place des hommes7.
5 Dans le panorama français des groupes de militants pour le « droit des pères » on
retrouve deux principaux types d’associations. D’une part les associations ayant une
activité d’accueil et de conseil des pères impliqués dans un divorce ou une séparation
conflictuelle. D’autre part, des associations, groupes, sites et blogs dont l’activité
principale est la production et la diffusion d’écrits, d’analyses, d’argumentaires et de
témoignages. Dans les deux cas, cela s’accompagne parfois d’une activité de lobbying et
d’organisation ponctuelle d’évènements publics comme des conférences ou des débats.
Le G-E-S, Groupe d’Étude sur les SexismeS8, association fondée en 2008 à Bron dans
l’agglomération lyonnaise, mène depuis sa création une action de lobbying et de
production de témoignages et d’analyses sur la situation des hommes dans la société
actuelle, que le groupe juge « misandre ». Il illustre donc le second type d’associations.
6 Patrick Guillot, président et fondateur du G-E-S, est l’auteur de plusieurs livres sur la
condition des hommes et les discriminations dont ils seraient victimes du fait de leur
sexe. Il était également organisateur et animateur des congrès « Paroles d’homme » qui
ont eu lieu à Genève en 2003, Montréal en 2005 et Bruxelles en 2008. Ces congrès étaient
des rencontres internationales entre les différents acteurs francophones du
mouvement masculiniste. Ils étaient également l’occasion du développement et de la
diffusion d’analyses et de stratégies dans les différentes composantes du mouvement
masculiniste au Québec, en Suisse, en Belgique et en France. Patrick Guillot et le G-E-S
occupent donc un rôle important dans la production et la diffusion d’analyses et
d’arguments pour la « cause des hommes ».
7 Dans le cadre de ma thèse de doctorat en sociologie, j’ai réalisé 26 entretiens semi-
directifs et 34 observations dans les permanences de 7 associations défendant le « droit
des pères », réparties dans 3 grandes villes de France. Ceci dans le but de recueillir les
discours produits dans ces contextes d’entretiens ou de permanences d’accueil et de
conseil — organisées en groupe de parole.
8 L’état actuel du traitement des données récoltées ne me permettant pas d’intégrer tous
les entretiens à l’analyse que je propose ici, j’ai choisi de mobiliser de façon plus
détaillée quatre entretiens réalisés avec des militants de deux associations situées dans
une même ville, grande agglomération française, éloignée géographiquement de la ville
de Lyon.
9 L’un de ces militants est animateur de l’antenne locale d’une association nationale dont
le fonctionnement est centré sur les permanences d’accueil et de conseil. Les trois
GLAD!, 04 | 2018
84
autres appartiennent à une association ayant un fonctionnement singulier par rapport
aux principales associations françaises pour le « droit des pères ». En effet, elle
concentre son activité sur la mise en place de processus de médiation familiale mais
sans reconnaissance légale ni professionnelle. Elle ne met pas en place de permanence
d’accueil ni de groupe de parole mais privilégie les accueils individuels et tente de
mettre en place un dialogue entre les parents séparés ou divorcés. L’association et ses
militants considèrent donc porter un discours et une approche particulièrement
mesurée et non-idéologique sur les séparations conflictuelles. Cependant, il apparaît
dans les entretiens que les militants partagent les analyses et argumentaires
masculinistes.
10 Ma démarche est ici d’étudier la cohérence des argumentaires et des rhétoriques entre
militants de différentes régions, engagés dans différentes activités. C’est pourquoi je
souhaite mettre en regard les propos de ces militants avec les écrits disponibles sur le
site internet du G-E-S qui, s’ils ne sont pas cités directement par les militants,
constituent des efforts importants de systématisation et de formalisation des
rhétoriques et revendications du mouvement masculiniste français.
11 Je montrerai dans un premier temps qu’une des préoccupations principales du
mouvement dans son ensemble est d’apparaître comme acteur légitime auprès des
pouvoirs publics et de l’opinion par l’utilisation de la rhétorique égalitaire. Dans un
deuxième temps, j’analyserai comment la critique de la justice, qui occupe une place
très importante dans les discours produits, est un vecteur de prises de positions
antiféministes. Enfin, en troisième temps je montrerai comment la construction des
hommes comme victimes sert à les déresponsabiliser, individuellement et
collectivement.
Devenir respectable en maniant le discours de l’égalité
12 Depuis de nombreuses années déjà les mouvements de pères des différents pays dits
occidentaux se sont lancés dans une quête de respectabilité qui passe par la
réappropriation du discours de lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes9.
Deux sociologues australiennes, Miranda Kaye et Julia Tolmie, ont étudié les appareils
rhétoriques utilisés par les groupes de pères dans leur pays. Elles insistent sur le fait
que ces discours bénéficient d’une certaine crédibilité parce qu’ils reprennent à leur
compte des normes sociales bien établies et renforcent ainsi les stéréotypes
dominants10. Elles identifient les stratégies rhétoriques suivantes : l’utilisation
d’anecdotes individuelles, l’usage abusif et détourné de statistiques, la confusion entre
l’intérêt de l’enfant et celui du père, la défense de la famille patriarcale traditionnelle et
la diffusion d’images négatives des femmes. Elles insistent également sur la
réappropriation du langage de l’égalité et des droits par ces associations et sur la
revendication du statut de victime pour les hommes en général et les pères militant
dans ces associations en particulier. Les recherches existantes sur les associations
françaises montrent que les mêmes appareils rhétoriques sont utilisés11.
13 En effet, depuis l’apparition des premières associations françaises, la question de la
modération du discours et de la légitimité retirée d’une argumentation en apparence
pondérée est présente dans le mouvement masculiniste. La recherche de mots et de
thèmes alimentant cette image modérée est une constante dans la majorité des
associations12. Quelques-unes privilégient un discours tranché et très explicitement
GLAD!, 04 | 2018
85
revendicatif13 mais la plupart adaptent leurs discours pour le rendre acceptable le plus
largement possible. Par exemple, les associations françaises ont tendance, depuis les
années 2000, à se définir comme défendant « l’égalité parentale », la « coparentalité »
ou la « résidence égalitaire » plutôt que défendant le « droit des pères »14. Le G-E-S
participe pleinement, depuis sa création, à cette dynamique de légitimation des
revendications du mouvement en se positionnant comme détenteur d’une expertise et
comme acteur institutionnalisé de par ses modes d’action. En effet, les multiples
saisines et pétitions adressées à différents ministères et services étatiques positionnent
l’association comme interlocutrice légitime des services de l’État [a]. Du moins en
apparence, puisque les réponses reçues sont majoritairement des fins de non-recevoir.
Le registre de langage utilisé ainsi que le format des publications renforcent le
caractère légitime des propos tenus ainsi que la respectabilité de l’association elle-
même et de sa supposée fonction d’expertise.
14 Par ailleurs, P. Guillot est un des rédacteurs et signataires du « manifeste hoministe »
[b] qui tente de donner une connotation positive à ce nouveau néologisme, suite au
travail de qualification négative du mot « masculiniste » par les mouvements
féministes. Toutefois, le « manifeste hoministe » énonce clairement, dès son premier
point, qu’il s’agit d’un « mouvement de réflexion et d’action des hommes du début du
vingt et unième siècle, concernant d’une part leur identité sexuelle et de genre, d’autre
part leurs droits et leurs devoirs dans la société. » Plus loin, on lit également :
(1) 8. Les hoministes dénoncent la montée en force des idéologies misandres.Ils réaffirment leur existence masculine comme aussi fondamentale etimportante que l’existence féminine. Attachés à l’égalité des genres et dessexes, ils combattent fermement tout déni, discrédit, discrimination,accusations et réécritures de l’histoire diffamantes à l’encontre de la moitiémasculine de l’humanité.
15 Il s’agit alors clairement d’un mouvement d’hommes pour les hommes et qui lutte
contre les critiques faites aux hommes et la remise en cause de leurs prérogatives,
privilèges et positions, donc contre les féminismes.
16 P. Guillot alimente également un site personnel avec un ton nettement moins mesuré,
plus explicitement antiféministe [c]. Cette répartition des différents tons de discours
suivant les sites internet utilisés (personnel ou associatif) souligne l’importance qui est
accordée à la stratégie de légitimation sur la scène publique : il s’agit de construire,
pour l’association au moins, une image respectable et modérée de défenseurs de
l’égalité.
17 Ainsi l’association G-E-S se présente comme étant « féministe, hoministe, pour l’égalité
des droits » et fait valoir dans le premier article de ses statuts que ses objectifs sont de
« produire et communiquer de l’information sur les sexismes ; promouvoir et mener
des actions de tous ordres en vue de combattre l’influence des sexismes » [d]. La grande
majorité des écrits disponibles sur le site internet de l’association vise à dépeindre les
hommes comme des victimes de discriminations systémiques dues à leur genre,
discriminations dont les responsables sont les femmes, et notamment les féministes.
Les premières lignes du préambule de la plate-forme de propositions de l’association
rendent explicite cette analyse et font apparaître le trope d’un féminisme qui serait allé
trop loin :
GLAD!, 04 | 2018
86
(2) Au vingtième siècle, l’action du mouvement des femmes, conjuguée àcelle de nombreux hommes, a permis de remédier à la plupart des inégalitésde en [sic] droits dont elles étaient victimes dans les pays développés.Mais la puissante mobilisation engendrée par cette cause a occultél’existence d’injustices au détriment des hommes. Bien plus, certainesmesures prises en faveur du genre féminin ont créé de nouvelles inégalités àl’encontre du genre masculin. [e]
18 Les associations que j’ai rencontrées utilisent toutes cette rhétorique de la défense des
droits, en utilisant la figure des enfants comme victimes innocentes à défendre. Celles
dont je traite plus particulièrement ici font très attention de se démarquer d’autres
associations jugées plus extrémistes ou radicales. Ces associations repoussoirs ne sont
pour autant pas nommées et il est difficile de savoir précisément qui elles sont. Il s’agit
donc, pour les militants, de se placer du côté modéré et légitime, du côté de ceux qui
défendent l’égalité, en condamnant les prises de position extrémistes.
19 André15, militant actif et animateur de permanences dans l’antenne locale de
l’association nationale explique le contexte de son engagement dans cette association
en particulier :
(3) Parce qu’il faut savoir qu’il y a pas que [notre association], il y a desassociations où la devise, entre guillemets, c’est « nous on est bons et ellesc’est les connes ». Non non non, je rentre pas du tout dans ce discours-là. Moile discours il est "je suis parent comme les mamans, je suis capable commeles mamans." voilà. Il est pas du tout… j’ai mon idée sur la maman desenfants mais ça n’a pas à intervenir sur l’idée que je me fais de la parentalité.Voilà.16
20 La distinction est clairement faite entre des associations qui portent un discours jugé
radical, et les associations qui font preuve de plus de nuance.
Ludovic, un membre actif de l’association centrée sur la médiation familiale, explique
qu’il cumule cet engagement avec un autre dans une association qu’il décrit comme
plus militante :
(4) Parce que je pense que c’est complémentaire. Y’a deux combats à mener.Y’a un combat médiation, proposer des solutions sur un plateau, dire çamarche, ça existe, c’est la solution, y’en a pas d’autre. Ce qui est la vérité. Etd’un autre côté dénoncer les mentalités, dénoncer les processus, dénoncer lajustice, il faut dire ce qui est et qui n’est pas adapté. Et je pense que ces deuxfronts là il faudrait qu’ils soient main dans la main. Et c’est important aussipour les parents, là c’est cadré, on n’est pas dans une action « je monte surune grue tout seul avec un pauvre chiffon et je passe pour un abruti et uncrétin et puis un fou ». Là c’est cadré, on est dans le cadre d’une association,tout est déclaré. Les trucs sont faits sérieusement, les tracts qu’on fait etvoilà quoi. Et les parents ils ont l’impression d’être acteurs, qu’ils sont dansla situation. Ce qu’ils demandent la plupart c’est d’agir quoi, ils peuvent passupporter d’attendre sans rien faire. Et ça fait partie d’une thérapie aussid’être sur le terrain, de rencontrer d’autres parents dans la même situation,ou dans une situation similaire et de faire quelque chose ensemble pourchanger les choses.17
21 Ludovic fait ici la différence entre les deux types d’engagements mais prend également
ses distances avec un militantisme qui serait moins organisé et qui nuirait, finalement,
à la cause des pères en renvoyant une image d’« abruti », de « crétin » et de « fou ». Il
GLAD!, 04 | 2018
87
est intéressant de souligner que l’engagement est vu comme une « thérapie » et
participe du règlement de la situation, en parallèle de la médiation. Ce point de vue est
rarement exprimé de la sorte par les militants mais se retrouve dans leur parcours
personnel et dans les raisons de leur engagement.
22 Romeo, président et fondateur de l’association, évoque des associations qu’il juge plus
radicales et qu’il accuse d’alimenter les conflits entre les parents plutôt que de
chercher à les résoudre :
(5) Malheureusement il y a des associations aujourd’hui où ça se passecomme ça. C’est-à-dire que dès que le père il voit qu’il se fait avoir, lesassociations elles disent « bah tu te fais pas chier, tu prends le gosse et tut’en vas avec ». Moi je crois pas que c’est la bonne solution, je crois qu’il vafalloir expliquer et changer de principe en disant « voilà, y’a un enfant, il abesoin de vous deux, quoi qu’il en soit ».18
23 Cette différence dans les modes d’action est une réalité et cette association met
effectivement en place des temps de médiation entre les parents pour apaiser les
conflits et surtout pour éviter ou limiter le recours aux procédures judiciaires. La
plupart des autres associations pour la cause des pères interviennent pendant les
procédures et recommandent d’agir de façon offensive et procédurière, elles tendent
donc à alimenter les conflits plus qu’à les apaiser.
24 Toutefois, cette différence n’implique pas une distance idéologique importante. Les
thèmes abordés et la façon dont ils sont traités sont très communs aux autres
associations.
La critique d’une justice « misandre » pour attaquer leféminisme
25 Dans les divorces et les séparations avec enfant, le passage devant un⋅e juge aux
affaires familiales est obligatoire, ce qui fait de ce domaine de la justice le principal
point de contact entre les justiciables et l’institution judiciaire19. Dans un processus de
divorce ou de séparation, d’autant plus s’il est conflictuel, le jugement cristallise
beaucoup d’attentes et de tensions pour les deux parents et ex-conjoint⋅e⋅s,
notamment lorsqu’il est investi comme le lieu d’une possible victoire ou défaite face à
l’ex-conjoint⋅e. Ce sujet est donc au cœur des discours masculinistes.
26 Sur son site internet, le G-E-S consacre un dossier complet au thème des divorces,
séparations et résidence des enfants dans lequel il indique à plusieurs reprises que la
justice est « misandre » et « contre les pères ». Ainsi, après avoir évoqué le chiffre de
17 % de résidences alternées (RA) prononcées par les juges, l’association précise :
(6) La Justice a une lourde responsabilité dans cette situation. Comme la RAest définie comme une possibilité parmi d’autres, et comme ils baignent dansla culture misandre, les juges ne l’attribuent que lorsqu’elle est demandéepar les deux parents, la demande du seul père ne suffisant pas. Dans lesprocédures où le désaccord persiste (10,3 % de l’ensemble, soit 13 000), 4600pères (35 %) demandent la RA (en opposition à la mère qui demande larésidence chez elle) mais ne l’obtiennent que dans 24,6 % des cas. Autrementdit, chaque année, environ 3500 pères qui demandent la RA ne l’obtiennentpas. [f]
GLAD!, 04 | 2018
88
27 L’association déplore ici le faible nombre de résidences alternées attribuées par les
juges, problème accentué par le fait que « la demande du seul père ne suffis[e] pas ». Il
n’est nulle part question de concertation ou de négociation entre les parents : le regret
exprimé est celui de la non-prise en compte automatique du souhait de l’homme. C’est
donc le modèle traditionnel de famille patriarcale qui prime et l’autorité du père et du
mari comme valeur de référence qui est revendiquée. Le féminisme serait, ici aussi, allé
« trop loin ».
28 Par ailleurs, cette présentation des chiffres tirés d’un rapport du ministère de la Justice
insiste sur les cas où les pères n’obtiennent pas la résidence alternée alors qu’ils la
demandent, en s’opposant à la demande de la mère des enfants. Or on peut éclairer très
différemment le phénomène en citant le rapport lui-même :
Compte tenu du poids important des parents en accord (80 %) dansl’ensemble des parents ayant fait une demande relative à la résidence, lesdécisions prononcées par les juges reflètent très largement le choix établi encommun par ces parents.– Ainsi, la résidence chez la mère est plus fréquemment prononcée par lejuge car c’est le mode de résidence le plus sollicité par les parents séparés.Parallèlement, la résidence alternée — dont la proportion a progressépassant de 10 % en 2003 à 17 % en 2012 — reste un mode de résidence moinsprononcé par les juges car moins sollicité par les parents. Enfin, le jugeprononce moins de 12 % de résidence chez le père, en lien avec une faibledemande de la part des parents.– En mettant en parallèle, l’ensemble des demandes des pères aux décisionsdes juges, on observe que 93 % des demandes des pères ont été satisfaites.– En mettant en parallèle, l’ensemble des demandes des mères aux décisionsdes juges, on observe que 96 % des demandes des mères ont été satisfaites.20
29 Dans les associations effectuant des permanences d’accueil, une grande part du temps
consacré aux pères venant chercher des conseils est dédiée à la sensibilisation au
monde judiciaire, aux différentes procédures, acteurs et actrices, étapes et calendriers.
Beaucoup de conseils stratégiques sont donnés aux pères afin de défendre au mieux
leur dossier. Généralement, ces conseils pratiques s’accompagnent de critiques plus ou
moins virulentes de la justice française et internationale, du personnel lié à l’institution
judiciaire ainsi que des lois et politiques encadrant les divorces et les séparations. Elles
sont l’occasion de prises de positions sexistes et antiféministes.
30 Ainsi, on retrouve, chez les militants des associations que j’ai rencontrés, ce discours
critique de la justice qui n’accorderait pas suffisamment de poids et de crédit à la
parole masculine et attribuerait trop d’importance et de validité à la parole féminine.
Ludovic est père de trois enfants, âgé de 38 ans au moment de l’entretien, cadre dans
l’administration territoriale. Lors de la procédure de divorce, il a demandé, sans
l’obtenir, la résidence alternée, après avoir initialement accepté un accord de droit de
visite et d’hébergement de quatre jours tous les 15 jours. Durant l’entretien, il accumule
les griefs contre les juges et la justice. Il se plaint notamment du fait que les éléments
qu’il a apportés à son dossier n’ont pas suffi à faire pencher le jugement en sa faveur
alors qu’il considère que les pièces apportées par son ex-femme sont moins
convaincantes que les siennes. Il insiste sur les discriminations et les préjugés de
l’institution judiciaire en la rendant responsable d’engendrer et d’alimenter la « guerre
des sexes » :
GLAD!, 04 | 2018
89
(7) On voit qu’il y a un gros problème avec la justice. Si la justice était juste,appliquait les lois strictement, bah ça remettrait tout le monde d’aplomb,d’équerre tout de suite quoi. Mais ils veulent pas, y’a une idéologie derrière,ils ont peur des papas, ils se disent « ouais, les papas ils sont militants, ils enont après la femme » etc. Mais c’est pas vrai. C’est eux qu’en arrivent à cesextrémités-là. Je suis pas après la femme, j’adore la femme. Je suis toujours…j’aime bien le contact féminin et tout. Qu’on dise pas… qu’on en a après lesfemmes et tout, c’est pas vrai. Ils vont faire une guerre des sexes qui a paslieu d’être.21
31 André est père de deux enfants, âgé de 44 ans au moment de l’entretien, cadre dans une
entreprise privée. Il fait partie des pères ayant obtenu la résidence alternée contre
l’avis de son ex-conjointe. Il insiste toutefois sur le fait qu’il a subi, durant la procédure
et au moment de son dénouement en sa faveur, une disqualification de la part de la
justice aux affaires familiales :
(8) Et donc après on s’est retrouvé au mois de juillet et fin juillet j’avais lagarde alternée. Et ce qui est fou, et ça ça m’a marqué, dans le jugement c’estpas marqué « monsieur XXX mérite la garde alternée » c’est marqué« Monsieur XXX ne démérite pas. » c’est-à-dire même dans le jugement, c’estfou hein, ça veut tout dire dans les mots, limite « je te la donne parce que j’aipas le choix » quoi. C’est pas « monsieur XXX mérite d’avoir la gardealternée », il ne démérite pas. Bon, c’est comme ça.22
32 La formule utilisée dans le jugement est interprétée comme une marque de l’idéologie
opposée aux pères qui serait prégnante dans la justice aux affaires familiales française.
Les travaux sociologiques existant sur ce pan de l’institution judiciaire montrent qu’il
n’existe pas d’écart significatif dans les décisions prises par les juges en fonction de leur
sexe et que les professionnel⋅le⋅s qui la composent sont, comme l’ensemble de la
société française, bien plus perméables aux valeurs patriarcales qu’aux valeurs
féministes et largement enclin⋅e⋅s à favoriser le maintien du lien père-enfant, parfois
en dépit de la sécurité et du bien-être des enfants23.
33 Par ailleurs, concernant les enfants, la justice aux affaires familiales ne se donne pas
pour mission d’évaluer le mérite des parents mais de répondre aux demandes
formulées par le père ou la mère. Pour ce faire elle se base sur la présence ou l’absence
d’éléments tangibles justifiant la limitation ou l’annulation d’un droit de visite et
d’hébergement, de l’attribution de l’autorité parentale ou d’un lieu de résidence. Les
formules négatives relevant l’absence d’argument justifiant l’annulation d’un droit de
visite, par exemple, sont fréquentes. Les dossiers d’archive d’une cour d’appel que j’ai
pu consulter en donnent plusieurs exemples. Ainsi, dans ses conclusions, l’avocat d’un
père indique, comme argument favorable au maintien du droit de visite et
d’hébergement de celui-ci que le rapport d’expertise joint au dossier « n’a pas par lui
seul apporté d’argument qui pourrait contrindiquer un droit de visite et d’hébergement
chez le père ». Dans un autre dossier, après un argumentaire très critique des capacités
éducatives de la mère, la cour d’appel écrit : « Dans la mesure où aucun élément ne
permet d’établir que la prise en charge éducative et affective du père est moins
satisfaisante que celle proposée par la mère, […] il convient de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a fixé la résidence habituelle de [l’enfant] chez son père ».
34 Ces formules relèvent donc du vocabulaire judiciaire et explicitent les décisions de la
cour en fonction des demandes des pères et mères mais elles sont interprétées par les
GLAD!, 04 | 2018
90
militants de la cause des pères comme des signes de l’orientation « misandre » de la
justice.
La construction d’une position déresponsabilisante devictime
35 Un autre élément de stratégie rhétorique qui apparaît dans les discours des
associations masculinistes, et ce quel que soit l’objet de ces discours, est la construction
des hommes en victimes de discrimination du fait de leur genre. Cette construction a
pour premier effet de limiter ou de nier toute responsabilité individuelle ou collective
des hommes dans les situations dans lesquelles ils se trouvent.
36 Sur son site, le G-E-S détaille par exemple les raisons pour lesquelles, selon lui, les pères
ne demandent pas la résidence alternée lors des divorces et séparations :
(9) Les parents des deux sexes sont donc traités inégalement :– en amont des procédures, les pères subissent une pression idéologiquenégative très forte, qui les dissuade de se battre pour la RA ou du moins lesaffaiblit dans ce combat ;– dans le cadre des procédures, même s’ils la revendiquent, ils subissent de lapart des acteurs sociaux et judiciaires un a priori très défavorable, qui donnelieu à [des] décisions très défavorables.Des mères, pour des raisons variables, sont également et injustement privéesde leurs enfants, et il est juste de les soutenir, même si elles sont en petitnombre. Les pères, eux, subissent une discrimination systémique, fondée surle sexe : ils sont discriminés en tant que parents de sexe masculin. [f]
37 Recourir ainsi à l’explication par une « discrimination systémique fondée sur le sexe »
dont seraient victimes les pères occulte le fait que les hommes sont en mesure de
choisir, avant, pendant et après la séparation, de s’investir davantage dans les tâches
ménagères et d’éducation mais qu’ils continuent à les déléguer aux femmes et à
privilégier massivement leur carrière professionnelle, même si des évolutions sont
notables, comme le montrent les enquêtes « emploi du temps » menées par l’INSEE24. La
responsabilité portée par les hommes dans le faible taux d’attribution de garde alternée
est ici déniée et les hommes sont présentés comme n’ayant aucune prise sur la
situation. Cela permet aux associations de s’abstenir de formuler des recommandations
sur le comportement des hommes, sur leur engagement dans le travail domestique et
d’éducation avant, pendant et après la séparation : tout se passe comme si la
participation des hommes était suffisante mais que la société ne s’adaptait pas assez
vite. Vision très répandue et largement diffusée par les masculinistes.
38 Les hommes avec qui j’ai effectué des entretiens ont tous demandé, et, pour l’un d’entre
eux, obtenu la résidence alternée de leurs enfants. Ils ne font donc pas partie des pères
décrits dans l’extrait ci-dessus. Cependant c’est un autre versant de cette logique de
déresponsabilisation qui ressort de leurs discours. En effet, ces pères expliquent être
« obligés » de faire certaines choses du fait du comportement de leur ex-conjointe et de
la discrimination qu’ils subissent en tant qu’hommes.
39 Ludovic me lit ainsi un extrait de la lettre qu’il a adressée au procureur pour porter
plainte contre le médecin de son ex-épouse qui, selon lui, aurait fourni à cette dernière
un certificat médical « de complaisance » ayant donné lieu à une Interruption Totale de
Travail (ITT) indue. Il m’explique immédiatement après la lecture les circonstances de
GLAD!, 04 | 2018
91
cette plainte : « Donc je porte plainte mais pas par plaisir hein. Je suis obligé. C’est
vraiment… ça fait chier quoi. Ça fait chier ! » Il insiste ici sur le fait qu’il se sent obligé
d’agir de la sorte et minimise donc sa responsabilité individuelle en affirmant que c’est
le processus judiciaire et les agissements de son ex-épouse et du médecin qui le
poussent à entreprendre cette action. La discussion sur la réalité du motif de l’ITT n’est
finalement pas au centre de ses préoccupations, elle est un moyen d’alimenter la
procédure et de justifier les actions de Ludovic. Cela malgré l’importance donnée au
discours d’apaisement, par l’association et par Ludovic lui-même. Sa volonté et sa
puissance d’agir sont minimisées dans le récit qu’il fait des évènements, ce qui a pour
effet de le dédouaner de comportements susceptibles d’empêcher tout accord entre les
deux parties sur l’organisation de la résidence des enfants. Il explique porter plainte à
contrecœur parce que son ex-épouse ne lui aurait pas laissé le choix en agissant ainsi.
Cette interprétation occulte le fait qu’il aurait pu choisir de ne pas rendre la situation
encore plus conflictuelle et procédurière, qu’il était en mesure de faire des choix
différents et donc qu’il porte une responsabilité importante dans le déroulé et l’issue de
la procédure et de la situation générale.
40 De la même manière, Adrien, père de trois enfants, militant dans la même association
que Ludovic, âgé de 48 ans et cadre d’une grande entreprise privée, raconte pendant
l’entretien qu’il a été contraint de « faire la morale » au directeur de l’école d’une de ses
filles après que l’institutrice ait fait un témoignage qui lui est défavorable :
(10) Ma fille était en moyenne section, elle avait 4 ans. Et son instit avait faitun témoignage pour dire que ça se passait pas bien, qu’elle pleurait le lundiquand je les avais le week-end. Donc je suis allé la voir la semaine d’après, jeme suis pas énervé parce que c’était fait et je suis pas… J’avais été voir ledirecteur et pareil, j’ai horreur de faire la morale, mais j’ai fini par envoyerune lettre disant qu’il fallait qu’il surveille ses troupes parce que c’est pasnormal, c’est pas normal. Deux témoignages qui sont hors cadre, c’estdégueulasse quoi, ça témoigne aussi de ce qu’elle a pu faire là en termes deprocédure quoi. C’est tout faire pour me rabaisser quoi.25
41 Comme Ludovic, Adrien explique être contraint par les circonstances à agir d’une façon
qu’il dit ne pas approuver. Il se déresponsabilise donc de ses choix et de ses
comportements en faisant porter la faute à son ex-conjointe et aux personnes qu’il
associe à ses soutiens. Ici les actions de l’ex-conjointe sont interprétées comme ayant
pour unique but de lui nuire. Il interprète donc la procédure judiciaire comme un
procès contre sa personne et considère qu’il est contraint à se défendre par tous les
moyens du fait des attaques qu’il subit. La responsabilité de la situation est donc
entièrement portée au compte de son ex-conjointe.
42 Les observations que j’ai menées dans les permanences d’accueil de plusieurs
associations m’ont permis de voir que les animateurs conseillent systématiquement
d’accumuler les éléments concrets pouvant être utilisés dans la construction d’un
dossier, notamment les témoignages. Par exemple, lors de la permanence d’une
association :
(11) [L’animateur] conseille d’essayer de « cumuler les bons points ». […]Il conseille au père de faire appel à des amis qui peuvent éventuellementtémoigner en sa faveur ou contre la mère. L’important étant de montrer que« le souci, c’est madame » et de faire attention à ne pas donner une imageconflictuelle.26
GLAD!, 04 | 2018
92
43 Il apparaît ici que les mêmes pratiques sont considérées comme déloyales lorsqu’elles
émanent des femmes et vont contre les intérêts des hommes, mais justifiées et
recommandées lorsqu’elles les servent.
Conclusion
44 Il est important d’indiquer que les militants cités ici se considèrent comme modérés sur
la question des rapports entre femmes et hommes : à plusieurs reprises, dans les
entretiens, ils insistent sur le fait qu’ils ne veulent pas renvoyer hommes et femmes dos
à dos et qu’ils déplorent certaines expressions des inégalités de genre. Ils considèrent
d’ailleurs appartenir à des associations modérées se démarquant de celles qui dénigrent
les femmes. Ils jugent ces dernières en partie responsables de la mauvaise image qu’ont
les pères et leurs associations. L’association locale dans laquelle militent Ludovic et
Adrien met en place des processus de médiation familiale et considère donc lutter
contre les conflits. Il en va de même pour le G-E-S qui se présente comme un groupe
d’étude, s’octroyant un statut d’expert légitime, comme tel non partisan et neutre sur
les questions dont il traite.
45 En mettant en relation les différents discours étudiés ici on observe une circulation des
arguments et des outils rhétoriques entre associations françaises. Ce résultat tend à
confirmer les travaux décrivant cet ensemble d’associations comme un mouvement
cohérent avec des analyses, des arguments et des revendications communes, y compris
dans les associations se considérant comme modérées sur ces questions. Cet article
rappelle donc que les associations françaises pour la cause des pères appartiennent
pleinement au mouvement masculiniste et il permet de mettre en avant la
déresponsabilisation constante qui est opérée par ces hommes, pour eux-mêmes mais
aussi pour l’ensemble des hommes.
46 Les principales stratégies rhétoriques ont ainsi pour effet de diluer la responsabilité
individuelle et collective des hommes en les faisant apparaître comme des victimes de
discriminations basées sur le genre (masculin) et non plus comme les acteurs, auteurs
et bénéficiaires principaux du patriarcat. La position de victime et le renversement
rhétorique du rapport de domination permettent de construire des explications
générales et de situer les causes des problèmes rencontrés à l’extérieur du champ
d’action du groupe des hommes et des individus qui le composent ; les femmes en
général et les féministes en particulier étant alors tenues pour responsables de la
plupart de ces problèmes. Cette rhétorique permet également de définir les problèmes
rencontrés par ces individus comme relevant de questions politiques et sociales. Aussi,
au-delà de la défense de cas individuels, peuvent-ils s’autoriser à formuler des
revendications générales visant à sauvegarder ou renforcer la position dominante dans
laquelle se trouve le groupe des hommes cis-genre dans la société patriarcale actuelle.
GLAD!, 04 | 2018
93
BIBLIOGRAPHIE
BARD, Christine (éd.). 1999. Un siècle d’antiféminisme. Paris : Fayard.
CHAMPAGNE, Clara, PAILHE, Ariane & SOLAZ, Anne. 2015. « Le temps domestique et parental des
hommes et des femmes : quels facteurs d’évolutions en 25 ans ? » Économie et Statistique [En ligne],
478-480, consulté le 13 juin 2018. URL : www.persee.fr/doc/
estat_0336-1454_2015_num_478_1_10563
DEVREUX, Anne-Marie. 2004a. « Autorité parentale et parentalité » Dialogue [En ligne], 165(3),
consulté le 13 juin 2018. URL : https://www.cairn.info/revue-dialogue-2004-3-page-57.htm.
DEVREUX, Anne-Marie. 2004b. Les résistances des hommes au changement. Paris : L’Harmattan.
DEVREUX, Anne-Marie & LAMOUREUX, Diane. 2012. « Les antiféminismes : une nébuleuse aux
manifestations tangibles » Recherches féministes [En ligne], 25(1), consulté le 13 juin 2018. URL :
http://id.erudit.org/iderudit/1011113ar
DUPUIS-DERI, Francis & BLAIS Mélissa (éds.). 2015 [2008]. Le mouvement masculiniste au Québec :
l’antiféminisme démasqué. Montréal : Les Éditions du remue-ménage.
DUPUIS-DERI, Francis et LAMOUREUX, Diane (éds.). 2015. Les antiféminismes : analyse d’un discours
réactionnaire. Montréal : Les Éditions du Remue-ménage.
FILLOD-CHABAUD, Aurélie. 2016. « Les usages du droit par le mouvement des pères séparés. Une
comparaison France-Québec » Genre, sexualité et société [En ligne], 15, consulté le 13 juin 2018.
URL : http://journals.openedition.org/gss/3746
FILLOD-CHABAUD, Aurélie. 2014. « Au nom du père ». Une sociologie comparative du militantisme paternel
en France et au Québec. Thèse de doctorat en Sciences politiques et sociales. Florence : Institut
Universitaire Européen.
GUILLONEAU, Maud & MOREAU, Caroline. 2013. La résidence des enfants de parents séparés De la demande
des parents à la décision du juge. France : Ministère la Justice, direction des affaires civiles et du
sceau.
KAYE, Miranda & TOLMIE, Julia. 1998. « Discoursing dads: The rhetorical devices of father’s rights
groups » Melbourne University Law Review, 22 : 162-194
LE COLLECTIF ONZE. 2013. Au tribunal des couples : enquête sur des affaires familiales. Paris : Odile Jacob.
LEFORT, Étienne. 2017. « Qui parle, et de quoi, dans les groupes de paroles des associations pour le
"droit des pères" ? » Communication au colloque Antiféminismes et masculinismes d’hier et
aujourd’hui, GEDI, réqef, CNRS-FRE, Angers.
LEPORT, Édouard. À paraître. Les usages de la parole des enfants et des femmes par les associations pour le
« droit des pères ». Rennes : PUR.
COLLIER, Richard & SHELDON, Sally (eds.). 2006. Fathers’ rights activism and law reform in comparative
perspective. Oxford : Hart
THIERS-VIDAL, Léo. 2007. De « L’ennemi principal » aux principaux ennemis : position vécue, subjectivité et
conscience masculines de domination. Thèse de doctorat en sociologie. Paris : École normale
supérieure.
GLAD!, 04 | 2018
94
THIERS-VIDAL, Léo. 2010. De « l’ennemi principal » aux principaux ennemis : position vécue, subjectivité et
conscience masculines de domination. Paris : L’Harmattan.
ANNEXES
Sitographie
[a] http://www.g-e-s.fr/base-de-documentation/qui-nous-sommes/ consulté le
06-03-2018.
[b] http://la-cause-des-hommes.com/spip.php?article5 consulté le 06-03-2018.
[c] http://la-cause-des-hommes.com/ consulté le 06-03-2018.
[d] http://www.g-e-s.fr/base-de-documentation/qui-nous-sommes/ consulté le
06-03-2018.
[e] http://www.g-e-s.fr/base-de-documentation/plate-forme-de-propositions-
maj-2016/ consulté le 06-03-2018.
[f] http://www.g-e-s.fr/base-de-documentation/dossiers/dossier-divorces-separations-
residence-des-enfants/ consulté le 06-03-2018.
NOTES
1. Cela a notamment été le cas lors de l’escalade d’une grue de chantier naval par Serge Charnay,
à Nantes en février 2013, ou lors des débats autour de la « loi famille » en 2014.
2. BARD, Christine (dir.). 1999. Un siècle d’antiféminisme. Paris : Fayard, p. 22.
3. BLAIS, Melissa et DUPUIS-DÉRI, Francis (dir.). 2015. Le mouvement masculiniste au Québec :
l’antiféminisme démasqué. Québec : Les Éditions du remue-ménage, p. 16.
4. Ibid., p. 17.
5. Ibid., p. 20.
6. THIERS-VIDAL, Léo. 2007. De « L’ennemi principal » aux principaux ennemis : position vécue, subjectivité
et conscience masculines de domination. Thèse de doctorat en sociologie. Paris : École normale
supérieure, p.189.
7. DEVREUX, Anne-Marie & LAMOUREUX, Diane. 2012. « Les antiféminismes : une nébuleuse aux
manifestations tangibles » Recherches féministes 25(1), p. 3 ; DUPUIS-DÉRI, Francis & LAMOUREUX,
Diane (dir.). 2015. Les antiféminismes : analyse d’un discours réactionnaire. Québec : Les Éditions du
remue-ménage ; DEVREUX, Anne-Marie. 2004. Les résistances des hommes au changement. Paris :
L’Harmattan ; FILLOD-CHABAUD, Aurélie. 2014. « Au nom du père ». Une sociologie comparative du
militantisme paternel en France et au Québec. Thèse de doctorat en sciences politiques et sociales.
Florence : Institut Universitaire Européen.
8. Le sexisme étant défini comme une attitude discriminatoire basée sur le sexe, il n’est pas
nécessaire de le mettre au pluriel pour, éventuellement, traiter de discriminations qui
concerneraient les hommes. Cet usage du pluriel par l’association révèle le caractère
fondamentalement essentialiste de sa pensée et sert à discréditer, pour « manque de nuance »
l’utilisation du terme de sexisme au singulier. Cette utilisation permet également de symétriser
rhétoriquement les situations des femmes et des hommes dans la société actuelle, donc de nier
ou minimiser la domination patriarcale exercée par les hommes sur les femmes.
GLAD!, 04 | 2018
95
9. COLLIER, Richard & SHELDON, Sally (dir.). 2006. Fathers’ rights activism and law reform in comparative
perspective. Oxford: Hart.
10. KAYE, Miranda & TOLMIE, Julia. 1998. « Discoursing dads: The rhetorical devices of father’s
rights groups » Melbourne University Law Review 22: 162-194.
11. FILLOD-CHABAUD, Aurélie. 2014. « Au nom du père ». Une sociologie comparative du militantisme
paternel en France et au Québec, op. cit. LEFORT, Étienne. 2017. « Qui parle, et de quoi, dans les
groupes de paroles des associations pour le "droit des pères" ? » Communication au colloque
Antiféminismes et masculinismes d’hier et aujourd'hui, GEDI, RéQEF, CNRS-FRE, Angers. LEPORT,
Édouard. À paraître. Les usages de la parole des enfants et des femmes par les associations pour le « droit
des pères ». Rennes : PUR.
12. DEVREUX, Anne-Marie. 2004. « Autorité parentale et parentalité » Dialogue 165(3) : 57‑68.
13. Voir par exemple Sos Papa Yvelines ou le Collectif La Grue Jaune.
14. FILLOD-CHABAUD, Aurélie. 2016. « Les usages du droit par le mouvement des pères séparés. Une
comparaison France-Québec » Genre, sexualité et société [En ligne], 15, consulté le 13 juin 2018.
URL : http://journals.openedition.org/gss/3746
15. Les prénoms et les éléments permettant de reconnaître les personnes ont été modifiés.
16. André, animateur de permanences, divorcé, 2 enfants, 44 ans, cadre du privé.
17. Ludovic, membre actif, divorcé, 3 enfants, 38 ans, fonctionnaire.
18. Romeo, président et fondateur de l’association, divorcé, 2 enfants, 40 ans, sans emploi.
19. LE COLLECTIF ONZE. 2013. Au tribunal des couples : enquête sur des affaires familiales. Paris : Odile
Jacob.
20. GUILLONEAU, Maud & MOREAU, Caroline. 2013. La résidence des enfants de parents séparés. De la
demande des parents à la décision du juge. France : Ministère la Justice, direction des affaires civiles
et du sceau.
21. Ludovic, membre actif, divorcé, 3 enfants, 38 ans, fonctionnaire.
22. André, animateur de permanences, divorcé, 2 enfants, 44 ans, cadre du privé.
23. LE COLLECTIF ONZE. 2013. op. cit. p. 179.
24. CHAMPAGNE, Clara, PAILHÉ, Ariane & SOLAZ, Anne. 2015. « Le temps domestique et parental des
hommes et des femmes : quels facteurs d’évolutions en 25 ans ? » Économie et Statistique [En ligne],
478-480, consulté le 13 juin 2018. URL : www.persee.fr/doc/
estat_0336-1454_2015_num_478_1_10563
25. Adrien, membre actif chargé de la recherche de subvention, divorcé, 3 enfants, 48 ans, cadre
du privé.
26. Notes personnelles, observation n°5.
RÉSUMÉS
Cet article met en regard les arguments de plusieurs associations pour les droits des pères afin
d’analyser la rhétorique de la partie la plus active du mouvement masculiniste français. En
étudiant conjointement les écrits d’une association se présentant comme un groupe d’étude et les
entretiens réalisés avec des militants d’autres associations tenant des permanences d’accueil, il
s’agit de faire apparaître les points communs dans les stratégies discursives des différents acteurs
de ce mouvement. La réappropriation de la question de l’égalité entre les sexes et la critique de la
justice des affaires familiales constituent les vecteurs privilégiés d’un discours antiféministe qui
GLAD!, 04 | 2018
96
autorise et alimente une dynamique de déresponsabilisation, individuelle et collective, des
hommes.
This article compares the arguments of several associations defending fathers’ rights in order to
study the rhetorics of the most active part of the French masculinist movement. By studying
together the writings of an association presenting itself as a study group and interviews made
with activists from other associations holding group meetings, this paper reveals the common
ground in the discursive strategies of the different actors of this movement. The appropriation of
the question of sex equality and the criticism of the family justice system are means to convey an
anti-feminist discourse which fuels a dynamic of individual and collective unaccountability for
men.
INDEX
Thèmes : Recherches
Keywords : masculinism, antifeminism, fathers’ rights, unaccountability, rhetoric, discourse
studies
Mots-clés : masculinisme, antiféminisme, droit des pères, déresponsabilisation, rhétorique,
étude de discours
AUTEUR
ÉTIENNE LEFORT
CRESPPA-CSU – Paris 8
Étienne Lefort, doctorant en sociologie dans l’équipe Cultures et Sociétés Urbaines du Centre de
Recherches Sociologiques et Politiques de Paris (CRESPPA-CSU) et de l’université Paris 8 mène
actuellement une thèse sur les mouvements masculinistes en France et plus précisément sur les
associations défendant les droits des pères. Il a notamment prononcé une communication
intitulée « Qui parle, et de quoi, dans les groupes de paroles des associations pour le "droit des
pères" ? » lors du colloque Antiféminismes et masculinismes d’hier et aujourd’hui, co-organisé par le
GEDI, RéQEF, CNRS-FRE, à Angers les 3 et 4 mars 2017. Il a également organisé et participé à la
table ronde « L’actualité des mobilisations avec et contre le genre » dans le cadre du colloque
international organisé par le CRESPPA Pensées critiques du genre : travail, corps, nation à Paris les 17,
18 et 19 mai 2017.
GLAD!, 04 | 2018
97
L’antiféminisme d’ÉtatUne analyse rhétorique du mouvement des pères séparés au Québec
State Antifeminism. A Rhetorical Analysis of the Fathers’ Rights’ Movement in
Québec
Aurélie Fillod-Chabaud
1 À partir des années 19701, des mouvements « masculinistes », qui déclarent défendre la
« condition masculine », se sont érigés en opposition aux revendications d’égalité de la
deuxième vague du mouvement féministe. Le militantisme paternel — ou mouvement
des pères séparés — est un mouvement social qui émerge au sein de ces mobilisations et
qui se focalise sur la place des pères en situation de post-conjugalité. Si le masculinisme
s’enracine dans une offensive globale dirigée contre le féminisme dans toutes les
strates de la société, le mouvement des pères séparés s’ancre plus spécifiquement dans
une contestation des mutations familiales. Dans un contexte de massification des
divorces, les nouvelles configurations familiales sont dénoncées : l’enfant est au cœur
de ces conflits et ses droits sont mis en avant dans les discours tenus. Les pères
s’engagent ainsi dans une lutte qu’ils disent mener au nom de leurs enfants et
formulent des revendications en matière de garde, présentées comme « égalitaires ».
De même, la féminisation de certaines professions, l’arrivée des femmes en politique et
la transformation des normes conjugales et sexuelles sont perçues comme des menaces
à l’équilibre non plus seulement familial, mais plus largement sociétal. Les fondateurs
de ce mouvement assimilent en effet les changements survenus depuis les années 1960
dans la sphère privée (diffusion de la cohabitation hors mariage ; banalisation du
divorce et des unions successives ; multiplication des familles monoparentales et
recomposées et mutation des rôles féminins au sein de la cellule familiale) à une remise
en cause profonde de la condition masculine et paternelle. Ce mouvement remet en
cause l’intervention de l’État dans la sphère privée en visant à délégitimer les
institutions en charge de réguler les séparations conjugales. Plus fondamentalement,
c’est la mise en concurrence de l’autorité paternelle avec celle de l’État qui est
dénoncée, au regard de l’augmentation croissante de l’intervention de la puissance
publique dans la sphère privée depuis la fin du XIXe siècle. La fin de la « puissance »
paternelle, c’est-à-dire la fin du monopole masculin des droits et des devoirs au sein de
GLAD!, 04 | 2018
98
la sphère familiale, coïncide avec une augmentation du contrôle étatique des
pratiques parentales visant la surveillance étroite des pères (Dulac et Lefaucheur 1997)
puis des mères (Cardi 2010). Ce constat est valable aussi bien pour la France — les
travaux sur l’histoire sociale du contrôle des familles le montrent bien (Badinter 1980 ;
Donzelot 2005 ; Knibiehler 1987) — que pour le Québec (Fish 2004), province à l’étude
dans cet article (cf. encadré méthodologique).
Encadré méthodologique : présentation des matériaux mobilisés dans cet article
Cet article se fonde sur une enquête de terrain réalisée dans le cadre de ma thèse de
doctorat sur le militantisme paternel en France et au Québec (2008-2012). 14 associations
ont été rencontrées et étudiées, 5 en France et 9 au Québec au sein desquels une soixantaine
d’entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les présidents et les membres des groupes.
Cet article ne se concentre que sur le cas québécois et plus spécifiquement sur le groupe
nommé l’Après-rupture. Ne seront mobilisés que les matériaux utiles à l’analyse du
positionnement du groupe sur les mouvements féministes (entretiens avec les président et
fondateur, analyse des lettres ouvertes sur le site Internet du groupe).
2 Cet article s’ancre dans une sociologie politique de l’État et du féminisme. À travers la
notion d’antiféminisme d’État2, il s’agit d’analyser la manière dont les pratiques
d’interventions étatiques sont perçues par les groupes de pères séparés comme une
forme de déconsidération de la masculinité. À la lumière de la littérature franco-
québécoise sur le féminisme d’État (Revillard 2016), je développerai les spécificités de la
rhétorique antiféministe au sein des groupes québécois. En accord avec F. Dupuis-Déri
et M. Blais (Blais & Dupuis-Déri 2014), je ne défends en aucun cas une exception
française en matière d’antiféminisme3 : loin d’être moins corrosif, voire inexistant, il
est aussi virulent au sein des groupes français mais se décline différemment de
l’antiféminisme québécois. Dans ma thèse de doctorat (Fillod-Chabaud 2014), j’ai
montré que l’espace de la cause des femmes (Béréni 2012) et les institutions du
féminisme sont davantage ciblés par les groupes de pères séparés québécois du fait de
leur institutionnalisation plus forte au sein de l’appareil d’État (Revillard 2016). Je
reprends ce constat à mon compte, dans cet article.
3 Dès lors, si l’antiféminisme se concentre davantage, au sein des groupes français, sur la
critique de la féminisation des grands corps d’État (magistrature), au Québec, il gravite
autour des institutions qui ont été créées depuis les années 1970 afin de mettre fin aux
inégalités de genre (I). J’y vois un « antiféminisme d’État » puisqu’il s’attaque
directement aux institutions du féminisme, comme l’illustreront les lettres ouvertes
publiées par le groupe L’Après-rupture (II). La fonction de cette rhétorique antiféministe
est de décrédibiliser les institutions en faveur de l’égalité en adoptant une posture
victimaire auprès des pouvoirs publics (III) : le féminisme d’État est accusé d’œuvrer en
défaveur des hommes.
Aux origines du militantisme paternel : le féminismed’État
4 Au Québec, le féminisme d’État, c’est-à-dire l’institutionnalisation de la cause des
femmes, prend originellement la forme d’une structure duale : le Conseil du statut de la
femme et le Secrétariat à la condition féminine constituent, depuis le début des années
GLAD!, 04 | 2018
99
1970, la « base d’une politique suivie et solidement ancrée dans l’appareil d’État. »
(Revillard 2016). Le mouvement masculiniste, auquel le mouvement des pères séparés
appartient, émerge à ce moment-là, en réponse à la création du Conseil du statut de la
femme. Un Conseil du statut de l’homme4 est créé par le groupe Égalitariste afin de
dénoncer les discriminations dont les hommes feraient l’objet.
5 Cette contestation à l’égard d’institutions d’État n’est pas propre à la province
québécoise : des groupes masculinistes américains et européens expriment également
un mécontentement à l’encontre de la régulation judiciaire des séparations conjugales.
À titre d’exemple, dans son analyse de la rhétorique des groupes de pères américains, la
sociologue Jocelyn E. Crowley remarque que les membres des groupes ont le sentiment
d’être les « perdants » du divorce, notamment dans le cas du divorce pour faute lorsque
la responsabilité des époux dans l’échec du mariage est engagée : selon eux, la garde de
leurs enfants leur serait restreinte suite au jugement de divorce (Crowley 2008).
6 Plus largement, ce constat est visible au Canada. Dans son analyse de la consultation
des groupes de pères canadiens au moment du vote de la loi sur le divorce de 1985, le
sociologue québécois Germain Dulac perçoit cette même position face à la justice : les
pères se sentent victimes d’un système accusé de ne pas les protéger. D’autres
institutions les discrimineraient également : les structures d’aide sociale offriraient,
par exemple, davantage de services et de facilités aux femmes qu’aux hommes (par
exemple, les maisons pour femmes battues, les services de santé en direction des
femmes, etc.) (Dulac 1989). Ces groupes accusent les services sociaux d’encourager les
femmes à prendre l’initiative des procédures de divorce, afin de se débarrasser d’un
homme dont la fonction de pourvoyeur serait facilement remplacée par les aides
sociales de l’État (cf. infra).
7 Ce positionnement face à l’institution judiciaire accusée d’être surféminisée ou face au
législateur « pro-femme » est commun aux groupes de pères. En France c’est la justice
familiale qui est au cœur de cette critique et plus particulièrement la féminisation de ce
corps de l’État. Les décisions de justice attribuant majoritairement la résidence des
enfants aux mères sont dénoncées comme étant une démarche volontaire de la part des
femmes juges afin de punir les pères qu’elles considéreraient comme incapables
d’élever des enfants. Ces critiques se soucient peu des études qui montrent que le sexe
du juge n’influe pas la décision de justice (Le Collectif Onze 2013, p.157-158) et que
l’attribution massive de la résidence des enfants chez leurs mères est le fait d’une
volonté commune des deux parents et non du juge lui-même (Le Collectif Onze 2013 ;
Guillonneau & Moreau 2013)5. Au Québec, le corps de la magistrature est bien moins
féminisé qu’en France6 : parmi l’ensemble des juges de la Cour supérieure du Québec,
32 % sont des femmes (Biland & Schütz 2014). L’argument de la surféminisation de la
magistrature n’est donc pas, de fait, saisi par les groupes de pères. Il s’agit plutôt, côté
québécois, de dénoncer les institutions d’État en faveur du féminisme, dans leur
ensemble.
GLAD!, 04 | 2018
100
Une rhétorique centrée sur les institutions d’État. Uneanalyse des lettres ouvertes publiées par le groupe L’Après-rupture (2000-2010)
8 « Partez mes fils, il doit encore exister en ce monde un pays où le respect de la vie des
hommes existe, où la justice ne soit pas genrée, où les pères ne sont pas des valeurs
négligeables. » Cette recommandation, formulée par le président de L’Après-rupture,
conclut une de ses nombreuses lettres ouvertes publiées sur le site Internet du groupe,
destinées à dénoncer les diverses manifestations du féminisme d’État auprès des
représentants politiques du Québec.
9 L’Après-rupture est un groupe québécois créé en 1996 par Gilbert Claes, un père séparé
gestionnaire d’une agence de voyages, qui s’inscrit dans la catégorie des réseaux
partisans développée dans ma thèse7. Présidé au moment de l’enquête, en 2011, par
Jean-Claude Boucher, le groupe, à la santé financière fragile, proposait difficilement à
l’époque une réunion-atelier par mois dans un restaurant. Contrairement à des groupes
tels que Fathers 4 Justice qui fondent leur mobilisation sur des actions spectaculaires et
médiatisées, L’Après-rupture est un groupe qui concentre son action sur la diffusion de
lettres ouvertes, et ce principalement au début des années 2000. L’Après-rupture est un
des représentants de la cause paternelle québécoise produisant le plus d’écrits sur leur
cause et les ennemis qu’elle combat. S’il est difficile d’évaluer son audience auprès des
pères séparés — le fichier des adhérents ne nous a pas été communiqué — ce groupe est
toutefois très visible au sein du paysage québécois du militantisme paternel. L’analyse
des lettres ouvertes présentes sur le site Internet du groupe8 et écrites sur une période
de dix ans environ constitue à ce titre un matériau pertinent pour analyser les
principaux arguments de l’antiféminisme d’État.
10 « Le féminisme d’État est la vache à lait qui nourrit l’industrie du mensonge féministe
et de la victimisation des femmes ». Selon Jean-Claude Boucher, les institutions en
charge de la régulation des séparations conjugales, de la lutte contre les violences
domestique et de l’aide à la petite enfance, organiseraient la fin du socle familial uni et
provoqueraient un malaise général au sein de la condition masculine : les pères privés
d’enfants se suicideraient de désespoir et les garçons privés de leurs pères tomberaient
dans la délinquance ou « la déviance sexuelle ». « On a quatre suicides par jour au
Québec, un des records mondial. C’est le résultat de trente ans de propagande haineuse
contre les hommes aux Québec », explique-t-il ainsi en entretien.
11 Selon L’Après-rupture, les institutions gaspilleraient l’argent public et pervertiraient les
Québécoises en créant des offres institutionnelles (maisons femmes battues, etc.) dont
elles n’auraient en fait pas besoin.
Il y a sept millions de Québécois... qui ne bénéficient en rien du Conseil dustatut de la femme ou du Secrétariat à la condition féminine... et qui paientpour les distorsions sociales causées par ces organismes sexistes d’état, quipaient en taxes et impôts, en destruction des familles, en taux de natalité à labaisse, en délinquance juvénile, en perte d’emploi... Monsieur le premierministre, permettez enfin aux femmes ordinaires d’être.Elles n’ont pas besoin des boucliers fallacieux d’une poignée de“protectrices” intéressées aux pouvoirs parallèles, aux honneurs et surtoutaux emplois communautaires très bien rémunérés à même nos taxes à tous.(…) Monsieur le premier ministre, le Conseil du statut de la femme et le
GLAD!, 04 | 2018
101
Secrétariat à la condition féminine doivent disparaître comme tout ce qui estféminisme d’état ; la justice et l’équité doivent être votre première priorité.(Lettre ouverte, adressée au Premier ministre, 2004).
12 Ainsi, selon ce groupe, les institutions en charge de faire respecter l’égalité ne
devraient en aucun cas produire une distinction genrée, en ne s’adressant qu’aux
femmes. Les organismes en leur direction seraient même, selon le président de L’Après-
rupture, à l’origine de nouveaux maux au sein de la condition féminine. Les femmes
« ordinaires » n’auraient en aucun cas besoin de bénéficier de services spécifiques, car
elles bénéficieraient de « justice » et d’« équité », au même titre que les hommes.
13 Par contraste, si de l’argent public est alloué à des maisons d’accueil pour violences
conjugales, aucun fond ne serait attribué pour traiter le suicide des hommes. Le
président de L’Après-rupture déclare être le seul organisme québécois à venir en aide
aux hommes suicidaires. En ne subventionnant pas le groupe, l’État saperait
volontairement son action envers les hommes :
Dernièrement, L’Après-rupture a dû mettre fin à sa ligne d’écoutetéléphonique d’urgence sans frais faute de financement, ligne téléphoniquequi était leur seul canal de communication par lequel des centaines de pèresen crise pouvaient à coup sûr, trouver une oreille masculine. Pourquoi l’Étatmet-il régulièrement des bâtons dans les roues à L’Après-rupture lorsqu’ils’agit de subventions ou de consultations (…) ? Pourquoi est-il toujours sicompliqué pour des regroupements de gars d’obtenir le moindre petitfinancement lorsqu’il s’agit d’aider des centaines de pères qui envisagent dese pendre après un divorce ? Pourquoi l’État favorise-t-il le taux grandissantd’enfants orphelins en refusant systématiquement d’aider financièrement leseul recours totalement masculin qui pourrait véritablement éviter desdrames humains paternels ? La masculinité serait-elle une maladie honteuseau Québec ?
14 Selon Jean-Claude Boucher, le financement massif de centres d’accueil pour femmes
battues et de campagnes de prévention contre les violences faites aux femmes
engendrerait une offre si dense qu’il n’y aurait pas assez de « demandes ». « Ma fille a
travaillé dans un centre pour femmes battues. Elle m’a dit : “papa, tous ces centres ils
sont vides ! Y a trop de lits pour le nombre de femmes qui viennent après des violences
conjugales !”. Moi après j’ai fait ma petite enquête : l’État lance toujours des
financements supplémentaires pour ces centres et du coup ils inventent des chiffres ! Y
doit y avoir 10 % de leurs centres qui sont occupés ! ». Cette dénonciation9 est mise en
balance avec l’absence de financements en direction des hommes censés être victimes
de violences conjugales en égale mesure. L’argument de la symétrisation de la violence,
chère au mouvement masculiniste, entre donc en résonnance avec une
décrédibilisation des services de l’État en charge des violences conjugales. C’est
notamment en contestant les enquêtes statistiques sur les violences faites aux femmes,
accusées d’être dirigées par des lobbies féministes vivant de « l’industrie des violences
conjugales » (Collectif Stop Masculinisme10 2013 : 38), qu’est relativisée la violence
masculine : les femmes aussi battraient leur conjoint et dans des proportions quasi
équivalentes aux hommes. En France au début des années 2000, l’enquête ENVEFF,
première enquête statistique réalisée dans le pays sur le thème des violences
conjugales, a ainsi déclenché une polémique relative à la méthode utilisée, afin d’en
contester les principaux résultats. Les principaux arguments avancés sont ainsi
résumés par le Collectif Stop Masculinisme (2013) : tout d’abord les plaintes d’hommes
GLAD!, 04 | 2018
102
envers des femmes violentes ne seraient jamais enregistrées par la police ; ensuite, les
violences subies par les hommes seraient moins visibles (violences psychologiques) ;
enfin, les femmes contraindraient les hommes à la violence physique pour ensuite en
faire un outil de chantage afin d’obtenir le divorce ou encore la garde des enfants. Or,
plus récemment, l’enquête Virage réalisée notamment par l’INED a bien pris en compte
la variable masculine dans le cadre de la collecte de données réalisée en 2015 auprès de
25 000 personnes (50 % de femmes, 50 % d’hommes) âgées de 20 à 69 ans. Les premiers
résultats de l’enquête publiés à la fin de l’année 2016 sur les viols et agressions
sexuelles montrent que malgré la prise en compte des violences faites aux hommes, les
femmes restent les principales victimes de ce type de violences11. Ces stratégies de
symétrisation de la violence, analysées notamment par Cardi et Pruvost dans leur
ouvrage sur la violence des femmes (Cardi & Pruvost 2012) consistent ainsi à banaliser
la violence des hommes faite aux femmes, mais participent également à la
déconstruction des valeurs masculines attachées au pater familias : les pères auraient les
mêmes souffrances que les mères.
15 Bien sûr, la place de l’État dans la régulation des séparations conjugales est également
dénoncée. Dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Justice du Québec en
janvier 2004, le président de L’Après-rupture déplore le fait que ce ministère ne finance
pas « le seul organisme qui tente de conserver des liens significatifs entre les pères
divorcés/séparés et leurs enfants, et qui lutte par voie de conséquence contre la
délinquance juvénile de façon directe ». Dans la lignée d’une littérature
« pathologisant » l’absence des pères et ses conséquences sur les enfants et, de la même
façon, sur la société (Bly 1992 ; Corneau 1989 ; Mitscherlich 1969), la dénonciation des
conséquences du divorce est constitutive de la dénonciation du féminisme d’État. En ne
subventionnant pas la cause paternelle, l’État favoriserait la délinquance juvénile ou
encore le chômage.
16 Enfin, la mixité scolaire et la surféminisation de l’éducation se retrouvent également
dans le collimateur de l’antiféminisme d’État. Selon le groupe étudié ici, l’institution
scolaire serait pensée par des femmes, pour des petites filles : « tant et aussi longtemps
que les petits enfants seront dans des garderies (d’État ou privées) et que ces garderies
seront faites en fonction des petites filles, et pour les petites filles, et gérées par des
femmes, les garçons y seront castrés, privés de leur nature masculine, privés de leur
besoin de bouger, d’explorer le monde qui les entoure, de tester leur agressivité, de
combattre, de risquer, ils n’auront pas d’avenir... » (lettre ouverte publiée en 2006). La
solution proposée par le groupe est la fin de la mixité et la création d’écoles pour
garçons. La mixité conduirait en effet les garçons à être catégorisés comme potentiels
agresseurs, tandis que les filles ne seraient jamais inquiétées pour leur violence
physique : « dans les écoles, les filles peuvent exciter les garçons, les harceler ou même
les violenter sans conséquences, et s’ils s’en défendent, ils seront punis et considérés
comme des criminels en puissance, des violents, des semences de prison... ». Le groupe
associe ainsi la surféminisation de l’institution scolaire, c’est-à-dire le fait que les
postes soient essentiellement occupés par des femmes, non seulement à un traitement
défavorisé des garçons, mais aussi au reniement des besoins biologiques que
constituerait leur nature masculine. « Dès la naissance, les garçons sont plus physiques,
moins attentifs et se mettent immédiatement à leur tâche d’exploration, d’essais, de
tentatives. Des tits-gars, c’est plus actif, moins attentif, plus faiseur de mauvais coups.
Les féministes tentent de nous convaincre que cette différence n’existe pas et que
GLAD!, 04 | 2018
103
toutes sortes de causes extérieures à l’enfant rendent les tites-filles différentes des tits-
gars » (lettre ouverte en date du 6 avril 2006). C’est ainsi à proprement dit la théorie de
la nature qui serait reniée par l’institution scolaire au profit de la théorie de la culture.
Le groupe demande ainsi à ce que cette institution revienne à des valeurs éducatives
traditionnelles : la non-mixité des écoles et la prise en compte de ce qu’ils appellent des
besoins physiologiques des individus et non des comportements en lien avec la
construction sociale et genrée des enfants. Cette rhétorique sur la surféminisation de
l’institution scolaire fait écho au débat plus large en faveur de la fin de la mixité
scolaire, défendu par des psychologues et intellectuels s’inscrivant dans la pensée
masculiniste. Ce même phénomène s’est produit en France puisque dans les années
2000, des ouvrages masculinistes en faveur de la défense des intérêts de petits garçons
ont vu le jour (Auduc 2009 ; Clerget 2001, 2005), en réaction à une série de publications
survenue au début des années 1990 encourageant les filles, suite à l’explosion de leur
intégration sur le marché scolaire depuis les années 1960, à choisir des carrières
universitaires plus valorisées, telles que les sciences ou la médecine (Baudelot &
Establet 1992 ; Duru-Bellat 1990).
17 Sur ces différents points, l’État — au Québec comme en France — est attaqué pour le
traitement différencié qu’il opèrerait envers ses administrés. L’État est accusé de
s’investir financièrement tout d’abord dans la cause des femmes et non des hommes. Il
est également accusé de ne pas accorder de l’importance aux conséquences sociétales
qu’auraient les ruptures de lien entre pères et enfants. L’État serait à la tête d’une vaste
entreprise de féminisation de ses institutions, qui engendrerait un mal-être masculin
qui toucherait toutes les générations d’hommes dans la société. Dénoncer l’illégitimité
de l’État à réguler la famille permet d’amorcer, on va le voir, la recherche de
reconnaissance d’un problème public auprès notamment du législateur.
Se dire « victimes » du féminisme d’Etat : une armecontre la remise en cause des rapports de domination
18 Dans leur article sur la rhétorique des groupes de pères, les sociologues américaines
Miranda Kaye et Julia Tolmie analysent la revendication du statut de victime comme un
des faits saillants de cette rhétorique. Les pères séparés seraient soit victimes du
féminisme et de la féminisation des institutions d’État, soit du système judiciaire, soit
de violences conjugales (Kaye & Tolmie 1998 : 173).
19 Pourquoi revendiquer ce statut de victime ? Ce postulat s’apparente à mon sens à une
lutte contre la remise en cause de la domination masculine. La victimisation n’est pas
circonscrite à la question du divorce, mais est utilisée dans de nombreux domaines, dès
lors que la légitimité de la domination des hommes est questionnée (Dulac 1989). Cette
stratégie discursive est notamment adoptée, on l’a vu, dans une démarche de
« symétrisation » : les hommes seraient, au même titre que les femmes victimes de
violences conjugales ou de fausses accusations.
20 Selon des groupes rencontrés au Québec tels que L’Après-rupture ou L’Association des
nouvelles conjointes du Québec12, deux principaux facteurs expliqueraient la
méconnaissance des violences conjugales faites aux hommes auprès de l’opinion
publique. Premièrement, les femmes auraient tendance à s’automutiler et à porter
plainte pour violence afin d’obtenir plus facilement le divorce et des aides sociales
(possibilité, par exemple, d’accéder à un logement d’urgence avec les enfants). Les
GLAD!, 04 | 2018
104
plaintes seraient donc majoritairement la conséquence de fausses allégations.
Deuxièmement, les hommes qui sont battus ou menacés par leur femme n’oseraient pas
porter plainte ou en parler à cause de leur fierté « masculine » et leur difficulté à se
confier. Le peu d’hommes qui se prêterait au jeu du dépôt de plainte serait dissuadé par
les autorités policières et ferait l’objet de railleries.
21 Les fausses allégations participent ainsi, selon les groupes, à la mise en œuvre d’une
forme de violence unilatérale par les institutions, les femmes en étant toujours victimes
et les hommes toujours auteurs. En sus de la complicité institutionnelle, c’est la
complicité féminine qui est dénoncée, et ce depuis la naissance du mouvement des
pères séparés, au début des années 1980. Ainsi, selon un groupe originel nord-
américain, le National congress for men, les charges d’accusation d’abus sexuel ou
émotionnel seraient le fait de travailleuses sociales femmes qui ont elles-mêmes été
victimes d’abus, voire de mères qui enrôlaient leurs enfants pour produire de fausses
accusations. L’accusation d’abus sexuel, c’est « l’arme nucléaire des relations
domestiques » dit un père durant ce congrès, « si tout le reste ne marche pas, lâchez la
bombe13 » (Coltrane & Hickman 1992 : 410). Dans The Rape of the male, R. Doyle,
président de la Men’s rights association affirme ainsi que les fausses allégations sont
régulièrement pratiquées par les mères pour avoir la garde des enfants ou du moins
limiter celle du père. Selon lui 700 000 fausses accusations sont enregistrées chaque
année, ce qui représenterait 77 à 90 % des accusations (Coltrane et Hickman 1992).
Encore aujourd’hui cette remise en cause des violences conjugales envers les femmes
persiste au sein des groupes québécois évoqués plus haut. Les deux président(e)s de
L’Après-rupture et L’Association des nouvelles conjointes du Québec ont ainsi participé à la
rédaction d’un livre publié en 2010 et intitulé 300 000 femmes battues, y avez-vous crû ?,
questionnant la véracité des statistiques produites par le gouvernement québécois.
22 Se faire reconnaître comme victime est également un moyen d’accéder à une
reconnaissance politique. La reconnaissance du statut de victime soulève des enjeux
politiques (de la réparation, du témoignage, de la preuve). Selon les anthropologues
Didier Fassin et Richard Rechtman, cette reconnaissance est une ressource grâce à
laquelle on peut faire valoir un droit, en lien avec un traumatisme (Fassin & Rechtman
2011). C’est justement sous cet angle que le sociologue Stéphane Latté et
l’anthropologue Richard Rechtman analysent les usages militants du traumatisme,
oscillant entre une parole de victime, individuelle, et « une parole collective,
revendicatrice et bruyante » (Latté et Rechtman 2006 : 170). Le traumatisme serait un
élément « fédérateur » des groupes protestataires, un « instrument central de
légitimation des revendications » (Latté et Rechtman 2006 : 172), une sorte de « liant »
au sein d’une cause. Ce cadre théorique est particulièrement propice à l’étude de la
cause paternelle, car si les pères ne se lancent pas dans une revendication d’un
processus de réparation, ils sont liés par une expérience traumatique commune — celle
du passage en justice — et revendiquent le statut de victime par l’accumulation de
témoignages individuels au sein d’une dénonciation commune du féminisme d’État.
C’est à cette condition que la formation d’une conscience collective devient possible et
qu’une mobilisation peut être envisagée : l’expérience judiciaire est commune entre les
pères — tout à fait novices en termes de socialisation militante — et la médiatisation de
récits individuels produit une parole collective. La rhétorique de la victimisation
permet ainsi à ces groupes d’avoir accès à une reconnaissance politique14. Cette
reconnaissance légitime dans un premier temps les revendications et la « souffrance »
des pères — vocable employé notamment dans le cadre de la rhétorique du trauma — et
GLAD!, 04 | 2018
105
permet dans un second temps de légitimer la lutte engagée par ces pères contre la
perte de privilèges masculins engendrés notamment par les séparations conjugales.
23 Selon les groupes de pères masculinistes, les institutions en charge des familles
auraient tendance à favoriser les femmes et à rejeter les hommes. Le fait de vouloir
accéder communément à un statut de victime du féminisme d’État amène les groupes à
mettre en œuvre une rhétorique dirigée contre les institutions d’État en charge de
l’égalité, comme j’en ai fait l’illustration grâce aux écrits du groupe L’Après-rupture. Loin
de questionner les effets de l’égalité sur les pratiques des hommes et des femmes dans
la sphère publique et privée, le militantisme paternel invoque les méfaits de ces
politiques sur la place des hommes dans la société et nie les rapports de domination et
les privilèges qui sont en jeu. Décrédibiliser la régulation publique de la sphère privée
tout en individualisant et en produisant un rapport sensible voire émotionnel au
politique, voilà la stratégie discursive qu’adopte le militantisme paternel.
BIBLIOGRAPHIE
AUDUC, Jean-Louis. 2009. Sauvons les garçons. Paris : Descartes Et Cie.
BADINTER, Elisabeth. 1980. L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel (XVIIè-XXè siècle). Paris :
Flammarion.
BAUDELOT, Christian & ESTABLET, Roger. 1992. Allez les filles !. Paris : Seuil.
BERENI, Laure. 2012. « Penser la transversalité des mobilisations féministes : l’espace de la cause
des femmes », in Christine BARD, Les féministes de la deuxième vague. Rennes : Presses universitaires
de Rennes, 27-41.
BILAND, Émilie & SCHUTZ, Gabrielle. 2014. « Tels pères, telles mères ? La production des déviances
parentales par la justice familiale québécoise » Genèses 97(4) : 26-46.
BLAIS, Mélissa & DUPUIS-DERI, Francis. 2014. « Antiféminisme : pas d’exception française » Travail,
genre et sociétés 32(2) : 151-156.
BLY, Robert. 1992. L’homme sauvage et l’enfant : l’avenir du genre masculin. Paris : Seuil.
CARDI, Coline. 2010. « La construction sexuée des risques familiaux » Politique sociales et familiales
101 : 35-45.
CARDI, Coline & PRUVOST, Geneviève. 2012. Penser la violence des femmes. Paris : La Découverte.
CLERGET, Stéphane. 2001. Nos enfants aussi ont un sexe. Comment devient-on fille ou garçon?. Paris :
Robert Laffont.
CLERGET, Stéphane. 2005. Élever un garçon aujourd’hui. Paris : Albin Michel.
COLLECTIF STOP MASCULINISME. 2013. Contre le masculinisme. Petit guide d’autodéfense intellectuelle.
Bambule.
COLTRANE, Scott & HICKMAN, Neal. 1992. « The Rhetoric of Rights and Needs: Moral Discourse in the
Reform of Child Custody and Child Support Laws » Social Problems 39(4): 400-420.
GLAD!, 04 | 2018
106
CORNEAU, Guy. 1989. Père manquant, fils manqué. Montréal : Éditions de l’Homme.
CROWLEY, Jocelyn. E. 2008. Defiant Dads: Fathers’ Rights Activists in America. New York: Cornell
University Press.
DONZELOT, Jacques. 2005. La police des familles. Paris : Éditions de Minuit.
DULAC, Germain. 1989. « Le lobby des pères, divorce et paternité » Canadian Journal of Women and
the Law 3(1) : 45-68.
DULAC, Germain & LEFAUCHEUR, Nadine. 1997. « Politiques du père » Lien social et politiques 37 : 5-9.
DUPUIS-DERI, Francis. 2013. « L’antiféminisme d’État » Lien social et Politiques 69 : 163-180.
DURU-BELLAT, Marie. 1990. L’école des filles. Paris : L’Harmattan.
FASSIN, Didier & RECHTMAN, Richard. 2011. L’empire du traumatisme : enquête sur la condition de
victime. Paris : Flammarion.
FILLOD-CHABAUD, Aurélie. 2014. « Au nom du père ». Une sociologie comparative du militantisme paternel
en France et au Québec. Thèse de doctorat en sociologie. Florence : Institut Universitaire Européen.
FILLOD-CHABAUD, Aurélie. 2016a. « Dénonciation, régulation et réforme du droit de la famille par les
groupes de pères séparés : ce que nous apprend la comparaison France-Québec » Revue Femmes et
Droit 28(2) : 617-641.
FILLOD-CHABAUD, Aurélie. 2016b. « Les usages du droit par le mouvement des pères séparés » Genre,
sexualité & société [En ligne], (15), consulté le 15 avril 2018. http://journals.openedition.org/gss/
3746 ; DOI : 10.4000/gss.3746.
FILLOD-CHABAUD, Aurélie. 2017. « Les JAF sont-ils anti-papas ? » Délibérée 2(2) : 92-95.
FISH, Cynthia. S. 2004. « La puissance paternelle et les cas de garde d’enfants au Québec,
1866-1928 » Revue d’histoire de l’Amérique française 57(4) : 509-533.
GUILLONEAU, Maud & MOREAU, Caroline. 2013. La résidence des enfants de parents séparés De la demande
des parents à la décision du juge Exploitation des décisions définitives rendues par les juges aux affaires
familiales au cours de la période comprise entre le 4 juin et le 15 juin 2012. Paris : Ministère de la Justice,
Direction des affaires civiles et du sceau. Pôle d’évaluation de la justice civile.
HAMEL, Christelle et ali. 2016. « Viols et agressions sexuelles en France : premiers résultats de
l’enquête Virage » Population et société 538 : 1-4.
KAYE, Miranda & TOLMIE, Julia. 1998. “Discoursing Dads: The Rhetorical Devices of Fathers’ Rights
Groups” Melbourne University Law review 22: 162-194.
KNIBIELHER, Yvonne. 1987. Les pères aussi ont une histoire. Paris : Hachette.
LATTÉ, Stéphane & RECHTMAN, Richard. 2006. « Enquête sur les usages sociaux du traumatisme à la
suite de l'accident 1 de l'usine AZF à Toulouse » Politix 73(1) : 159-184. DOI : 10.3917/pox.073.0159.
LE COLLECTIF ONZE. 2013. Au tribunal des couples. Enquête sur des affaires familiales. Paris : Odile Jacob.
MITSCHERLICH, Alexander. 1969. Vers la société sans pères. Essai de psychologie sociale. Paris : Gallimard.
REVILLARD, Anne. 2016. La cause des femmes dans l’État. Une comparaison France-Québec. Grenoble :
Presses universitaires de Grenoble.
GLAD!, 04 | 2018
107
NOTES
1. L’auteure a réalisé ce travail dans le cadre du laboratoire d’excellence LabexMed – Les sciences
humaines et sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée portant la référence
10---LABX---0090. Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la
recherche au titre du projet Investissements Avenir A*MDEX portant la référence n°ANR-11-
IDEX-0001-02.
2. Cette notion fait certes écho à un article de F. Dupuis-Déri portant le même intitulé (Dupuis-
Déri 2013) mais elle ne vise pas le même objet. Si je m’appuie sur la même définition de
l’antiféminisme que l’auteur, c’est-à-dire « tout geste (action ou discours) individuel ou collectif
qui a pour effet de ralentir, d’arrêter ou de faire reculer le féminisme » (Op. Cit. p. 164), ce dernier
définit l’antiféminisme d’Etat comme les actions engagées par « les agents et les agences de l’État
pour ralentir, arrêter ou faire reculer les mobilisations du mouvement féministe (dans l’État ou
hors de l’État) » (Ibid. p. 165). Je considère pour ma part le féminisme d’Etat comme la cible
principale du militantisme paternel, et c’est pour cela que je défends le concept d’antiféminisme
d’Etat.
3. Les auteur.e.s déconstruisent l’idée défendue par des intellectuel.le.s tel.le.s que Mona Ozouf,
Pascal Bruckner, etc., qu’il n’y aurait pas besoin de pensée féministe en France — ni de
manifestations d’antiféminisme — puisque l’homme français, séducteur né, aurait un amour
inconditionnel et bien intentionné envers les femmes.
4. http://www.egalitariste.org/conseil_statut_homme.htm, page consultée le 21 février 2014.
5. Pour plus de détails sur la critique de la féminisation de la magistrature française par les
groupes de pères, voir Fillod-Chabaud, 2016a, 2017.
6. Le sexe des juges aux affaires familiales en poste n’est à ce jour pas communiqué par la
Chancellerie. À tout le moins, en 2011, 68% des juges non spécialisés des tribunaux de grande
instance sont des femmes. Les chambres aux affaires familiales en font partie.
7. Dans ma thèse, je distingue les réseaux partisans des réseaux institutionnels afin de distinguer
le mode de fonctionnement et de financement des groupes de pères séparés en France et au
Québec. Les premiers, présents aussi bien en France qu’au Québec, sont généralement composés
de bénévoles et ont été créés sous l’impulsion d’un ou deux individus. Ils ne sont pour la plupart
financés que par des fonds privés. Ils diffusent une utilisation agressive du droit et valorisent
l’hyperjudiciarisation des séparations. A l’inverse, les réseaux institutionnels sont composés de
professionnels (travailleurs sociaux, psychologues) et ont été créés sous l’impulsion d’une
institution (service d’action sociale d’une commune, etc.). Ils sont pour la plupart financés par
des subventions publiques. Ces réseaux présents essentiellement au Québec promeuvent une
vision pacifiée et déjudiciarisée de la séparation, en écho à la politique de déjudiciarisation
engagée par la Province, il y a une trentaine d’années. Pour plus de détails voir Fillod-Chabaud
2016a et 2016b.
8. Au moment de la rédaction de cet article, le site Internet du groupe n’était plus actif. Il l’était à
tout le moins jusqu’en 2014, lorsque j’ai rédigé ma thèse.
9. Pourtant, une rapide recherche dans la presse québécoise à ce sujet laisse entendre qu’au
Québec, comme dans beaucoup d’autres pays, les maisons d’accueil pour femmes victimes de
violences conjugales souffrent d’un manque récurrent de places et de moyens. Voir par exemple,
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087765/maisons-hebergement-femmes-violence-aide-
insuffisante-quebec ; http://www.lapresse.ca/actualites/201711/15/01-5143590-violence-
conjugale-les-maisons-dhebergement-pour-femmes-debordent.php.
10. Le Collectif Stop Masculinisme est un regroupement de militants qui déconstruisent les
arguments avancés par les masculinistes sur des sujets tels que les violences conjugales, le
divorce et la garde des enfants, etc.
GLAD!, 04 | 2018
108
11. Durant l’année 2015, en France, 62 000 femmes et 2700 hommes ont été victimes d’un viol ou
d’une tentative de viol. On estime que 553 000 femmes et 185 000 hommes ont été victimes
d’autres formes d’agressions sexuelles (attouchements, baiser imposé etc.) (Hamel et al. 2016).
12. L’association présidée par Lise Bilodeau depuis 1999 défend les droits des nouvelles
conjointes face aux ex-conjointes. Elle considère que la justice québécoise donne trop de pouvoir
aux femmes mariées et dénonce des mesures telles que la pension alimentaire sans terme
(équivalent d’une rente à durée indéterminée versée par l’ex-époux).
13. Traduction personnelle.
14. La reconnaissance politique se manifeste par la mise sur agenda – jusque-là non concluante –
de la résidence égalitaire des enfants (alternée ou partagée) dans la loi. Ce processus s’est engagé
il y a presque 20 ans au Canada, lorsqu’une commission fédérale fut établie pour évaluer la
pertinence d’inscrire dans la loi la présomption de garde partagée. Le projet de loi C-22 est
finalement abandonné en 2002 puis relancé en 2009 (projet C-422) et régulièrement remis à
l’ordre du jour par des députés proches du mouvement des pères en 2011 et 2016. En France, de la
même manière qu’au Québec, la présomption de résidence alternée est mise sur l’agenda
politique entre 2009 et 2012 par des députés proches des groupes de pères et sont plus ou moins
médiatisées ; leur succès est très mitigé auprès de l’opinion publique. De 2013 à 2017, la mise sur
agenda de la résidence alternée par défaut obtient plus d’intérêt de la part de la classe politique
et de l’opinion politique. En cela, les groupes de pères s’engagent dans un processus de
reconnaissance de plus en plus cohérent. Pour plus de détails, voir Fillod-Chabaud 2016a et
2016b.
RÉSUMÉS
Le militantisme paternel — ou mouvement des pères séparés — est un mouvement social qui
remet en cause l’intervention de l’État dans la sphère privée en visant à délégitimer les
institutions en charge de réguler les séparations conjugales. À travers la notion d’antiféminisme
d’État, cet article met en lumière la manière dont les pratiques d’interventions étatiques sont
perçues par ces groupes comme une forme de déconsidération de la masculinité. L’exemple du
Québec sera développé par l’intermédiaire des productions discursives et rhétoriques du groupe
L’Après-Rupture.
Fathers’ rights activism is a social movement that challenges state intervention in the private
sphere by seeking to delegitimize the institutions in charge of regulating marital separation.
Through the notion of state antifeminism, this article highlights how state intervention practices
are perceived by these groups as a way to discredit masculinity. The example of Quebec will be
developed through the discursive and rhetorical productions of the group L'Après-Rupture.
INDEX
Thèmes : Recherches
Keywords : masculinism, fathers’ rights’ activism, antifeminism, state, Québec
Mots-clés : masculinisme, militantisme paternel, antiféminisme, État, Québec
GLAD!, 04 | 2018
109
AUTEUR
AURÉLIE FILLOD-CHABAUD
Post-doctorante Aix-Marseille Univ, CNElias et IREMAM, programme LabexMed.
Aurélie Fillod-Chabaud est sociologue. Elle travaille sur les rapports entre familles et États, dans
une perspective comparative. Elle a réalisé sa thèse doctorat sur le militantisme paternel en
France et au Québec. Elle travaille actuellement sur la régulation institutionnelle de la kafala en
France, un mode de recueil en droit musulman et analyse les conditions socio-politique de la
circulation des enfants abandonnés entre France et Maghreb (Algérie, Maroc).
GLAD!, 04 | 2018
110
Retour sur un siècle et demi derhétorique anti-égalitaire etantiféministe Entretien avec Juliette Rennes
Reflecting on One and a Half Century of Anti-Egalitarian and Anti-Feminist
Rhetoric. An Interview with Juliette Rennes
Juliette Rennes et Revue GLAD!
1. En réaction au récent mouvement MeToo, le 9 janvier 2018 un collectif de « 100femmes » se prononçait en faveur de la « liberté d’importuner, indispensable à la libertésexuelle ». Vous avez réagi à cette tribune publiée par le Monde, en disant qu’elle réhabilitaitun ordre social à l’ancienne et qu’elle vous inspirait un fort sentiment de déjà-vu par rapportà des discours antiféministes de différentes époques, particulièrement virulents à desmoments où les femmes s’en prennent collectivement à des pratiques sexistes dans lesrelations érotiques ou sexuelles1. Pourriez-vous développer sur quoi repose ce sentiment dedéjà-vu ?
1 Les arguments mobilisés dans cette tribune n’ont pas tous la même ancienneté, mais la
plupart datent au moins des années 1980. Au cours des quarante dernières années, des
féministes se sont mobilisées pour dénoncer le sexisme dans les médias, dans la
publicité et dans l’industrie du porno, rendre visibles les violences sexuelles et, plus
récemment, le harcèlement de rue. Ces campagnes ont suscité des débats récurrents
sur la pertinence de réclamer l’égalité des sexes en matière de séduction, de sexualité
et de représentations érotiques. Au fil de ces différentes controverses, les arguments
hostiles aux analyses et aux revendications féministes se sont peu renouvelés.
2 L’une des stratégies récurrentes relève d’une logique ad personam : elle consiste moins à
réfuter directement le contenu des raisonnements féministes qu’à discréditer celles qui
les tiennent : derrière leur plaidoyer en faveur de l’égalité des sexes apparemment
acceptable et légitime, il y aurait, en réalité, une « haine des hommes et de la
sexualité », selon l’expression de la tribune des 100 femmes, c’est-à-dire une logique de
ressentiment. À cette démystification, s’ajoute un argument par les effets : en
dénonçant la domination masculine dans les rapports de séduction, les féministes
GLAD!, 04 | 2018
112
menaceraient le caractère spontané de la drague et la possibilité même des rencontres
amoureuses. La tribune des 100 femmes reprend cet argument en mobilisant une
définition de la pulsion sexuelle comme un phénomène « naturel et sauvage » dont les
revendications féministes entraveraient l’expression.
3 Généralement, les féministes tendent à rétorquer que l’objet de leur dénonciation est le
« sexisme » et non « le sexe » et qu’il s’agit d’en finir avec un système — les inégalités
de genre, l’infériorisation des femmes, la domination masculine, le virilisme, le
patriarcat, etc. — et non avec les individus assignés hommes à la naissance. Souvent,
elles opposent aussi une autre définition du désir sexuel, non pas comme une pulsion
naturelle, mais comme une relation sociale dont l’expérience et les modalités
d’expression sont susceptibles d’évoluer avec la diffusion des normes égalitaires.
Cependant, comme on sait, dans les controverses durables sur des enjeux politiques et
normatifs, les arguments ont surtout pour effet de consolider et d’étayer les
convictions des partisans de chaque camp plutôt que de rallier les adversaires !
4 Ces affrontements argumentatifs se répètent régulièrement depuis les années 1980,
mais certaines de leurs dimensions remontent plus loin dans l’histoire. Suspecter chez
les féministes une « haine des hommes » et prédire que l’égalité des sexes tuerait le
désir, l’amour et le couple étaient des raisonnements très courants parmi les
antiféministes des années 1900. On pronostiquait à l’époque que les « femmes
nouvelles », celles qu’appelaient de leurs vœux les féministes, allaient cesser d’être
attirées par les hommes et d’être attirantes pour eux parce qu’il n’y aurait plus de
« complémentarité » entre les sexes. Comment une avocate ou une doctoresse autant
ou plus savante que son mari pourrait-elle l’admirer ? Pourquoi une femme
financièrement indépendante aspirerait-elle à la protection masculine que donne le
mariage ? Quel goût trouverait à la galanterie une femme qui se perçoit comme égale
aux hommes ? Et comment les hommes pourraient-ils désirer des femmes qui ont
davantage développé leur « cerveau » que leur « cœur » et sont plus intéressées par
leur carrière professionnelle que par leur rôle de « fée du logis » ? L’idée que l’amour
(hétérosexuel) ne pouvait qu’être lié à l’inégalité de statuts et de rôles entre les sexes
est explicitement formulée par nombre d’antiféministes de l’époque, comme Charles
Turgeon, Théodore Joran, Clément Vautel ou Colette Yver.
5 L’essayiste et dramaturge Marcel Prévost, qui soutenait alors la cause féministe,
répondait à ces craintes en 1912 : « L’important pour les femmes de demain c’est de
plaire aux hommes de demain. Et vous pouvez être sûrs qu’elles leur plairont. Car en
même temps qu’elles, dans le même sens, les hommes se seront modifiés2 ». Bref, il ne
croyait pas à une essence anhistorique ni de la masculinité ni de l’attirance entre les
sexes, qui selon lui, évolueraient en relation avec le développement des mouvements
féministes. Ces représentations antagonistes du désir perdurent dans les controverses
contemporaines sur ce que les avancées féministes font aux normes traditionnelles
concernant la drague, la séduction et les relations amoureuses.
2. Y avait-il entre féministes et antiféministes des années 1870-1930 des débats portantdirectement sur la séduction et la sexualité ?
6 Il existait des revendications en relation avec ces questions : les féministes dénonçaient
notamment la « double morale sexuelle » qui consistait à valoriser pour les hommes le
fait d’avoir des maîtresses et de fréquenter des prostituées, alors que les femmes
étaient censées être vierges jusqu’au mariage et rester fidèles à leur mari ; certaines
féministes formulaient également une critique de la galanterie qui se poursuit jusqu’à
GLAD!, 04 | 2018
113
aujourd’hui : elles dénonçaient, derrière cette attitude masculine prévenante envers les
femmes, une forme de rappel à l’ordre « enjolivé » de leur supposée faiblesse et de leur
besoin de protection masculine.3 Mais l’analyse des normes inégalitaires qui régissent
la séduction hétérosexuelle et, plus largement, les travaux sur l’hétérosexualité comme
système politique datent véritablement des années 1970. Il est d’ailleurs surprenant,
quand on se plonge dans des archives du début du XXe siècle, de constater à quel point
ce qu’on appellerait aujourd’hui le « harcèlement de rue » était une pratique très
courante : les jeunes travailleuses parisiennes et, dans une moindre mesure, les femmes
bourgeoises étaient si couramment abordées et suivies sur la voie publique par des
hommes, généralement plus âgés qu’elles, que le « suiveur » ou le « vieux marcheur »
était devenu un « type » parisien dans la littérature, la presse et la culture visuelle4.
Mais la dénonciation féministe de ces pratiques était alors tout à fait marginale au sein
de l’agenda militant de l’époque qui se concentrait sur l’égalité juridique dans le
domaine éducatif, professionnel, familial, civil et politique.
7 Pourtant, comme je l’ai mentionné, le fait que la séduction et l’amour hétérosexuels
n’étaient pas encore un enjeu direct d’analyse et de lutte féministes n’empêchait pas les
adversaires de l’égalité des sexes de s’inquiéter de ce qu’allaient devenir les relations
entre hommes et femmes avec les progrès du féminisme. Le roman et la comédie
théâtrale, en tant que genres littéraires spécialisés dans les histoires d’amour (et de
désamour), ont d’ailleurs très largement traité ce thème au tournant du siècle. Des
récits mettent en scène des hommes qui perdent leur attirance pour une femme en
apprenant qu’elle est agrégée, étudiante en médecine ou avocate5. Dans d’autres
fictions, au contraire, ils tombent amoureux de ces « femmes nouvelles » mais ils sont
alors confrontés, une fois mariés, à toutes sortes de déboires conjugaux causés par
l’ambition professionnelle de leur épouse et le fait qu’elle se désintéresse des activités
ménagères et domestiques6.
GLAD!, 04 | 2018
114
Doctoresse ! Pantomime en un acte. Couverture de l’édition de la pièce théâtrale de Paul Hugounet &G. Villeneuve 1891
3. Indépendamment des questions de séduction et d’amour, y a-t-il des arguments quirefont surface à différentes époques pour tenter de freiner toute avancée vers l’égalité dessexes ?
8 Depuis la fin du XIXe siècle, l’un des arguments les plus constants est de décréter
l’égalité acquise et, par conséquent, les luttes féministes sans objet. Dans les débats sur
l’accès des femmes aux métiers réservés aux hommes des années 1870 aux années 1930
en France, cet argument antiféministe était récurrent et se déclinait de trois manières.
On soulignait quelques conquêtes juridiques obtenues par les femmes pour faire valoir
que l’égalité en droit était chose faite ; on citait le nombre de femmes dans tel ou tel
secteur universitaire ou professionnel — par exemple le fait que Paris comptait 300
femmes médecins — pour soutenir qu’il y avait une féminisation déjà impressionnante
de ces métiers, voire une invasion féminine (peu importe que ces 300 femmes
représentaient alors 2 % des médecins parisiens, on ne jugeait pas les progrès du
féminisme à l’aune d’une exigence paritaire, selon une logique qui date des
années 1990, mais en relation avec l’absence initiale de femmes au sein de ces
secteurs…) ; enfin, on occultait les résistances rencontrées par les femmes pour accéder
à ces études et métiers en soulignant qu’elles y étaient au contraire très bien
« accueillies » par les hommes et donc qu’il n’y avait pas besoin de lutte féministe ; en
gros, les féministes « enfonçaient des portes ouvertes » selon les mots d’un
antiféministe de l’époque7.
9 À partir du moment où l’on considérait l’égalité acquise, le fait que les féministes
continuaient à lutter signifiait que leur objectif n’était pas l’égalité, mais la domination.
C’est un dévoilement très courant des antiféministes de l’époque, et, encore une fois, la
fiction hostile à l’émancipation des femmes a contribué à sa diffusion : dans nombre de
dessins satiriques, pièces de théâtre et films des années 1900, on représente des sociétés
GLAD!, 04 | 2018
115
futures où des hommes, sous la coupe de féministes dictatoriales, sont réduits à
accomplir les activités les plus socialement dévalorisantes traditionnellement
féminines8.
La culotte. Carte postale 1911
©J. Rennes
10 Dans un régime politique tel que la Troisième République qui se réclamait des valeurs
égalitaires, il était plus acceptable de débusquer la supposée volonté de domination des
féministes que de critiquer frontalement leurs aspirations à l’égalité. Cet argument a
survécu. Dans l’histoire des controverses sur des demandes d’égalité depuis la fin du
XIXe siècle, il y a d’ailleurs des arguments qui s’éclipsent provisoirement, mais rares
sont ceux qui disparaissent complètement.
4. Y a-t-il des arguments ou des topoï qu’on retrouve aussi bien au sujet des rôles genrésdans le domaine des professions qu’à propos des rôles genrés dans les rapports amoureuxou sexuels ?
11 Je dirais qu’il y a une matrice idéologique commune à tous les discours qui s’opposent
aux réclamations féministes, au moins pour la période 1870-1930. Cette matrice, le
naturalisme différentialiste, est désormais bien connue dans l’histoire des idéologies
antiféministes. Le fait de justifier l’ordre social qu’on souhaite maintenir ou voir
advenir en le renvoyant à une transcendance qu’on appelle la « nature » n’est pas le
propre des antiféministes ; dans mon travail, j’ai aussi analysé différentes formes de
naturalisme mises en œuvre dans les discours progressistes9. Mais la dimension
différentialiste de cet ordre naturel est caractéristique des discours conservateurs,
comme l’a bien montré Colette Guillaumin10.
12 Les discours d’opposition aux revendications féministes des années 1870-1940
défendent l’existence de différences naturelles et incommensurables entre les sexes et
GLAD!, 04 | 2018
116
posent le maintien de ces différences comme un impératif social. La différence de droits
et de devoirs selon le sexe et leur « spécialisation » sont conçues comme nécessaires à
l’équilibre social, aussi bien dans les rapports conjugaux et familiaux que dans le
monde du travail. Les antiféministes qui promouvaient cette vision de l’ordre social
contre les offensives égalitaristes des féministes ne faisaient d’ailleurs qu’expliciter les
normes qui régissaient jusqu’alors les rapports de genre, inscrites, par exemple, dans le
Code civil. Mais ce qui caractérise la période, c’est que ces normes étaient justement en
train de perdre leur évidence et leur naturalité. Cela poussait les plus conservateurs en
matière de statut des femmes à consolider leurs arguments, en recherchant par
exemple dans les hormones ou le cerveau la source de la « complémentarité des
sexes ».
13 Les guides d’orientation professionnelle pour les filles qui se développent à partir du
début du XXe siècle témoignent de ce trouble dans les représentations traditionnelles de
l’ordre des sexes. Leurs auteur·es semblaient hésiter constamment entre une logique
différentialiste qui consistait à enjoindre aux femmes de n’exercer que les métiers où
elles pouvaient mettre en œuvre leurs « qualités différentes », celles qu’elles étaient
censées mobiliser dans la sphère domestique, conjugale et maternelle (altruisme,
dévouement, tact, goût des activités minutieuses et répétitives, etc.) et une logique
égalitaire, libérale et méritocratique, promue par les féministes, qui encourageait les
femmes à choisir les activités qui leur convenaient le mieux, non pas en tant que
femmes, mais en tant qu’individus. Par ailleurs, les rôles genrés dans le domaine des
professions et dans les relations intimes n’étaient pas seulement perçus à travers une
même matrice, ils étaient vus aussi comme interdépendants : comme je l’ai dit, l’un des
éléments qui inquiétait le plus les antiféministes dans les réclamations d’égal accès des
deux sexes aux métiers et aux professions avait trait aux effets de ces revendications
dans la sphère privée. Une femme diplômée et indépendante deviendrait
nécessairement une femme « nouvelle » à tous points de vue, y compris en tant que
mère, épouse et amoureuse. Le débat sur le travail des femmes et celui sur les relations
intimes entre les sexes ont donc émergé en étant indissociables.
5. Est-ce que ce discours antiféministe était davantage focalisé sur les femmes de labourgeoisie que sur celles des classes populaires ?
14 Disons que l’accès au salariat d’une partie croissante des femmes de la bourgeoisie a
frappé les contemporains, alors que le travail des femmes des classes populaires n’avait
rien de nouveau. Par ailleurs, les hommes qui publiaient pour s’opposer aux
revendications féministes d’égal accès des deux sexes à tous les métiers étaient eux-
mêmes membres de la bourgeoisie diplômée : ils étaient juristes, avocats,
parlementaires, médecins, journalistes, publicistes, professeurs d’université. L’arrivée
des femmes au sein d’univers professionnels où ils bénéficiaient jusqu’alors d’un entre-
soi et qui rassemblaient des activités concurrentielles et difficiles d’accès menaçait
directement leurs privilèges. Cette défense des privilèges n’était bien sûr pas dicible
comme telle. Du coup, leur argumentation contre l’accès des femmes à ces métiers
diplômés consistait principalement à faire valoir que le travail à l’extérieur du foyer
était incompatible avec la fonction d’épouse et de mère et la fragilité féminine. Or, ces
hommes semblaient rester de marbre au fait qu’une grande partie des femmes des
classes populaires, elles aussi épouses et mères, travaillaient toute la journée hors de
chez elles dans des usines, des ateliers, des magasins. Ce biais de classe sociale était
d’ailleurs pointé dans la presse féministe de l’époque pour faire valoir que les
GLAD!, 04 | 2018
117
arguments des bourgeois antiféministes contre l’avocate et la doctoresse étaient en
réalité motivés par la peur de la concurrence11.
15 Je fais actuellement une enquête sur les travailleuses parisiennes au début du XXe siècle
et j’ai été frappée de voir à quel point les femmes qui accédèrent au métier très
masculin de cocher ont été très bien accueillies dans la presse de l’époque, alors
qu’elles étaient souvent conspuées et agressées sur la voie publique par des travailleurs
de rue, des passants et surtout d’autres cochers. Les journalistes qui empruntaient
régulièrement des fiacres trouvaient charmante cette « nouveauté parisienne »
consistant à se faire conduire par des femmes ; le fait qu’il s’agissait d’un métier
traditionnellement masculin exigeant de rester dehors toute la journée et de faire
preuve de force et de résistance physique ne les conduisait pas à s’inquiéter du sort des
femmes dans ces métiers. Il n’en allait pas de même des cochers qui, dans la presse
syndicale, dans la rue, faisaient valoir que les femmes n’étaient pas à leur place dans ce
métier, ce que les avocats disaient aussi des avocates. Or, tout comme le barreau, le
métier de cocher était très concurrentiel. Cet antiféminisme des hommes des classes
laborieuses urbaines a laissé moins de traces dans la presse quotidienne, la littérature
et les productions culturelles qui étaient avant tout des supports d’expression de la
bourgeoisie masculine.
6. Avez-vous l’impression que les discours de type « doxa partagée » ont beaucoup changédepuis le XIXe siècle, en ce qui concerne la place des femmes dans le monde du travail ?
16 Depuis plus d’un siècle, les conquêtes féministes et la féminisation du salariat ont
contribué à changer les normes et les représentations sociales en matière de genre au
travail. Au cours de la période 1870-1930, un très grand nombre d’établissements
d’enseignement supérieur et de métiers, dans le domaine juridique, politique, dans la
haute fonction publique, la police, l’armée étaient fermés aux femmes. Après la
Seconde Guerre mondiale, ces interdits légaux ont été peu à peu levés et, quand il y a eu
des controverses, par exemple concernant l’accès à la magistrature, à l’armée ou à la
police, elles ont été résolues en vertu d’un principe d’égal accès. Ce processus a
contribué à rendre peu à peu illégitime l’idée qu’il y aurait des métiers que les femmes,
par nature, ne seraient pas capables de faire. Au début du XXe siècle, c’était au contraire
l’idée que les capacités professionnelles ne dépendaient pas du sexe des personnes qui
était hétérodoxe et dissidente.
17 Les activités de cadres de la fonction publique, les métiers de l’information, la médecine
et le barreau caractéristiques de la bourgeoisie masculine à la fin du XIXe siècle sont
devenus globalement mixtes un siècle plus tard. En 2011, 51 % des personnes inscrites
au barreau de Paris sont des femmes alors qu’il n’y avait que 5 femmes avocats en tout
en 1911. Mais, comme l’ont bien montré les sociologues du travail et du genre depuis les
années 1990, les spécialités et les grades à l’intérieur de ces domaines professionnels
demeurent très genrés12, ce qui contribue aux forts écarts de salaire entre les sexes. Au
barreau de Paris, les hommes sont par exemple cinq fois plus nombreux que les femmes
en droit fiscal et le revenu moyen masculin annuel est supérieur de 67 % à celui des
femmes13.
18 Dans les métiers les moins diplômés, la ségrégation genrée des activités est
particulièrement forte : des secteurs professionnels entiers — par exemple le bâtiment
côté masculin, l’aide à la personne côté féminin — sont quasiment non mixtes14. Or, ce
processus se soutient sur un ensemble de pratiques et de discours qui depuis
l’éducation des enfants jusqu’à l’orientation professionnelle et l’accès aux métiers
GLAD!, 04 | 2018
118
fabrique des « préférences » des filles et des garçons pour certaines activités et les
dissuade de transgresser les normes de genre en matière d’orientation professionnelle.
Bref, la logique différentialiste s’est perpétuée, malgré la disparition d’interdits
juridiques concernant l’accès des femmes aux métiers anciennement masculins. Les
arguments consistant à faire valoir que les métiers liés au soin, au nettoyage, à la petite
enfance permettent de mettre en œuvre des qualités dont les femmes font preuve dans
la sphère privée et dans les relations familiales n’ont pas disparu ; cet argumentaire va
de pair avec un déni de qualification professionnelle et une moindre reconnaissance
économique de ces activités.
7. Et concernant le couple et le foyer, est-ce que le discours doxique vous semble avoirbeaucoup évolué ?
19 Sur la question des activités domestiques et parentales, il y a eu des évolutions
flagrantes en relation avec les luttes féministes des quarante dernières années et la
généralisation du salariat des femmes de la bourgeoisie. Beaucoup de discours
antiféministes de la première moitié du XXe siècle sur le couple et la famille nous
apparaitraient aujourd’hui exotiques, et je crois qu’ils le seraient même pour les
adversaires des féministes au XXIe siècle. J’ai évoqué tout à l’heure les dystopies
antiféministes sur les malheurs du mari dont l’épouse serait une « femme nouvelle » :
les représentations d’hommes obligés d’accomplir des tâches domestiques et parentales
en raison de l’engagement de leur épouse dans une activité professionnelle suscitaient
alors horreur et indignation. L’idée d’un homme devant changer une couche ou faire la
vaisselle était dégradante.
À gauche : Les rôles renversés. Carte postale 1900-1920, s.d. À droite : Le féminisme à l’apogée. Cartepostale 1910.
©J. Rennes
GLAD!, 04 | 2018
119
20 Les luttes féministes ont contribué à faire évoluer ces normes : aujourd’hui, il est
devenu peu à peu stigmatisant pour un père ou un mari non pas de participer aux
activités domestiques et parentales, mais au contraire de ne jamais s’y intéresser.
Certes, la parité est loin d’être atteinte dans ce domaine et il est important de
distinguer le rythme auquel se transforment les normes publiques et celui auquel se
transforment les pratiques : le discours prônant un égal partage des activités
domestiques et parentales, marginal au début du XXe siècle même chez les féministes,
est devenu publiquement légitime, mais il est contrecarré par d’autres logiques sociales
qui contribuent à la perpétuation du faible engagement des hommes dans ces activités,
par exemple, la socialisation inégale des filles et des garçons aux tâches domestiques
puis les différences de salaire et de statut professionnel entre les sexes qui conduisent
les couples à privilégier la carrière du conjoint.
8. Pourrait-on affirmer que la misogynie est moins ouvertement exprimée de nos jours, etque les discours antiféministes se doivent d’être plus subtils ?
21 Concernant l’antiféminisme, je ne sais pas si les discours d’Éric Zemmour, Alain Soral
ou les Unes du magazine Causeur sont « plus » subtils que ce qu’on pouvait lire et
entendre dans les années 1900. On constate même aujourd’hui des formes de
« radicalisation antiféministe » de certains intellectuels qui se mettent à redécouvrir
les arguments les plus éculés contre les luttes pour l’émancipation des femmes et
l’égalité des sexes. L’évolution des positions de quelqu’un comme Pierre-André Taguieff
m’a affligée, parce que, dans les années 1980, Taguieff avait produit un travail critique
de grande ampleur pour décrypter les logiques argumentatives du néoracisme
différentialiste qui s’était développé à partir des années 1970. Ses analyses me
semblaient heuristiques pour comprendre la matrice commune entre idéologie raciste
et sexiste. Or dans ses dernières interventions, à la fois il met en question la légitimité
des luttes antiracistes contemporaines et il reprend à son compte un discours
antiféministe des plus traditionnels consistant à décréter l’égalité déjà acquise et le
combat féministe dépassé, à dénoncer la volonté de domination des féministes, la
guerre des sexes qu’elles seraient en train d’attiser et la haine des hommes qui serait
leur passion négative15.
22 Mais il faudrait évidemment distinguer cet antiféminisme militant d’intellectuels ayant
pignon sur rue et les formes de critique ordinaire, au travail, dans les repas de famille,
sur les réseaux sociaux, au café, des « excès du féminisme » qui consistent à faire le tri
entre des domaines où l’exigence d’égalité serait légitime et d’autres où il vaudrait
mieux en rester là ; de même qu’il faudrait distinguer l’antiféminisme et la misogynie :
les deux sont liés, mais ils ne sont pas inséparables. Au début du XXe siècle, des hommes
pouvaient très bien militer pour l’égalité des droits entre les sexes et donc participer
aux luttes féministes tout en ayant des opinions qu’on pourrait qualifier de misogynes,
consistant, par exemple, à exprimer l’idée que les femmes avaient moins de capacités
intellectuelles que les hommes, étaient globalement plus faibles ou que les « génies »
n’existaient que parmi la gent masculine. Autrement dit, on pouvait défendre les droits
des femmes par allégeance aux valeurs républicaines et méritocratiques d’égalité des
chances, sans forcément penser que les sexes étaient égaux « en nature ». C’est un
raisonnement que l’on retrouve par exemple chez un essayiste et critique littéraire de
l’époque, Émile Faguet, dans un ouvrage favorable au féminisme ou chez l’avocat
Fernand Corcos dans un livre qui dénonce les préjugés contre l’accès des femmes au
barreau16.
GLAD!, 04 | 2018
120
23 Inversement, prendre une position antiféministe, c’est-à-dire, à l’époque, s’opposer à
l’égalité des droits entre les sexes, n’impliquait pas forcément la conviction misogyne
que les femmes étaient inférieures aux hommes. L’adhésion au volet prescriptif de
l’idéologie différentialiste (l’idée que la spécialisation des sexes est un bien pour
l’équilibre social) primait parfois sur l’adhésion à son volet « ontologique » (la croyance
selon laquelle il existe des capacités naturellement différentes entre les sexes). Par
exemple, la romancière et essayiste catholique antiféministe Colette Yver, dans ses
récits contre les « émancipées », mettait en scène des personnages de femmes
intelligentes et ambitieuses qui, au terme de l’intrigue, renonçaient à leur profession,
non pas tant parce qu’elles se révélaient incompétentes, mais, au contraire, parce que
leurs succès professionnels commençaient à faire de l’ombre à leur mari, bouleversant
ainsi l’ordre traditionnel des sexes17.
24 Il y avait bien sûr, parallèlement à ce type de discours antiféministe qui ne
présupposait pas forcément une infériorité naturelle des femmes, de très nombreuses
prises de position publiques plus directement misogynes, qui cherchaient à s’appuyer
sur des études médicales pour démontrer la hiérarchie naturelle entre les sexes. Mais la
plupart des discours misogynes étaient justement plus « subtils », prenant la forme de
l’éloge de « la femme » et visant à préserver, selon le vocabulaire de l’époque, ses
« qualités propres », sa « nature distinctive », sa « singularité », sa « différence
spécifique », bref, tout ce que le féminisme menaçait en réclamant l’égalité. Le travail
critique féministe consistait alors à rompre le charme de ce discours, à dévoiler ce que
recouvrait la « guitare des antiféministes » selon une expression de l’époque18. Les
militantes de la Troisième République se sont attelées à démystifier l’éloge de la « reine
du foyer » : « Femmes ménagères, vous êtes reines ! Reines de l’eau de vaisselle et des
chaussettes trouées » ironisait par exemple la syndicaliste féministe Marthe Bigot19.
Elles mettaient aussi en relation divers récits antiféministes pour en montrer la logique
cachée : d’un côté, le discours sublimant et esthétisant la splendeur des tâches
domestiques et comparant l’espace domestique à un « royaume » ou un « sanctuaire »
où trônait la reine du foyer ; de l’autre, les dystopies mettant en scène des hommes
humiliés de devoir se consacrer à ces tâches, finalement pas si splendides que ça.
25 La déconstruction féministe du caractère enchanté des relations de séduction
hétérosexuelles, elle, est plus contemporaine que le désenchantement du mythe de la
splendeur des activités domestiques. Mais elle mobilise des procédés rhétoriques
analogues. Dans les prises de position féministes sur l’affaire Strauss-Kahn en 2011 — je
pense par exemple au livre coordonné par Christine Delphy20 —, figurait notamment
une dénonciation des rapports de pouvoir que cachaient les euphémismes employés
dans une partie des médias (« libertinage », « partie fine », « donjuanisme », « affaire de
mœurs »). Bref, depuis un siècle et demi au moins, les féministes jouent le rôle de
« rabat-joie » comme le rappelle Sara Ahmed dans son article sur les « killjoys »
féministes21. Elles révèlent que la joie domestique, maternelle, sexuelle, n’est peut-être
pas si joyeuse que ça pour celles qui sont censées se satisfaire du bonheur qu’elles
prodiguent aux autres (les enfants, le mari, les proches, ou les clients de celles qu’on
appelait « les filles de joie »…) ; l’analyse féministe montre qu’il peut y avoir de la
contrainte, du malaise, des désajustements, de la souffrance, de la domination. Il est
compréhensible que ce dévoilement, libérateur pour certaines, suscite des réactions
virulentes de la part de ceux et celles qui trouvent leur compte dans cet ordre des
sexes.
GLAD!, 04 | 2018
121
9. Les discours antiféministes et misogynes actuels prennent souvent la précaution de sedéclarer féministes ; on y retrouve souvent une dichotomie entre « les féministes bien, quiluttent pour une égalité acceptable » et les « féminazies » qui exagèrent, qui demandent lalune et qui détestent les hommes. Or, en général « les féministes acceptables » sont desfemmes qui ne font que bénéficier des acquis des combats menés par les féministes desgénérations précédentes, et les « féminazies » sont les féministes actuelles qui continuentà se battre pour l’avenir. Peut-on dater depuis quand il y a des féministes « bien » dans lesdiscours réactionnaires et conservateurs ? Depuis quand les discours antiféministes s’auto-qualifient de discours féministes pour camoufler leur misogynie ?
26 Au début du XXe siècle, il était bien vu de se dire féministe et dans les années 1905-1910
le mot « féminisme » est devenu le lieu de batailles sémantiques entre partisans et
adversaires de l’égalité juridique entre les sexes. Ceux qui s’opposaient à l’égalité en
droit se disaient féministes tout en distinguant le « bon » et le « mauvais » féminisme.
Cela permettait de s’approprier le mot tout en rejetant les luttes que ce mot recouvrait
jusqu’alors. Un juriste hostile à l’égalité juridique entre les sexes, Paul Cambon,
expliquait que dans « le féminisme, on peut distinguer deux courants. L’un a pour but
d’augmenter la valeur personnelle de la femme tout en maintenant celle-ci dans son
rôle spécial » ; c’est un féminisme qu’il jugeait légitime par opposition au féminisme qui
prétend « être distingue sous ce nom » et, selon lui, vise à « transformer [la femme] en
“individu” ou pour parler plus clairement en homme [faisant] tous ses efforts pour
masculiniser la femme, pour lui donner les habitudes, les façons de penser et de sentir,
les occupations et les travaux de son compagnon »22.
27 Théodore Joran, connu à l’époque pour ses essais antiféministes, récompensés d’ailleurs
par l’Académie française, expliquait que « ce sont ceux qu’on appelle les antiféministes
qui sont les vrais amis des femmes » et expliquait que « [son] féminisme » consisterait à
promouvoir la spécialisation des activités selon les capacités de chaque sexe contre
« l’invasion » des carrières masculines « sous prétexte d’égalité »23. Dans la même veine,
mais un peu plus tard, en 1918, le journaliste Clément Vautel met en scène, dans un
récit de politique-fiction se déroulant en 1958, des femmes traditionnelles qui se
révoltent contre la dictature féministe et créent une ligue des « nouvelles féministes »
promouvant le statut féminin de « reine de la maison, reine de la famille, reine de
l’homme24 ».
GLAD!, 04 | 2018
122
Extrait du récit de Clément Vautel 1918
28 Les militantes pour les droits des femmes n’étaient pas dupes de ce distinguo entre bon
et mauvais féminisme. Maria Martin, directrice du Journal des Femmes, le démystifiait
dans un long éditorial qui se concluait par ces termes : « Le but que poursuivent les
féministes est partout le même et peut se résumer dans un mot : égalité de l’homme et
de la femme devant la loi. [...]. Voila le féminisme sans épithète. S’il vous convient, vous
l’appellerez le “bon féminisme”, et vous vous rangerez parmi ses adhérents. S’il vous
déplait, vous le nommerez le “mauvais féminisme”. Mais vous nous permettrez dans ce
cas de vous appeler antiféministes25 ».
29 Aujourd’hui, on retrouve un brouillage un peu comparable avec la revue catholique et
« bio-conservatrice » Limite créée en 2015 et le manifeste du « féminisme intégral » qui
a émergé dans son sillage26. Eugénie Bastié et Marianne Durano, qui sont à l’origine de
ce manifeste, revendiquent le terme de « féminisme » pour signifier le respect de la
différence des sexes et la valorisation du rôle maternel ; dans cette perspective, elles
dénoncent les revendications des associations féministes et LGBT en matière de droits
sexuels et reproductifs.
10. Peut-on catégoriser politiquement les traditions antiféministes en France ? À l’époquesur laquelle vous avez travaillé, les années 1870-1930, peut-on identifier les courantspolitiques les plus ouvertement antiféministes, les plus constants dans leurantiféminisme ?
30 Si on appelle « antiféminisme » le fait de s’opposer aux revendications féministes en les
dénonçant, en les empêchant d’aboutir ou en niant leur légitimité, l’antiféminisme est
présent dans tous les courants politiques. Mais il y a bien sûr toujours eu une diversité
de formes et de degrés d’antiféminismes, ce que rend bien visible l’ensemble des
travaux rassemblés par Diane Lamoureux et Francis Dupuis-Déri et antérieurement par
Christine Bard27. Sous la Troisième République, l’hostilité aux revendications d’égalité
GLAD!, 04 | 2018
123
des sexes était par exemple exprimée de façon tout à fait directe à l’extrême droite, car,
pour les adversaires du régime républicain, le féminisme était perçu comme un
épiphénomène des « principes de 1789 » et il pouvait être condamné à l’instar de
l’ensemble des « passions égalitaires » qui en découlaient.
31 Ceux qui, politiquement, se réclamaient de ces « principes de 1789 » étaient davantage
dans l’embarras pour rejeter les revendications d’égalité des sexes qui ne cessaient de
se réclamer elles-mêmes de la Révolution française. À gauche, d’autres stratégies
étaient mobilisées, par exemple le fait de décréter que les luttes féministes n’étaient
pas la priorité, que l’égalité des sexes allait se produire naturellement une fois
éliminées les autres formes d’injustices sociales ou encore que le féminisme était une
idéologie bourgeoise, comme on le disait au sein de la SFIO, fondée en 1905. C’est une
ressource argumentative qui n’a pas disparu, même si évidemment, la prise en compte
de l’agenda féministe par les partis politiques a changé du moment où les femmes sont
devenues électrices. L’une des caractéristiques de la Troisième République, concernant
les relations entre le féminisme et les autres clivages politiques, c’est aussi la
stupéfiante oscillation idéologique de certains acteurs. Certains qui soutenaient la
cause des femmes dans les années 1900-1910 opèrent un tournant conservateur au
cours des années 1930 et franchement réactionnaire sous Vichy. C’est particulièrement
frappant dans le champ intellectuel et littéraire ; un auteur comme Maurice Donnay
écrit par exemple une pièce de théâtre saluée par les féministes en 1912 où il met en
scène des intellectuelles et des artistes qu’il appelle des « éclaireuses », engagées de
façon heureuse dans leur vie amoureuse et professionnelle ; en 1941 il coordonne un
ouvrage collectif La femme et sa mission qui promeut le retour des femmes au foyer au
nom de leur vocation naturelle d’épouse et de mère.28
11. Par-delà l’antiféminisme, est-ce que les rhétoriques anti-égalitaires sont toujours plusou moins les mêmes ?
32 Depuis un siècle et demi, les adversaires des réclamations d’égalité des droits, qu’il
s’agisse de celles concernant les femmes, les étrangers, ou les minorités sexuelles, ont
été confrontés à une institutionnalisation croissante des valeurs égalitaires et, plus
récemment, au développement du droit antidiscriminatoire. Ce cadre de contrainte
partagé a en partie déterminé les similarités de leurs rhétoriques. L’égalité des droits
étant censée constituer un principe central de la République, inscrite dans les textes
juridiques fondamentaux à l’échelle nationale et européenne, il faut toujours
commencer la critique des aspirations égalitaires en se disant favorable à l’égalité. La
stratégie peut consister, comme je l’ai mentionné, à contester le diagnostic d’inégalité
ou de discrimination, en faisant valoir que l’égalité est déjà acquise et que les luttes
égalitaires n’ont donc plus lieu d’être ; les anti-égalitaires peuvent aussi s’en prendre
aux effets négatifs des demandes d’égalité ; telle ou telle revendication d’égalité
apparemment légitime produirait en fait des conséquences contraires à celles
escomptées, pour celles et ceux mêmes à qui ces mesures sont destinées : c’est
l’argument des « effets pervers » qu’avait bien analysé Hirschman29 ; on pointe aussi
l’enchaînement fatal d’effets catastrophiques pour la société entière des réclamations
égalitaires, selon la logique de l’effet « boule de neige » ou de la « pente savonneuse »
qu’a étudié Douglas Walton30. Les féministes de la fin du XIXe siècle avaient d’ailleurs
bien repéré cette rhétorique chez leurs adversaires et l’appelaient « l’argument de mal
en pis31 ».
GLAD!, 04 | 2018
124
33 Les assises idéologiques des arguments contre les droits des femmes, des homosexuels,
des étrangers n’ont cependant pas suivi la même évolution. Par exemple, l’idée d’une
différence biologique entre des groupes ethnoraciaux, qui était tout à fait dicible
jusqu’aux années 1950, surtout à l’extrême droite, mais aussi plus largement, dans le
discours commun, a été peu à peu remplacée par une essentialisation des différences
« culturelles » entre ces groupes. En matière de genre et de sexualité, le naturalisme
différentialiste est demeuré beaucoup plus vivace. L’idée que la moindre légitimité
sociale des couples homosexuels tiendrait au caractère naturel de l’hétérosexualité ou
que les inégalités des sexes au travail, à la maison, dans la sexualité, auraient des
sources biologiques (anatomiques, hormonales, neurologiques…) demeure encore
courante. Les savoirs cumulés des sciences sociales en matière de genre et de sexualité,
les conquêtes féministes/LGBTQ et les transformations des rapports de genre ont
fragilisé ce socle naturaliste de la pensée de la différence des sexes et des sexualités.
Mais je ne vois pas aujourd’hui de discours hostiles aux revendications des féministes et
des minorités sexuelles qui se passerait entièrement d’une référence à un ordre naturel
pour défendre la préservation des rôles de genre traditionnels.
BIBLIOGRAPHIE
AHMED, Sara. 2012. « Les rabat-joie féministes (et autres sujets obstinés) » Cahiers du Genre 53(2) :
77-98.
ARGOUARC’H Julie & CALAVREZO Oana. 2013. « La répartition des hommes et des femmes par
métier » DARES analyse 79.
BARD, Christine (dir.). 1999. Un siècle d’antiféminisme. Paris : Fayard.
BENTZON, Thérèse. 1887. Émancipée. Paris : Calmann-Lévy.
BIGOT, Marthe. 1921. La servitude des femmes. Paris : Librairie de l’humanité.
CAMBON, Paul. 1906. La femme et le fonctionnarisme. Publication issue d’une thèse de doctorat,
soutenue le 21 déc. 1906. Rennes : Faculté de Droit, Université de Rennes.
CORCOS, Ferdinand. 1931. Les avocates. Paris : Montaigne.
DELPHY, Christine (éd.). 2011. Un troussage de domestique. Paris : Syllepse.
DONNAY, Maurice. 1913. Les éclaireuses. Pièce en 4 actes. Paris.
DONNAY, Maurice (dir.). 1941. La femme et sa mission. Paris : Plon.
FAGUET, Emile. 1910. Le féminisme. Paris : Boivin & Cie éditeurs.
GATTI DE GAMOND, Isabelle. 1907. Éducation-Féminisme, édité par Hector Denis et Eugène Hins,
Paris-Bruxelles : V. Girard et E. Brière & Henri Lamertin.
HIRSCHMAN, Albert O. 1991. Deux siècles de rhétorique réactionnaires. Paris : Fayard.
GUILLAUMIN, Colette. 1992. Sexe, race et pratique du pouvoir. Paris : Côté Femmes.
GLAD!, 04 | 2018
125
HUGOUNET, Paul & VILLENEUVE, G. 1891. Doctoresse ! Pantomime en un acte. Paris : Maurice
Dreyfus éd.
JORAN, Théodore. 1908. Au cœur du féminisme. Paris : Arthur Savaète éditeur.
LAMOUREUX, Diane & DUPUIS-DÉRI, Francis (dir.). 2015. Les antiféminismes. Analyse d’un discours
réactionnaire. Montréal : Éditions du Remue-Ménage.
MARUANI, Margaret (éd.). 2013. Genre et travail dans le monde. Paris : La Découverte.
PREVOST, Marcel. 1912. « Le féminisme », in La femme dans la nature, dans les mœurs, dans la
légende, dans la société, BLED, Victor et alii (éd.). Paris : Bong et Cie.
RENNES, Juliette. 2007. « L’hégémonie des catégories cognitives et raisonnements naturalistes »
in Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige
(1880-1940), RENNES, Juliette. Paris : Fayard.
RENNES, Juliette. 2013. Femmes en métiers d’hommes (1890-1930). Une histoire visuelle du travail et du
genre. Saint-Pourçain : Bleu Autour.
ROUSSEL, Nelly. 1979 [1905]. L’éternelle sacrifiée. Conférence. Paris : Syros.
TURGEON, Charles. 1902. Le féminisme français. Paris : L. Larose.
WALTON, Douglas. 1992. Slippery Slope Argument. Oxford: Clarendon Press.
YVER, Colette. 1903. Les cervelines. Paris : Calmann-Lévy.
YVER, Colette. 1910. Les dames du palais. Paris : Calmann-Lévy.
YVER, Colette. 1923 [1907]. Princesse de science. Paris : Calmann-Lévy.
YVER, Colette. 1943. Madame sous-chef. Paris : Plon.
NOTES
1. RENNES, Juliette. « Cette tribune réhabilite un ordre social à l’ancienne » Le Nouveau Magazine
littéraire, 2 mai 2018 https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/-cette-tribune-
réhabilite-un-ordre-social-à-lancienne-
2. PREVOST, Marcel. 1912. « Le féminisme », in La femme dans la nature, dans les mœurs, dans la
légende, dans la société, BLED, Victor et alii (éd.). Paris : Bong et Cie, p.345.
3. Voir par exemple GATTI DE GAMOND, Isabelle. 1907. Éducation-Féminisme, édité par Hector
Denis et Eugène Hins, Paris-Bruxelles : V. Girard et E. Brière & Henri Lamertin, p.234-237.
4. Par exemple : BERYL, Luce. « La vie féminine. Causerie. Ceux qui nous suivent » Le Journal pour
Tous, Supplément hebdomadaire illustré du Journal, 24 fév. 1897, p.7 ; « Suiveurs » Le Froufrou, 26
déc. 1903 ; LA MESANGERE. 1908-1909. Les petits mémoires de Paris. Carnet d'un suiveur. Paris :
Dorbon l'aîné.
5. Voir par exemple BENTZON, Thérèse. 1887. Émancipée. Paris : C. Lévy.
6. Voir HUGOUNET, Paul & VILLENEUVE, G. 1891. Doctoresse ! Pantomime en un acte. Paris : Maurice
Dreyfus éd.
7. TURGEON, Charles. 1902. Le féminisme français. Paris : L. Larose, p. 299.
8. Voir RENNES, Juliette. 2013. Femmes en métiers d’hommes (1890-1930). Une histoire visuelle du travail
et du genre. Saint-Pourçain : Bleu Autour, p. 181-189.
9. RENNES, Juliette. 2007. « L’hégémonie des catégories cognitives et raisonnements
naturalistes » in Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions
de prestige (1880-1940), RENNES, Juliette. Paris : Fayard, 3e partie, chap. 1. En ligne ici.
GLAD!, 04 | 2018
126
10. GUILLAUMIN, Colette. 1992. Sexe, race et pratique du pouvoir. Paris : Côté Femmes.
11. Voir par exemple ROUSSEL, Nelly. 1979 [1905]. L’eternelle sacrifiee. Conference. Paris : Syros
« Memoire des femmes », p.49.
12. MARUANI, Margaret (éd.). 2013. Genre et travail dans le monde. Paris : La Découverte.
13. Rapport de la Commission Égalite Professionnelle et Questions Sociétales de l'UJA de Paris,
2012.
14. Voir par exemple ARGOUARC’H Julie & CALAVREZO Oana. 2013. « La répartition des hommes
et des femmes par métier » DARES analyse 79.
15. Voir par exemple TAGUIEFF, Pierre-André. « La nouvelle figure répulsive est l’homme blanc
hétérosexuel de plus de 50 ans » Le Figaro Magazine, 20 mai 2016.
16. FAGUET, Emile. 1910. Le féminisme. Paris : Boivin & Cie editeurs ; CORCOS, Ferdinand. 1931. Les
avocates. Paris : Montaigne.
17. YVER, Colette. 1903. Les cervelines. Paris : Calmann-Lévy ; YVER, Colette. 1910. Les dames du
palais. Paris : Calmann-Lévy ; YVER, Colette. 1923 [1907]. Princesse de science. Paris : Calmann-
Lévy ; YVER, Colette. 1943. Madame sous-chef. Paris : Plon.
18. LEFRANC. « Madame l’avocat » Mémorial a Amiens, 4 juillet 1899.
19. BIGOT, Marthe. 1921. La servitude des femmes. Paris : Librairie de l’humanité, p.10.
20. DELPHY, Christine (éd.). 2011. Un troussage de domestique. Paris : Syllepse.
21. AHMED, Sara. 2012. « Les rabat-joie féministes (et autres sujets obstinés) » (traduction
Oristelle Bonis) Cahiers du Genre 53(2) : 77-98.
22. CAMBON, Paul. 1906. La femme et le fonctionnarisme. Publication issue d’une thèse de doctorat,
soutenue le 21 décembre 1906. Rennes : Faculté de Droit, Universite de Rennes, p.113.
23. JORAN, Théodore. 1908. Au cœur du feminisme. Paris : Arthur Savaète éditeur, p.74 et p.52.
24. VAUTEL, Clément. « Le féminisme en 1958 » (récit) Je sais tout. 15 mai 1918.
25. MARTIN, Maria. « Les deux féminismes » Journal des femmes, mars 1908.
26. Voir DELAPORTE, Lucie. « Entre alterféminisme et antiféminisme, la droite tâtonne »
Mediapart, 11 fév. 2018. Pour une réponse féministe au « féminisme intégral », voir STORTI,
Martine. « Attention, détournements de féminismes » (tribune) Libération, 28 avril 2018.
27. LAMOUREUX, Diane & DUPUIS-DERI, Francis (dir.). 2015. Les antiféminismes. Analyse d’un
discours réactionnaire. Montréal : Éditions du Remue-Ménage ; BARD, Christine (dir.). 1999. Un
siècle d’antiféminisme. Paris : Fayard.
28. DONNAY, Maurice. Les Éclaireuses. Pièce en 4 actes. Paris, 1913 ; La Femme et sa mission. Paris :
Plon, 1941.
29. HIRSCHMAN, Albert O. 1991. Deux siècles de rhétorique réactionnaire. Paris : Fayard.
30. WALTON, Douglas. 1992. Slippery Slope Argument. Oxford: Clarendon Press.
31. « L’argument de mal en pis », Le Droit des femmes, juillet 1887.
RÉSUMÉS
Cet entretien porte sur les continuités et les recompositions de la rhétorique antiféministe depuis
la fin du XIXe siècle en France, en relation avec l’évolution sociale et politique des rapports de
genre et l’institutionnalisation de certaines conquêtes féministes.
This interview addresses the continuities and the recompositions of antifeminist rhetoric since
the end of the 19th century in France. The discursive and ideological transformations of
GLAD!, 04 | 2018
127
antifeminism are examined in the light of the social and political evolution of gender relations
and the partial institutionalization of feminist conquests.
INDEX
Thèmes : Explorations
Keywords : antifeminism, argumentation, couple, misogyny, work and gender
Mots-clés : antiféminisme, argumentation, couple, misogynie, travail des femmes
AUTEURS
JULIETTE RENNES
CEMS, EHESS
Juliette Rennes est maîtresse de conférences à l’EHESS, membre du Centre d’étude des
Mouvements sociaux. Ses recherches portent sur l’histoire des revendications d’égalité des droits
et leurs contestations depuis la fin du XIXe siècle en France. Elle a publié notamment Le mérite et la
nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige, 1880-1940 (Fayard,
2007) et Femmes et métiers d’hommes. Une histoire visuelle du travail et du genre, 1890-1930 (Bleu
autour, 2013).
GLAD!, 04 | 2018
128
Antiféminisme sur papier glacéLa rhétorique réactionnaire des magazines féminins
Antifeminism on Glossy Paper. Reactionary Rhetoric in Women’s Magazines
Auréline Cardoso
1 Des journaux issus des mouvements suffragistes à ceux dédiés à l’accomplissement du
rôle de « fée du logis », un certain nombre de publications rédigées par et pour les
femmes1 constituent le vaste domaine de la presse dite féminine (Sullerot 1996).
Catégorie commerciale plutôt que sociologique, la presse féminine agrège un champ
plus ou moins ample de titres selon la définition adoptée (Darras 2004). La presse
féminine est ici entendue comme un ensemble de magazines visant explicitement un
lectorat féminin (Blandin et Eck 2010), et dont les contenus contribuent à (re)définir les
attentes et préoccupations des femmes, tout en prétendant y apporter des réponses
(Giet 2005). S’arrogeant un rôle de compagnon, de guide (Bonvoisin et Maignien 1996),
les magazines féminins peuvent être considérés comme de véritables « technologies du
genre »2 (de Lauretis 2007), en ce qu’ils produisent un « sujet femme » doté de
caractéristiques et de pensées spécifiques (Ghigi 2004). Dès les années soixante-dix, des
ouvrages à charge dénoncent le caractère aliénant de la presse féminine (Dardigna
1978), travail qui se poursuit aujourd’hui notamment au travers d’études
journalistiques (Chollet 2012)3 ou d’articles militants de critique des médias4.
2 Cet article5 se propose d’analyser les rhétoriques antiféministes sous-jacentes à certains
articles issus de quatre titres de presse féminine (Marie-Claire, Biba, Elle et Femme
Actuelle) publiés entre mars 2012 et juin 2013. Ces quatre titres ont été choisis pour leur
caractère généraliste : ils proposent des articles sur des sujets de société autant que sur
le couple, l’éducation des enfants, la vie quotidienne, contrairement à d’autres
publications qui traitent de thèmes spécifiques comme la décoration, le corps et la
beauté. La taille des articles proposés (au moins une page) permet également une
certaine analyse de contenu. Marie-Claire, Elle et Biba se situent dans la tranche « haut
de gamme » de la presse féminine de par le contenu et le public visé, quand Femme
Actuelle s’adresse à un public plutôt composé de femmes issues des professions
intermédiaires (Darras 2004).
GLAD!, 04 | 2018
129
Titre Marie-Claire Biba Elle Femme Actuelle
Parution Mensuel Mensuel Hebdomadaire Hebdomadaire
Coût 2,20 1,90 2,20 2,00
Public cible
Femmes
trentenaires et
plus, actives,
mères, professions
libérales,
intellectuelles et
supérieures
Femmes entre vingt
et trente ans, actives,
avec ou sans enfants,
professions
intermédiaires et
intellectuelles et
supérieures
Femmes
trentenaires et
plus, actives,
mères, professions
libérales,
intellectuelles et
supérieures
Femmes
trentenaires et plus,
avec des enfants,
plutôt en couple,
professions
intermédiaires.
Contenu
(thèmes
récurrents)
Culture,
information « au
féminin »6, couple,
sexualité, mode,
beauté, santé,
décoration,
voyage
Culture, couple,
psychologie,
sexualité, mode,
beauté, santé, vie
quotidienne, voyage
Culture,
information « au
féminin » et
« people », mode,
beauté, santé,
sexualité, couple
Bien-être, conseils
pratiques,
décoration, famille,
psychologie
Diffusion7 397 431 317 938 351 121 645 183
3 Les articles ont été d’abord analysés individuellement, reprenant l’étude verticale
(Bertaux 1997 ; Bourdieu 1993), avant d’être mis en relation les uns avec les autres.
Pour chaque article, au-delà du contenu, l’analyse porte sur le champ lexical, le ton
employé par les journalistes (alarmant, humoristique, normatif, impératif…), ainsi que
sur les images notamment lorsqu’elles viennent renforcer le propos de l’article. Il s’agit
également de mettre en regard certains argumentaires, discours et statistiques
proposés dans ces articles avec la littérature, notamment sociologique, sur le sujet.
Cette démarche semble nécessaire, notamment parce que certains articles de presse
féminine présentent des épiphénomènes ne concernant qu’une minorité de personnes,
comme par exemple le célibat masculin, comme des faits sociaux massifs. Cela implique
notamment de rechercher des données objectives (statistiques, études empiriques) sur
les sujets traités par la presse féminine, ainsi que d’identifier les expertes et experts
convoqué-e-s par les articles pour donner une caution de sérieux aux propos énoncés8.
Enfin, il est question de repérer dans ces articles certaines techniques argumentatives
caractéristiques des rhétoriques antiféministes.
4 L’article s’articule autour des trois thèses identifiées par Albert O. Hirschman dans son
analyse des rhétoriques réactionnaires : la thèse de l’inanité, la thèse de l’effet pervers
et celle de la mise en péril (Hirschman 1991). En effet, analysant les discours hostiles à
la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle, ceux s’opposant au suffrage universel à la
fin du XIXe siècle et enfin les discours contre l’État-providence dans les années soixante-
dix, Hirschman montre comment à ces trois époques, les argumentaires mobilisent de
façon récurrente des registres argumentatifs similaires. La thèse de l’inanité postule
que toute transformation de l’ordre social est vaine, tant les structures sociales sont
contraignantes ; la thèse de l’effet pervers critique les moyens mis en œuvre pour
changer les choses, arguant qu’ils risquent d’aboutir à une aggravation de la situation
GLAD!, 04 | 2018
130
voire à un résultat contraire à celui escompté. La thèse de la mise en péril enfin, met en
garde contre le risque que les changements sociaux ne viennent bouleverser des droits,
avantages ou privilèges précédemment acquis. La force de ces trois thèses est qu’elles
permettent de s’attaquer aux changements sociaux, sans en contester les principes
directement ; à l’heure où l’égalité femmes-hommes est érigée en norme dans
différentes sphères sociales (le travail, la politique, le couple, la famille…), le recours à
ces stratégies permet de se distinguer des discours antiféministes plus explicites et
moins tolérés socialement. Un certain nombre d’analyses des discours antiféministes
reprennent par ailleurs les travaux d’Hirschman (Dupuis-Déri & Lamoureux 2015) et
montrent comment ces trois thèses sont identifiables dans ces discours, qu’il s’agisse de
s’opposer, par exemple, au suffrage féminin (Harden Chenut 2012) ou à la « théorie du
genre » (Carnac 2014).
5 Il s’agira ainsi, dans cet article, de voir comment ces trois stratégies argumentatives se
déploient dans les magazines féminins. Nous verrons d’abord que l’on retrouve la thèse
de l’inanité dans les discours sur le caractère indépassable des différences de sexe ;
ensuite, nous nous intéresserons à la thèse de l’effet pervers, qui imprègne les articles
sur les relations amoureuses, insinuant que les femmes paieraient de la solitude leur
indépendance. Enfin, la thèse de la mise en péril se retrouve lorsque les magazines
féminins se penchent sur la situation des hommes et reprennent la rhétorique
masculiniste de la « crise de la masculinité ».
6 La rhétorique est généralement définie comme l’art de convaincre et de persuader au
moyen de techniques du discours. C’est également une science, en ce qu’elle consiste en
la connaissance des propriétés du discours et la capacité à formuler « de beaux
discours », au service du discours en lui-même (Ducrot et Todorov 1972). Ainsi, si la
majeure partie de l’analyse porte sur le fond des argumentaires, nous chercherons à
identifier quelques-unes des techniques formelles utilisées, en termes de langage mais
également au travers des images illustrant les articles.
Un couple hétérosexuel forcément inégalitaire
7 Le sujet du couple hétérosexuel9 est omniprésent dans les magazines étudiés, et se
décline à travers de multiples papiers incitant les lectrices à prendre soin de leur
couple hétérosexuel, à le faire tenir malgré les difficultés. C’est dans deux articles
traitant des épreuves quotidiennes traversées par les couples que l’on retrouve la thèse
de l’inanité : en mettant en exergue l’incommensurabilité des différences entre femmes
et hommes, ces articles concluent que tenter de faire évoluer son conjoint, et viser une
répartition plus égalitaire du travail ménager10 est vain, voire dangereux.
D’indépassables différences
8 Dans les quatre magazines étudiés, hommes et femmes sont presque toujours présenté-
e-s comme incommensurablement différents, en termes de gouts et de capacités
biologiques, et également et peut-être surtout sur le plan psychologique11. Ces
différences pouvant rendre impossible la vie en couple, les magazines féminins
s’emploient à soutenir leurs lectrices dans la cohabitation avec l’homme, cet « autre »
aux mœurs étranges. Biba propose par exemple tous les mois une rubrique intitulée
« nos hommes : le plein d’infos pour mieux les comprendre (et les aimer !) ». L’usage du
GLAD!, 04 | 2018
131
pronom possessif nos révèle l’hétéronormativité du discours, incluant les lectrices
comme les journalistes du magazine dans une même communauté de femmes
hétérosexuelles. Donner à voir les liens entre journaliste et lectrice permet de légitimer
le rôle de « guide » du magazine, et participe à rendre les lectrices d’autant plus
disposées à suivre les conseils qui y sont dispensés (Bonvoisin et Maignien 1996).
9 La mise en page vient renforcer les discours, comme lorsque Femme Actuelle oppose les
témoignages des femmes et des hommes dans sa rubrique « psycho », séparant la page
en deux, une partie sur fond bleu étant réservée aux témoignages des hommes et
l’autre, sur fond rose, à ceux des femmes. Les photos illustrant les articles mettent
également en scène des formes de féminité hyperboliques et de masculinité
hégémonique (Connell 2014 ; Demetriou 2015), avec des femmes aux coiffures et tenues
sophistiquées, maquillées, épilées, et des hommes plutôt musclés, aux cheveux courts,
s’adonnant à des pratiques assignées aux hommes (sports collectifs, bricolage...).
Biba, nº 724, novembre 2012, page 126, article « Pourquoi ils aiment les femmes qui réussissent »
GLAD!, 04 | 2018
132
Elle, nº 3490, 16 novembre 2012, page 195, article « Je gagne plus que lui, et alors ? »
10 Les femmes représentées dans les illustrations présentent donc un certain nombre
d’attributs de la féminité conventionnelle (bijoux, maquillage, cheveux longs,
habillement).
11 En raison de ces différences pensées comme incommensurables, la cohabitation
hommes/femmes devrait nécessiter un certain nombre d’ajustements, et il semble, à
lire la presse féminine, que ce soit bien aux femmes de s’adapter aux hommes, et non
l’inverse12. Cela signifie notamment renoncer à l’idée d’un égal investissement des
hommes dans le travail ménager, puisque ceux-ci ne seraient pas dotés des capacités
nécessaires pour arriver au niveau des femmes :
Accepter qu’il fasse le ménage « à sa façon »Comment ça, « à sa façon » ? Qu’il frotte le sol avec le nez ? Ou lave lescarreaux à l’Harpic Power Plus ? Mais non. Ça veut juste dire qu’on baissenotre exigence d’un cran. Il faut s’y résigner, Max ne fera pas le ménagecomme nous, mais c’est déjà ça : selon l’INSEE (en 2010), les hommes passent2 h 24 par jour aux tâches domestiques, contre 3 h 52 pour les femmes...« 20 idées pour mettre plus d’amour dans sa vie », Biba, Juin 2013, n° 400, p.86
12 Là encore, la journaliste joue de la proximité avec les lectrices (« Max ne fera pas le
ménage comme nous ») ; le ton humoristique, l’exagération quant aux techniques
supposément masculines de ménage (« qu’il frotte le sol avec le nez »), évoque presque
une conversation amicale à laquelle journaliste et lectrice prendraient part. Cela vient
servir le propos différentialiste : toutes les femmes, journalistes de Biba comprises,
rencontrent le même problème avec leurs conjoints dans la répartition des tâches
ménagères. Face à ce problème, présenté comme indépassable et universellement
rencontré par une « communauté » de femmes hétérosexuelles créée artificiellement
GLAD!, 04 | 2018
133
par la journaliste, l’attitude la plus « raisonnable » serait donc de « se résigner » à la
moindre participation des hommes, présentée implicitement comme suffisante (« c’est
déjà ça »).
13 Le moindre temps que les hommes consacrent au travail ménager n’étant pas
problématisé ni expliqué notamment par la socialisation masculine qui n’entraine pas
les hommes (contrairement aux femmes) à prendre part aux tâches ménagères,
l’inégale répartition du travail ménager est renvoyée à une évidence « naturelle ».
Cette naturalisation de l’inaptitude masculine à accomplir les tâches domestiques laisse
dans l’ombre la question de la socialisation sexuée, qui prépare dès le plus jeune âge les
filles à entretenir un foyer et à développer un gout pour la propreté (Gianini Belotti
1976).
14 De même, Biba conseille à ses lectrices de se montrer encourageantes lorsque leurs
conjoints font des efforts, et de valoriser leur participation au travail ménager et
parental :
Quand on rentre, on se fend d’un « c’était cool ? » plutôt que de lui demanders’il a pensé à brosser les dents de la marmaille. Un homme préfère que sapapaïsation soit un jeu, plutôt qu’un devoir […]. On dit bravo quand il pense àprogrammer le lave-linge. S’il passe mal la cire d’abeille, on ne le sermonnepas.« 20 idées pour mettre plus d’amour dans sa vie », Biba, Juin 2013, n° 400, p.86
15 Les lectrices doivent donc ruser pour que leur conjoint accepte d’endosser une partie
du travail ménager, et elles sont incitées à ne pas se montrer trop exigeantes, mais
plutôt à exprimer leur gratitude. L’utilisation du pronom on, par ailleurs assez courant
chez Biba, accentue le caractère injonctif du propos, tout en laissant entendre que la
journaliste du magazine agirait de même avec son conjoint. Il semble que ce procédé
rhétorique ne soit pas spécifique à ce magazine, puisqu’Anne-Marie Dardigna soulignait
déjà la tendance récurrente à mobiliser ce pronom dans la presse féminine, dès les
années 1970 (Dardigna 1978).
16 On peut ajouter qu’en plus de prendre en charge l’organisation du travail ménager, les
lectrices sont invitées à se soucier du bien-être émotionnel de leur conjoint (« un
homme préfère que sa papaïsation soit un jeu ») : c’est une double charge mentale qui
leur incombe. Comme le soulignent les travaux sur le care, l’assignation des femmes à
prendre soin des autres reste perçue comme une évidence, leurs compétences en la
matière étant ainsi naturalisées (Molinier et al. 2009 ; Tronto 2008).
Chassez le naturel..
17 Aux lectrices qui seraient tentées de remettre en cause ce partage inégal des tâches, un
article de Femme Actuelle vient rappeler que l’on ne trouble pas l’ordre sexuel, érigé au
rang d’ordre naturel, sans conséquence.
Vous lui réclamez à cor et à cri de passer la serpillière ou de se coller aurepassage. Mais quand il le fait, un certain malaise s’empare de vous. « Pourcertaines femmes, un homme plongé dans des tâches réputées fémininesperd de sa puissance sexuelle : elles peuvent oublier tout désir pour lui. Etcela arrive même à la féministe la plus convaincue ! Pour la simple raisonque le désir pour l’autre sexe ne se construit pas intellectuellement, mais sur
GLAD!, 04 | 2018
134
des schémas parfois très archaïques » remarque Catherine Serrurier.« Partage des tâches : c’est bien de tout calculer ? », Femme Actuelle, 16Décembre 2012, n°1472, p. 55
18 L’intervention de l’experte Catherine Serrurier (présentée comme psycho-sexologue,
donc spécialiste des rouages du désir sexuel), renforce et légitime le propos
naturalisant de l’article, qui s’inscrit lui-même dans un certain discours de sens
commun véhiculé par d’autres médias (Jonas 2011).
19 Toujours dans cet article, on peut lire qu’un homme qui refuse d’effectuer certains
travaux domestiques est avant tout un homme « peu sûr de sa virilité ». Cette crainte
que les hommes perdent leur « puissance sexuelle » (ou, autrement dit, leur virilité), en
effectuant des tâches habituellement assignées aux femmes, renvoie aux travaux
anthropologiques qui établissent que c’est bien la division sexuelle du travail qui fait le
genre (Tabet 1998 ; Guillaumin 1992). Il s’agit, par cette répartition, de lutter contre le
« tabou de la similitude » :
La division du travail selon le sexe peut donc être vue comme un « tabou » : untabou contre la similitude des hommes et des femmes, un tabou divisant les sexesen deux catégories mutuellement exclusives, un tabou qui exacerbe les différencesbiologiques entre les sexes et, par-là, crée le genre. La division du travail peut aussiêtre vue comme un tabou contre les arrangements sexuels autres que ceuxcomportant au moins un homme et une femme, prescrivant de ce fait le mariagehétérosexuel. (Rubin 1998)
20 L’argument de l’indépassable nature permet donc de valoriser le maintien du statu quo,
et d’inciter les lectrices à abandonner toute velléité de subversion des rôles féminins et
masculins et de remise en cause de la division sexuelle du travail, enjeu matériel et
fondamental des rapports sociaux de sexe (Kergoat 2000). Voici comment Catherine
Serrurier promeut, dans ce même article, le statu quo pour préserver l’équilibre du
couple :
Et si la solution passait par la recherche de complémentarité plutôt que cellede la parité absolue ? « En laissant faire à chacun ce qu’il déteste le moins à lamaison, sans tenir compte du temps précis que cela prend à chacun, onménage le sentiment amoureux. On est dans l’écoute de l’autre et de sesdésirs, dans la prise en considération de ses goûts, de ses détestations et deses limites. C’est mieux que la revendication hargneuse, l’agressivité et lesreproches infantilisants parce que l’autre n’a pas obéi ! » estime CatherineSerrurier […]. Il n’y a pas de honte à opter pour un partage traditionnel destâches, à l’ancienne : à la femme le ménage, à l’homme le bricolage ».« Partage des tâches : c’est bien de tout calculer ? » Femme Actuelle, Décembre2012, n° 1472, p. 54-55
21 Le modèle « traditionnel » de partage des tâches (« à la femme le ménage, à l’homme le
bricolage ») est opposé à un idéal de « parité absolue »13, ce dernier ouvrant la brèche
aux conflits (« revendication hargneuse », « agressivité », « reproches infantilisants »),
alors que le partage « à l’ancienne » est lui associé à l’harmonie conjugale (« écoute de
l’autre », « prise en compte de ses goûts, de ses détestations et de ses limites »).
Comment mieux convaincre de l’inanité du combat pour le partage égalitaire des tâches
ménagères qu’en brandissant l’épouvantail du divorce ? Cet article de Femme Actuelle
évoque par ailleurs une étude norvégienne qui révèle que les ménages où les tâches
sont partagées le plus équitablement sont aussi ceux où l’on divorce le plus, ce qui
permet au magazine d’affirmer que le partage des tâches serait « une cause de
GLAD!, 04 | 2018
135
séparation »14. Le message est donc clair : mieux vaut passer l’éponge derrière son
conjoint plutôt que d’entrer dans de vaines négociations susceptibles de nuire à
l’équilibre conjugal.
22 Ces deux articles évoquant le partage du travail ménager donnent à voir comment la
thèse de l’inanité est mobilisée pour enjoindre les lectrices à renoncer à combattre la
« naturelle » division sexuelle du travail, aussi inégalitaire soit-elle. Non seulement il
serait vain de vouloir partager équitablement ce travail ménager, mais en plus cela
serait un danger pour le couple.
23 La thèse de l’inanité est mobilisée de deux manières différentes : tout d’abord, en
présentant constamment les hommes et les femmes comme infiniment différents, les
magazines féminins tendent à valoriser la complémentarité, qui apparait comme plus
raisonnable qu’une recherche d’égalité, puisqu’elle s’inscrit dans le respect de
différences présentées comme naturelles. Ensuite, l’exemple du travail ménager vient
renforcer l’idée selon laquelle la division sexuelle du travail, et notamment du travail
reproductif, découlerait d’aptitudes naturelles différenciées et non de rapports de
pouvoir structurants (Tabet 1998). Inciter son conjoint à prendre une part égale à ce
travail serait alors perdu d’avance, les hommes étant présentés comme naturellement
incapables de faire aussi bien que les femmes dans ce domaine. Contre l’apparente
symétrie de ce partage « traditionnel » des tâches, les recherches empiriques et
statistiques viennent rappeler qu’au-delà du fait que les femmes consacrent plus de
temps au travail ménager, les tâches assignées aux hommes comme le bricolage ou le
jardinage procurent une certaine satisfaction, ce qui n’est pas le cas des tâches très
féminisées comme l’entretien du linge (Brousse 2015). De plus, ces derniers travaux se
répètent quotidiennement, impliquent une gestion du temps et une charge mentale
(Haicault 2005) incomparable avec un travail de bricolage, qui peut certes être
chronophage le temps d’un week-end, mais n’oblige pas à articuler quotidiennement
les contraintes professionnelles et domestiques. Si, dans une perspective matérialiste,
on considère que le travail est bien au cœur de la (re)production des rapports sociaux
de sexe (Kergoat 2000), on peut raisonnablement soutenir que ces articles participent à
maintenir un ordre de genre inégalitaire.
Des femmes indépendantes qui effraient les hommes
24 Deux des articles étudiés font référence implicitement à la thèse de l’effet pervers : idée
selon laquelle les avancées sociales permises par les luttes féministes se retourneraient
contre les femmes. Les articles traitant du célibat féminin ou des difficultés à séduire
les hommes (ou plutôt à être séduites par eux) illustrent particulièrement bien ce
phénomène.
L’épouvantail de la célibataire repentie
25 Un article de Marie-Claire consacré aux femmes célibataires « de longue durée », est
l’occasion de mettre en scène la figure repoussoir de la célibataire repentie. Bien qu’il
date de 2012, on retrouve des constats très similaires à ce que relève près de vingt ans
plus tôt Érika Flahault dans son ouvrage sur les femmes vivant seules, dans lequel elle
montre comment la presse généraliste comme féminine présente le célibat féminin
comme un triste sort (Flahault 2009)15. Dans cet article où cinq femmes célibataires
GLAD!, 04 | 2018
136
témoignent, le vocabulaire utilisé pour faire référence à leur situation évoque une
situation plus subie que choisie : une femme parle de son célibat comme d’une « prison
solitaire » et l’article évoque des femmes se retrouvant dans un « désert amoureux »16.
Les photos illustrant le papier renforcent ce propos.
« Tout pour plaire… et toujours célibataire », Marie-Claire, mars 2012, nº 716.
« Tout pour plaire… et toujours célibataire », Marie-Claire, mars 2012, nº 716. (2)
GLAD!, 04 | 2018
137
26 L’image du haut met en scène une femme pourvue de certains attributs de réussite
économique (bijoux, vêtements de luxe, bouteille de champagne, table dans un
restaurant haut de gamme, etc.). Il semble qu’elle paie sa situation économique
enviable par le célibat, puisqu’elle est au restaurant avec son chien, qui se substitue au
conjoint que l’on imagine qu’elle n’a pas su garder ou rencontrer. L’image du bas met
en scène la solitude supposée des femmes célibataires dans la vie quotidienne, avec une
femme qui va seule au café. Ce qui pourrait dans un autre contexte revêtir une
dimension positive (la possibilité pour une femme d’être seule dans l’espace public),
vient ici plutôt renforcer les propos de l’article, notamment en associant cette image
d’une femme qui semble indépendante, décidée, aux propos de Léa qui dit s’être rendue
inaccessible pour les hommes.
27 Cet article de Marie-Claire s’ouvre sur le constat du sociologue Pascal Lardellier17, qui
explique que le nombre de célibataires est passé de 6 à 12 % en France en trente ans ;
l’auteure cite ensuite une étude de l’INED sur les personnes résidant seules en France
pour expliquer que le nombre de femmes vivant seules a doublé entre 1962 et 2007, et
la proportion d’hommes dans le même cas a triplé. De ces statistiques, l’article tire la
conclusion que le célibat touche alors de plus en plus de personnes et notamment de
femmes, le présentant comme un phénomène presque « épidémique », sur un ton
alarmant. Pour autant, comme le rappellent plusieurs recherches, les statistiques sur le
célibat recouvrent une large palette de situations, allant du « véritable célibat » aux
couples décohabitants, en passant par les couples non mariés ni unis civilement
(Flahault 2009 ; Frischer 1997). Dès les années 1990 en France et 1980 aux États-Unis, les
magazines féminins et hebdomadaires grand public gonflaient déjà les chiffres du
célibat pour faire croire à une solitude moderne, dont les mouvements féministes
étaient rendus responsables (Frischer 1997 ; Faludi 1993).
28 L’article donne ensuite la parole aux femmes célibataires, qui exposent leurs doutes
sinon leurs regrets quant aux choix qu’elles ont pu faire :
À 20 ans, c’était moi qui avais le plus de succès dans la bande, se souvientCaroline, 34 ans. Depuis, j’enchaîne les fiascos amoureux, je ne sais paspourquoi. Je ne peux même pas tirer de leçon de mes échecs car je suis dansun schéma de répétitions. Mes amis m’ont présenté tous leurs prochescélibataires, avec lesquels, évidemment, ça n’a pas collé. […] Léa racontecomment elle a quitté Marc, il y a cinq ans, parce qu’elle ne voulait pas queleur « belle histoire s’enlaidisse », et a plongé à cœur et corps perdu dans sanouvelle vie de célibataire, savourant une liberté qu’elle avait quitté trop tôt.Mais à 43 ans, elle commence à désespérer de retomber amoureuse. « J’aipeur de m’être endurcie, analyse-t-elle. (...) C’est un cercle vicieux car plus letemps passe, plus mon armure de célibataire se perfectionne. Celui quiarrivera à me libérer de ma prison solitaire sera le plus courageux et le plusvaillant ! »« Tout pour plaire... et toujours célibataires » Marie-Claire, Mars 2012, n°716, p. 162
29 Ces deux femmes ont donné la priorité à leur liberté à un moment de leur vie : Caroline
n’a pas souhaité s’engager trop tôt et Léa a décidé de mettre fin à une histoire qui ne lui
convenait plus. Leurs témoignages servent à incarner la figure de la « célibataire
repentie » : elles ne remettent pas forcément en cause leurs choix, mais elles admettent
éprouver quelques regrets, voire ressentir une certaine angoisse face au temps qui
passe. La menace de finir ses jours « seule » semble très prégnante pour Léa. Les mots
GLAD!, 04 | 2018
138
choisis pour parler de leur situation sont éloquents : « fiasco amoureux », « prison
solitaire », etc.
30 Toutes deux se rendent responsables de leur situation, Caroline mentionne « un
schéma de répétition », Léa pense qu’elle se rend malgré elle inaccessible, avec son
« armure de célibataire ». Toutes deux font figure de modèle repoussoir pour les
lectrices, et leurs récits fonctionnent comme des avertissements : on peut choisir de
privilégier sa liberté, on a le droit d’attendre beaucoup des relations amoureuses, mais
le temps passe, la solitude menace, et, avec elle, le remords d’avoir en quelque sorte
laissé passer sa chance. La façon dont est présentée l’histoire de Léa sonne comme une
mise en garde à peine voilée : l’utilisation de l’expression « à cœur et corps perdu »
évoque la souffrance amoureuse, et la mention de son âge (43 ans) vient implicitement
rappeler aux lectrices que vouloir retrouver une vie de célibataire à l’approche de la
quarantaine est un pari risqué. L’article donne la parole à un deuxième type de
« célibataire repentie », celle qui a donné la priorité à sa carrière et n’a, par
conséquent, pas pu fonder une famille :
À un moment, il faut choisir, résume Suzanne, 47 ans. Et c’est cruel. J’ai faitde longues études, puis me suis lancée dans un boulot passionnant qui meconduit aux quatre coins du monde. (...). À l’âge où les autres se casaient,j’explorais les possibles. Le couple qui dure, la famille c’était pour « quand jeserai grande ». J’ai même renoncé à un homme que j’aimais profondémentmais qui, lui, était plus pressé. Et dû me rendre à l’évidence, quelques annéesplus tard, que j’avais peut-être laissé passer ma chance. (...) Je ne dis pas qu’iln’y a pas une forme d’amertume en moi. Mais cette femme hyperactive, quin’a jamais manqué d’amis, d’amours et d’adrénaline, sans jamais supporter laroutine ni su tisser une relation durable, c’est moi. J’ai choisi sans le vouloir.La suite risque d’être difficile mais je ne me projette pas. J’aurais sans douteété plus malheureuse autrement. »« Tout pour plaire... et toujours célibataires » Marie-Claire, Mars 2012, n°716, p. 158
31 Là encore, le témoignage fonctionne comme une piqûre de rappel pour les lectrices :
elles sont libres, comme Suzanne, de privilégier leur carrière et leur bien-être
personnel, mais elles pourraient le regretter ensuite : l’horloge biologique tourne, et
vient le jour où il est trop tard pour songer à la vie de famille. Même si Suzanne semble
apprécier la vie qu’elle mène (« j’aurais sans doute été plus malheureuse autrement »),
elle dit aussi qu’elle a « choisi sans le vouloir ».
32 Le récit de Suzanne est le plus « nuancé » de l’article, notamment parce qu’il laisse la
place à la réflexivité de cette femme qui assume ses choix tout en mettant en avant
certaines de leurs conséquences. Mais pour autant, tout se passe comme si le célibat
féminin ne pouvait être un choix dicible ; la situation doit être justifiée par d’autres
contingences (le travail, les longues études). On retrouve ici des logiques similaires à
celles des personnes volontairement sans enfants, qui doivent trouver des arguments
pour expliquer un choix de vie stigmatisé et stigmatisant (Debest 2014). Érika Flahault
dans sa recherche sur les femmes seules, montre combien il est difficile d’assumer
pleinement ce choix ; et, de fait, parmi les femmes qu’elle a rencontrées, seule une
minorité dit en être heureuse et ne pas souhaiter un autre style de vie (Flahault 2009).
33 Ainsi le parti pris de l’article est bien de donner à voir des témoignages de femmes qui
subissent leur célibat, témoignages qui auraient pu être nuancés par la mobilisation
d’autres expériences de femmes qui apprécient leur célibat. Ici, l’on voit comment l’un
GLAD!, 04 | 2018
139
des gains des luttes féministes, à savoir la possibilité pour les femmes de s’extraire,
temporairement ou définitivement, de l’obligation de la conjugalité, est implicitement
présenté comme finalement délétère pour les femmes, qui après avoir profité de leur
liberté, éprouveraient des remords lorsque, à l’aube de la quarantaine, elles sont encore
célibataires.
Une indépendance qui fait peur aux hommes
34 L’autre « effet pervers » de cette indépendance nouvellement acquise par les femmes
serait à trouver, selon la presse féminine, dans les bouleversements survenus dans les
rapports de séduction hétérosexuels. Les femmes trop sûres d’elles ou trop
indépendantes effraieraient les hommes, une idée de sens commun renforcée par les
propos du sociologue Jean-Claude Kauffmann, sollicité par Marie-Claire :
Marie-Claire : Et les hommes dans tout ça ?Jean-Claude Kaufmann : Ils ont peur ! Ces femmes les séduisent, mais pour unengagement sur le long terme, c’est plus compliqué. Ils sont, eux aussi,devenus plus exigeants, mais pas sur les mêmes critères. Les femmes rêventde passion, veulent une vie de couple riche, alors qu’eux ont tendance àrechercher la tranquillité auprès d’une douce compagne »« Tout pour plaire... et toujours célibataire » Marie-Claire, Mars 2012, n° 716,p. 162
35 Si Jean-Claude Kaufmann ne nous dit pas de quoi les hommes ont peur, il révèle par
contre ce qu’ils veulent : une compagne douce et tranquille. Dans un magazine qui
s’adresse à un lectorat essentiellement féminin, et dans un article consacré aux causes
du « célibat de longue durée » chez les femmes, la parole du sociologue qui explique ce
que veulent les hommes fonctionne comme un conseil : mieux vaut essayer de s’y
conformer, au risque de rester seule. Un article du magazine Biba, s’alarmant de ce que
les hommes n’oseraient plus aborder les femmes, met également ce retournement de
situation sur le compte de la peur que leur inspireraient les femmes : « À croire qu’on
en serait arrivées à faire peur aux hommes... Et que le féminisme de nos mères se serait
mué en une féroce agressivité ! »18. L’association entre le féminisme et la peur que ce
mouvement inspire aux hommes fait partie de l’arsenal rhétorique des antiféministes :
entre autres maux, le féminisme est régulièrement accusé de porter préjudice aux
femmes, les empêchant notamment de développer des relations de couple
harmonieuses (Lamoureux 2008). Parmi les critiques adressées aux mouvements
féministes, la supposée agressivité de ses protagonistes est régulièrement mentionnée
(Bard 1999), notamment au travers du mythe des féministes brulant leur soutien-gorge,
alors que rien ne prouve que cela soit arrivé réellement (Bard 2012). Enfin, évoquer « le
féminisme de nos mères », permet à la journaliste, encore une fois, de jouer avec la
proximité de génération, réelle ou supposée, tout en mettant à distance le féminisme.
Pour ces femmes nées dans les années 1980, le mouvement féministe dit de la deuxième
vague19 appartient au passé. Il semble ici relever d’un héritage quelque peu encombrant
et indésirable : ces femmes élevées dans le sillage du militantisme féministe porteraient
en elles, à leur insu, « une féroce agressivité ».
36 Cette indépendance des femmes est perçue par certains hommes comme une prémisse
à d’autres bouleversements sociétaux, mettant à mal l’union hétérosexuelle : « Les
femmes de 30-35 ans partent du principe qu’elles n’ont plus besoin de nous, que ce soit
GLAD!, 04 | 2018
140
financièrement ou physiquement, rage Philippe, 34 ans. Même pour faire un enfant,
nous sommes limite superflus ! »20. Cet extrait met en lumière l’importance de la
complémentarité dans le maintien des rapports sociaux de sexe, cette complémentarité
socialement créée venant justifier la nécessité de l’union hétérosexuelle (Rubin 1998).
Ainsi, dans un monde, largement fantasmé, où les femmes pourraient se passer des
hommes pour tout, l’ordre de genre serait menacé. Ce témoignage est révélateur de la
crainte, voire de la colère (Philippe « rage »), que l’émancipation des femmes peut
inspirer à certains hommes. Philippe est un homme qui a l’impression de voir ses
privilèges décliner avec les avancées sociales permises par le féminisme, et qui se sent
lésé, injustement dénigré. Il faut souligner que ces propos quelque peu exagérés ne sont
pas nuancés dans l’article, qui pourrait par exemple rappeler que la vie des femmes
cheffes de famille monoparentale est loin d’être simple21, ou que l’accès aux techniques
de procréation médicalement assistée reste presque exclusivement réservé aux couples
hétérosexuels.
37 L’autonomie des femmes est à nouveau critiquée, de manière plus sournoise, dans le
même article, à travers le témoignage d’un autre homme, Jean-Philippe, 36 ans, qui
critique l’attitude trop indépendante de son ex-compagne, jugée excessive :
Mon ex passait son temps à me faire comprendre qu’elle n’avait pas besoinde moi. Je ne sais pas si c’était un relent de féminisme ou une fierté malplacée, mais dès que je voulais l’aider, elle refusait sec. Sauf que sur le fond,jouer à l’homme est très valorisant, que ce soit pour raccompagner une filleou changer une ampoule !« Au secours, les hommes ne draguent plus ! » Biba, Mars 2013, n° 397, p. 96
38 Pour avoir envie de séduire les femmes, les hommes devraient donc pouvoir jouer le
rôle de protecteur ; l’arrangement des sexes décrit par Goffman, assignant aux hommes
la tâche de secourir les femmes et de les éloigner de tout ce qui est salissant, lourd,
dangereux (Goffman 2002), est alors présenté comme un élément essentiel du processus
de séduction hétérosexuel. Les femmes qui refusent d’exécuter l’acte de la « demoiselle
en détresse » courraient le risque de faire fuir les hommes, qui se sentiraient inutiles et
seraient rendus incapables de « faire » leur genre (West et Zimmerman 1987).
39 À travers ces articles sur le célibat ou sur les transformations dans les rapports de
séduction hétérosexuels, les magazines féminins nourrissent la thèse de l’effet pervers,
selon laquelle les avancées sociales permises par le féminisme se retourneraient contre
les femmes. Celles-ci paieraient le prix de leur liberté par une forme de solitude, soit
parce qu’elles auraient trop attendu pour former un couple, soit parce que leur
indépendance effraierait et repousserait les hommes.
40 Dans les articles présentés dans cette section, les témoignages des hommes et des
femmes ont deux fonctions distinctes. Ceux des femmes célibataires de longue durée
visent à avertir les lectrices des conséquences potentielles si elles privilégient leurs
carrières, ou repoussent l’installation dans une vie de couple. En revanche, les propos
des hommes incitent les lectrices à adopter des comportements qui rassurent les
hommes, c’est-à-dire ne pas paraitre trop indépendantes. Dans des magazines qui font
du couple hétérosexuel un élément indispensable au bonheur, ces témoignages
masculins sur ce que les hommes attendraient d’une potentielle compagne
fonctionnent comme des conseils, voire des injonctions. Les propos d’« experts »,
comme le sociologue Jean-Claude Kauffman, contribuent à donner une apparence de
fait social massif à un phénomène finalement circonscrit à un petit nombre d’individus,
GLAD!, 04 | 2018
141
et les témoignages viennent en quelque sorte incarner ce phénomène. Les quelques
informations disponibles sur leurs auteur-e-s (âge, statut conjugal, éventuellement
profession), peuvent amener les lectrices à s’identifier ou à y reconnaitre certain.es de
leurs proches, renforçant ainsi l’impression de réel. De plus, la parole à la première
personne, qui exprime un ressenti difficilement contestable, participe à conférer une
légitimité au propos de l’article : ce n’est pas seulement la journaliste qui le dit, mais
également des femmes et hommes « ordinaires ».
Le masculinisme dans les magazines féminins
41 Si les magazines étudiés visent un lectorat féminin, les hommes en peuplent les pages :
outre leur omniprésence dans les articles portant sur les relations amoureuses, certains
papiers sont entièrement consacrés à la condition masculine, qui est régulièrement
présentée comme étant en déclin. Dans les magazines étudiés, quatre articles sont
exclusivement consacrés à une supposée transformation de la situation des hommes.
L’angle de vue choisi nourrit très souvent l’idée selon laquelle les hommes seraient
sortis perdants des bouleversements survenus dans les rapports sociaux de sexe au
cours de la seconde moitié du XXe siècle. Puisqu’il s’agit ici de repérer les déclinaisons
de la thèse de la mise en péril, deux grandes thématiques seront mentionnées : la perte
de pouvoir des hommes sur le plan économique, et la dévalorisation de la virilité ainsi
que ses conséquences sur le plan des relations affectives.
L’inéluctable déclin des hommes
42 L’arrivée des femmes sur le marché du travail suscite et a suscité des réactions
masculines de défense, notamment de la part des syndicats, craignant que cela fasse
baisser leurs salaires ou dénonçant une concurrence déloyale (Battagliola 2004 ;
Dupuis-Déri 2012). La question du pouvoir économique est présente dans bon nombre
de discours masculinistes, mobilisant la thèse de la mise en péril pour alerter sur une
dégradation de la position des hommes sur le marché du travail. On retrouve cette idée
dans les magazines féminins étudiés, qui, tout en célébrant l’indépendance économique
des femmes, déplorent que celle-ci se fasse au détriment des hommes.
43 Ainsi, dans un article consacré aux rapports de séduction, Biba citant Hanna Rosin 22,
assure que l’heure serait à la « mancession », les hommes étant condamnés au chômage
dans une société post-industrielle qui n’a « que faire des muscles »23. Un article de Elle
sur le célibat masculin affirme que les femmes peuvent désormais se passer des
hommes, car elles seraient « plus diplômées, mieux insérées, moins mal payées »24.
Dans un autre numéro, le magazine Elle propose une interview d’Hanna Rosin, qui vient
exposer les thèses de son ouvrage25.
44 Le magazine Elle du 8 mars 2013 (n° 3506) offre à Hanna Rosin une tribune pour exposer
ses thèses. Si le livre d’Hanna Rosin est plus nuancé qu’un argumentaire purement
masculiniste et mentionne les obstacles existant à l’égalité réelle, la ligne adoptée par
l’article insiste particulièrement sur les idées masculinistes reprises par la journaliste.
Le titre (« Les hommes sont-ils finis ? »), l’usage d’expressions telles que « la fin des
hommes », « le déclin des hommes » dans les questions posées par la journaliste, ainsi
que la photo choisie pour illustrer l’article viennent plutôt appuyer la thèse de la mise
en péril.
GLAD!, 04 | 2018
142
« Les hommes sont-ils finis ? » Elle, 8 mars 2013, n° 3506
Capture d’écran du site internet : http://www.elle.fr/Societe/Les-enquetes/Les-hommes-sont-ils-finis-2391376# page consultée le 13 février 2017
Elle : Dans votre essai, vous soutenez que la ‘‘fin des hommes’’ est arrivée,c’est de la provocation ?Hanna Rosin : Bien sûr, mais pas seulement ! (...) Plusieurs professions sesont féminisées, alors qu’aucun métier ne s’est franchement masculinisé. Leshommes que j’ai rencontrés sont tétanisés à l’idée d’embrasser de nouveauxrôles : aide-soignant, père à plein-temps... Ils ont du mal à trouver leur place.Elle : Ce déclin des hommes découlerait selon vous d’une dégringoladeéconomique ?Hanna Rosin : Tout à fait. Nous sommes passés d’une société industrielle àune économie de services. La force naturelle des hommes n’est plusdéterminante dans la course aux jobs. En 1950, un homme sur vingt netravaillait pas. Aujourd’hui, c’est un homme sur cinq qui est au chômage.Dans le même temps, les femmes sont devenues majoritaires parmi lapopulation active américaine. En France, elles représentent 58 % desmédecins de moins de 35 ans et près d’une Brésilienne sur trois gagne plusd’argent que son mari.« Les hommes sont-ils finis ? » Elle, 8 mars 2013, n° 3506, p. 117
45 L’une des stratégies récurrentes des rhétoriques masculinistes consiste à tordre la
réalité au moyen d’interprétations fallacieuses des statistiques, voire en avançant des
chiffres peu fondés empiriquement (Descarries 2005). C’est cette stratégie que l’on
retrouve dans les propos d’Hanna Rosin, qui, en citant trois cas distincts
(l’augmentation du chômage des hommes, la prépondérance des femmes parmi les
jeunes médecins, et le salaire des Brésiliennes), tire une conclusion peu nuancée sur la
situation économique des femmes, qui serait désormais plus enviable que celle des
GLAD!, 04 | 2018
143
hommes. On peut également souligner combien le vocabulaire employé pour parler des
hommes, par la journaliste de Elle comme par Hanna Rosin, aiguise l’impression d’une
forme de crise dans la situation des hommes (« déclin », « dégringolade », « les hommes
sont tétanisés », « ils ont du mal à trouver leur place »).
46 Une remise en contexte de ces éléments amène à relativiser l’ascension économique des
femmes, ainsi que leur responsabilité dans la perte de pouvoir économique des
hommes. En ce qui concerne le chômage tout d’abord, il a effectivement augmenté plus
rapidement chez les hommes que chez les femmes, pour arriver à ce que les taux de
chômage convergent en 2017, avec un taux légèrement plus élevé chez les hommes26.
Pour autant, il faut d’une part souligner que bon nombre de femmes sans emploi
n’entrent pas dans les statistiques du chômage car elles sont considérées comme
inactives (ne cherchant pas d’emploi), souvent pour des raisons liées aux charges
familiales. D’autre part, le sous-emploi touche particulièrement les femmes et elles sont
plus nombreuses parmi les demandeurs d’emploi « exerçant une activité réduite »,
c’est-à-dire qui travaillent mais pas assez pour que cet emploi leur rapporte
suffisamment pour vivre27. De plus, si certains métiers comme la médecine se
féminisent, les postes les plus prestigieux restent encore majoritairement masculins
dans ce domaine comme dans d’autres secteurs professionnels, privés ou publics28. Les
inégalités salariales persistent, en France comme aux États-Unis. En France, en 2009, les
femmes gagnaient 26,9 % de moins que les hommes, tous temps de travail confondus.
Aux États-Unis, la différence était de 23 % en 2010, selon un rapport de l’IWPR (Institute
Women’s Policy Research)29. Quant au Brésil, les recherches de l’Institut Brésilien de
Géographie et de Statistiques (IBGE) montrent que les femmes gagnent en moyenne
30 % de moins que les hommes et sont minoritaires parmi les postes de direction,
malgré un niveau de diplômes en augmentation30. On est donc loin de la « fin des
hommes » prédite par Hanna Rosin ; si la féminisation de certaines professions peut
signifier que des brèches s’ouvrent dans les rapports sociaux de sexe (Lefeuvre et
Guillaume, 2007), conclure à leur disparition ou leur renversement semble encore
prématuré.
47 Au-delà de l’aspect économique, le déclin de la condition masculine se mesurerait
également, toujours selon Hanna Rosin dont les propos ne sont pas discutés, sur le plan
sexuel et familial :
Elle : Vous évoquez aussi les conséquences de cette domination féminine surle plan sexuel...Hanna Rosin : Certaines jeunes femmes ont tendance à sélectionner leurcopain afin qu’il ne fasse pas barrière à leur carrière. L’homme est devenu dusuperflu, de l’accessoire. Donc, elles multiplient les expériences sexuelles,adoptent un comportement de prédatrices... et expérimentent de plus enplus la sodomie (...). C’est un bon indicateur de la « plasticité sexuelle » desfemmes et de leur prise de pouvoir progressive au lit. Elles retournent cetacte sexuel de soumission à leur avantage en le désirant. (...) j’ai vu desbanlieues entières (...) se transformer en véritables matriarcats, régentés pardes mères de famille qui remboursent le crédit de la maison et qui décidentde tout, de l’éducation des enfants jusqu’à l’achat de la voiture... Que reste-t-il aux hommes ? Les miettes. »« Les hommes sont-ils finis ? » Elle, 8 mars 2013, n° 3506, p. 117
48 Là encore, Hanna Rosin met en exergue quelques faits observés pour affirmer que la
domination masculine est bousculée jusque dans les familles. Ainsi, l’augmentation du
GLAD!, 04 | 2018
144
nombre de partenaires pour les femmes et la levée de tabous par rapport à certaines
pratiques deviennent synonymes d’une prise de pouvoir féminine dans les relations de
couple. Ses propos mettent en opposition la situation des hommes et des femmes : ces
dernières sont présentées comme très actives, tirant avantage des transformations
socio-économiques, quand les hommes semblent accuser passivement ces
changements. Il ne reste aux hommes que « les miettes », ils sont devenus « superflus »
pour des femmes à qui tout semble réussir (carrière professionnelle, éducation des
enfants et vie sexuelle). L’utilisation du terme « matriarcat », très présent dans la
rhétorique antiféministe, associé aux « banlieues », vient là jouer en partie, sur un
stéréotype raciste fortement ancré aux États-Unis, où les familles noires, qui sont plus
présentes en banlieue qu’en centre-ville, sont souvent présentées à travers l’image
d’Épinal de la mère de famille autoritaire, frappant ses enfants et dévirilisant son
conjoint (hooks 2015)31. Hanna Rosin joue également du crédit que donne son statut de
journaliste à ses propos, lorsqu’elle affirme qu’elle a observé ce schéma de ses propres
yeux (« j’ai vu des banlieues entières »).
49 Cette fois également, la confrontation avec les enquêtes sociologiques oblige à nuancer
ces propos : si l’écart en termes de nombres de partenaires se réduit, il semblerait que
les hommes continuent d’avoir plus d’expériences sexuelles à leur actif que les femmes,
toutes classes d’âges confondues (Léridon 2008). Quant à la sélection du conjoint en
fonction de la carrière, les recherches empiriques sur ce sujet montrent plutôt que ce
sont les femmes qui ont tendance à mettre leur carrière de côté pour soutenir le projet
professionnel de leurs conjoints (Bertaux-Wiame 2008). De plus, la généralisation de
pratiques sexuelles autrefois taboues (rapports oraux ou anaux) ne traduit pas
forcément une libération des mœurs et encore moins un renversement des rapports de
genre, mais plutôt une intériorisation de nouvelles normes sexuelles (Simon et Bozon
2002) : ainsi, la « plasticité sexuelle » des femmes qui est pour Hanna Rosin le signe
d’une « prise de pouvoir » sur le plan sexuel pourrait plutôt être un indicateur de la
persistance de l’injonction pour les femmes à s’adapter aux désirs des hommes, qui
restent prioritaires par rapport aux leurs (Simon et Bozon 2002). Enfin, les violences et
notamment les violences sexuelles, au sein des couples hétérosexuels, restent
majoritairement commises par les hommes sur les femmes ; on est encore loin d’un
renversement des rapports de pouvoir tel que l’évoque Hanna Rosin.
50 La description des familles supposément matriarcales évoque l’image de femmes
autoritaires, régnant en despotes sur leurs conjoints et leurs enfants32. En réalité, s’il
arrive que dans certaines familles, les femmes prennent en charge l’intendance et
subviennent aux besoins économiques et éducatifs des enfants, cela peut être dû au
désinvestissement, partiel ou total, des pères (Jamoulle 2008), ou tout simplement à
leur assignation prioritaire à la sphère privée. Le fait que les femmes prennent en
charge la logistique familiale peut tout aussi bien être le signe de la persistance du
patriarcat qui organise la division sexuelle du travail (Kergoat 2000) qui sépare et
hiérarchise les tâches, réservant prioritairement la gestion du travail ménager et
l’éducation des enfants aux femmes.
La crise masculine
51 Tout en insistant sur le caractère indépassable des différences entre les sexes, certains
articles affirment que la rigidité des catégories de sexe serait en train de s’émousser
GLAD!, 04 | 2018
145
(« Les frontières des genres se brouillent »33). Certains articles reprennent à leur
compte les discours sur la « crise masculine ». L’idée selon laquelle les hommes
vivraient une crise de l’identité masculine fait partie intégrante du discours
masculiniste, qui voit dans l’absence de modèles masculins positifs, l’échec scolaire des
hommes, l’incapacité à séduire des femmes, et le déclin de la libido masculine les
principaux symptômes de la « crise masculine » (Dupuis-Déri 2012). Le diagnostic de la
crise a gagné une légitimité dans certains discours scientifiques : des psychologues
écrivent que la multiplication des modèles d’identification pour les hommes, allant de
l’archétype du « macho » à « l’homme efféminé », rendrait leur construction identitaire
problématique (Hazan 2009). Certains sociologues affirment que dans la période de
transition entre domination masculine et égalité des sexes qui caractériserait notre
époque, les hommes auraient du mal à investir les nouvelles formes de la masculinité
(Castelain-Meunier 2011 ; Welzer-Lang 2009). L’historien André Rauch nous dit que ce
sont les mouvements LGBTI qui « interpellent » l’identité masculine, tout comme la
disparition progressive des rôles sexués (Rauch 2011). Dans une perspective critique
par rapport à ces propos, Francis Dupuis-Déri rappelle que le discours de la « crise de la
masculinité » est mobilisé de façon récurrente à travers les siècles et les différentes
régions du monde, et s’inscrit dans une stratégie de délégitimation des revendications
féministes (Dupuis-Déri 2012). De plus, ce discours de la crise de la masculinité s’appuie
sur une conception essentialiste et figée de la masculinité, qui correspond plus à un
idéal socialement construit qu’à une réalité. Une approche sociologique de la
masculinité, proposée notamment par Raewyn Connell, amène en effet à conjuguer la
masculinité au pluriel (Connell parle ainsi « des masculinités »), pour mettre en
exergue les rapports de pouvoir qui se jouent entre hommes. Les hommes incarnent
différentes formes de masculinités, plus ou moins valorisées, qui leur donnent un accès
inégal aux « dividendes du patriarcat » (Connell 2014). Pour le dire autrement, d’une
part tous les hommes n’adhèrent pas au même modèle de masculinité, et d’autre part,
tous ne tirent pas les mêmes bénéfices du système sexe/genre (Rubin 1998) : les
hommes homosexuels par exemple incarnent des formes de masculinités
subordonnées. Les propos pessimistes sur la crise de l’identité masculine sont donc
révélateurs non pas d’une véritable crise touchant tous les hommes mais bien des
craintes suscitées par les transformations de l’idéal de la masculinité hégémonique
(attitude active, hétérosexualité...)34. L’un des grands apports de Connell est de montrer
comment l’adhésion à la norme de la masculinité hégémonique est un vecteur de
pouvoir, sur les femmes mais également sur les autres hommes ; ainsi, l’on voit bien
comment le discours sur la crise de la masculinité (hégémonique) reflète un refus, plus
ou moins explicite, de l’égalité femmes-hommes (Dupuis-Déri, 2012)35, ainsi que de la
possibilité pour les hommes de s’éloigner du modèle hégémonique.
52 Au-delà de certains universitaires, le thème de la crise de la masculinité est également
diffusé par la presse féminine. Dans un article sur les rapports de séduction dans Biba,
on trouve ainsi un entretien avec le philosophe Vincent Cespedes36, sous le titre : « la
crise masculine, réalité ou bonne excuse ? » :
Biba : Aurions-nous castré les hommes ?Vincent Cespedes : Non, cette crise est assez indépendante de l’émergencedes femmes. Les générations précédentes ont également été élevées par desfemmes fortes. (...)Biba : La crise masculine ne serait-elle pas une bonne excuse pour ne plusavoir à draguer ?
GLAD!, 04 | 2018
146
Vincent Cespedes : Oui, c’est une flemme d’aimer. Le problème n’est pas quel’homme est volage mais qu’il ne l’est plus. (..) Il ne supporte plus de désirer,et c’est pour cela qu’il ne drague plus.« Au secours, les hommes ne draguent plus ! » Biba, mars 2013, n° 397, p. 95
53 S’il dissocie les avancées sociales permises par le féminisme (« l’émergence des
femmes ») de la crise masculine, Vincent Cespedes confirme sa réalité et sa nouveauté
(puisque les hommes des « générations précédentes » semblent en avoir été épargnés).
Il appuie également les propos de la journaliste, qui articule crise masculine et retrait
des hommes du jeu de la séduction : les hommes n’assumeraient plus leurs désirs (on a
peu d’explications à ce sujet, mais on peut supposer que cela est lié à la crainte de ne
pouvoir les satisfaire), et par conséquent, cesseraient de tenter de séduire les femmes.
Les hommes engagés dans la « communauté de la séduction », nébuleuse recouvrant
des forums en ligne, des conférences et des rencontres entre pairs pour apprendre à
séduire, mobilisent eux aussi ce discours de la crise de la masculinité (Gourarier 2017).
Ils accusent régulièrement les mouvements féministes d’avoir mis à mal la masculinité,
à travers la dévalorisation de certaines de ses caractéristiques (force physique,
disposition à la violence…).
54 Les rhétoriques masculinistes sur le mal-être des hommes accusent régulièrement les
féministes d’avoir imposé un mode de gestion « féminin » ou « matriarcal » de la
société, dévalorisant tout ce qui a trait à la masculinité hégémonique (Bouchard 2004).
Un article de Marie-Claire tout entier consacré au retour de la mode du muscle chez les
hommes, évoque cette période de dévalorisation de la virilité, dont nous sortirions à
présent. Si l’on en croit l’introduction de l’article, cette mode de « l’androgynie » aurait
presque réussi à mettre fin à la division sexuelle du travail ménager : « On l’avait cru
définitivement perdu. Condamné à jouer les métrosexuels. Obligé de s’épiler, de
descendre les poubelles et d’exhiber, à défaut de pectoraux, sa part de sensibilité
d’origine féminine contrôlée. »37
55 Sur un ton catastrophiste, l’article expose donc les conséquences de ce brouillage de
l’ordre de genre : l’imposition d’un modèle de masculinité contraire au « naturel » viril
des hommes, auquel les hommes devraient se conformer parfois à leurs corps
défendant comme le sous-entend l’usage des mots « perdu », « condamné » et
« obligé ». L’expression « jouer les métrosexuels » rappelle bien qu’adopter des
comportements dits féminins (prendre soin de soi, exprimer ses sentiments) est en
quelque sorte contre nature pour les hommes, puisqu’ils doivent « jouer », autrement
dit adopter un rôle. L’homme « métrosexuel », dévirilisé, se trouverait donc obligé de
descendre les poubelles : on voit bien, encore une fois, comment le « tabou de la
similitude » imprègne l’organisation de la division sexuelle du travail et est invoqué
lorsque celle-ci est bouleversée (Rubin 1998) : c’est bien parce qu’ils se seraient
efféminés que les hommes auraient été forcés de prendre en charge des tâches
assignées aux femmes. Cet article de Marie-Claire illustre bien comment la rhétorique de
la crise masculine est entrée dans le sens commun : contre toute vérité statistique (le
temps consacré quotidiennement au travail ménager par les hommes a augmenté de
trois minutes entre 1986 et 2010 (Ricroh 2012)), le magazine mobilise la thèse de la mise
en péril, alertant sur la situation des hommes qui seraient bouleversés par une
dévalorisation supposée de la masculinité hégémonique.
GLAD!, 04 | 2018
147
Le cout d’être un homme
56 Bien qu’apparemment dévalorisée, la virilité n’en serait pas moins un fardeau pour les
hommes. L’article sur le retour de la mode du muscle chez les hommes, tout en
célébrant les corps virils, est une occasion de plaindre les hommes qui verraient peser
sur leurs (larges) épaules des contraintes de plus en plus fortes. Après l’obligation de
faire taire leur virilité, les hommes se verraient maintenant contraints à l’effort
physique, nécessaire pour exalter leur masculinité et pour s’imposer. Les heures
d’entrainement ne seraient pas les seules obligations pour les hommes :
Vers l’ultra-performance. Assurer sur tous les plans : être viril mais pas que— beau, fort, sensible, rasé de près et pas con avec ça. Alors qu’on croyaitréservé aux seules femmes le diktat de l’ultra-performance, l’image de laWonder Woman mère-de-famille-épanouie-véritable bombe au lit (mais pastrop ronde non plus) aurait désormais son pendant masculin. Parce qu’il nefaut pas croire qu’on puisse devenir viril sans souffrir un peu.« Le retour du biscoteau », Marie-Claire, juin 2012, n° 718, p. 108
57 Tout comme les femmes, les hommes devraient donc jongler entre plusieurs
injonctions contradictoires : virilité (musculation, puissance...), sensibilité et
intelligence, entretien de son corps (rasé de près, lavé, parfumé...). Les attentes des
femmes à l’égard du couple hétérosexuel ont en effet changé : la norme d’égalité
conjugale se diffuse (Bozon 2016), et les formes de masculinité hégémonique ont
intégré cette attente pour mieux se transformer (Demetriou 2015).
58 Ces différentes exigences auxquelles les hommes doivent se plier afin d’incarner la
masculinité hégémonique permettent d’amener un discours des couts de la masculinité,
qui trouve un écho chez certains sociologues (Neveu 2012) : la virilité ne s’acquiert pas
sans une part de souffrance, les dominants se trouveraient donc, d’une certaine
manière, dominés par leur propre domination (Bourdieu 1998). Si l’engagement dans la
masculinité hégémonique peut effectivement comporter des couts, en termes de santé
par exemple (Gaussot et Palierne 2012), il s’agit bien de l’apprentissage de ce qui
permet la (re)production de rapports sociaux de sexe inégalitaires (Neveu 2012), dont
les femmes supportent elles aussi les couts, voire les coups lorsque l’exacerbation de la
virilité conforte les hommes dans des attitudes violentes (Lefaucheur et Mulot 2012). De
plus, en établissant une symétrie entre l’injonction à l’ultra performance masculine et
l’obligation d’articuler de multiples sphères d’activité pour les femmes, l’article laisse
entendre qu’hommes et femmes pourraient être victimes du sexisme de la même
manière. Pourtant, alors que l’injonction à la virilité maintient les hommes dans une
position de dominant qui leur apporte d’incontestables bénéfices matériels, sociaux et
symboliques, le diktat de la « superwoman », décharge les hommes d’un certain
nombre d’obligations (l’éducation des enfants et l’entretien du foyer), tout en ayant un
cout élevé pour les femmes (stress, culpabilité).
59 Un article publié par le magazine Elle et portant sur la réussite scolaire des filles
rappelle ainsi les conséquences du carcan masculin en termes d’éducation :
Olivier Fournout, enseignant dans une grande école d’ingénieurs Télécom(...) a mis sur pied un stage de théâtre axé sur les rapports hommes/femmes.« Les garçons viennent ici se libérer du fait d’avoir été durant leurs étudesdes boucs émissaires simplement parce qu’ils étaient bons en classe », dit-il.Car être un bon élève, c’est pour les garçons faire partie d’une minorité
GLAD!, 04 | 2018
148
visible qu’on accable. Une fille douée garde des copines, un garçon doué estrejeté.« Les filles en tête », Elle, 27 Juillet 2012, n° 3474, p. 15
60 Les recherches en sciences de l’éducation montrent en effet que « les garçons sont
renvoyés à une contrainte de virilité et à une position de supériorité et de dominance,
pas toujours compatibles avec un rapport positif à l’école » (Mosconi 2004). Cependant,
si la socialisation des garçons peut leur porter préjudice pour se conformer à
l’institution scolaire en primaire et au collège, l’esprit de compétition, le culte de la
performance devient un avantage quand il s’agit de s’engager dans des filières
compétitives et valorisées comme les filières scientifiques, les classes préparatoires ou
les écoles d’ingénieurs, ce qu’ils font d’ailleurs plus massivement que les filles (Baudelot
et Establet 2006). De plus, à niveau scolaire égal, les garçons formulent des vœux
d’orientation plus ambitieux que les filles, et ils sont en cela soutenus à la fois par leurs
familles et par les enseignant-e-s (Caille et Lemaire 2002). Enfin, il faut souligner que la
situation décrite dans cet article ne concerne pas l’ensemble des garçons, et que le
degré d’adhésion aux normes scolaires dépend davantage de la classe sociale que du
genre (Marry 2004) ; les jeunes garçons des classes moyennes et supérieures, qui
composent sans doute une partie du public du stage de théâtre d’Olivier Fournout,
courent finalement peu le risque d’être des « boucs émissaires » parce qu’ils obtiennent
de bons résultats scolaires.
61 Ainsi on voit qu’en ce qui concerne la situation des hommes, les articles reprennent
(sciemment ou non) une partie des discours masculinistes : crise de la masculinité,
manque de modèles masculins, discours des couts de la masculinité, échec scolaire des
garçons. Associés à une victimisation des hommes et à la propagation du mythe du
déclin masculin, ces articles permettent d’habituer les lectrices à l’idée selon laquelle,
tout en faisant désormais partie des acquis, les combats féministes devraient soit être
abandonnés, soit intégrer à leur agenda les problématiques qui concernent les hommes.
Il s’agit bien de penser les rapports de genre du point de vue des hommes avant tout, ce
décalage genré de perception de l’oppression (Thiers-Vidal 2013) permettant de nier
l’existence d’un système sexe/genre dont les hommes sont les bénéficiaires (Rubin
1998). Ainsi, dans une perspective « antisexiste » niant la hiérarchie des rapports
sociaux de sexe, les hommes peuvent être pensés comme les victimes de
réarrangements des rapports sociaux de sexe (Lamoureux 2008).
Conclusion
62 Sans prétendre à l’exhaustivité, cette analyse des discours d’une partie de la presse
féminine donne à voir un continuum de discours antiféministes, allant de la
dévalorisation des acquis du féminisme (notamment les gains en indépendance pour les
femmes) à une forte adhésion aux thèses masculinistes sur la « crise de la masculinité ».
Entre les lignes de plusieurs papiers traitant du couple hétérosexuel, on décèle en effet
une défiance vis-à-vis du féminisme, présenté comme une menace pour l’équilibre
conjugal (notamment en ce qui concerne le travail ménager), ou comme un véritable
repoussoir pour beaucoup d’hommes. Plus subtilement, certains acquis du féminisme,
comme l’indépendance financière et la possibilité de se réaliser hors de la vie conjugale,
s’ils peuvent être valorisés, sont assortis de mises en garde, à travers la triste figure de
la célibataire repentie.
GLAD!, 04 | 2018
149
63 Quant aux discours sur les hommes et la condition masculine, ils laissent percevoir un
masculinisme peu voilé, mais qui peut être difficile à repérer, notamment parce qu’ils
sont nourris par des thèses jouissant d’une certaine légitimité. En effet, l’idée selon
laquelle la situation des hommes aurait pâti des avancées sociales permises par les
mouvements féministes, a réussi à se diffuser au-delà des seuls cercles des militants
masculinistes, comme le montre notamment l’exemple de la communauté de la
séduction (Gourarier 2017). La rhétorique de la crise masculine, traversant les âges et
les continents, a trouvé sa place dans les pages des magazines féminins. Ceux-ci se font
le porte-voix de ces hommes apparemment en déclin, déplorant la dévalorisation de la
masculinité hégémonique, sans toutefois apporter d’éléments tangibles qui
prouveraient l’existence d’une crise de la masculinité.
64 Choisir l’angle des trois thèses d’Hirschman implique de laisser de côté d’autres formes
d’antiféminismes présents dans les magazines féminins, notamment tout ce qui a trait à
la valorisation d’une certaine forme de féminisme peu transformateur, raciste et de
classe, incarné par des figures comme Élisabeth Badinter ou des associations comme
Osez le féminisme. Bien qu’il ne s’agisse pas de l’objet de cet article, il est intéressant de
mentionner que les magazines féminins étudiés traitent bien de certains sujets qui
intéressent les mouvements féministes, comme le manque de places en crèche ou les
violences envers les femmes. Certains articles sur les violences, les inégalités salariales,
la difficulté à articuler vie familiale et vie professionnelle, donnent à voir les prémisses
d’une conscience de genre (Aronson 2015), dans la mesure où des inégalités touchant
les femmes sont dévoilées et présentées comme illégitimes.
65 Pour autant, le féminisme affiché de certains pourrait être considéré comme une forme
d’antiféminisme ordinaire, ce que Francine Descarries a qualifié de « féminisme de
façade » (Descarries 2005). Tout d’abord, il s’agit, bien souvent, de mettre en avant un
certain type de féminisme, élitiste et libéral, qui s’adresse aux femmes des classes
moyennes et supérieures (Klaus 2010). Le répertoire d’action et les revendications de
formes plus transformatrices de féminisme sont peu présentes dans les pages de ces
magazines, et le « bon » féminisme est plutôt porté par des femmes jeunes,
hétérosexuelles, qui ne remettent pas fondamentalement en cause les rapports
structurels de pouvoir38. De plus, dans ces articles sur les inégalités de genre, les
dimensions de classe et de race de ces inégalités sont soit occultées, soit
instrumentalisées. Ainsi certains magazines sont plus prompts à dénoncer les violences
lorsqu’elles ont cours « ailleurs », un ailleurs se référant aux pays non occidentaux
comme aux « banlieues défavorisées », dont la population n’est apparemment pas le
lectorat visé par la presse féminine. Le traitement des violences se fait, bien souvent, au
prisme d’une forme de racialisation du sexisme (Hamel 2005). Le fait de limiter le
féminisme à des revendications purement correctrices (égalité de salaire notamment
dans les professions supérieures, augmenter le nombre de places en crèche ou
dénoncer les violences), sans s’interroger sur les rapports de pouvoir dans lesquels
s’enracinent les inégalités, participe à marginaliser les analyses et les pratiques des
courants plus transformateurs du féminisme, et constituent ainsi une autre forme
d’antiféminisme.
GLAD!, 04 | 2018
150
BIBLIOGRAPHIE
ARONSON, Pamela. 2015. « Féministes ou post-féministes » Politix, 109 : 135-158.
BARD, Christine. 1999. Un siècle d’antiféminisme. Paris : Fayard.
BARD, Christine. 2012. Le féminisme au-delà des idées reçues. Paris : Le Cavalier bleu.
BATTAGLIOLA, Françoise. 2004. Histoire du travail des femmes. Paris : Éd. la Découverte.
BAUDELOT, Christian et ESTABLET, Roger. 2006. Allez les filles. Paris : Éd. du Seuil.
BERTAUX, Daniel ; 1997. Le récit de vie. Paris : Armand Colin.
BERTAUX-WIAME, Isabelle. 2008. « Les comptes privés de la banque : les cadres et leur famille à
l’épreuve de la mobilité », in Pourquoi travaillons-nous ?, LINHART, Danièle (éd). Toulouse : Érès,
295-319.
BLANDIN, Claire et ECK, Hélène. 2010. « Devoirs et désirs : les ambivalences de la presse
féminine » in La vie des femmes : la presse féminine aux XIX e et XX e siècles, BLANDIN, Claire et ECK,
Hélène (éds). Paris : Panthéon Assas.
BONVOISIN Samra Martine et MAIGNIEN Michèle. 1996. La presse féminine. Paris : Presses
Universitaires de France.
BOUCHARD, Pierrette. 2004. « Les masculinistes face à la réussite scolaire des filles et des
garçons », Cahiers du genre, 36(1) : 21-44.
BOURDIEU, Pierre. 1993. La misère du monde. Paris : Seuil.
BOURDIEU, Pierre. 1998. La domination masculine. Paris : Seuil.
BOZON, Michel. 2016. Pratique de l’amour. Paris : Payot & Rivages.
BRAVERMAN, Louis. 2014.« Rosin Hanna, The end of men. Voici venu le temps des femmes »,
Genre, sexualité & société [en ligne], consulté le 31 mai 2018, https://journals.openedition.org/gss/
3086.
BROUSSE, Cécile. 2015. « Économie et statistique. Travail professionnel, tâches domestiques,
temps « libre » : quelques déterminants sociaux de la vie quotidienne » Économie et statistique,
478 480 : 119-154.
CAILLE, Jean-Paul, LEMAIRE, Sylvie et VROLANT, Marie-Claude. 2002. « Filles et garçons face à
l’orientation » Éducation et formation, 23 : 111-121.
CARDI, Coline. 2007. « La « mauvaise mère » : figure féminine du danger » Mouvements, 49(1) :
27-37.
CARNAC, Romain. 2014. « L’église catholique contre “la théorie du genre”: construction d’un
objet polémique dans le débat public français contemporain » Synergies Italie, 10 : 125-143.
CASTELAIN-MEUNIER, Christine. 2011. « Masculinités et mobilités des identités dans une société
en transition », in Masculinités : état des lieux, WELZER-LANG, Daniel et ZAOUCHE GAUDRON,
Chantal. Toulouse : Éres, 25-40.
CHOLLET, Mona. 2012. Beauté fatale. Les nouveaux visages d’une aliénation féminine. Paris : La
Découverte.
CONNELL, Raewyn. 2014. Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie. Paris : Éditions Amsterdam.
GLAD!, 04 | 2018
151
DARDIGNA, Anne-Marie. 1978. La presse féminine : fonction idéologique. Paris : Maspero.
DEBEST, Charlotte. 2014. Le choix d’une vie sans enfant. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
DELPHY, Christine. 2008 ; L’ennemi principal. Tome 1: économie politique du patriarcat. Paris : Éditions
Syllepse.
DELPHY, Christine. 2013. L’ennemi principal. Tome 2: Penser le genre. Paris : Éditions Syllepse.
DEMETRAKIS, Demetriou. 2015. « La masculinité hégémonique : lecture critique d’un concept de
Raewyn Connell » Genre, sexualité & société, 13 [en ligne], traduit par BOUVARD, Hugo, consulté le
31 mai 2018, https://journals.openedition.org/gss/3546
DESCARRIES, Francine. 2005. « L’antiféminisme “ordinaire” » Recherches féministes, 18(2) : 137-151.
DUCROT, Oswald et TODOROV, Tzvetan. 1972. « Rhétorique et stylistique », in Dictionnaire
encyclopédique des sciences du langage. Paris : Seuil, 99-105.
DUPUIS-DÉRI, Francis et LAMOUREUX, Diane. 2015. Les antiféminismes. Analyse d’un discours
réactionnaire. Montréal : Les éditions du Remue-ménage.
DUPUIS-DÉRI, Francis. 2012. « Le discours de la « crise de la masculinité » comme refus de
l’égalité entre les sexes : histoire d’une rhétorique antiféministe » Cahiers du Genre, 52(1) :
119-143.
FALUDI, Suzanne. 1993. Backlash. Paris : Des femmes.
FLAHAULT, Érika. 2009. Une vie à soi. Nouvelles formes de solitude au féminin. Rennes : Presses
universitaires de Rennes.
FRISCHER, Dominique. 1997. La revanche des misogynes. Paris : Albin Michel.
GAUSSOT, Ludovic et PALLIERNE, Nicolas. 2012. « Les privilèges et les coûts de la masculinité en
matière de consommation d’alcool », in Boys don’t cry ! Les coûts de la domination masculine, NEVEU,
Erik, GUIONNET, Christine, DULONG, Delphine. Rennes : Presses universitaires de Rennes,
253-274.
GHIGI, Rosella. 2004. « Le corps féminin entre science et culpabilisation » Travail, genre et sociétés,
12(2) : 55-75.
GIANINI BELOTTI, Elena. 1976. Du côté des petites filles. Paris : Éditions des femmes.
GIET, Sylvette. 2005. Soyez libres ! C’est un ordre. Le corps dans la presse féminine et masculine. Paris :
Autrement.
GOFFMAN, Erving. 2002. L’Arrangement des sexes. Paris : La Dispute.
GOURARIER, Mélanie. 2017. Alpha mâle. Séduire les femmes pour s’apprécier entre hommes. Paris :
Seuil.
GUILLAUMIN, Colette. 1992. Sexe, race et pratique du pouvoir. Paris : Côté-femmes.
HAICAULT, Monique. 2005. « Des pratiques temporelles du travail aux temporalités urbaines 20
années de recherches sur la thématique des temps sociaux », Conférence invitée « Femmes et
villes », Commission consultative de la ville de Liège.
HAMEL, Christelle. 2005. « De la racialisation du sexisme au sexisme identitaire » Migrations et
Société, 99-100(17) : 99-104.
HARDEN-CHENUT, Helen. 2012. « L’esprit antiféministe et la campagne pour le suffrage en
France, 1880-1914 » Cahiers du Genre, 52(1) : 51
GLAD!, 04 | 2018
152
HAZAN, Marie. 2009. « Y a-t-il une condition masculine ? Le masculin aujourd’hui : crise ou
continuité » Dialogue, 183(1) : 81-93.
HIRSCHMAN, Albert. 1991. Deux siècles de rhétorique réactionnaire. Paris : Fayard.
hooks, bell. 2015. Ne suis-je pas une femme ? Paris : Cambourakis.
JAMOULLE, Pascale. 2008. Des hommes sur le fil. Paris : La Découverte.
JONAS, Irène. 2011. Moi Tarzan, toi Jane. Paris : Éditions Syllepse.
KERGOAT, Danièle. 2000. « Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe », in
Dictionnaire critique du féminisme, HIRATA, Helena, LABORIE, Françoise, LE DOARÉ, Hélène et
SENOTIER, Danièle. Paris : Presses Universitaires de France, 35-44.
KLAUS, Elizabeth. 2010. « Antiféminisme et féminisme élitiste en Allemagne : les termes du
débat » Travail, genre et sociétés, 24(2) : 151-165.
LAMOUREUX, Diane. 2008. « Un terreau antiféministe », in Le mouvement masculiniste au Québec,
l’antiféminisme démasqué, BLAIS, Mélissa et DUPUIS-DÉRI, Francis (dir). Montréal : Les Éditions du
Remue ménage, 55-73.
DE LAURETIS, Teresa. 2007. Théorie queer et cultures populaires. De Foucault à Cronenberg. Paris : La
Dispute.
LEFAUCHEUR, Nadine et MULOT, Stéphanie. 2012. « La construction et les coûts de l’injonction à
la virilité en Martinique », in Boys don’t cry ! Les coûts de la domination masculine, NEVEU, Erik,
GUIONNET, Christine, DULONG, Delphine, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 207-230.
LEFEUVRE, Nicky et GUILLAUME, Cécile. 2007. « Les processus de féminisation au travail : entre
différenciation, assimilation et « dépassement du genre » » Sociologies pratiques, 14 : 11-15.
LÉRIDON, Henri. 2008. « Le nombre de partenaires : un rapprochement, mais des comportements
encore très différents », in Enquête sur la sexualité en France : pratiques, genre et santé, BOZON,
Michel et BAJOS, Nathalie (dir). Paris : La Découverte, 215-242.
MATHIEU, Nicole-Claude. 2013. L’anatomie politique. Donnemarie-Dontilly : Éd. iXe.
MARRY, Catherine. 2004. « Mixité scolaire : abondance des débats, pénurie des recherches »
Travail, genre et sociétés, 11 : 189-194.
MOLINIER, Pascale, LAUGIER, Sandra et PAPERMAN, Patricia. 2009. Qu’est-ce que le care ?. Paris :
Payot.
MOSCONI, Nicole. 2004. « Effets et limites de la mixité scolaire » Travail, genre et sociétés, 11 :
165-174.
NENGEH-MENSAH, Maria. 2005. Dialogues sur la troisième vague féministe. Montréal : Les Éditions du
Remue-ménage.
NEVEU, Érik. 2012. « Gérer les coûts de la masculinité ? Inflations mythiques, enjeux pratiques »,
in Boys don’t cry ! Les coûts de la domination masculine, NEVEU, Erik, GUIONNET, Christine et
DULONG, Delphine. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 111-140.
RAUCH, André. 2011. « Quelques pistes d’historien sur le masculin », in Masculinités : état des lieux,
WELZER-LANG, Daniel et ZAOUCHE GAUDRON, Chantal. Toulouse : Éres, 55-68.
RICROH, Layla. 2012. « En 25 ans, moins de tâches domestiques pour les femmes, l’écart de
situation avec les hommes se réduit », Dossier, INSEE. https://www.insee.fr/fr/statistiques/
1372773?sommaire=1372781
GLAD!, 04 | 2018
153
RUBIN, Gayle. 1998. « L’économie politique du sexe : transactions sur les femmes et systèmes de
sexe/genre » Les cahiers du CEDREF, 7 : 3-81.
SIMON, Patrick et BOZON, Michel. 2002. « Révolution sexuelle ou individualisation de la
sexualité ? » Mouvements, 20(2) : 15-22.
SULLEROT, Evelyne. 1996. La presse féminine. Paris : Armand Colin.
TABET, Paola. 1998. La construction sociale de l’inégalité des sexes. Paris : l’Harmattan.
THIERS-VIDAL, Léo. 2013. Rupture anarchiste et trahison proféministe. Lyon : Bambule.
TRONTO Joan. 2008. « Du care » Revue du MAUSS, 32 : 243-265.
WELZER-LANG, Daniel. 2009. Nous, les mecs. Paris : Payot.
WEST, Candace et ZIMMERMAN, Don. 1987. « Doing Gender » Gender and Society, 2(1) : 125-151.
NOTES
1. Tout au long de cet article, « les femmes » sont entendues comme un groupe socialement
constitué et non comme une catégorie biologique. À ce sujet voir les travaux des féministes
matérialistes (Delphy 2013 ; Guillaumin 1992 ; Mathieu 2013 ; Tabet 1998). Il en va de même pour
le groupe social des hommes.
2. Teresa de Lauretis, s’inspire ici du concept de « technologies du corps » forgé par Michel
Foucault. Ces technologies du corps correspondent à un ensemble de pratiques sociales et
discursives de production du soi ; dans cette perspective, les technologies du genre renvoient à
tout ce qui intervient dans la construction ou la déconstruction du genre. Teresa de Lauretis
s’intéresse particulièrement au cinéma.
3. Il faut souligner que cet ouvrage ne s’intéresse pas exclusivement à la presse féminine mais
également aux blogs.
4. Voir notamment le dossier d’Acrimed consacré à la presse féminine (http://www.acrimed.org/
+-Presse-feminine-+).
5. Cet article est issu d’un mémoire de première année de master pour le master Genre, Égalité et
Politiques Sociales de l’Université de Toulouse, soutenu en juin 2013 et réalisé sous la direction de
Julie Jarty, maitresse de conférence, qui est ici remerciée pour son aide dans la réalisation de ce
qui fut un premier travail de recherche.
6. Par information au féminin, nous faisons référence aux articles portant sur la situation des
femmes, en France et dans le monde, ainsi que sur les inégalités de genre. Il peut s’agir par
exemple d’articles sur le manque de place en crèche, les mariages forcés, les inégalités salariales,
ou encore de portraits de femmes politiques, activistes...
7. Distribution totale, chiffres 2016, fournis par l’alliance pour les chiffres de la presse et des
médias, http://www.acpm.fr/Classement-personnalise/page/presse?
section=0&departement=0&family=5&thematic=14&btn-filter-form=Valider consulté le 07 juillet
2017.
8. Tous articles confondus, nous avons recensé quinze psychologues, psychanalystes,
psychothérapeutes, psychiatres ou conseillères conjugales/sexologues. Douze sociologues et
historiennes, cinq philosophes, quatorze personnes issues du milieu associatif (féministe ou pas),
politique et institutionnel (ministre, inspectrice du travail) ou juridique (avocates, défenseur des
droits) et onze personnalités médiatiques et culturelles (auteur-e-s, réalisatrice, journalistes,
blogueuses). Il faut savoir que certains de ces expertes et experts sont mobilisé-e-s de manière
récurrente.
GLAD!, 04 | 2018
154
9. Comme en témoignent le nom des rubriques (« nos hommes » pour Biba et Marie-Claire, « Lui et
moi » pour Femme Actuelle), le couple dont il est question dans la presse féminine est presque
toujours hétérosexuel. L’hétérosexualité va de soi : dans les articles sélectionnés, il n’y a aucun
témoignage de personnes homosexuelles et lorsque l’homosexualité féminine est évoquée c’est
au titre d’exception ou comme une manière de réinventer son couple (Marie-Claire, février 2013,
nº 726) ou comme une expérience piquante (Elle, 21 mars 2013, nº 3507). Elle est également
envisagée comme un moyen de réparation après de multiples déceptions amoureuses (Femme
Actuelle, 11 mars 2013, nº 1485).
10. Par travail ménager, on entend l’ensemble des tâches permettant la (re)production de la
famille et de ses membres. Le concept de travail domestique, souvent employé comme synonyme
de travail ménager ou tâches ménagères, renvoie à une relation de production, établie dans le
cadre du mariage, dans laquelle le conjoint s’approprie une partie du travail réalisé gratuitement
par sa conjointe (Delphy 2008). Nous préférons parler de travail ménager plutôt que de tâches
ménagères pour mettre en évidence le fait qu’il s’agit bien d’un travail, même s’il n’est pas
rémunéré et effectué dans le cadre privé.
11. Pour une étude détaillée des discours sur les psychologies « masculines » et « féminines »
dans les ouvrages grand public destinés à faciliter la vie de couple, voir (Jonas 2011).
12. Irène Jonas fait un constat similaire à la lecture des ouvrages de psychologie grand public.
13. Il convient ici de noter que la diffusion d’une « grammaire paritaire » dans différentes
sphères sociales entraine l’utilisation des termes de « parité » et « paritaire » comme synonymes
d’égalité (Bereni et al. 2011).
14. Femme Actuelle, 16 décembre 2012, nº 1472, p. 54. La pertinence de l’interprétation qui a été
faite des résultats de cette enquête est questionnée par ses auteurs. Thomas Hansen, co-auteur de
l’étude, explique que le taux de divorce plus élevé que l’on trouve chez les couples « égalitaires »
est sans doute plutôt à mettre en relation avec le profil de ces couples (dont le partage des tâches
serait un élément). Au sein de ces couples où les femmes travaillent et sont indépendantes
financièrement, elles peuvent divorcer plus facilement car la question financière n’est pas un
obstacle comme dans d’autres couples où le partage des tâches est plus inégalitaire et où les
femmes ne travaillant pas ou peu n’ont pas forcément la possibilité de divorcer. (source : http://
www.lesnouvellesnews.fr/partage-des-taches-et-divorce-le-mauvais-titre-de-lafp/, consulté le 11
août 2017). En outre, d’autres enquêtes montrent le contraire : en 2010, des chercheurs de la
London School of Economics ayant observé 3500 couples sont arrivés à des résultats opposés :
plus la répartition du travail ménager était égalitaire, moins les couples divorçaient. (Source :
http://www.lesnouvellesnews.fr/plus-ils-frottent-moins-elles-divorcent/, consulté le 11 août
2017)
15. Les entretiens qui forment la matière de cet ouvrage sont réalisés dans les années quatre-
vingt-dix.
16. « Tout pour plaire… et toujours célibataire », Marie-Claire, Mars 2012, n° 716, p. 158.
17. Auteur de Les célibataires. Idées reçues, Le Cavalier bleu, collection "Idées reçues", 2006
18. « Au secours, les hommes ne draguent plus ! » Biba, Mars 2013, n° 397, p. 95
19. Pour une discussion autour de l’effet homogénéisant des « vagues » du féminisme, on peut se
référer à Dialogues sur la troisième vague féministe (Nengeh-Mensah 2005).
20. « Au secours, les hommes ne draguent plus ! » Biba, Mars 2013, n° 397, p. 95
21. Voir par exemple « Les mères célibataires, catégorie précaire », publié dans Le Monde, cinq
septembre 2013 (http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/09/05/les-meres-celibataires-
categorie-precaire_3471759_3224.html). Sur la perception des mères célibataires par les acteurs
du travail social, voir (Cardi 2007).
22. Journaliste américaine, auteur de l’essai The end of men. Voici venu le temps des femmes, paru en
France en 2013 aux éditions Autrement.
23. « 20 idées pour mettre plus d’amour dans sa vie », Biba, Juin 2013, n° 400, p. 83
GLAD!, 04 | 2018
155
24. « Les hommes sont-ils les nouvelles Bridget Jones ? » Elle, 23 Novembre 2012, n° 3491, p. 118.
Cet article reprend d’ailleurs certains arguments masculinistes, érigeant le célibat masculin au
rang de problème social dû, entre autres, à l’indépendance financière des femmes qui les
détourneraient du couple hétérosexuel.
25. Pour une recension critique et complète de ce livre, on peut lire Louis Braverman, « ROSIN
Hanna, The end of men. Voici venu le temps des femmes », Genre, sexualité & société (Braverman 2014).
26. http://www.inegalites.fr/spip.php?article1122, consulté le 10 août 2017.
27. http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1969, consulté le 10 août 2017.
28. http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/reperes-statistiques-47/, consulté le 11 août
2017.
29. http://www.iwpr.org/initiatives/pay-equity-and-discrimination, consulté le 10 août 2017.
30. http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/02/salario-das-mulheres-e-inferior-ao-
dos-homens, consulté le 10 août 2017.
31. Le cadre de cet article ne nous permet pas de discuter plus en profondeur cela, mais dans cet
ouvrage bell hooks met particulièrement en exergue les contradictions inhérentes aux
représentations stéréotypées des familles Noires aux États-Unis. Elles sont notamment
présentées comme matriarcales, la sexualité des femmes Noire étant supposée débridée ; pour
autant, les hommes Noirs sont également perçus comme violents, et l’idée selon laquelle la
violence conjugale serait plus prégnante parmi les Africains-Américains est bien ancrée.
32. Sur les représentations racistes des familles Noires pensées comme « matriarcales » du fait
d’une supposée dévalorisation des hommes, on peut lire bell hooks (hooks, 2015).
33. « 20 idées pour mettre plus d’amour dans sa vie », Biba, Juin 2013, n° 400, p. 86
34. « La masculinité hégémonique peut être définie comme la configuration de la pratique de
genre qui incarne la réponse acceptée à un moment donné au problème de la légitimité du
patriarcat. En d’autres termes, la masculinité hégémonique est ce qui garantit (ou ce qui est
censé garantir) la position dominante des hommes et la subordination des femmes. » (Connell
2014 : 74).
35. Il faut ici ajouter que la transformation de la masculinité hégémonique, par un jeu
d’intégration de nouvelles formes de masculinités, consiste également en une stratégie pour
maintenir sa domination, en s’adaptant aux changements sociétaux (norme égalitaire, plus
grande tolérance envers les LGBT…). Nous renvoyons ici à Demetriou (2015).
36. Auteur de L’homme expliqué aux femmes (2012, éditions J’ai lu). S’il se présente comme pro-
féministe, il reprend certaines thèses masculinistes, notamment lorsqu’il met les violences
conjugales sur le compte d’hommes peu sûrs de leur virilité (voir une la vidéo où il expose le
propos de son ouvrage : https://www.youtube.com/watch?v=SkzSyOIjeYo, consultée le 10 août
2017).
37. « Le retour du biscoteau », Marie-Claire, juin 2012, n° 719, p. 105
38. Ici il convient de rappeler que les matériaux empiriques datent de 2012-2013 ; la montée en
visibilité des luttes féministes au cours des dernières années a pu modifier les représentations du
féminisme par la presse féminine. N’ayant pas depuis réalisé de nouvelle étude de ces magazines,
nous ne préférons pas nous avancer à ce sujet.
GLAD!, 04 | 2018
156
RÉSUMÉS
En 1991, l’économiste Albert O. Hirschman publiait Deux siècles de rhétorique réactionnaire
(Hirschman 1991) dans lequel il analyse les réactions hostiles à la Révolution française, puis les
discours s’opposant au suffrage universel au tournant du XXe siècle, et enfin les critiques plus
contemporaines de l’État-providence. À partir de cette matrice intellectuelle et des recherches
plus récentes sur les antiféminismes, cet article se propose d’analyser certains discours parus
dans quatre magazines féminins (Femme Actuelle, Biba, Marie-Claire, Elle) entre mars 2012 et juin
2013. Il s’agira d’articuler les trois thèses mises à jour par Hirschman dans son ouvrage sur les
rhétoriques réactionnaires, à quelques thèmes traités par la presse féminine. Ainsi nous verrons
dans un premier temps comment la thèse de l’inanité traverse les discours sur l’impossible
égalité dans le couple hétérosexuel ; ensuite, nous montrerons comment la thèse de l’effet
pervers est au cœur de l’argumentation sur l’indépendance féminine qui se serait retournée
contre les femmes. Enfin, la thèse de la mise en péril constitue un outil fécond pour traiter les
articles se penchant sur la situation des hommes, présentés comme perdants en tout point des
recompositions des rapports sociaux de sexe.
With his book The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy published in 1991, economist
Albert O. Hirschman offered an analysis of different rhetorics against social changes (French
revolution, universal suffrage and welfare state). His frame of analysis and the three thesis
(perversity, futility, jeopardy) he uncovered in reactionary speeches have often been used in
researches about antifeminist rhetoric. This article intends to show how one can find that type of
rhetoric in women’s magazines. The futility thesis is used in articles explaining why gender
equality seems to be out of reach within heterosexual couples; the perversity thesis shapes an
antifeminist rhetoric about how women’s self-reliance would, after all, harm women. The articles
dealing with men convey many masculinist ideas, using the jeopardy thesis to speak in favour of
a “masculinity crisis”.
INDEX
Thèmes : Explorations
Mots-clés : presse féminine, antiféminisme, masculinisme
Keywords : women’s magazines, antifeminism, masculinism
AUTEUR
AURÉLINE CARDOSO
Université Toulouse II Jean Jaurès, CERTOP UMR 5044
Doctorante en sociologie
GLAD!, 04 | 2018
157
Le traitement médiatique desviolences faites aux femmes : entreinstrumentalisation etinvisibilisationViolence Against Women in the Media: Between Instrumentalization and
Invisibilization
Association Faire Face
1 Faire Face est une association toulousaine de prévention des violences faites aux
femmes et adolescentes qui diffuse l’autodéfense féministe comme outil de prévention1.
La méthode mobilisée à Faire Face vient du Québec et s’appuie sur le partage de
stratégies d’autodéfense verbale, physique et psychologique. C’est une méthode qui vise
à prévenir les violences spécifiques2 que vit le groupe social des femmes dans les
espaces privés, professionnels et publics. L’autodéfense féministe se pratique dans un
espace non mixte3 et au travers notamment d’une réflexion sur les messages
intériorisés qui peuvent entraîner des freins au fait de se défendre, mais aussi au
travers d’une réappropriation du corps, des ressources à notre disposition et d’une
prise de conscience de nos capacités à se défendre4.
2 Les journées d’étude organisées par Arpège-EFiGiES-Toulouse en 2016 sur les
« Rhétoriques antiféministes » ont été une opportunité pour notre association
d’approfondir nos réflexions autour de l’appréhension des violences par les médias, par
les politiques publiques et par les femmes elles-mêmes au sein des ateliers et stages
d’autodéfense. En tant qu’association, nous tentons d’avoir un regard critique sur les
choix politiques de lutte contre les violences faites aux femmes. Par ailleurs, les
expériences partagées par les participantes aux ateliers évoluent en fonction de cette
médiatisation5. Ainsi, nous tentons de mettre en parallèle les discours et
représentations véhiculés sur les violences faites aux femmes avec l’état des savoirs
divulgués par les enquêtes sociologiques. Il est question d’identifier la construction des
GLAD!, 04 | 2018
158
peurs, des représentations diffusées sur les violences et, par conséquent, en quoi cela
peut constituer un frein à se défendre pour les femmes.
3 Avant toute chose, rappelons qu’il existe différents types de violences (agressions
verbales, agressions physiques, atteintes et avances sexuelles, agressions sexuelles,
pressions psychologiques, harcèlement psychologique) et qu’elles sont exercées dans
les espaces publics6, au travail, dans le couple et la famille. Les violences envers les
femmes restent majoritairement perpétrées dans l’espace privé. L’enquête ENVEFF7 a
montré l’ampleur des violences conjugales8 : une femme sur dix en est victime. Selon
l’enquête VIRAGE9 (INED, 2016), une femme décède tous les trois jours, tuée par son
partenaire ou ex-partenaire en 2016. Dans 91 % des cas, les viols ou tentatives de viols
ont été perpétrés par une personne connue de la victime, dans 45 % des cas, par le
conjoint ou l’ex-conjoint.
4 Avec cette compréhension que nous apportent les enquêtes scientifiques, nous tentons
de saisir les représentations biaisées des violences pouvant être véhiculées (image de la
femme faible qui ne peut pas se défendre, construction d’un profil type d’agresseur) et
leurs conséquences dans l’expérience des femmes : restriction de la mobilité des
femmes, sentiment d’insécurité accru et centré sur l’espace public, invisibilisation des
violences conjugales, etc. En cela, nous estimons qu’une représentation biaisée ou
partielle des violences sert une autre finalité que la lutte contre les violences faites aux
femmes à proprement parler et révèle une forme d’antiféminisme puisque cela
empêche l’identification par les femmes des violences et des auteurs, et donc
représente une entrave à leur empowerment10. Nous prenons ici l’exemple du traitement
médiatique des violences faites aux femmes et sa focale sur les violences exercées dans
l’espace public. Cet article s’attachera donc à identifier la dimension antiféministe
reposant sur une idéologie sécuritaire et raciste du traitement médiatique des
violences.
Une visibilité partielle des violences faites auxfemmes sur la scène publique et médiatique : quellesconséquences ?
5 Ce sont, en premier lieu, les violences conjugales qui ont été considérées au niveau
institutionnel en France.
Réclamée depuis les années 1970 par les féministes, cette prise en charge, permettant la
constitution des violences conjugales en « problème public », arrive en 1989 avec la
première campagne de lutte contre les violences conjugales. Les années 2000 ont vu
s’opérer une prise de conscience du phénomène social : la visibilisation des violences
faites aux femmes s’accentue via les médias, des campagnes de sensibilisation à une
échelle nationale. Un tournant s’opère sur la scène publique et dans les médias après
les années 2000. Alors que les violences envers les femmes dans l’espace public
restaient sans grand relais médiatique ni politique (malgré les dénonciations du
phénomène de la part de nombres d’universitaires et d’associations féministes), la
décennie 2010 a vu émerger une médiatisation massive de ces violences, réduites le
plus souvent à l’appellation « harcèlement de rue ». Des collectifs et associations
travaillent à dénoncer la banalisation des violences dans les espaces publics et dans les
transports en commun. Le terme « harcèlement de rue » devient incontournable. En
novembre 2015, une campagne publique est lancée par le ministère des Affaires
GLAD!, 04 | 2018
159
sociales, de la Santé et des Droits des femmes annonçant pour 2016 un plan national
« sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun »
présentant 12 « mesures concrètes »11.
6 Reste que cette prise de conscience n’est pas sans contradiction. Les violences de
genre12, dont le harcèlement sexiste, dans les espaces publics sont des réalités du
quotidien qu’il est important de visibiliser mais non pas sans expliciter qu’elles
s’inscrivent, comme le rappelle Marylène Lieber, dans un continuum des violences
envers les femmes13 et ne sont qu’une des expressions plurielles et multiformes de ces
violences. Nous identifions trois conséquences à cette focalisation de l’attention et de
l’action sur les violences faites aux femmes dans l’espace public : la mise en retrait des
violences conjugales, les effets sur le sentiment d’insécurité et la mobilité des femmes,
l’alimentation de discours et politiques sécuritaires.
7 Fonctionnant comme des vases communicants, la contrepartie de cette focale a été une
moindre attention et donc appréhension des violences perpétrées dans l’espace privé.
La mise en lumière de celles-ci a permis à nombre de femmes de les identifier et de les
dénoncer. Cependant, le fait de moins visibiliser les violences conjugales et leurs
auteurs14 (majoritairement des proches) engendre une difficulté réaffirmée
d’identification par les femmes elles-mêmes : elles peuvent avoir davantage de mal à
nommer les violences qu’elles vivent au quotidien au sein de leur couple.
8 Par ailleurs, sur-médiatiser les violences de genre dans l’espace public a des
conséquences sur le sentiment d’insécurité des femmes et sur leur mobilité, comme
nous allons le développer dans la deuxième partie de cet article. Les féministes ont
depuis longtemps pointé du doigt les effets d’une telle représentation des violences.
Colette Guillaumin15 a qualifié de « dressage négatif » l’alimentation des craintes et du
sentiment d’insécurité des femmes dans l’espace public, délégitimant leur présence
hors de la sphère privée puisqu’elles s’exposeraient alors (volontairement) aux
violences. Le pendant de ce dressage négatif est le dressage positif, soit la valorisation
des femmes et de leur place dans la sphère privée. L’invisibilisation des violences
conjugales à laquelle contribue cette focale sur les violences dans l’espace public nous
semble jouer ce rôle de dressage négatif/positif.
9 Enfin, cette posture ne désigne qu’un seul type d’agresseurs. Ce changement de focale
et la prise en considération par les institutions est en lien avec la montée des discours
sécuritaires, qui s’installent dès la fin des années 1990, puis deviennent symbole des
présidentielles de 2002. En lien avec le déclin de la gauche dans les urnes et la percée du
FN au second tour de la présidentielle de 2002, la campagne présidentielle puis la
politique de Nicolas Sarkozy a été largement basée sur cette problématique. Comme le
souligne Pauline Delage, c’est dans le cadre de l’aide aux victimes et de la sécurité — et
non de l’égalité entre femmes et hommes — que les associations de lutte contre les
violences sont invitées à travailler avec les forces de l’ordre16. Le contexte politique est
donc favorable à la visibilisation de ces violences, tout en étant instrumentalisées par
certains partis et certaines personnalités politiques. Cette appréhension politique va de
pair avec une « dépolitisation visant à éviter de remettre en cause les discriminations
dont les femmes font l’objet »17. Certains faits d’agressions, en particulier d’agressions
sexuelles envers des femmes dans la rue ou les transports, abondamment relayés par
les médias deviennent des cas exemplaires associés à une rhétorique sécuritaire. Les
médias ont ainsi joué un rôle dans l’émergence puis la sur-visibilisation des violences
GLAD!, 04 | 2018
160
dans l’espace public, alimentant ainsi les discours sécuritaires et la « nécessité » de
politiques s’y intéressant.
Médiatisation des violences de genre dans l’espacepublic : l’alimentation d’une rhétorique sécuritaire etraciste
10 Le traitement médiatique des violences de genre dans l’espace public s’appuie sur deux
stéréotypes sexués qu’il renforce aux conséquences politiques fortes : la femme faible,
et le prédateur sexuel. Nous allons identifier ce type de rhétorique dans certains
médias et présenter les effets pour les femmes dans un premier temps, sur leur
sentiment d’insécurité, leur mobilité et sur leur propension à se défendre18, puis les
effets en termes politiques, de renforcement d’une idéologie raciste et sécuritaire
desservant la lutte contre les violences faites aux femmes dans un second temps. Nous
nous appuyons sur des vidéos diffusées et des articles parus en ligne entre 2013 et 2017
dans la presse régionale, nationale et internationale.19
Les femmes : des proies fragiles
11 Le traitement médiatique des agressions sexistes et sexuelles s’inscrit en grande partie
dans une rhétorique que nous qualifions de « sensationnaliste ». Premièrement,
certaines agressions sont présentées comme des exemples symboliques, des cas
« exemplaires » dans la mesure où ils sont très largement repris dans les presses
locales, nationales et à la télévision. Cela a été le cas d’une agression sexuelle survenue
à Lille, le 25 avril 2014, qui a fait couler beaucoup d’encre : « une jeune femme a été
agressée sexuellement pendant 30 minutes par un homme ivre dans le métro de
Lille »20, relatée notamment sur le site du Nouvel Obs. La médiatisation insistait sur la
non-réaction des témoins21. Ceci joue un rôle sur l’alimentation du sentiment
d’insécurité des femmes : même en cas d’agression, elles ne peuvent solliciter d’aide ni
même en attendre ; les personnes alentour resteront immobiles. Les cas contraires —
des cas de réponses, de ripostes à des agressions ou des récits de « victoires » comme
nous encourageons à en partager dans les ateliers d’autodéfense féministe afin de
mettre en avant la capacité des femmes à se défendre — ne trouvent pas leur place dans
les médias.
12 Le traitement médiatique a pour effet de promouvoir la restriction de la mobilité des
femmes, en alimentant la représentation du caractère dangereux de l’espace public :
comme le souligne Virginie Despentes dans King King Théorie22, oser s’y aventurer, cela
signifie alors prendre un risque. Le traitement médiatique peut être plus ou moins
subtil. L’exemple caricatural d’articles publiés sur LaDépêche.fr (quotidien régional)
laisse peu de doutes quant aux objectifs des journalistes. L’article du 2 mai 2013, « Une
étudiante violée en rentrant de soirée », décrivait avec de (trop) nombreux détails
l’agression sexuelle d’une étudiante de 23 ans « revenant de soirée ». En conclusion,
une recommandation qui frôle l’injonction : « Régulièrement, à Toulouse, des jeunes
filles sont victimes d’agressions sexuelles la nuit. Il leur est conseillé d’éviter de se promener
toutes seules ». L’article du 18 mai 2013, « Agressions sexuelles sur des étudiantes : faut-il
avoir peur la nuit à Toulouse ? », conseillait une fois de plus aux femmes « la
prudence », il conviendrait pour les femmes la nuit à Toulouse de « marcher tête
GLAD!, 04 | 2018
161
baissée », de « prier pour qu’il ne [leur] arrive rien ». Le journal s’adressait donc aux
victimes plutôt qu’aux agresseurs, alimentant ce « dressage négatif » de façon explicite.
Le Planning familial 31 s’était alors mobilisé pour dénoncer ce traitement médiatique
avec deux communiqués publiés les 13 mai 2013 et 28 mai 2013. Aucune réaction du
média local.
13 Interviewée sur LeMonde.fr, Marylène Lieber rappelle que les femmes subissent des
« rappels à l’ordre sexués, […] qui leur rappellent sans cesse qu’elles sont des “proies”
potentielles dans l’espace public »23. En effet, la figure type du violeur s’attaquant à des
jeunes femmes dans une rue sombre la nuit alimente l’idée de la faiblesse des femmes,
les encourage à se percevoir comme des cibles, des victimes, des proies, justifiant ainsi
le sentiment d’insécurité à l’extérieur (et non pas dans la sphère privée). Cette posture
nie non seulement la réalité des violences conjugales mais également les histoires de
« réussite » : la possibilité et les outils à disposition des femmes pour se défendre. De
tels discours réitérés jouent non seulement sur la mobilité des femmes mais
représentent aussi un frein à leur empowerment. Très régulièrement, lors de nos ateliers
ou stages, des participantes partagent des peurs, font référence à des situations de type
« seule dans la rue, la nuit/dans un parking souterrain… ». Parmi les situations types
proposées par l’animatrice figure le fait d’être suivie dans la rue. Il s’agit de
transmettre et de faire émerger des stratégies mais aussi d’illustrer des échanges
précédents dans l’atelier invitant à déconstruire les messages extérieurs et stéréotypes
véhiculés par les médias, les films, etc.
Les agresseurs : des figures d’exception
14 En parallèle de la représentation des femmes comme des proies fragiles est véhiculée
une représentation « exceptionnelle » des agresseurs. Les auteurs de violence tels que
décrits dans les médias relèvent volontiers du « hors-norme », soit ayant un caractère
psychologique défaillant (« fou », « dérangé ») soit relevant d’une figure
« extraordinaire » (« prédateur », « vampire », « inconnu », « frotteur »). Les agresseurs
ne sont donc pas qualifiés en tant que tels, ni même nommés en tant qu’« hommes ». À
titre d’exemple, des titres accrocheurs comme : « Paris : le frotteur du métro avait
découpé ses pantalons à l’entrejambe »24 ou « Le prédateur avait sévi en pleine nuit »25.
15 Ce type de traitement médiatique a deux effets :
– l’invisibilisation du caractère systémique des violences de genre : le « fou » ou
« prédateur » n’est pas un « monsieur-tout-le-monde », il est donc hors norme et fait
figure d’exception. S’il s’agit d’une exception, il ne s’agit donc pas d’un fait de société,
d’une conséquence de la socialisation genrée à la violence ou de la culture du viol. Il n’y
aurait pas de dimension structurelle au phénomène de ces violences et donc pas
d’actions de fond à réaliser pour lutter contre elles.
– le profil type de l’agresseur est un « autre » non identifiable, un inconnu. L’insistance
médiatique sur ce type d’agression corrélée à la banalisation, la romantisation et à
l’invisibilisation des violences conjugales (qualifiées volontiers de querelles de couple,
de disputes qui tournent mal, de crime passionnel, etc.) renforce la distorsion de la
représentation des violences de genre qui seraient davantage le fait d’inconnus, donc
des violences au caractère imprévisible et perpétrées dans la sphère publique. Or les
chiffres nous montrent la prégnance et la prédominance des violences perpétrées par
un proche : les femmes ayant vécu des violences sexuelles connaissent leurs agresseurs
GLAD!, 04 | 2018
162
dans 86 % des cas, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes (Lettre
N° 4 – novembre 2014)26. Cette représentation complexifie l’identification des violences
conjugales et la capacité des femmes à se défendre lorsque l’agresseur est un de leur
proche, leur compagnon ou mari ou membre de la famille.
16 Par ailleurs, l’alimentation de cette figure de l’autre, d’un inconnu, fou et/ou dérangé
comme profil type de l’agresseur vient jouer un rôle de construction de l’altérité et
d’une population-type d’agresseurs basée sur une stigmatisation liée à une idéologie
raciste ambiante, comme nous le développons en troisième partie de cet article.
Les « autres », les hommes racisés, toujours plus sexistes
17 La compréhension du contexte politique dans lequel s’inscrit ce traitement médiatique
est fondamentale pour saisir la construction des représentations sur les auteurs de
violences. Nous défendons l’idée que le discours sécuritaire qui s’installe dès la fin des
années 1990 dans le champ politique prend très largement appui sur une idéologie
raciste. Le traitement médiatique des violences dans l’espace public est le reflet et le
moteur de cette rhétorique.
18 Avec l’émergence de la problématique publique du « harcèlement de rue », la figure
type du « harceleur de rue » se construit. Celui-ci est majoritairement présenté (dans
les médias et dans les discours) comme un jeune homme racisé et/ou issu des classes
populaires (« le banlieusard », « la racaille », « l’arabe »). Cette figure est relayée par
différents types de médias et intériorisée massivement.
19 Le 26 juillet 2012, un documentaire réalisé à Bruxelles par une étudiante en audiovisuel
fait un buzz médiatique. En caméra cachée, Sofie Peeters montrait le harcèlement
coutumier dont elle était victime en se déplaçant dans les rues de son quartier. Si le
documentaire a le mérite de dénoncer une réalité vécue par une majorité des femmes,
son traitement médiatique a de quoi questionner. Une telle médiatisation n’est pas
étrangère au fait que le documentaire se déroule dans un quartier où la population
d’origine maghrébine est importante. Les personnes qui interpellent Sofie Peeters sur
la vidéo sont en effet presque uniquement des hommes racisés.
20 Suite à ce buzz, quelques associations féministes ont attiré l’attention sur le fait que le
harcèlement de rue est présent en tout lieu et perpétré par des hommes de toutes les
classes sociales et origines et donc aussi par les hommes blancs. Elles rappellent le
phénomène structurel des violences envers les femmes, dans lequel s’inscrivent les
violences perpétrées dans l’espace public. Malgré ces alertes, les médias de masse se
sont servis de la vidéo afin d’alimenter une rhétorique stigmatisante. Ainsi, le quotidien
régional belge, Sudinfo.be, titre : « Femmes insultées dans les rues de Bruxelles : dans
95 % des cas ce serait par des Maghrébins »27. Notons que l’information est
immédiatement relayée par le site fdesouche.com. Évidemment, ce phénomène ne reste
pas cantonné à la Belgique. Le 3 mars 2013, l’émission télévisée Envoyé spécial reprenait
cette rhétorique avec le documentaire « Femmes : le harcèlement de rue » qui tentait
de faire l’expérience en France. Une journaliste sortait alors dans les rues en utilisant
une caméra cachée. Interrogée à la fin du documentaire, elle insistait « sans vouloir
stigmatiser » sur le fait que les jeunes hommes qui l’avaient abordée étaient surtout
noirs ou arabes… La plus récente polémique médiatique (reprise aussi bien par la presse
locale que nationale et même internationale) autour du quartier populaire de La
GLAD!, 04 | 2018
163
Chapelle à Paris, qui serait devenue une « no-go zone » pour les femmes, réemploie ce
même registre.
21 On voit donc se généraliser dans le discours médiatique cette figure du harceleur jeune,
noir, arabe ou encore banlieusard. Ce phénomène n’est pas nouveau : le présupposé du
jeune arabe de banlieue présumé davantage sexiste que les hommes blancs, existe
depuis longtemps. Des chercheuses comme Christelle Hamel et Sylvie Tissot ont montré
que l’accent mis sur le sexisme dans les banlieues « a eu comme premier effet de rendre
invisibles la domination masculine et l’oppression de genre qui sévissent “ailleurs”,
c’est-à-dire dans le “monde occidental” ou chez les “Blancs” »28.
22 Comme autre exemple d’un racisme et d’un classisme libéré, on peut citer la chronique
« les cons des rues »29. Chroniqueuse blanche, Noémie de Lattre est très explicite quand
elle affirme que « les auditeurs de France Inter ne sont bien sûr pas ces gros cons ».
Ainsi, elle réaffirme le présupposé classiste et raciste que le sexisme dans l’espace
public ne concerne pas les intellectuels, les bourgeois, les Blancs. Noémie de Lattre cite
explicitement le « jeune de banlieue », imitant un accent, le qualifiant d’« avorton au
charisme d’huître [...], avec un jean sous les fesses, sa casquette à l’envers et son 18 de
QI ». Elle s’indigne qu’il ose lui parler, à elle, qui est « un milliard de fois plus
intelligente que lui, plus évoluée, plus sophistiquée et meilleure que lui ». Cette
chronique reprend à son compte les arguments culturalistes visant à exotiser la
sexualité des jeunes des banlieues qui agresseraient des femmes par « frustration
sexuelle » liée à un « tabou culturel ». Ce stéréotype va dans le sens des travaux de
Laurent Mucchielli et de ceux de Christelle Hamel30 qui ont démontré une sur-
médiatisation des viols collectifs dans les quartiers populaires ne correspondant pas
aux réalités statistiques.
23 Si on parle de « frustration sexuelle » lorsqu’il s’agit d’un jeune homme racisé, à
l’inverse, le viol ou tentative de viol d’un homme politique comme DSK va être qualifié
de « troussage de domestique » (selon Jean-François Kahn), qui ne provoque pas « mort
d’homme » (selon les propos de l’ancien ministre socialiste Jack Lang) et celui-ci sera
identifié comme « libertin » et non agresseur (en une de Sud-Ouest à la suite des
affaires du Sofitel et du Carlton). En effet, comme le dit Alix Van Buuren, en réponse à
la chronique de Noémie de Lattre, « nous ne dénonçons pas la violence des riches de la
façon dont nous dénonçons la violence des “pauvres”, on ne dénonce pas la violence
des Franco-Français de la façon dont on dénonce celle des autres ou du moins celle
qu’on décrit comme étant autre »31.
Conclusion
24 À notre échelle d’action associative et militante, ces focales sur l’insécurité dans
l’espace public s’expriment dans les échanges lors des ateliers d’autodéfense : les
participantes vont avoir davantage tendance, dans les premiers temps de l’atelier, à
prendre pour exemple des agressions vécues dans la rue. Certes, il peut être considéré
comme plus simple de parler de ce type d’agression que d’exposer en groupe la violence
d’un proche. Cependant, nous notons une évolution des témoignages qui se portent
davantage sur l’espace public ces dernières années. La grande visibilité de ce type de
violences permet certes de les identifier et de les dénoncer mais les récits d’expériences
peuvent également être empreints des stéréotypes véhiculés par les discours
médiatiques.
GLAD!, 04 | 2018
164
Ainsi, il nous semble important de souligner que les violences faites aux femmes dans
l’espace public ne sont pas prises en compte dans leur ensemble et leur complexité
mais sont instrumentalisées à des fins racistes par les médias et l’espace politique. À
contrario, les violences faites aux femmes racisées dans l’espace public sont totalement
invisibilisées. Nous souhaitons citer à ce titre, l’article « du caractère polymorphe et
multicolore du relou en milieu urbain » publié sur le blog asclemmiewonders32 faisant
état de toutes les violences vécues par l’auteure du blog en tant que femme racisée « en
mini short et collants troués » et perpétrées par des hommes blancs et/ou bourgeois. Il
est important également de pouvoir relayer les violences vécues par les femmes
portant un voile et, en particulier, depuis les attentats de Charlie Hebdo. Selon le CCIF33,
les agressions contre les musulman-e-s concernent beaucoup plus de femmes que
d’hommes : elles représentent plus de 81 % des victimes et la quasi-totalité des
agressions violentes34. Les médias ne relayent pas la parole de toutes. Il nous semble
important que les associations ou collectifs féministes qui s’emparent de la question
des violences dans l’espace public soient vigilantes à relayer toutes les formes de
violences.
25 Dans nos pratiques féministes, une réflexion intersectionnelle s’impose. Qu’il s’agisse
des termes que nous employons entre nous ou dans les ateliers dispensés de façon à
faciliter la parole de toutes sur l’ensemble des violences vécues, qu’il s’agisse des
exemples présentés par l’animatrice ou de notre propre intériorisation des stéréotypes,
nous souhaitons veiller à ne pas alimenter les effets de la sur-médiatisation ici
développée. Il reste primordial de placer au cœur de nos pratiques l’expérience des
femmes participantes, partir de leur vécu.
26 Par ailleurs, nous devons être vigilantes aux récupérations de l’autodéfense féministe.
En effet, de ces discours sécuritaires associés à la sécurité des femmes naît un secteur
florissant de la self-défense ou autodéfense féminine, majoritairement avec un
animateur homme lors des ateliers. Or, on peut observer dans les communications de
certains « instructeurs » de ce secteur, qu’ils véhiculent le discours sécuritaire, utilisent
les figures de l’inconnu dangereux dans la rue, du jeune de banlieue et se prévalent,
bien entendu, de toute approche systémique des violences et de toute compréhension
féministe de la question des violences faites aux femmes, pour attirer des femmes dans
leurs cours. Pour nous, l’autodéfense féministe ne peut être associée à ces rhétoriques
sécuritaires et antiféministes. L’autodéfense féministe est un outil et doit rester un
espace et un outil d’empowerment, de renforcement de la confiance en soi, de prise de
conscience de ses propres armes par et pour les femmes.
Héloïse Prévost et Jennifer Quintas, pour
l’association Faire Face
Pour prendre contact avec l’association et/ou s’inscrire à des ateliers ou stages
d’autodéfense :
Écrire à [email protected] — inscriptions@faireface-
autodefense.fr
Appeler le 07-62-62-70-80
Suivez nos actus sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/
FaireFaceAutodefense/
Ou consulter les prochaines dates et s’inscrire directement via le site internet
www.faireface-autodefense.fr
GLAD!, 04 | 2018
165
BIBLIOGRAPHIE
DELAGE, Pauline. 2017. Violences conjugales. Du combat féministe à la cause publique. Paris : Presses de
Sciences Po.
DESPENTES, Virginie. 2006. King Kong Théorie. Paris : Grasset.
GUILLAUMIN, Colette. 2016 [1992]. Sexe, race et pratique du pouvoir. Paris : Éditions iXe.
HAMEL, Christelle. 2003. « Faire tourner les meufs. Les viols collectifs : discours des médias et des
agresseurs » Gradhiva 33 : 85-92.
JASPARD, Maryse. 2007. « L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France
(Enveff) : historique et contexte », in Violence envers les femmes. Trois pas en avant deux pas en
arrière, CHETCUTI Natacha et JASPARD Maryse (éd.), Paris : L’Harmattan, 25-39.
LIEBER, Marylène. 2003. « La double invisibilité des violences faites aux femmes dans les contrats
locaux de sécurité français » Cahiers du Genre [En ligne] 35(2), consulté le 17 juin 2018. URL :
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2003-2-page-71.htm ; DOI : 10.3917/cdge.
035.0071.
LIEBER, Marylène. 2008. Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en question.
Paris : Presses de Sciences Po.
MUCCHIELLI, Laurent. 2005. Le scandale des tournantes : dérives médiatiques et contre-enquête
sociologique. Paris : La Découverte.
SANCHEZ, Camille. 2017. « Ivres, les médias nous parlent de féminicides » [En ligne], consulté le 28
juin 2018. URL : https://camillesanchez.atavist.com/ivres-les-medias-nous-parlent-des-
fminicides
TISSOT, Sylvie. 2007. « Bilan d’un féminisme d’État » Plein droit [En ligne] 75, consulté le 17 juin
2018. URL : https://www.gisti.org/spip.php?article1072
NOTES
1. L’association Faire Face organise et anime, à Toulouse et en région Occitanie, des ateliers et des
stages d’autodéfense tout au long de l’année à travers différentes formules ponctuelles (séances
de 3 heures à 8 heures, ou stages de 14 heures sur plusieurs jours).
2. Par « spécifiques » est entendu la pluralité des formes de violences que subit le groupe social
des femmes. Ce groupe social est bien entendu hétérogène : nous n’avons pas toutes le même
vécu de violences selon nos origines, nos milieux sociaux, nos sexualités, nos identités de genre,
nos âges, nos conditions physiques, nos expériences de vies, etc.
3. Les participantes aux ateliers de notre association, à l’heure actuelle, sont presque
exclusivement des femmes cisgenre. C’est pourquoi, lorsque nous utilisons la catégorie
« femmes », c’est à ce groupe que nous faisons référence. Pourtant, les personnes trans et
intersexes sont également touchées par les violences de genre. Différentes associations et
collectifs développent des stages pour et avec elles.
4. L’autodéfense féministe se distingue ainsi d’autres pratiques de self-défense ou autodéfense
féminine où l’animation est souvent assurée par un homme provenant du secteur de la
GLAD!, 04 | 2018
166
surveillance ou de la police ou militaire et dont la pratique n’est pas basée sur une réflexion et
analyse de genre des violences.
5. Lors des ateliers et stages, les participantes sont invitées à partager, si elles le souhaitent, des
expériences d’agressions, de violences vécues ou dont elles ont été témoin, que ce soit avec des
personnes de l’entourage, des personnes inconnues, des collègues, des proches, unE conjointE,
des membres de la famille, des personnes travaillant dans des institutions/autres structures
fréquentées.
6. L’espace public est entendu comme un environnement « exterieur », par opposition au couple,
a la famille, au foyer, au cercle d’amis. Il exclut aussi le lieu du travail et recouvre des lieux aussi
divers que la rue, les grands magasins, les clubs de sport, les restaurants, les transports en
commun etc. voir JASPARD, Maryse. 2007. « L’enquête nationale sur les violences envers les
femmes en France (Enveff) : historique et contexte », in CHETCUTI Natacha et JASPARD Maryse (dir),
Violence envers les femmes. Trois pas en avant deux pas en arrière. Paris : L’Harmattan, 25-39
7. Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France, premie re enque te
statistique sur ce theme en France menée en 2000 auprès d’un échantillon représentatif de 6970
femmes âgées de 20 à 59 ans et résidant en métropole.
8. « Par-dela les actes violents caracte rise s (brutalites physiques et sexuelles), l’accumulation de
faits, de gestes, de paroles en apparence sans gravite peuvent constituer un comportement
violent. Perpetre s dans la dure e, les actes violents constituent un continuum, si bien que
distinguer séparément des types de violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles
s’avère peu pertinent ; le terme “situation de violences conjugales” apparait plus a meme de
rendre compte de la realite du phenomene » J ASPARD, Maryse. 2007. « L’enquête nationale sur les
violences envers les femmes en France (Enveff) : historique et contexte », in CHETCUTI Natacha et
JASPARD Maryse (dir), Violence envers les femmes. Trois pas en avant deux pas en arrière. Paris :
L’Harmattan, p. 36.
9. L’enquête Violences et rapports de genre (VIRAGE) a été réalisé en 2015 auprès d’un
échantillon de 27000 femmes et hommes, représentatif de la population âgée de 20 à 69 ans,
vivant en ménage ordinaire, en France métropolitaine
10. Par empowerment est entendu le processus dynamique d’acquisition de différentes formes de
pouvoir : pouvoir sur, pouvoir avec, pouvoir de, pouvoir intérieur pouvant engendrer des
changements à l’échelle individuelle, collective et structurelle.
11. Plan national de lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les
transports en commun, téléchargeable sur http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Le-plan-
national-de-lutte-contre.html
12. À noter que l’expression « violence faites aux femmes » a été celle d’abord utilisée au sein de
la recherche scientifique et par les politiques publiques. Par la suite, la notion de « violence de
genre » est apparue (comme le montre le nom de l’enquête Virage), notion que nous adoptons
dans ce texte lorsque que nous présentons des éléments de notre propre analyse. Lorsque nous
abordons l’appréhension par les politiques publiques, nous adoptons l’expression que ces mêmes
politiques adoptent sur la période citée.
13. LIEBER, Marylène. 2003. « La double invisibilité des violences faites aux femmes dans les
contrats locaux de sécurité français » Cahiers du Genre [En ligne] 2(35), consulté le 17 juin 2018.
URL : https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2003-2-page-71.htm ; DOI : 10.3917/cdge.
035.0071.
14. Ici le terme « auteurs » est employé au masculin, du fait de la prise en compte de la réalité et
des données statistiques qui montrent que la grande majorité des auteurs de violences sont des
hommes.
15. GUILLAUMIN, Colette. 2016 [1992]. Sexe, race et pratique du pouvoir. Paris : Éditions iXe.
GLAD!, 04 | 2018
167
16. DELAGE, Pauline. 2017. Violences conjugales. Du combat féministe à la cause publique. Paris : Presses
de Sciences Po.
17. LIEBER, Marylène. 2008. Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en question.
Paris : Presses de Sciences Po, p. 301
18. C’est-à-dire mettre en place des stratégies, que ce soit en ripostant par des mots, par des
gestes et/ou des coups, en désamorçant, en fuyant, en interpelant, en cherchant la désescalade,
en créant de la solidarité autour de soi, en dénonçant, en en parlant…
19. Dans une même démarche, notons l’enquête réalisée par Camille Sanchez sur le traitement
médiatique des féminicides : SANCHEZ, Camille. 2017. « Ivres, les médias nous parlent de
féminicides » [En ligne], consulté le 28 juin 2018. URL : https://camillesanchez.atavist.com/ivres-
les-medias-nous-parlent-des-fminicides
20. Source : http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20140425.OBS5175/lille-une-femme-
agressee-dans-le-metro-dans-l-indifference-generale.html
21. « Agression dans le métro de Lille: ce qui a poussé les passagers... à ne rien faire » ; source :
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1194546-agression-dans-le-metro-de-lille-ce-qui-a-
pousse-les-passagers-a-ne-rien-faire.html
22. DESPENTES, Virginie. 2006. King Kong Théorie. Paris : Grasset.
23. Source : https://www.lemonde.fr/culture/article/2012/10/04/la-rue-fief-des-
males_1770418_3246.html
24. Dépêche du 11 janvier 2016 reprise, entre autres, dans LeParisien.fr (http://www.leparisien.fr/
paris-75/le-frotteur-du-metro-avait-decoupe-ses-pantalons-a-l-
entrejambe-11-01-2016-5440895.php), LaDépêche.fr (https://www.ladepeche.fr/article/
2016/01/12/2254195-paris-frotteur-metro-avait-decoupe-pantalons-entrejambe.html),
20minutes.fr, lenouveaudétective.com, lejournaldesfemmes.com.
25. Source : https://www.ladepeche.fr/article/2015/10/09/2194213-le-predateur-sexuel-avait-
sevi-en-pleine-nuit.html
26. Source : http://stop-violences-femmes.gouv.fr/no4-Violences-au-sein-du-couple-et.html
27. Source : http://www.sudinfo.be/archive/recup/468479/article/regions/bruxelles/
2012-07-26/femmes-injuriees-dans-les-rues-de-bruxelles-dans-95-des-cas-ce-serait-par-des-ma
28. TISSOT, Sylvie. 2007. « Bilan d’un féminisme d’État » Plein droit [En ligne] 75, consulté le 17 juin
2018. URL : https://www.gisti.org/spip.php?article1072
29. Chronique du 21 juin 2014, visible sur https://www.youtube.com/watch?v=U7OzhGqL-Kc
30. Voir MUCCHIELLI, Laurent. 2005. Le scandale des tournantes : dérives médiatiques et contre-enquête
sociologique. Paris : La Découverte, et HAMEL, Christelle. 2003. « Faire tourner les meufs. Les viols
collectifs : discours des médias et des agresseurs » Gradhiva 33 : 85-92.
31. Source : https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20140626.RUE4631/
le-harcelement-de-rue-et-le-feminisme-bourgeois.html
32. http://clemmiewonder.tumblr.com/post/98134059269/du-caract%C3%A8re-polymorphe-et-
multicolore-du-relou-en
33. Collectif Contre l’Islamophobie en France
34. LORRIAUX, Aude. 19/10/2015. "Les actes anti-musulmans cachent-ils une misogynie?", Slate,
date de consultation. URL : http://www.slate.fr/story/106363/actes-anti-musulmans-misogynie
GLAD!, 04 | 2018
168
RÉSUMÉS
À partir de l’expérience et des réflexions portées au sein de l’association d’autodéfense féministe
Faire Face, cet article présente une analyse sur l’instrumentalisation des violences faites aux
femmes par les médias et certains discours politiques. Au travers d’exemples médiatiques, nous
étudions en quoi l’importante médiatisation des violences dans l’espace public contribue à
invisibiliser les violences dans l’espace privé et peut porter à une restriction de la mobilité des
femmes. En perpétuant les mythes selon lesquels la rue est plus dangereuse pour les femmes que
l’espace privé, ces rhétoriques alimentent leur sentiment d’insécurité. Par ailleurs, les focales sur
les violences perpétrées par certaines populations (racisées et/ou issues de la classe populaire)
invisibilisent les auteurs de violences issus d’autres groupes sociaux ainsi que les violences
spécifiques vécues par les femmes racisées dans l’espace public. Enfin, le processus de
récupération des pratiques féministes comme l’autodéfense féministe est discuté, avec l’exemple
des initiatives de « self-defense féminine ». Nous réaffirmons que l’autodéfense féministe est un
outil d’empowerment, de renforcement de la confiance en soi, de prise de conscience de ses
propres armes par et pour les femmes.
Based on the experience and reflections of the feminist self-defense Association Faire Face, this
article presents an analysis of the instrumentalization of violence against women by the media
and by political discourses. Through media examples, we study how the important media
coverage of violence in the public space contributes to invisibilize violence in private spaces and
can lead to a restriction of women mobility. By perpetuating the myths that streets are more
dangerous for women than private spaces, these rhetorics increase their sense of insecurity.
Moreover, focusing on violence perpetrated by certain populations (racialized and / or from the
popular class) invisibilizes violent acts perpetrated by men from other social groups as well as
the specific violence experienced by racialized women in the public space. Finally, the process of
appropriation of feminist practices is discussed, with the example of "women’s self-defense"
initiatives. We reaffirm that feminist self-defense is a tool for empowerment, self-confidence,
awareness of one’s own weapons by and for women.
INDEX
Keywords : feminist self-defense, media, violence, sexual harassment, discourses on women’s
safety, security rhetorics, racist rhetorics
Mots-clés : autodéfense féministe, médiatisation, violences, harcèlement de rue, discours
sécuritaires et racistes
Thèmes : Explorations
AUTEUR
ASSOCIATION FAIRE FACE
Créée à Toulouse en 2007, Faire Face est une association de prévention des violences contre les
femmes qui organise et anime des ateliers et stages d’autodéfense. Méthode créée par des
femmes pour des femmes, l’autodéfense consiste à transmettre et partager une large palette
d’outils et de stratégies psychologiques, verbales et physiques afin de favoriser et d’encourager la
liberté, la confiance en soi et l’autonomie des femmes.
GLAD!, 04 | 2018
169
Des corps « monstres ». Historiquedu stigmate féministe« Monstrous » Bodies. History of the Feminist Stigma
Caroline Fayolle
Harpie Monstre Amphibie Vivant
Gallica http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69423849/
1 Le gain de légitimité acquis actuellement par la lutte pour l’égalité des sexes ne doit pas
faire oublier que les féministes ont longtemps été, non seulement inaudibles dans
GLAD!, 04 | 2018
170
l’espace public, mais aussi porteuses d’un stigmate. Comme l’a montré le sociologue
Erving Goffman, le stigmate constitue un attribut visant à dévaloriser certaines
catégories de population qui sont censées s’écarter de la norme sociale dominante
(Goffman 1975). Les féministes ont subi, et subissent encore, une violence symbolique
visant à sanctionner leur « déviance » vis-à-vis de la norme sexuée. Cette stigmatisation
s’opère notamment par une rhétorique antiféministe (Bard 1999). Dans une démarche
archéologique, on se propose ici d’exhumer du passé une des formes de cette
rhétorique qui continue d’innerver, de manière implicite, les perceptions
contemporaines du féminisme : celle du « monstre mi-homme mi-femme » qui permet
d’éclairer à la fois l’entreprise de pathologisation du féminisme et les stratégies mises
en œuvre par les militantes pour riposter contre elle, se défendre contre les mots et par
les mots.
2 Cette forme de stigmatisation du féminisme émerge à la Révolution française, période
durant laquelle la figure du « monstre » constitue une arme discursive courante pour
disqualifier les adversaires politiques comme les aristocrates. Cet imaginaire se
développe dès le début de la période révolutionnaire pour stigmatiser notamment la
reine Marie-Antoinette représentée comme un être hybride mi-humain mi-bête comme
en témoigne l’iconographie de l’« Antoinette-méduse » (De Baecque 1993). Par ces
représentations, il s’agit de dénoncer la dégénérescence du corps aristocratique qui
menace, par risque de contagion, l’ensemble du corps de la Nation. Par la suite, cette
entreprise de stigmatisation s’étend aux femmes révolutionnaires qui aspirent à
prendre part à la vie politique. Si le mot « féminisme » n’existe pas encore à cette
époque, des militantes révolutionnaires, comme Olympe de Gouges, Etta Palm d’Aelders
ou encore Mary Wollstonecraft, se sont engagées contre l’oppression des femmes et en
ont payé le prix fort. Dans un contexte où les élites révolutionnaires aspirent à fonder
une société nouvelle sans pour autant remettre en cause la division sexuée des rôles
sociaux, s’élabore un discours sur la menace de la confusion des sexes. Les femmes, qui
dénoncent l’exclusion politique dont elles sont l’objet, sont perçues comme
l’incarnation de cette menace. Elles viendraient remettre en cause « l’ordre de la
nature » sur lequel se fonde la société « régénérée ». Pour cette raison, elles sont
accusées d’être des « viragos » — terme couramment utilisé sous l’Ancien Régime pour
désigner des femmes autoritaires et masculines —, des « monstres » sur le plan
physique et moral, des « êtres mi-hommes mi-femmes ». On peut citer en guise
d’exemple le révolutionnaire Chaumette, élu procureur de la Commune révolutionnaire
depuis décembre 1792, qui cherche à convaincre les femmes de rester « à leur place »
en évoquant « cette virago, cette femme-homme, l’impudente Olympe de Gouges qui, la
première, institua des assemblées de femmes, voulut politiquer et commit des crimes »
(Fayolle 2016). Ces corps hybrides et malades viennent paradoxalement témoigner de la
fluidité des identités sexuées puisqu’ils prouvent que la féminité, loin
d’être « naturelle », nécessite d’être performée par un comportement jugé adéquat avec
les normes sexuées. Face à cette entreprise de stigmatisation, les pionnières du combat
pour l’égalité des sexes élaborent des stratégies. Olympe de Gouges tente ainsi un
retournement du stigmate. Peu de temps avant sa mise à mort sur la guillotine, elle
écrit : « Je suis un animal sans pareil, je ne suis ni homme, ni femme. J’ai tout le courage
de l’un, et quelque fois les faiblesses de l’autre » (cité dans Hesse 2001 : 140). Ainsi, pour
mieux lutter contre l’opprobre du « monstre », Olympe de Gouges non seulement
l’assume, mais essaie d’en faire une force : son hybridité sexuelle lui permettrait de
GLAD!, 04 | 2018
171
faire l’expérience du courage viril, d’autant plus vertueux qu’il ne s’accompagne pas de
la force physique traditionnellement attribuée aux hommes.
3 À la période postrévolutionnaire, un discours conservateur réactive le souvenir de ces
monstres mi-hommes mi-femmes qui sont perçus comme le symptôme des « excès » de
la Révolution et de son immoralité. Au même moment, les médecins, qui participent à
justifier par un discours « savant » la mise sous tutelle des femmes par le Code Civil,
entreprennent de naturaliser l’inégalité entre les sexes (Knibiehler 1976). Les femmes
qui refusent d’être cantonnées à leur rôle d’épouse et de mère sont jugées malades,
infertiles et sujettes à des troubles physiques et psychologiques. Incarnation d’une
féminité « déviante », elles servent de contre-exemples pour apeurer les autres femmes
et les inciter à rester à la place à laquelle la société les assigne. Le stigmate du monstre
est aussi associé aux « femmes auteurs » qui transgressent l’ordre sexué en prenant la
plume. Germaine de Staël tente alors de le contourner. Pour cela, dans son ouvrage De
la littérature, elle substitue à la figure du monstre la figure romantique de la paria
(Varikas 2007) qui n’appartient ni à la classe des femmes ni à celle des hommes (Staël
1991 [1800] : 341-342). L’usage du travestissement masculin, utilisé par George Sand et
plus tard par la féministe Madeleine Pelletier, peut aussi se lire comme une résistance à
cette entreprise de stigmatisation.
4 La menace de la confusion des sexes, et sa dimension pathologique, est au cœur même
de l’émergence du mot « féminisme ». Ce dernier apparait, au début des années 1870,
dans la thèse de médecine de Ferdinand-Valère Fanneau de La Cour qui a pour titre Du
féminisme et de l’infantilisme chez les tuberculeux. Pour le médecin, les corps des hommes
tuberculeux seraient affectés, en raison de la maladie, par un processus de
féminisation : le système pileux serait peu développé, la peau plus fine et « molle »,
leurs mouvements auraient « ce je-ne-sais-quoi d’ondulant et de gracieux qui est le
propre de la chatte et de la femme » (Preciado 2014). Le mot « féminisme » est par la
suite utilisé par l’écrivain Alexandre Dumas (fils), connu pour ses multiples
déclarations misogynes, qui lui donne un sens sensiblement différent dans son ouvrage
L’homme-femme : réponse à M. Henri d’Ideville paru en 1872 (Offen 1987). Il y qualifie de
« féministes » les hommes qui soutiennent les luttes pour les droits des femmes. Par ce
néologisme, il exprime son mépris envers ces hommes qui auraient perdu leurs
attributs virils. Cet usage du mot, s’il perd son sens médical, conserve en lui le spectre
du monstre hybride. À nouveau, les militantes pour l’égalité des sexes expriment une
capacité d’agir politique en opérant une démarche de réappropriation des mots
infâmants. Dans le sillon de la militante Hubertine Auclert qui se revendique pour la
première fois comme féministe, les suffragettes utilisent le mot « féminisme » pour
désigner la lutte politique pour l’égalité entre les sexes. Cette signification se diffuse à
la fin du XIXe siècle comme en témoigne par exemple la création d’une Fédération
française des sociétés féministes en 1891. Pour autant, ce retournement de sens
n’empêche pas la persistance tout au long du XXe siècle d’un discours associant le
féminisme au péril de l’indifférenciation sexuelle perçue comme une pathologie sociale
de la modernité. Mi-hommes, mi-femmes, les féministes se seraient écartées du
« chemin de la nature ». Leur hybridité sexuelle participe à expliquer que la rhétorique
antiféministe les associe aux « lesbiennes », autre figure d’une féminité jugée
monstrueuse. Lesbophobie et antiféminisme s’allient pour rejeter dans l’opprobre
celles qui dérogent aux normes sexuelles issues du patriarcat (Bard 1999 : 27).
GLAD!, 04 | 2018
172
5 Ainsi, les militantes pour l’égalité des sexes ont été l’objet d’un discours qui situe leurs
corps au-delà des frontières du « normal », dans les limbes pathologiques du
monstrueux. Elles partagent en cela, mais dans une bien moindre mesure, l’expérience
des prostitué.es, des homosexuel.les, des trans et des intersexué.es qui, depuis le XIXe
siècle, subissent une police du genre impliquant une psychiatrisation et une
pathologisation de leurs corps. L’origine médicale du terme « féminisme » fait d’ailleurs
écho à celle du mot « genre » également théorisé par des médecins du milieu du XXe
siècle qui cherchaient à réassigner au « bon » sexe les enfants né.es intersexué.es
(Dorlin 2008 : 33-43). Cette communauté de stigmate participe sans doute à expliquer
les alliances contemporaines qui se nouent notamment à l’intérieur de la théorie et de
l’activisme queer. La revendication de l’identité queer — mot qui est un retournement
du stigmate associé à l’homosexualité — pourrait aussi être vue comme l’expression
d’une révolte de tous les corps monstres qui cherchent à échapper au carcan du genre.
Cette révolte passe notamment par le langage et par des stratégies de réappropriation,
de contournement et de déconstruction de la rhétorique anti-genre actuelle où peuvent
se lire les traces du spectre du monstre mi-homme mi-femme. Inversement, à l’heure
où le féminisme est aussi récupéré et instrumentalisé à travers les pratiques
institutionnelles et marketing du « féminisme-washing », le retour sur ce processus
historique de stigmatisation peut participer à réactualiser la portée subversive du mot
« féminisme ». En ce sens, la monstration d’un corps féministe qui refuse la binarité des
sexes peut se lire, à travers une dialectique passé-présent, comme le renversement
critique d’un ancien stigmate.
BIBLIOGRAPHIE
BARD, Christine (éd.). 1999. Un siècle d’antiféminisme. Paris : Fayard.
DORLIN, Elsa. 2008. Sexe, genre et sexualités. Paris : PUF.
FAYOLLE, Caroline. 2016. « La “femme monstre”. La citoyenneté à l’épreuve de la peur de la
confusion des sexes », in La citoyenneté républicaine à l’épreuve des peurs, BOGANI, Lisa, BOUCHET,
Julien, BOURDIN, Philippe, CARON, Jean-Claude (éd.). Rennes : PUR, 109-118.
DE BAECQUE, Antoine. 1993. Le Corps de l’Histoire. Métaphores et politique (1770-1800). Paris : Calmann-
Lévy.
GOFFMAN, Erving. 1975 [1963]. Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Paris : Éditions de Minuit.
HESSE, Carla. 2001. The Other Enlightenment. How French Women Became Modern. Princeton & Oxford :
Princeton University Press.
KNIBIEHLER, Yvonne. 1976. « Les médecins et la “nature féminine” au temps du code civil » Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations 31(4) : 824-845.
OFFEN, Karen. 1987. « Sur l’origine des mots féminisme et féministe » Revue d’histoire moderne et
contemporaine, 3 : 492-496.
GLAD!, 04 | 2018
173
PRECIADO, Paul. 2014. « Féminisme amnésique » Chroniques « philosophiques » de Libération, consulté
le 20 avril 2018. URL : http://www.liberation.fr/france/2014/05/09/feminisme-
amnesique_1014052
VARIKAS, Eleni. 2007. Les rebuts du monde. Figures du paria. Paris : Stock.
RÉSUMÉS
Cet article analyse la stigmatisation des pionnières de la lutte pour les droits des femmes. En se
focalisant sur la figure monstrueuse de la « femme-homme », il s’agit d’étudier l’entreprise de
pathologisation du féminisme et les stratégies de résistance mises en œuvre par les militantes. La
démarche d’historicisation de cette rhétorique anti-féministe offre aussi un éclairage sur des
enjeux politiques du féminisme actuel.
This article analyses the stigmatization of pioneers in the struggle for women’s rights. By
focusing on the monstrous figure of the « woman-man », it examines the pathologisation of
feminism and the strategies of resistance developed by activists. Historicizing this anti-feminist
rhetoric also highlights political challenges of contemporary feminism.
INDEX
Thèmes : Explorations
Mots-clés : féminisme, stigmate, hybridité (sexuelle), rhétorique, genre
Keywords : feminism, stigma, rhetoric, sexual hybridity, gender
AUTEUR
CAROLINE FAYOLLE
Caroline Fayolle est historienne, maitresse de conférences à l’Université de Montpellier (LIRDEF).
Elle est spécialisée dans l’histoire du genre, du féminisme et de l’éducation pendant la Révolution
française et le XIXe siècle. Ses recherches interrogent les enjeux politiques liés à la fabrique des
identités sexuées dans les contextes révolutionnaires et postrévolutionnaires. Elle a notamment
publié : La Femme nouvelle. Genre, éducation, révolution (1789-1830), Paris, Éditions du CTHS, 2017.
GLAD!, 04 | 2018
174
Les femmes en philo, qu’est-ce queça mange en hiver ?Women in Philosophy: How To Understand This Rare Species?
Sarah Arnaud et Cloé Gratton
Qui sommes-nous ?
1 Mon nom : Sarah. Mes 30 ans sont à la porte. Quand vous lirez ceci, ils seront déjà là. Je
suis un pur produit de l’école et de l’université. Après une licence et un master en
philosophie à Paris, je suis partie faire mon doctorat à Montréal ; je viens de le
terminer. En 2013, j’ai fait partie de l’équipe à l’origine de Fillosophie. Je commence un
post-doc à New York cet été. C’est à la fois la fin et le début d’un parcours. Un parcours
parsemé de privilèges ― ma situation sociale, mon groupe « racial », mon éducation,
mon lieu de naissance et j’en passe ; et de quelques embûches ― l’une d’elles : être une
femme en philosophie. Aujourd’hui, Cloé et moi, on vous en parle.
2 Je m'appelle Cloé. Je suis une étudiante québécoise à la maîtrise en philosophie à
Montréal. Je m'intéresse depuis peu de temps à la question de la diversité et de l’égalité
en contexte académique et social, en plus de compléter un mémoire de recherche sur
un sujet qui n'a rien à voir avec ces enjeux, soit le concept de langage privé chez le
philosophe Ludwig Wittgenstein. Au jour le jour, je nourris l’humble projet de faire de
mon entourage un espace plus juste. J’apprends à tâtons, de ma perspective de
personne blanche, quelles sont les limites de l'espace que je peux prendre dans la lutte
pour la diversité, laquelle a commencé, pour moi, quand j'ai rejoint Fillosophie à l'hiver
2015.
GLAD!, 04 | 2018
175
Défis et enjeux pour la place des femmes1 enphilosophie
3 D'entrée de jeu, on souhaite souligner que si notre perspective se situe à propos et à
partir de nos expériences d'étudiantes en philosophie, on pense pourtant qu'elle est
généralisable ― et qu'elle doit être généralisée ― à l'intérieur et à l'extérieur du monde
académique. Parce que l'université n'est pas le théâtre exclusif où se déroulent les
inégalités liées au genre, à la « race », à la classe sociale, à l'apparence, aux capacités,
etc., parce que le monde académique comporte son lot de contradictions et
d'oppressions, aux niveaux individuel et institutionnel, il est permis de considérer
l'université comme s’il s’agissait d’une microsociété qui reproduit les mêmes structures
oppressives et familières que l'on retrouve à la sortie des classes, lorsqu'on passe ses
portes.
4 Si on peut penser que la philosophie est la discipline par excellence d'où peuvent
foisonner des réflexions humanistes sur le Bien ou le Juste (on classe d'ailleurs la philo
sous l'appellation Humanities, en anglais), il est pour le moins étonnant d'observer
qu'elle reproduit, de manière particulièrement tenace et insidieuse, des structures
d'oppression responsables d'inégalités et d'injustices criantes. La philosophie, en effet,
se targue généralement d'être la discipline qui permet de comprendre les grands -ismes,
tel que le réalisme, le naturalisme, ou encore le libéralisme pour n’en citer que
quelques uns. On pourrait donc s’attendre à ce qu’elle soit la première à nous faire
comprendre les problèmes que posent le racisme, le sexisme, le capacitisme, le
classisme, le spécisme, l'âgisme, et plusieurs autres. Comment se fait-il alors que ce que
l'on entend par philosophie (littéralement, en Grec, philo – aimer, chercher ; et sophia –
connaissance, savoir, sagesse) cadre si peu avec les défis liés à la diversité des groupes
sociaux et à la justice, pourtant nombreux, qui configurent depuis toujours la
discipline ? Les Grecs du temps de Platon, champions de la vertu, faisaient de la
philosophie l'apanage exclusif des hommes blancs, dont les plus privilégiés furent par
ailleurs propriétaires d'esclaves. Comment rendre compte de ces comportements et de
ces systèmes idéologiques qui se présentent à la fois comme les derniers bastions de
l’Esprit Critique et comme des structures reproductrices d’oppression ?
5 Nous vous proposons ici un aperçu, un état des lieux, d’une partie de la réponse à cette
question : celle qui concerne la place des femmes en philosophie. Parmi les inégalités et
injustices que le monde de la philosophie renferme et reproduit, on retrouve la
discrimination envers le genre féminin. C’est sous cet angle et d’après nos expériences
personnelles que nous vous répondons aujourd’hui : la philosophie est un domaine
dominé par le genre masculin. Et c’est la philosophie elle-même qui justifie cette
domination, qui est bien ancrée dans les mentalités par un ensemble de tactiques
insidieuses, conscientes et inconscientes, constamment renforcées par le contexte
systémique oppressant qu'elle met en place et qu’elle maintient. Les femmes
philosophes ont du pain sur la planche. Encore une fois, cette situation d’oppression
n’est ni le seul lot des femmes, ni le seul lot de la philosophie. Les injustices et
oppressions liées à la « race », aux situations économiques et sociales, aux handicaps,
etc. ne sont pas ou peu abordées ici, mais doivent également être considérées, et de
manière tout aussi urgente, dans la réflexion sur la diversité et l'égalité.
GLAD!, 04 | 2018
176
Un domaine masculin…
6 Admettons que vous soyez une femme et que votre situation socio-économique et
personnelle soit ainsi faite que vous ayez la possibilité de vous inscrire à l’université.
Admettons donc que vous n’ayez pas seule la charge d’un ou plusieurs enfants, que
vous ne soyez pas en obligation de cesser vos études, que vous n’ayez pas à travailler à
temps plein. Vous avez la liberté de vous inscrire dans le programme d’études de votre
choix. Pourquoi ne choisiriez-vous pas la philosophie ? D’abord, parce qu’une telle
discipline ne semble pas particulièrement adressée aux femmes.
7 Quel que soit votre niveau en philosophie, votre expérience de philosophe ou de
néophyte, que vous soyez docteur-e, prof-e, étudiant-e, ou que vous n’ayez jamais mis
les pieds dans un cours, vous connaissez les noms de Platon et Kant et vous avez
surement une idée de qui est BHL ou Onfray si vous vivez en France ou au Québec. Plus
difficile, par contre, de trouver les noms de plus d’une ou deux femmes philosophes
sans réfléchir un peu plus longuement ou aller voir sur internet. Oui, vous avez dû
entendre parler une ou deux fois de la copine de Sartre ou de l'amoureuse de Martin
Heidegger... Pensez aussi au stéréotype du philosophe : n’est-ce pas cet homme, blanc
et barbu (voire même mort) ? Ici encore la philosophe n’est pas celle qui vous vient à
l’esprit tout de suite. La philosophie donc, semble être faite par des hommes. Pour des
hommes. Deux de nos collègues étudiant-e-s ont fait quelques statistiques sur les plans
de cours de philosophie de l’Université du Québec à Montréal. En moyenne, 83 % des
textes étudiés dans les cours sont écrits par des hommes, seulement 17 % par des
femmes. Peut-être est-ce tout simplement parce qu’il y a moins de femmes qui
s’intéressent à la philosophie ? Vous allez voir que, justement, ce n’est pas si simple.
Certes, il y a moins de femmes philosophes que d’hommes philosophes. Mais s’arrêter à
ce constat serait une explication bien insuffisante de la situation. Regardons cela de
plus près.
8 La philosophie est une discipline qui fait intervenir l’argumentation, la pensée critique,
la logique et la rigueur. Rendez vous à une conférence de philosophie, n’importe
laquelle (ou presque) et vous aurez des chances d’y voir des gens se couper la parole
pendant la période de questions et gagner le tour s’ils parlent assez fort. Vous aurez
peut-être même droit à quelques joutes verbales et attaques en règle de la
conférencière ou du conférencier. Finalement, vous assistez davantage à un combat
argumentatif (on est généreuses, parfois l'argument est supplanté par un monologue
sans lien apparent à la conférence) qu’à de sincères questionnements sur le contenu de
la présentation. Loin de l'idéal socratique où l'on prônait une attitude humble, toute
entière tournée vers le savoir et la découverte de la vérité, vous observez plutôt ici la
forme creuse d'une querelle qui n'a de visée autre que celle de produire un vainqueur :
c'est le meilleur philosophe. Qu'à cela ne tienne, nous vivons dans une société où les
caractéristiques suivantes sont bien souvent associées aux traits de caractère
masculins : l'autorité, la course à la victoire, la domination. Le meilleur philosophe est
quelqu'un qui coïncide parfaitement avec son milieu : il s'y sent toujours chez lui. En
effet, la société valorise l’action et la prise de pouvoir pour les hommes et non pas pour
les femmes, que l’on attend plutôt calmes, douces et avenantes. Autant vous dire que le
peu d’entre elles qui osent prendre la parole dans ce genre de contexte ont intérêt à
être d’excellentes receveuses de jugements sur leur personnalité. Voilà un tableau qui
GLAD!, 04 | 2018
177
peut constituer un début d’explication pour comprendre pourquoi plusieurs femmes ne
se lancent tout simplement pas en philosophie.
9 Malgré cela, vous nous trouvez spéculatives ? Très bien, restons rigoureuses. Après
tout, nous sommes passées maîtresses dans l’art de justifier scientifiquement les
situations problématiques qui configurent notre quotidien, alors autant en profiter.
Avant de reprendre notre exutoire de « bourgeoises frustrées » (on n’invente pas le
terme, il vient d’un prof de chez nous) voici donc quelques chiffres qui font état de la
sous-représentation des femmes en philosophie :
35 % = Proportion d’étudiantes femmes, par rapport aux étudiants hommes, au
département de philosophie de l’Université du Québec à Montréal. À l'UQAM, pour
l’année 2017-2018, on ne compte que 34 étudiantes pour 105 étudiants au niveau
du baccalauréat en philosophie2, 14 étudiantes pour 39 étudiants au niveau de la
maîtrise, et 9 étudiantes pour 17 étudiants au niveau doctoral [Figure 1]3.
26 % = Proportion des femmes professeures et chercheures employées dans un
département de philosophie dans les universités du Québec pour l’année
2017-2018, par rapport aux hommes [Figure 2].
20 à 30 % = Proportion de femmes composant le corps professoral des
départements de philosophie dans le monde ; que ce soit au Royaume-Uni (18 % en
2009), en Australie (23 % en 2006), aux États-Unis (22 % en 2009) ou au Canada
(31 % en 2011) (Di Croce 2015).
15,5 % = Proportion de professeures et chercheures qui sont des femmes au
département de philosophie de l’UQAM, par rapport aux hommes. Le département
est composé de 13 hommes et 2 femmes.
20,7 % = Proportion de femmes employées dans le domaine de la philosophie aux
États-Unis, par rapport aux hommes. Parmi les philosophes employé-e-s à temps
plein aux États-Unis en 2003, les femmes constituaient 16,6 % des 13 000
professeurs d’université (2,158 / 13 000) et 26 % des 10 000 enseignants à temps
partiel (2,600 / 10 000). En d’autres mots, il y a 4,758 femmes sur 23 000 hommes
philosophes employé-e-s aux États-Unis en 2003 (Norlock 2011).
23,14 % = Proportion de femmes ayant obtenu des postes d’enseignement aux
cycles supérieurs en philosophie entre 2002 et 2015, aux États-Unis (données
recueillies dans 98 universités, Van Camp [2015]).
31,4 % = Proportion de femmes ayant obtenu un doctorat en philosophie dans des
universités américaines en 2011, par rapport aux hommes (Haslanger 2013, voir
également Healy 2011). [Figure 3].
17 % = Proportion approximative d’auteures femmes étudiées dans les cours de
philosophie du département de l’Université du Québec à Montréal en 2017-2018
[Figure 4]4.
GLAD!, 04 | 2018
178
Figure 1 : Représentation du nombre de femmes étudiantes en philosophie
Figure 2 : Professeures de philosophie au Québec
GLAD!, 04 | 2018
179
Figure 3 : Doctorats obtenus par les femmes
Figure 4 : Femmes dans les plans de cours à l’UQAM
10 Reprenons notre petite expérience de pensée. On peut dire qu’au vu de ces chiffres, il
semble difficile de vouloir s’inscrire dans un programme de philosophie. Mais peut-être
êtes-vous prête à relever le défi. Ou bien tout simplement, comme nous l’étions nous-
GLAD!, 04 | 2018
180
mêmes en choisissant ce domaine d’études, vous êtes totalement inconsciente de cette
situation problématique et foncez à toute allure, candide dans le meilleur des mondes.
Alors, dans ce cas, pourquoi pas la philo ?
11 Si vous souhaitez entreprendre des études à temps plein, dans n’importe quel domaine,
vous êtes probablement encline à envisager que certains obstacles ordinaires se
mettront parfois en travers de votre route, et que votre aventure ne sera pas qu’une
partie de plaisir. Ainsi va la vie. Parmi les obstacles qui n’ont pas de quoi surprendre,
on peut penser à des moments de fatigue, de maladie, à une peine d’amour, un
déménagement, un licenciement, par exemple. Qui plus est, si vous faites partie d’un
groupe qui n’est pas celui de l’homme blanc bien nanti, vous serez non seulement
confronté-e-s aux aléas ordinaires de la vie, mais aussi à des obstacles qui sont conçus
sur mesure pour vous. On souhaite à présent vous brosser ce tableau, en ce qui
concerne les femmes en philo, comme on aurait peut-être aimé que quelqu’un le fasse
pour nous. Soyons claires. Notre objectif n'est pas de vous décourager d'entreprendre
ces études, mais plutôt de vous partager notre expérience afin de faire voir ce qui peut
être fait d'emblée, sans trop de mal, pour se munir des outils permettant de passer à
travers cette épreuve.
12 Avant de nous lancer dans cette étude, notons d'emblée qu’il n’est pas nécessaire
d’imaginer que tous ces obstacles devraient être rencontrés en même temps et tous
ensemble pour avoir raison de l’étudiante la plus résiliente. Parfois, un seul d’entre eux
suffit à décourager définitivement une personne de poursuivre ses études, et avec
raison. Réciproquement, il est permis de penser que tous ces obstacles réunis devront
être surmontés pour qu’une personne marginalisée puisse seulement oser penser à
poursuivre ses études dans un tel milieu. Il va sans dire que ces obstacles affectent de
manière différenciée les personnes issues de différents groupes sociaux.
Quels modèles pour les femmes en philo ?
13 Reprenons à présent la question qui nous intéressait et voyons comment y répondre à
la lumière des obstacles que nous mettrons en relief. Pourquoi pas la philo ? Voici une
première réponse : parce qu’il est permis de croire que se lancer dans une carrière, ou
même tout simplement considérer un domaine d’intérêt, demande d’avoir quelques
exemples autour de soi. Et les chiffres parlent : peu de femmes philosophes, comme on
l’indiquait quelques lignes plus haut.
14 La décision est prise, vous allez vous inscrire en philosophie, contre vents et marées.
Vous allez devenir l’exception à la règle, le modèle que vous n’avez pas eu ! Mais qu’en
pensent vos proches ? Il est bien possible qu’on vous demande ce que vous allez faire
avec ça, comment vous allez gagner votre vie, ou si vous connaissez qui que ce soit
ayant réussi là-dedans, et ce que ça vient faire là cette drôle d’idée de faire de la
philosophie. Votre entourage est-il en mesure de vous soutenir moralement dans vos
choix ? Vous demande-t-il à chaque réunion de famille ce qu’est un [sic] philosophe ? Ce
que ça mange en hiver ? Ce que ça gagne, un philosophe ? Est-ce qu’on vous considère
comme une espèce de créature arrogante œuvrant dans un domaine qui n’aura jamais
d’application pratique, à vaincre des moulins à vent telle une Don Quichotte dont le
courage n'a d’égal que sa désillusion ? ! Si vous avez la chance d’avoir un entourage
favorable et motivant à vos côtés, vous pouvez passer à l’obstacle suivant. Vous
réussissez cette étape et vous notez au passage que vous appartenez à une espèce rare !
GLAD!, 04 | 2018
181
Là encore on a déjà de fortes chances d’avoir un plus haut pourcentage d’hommes que
de femmes qui n’ont pas à faire face à cet obstacle, puisque la philosophie, si elle n’est
pas faite pour grand monde, n’est certainement pas faite pour les femmes, de toute
façon. Pour celles qui constituent ce petit pourcentage, ou celles qui arrivent à
surmonter cette étape, la course d'obstacles ne fait que commencer.
15 Le prochain obstacle potentiel concerne spécifiquement votre futur domaine : la
philosophie. Êtes-vous considérée comme ayant des aptitudes pour la philosophie ?
Savez-vous même ce que cela signifie ? Êtes-vous prête à défendre toutes vos opinions
philosophiques comme si votre vie en dépendait, devant des détracteurs avides de
décider que vous êtes ou non « douée pour une femme » ? Êtes-vous prête à vous tailler
une place dans un monde où « faire ses preuves » consiste à jouer un jeu décidé par des
hommes blancs confortables et confiants ? Si oui, votre place est en philosophie. Sinon,
vous pouvez encore changer d’idée. Rappelez-vous, à ce stade, vous vous préparez
simplement à vous inscrire !
Vos nouveaux rôles
Le rôle d’experte
16 Admettons que vous envisagiez tous ces obstacles avec une mentalité de guerrière
solitaire plutôt sereine. Vous vous rassurez dans vos appréhensions par l’idée que ces
obstacles envisageables sont jusqu'ici des faits abstraits et sans visage, inoffensifs : vous
n'avez pas de bâtons dans les roues. Après tout, peut-être aurez-vous de la chance.
Peut-être que tout ira bien, que ce sera facile. Vous arrivez dans ce monde qui ne vous
est pas ouvert (mais pas fermé non plus !). Il est temps de s’y mettre. Vos cours sont
principalement donnés par des hommes qui vous font lire des hommes, vos collègues
sont des hommes, on lit tous ensemble des textes écrits par des hommes, qui parlent du
Bon, du Bien, de la Justice et de la Vérité, on parle aussi des hommes, avec un petit ‘h’,
pour parler des humains et de l’Homme avec un grand H, pour parler de l’Humain. Au
départ, rien de tout cela ne vous apparait étrange. Peu s’en faut pour que vous vous
imaginiez appartenir à une frange particulièrement résiliente de l’humanité, ou encore
que vous pensiez être une femme particulièrement chanceuse d’avoir fait son entrée
dans le boys club si convoité. Presque tout le monde est blanc, érudit, content.
17 Vous participez à cette fête jusqu’à ce que vous remarquiez le climat qui s'immisce de
sous les pupitres, par la porte, le plafond, le plancher, ce climat qui vous fait battre en
retraite, battre le cœur. Très vite, vous prenez son pouls (au climat, pas à votre cœur –
déjà, vous n’écoutez plus beaucoup votre cœur, vous êtes sur un mode défensif, vous ne
doutez de rien, sauf de vous) : on ne veut pas de vous pour les travaux d’équipe,
certain-e-s prof-e-s ne vous donnent jamais la parole, on vous décrit comme étant
« charmante » ou « sympathique », mais jamais comme étant « brillante » ou « douée ».
On s’intéresse à vous parfois, mais pas souvent pour vos idées. On vient vers vous pour
vous expliquer des choses, ça oui ! On vous propose des emplois administratifs
d’arrière-plan, car les femmes sont naturellement de bonnes secrétaires. Vous vous
isolez de plus en plus et croyez de moins en moins à votre pertinence. Vous êtes une
imposteure, honteuse devant votre imposture. Si vous pensez avoir quelque chose à
dire, ou des questions à poser, vous risquez de questionner votre légitimité un bon
nombre de fois avant de tout simplement oser le faire. Vous vous mettrez dans un état
GLAD!, 04 | 2018
182
pas possible, vous serez prise de vertige, avant de renoncer à votre question, alors
même que vos collègues hommes eux, n’hésitent pas.
18 Mille fois vous revivrez cette situation, en vrai et en imagination. Vos collègues doivent
être meilleurs que vous s’ils y arrivent si bien. Ils vous reprocheront souvent votre
sensibilité et votre susceptibilité. C’est surement vous le problème. Et quand vous osez
timidement lever la main, le prof ne vous voit pas. Vous la levez plus haut, mais
malheureusement, avant qu’on puisse vous donner le droit de parler, votre collègue de
droite l’a déjà pris tout seul. Et sa voix couvre le petit bruit qui commençait à sortir de
votre bouche. Raté, ce sera pour la prochaine fois. Cette prochaine fois se présente, car
vous ne jetez pas l’éponge, vous sentez votre cœur battre la chamade, levez la main
bien haut, la parole est à vous et votre collègue bruyant n’est pas là. Vous proposez une
explication au concept étudié. On donne la parole ensuite à votre collègue de gauche
qui répète vraisemblablement la même chose. Selon le prof, c’est une très bonne
intervention qu’il a faite là. Remarquable (littéralement) ! Ce genre de choses arrive
fréquemment. Et le prof n’est pas un macho, n’a pas de problème avec les femmes, n’a
jamais eu de comportement sexiste, vous dit-on. Non, non. Et vous vous dites que votre
collègue a surement mieux expliqué la situation que vous, qu’il a été plus clair.
19 Vous vous demandez ce qui est le pire entre : (1) le fait que votre collègue vous prête si
peu d’attention, qu’il répète tout bonnement votre propos sans s’en rendre compte ; (2)
le fait que votre collègue reprenne l’idée qui est la vôtre avec un ton fier et assuré pour
se faire du capital politico-académique sur votre dos ; (3) le fait que de toute évidence,
votre prof-e n’envisage ni l’un ni l’autre de ces scénarios. Vous venez de perdre 6
minutes de cours à nourrir ce débat avec vous-même. Vous commencez à songer au fait
troublant que peut-être, vous êtes la meilleure personne dans la salle avec qui avoir un
débat honnête. Ici, le prof, le collègue et vous-même, agissez à travers un certain
nombre de biais, tout à fait fréquents et inconscients, dont on vous parle dans un
instant. En attendant, toute cette situation s’inscrit dans un cadre biaisé duquel vous
êtes maintenant partie et actrice. Si vous voulez réussir, il va falloir redoubler d’effort.
Pas seulement parler plus fort, mais moins hésiter à le faire. Pas seulement travailler
dur, mais travailler très dur ; pour que votre travail ne soit pas noyé dans la masse,
mais ressorte du lot.
20 Imaginez que vous travaillez, vous travaillez dur. Vous y arrivez, même. Vous êtes
excellente et on commence à constater votre existence. Pourtant, on ne vous entend
toujours pas beaucoup. La reconnaissance n’est pas tout à fait à la porte. Vous devez
prendre conscience de ce qui se passe. Et pas seulement le garder pour vous, mais le
crier haut et fort. Vous allez vite devoir endosser un deuxième rôle important si vous
voulez rester dans ce milieu : celui de sensibilisatrice.
Le rôle de sensibilisatrice
21 Le fait que cette communauté ne soit pas un lieu très accueillant pour les femmes (on
apprend vite à parler par euphémismes), est un problème peu constaté et peu reconnu.
Pourtant, il fait des ravages. Ceux qui vous expliquent que personne n’empêche les
femmes de s’inscrire vous diront aussi que personne ne les empêche de continuer, ni ne
les force à abandonner, ni même ne leur met de bâtons dans les roues. Si vous ne vous
sentez pas à l’aise, vous allez mettre ça avant tout sur le compte du domaine : et si ce
n’était pas votre truc, la philosophie, finalement ? Les femmes elles-mêmes qui sont en
philosophie ne se rendent pas nécessairement compte du problème, ni des efforts
GLAD!, 04 | 2018
183
supplémentaires qu’elles doivent fournir par rapport à leurs collègues masculins. On a
vu les chiffres : beaucoup de femmes arrêtent en cours de route. Parce qu’évidemment,
si un domaine vous est hostile, vous aurez tendance à penser que c’est le domaine qui
n'est pas pour vous. Pourtant en philosophie, c’est d’abord vous qui ne convenez pas au
domaine. Ce domaine ne veut pas de vous même si vous avez toutes les compétences
nécessaires. Pour continuer, il va falloir en prendre conscience.
22 Si vous vous rendez compte du climat discriminatoire qui règne autour de vous, que
vous osez essayer d’en parler, on vous demandera immédiatement justification. Vous
allez alors vous heurter aux sensibilités de personnes qui confondent les problèmes
personnels et systémiques et qui vont vous dire que, non, elles n’ont aucun problème
avec les femmes. Vous expliquez, vous faites référence aux biais, aux injustices qui
proviennent d’un système et non pas des individus, vous êtes patiente et rigoureuse :
vous allez chercher des chiffres, des études, des explications théoriques, voire
scientifiques. Et sans même vous en rendre compte, vous devenez une sensibilisatrice
hors pair, une connaisseuse de certains enjeux, une personne-ressource pour vos
collègues femmes qui n’ont pas d’autre modèle que vous, une capricieuse selon votre
département et vos autres collègues, une féministe qui doit se justifier de l’être. Vous
allez peut-être devenir militante ! Et plutôt que de penser que c’est parce qu’il y a des
problèmes à régler, on va penser que c’est parce que vous aimez ça ― les conflits ― ou
que vous avez quelques frustrations à régler. Qui n’aimerait pas en effet consacrer le
plus clair de son temps à une besogne qui n’a rien à voir avec ses études, qui donne
froid dans le dos et une boule dans la gorge, et qui consiste à aller contre le vent sur son
lieu d’étude et de travail, au milieu de collègues et employeurs qui, pour la plupart, se
porteraient mieux sans vos revendications ?
23 Vous souhaitez malgré tout cela continuer en philosophie. Vous vous demandez si vos
revendications sont entendues ou si elles contribuent à une montée de la tension que
vous devez affronter chaque jour. Vous cherchez à savoir si vous recevez plus de haine
que de soutien dans vos démarches. Êtes-vous fatiguée du fait que cette lutte vous
définisse et qu’on ne s’imagine même plus que vous êtes à l’université parce que vous
aimez la philo ? Pensez-vous toujours que le jeu en vaut la chandelle (que vous brûlez
par les deux bouts) ? Est-ce que vous allez bien ?...
Les conséquences de votre double mandat
24 Bravo ! Les deux conditions sont réunies pour que votre place soit faite en philosophie :
vous êtes bonne en philosophie et vous êtes consciente des difficultés inhérentes au fait
d’être une femme dans ce milieu. Vous êtes même active dans la communauté
philosophique dans l’espoir de faire bouger les choses. Tout cela au détriment de votre
temps libre, de votre repos et de votre domaine d’étude. Avez-vous encore du temps
pour vos études en philosophie ? Si par miracle vous répondez « oui », c’est que vous
avez fait le pari d’être une femme en philosophie ! Attendez-vous à ce que personne ne
remarque qu’il s’agit d’un exploit, et poursuivez votre route sans trop vous retourner :
vous aurez besoin de beaucoup de vent dans vos voiles pour perdurer jusqu’à
l’obtention de votre diplôme.
25 Chaque investissement dans l'un de ces deux rôles ― celui d’experte et celui de
sensibilisatrice ― se fait au détriment de l’autre. Votre temps de travail est amputé par
celui que vous passez à sensibiliser votre entourage. Et si vous travaillez sur vos cours
GLAD!, 04 | 2018
184
ou vos recherches, comment allez-vous agir utilement dans votre communauté ? Le
rôle de sensibilisatrice vous mène à rencontrer des femmes qui éprouvent des
difficultés et sont sujettes à de la discrimination. Ce rôle de conseillère, d’aidante,
implique des prises de décisions, des plans d’aide, de nouvelles initiatives (discuter au
sein du département, se renseigner sur les démarches à mettre en place, apprendre à
écouter et à réagir face à des situations parfois graves). Tout ça demande du temps, de
l’énergie et une sacrée force morale.
26 Votre spécialisation en prend un coup : vous commenciez à vous spécialiser en
philosophie médiévale ? en sciences cognitives ? en logique ? vous développiez une
expertise obscure mais passionnante sur Wittgenstein ? C’est bien beau tout ça. Mais
votre travail de sensibilisatrice vous demande des recherches dans un autre domaine :
celui de la philosophie féministe, ou plus largement de la philosophie politique. Vous
cherchez des justifications pour qu’on vous prenne au sérieux et vous vous mettez à
travailler sur les concepts de « discrimination », d’« injustice systémique et
épistémique ». Par défaut, vous vous spécialisez dans un domaine parallèle. Bientôt,
vous ne travaillez plus sur votre mémoire, sur votre thèse, qu'à vos heures perdues.
C’est l’étiquette qu’on va vous faire endosser rapidement. Il y a bien d’autres personnes
à aller chercher pour les sciences cognitives. On s’intéressera éventuellement à vous
pour vos connaissances en philosophie féministe. Un beau résultat que celui-là : le
féminisme est étudié par les femmes, la « vraie » philosophie peut continuer d’être le
travail des « vrais » philosophes : les hommes. Et puis la philosophie féministe est un
domaine de recherche qui demande un plein investissement, comme tous les domaines
de la philosophie. Être militante ne vous a pas rendue suffisamment à la pointe des
recherches pour pouvoir en faire votre domaine d’expertise. Il va falloir laisser tomber
un peu le militantisme si vous voulez faire vos preuves en philo, rédiger votre mémoire,
votre thèse, devenir professeure, ou publier votre prochain article.
27 Finalement, c’est tout un tas d’obstacles que vous allez devoir franchir pour être une
femme en philosophie. Le schéma ci-dessous [Figure 5] propose une représentation des
obstacles qui doivent être franchis pour accéder aux études en philosophie (Arnaud et
Medeiros Ramos, 2015). La plupart de ces obstacles, à la lumière de ce que nous venons
d’expliquer, sont plus difficiles à franchir pour les femmes. Nous pensons par ailleurs
que ce parcours d’obstacles peut s’appliquer à d’autres disciplines et à d’autres groupes
et contextes sociaux et professionnels en dehors du milieu académique.
GLAD!, 04 | 2018
185
Figure 5 : Les obstacles rencontrés par les femmes en philosophie
Les biais implicites comme facteur pouvant expliqueren partie la sous-représentation féminine enphilosophie
28 Les tentatives pour expliquer les raisons qui font que le domaine de la philosophie est
réservé aux hommes ne manquent pas dans le paysage académique. À qui, à quoi la
faute ? On place parfois la faute sur les femmes elles-mêmes, qui ne seraient pas douées
pour la philosophie, les mathématiques ou les sciences en général. C’est d’ailleurs ce
qu’expliquent certains philosophes masculins, jeunes et moins jeunes, au nombre
desquels on retrouve sans surprise les Nietzsche, Hegel, Stuart Mill et bien d’autres.
Selon l’école philosophique à laquelle on appartient, on peut soutenir que les femmes
qui aspirent à des études en philo sont découragées par le style combatif des débats qui
fait le propre de la discipline (Martin Alcoff 2013), ou encore par l’image stéréotypique
du philosophe à laquelle elles ne correspondront jamais (Langton 2013). Quant à nous,
nous ne pensons pas que le « style masculin » de la discipline ne convienne pas à une
femme, que les débats de la philosophie soient trop musclés pour elle, ou que cette
discipline ne convienne pas à son tempérament (peu importe ce que cela pourrait
vouloir dire). Nous refusons d'envisager l'hypothèse d'une incompétence innée, mais
nous pensons que d'autres hypothèses méritent qu'on s'y attarde.
Que sont les biais implicites ?
29 Au contraire, nous pensons que ce sont des facteurs comme la « menace de
stéréotypes », qui sont à l’œuvre. La « menace de stéréotypes » survient lorsque la
GLAD!, 04 | 2018
186
communauté a des biais implicites négatifs à l’endroit d’un groupe spécifique. Qu’est-ce
qu’une menace de stéréotype ? Qu’est-ce qu’un biais implicite ? Voici un bref survol de
ces notions et d’autres notions liées, que nous empruntons à un article de la philosophe
Jennifer Saul (2013) intitulé Implicit Bias, Stereotype Threat and Women in Philosophy5 :
30 Biais explicite : Il s'agit d'une croyance que l’on abrite consciemment. Exemple : la
croyance que les femmes ne sont pas douées pour la philo (cette croyance est très
répandue. Si vous êtes sceptiques, on vous suggère de consulter le blog Being a Woman
in Philosophy ― attention, il faut avoir les nerfs solides).
31 Biais implicites : Ce sont des biais inconscients qui affectent la manière dont nous
percevons ou évaluons les gens qui sont issus des groupes visés par nos biais. Il peut
aussi s’agir d’amalgames ou d’associations inconscientes (les biais implicites n’ont
d’ailleurs pas forcément toujours d’effet négatif).
32 Exemple de biais qui ont des effets négatifs : un biais inconscient qui nous conduit à
évaluer plus négativement que ce qu’il mérite le travail effectué par une femme.
33 Des recherches en psychologie ont révélé au cours des 10 dernières années que la
plupart des gens, même ceux et celles qui ont des opinions égalitaires sincères, abritent
des stéréotypes implicites contre des groupes comme les Noirs, les femmes, les
personnes homosexuelles, trans, et encore d’autres (Saul 2013, p. 40). Ceci est
également vrai des personnes qui font partie du groupe en question. Par exemple, des
tests ont montré que les femmes et les hommes ont des biais implicites négatifs à
l’endroit des femmes (pour faire soi-même ce genre de test gratuitement, c’est par ici.)
34 Au cas où vous ne seriez pas convaincu-e-s par l’existence des biais implicites, voici
quelques faits en vrac (Saul, 2013)…
35 Pour la tâche qui consiste à associer des adjectifs positifs ou négatifs à des visages
blancs ou noirs, la plupart des gens sont plus rapides quand vient le temps d’associer
des adjectifs négatifs aux visages noirs.
36 Les publications scientifiques fonctionnent généralement sous la méthode du peer-
review anonyme. Quand le journal Behavioural Ecology a décidé de passer au peer-review
anonyme, le pourcentage d’auteures féminines acceptées a grimpé subitement de 33 %.
37 Dans le cas des CVs, plusieurs études révèlent qu’en France, pour le même CV, on juge
que celui qui porte le nom d’un homme est classé comme étant plus pertinent pour
l’embauche, son titulaire comme méritant un meilleur salaire, et comme proposant une
candidature plus intéressante. D’autres études sont convergentes en ce qui concerne la
« race », où les personnes dont les noms sont à consonance occidentale ont plus de
rappels que les personnes qui indiquent un nom ne répondant pas à ces « critères » sur
leur CV.
38 Menace de stéréotype : Il s'agit d'une menace vécue consciemment ou inconsciemment
qui concerne le fait qu’une personne est au courant de la manière dont est perçue son
appartenance à tel groupe, et qui affecte négativement sa performance. Les personnes
sont affectées par la menace de stéréotype en vertu du fait qu’elles sont consciemment
ou inconsciemment préoccupées par la peur de confirmer les stéréotypes qui
« circulent » à l’égard de leur groupe.
39 Exemple : Le fait pour une femme de savoir que des stéréotypes à propos de son groupe
sont entretenus par des professeur-e-s et des étudiant-e-s conduit au fait que la femme
performera moins bien. Cela peut être décrit par le cercle vicieux suivant : (1) On
GLAD!, 04 | 2018
187
entretient à tort des stéréotypes voulant que les femmes soient moins douées que les
hommes pour la philosophie ; (2) Les femmes sont au courant que ces stéréotypes sont
présents dans leur domaine d’études ; (3) Les femmes sous-performent par rapport à
leurs collègues masculins ; (4) Cette sous-performance sert de base à l'adoption d'un
biais explicite voulant que les femmes soient moins douées que les hommes dans ce
domaine.
40 C’est là qu’on dit « halte ! ». Si (3) n’est pas un fait naturel et inaltérable, il est permis de
penser que des modifications concrètes sur (1), (2) et (3) permettront une sortie du
cercle vicieux. Pour le dire simplement, briser les stéréotypes pourra atténuer la
menace de stéréotype, ce qui aura pour effet d’augmenter la performance des femmes
en philo, de sorte que les raisons qu’on avait de discriminer les femmes sur la base du
fait qu’elles seraient moins douées seront réfutées par les faits. Notons que les
personnes racisées font également face à la menace de stéréotype. Une femme racisée
noire, par exemple, vivra une double menace ; elle sera étiquetée comme étant moins
douée en vertu de son genre, et également en vertu de son groupe racial.
41 La menace de stéréotypes peut avoir des effets très néfastes. En voici quelques
exemples (Saul 2013 : 42) :
42 En situation dite « menaçante », c’est-à-dire dans la situation où un stéréotype est
entretenu (consciemment ou non) par des personnes à propos d'autres personnes
appartenant à un groupe spécifique, lesquelles sont conscientes de l'existence de ces
stéréotypes dans la situation donnée :
les personnes noires performent moins bien que les personnes blanches à leurs examens sur
table.
les femmes performent moins bien que les hommes en mathématiques.
les personnes blanches performent moins bien que les personnes noires dans les sports.
43 Pourtant, quand l’aspect menaçant de la situation est neutralisé, la performance des
groupes visés s’améliore drastiquement, au point d’atteindre l’égalité. Les contextes des
situations « menaçantes » et des situations où la menace est neutralisée sont
évidemment à étudier et à méditer. Des études montrent que parfois, le simple fait de
stimuler visuellement les membres d’un groupe particulier en lui montrant des
graphiques qui lui rappellent sa sous-représentation dans tel domaine suffit à créer une
situation menaçante qui fera baisser la performance des personnes. L’exemple
paradigmatique des fillettes qui sous-performent en mathématiques est très parlant : il
a été montré que si l’on demande à des fillettes de colorier des dessins montrant des
poupées, juste avant un test de mathématiques, elles seront systématiquement moins
performantes que des fillettes à qui l’on n’aurait pas demandé de colorier ces images au
préalable (Steele, citée dans Saul 2013 : 42). Dans la plupart des cas, néanmoins, la seule
habitude de vivre dans une société qui comporte certaines inégalités ou dont les
politiques sont tendanciellement inégalitaires (parce qu'elles favorisent toujours les
mêmes groupes, par exemple, sans être ouvertement sexistes ni racistes) suffit à créer
une situation menaçante. À la lumière de cela, il est primordial d’envisager des
situations où la menace est neutralisée. Cela n’est pas une tâche facile, mais c’est une
tâche qu’il est réellement possible d’accomplir.
•
•
•
GLAD!, 04 | 2018
188
La manifestation des biais implicites en philosophie
44 Les étudiantes femmes seront probablement en minorité dans leur département de
philo, et certainement dans des classes où les stéréotypes font que les sujets
philosophiques sont typiquement associés aux hommes. Au vu de ces données, vous
pouvez être certaine qu’à mesure que vous gravissez les échelons dans vos études, vous
serez de moins en moins représentée. Vous serez en minorité dans toutes ces classes
sauf peut-être celles sur le féminisme (!).
45 Voyons quelques exemples de la manière dont les biais implicites peuvent avoir des
effets dramatiques sur le parcours des femmes (et de toute personne marginalisée) en
philosophie, en créant des situations où la menace de stéréotype est présente :
Dans tous ses cours, l’étudiante se retrouve confrontée à un syllabus constitué presque
exclusivement d’ouvrages écrits par des hommes (à l’exception classique de Simone de
Beauvoir ou Hannah Arendt, qui font monter la moyenne de 0 à 2 % d’auteures féminines si
jamais vous faites de la philo sociale ou politique !).
Il est permis de penser qu’à la lecture de copies similaires, les professeur-e-s auront
tendance à évaluer plus négativement celles écrites par des femmes.
Au niveau des cycles supérieurs, les superviseur-e-s auront tendance à encourager les
hommes à publier davantage ou à faire plus de communications.
Les lettres de références seront parfois plus faibles pour les femmes que pour les hommes.
De grandes maladresses issues de biais implicites sont parfois décelées dans les lettres faites
pour les femmes.
Si les femmes veulent publier dans une revue scientifique qui n’a pas de processus de
révision anonyme, et si elles veulent postuler pour un emploi et que leur candidature n’est
pas initialement anonymisée, elles ont beaucoup moins de chance que les hommes. À voir les
ratios d’embauches dont on parlait plus tôt…
Si par chance (ou par erreur !) une femme était embauchée dans un département de
philosophie, elle continuerait de faire les frais des biais implicites, mais avec de nouveaux
défis en prime : consultation avec des étudiants qui dévaluent son autorité ou sa compétence
et qui s’attendent à ce qu’elle soit compréhensive. Si elle est autoritaire et juste, on dira
d’elle qu’elle exagère et pas qu’elle commande le respect. On considère que si elles font
preuve du même leadership que leurs collègues masculins, les femmes sont perçues comme
étant bossy, bitch ou dominatrices, alors que ces traits sont spécifiquement valorisés chez les
hommes. On retrouve d’ailleurs cela dans de très nombreux domaines académiques et
professionnels.
46 Vous aurez donc des difficultés à atteindre un niveau de performance similaire à celui
de vos collègues masculins dans un univers ponctué de biais implicites et y mettrez plus
d’efforts que ces derniers. Il est difficile pour les hommes de voir que la sous-
représentation des femmes n’est pas due à l’incompétence qu’on leur attribue
inconsciemment. La sous-représentation est renforcée par les biais implicites et la
menace de stéréotypes. Ces problèmes, à l'origine d'un cercle vicieux, doivent être
regardés en face par les philosophes. Ils appellent une action concrète, sur la base de
préoccupations sincères pour 1) l’équité ou 2) la pratique philosophique et son
potentiel d’enrichissement en tant que tels. Si les biais ont les effets que nous leur
attribuons dans le domaine de la philosophie, alors le travail des femmes est jugé
injustement, ce qui conduit au fait que des philosophes femmes talentueuses, dont vous
faites peut-être partie, ne sont pas encouragées à continuer, ne reçoivent pas de
•
•
•
•
•
•
GLAD!, 04 | 2018
189
bourses, n’ont pas d’emplois, ne sont pas lues, etc. Qui plus est, vous ne disposez pas des
outils, ni du contexte, pour réaliser de la philo aussi « reconnue » que si on vous mettait
le vent dans les voiles comme on le fait pour les hommes. Comme le souligne Jennifer
Saul :
Un bon moyen d’en finir avec les stéréotypes est de s’assurer que les gens sontexposés à d’excellentes chercheuses en philosophie. Il y a plusieurs façons de s’yprendre : s’assurer d’inviter des conférencières aux conférences départementales ;inclure les femmes aux ouvrages choisis en classe ; afficher des images de femmesphilosophes sur le site web du département et sur les murs. Ces formes d’actionsaideront à briser les stéréotypes en plus de contrecarrer les effets de cesstéréotypes sur le coup. Premièrement, ces actions aideront à s’assurer que letravail des femmes n’est pas ignoré, comme c’est généralement le cas en raison desbiais implicites. Deuxièmement, ces actions contribueront à créer des situations oùla menace de stéréotype est moins forte (Saul, 2013, notre traduction).
Les pistes de solutions
47 On vous noircit le tableau, pensez-vous ? C’est vrai qu’on décrit le négatif, on insiste sur
ce qui pose problème, on met en évidence des détails difficiles, on vous présente les
obstacles. Mais c’est une première étape pour que ça bouge. Au début de la création de
Fillosophie, le département de philosophie de notre université a été… chamboulé,
dirons-nous. Évidemment : on était en train de secouer un système bien en place dans
ses inégalités, presque légitime dans ses discours discriminants, on remettait en
question une situation ancrée dans les cultures et les mentalités, on contredisait le
bien-fondé de la petite maison tranquille des philosophes : ces gens qui réfléchissent
aux vraies choses et qui n’ont certainement pas besoin qu’un groupe de « petites
bourgeoises capricieuses » viennent leur apprendre la vie.
En parler
48 La première solution, c’est d’en parler. Plusieurs d’entre nous ont été soulagées de voir
que d’autres vivaient le même malaise et se sont senties soutenues. La solidarité peut
naitre tranquillement et permettre une division des charges. Le travail fourni pour la
cause, tant de sensibilisation que de mise en place de stratégies concrètes, ne peut se
faire seule. Déjà parce que la charge est colossale. Aussi parce que le nombre donne
souvent une légitimité aux revendications. Et le modèle, encore une fois. Si une
personne que vous admirez s’engage dans un combat, vous allez peut-être devenir
moins réticent-e aux causes du combat en question. C’est ce qui s’est passé
(lentement…) au département de philo. Quelques prof-e-s ont commencé à soutenir la
cause et ont servi d’exemple aux autres. Ça, c’est notre interprétation, certains vous
diront peut-être qu’ils y ont toujours été favorables. Quoi qu’il en soit, les réticents ou
les antiféministes, s’ils sont toujours là, se savent non légitimes. Cette solidarité est
importante dans les moments d’action mais aussi dans ceux de relâchement, pendant
lesquels on a besoin de “ventiler”, d’être comprise, soutenue, et surtout de savoir que
quelqu’un-e va prendre le relai.
GLAD!, 04 | 2018
190
La non-mixité et les safe spaces
49 Une des pistes à explorer lorsqu’on est un groupe minorisé est celle de la non-mixité.
C’est dans ces regroupements entre femmes que certaines d’entre nous ont pu se sentir
en sécurité. Le safe space, comme on l’appelle, permet de se retrouver entre femmes –
ou entre personnes d’autres groupes minorisés, vivant une discrimination commune –
et de se savoir entourée. On se rend compte que d’autres vivent et ressentent des
pressions et des difficultés similaires, que certaines ont pu trouver des solutions pour
des problèmes auxquels on ne parvient pas soi-même à faire face, et vice-versa. Le safe
space fait en sorte qu’on puisse parler librement sans avoir à se demander comment le
discours va être perçu par certains membres du groupe dominant qui, bien que pas
nécessairement sexistes, ont parfois l’impression que les revendications des féministes
sont des attaques contre la masculinité (*soupir*). Pour éviter les not all men ! (« c’est
pas tous les hommes ! ») », « je ne suis pas sexiste, mais… » ou autres « le féminisme
c’est dépassé », voire « pourquoi ça t’a mise mal à l’aise ? », se retrouver entre nous est
parfois reposant et nécessaire. C’est aussi dans ce genre de contexte que les activités
militantes (et pas seulement) vont pouvoir se mettre en place, dans un climat sans
pression.
Fillosophie
50 C’est comme ça qu’on a commencé à créer Fillosophie. Quelque part à l'automne 2013, les
femmes du département ont été conviées à une réunion. Sarah y est allée sans trop
savoir de quoi il en retournait, encore assez peu sensibilisée aux enjeux de genre,
notamment dans son environnement d’études. Plusieurs femmes étaient là, étudiantes
et profes. Beaucoup s’attendaient à un genre de safe space justement, pour pouvoir
parler de la situation des femmes en philo, des possibles solutions, etc. Chacune s’est
présentée et a dit pourquoi elle était là. Le besoin de se regrouper est revenu souvent.
Puis, la réunion a été modérée par une représentante d’un institut qui s’est contentée
de présenter un programme d’étude en recherche féministe ouvert aux étudiant-e-s de
philo. Pourquoi n’étions-nous que des femmes alors ? Clientèle-cible des études
féministes, notre pseudo-expertise en affaires liées au féminisme nous valait désormais
d’être invitées à participer à ce club exclusif où l’on pouvait s’adonner toute entière à
ce qui avait été notre moyen de perdurer dans un milieu hostile aux femmes. Que faire
de toutes ces attentes prononcées en début de réunion ? C’est avec un sentiment à la
fois d’urgence et d’échec que Sarah est sortie de cette réunion. La situation est
problématique, l’heure est grave et personne ne fait rien. Que faire ? Par chance,
d’autres avaient ressenti le même malaise et ne se sont pas contentées de rentrer chez
elles le cœur gros.
51 Marina, une étudiante en philo qui était présente aussi, a écrit à Sarah et quelques
autres qu’elle connaissait ou qu'elle avait croisées dans le département, quelques jours
après la réunion catastrophique. Elle faisait état de son malaise et se demandait si
certaines voudraient se retrouver autour d’un café pour discuter de la situation. C’était
vague, mais tellement soulageant ! Nous nous sommes réunies à cinq, dès le lendemain :
Marina, Clélia, Aline, Raphaëlle et Sarah. Nous avons envisagé différentes solutions
pour tenter de mettre en avant la place et l’image des femmes dans notre département.
C’est là que l’idée d’organiser des conférences données par des femmes nous est
GLAD!, 04 | 2018
191
apparue comme une première piste de solution possible : une sorte de plateforme pour
la philosophie faite par des philosophes femmes. On a pris rendez-vous avec les
professeures femmes du département. Elles étaient quatre à l’époque et ont été d’une
grande aide.
52 L’une d’elles, notamment, est encore là aujourd’hui et nous soutient presque
inconditionnellement. On allait créer une plateforme pour les femmes, qui ne les
confinerait pas au rôle exclusif de féministes. La tribune n’allait pas être une tribune de
sensibilisation. On allait plutôt prendre les grands moyens pour influencer notre
domaine en faisant ce qui nous intéressait : de la philosophie.
53 On s’est réunies plusieurs fois toutes les cinq, pour trouver un nom, savoir comment
procéder, qui contacter, comment préparer une conférence, etc. La machine s’est mise
en marche avec pour seul moteur notre volonté. La première conférence a eu lieu le 5
février 2014. Marina s’est portée volontaire pour être la conférencière. On a réservé une
salle, on s’est arrangées pour avoir du café, et on a contacté le département de philo,
étudiant-e-s et professeur-e-s, pour les convier à l’événement. Une bonne quinzaine de
personnes s’est prêtée au jeu. La deuxième conférence a eu lieu en mars. Sarah
présentait. La troisième en avril. Ce fut au tour de Clélia. Petit à petit, on a construit la
structure qui nous a fait arriver là où on est aujourd’hui : un site internet, une page
Facebook, du financement, un réseau, et on en passe…
54 Aujourd’hui, Fillosophie, c’est huit étudiantes, tous cycles d’études confondus, qui
contribuent activement et constamment à la valorisation du travail des femmes en
philosophie. Les conférences présentent les travaux de chercheuses du Canada, des
États-Unis et de l’Europe, et les sujets traités sont choisis par les conférencières, qui
sont des étudiantes aux cycles supérieurs ou des professeures/chercheuses au niveau
universitaire ou collégial. Gratuites et ouvertes à tou-te-s, les conférences réunissent en
moyenne une cinquantaine de personnes : des philosophes, des étudiant-e-s,
professeur-e-s et chercheurs/chercheuses en d’autres domaines, ainsi que des
personnes extérieures à l’université. Elles donnent une visibilité aux recherches des
conférencières et permettant un retour constructif sur leur travail grâce à la présence
de leurs collègues. Suite à leur présentation, certaines conférencières ont reformulé des
parties importantes d’un mémoire, d’une thèse ou d’un article scientifique, car les
questions qui ont suivi les présentations ont donné lieu à des débats très constructifs.
55 À l’heure où l’on écrit ces lignes, nous avons déjà organisé 32 conférences. Nous avons
également été présentes dans différents congrès professionnels, à titre d’invitées : au
congrès annuel de la Société de Philosophie du Québec à l’ACFAS, où nous avons parlé
de la façon de promouvoir la place des femmes en philosophie, et au Congrès
International des Recherches Féministes dans la Francophonie (CIRFF) en 2015. Nous
avons été invitées au premier Colloque philosophique pour les étudiant-e-s du niveau
secondaire, le Colloque Philo-Cité du Pensionnat Saint-Nom-de-Marie, pour parler
d’injustice épistémique en lien avec les femmes. Nous pouvons également compter sur
le soutien financier du Département de philosophie de l’UQAM, de la Société de
Philosophie du Québec, du Canadian Journal of Philosophy, et avons été finalistes du
Concours provincial québécois Forces Avenir en 2017 et en 2018. Nous avons également
reçu une invitation à participer au CIRFF à l’Université Paris-Nanterre à l’été 2018.
Venez nous y écouter !
56 En mettant en relief le travail de femmes, nos conférences servent à montrer aux
étudiantes que leur place en philosophie est légitime et primordiale : ce milieu
GLAD!, 04 | 2018
192
majoritairement masculin a besoin de leur persévérance pour devenir une
communauté éclairée et stimulante. Si l’on se rapporte à notre schéma de la Figure 5,
Fillosophie peut agir sur les trois derniers leviers, soit le climat, la militance et le travail.
57 Au-delà de ses retombées concrètes, Fillosophie, c’est aussi une sorte de bulle où l’on
peut se retrouver entre nous. C’est un endroit où l’on n’a pas à prouver, à expliquer ou
à justifier notre expérience quotidienne par rapport aux enjeux étudiés ici. C’est un
endroit où l’on sait, où l’on se comprend et où l’on se soutient. Fillosophie, c’est parfois
une aventure difficile, ambiguë, éprouvante. C’est un espace de frictions et de remise en
question, c’est un lieu où l'on apprend à travailler sans hiérarchie, où l’on tente de
créer un espace de travail idéal et sans contraintes, où la réalité nous rattrape parfois.
C’est un groupe où les membres sont fatiguées mais résilientes, un lieu où elles tentent
de surmonter leurs divergences d’opinion par l’écoute et le respect. On a appris au fil
du temps qu’il est difficile de voir des membres arriver, puis repartir. Comment
interpréter le départ des membres ? Avons-nous fait quelque chose de mal ? Sommes-
nous assez inclusives ? Évoluons-nous dans un safe space ? Le niveau personnel et
individuel prend-il le pas sur les bienfaits de l’organisation ? Chacune porte sa lutte en
elle et tente de conjuguer ses tactiques à celles des autres, sans imposer de vision, sans
parler plus fort. Les questions sont nombreuses et les réponses ne viennent pas
toujours spontanément.
58 Récemment, avec les autres membres, on s’est posé la question de la représentativité de
Fillosophie. Est-ce que Fillosophie est trop blanche ? Assurément. Est-ce que Fillosophie est
accueillante et suffisamment inclusive pour les personnes trans ? On souhaite mettre
sur pied une réflexion par rapport à ces problématiques et l'on souhaite également
s’instruire sur des terminologies et des tactiques qui se dessinent pour des luttes
auxquelles elles n’étaient pas initialement destinées. Peut-être pourrions-nous voir
sous peu une transformation dans notre nom… on peut penser à quelque chose comme
« Fillosophie et compagnie » (!), pour inclure d’emblée dans notre groupe des personnes
qui ne s’inscrivent pas dans la catégorie rigide du genre qui a motivé initialement le
nom Fillosophie. Il faut également se plier à l’exercice de travail sur soi que nous
attendons nous-mêmes de la part quiconque appartient au milieu philosophique, et
considérer que notre groupe doit représenter un espace où les personnes de couleur, les
personnes trans, les personnes neuroatypiques et encore d’autres, ont leur place. Pour
cela, il faut favoriser la diversité de nos conférencières et de nos membres. Ce travail
est tellement simple et tellement délicat à la fois. Ce que l’on désire enfin souligner,
c’est qu’on ne pense pas que Fillosophie a pensé à tout. On ne pense pas que Fillosophie a
la bonne réponse, ou que le groupe est exemplaire, qu’il n’a plus rien à apprendre ou à
améliorer. Fillosophie, c’est grandir de ses erreurs, c’est être résilientes, c’est aussi
écouter et apprendre à réfléchir ensemble.
La création d’un groupe
59 Fillosophie est la piste de solution à laquelle on a pensé et qu’on a mise en place. On peut
vous livrer quelques autres « trucs » qui nous semblent pouvoir faire une différence
efficace dans certains cas. D’abord, si vous vous êtes réunies, même une ou deux fois, il
peut être utile de constituer un groupe. Non seulement pour être ralliées à une cause
par un nom, mais surtout pour utiliser ce nom dans certaines de vos revendications ou
communications. Ça peut vous éviter de vous faire reconnaitre en tant qu’individu
(lorsque, par exemple, vous militez dans votre département où les profs connaissent
GLAD!, 04 | 2018
193
votre nom, vous notent, vous évaluent, etc.) et de vous faire étiqueter sans arrêt comme
la féministe de service à qui on va venir demander des comptes. Vos revendications
sont une chose, votre travail en est une autre. En tous cas, pour les autres. Ça vous
permet aussi éventuellement d’être présente sur plusieurs fronts et, pourquoi pas, de
vous engager dans plusieurs causes.
La prise en compte de l’intersectionnalité
60 À ce propos, une réflexion sur l’intersectionnalité nous apparait nécessaire en tant que
membres d’un groupe qui revendique certains droits. En effet, il peut être utile, voire
nécessaire, de se questionner sur les autres mouvements de lutte et de savoir que
certaines personnes se trouvent doublement, voire triplement marginalisées ou
discriminées parce qu’elles appartiennent à d’autres minorités. Pour commencer, il est
bon de se questionner sur nos pratiques : notre groupe est-il suffisamment diversifié
pour que plusieurs voix puissent être entendues et s’exprimer librement ? Nous
sommes au fait de ce qu’est le sexisme, mais qu’en est-il du racisme, du capacitisme, des
discriminations liées à l’orientation sexuelle ? Que pouvons-nous changer et améliorer
pour être conscientes et conscientiser ? Ouvrir la porte et l’oreille à ces éléments est
essentiel. Cela peut aussi être favorisé en invitant des personnes marginalisées à
prendre la parole dans notre milieu, ou en invitant les personnes issues de ces groupes
prendre la place qu'elles désirent dans notre projet. Fillosophie est une tribune et une
manière de faire de la philosophie qui doit être représentative de la diversité de
perspectives qui sont susceptibles d'enrichir sa pratique. Cette diversité est ignorée par
le système académique philosophique, et il est de notre responsabilité de lui donner la
visibilité qu'elle mérite.
L’allègement de la charge ou la demande de reconnaissance
61 À un certain point, la charge est lourde. Le travail est difficile et prend le dessus sur ce
que vous avez à faire ou voudriez faire. Étant donnée toute la charge que le travail de
sensibilisation et de mobilisation représente, il est parfois difficile de garder du temps
pour soi. Lorsqu’on est très mobilisée, on est aussi souvent sollicitée, puisqu’on devient
« experte ». Tous les « petits travaux » à faire concernant la sensibilisation, l’aide, la
rédaction de tracts, l’appel pour un projet féministe, la mise en place d’une discussion,
l’organisation de plateformes d’échange, la modération de groupes internet, etc. nous
reviennent souvent ! Dans ces cas-là, une première chose à faire est de voir si vous
pouvez en faire un peu moins, en vous tournant vers vos allié-e-s. Une seconde est de
demander rémunération lorsque vous jugez cela pertinent. Il arrive qu’un-e prof-e ou
un-e chercheur-e nous sollicite pour effectuer une tâche liée à nos revendications. Dans
ces cas-là, on se pose la question de savoir si c’est un travail qui peut permettre un prix,
une rémunération, un financement, ou même un défraiement. Et il est tout à fait
légitime de poser la question à la personne qui nous sollicite.
La rémunération
62 Et finalement, même quand on ne nous sollicite pas, il est parfois utile de demander
rémunération. C’est le cas par exemple si vous vous mettez à demander à ce qu’on
féminise les plans de cours et le site de votre département et qu’on vous répond que
GLAD!, 04 | 2018
194
personne n’a le temps pour un tel travail. S’il se trouve que vous l’avez, vous, ce temps,
cela peut être une bonne idée de demander un contrat de travail pour la mise en place
d’une telle chose. Les plans de cours sont pleins d’hommes blancs morts ? Et si vous
aviez la possibilité de suggérer une liste d’auteur-e-s « non canoniques » à votre
département grâce à un contrat de recherche ? Évidemment, il y a peu de chance qu’on
vous approche, mais peut-être y a-t-il des prof-e-s que vous pensez soucieux-soucieuses
de la cause et à qui vous pourriez parler de ce projet ? C’est là qu’il est important aussi
de savoir qui sont vos allié-e-s et vos allié-e-s potentiel-le-s, quel que soit votre milieu
de travail et de revendication.
BIBLIOGRAPHIE
MARTIN ALCOFF, Linda. 3 septembre 2013. « What’s Wrong with Philosophy ? », The New York
Times, [En ligne, consulté le 23/04/2018] URL : https://opinionator.blogs.nytimes.com/
2013/09/03/whats-wrong-with-philosophy/
ARNAUD, Sarah, MEDEIROS RAMOS, Aline. 2015. Schéma présenté lors de la conférence : « Doit-
on être toujours féministe en philosophie ? » dans le cadre de la table ronde : Quel rôle pour les
femmes en philosophie. Congrès International des Recherches Féministes dans la Francophonie.
BAGGINI, Julian. 2011. « The Long Road to Equality », The Philosophers Magazine, (53) :14-19.
BAKER, Kelly J. 9 octobre 2014. « Writing About Sexism in Academia Hurts », Chronical Vitea.
BISHOP, Glenis, BEBEE, Helen, GODART, Eliza, RINI, Adriane. 2013. « Seeing the Trends in the
Data » in Women in Philosophy. What Needs to Change ?, HUTCHISON Katrina, JENKINS Fiona (éd.).
New York. Oxford University Press, 231-259.
DI CROCE, Marianne. 19 novembre 2015. « Place des femmes en philosophie : un panorama de la
question. », Raisons Sociales, [En ligne, consulté le 23/04/2018] URL : http://raisons-sociales.com/
articles/place-des-femmes-en-philosophie-un-panorama-de-la-question/.
HASLANGER, Sally. Printemps 2008. « Changing the Ideology and Culture of Philosophy : Not by
Reason (Alone) », Hypathia, 23, (2) : 210-223.
HARLANGER, Sally. 2013. Data on Women in Philosophy compiled in the APA Committee on the Status of
Women Report. [En ligne, consulté le 23/04/2018] URL : http://www.apaonlinecsw.org/data-on-
women-in-philosophy
LANGTON, Rae. 4 septembre 2013. « The Disappearing Women », The New York Times. [En ligne,
consulté le 23/04/2018] URL : https://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/09/03/whats-wrong-
with-philosophy/
LEGAULT, Mylène. Hiver 2018. « Recension des étudiants et étudiantes inscrit-e-s au département
de philosophie de l'Université du Québec à Montréal pour l'année 2017 ». Atelier non-mixte sur la
place des femmes en philosophie au Québec à l'Université Laval à Québec.
NORLOCK, Kathryn J. 2011. Update from the Report for the APA Committee on the Status of Women.
Trent University.
GLAD!, 04 | 2018
195
PAXTON, Molly FIGDOR, Carrie, TIBERIUS, Valerie. Automne 2012. « Quantifying the Gender Gap :
an Empirical Study of the Underrepresentation of Women in Philosophy », Hypatia, 27, (4) :
949-957
PEDNEAULT, Hélène. 4 mars 1999. « Apologie de la colère des femmes », Voir.ca [En ligne, consulté
le 23/04/2018] https://voir.ca/chroniques/grandes-gueules/1999/03/04/apologie-de-la-colere-
des-femmes/
SAUL, Jennifer. 2013. « Implicit Biais, Stereotype Threat and Women in Philosophy » in Women in
Philosophy. What Needs to Change ?, HUTCHISON, Katrina, JENKINS, Fiona (éd.). New York. Oxford
University Press, 39-60.
ANNEXES
Notre site internet : fillosophie.org
Notre page facebook : https://www.facebook.com/fillosophie.uqam/
Blogue : What is it Like to Be a person of Color in Philosophy
Blogue : https://beingawomaninphilosophy.wordpress.com
Blogue : https://whatweredoingaboutwhatitslike.wordpress.com
Blogue : https://beingaphilosopherofcolor.wordpress.com/
Blogue : https://feministphilosophers.wordpress.com/2012/11/05/resources-related-
to-climate/
Site internet du Département de philosophie de Rutgers University, dans la section
« Climate for Women and Underrepresented Groups at Rutgers » : http://
philosophy.rutgers.edu/graduate-program/climate/133-graduate/climate
NOTES
1. Tout au long de cet exposé nous entendons par « femmes » toutes les femmes. Le terme est
trans-inclusif.
2. Ce que l’on appelle le baccalauréat au Québec correspond aux trois années de licence en France
3. Données recueillies et compilées par Mylène Legault (2018), candidate au doctorat à
l'Université du Québec à Montréal et membre de Fillosophie.
4. Données recueillies par le Comité Équité et Climat du département de philosophie de l'UQAM
et éditées par Mylène Legault.
5. Jennifer SAUL. “Implicit Biais, Stereotype Threat and Women in Philosophy”, in Women in
Philosophy. What Needs to Change? (dir. Katrina Hutchison et Fiona Jenkins), Op. Cit., 39-60.
GLAD!, 04 | 2018
196
RÉSUMÉS
Cet article propose d'explorer les enjeux liés à la domination du genre masculin dans les milieux
académiques au sein de la discipline philosophie. Deux jeunes chercheuses formées à l'université
du Québec à Montréal partagent leur expérience, leur prise de conscience et retracent la
trajectoire qui les a amenées à co-fonder ou à rejoindre l'association Fillosophie.
Philosophy is a field dominated by the male gender. This domination manifests itself by
numerous problems for women in philosophy. This paper questions the causes and the nature of
women’s roles in philosophy, through the experience of two of them.
INDEX
Thèmes : Explorations
Keywords : women, philosophy, minorities, implicit biases
Mots-clés : femmes, philosophie, minorités, biais implicites
AUTEURS
SARAH ARNAUD
Sarah Arnaud est docteure en philosophie, diplômée de l’Université Paris-Sorbonne et de
l’Université du Québec à Montréal. Elle s’intéresse aux émotions et aux psychopathologies, ainsi
qu’à la caractérisation de la conscience. Elle commence son postdoctorat à la City University of
New York. Elle s’intéresse également aux enjeux féministes dans la société. Elle est une des
membres fondatrices de Fillosophie, un regroupement féministe qui promeut la place des femmes
en philosophie.
CLOÉ GRATTON
Cloé Gratton est étudiante à la maitrise en philosophie à l’Université du Québec à Montréal. Elle
s’intéresse à la philosophie de l’esprit et à la philosophie de la psychologie. Elle poursuivra en
septembre des études en psychologie. Elle est membre de Fillosophie depuis 2015.
GLAD!, 04 | 2018
197
Une chambre à soi : genres et corpsen artA Room of One’s Own: Genders and Bodies in Art
Luc Schicharin et Anne-Laure Vernet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Souhaitant rendre lisibles et visibles des pratiques d’écriture de la recherche
exploratoires, nous publions dans la section Recherches les courts-métrages de Luc
Schicharin et Anne-Laure Vernet ainsi que leur texte d’accompagnement.
Présentation du contexte scientifique des courts-métrages documentaires réalisés dans le cadre desJournées d’études
1 Dans le cadre de cinq journées d’étude intitulées Une chambre à soi : genres et corps en art
tenues d’octobre 2015 à janvier 2016, la problématique de la politique des subjectivités
a été abordée à partir d’une étude esthétique et philosophique des créations
plasticiennes articulées selon les registres et les codes de l’art contemporain, ainsi que
des pratiques artistiques militantes issues des subcultures et cultures populaires.
2 Ces journées d’étude faisaient suite à trois autres journées préalablement tenues en
mars 2015, intitulées Genderqueer Workshop : Réflexion sur les corps contemporains à travers
les arts, qui initiaient un premier temps de réflexion sur les corps contemporains à
travers les arts.
3 L’ensemble de ces huit journées visait à provoquer échanges, partages et
confrontations notionnelles et conceptuelles sur le sujet. Pour cela, a-t-on entrepris
d’emblée la mise en place d’un réseau international d’historiennes, d’anthropologues
GLAD!, 04 | 2018
200
de l’art, de spécialistes des théories féministes et queer, de spécialistes en iconologie et
en études culturelles, et d’artistes plasticien.ne.s.
4 La diversité voulue des contextes épistémologiques d’analyse, des méthodologies et des
analyses à proprement parler a fait beaucoup plus que nourrir et enrichir les échanges.
Cette diversité s’est en effet révélée absolument nécessaire à l’approche de la question
des corps contemporains dans les arts, dont le caractère polymorphe la rend
irréductible à un point de vue unique.
5 Il s’agissait de confronter la production artistique à la littérature scientifique la plus
récente produite par le féminisme et les études de genre, afin de dégager de nouvelles
interrogations liées à la construction biopolitique du sujet (dans une perspective
foucaldienne1) et à l’épistémologie du corps (Bernard Andrieu2), sans omettre la mise en
question des normes sociales qui structurent et qui constituent le genre sur le plan
social, psychique, corporel et sexuel (Christine Delphy 2001, 2002 ; Nicole C.
Mathieu 1991 ; Paola Tabet 1998).
6 Notre programme de recherche étudiait la mise en question artistique des enjeux
politiques, esthétiques et philosophiques de la construction des subjectivités dans la
société contemporaine, s’inscrivant dans un contexte de tension idéologique en France
et dans le monde autour des théories constructivistes du genre3, médiatisées dans
l’espace public en tant que « la théorie du genre ». La somme des diverses
communications et des ateliers de réflexion a permis d’observer comment les artistes et
leurs œuvres rendent visible par son ébranlement, l’intrication complexe des processus
de construction des sexes, des races, des classes, des sexualités, des genres et des corps.
7 Ces journées ont permis également de mesurer l’enjeu politique de cette visibilisation,
en localisant d’une part les instances du pouvoir, et d’autre part les stratégies de
résistance qui s’y opposent dans la création artistique et les mouvements militants. En
appui sur les sciences philosophiques et les sciences de l’art, nous avons engagé une
relecture critique des représentations artistiques qui participent à la constitution d’un
imaginaire différentialiste clivant, formatant nos définitions du monde, des êtres et des
choses, et donc, de nos perceptions/conceptions idéologiques des corps et des identités
culturelles.
8 Les rapports de pouvoir entre les genres, les races, les nationalités, les classes sociales,
les pratiques religieuses et les sexualités constituent l’actualité complexe des sujets
contemporains et les génèrent, en conséquence, comme les véhicules de l’intelligence
collective aujourd’hui.
Généalogie du projet
9 En mars 2015, comme indiqué plus haut, se tenait le premier volet de journées d’études
intitulé Genderqueer Workshop : Réflexion sur les corps contemporains à travers les arts. Il
était organisé par une équipe interdisciplinaire de chercheur.se.s du département Arts
de l’Université de Lorraine (UFR Arts, lettres et langues - Metz), du Centre de Recherche
sur les Médiations (CREM - équipe de recherche Praxitèle) et du Laboratoire Lorrain de
Sciences Sociales (2L2S). Notre volonté théorique et pédagogique d’interdisciplinarité
pour l’approche de notre sujet en a donc appelé à croiser l’iconologie, les études
littéraires françaises et anglaises, et l’étude des pratiques artistiques (militantes ou
non), avec la pensée des féminismes, des théories queer et des études de genre.
Échanges et débats furent menés à la suite des communications sur : les textes poético-
GLAD!, 04 | 2018
201
politiques de Virginie Despentes (Alexandra Giraud) ; la philosophie de Michel Foucault
à l’épreuve du genre (Marie-Aimée Lebreton) ; les stéréotypes et la stigmatisation des
corps dans la pornographie (Lionel Renaud) ; les performances et les vidéos post-
pornographiques (Claire Lahuerta et Émilie Landais) ; les mutations corporelles dans les
œuvres de Matthew Barney (Aurélie Michel) et chez les artistes transgenres (Luc
Schicharin) ; la figure du monstre féministe/queer dans la bit lit4 (Gaïane Hanser) ; la
tension entre praxis militante et théories féministes et du genre, au sein du groupe
d’action féministe français La Barbe (Anne-Laure Vernet) ; l’utilisation de la nudité et de
la sexualité dans la performance, comme résistance au néo-capitalisme dans les
collectifs queer comme Zarra Bonheur en France ou Quimera Rosa à Barcelone (Sam
Bourcier) ; la pratique plasticienne d’une artiste mosellane (Violaine Higelin) et
d’étudiant.e.s en arts plastiques (Delphine Harmant, Naura Kassou, Lola Moreau, et
Maxime Notin).
10 La discussion théorique conduisit vers un recentrement des problématiques communes
à la pensée féministe/queer et aux pratiques plasticiennes autour de la notion de corps
en tant que « chambre à soi ».
Le corps (dé)genré comme « chambre(s) à soi » dans la création
artistique contemporaine
11 C’est ainsi que d’octobre 2015 à janvier 2016, notre équipe scientifique a organisé un
second volet de journées d’études intitulé Une chambre à soi : genres et corps en art. Des
spécialistes du champ, en provenance de diverses universités européennes, étaient
invité.e.s à poursuivre et compléter les analyses et les hypothèses qui avaient été
émises lors de la précédente session autour de la problématisation de la pratique
artistique et des représentations iconographiques par les réflexions féministes, les
théories queer et les études de genre, et réciproquement, de ces mêmes réflexions et
théories par la pratique artistique.
12 Partant de l’idée foucaldienne selon laquelle le pouvoir appelle la résistance, nous
avons suggéré que, par delà l’assujettissement du sujet, le corps apparaissait en art
comme une « chambre à soi », une zone d’autonomie temporaire (Hakim Bey5) dans
notre monde contemporain ; cette spatialisation politique de l’anatomie relevait d’une
volonté de comprendre les modes d’action et les stratégies de lutte du sujet face au
biopouvoir à travers les usages performatifs de la nudité, de la sexualité, du corps, de
l’identité, de l’expérience sensible, ou de l’émotion critique. Le motif de la chambre
appliqué au corps prolonge l’affirmation féministe selon laquelle « le privé est
politique », il poursuit l’intuition de Virginia Woolf (Une chambre à soi, 1929), selon
laquelle, sous certaines conditions, il procure un espace de libre création aux femmes
et, par extension, à d’autres sujets, dits minoritaires. Cet élargissement participait en
tout cas de l’hypothèse que nous souhaitions aborder lors du second cycle de journées
d’études. Mais la chambre impliquait aussi une pratique de soi sans limite, avec sa
chair, ses organes, ses orifices et ses plaisirs, à l’image de Guillaume Dustan (Dans ma
chambre, 1994). Ainsi, détachée de la conception immobilière usuelle que l’on s’en fait,
mais aussi s’inscrivant dans une logique qui va à l’encontre de la psychanalyse
freudienne qui pensait que l’art était une sublimation du sexuel, la thématique de la
chambre suggérait un lieu idéel où peuvent se confondre la créativité artistique et la
vie corporelle, jusqu’à l’entremêlement, dans l’exaltation et/ou dans la révolte. De fait,
GLAD!, 04 | 2018
202
le corps, la sexualité et l’identité, en tant que constructions subjectives à partir d’une
anatomie politique6, de structures psychiques, d’acquis sociaux et de prothèses
technologiques, ne peuvent-ils pas eux aussi être questionnés comme les toutes
premières chambres à soi ?
13 Ces journées d’études ont en effet permis d’interroger : la possibilité de constituer une
communauté de résistance à travers l’activisme cinématographique queer et féministe
chez Lizzie Borden, Marlon Riggs et Lana Wachovski (Peggy Pierrot) ; le sang menstruel
comme construction sociale de la différence des sexes, de l’hétérosexualité et de la
valence différentielle des sexes (Lourdes Mendez) ; le corps et la sexualité comme
armes, paroles, et résistance plurielle dans l’œuvre « pornoterroriste » de Diana J.
Torres (Karine Bergès) ; la performance collective, dans sa capacité à résister au néo-
capitalisme au regard des expropriations subies par les collectifs queer comme Atlantide,
dont les résident-e-s ont récemment été expulsé.e.s de force par la municipalité
bolognaise (Sam Bourcier) ; la pratique autobiographique ou autofictionnelle comme
espace artistique et de mise en jeu de l’émotion pour une réflexivité sociétale (Camilla
Graff) ; l’esthétique et la politique de résistance à la représentation, via les techniques
de floutage dans les portraits photographiques de sujets transgenres/queer réalisés par
J. Jackie Baier (Eliza Steinbock) ; les politiques croisées d’oppression raciste et sexiste à
l’encontre des femmes immigrées en Europe, déployées dans l’espace à la fois
disciplinaire et de non-droit de la chambre à coucher, à travers l’œuvre de Hristina
Tasheva (Annie Ferrand) ; la réappropriation émancipatrice des instruments de
contrôle et de subordination des corps dans la création plasticienne actuelle (Violaine
Higelin et Anthony Marquelet).
14 L’ensemble des discussions scientifiques et des performances, qui furent données lors
de ces journées, nous amenèrent à répertorier plusieurs techniques de corps7, élaborées
à partir d’actions militantes/artistiques qui, créant des espaces expérimentaux,
renégocient le périmètre de surveillance établi par le pouvoir. Ces recherches à la fois
théoriques et créatives génèrent des « chambres à soi », des périmètres d’explorations
temporaires pour les sujétions/les assujettissement non-anticipées et à contre-courant,
susceptibles de générer une pensée, une subjectivité, un corps, voire un peuple critique
qui bousculent, voire renouvellent les normes sociales. Toutefois, il a aussi été
démontré que le relâchement de la vigilance n’était pas possible en ces espaces
alternatifs, dans la mesure où les foyers de résistance demeurent très vulnérables à la
répression, à l’invasion et à la destruction ou aux expropriations et aux
réappropriations par le pouvoir politique.
15 Les travaux présentés au cours de ces journées d’étude et les échanges qu’ils ont
occasionnés ont donc permis d’affiner la réflexion engagée et de faire apparaître des
points de focalisation des enjeux, tout en confirmant la nécessité de maintenir un
processus de recherche sur les questions concernant la pleine actualité des corps
contemporains en art.
GLAD!, 04 | 2018
203
Présentation des choix de réalisation des courts-métrages documentaires réalisés dans le cadre desJournées d’études
La vidéo en partage numérique comme support de diffusion
scientifique : la recherche à l’ère du web 2.0
16 Les courts-métrages vidéographiques présentés ici ont pour vocation de documenter de
façon abrégée et synthétique les interventions données lors de journées d’études
tenues à l’Université de Lorraine, en partenariat avec le Frac Lorraine et l’Arsenal,
entre octobre 2015 et janvier 2016 : Une chambre à soi : corps, genre et art.
17 Ces montages courts sont issus d’un type de tournage qui relève du plus simple
dispositif, à savoir la captation audiovisuelle des communications et des débats.
18 Cette captation a été autogérée par nous, porteur.se.s du projet, avec des moyens
limités du fait de l’affaiblissement des soutiens financiers et humains qui traversent
actuellement le monde universitaire. Aussi avons-nous dû, tout en travaillant à la
conduite scientifique des journées d’études, nous occuper de la mise en œuvre de la
captation. Bien que du matériel ait été mis à notre disposition, il s’agissait d’un
équipement difficile à manipuler et peu adapté à un projet d’enregistrement mobile qui
devait suivre les différentes interventions au fil des lieux où elles avaient lieu : le Frac
Lorraine, l’Arsenal (Metz) et le site de Metz de l’Université de Lorraine. Ces conditions
de travail nous ont amené.e.s à adopter une posture esthétique et politique relevant du
cinéma militant, inspirée en particulier par le cinéma féministe de Carole
Roussopoulos, initiatrice de référence d’une pratique militante de filmage et de
réalisation, sans intervention extérieure, en totale autonomie. En l’absence de moyens
de tournage professionnel et de personnel de soutien, nous avons donc choisi de
réaliser les captations des communications et des débats par nos propres moyens,
plutôt que de ne pas tourner. En cohérence avec cette démarche militante où le
message prévaut sur son adéquation aux normes formelles, notre démarche d’écriture
audiovisuelle s’est détournée d’une réalisation pensée comme un produit télégénique
ou comme une œuvre d’art réservée à une diffusion confidentielle. C’est bien une
volonté de partage et de transmission des savoirs qui a animé notre geste filmique. Ce
qui situe notre travail dans un tressage que nous pensons fructueux, entre la recherche
universitaire et une action militante, dont la plupart des chercheur.se.s sur les
questions de genre et sur les questions féministes sont issu.e.s ou à laquelle i.els
appartiennent encore.
19 Ces courts-métrages répondent à un cahier des charges préalablement établi dans le
cadre d’un projet soutenu par la MSH Lorraine (Maison des Sciences de l’Homme), et
participent d’une volonté de diversifier les formats et les supports de la recherche
universitaire afin de renouveler la diffusion des savoirs académiques. La production
vidéographique de discours scientifiques n’étant ni une fin en soi, ni leur format
académique, qui est le texte ou la communication orale, il était important de penser le
support de diffusion : c’est ainsi que nous avons souhaité travailler avec une revue
numérique qui propose un accès gratuit à la production de connaissances dans l’espace
virtuel démocratisé d’Internet. En lien avec un tel projet de diffusion, l’enregistrement
sonore et audiovisuel de l’ensemble des rencontres, séminaires, et ateliers, avait été
GLAD!, 04 | 2018
204
pensé d’emblée dans une finalité triple : de constitution d’archives, de création d’outils
partagés et de préparation à des restitutions documentaires.
20 Aussi, ces courts-métrages de trois à sept minutes répondent-ils à cette triple finalité, à
savoir documenter et partager la teneur des discours des intervenants, en en mettant
en avant certains éléments choisis. Car il s’agit bien ici du montage d’extraits choisis de
communications orales, dont la durée réelle était de une heure à une heure et demie.
Ces extraits ont été montés de façon à rendre intelligible l’un ou l’autre des axes de
réflexion de l’intervenant.e, sans nécessairement suivre l’ordre réel d’arrivée des
arguments. Nous avons choisi d’adopter un montage brut, sans aucune volonté de
diriger/contrôler les discours et les images par le découpage, notre objectif étant au
contraire d’éviter, autant que possible, l’emprise autoritaire du montage audiovisuel
sur la parole des intervenant.e.s tenue lors des journées d’étude. La postproduction a
ainsi été pensée et menée dans un effort de restitution des discours et de la
construction théorique des spécialistes invités. Le travail de sélection nous a permis de
considérablement raccourcir la durée des interventions dans la restitution
vidéographique que nous proposons aujourd’hui ; il a été accompli dans un souci de
lisibilité tenant compte des pratiques des usager.e.s de la navigation sur Internet, et
dans un souci de fluidité quant à la réception de la pensée exposée par les différent.e.s
spécialistes. C’est également dans cette optique de clarté que nous avons choisi de ne
pas entrecouper la restitution vidéographique des interventions des différentes
conférencièr.e.s avec des séquences qui présentent les réactions de l’auditoire ; avec de
si brefs formats, la restitution d’échanges avec le public aurait brouillé la construction
sémantique du propos.
21 Du fait de notre engagement méthodologique et éthique, notre position de
réalisateur.trice — délibérément en retrait — a exigé de travailler la postproduction de
façon à ce que le montage ne se présente pas comme une réappropriation ou une
instrumentalisation des discours formulés par les invité.e.s qui nous avaient par
ailleurs autorisé.e.s à filmer leur communication lors des journées d’études. La
réalisation, entremêlant une démarche d’écoute et de restitution, se tient sur le fil du
désengagement de notre part d’une posture d’auteur.e, d’une forme audiovisuelle qui
nous présenterait comme les détenteurs.trices ou comme les médiateurs.trices de la
parole et des idées exprimées à l’image. Cette posture concorde avec le fait que, avec ce
que nous pourrions aussi appeler ces « synthèses vidéographiques de communications
scientifiques », il ne s’agit en aucun cas de proposer un état de notre propre pensée sur
les questions soulevées par nos journées d’étude. Conformément à ce positionnement
de réalisateur.trice, nous avons veillé à ce que chacun des films soit présenté à et
approuvé par les intervenant.e.s qui apparaissent respectivement à l’écran.
22 La finalité scientifique de ces journées d’étude était de questionner les pratiques
corporelles contemporaines (dé)genrées dans les cultures féministes et la création
plasticienne politisée. Ou, pour le formuler de manière plus problématique, il s’agissait
d’interroger la capacité des études de genre, féministes et queer à comprendre les
pratiques corporelles au sein de l’art et le militantisme artistique actuel ; et
réciproquement, il s’agissait d’interroger la capacité des pratiques/théories du corps
dans les arts et le militantisme à appréhender les travaux scientifiques sur le genre, le
féminisme et les théories queer. Nous souhaitions articuler deux dimensions du langage,
que sont la production théorique (les studies) et les pratiques discursives/corporelles
(dans la création artistique et le militantisme), en tant que mode d’expression sur des
GLAD!, 04 | 2018
205
sujets de réflexion scientifique que ces domaines ont en commun, comme le corps et, de
manière générale, l’identité. Nous nous demandions alors : quelles sont les modalités
possibles de la traduction ou de la transcription interdisciplinaire, de l’expressivité
politique dans la pratique artistique (faisant usage du corps et de l’identité) vers la
production de théories scientifiques ? Et inversement, comment la pratique langagière
de l’écriture/de la prise de parole scientifique se manifestait en feedback dans l’écriture
artistique des œuvres corporelles ou des actions militantes ? Ces problématiques nous
ont amené.e.s ainsi à traiter des questions sémiologiques par le biais de l’étude des
relations épistémiques entre les langages corporels, politiques et scientifiques au sein
de cadres illocutoires différents comme les arts, les subcultures, le militantisme et la
théorie. Ainsi, c’est en premier lieu au titre des contenus de ces journées d’étude que
ces courts-métrages pourront avoir leur place dans la revue GLAD!.
23 Nous l’avons dit, les films que nous avons réalisés n’ont pas été conçus dans une visée
de renouvellement du langage cinématographique ou comme un discours d’auteur,
c’est pourquoi nous pouvons interroger l’intérêt scientifique de cet objet final (une
série de films documentant la recherche scientifique) dans une revue dédiée à
l’exploration de la langue et à la réflexion critique sur le langage. Notre utilisation de la
forme audiovisuelle comme support d’un discours non cinématographique ne peut pas
faire simultanément de retour analytique ou réflexif sur elle-même, sauf à perdre sa
visée, qui était la restitution et la diffusion dudit discours. Cependant, le geste filmique
qui est le nôtre s’inscrit comme un geste scientifique dans la mesure où il produit une
ethnographie audiovisuelle de la recherche : ethnographie de la construction de
scientificité à travers la prise de parole scientifique et à travers cette agora que sont les
journées d’études mêmes. En outre, ces courts-métrages, synthèses audiovisuelles de
communications orales donc, ressortent de l’archive scientifique, et dès lors, en tant
que contenants d’éléments de savoir, contribueront, par leur diffusion, à la production
de savoirs.
24 Enfin, rappelons-nous que ces vidéos enregistrent la dimension performative (au sens
de la linguistique et du théâtre) de la théorie vivante et concrète, en train de se dire, en
train de se faire, dans le cadre d’un dispositif universitaire comme les journées d’étude.
L’expressivité orale et le langage corporel de chacun.e.s des théoricien.ne.s sont
enregistrés par la caméra. Filmer une parole en train de s’accomplir, de produire et de
diffuser du sens, de se transmettre d’un corps à l’autre (par la performance de la voix,
les performativités des mots et l’incorporation de la gestuelle) participe d’un travail
sémiotique par la réalisation vidéographique. Ainsi, si notre discipline (l’esthétique, les
sciences de l’art) et nos spécialisations (féministes, queer) ne sont donc pas directement
reliées aux questions de linguistique et de sémiologie, elles sont néanmoins traversées
partout, à tout moment, par la question politique du langage, dans la mesure où la
réalisation de films enregistrant la production scientifique de savoir implique
forcément une réflexion sur les discours. Notre usage de la caméra est donc défini
comme une capture vidéographique de discours scientifiques qui pourront, sans aucun
doute, intéresser l’expertise sémiologique.
25 Nos réalisations filmiques s’inscrivent dans une méthodologie de la recherche qui
souhaite maintenir le processus de théorisation vivant, selon un work in progress qui
laisse ouverte la possibilité de la contradiction, et plus encore, la possibilité de
l’indécision et de l’irrésolution des sous-problématiques posées. Ainsi, ces courts-
métrages peuvent apparaître comme une forme de bilan de ces journées d’étude, parce
GLAD!, 04 | 2018
206
qu’attestant des questionnements développés, en même temps que donnant à voir et
entendre la richesse de la réflexion conduite. Cependant, si nous avons, cette fois-ci,
cherché à effacer notre point de vue des communications et de leurs restitutions
vidéographiques, nous projetons à moyen terme de réaliser un film — court ou moyen-
métrage — où notre propre pensée pourra clairement apparaître à l’écran, par le biais
d’une écriture scientifique audiovisuelle qui sera identifiable comme notre propre
discours.
Ce média ne peut être affiché ici. Veuillez vous reporter à l'édition en ligne http://
journals.openedition.org/glad/1107
Ce média ne peut être affiché ici. Veuillez vous reporter à l'édition en ligne http://
journals.openedition.org/glad/1107
Ce média ne peut être affiché ici. Veuillez vous reporter à l'édition en ligne http://
journals.openedition.org/glad/1107
Ce média ne peut être affiché ici. Veuillez vous reporter à l'édition en ligne http://
journals.openedition.org/glad/1107
BIBLIOGRAPHIE
ANDRIEU, Bernard. 2006. « Quelle épistémologie du corps ? » Corps, 1 : 13-21.
BEY, Hakim. 1997. TAZ. Zone Autonome Temporaire. Paris : Éditions de l’Éclat.
DELPHY, Christine. 2001. L’ennemi principal 2, Penser le genre. Paris : Syllepse.
DELPHY, Christine. 2002. « Penser le genre ». Sexe et genre. De la hiérarchie entre les sexes, HURTIG
Marie-Claude, KAIL Michèle, ROUCH Hélène (dir). Paris : CNRS éditions, 89-101.
FOUCAULT, Michel. 1975. Surveiller et punir. Paris : Gallimard.
FOUCAULT, Michel. 1976. Histoire de la sexualité, La volonté de savoir. Paris : Gallimard.
MATHIEU, Nicole-Claude. 1991. L’anatomie politique : catégorisations et idéologies du sexe. Paris : Côté-
femmes.
MAUSS, Marcel. 2006. « Les techniques de corps », in Sociologie et anthropologie, MAUSS, Marcel.
Paris : PUF, 363-386.
PERREAU, Bruno. 2016. Queer Theory : The French Response. Bloomington : Standford University
Press.
TABET, Paola. 1998. La construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et des corps. Paris :
L’Harmattan.
GLAD!, 04 | 2018
207
NOTES
1. FOUCAULT, Michel. 1976. Histoire de la sexualité, La volonté de savoir. Paris : Gallimard, p. 183-184.
2. ANDRIEU, Bernard. 2006. « Quelle épistémologie du corps ? » Corps, 1 : 13-21.
3. PERREAU, Bruno. 2016. Queer Theory : The French Response. Bloomington : Standford University
Press.
4. Genre littéraire qui met en scène des vampires et d'autres créatures surnaturelles tirés du
bestiaire traditionnel de l'heroic fantasy, dans des décors urbains contemporains.
5. BEY, Hakim. 1997. TAZ. Zone Autonome Temporaire. Paris : Éditions de l'Éclat.
6. FOUCAULT, Michel. 1975. Surveiller et punir. Paris : Gallimard. p. 162 ; MATHIEU, Nicole-Claude.
1991. L'anatomie politique : catégorisations et idéologies du sexe. Paris : Côté-femmes.
7. Mauss, M. (2006), « Les techniques de corps », in Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, p. 368.
RÉSUMÉS
Dans le cadre d’une double série de journées d’étude intitulées respectivement Genderqueer
Workshop : Réflexion sur les corps contemporains à travers les arts, et Une chambre à soi : genres et corps
en art, tenues de mars 2015 à janvier 2016, la problématique de la politique des subjectivités a été
abordée à partir d’une étude esthétique et philosophique des créations plasticiennes articulées
selon les registres et les codes de l’art contemporain, ainsi que des pratiques artistiques
militantes issues des subcultures et cultures populaires. Grâce à l’interdisciplinarité des
intervenant.e.s issu.e.s d’un réseau de dimension international, la diversité des contextes
épistémologiques d’analyse, des méthodologies et des analyses a permis une approche incisive et
renouvelée de la question des corps contemporains dans les arts. La captation des conférences et
des échanges qu’elles ont suscités a donné lieu à la réalisation de courts-métrages
vidéographiques, dont la vocation est, outre la documentation abrégée et synthétique de ces
échanges scientifiques, la construction d’une ethnographie audiovisuelle de la construction de
scientificité, et un partage innovant de cette co-élaboration scientifique dans les supports
numériques.
During the course of 2 symposium respectively called « Genderqueer Workshop : a Reflexion on
Contemporary Bodies through the Arts », and « A Room to One’s Own : Genders and Bodies in
Art » held from March 2015 to January 2016, the problematic of political subjectivity has been
approached through an aestethical and philosophical study of works of art which are organized
according to the codes of contemporary art and of militant artistic practices coming from
subcultures and popular cultures. Thanks to the interdisciplinarity of the many lecturers, all
coming from an international network, the diversity in epistemological analytic context,
methodology and analysis, allowed an approach both sharp and renewed of the problematic of
the contemporary bodies in art. The filming of the symposiums and of the conversations and
debates that they provoqued led to the making of several short movies. The aim is to use them as
shortened and summarized version of those scientific discussions, but also as the start of an
ethnographic study of this scientific process, and as an innovative way of sharing this scientific
coelaboration through digital support.
GLAD!, 04 | 2018
208
INDEX
Thèmes : Recherches
Keywords : contemporaneous bodies, genders, identities, cultures
Mots-clés : corps contemporains, genres, identités, cultures
AUTEURS
LUC SCHICHARIN
Docteur en arts, CREM, Université de Lorraine, plasticien. Ses recherches portent sur les
pratiques du corps dans les arts, sur les usages et les pratiques artistiques des théories
féministes, queers, transgenres et postcoloniales, ainsi que sur les figures de la « post-humanité »
dans la création artistique contemporaine (les extraterrestres, les transspécistes, les cyborgs).
Actuellement, il étudie les constructions complexes de la subjectivité permettant à une identité
dominante comme la sienne d’être affectée par les problématiques sociales et politiques vécues
par les groupes minoritaires.
ANNE-LAURE VERNET
MCF arts, laboratoire CREM, Université de Lorraine ; co-responsable de la Galerie 0.15//Essais
Dynamiques ; activiste du groupe La Barbe dès 2008 ; photographe et plasticienne. Ses recherches
universitaires interrogent les arts selon les axes croisés des gender studies et du féminisme
matérialiste, et portent en particulier sur la construction sociale de l’exclusion des artistes
femmes de l’histoire de l’art officielle et du monde de l’art, ainsi que sur la mise en question des
subjectivités et des corps dans l’art contemporain et dans les pratiques artistiques militantes
issues des subcultures et cultures populaires, et actuellement, sur la qualification de la réception
émotionnelle des œuvres d’art.
GLAD!, 04 | 2018
209
L’agitation du quotidien Une conversation sur la réflexion Ⓐnarchiste face au sexisme dans lalangue
Agitando lo cotidiano. A Conversation on the Ⓐnarchist Challenge Regarding
Sexism in Language
Mariel Acosta et Ernesto Cuba
Traduction : Sara Martinez
RÉFÉRENCE
Mariel Acosta & Ernesto Cuba. 2016. « Agitando lo cotidiano. Una conversación sobre el
desafío Ⓐnarquista frente al sexismo en el lenguaje » The Journal of the Students of the
Ph.D. Program in Latin American, Iberian and Latino Cultures [En ligne], 11(2). URL : https://
lljournal.commons.gc.cuny.edu/2016/12/02/cuba-v11-216/
1 Ernesto Cuba (EC) : Mariel et moi nous sommes rencontré·e·s en octobre 2015 lors de la
quatrième conférence du programme Culture, Language & Social Practice (CLASP) de
l’université du Colorado à Boulder. Depuis, comme nous vivons tous·tes les deux à New
York, nous avons eu l’occasion de débattre de notre passion universitaire commune, les
études sur la langue et le genre.
2 Il y a peu, j’ai lu son mémoire de master — qui a constitué le texte de son intervention à
Boulder. Intitulé Subverciones lingüisticas del español: @, x, e como morfemas de género
inclusivo y otros recursos estilísticos en publicaciones anarquistas contemporáneas1, ce
mémoire analyse les dernières propositions en date en matière de langue non sexiste
en espagnol. Dans cet entretien, qui a eu lieu à Brooklyn (New York) en octobre 2016,
Mariel et moi parlons de ses découvertes, du lien qu’entretiennent des mouvements
sociaux comme l’anarchisme et le mouvement LGBTQ avec l’usage de la langue, ainsi
que de nos impressions quant à l’adoption et à l’évaluation de certaines propositions
d’activisme linguistique féministe. Débattre de ce sujet, en tant que Latino·a vivant aux
États-Unis, offre l’occasion d’observer l’usage de ces morphèmes par la communauté
GLAD!, 04 | 2018
211
latina de ce pays. Cela nous permet également d’évaluer la dynamique transnationale
de leur usage par la communauté linguistique hispanophone à l’échelle mondiale.
EC : J’aimerais avant tout te féliciter pour ton travail et te remercier de partager ici tes idées.Pour commencer, peux-tu nous dire quels sont les morphèmes de genre que tu asobservés ? Dans quelles circonstances certains apparaissent plutôt que d’autres ?
3 Mariel Acosta (MA) : Mon mémoire est une analyse qualitative des symboles
graphiques et des graphèmes qui remplacent les morphèmes normatifs indiquant le
genre grammatical, comme le @, le signe = et les lettres x et e, ainsi que des
dédoublements au niveau morphologique apportés par l’utilisation de la barre oblique,
qui sépare les morphèmes binaires de genre (a/o)2. J’ai analysé trois revues sur la
centaine de revues et de journaux anti-autoritaires autogérés circulant en Amérique
latine. Au début de mes recherches, je souhaitais en étudier dix pour que l’échantillon
soit plus représentatif de la communauté linguistique hispanophone, mais je me suis
finalement cantonnée à trois publications, car ce type de morphèmes n’était pas si
courant que ça. Le corpus se compose ainsi de trois titres anarchistes : El Amanecer,
publié par le groupe anarchiste chilien El Amanecer3 ; Acción directa, du groupe
péruvien Acción directa4 ; et enfin Organización obrera, de la Fédération régionale
ouvrière argentine (FORA)5. J’ai analysé au total 21 articles issus de trois numéros de
chaque titre.
4 L’arobase est présente dans deux des trois revues analysées ; c’est le morphème le plus
répandu, notamment dans des phrases comme l@s rebeldes que se encuentran sol@s6 et
l@s jamaiquin@s migran para EE.UU7, que j’ai pu observer dans Acción directa. Ce choix
semble être le plus répandu dans les textes mainstream, formels comme informels, peut-
être parce que l’arobase symbolise la juxtaposition des lettres a et o, ce qui indique
qu’elle s’inscrit encore dans le cadre des catégories binaires féminin/masculin.
5 L’usage du x est plus ambigu quant à l’identité de genre du référent. De même, la
position de l’énonciateur·rice n’est ni féminine ni masculine, mais ambiguë, ce qui
rappelle les pratiques non verbales d’identité et de communication de certain·e·s
militant·e·s anti-autoritaires, généralement insurrectionnalistes, consistant à masquer
leurs visages pour garder l’anonymat, particulièrement lors d’affrontements avec la
police dans le cadre de manifestations.
6 Cette lettre donne la possibilité à l’énonciateur·rice de ne pas assigner d’identité de
genre non souhaitée aux référent·es de l’énoncé ni à lui/elle-même (s’il s’agit d’une
phrase auto‑référentielle). Le x peut également élargir les possibilités d’identification
des personnes dont les identités ne s’inscrivent pas dans la binarité normative féminin/
masculin, qui limite les possibilités de l’énonciateur·rice en matière d’auto-référence.
On l’observe dans des phrases telles que ¡Libertad a todxs lxs presxs políticxs chilenxs y
mapuches!8
7 La barre oblique est utilisée pour séparer les morphèmes de genre dans les articles (un/
a)9 et les adjectifs démonstratifs (ese/a)10. Ces déterminants modifient les substantifs
pour lesquels ce n’est pas la barre oblique qui vient remplacer le morphème de genre
mais le x, comme dans Escrito por un/a an ónimx11. Dans d’autres cas, le masculin
générique12 est maintenu pour l’article défini et l’adjectif, à côté de la barre oblique
pour le nom, par exemple Los propios afectados/as13 ou bien les articles sont dédoublés,
comme dans Las y los oprimidos/as14.
8 Le e et le signe = ne sont pas utilisés dans les publications que j’ai étudiées, mais on les
trouve dans certains textes anarchistes circulant en Espagne. J’ai donc analysé leur
GLAD!, 04 | 2018
212
utilisation par le collectif Pirexia, de Séville. Pirexia indique que son choix de –e et de –
es pour remplacer les morphèmes normatifs binaires est une façon de créer un
« quatrième genre grammatical » (les deux premiers étant le féminin et le masculin, et
le troisième le masculin générique). Le collectif préfère cette possibilité en raison de sa
facilité de prononciation, comme dans les compañeres anarquistes15. En parallèle, illes
expliquent l’utilisation d’autres morphèmes tels que ceux dont j’ai déjà parlé, et
ajoutent que l’usage du = exprime l’égalité souhaitée, comme dans l=s trabajador=s aquí
reunid=s…16.
EC : Quels liens as-tu observés entre l’utilisation de ces morphèmes par les collectifsanarchistes et par des groupes d’autres régions du monde pouvant également avoir cettepratique linguistique ?
9 MA : Aux États-Unis, l’année 2015 a vu ces derniers mois s’intensifier le débat entre
étudiant·e·s et universitaires sur les réseaux sociaux et dans des articles publiés sur
différents blogs17 : l’enjeu est de déterminer si l’utilisation de x est correcte, s’il faut
adopter latinx18, etc. Plusieurs points de vue s’affrontent ; certain·es soutiennent l’usage
du x tandis que d’autres y sont réticent·e·s, car il·elle·s estiment notamment que cela
porte atteinte à la structure de la langue et que le masculin générique est suffisant. Ce
débat pointe une évidence : les immigré·e·s et les générations qui sont nées et ont
grandi ici continuent de parler espagnol, la langue qui leur sert de lien avec leur pays
d’origine. Il exprime également la diversité des positions et des doctrines linguistiques
des hispanophones.
10 Si l’on définit le transnationalisme comme le processus d’émigration et de maintien des
liens sociaux et économiques avec le pays d’origine, le fait que la communauté
linguistique hispanophone de la diaspora rejette ou adopte ce type de morphèmes de
genre inclusif reflète la mobilité et la portée de certaines idéologies linguistiques. Je
n’explore pas cela à fond dans mon mémoire, mais j’estime que le concept de
transnationalisme a toujours été présent dans la praxis anarchiste. À la fin du XIXe siècle
et au début du XXe siècle, il existait par exemple des réseaux internationaux entre
anarchistes de Cuba, de République dominicaine et de Puerto Rico, favorisés
notamment par la mobilisation internationale de penseur·e·s et la circulation de
publications anarchistes d’un pays à l’autre. Tout comme les anarchistes se déplaçaient
et s’installaient à l’étranger (ce qu’illes font encore de nos jours), l’information circulait
par le biais de revues entre l’Europe, l’Amérique latine et les Caraïbes, ce qui a
également contribué au développement et à la diffusion des idées anarchistes dans
diverses régions du monde.
11 J’ai constaté qu’il y a déjà eu de nombreux débats entre des collectifs féministes et LGBT
mainstream et des universitaires prescriptivistes. J’estime toutefois que l’analyse des
discours métapragmatiques d’anarchistes sur ces morphèmes, elle aussi, contribuerait
considérablement à alimenter la discussion. Notamment parce qu’il est nécessaire de
tenir compte de la position idéologique et de la pratique anarchiste pour comprendre
les différentes raisons motivant le recours à ces morphèmes. En outre, il faut mettre en
évidence et problématiser les contradictions au sein du mouvement anarchiste lui-
même (comme des comportements patriarcaux, le rejet de ces morphèmes, etc.). Je
pense donc que cette démarche apporterait de nouvelles perspectives aux débats sur ce
sujet.
GLAD!, 04 | 2018
213
EC : De nombreuses personnes ont le sentiment que l’usage du x et de l’@ est né au débutdes années 2010. Mais d’après ce que tu m’as indiqué, ces deux morphèmes sont bien plusanciens. Peux-tu nous en dire plus ?
12 MA : Bien sûr ! Il me semble que cette impression est due au fait de leur utilisation sur
les réseaux sociaux et dans d’autres espaces de communication informelle, ainsi qu’à
leur association au type de langage que nous utilisons en ligne. Toutefois, comme le
rappelle la linguiste Mercedes Bengoechea (2009), l’@ en tant que substitut aux
morphèmes normatifs caractérisant le genre a commencé à être utilisée en Espagne
dans les années 1970 dans des textes de groupes de gauche radicale et dans des revues
alternatives comme Ajoblanco. J’ignore qui a lancé le x pour neutraliser les genres
grammaticaux, mais d’après une autre étude de Bengochea (2015 : 14), dans laquelle
elle s’intéresse spécifiquement à la communauté intersexe, cet usage est né dans les
collectifs LGBTQIA.
EC : Comme tu le sais, j’ai été chargé de rédiger la deuxième édition du manuel de langueinclusive pour le gouvernement péruvien (MIMP [Ministère des femmes et des populationsvulnérables], 2013). C’était à la mi-2013, et je connaissais déjà le x. Pourtant, je n’ai paspensé à proposer des morphèmes de genre inclusif car mes employeurs me demandaientde m’en tenir aux règles de la RAE, l’Académie royale espagnole. Mais comme on le sait, laRAE est réticente à ce type de pratiques, et je me suis donc retrouvé dans une situationdélicate. Je sais bien qu’une publication de l’État n’a pas grand-chose à voir avec unebrochure anarchiste, mais il n’en reste pas moins que de nombreux thèmes se recoupent.Que penses-tu des politiques féministes en matière de langue (Pauwels 2003) prescritespar une autorité (top down), à la lumière des résultats de tes recherches ?
13 MA : J’ai été confrontée à un conflit de ce type, car j’évolue moi aussi au sein des
institutions d’État et de leurs normes. Mais dans mon cas, le dilemme est plus
idéologique que pratique, car je n’ai pas été engagée pour réaliser de guide linguistique.
Je souhaite (de manière utopique, si l’on veut) que les morphèmes non normatifs se
banalisent et que nous les utilisions comme bon nous semble, mais ça ne m’empêche
pas de me réjouir d’initiatives libérales top down telles que la féminisation de la langue
proposée par Pauwels. Certes, ces initiatives s’inscrivent dans le système de normes
grammaticales, mais elles sont tout de même subversives. Par contre, ce qui me déplaît
dans les discours et les aspirations de ces politiques et initiatives féministes, c’est
qu’elles portent uniquement sur l’inclusion des points de vue et des expériences des
femmes, et qu’elles sont axées sur une volonté de représentation égalitaire des hommes
et des femmes dans la langue. Elles ne tiennent pas compte d’autres identités
opprimées — en effet, l’hétéropatriarcat et son incarnation dans le sexisme linguistique
ne concernent pas que les femmes.
EC : Il semble que tu n’aies pas rencontré de cas d’usage générique du féminin, comme« toutes les avocates » pour renvoyer à tous les genres. C’est bien ça ?
14 MA : Tout à fait. Je n’ai jamais vu d’usage du féminin générique dans les revues que j’ai
analysées, pas plus que dans des articles sur ce thème rédigés par des collectifs ou des
individus anarchistes. Il se peut que j’en trouve dans mes recherches à venir, car ces
revues et fanzines19 publient des textes d’auteurs/autrices ne faisant pas forcément
partie du collectif qui les gère ; l’usage de ces morphèmes dépend donc du/de la
rédacteur·rice.
GLAD!, 04 | 2018
214
EC : Dans l’un des premiers chapitres, tu indiques que les « politiques de préfiguration »sont partie prenante de l’éthique anarchiste. Pourrais-tu développer ce point ?
15 MA : Nous — anarchistes et collectifs ou individus ayant des positions politiques
radicales — cherchons à transformer la société, ou plutôt à en créer une nouvelle, par le
biais d’actions et de modes d’organisation défiant les normes établies. La politique
préfigurative est sous-tendue par l’idée que les actes d’aujourd’hui façonnent ou
représentent le type de société égalitaire que nous appelons de nos vœux. Par
conséquent, nous ne reportons pas nos désirs à un futur incertain et utopique. La
résistance anarchiste ne se définit pas essentiellement par ses objectifs, mais par le
processus de mise en œuvre des changements qu’elle souhaite voir advenir.
16 Par conséquent, cette modification de la langue à des fins politiques incarne en partie
cette politique de préfiguration. Au sein du mouvement anarchiste, l’opposition aux
structures de domination sociale, telles que l’hétéronormativité et le patriarcat, s’est
élargie à la langue et implique de défier les normes reflétées dans la langue canonique.
Nous modifions la langue pour exprimer l’égalité que nous désirons, tout en œuvrant à
changer les conditions matérielles des personnes LGBTQIA (lesbiennes, gays,
bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et asexuelles) et à faire cesser les oppressions
qu’elles subissent.
EC : Dans tes recherches, tu parles de planification linguistique, ainsi que d’anarchie et deremise en cause des forces sociales dominantes. La planification et l’anarchisme n’enviennent-ils pas à se contredire, dans le domaine des propositions de morphèmes de genreinclusif ?
17 MA : Bien souvent, l’anarchie — peut-être en raison de l’étymologie du terme — est
assimilée au désordre, et l’anarchisme est considéré comme une philosophie politique
et une pratique promouvant les débordements en tout genre. Mais c’est tout le
contraire. L’anarchisme propose l’association et l’organisation de personnes, de
groupes et de sociétés en l’absence d’un pouvoir centralisé, au niveau micro (groupes
affinitaires, militant·e·s, comités, etc.) et macro (société complète). À petite échelle, par
exemple, nous pouvons nous organiser en collectif de camarades et d’ami·e·s autour
d’un potager urbain, où rien n’appartient à personne et où nous travaillons tou·te·s
ensemble à construire le lieu et à l’entretenir. À plus grande échelle, j’aime citer
l’exemple de l’Espagne de 1936, celle de la Guerre civile. Des terres, des usines et des
industries furent expropriées ; pendant sept mois, selon un modèle autogéré
d’organisation sociale et politique mis en place par des communistes libertaires et des
communistes autoritaires, les industries manufacturières, l’agriculture, les transports,
etc. furent collectivisés et gérés par des syndicats anarchistes et socialistes.
18 Organiser des personnes, des groupes et des espaces anarchistes implique une forme de
planification par les personnes composant ce groupe, ainsi que la participation de
tou·te·s aux processus de prise de décision en assemblée, dans des dynamiques
horizontales et décentralisées. Il ne doit pas y avoir de hiérarchie (c’est-à-dire de chef),
mais des facilitateur·rice·s ou des modérateur·rice·s guidant les réunions, la prise de
décisions, etc. Ainsi, lorsque je parle d’initiatives de planification de la langue par des
anarchistes, je pars du principe que s’organiser peut aussi consister à produire
volontairement des transgressions linguistiques, qui reflètent les idéologies politiques
de celleux qui les utilisent et les promeuvent.
19 J’aimerais souligner un autre point important, qui permet de mieux comprendre leur
différence vis-à-vis des stratégies de planification linguistique normative par des
GLAD!, 04 | 2018
215
secteurs dominants de la société : toutes les explications que j’ai lues sur les usages de
morphèmes neutres font état de leur caractère non contraignant. Il ne s’agit pas
d’obliger qui que ce soit à les adopter, pas plus que de privilégier telle ou telle solution,
mais de présenter plusieurs idées permettant d’exprimer des identités de genre non
binaires.
EC : Dans ton mémoire, tu parles de l’usage du k et du $ parmi d’autres pratiques detransgression linguistique. Quelle valeur revêtent ces symboles dans les publications quetu as analysées ? Ce type d’innovations orthographiques est-il courant dans les textesanarchistes ? D’autres communautés de pratique y ont-elles recours ?
20 MA : Pour moi, des lettres comme le k et des symboles comme le $, utilisés depuis
quelque temps déjà, ajoutent de l’intensité à la transgression représentée par les autres
symboles et lettres utilisés pour remplacer les morphèmes de genre binaires (a et o).
Le k vient remplacer le c dans les cas où il a une valeur de consonne occlusive vélaire (/
k/), surtout en début de mot, par exemple kultura, koncierto ou kolectivo20. Tout comme
le k, le signe $, également utilisé dans ces publications, ne fait toutefois pas partie des
signes et symboles utilisés pour remplacer les morphèmes de genre binaires. Son usage
représente la critique anarchiste du capitalisme et du néolibéralisme. Il est également
utilisé pour représenter des noms de pays (U$A, Libertad a lxs compañerxs en $hile21…)
21 Ces innovations orthographiques sont courantes dans les publications anarchistes
(revues mais aussi flyers, manifestes, graffitis, fanzines et diverses publications
autogérées à faible tirage). Dans les textes que j’ai analysés, leur usage n’est toutefois
pas régulier ; on peut les observer à l’occasion dans tel ou tel article, en fonction de
l’auteur/autrice, mais globalement, elles ne sont pas très fréquentes. Bien sûr, ces
innovations ne sont pas utilisées exclusivement par des anarchistes ou d’autres
mouvements de gauche. Le « k punk », par exemple, est très courant dans les fanzines
de musique, d’écrits personnels (comme des poèmes) ou traitant de thèmes radicaux
pas forcément anarchistes.
EC : J’ai été particulièrement intéressé par ta présentation des concepts de constructiond’identités négatives et positives (Bucholtz, 1999) et de « moments d’identification »(Omoniyi, 2006). Peux-tu nous en dire davantage sur ces concepts et sur la manière dont ilst’ont aidée à mettre en ordre tes observations sur ces publications anarchistes ?
22 MA : Lorsque je compilais les données et les exemples de genre neutre utilisés dans ces
publications, j’ai eu du mal à trouver des cadres théoriques appropriés et pertinents
pour expliquer ces innovations dans la langue écrite, notamment en raison de la
nouveauté du sujet, de l’apparente inconsistance de leur usage dans un même texte ou
une même publication et des contextes particuliers dans lesquels elles sont utilisées.
23 En explorant plusieurs cadres théoriques relatifs à l’identité et au positionnement
identitaire, je suis tombée sur les concepts de construction d’identités de type négatif
et de type positif élaborés par Bucholtz, que j’ai empruntés pour mon mémoire. Ces
concepts expliquent le processus de positionnement de l’identité et la façon dont celle-
ci surgit dans l’interaction en situation spécifique, particulièrement lorsqu’il s’agit
d’essayer de créer une cohésion de groupe (par opposition à une séparation).
24 D’après cette linguiste, c’est à travers les pratiques d’identité positive que les individus
construisent de manière active une identité choisie. Ces pratiques définissent ce que
sont et qui sont les usager·e·s (de la langue et des pratiques non linguistiques
définissant cette identité), et mettent l’accent sur la cohésion du groupe. L’usage de ces
morphèmes pour élaborer des référents non binaires permet aux anarchistes de
GLAD!, 04 | 2018
216
construire des identités contre-hégémoniques par le biais desquelles il·elle·s peuvent se
référer à eux/elles-mêmes de manière positive, ou exprimer leur solidarité ou leurs
affinités avec les sujets de la phrase, par exemple nosotrxs, amigxs22 et d’autres
formulations de ce type déjà mentionnées. Ce processus représente la catégorie de
pratiques d’identité positive.
25 Par le biais des pratiques d’identité négative, les individus prennent leurs distances vis-
à-vis d’une identité rejetée. Cette position d’opposition a lieu lorsque, dans le discours
écrit, les anarchistes associent les manières normatives de marquer le genre
grammatical à des entités ennemies (particulièrement celles qui représentent des
institutions autoritaires ou l’État, comme la police et les chefs). Dans de nombreux
articles, j’ai rencontré dans une même phrase ces morphèmes appliqués à des
substantifs renvoyant à l’auteur/autrice du texte ou à d’autres anarchistes, tandis qu’en
parallèle on pouvait également voir el abogado, el policía, los jueces, los carabineros23, c’est-
à-dire le masculin générique, comme dans la phrase Todxs llevamos un policía dentro.
Acábalo!24
26 Le fragment de phrase todxs llevamos… (incluant le.la lecteur·rice et le.la rédacteur·rice)
contraste avec un policía… Acábalo!; écrite au masculin, elle invite la·le lecteur·rice à
lutter contre ses idées oppressives intériorisées. Cela fait référence à la notion
foucaldienne de panoptique, d’après laquelle le système carcéral s’étend au-delà de
l’infrastructure et des murs des prisons : il est partout, et pousse les individus à
s’autoréguler ainsi qu’à se réguler entre eux.
27 Les pratiques d’identités négative et positive peuvent être mises en œuvre
simultanément dans un même texte, et ce contraste met en évidence leur fonction,
comme dans la phrase con ella [la capucha] me igualo a mis compañerxs mientras insultamos
a los esbirros del poder25 dans El Amanecer.
28 En parallèle, le concept de « moments d’identification » m’a également aidée à
contextualiser l’usage de ces morphèmes. Pour Omoniyi, ce concept désigne les
moments de la performance et de la perception (de soi) pendant lesquels les codes de
communication verbaux et non verbaux sont utilisés pour exprimer une image de soi.
Autrement dit, tandis que les processus de construction d’identités positives et
négatives font référence à la formation et à la présentation de l’identité ou des
identités, les moments d’identification renvoient au temps/moment où ces identités
sont créées, négociées, présentées. Les moments d’identification adviennent lorsque
sont utilisés les morphèmes transgressifs censés contrer l’usage du masculin normatif
et générique. On peut observer ce phénomène dans les exemples illustrant les pratiques
d’identité de type négatif. C’est une identité ambiguë ou non binaire qui présente la
perspective de la personne faisant référence à elle-même et s’oppose à la perspective
hégémonique.
29 Ces concepts m’ont aidée à comprendre certaines des fonctions que peuvent avoir ces
morphèmes, que l’on peut manquer à la première lecture. S’ils ne sont pas analysés
attentivement, ces usages peuvent être considérés comme manquant de rigueur et de
régularité, car ils varient au sein d’une même phrase.
EC : Tes découvertes sur les morphèmes de genre inclusif et d’autres propositionsorthographiques s’inscrivent dans un champ d’études relativement novateur et très richequi étudie les usages orthographiques en tant que pratiques sociales (Sebba 2007).L’usage du k pour le phonème/k/a également été observé au sein de mouvementspolitiques indépendantistes (Thomas 2007) et indigénistes dans différentes régions et à
GLAD!, 04 | 2018
217
différents moments. Justement, en ce qui concerne l’assignation de (nouvelles) valeurssociales aux morphèmes et aux signes orthographiques, je m’interroge sur l’usage dumasculin générique dans ces fanzines, dont la valeur est assez différente de celle despublications mainstream. Pourrais-tu nous en dire plus sur cette différence et la valeur del’usage du masculin générique et des morphèmes de genre inclusifs ?
30 MA : Cet usage du masculin dans les publications que j’ai analysées me semble
également très intéressant. Le masculin générique souligne la valeur négative conférée
au référent qui incarne ou représente des entités ennemies, dont il faut se démarquer.
L’anarchisme en tant qu’idéologie est intrinsèquement incompatible avec
l’autoritarisme et la centralisation du pouvoir que représentent l’État et les entités
composant son bras idéologique (église, école, université, etc.) et son bras répressif
(police, armée, etc.). Les exemples suivants sont parlants :
…ni nosotrxs mismxs entendemos… no podemos ni guardaremos silencio porNelson Vildósola, el joven de 19 años asesinado en manos de Carabineros trasun « confuso » incidente…26
los jueces que obedecen a un represivo sistema carcelario y a los verdaderosasesinos…27
31 Dans ces phrases, le masculin représente le système normatif et oppressif auquel sont
opposé·e·s les anarchistes, et réaffirme leur opposition aux entités représentant le
système contre lequel il·elle·s luttent. Je pense que cela indique également que les
morphèmes inclusifs ne sont pas de simples manipulations pénibles de la langue : on
voit mieux l’importance de ces transgressions linguistiques, leur fondement et leur
ambition politique.
EC : Les anarchistes de ton étude souhaitent-illes que les morphèmes de genre inclusifsoient adoptés par la majorité de la population ? Veulent-illes que ce type de propositionslinguistiques féministes se pérennise ?
32 MA : Je n’ai pas l’impression qu’il·elle·s aimeraient que ces propositions soient adoptées
à grande échelle. Ce qui me fait dire cela, c’est le concept d’identités négatives, qu’illes
utilisent pour se démarquer d’entités hégémoniques (ellos allá y nosotrxs aquí28). Il se
peut que je sois dans l’erreur ; tu pourras me reposer la question une fois que j’aurai
réalisé la partie ethnographique de ce travail et interrogé des personnes qui me
permettront de déterminer plus précisément à qui sont adressés ces textes et qui est
intéressé par l’usage de ces morphèmes inclusifs.
33 Il me semble qu’une étude ethnographique pourrait également permettre de répondre
à ta deuxième question, bien que j’ose avancer que, si nous nous basons sur la politique
de préfiguration des anarchistes, il se peut que leur intention soit en réalité de faire
perdurer ce type de propositions ou, du moins, de les voir se transformer au fil des
besoins linguistiques en matière d’auto-référence et de référence à autrui.
EC : D’après mon expérience, l’objection principale aux morphèmes inclusifs tels que x et @consiste à dire qu’ils ne fonctionnent pas à l’oral. Qu’en penses-tu ? Selon toi, quepourraient répondre à cela les auteurs/autrices des publications que tu as étudiées ?
34 MA : J’ai moi aussi entendu ce type d’arguments contre l’@ et le x. Outre la surprise que
peut provoquer l’orthographe, on peut en effet se heurter à des difficultés de
prononciation. Mais de la même façon qu’ont été créés ces morphèmes, on pourrait
créer des façons de les prononcer.
35 Certaines personnes proposent que l’@ se prononce [oa], par exemple compañeroas.
D’autres préfèrent le prononcer comme le féminin a, [a]. En ce qui concerne le x, j’avoue
GLAD!, 04 | 2018
218
que je ne sais pas du tout quelle prononciation suggéreraient les auteurs/autrices, mais
des collectifs ont fait des propositions. Par exemple, pour le terme latinx, dont toi et
moi avons discuté et à propos duquel nous avons échangé des articles, on peut trouver
des entretiens et des vidéos qui expliquent sa signification et proposent de le
prononcer « latin-ex ».
36 D’après la romancière et poète étasunienne d’origine mexicaine Ana Castillo, qui a créé
le terme xicanisma ou féminisme chicano, les langues nahuatl et mayas ne sont pas
genrées comme l’est l’espagnol, ce qui aurait influencé l’usage de ce type de
morphèmes de genre neutre par des activistes latinxs et chicanxs.
37 À cet égard, je dois remercier Summer Abbot, doctorante en études américaines à
l’université du Nouveau-Mexique, que j’ai rencontrée l’année dernière à la conférence
Anarchism and the Body à l’université Purdue et qui m’a parlé du mémoire de maîtrise
d’Omar Ramírez. Dans ce mémoire, Ramírez discute de certaines des possibilités de
prononciation du x comme dans xicanx, où le x initial et le x final correspondent à la
consonne fricative palato-alvéolaire sourde [ʃ], basée sur la valeur phonétique du x en
nahuatl. Cela se prononce donc « shi‑kan‑sh ». Dans chicanx, prononcé « tchi-kan-ex »,
le x de la fin du mot se prononce [ks] comme dans latinx.
38 Ces exemples sont passionnants, car ils soulignent également l’intersection de la race/
ethnicité avec l’identité de genre. Ainsi, dans certains contextes, l’usage du x
représente une forme de décolonisation de la langue.
BIBLIOGRAPHIE
EC : C’est très intéressant ! La valeur de ces nouveaux morphèmes peut tellement changer selon
les lieux et les personnes qu’il est impossible de parler de « la langue » tout court ou du « système
linguistique » ; nous sommes obligé·e·s de prêter attention aux locuteur·rice·s, à leurs luttes et à
leurs pratiques dans des contextes donnés. Un immense merci d’avoir pris de ton temps pour ce
précieux échange d’idées, Mariel.
BENGOECHEA, Mercedes (éd.). 2009. « Efectos de las políticas lingüísticas antisexistas y la
feminización del lenguaje. Año 2006- 2009 ». Alcalá : Instituto de la Mujer. Université d’Alcalá de
Henares. Consulté le 10 octobre 2016. <http://www.inmujer.gob.es/fr/areasTematicas/estudios/
estudioslinea2010/docs/efectosPoliticasLinguistas.pdf>
BENGOECHEA, Mercedes. 2015. « Cuerpos hablados, cuerpos negados y el fascinante devenir del
género gramatical » Bulletin of Hispanic Studies, 92(1) : 1-23.
BUCHOLTZ, Mary. 1999. « ‘Why be Normal?’: Language and Identity Practices in a Community of
Nerd Girls » Language and Society, 28 : 203-223.
CASTILLO, Ana. 1994. Massacre of the Dreamers: Essays on Xicanisma. Alburquerque : University of
New Mexico Press.
GLAD!, 04 | 2018
219
Grupo Anarquista Pirexia. 2011. « Nota al uso del lenguaje ». Aspectos básicos sobre federalismo
anarquista. Organizándonos en libertⒶd. 32-41. Consulté le 10 octobre 2016. <http://
www.mundolibertario.org/pirexia/?page_id=304>
OMONIYI, Tope. 2006. « Hierarchy of Identities », in The Sociolinguistics of Identity. OMONIYI, Tope
& WHITE, Goodwith (éd.). Londres : Continuum, 11-33.
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú [MIMP]. 2013. Si no me nombras, no
existo. Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Lima. 10 octobre 2016. <https://www.mininter.gob.pe/
pdfs/Guia_Uso_Lenguaje_Inclusivo.pdf>
PAUWELS, Anne. 2003. « Linguistic Feminism and Feminist Linguistic Activism », in Handbook of
Language and Gender, HOLMES, Anne & MEYERHOFF, Miriam (éd). Malden MA : Blackwell, 550-570.
RAMÍREZ, Omar. 2008. « Black Flag, Red Heart: A Study of Chicana and Chicano Anarchy ».
Mémoire de maîtrise. Chicana/o Studies Department : CSU Northridge.
SEBBA, Mark. 2007. Spelling and society: The culture and politics of orthography around the world.
Cambridge : Cambridge University Press.
THOMAS, Megan C. Octobre 2007. « K Is for De-Kolonization: Anti-Colonial Nationalism and
Orthographic Reform » Comparative Studies in Society and History, 49(4) : 938-967.
ANNEXES
Sources primaires
« Libertad a los compañer@s pres@s » Collectif El Amanecer. 14 juin 2012. Consulté le
10 octobre 2016. <https://periodicoelamanecer.wordpress.com/2012/06/14/afiche-
solidario-con-carla-verdugo-e-ivan-silva-companers-rehenes-del-estado/>
« Couverture » Federación Obrera Regional Argentina. Organización Obrera, 10.33,
2011.
« Todxs llevamos un policía dentro. Acábalo! » Grupo Acción Directa. Acción Directa,
1.1, 2011.
« BAGUA: Libertad a los presos del 5 de junio », Acción Directa, 3.5, 2013.
NOTES
1. Subversions linguistiques de l’espagnol : @, x et e en tant que morphèmes de genre inclusif et
autres ressources stylistiques dans des publications anarchistes contemporaines
2. En espagnol, le o marque le masculin et le a le féminin – il existe toutefois des termes épicènes
se terminant par a (anarquista, idiota, etc.). Sauf spécifié autrement, toutes les notes sont de la
traductrice.
3. Est cité dans cet article : « Libertad a los compañer@s pres@s » Collectif El Amanecer. 14 juin
2012. https://periodicoelamanecer.wordpress.com/2012/06/14/afiche-solidario-con-carla-
verdugo-e-ivan-silva-companers-rehenes-del-estado/. Consulté le 10 octobre 2016.
4. Sont cités dans cet article : « Todxs llevamos un policía dentro. Acábalo! », Grupo Acción
Directa, 1.1, 2011 et « BAGUA: Libertad a los presos del 5 de junio », Grupo Acción Directa, 3.5,
2013.
GLAD!, 04 | 2018
220
5. Est cité dans cet article : « Couverture », Federación Obrera Regional Argentina. Organización
Obrera, 10.33, 2011.
6. Les formes distinctes du masculin et du féminin seraient : los / las rebeldes... solos / solas. On
peut traduire : « Les rebelles se retrouvant seul·e·s » ou « seul@s ».
7. Les formes distinctes du masculin et du féminin seraient : los / las jamaicanos / jamaicanas.
En français, on pourrait traduire par : « Les Jamaïcain·e·s émigrent aux États-Unis ».
8. Si l’on voulait marquer les deux genres distinctement, cela serait : Libertad a todos los presos
politicos chilenas y mapuches / todas las presas politicas chilenas y mapuches. En français, on
peut proposer : « Liberté pour toux les prisonnixs politiques chilixs et mapuches ».
9. « un/e »
10. « ce/tte »
11. « Rédigé par un/e anonym·e »
12. L’auteure parle de masculino epiceno au sens d’un masculin grammatical utilisé
sémantiquement comme un générique. Nous traduisons ici systématiquement par masculin
générique. En espagnol, il peut arriver que ces termes syntaxiquement masculins soient
morphologiquement marqués par un suffixe habituellement féminin, comme los anarquistas (en
français, « un squelette » s’approche de ce type de cas).
13. « Les[MASC] concerné/e/s eux-mêmes »
14. « Les[FEM] et les[MASC] opprimés/ées »
15. Une utilisation standard du genre serait la suivante : los compañer os / las compañer as
anarquistas. Ici, le –a de anarquista est un morphème épicène (voir note 9) et aurait d’ailleurs pu
être laissé tel quel en espagnol. En français, les termes « camarades » et « anarchistes » sont tous
deux épicènes, mais on pourrait imaginer « les étudiantis contentis » pour « les étudiantes
contentes / les étudiants contents ».
16. « Les travailleu=s ici réuni=s »
17. Pour une illustration de ces débats, voir « The case against ‘Latinx’« Los Angeles Times :
http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-hernandez-the-case-against-latinx-20171217-
story.html, « Why People Are Using The Term ‘Latinx’« Huffington Post : https://
www.huffingtonpost.com/entry/why-people-are-using-the-term-
latinx_us_57753328e4b0cc0fa136a159, ou encore cet article du Merriam-Webster sur le sujet :
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/word-history-latinx.
18. À la place de latino et / ou latina.
19. NdA : Les fanzines ou zines sont des textes écrits et publiés de manière autogérée.
Généralement rédigés à la main, à la machine à écrire ou à l’ordinateur, ils comportent souvent
des collages, des découpages et des dessins. Ce sont des publications à faible tirage, que l’on peut
se procurer directement auprès de l’auteur / autrice ou de distros (collectifs ou individus qui
diffusent des textes, de la musique, des t-shirts, des badges, etc. généralement lors de concerts,
de foires aux livres anarchistes et d’autres types d’événements).
20. « kulture », « koncert », « kollectif ». Ces termes, ainsi orthographiés, sont aussi en usage en
français.
21. « Liberté pour lxs camaradxs du $hili »
22. « nou·e·s », « amixs »
23. « l’avocat[MASC] », « le policier », « les juges[MASC] », « les carabiniers »
24. « Nou·e·s avons toux un policier en nous. Tuons-le ! »
25. « avec elle [la capuche] je suis sur un pied d’égalité avec mes amixs pendant que nous
insultons les chiens de garde du pouvoir »
26. Littéralement : « noues-mêmes ne comprenons pas… nous ne nous tairons pas au sujet de
Nelson Vildósola, le jeune de 19 ans assassiné par les Carabiniers après un incident “confus” »
27. « Les juges[MASC] qui obéissent à un système carcéral répressif et aux véritables assassins… »
28. « eux là-bas et noues ici »
GLAD!, 04 | 2018
221
RÉSUMÉS
Ernesto Cuba interviewe Mariel Acosta au sujet des résultats de son mémoire de master, qui
traite des propositions de morphèmes de genre inclusif dans des publications anarchistes de
langue espagnole, parmi lesquelles le @, le x et d’autres innovations orthographiques cherchant à
contrecarrer le biais androcentré de la langue.
Ernesto Cuba interviews Mariel Acosta about the findings in her master’s thesis, which
investigates inclusive gender morphemes in Spanish-language anarchist publications, among
which is the use of @, x and other orthographic innovations that seek to challenge the
androcentric bias of language.
INDEX
Thèmes : Explorations
Mots-clés : langue non sexiste, anarchisme, orthographe, sociolinguistique, genre et langage,
espagnol
Keywords : non-sexist language, anarchism, orthography, sociolinguistics, Gender and Language
studies, Spanish
AUTEURS
MARIEL ACOSTA
Mariel Acosta est née à Saint-Domingue, en République dominicaine, et s’est installée aux États-
Unis pour ses études universitaires. Elle a suivi un cursus de premier cycle en anthropologie avec
une majeure en anthropologie linguistique au Hunter College (CUNY), où elle a également obtenu
un diplôme de traduction et d’interprétation. Elle a ensuite fait une maîtrise d’espagnol au City
College (CUNY). Parmi ses centres d’intérêts et thèmes de recherche se trouvent notamment les
questions genre et langage, les idéologies linguistiques, les politiques anarchistes et l’histoire de
l’anarchisme en Amérique latine. Dans le cadre de conférences et d’ateliers, elle a récemment
présenté les premiers résultats de son enquête sur les origines de l’anarchisme en République
dominicaine, ainsi que sa recherche sur les morphèmes de genre inclusifs et d’autres
transgressions linguistiques dans des textes anarchistes contemporains d’Amérique latine.
ERNESTO CUBA
Ernesto Cuba est étudiant en troisième année de doctorat de linguistique hispanique du
Graduate Center de l’université de la ville de New York (CUNY). Il a suivi un cursus de
linguistique et d’études de genre à l’université pontificale catholique du Pérou. Ses recherches
portent sur le langage, le genre et la sexualité. Il a rédigé le guide de langue inclusive intitulé Guía
de Uso de Lenguaje Inclusivo. Si no me nombras, no existo(Manuel de langue inclusive. Si tu ne me nommes
pas, je n’existe pas) pour le gouvernement de son pays, le Pérou (2013). Il s’intéresse tout
particulièrement aux pratiques sociolinguistiques des communautés hispanophones queer, ainsi
qu’aux politiques linguistiques autour de l’espagnol et des langues indigènes péruviennes.
Ernesto est féministe et militant LGBT, et se dit linguiste féministe. Depuis son installation à New
GLAD!, 04 | 2018
222
York, il est engagé dans des collectifs et des réseaux activistes et universitaires de personnes
LGBT racisées.
GLAD!, 04 | 2018
223
Les genres décrits n°2Le genre exemplaire. Bestiaire des exemples et contre-exemples dugenre dans les grammaires
An Exemplary Gender. A Collection of Examples and Counterexamples of Gender
in Grammars
Julie Abbou
1 Qui a déjà tenté de décrire ou d’enseigner le genre s’est rapidement confronté.e à la
multiplicité de ses formes linguistiques. Aussi, pour bien se faire comprendre, une
grande quantité d’exemples est nécessaire. Vous l’avouerez volontiers si vous avez déjà
pratiqué l’exercice, trouver des exemples est un amusement savoureux1, qui, par-delà
la justesse technique, nous entraine sur les pentes de nos imaginaires ― imaginaires de
linguistes peut-être davantage qu’imaginaires linguistiques ― rappelant ce jeu qui
consiste à répéter un incalculable nombre de fois un mot jusqu’à le vider de son sens et
ne garder en bouche que sa matière phonique pour la remâcher dans un plaisir infini.
2 Mais dans le jeu de la répétition, comme dans la chasse aux exemples, ce sont en
premier lieu les champs de mots qui nous sont disponibles qui se présentent à nous.
Une formation en linguistique, la dissection du signe, nous a appris à regarder ces mots
de façon dépassionnée, sur la table opératoire de la morphosyntaxe. Pourtant, malgré
le regard froid qu’exige la chirurgie linguistique, les sonorités qui nous amusent, les
mots qui nous surprennent, les hapax et autres jouissances sonores et graphiques,
reviennent nous hanter au moment de choisir l’exemple. Aux côtés de l’acuité
linguistique, de cette tentative d’isoler le signe pour le donner en pâture à l’illustration,
nos univers, nos imaginaires débordent toujours un peu et viennent colorer nos textes.
Ce sont ces imaginaires de l’exemple que je voudrais mettre au travail dans cette
chronique en deux volets, l’un consacré aux grammaires traditionnelles, l’autre aux
travaux de linguistique féministe.
3 Pour ce premier volet, je me concentrerai donc sur les exemples que l’on trouve dans
les grammaires traditionnelles. Ils offrent un paysage souvent un peu rude du genre,
avec lequel on me permettra de jouer un peu, à la façon de l’Oulipo, pour faire
apparaitre l’imaginaire du genre, et au-delà, qui traverse les grammaires. Bien sûr, cela
reste un exercice ludique, et on serait parfois bien en peine de trouver des contre-
GLAD!, 04 | 2018
225
exemples, mais visitons tout de même ces galeries de personnages saugrenus que font
s’animer les grammaires lorsqu’il s’agit du genre.
4 Il y a tout d’abord les exemples du procureur : ceux qui accusent, par leur misogynie
crasse, ou leur défiance à l’égard du genre. On relèvera dans cette catégorie la
Grammaire méthodique du français, qui non seulement déçoit par son manque de poésie,
mais surtout qu’on ne pouvait manquer de citer dans ce numéro sur les antiféminismes,
avec son premier exemple :
hommes libertins, femmes vertueuses
5 Plus subtile, La grammaire d’aujourd’hui ouvre sa section « genre » par :
De ces études sur le genre, aucune n’est intéressante
6 On ose espérer (et c’est d’ailleurs le plus probable) qu’en 1986, au moment de la
publication de la grammaire, les études ainsi accusées ne puissent être que pure
linguistique et sphères célestes, les études sur le genre étant probablement encore de
lointaines études sur les rapports sociaux de sexe, ou des gender studies.
7 On trouve un peu plus loin, dans la même grammaire, une section sur l’inconstance de
« l’homologie entre les deux classifications du sexe et du genre », illustrée par la
fatidique liste de laideron, souillon, tendron, louchon, bas-bleu que ne manque quasiment
aucune grammaire, et ses corolaires d’estafette, ordonnance, recrue, sentinelle, vigie. Aux
hommes le militaire, aux femmes l’apparence physique. Puis, poursuivant la liste, à
côté des insultes de type canaille, gouape, fripouille, apparaissent folle, tante et tapette.
Certes, ce n’est guère ici la faute des grammaires. Sauf qu’en y regardant de plus près,
les recrues un peu canailles n’ont aujourd’hui aucun mal à désigner des femmes, tandis
que le laideron désignera difficilement un homme et une tapette difficilement une
femme… Peut-être bien qu’il ne s’agit pas vraiment ici des mêmes phénomènes.
Malheureusement, la Grammaire d’aujourd’hui range tout cela ensemble, se justifiant
tout de même que ces derniers sont là « pour des raisons sexuelles évidentes ».
8 Plus récemment, le grammairien Jacques Poitou, qui consacre une longue page de son
site à la « Féminisation, “écriture inclusive”, etc. » (2018), relativement bien
documentée grammaticalement par ailleurs, relève dans ses préliminaires l’étymologie
de féminin (reprise à Alain Rey) :
féminin < latin femininus < femina = femme < indo-européen *dhē- = sucer,têter : la femme est donc celle qui allaite, qui est sucée ; de la même famillerelèvent felix (heureux), fellare (sucer), fecundus (fécond), etc.
9 Ma grande confiance en Alain Rey compensera mes absentes connaissances du latin et
de l’indo-européen, mais mes modestes connaissances dans ces (inintéressantes) études
de genre me permettent de me questionner sur l’efficacité pédagogique — pour
expliquer l’écriture inclusive — d’un rapprochement entre la femme et l’action de
sucer…
10 On me dira que j’extrapole, et pourtant n’est-il pas tout aussi incongru de retrouver,
sur cette même page, dans la section consacrée à la « formation de termes représentant
des personnes de sexe féminin », une improbable sous-partie « personne, on, con »,
illustrée par un extrait de la chanson de Brassens Le Temps ne fait rien à l’affaire, hymne
anti-âgiste fataliste, scandant « quand on est con, on est con » ? Brassens, qui n’est
GLAD!, 04 | 2018
226
pourtant pas en reste quand il s’agit de grivoiser, ne parle pas ici pour une fois de sexe
féminin, et aurait sûrement été bien en peine d’écriture-inclusiver ses jeunes blancs-
becs [qui] prennent les vieux mecs pour des cons… Le corps et le sexe féminins
semblent donc bien nécessaires pour illustrer l’écriture inclusive, qui bientôt fournira
peut-être des points médians sous forme d’émoticônes…
11 Mais laissons de côté ces exemples un peu vulgaires et très misogynes, pour nous
intéresser aux exemples de la société civile. J’entends par là, les exemples du type :
une femme enfant, une grande fille très bien, une jupe marron, etc. (La Grammaire d’Aujourd’hui, formation des adjectifs)
12 Pouvez-vous vous empêcher désormais d’imaginer cette grande femme enfant, pleine
de retenue et de convenance, dans sa jupe marron (en laine, pour ma part) ?
13 Continuons avec la « liste des marques de l’opposition des genres des noms pour la
classe des animés ». Si la liste des oppositions de deux noms différents (type fille/garçon)
est une liste relativement restreinte, celle illustrant l’opposition de deux noms sur le
modèle de l’opposition des genres de l’adjectif nous donne un peu plus la saveur de
l’imaginaire grammairien :
Bourgeois, bourgeoiseEpoux, épouseMarchand, marchandeMarquis, marquiseBerger, bergère, Boulanger, boulangèreSultan, sultane, Paysan, paysanneVoisin, voisineJuif, juiveVeuf, veuve
14 Immédiatement s’offrent à nous des images de pastorales, où le paysan veuf, après sa
rude journée, rentre retrouver sa bergère juive, peut-être épouse de sultan, au grand
dam des voisins et voisines scandalisé.es, alors que dans les palais, marquis et
marquises s’encanaillent sur de coquins menuets et que les marchands et leur
bourgeoise, probablement tisserand.es, pourquoi pas, reviennent en charrette du
marché du bourg.
15 Mais voyons voir ce qui se passe en présence d’un suffixe pour le nom féminin :
Héros, heroineSpeaker, speakerineTzar, tzarine(voir aussi quelques prénoms : Jacques, Jacqueline, Michel, Micheline)
16 Bien sûr ! Micheline, épouse de Jacques, la speakerine de l’ORTF, a héroïquement bravé
le froid moscovite pour interviewer la tzarine héritière.
17 Passons au –esse pour qu’une magie toute cléricale nous enveloppe : la traitresse
chanoinesse enviait terriblement son hôtesse, l’abbesse négresse, qui, poétesse à ses
heures perdues, enchantait tout le monastère des ogresses, accompagnée de sa lyre.
18 Un saut dans le temps accompagne la section dédiée aux oppositions de la forme
masculine et de la forme féminine du même suffixe. Laissons donc de côté les
GLAD!, 04 | 2018
227
rarissimes enchanteresses et autres demanderesses, pour plonger dans les années 1990,
où sur fond d’attaché-case et d’images d’avion en contre-plongée, nous sommes
étourdies par des ingénieures administratrices qui, inquiètes de la visite de
l’inspectrice, ancienne exportatrice de puces électroniques, se sont reconverties en
conservatrices et promotrices d’art.
19 Et chez Grevisse ? La section du genre du nom (2009) nous donne en tout premier lieu
les « noms d’êtres animés [qui] sont, en général, du genre masculin quand ils désignent
des hommes ou des animaux mâles [et] du genre féminin quand ils désignent des
femmes ou des animaux femelles. » Passons sur le fait que c’est relativement faux
concernant les animaux (mais le Grevisse n’est-il pas le spécialiste de l’exception ?
Quelques assertions généralisantes sont bien nécessaires pour réaffirmer la force de
l’exception si française…) pour voir cette affirmation illustrée par :
Le père, un cerf (mais diable, pourquoi un cerf ?! Que ne ferait-on pas pour larime ?)La mère, une brebis (est-ce la peine de s’exclamer…)2
20 Mais il est encore plus savoureux de prendre tous ensemble les exemples de cette
section sur les cas particuliers (pas toujours si particuliers que ça, je le répète) :
Ami, amie, ours, ourse, têtu, têtue, aïeul, aïeule, marchand, marchande,parent, parente, intellectuel, intellectuelle, Gabriel, Gabrielle, chameau,chamelle, gardien, gardienne, baron, baronne, Lapon, Letton, Nippon, Simon,Lapone (ou Laponne, l’usage hésite), Lettone, Nippone et Simone ou SimonneOrphelin, orpheline, châtelain, châtelaine, gitan, gitane, Jean, Jeanne,paysan, paysanne, cadet, cadette, coquet, coquette, préfet, préfète, avocat,avocate, idiot, idiote, chat, chatte, linot, linotte, sot, sotte, berger, bergère,bourgeois, bourgeoise, époux, épouse, ambitieux, ambitieuse, andalou,andalouse, métis, vieux, roux, métisse, vieille, rousse, captif, captive, juif,juive, veuf, veuve3, Frédéric, Frédérique, Turc, Turque4
21 Pour rester à la mesure de la chronique, je ne devrais pas me lancer ici dans le récit
baroque et oulipien que contient en filigrane cette liste, et me contenter de laisser
lectrice et lecteur l’imaginer, mais je ne tiens pas : la baronne nipponne Gabrielle et sa
cadette rousse, la très intellectuelle Simon(n)e, toutes deux orphelines d’une châtelaine
qui fut préfète, menaient une vie d’épouses bourgeoises modèles. Leur gardienne
Frédérique, une bergère métisse lettone et gitane plutôt têtue et coquette, bien qu’un
peu sotte, qui tous les soirs, rentrait le troupeau de chamelles andalouses captives du
château était une ambitieuse qui rêvait de devenir avocate. Certes, avec Grevisse on
quitte un peu la pastorale, mais quel drôle d’univers…
22 Je passe sur les –esse (où l’on gagne, par rapport à la Grammaire d’aujourd’hui, ivrognesse
et druidesse entre autres), pour relever la surprenante illustration de la phrase
suivante : « Certains noms de personnes, terminés pour la plupart en –e, ont la même
forme pour les deux genres », illustrée par :
Un bel enfant, une charmante enfant
23 Ici, je ne sais plus si ce sont ces anachroniques charmantes enfants droit sorties des
images obtenues par 10 bons points qui me font frémir, ou bien la contradiction
flagrante entre la règle et l’exemple. Mais ce serait là le sujet d’une autre chronique.
GLAD!, 04 | 2018
228
Bon Point
24 Revenons à nos moutons (et nos brebis, mais aussi nos chèvres, vous allez voir), pour
certes ne rien apprendre sur le genre, mais apprécier ― for the sake of rhythm ―l’enchainement que je vous livre tel quel :
Une chèvre angora. Elle est demeurée capot. Une toilette chic. De la musique pop. Une chanteuse de rock.Une sculpture rococo. Une vareuse kaki. Elle est un peu snob.
25 Vraiment : une chèvre angora demeurée capot, dans sa toilette chic, dansait sur la
musique pop d’une chanteuse de rock. Mais ce n’était qu’une sculpture rococo, habillée
d’une vareuse kaki, qui lui donnait un air un peu snob ! Qui eût cru qu’une écriture
générique si exemplaire puisse générer tant de surréalisme délicieux ?5
26 Il y a toujours une poésie dans les exemples linguistiques (que savoure l’auteur de Poésie
du gérondif, d’ailleurs), et leur circulation nous imprègne. Ils deviennent des supports
ou des repoussoirs, tout un petit arsenal d’empirie.
BIBLIOGRAPHIE
Grammaire méthodique du français. 1994. Martin RIEGEL, Jean-Christophe PELLAT, René RIOUL. Paris :
PUF
La Grammaire d’aujourd’hui. 1986. Michel ARRIVÉ, Françoise GADET, Michel GALMICHE. Paris :
Flammarion
GLAD!, 04 | 2018
229
Le Petit Grevisse : Grammaire française. 2009 [32° édition]. Maurice GREVISSE, Marc LITS. Bruxelles : De
Boeck Duculot
MINAUDIER Jean-Pierre, DUBOIS Denis. 2014. Poésie du Gérondif. Vagabondages linguistiques. Paris : Le
Tripode.
POITOU Jacques. 2018. « Féminisation, “écriture inclusive”, etc. » http://j.poitou.free.fr/pro/html/
typ/feminisation.html, consulté le 23 mars 2018
NOTES
1. Exemple d’exemples, on pense au werewolf <loup-garou> de la linguiste féministe Deborah
Cameron : elle revient sur l’opposition (aujourd’hui disparue) du vieil anglais entre wereman /
wifman (<homme / femme>) pour souligner le sens générique de –man, par opposition à were- et
wif- qui marquaient le genre. Et elle relève au passage que le masculin were- ne subsiste
aujourd’hui que dans werewolf. C’est elle également qui nous offre : « Man is unique among the
apes because he grows a long beard, and it is to this that he owes his superior intelligence ». Au-
delà de la linguistique ou du genre, les nombreux exemples dans Le Mot d’esprit et sa relation à
l’inconscient de Freud restent savoureux.
2. Mon comparse de chronique me souffle qu’en application des recommandations de la Manif
pour Tous, il faut effectivement mentionner le droit pour tous les petit.es brefs et cerbis à avoir
un cerf et une brebis.
3. On retrouve là une série quasiment identique à celle de La Grammaire d’Aujourd’hui : bourgeois,
bourgeoise, époux, épouse, berger, bergère, juif, juive, veuf, veuve (voir plus haut).
4. Le Grevisse présente majoritairement des paires M F, ponctuées de séries M M M F F F, et
reproduites ici dans l’ordre où elles sont présentées dans l’original. On peut supposer que cela est
dû à la section « cas particuliers » dans laquelle sont présentés ces exemples, et que les séries ont
été jugées un peu moins particulières ?
5. Mais pouvait-on en attendre moins de la part d’une grammaire éditée chez Duculot, éditeur
qui par ailleurs, dans un catalogue très majoritairement consacré à la langue française, publie
l’incroyable Pourquoi les femmes des riches sont belles - Programmation génétique et compétition
sexuelle…
RÉSUMÉS
Cette chronique propose une déambulation parmi les exemples choisis par les grammaires
traditionnelles et/ou de référence pour illustrer le genre. Ces exemples offrent un paysage du
genre, avec lequel on jouera un peu, pour faire apparaitre l’imaginaire du genre, et au-delà, qui
traverse les grammaires.
This chronicle offers a journey through gender in traditional grammars. Different examples are
chosen to depict in a playful manner how the gender imaginary is circulated by grammars. These
examples draw the landscape of grammatical gender and allow us to playfully outline the
imaginary of gender circulated by grammars.
GLAD!, 04 | 2018
230
INDEX
Mots-clés : grammaire, genre, exemple, imaginaire de l’exemple
Thèmes : Chroniques
Keywords : grammar, gender, example, example imaginary
AUTEUR
JULIE ABBOU
Titulaire d’un doctorat de Sciences du Langage (Aix-Marseille Université) sur les modifications du
genre linguistique pour des motifs politiques, Julie Abbou mène des recherches sur les apports
théoriques réciproques des études de genre et des sciences du langage. Elle travaille également
sur les dimensions sémiotiques du genre grammatical, ainsi qu’en rhétorique sur le traitement
du genre dans différents types de discours. Récemment, elle a co-dirigé l’ouvrage Gender,
Language and the Periphery. Grammatical and social gender from the margins (John Benjamins) et
publié des articles dans des revues telles que Semen, Mots les langages du politique, Current issues in
Language Planning, etc.
GLAD!, 04 | 2018
231
Les genres récrits n° 3Au-delà de la binarité : le trouble entre les genres
Beyond Binarity: The Trouble Between Genders
Daniel Elmiger
1 En matière de genre(s), il n’est pas toujours simple de s’y retrouver : non seulement le
mot genre est très polysémique (et s’utilise tantôt comme un terme technique, tantôt
non, comme la plupart des mots en général…), mais il se rapporte aussi à des domaines
variés : la grammaire, l’identité personnelle ou sexuelle, etc.
2 Prenons les cas les plus fréquents qui touchent le domaine de cette chronique.
3 Le genre grammatical est une information qui est inhérente aux noms et qui se
retrouve, au niveau de la langue, dans les relations de congruence entre les noms et
d’autres mots susceptibles de varier en termes de genre : notamment les déterminants,
pronoms, adjectifs et participes. Pour ce qui est des êtres animés sexués, c’est-à-dire
certains animaux et les humains, on constate souvent une congruence entre formes
grammaticalement féminines ou masculines et l’identification genrée du référent, le
sexe (déterminé par autrui) ou l’identité de genre (de l’individu même). Ceci nous
amène à la deuxième acception importante : le genre est ainsi une manière de
s’identifier à une catégorisation – qui traditionnellement se divise en deux valeurs :
féminine et masculine.
4 (D’autres acceptions de genre, comme les genres musicaux, les genres textuels, etc. ne
nous intéressent pas, ici – mais elles ajoutent tout de même de la complexité au terme
genre.)
5 Aujourd’hui, on va parler des personnes qui ne se retrouvent pas dans l’une des
catégories préétablies, qu’il s’agisse d’une identité genrée (assignée à la naissance) ou
plus généralement d’une des deux valeurs d’une binarité, qu’il se traduise par des traits
physiques, des comportements sociaux ou… la bicatégorisation du langage.
6 Dans notre société, on assigne un sexe aux êtres humains à leur naissance. Pour une
majorité des gens, cette assignation ne semble pas poser problème, car il y a une
identification avec la catégorisation en filles/garçons : le jugement externe concorde
apparemment avec le sentiment interne de la personne même. (Mes collègues qui ont
GLAD!, 04 | 2018
232
relu une première version de la chronique m’ont fait remarquer que cette identification
est peut-être souvent liée au fait qu’elle n’est pas faite de manière consciente, voire
sujette à la pression hétéronormative et patriarcale. Elles n’ont pas tort ― mais qui
peut savoir dans quelle mesure ce type d’identification varierait, dans un monde sans
contraintes ?)
7 Pour un certain pourcentage de personnes (dont le taux est soumis à discussion), les
choses s’avèrent plus complexes : d’une part, l’assignation d’un sexe peut s’avérer
difficile, car les critères que l’on utilise en général pour déterminer un sexe
(l’apparence des organes génitaux, voire les chromosomes, les taux d’hormones) ne
donnent pas toujours un résultat très clair. Dans ce cas, on parle en général
d’intersexuation, qui peut être vécue très difficilement par les personnes entourant
l’enfant, car la pression sociale et médicale ― notamment, à la naissance ― d’être soit
mâle soit femelle est très grande.
8 D’autre part, l’identité de genre d’une personne, qui se construit au fil du temps et des
expériences vécues par l’enfant, puis l’adolescent·e et l’adulte, peut varier à travers le
temps ― et s’avérer notamment en contradiction avec une assignation effectuée à la
naissance : dans ce cas, on parle de différents types de transidentités , ou de personnes
trans*.
9 (Évidemment, il peut y avoir intersection entre transidentité et intersexuation ―comme avec bien d’autres traits et expériences.)
10 Comment tout cela se traduit-il au niveau du langage ? Ce n’est pas une affaire triviale,
car les mêmes formes langagières servent non seulement à parler (ou à faire référence
à) des personnes ayant des identités de genre plus ou moins marquées, plus ou moins
attachées à un système binaire de genres ― ou s’en détachant ―, mais il sert aussi à
parler de groupes de personnes plus ou moins hétérogènes (p. ex. mes voisins ― ou
voisin·e·s, voisinEs, etc.) ou de personnes non déterminées (p. ex. Si tes douleurs de dents
persistent, il faut aller chez le dentiste!). Traditionnellement, on trouve surtout des formes
masculines (à valeur générique) dans ces contextes, mais cette primauté du genre
masculin (qui « l’emporte », selon la formule bien connue…) a été remise en question,
ces derniers temps (selon le pays et la sensibilité personnelle, cette critique remonte à
quelques décennies ― ou à quelques mois).
11 La grammaire traditionnelle connait une dichotomie de genres (féminin et masculin)
qui se traduit tantôt par des formes distinctes (toutes/tous, grande/grand, femme/homme),
tantôt par des formes épicènes, donc formellement indistinctes (plusieurs, considérable,
élève). Dans un langage inclusif (ou : épicène, non sexiste), on peut privilégier ce type de
formes épicènes : qui ne préfère pas les jeunes bibliothécaires agiles aux vieux prêteurs de
livres maladroits ?…
12 Certaines propositions visent à en créer davantage, plus ou moins régulières ou
ludiques (cf. p. ex. Larivière 2000) :
professoraires ou professoristes ; professionnèles
13 Localement, on peut donc faire disparaitre la différence entre formes féminine et
masculine au profit d’un seul mot épicène. Mais que faire avec les pronoms, les
participes passés, les termes de parenté, où la bicatégorisation est particulièrement
prégnante ? Quelles formes utiliser s’il ne s’agit pas d’un lui ou d’une elle ― ou si la
personne en question ne veut ou ne peut pas se déterminer ?
GLAD!, 04 | 2018
233
14 Dans ces cas-là, les outils traditionnels de la langue ne sont guère utiles, mais plusieurs
solutions de substitution ont été suggérées récemment, par exemple1 :
chômeureuses, keufFEs (Abbou 2011 : 19)iel(s), yel(s), celleux, toustes (cf. Greco 2013 : 5)lecteurice, copaine, frœur (Lessard & Zaccour 2017 : 53)al(s) (< elle/il), çauz (< celles/ceux) (Alpheratz 2018, à paraitre)
15 Selon le positionnement individuel de l’auteur·e, ces formes complémentent d’autres
stratégies de rédaction non sexiste (ou inclusive) ― ou s’intègrent dans un projet de
dégenrisation complète de la langue.
16 Si l’on se tourne vers d’autres langues, on peut constater que d’autres types de
procédés formels de débinarisation ont été développés, p. ex. en allemand l’utilisation
de symboles tels que le tiret bas _ ou l’astérisque * (S_he 2003, Baumgartinger 2008) ―ou le choix de terminaisons comme -x ou -ecs2 ; les deux symbolisant un espace qui
s’ouvre (ou se réserve) à toute personne qui peut se situer entre les deux extrémités
d’un choix binaire ― ou s’y substituer complètement (cf. p. ex. AG Feministisch
Sprachhandeln der Humboldt-Universität zu Berlin 2015) :
Student_innen (étudiant_es)Student*innen (étudiant*es)Studierx, Studierecs (étudiantx, étudiantecs)
17 Afin d’augmenter le potentiel irritant de ces procédés pour le lectorat ― d’ailleurs un
effet qui, au lieu d’être évité, est plutôt recherché activement, par certains groupes
engagés ―, on peut voir que le tiret bas statique devient dynamique3 et se trouve ailleurs
qu’à la jointure morphologique entre la base et le suffixe, p. ex. :
Stu_dentinnen, Stud_entinnen, Studentin_nen
18 Ainsi, ce signe n’appuie plus forcément la formation du mot, mais il peut se trouver, en
principe, à n’importe quel endroit du mot, puisque son but n’est plus simplement de
séparer les terminaisons féminines et masculines. Ainsi, ces formes ont une charge
symbolique forte ― mais elles sont d’ailleurs aussi fortement critiquées, entre autres
par certaines féministes comme Luise F. Pusch, qui trouvent qu’elles détachent trop les
désinences féminines de la base des désignations, ce qui serait contraire à ce pour quoi
elles se sont battues depuis une quarantaine d’années. Dans une chronique du 4 mai
2014, elle écrit4 :
Ob Abtrennung durch Klammern, Schrägstrich, Bindestrich, Unterstrich oderGenderstern – Lehrer(in), Lehrer/in, Lehrer-in, Lehrer_in, Lehrer*in – für Frauenwird durch diese Mannipulationen nichts erreicht: Uns vermitteln dieseSchreibweisen, eine wie die andere, die Botschaft: Die Frau ist zweite Wahl. DemNormalgeschlecht gebührt der Wortstamm, dem abweichenden Geschlecht dieabgeleitete Form. Je weiter dabei das äußere Kennzeichen des Abgeleitetseins, diefeminine Endung, vom Wortstamm entfernt wird durch Zwischenschaltungweiterer, wenn auch gutgemeinter, Elemente - umso mehr wird der Status derweiblichen Zweitrangigkeit betont.« Que ce soit une séparation par des parenthèses, des barres obliques, un traitd’union, un tiret bas ou l’astérisque genré – Lehrer(in), Lehrer/in, Lehrer-in,Lehrer_in, Lehrer*in – rien n’est obtenu par cette mannipulation5 pour les femmes :ces graphies, l’une comme l’autre, nous véhiculent le message : la femme relève dudeuxième choix. La racine du mot incombe au genre normal, la forme dérivée au
GLAD!, 04 | 2018
234
genre déviant. Plus la marque extérieure de la dérivation, la désinence féminine, estséparée de la racine, par l’intercalation d’autres éléments, aussi bien intentionnés
soient-ils ― plus on accentue le statut de la secondarité féminine. »
19 Quant à la formulation concernant les personnes trans*, je ne vois pas de différence
fondamentale par rapport à une personne cis* (c’est-à-dire dont le genre ressenti est en
accord avec son sexe de naissance). Si un individu trans* revendique une identité
genrée, il me semble qu’il va de soi que nous allons parler avec (ou d’)une femme trans*
comme n’importe quelle femme ― et un homme trans* sera un homme comme un
autre.
20 Et si ce n’est pas clair: s’il s’agit d’une personne qui ne veut ou ne peut pas s’identifier
comme une femme ou comme un homme ― ou si j’ai un doute ? Le meilleur moyen sera
probablement de lui poser la question: quel est votre pronom ? Si ce n’est pas un « il »
ou un « elle », la personne saura certainement le mieux quel pronom (et quelles formes
genrées) conviennent le mieux. Si elle se situe au-delà de la binarité, il y a des pronoms
qui permettent de contourner bon nombre de problèmes.
21 Tant mieux si ces formes se prêtent aussi à la référence générique, par exemple pour
parler des lecteur*ices, c’est-à-dire cell_eux qui liront ce texte !
BIBLIOGRAPHIE
AG FEMINISTISCH SPRACHHANDELN DER HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN. 2015. Was tun? Sprachhandeln –
aber wie? W_ortungen statt Tatenlosigkeit!. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin (2e éd., 1re éd.
2014).
ALPHERATZ. 2018, à paraitre. Grammaire du français inclusif. Châteauroux: Éditions Vent Solars.
BAUMGARTINGER, Persson Perry. 2008. « Lieb[schtean] Les[schtean], [schtean] du das gerade liest…
Von Emanzipation und Pathologisierung, Ermächtigung und Sprachveränderungen ». liminalis.
Zeitschrift für geschlechtliche Emanzipation und Widerstand 2: 24-39.
ELMIGER, Daniel. 2015. « Masculin, féminin: et le neutre ? Le statut du genre neutre en français
contemporain et les propositions de ‹ neutralisation › de la langue » Implications philosophiques [En
ligne], consulté le 19 juin 2018. URL : http://www.implications-philosophiques.org/actualite/
une/masculin-feminin-et-le-neutre/comment-page-1/.
ELMIGER, Daniel. 2017. « Binarité du genre grammatical – binarité des écritures ? » Mots. Les
langages du politique 113: 37-52.
GRECO, Luca. 2013. « Langage et pratiques ‹transgenres › » Langues et cité. Féminin, masculin: la
langue et le genre 24: 4-5.
LARIVIÈRE, Louise. 2000. Comment en finir avec la féminisation linguistique ou Les mots pour LA dire.
Paris: Editions 00h00.
LESSARD, Michaël & Suzanne ZACCOUR. 2017. Grammaire non sexiste de la langue française. Le masculin
ne l’emporte plus!. Saint-Joseph-du-Lac; Paris: M Éditeur; Éditions Syllepse.
GLAD!, 04 | 2018
235
S_HE. 2003. « Performing the Gap. Queere Gestalten und geschlechtliche Aneignung » arranca! 28.
NOTES
1. Cf. aussi notre article qui regroupe plusieurs types de procédés (Elmiger 2017).
2. À part cette dernière forme, pour laquelle une explication se trouve sur le site de Lann
Hornscheidt (http://www.lannhornscheidt.com, consulté le 14 mars 2018), qui écrit à propos de
cette forme (utilisée également comme pronom) : « Ecs steht für Exit Gender, das Verlassen von
Zweigeschlechtlichkeit. » (« Ecs signifie Exit Gender, l’abandon de la bicatégorisation du genre. »).
3. Il est ainsi appelé dynamischer Unterstrich dans le guide AG Feministisch Sprachhandeln der
Humboldt-Universität zu Berlin et se distingue du Wortstammunterstrich (tiret bas du radical) par
le fait qu’il ne marque pas une frontière morphologique (en l’occurrence le radical), mais se place
à un endroit quelconque du mot.
4. http://www.fembio.org/biographie.php/frau/comments/sprachliche-diskriminierung-hat-
viele-gesichter-welches-ist-das-schlim/
5. En allemand, il a un jeu de mot avec Mann (« être humain masculin ») et Manipulation.
RÉSUMÉS
Que désigne le mot « genre », dans le langage ? Il s’utilise, entre autres, pour désigner des genres
grammaticaux et pour des identités de genre. Que faire lorsque cette identité ne correspond pas à
un choix binaire (de type « femme » ou « homme ») ou lorsqu’une personne entreprend une
transition ? Comment cela se traduit-il au niveau du langage ? Dans cette chronique, différents
procédés sont présentés et discutés.
What does the word “gender" mean, in language? It is used, among other things, to designate
grammatical genders as well as gender identities. What can we do when such an identity does not
correspond to a binary choice (such as “woman” or “man”) or when a person undertakes a
transition? How does this translate in terms of language? In this column, different processes are
presented and discussed.
INDEX
Thèmes : Chroniques
Keywords : non-sexist writing, abbreviations, genders, trans people, intersex
Mots-clés : écriture inclusive, rédaction non sexiste, abréviations, genres, personnes trans*,
intersexuation
GLAD!, 04 | 2018
236
AUTEUR
DANIEL ELMIGER
Université de Genève
Daniel Elmiger est linguiste et travaille à l’Université de Genève. Parmi ses intérêts de recherche
figurent divers domaines en lien avec la politique linguistique, notamment l’enseignement des
langues et le langage non sexiste dans les discours et les textes administratifs.
GLAD!, 04 | 2018
237
Sara Garbagnoli & Massimo Prearo.2017. La croisade « anti-genre ». DuVatican au Manif pour Tous Julie Abbou
RÉFÉRENCE
Sara Garbagnoli & Massimo Prearo. 2017. La croisade « anti-genre ». Du Vatican au Manif
pour Tous. Paris : Éditions Textuel. 128 pages.
1 Le mouvement « anti-genre », visibilisé en France par La Manif pour Tous en 2013, a
surpris par son ampleur soudaine. Passé le moment de stupéfaction qui a pu saisir le
féminisme face à cette offensive réactionnaire, antiféministe, qui semblait surgir du
passé, il importait de revenir sur la généalogie et les enjeux discursifs, idéologiques et
sociaux de ce mouvement. C’est ce que fait cet ouvrage, en montrant qu’il ne s’agit en
rien d’un mouvement spontané, d’un accident idéologique, mais au contraire d’une
offensive aussi stratégique qu’idéologique, extrêmement préparée — et réussie — de la
part du Vatican, qui lui a permis de se repositionner dans l’espace public tout en
affirmant un nouveau discours interne. Ce repositionnement s’est principalement
opéré par une refonte idéologique et argumentative sur la question du genre :
« L’entreprise de contestation du concept de genre a pris la forme d’une nouvelle
croisade catholique » (p. 12).
2 Véritable ouvrage de rhétorique, La croisade « anti-genre » offre un travail d’une rare
précision sur la matérialité discursive du Vatican, en retraçant les lieux où se forment
les discours, par qui, par quels déplacements discursifs, dans quel mouvement
rhétorique, où et comment ils se diffusent. Le livre donne ainsi littéralement corps au
discours « anti-genre » afin d’en faire la critique. Son objectif est en effet de dénoncer
« l’avancée d’une vague réactionnaire qui, à partir de sa matrice catholique, se déploie
sous la forme d’une contre-révolution sexuelle » (p. 16).
GLAD!, 04 | 2018
240
3 Après une introduction générale qui permet d’asseoir le propos, le livre est composé en
diptyque. La première partie, de Sara Garbagnoli, s’applique à détailler et à mettre au
jour l’argumentaire « anti-genre », les axes de son dispositif discursif, et les processus
de politisation de ce discours (p. 13). La seconde, de Massimo Prearo, cherche quant à
elle, à comprendre comment les arguments de cette croisade se sont métamorphosés en
mouvement social dans le passage à la rue. Ces deux aspects extrêmement
complémentaires (fabrique discursive d’un renouveau idéologique et fabrique sociale
d’une cause) offrent ainsi un tableau détaillé d’une offensive réactionnaire. Les deux
parties partagent également une utilisation fine, informée et efficace des outils des SHS,
non seulement pour produire une analyse théorique mais, en allant plus loin, pour
contre-attaquer idéologiquement. Très informé, mais sans verbiage ni excès de citation
pour se légitimer, le livre montre une réelle utilisation des concepts plutôt qu’un
bardage et renoue ainsi avec les études féministes comme positionnement politique.
Pourquoi et comment le Vatican s’en prend-il augenre ? (Sara Garbagnoli)
4 Dans un texte clair, argumenté et incisif, Garbagnoli met à jour « l’invention puis la
mise en circulation de l’objet “la théorie du genre” » comme une véritable politique
discursive d’un ordre moral, qui repose sur la délégitimation des théories féministes et
queers et sur le choix du concept de genre pour identifier un ennemi porteur d’une
vision dénaturalisée de l’ordre sexué et sexuel (p. 10).
5 Le texte offre une solide démonstration que la binarité, l’essentialisation et la
naturalisation ne sont pas des accidents idéologiques, mais bien des combats
idéologiques. Garbagnoli en fait l’analyse en décortiquant les instances de diffusion
doctrinaire, de production de textes, d’organisation de colloques, etc. qui vont servir de
chambre de résonnance. Faire la critique de ce mouvement idéologique implique alors
de se situer au carrefour du discursif et de l’idéologique, et d’assumer les enjeux
rhétoriques de ce combat. C’est ce que fait l’auteure en menant un travail d’une grande
précision factuelle sur les traces effectives de la matérialité discursive de l’idéologie
anti-genre du Vatican, faisant apparaître sous nos yeux une histoire ultra-
contemporaine. La force du texte repose autant sur sa solidité intellectuelle que sa
clarté politique, pour en faire une véritable réponse féministe à l’offensive
réactionnaire du Vatican.
6 Après un rappel de la teneur du genre comme une révolution touchant aux catégories
de perception du monde social les mieux naturalisés, (rappel d’ailleurs à la fois puissant
et synthétique des apports du genre), Sara Garbagnoli montre que le Vatican « a bien
saisi le potentiel révolutionnaire » que celui-ci recèle, comme « concept de combat »
(p. 27) et qu’il « a obtenu ce dont les féministes rêvaient — faire du concept de genre un
enjeu politique majeur » (p. 63-64). Il est donc nécessaire d’étudier les nouvelles
positions argumentatives vaticanes, les énonciations contemporaines de son ordre
moral, qui recourent à la promotion de la différence et de complémentarité entre sexe
comme fondement de l’humain et à l’opposition au genre conçu comme instrument qui
conduirait au règne du transhumanisme.
7 Garbagnoli contextualise et analyse ce renouveau argumentatif comme se produisant
en deux mouvements : 1) l’euphémisation, par la création d’un pseudo-concept qui se
GLAD!, 04 | 2018
241
superpose au genre (« idéologie du genre », « gender »), et 2) la déformation,
notamment par des références fallacieuses à des théories, qui va permettre la
diabolisation des théories adverses.
8 Les années 1940 et 1950 constituent « une discontinuité argumentative » dans le
discours du Vatican qui abandonne l’ordre hiérarchique de la famille et la notion de
naturelle soumission des femmes aux hommes pour lui préférer la notion de
« complémentarité », tout en maintenant la notion de « nature spécifique » des
femmes, articulée à la question de la maternité. Ainsi, écrit l’auteure, la différence
sexuelle porte un statut paradoxal de « marque indélébile à ne pas effacer ». Dans cette
« opération antiféministe de police discursive », la maternisation des femmes est le
rouage principal d’une vision familialiste, paradigmatique sous les régimes vichystes et
fascistes (p. 31). Dans les années 1960, ce glissement de la soumission à la
complémentarité permet au Vatican de distinguer un bon féminisme d’un mauvais
féminisme, plutôt que de s’y opposer frontalement dans un espace idéologique qui ne le
permet plus. Il s’agit de dire que les injustices subies par les femmes consistent en
l’empêchement de tenir leurs missions naturelles.
9 Sous le pontificat de Wojtyla (Jean-Paul II), les décennies suivantes (1980-2000)
accentuent cette tendance par une surévaluation des vertus féminines : non seulement
les femmes ont une dignité égale aux hommes, mais elles sont plus précieuses que ces
derniers. Cela va s’accompagner d’une rupture doctrinale autour de la sexualité, qui
n’est plus un péché, mais est réhabilitée comme une composante fondamentale de la
personne, dans une théologie des corps. La conjugalité hétérosexuelle est ainsi pensée
comme un don réciproque de soi entre deux espèces ontologiquement différentes, ce
qui ouvrira la porte à la notion de « loi morale naturelle », et permettra l’argument de
« l’égalité dans la différence », dans une « tradition de racisation des femmes (…)
comme une espèce, un “groupe naturel”. (…) Cette torsion des notions féministes
produit un discours qui, en se réclamant du féminisme, se déploie comme une arme
antiféministe » (p. 38-39).
10 Enfin, sous Ratzinger (Benoît XVI), le mouvement d’euphémisation entrainera une
distinction entre les bons homosexuels (chastes) et les mauvais (qui vivent leur
homosexualité comme une identité politique) dans une doctrine de la bipolarité
sexuelle. Le Vatican proposera alors la notion de « discrimination non injuste ».
11 À côté de cette entreprise d’euphémisation pour prendre place dans le débat et se
rendre audible, l’appropriation et la torsion lexicale constituent également une contre-
attaque. Au début des années 2000, le Vatican réagit à l’arrivée du concept de genre
dans les politiques d’égalité (notamment de l’ONU), en créant une multitude d’instituts
et d’académies, « des plateformes de scientifisation » de son discours théologique, avec
« des actions de lobbying auprès des instances politiques internationales et des
Parlements nationaux » (p. 45), et en produisant un ensemble d’outils rhétoriques de
déformation qui vont lui permettre de structurer les cadres du débat, tout en
s’affichant comme un discours séculier, scientifique et féministe qui repose sur la
croyance dans la naturalité et dans la complémentarité entre les sexes (p. 58). Cette
déformation discursive est menée à travers une prolifération des techniques de
labellisation, qui fonctionnent comme des anathèmes et des signifiants déformants, que
Garbagnoli détaille dans cette dernière section.
12 Elle décrit tout d’abord la création d’un répertoire de syntagmes (« idéologie du
genre », « théorie du genre », « idéologies des féministes du gender », « théorie du
GLAD!, 04 | 2018
242
genre sexuel », « théorie du gender queer », etc.), utilisé pour constituer un ennemi
unique, et dont l’un des outils majeurs est le Lexique des termes ambigus et controversés sur
la famille, la vie et les questions éthiques (2003). L’usage du mot théorie s’inscrit, lui, dans
une stratégie anti-intellectualiste tout en proposant une opposition entre science et
idéologie, pour défendre un déterminisme biologique et de la nature sexuelle des
individus. Par ailleurs, l’usage du terme gender lui permet d’exotiser le concept au nom
d’une critique de l’impérialisme culturel américain. Le Vatican recourt également à des
mésusages conceptuels : le genre, renvoyant tantôt à la dimension sociale du sexe,
tantôt au principe de hiérarchisation qui produit les sexes. Autre stratégie d’anathème,
que Garbagnoli identifie comme la torsion la plus déformante : la diabolisation ad
personam : « la théorie du genre affirmerait que genre et sexualité serait une affaire de
“choix individuel” » dans une évaporation des hiérarchies. Ce brouillage du genre
comme reflet du sexe est bien sûr au service d’une « tentative de renaturalisation du
concept de genre » (p. 57). Elle affirme ainsi que la croisade « anti-genre » du Vatican
prend la forme d’un double combat : « il ne s’agit pas seulement de délégitimer ce
concept, mais aussi de le vider de sa charge critique » (p. 57-58).
13 Enfin, dernière déformation rhétorique étudiée : l’amphibologie, c’est-à-dire
l’ambiguïté grammaticale que le Vatican entretient autour du terme genre qui désigne
en fait simultanément : l’homosexualité, la famille, et la reproduction de l’ordre social
(p. 59). Grâce à ce brouillage, il pourra présenter la famille hétérosexuelle comme la
cellule de base de l’ordre national, en s’appuyant sur la mise en circulation des termes
tels que « hétérophobie » ou « familiphobie » et construire un ennemi intérieur. Cette
articulation du national, du familial et de la filiation lui permet de s’inscrire dans des
rapports (de force ?) aux États nationaux.
14 C’est là peut-être un des arguments les plus frappants du livre, et l’un des plus
éclairants sur cette vague réactionnaire : avec l’intention « de vouloir garder (ou
reprendre) le monopole du pouvoir d’établir la définition légitime de ce qu’est une
famille — c’est-à-dire le groupe qui demeure le principal vecteur de transfert sexué et
intergénérationnel du patrimoine — dans un contexte national donné » (p. 61), le
Vatican se positionne en fait comme instance d’organisation et de gouvernance des
vies, faute d’avoir gardé le gouvernement des sociétés, et s’affiche « non pas seulement
comme une institution religieuse, mais aussi bien comme (…) l’autorité morale de
référence de l’“Occident”, (…) un modèle de nationalisme sexuel qui lie hétérosexualité,
chrétienté, blanchitude et “identité nationale” » (p. 62).
Un contre-mouvement sexuel (Massimo Prearo)
15 La partie de Massimo Prearo s’ouvre par un questionnement : comment des milliers de
personnes ont été amenées à descendre dans la rue pour défendre la famille
hétérosexuelle ? C’est-à-dire comment la police discursive et argumentative décrite par
Sara Garbagnoli dans la première partie a-t-elle pu se transformer en un processus
efficace de mobilisation à échelle globale ? À partir d’observations des situations
française et italienne, principalement dans les années 2010, Prearo met au jour la
fabrique des possibilités d’un passage à l’acte du monde catholique, comme une
politique sexuelle contre-révolutionnaire, mais aussi comme la réaffirmation
identitaire d’un « nous catholique ».
GLAD!, 04 | 2018
243
16 Pour comprendre comment l’argumentaire « anti-genre » passe d’un dispositif
rhétorique à un dispositif de mobilisation, l’analyse procède en trois temps : (1) les
foyers de production du savoir catholique, de ses acteurs et de ses outils, (2) les
logiques de politisation de l’identité catholique par l’utilisation du discours « anti-
genre » comme propulseur d’une forme d’engagement militant, et (3) l’expression
publique d’une sentiment de revanche identitaire, portée par la minorité des
catholiques intégristes.
17 La première partie s’intéresse donc à la fabrique du corps théorique, cette fois-ci d’un
point de vue sociologique : qui sont les producteurs de ce savoir, « au nom de qui et au
nom de quoi construisent-ils/elles leur légitimité ? (…) avec quels outils, quels
canaux ? » (p. 71). Prenant le relai de Garbagnoli, Prearo montre comment le Vatican
s’est approprié « le vocabulaire de la démocratie sexuelle » (p. 72).
18 Prearo jette une lumière sociologique sur cette fabrique idéologique puisqu’il mène sa
démonstration par un travail précis d’identification des acteurs (Marguerite Peeters,
Dale O’Leary, Xavier Lacroix etc.), des institutions (think tanks, instituts, groupes de
travail, etc.), des évènements, et des productions textuelles du Vatican des années 2000
qui vont servir à « réaffirmer les valeurs et les principes du modèle anthropologique
catholique ». Ce travail sur les foyers discursifs lui permet de fonder son argument
principal : le savoir « anti-genre » est une occasion « de restaurer la cohésion du
catholicisme français autour d’affirmations doctrinales fortes » (p. 75), affirmations que
Prearo analyse en deux moments : un moment identitaire, et un moment politique. Il
prolonge et explicite ainsi la thèse amorcée dans la partie précédente : la volonté de
l’Église de réaffirmer une autorité sur le gouvernement des conduites, vis-à-vis des
États.
19 La deuxième sous-partie montre comment ces laboratoires « anti-genre » ont su se
transformer en activisme, puis en mobilisations de rue. En écho à Garbagnoli qui
montrait qu’il s’agit d’une stratégie rhétorique, Prearo démontre, données précises à
l’appui, que cette mobilisation n’est en rien une adhésion spontanée mue par une
panique morale, mais correspond plutôt à une vaste campagne de recrutement et de
formation par des experts : en 2013, des centaines de conférences sont organisées dans
toute l’Italie, puis diffusées sur Internet, avec un cahier des charges méthodiquement
préparé et un vocabulaire précis, parsemé de buzz words : d’abord un rappel du
« fondement biologique, chromosomique, anthropologique de la différence sexuelle »,
puis « l’exposition des origines de “la théorie du genre” » et enfin la mention « des
dangers réels » du gender qui « vise à instaurer un nouvel ordre mondial » pervers et un
état totalitaire.
20 En France, le même mouvement se met en place dès 2011, avec la polémique des
manuels scolaires de SVT. Là encore, des acteurs identifiés tels que Mgr d’Ornellas,
Elizabeth Monfort, Christian Vanneste, etc. œuvrent au sein de groupes de travail et de
think tanks néoconservateurs (l’Association pour la Fondation du Service politique,
l’Académie d’éducation et d’études sociales, Famille & Liberté, Alliance Vita, l’Opus Dei,
etc.) et agissent au sein des paroisses mais aussi au-delà, un peu partout en France.
Simultanément, une pratique réflexive catholique fournit un cadre de compréhension
permettant la « remise en cause des fondements doctrinaires du catholicisme », que
Massimo Prearo désigne comme un aggiornamento réflexif de la morale catholique, et
la fabrique d’une identité collective catholique renouvelée. C’est donc l’orchestration
GLAD!, 04 | 2018
244
d’une panique morale que Prearo met au jour par l’identification et la contextualisation
des acteurs collectifs et individuels.
21 Dans la troisième et dernière partie, Prearo propose de comprendre quels ont été les
effets de cette mobilisation sur le militantisme catholique. Il avance en ce sens que « la
cause “anti-genre” a reconfiguré le cadrage identitaire du militantisme religieux en
contexte démocratique sécularisé » (p. 97). Son hypothèse, convaincante, est que
l’incarnation du discours « anti-genre » dans les manifestations, a révélé et réactivé
« une agency catholique, une capacité d’agir politiquement, à partir de son appartenance
religieuse, mais au nom d’un combat “anthropologique” de défense de l’ordre naturel »,
ce qui a permis de penser l’identité catholique comme une identité politique (p. 101).
22 On retrouve là l’idée rencontrée plus tôt, que lorsque la religion veut gouverner alors
qu’elle n’a plus d’emprise sur les États, elle est obligée de se faire plus ouvertement
politique. Or, ce projet politique émane d’une tendance précise du catholicisme, à sa
droite dure : le Chemin Néocatéchuménal. Prearo étudie les discours et
positionnements de ces tendances pour dessiner les contours de leur projet idéologique
comme profondément anti-démocratique, et contre-révolutionnaire, et la façon dont ils
mettent en place un « nous », un moment de reconnaissance identitaire qui (se)
manifeste. La présence ecclésiastique dans les mouvements « anti-genre » ne relève pas
seulement de leur racine intégriste et orthodoxe, mais d’un travail identitaire sous une
forme politisée qui permet d’affirmer « un catholicisme sans concessions, par ailleurs
en perte d’hégémonie culturelle » (p. 105). C’est ce moment que l’auteur qualifie de
revanche identitaire. Si la démonstration de cette affirmation identitaire et politique
est très convaincante, la qualification de revanche identitaire, qui revient beaucoup,
l’est un peu moins. On comprend bien que la revanche et l’offense dont parle Prearo
sont des analogies pour le corps social catholique, mais le glissement métaphorique, qui
psychologise, ne fonctionne que partiellement, surtout qu’a été montrée au préalable la
complexité idéologique de l’institution catholique. Certes les discours « anti-genre » le
formulent parfois en des termes proches (voir Tugdual Derville qui parle « du
traumatisme provoqué par une dérive libertaire post-soixant-huitarde », p. 109), mais
l’analyse critique gagnerait à replacer cela sur un terrain clairement politique (ce qui
est fait par ailleurs dans les deux parties de l’ouvrage), sans glisser vers la métaphore
psychologique. L’allégorie de « l’immeuble qui s’écroule » employée à l’occasion,
fonctionne mieux pour comprendre comment l’Église catholique cherche à sauver les
meubles idéologiques, dans un mouvement certes très offensif, mais pas
nécessairement pensé — et vécu — comme la réponse à une perte morale à réparer.
23 Ce choix problématique du terme « revanche » est illustratif d’un registre accusateur,
dans cette seconde partie, et dans une certaine mesure, d’un discours très imagé du
dévoilement (Prearo parle de déguisement, d’infiltration, etc.), des effets de formule,
qui certes sont frappants mais donnent parfois un sentiment de répétition,
d’enchaînement de phrases chocs (par ailleurs très bien trouvées) et qui font par là
perdre un peu de force au discours en l’inscrivant dans une stratégie dépréciative, qui
fait parfois penser plus à l’essai qu’au texte politique. Mais c’est l’un des rares défauts
du livre, et l’analyse compense largement l’effet terminologique.
24 L’ouvrage conclut sur l’idée forte que la construction du discours « anti-genre » du
Vatican lui a permis de séculariser sa « morale sexuelle » (p. 113) et d’imposer dans
l’agenda politique ses propres termes. La mobilisation a également permis aux
mouvements ecclésiaux d’agir « en garants et défenseurs d’une identité catholique pure
GLAD!, 04 | 2018
245
et dure » (p. 114), face à un catholicisme mou. Il s’agit donc d’un double mouvement, à
l’adresse de l’espace public (séculier) mais aussi à l’intérieur de l’espace catholique. Cet
argumentaire, tour de force rhétorique, révèle « le logiciel du système idéologique
patriarcal et hétéronormatif avec ses hiérarchisations » par l’affirmation « audible et
“démocratiquement” acceptable que les hommes et les femmes, les personnes
hétérosexuelles et les personnes homosexuel-le-s et trans n’ont pas le droit à la même
place dans le monde » (p. 115).
25 On pourra regretter des détails mineurs : à plusieurs reprises l’ouvrage rappelle qu’il se
consacre uniquement aux discours du Vatican, qui ne sont pas les seuls dans l’arène des
tenants de « la théorie du genre » et de cette refonte antiféministe. On regrette
toutefois que ces autres discours ne soient pas mentionnés, au moins pour les situer. De
même, quelques explications complémentaires sur les différentes mouvances
catholiques mentionnées (mouvements ecclésiaux, néocatéchuménal, charismatiques,
etc.) auraient aidé la lectrice profane, peu au fait des tendances internes au
catholicisme, à être moins perdue dans cette cartographie. De manière plus formelle, le
choix des titres de section n’est pas toujours limpide, ce qui produit une impression de
redondance, d’accumulation, vite balayée par la clarté d’analyse des deux textes, leur
solidité factuelle, leur perspicacité politique et leur grande complémentarité. Enfin,
l’ouvrage a les défauts de ses qualités : si la focale discursive et la focale sociale mettent
au jour des aspects différents du phénomène, ce découpage méthodologique produit
parfois un effet de redondance, dans ces différentes analyses des discours de l’Église
catholique. Mais cet effet est précisément ce qui permet d’éviter une division
artificielle entre discursivité et société, ce qu’on ne peut que saluer.
26 Face aux débats sur la théorie du genre, deux types de réactions féministes se sont fait
entendre : d’une part des voix s’élevaient pour assumer la portée théorique des études
de genre et revendiquer le segment « théorie du genre », d’autre part des voix
critiquaient la mise en circulation de cette notion. À travers l’analyse de la fabrique
discursive, médiatique et évènementielle — et en fait performative — de « l’objet “la
théorie du genre” », cet ouvrage1 démontre brillamment que les termes mêmes du
débat ont été conçus dans la visée d’une offensive anti-féministe à échelle mondiale, et
qu’il est urgent de formuler une réponse féministe puissante. Si ce n’est chose faite,
c’est au moins commencé.
NOTES
1. Un reflet de ces discussions s’est d’ailleurs glissé dans l’objet lui-même du livre, dont la
couverture titre La croisade anti-genre, accompagné d’un carton d’erratum rappelant que : « le
titre exact du livre est : La croisade “anti-genre” avec des guillemets ».
GLAD!, 04 | 2018
246
INDEX
Thèmes : Actualités
Keywords : manif pour tous, Vatican, rhetoric, ideology, social movements
Mots-clés : manif pour tous, Vatican, rhétorique, idéologie, mouvements sociaux
AUTEURS
JULIE ABBOU
Titulaire d’un doctorat de Sciences du Langage (Aix-Marseille Université) sur les modifications du
genre linguistique pour des motifs politiques, Julie Abbou mène des recherches sur les apports
théoriques réciproques des études de genre et des sciences du langage. Elle travaille également
sur les dimensions sémiotiques du genre grammatical, ainsi qu’en rhétorique sur le traitement
du genre dans différents types de discours. Récemment, elle a co-dirigé l’ouvrage Gender,
Language and the Periphery. Grammatical and social gender from the margins (John Benjamins) et
publié des articles dans des revues telles que Semen, Mots les langages du politique, Current issues in
Language Planning, etc.
GLAD!, 04 | 2018
247
Elsa Dorlin. 2017. Se défendre. Unephilosophie de la violence Vers une phénoménologie de la violence défensive
Mickaëlle Provost
RÉFÉRENCE
Elsa Dorlin. 2017. Se défendre. Une philosophie de la violence. Paris : Zones. 200 pages.
1 L’ouvrage d’Elsa Dorlin, professeure de philosophie politique et sociale à l’Université
Paris VIII, ouvre la voie à une philosophie singulière de la violence, pensée depuis le
point de vue de l’expérience vécue, une expérience subjective et corporelle qui façonne
un certain rapport au monde, aux autres et à soi. Plus précisément, l’ouvrage
s’intéresse à la défense, aux réactions ordinaires par lesquelles les corps se donnent la
possibilité de « répliquer » à une violence devenue invivable, ne pouvant plus être
répétée. C’est ce point de basculement ou ce seuil, à même l’expérience vécue, qui
constituera le fil de notre lecture du livre. En nous centrant sur la « phénoménologie de
la violence1» proposée par l’auteure, il s’agira d’en souligner l’importance au sein de
l’économie générale de l’ouvrage et de voir en quoi celle-ci sous-tend les différents
questionnements. Le livre se compose, en effet, de huit chapitres (« La fabrique des
corps désarmés », « Défense de soi, défense de la nation », « Testaments de
l’autodéfense », « L’État ou le non-monopole de la défense légitime », « Justice
Blanche », « Self-Defense : Power to The People ! », « Autodéfense et sécurité »,
« Répliquer ») qui arpentent une « histoire constellaire de l’autodéfense » (p. 16). Le
déroulement de l’analyse ne suit pas une chronologie linéaire qui viserait à retracer de
manière causale l’histoire de la violence défensive mais dessine plutôt une trame
historique faite d’un enchevêtrement d’archives, de récits historiques, philosophiques
ou littéraires. Les chapitres sont ainsi des contributions successives, embarquant la
question de la violence défensive dans des perspectives historiques nouvelles où elle est
instruite, éclairée, transformée. Il s’agit, pour l’auteure, de rechercher une « mémoire
des luttes dont le corps des dominé.e.s constitue la principale archive » en reliant par
GLAD!, 04 | 2018
248
« des échos, des adresses, des testaments, des rapports citationnels » (p. 16) des
pratiques et savoirs de l’autodéfense esclave, féministe, queer, les techniques de
combat mises en place par les organisations juives contre les pogroms etc. Cette
« histoire constellaire » peut alors être lue au prisme d’une phénoménologie de la
violence défensive : comment, au cœur de l’expérience la plus intime, une situation
d’oppression peut-elle être reconfigurée ? Comment les corps peuvent-ils redéployer
une violence qu’ils ont incorporée et qui a façonné tous les aspects de leur existence
quotidienne ? Sous quelles conditions historiques, politiques, subjectives et corporelles,
le passage à la violence défensive est-il possible ?
2 L’articulation de ces questions permet de saisir la manière dont la violence, exercée de
manière polymorphe par différents systèmes de pouvoir (principalement coloniaux,
racistes et sexistes), constitue la trame de nos expériences. Celle-ci informe nos
habitudes et nos gestes les plus élémentaires, les manières de nous mouvoir, d’habiter
le monde, et nous dépossède des ressources cognitives, affectives, corporelles pour y
faire face. En effet, la violence ne saurait être comprise sous le seul prisme de
l’agression, de la répression ou de la coercition : elle est productive en ce qu’elle opère
sur des possibilités d’action, sur ce que peuvent les corps, par l’anticipation de ce qui va
et doit avoir lieu. En ce sens, elle constitue bien l’arrière-plan de nos expériences les plus
ordinaires, elle en est leur forme a priori. Cette conceptualisation constitue le point de
départ de l’analyse menée par Elsa Dorlin et permet de voir en quoi la violence ne
s’exerce pas « après coup » sur des sujets et des corps déjà constitués, mais oriente ce
qu’ils peuvent être et faire. Elle est un processus d’assujettissement indissociable d’un
« dispositif défensif » qui procède
en ciblant ce qui relève d’une force, d’un élan, d’un mouvement polarisé à sedéfendre, balisant pour certain.e.s sa trajectoire, favorisant son déploiement dansun cadre qui le légitime, ou bien, au contraire, pour d’autres, empêchant soneffectuation, sa possibilité même, rendant cet élan inhabile, hésitant ou dangereux,menaçant, pour autrui comme pour soi-même. (p.14)
3 Le « dispositif défensif » ne trace pas seulement une ligne de partage entre sujets
dignes ou légitimes à se défendre et ceux qui sont dépossédés d’un droit de défense, il
rend possible ou non le déploiement d’un élan défensif vital en façonnant des corps
capables ou non de se défendre. En d’autres termes, il cible la puissance défensive du
sujet en la renforçant ou en l’inhibant. Néanmoins, si les logiques de pouvoir
structurent à l’avance le champ de l’agir défensif, les corps travaillent en retour les
normes qui les constituent. La défense de soi constitue un seuil, immanent à
l’expérience vécue de la violence, à partir duquel les corps excèdent les normes qui les
façonnent et reconfigurent l’espace de leur puissance d’agir. La singularité de
l’ouvrage est ainsi de développer l’analyse non à partir d’une conception normative (le
partage entre violence légitime et illégitime), ni même d’une distinction a priori entre
violence et non-violence, mais depuis les usages multiples qui en réactivent et en
pluralisent la signification. Aussi la violence mise en acte par la défense est-elle un
processus faisant partie d’un continuum d’expériences corporelles et psychiques,
d’affects, d’objets détournés en armes, de représentations symboliques, qui ouvrent la
violence subie à des devenirs possibles. À partir de là, il est possible d’envisager des
formes de défense de soi oubliées par l’histoire de la philosophie : défense mise en
scène par les rêves (les rêves des colonisés décrits par Frantz Fanon et analysés au
chapitre 1), défense affective (la rage ou colère se transformant en tension musculaire),
défense par projection mentale (exercée par le jeu vidéo Hey Baby!, comme le montre le
GLAD!, 04 | 2018
249
chapitre 7), etc. En repérant les lignes de fracture ou de rupture qui émergent au cœur
des déterminations historiques, l’ouvrage retrace une généalogie de l’autodéfense, un
continuum d’expériences intimes ou collectives où les corps apparaissent comme autant
« d’histoires sédimentées2 ».
4 Cette épistémologie de la violence, depuis le point de vue de celles et ceux qui n’ont pas
d’autre choix que de se défendre pour survivre, offre ainsi la possibilité de mettre en
lumière les pratiques de visibilité et d’invisibilité de la violence mises en place par les
structures de pouvoir. Autrement dit, il s’agit de comprendre les conditions historiques
et politiques de ce qui apparaît et nous apparaît comme violent, invivable, digne d’être
défendu ou non, à même de susciter colère ou indifférence. En articulant ainsi une
phénoménologie des modes de perception de la violence et une critique de nos
réactions à son égard, le travail d’Elsa Dorlin entrecroise les différentes perspectives
ouvertes par les travaux de Judith Butler3 ou ceux de Talal Asad4, cherchant à mettre en
cause les présupposés qui sous-tendent les questions de légitimité ou d’illégitimité
morale de la violence. Ici, la question d’une éthique de la violence ne surplombe pas
l’analyse et n’en constitue pas le point de départ. Elle se dessine plutôt de manière
immanente par une distinction ou une typologie des différentes formes d’expériences
que la violence rend possible. Sous quelles conditions la violence est-elle un processus
de subjectivation politique, une création ouvrant l’expérience à d’autres devenirs
politiques ? Comment l’expérience subie de la violence, une expérience souvent
marquée par l’inintelligibilité, peut-elle être transformée et transformer en retour les
corps et les subjectivités ? Ces questions constituent le fil du travail généalogique et
permettent de déplier les différentes strates historiques et politiques qui constituent
l’expérience de la violence.
La relation entre légitime défense et autodéfense
5 L’ambition de l’ouvrage est de penser ensemble comment les mécanismes de pouvoir
exposent les corps de manière différentielle à la violence et à la mort, et la manière
dont ceux-ci survivent à la violence à laquelle ils sont confrontés. À partir de là, le
second déplacement théorique majeur est de mettre en cause, non seulement
l’essentialisation de l’expérience subie de la violence (celle-ci serait en elle-même
destructrice de toute possibilité de défense), mais également l’essentialisation d’une
résistance, inhérente à cette même expérience. Il importe, en effet, de saisir la manière
dont les mouvements défensifs vitaux excèdent la violence perpétrée par les pouvoirs
oppressifs, alors même que celle-ci agit sur la possibilité de cet excès. Cette co-
implication entre l’irréductibilité de l’élan défensif vital (à l’égard des normes qui le
conditionnent) et la manière dont cette irréductibilité est investie par les mécanismes
de pouvoir, constitue le nœud de la problématisation. La défense n’est pas en elle-même
ce qui résiste et échappe aux pouvoirs, précisément parce qu’elle peut être orchestrée
et se déployer au sein d’espaces de violence mis en place par les pouvoirs. La
coprésence simultanée de ces deux logiques est à l’œuvre dans la structure de l’ouvrage
et des chapitres : celle-ci lie simultanément les deux « expressions antagoniques de la
défense de “soi” » (p. 16).
6 D’une part, l’analyse souligne l’organisation par l’État-nation des modes d’exercice de
la violence et leur hiérarchisation : la manière dont historiquement, depuis la
colonisation, l’État construit des formes de perception, de reconnaissance et
GLAD!, 04 | 2018
250
d’intelligibilité de la violence, la manière dont il fabrique des sujets et des corps
légitimes à se défendre et à être défendus, dont la vie importe ou non. La
compréhension de la violence entendue comme légitime défense, fait fond sur une
conception de l’individu-sujet, propriétaire de soi et de ses biens, dont l’identité fonde
et justifie de manière a priori tout acte de défense. Cette « économie impériale de la
violence qui paradoxalement défend des individus toujours déjà reconnus légitimes à se
défendre par eux-mêmes » (p. 15) fonctionne là encore sur le plan de l’expérience
vécue : la défense se déploie à l’intérieur des limites fixées par l’État et mobilise des
affects, des corps, des représentations qui ne sont que le relai individualisé d’une
violence institutionnalisée. Cette conception de la défense, arrimée à une pensée de
l’individu propriétaire de lui-même et d’un droit à se conserver, est présente dans la
philosophie de Locke (chapitre 4). Elle articule une défense des privilèges et la défense
de « soi », en tant que ce « soi » constitue une identité ou un corps à immuniser de ce
qui les menacerait. Cette problématisation du droit à la défense s’exerce par des
pratiques a priori distinctes dont l’analyse parvient à ressaisir le dénominateur
commun. C’est le cas par exemple du passage à tabac de Rodney King analysé dès le
« Prologue » : la violence des policiers est le transfert de la violence raciste exercée par
l’État, une violence a priori légitime car elle est fondée sur une identité nationaliste,
blanche, à défendre. Les corps étrangers (ici noirs) dépossédés d’eux-mêmes et de
« soi » à défendre, ne sont perçus et reconnus qu’en tant qu’ils constituent une menace
étrangère à l’intégrité de la nation. La dépossession du droit et des capacités à se
défendre repose sur une dépossession des dominé.e.s de leurs moyens d’existence
matériels, de leur corps, de leur « soi ». En outre, le renforcement du corps national
repose sur une fabrication genrée et racialisée des corps aptes à se défendre pour
défendre l’État-nation dont ils font partie. C’est ce qu’illustre la généralisation de la
technique du krav maga au sein de la société israélienne : l’injonction virile à la défense
de soi opère comme une technique de renforcement du pouvoir colonial (chapitre 3).
Cette défense conservatrice ne fait que renforcer les logiques d’oppression de sexe, de
race et de classe articulées par les instances de pouvoir et fonctionne comme un
mécanisme de reproduction de leurs conditions. En ce sens, l’expérience de la violence
ne se déploie qu’à l’intérieur d’un champ structuré d’avance par les normes coloniales,
sexistes ou racistes, empêchant toute singularisation et réinvention d’un rapport au
monde. C’est précisément l’aporie à laquelle peuvent être confrontés certains cadres
militants (chapitre 7) : ceux-ci peuvent être minés de l’intérieur par une politique de
sécurité qui chercherait à défendre une identité figée et homogène (fut-elle minorisée)
contre un dehors qui pourrait la menacer. Toute défense est d’emblée légitimée, au
risque de déposséder d’autres groupes opprimés de leurs moyens d’habitat.
7 Cette histoire de la légitime défense est pourtant travaillée par une autre forme de
problématisation de la violence, celle de l’autodéfense. C’est précisément parce que la
défense n’est pas intrinsèquement subversive et qu’elle peut fonctionner comme un
mécanisme de reproduction et de renforcement des normes, qu’il importe de souligner
en quoi les pratiques d’autodéfense prennent sens dans leur différenciation à l’égard de
la légitime défense. En d’autres termes, ces pratiques ne conquièrent leur force
subversive que par un travail de singularisation, de création, à l’égard des pratiques
défensives dominantes. En effet, l’autodéfense n’est pas une défense des privilèges ou
d’une identité qu’il s’agirait de conserver, mais de la vie et des libertés puisque « le
sujet prend et se donne à lui-même un droit qui lui est dénié » (p. 130). Pour les groupes
opprimés, dépossédés du droit à la légitime défense, la défense prend le sens d’un élan
GLAD!, 04 | 2018
251
vital, « qui n’a d’autre enjeu que la vie : ne pas être abattu.e d’emblée » (p. 16).
L’autodéfense n’est pas fondée par un principe (de propriété ou d’identité) ; elle est une
résistance inéluctable à ce qui met en jeu la vie. C’est alors dans la réponse à la violence
que se déploie un processus de subjectivation : le sujet ne préexiste pas à l’agir défensif
mais se crée par l’expérience de la violence défensive, en ce que celle-ci inaugure une
nouvelle relation à soi, à son corps, à ses affects, à la manière dont nous habitons le
monde et dont nous nous rapportons aux autres. Ces pratiques d’autodéfense dessinent
des « éthiques martiales de soi » (p. 15) en ce qu’elles font éclater les identités assignées
(être « Noir », « femme », « victime » etc.) et offrent la possibilité de se réinventer par la
violence. Cette co-implication entre éthique et politique est par exemple à l’œuvre dans
la lecture du roman de Helen Zahavi, Dirty Week-end (chapitre 8) : la violence qui a
façonné le rapport au monde de Bella et l’a dépossédée de sa propre expérience est
réappropriée par Bella lorsque celle-ci choisit de fracasser la tête de son agresseur. Le
passage à la violence entrepris par Bella constitue alors un évènement au sein de sa
propre histoire : elle ouvre un autre rapport au monde, transformant la peur en rage, le
sentiment de dépossession en agir féministe.
8 Si le cheminement de l’ouvrage pourrait paraître, à première lecture, sinueux (par le
foisonnement ou l’hétérogénéité apparente des analyses) la manière dont il déploie
progressivement les dimensions contradictoires des expériences de la violence
défensive, en fait pourtant la force. Celle de ne pas céder à une compréhension
(militante ou théorique) de la légitime défense ou de l’autodéfense comme deux
branches d’une alternative, mais bien de saisir la relation conflictuelle qui les
détermine. Cette coprésence, qui est aussi le signe d’une réversibilité possible
(l’ambivalence, par exemple, du jeu Hey Baby! analysé au chapitre 7, dont les
potentialités subversives peuvent être captées par un schème défensif néolibéral)
permet de maintenir ouvertes les problématiques sans chercher à y répondre de
manière hâtive ou normative. Elle souligne, au contraire, le déséquilibre et la
conflictualité à l’œuvre dans les pratiques de résistances, conditions sous lesquelles
celles-ci peuvent être la matière d’expériences politiques transformatrices.
BIBLIOGRAPHIE
AHMED, Sara. 2006. Queer phenomenology. Orientations, Objects, Others. London : Duke University
Press.
ASAD, Talal. 2018. Attentats-suicides. Questions anthropologiques (traduction Rémi Hadad). Bruxelles :
Zones sensibles.
BUTLER, Judith. 2010. Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre, le deuil (traduction Joëlle
Marelli). Paris : La Découverte.
GLAD!, 04 | 2018
252
NOTES
1. DORLIN, Elsa. 2017. Se défendre. Une philosophie de la violence. Paris : Zones, p. 17. Toutes les
références de page seront désormais indiquées entre parenthèses dans le texte.
2. AHMED, Sara. 2006. Queer phenomenology. Orientations, Objects, Others. London : Duke University
Press, p. 56.
3. BUTLER, Judith. 2010. Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre, le deuil (traduction Joëlle
Marelli). Paris : La Découverte.
4. ASAD, Talal. 2018. Attentats-suicides. Questions anthropologiques (traduction Rémi Hadad).
Bruxelles : Zones sensibles.
INDEX
Thèmes : Actualités
Keywords : self-defense, violence, phenomenology, racism, feminism
Mots-clés : autodéfense, violence, phénoménologie, racisme, féminisme
AUTEURS
MICKAËLLE PROVOST
UMR 8103 – ISJPS : Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne
Mickaëlle Provost est doctorante et chargée d'enseignement à l'Université Paris 1, en
philosophie. Sa thèse, rattachée à l'Institut des Sciences Juridiques et Philosophiques de la
Sorbonne, s'intitule "Une phénoménologie des résistances : de l'expérience de l'oppression à
l'expérimentation féministe".
GLAD!, 04 | 2018
253
He-Yin Zhen. 2018. La Revanche desfemmes et autres textes Agathe Senna
RÉFÉRENCE
He-Yin Zhen. 2018. La Revanche des femmes et autres textes. Paris : Editions de l’Asymétrie.
142 p. Coll. Rimanenti. Préface de Jean-Jacques Gandini, postface de Marine Simon.
Traduction du chinois par Pascale Vacher.
1 C’est en exil depuis le Japon que He-Yin Zhen何殷震 (1884 - ca. 1920), anarchiste et
révolutionnaire chinoise, signe en juin 1907 un de ses premiers textes, le Manifeste
féministe, qui sera suivi de plusieurs articles et courts essais autour de la question de
l’urgence de la « libération des femmes », publiés dans le journal anarchiste Justice
Naturelle (Tianyi). Les éditions de L’Asymétrie proposent pour la première fois une
traduction en français de six de ses textes majeurs, tous datés de 1907, parmi lesquels
La Revanche des femmes, qui donne son titre au recueil. Une superbe occasion pour le
public français d’avoir accès et de découvrir la pensée de cette théoricienne féministe.
2 Comme le note Jean-Jacques Gandini dans sa courte préface à l’ouvrage, l’anarchisme
chez He-Yin Zhen se veut « vecteur » du féminisme, indissociable dans la mesure où ce
sont ses idées anarchistes qui confèrent à sa théorie féministe sa radicalité, et ses idées
féministes qui démarquent He-Yin Zhen des courants socialistes et anarchistes chinois
de l’époque. Il ne faut donc pas s’y méprendre, si elle parle de « revanche », la lutte des
femmes ne vise pas à prendre le pouvoir d’entre les mains des dominants, mais
véritablement à renverser ces rapports de pouvoir ; non pas faire des dominé.e.s les
égaux.ales des dominants ou les dominant.e.s de demain, mais abolir la domination
même, et actualiser l’idée de « justice », pour tous et toutes.
3 Ces textes sont relativement oubliés en Chine où l’histoire des mouvements anarchistes
et leur rôle dans l’élaboration du discours révolutionnaire et dans le développement
des idées socialistes a été largement escamoté. C’est le double aspect, féministe et
radical, de sa critique des traditions patriarcales et confucéennes, qui en font encore
GLAD!, 04 | 2018
254
aujourd’hui une essayiste écartée du roman historique national et hégémonique, et
lorsqu’elle est abordée, en Chine ou à l’étranger, c’est souvent sous l’angle d’un
personnage ou d’une curiosité historique, plutôt que sous l’angle d’une essayiste et
théoricienne. C’est grâce au formidable travail pionnier de Rebecca Karl, Lydia Liu et
Dorothy Ko, qui ont publié ses textes en anglais (2013), sous un titre1 qui rend
davantage justice à la pensée de He-Yin Zhen, et en mandarin (2016), qu’elle a ressurgi
récemment ; c’est ce qui aura permis aux éditions de l’Asymétrie d’entreprendre la
traduction en langue française. Présentée par ces trois chercheuses comme la première
grande féministe chinoise, on peut désormais espérer que les idées de He-Yin Zhen
soient davantage reconnues et mises en valeur dans le champ académique et le terrain
des luttes féministes actuelles, en Chine et ailleurs.
Les rouages de la domination
4 Ces textes sont remarquables dans la mesure où He-Yin Zhen s’attache à analyser le
« mécanisme de distinction » (Liu, Karl & Ko 2013 : 14), explorer les rouages des
inégalités de genre, et ce en posant d’abord que la domination des hommes sur les
femmes n’est pas une simple domination au sens politique ― tel un tyran sur ses sujets
― mais une domination inédite car plurielle et multidimensionnelle. C’est ainsi qu’en
ce tout début de vingtième siècle, elle couche sur le papier cette phrase qui trouvera de
nombreux échos : « en parlant de genre masculin et de genre féminin, nous ne parlons
pas de leur nature, mais de la différentiation résultant de la culture et de l’éducation »
(p. 127).
5 Ces textes sont remarquables aussi car, pied de nez à toute une tradition lettrée et bien
avant les mouvements politiques et sociaux des années 1920 en Chine, c’est une femme
qui prend la plume pour s’adresser aux femmes ; elle écrit à propos des femmes et pour
les femmes. Et c’est l’indignation qui anime sa plume, dès le Manifeste, texte concis mais
clair sur ses objectifs et idées. « Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les
hommes tyrannisent les femmes, mais on peut se demander, pourquoi les femmes
acceptent-elles leur soumission ? Serait-ce que le pouvoir des coutumes sociales et
l’enseignement de lettrés pédants aient réussi à faire plier et à dominer les femmes ? »
(p. 122).
6 Dans La Revanche des femmes, juillet 1907, sans doute son texte au style le plus dense et
original, He-Yin Zhen explore le processus de légitimation des inégalités de genre, par
le biais notamment du langage et des « enseignements », cet ensemble s’inscrivant
ensuite dans la législation et les mœurs. C’est donc là une première étape pour elle dans
la déconstruction des identités et rôles sexués, elle en dévoile la construction
culturelle, historique et politique dans la société chinoise. Plus encore que la
légitimation, c’est la « naturalisation » ― le fait de rendre naturel ― dont elle parle :
inscrire ces rôles et identités figées dans la nature, en tentant ainsi de faire croire aux
femmes que c’est là une « destinée naturelle » (p. 96), les empêchant souvent de
prendre conscience des injustices et de résister. Ainsi certaines femmes développent-
elles, à sa grande surprise et colère, des discours antiféministes, faisant le jeu de ceux
qui justifient les inégalités et œuvrent à les maintenir, et celles-ci, déplore He-Yin
Zhen, « font honte à la femme » (p. 97).
7 De l’examen de l’étymologie et du langage, elle conclut que la femme est « le nom du
rang le moins respecté » (p. 87), que les femmes sont « assujetties » et « accablées de
GLAD!, 04 | 2018
255
tâches » ― elle prend notamment l’exemple des caractères « domestique » 婢 et
« esclave » 奴 dans lesquels on retrouve le caractère de « femme » 女. De l’examen des
textes classiques, parmi lesquels le Canon des Poèmes et Le Livre des Rites ― dont elle tire
des citations éloquentes ― et des enseignements confucéens, elle conclut qu’ils ne sont
qu’« affronts aux femmes », ont « torturé leurs corps », les ont « enchainées », et
« restreintes ». Cet ensemble de « règles injustes », poursuit-elle, tente, par tous les
moyens, d’entériner l’infériorité des femmes et les forcer à la soumission et à
l’obéissance. Cette relecture des Classiques sous l’angle des discours misogynes et des
traditions patriarcales retient l’attention, tant elle semble pertinente et par ailleurs
salutaire en temps de sacralisation nationaliste de ces textes en Chine.
8 Elle prévient aussi les femmes contre la tentation de s’élever au-dessus de certaines de
leurs paires sans remettre en question les limites de leur propre liberté : « les femmes
européennes et américaines sont fières de se dire civilisées, mais pourquoi doivent-
elles se plier à la vieille coutume et abandonner leur nom de famille pour prendre celui
de leur époux ? Ne ressentent-elles pas qu’il y a là quelque chose d’absurde ? Je déplore
cette folie et je suis mortifiée de l’absence de conscience de leur propre humiliation »
(p. 80). Elle refuse par là le colonialisme idéologique des mouvements féministes
occidentaux, qui tenteraient de s’imposer comme modèle et norme de l’émancipation
des femmes, de par leurs prétentions à la « civilisation » et donc au rang des
« dominant.e.s », tout comme, plus loin, elle récuse ces mêmes tendances chez les
femmes de l’aristocratie ou de la bourgeoisie chinoise.
9 Dans Révolution économique et révolution des femmes, décembre 1907, He-Yin Zhen analyse
la domination des femmes sous l’angle économique et sexuel. « En Chine, les femmes
sont contrôlées par l’argent et la brutalité qui découle directement de l’argent » (p. 53),
résume-t-elle. De là, la prostitution, la pornographie et « toutes les formes
d’obscénité », découlent de la marchandisation du corps féminin : « lorsqu’un homme
voit une femme, ce qui apparaît devant lui est tout juste une marchandise que l’argent
peut acheter (…) il ne s’agit que de vente et d’achat de chair, une transaction fondée sur
l’argent » (p.55). Elle poursuit, « quand l’argent est l’essence des choses, le mariage
échappe non seulement à toutes les lois sur la liberté, mais il maintient les femmes dans
le carcan de la servitude ». Dans ce contexte, le mariage n’est qu’un « contrat
d’esclavage », dont elle résume ainsi les termes : « la femme met en gage son corps pour
l’homme, et elle met en place un prêt à perpétuité » (p. 56).
10 Si elle n’est pas opposée au mariage en tant que tel mais aux inégalités économiques et
sociales qui régissent les rapports entre les deux sexes, et ce notamment dans le
mariage tel qu’il est pratiqué, elle s’emploie à débusquer les rapports de pouvoir liés à
l’inégalité économique dans ces rapports sociaux : « c’est pourquoi, au lieu d’appeler ce
genre de transaction les relations entre les hommes et les femmes, il serait plus juste de
les appeler relations de classe entre pauvres et riches » (p. 64). Pour elle, la révolution
économique est donc indissociable de la révolution des femmes, ayant pour objectif de
« renverser le système de la propriété privée » et d’« abandonner toute forme
d’argent » (p. 66). La lutte des femmes est impossible sans lutte révolutionnaire plus
complète, comme la lutte révolutionnaire est impossible sans la lutte des femmes au
premier rang.
GLAD!, 04 | 2018
256
La lutte pour l’émancipation et la « libération »
11 Dans La question de la libération des femmes, septembre 1907, He-Yin Zhen passe en revue
les deux grandes « directions » qu’ont prises les luttes pour l’émancipation des femmes
à son époque : d’une part, les revendications pour l’indépendance économique ― c’est-
à-dire l’entrée des femmes dans le monde du salariat ― et d’autre part les
revendications pour l’entrée des femmes dans le monde du politique ― à la fois du côté
de l’électorat et de la représentation.
12 Elle commence alors par poser une nouvelle fois le constat fondamental qu’est le
mécanisme opérant de distinction nan-nü男女, littéralement « homme-femme », ou
« masculin-féminin », distinction et séparation nourries par l’imbrication entre un
système socio-économique et des enseignements moraux, et dont la séparation dedans-
dehors est emblématique. Elle fait de ce terme un concept pivot, un outil, dépassant la
simple signification relationnelle que ce terme prend encore aujourd’hui ― le
gouvernement chinois emploie par exemple le terme de 男女平等, nan nu ping deng,
« égalité homme-femme », et dans ce contexte le terme n’est pas un outil
épistémologique ou un outil critique, qui fait la spécificité de son emploi chez He-Yin
Zhen.
13 De par cette distinction établie comme fondement, les femmes sont reléguées au rang
d’« instruments pour fabriquer et nourrir la semence humaine » (p.17) et au rang de
propriété privée que les hommes achètent, protègent, possèdent. Or, elle démontre que
ni l’injonction à l’indépendance économique ni l’injonction à l’égalité politique ne
peuvent renverser ce système de domination, et elle prévient les femmes contre ces
« leurres », ces simulacres de liberté et d’égalité qui ne sont qu’une reproduction
déguisée des inégalités.
14 D’abord, la liberté du corps, explique-t-elle en substance, qu’elle passe par le travail
hors de l’espace clos ou par l’émancipation sexuelle des femmes, n’est pas liberté de
l’esprit, et de là, n’est pas une liberté réelle. En effet, l’indépendance économique cache
souvent un travail éprouvant, qui allie exploitation et humiliation pour nombre de
femmes, et qui ne fait en rien avancer leur lutte pour la liberté et l’égalité.
15 Ensuite, là où, aux États-Unis par exemple, prévalent théoriquement la monogamie, des
mœurs plus souples et des systèmes d’éducation égalitaires, le monde est toujours
« souverainement dirigé par les hommes », et « la prétendue égalité des genres n’existe
que sur le papier » (p. 25). À elle de conclure, « si nous décidons de suivre le modèle des
systèmes actuels européens et américains, nous n’obtiendrons qu’une liberté nominale
mais non réelle, et nous n’aurons des droits égaux que nominalement » (p. 25). Elle
rejoint là les discours d’autres intellectuel.le.s anarchistes de son époque, qui ne voient
pas dans le « progrès occidental » un modèle irrévocable et tentent de trouver un
équilibre idéologique dans leur rapport aux textes et traditions politiques européennes
et américaines.
16 De même, le système parlementaire, le système de la représentation, sont pour elle des
leurres, puisqu’ils sont enracinés dans les inégalités sociales, et participent aux
rapports de domination. « La majorité des femmes a toujours été opprimée par deux
forces majeures dans le monde : d’un côté, le gouvernement, l’Etat, et de l’autre les
hommes » (p. 42). C’est pourquoi elle engage les femmes à ne pas se satisfaire des
apparences, et à mener la lutte sans perdre des yeux l’objectif, c’est-à-dire l’abolition de
GLAD!, 04 | 2018
257
toutes les formes d’oppression. Elle prévient les femmes, formule particulièrement
frappante, contre les tentations de l’« auto-gratification » ; il ne faut, dit-elle en
substance, se satisfaire de l’obtention de quelques bouquets de droits et de quelques
étiquettes, car la lutte des femmes a pour objectif « la transformation du monde ». Ce
texte est un texte majeur pour approcher sa théorie politique anarchiste, notamment
concernant l’État et les systèmes de production.
17 Elle appelle les femmes à être actives et actrices de leur propre émancipation, unique
moyen pour parvenir au but, puisqu’elle démontre que les hommes de son époque
« poursuivent en réalité leur propre intérêt » lorsqu’ils appellent à la libération des
femmes et mettent en avant leurs propres agendas politiques et politiciens, souvent
conservateurs et nationalistes, sous couvert d’œuvrer prétendument pour les droits des
femmes.
18 Comme elle l’exprime dans Ce que les femmes devraient savoir à propos du communisme,
c’est l’abolition du système du salariat et de la propriété privée qui serait la
contrepartie économique de ce programme politique. Après avoir examiné trois cas,
que sont les servantes, les ouvrières et les prostituées, elle fait de la dépendance
économique ― le fait de n’avoir d’autre moyen de subsister que de se « déshumaniser »
― l’obstacle principal à la liberté et à la dignité des femmes. C’est la « mise en
commun » des richesses et la vie collective qui semblent alors la solution. Elle s’insère
là dans le courant d’idées anarcho-communistes qui prendra de l’ampleur dès 1915 ; ses
figures principales, Ba Jin ou Huang Lingshuang parmi d’autres, rejoignent He-Yin Zhen
sur de nombreux points dans leur développement théorique de la révolution anarcho-
communiste, sans pour autant développer leur pensée du point de vue des femmes,
mais de la « masse des opprimés » ― opprimés au masculin.
19 Le texte sans conteste le plus original de ce recueil est L’antimilitarisme des femmes,
décembre 1907, s’inspirant des années de conflits et guerres qui ont secoué l’histoire de
la région et alors même que la Chine s’engouffre dans plusieurs années d’instabilité
politique et de guerre civile. Elle y écrit que les femmes devraient s’opposer
viscéralement au militarisme, pour plusieurs raisons : les femmes sont d’abord les
premières victimes des violences liées à la guerre et aux conflits armés, par le viol, le
pillage et la mise en esclavage. La mort, l’appauvrissement et les dégâts des guerres
touchent d’abord les groupes sociaux défavorisés, qui sont toujours en première ligne,
et les femmes. Elle conclut que, « peu importe que la nation soit victorieuse ou vaincue,
les femmes n’ont rien à gagner des conséquences de la guerre » (p. 107). Or, de manière
également très intéressante, elle pousse l’argument plus loin, en arguant que non
seulement les guerres asservissent les peuples, et en premier lieu les femmes, mais de
plus, le militarisme et le système de la conscription servent d’arguments pour justifier
la supériorité masculine. Une des origines de l’inégalité résiderait donc également dans
la création des armées : « ceux qui s’opposent aux droits des femmes pointent le fait
que les femmes ne peuvent pas devenir soldats comme preuve de leur inégalité avec les
hommes » (p. 116). L’antimilitarisme est une priorité, pour les femmes en tant que
groupe opprimé, et au nom des groupes opprimés. D’une certaine manière, on
comprend par cet exemple pourquoi la vision de He-Yin Zhen du rôle des femmes dans
la révolution se rapproche du rôle d’avant-garde du prolétariat dans la révolution chez
Marx.
20 Le Manifeste nous fait plus largement réfléchir à l’ensemble des catégories et
distinctions, et avec elles, l’ensemble des normes d’appréciation ou de dépréciation, de
GLAD!, 04 | 2018
258
discrimination et d’oppression : certains groupes de personnes étant considérés plus ou
moins « civilisés », plus ou moins « humains », et maintenus comme tels. Elle nous
exhorte à nous attaquer aux racines, à remettre en question le système socio-
économique et politique jusque dans ses prémisses : elle nous fait réfléchir au système
du salariat, aux échecs et aux hypocrisies des politiques de la représentation, aux liens
étroits entre ceux qui dominent, et leur usage du militarisme et de la violence, à la
permanence aussi de certains enseignements et représentations culturelles et sociales.
21 C’est dans un style très didactique, avec un argumentaire minutieux, riche et illustré,
qu’elle nous livre une dénonciation vibrante de la construction des genres et ses
implications réelles pour les femmes. Une dénonciation vibrante également de la
prostitution et de l’asservissement pluriel des femmes, une indignation face à la
servitude volontaire dans laquelle nombre d’entre elles sont maintenues, le tout avec
une plume qui veut nous guider pour lutter et résister, en nous prévenant contre les
mots creux et les « droits nominaux », brandis comme des faire-valoir par ceux et celles
qui possèdent et ont le pouvoir.
22 On pourrait certes regretter dans cet ouvrage, bien que la transposition en français de
la prose de He-Yin Zhen soit un exercice difficile, certaines petites maladresses de
traduction et également des choix de traduction qu’il aurait été utile de commenter ou
de justifier. On pourrait aussi regretter l’absence d’une reproduction en caractères ou
en pinyin des termes et concepts clés, entre parenthèses ou en notes, pour que les
lecteurs.rices puissent connaitre l’expression originale en chinois, dont la traduction ne
permet pas toujours de rendre les subtilités ou le sens original. Toute une tradition
philosophique s’attache à reproduire les termes en langue originale dans la traduction,
notamment en allemand ou en anglais. On pourrait donc se demander pourquoi on ne
pourrait envisager ici la même chose en chinois.
23 Il aurait enfin été utile d’ajouter aux textes une analyse ou un exposé théorique et
critique des idées de He-Yin Zhen, ainsi que des éléments du contexte intellectuel et
politique à la place peut-être d’une postface ici consacrée à une féministe japonaise, car
même si cette mise en parallèle est intéressante, elle tend à masquer l’enjeu et la
spécificité des textes rassemblés.
24 Il demeure cependant tout à l’honneur de cette maison d’édition d’avoir entrepris de
publier ces textes, tant il est urgent de redécouvrir et de rendre audibles les idées de
He-Yin Zhen, à l’heure où les militantes féministes chinoises se battent pour continuer
à faire entendre leurs voix, où les recherches sur le féminisme chinois se concentrent
principalement sur des discours plus consensuels et beaucoup moins radicaux, et où il
semble primordial aussi de décloisonner et décoloniser l’histoire du féminisme.
BIBLIOGRAPHIE
LIU, Lydia, KARL, Rebecca & KO, Dorothy. 2013. The Birth of Chinese Feminism: essential texts in
transnational theory. New York: Columbia University Press.
GLAD!, 04 | 2018
259
NOTES
1. LIU, Lydia, KARL, Rebecca & KO, Dorothy. 2013. The Birth of Chinese Feminism: essential texts in
transnational theory. New York: Columbia University Press.
INDEX
Thèmes : Actualités
Keywords : feminism, China, anarchism, revolution
Mots-clés : féminisme, Chine, anarchisme, révolution
AUTEURS
AGATHE SENNA
ENS Lyon
Agathe Senna, ENS Lyon, histoire intellectuelle et politique de la Chine
GLAD!, 04 | 2018
260