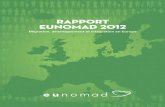Cuivre et alliages en Iran.....
Transcript of Cuivre et alliages en Iran.....
C. VolfovskyM. MenuL.p. HurtelS. CleuziouThierry Berthoud
Cuivres et alliages en Iran, Afghanistan, Oman au cours des IVeet IIIe millénairesIn: Paléorient. 1982, Vol. 8 N°2. pp. 39-54.
AbstractArsenic, lin, lead and zinc are the principal elements used in copper-alloys of Middle East objects from the IVth and IIIrdmillennia. On the basis of analytical results from the Laboratoire de Recherches des Musées de France and from the works of theR.C.P. 442 of the C.N.R.S., the evolution of the alloying technique has been demonstrated to occur discontinuously anddifferently from one region to another. Natural ressources, trade, technology, local particularisms, social structures allow toexplain the main patterns of this complex evolution.
RésuméL'arsenic, l'étain, le plomb et le zinc sont les principaux éléments que l'on trouve alliés au cuivre dans les objets moyen-orientauxdes ive et ine millénaires. Sur la base des résultats analytiques acquis au Laboratoire de Recherche des Musées de France et aucours des travaux de la R.C.P. 442 du C.N.R.S.. l'évolution de la technique des alliages apparaît s'effectuer de manièrediscontinue et variable d'une région à l'autre. Ressources naturelles, commerce, technologie, particularismes locaux, types desociété permettent d'expliquer dans les grandes lignes la complexité de cette évolution.
Citer ce document / Cite this document :
Volfovsky C., Menu M., Hurtel L.p., Cleuziou S., Berthoud Thierry. Cuivres et alliages en Iran, Afghanistan, Oman au cours desIVe et IIIe millénaires. In: Paléorient. 1982, Vol. 8 N°2. pp. 39-54.
doi : 10.3406/paleo.1982.4319
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/paleo_0153-9345_1982_num_8_2_4319
PAL.EORIENT. vol. 8 2 - 1982
CUIVRES ET ALLIAGES
EN IRAN, AFGHANISTAN, OMAN
AU COURS DES IVe ET IIP MILLÉNAIRES
T. BERTHOUD, S. CLEUZIOU, L P. HURTEL, M. MENU et С VOLFOVSKY
RESUME. - L'arsenic, l'étain, le plomb et le zinc sont les principaux éléments que l'on trouve alliés au cuivre dans les objets moyen-orientaux des ive et ine millénaires. Sur la base des résultats analytiques acquis au Laboratoire de Recherche des Musées de France et au cours des travaux de la R.C.P. 442 du C.N.R.S.. l'évolution de la technique des alliages apparaît s'effectuer de manière discontinue et variable d'une région à l'autre. Ressources naturelles, commerce, technologie, particularismes locaux, types de société permettent d'expliquer dans les grandes lignes la complexité de cette évolution. ABSTRACT. - Arsenic, lin, lead and zinc are the principal elements used in copper-alloys of Middle East objects from the ivlh and mrd millennia. On the basis of analytical results from the Laboratoire de Recherches des Musées de France and from the works of the R.C.P. 442 of the C.N.R.S., the evolution of the alloying technique has been demonstrated to occur discontinuously and differently from one region to another. Natural ressources, trade, technology, local particularisms, social structures allow to explain the main patterns of this complex evolution.
INTRODUCTION
La question des premiers alliages métalliques au Moyen-Orient a déjà fait l'objet de nombreuses études (1). Chimistes, archéologues, philologues collaborent depuis plus d'un siècle pour acquérir et interpréter les informations se rapportant a la pratique des alliages. Les grandes lignes de l'évolution qui conduit de l'utilisation du cuivre natif a une métallurgie standardisée du bronze ont maintes fois été évoquées.
Aujourd'hui, si ce schéma général reste valable, l'accumulation des données de fouilles et la multiplication des travaux de laboratoire ont mis en évidence un diachronisme de cette évolution en fonction des diverses régions concernées, ainsi que l'existence de variantes dans les techniques utilisées sur certains sites et a certaines périodes.
Les problématiques archéologiques actuelles, que ce soit l'apparition de l'état, la culture technique, les cultures régionales, ... nécessitent des informations extrêmement fines. Loin de relever d'une obsession du détail et du particularisme local, l'étude exhaustive de corpus d'objets métalliques est indispensable si l'on veut parvenir à dresser de la situation un tableau suffisamment riche, qui seul permettra de dépasser les énoncés généraux sur l'évolution de la métallurgie.
Bien entendu l'étude des alliages n'apporte guère d'informations par elle-même. Les informations qu'elle apporte doivent être restituées dans le processus plus général de la production métallurgique. On sait l'attention que les archéologues portent aujourd'hui au mode de production et à son contexte social. Le mode de production métallurgique centralisé que Nissen décrit a Uruk(2) ou le «Domestic mode of production» de Hauptmann et Weisgerber (3) ou encore la «Cottage Industry » de Nicholas (4) sont autant d'exemples de ces préoccupations.
On conçoit alors aisément a quel point des données détaillées sur la pratique des alliages sont importantes.
Nous nous proposons de présenter ici les grandes lignes des résultats obtenus au cours de deux programmes de recherches se recoupant d'ailleurs partiellement.
Le premier, conduit en collaboration entre le Département des Antiquités Orientales et le Laboratoire de Recherche des Musées de France, porte sur l'étude systématique de tous les objets à base de cuivre du D.A.O. Une première partie des résultats de ce programme a déjà été présentée (5).
Le second programme et celui de la R.C.P. 442 du C.N.R.S. qui a été mené en coopération entre le L.R.M.F., le Commissariat a l'Energie Atomique, les Universités de Paris I et Paris VI, porte sur la circulation du métal au Moyen-Orient aux IVe et IIIe millénaires avant J.-C.
(1) BERTHELOT 1889; DESCH 1928. 29. 31. 33: FORBES 1950; LIMET I960; CALEY 1964; CHARLES 1967: COGHLAN 1951. I960; DESHAYES I960; de JESUS 1972; LAMBERG-KAR- LOVSKY 1967; MOOREY 1969; MUHLY 1973. 1976; SELIMKHA- NOV I960: TYLECOTE 1976; WERTIME 1973.
(2) NISSEN 1970. 1971. (3) HAUPTMANN et WEISGERBER 1981 (4) NICHOLAS 1980. (5) TALON 1982.
39
Nous avons tenté, ici, une présentation synthétique des résultats obtenus de part et d'autre sur la pratique des alliages. On conçoit aisément qu'il n'est pas possible de faire état de tous les aspects des recherches qui ont été menées dans les deux cas; la synthèse des résultats rassemblés n'a pu être faite qu'au prix d'une réduction des informations communes aux deux programmes (6).
CADRE HISTORIQUE
Le sous-sol de la plaine alluviale de Mésopotamie et du Khuzistan ne recèle pas le cuivre dont les habitants de cette région firent un usage considérable à partir du IVe millénaire. Aussi durent-ils l'importer des régions voisines. Les fournisseurs potentiels ne manquent pas : la Turquie centrale et orientale, le Caucase, l'Azerbaid- jan, l'Iran central (Anarak). C'est vers les mines d'Ana- tolie et d'Iran occidental que se tournaient les archéologues, lorsqu'ils ne faisaient pas provenir le cuivre du Luristan où les fouilles clandestines mettaient au jour beaucoup de bronzes, ... mais cette région ne possède pas de mines de cuivre importantes (7).
Le cuivre a été travaillé en Iran dès le début du VIe millénaire, et une métallurgie apparaît pleinement développée â partir de 4500 avant J.-C. On connaît certes des exemples plus anciens d'outils en cuivre natif martelé, Cayônù Tepesi et Sùberde en Turquie, Tell Ramad en Syrie, etc., mais pour remarquables qu'elles soient, ces trouvailles ne s'inscrivent pas dans un contexte socio-économique qui permettrait de les considérer comme les produits d'une industrie spécialisée (8).
Une métallurgie élaborée était déjà attestée sur le plateau iranien par les fouilles anciennes de Tepe Sialk (9). Elle est maintenant bien documentée par les recherches de Tal-i-Iblis dans la région de Kerman(lO). Dès le niveau I, le plus ancien, apparaissent non seulement des objets de cuivre (ciseaux, épingles, anneaux, perles) mais aussi de nombreux restes de creusets, des scories et des fragments de minerais (malachite, azurite). C'est dans le cadre des cultures villageoises â artisanat différencié, installées au Ve millénaire dans tout le Moyen-Orient, que ces témoins indiquent une activité réellement spécialisée : la première métallurgie.
Par la suite, les trouvailles se généralisent en Iran (Tepe Yahya VC, Tepe Giyan VB) alors que la Mésopotamie en reste pratiquement dépourvue. Seul le contexte géologique explique que des sociétés de même niveau culturel aient eu un développement technologique différent : aucune ressource minière dans la vaste
plaine alluviale du Tigre et de l'Euphrate. C'est au IVe millénaire, lorsque se met en place un système politique suffisamment développé, que les échanges s'organisent à une échelle assez grande pour effacer les différences naturelles. Cette évolution est particulièrement manifeste en Elam (actuel Khuzistan iranien) lorsque l'on étudie la création de la cité de Suse, la naissance du pouvoir élamite et l'extension de sa domination sur le plateau iranien (11).
Vers le début du IVe millénaire, en effet, les villages de Susiane se regroupent, l'activité économique se concentre sur quelques grands sites et l'un d'eux domine très vite les autres : Suse. Des fouilles, pratiquement ininterrompues depuis 1884, ont permis de recueillir un important matériel rassemblé pour l'essentiel au Musée du Louvre. La quantité d'objets en cuivre provenant des niveaux les plus anciens (haches, miroirs, ciseaux, épingles, ...) est particulièrement remarquable pour une région dépourvue de ressources minières. Une économie organisée était nécessaire pour l'approvisionnement de la grande cité en produits agricoles et en matières premières.
Les fouilles de la dernière décade ont révélé une extension insoupçonnée de la zone d'approvisionnement de Suse aux environs de 3000. Déjà manifeste à l'analyse des fouilles anciennes (Tepe Sialk, Tepe Giyan), elle apparaît maintenant dans toute son ampleur avec la mise au jour ce qu'on a pu considérer comme des « comptoirs » susiens dans le Sud (Tal-i- Iblis, Tepe Yahya) et dans l'Est de l'Iran (Shahr-i- Sokhta)(12).
Vers 3000, Suse perd son autonomie et entre dans la zone d'influence mésopotamienne. L'écriture locale (proto-élamite) est remplacée par le cunéiforme mésopo- tamien, la culture matérielle est uniformisée. Certains sites iraniens présentent à ce moment une phase d'abandon (Tepe Sialk, Tepe Yahya, Tal-i-Iblis) alors que les cultures à céramique peinte du Baluchistan et du Seistan (Bampur, Shahr-i-Sokhta) gardent un caractère autonome. Si une circulation de matières premières et d'objets de luxe se maintient (vase en chlorite, objets en métal), elle n'a plus le caractère exclusif du commerce de comptoir élamite (13).
A partir du deuxième quart du IIIe millénaire les textes cunéiformes mésopotamiens indiquent que l'approvisionnement en cuivre s'effectue par le Golfe Persique(14). Ils évoquent une « montagne de cuivre de Makkan ». Ces mêmes textes indiquent qu'une étape dans le trajet de ce cuivre vers la Mésopotamie était Dilmoun, définitivement identifié aujourd'hui avec Bahrain (15).
Lorsqu'en 1928 Peaked 6) proposa d'identifier la « montagne de cuivre de Makkan » des textes cunéi-
(6) RCP 442 1983 à paraître. Pour les détails sur les techniques analytiques utilisées dans ces deux programmes, on se reportera à BERTHOUD et FRANÇAIX 1980.
(7) DESCH 1928. 1929, 1931. 1933. (8) MELLAART 1966; FRANCE-LANORD et CONTENSON
1973; DESHAYES 1969; de JESUS 1980. (9) GHIRSHMAN 1938. (10) CALDWELL 1967.
(11) AMIET 1966; LAMBERG-KARLOVSKY 1973; STEVE et GASCHE 1971 ; LE BRUN 1971.
(12) TOSI 1973. (13) DESHAYES 1977. (14) GELB 1970. (15) BIBBY 1969. (16) PEAKE 1928.
40
formes avec les mines anciennes d'Oman, il ne pouvait guère alimenter qu'une querelle de géographie historique. Toute la région s'étendant à l'Est du Shatt el-Arab était, à cette époque, un « désert » archéologique.
Les fouilles de l'équipe danoise à Bahrain et Umm an-Nar ont apporté des arguments nouveaux en faveur de l'identification d'Oman avec le pays de Makkan. Sur le piémont et dans les grandes vallées des montagnes, un ensemble de cultures agricoles locales a été reconnu (17); celles-ci ont pu exploiter le cuivre et en assurer le commerce, sous quelques modalités que ce soit.
Aux confins du monde iranien, dès le IVe millénaire, une métallurgie du cuivre est bien attestée à Mundi- gak(18), Shahr-i-Sokhta(19) et d'une manière générale sur les sites afghans de cette période (20). Le lapis-lazuli, dont la seule source est située dans le Badakhshan (mine de Sar-e-Sang) à l'extrême Est de l'Afghanistan, se répand à cette époque dans le monde iranien et, de là, vers les cultures plus occidentales (Mésopotamie puis
(17) CLEUZIOU 1980: WEISGERBER 1981 (18) CASAL 1961. (19) TOSI 1968. (20) LAMBERG-KARLOVSKY 1967.
Egypte) (2 1 ). La preuve d'échanges sur d'aussi longues distances est ainsi attestée de manière irréfutable et un certain nombre d'indices archéologiques tendent à prouver que le commerce particulier du lapis-lazuli n'est pas indépendant d'échanges affectant la production métallique, cuivre et étain en particulier (22). La découverte d'une tablette proto-élamite au niveau I du site de Shahr-i-Sokhta (23) confirme l'existence de contacts entre Suse et la zone orientale du désert iranien (24).
Le cadre de notre étude s'étend donc depuis la plaine mésopotamienne jusqu'aux montagnes d'Oman et à la frontière pakistano-afghane.
(21) HERMANN 1968. Des recherches récentes ont montré l'existence d'une source de lapis-lazuli au Pakistan, non loin de la frontière iranienne. L'existence de cette source de lapis-lazuli, si elle modifie sensiblement l'interprétation que l'on peut avoir de la présence de ce minéral sur les sites de l'Iran oriental, ne modifie pas les données principales de son commerce à destination de la Mésopotamie.
(22) MUHLY 1973. (23) TOSI 1973. (24) DESHAYES 1977.
41
LES ALLIAGES
Cet aspect de la métallurgie du cuivre est certainement celui qui a été le plus étudié, tant du point de vue des analyses que de celui de leurs implications archéologiques. Childe, Renfrew et Wertime ont ainsi proposé des modèles évolution nistes (25), intégrant les techniques d'alliage, les techniques de façonnage, la forme et l'utilisation des objets. Heskel et Lamberg-Kar- lowsky(26) ont montré que l'état actuel des données analytiques ne permettait plus de se satisfaire de ces modèles trop généraux. Deshayes (27) a tiré de l'approche typologique des conclusions historiques partielles, mais a également mis en évidence les limites d'une telle démarche. Coghlan, Caldwell, Pleiner et Smith ont à juste titre insisté sur l'importance de la pyrotechnologie dans la maîtrise des alliages et la fabrication des objets (28).
Au cours des dix dernières années, de nombreuses études ont démontré l'étroite complémentarité des données sur les ressources minérales, la minéralurgie, les alliages et l'utilisation des objets. Ceci vaut en particulier pour le problème du cuivre à l'arsenic (29). Les travaux de Limet et ceux de M uhly ont également attiré l'attention sur l'intérêt des sources cunéiformes en ce domaine (30).
L'information textuelle
Les textes sumériens nous fournissent une remarquable documentation sur les alliages utilisés à la fin du IIIe millénaire. Ceci apparaît notamment dans la synthèse qu'en donne Limet (31) pour la IIIe dynastie d'Ur. Les alliages mentionnés sont toujours des bronzes à l'étain, qui apparaissent dès les époques antérieures, dans les textes lexicographiques de Fara. La première recette de fabrication figura dans un texte présargoni- que(32) il s'agit d'un bronze à une partie d'étain pour six de cuivre. C'est cette proportion qui est la plus fréquente dans les textes de la IIIe dynastie d'Ur : le bronze 7-lal (soit 14%). On connaît également un bronze 10-lal (9%), un bronze 8-lal (12,5%) et un bronze 6-lal (17 %). Il est difficile de savoir s'il s'agit là d'étain sous forme métallique ou de cassitérite. Dans ce dernier cas, les teneurs en étain dans les objets seraient légèrement inférieures à celles que nous venons de mentionner. Ce qui est certain, c'est qu'à cette époque les proportions sont depuis longtemps parfaitement standardisées.
(25) CHILDE 1934; RENFREW 1972; WERTIME 1973. (26) HESKEL and LAMBERG-KARLOVSKY 1980 : 229. (27) DESHAYES 1960. (28) COGHLAN 1942; CALDWELL 1967; PLEINER 1980;
SMITH 1965. (29) Me KERREL and TYLECOTE 1972; MARECHAL 1958. (30) LIMET 1960 : 58-74, 121-124; MUHLY 1973 ; 243-244. (31) LIMET 1960 : 58-74. (32) Ibid : 67.
D'après Limet, le plomb n'est jamais attesté, sauf une fois pour la fabrication d'une statue, vraisemblablement en liaison avec la couleur qu'on souhaitait obtenir. Le même auteur ne mentionne jamais de bronze à l'arsenic, mais fait souvent état de l'adjonction de Sù-gan, dans des proportions de 0,5 à 1 %, et traduit ce terme par antimoine. Néanmoins cette identification est loin d'être assurée, d'autres possibilités comme le zinc, sous forme de calamine, l'arsenic ou même le plomb ayant été proposées par divers auteurs (33).
Cette absence de référence à l'arsenic dans les textes ne manque pas d'étonner, alors que nos analyses révèlent son utilisation constante dans la métallurgie mésopotamienne du IIIe millénaire. C'est là un point sur lequel nous aurons à revenir dans la suite de cette étude.
Les éléments d'alliage dans les minerais
D'un point de vue métallurgique, aux périodes qui nous occupent ici, les éléments susceptibles d'être ajoutés volontairement au cuivre pour en faciliter la coulée ou en modifier les propriétés sont l'arsenic, l'antimoine, l'étain, le plomb et le zinc.
Avant de passer à l'étude détaillée de ces éléments dans les objets, telle qu'elle ressort de nos analyses, il convient de prendre en compte les teneurs de ces éléments telles qu'on les décèle dans les minerais des zones cuprifères échantillonnées au cours des travaux de la R.C.P. 442.
Ces diverses zones sont représentées sur la carte n° 1 . Une centaine de mines ont été étudiées. L'échantillo- nage couvre l'essentiel des indices cuprifères se trouvant au Sud d'une ligne s'étendant de Bagdad à l'Amou Daria. 500 échantillons ont été analysés par diffraction X ; les résultats obtenus ont permis de sélectionner 70 échantillons représentatifs de l'ensemble qui ont été analysés par spectrométrie d'émission et spectrométrie de masse à étincelles. La base de données géochimiques ainsi formée a fait l'objet de traitements statistiques qui ont montré qu'elle décrivait bien l'ensemble des unités structurales prises en compte. Ainsi cette base de données réalise une description appropriée des provinces métallogéniques de la zone étudiée.
A rsenic La donnée la plus importante pour notre étude est la
présence d'arsenic dans le cuivre natif de Talmessi (Iran, région d'Anarak). D'après les analyses, la teneur varie de 0,04% à 1 ,7 % avec une moyenne autour de 0,8 % . L'arsenic est d'ailleurs présent dans cette zone sous d'autres formes minérales (34).
Dans les autres minerais échantillonnées au cours du programme (Iran, Afghanistan, Sultanat d'Oman), la teneur moyenne en arsenic est de l'ordre de 0,01 %. Trois échantillons seulement présentent des teneurs de
(33) Ibid: 56-58. (34) BARIAND 1963.
42
l'ordre de 0,3 % à Tang-e-Chenah et Tal-i-Homi en Iran. Anguri en Afghanistan.
L antimoine Les teneurs en antimoine dans les minerais sont
généralement inférieures à 10 ppm. La seule exception notable est un échantillon de Tang-e-Chenah (Iran, région de Yazd), qui contient 2,5 % ďantimoine.
L éiain Les concentrations en étain sont généralement de
Tordre de quelques ppm, avec une seule exception notable pour Misgaran, en Afghanistan occidental, où nous avons relevé des teneurs de 150 à 610 ppm. Rappelons que la mine de Misgaran n'est située qu'à une cinquantaine de kilomètres au Nord de Sarkar, où la prospection de la R.C.P. 442 a étudié de nombreux indices stannifères. Toute la région est d'ailleurs riche en indices stannifères (35).
Le plomb Les teneurs en plomb sont relativement variables en
Iran et en Afghanistan, de quelques ppm à 1 % environ. Les teneurs les plus élevées sont celles décelées en Iran oriental à Qaleh Zari -.2% et 4 % . Elles sont très faibles en Oman avec une moyenne inférieure à 1 ppm et un maximum à 4 ppm, à Niba.
Le zinc A Tchehel Kureh (Iran oriental) et à Nizwa (Oman),
nous avons observé de la rosacite, qui est un carbonate mixte de cuivre et de zinc (Zn, Cuh (СОз) (OHh. La teneur en zinc des minerais analysés atteint 2,5 % à Tchehel Kureh; mais elle est très faible à Nizwa et la présence de rosacite dans ce cas pourrait être un accident minéralogique. Toutefois, en Oman, des teneurs en zinc de quelques milliers de ppm sont fréquentes.
Ailleurs, les teneurs en zinc s'échelonnent, selon les contextes géologiques de quelques ppm à quelques % , les plus fortes teneurs étant observées en Iran oriental : Sheihk Ali (3,2 %) et Qaleh Zari (6,5 %).
Les éléments d'alliages dans les objets
On se reportera aux publications spécifiques des deux programmes mentionnés plus haut pour l'ensemble des informations sur les objets formant le corpus dont nous présentons la synthèse des résultats.
Le tableau A fournit les informations principales concernant les divers groupes d'objets. Ce tableau donne les valeurs moyennes de concentration des 5 éléments pour les ensembles d'objets pris en compte (il s'agit de moyennes géométriques qui sont les plus
représentatives compte tenu de la dispersion et de la répartition des concentrations observées) (36).
La comparaison des teneurs de ces éléments entre les minerais et les objets indique que l'arsenic, l'étain et le plomb ont été ajoutés délibérément sur certains sites et à certaines époques. L'association est rarement systématique, mais parfois les teneurs sont suffisamment élevées pour parler d'alliage véritable. C'est en particulier le cas pour l'arsenic à Suse à partir de la période II, en Mésopotamie, dans le Golfe à Sialk et à Mundigak; l'arsenic a pu être également ajouté sur quelques objets de Tepe Yahya. L'adjonction d'étain est manifeste sur certains objets à Suse à partir de la période IV (DA III B), en Mésopotamie et dans le Golfe. Le plomb est ajouté à Suse, période II, dans 2 objets de Mundigak et à Shortugai, il semble que cela soit aussi le cas.
On étudiera maintenant plus en détail les résultats obtenus pour chacun de ces éléments.
L arsenic On sait l'importance de l'arsenic dans les débuts de la
métallurgie et nos analyses confirment largement ce point. Sur le corpus étudié les concentrations s'échelonnent de 1 4 ppm à 9,2 % .
Le tableau В qui donne les histogrammes de répartition des concentrations en arsenic pour les divers groupes montre des distributions très variables :
- Les 3 groupes où la variation est la plus forte sont aussi ceux où les valeurs moyennes en arsenic sont les plus faibles (Suse période I, 1 500 ppm; Tepe Yahya 700 ppm et Shahr-i-Sokhta 2 000 ppm).
D'après les expériences de Tylecote(37), un minerai contenant 0,05 % d'arsenic (500 ppm) a produit du cuivre à 0,2-0,3 % d'arsenic (200-3 000 ppm); la teneur en cuivre du minerai, utilisé au cours de cette expérience était de 23,7%. Cela signifie que l'arsenic contenu dans le minerai est entièrement passé dans le cuivre et réduit.
Des conclusions similaires ont été obtenues à partir des divers modèles de transformation minerais-objets dans les travaux de la R.C.P. 442 (38).
Si l'on considère qu'en dessous de 0,3 % l'arsenic provient avec certitude du minerai de cuivre, ce n'est qu'à Suse (période I), Tepe Yahya, Shahr-i-Sokhta et Shortugai que les cuivres non alliés à l'arsenic sont attestés de manière significative.
Pour interpréter complètement le tableau B, il faut tenir compte des conclusions sur la provenance des minerais de cuivre utilisés (39). En particulier il a été établi que les objets de Suse (période I) et d'Hamrin ont été fabriqués avec un cuivre provenant de la région d'Anarak. Dans la mesure où les teneurs en arsenic de ces minerais sont usuellement de l'ordre de 1 % , les
(35) CHMYRIOV et al. 1977.
(36) BERTHOUD 1979 : 56 et 62. (37) CRADDOCK 1980a: 167. (38) BERTHOUD 1979 : 119. (39) RCP 442 1983. a paraître.
43
TABLEAU A
Référence des groupes d'objets
MÉSOPOTAMIE (IIIe millénaire)
HAMRIN (protodynastique 1)
OMAN (IIIe millénaire)
SIALK (III - IV) (IVe millénaire)
TEPE YAHYA (IVe et IIIe millénaire)
SHAHR -i-SÛKHTA (IIIe millénaire)
MUNDIGAK (IIIe millénaire)
SHORTUGAI (Début IIe millénaire)
SUSE * (ensemble)
Période 1 Suse A
Période II Suse В
Période III Suse С
Période IV<
Période V <
Suse DA III A
Suse DA III B
Suse Agadé
Suse Ur Ml
Suse Isin Larsa
Nombre d'objets
25
13
12
10
13
17
10
11
452
65
31
7
19
46
41
20
92
As
9000
6000
8000
18000
2000
700
11000
4000
8700
1500
11300
24000
18000
12000
14000
4300
9200
Sb
1000
300
180
1500
54
27
190
42
340
110
660
600
260
40
580
40
640
Sn
2400
8
450
14
28
33
328
130
500
30
80
80
40
310
620
70
13000
Pb
6000
600
100
8000
2000
2000
4500
5000
1300
180
12000
1300
1200
430
2000
460
1600
Zn
3500
27
21
360
120
300
20
50
40
10
20
110
10
10
30
25
110
Les teneurs sont exprimées en ppm (lOOOOppm =1%) Pour la définition exacte de la chronologie de Suse, on se reportera à TALON 1982 et LE BRETON 1958. 131 objets de Suse ne sont affectés à aucun groupe chronologique.
teneurs observées sur les objets, le plus fréquemment pratique d'alliage volontaire à faible teneur; le résultat, comprises entre 0,3 et 3 % , peuvent aussi bien s'expli- quant aux propriétés du métal obtenu, est identique, quer par l'emploi de ce type de minerai ou pour une _ Pour tous ,es autres groupes ďobjets des teneur§
44
supérieures à 1 % sont fréquentes (Oman, Tepe Yahya, Suse (période II). Suse (période Isin-Larsa). ou même la règle générale (Suse, périodes III et IV), Mésopotamie, Sialk, Mundigak). L'introduction volontaire d'arsenic devient doncune pratique usuelle à Suse à la période III (la période II apparaît nettement comme une période de transition) et est générale en Mésopotamie, dansle Golfe, à Sialk et à Mundigak.
A Suse. à la période V, l'usage du cuivre à l'arsenic commence à décliner.
Pour des sites comme Suse (périodes II et III), Sialk, Tepe Yahya, on peutraisonnablement penser que l'arsenic ajouté provient d'Anarak. Cela est d'autant plus plausible que cette pratique est attestée à une période où les contacts entre Suse, Sialk et le Sud-Est de l'Iran sont étroits (période proto-élamite), période qui fait suite à une époque où déjà le cuivre lui-même vient d'Anarak (Suse période I, Tepe Yahya VA).
En ce qui concerne la Mésopotamie du IIIe millénaire et Suse (période IV), il est difficile de penser que les contacts avec Anarak se maintiennent alors que le cuivre vient par un tout autre circuit. On ne peut cependant pas exclure cette hypothèse. L'autre source d'arsenic généralement envisagée est l'Arménie avec laquelle les contacts ne sont pas beaucoup plus évidents (40).
Le même problème se pose sur les objets d'Oman, dont certains ont des teneurs en arsenic de près de 7 % , alors que celles observées dans les minerais ne dépassent pas 690 ppm. Nous sommes là encore devant un problème pour lequel nous n'avons pas de solution. Il est certain que l'arsenic était importé, mais nous ne savons pas d'où, ni sous quelle forme.
L'emploi de l'arsenic a été souligné par de nombreux auteurs, et on a même parlé de « provinces » de métallurgie à l'arsenic au Caucase, en Europe Centrale, ou plus récemment en Asie Centrale. En Bactriane (Shortugai) son usage semble se réduire au début du IIe millénaire mais reste attesté sur quelques objets. Cependant, la provenance de cet arsenic n'a jamais été clairement envisagée sinon pour les cas d'approvisionnement local.
Ceci amène à s'interroger sur certains aspects des textes cunéiformes oùl'interprétation de nombreux termes demeure incertaine. Ainsi Limet(41) hésite-t-il pour la traduction du terme Sù-gan entre antimoine et arsenic, choisissant finalement le premier. On ne peut être que frappé par l'absence de toute référence à l'arsenic dans les textes, alors que le bronze à l'arsenic était encore fabriqué à la période d'Akkad. Faut-il rechercher l'arsenic (ou le bronze a l'arsenic) dans un des nombreux termes mentionnés par Limet comme ayant déjà disparu à la période de la IIIe dynastie d'Ur ?
Si l'arsenic ne figure jamais dans les traductions des philologues, cela peut être simplement dû à leur méconnaissance du problème des alliages a l'arsenic tel qu'il a été posé ces vingt dernières années.
tion de certains termes est en effet très difficile et le traducteur n'a souvent pas d'autre possibilité que de se référer aux connaissances analytiques disponibles sur la métallurgie de l'époque, au moment où il écrit. Il n'est donc pas surprenant de voir Limet en 1960 ignorer les possibilités de l'arsenic en tant qu'élément d'alliage, et n'y voir qu'un concurrent possible de l'antimoine pourla traduction de Sù-gan, une matière employée comme agent de fluidité ou de désoxydation. En l'occurrence, l'arsenic est un bien mauvais candidat puisque le mot Sù-gan n'apparaît que sous la IIIe dynastie d'Ur alors que l'arsenic était sans doute déjà utilisé en Mésopotamie depuis un millénaire.
L antimoine L'introduction volontaire d'antimoine a été souvent
évoquée mais les teneurs supérieures à 1 % sont tout à fait exceptionnelles. Certains objets révèlent des concentrations comprises entre 0,2 et 1 % en particulier à Suse (périodes I et II) et Suse (période Isin-Larsa) ainsi qu'à Sialk.
D'un point de vue minéralogique l'antimoine est fréquemment lié à l'arsenic ou au plomb et ces teneurs intermédiaires semblent effectivement liées à la présence de l'un ou l'autre de ces éléments.
Si l'antimoine peut servir pour l'identification des origines de l'arsenic et du plomb, aucune pratique systématique d'alliage a l'antimoine ne peut être envisagée.
Le plomb De fortes teneurs en plomb caractérisent les objets de
Suse (périodes II et III, jusqu'à 15 % pour une épingle). A la même époque, un petit objet coulé à la cire perdue est attesté dans l'inventaire du « Sammelfund » d'Uruk (43). La question des alliages au plomb se pose de manière différente. Les autres catégories d'alliages, dans la mesure où il est vraisemblable que le plomb était alors isolé en tant que métal, ce qui n'était certainement pas, aux alentours de 3000, le cas de l'arsenic, de l'antimoine (isolé sous sa forme métallique à la fin du IIIe millénaire semble-t-il (44)), du zinc; on ne sait pas ce qu'il en était alors pour l'étain. De nombreux vases en plomb sont par contre attestés à Suse (périodes II et III) ou, en Mésopotamie, au cimetière Jemdet Nasr à Ur(45). Les fouilles récentes de M.Tosi sur le South Hill à Tepe Hissar (début IIIe millénaire), celles de I. N. Nicholas dans le niveau III de la phase Banesh (fin IVe millénaire) sur l'opération T.U.V. à Tal-i-Malyan montrent que le plomb était travaillé sur les mêmes lieux que le cuivre (46). Il est donc vraisemblable que des alliages cuivre-plomb aient été expérimentés à cette époque, qui voit aussi les premiers alliages à l'étain (cf. infra).
(40) MUHLY 1976 : 90. (41) LIMET 1960 : 55-58.
(42) LIMET 1960. (43) MOOREY 1982a (44) MUHLY 1976. (45) MOOREY 1982a (46) PIGOTT 1980.
23.
45
1000 80 60 40 20
100 80 60 40 20 100 80 60 40 20
100
TABLEAU B Histogrammes de fréquence pour l'arsenic. >3% 300 3000 1 à <300 à 3000 à 1 % 3%
Su se
1 ' — -
Su se
1 \ Suše
Période IV (ensemble)
DA III A
DA III B
Agade
Période V (ensemble)
Ur
I sin Larsa
Suse- TOTAL
46
TABLEAU B (Suite)
00 80 60 40 20
300 3000 1 à ъ < 300 à 3000 à 1 % 3 % ^
«^
Mésopotamie
3 % 100 80 60 40 20
Г I i
■ ! / \ à., i Sialk
100 80 60 40 20
Hamrin Shahr — j — Sokhta
100 80 60 40 20
Oman Mundigak
Yahya
uu 80 60 40 20
j |
Shortugaï
Comme on Га noté plus haut, Limet exclut les possibilités d'alliage au plomb en Mésopotamie pour la IIIe dynastie d'Ur, sauf dans un cas où il s'agit de donner une couleur particulière à l'objet (47).
Les alliages binaires cuivre-plomb sont abandonnés au cours du IIIe millénaire, dans le même temps où la métallurgie du plomb paraît, elle-même, en régression.
A la période Isin-Larsa, à Suse, le plomb est toutefois encore attesté mais dans des alliages complexes. Il est alors associé à l'étain et parfois à l'arsenic. Il s'agit dans ces cas là de poignards et pointes de flèche et l'usage de tel type d'alliage ternaire doit être lié à un compromis élaboré entre les procédés de fabrication et la qualité du métal obtenu.
L étain L'interprétation de nos analyses permet de classer les
teneurs en étain dans les objets en 4 catégories avec les seuils suivants : 500 ppm, I % , 5 % . La répartition des objets de chaque groupe est donnée dans le tableau C.
On peut aisément interpréter deux de ces classes. Au-dessous de 500 ppm, on considérera qu'il n'y a eu aucun ajout significatif d'étain, les teneurs observées provenant du minerai. Craddock (48) met cette limite vers 1000 ppm pour Timna.
Au delà de 5 % , il s'agit sans aucun doute possible d'un bronze de fabrication délibérée. A deux exceptions près (de Suse période II), on ne trouve ces objets qu'à partir du second tiers du IIIe millénaire, au Khuzistan (Suse période IV) et en Mésopotamie (principalement les tombes royales d'Ur). Le seul objet du Golfe appartenant à cette catégorie (qui provient de Hili A), doit sans soute être daté d'une époque un peu plus tardive (fin du IIIe millénaire). Ces analyses confirment celles de Desch (49) pour les tombes royales d'Ur (50), ou les objets de Kish, ainsi que des analyses de Khafadje(51). Il est intéressant de noter qu'au IIIe millénaire aucune corrélation particulière n'apparaît entre la teneur en étain et le type d'objet, les fortes teneurs en
(47) LIMET 1960 : 23-24.
(48) CRADDOCK 19806: 104. (49) DESCH 1978-79 : 31-33. (50) LIMET 1960 : 64. (51) DELOUGAZ 1940: 152.
47
Tableau С
ETAIN
total Suse Suse A - période I Suse В - période II Suse С - période III
Période IV (ensemble)
IIIA
DAm В Agadé
période V (ensemble)
Ur III
I sin Larsa Mésopotamie Hamrin Oman Tepe Yahya Sialk Shahr-i-Sokhta Shortugaï Mundigak
Nb total d'objets
458 65 31
7 191
19
49
41 116
20
9? 25 13 51 13 10 17 11 10
< 500 ppm
270 63 25 6
125
18
29
23 32
16
14 9
13 5
12 10 15 10 9
500 ppm à
1 % 80 2 3 1
38
1
14
9 18
1
16 7
5 1
2
1
1-5 %
42
1
8
2
3 21
1
20 4
1
> 5 %
86
2
20
4
6 55
2
52 5
1
étain correspondant aussi bien à des vases (8 % pour un vase de la tombe de Shubad à Ur, 10,9 %, 9,2 % pour des récipients du « Vase à la cachette » de Suse période IV, ...) qu'à des outils ou à des armes. On notera cependant que, bien que les alliages à l'étain restent minoritaires, tant à Suse (période IV) que dans les tombes royales d'Ur où la vaisselle et les bijoux tiennent une place importante.
Les deux classes intermédiaires ne sont valablement représentées que dans les trois mêmes ensembles : période IV de Suse, Mésopotamie et Oman. Ces teneurs, et notamment les plus basses (de 500 ppm à 1 % ), ne peuvent s'interpréter comme provenant du minerai que dans le cas où il est possible de démontrer l'utilisation d'un minerai, à forte teneur en étain, du type de ceux que nous avons relevés dans l'ouest de l'Afghanistan à Misgaran : 150 ppm pour une malachite, 610 ppm pour une chalcopyrite. Or, si l'on excepte l'Afghanistan occidental, les teneurs en étain des minerais étudiés sont
toujours très basses, et plus particulièrement pour l'Oman d'où provient le cuivre utilisé dans la fabrication de ces trois ensembles d'objets. Dans ce dernier cas, en effet, les teneurs décelées sont de 0,1 8 à 6,1 ppm, la moyenne étant inférieure à 1 ppm. On peut dès lors considérer avec certitude que l'étain décelé dans tous les objets de ces trois ensembles a bien été ajouté au cuivre, dès que sa teneur dépasse 500 ppm.
La raison de ces additions, surtout lorsqu'elles sont comprises entre 500 ppm et 0,5 % ne sont pas évidentes. Il est certain qu'au dessous de 1 % , l'effet de l'étain sur les propriétés de l'alliage devrait être faible. On doit donc envisager son utilisation comme désoxydant ou comme fondant si l'addition d'étain a lieu au moment de l'obtention du métal à proximité de la mine, comme à Timna(52), soit comme désoxydant ou comme agent de fluidité si l'opération a lieu au moment de la
(52) CRADDOCK 1980 : 172.
48
fabrication des objets. L'analyse des scories résultant des opérations de réduction relevées sur les mines et les sites archéologiques n'ayant révélé que des teneurs en étain de l'ordre de 15 à 20 ppm, l'utilisation d'étain sur les sites de réduction n'est pas attestée dans la région qui nous concerne.
Cette dualité entre l'étain comme élément d'alliage et l'étain comme auxiliaire dans la coulée du métal apparaît bien dans les textes sumériens selon qu'il est ajouté dans les proportions standard de 1/6, 1/7, 1/8 ou 1/10 pour produire un bronze (53) ou en très petite quantité, 1 % ou moins, pour aider à la fabrication d'un objet en cuivre. Dans le dernier cas, il est souvent remplacé, en proportion comparable, par du Sù- gan (54). Les cas intermédiaires où l'étain est présent à des teneurs de quelques % ne sont toutefois pas très clairs.
Nous ignorons si l'étain était introduit sous forme métallique ou sous forme de cassitérite. A Timna au IIe millénaire, il semble qu'il le soit sous forme métallique (55). On sait qu'en Mésopotamie, à l'époque de la IIIe dynastie d'Ur, l'étain était, selon les textes, utilisé pour fabriquer des objets, mais il semble que cela soit très rare (56). L'étain métal est donc connu, mais nous ne savons pas si c'est ainsi qu'on l'utilisait dans le travail du cuivre, et pour les périodes antérieures, nous ne savons rien.
L'origine de l'étain utilisé dans la métallurgie orientale est longtemps restée obscure. Il n'y a pas au Moyen-Orient l'équivalent des cuivres stannifères de la Cornouaille, du Hartz, de Bohème ou d'Espagne, qui jouèrent un rôle prépondérant dans la métallurgie protohistorique de l'Europe, et même sans doute dans celle du Levant, à partir du IIe millénaire. Il a fallu dès lors se tourner vers les possibilités de galets ou de paillettes dans les lits de rivières, et tous les indices géologiques, si ténus soient-ils, ont été tour à tour candidats à l'approvisionnement en étain de l'Orient au IIIe millénaire : torrents côtiers de la région de By- blos (57), bassin de la Sakariya en Anatolie, Delta du Sefid Rud et rivières du Luristan en Iran occidental (pour ces dernières d'après les géographes arabes Muqaddasi et Mustawfi), Seistan (d'après Strabon). L'absence de ressources comparables à l'heure actuelle ne pouvait pas être considérée comme une preuve, dans la mesure où les gisements en question risquaient d'avoir été complètement exploités dans l'antiquité. Les recherches, infructueuses, de T. Wertime(58) ont la
rgement dissipé ces illusions, au moins pour ce qui concerne l'Iran, où la pauvreté en étain des granites exclut qu'aucun dépôt alluvial aujourd'hui épuisé ait pu exister.
Si l'on se tourne vers les textes anciens, tout laisse croire qu'au IIIe millénaire, l'étain vient de l'Est. On sait
que Mari importait de l'étain d'origine orientale, qui était ensuite, en partie, acheminé vers la Syrie et la Palestine. De même, les tablettes cappadociennes montrent elles que l'étain était acheminé d'Assur vers l'Anatolie centrale.
Sans entrer dans les détails d'interprétation des textes (voir sur ce point Muhly(59)), on peut distinguer deux routes possibles, l'une par voie de terre, le long de la grande route du Khorassan, l'autre par voie maritime, via le commerce du Golfe. Dans les deux cas, l'étain est associé au lapis-lazuli. La première fait référence au royaume d'Aratta dont « les bastions sont de lapis- lazuli », « le sol est de pierre d'étain », encore que cette traduction ne soit pas évidente. La seconde, s'appuie sur un texte de Gudea de Lagash (2 1 50-2 1 1 1 ) qui mentionne l'étain de Meluhha.
On a objecté contre cette seconde route l'absence complète d'étain dans les objets du Golfe au IIIe millénaire, à partir d'analyses (non publiées) effectuées sur des objets de Bahrain, qui ne contenaient pas d'étain (60). Ces conclusions générales sur l'absence complète de l'étain sont maintenant contredites par nos propres résultats sur le matériel de Hili et Umm an-Nar, dans la Péninsule d'Oman.
Même si on admet que l'étain venait de Meluhha cela ne résout pas la question :
- on ne sait pas où se situe exactement Meluhha, dans lequel on s'accorde généralement à reconnaître la vallée de l'Indus et/ou le Baluchistan;
- il n'y a pas d'étain dans ces régions. S'il faut donc admettre selon Muhly(61) que l'étain
ne faisait que transiter via Meluhha, d'où venait-il ? Certains auteurs sont allés jusqu'à envisager l'hypothèse d'une origine plus orientale : le Rajasthan et le Bihar en Inde (62), voire les riches gisements de Thaïlande.
A l'heure actuelle, deux sources d'étain nous paraissent intéressantes à considérer. La première est la vallée de la Zeravshan, en Uzbekistan, où les archéologues soviétiques font remonter l'exploitation jusqu'au début du second millénaire (63). La seconde est située dans l'Ouest de l'Afghanistan, au Sud d'Hérat. Cette région où plusieurs gisements stannifères sont mentionnés par les géologues (64) est la seule où les prospections de la R.C.P. 442 aient permis de recueillir des minerais de cuivre ayant quelques teneurs en étain; il s'agit de la mine de Misgaran où la zone minéralisée s'étend sur plusieurs kilomètres évoluant d'une minéralisation cuprifère à une minéralisation stannifère, des traces d'exploitation protohistorique étant manifestes dans la zone cuprifère. Un peu plus au sud, dans la vallée de Sarkar, un lavage à la battée des sables granitiques a fourni un concentré assez riche en cassitérite. Ces sables proviennent de l'altération des granites stannifères environnants où la minéralisation en étain est locale-
(53) LIMET 1960: 67-73. (54) Ibid . 122-124. (55) CRADDOCK 1980 : 171 (56) LIMET 1960 : 52. (57) LANTIER 1949: 75. (58) WERTIME 1979 : 3-4.
(59) MUHLY 1976: 109-11 et 1979: 188-333. (60) Me KERREL 1978 : 21. (61) MUHLY 1973 : 307. (62) HEDGE 1978. (63) MASSON et SARIANIDI 1972 : 128. (64) AFZALI 1981.
49
ment associée au cuivre. Ainsi l'ensemble des indices permettant de supposer une exploitation ancienne de l'étain, dans un premier temps associée à une exploitation de cuivre se trouve réuni tant à Sarkar qu'a Misgaran.
Dans la perspective d'identification de Meluhha, prenant en compte les données de terrain, les textes sumériens et aussi la localisation de la Drangiane de Strabon, dont une citation (abondamment commentée), nous dit que les habitants ont « peu de vin, mais ils ont de rétain dans leur pays » (XV. 2. 10), il nous paraît que l'Afghanistan occidental est certainement une région à considérer en priorité.
Si les données recueillies sur le terrain sont très positives, les modalités de la circulation de l'étain à partir de cette région doivent encore être étudiées, de même que les implications pour les divers sites de la région restent à préciser. Les analyses que nous avons effectuées sur des objets de Mundigak et de Deh Morasi Ghundaï n'ont pas révélé de teneur significative en étain, ni d'ailleurs en arsenic. Les 5 % décelés sur une hache à collet de Mundigak Шб(65) restent une information isolée. A Shahr-i-Sokhta, deux objets de surface ont fourni des teneurs en étain de 560 et 840 ppm. Ceci, combiné à l'analyse d'une paroi de four de la phase III où 110 ppm d'étain ont été décelés, atteste au moins l'utilisation occasionnelle de cuivre a forte teneur en étain dans la métallurgie de ce site.
S'agissant des voies d'échanges possibles, qui correspondent assez bien aux routes d'approvisionnement envisagées par Muhly pour la Mésopotamie, le manque de fouilles archéologiques (dans le Khorassan oriental) ne permet pas une étude consistante. La métallurgie de Tepe Hissar est réputée ne pas contenir de bronze à l'étain (66) mais ces analyses n'étant pas publiées, il est difficile de savoir ce qu'on entend par « absence d'étain ». Sur la « route méridionale », on dispose d'un peu plus d'informations. Pour Tepe Yahya, la période IV В a livré un seul objet, analysé par Tylecote et Me Kerrel, avec une teneur en étain de 8 % (67) et plusieurs objets à 2 ou 3 % d'étain proviennent de la période IV A (68). Par ailleurs, l'usage d'étain ou de cuivre a forte teneur en étain est attesté à la période IV C, avec une teneur de 460 ppm, IV B2 avec 1 100 ppm et IV В 1 avec 0,1 % sur un anneau (69). La composition de ce dernier est rapportée par les auteurs à la métallurgie de Shahr-i-Sokhta, ce qui nous paraît concorder avec nos propres données.
Dans la Péninsule d'Oman, l'utilisation de l'étain est attestée pour un alliage à 6 % et par des teneurs de
1 300 ppm et 2 600 ppm à Umm-an-Nar, l'addition
(65) CASAL 1961. (66) MUHLY 1960 : 304; PIGOTT 1980 : 105. D'après une com
munication personnelle de V. Pigott, sur 203 objets provenant des fouilles de SCHMIDT les seuls contenant de l'étain sont un bracelet (0,63 % Sn) de la période II et 3 objets de la période III (4, 1 % ■ 3, 6 % ; 0, 67%).
(67) HESKEL and LAMBERG-KARLOVSKY 1980 : 250. (68) Ibid: 253-256. (69) Ibid: 250.
d'étain sur place par la métallurgie locale étant assurée par une teneur de 4 800 ppm décelée dans une goutte de cuivre sur la paroi d'un canal de coulée. Au regard de ces informations, l'absence de l'étain à Barhain établie à partir de données non publiées (70) doit certainement faire l'objet d'autres examens avant de pouvoir être sérieusement confirmée.
Nous sommes donc à l'heure actuelle en possession d'un ensemble d'indices concordants en faveur d'une importation d'étain depuis l'Afghanistan occidental, très supérieurs à toutes les notations isolées qui ont pu apparaître çà et là ; sous réserve de plus ample information, les objections qu'on peut soulever à propos du trajet suivi par ces échanges peuvent difficilement être prises en considération.
Au terme de ces considérations, le point sur l'utilisation de l'étain est le suivant. Les premiers essais d'emploi de l'étain dans la métallurgie du Moyen-Orient remontent au IVe millénaire; celui-ci est utilisé en même temps que l'arsenic, et ne s'y substitue jamais. Aux environs de 3000 av. J.-C. apparaissent les premiers bronzes à l'étain (avec une teneur de l'ordre de 5 % ) et l'utilisation de l'étain sans arsenic, à une époque où sont également pratiqués des alliages au plomb. L'usage tend à se fixer vers le début du IIIe miiiénaire et la production de bronze à l'étain apparaît déjà totalement maîtrisée en Mésopotamie et au Khuzistan au protodynastique III (Tombes royales d'Ur, Suse période IV), où le bronze à l'étain est produit parallèlement au cuivre à l'arsenic. L'emploi de bronze à l'étain tend à se développer par la suite, sans pour autant se généraliser, peut-être du fait d'une relative rareté dans l'approvisionnement. Dans le même temps, durant tout le IIIe millénaire, l'étain continue à être utilisé comme agent de fluidité, simultanément à d'autres matériaux (le Sù-gan par exemple). Toute étude future du rôle de l'étain dans la métallurgie orientale nous paraît obligatoirement devoir prendre en considération ces deux aspects de son utilisation.
Nos analyses confirment l'emploi plus systématique du bronze au début du II e millénaire. A Suse à cette époque, il semble y avoir une spécialisation des ateliers puisque seules les analyses des armes ont révélé un ajout d'étain. La métallurgie y est donc plus élaborée et ce fait semble être corroboré par la découverte d'alliages plus complexes, chaque métal ajouté au cuivre apportant sa propriété spécifique. A partir de cette période un approvisionnement de type occidental ne peut plus être exclu et c'est dans une perspective bien différente qu'il convient d'étudier ces produits.
Le zinc Le zinc dans les objets est plus souvent présent à des
très bas niveaux ( < 200 ppm). Les cas d'objets isolés où l'on rencontre des teneurs plus élevées doivent s'expliquer par la présence de minéraux du type aurichalcite (Zn, Cu)s (СОз)г (ОН)б ou de rosacite (Zn,
(СОз) (ОН)г qui peuvent être étroitement mêlés à (70) Me KERREL 1978 : 21.
50
d'autres minéraux de cuivre comme à Tchehel Kureh. C'est probablement là l'origine des quelques cas de fortes teneurs en zinc observées dans les objets de Shahr-i-Sokhta qui sont fabriqués précisément avec les minerais de la région de Tchehel Kureh.
De manière systématique, le zinc n'est présent a des teneurs élevées que dans les objets de Mésopotamie et cela jusqu'à des concentrations de 2,5 %.
La figure D montre que pour ces objets nous avons 2 types de répartitions des concentrations en zinc en fonction des concentrations en arsenic :
1 . - Des objets où le zinc est inférieur a 300 ppm ; alors l'arsenic varie de manière aléatoire entre 2 000 ppm et 1 ,7 % .
2. - Des objets où le zinc et l'arsenic sont fortement anticorrelés.
Le premier cas correspond à du zinc provenant du minerai de cuivre où il se trouve à des faibles teneurs.
Le deuxième cas met en évidence une liaison entre les concentrations en arsenic et en zinc. Cette liaison peut s'interpréter de diverses manières .-
- il peut s'agir d'une adjonction volontaire ou involontaire d'un minéral où le zinc et l'arsenic peuvent venir en substitution l'un de l'autre;
- il peut s'agir d'une liaison dépendante de la solubilité du zinc dans le cuivre en fonction de la concentration en arsenic;
- on peut aussi envisager un minerai de cuivre auquel du zinc serait naturellement associé (et ce n'est pas exclu dans le cas des minerais d'Oman) dont les métallurgistes auraient modifié empiriquement les propriétés par un ajout d'arsenic, ajout dont l'importance aurait été fonction de la teneur initiale en zinc.
Les teneurs en étain des objets considérés ne paraissent par ailleurs pas liées à la distribution zinc-arsenic. Il en va de même pour le plomb. On peut toutefois noter que le plomb n'est, dans ces objets de Mésopotamie, jamais présent isolément : pour tous ceux qui ont une teneur en plomb supérieure à 1 % (9 objets sur 25) on retrouve des concentrations élevées en étain ( > 3 % ), zinc ( > 2 % ) ou arsenic ( > 4 % ).
Il est donc difficile de tirer une conclusion sur la présence du zinc dans les objets de Mésopotamie mais l'impression qui se dégage est celle d'une métallurgie élaborée, avec de multiples alternatives pour l'introduction d'agents fluidifiant, désoxydant et d'éléments d'alliage qui rendent difficile l'interprétation des données analytiques, du rôle des divers éléments et plus encore des connaissances exactes sur le plan minéralo- gique et métallurgique des artisans sumériens.
CONCLUSION
Le schéma traditionnel d'une évolution continue, depuis le cuivre pur jusqu'au bronze à l'étain en passant par les alliages à l'arsenic, ne résiste pas à l'analyse des
560 objets de notre corpus et la réalité apparaît beaucoup plus complexe. La pratique des alliages est étroitement liée aux connaissances mineralogiques des mineurs et métallurgistes de l'époque ainsi qu'aux possibilités d'approvisionnement, plus particulièrement pour les cités des grandes plaines alluviales. La présence des éléments d'alliage dans certains minerais de cuivre contribue à rendre difficile l'interprétation des résultats analytiques, comme on l'a vu a propos de l'arsenic dans le cuivre natif d'Anarak.
D'un point de vue technologique, la comparaison entre les informations textuelles et les données analytiques ne donne pas toujours une vision concordante des pratiques en cours au IIIe millénaire. L'existence d'alliages au plomb, d'alliages ternaires (Cu, As, Sn) et même quaternaires (Cu, As, Sn, Pb) prouve la très grande variété des techniques utilisées. Il semble que cette complexité ne doive rien à la pratique des refontes, dont la plupart des auteurs tendent aujourd'hui a minimiser l'importance, que ce soit au regard des grandes quantités de cuivre importé ou en fonction de considérations analytiques. Il existe certainement une liaison entre la composition des alliages et les impératifs de la coulée ou la fonction de l'objet, mais celle-ci n'est pas facile à mettre en évidence. Enfin et surtout, l'emploi synchrone de diverses techniques est la règle générale, ce qui interdit de dresser un tableau simple de l'histoire de la technique des alliages.
La comparaison entre les diverses régions donne des informations beaucoup plus pertinentes. En particulier, le bronze à l'étain n'est rencontré en quantité significative que sur les sites du Khuzistan et de Mésopotamie. Même au long des diverses voies d'approvisionnement en étain que l'on peut rencontrer, son usage semble limité. Ce paradoxe apparent n'est peut-être que la marque de l'importance d'une forte demande, celle de la Mésopotamie et du Khuzistan, dont les villes étaient en situation de drainer tout l'étain disponible.
D'autres particularismes originaux peuvent être mis en évidence. L'usage de l'arsenic ne semble jamais s'être généralisé en Iran oriental (Shahr-i-Sokhta, Tepe Ya- hya) alors qu'il est systématique partout ailleurs. L'usage du plomb n'est pratiquement pas attesté dans le Hamrin et en Oman et dans ce dernier cas il semble que l'absence de toute ressource en plomb avoisinante soit l'explication la plus plausible. Les données synthétiques récemment présentées par Moorey vont exactement dans le même sens (7 1 ).
Deux faits essentiels marquent ainsi l'histoire des alliages :
- Dans la zone étudiée, des le IVe millénaire, la technique de l'alliage est connue et massivement employée, en particulier les alliages a l'arsenic et au plomb.
- C'est avant tout en Mésopotamie et au Khuzistan que se développe l'intérêt pour le bronze, et c'est essentiellement celui-ci qui conditionne la circulation de l'étain.
(71) MOOREY 1982.
51
Ainsi le rôle moteur joué par les régions minières du plateau iranien dans les débuts de la métallurgie disparaît à la fin du IVe millénaire, et c'est dans les villes des plaines alluviales qu'apparaissent les principales innovations du IIIe millénaire. Ce dynamisme technologique nous semble aller de pair avec l'ensemble des techniques très élaborées qui se développent au profit des élites urbaines, autour des palais et des temples. Cela conduit au développement de relations lointaines pour l'approvisionnement en matières premières, mais ne paraît pas s'accompagner d'une rediffusion des techniques nouvelles. Dans l'état actuel de notre documentation, s'il est certain que les matières premières de tout le monde iranien atteignent Sumer et l'Elam, rien n'indique en retour une diffusion simultanée de la technologie. Héritières de toutes les traditions de leurs voisines exploitant leurs ressources multiples, les villes du IIIe millénaire paraissent avoir gardé pour elles les techniques nouvelles élaborées dans leurs ateliers. Significativement, la diffusion massive de ces techniques coïncide avec les profonds changements qui, au début du IIe millénaire, transforment complètement les sociétés urbaines de Mésopotamie.
Remerciements
Nous remercions tous les archéologues et conservateurs qui nous ont confié les objets pour analyse et en particulier M. Amiet, Conservateur en Chef du Département des Antiquités Orientales, M. Francfort, Directeur des fouilles de Shortugaï, M. Jarrige, Directeur de la Mission Archéologique française au Pakistan, M. Lamberg-Karlovsky, Directeur du Peabody Museum of Harvard University, M. Muayad Sa'id, Directeur de l'Iraqi Museum de Bagdad, M. Tosi, Directeur de la fouille de Shahr-i-Sokhta, M. Huot, Directeur de la Délégation Archéologique Française en Iraq.
Mr. Françaix a réalisé une partie des analyses en spectro- métrie d'émission au Laboratoire de Recherche des Musées de France.
Les identifications des minerais ont été effectuées par M. Cesbron et M. Drin au Laboratoire de Minéralogie de l'Université Pierre et Marie Curie. Ils ont également collaboré à l'élaboration de diverses phases de cette étude, de même que R. Besenval et J. Liszak-Mours.
Nous avons bénéficié, pour les problèmes archéologiques de Suse, de l'aide de Mme Talon.
Mme Hours, Directeur du laboratoire de Recherche des Musées de France, M. Roth, Directeur de Recherche au CE. A. et M. Baudin, Chef du S. E. A. (CE. A.) ont permis la réalisation de cette étude.
Les données analytiques brutes ainsi que toutes les informations d'ordre technique sont accessibles sous forme de tableaux ou de cartes perforées (Système I.B.M.) sur simple demande auprès de T. Berthoud.
BIBLIOGRAPHIE
AFZALI H. 1981 Les ressources d'hydrocarbures, de métaux et de
substances utiles de l'Afghanistan. Chron. Rech. Min., 460 : 29-51.
AMIET P. 1966 Elam. Auvers-sur-Oise : Archée. BARIAND P. 1963 Contribution à la minéralogie de l'Iran. Bull. Soc.
Franc. Minéral. Cristal, LXXXVI : 17-64. BERTHELOT M. 1889 Introduction à l'étude de la chimie des anciens et du
Moyen-Age. Paris : Librairie des Sciences et des Arts (rééd. 1939).
BERTHOUD T. 1979 Etude par l'analyse de traces et la modélisation de la
filiation entre minerai de cuivre et objets archéologiques du Moyen Orient (IVe et II f millénaires avant notre ère). Thèse de Doctorat Paris : Université Pierre et Marie Curie.
BERTHOUD T., CRADDOCK P. T., HAUPTMANN A., MAD- DIN R., MUHLY J.D., PIGOTT V.C., STECH-WHEELER T. et WEISGERBER G. 1981 Production, échange et utilisation du métal: bilan et
perspectives des recherches archéométriques récentes dans le domaine oriental. Paléorient, 6 : 39-127.
BERTHOUD T. et FRANÇAIX J. 1980 Contribution à l'étude de la métallurgie de Suse aux IVe et IIIe millénaires - Gif-sur-Yvette - Rapport
C.E.A.-R-5O33. BIBBY G. 1 969 Looking for Dilmun. Harmondsworth : Pelican. CALDWELL JR., ed. 1967 Investigations at Tal-i-Iblis. Illinois State Museum
Preliminary Report 9. CALEY E.R. 1964 Analysis of ancient metals. New York: Pergamon
Press. 1971 Analysis of some metal artefacts from ancient
nistan. In BRILL R. H., (éd.): Science and Archaeology: 106-113. Cambridge: MIT.
CASAL J. M. 1961 Fouilles de Mundigak (2 vol.). Mémoires de la
tion Archéologique Française en Afghanistan, XVII. Paris : Geuthner.
CHARLES J. A. 1967 Early arsenical bronzes - a metallurgical view. A.J.A.,
71 : 21-26. CHILDE G.V. 1934 New light on the most Ancient Near East. London:
Kegan, Trench, Trubner and Co. CHMYRIOV V. M. et al. 1977 Mineral resources of Afghanistan. Kaboul: Dpt. of
Geological and Mineral Survey. CLEUZIOU S 1980 Three seasons at Hili : Toward a chronology and
cultural history of Oman peninsula in the IIIrd Millennium B.C. Proc. of the seminar for Arabian StudiesAO : 19-32.
COGHLAN H. H. 1951 Native copper in relation to prehistory. Man 51 : 90-93. 1960 Prehistorical working of bronze and arsenical copper.
Sibrium 5 : 145-152. CONTENAU G. et CHIRSHMAN R. 1935 Fouilles de Tepe Giyan. Paris: Geuthner. CRADDOCK P.T. 1980 The composition of the Copper produced at the
Ancient Smelting Camps of the Wadi Timna, Israel. //; CRADDOCK P.T. (ed.) : Scientific Studies in Early Mining and Extractive Metallurgy. London : British Museum, occasional Papers n° 20.
1981 Bronze Age Copper Production in the Wadi Timna. Paléorient, 6 : 93-127.
DELOUGAZ P. 1940 The Temple Oval at Khafajah. Oriental Institute
Publications, Chicago : University of Chicago Press. DESCH С. Н. 1928 Sumerian Copper. Report of the British Association for
the Advancement of Science : 437-44 1 . 1929 Ibid. : 264-265. 1931 Ibid. : 269-272. 1933 Ibid. : 302-305. DESHAYES J. 1960 Les outils de bronze de l'Indus au Danube (I Ve -//'
lénaires). Paris : Geuthner. 1969 Les civilisations de l'Orient ancien. Paris: Arthaud. 1977 Le plateau iranien et i Asie centrale des origines à la
conquête islamique. Leurs relations à la lumière des documents archéologiques. Paris : CNR. S.
FORBES R.J. 1950 Metallurgy in antiquity. Leiden: Brill. 1968 Studies in ancient technology. Leiden : Brill. FRANCE-LANORD A. et CONTENSON H. de 1973 Une pendeloque en cuivre natif de Tell Ramad.
rient . I, 1 109-115. FRANKLIN A. D.. OLIN J. S. and WERTIME T. A. éd. 1978 The search for ancient tin. Washington: Smithsonian
Institution and National Bureau of Standards. GELB J. 1970 Makkan and Meluhha in early Mesopotamian sources.
R.A. 64 : 1-8. GHIRSHMAN R. 1938 Fouilles de Sialk. Paris Geuthner. HAUPTMANN A. 1980 Zur Frùhbronzezeitlichen Métallurgie von Shahr-i-
Sokhta, Iran. Der Anschnitt, 322/3 : 55-61 . HAUPTMANN A. and WEISGERBER G. 1981 a Third Millennium B.C. Copper Production in Oman.
Revue d'Archéométrie, supplément I98I, Actes du XX1 Symposium International d'Archéométrie, vol. III : 131-138.
1981 b The Early Bronze Age Copper Metallurgy of Shahr-i- Sokhta, Iran. Paléorient 6 : 99-127.
HEDGE К.. ALLCHIN В. and GOUDIE A. 1978 The prehistory and paleogeography of the Great Indian
Desert. London : Academic Press. HERMANN G. 1968 Lapis lazuli : The early phases of its trade. Iraq, 30 ;
21-57. HESKEL D. and LAMBERG-KARLOVSKY C.C. 1980 An alternative sequence for the development of
metallurgy : Tepe Yahya, Iran. //; MUHLY J. D. and WERTIME T. R., (eds.) : The coming of the Age of Iron. 229-265. New-Haven : Yale University Press.
de JESUS PS. 1972 Prehistoric metallurgy-another look, Anadolu, 16 :
129-140. 1980 The Development of Prehistoric Mining and
lurgy in Anatolia. British Archaeological Reports, International Series 74, Oxford.
LAMBERG-KARLOVSKY C.C. 1967 Archaeology and metallurgical technology in
historic Afghanistan. India, and Pakistan. American Anthropologist, 69: 145-162.
1970 Excavation at Tepe Yahya. Iran, 1967-1969. Progress Report. I. Cambridge (Mass).
1971 The proto-elamite settlement at Tepe Yahya. /ran IX : 87-96.
1972 Tepe Yahya 1971. Mesopotamia and the Indo-Iranian borderland. Iran X : 89-100.
1973 Urban interactions on the Iranian plateau-Excavation at Tepe Yahya. 1967-1973. Proceedings of the British Academy, vol. LIX : 7-43.
1975 Market network and trade mechanisms: a case of study. In SABLOFF J. and LAMBERG-KARLOVSKY C.C. (eds.) : Ancient civilization and Trade. Tucson : University of Arizona Press.
LANTIER R 1 949 Le rôle de la Syrie dans la découverte du bronze.
Revue Archéologique, XXXIV: 75-76. LE BRUN A. 1971 Recherches stratigraphiques a l'Acropole de Suse.
1969-1971. Cahier de la DAFI, I : 163-216. 1978 Suse. Chantier « Acropole 1 ». Paléorient. 4 : 47-62. LIMET H.
1 960 Le travail du métal au pays de Sumer au temps de la llf dynastie d'Ur. Paris : Les Belles Lettres.
Me KERREL H. 1978 The use of tin-bronze in Britain and the comparative
relationship with the Near East. In FRANKLIN A.D.. OLIN J.S and WERTIME T.A., (eds). The Search for ancient Tin. Washington (DC) : Smithsonian Institution and the National Bureau of Standards.
Me KERREL H. and TYLECOTE R.F. 1972 The working of copper-arsenic alloys in the early
Bronze Age and the effect on the determination of provenance. Proceedings of the Prehistoric Societv. 38 : 209-219.
MARECHAL JR. 1958 Etude sur les propriétés mécaniques des cuivres a
l'arsenic. Métaux, corrosion, industries, 397 : 377-383. MASSON V.M. and SARIANIDI VI. 1972 Central Asia. Turkmenia before the Achaemenids.
London : Thames and Hudson. MELLAART J. 1966 Catal Hoyùk, a neolithic city in Anatolia. Proceedings
of the British Academy 5 I ( I 965) : 202-2 I 3. MOOREY P.R.S. 1969 Prehistoric copper and bronze metallurgy in Western
Iran. Iran, VII : I 32- 1 53 . 1971 Catalogue of the ancient bronzes in the Ashmolean
Museum. Oxford : Clarendon Press. 1982 Archaeology and pre-Achaemenid metalworking in
Iran : A fifteen year retrospective. Iran 20 : 81-102. MOOREY P.R.S. and SCHWEITZER F. 1974 Copper and copper alloys in ancient Turkey: some
new analysis. Archaeometry, 16 : 112-115. MUHLY J.D. 1973
1976
1977 1978
Copper and Tin. Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, vol. 43. Hamden : Archon Books : 155-535. Supplement to Copper and Tin. Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, vol. 46. Hamden : Archon Books : 77-1 36. The copper ox hide ingots and the bronze age metal trade. Iraq, XXXIX I : 73-82. New evidence for sources of and trade in Bronze age tin. In FRANKLIN A.D.. OLIN J.S. and WERTIME T.A.. (eds.): The Search for ancient Tin. Washington (DC) : Smithsonian Institution and the National Bureau of Standards.
53
NICHOLAS I. M. 1980 A Spatial I Functional Analysis of Late Fourth
nium Occupation at the TUV Mound, Tal-i-Ma- lyan.lran. PhD Dissertation, Dept of Anthropology, University of Pennsylvania, Philadelphia.
NISSEN H.J. 1970 19754
Grabung in den Planquadraten K/L XII in Uruk Warka. Baghdader Mitteilungen, 5 : 101-192. Zur Frage der Arbeitsorganisation in Babylonien wáhrend der Spát Uruk-Zeit. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae XXII : 5-14.
PEAKE R.H. 1928 The Copper Mountain of Magan. Antiquity 2
452-457. PIGOTT V.C. 1980
1981
The Iron Age in Western Asia. In MUHLY J.D. and WERTIME A., (eds.) : The Coming of the Age of Iron. New Haven : Yale University Press. Research at the University of Pennsylvania on the Development of Ancient Metallurgy. Paleorient, VI : 99-127.
PIGOTT V.C.. HOWARD S.M. and EPSTEIN S.M. sous presse Pyrotechnology and Culture at Bronze Age Tepe
Hissar (Iran). //; Seminar on Early Pyrotechnology. Washington (DC) : Government Printing Office.
PLEINER R. 1980 Early Iron Metallurgy in Europe. In MUHLY J.D. and
WERTIME TA., (eds.): The coming of the Age of Iron, New Haven : Yale University Press : 375-416.
RENFREW С (ed.) 1973 The explanation of culture change
řon», London : Duckworth. Models in Prehis-
SCHMIDT EF. 1937 Excavations at Tepe Hissar, Damghan 193 1 -1932. Phila
delphia : The University of Pennsylvania Press. SELIMKHANOV I.J. 1960 /storico-khimcieskiie i analyticeskiie issledovaniia.
Drevnih mednyh splavov, Izdaniie Akadamii nauk, Azerbaidehanskoi SSR, Bakou.
SMITH C.S. 1965 The interpretation of micro-structures of metallic
artefacts. /// Application of Science in examination of works of Art. Boston : Museum of fine Arts.
STEVE M.J. et GASCHE H. 1971 L'Acropole de Suse. Nouvelles fouilles. Mémoire de la
Délégation Archéologique Française en Iran, XLVI. Paris : Geuthner.
TALON F 1982 Les bronzes de Suse du Musée du Louvre de l'époque
pré-Sargonique au début du if millénaire avant J.C.. Thèse de 3e cycle. Université de Paris I.
TOSI M. 1968
1973
1974
Excavation at Shahr-i-Sokhta, a chalcolithic settlement in the Iranian Sistan, preliminary report of the first campaign, oct. dec. 1967. East and West, 18, n° 1-2 : 9-66. Early evolution and settlement patterns in the Indo- Iranian bordeland. In Renfrew C, (ed.) : The explanation of culture change : Models in Prehistory, 423-446. London : Duckworth. The lapis lazuli trade across the Iranian plateau in the third millennium B.C., Gururayamanjanika, Miscellanea in Onore di Giuseppe Tucci, 3-20. Napoli :
TYLECOTE R.F. 1976 History of metallurgy. London : The metal Society. WEISGERBER G. 1977 1980 1981 WEISS H. 1978
Beobachtungen zum alien Kupfer Bergbau im Sultanat Oman. DerAnschnitt 5-6 : 190-21 1 . ... und Kupfer in Oman. Der Anschnitt 32/2-3 : 62-1 10. Mehrals Kupfer in Oman. Der Anschnitt 33 : 174-263.
The comparative Stratigraphy of third millennium Khuzistan. Paleorient 4 : 105-106.
WERTIME TA. 1973 The beginning of metallurgy : a newlook. Science 182 :
875-897. WRIGHT H. 1978 The comparative stratigraphy of fourth millennium
Khuzistan. Paleorient 4 : 103-104.
54