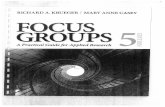a-basic-course-wolof-dakar2f.pdf - Español para inmigrantes y ...
Focus et focalisation en wolof contemporain
-
Upload
cardiodantec -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Focus et focalisation en wolof contemporain
Mamadou CISSEDépartement de linguistique et sciences du langageFaculté des Lettres et Science humainesUniversité Cheikh Anta Diop. Dakar, SénégalTél 00 221 77 557 17 [email protected]
Focus et focalisation en wolof contemporain : unexemple d’orientation morphosyntaxique de l’énoncé.
Sommaire :
Il est nécessaire d’accorder, à l’intérieur desdescriptions linguistiques, une attention toute particulière àdes phénomènes tels que le focus et la focalisation qui en estissue, pour éviter de les interpréter systématiquement commedes paradigmes de conjugaison, comme c’est le cas pour beaucoupd’études sur le système verbal du wolof. L’objectif principalde cet article est de montrer que l’analyse à tous les niveaux(morphologique, syntaxique et sémantique) du système verbal dela langue wolof, milite pour le maintien de la marque defocalisation hors du système de conjugaison de cette langue. Cequi semble être une évidence si l’on sait que la combinaison dumorphème de focalisation avec le différents verbatifs (temps,aspect et mode) y est soumise à des contraintesmorphosyntaxiques, sémantiques et pragmatiques.
Mots clés : focus, focalisation, morphosyntaxe, paradigme,pragmatique, système verbal, sémantique wolof.
Summary
It is necessary to pay a particular attention tophenomenons such as focus and focalization within linguisticdescription in order to avoid interpreting them as conjugationmarks. Such is the case in many analyses of wolof verbalsystem.
1
The main target of this article is to demonstrate that theanalysis on all levels (morphology, syntax and semantic) of thewolof verbal system sustains keeping the focalization mark outthe conjugation of the language. That seem obvious, if weobserve that the combination of the focalizing morphemedifferent verbatives (time, aspect and mode) undergo within theprocess morphosyntaxic, semantic and pragmatic constraints.
Key-words: focus, focalization, morphosyntax, paradigm,pragmatics, verbal system, semantic, wolof.
Introduction
La linéarité du discours peut souvent être délibérémentbrisée. C’est le cas quand le locuteur décide de changer sonpoint de vue sur le message en ayant recours à des stratégiesde communication ou plus exactement à des opérationsdiscursives dont la conséquence est un écart par rapport à lanorme canonique. La focalisation, objet de notre analyse, estune de ces stratégies communicatives en question. En tant querupture, la focalisation se situe au cœur de l’analysephrastique. Elle est aujourd’hui l’objet d’un regain d’intérêt,notamment dans le cadre de la classification typologique deslangues.
En wolof, et surtout à l’oral, il est fréquent que le
locuteur ait recours à la focalisation pour mettre en vedette
un des constituants de l’énoncé par rapport au reste. Dans
une perspective morphologique, cette opération est
généralement intégrée dans le système de conjugaison. Morpho-
syntaxiquement, l’analyse la situe en dehors de la conjugaison.
Que sont donc le focus et la focalisation en termes de
2
réorientation de l’énoncé wolof ? Comment et à quel niveau
d’analyse de l’énoncé appréhender cette stratégie
communicative ? Pour apporter un éclairage à ces
problématiques, nous allons d’abord tenter de distinguer le
focus et la focalisation, définir la focalisation, faire
l’inventaire des focalisateurs en wolof et leurs
caractéristiques formelles. Nous procéderons ensuite à
l’analyse de la focalisation et de l’ordre d’occurrence des
constituants dans l’énoncé focalisé, des fonctions pouvant être
focalisées, de la morphosyntaxe de la focalisation, de ses
valeurs d’emploi, de quelques problèmes de son interprétation,
du traitement dont il a fait. Il sera aussi question d’un
aperçu terminologique sur la focalisation afin de rendre
visible notre contribution à la problématique soulevée. La
conclusion fera le bilan de la réflexion et dégagera des
perspectives.
I-Focus et focalisation
En wolof, le prédicat ainsi que tous les arguments peuventêtre focalisés, c’est-à-dire mis en valeur pour le regardmental du locuteur, et implicitement opposés à tous les membresdu même ensemble d’entités qui auraient pu remplir les mêmesfonctions. Cette sélection s’effectue sur l’axe paradigmatiqueà l’aide d’un morphème de focus contrastif. Elle est plusprécisément une emphatisation dite aussi rhématisationcontrastive chez certains auteurs comme NDIAYE CORREARD (1989et 2003).
En français, ce procédé recouvre aussi la phrase clivée. Cettedernière se caractérise par l’extraction d’un de sesconstituants que l’on place au début. Ledit constituant est
3
ensuite encadré par c’est et le pronom relatif qui ou que selon lafonction du constituant emphatisé
[- ou + sujet]
Exemples :
-Sabine caresse le chien
-C’est Omar qui mange une mangue (C’est lui et non personned’autre)
-C’est une mangue que mange Omar (C’est une mangue et pas unautre fruit)
En effet, si les clivées sont dites emphatiques, c’est toutsimplement parce que le focus syntaxique et l’acceptionemphatique vont de pair dans ces constructions. Mais l’emphasene peut aucunement modifier le rapport syntaxique entre lesconstituants de la phrase. Toutefois, lorsqu’elle devientcontrastive, l’emphase est siège de focus et devient ainsiopération de focalisation.
Emprunté au domaine de l’optique, le focus (le viseur oule capteur), permet la sélection et l’extraction grâce àl’objectif.
Des situations similaires se présentent en wolof, avec laseule différence qu’en wolof, la forme verbale peut fairel’objet d’emphase contrastive dite aussi focalisation.
I-1-Définition de la focalisation
S. Robert donne une définition assez précise du focus, en
affirmant qu’il y a « focalisation lorsque l’un des
constituants phrastiques assure une double fonction à la fois
syntaxique et rhématique. Ces deux fonctions sont distinguées
et indiquées de manière concomitante au sein de l’énoncé ».
C’est un fait très courant en wolof que d’un point de vue
sémantique, l’opération de mise en focus « consiste en une
4
désignation de l’élément qui est la bonne valeur par rapport
aux valeurs possibles pouvant remplir la place vide dans la
relation prédicative préconstruite (Robert 1993 et 2000).
Retenons cependant que le focus wolof est, sur le plan
discursif un élément de discours pragmatique ; il peut aussi
opérer, en dehors du cadre discursif, comme proposition
solitaire et disjointe.
II-Inventaire et caractéristiques formelles du focus
Il présente trois variantes de signifiants selon la fonctionsyntaxique du noyau dont il est le satellite. Il s’agit desmorphèmes suivants:
- a, lorsque l’élément focalisé est en fonction dite desujet;
- la, lorsque l’élément focalisé est en fonction decomplément (dans le sens le plus large du terme impliquantainsi les circonstants et mêmes les syntagmes.) ;
- dafa~da lorsque l’élément mis en relief est un prédicatverbal.
III-Focalisation et ordre des constituants
En wolof, les relations grammaticales et l’ordre linéairedes constituants ne sont pas toujours liés, même si lastructure de base de la phrase verbale et de type SVO. Leprédicat verbal a vocation à être le noyau syntaxique etcentral de l’énoncé.
La focalisation se caractérise généralement par latransposition en début d’énoncé de l’élément sur lequel elleporte et dont la tête d’énoncé n’est pas habituellement laplace. Mais on ne peut pas aligner plus d’un focus sur unemême lancée énonciative parce que le focus est syntaxiquementintégré dans l’énoncé.
5
III- Les fonctions pouvant être focalisés
Le prédicat ainsi que tous ses arguments (sujet, objet etcirconstant au sens large du terme), peuvent être focalisés,c’est-à-dire implicitement opposés à tous les membres du mêmeensemble d’entités qui auraient pu remplir les mêmes fonctions.Les fonctions qui peuvent être focalisées sont le sujet, leverbe et le complément
Focalisation du sujet,
Sàmba-a jënd xar y-i
NP +foc acheter mouton cl+prox
C’est Sàmba qui a acheté les moutons.(et pas Demba par exemple)
Ma-a f-a dem-oon ak sama nijaay
1sg+foc loct+éloi aller+passé fonct poss 1sg onclematernel
C’est moi qui y suis allé avec mon oncle paternel.(et personne d’autre)
Focalisation du complément (expansion d’un énoncé àplus de deux constituants)
Sàmba la-a jox waxande w-i
NP foc+1sg donner malle cl+prox
C’est à Sàmba que j’ai donné la malle.(ce n’est à personne d’autre)
Jabar-am la-nu bëgg mu teew, d-umoom?
épouse+poss 3sg foc vouloir 3sg être présent,Apx+négt 3sg
6
Nous voulons que ce soit son épouse qui soit présente, pas lui.
Feneen lanuy beye dugub ren
loct+alter foc+1pl+inacc cultiver mil cette année
C’est dans un autre endroit que nous cultiverons le mil cette année.
Focalisation du prédicat verbal
Elle n’est opérante qu’avec les unités employées commeprédicats verbaux, c’est-à-dire celles qui sont compatiblesavec les modalités dites verbales.
Exemple:
Da-ngeen di karawaat -u ba mel n-i a-ypataroŋ dëgg
foc +2pl inacc cravate+réfléchi fonct avoir l’air fonctindéf+cl patron adv
Vous allez mettre des cravates de manière à avoir l’air de vrais patrons.
IV-Morphosyntaxe de la focalisation
Le morphème de focalisation présente trois variantes designifiants qui sont a, la et dafa~da~fa. L’apparition de l’uneou l’autre de ces variantes dépend de la fonction duconstituant de l’énoncé mis en relief. Lorsque l’élément mis enrelief est en fonction sujet, le signifiant a lui estdirectement postposé.
Exemple:
Faatoo togg ceeb b-i.
NP+ foc (a) préparer riz cl+prox
C’est Faatu qui a préparé le riz.
Lorsqu’il est en fonction complément, c’est-à-dire d’expansiondirecte ou indirecte ou circonstancielle; que ce complément
7
soit une unité ou un syntagme, il est déplacé en tête d’énoncéet le marqueur la lui est immédiatement postposé.
Biig la leen f-a denk-oon mbuus m-i.
la nuit dernière foc 2pl loct+éloi confier+passé saccl+prox
C’est la nuit dernière qu’il vous y avait confié le sac. (A ceux à qui on veutrafraîchir la mémoire sur des faits qu’ils nient)
Lorsqu’enfin le constituant mis en relief est un élémentemployé comme prédicat verbal, on lui antépose dafa ou une deses variantes.
Da-ñu ko xam-ul moo tax1 ñ-u ko-ysaaga.
foc+3pl 3sg connaître+négt c’est pourquoi 3pl 3sg+inaccinsulter
C’est parce qu’ils ne le connaissent pas qu’ils l’insultent.
Les indices personnels sujets sont soit partiellement, soittotalement amalgamés au signifiant du morphème defocalisation. Ils apparaissent dans le paradigme suivant:
Singulier Pluriel
1-Ma-a Noo ( nu+a)
2-Ya-a Yeen a
3-Moo(mu+a) Ñoo (ñu+a)
Le fait d’isoler le signifiant du morphème defocalisation sujet (a) n’est possible que parce qu’elle peut
1- Ce fonctionnel peut être analysé comme composé de mu (3sg)+foc (a)+ tax (être la cause).Il est de moins en moins conçu comme tel parce qu’il s’est figé en se spécialisant dans la fonction de subordonnant.
8
s’expliquer en termes de contraction et d’assimilationprogressive. Quant aux signifiants 2sg et 2pl, ils sont loind’être identiques aux signifiants des pronoms personnels enfonction sujet (respectivemen nga et ngeen). Cela peuts’expliquer par le fait que, ya-a et yeen-a sont des variantescontextuelles de nga-a et ngeen a comme en témoignent lesexemples suivants:
Ya-a ka baax te gore.
2sg+foc fonct être bon fonct être honnête
Comme tu es bien et honnête !
Aka nga-a baax te gor-e.
fonct 2sg+foc être bon fonct hommehonnête+particularisant
Comme tu es bien et honnête !
En effet, l’adverbe exclamatif aka (comme, que …) fait, selonqu’il lui est antéposé ou postposé, apparaître l’une desvariantes de signifiants des deuxièmes personnes du singulieret du pluriel des indices personnels en fonction sujet.
Singulier Pluriel
1-La-a La-nu
2-Nga Ngeen
3-La La-ñu
Le signifiant de la focalisation du complément estnettement localisé aux premières et troisièmes personnes dusingulier et du pluriel. Ce n’est pas le cas aux deuxièmespersonnes du singulier et du pluriel qui apparaissent sous laforme nga et ngeen, amalgames permanents des signifiants de1sg+la et 2sg+la..
Bien qu’impliquant deux unités syntaxiques, le même phénomèned’amalgame peut ne pas aboutir au même résultat. Ce qui rend
9
inopérante l’explication par le seul fait de la contraction.Les signifiants 2sg+la et 2pl+la ne sont pas, sous les formes ngaet ngeen, analysables en unités significative minimales. Cen’est que par la prise en compte du mouvement obligatoire entête d’énoncé du constituant complément mis en relief, que peutse faire le départ entre les signifiants 2sg et 2pl des pronomsen fonction sujet et ceux issus de l’amalgame 2sg+la et 2pl+la.
Exemples:
Jàmm rekk ngeen war a ñaan.
paix adv 2pl+foc devoir con. v souhaiter
Vous ne devez souhaiter que la paix.
Da-nu bëgg ngeen ñaam jàmm rekk.
foc+1pl vouloir 2pl souhaiter paix adv
Nous voulons que vous souhaitiez seulement la paix.
Il serait important de souligner, par ailleurs, que la-ma aulieu la-a est la marque qui prévaut dans le parler lébou.
Lorsqu’ils sont en contact, les pronoms personnels en fonctionsujet et le signifiant du morphème de focalisation du prédicatverbal ou de toute autre unité employée comme telle,apparaissent selon le paradigme suivant:
Singulier Pluriel
Da-ma Da-nu
Da-nga Da-ngeen
Dafa Da-ñu
Le signifiant du pronom personnel en fonction sujet estfacilement isolable du signifiant du morphème de focalisationsujet dafa~da.
Se pose maintenant le problème de savoir qui entre dafa et daest le signifiant de la focalisation sujet. Dans un premiertemps, nous considérons dafa comme la forme de base. Il
10
apparait sous la forme de sa variante da lorsqu’il se trouvedevant un pronom en fonction sujet matériellement signalé etsous la forme de sa variante dafa à la troisième personne dusingulier caractérisé ici par l’absence de marque. Une autreforme fa (uniquement) est attestée dans une variété du wolofparlée au Saalum et caractérisée par cette utilisation de fa aulieu de dafa ou da (la variété en question est dénommée lefaane-faane).
Exemple:
Fa ngeen di jafeell-u yomb lool sax!
foc 2pl inacc être difficile+applicatif cl+relt êtrefacile adv insistence
Vous rendez difficile ce qui est pourtant très facile.
Au lieu de la forme ma qui serait attendue à la premièrepersonne du singulier, comme pour la totalité des variantesdialectales du wolof, c’est plutôt a qui apparaît dans lefaane-faane.
Fa-a-y dem seet-i ko ngir kollëre aksutura.
foc+1pl+inacc aller voir+allatif 3sg fonct alliance fonctdiscrétion
Je vais aller le voir au nom de l’alliance et de la discrétion.
Les signifiants des indices personnels sujets peuventapparaître sous des formes dont les voyelles finales sontamputées. Ce phénomène est attesté lorsqu’ils sont en contactdirect avec le morphème de focalisation du complément et qu’ilssont immédiatement suivis d’un pronom personnel en fonctiond’expansion directe. Cela explique l’existence des variantescontextuelles da-m ,da-ŋ-daf,da-n,da-ñ.
Exemple:
11
Daŋ ma-y nax rekk
foc+2sg 1sg+inacc tromper adv
Tu ne fais que me tromper
La variété lébou atteste dala comme signifiant de lafocalisation du verbe et daha comme signifiant de l’amalgamefoc+2sg.
V- Valeur d’emploi de la focalisation
La focalisation est avant tout un procédé morphosyntaxiquepar le biais duquel on attire l’attention sur une descomposantes du discours à l’exclusion de toutes autresprésentes ou supposées. C’est ainsi qu’on pourrait à justetitre gloser en français la focalisation du sujet par : c’est xqui....( à l’exclusion de toute autre personne ou entitépouvant commuter avec x).
De façon analogue, la focalisation du complément peut segloser en français par c’est x que.. (à l’exclusion de toute autrepersonne ou entité pouvant avoir la même fonction que x). Quantà la de focalisation du prédicat verbal, elle peut à son tourêtre glosée par: c’est que.., c’est pour quoi.
Les traductions souvent proposées ne sont que desrapprochements qui ne reflètent en réalité qu’un aspect desvaleurs de la sélection et de l’exclusion véhiculées par lafocalisation. ..
Tout en véhiculant la valeur démonstrative commune à latopicalisation, la focalisation y ajoute une valeur contrastiveque lui confère le morphème de focalisation.
La focalisation du sujet est fréquemment employée dans les casde comparaison, dans les réponses justificatives ouexplicatives et dans les cas où on voudrait simplement attirerl’attention sur le complément obligatoire d’un prédicat verbal.
Exemples:
12
Omar a gën a muus c-ixale y-i.
NP foc être meilleur con.v être malin fonct+proxenfant cl+prox
Omar est le plus malin des enfants.
Nun noo-y sonn ndax nooymbokk-i dof bi.
1pl 1pl(nu)+foc(a)+inacc être fatigué fonct 1pl(nu)+foc(a)+inacc parent+fonct fou
cl+prox
C’est nous qui allons nous fatiguer parce que nous sommes les parents du fou.
La focalisation du complément implique nécessairement ledéplacement du constituant mis en relief en tête d’énoncé. Ellepeut concerner non pas une unité mais tout un syntagme, voireun énoncé.
Exemple:
Ci loxo càmmoñ b-i la takk téere b-i
fonct+prox main gauche cl+prox foc porter amulettecl+prox
Il porte l’amulette sur la main gauche.
Tout comme le signifiant de la focalisation du sujet a, celuide la focalisation du complément la peut connaître un emploi deprédicatif nominal d’identification. Il s’agit précisément desénoncés dans lesquels ne figure aucun constituant dont lecomportement syntaxique permet de l’identifier comme étant unverbe.
Exemples:
Xale buur la.
13
enfant roi c’est
L’enfant est roi
Yeen a-woon !
2pl foc+passé
C’était vous!
Bien qu’appartenant à un type d’identification différent decelui de a (focalisation du sujet), la (focalisation ducomplément) peut en tant que prédicatif nominal se substituer àa dans tous les contextes. L’inverse n’est vrai que lorsque leprédicat nominal est défini.
Exemples:
Wóor na. bukki la!
être sûr pft . Hyène c’est
C’est sûr.C’est (une)’Hyène! (Un conte, dans lequel on cherche àidentifier l’auteur d’une trahison)
Wóor na. bukki bee!
être sûr pft .Hyène c’est
C’est sûr.C’est l’hyène! (Référence à une hyène particulière).
VI- Quelques problèmes d’interprétation
Les morphèmes de focalisation et les pronoms personnels enfonction sujet relèvent de deux entités syntaxiquesdifférentes. Leur autonomie syntaxique respective est souventobscurcie par les cas d’amalgames, surtout permanents, alorsqu’ils conservent leur autonomie sémantique. La contractionn’ayant qu’une capacité explicative « restreinte, » le recoursà la diachronie devient tentant. On ne peut pas cependant etsous peine de s’éloigner des faits les plus immédiatementobservables, les considérer tous comme des paradigmesinsécables de conjugaison.
14
Les faits observés ici sont du ressort de la viséecommunicative. En effet, tout dépend de l’emprise que veutavoir le locuteur sur le discours en privilégiant tel ou telautre constituant. Le traitement des classes syntaxiques sefait au détriment des procédés généraux de visée communicativequi relèvent de l’articulation de l’énoncé selon des conditionsdonnées:
La focalisation met l’accent sur l’orientation de laphrase sur la communication. Elle s’apparente, d’un point desémantique, à la négation. Elle implique une sélectionexclusive par rapport aux autres entités possibles, c’est-à-dire une négation implicite par rapport aux autres unités dumême paradigme.
Le fait que les signifiants de la focalisation sujet etcomplément fonctionnent comme prédicatifs nominaux nous aamené à interpréter les énoncés dans lesquels ils figurentcomme des énoncés complexes. Ils sont composés d’un énoncénominal (phrase nominale) suivi d’un énoncé verbal sansqu’aucun fonctionnel ne soit introduit entre eux. Il s’agit làd’un phénomène d’enchâssement. Cet argument est conforté par lecaractère obligatoire de la co-référencialité avec le sujet duprédicat nominal qui n’est pas repris devant le prédicat verbalparce que redondant.
Sàmba-a-y may-e jarbaat-amàjjuma j-ii
NP+ foc+inacc donner+verbalisant nièce+poss 3sg vendredicl+démonstr prox
C’est Sàmba qui donne la main de sa nièce ce vendredi
Ce n’est pas le cas pour le signifiant de focalisation du sujetqui, lui, est uniquement spécialisé dans cette fonction.
Etant donné que le procédé de focalisation présuppose desrelations entre classes syntaxiques, les données attestées àce niveau d’analyse relèvent incontestablement de lamorphosyntaxe. Cet argument milite en faveur de l’intégrationde la focalisation dans le système des modalités verbales. En
15
effet, elle a les mêmes compatibilités que celles-ci tout enfaisant par ailleurs l’objet d’un choix unique.
C’est uniquement la dépendance vis-à-vis des paradigmes deconjugaison tels qu’ils existent dans d’autres langues, enparticulier celles d’Europe, qui fait qu’on s’écarte trèssouvent de l’observation des faits et du fonctionnement réel dela langue. A l’origine de cette dépendance, la volontéd’identifier la “catégorie” (donc un postulat) par rapport àla commutation tout ayant à l’esprit que la catégorie relève dela syntagmatique.
VII-Traitement de la focalisation en wolof
L’analyse traditionnelle héritée de Kobès (1869) intègre les faits de focalisation dans le système de conjugaison.La pratique s’est perpétuée avec Sauvageot (1965), Church (1981) est repris avec quelques modifications par A FAL (1999) et les générativistes (J. LDiouf, 1982, Codu Njie Mbassy 1982, Omar Ka(1982) ne sont pas en reste. Même s’ils donnent une meilleure visibilité sémantique et pragmatique, de la focalisation, les tenants de l’énonciation et de la théorie du discours, optent pour une conjugaison focalisante intégrée au système verbal. D’ailleurs, Robert (1986, 1991 et 1993) se fonde sur les travaux de Sauvageot (1965) en prenant en charge l’aspect sémantique jusqu’ici marginalisé par les fonctionnaliste au profit de la de la syntaxe. J L Diouf (1985) s’écarte peu de la présentation la plus courante en identifiant la forme na (énonciatif ou terminatif ou parfait selon les auteurs), comme le vrai focalisateur verbal.
Dans le cadre de ce système, on identifie les signifiantsdes différentes focalisations, mais l’analyse bute sur lesindices de personnes (pronoms amalgamés occasionnellement oupermanemment, variantes de signifiant, le problème reste entieret risque de ressurgir. La notion d’IPAM (indice personneaspecto-modale) soutenue par Robert et empruntée aux languesTchadiques n’est, à l’état de nos connaissances, qu’une réponsepartielle à la question. Un problème similaire d’amalgame se
16
pose pour le français s’agissant notamment de au (à+le), aux(à+les), du (de les+) des (de+ les) où la morphologie empiètesur territoire de la syntaxe.
Si les signifiants sont plus souvent isolables etsécables qu’ils ne sont amalgamés, on peut statistiquementtrancher en faveur de la fréquence et de la généralité. C’estun principe bien établi depuis Aristote que la science sefait sur la généralité et non sur la spécificité. Un indice(une trace) n’est jamais identique à l’entité dont elle est laprojection.
En plus, dans les reprises anaphoriques ou cataphoriques,le pronom clitique n’est pas identique à son antécédent. Onpeut même constater que les clitiques sujets ne sont que desprédicatifs verbaux délexicalisés. On ne les rencontre doncqu’avec des verbes. Et d’ailleurs, si le présentatif estsouvent identifié comme une forme de focalisation situative,devrait-on toujours parler de focus du verbe ?
Conclusion Les analyses restent à être affinées parce qu’elles se
fondent le plus souvent sur des bases morphologiques audétriment de la syntaxe, mais surtout de la morphosyntaxe. Pourun meilleur éclairage, ces deux niveaux d’analyse ne doiventpas être séparés, même s’ils sont par ailleurs distincts. Cedont dispose la syntaxe c’est la morphologie qui l’exprime. Parconséquent, en wolof, la focalisation relèverait aussi duniveau morphosyntaxique et pas uniquement du niveaumorphologique ou syntaxique. Les différentes terminologiesadoptées par les auteurs ne sont pas de simples étiquetages.Elles dissimulent mal des carences explicatives, notammentsémantiques et pragmatiques au profit d’une définition quireste être à être faite. Nous devons le terme d’« emphatiqueà Church (1981) qui le précise dans le cadre du wolof et lesautres auteurs l’adoptent à la suite sans la remettre enquestion. Mais pourquoi pas le terme d’emphatisation, comme
17
topicalisation pour faire ressortir l’idée de manipulation etcelle de construction/déconstruction comme dirait Derida.
Les énoncés focalisés n’ont de valeur d’emphase qu’après avoirsubi l’opération qui l’implique. Ce que la syntaxe structure,la morphologie le configure et la sémantique l’interprète. Bienqu’ayant des caractéristiques syntaxiques importantes, lesphrases focalisées, en wolof, ont aussi des implicationspragmatiques qui leur sont spécifiques. On ne saurait lespasser sous silence.
Il est aussi quasiment impossible de rendre compte dufonctionnement du wolof et d’occulter en même temps le problèmedes indices de personnes. Surtout lorsqu’ils se combinent avecd’autres morphèmes verbaux celui de la focalisation. Lesparadigmes décrits comme fondamentaux de la conjugaison« emphatique », focalisante dans la plupart des travauxrécents, sont en réalité la réalisation des propositions àorganisation morphosyntaxique et communicative habituelle,c’est-à-dire renfermant un élément de focus. Le foyer del’attention est orienté soit vers le prédicat verbal lui-même,soit vers un de ses actants. C’est là une technique spécifiquede codage.
L’étroite connexion entre la morphosyntaxe, le discours et lasituation révèle que ces marques aménagées ne peuvent pas êtreanalysées dans le cadre de la conjugaison. Car cette dernièreest autonome par rapport au discours et à la situation. Onprivilégie certaines sphères d’emplois de la focalisation audétriment d’autres. De ce fait, ce que la description gagne enprécision, le système semble le perdre en présentation à causede son incohérence dans l’organisation générale. Car danscette approche restreinte, la morphologie est plusclassificatoire qu’explicative. Ce qui débouche sur unensemble hétéroclite. Mais à y voir de plus près, la commodités’estompe au profit d’une volonté de comprendre unfonctionnement et pas simplement une charpente achevée. Il
18
suffit juste de décrocher de ces schèmes explicatifs et de voirla langue synchroniquement de l’intérieur.
Y –t-il pour autant une volonté de faire passer la morphologieavant la syntaxe parce que plus accessible et plus visible ?Certainement ! Mais la difficulté de séparer la morphologie dela syntaxe fait que je sera choisi contre moi pour une raisonde fonction. L’enclitique des différents pronoms s’accompagnede différents processus morphologiques qui concernent lespoints d’incidence matérielle entre l’élément enclitique et lemorphème modalisateur.
Abréviations
Adv. :adverbe alt. : altérité cl. : classificateur cov. : co-verbe con.v. : connectif verbal déf : défini démonstr. : démonstratif déter. déterminant/tif éloi. : éloigné fonct :fonctionnel impért. : impératifindef. : indéfini inst : insistence inac. : inaccompli intérg. :interrogatif globt. : globalité locat. : locatifFoc. : focalisation nég. : négatif NP : nom propre pft : parfait poss. :possessif prdf. : prédicatifprox. : proximité prst. : présentatif sg. :singulier interr. :interrogatif.1, 2, 3 : personnes.
Bibliographie
CHURCH, Eric, (1981), Le système verbal du wolof, Doc. Ling. n°27, Publ. du Dépt. de Linguistique Générale et de LanguesNégro-africaines de la Faculté des Lettres et Sciences Humainesde l’Université de Dakar, 365 p.
CISSE, M., (2001), Dictionnaire Français-wolof, Langues&Mondes,L’Asiathèque première édition (1998), 351 p
(2005) « Revisiter « La grammaire de la langue wolof » de A Kobès (1869) ou étude critique d’un pan de l’histoire de la grammaire wolof. Sudlangues n°4 sitewww.sudlangues.sn
19
CISSÉ, Momar, (1987), Expression du temps et de l’aspect dansla communication linguistique (Analyse de quelques énoncés dufrançais (langue dite à “temps”) et du wolof (langue dite à“aspects”) dans le cadre de la théorie générale del’énonciation) ,Thèse pour le doctorat de 3éme cycle,Université de Nice, 250 p.
(2007), Déixis at anaphore en grammairewolof.Annalles de la Faculté des Lettres et Sciences Humainesde Dakar n°36. pp317-336
DIALO, Amadou, (1981), Structures verbales du wolofcontemporain, Dakar, C.L.A.D. , Les langues nationales auSénégal n° 80, 70 p.
-(1983), Eléments systématiques du wolofcontemporain, Dakar,CLAD, 85p.
DIOUF, Jean-Léopold, (1985), Introduction à une étude dusystème verbal wolof, Dakar, C.L.A.D. , Les langues nationalesau Sénégal W 26, 72 p.
(2001), Grammaire du Wolof contemporain,ILCAA, University of Foreign studies Tokyo, 200p.
FAL, A. (1999), Précis de grammaire fonctionnelle de la languewolof, Dakar, OSAD, 152p.
FALL, SANTOS R., DONEUX, J. .L. , (1989), Dictionnaire wolof-français, suivi d’un index français-wolof, Paris, Karthala, 342.p
KA, Omar, (1982), La syntaxe du wolof: essai d’analysedistributionnelle, Dakar, Département. de linguistique généraleet linguistique africaine, Thèse de 3 ème cycle, 250 p.
LOÏC-Michel, Perrin (2005), Des représentations du temps enwolof. Thèse de doctorat. Université Paris, 706p
NDIAYE CORREARD, G., (1989), Focalisation et système verbal enwolof, Annales de la Faculté des lettres et Sciences humaine,n°19, Dakar, pp.177-190, p.179.
20
(2003), Structure des proposition etsystème verbal en wolof, sudlangues n°3. site www. sudlangue.sn
NJIE, Codu Mbassy, (1982) , Description syntaxique du wolof deGambie, Grenoble, N.E.A. ,
Dakar-Abijian-Lomé, 288 p.
ROBERT, Stéphane,(1986), “Le wolof: un exemple d’expressionmorphologique et d’emphase”, in Bulletin de la Société deLinguistique de Paris, T. LXXXI, Paris, p. 319-341.
(1991), Approche énonciative du système verbal,le cas du wolof, Edition du C.N.R.S., Paris, 349 p.
(SAMB, Amar, (1983), Initiation à la grammaire wolof, Dakar,I.F.A.N. , 128 p.
SANTOS, R.,(1981), “Le verbe dans les langues africaines”, inAnnales de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, n°11,Dakar, Paris, PUF, p. 269-300.
SAUVAGEOT, Serge, (1965), Description synchronique d’undialecte wolof: le parler du Dyolof, Mémoire de l’InstitutFrançais d’Afrique Noire, n° 73, I.F.A.N. , Dakar, 274 p.
-(1981), “Le wolof”, in Les langues du mondeancien et moderne, vol - 1 : Langues de l’Afriquesubsaharienne, Ed. du C.N.R.S. , Paris, pp. 35 - 53 .
21