Multichannel Calibrator PASCAL ET, ET-P, ET/IS, ET-P/IS GB ... - WIKA
Samuel Bochart (1599-1667) et ses sources arabes en zoologie et en médecine
Transcript of Samuel Bochart (1599-1667) et ses sources arabes en zoologie et en médecine
Samuel Bochart (1599-1667)
et ses sources arabes en zoologie et en médecine
Pierre Ageron,
Ve congrès de la Société française d’histoire des sciences et des techniques, 28 avril 2014
1599 : naît à Rouen dans une famille protestante
étudie à Sedan et Saumur (grec, hébreu, théologie, ...)
1620-1622 : étudie à Leyde
apprend l’arabe avec Erpenius (Thomas van Erpe)étudie ce livre imprimé à Rome en 1592 →
1622-1623 : étudie à Oxford
déchiffre son premier manuscrit arabe : ;äؤOwا ïk Oã8f>w5ب ا>s de Nasr al-Dînawarî
1624-1667 : exerce la charge de pasteur à Caen seul voyage : séjour d’un an à Stockholm
1667 : meurt à Caen, laissant une fille unique
Samuel Bochart
bibl. Caen, RES B162 annoté par Bochart
1599 : naît à Rouen dans une famille protestante
étudie à Sedan et Saumur (grec, hébreu, théologie, ...)
1620-1622 : étudie à Leyde
apprend l’arabe avec Erpenius achète et annote le 5ق>W"ا ;ÉQ� 5ب>s (Rome, 1592) →
1622-1623 : étudie à Oxford
déchiffre son premier manuscrit arabe : ;äؤOwا ïk Oã8f>w5ب ا>s de Nasr al-Dînawarî
1624-1667 : exerce la charge de pasteur à Caen seul voyage : séjour d’un an à Stockholm
1667 : meurt à Caen, laissant une fille unique
Samuel Bochart
bibl. Caen, RES B162
1599 : naît à Rouen dans une famille protestante
étudie à Sedan et Saumur (grec, hébreu, théologie, ...)
1620-1622 : étudie à Leyde
apprend l’arabe avec Erpenius achète et annote le 5ق>W"ا ;ÉQ� 5ب>s (Rome, 1592) →
1622-1623 : étudie à Oxford
déchiffre son premier manuscrit arabe : ;äؤOwا ïk Oã8f>w5ب ا>s de Nasr al-Dînawarî
1624-1667 : exerce la charge de pasteur à Caen seul voyage : un an en Suède invité par la reine
1667 : meurt à Caen, laissant une fille unique
Samuel Bochart
bibl. Caen, RES B162
Le Hierozoicon : plan général
Geographia Sacra (Caen, 1646) Hierozoicon (Londres, 1663)
PARS POSTERIOR
I – De mundis avibusII – De immundis avibusIII – De serpentibusIV – De insectis animalibusV – De aquaticis animalibusVI – De dubiis vel fabulosis animalibusIndex septuplum
PARS PRIOR
Praefatio ad lectoremI – De animalibus in genereII – De domesticis quadrupedibusIII – De feris quadrupedibusIV – De quadrupedibus oviparis
Ibn al-Baytâr al-Mâlaqî(1195-1248)
اجلامع في األدوية املفردةprêté vers 1645 à Samuel Bochart par Claude Saumaise qui le tenait de N.-Cl. Fabri de Peiresc qui l’avait fait acheter au Caire en 1635 par le père Agathange de Vendôme
bibl. de Caen, ms. 90
lettre à Claude Saumaise, Caen, 19 mars 1646 :
« Je crains que vous ne soyez privé des deux manuscrits arabes que vous m’avez permis d’emporter momentanément pour des travaux. »
Muh. b. Mûsâ al-Damîrî (1341-1405)
حياة احليوان الكبرىcopié à Tripoli en 1459,
acquis par Gabriel Naudé pour le cardinal Mazarin en 1647, prêté à Samuel Bochart avant 1650
bibl. de Caen, ms. 188
lettre à I. Vossius, Caen, 13 mars 1651 :
« J’ai chez moi deux manuscrits arabes qui sont à lui [Saumaise], que j’utilise très fréquemment, et, puis-je ajouter, très fructueusement. Son éminence le Cardinal Mazarin m’a prêté un Damir sur les animaux, certes semblable en beaucoup de choses à son Damir, et cependant différent en beaucoup d’autres. »
Zakariyyâ al-Qazwînî (1202-1283)
عجائب ا0لوقات offert à Samuel Bochart
par la reine Christine de Suède en 1653,
après qu’il en ait copié une grande partie !
bibl. de Caen, ms. 80
Hierozoicon, préface (1663) :
« Parmi [les livres arabes que je possède] : […] Les Merveilles des créatures d’Alkazuini, écrit il y a presque cinq cents ans, que je dois à la libéralité de la sérénissime Christine. »
Un exemple du travail de Samuel Bochart : copie des sections sur les animaux de al-Qazwînî avec traduction latine
bibl. de Caen, ms. 199
Ikhwân al-Safâ’ (Xe siècle ap. J.-C.)الرسالة الثانية والعشرون
في أصنافاحليوانات
traduction hébraïque de Kalonymos (1316)
extraits copiés et traduits par Bochart à Stockholm en 1653
bibl. de Caen, ms. 199
Responsio ad Quæstionem viri doctissimi,
quid sit
Melancholia errabunda
Cutubuth Arabice dicta, ab animali quodam
in superficie aquarum stagnantium, perpetuo et indesinenter currante
BnF, ms. NAF 2488, fol. 198-218
Réponse à la question d’un homme très savant
demandant ce qu’est la
melancholia errabunda, dite en arabe
cutubuth, du nom d’un certain animal
qui s’agite continuellement et sans relâche à la surface des eaux stagnantes
BnF, ms. NAF 2488, fol. 198-218
Contenu de la Réponse sur le cutubuth (version III)
7. D’après la Bible, le roi Nabuchodonosor, se croyant changé en bœuf, brouta de l’herbe pendant sept ans et eut poils et griffes comme un aigle8. Exégèse de ce passage et censure d’écrits sur le supposé pléramorphisme de Nabuchodonosor 9. Concernant Nabuchodonosor, les historiens ont parlé d’aliénation et non de métamorphose, les pères de l’Église étaient du même avis et les rabbins juifs aussi
1. La nom de la maladie dite cutubuth en Europe résulte de la déformation du mot arabe al-qutrub2. Description de la maladie dite al-qutrub par Avicenne3. Description des maladies dites lycanthropie et cynanthropie par les médecins grecs
11. Origine du mot arabe al-qutrub selon les auteurs arabes : nom d’une araignée d’eau, d’un vampire...12. Proposition d’une autre étymologie : al-qutrub dérive du mot grec lycanthropia
10. Les démoniaques décrits par les Évangiles synoptiques présentent les symptômes de la lycanthropie
13. Hypothèses et discussion sur l’étymologie du mot français loup-garou (varou en Normandie)
4. Pourquoi la lycanthropie est aussi appelée lycaon ; transformation périodique des Neuriens en loups5. Transformation d’hommes en loups chez les Arcadiens6. Transformation d’hommes en loups en Livonie, Lithuanie, Irlande et Rhénanie Conclusion : ce sont pures vues de l’esprit
Ce que Bochart a appris dans l’édition arabe du Canon d’Avicenne
(Rome, 1593)
ïِk ٌyْZَk ٱOْaُpْwُبِ
« C’est une espèce de mélancolie, qui survient le plus souvent au mois de février, qui fait que l’individu fuit les vivants et aime fréquenter les morts et les cimetières, est mal intentionné envers qui le surprend à l’improviste, sort la nuit et se cache le jour, toujours à la recherche de la solitude et de l’éloignement des gens. De plus, il ne reste jamais dans un endroit plus d’une heure, mais ne cesse de marcher de-ci de-là, sans savoir où il se dirige, par défiance envers les gens […]
De plus, il est d’une extrême langueur, morosité, affliction et tristesse ; son teint est jaune, sa langue est sèche et il est assoiffé, […] ses yeux sont sans larmes […]
Ceci a été nommé qutrub, car celui qui en est atteint fuit de manière désordonnée […] et le qutrub est une bestiole qui se forme à la surface de l’eau, a des mouvements variés et désordonnés, et toutes les heures, plonge, disparaît, puis réapparaît. On a parlé d’une autre bestiole ne trouvant pas le repos en évoquant le vampire ; on a aussi parlé du loup pelé. »
Ce que Bochart a appris dans l’édition arabe du Canon d’Avicenne
(Rome, 1593)
ïِk ٌyْZَk ٱOْaُpْwُبِ
Grâce à la publication en 1549 des livres de médecine d’Aèce d’Amide, les médecins savent que Marcellus de Side a décrit au IIe s. après J.-C.
une maladie dite lycanthropie et sa variante la cynanthropie dont les symptômes sont très exactement les mêmes
que ceux du cutubuth, avec un de plus : le fait d’imiter en toutes choses les loups, ou les chiens.
Que voulait exactement savoir le savant qui interrogea Bochart ?
Grâce à la publication en 1549 des livres de médecine d’Aèce d’Amide, les médecins savent que Marcellus de Side a décrit au IIe s. après J.-C.
une maladie dite lycanthropie et sa variante la cynanthropie dont les symptômes sont très exactement les mêmes
que ceux du cutubuth, avec un de plus : le fait d’imiter en toutes choses les loups, ou les chiens.
Que voulait exactement savoir le savant qui interrogea Bochart ?
Grâce à la publication en 1549 des livres de médecine d’Aèce d’Amide, les médecins savent que Marcellus de Side a décrit au IIe s. après J.-C.
une maladie dite lycanthropie et sa variante la cynanthropie dont les symptômes sont très exactement les mêmes
que ceux du cutubuth, avec un de plus : le fait d’imiter en toutes choses les loups, ou les chiens.
Que voulait exactement savoir le savant qui interrogea Bochart ?
D’où un dilemme : cutubuth et lycanthropie sont-ils la même maladie ?
traduction:
« Pour dire maintenant la chose comme elle est, ces étymologies ne me plaisent pas, parce que alkotrob est une bestiole grégaire, appelée en latin tipula ou tipulla (araignée d’eau), alors que rien n’est plus caractéristique des lycanthropes ou cynanthropes que l’amour de la solitude. Ainsi ils passent leur temps dans les cimetières, et, comme l’a dit Avicenne, ils fuient les vivants et ne fréquentent que les morts. Mais kotrob se déduit de λυκανθρωπία (lycanthropie) par ἀφάιρεσιν (aphérèse), ou de κυνανθρωπία (cynanthropie) par συγκοπὴ (syncope). De ces deux étymologies, la première me semble à coup sûr plus vraisemblable, parce que le mot lycanthropie est d’usage plus fréquent. Les exemples de semblables aphérèses ne manquent pas. Ainsi les Grecs appellent le port λιμένα limena, mais les Arabes seulement 5Äã{ mina par aphérèse de la première syllabe. Le navire appelé liburna ou liburnica (liburne) est dit en chaldéen בורכי burni. Le B final dans kotrob pour le π grec dans lycanthrope n’arrêtera personne. En effet, les Arabes ne rendent pas le π grec autrement que par un B, parce qu’il leur manque la lettre P. C’est pourquoi Petrus (Pierre) est pour eux « .Oa7 Betruso et Paulus (Paul) Uwá7 Baulusoس
Que pense Bochart de l’étymologie de qutrub donnée par Avicenne ?
En 1659, un nouveau traducteur d’Avicenne a choisi – pour la première fois – de
traduire qutrub par lycanthropia
En 1659, un nouveau traducteur d’Avicenne a choisi – pour la première fois – de
traduire qutrub par lycanthropia
Il s’agit de Pierre Vattier, un autre arabisant normand. Aurait-il pris l’avis de son ami Samuel Bochart ?
En guise de conclusion :
« Rien ne me fut plus utile que ma connaissance de la langue arabe, quelque imparfaite soit elle. En effet, quoique je possède peu de livres arabes et que j’en ai lu moins encore, c’est de ce peu que de grandes lumières me sont apparues. »
Samuel Bochart, préface du Hierozoicon, 1663 (traduction)
















































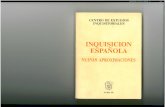

![[tapuscrit original] Femme et langue. Sexe et langage (1982)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6336af56e8daaa60da100428/tapuscrit-original-femme-et-langue-sexe-et-langage-1982.jpg)





