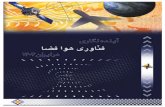Le xwedodah en Iran ancien.
Transcript of Le xwedodah en Iran ancien.
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
1
Xwēdōdah
Plan 1. Plusieurs couples :
Cosmogoniques Vue de l’embryologie Mythiques Cas des jumeaux
2. Valeur sociale Structure de parenté
3. Valeur religieuse
Introduction
De nombreuses mythologies présentent des incestes, souvent cosmogoniques ou anthropogoniques, pourtant, aucune des cultures porteuses de ces mythes ne les valorise, ou mieux encore, ne les autorise dans la société humaine. Alors, comment est-on passé en Iran d’une pratique des dieux à une pratique des hommes ? Quels éléments du mazdéisme et quelles structures de pensée permettent le mariage que l’on nomme xwēdōdah ?
Le mot xwēdōdah vient du composé avestique X aētu+vadaϑa- « qui contracte mariage dans la lignée », avec X aētu- dérivé du pronom réfléchi X a(ē)-, et de vadaiia- « conduire au mariage », en pehlevi xwēdōdah « mariage dans la lignée »1. On trouve un certain nombre d’attestation du mot en avestique qui concernent soit le jeune homme pieux, qui y est soumis, soit la daēnā, qui est à la fois la personnification de la religion et de la doctrine
1 AIW. 1860. Le mot avestique est tatpuru a « qui contracte le mariage dans la lignée », alors que le mot pehlevi est un bahuvrīhi « mariage dans la lignée ». Kellens. 1995, p.40 n.51.
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
2
mazdéenne , et en même temps l’âme féminine et pérégrinante du mazdéen2. L’homme mazdéen, le ritualiste, tout comme son âme sont donc soumis à ce rite : c’est donc un acte autant religieux que social.
1. Couples endogamiques Cosmogoniques
Tout commence dans le mazdéisme comme dans bien d’autres mythologies indo-européennes, c’est à dire par des incestes cosmogoniques. Le Dēnkard3, nous dit que Ohrmazd, le grand dieu du zoroastrisme, et sa fille Spandarmat, la terre, engendrèrent Gayōmard, dont le nom signifie « vie mortelle ». Prototype de l’humanité, lorsque il meurt, son sperme tombe au sol et féconde sa mère, pour engendrer Mašya et Mašyāne, jumeaux qui engendrent à leur tour l’humanité.
Schéma 1
C’est à partir de ces trois modèles de relations que sont définis les différents types de mariages consanguins. L’union entre une mère et son fils est la plus bénéfique4, nous dit la Rivayat pelhevie accompagnant le dadestan i denig, suit celle entre un père et sa fille5, et enfin entre frère et sœur6. On peut expliquer cette classification par la proximité qu’il existe entre les individus7 : en effet, plus ils sont proches, plus le mariage est profitable.
vision de l’embryologie
2 V 8.13 parle de l’urine purifiante de ceux qui ont contracté le xwēdōdah, Vr 3.3 Kh 4.8 etYt 17 du jeune homme, Y 12.9 de la daēnā. 3 Dk. III, 86, de Menasce. 1973, p. 86-87. 4 Macuch. 1991, 141-154 cité par de Jong. 1997, p 431 n.59 « as Macuch rightly stresses, the fact that in the case of the mother-son relation, the mother is referred to by the word burdār, “she who has given birth (to him)” instead of the common word mād, “mother”, leaves no room for speculations on the possibilities of the relation being between the son and his father’s wife (who is not his mother). » 5 AV Williams. 1990, T2, p12, 8d1 « this is also (is) revealed, that a man practises one xwēdōdah (with his) mother and one with is child, (his) daughter ; the one with (his) mother is superior to the other ; the spiritual authorities (say it is) because he who has come from her body is nearer (to her) ». 6 Huyse. 2004 donne de frère, av. brātā-, et sœur, av. xvaŋhar-, la définition suivante « consanguin masculins/féminins de la même génération appartenant au même clan ». Le point ambigu de cette définition est le système de clan dans le système de parenté zoroastrien, qui, mal étudié, peut facilement engendrer des interférences entre les termes techniques modernes et la réalité avestique. 7 De Jong. 1997, p.431.
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
3
Pour mieux comprendre cette proximité, il nous faut envisager les principes d’embryologie mazdéens. Si le mariage entre le fils et sa mère constitue le rapport entre plus proches parents, c’est que l’on considère que la mère est « conceptrice » autant que le père. Les deux parents entrent donc en jeu dans la conception, mais la mère, de surcroit porte l’enfant en elle sans en être séparé8. Ce fait n’est pas systématique, car, dans certaines sociétés, on considère que c’est le père qui donne matière à l’enfant, qui se développe dans une matrice sans jamais avoir de contact avec elle, car séparé par la poche placentaire.
Voici ce que nous dit le Bundahišn 16.1-6 :
« quand la semence de l’homme est plus puissante, il naît un fils ; quand la semence de la femme est plus puissante, il naît une fille ; quand les deux semences s’équivalent, il naît des jumeaux ou des triplés »9.
Ainsi, les semences vont chacune créer certains organes, pour la semence mâle le cerveau et la moelle, pour la féminine les côtes et les os ; mais c’est la plus puissante des deux, celle qui s’imposera, qui rendra l’enfant sexuellement identique à l’un de ses parents. Le cas des jumeaux se distingue par la perfection d’équilibre entre les deux semences, entre les deux legs. On notera cependant que seuls les naissances gémellaires de sexes opposés sont prises en compte. Nous y reviendrons.
Est donc sous-entendue par cette hiérarchie, dans les mariages consanguins, l’idée d’une identité de substance entre parents et enfants, et de là, entre frères et sœur. Le xwēdōdah est donc presque un mariage avec soi-même.
Mythiques
Le plus connu des incestes mythiques, donné par plusieurs textes pehlevis10, concerne l’inceste gémellaire de Yima et Yami. En voici un exemple :
« Et un jour, que Jim et le démon étaient ivres de vin, elle [Jimaγ] échangea sa position [contre celle de la sorcière] et endossa les vêtements de la sorcière ; et quand Jim s’approcha d’elle, il était ivre, et il coucha avec Jimaγ, sa sœur, sans le savoir. Alors, ils décidèrent que le χvēðvaγ-das était une bonne œuvre. Beaucoup de
8 Cf. Leach. 1980, p.77-107. 9 Trad. Herrenscmidt.1994, p 122. 10 Bnd.XXIII.1; West. 1880, p.87 et Bnd XXXI, 4. Jāmāsp Nāmag citée par Christensen. 1934. p.29.
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
4
démons furent complètement écrasés et moururent, et [les autres] s’enfuirent à l’instant et retombèrent en enfer. »11
Ou bien encore, dans le cadre des générations humaines :
« From Jam {Jamshed} and Jami, who was his sister, was born a pair of man and woman, and they became wife and husband together […] »12
Yima et Yami sont l’archétype du couple incestueux. Mais, s’ils en sont le modèle de référence, car cités en exemple pour cette pratique, ils ne font que reproduire l’anthropogonie. Dans le cadre de l’Iran mazdéen, où le mariage entre germains est encouragé, on perçoit à quel point le lien gémellaire renforce encore l’idée d’endogamie extrême.
Cas de gémellité
La gémellité pose donc un problème différent, ou du moins plus marqué, que la relation frère/sœur. Nous avons vu qu’en Iran, elle représente l’équilibre parfait entre l’essence du père et de la mère. Dans l’idée, ils participent de la même essence et sont semblables à leurs parents, dont ils reproduisent le couple. Ils condensent donc toutes les formes d’inceste en eux. Ainsi, le mariage entre jumeaux est il à mettre à part des trois autres cas d’unions au plus proche, comme le point d’acmé d’une telle pratique.
Ce n’est pas éloigné de ce qu’indiquent les textes indiens relatif au couple Yama/Yami, qui, quoique prohibant l’inceste, en montrent la tentation qu’en a la sœur :
«Vers moi Yamī l’amour pour Yama est venu,
m’étendre avec lui sur une couche commune.
Comme la femme à l’époux, je veux livrer mon corps.
Roulons-le de-ci de-là, comme (font) les roues du char ! » 13
Bien sur, Yama refuse, mettant en avant Son respect de l’ordre établi, « Haute est
l’institution de Varuṇa, de Mitra », de la vérité, « Ce que nous n’avons jamais fait, le ferons
nous maintenant ? / Disant le vrai à voix haute, murmurer le faux ? », et sa responsabilité vis-
à-vis des institutions humaines, « Il viendra sans doute des générations plus tard / où les
11 Rivāyat pehlevi citée par Christensen. 1934, pp.28-29. 12 GBnd 35. 4. 13 Renou. 1956, p.55-57.
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
5
consanguins feront l’acte interdit aux consanguins », font qu’il repousse sa sœur. Après tout,
il n’est pas dharmarāja pour rien !
Cependant, par ses propos, Yami sous-entend que leur gémellité, loin de rendre plus étroits leur lien de consanguinité qui leur interdit tout rapport sexuel, efface entre eux les limites14 : « Dès le sein maternel, le Créateur nous fit mari et femme »15. Issus de la même matrice où ils étaient couchés ensemble côte à côte, comme un couple d’époux « maître de maison »16, ils sont destinés à coucher ensemble une fois nés. Le système indien qui prohibe les mariage consanguins frères/sœur, indique cependant l’ambiguïté du lien gémellaire qui nécessite une redéfinition des règles.
Par les traitements différents du même motif d’inceste gémellaire, les mythologies indiennes et iraniennes mettent en exergue la délicate proximité essentielle comme sexuelle des jumeaux.
2. Valeur sociale
Qu’en est il dans la société ? Un certain nombre de textes pehlevis traitent des différents problèmes que l’on peut rencontrer au sein de familles où sont mêlés liens de filiations et d’unions17. Il est des plus intéressant de noter que les questions abordées concernent plus le mérite et le bénéfice de l’acte que les questions d’héritages. En effet, la descendance n’était pas nécessaire au bon accomplissement du xwēdōdah. Ainsi, s’il s’agissait uniquement de raisons sociales ou économiques pour justifier ces mariages, c'est-à-dire si le but recherché était avant tout la préservation des biens, la descendance serait fondamentale, ce qu’infirme la Rivāyat d’Ēmēt I Ašavahištān :
« Quand on fait le xvêlôdas avec les trois (mère, sœur, fille) selon toutes les lois qui sont, l'action méritoire du xvêtôdas est accomplie parfaitement, et en conséquence,
14 Sur jāmī « consanguin » et mithuná « partenaire », voir Renou.1958, p.46-50 et Malamoud. 2012, p.103 et ss.. 15 RV X.10, trad Renou. 1956, p.55-57. 16 Dampati voir Malamoud. 2002, p.51. 17 Voir B.Hjerrild. 2003. p 167-205 : les textes du Mātiyān ī hazār Dātistān 44.8-14, 104.9-14, 105.5-10 prennent essentiellement en compte les problèmes d’héritages. Ceux de la Rivāyat pehlevi d’Aturfarnbag et Farnbag Srōš 20.1-2, 143.1-4 et de la Rivāyat d’Ēmēt I Ašavahištān 22.1-4, 24.1-3, 27.1-4, 28.1-2, 29.1-8, 30.1-2 essaient d’éclaircir les circonstances qui pourrait diminuer le mérite du rituel ou des actes qui pourraient entraîner une faute.
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
6
quand il n'en résulte pas d'enfants, il n'y a pas de diminution du mérite du xvêtôdas. »18.
De plus, dans ce même texte, il nous est dit que le commanditaire d’un tel acte, qui, par exemple, finance le mariage, voit les mérites de l’acte rejaillir sur lui. Enfin, cette même Rivāyat pose la question suivante :
« Un homme ayant l’intention d’accomplir le xvêtôdas ; il prend dans son lit celle avec qui il peut le faire, mais s’il est incapable de s’en acquitter selon sa volonté, à cause de son grand âge ou d’une maladie, y a-t-il alors mérite du xvêtôdas ou non ? »19
La réponse est non, même si la volonté de l’accomplir est d’un grand secours pour l’âme dans l’au-delà. Cependant, la question montre bien l’importance de l’acte sexuel et non seulement du mariage, qui est un objet social, ou de la descendance, fortement compromise dans ce cas. C’est aussi ce que semblent indiquer les textes qui parlent de la valeur des années de mariage ou de la valeur de chaque acte sexuel20. Il semblerait donc qu’il ne s’agisse pas uniquement d’un fait à valeur politique ou économique21, mais bien d’un fait religieux, qui se base sur des données conceptuelles à élucider.
Certains auteurs parlent de « pratiques favorisant l’unité du groupe et sa pureté raciale », d’autres de « pureté du sang et d’eugénisme »22. Pourtant, ces propositions ne sont pas envisageables, car elles contredisent ouvertement les textes. En effet, dans, la Rivāyat de Emēt ī Ašahištān, on peut lire ch. 28 que le fait d’engendrer ou pas n’accroît ni ne décrois le mérite du xwēdōdah (à tel point que si l’homme est impuissant à procréer, cela ne change rien au mérite acquis !). Cette pratique ne peut donc pas avoir un but eugénique puisqu’il ne vise pas obligatoirement à procréer. Son bienfait ne se situe pas dans la génération à venir, c’est un bienfait en soi.
De plus, il faut noter qu’une interprétation par la pureté raciale implique endogamie mais pas forcement inceste, et qu’elle ne justifie pas la hiérarchie de ces mariages. enfin, citons Shaked pour un dernier argument contra : « But most important objection to this 18 de Menasce. 1962, p 86. 19 Ibid. 20 Williams, op. cit., 8f3 et 56. 16 parlent de la valeur de chaque acte sexuel alors que 8f1-3 parle du mérite des années de mariages. 21 Pour les attestations historiques des monarques qui épousent leurs sœurs ou leurs filles, voir M. Boyce. 1975, p.254 n24, Boyce. 1982, pp75-77 22 García. 2001, p181-198, le xwēdōdah serait « una práctica que favorece la unidad de grupo al mantener la pureza racial ». Ce n’est rien de plus que dit d’Arx. 2005 lorsqu’elle dit que « ce sont les motifs liés de pureté du sang et d’eugénisme qui font l’objet d’une propagande dans laquelle le xwēdōdah a la première place ».
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
7
explanation [a national as well as a religious means of preservation] is the simple fact that Zoroastrianism, unlike Judaism, was not a religion on the defensive. It was the state religion, commanding the large population of a vast empire in the early Sasanian period, and whatever it may have lacked in internal cohesion it certainly did not lack in numbers »23.
Il y a tout un jeu subtil dans ces identités et communauté sexuelles, car il faut chercher l’individu le plus proche, le plus identique, sachant qu’une parfaite identité sexuelle n’est pas permise. Il ne s’agit pas de refuser le mariage avec l’étranger, ni de s’en tenir à une forme d’endogamie large (entre clans par exemple), mais bien de se marier avec soi-même, ou du moins, ce qui en est la forme la plus immédiate, se marier avec ses proches parents. Mettre en avant des raisons politiques, cohésion du groupe, mise en marge des systèmes d’échanges, équivaudrait à ne pas prendre toute la mesure religieuse et rituelle d’un tel mariage.
Système de parenté
Lorsqu’à certaines époques, à partir de la conquête musulmane, il devint délicat de contracter ce genre de mariage, ceux entre cousins se sont développés, en essayant d’en conserver la symbolique. Ainsi, on trouve dans les notes du Shāyest nē-shāyest24 un système de préférences des mariages entre cousins. Tout y est noté en fonction des liens entre germains ; ainsi, le meilleur mariage se fait entre la fille de la sœur et le fils du frère, le second se fait avec l’enfant d’un germain cadet, c’est à dire pour un Ego masculin avec la fille du frère du père ou de la sœur de la mère, enfin, le dernier type se fait avec les cousins croisés.
Schéma 2 et 3
Le meilleur mariage est donc alterné : la fille suit une voie matrilinéaire et le fils patrilinéaire. Le second suit la branche cadette des cousins parallèles, dans le troisième, les cousins croisés. Si, comme nous l’avons vu grâce à l’entr’aperçu d’embryologie, il y a une forte identité de l’enfant et du parent de même sexe, alors, grâce aux jeux d’assimilation, le premier cas représente l’inceste fraternel, le second les incestes parents/enfants, et le troisième une forme d’avunculat. L’inceste parents/enfants est ici mis au second plan à cause du nombre d’assimilations nécessaires : les deux sœurs sont assimilées et la fille s’assimile à la mère.
23 Shaked. 1994, p.121: 24 West. 1880, p.389, et Manuscrit M5, fols.54-55.
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
8
Ce système envisagé, à une époque tardive, pour les mariages consanguins entre cousins tentait de concilier deux modes de pensées différents, et le clergé, devant se résoudre aux seuls mariages entre cousins, dû trouver un moyen de reproduire les trois types de xwēdōdah. Ces considérations montrent les questions qui devaient surgir de la confrontation avec le système musulman, et laissent deviner une profonde incapacité à harmoniser de manière cohérente des usages aussi dissemblables.
3. Valeur religieuse
Un tel mariage a de grandes vertus religieuses : il garantit le paradis à ceux qui le pratiquent, efface les péchés, et tue les démons pour renforcer le monde du Bien. Briser une promesse de xwēdōdah, en contractant un autre type de mariage par exemple, est un péché passible de mort, qui maudit l’âme dans l’au-delà.
En effet,
« Tous les hommes qui ont été et seront proviennent de la semence première d’un xwêtôdas : c’est là la cause de la production qui a été faite par Ohrmazd, le projet visant à l’accroissement de l’humanité de toutes les parties du monde. Je dis que les démons sont les ennemis des hommes et que leurs désirs de néant est d’une particulière énergie quant on opère le xwêtôdas, car alors le souvenir leur revient du projet de l’opération première de laquelle proviennent toutes les légions d’hommes dont ils sont les adversaires : ils sont alors pris de grave crainte, de maux et de douleurs, leur puissance diminue et ils ne pensent plus guère à combattre et détruire les hommes. »25
A partir de l’importance qui est donnée à l’acte sexuel dans ce type de mariage, certains auteurs postulent une forme de hiérogamie, liés aux principes de fertilité et de régénération26. Il s'agit d'un rituel, mais qui aurait subit tout un processus d'inversion des caractéristiques principales liées aux hiérogamies : plutôt que créateur du bien, l'acte serait destructeur du mal, au lieu de générer la vie, il engendre la mort de la mauvaise création.
25 Dk 3.80, trad. De Menasce. 1973, p.86. 26 Hjerrild, op. cit. p 201:« the power issuing from it is remarkably like that of the hierogamos known from many other cultures, having the power to spread fertility, make crops grow, and incite humans as well as cattle to procreate. Here in the middle Persian version the power seems to be reversed, so that instead of creating it kills, but the principle is the same: a magic power that kills evil, parallel to the magic, creative power of hierogamos, because good will grow where evil disappears. »
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
9
Parallèlement, il y aurait des actes sexuels bénéfiques, faisant partie de la bonne création, et d'autre, tout aussi créateurs, mais maléfiques, comme dans le Menokh i xrat ch827:
« Ahriman l’ennemi produisit les démons, les esprits menteurs et puis les sorciers en exerçant l’acte homosexuel (kunmarz) sur lui-même. »
Schéma 4
Si les différentes manières de se reproduire cherchent l’être le plus proche possible, on notera que les actes maléfiques sont l’homosexualité et la sodomie28. Les deux types de sexualité sont constamment considérés comme les actes au sommet des échelles de valeurs, et forment une dialectique de l’opposition des forces. Il est à noter que si le couple gémellaire peut accomplir une forme presque parfaite de xwēdōdah, un couple gémellaire de même sexe en serait le parfait antagoniste.
Bien sur, le xwēdōdah réitère les procédés qui ont donnés naissance à la bonne création, pourtant, son pouvoir destructif ne lui vient pas de la réactualisation de l’inceste primordial, mais plutôt d’une préfiguration eschatologique.
A la mort de l’individu, l’uruuan, âme masculine qui représente la conscience, et la daēnā, son âme féminine pérégrinante, se retrouvent au paradis. Les deux sont des jeunes gens en âge de procréer qui lors de leur rencontre se disent des mots tendres, où le mot aimer, √kan, est employé à de nombreuses reprises, et laissent sous-entendre une possibilité matrimoniale29.
Traduction H2
En effet, daēnā, qui est qualifiée de XaETUUada{=M celle qui « contracte le mariage dans la lignée »30, passe de l’appellation kainīn- « jeune fille célibataire » à carāitī- « femme enceinte ou mariée » lors de sa rencontre avec l’uruuan. Ce couple, formé des deux âmes pieuses et bonnes, que le rituel a fortifié, est extrêmement homogène, et en quelques sorte, condense les vertus.
On peut postuler que de tels rite sont le moyen efficace de lutter contre le monde du mélange créé lors de l’Assaut de la création par Ahriman et ses démons, assaut que les
27 Nyberg. 1929, p. 199-310. 28 V 8.26-32. 29 HN 2. 30 Kellens, ibid. p.41.
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
10
théologiens sassanides appellent ēbgat31, et qui nécessite de la part des forces bénéfiques la création du temps qui s’écoule, afin de circonscrire le monde où les forces négatives se développent, et de permettre aux forces du bien, à la fin du temps imparti, de se purifier de cette promiscuité.
Celui qui pratique le xwēdōdah, en se rapprochant de la création ahurique, en effectuant les bons rituels, « condense » le bien et les bénéfices de sa pratique religieuse. En mariant à sa mort ses deux âmes, il les purifie encore de tout élément étranger et leur permet de retrouver un état de pureté antérieur au mélange du monde. Le xwēdōdah préfigure et anticipe de manière individuelle la fin des temps où les forces du mal seront balayées, où le monde retrouvera son intégrité, où le temps redeviendra fixe et immuable.
Conclusion
Les sociologues modernes, et Lévi-Strauss en tête, ont fait du tabou de l’inceste une des règles qui fondent la vie sociale : « le lien d’alliance avec une famille différente assure la prise du social sur le biologique, du culturel sur le naturel »32, une stratégie sociologique pour obtenir des alliances entre groupes 33. Pourtant, si certaines sociétés pratiquent ce genre de mariage, c’est qu’elles privilégient, dans leurs systèmes de représentations, une valorisation de l’identique, car, pour citer Françoise Héritier, « la prohibition de l’inceste n’est rien d’autre qu’une séparation du même, de l’identique, dont le cumul, au contraire, est redouté comme néfaste. Réciproquement, la recherche de l’inceste ne serait possible que dans une culture où le cumul d’identiques est recherché comme quelque chose de faste »34. L’identité de substance, la confusion des êtres assimilés les uns aux autres, est fondamentale dans les unions consanguines iraniennes : il est préférable, dans ce système de valeurs, d’associer les identiques, de cumuler les semblables35. Enfin, Malinowski dit que « l’inceste
31 Yt 13.53-58. 32 Lévi-Strauss. 2002, p. 549. D'autres anthropologues réfutent cette prétention à l'universalité de ce tabou majeur et Malinowski, avec ses Argonautes du Pacifique s'est rendu célèbre en soutenant qu'il n'y a pas de «complexe d'Œdipe» auprès de la population de l'Océan Pacifique et en conséquence pas d'idée d'inceste générée par ce discours social 33 « l’humanité a compris très tôt que, pour se libérer d’une lutte sauvage pour l’existence, elle était acculée à un choix très simple : soit se marier en dehors, soit être exterminée aussi par le dehors »Lévi-Strauss. 2002, p. 120. 34 Héritier, Cyrulnik & Nouari. 2000, p. 10-11. 35 Nous ne pouvons adhérer à l’hypothèse de d’Arx à propos de l’homosexualité, d’Arx. 2005, p. 9, « Cette dernière [l’homosexualité] est sans doute condamnée à cause de sa stérilité mais également parce qu’elle représente un cumul d’identique qui ne peut que déstabiliser l’univers. ». En effet, le mariage entre proches parents est le meilleur exemple de ce cumul d’identique, il faut donc chercher la raison de la prohibition ailleurs. Ce qui vaut en général en sociologie ne fonctionne pas aussi simplement ici.
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
11
équivaudrait à la confusion des âges, au mélange des générations […] »36, en somme à une abolition du temps.
Le mariage endogamique est alors la quintessence des mariages humains pour chacun de ces points. L’acte, en même temps qu’il préfigure la fin de chaque être, annihile la distinction entre mortels et immortels qui partagent les mêmes pratiques, permet aux hommes de participer à la lutte contre les forces ennemies et de préparer l’abolition du temps fini dans lequel se meut la création.
Le xwēdōdah représente la croyance d’une société en des rituels efficaces, imitant, ou plutôt réactualisant dans le temps présent, les actes qui créèrent le monde, et ceux qui finissent la vie et le temps. Cosmogonie et eschatologie sont alors réunies dans ce rite, dans cet instant.
36 Malinowski. 1932, p. 125.
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
12
Bibliographie
AIW. Bartholomae. Altiranisches Wörtenbuch. Strassburg : Verlag von Karl Trübner. 1904. 2000col. Boyce. 1975. A History of Zoroastrianism. vol. 1. The Early Period. Leiden-Köln. Brill. 1975. 347p. et Boyce. 1982. vol 2. Under the Achaemenians. Leiden. Brill. 1982. 296p. Christensen. 1934. Les types du premier homme et du premier roi dans l’histoire légendaire des iraniens. Archives d’études orientales. vol.14. 2, n°27. Upsalla. 1934. 196p. d’Arx. 2005. « Mystère du choix de la deuxième vertu. courte réflexion sur l’inceste à l’iranienne ». in Barbares et civilisés dans l’antiquité. Kubaba. l’Harmattan. 2005. p. 248-265. De Jong. 1997. Traditions of the magi, Zoroastrianism in Greek and Latin literature. Brill. 1997. 496p. de Menasce. 1982. « La Rivāyat d’Ēmēt I Ašavahištān ». in RHR. 81. 1962. p. 69-88. de Menasce. 1973. Le troisième livre du Dēnkart. Paris : Klincksiek. 1973. 465p. García. 2001. « Xwēdōdah : el patrimonio consanguíneo en la Persia sasánida. Una comparación entre fuentes pahlavíes y greco-latinas » in Iberia Revista de la Antigüedad. 4. 2001. p. 181-197. Héritier, Cyrulnik & Nouari. 2000. De l’inceste. Paris : Odile Jacob. 2000. 216p. Herrenscmidt. 1994. « Le xwêtôdas ou mariage « incestueux » en Iran ancien » in Epouser au plus proche. Inceste. prohibition et stratégies matrimoniales autour de la méditerranée. Paris : éditions de l’EHESS. 1994. p. 113-125. Hjerrild. 2003. Studies in zoroastrian family law. Copenhagen . Carsten Niebuhr Institute of Ancient Near East Studies. University of Copenhagen . Museum Tusculanum Press. 2003. 224p. Huyse. 2004. La famille et les noms de parenté en Iran ancien. conférence du 24 mai 2004. Monde iranien Cnrs. Ivry. Kellens. 1995. « L’âme entre le cadavre et la paradis ». JA 283. 1995. p. 19-56. Leach. 1980. « Les vierges-mères ». in Unité de l’homme et autres essais. Paris. Gallimard. 1980. p. 77-107. Lévi-Strauss. 2002. Les structures élémentaires de la parente. Berlin; New-York : Mouton de Gruyter. 2002. 591p. Macuch. 1991. « Inzest im vorislamischen Iran» in Archäologische Mitteilungen aus Iran. 24. 1991. p. 141-154. Malamoud. 2002. Le jumeau solaire. Paris : Seuil. 2002. 193p. Malinowski. 1932. La sexualité et sa répression dans les sociétés primitives. Paris : Payot. 1932. 215p.
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
13
Nyberg. 1929. «Questions de cosmogonie et de cosmologie mazdéennes ». in JA. 214. 1929. p. 193-310 ; 219. 1931. p. 1-134 et 193-244. Renou.1958. Etude sur le vocabulaire du Rg-Veda. Pondichéry : Institut français d’Indologie. 1958. 69p. Shaked, Dualism in transformation, varieties of religion in sasanian Iran, school of oriental and african studies, 1994 West. 1880. Pahlavi texts part 1. The Sacred books of the East. Oxford . Clarendon press. 1880. 438p. Williams. 1990. The Pahlavi Rivāyat Accompanying the Dādestān ī Dēnīg. Translation, commentary and Pahlavi text. vol2. Copenhagen: The Royal Danish Academy of Science and Letters. 1990. 381p.
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
14
Schéma 1- Incestes cosmogoniques
Ahura Mazdā (Ohrmazd)
Spenta Ārmaiti (Spandarmat)
Gaiia Marǝtan (Gayōmard)
Mašya Mašyāne
Humanité
Schéma 2- Mariages préférentiels entre cousins
premier cas
deuxième cas
troisième cas
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
15
Schéma 3- Jeux d’identité sexuelle dans les mariages entre cousins
Identité sexuelle Ego/branche considérée
Identité sexuelle des parents des contractants
Ego participe de l’essence du contractant
1 cas Oui Non +++ 2 cas Oui Oui ++ 3 cas Non Non +
Schéma 4- Types de sexualité
HN 2
(Trad. Kellens.1995 modifiée)
9- aŋ hā dim vātaiiā fr r nta saδaiiaeiti yā hauua daēna kainīnō k hrpa srīraiiā xšōiϑniiā auruš a.bāzuuō amaiiā huraoδaiiā huzarštaiiā b r zaitiiā r duuafšniiā sraotanuuō āzātaiiā raēuuasciϑraiiā paṇcadasaiiā raoδaēšuua k hrpa auuauuatō sraiiā yaϑa dām n sraēštāiš
9- (...) sa propre daēnā lui apparait sous la forme d’une belle jeune fille au teint claire, aux bras roses, forte, bien faite, gaie, grande, aux seins fermes, au corps mince, de bonne et riche famille, ayant apparemment l’âge de quinze ans, aussi belle que les plus belles créatures divines.
sexualité bénéfique
incestes primordiaux
création du monde et des
hommes
sexualité bénéfique
incestes humains
destructeur du mal
sexualité maléfique
sodomie et parthénogenèse
création du mal et des
démons
sexualité maléfique homosexualité
transforma-tion de
l'homme en démon
A. Tzatourian - le xwēdōdah en Iran ancien Colloque "Sexualité et procréation : les Dieux, les Héros , les Hommes"
Louvain-la-Neuve. 12-14septembre 2013
16
10- āat hīm aoxta p r sō yō narš ašaonō uruua cišca carāitiš ahi y m it yauua carāitin m k hrpa sraēšt m dādar sa 11- āat he paiti.aoxta yā hauua daena az m bā te am i yim humanō huuacō huš iiaoϑana hudaena yā hauua daena xvaēpaiϑe tanuuō cišca ϑ m cakana auua masanaca vaŋhanaca sraiianaca hubaoiδitaca v r ϑra staca paiti.duuaēšaiiaṇtaca yaϑa yat me saδaiiehi 12- tum m m cakana yum humanō huuaca huš iiaoϑana hudaena auua masanaca vaŋhanaca sraiianaca yaϑa yat te saδaiiemi
10- L’uruuan de l’homme juste lui dit « jeune femme enceinte, qui est la plus belle que j’aie jamais vue, qui es-tu ? » 11- Sa propre daēnā lui répondit « Jeune homme de bonne pensée, de bonne parole, de bon geste, de bonne daēnā, je suis la daēnā de ton propre corps. Chacun t’a aimé pour la grandeur, la bonté, la beauté, le parfum, la force de victoire et de haine rendue avec lesquels tu m’apparais. 12- Et toi, à présent, jeune homme de bonne pensée de bonne parole, de bon geste, de bonne daēnā, tu m’aimes pour la grandeur la bonté et la beauté avec lesquelles je t’apparais. »